
ROYAUME D'AVA.—Grande pagode de Rangoun.—Dessin de Français d'après une photographie.
Title: Le Tour du Monde; Ava
Author: Various
Editor: Édouard Charton
Release date: May 7, 2008 [eBook #25370]
Language: French
Credits: Produced by Carlo Traverso, Christine P. Travers and the
Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net
(This file was produced from images generously made
available by the Bibliothèque nationale de France
(BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)
Note au lecteur de ce fichier digital:
Seules les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées.
Ce fichier est un extrait du recueil du journal "Le Tour du monde: Journal des voyages et des voyageurs" (2ème semestre 1860).
Les articles ont été regroupés dans des fichiers correspondant aux différentes zones géographiques, ce fichier contient les articles sur Ava.
Chaque fichier contient l'index complet du recueil dont ces articles sont originaires.
IMPRIMERIE GÉNÉRALE DE CH. LAHURE
Rue de Fleurus, 9, à Paris
PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION
DE M. ÉDOUARD CHARTON
ET ILLUSTRÉ PAR NOS PLUS CÉLÈBRES ARTISTES
1860
DEUXIÈME SEMESTRE
LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET Cie
PARIS, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, No 77
LONDRES, KING WILLIAM STREET, STRAND
LEIPZIG, 15, POST-STRASSE
1860
Un mois en Sicile (1843.—Inédit.), par M. Félix Bourquelot.
Arrivée en Sicile. — Palerme et ses habitants. — Les monuments de Palerme. — La cathédrale de Monreale. — De Palerme à Trapani. — Partenico. — Alcamo. — Calatafimi. — Ruines de Ségeste. — Trapani. — La sépulture du couvent des capucins. — Le mont Éryx. — De Trapani à Girgenti. — La Lettica. — Castelvetrano. — Ruines de Sélinonte. — Sciacca. — Girgenti (Agrigente). — De Girgenti à Castrogiovanni. — Caltanizzetta. — Castrogiovanni. — Le lac Pergusa et l'enlèvement de Proserpine. — De Castrogiovanni à Syracuse. — Calatagirone. — Vezzini. — Syracuse. — De Syracuse à Catane. — Lentini. — Catane. — Ascension de l'Etna. — Taormine. — Messine. — Retour à Naples.
Voyage en Perse, fragments par M. le comte A. de Gobineau (1855-1858), dessins inédits de M. Jules Laurens.
Arrivée à Ispahan. — Le gouverneur. — Aspect de la ville. — Le Tchéhar-Bâgh. — Le collége de la Mère du roi. — La mosquée du roi. — Les quarante colonnes. — Présentations. — Le pont du Zend-è-Roub. — Un dîner à Ispahan. — La danse et la comédie. — Les habitants d'Ispahan. — D'Ispahan à Kaschan. — Kaschan. — Ses fabriques. — Son imprimerie lithographique. — Ses scorpions. — Une légende. — Les bazars. — Le collége. — De Kaschan à la plaine de Téhéran. — Koum. — Feux d'artifice. — Le pont du Barbier. — Le désert de Khavèr. — Houzé-Sultan. — La plaine de Téhéran. — Téhéran. — Notre entrée dans la ville. — Notre habitation.
Une audience du roi de Perse. — Nouvelles constructions à Téhéran. — Température. — Longévité. — Les nomades. — Deux pèlerins. — Le culte du feu. — La police. — Les ponts. — Le laisser aller administratif. — Les amusements d'un bazar persan. — Les fiançailles. — Le divorce. — La journée d'une Persane. — La journée d'un Persan. — Les visites. — Formules de politesses. — La peinture et la calligraphie persanes. — Les chansons royales. — Les conteurs d'histoires. — Les spectacles: drames historiques. — Épilogue. — Le Démavend. — L'enfant qui cherche un trésor.
Voyages aux Indes Occidentales, par M. Anthony Trollope (1858-1859); dessins inédits de M. A. de Bérard.
L'île Saint-Thomas. — La Jamaïque: Kingston; Spanish-Town; les réserves; la végétation. — Les planteurs et les nègres. — Plaintes d'une Ariane noire. — La toilette des négresses. — Avenir des mulâtres. — Les petites Antilles. — La Martinique. — La Guadeloupe. — Grenada. — La Guyane anglaise. — Une sucrerie. — Barbados. — La Trinidad. — La Nouvelle-Grenade. — Sainte-Marthe. — Carthagène. — Le chemin de fer de Panama. — Costa Rica: San José; le Mont-Blanco. — Le Serapiqui. — Greytown.
Voyage dans les États scandinaves, par M. Paul Riant. (Le Télémark et l'évêché de Bergen.) (1858.—Inédit.)
Le Télémark. — Christiania. — Départ pour le Télémark. — Mode de voyager. — Paysage. — La vallée et la ville de Drammen. — De Drammen à Kongsberg. — Le cheval norvégien. — Kongsberg et ses gisements métallifères. — Les montagnes du Télémark. — Leurs habitants. — Hospitalité des gaards et des sæters. — Une sorcière. — Les lacs Tinn et Mjös. — Le Westfjord. — La chute du Rjukan. — Légende de la belle Marie. — Dal. — Le livre des étrangers. — L'église d'Hitterdal. — L'ivresse en Norvége. — Le châtelain aubergiste. — Les lacs Sillegjord et Bandak. — Le ravin des Corbeaux.
—Le Saint-Olaf et ses pareils. — Navigation intérieure. — Retour à Christiania par Skien.
L'évêché de Bergen. — La presqu'île de Bergen. — Lærdal. — Le Sognefjord. — Vosse-Vangen. — Le Vöringfoss. — Le Hardangerfjord. — De Vikoër à Sammanger et à Bergen.
Voyage de M. Guillaume Lejean dans l'Afrique orientale (1860.—Texte et dessins inédits.)—Lettre au Directeur du Tour du monde (Khartoum, 10 mai 1860).
D'Alexandrie à Souakin. — L'Égypte. — Le désert. — Le simoun. — Suez. — Un danger. — Le mirage. — Tor. — Qosséir. — Djambo. — Djeddah.
Voyage au mont Athos, par M. A. Proust (1858.—Inédit.)
Salonique. — Juifs, Grecs et Bulgares. — Les mosquées. — L'Albanais Rabottas. — Préparatifs de départ. — Vasilika. — Galatz. — Nedgesalar. — L'Athos. — Saint-Nicolas. — Le P. Gédéon. — Le couvent russe. — La messe chez les Grecs. — Kariès et la république de l'Athos. — Le voïvode turc. — Le peintre Anthimès et le pappas Manuel. — M. de Sévastiannoff.
Ermites indépendants. — Le monastère de Koutloumousis. — Les bibliothèques. — La peinture. — Manuel Panselinos et les peintres modernes. — Le monastère d'Iveron. — Les carêmes. — Peintres et peintures. — Stavronikitas. — Miracles. — Un Vroukolakas. — Les bibliothèques. — Les mulets. — Philotheos. — Les moines et la guerre de l'Indépendance. — Karacallos. — L'union des deux Églises. — Les pénitences et les fautes.
La légende d'Arcadius. — Le pappas de Smyrne. — Esphigmenou. — Théodose le Jeune. — L'ex-patriarche Anthymos et l'Église grecque. — L'isthme de l'Athos et Xerxès. — Les monastères bulgares: Kiliandari et Zographos. — La légende du peintre. — Beauté du paysage. — Castamoniti. — Une femme au mont Athos. — Dokiarios. — La secte des Palamites. — Saint-Xénophon. — La pêche aux éponges. — Retour à Kariès. — Xiropotamos, le couvent du Fleuve Sec. — Départ de Daphné. — Marino le chanteur.
Voyage d'un naturaliste (Charles Darwin).—L'archipel Galapagos et les attoles ou îles de coraux.—(1838).
L'Archipel Galapagos. — Groupe volcanique. — Innombrables cratères. — Aspect bizarre de la végétation. — L'île Chatam. — Colonie de l'île Charles. — L'île James. — Lac salé dans un cratère. — Histoire naturelle de ce groupe d'îles. — Mammifères; souris indigène. — Ornithologie; familiarité des oiseaux; terreur de l'homme; instinct acquis. — Reptiles; tortues de terre; leurs habitudes.
Encore les tortues de terre; lézard aquatique se nourrissant de plantes marines; lézard terrestre herbivore, se creusant un terrier. — Importance des reptiles dans cet archipel où ils remplacent les mammifères. — Différences entre les espèces qui habitent les diverses îles. — Aspect général américain.
Les attoles ou îles de coraux. — Île Keeling. — Aspect merveilleux. — Flore exiguë. — Voyage des graines. — Oiseaux. — Insectes. — Sources à flux et reflux. — Chasse aux tortues. — Champs de coraux morts. — Pierres transportées par les racines des arbres. — Grand crabe. — Corail piquant. — Poissons se nourrissant de coraux. — Formation des attoles. — Profondeur à laquelle le corail peut vivre. — Vastes espaces parsemés d'îles de corail. — Abaissement de leurs fondations. — Barrières. — Franges de récifs. — Changement des franges en barrières et des barrières en attoles.
Biographie.—Brun-Rollet.
Voyage au pays des Yakoutes (Russie asiatique), par Ouvarovski (1830-1839).
Djigansk. — Mes premiers souvenirs. — Brigandages. — Le paysage de Djigansk. — Les habitants. — La pêche. — Si les poissons morts sont bons à manger. — La sorcière Agrippine. — Mon premier voyage. — Killæm et ses environs. — Malheurs. — Les Yakoutes. — La chasse et la pêche. — Yakoutsk. — Mon premier emploi. — J'avance. — Dernières recommandations de ma mère. — Irkoutsk. — Voyage. — Oudskoï. — Mes bagages. — Campement. — Le froid. — La rivière Outchour. — L'Aldan. — Voyage dans la neige et dans la glace. — L'Ægnæ. — Un Tongouse qui pleure son chien. — Obstacles et fatigues. — Les guides. — Ascension du Diougdjour. — Stratagème pour prendre un oiseau. — La ville d'Oudskoï. — La pêche à l'embouchure du fleuve Ut. — Navigation pénible. — Boroukan. — Une halte dans la neige. — Les rennes. — Le mont Byraya. — Retour à Oudskoï et à Yakoutsk.
Viliouisk. — Sel tricolore. — Bois pétrifié. — Le Sountar. — Nouveau voyage. — Description du pays des Yakoutes. — Climat. — Population. — Caractères. — Aptitudes. — Les femmes yakoutes.
De Sydney à Adélaïde (Australie du Sud), notes extraites d'une correspondance particulière (1860).
Les Alpes australiennes. — Le bassin du Murray. — Ce qui reste des anciens maîtres du sol. — Navigation sur le Murray. — Frontières de l'Australie du Sud. — Le lac Alexandrina. — Le Kanguroo rouge. — La colonie de l'Australie du Sud. — Adélaïde. — Culture et mines.
Voyages et découvertes au centre de l'Afrique, journal du docteur Barth (1849-1855).
Henry Barth. — But de l'expédition de Richardson. — Départ. — Le Fezzan. — Mourzouk. — Le désert. — Le palais des démons. — Barth s'égare; torture et agonie. — Oasis. — Les Touaregs. — Dunes. — Afalesselez. — Bubales et moufflons. — Ouragan. — Frontières de l'Asben. — Extorsions. — Déluge à une latitude où il ne doit pas pleuvoir. — La Suisse du désert. — Sombre vallée de Taghist. — Riante vallée d'Auderas. — Agadez. — Sa décadence. — Entrevue de Barth et du sultan. — Pouvoir despotique. — Coup d'œil sur les mœurs. — Habitat de la girafe. — Le Soudan; le Damergou. — Architecture. — Katchéna; Barth est prisonnier. — Pénurie d'argent. — Kano. — Son aspect, son industrie, sa population. — De Kano à Kouka. — Mort de Richardson. — Arrivée à Kouka. — Difficultés croissantes. — L'énergie du voyageur en triomphe. — Ses visiteurs. — Un vieux courtisan. — Le vizir et ses quatre cents femmes. — Description de la ville, son marché, ses habitants. — Le Dendal. — Excursion. — Angornou. — Le lac Tchad.
Départ. — Aspect désolé du pays. — Les Ghouas. — Mabani. — Le mont Délabéda. — Forgeron en plein vent. — Dévastation. — Orage. — Baobab. — Le Mendif. — Les Marghis. — L'Adamaoua. — Mboutoudi. — Proposition de mariage. — Installation de vive force chez le fils du gouverneur de Soulleri. — Le Bénoué. — Yola. — Mauvais accueil. — Renvoi subit. — Les Ouélad-Sliman. — Situation politique du Bornou. — La ville de Yo. — Ngégimi ou Ingégimi. — Chute dans un bourbier. — Territoire ennemi. — Razzia. — Nouvelle expédition. — Troisième départ de Kouka. — Le chef de la police. — Aspect de l'armée. — Dikoua. — Marche de l'armée. — Le Mosgou. — Adishen et son escorte. — Beauté du pays. — Chasse à l'homme. — Erreur des Européens sur le centre de l'Afrique. — Incendies. — Baga. — Partage du butin. — Entrée dans le Baghirmi. — Refus de passage. — Traversée du Chari. — À travers champs. — Défense d'aller plus loin. — Hospitalité de Bou-Bakr-Sadik. — Barth est arrêté. — On lui met les fers aux pieds. — Délivré par Sadik. — Maséna. — Un savant. — Les femmes de Baghirmi. — Combat avec des fourmis. — Cortége du sultan. — Dépêches de Londres.
De Katchéna au Niger. — Le district de Mouniyo. — Lacs remarquables. — Aspect curieux de Zinder. — Route périlleuse. — Activité des fourmis. — Le Ghaladina de Sokoto. — Marche forcée de trente heures. — L'émir Aliyou. — Vourno. — Situation du pays. — Cortége nuptial. — Sokoto. — Caprice d'une boîte à musique. — Gando. — Khalilou. — Un chevalier d'industrie. — Exactions. — Pluie. — Désolation et fécondité. — Zogirma. — La vallée de Foga. — Le Niger. — La ville de Say. — Région mystérieuse. — Orage. — Passage de la Sirba. — Fin du rhamadan à Sebba. — Bijoux en cuivre. — De l'eau partout. — Barth déguisé en schérif. — Horreur des chiens. — Montagnes du Hombori. — Protection des Touaregs. — Bambara. — Prières pour la pluie. — Sur l'eau. — Kabara. — Visites importunes. — Dangereux passage. — Tinboctoue, Tomboctou ou Tembouctou. — El Bakay. — Menaces. — Le camp du cheik. — Irritation croissante. — Sus au chrétien! — Les Foullanes veulent assiéger la ville. — Départ. — Un preux chez les Touaregs. — Zone rocheuse. — Lenteurs désespérantes. — Gogo. — Gando. — Kano. — Retour.
Voyages et aventures du baron de Wogan en Californie (1850-1852.—Inédit).
Arrivée à San-Francisco. — Description de cette ville. — Départ pour les placers. — Le claim. — Première déception. — La solitude. — Mineur et chasseur. — Départ pour l'intérieur. — L'ours gris. — Reconnaissance des sauvages. — Captivité. — Jugement. — Le poteau de la guerre. — L'Anglais chef de tribu. — Délivrance.
Voyage dans le royaume d'Ava (empire des Birmans), par le capitaine Henri Yule, du corps du génie bengalais (1855).
Voyage aux grands lacs de l'Afrique orientale, par le capitaine Burton (1857-1859).
But de l'expédition. — Le capitaine Burton. — Zanzibar. — Aspect de la côte. — Un village. — Les Béloutchis. — Ouamrima. — Fertilité du sol. — Dégoût inspiré par le pantalon. — Vallée de la mort. — Supplice de M. Maizan. — Hallucination de l'assassin. — Horreur du paysage. — Humidité. — Zoungoméro. — Effets de la traite. — Personnel de la caravane. — Métis arabes, Hindous, jeunes gens mis en gage par leurs familles. — Ânes de selle et de bât. — Chaîne de l'Ousagara. — Transformation du climat. — Nouvelles plaines insalubres. — Contraste. — Ruine d'un village. — Fourmis noires. — Troisième rampe de l'Ousagara. — La Passe terrible. — L'Ougogo. — L'Ougogi. — Épines. — Le Zihoua. — Caravanes. — Curiosité des indigènes. — Faune. — Un despote. — La plaine embrasée. — Coup d'œil sur la vallée d'Ougogo. — Aridité. — Kraals. — Absence de combustible. — Géologie. — Climat. — Printemps. — Indigènes. — District de Toula. — Le chef Maoula. — Forêt dangereuse.
Arrivée à Kazeh. — Accueil hospitalier. — Snay ben Amir. — Établissements des Arabes. — Leur manière de vivre. — Le Tembé. — Chemins de l'Afrique orientale. — Caravanes. — Porteurs. — Une journée de marche. — Costume du guide. — Le Mganga. — Coiffures. — Halte. — Danse. — Séjour à Kazeh. — Avidité des Béloutchis. — Saison pluvieuse. — Yombo. — Coucher du soleil. — Jolies fumeuses. — Le Mséné. — Orgies. — Kajjanjéri. — Maladie. — Passage du Malagarazi. — Tradition. — Beauté de la Terre de la Lune. — Soirée de printemps. — Orage. — Faune. — Cynocéphales, chiens sauvages, oiseaux d'eau. — Ouakimbou. — Ouanyamouézi. — Toilette. — Naissances. — Éducation. — Funérailles. — Mobilier. — Lieu public. — Gouvernement. — Ordalie. — Région insalubre et féconde. — Aspect du Tanganyika. — Ravissements. — Kaouélé./p>
Tatouage. — Cosmétiques. — Manière originale de priser. — Caractère des Ouajiji; leur cérémonial. — Autres riverains du lac. — Ouatata, vie nomade, conquêtes, manière de se battre, hospitalité. — Installation à Kaouélé. — Visite de Kannéna. — Tribulations. — Maladies. — Sur le lac. — Bourgades de pêcheurs. — Ouafanya. — Le chef Kanoni. — Côte inhospitalière. — L'île d'Oubouari. — Anthropophages. — Accueil flatteur des Ouavira. — Pas d'issue au Tanganyika. — Tempête. — Retour.
Fragment d'un voyage au Saubat (affluent du Nil Blanc), par M. Andrea Debono (1855).
Voyage à l'île de Cuba, par M. Richard Dana (1859).
Départ de New-York. — Une nuit en mer. — Première vue de Cuba. — Le Morro. — Aspect de la Havane. — Les rues. — La volante. — La place d'Armes. — La promenade d'Isabelle II. — L'hôtel Le Grand. — Bains dans les rochers. — Coolies chinois. — Quartier pauvre à la Havane. — La promenade de Tacon. — Les surnoms à la Havane. — Matanzas. — La Plaza. — Limossar. — L'intérieur de l'île. — La végétation. — Les champs de canne à sucre. — Une plantation. — Le café. — La vie dans une plantation de sucre. — Le Cumbre. — Le passage. — Retour à la Havane. — La population de Cuba. — Les noirs libres. — Les mystères de l'esclavage. — Les productions naturelles. — Le climat.
Excursions dans le Dauphiné, par M. Adolphe Joanne (1850-1860).
Le pic de Belledon. — Le Dauphiné. — Les Goulets.
Les gorges d'Omblèze. — Die. — La vallée de Roumeyer. — La forêt de Saou. — Le col de la Cochette.
Excursions dans le Dauphiné, par M. Élisée Reclus (1850-1860).
La Grave. — L'Aiguille du midi. — Le clapier de Saint-Christophe. — Le pont du Diable. — La Bérarde. — Le col de la Tempe. — La Vallouise. — Le Pertuis-Rostan. — Le village des Claux. — Le mont Pelvoux. — La Balme-Chapelu. — Mœurs des habitants.

ROYAUME D'AVA.—Grande pagode de Rangoun.—Dessin de Français d'après une photographie.
PAR LE CAPITAINE HENRI YULE,
DU CORPS DU GÉNIE BENGALAIS.
1855.
Départ de Rangoun. — Frontières anglaises et birmanes. — Aspect du fleuve et de ses bords.
Lord Dalhousie, gouverneur général de l'Inde, ayant décidé l'envoi d'une ambassade près de la cour d'Ava, les membres de la mission, à laquelle il voulut bien m'adjoindre en qualité de secrétaire, se réunirent à Rangoun dans le courant de juillet 1855. Cette ville est célèbre par sa belle position commerciale et maritime au débouché de la navigation intérieure du Pégu et de l'Ava, ainsi que par sa grande pagode, un des sanctuaires les plus renommés de l'Indo-Chine.
Le 1er août, au point du jour, toute l'ambassade, portée sur les bateaux plats le Sutlege et le Panlang, remorqués par le Bentinck et le Nerbudda, quitta cette ville et gagna le bras principal de l'Irawady.
Après avoir traversé les provinces anglaises d'Enzada et de Prome, on nous annonça l'approche d'une députation birmane qui devait nous servir d'escorte.
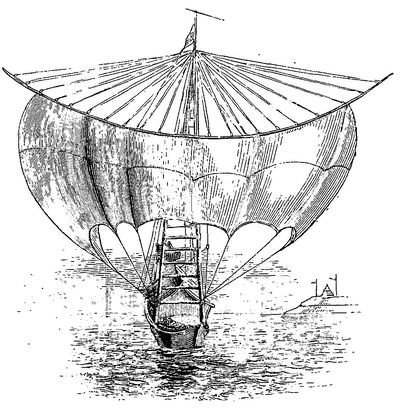
Bateau à voile sur l'Irawady.
À quelques heures au nord de Prome, des piliers blancs élevés sur chaque rive du fleuve nous indiquent la ligne frontière des possessions anglaises et birmanes. Les canons des forts saluent notre passage.
Entre le fleuve et la base des chaînes qui bordent son bassin s'étendent des bandes de terrain où se déploie cette richesse de végétation qu'impriment au paysage les bois où les grands arbres se mélangent aux palmiers élancés. Les villages sont assez nombreux, agréables d'aspect; le plus souvent la masse sombre d'un monastère domine de ses triples étages les cabanes et les arbres; puis en arrière, pour dernier plan, se dressent des collines qui, couvertes d'un gazon sec, sont couronnées de pagodes auxquelles conduisent des sentiers tortueux.
Une course au sommet d'une des premières collines des terres d'Ava nous procure une vue magnifique de la contrée et du cours du fleuve. Dans le lointain nous n'apercevons pas de villages, mais des routes se dirigeant vers l'intérieur, et de temps à autre apparaissent quelques-uns de ces chariots indigènes (neat) qu'entraînent de leur trot rapide des bœufs rouges, vigoureux et en parfait état.
Ces animaux, quoique beaucoup plus petits que les bœufs de l'Inde centrale et du Deccan, sont beaucoup plus forts, plus grands que les bœufs du Bengale; je n'en ai peut-être jamais vu en meilleure condition. Ces bœufs sont loin de se livrer à des excès de travail. La principale raison de leur parfait état tient probablement à ce que, les indigènes ne consommant pas de lait, les veaux ne sont pas privés de leur aliment naturel.
Les terres qui avoisinent la frontière sont excessivement ondulées, et les fonds seuls sont cultivés. Le nom de charrue ne peut s'appliquer à l'instrument qu'on emploie dans les cultures sèches; c'est plutôt une sorte de râteau avec trois larges dents d'acacia. Près d'Ava, surtout dans les rizières, les paysans se servent de charrues qui rappellent un peu plus les charrues indoues.
Les terres, bien qu'imparfaitement labourées, étaient proprement tenues et leurs sillons plus réguliers que dans la plupart de nos champs de l'Inde. Ce mode de culture n'en excita pas moins le mépris d'un robuste Hindoustan du Doab, zémindar dans notre cavalerie irrégulière. «C'est à Dieu et non pas à leur travail qu'ils doivent leur nourriture,» disait-il. Les paysans se plaignaient beaucoup de la sécheresse; ils n'avaient pas récolté de riz depuis plusieurs années, et n'espéraient pas même une récolte cette année encore.
Nous trouvâmes enfin à Menh'la, chef-lieu de district, (p. 259) la députation annoncée depuis plusieurs jours. Elle se composait du Woondouk[1] Moung Mhon; du gouverneur de Tseen-goo, petit vieillard original; de Makertich, gouverneur du district de Maloon. Ce dernier, d'origine arménienne, s'habille comme les Birmans; son teint est peut-être un peu plus foncé que celui des indigènes, dont il se distingue par des traits plus aquilins. Il y avait en outre des scribes et des officiers.
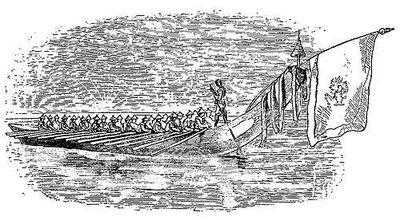
Canot de parade.
La députation était escortée de cinq ou six canots de guerre; c'était la première fois que nous rencontrions ces immenses embarcations; l'avant en est très-bas et très-fin; l'arrière, très-élevé, se recourbe au-dessus de l'eau; les rameurs, au nombre de quarante à soixante, sont deux sur chaque banc: tout l'extérieur du canot est doré, et toutes les rames le sont aussi. Les matelots, vigoureux et robustes, portaient tous leur conique chapeau de bambou; dans quelques canots ils étaient vêtus de mauvaises jaquettes noires d'uniforme. Des bandes de mousseline et des filets couverts de clinquant ornent les poupes élevées des canots de guerre, où flotte avec grâce une grande bannière blanche bordée d'argent, sur laquelle s'étale le blason de l'empire, un paon grossièrement dessiné. Souvent, à côté de l'oiseau oriental, une carafe européenne sert de pomme au mât de bambou auquel s'attache le pavillon. C'est un ornement très en faveur chez les Birmans, et parfois même une modeste bouteille à eau de Seltz domine la pointe extrême des pagodes. Un court mâtereau dressé à l'extrémité de la poupe des canots de guerre porte le htee[2], cet emblème royal et sacré. Ce n'est pas à l'arrière, comme en Europe, mais à l'avant du canot, sur une espèce de petite plate-forme, que se place le personnage le plus important du bord.
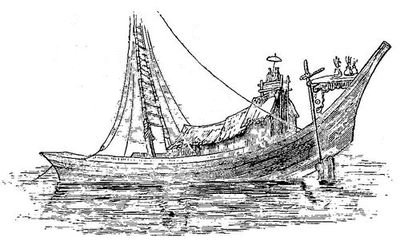
Bateau de commerce.
Nous débarquâmes et nous nous rendîmes à la résidence de Makertich. C'est une élégante construction en bambou, élevée sur piliers et entourée d'une palissade de même bois, selon la mode du pays. Une chambre tout à jour d'un côté, garnie de tapis indiens, servait de pièce de réception. Au fond de la salle, on voyait rangés sur un râtelier les fusils de la garde du gouverneur, qui habite, dans un coin de la cour, un petit corps de bâtiment, d'où les femmes regardaient curieusement les Kalàs (étrangers); les communs et les corps de garde étaient appuyés sur la clôture elle-même.
Dans la soirée, en compagnie de Makertich, nous allâmes faire un tour dans la ville, qui est toute neuve, et ne date que de l'entrée en fonction de ce gouverneur; elle n'a que six mois d'existence. C'est certainement la ville la plus propre et d'aspect le plus prospère que nous ayons rencontrée sur le fleuve depuis notre départ de Rangoun: une longue voie perpendiculaire à la rivière, et que viennent croiser trois autres rues, compose cette jeune cité. Les maisons ne sont pas situées au bord de la rivière; les Birmans négligent presque universellement les avantages d'une telle position; une large zone couverte de grands arbres s'étend toujours entre l'eau et leurs habitations; des simul (l'arbre à coton des Anglo-Hindous), des tamarins, de nombreuses variétés de figuiers forment un ombrage impénétrable aux rayons du soleil. Les rues sont larges, bien entretenues, bien drainées. Un groupe de monastères et de pagodes entouré d'un bosquet de tamarins, de palmiers et de talipots, s'élève sur le bord du fleuve, et nous remarquons dans plusieurs de ces édifices religieux l'absence de la forme conique ou mieux de cette forme en poire qui est le modèle stéréotypé de toutes les pagodes du Pégu.
Le lendemain 13 août nous nous remîmes en route, après une visite matinale de notre escorte, ennuyeux cérémonial qu'il fallut subir pendant tout le voyage. Le woondouk et sa suite étaient dans deux barges remorquées par les canots de guerre; ces barges étaient peintes tout en blanc, couleur royale; les parasols d'or des dignitaires se dressaient aux coins de la cabine, devant laquelle était une verandah tendue en drap grossièrement brodé.
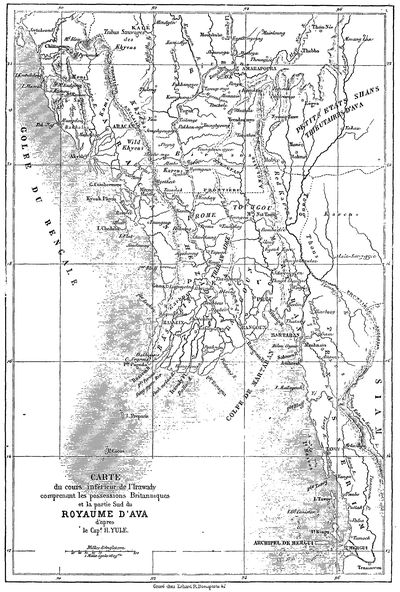
Carte du cours inférieur de l'Irawady
comprenant les possessions Britanniques
et la partie Sud du
Royaume d'Ava
d'après
le Capitaine H. Yule.
Les bateaux, nombreux à Menh'la, offraient quelques (p. 261) bons spécimens des grandes embarcations de l'Irawady; il y en avait de 120 à 130 tonneaux.
On se sert sur la rivière de deux sortes de barques différant complétement l'une de l'autre. Les plus grandes, les hnau, sont aussi les plus employées: quelle que soit leur grandeur, le modèle pour toutes est le même. La quille se compose d'un tronc d'arbre qu'on creuse et qu'on élargit à l'aide du feu, quand le bois est vert encore; c'est simplement un canot. Sur cette espèce de quille on monte les membrures et les clins. Les courbes de l'avant, toujours très-bas, sont magnifiques, très-évidées, et ressemblent beaucoup à celles de nos steamers modernes. L'arrière s'élève beaucoup au-dessus de l'eau, et ses lignes d'eau sont très-fines. On y trouve toujours un banc élevé, ou plutôt une espèce de plate-forme soigneusement sculptée servant au timonier. Le gouvernail est un large aviron attaché à la hanche de bâbord; il se manœuvre à l'aide d'une petite barre qui vient en travers du banc du pilote.

Birmans dans une forêt.—Dessin de J. Pelcoq d'après une photographie.
Ce qu'il y a de plus curieux dans ces navires, c'est la mâture et la voilure. Le mât se compose de deux espars; attachés à deux morceaux de charpente et fixés à la quille, ils sont disposés sur ces pièces de bois de façon à pouvoir s'abaisser et même se démonter à volonté. Cette même mâture sert aux fameux pirates d'Ilanon, dans l'archipel Indien; quand ces écumeurs de mer sont poursuivis, ils se réfugient dans une crique et abaissent leurs mâts, qui pourraient trahir leur retraite. Il me semble qu'il y a entre les races indo-chinoises et les habitants de l'archipel Indien de nombreux points de ressemblance qui doivent fixer l'attention des ethnologistes.
Ces deux mâtereaux, réunis par des traverses qui forment (p. 262) une espèce d'échelle, se rejoignent au-dessus de la vergue, et se terminent en un mât unique.
La vergue est formée d'un ou de plusieurs bambous d'une longueur énorme, très-flexibles; elle est attachée au mât par de nombreuses drisses, de manière à se courber en forme d'arc. Le long de la vergue court une corde dans laquelle passent des anneaux servant à attacher la voile, qui, à la manière d'un rideau, se tire des deux côtés du mât. Il y a de plus un hunier installé de la même manière. La voile est de cette toile de coton légère qui sert aux vêtements des indigènes. S'il n'en était pas ainsi, il serait impossible à ces bateaux de porter l'immense voilure qui les caractérise. À Menh'la, un de ces bateaux se trouvait près du rivage, je pus mesurer sa vergue; elle avait, tout en négligeant sa courbure, cent trente pieds (trente-neuf mètres) de long, et la surface de la voilure ne pouvait pas être au-dessous de quatre mille pieds carrés (367 mètres).
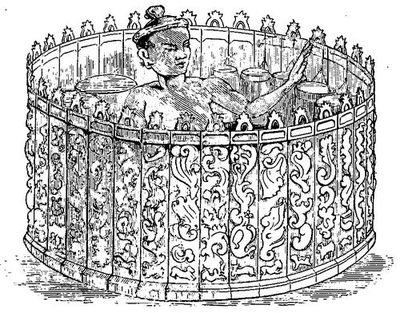
Pattshaing ou tambour-harmonica.
Ces bateaux ne peuvent marcher que vent arrière; mais pendant la saison des pluies, le vent est presque toujours favorable à la remonte d'Irawady. Une flottille de ces bateaux filant devant le vent, avec le soleil dorant leurs immenses voiles blanches, ressemble à de gigantesques papillons effleurant l'eau.
Au-dessus de Menh'la le courant est très-violent, nos steamers remorqueurs n'avançaient qu'à grand'peine. Sur notre gauche se dressaient d'abruptes collines de grès rouge; au pied de ces rochers, qui s'entr'ouvrent çà et là pour former de charmants vallons herbeux, apparaissaient de magnifiques arbres qui projetaient leurs ombres sur les remous de la rivière. La pagode de Myenka-taoung, déjà signalée par Crawfurd en 1824, se dresse encore à l'extrémité de la falaise, suspendue au-dessus des eaux qui minent la base des rochers sur lesquels elle est assise. C'est là qu'en 1056 fut assassiné Chaulu, roi de Pagán.
Nous nous arrêtons à Men-goon (le site du palais rustique), grand village de deux à trois cents maisons. La population entière est sur le rivage, drapeaux et bannières flottant au vent, un corps de musique jouant à tout rompre; des bateaux dorés, d'autres embarcations moins éclatantes, mais ayant le même aspect «centipède,» circulent autour de nos vaisseaux; les rameurs poussent des hurlements ou chantent en chœur, ce qui est la même chose; deux ou trois individus ressemblant à des démons dansent avec frénésie sur les bancs des canots; l'excitation générale donne à ce spectacle un caractère étrange et bizarre.
Un peu au-dessus de Men-goon, le fleuve change d'aspect, il s'étend en un immense chenal de deux à cinq milles de large (trois mille deux cents à huit mille mètres), embrassant de nombreuses îles d'alluvion; et il conserve cet aspect jusqu'au confluent du Kyend-wen.
Dans tout ce parcours, des berges élevées, des falaises escarpées de grès ou d'argile rouge encaissent la rivière à l'orient. Près du fleuve les terrains sont ravinés et tourmentés; plus loin le sol s'élève en longues pentes ou en collines ondulées. La végétation a perdu ici son caractère tropical: rare et rabougrie en quelque sorte, elle ne se compose guère que d'une variété de zizyphus jujuba, acacia cathechu, entremêlés de ces euphorbes décharnés et de ces pâles et maladifs madars qui se rencontrent dans tous les endroits stériles et desséchés de l'Inde, depuis le Peshawer jusqu'au Pégu.
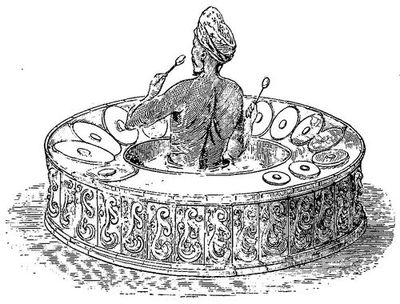
Pattshaing à baguettes.
Hâtons-nous de dire que ces falaises stériles s'ouvrent de temps à autre pour laisser entrevoir, dans l'intérieur des terres, de jolis vallons perpendiculaires au fleuve; au débouché de tous, de verdoyants bosquets de palmiers et de grands arbres ombragent de riants petits villages dont la verte ceinture de champs cultivés et de haies bien entretenues forme un charmant contraste avec les collines stériles et nues qui les environnent.
Sur la rive droite, ces hautes terres disparaissent près Memboo, à dix-huit milles (vingt-neuf kilomètres) de Menh'la; une immense plaine d'alluvion s'étend jusqu'aux derniers contre-forts des monts Aracan; c'est la province de Tsalen, une des plus riches de l'empire birman.
De Men-goon, nous gagnons Magwé; entre ces deux localités, sur des collines dénudées, brillent les blanches pagodes de Kwé-zo, auxquelles on arrive par d'interminables escaliers.
(p. 263) La ville de Magwé. — Musique, concert et drames birmans.
Magwé, peuplée de huit à neuf mille âmes, est la plus grande ville que nous ayons encore vue en ce pays. Il y avait sur la plage deux ou trois cents bateaux de toute forme et de toute grandeur. Selon le wondouk, la ville renferme trois mille maisons, et ce chiffre ne nous sembla nullement exagéré.
En approchant de Magwé, nous vîmes un joli spécimen de pont birman: les Birmans sont bien plus avancés que les Hindous dans ce genre de construction; il est rare de ne pas rencontrer de pont là où les débordements empêchent la circulation.
La longueur de ces ponts est souvent excessive; leur construction ne m'a jamais semblé varier. Des pilotis en bois de teck de douze à treize pieds de long, des traverses qui se fixent aux pieux par des mortaises, un plancher solide, une balustrade souvent élégamment sculptée, voilà tout ce qu'on exige d'un ingénieur birman. Les pilotis, enfoncés sans l'aide du mouton, résistent pourtant au courant.
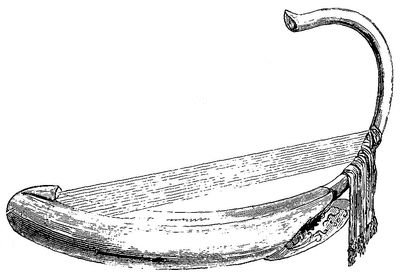
Harpe birmane.
Les chaumières des faubourgs étaient en bon état; presque toutes avaient un large porche en treillage, qui, recouvert de plantes grimpantes, formait un frais berceau d'ombre et de verdure.
Les principales maisons de la grand'rue étaient occupées par des soldats dont les armes étaient rangées le long des verandahs. De nombreux chevaux circulaient dans les rues; c'était la monture de la milice du pays, convoquée sans doute pour notre arrivée.
Les boutiques étaient veuves de leurs marchandises, et la population avait un air d'inquiétude qui est peu dans le caractère des Birmans; notre présence semblait les préoccuper.
Nous ne rencontrâmes aussi que très-peu de femmes, ce qui n'est pas l'habitude du pays. C'est la seule fois que nous nous soyons aperçus de ce manque de confiance; mais les femmes ne se montrèrent plus en grand nombre que dans le voisinage de la capitale.
En sortant de la ville, nous nous trouvâmes dans une campagne ouverte, ondulée et divisée en enclos par des haies de jujubiers morts. La principale culture était le sésame. L'aspect des routes et des champs nous montrait un degré de civilisation auquel nous ne nous attendions pas.
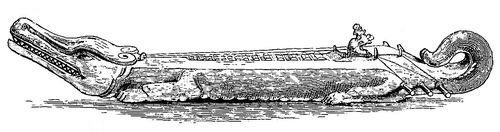
Harmonica birman.
Du bord de notre bateau à vapeur, nous avions remarqué une masse sombre de toitures s'étageant les unes sur les autres; c'étaient deux immenses monastères, d'une construction solide et simple, une chapelle (thein) et enfin une pagode. Le tout, y compris de vastes terrains, était entouré d'une grossière palissade de bois de teck de sept à huit pieds de haut.
Le thein était le monument le plus remarquable et le plus richement sculpté que nous ayons encore rencontré: ce n'est que dans les environs d'Amarapoura que nous avons vu des monastères le surpassant; plutôt encore par la richesse que par le goût de l'ornementation.
M'étant mis à en faire un croquis, je fus aussitôt entouré d'une foule de moines et de profès, tous très-joyeux, mais aussi très-questionneurs. Quand je demandais à l'un d'eux de poser pour que je pusse le représenter dans mon dessin, il s'approcha à toucher mon visage, et je ne pus lui faire comprendre qu'il était trop près.
Le soir, nous fîmes connaissance avec le drame birman, distraction qui prendrait grande place dans ma narration, s'il me fallait raconter ceux dont nous avons été journellement gratifiés pendant tout notre voyage.
Le gouverneur avait ordonné une exhibition de marionnettes et un drame régulier et classique; comme c'était la première fois qu'on nous faisait une politesse de ce genre, le major Mac Phayre, l'ambassadeur, y exigea notre présence.
Nous avions un orchestre birman au grand complet, composé d'instruments très-curieux, et qui, je crois, sont particuliers à la Birmanie.
Le principal instrument, tant au point de vue du volume que du son, est le pattshaing ou tambour-harmonica. C'est une espèce de châssis circulaire, en forme de baquet, d'environ trente pouces (soixante-quinze centimètres) de haut sur quatre pieds et demi (un mètre cinquante centimètres) de diamètre. Ce châssis consiste en espèces de douves curieusement sculptées, qu'on maintient les unes près des autres à l'aide d'un tenon qui s'introduit dans une mortaise taillée dans un cercle. À (p. 264) l'intérieur sont suspendus verticalement dix-huit à vingt tambourins, dont le diamètre varie, de six à vingt-cinq centimètres. Pour accorder l'instrument, on modifie le son de chaque tambour, quand cela est nécessaire, en étendant avec le pouce un peu d'argile mouillée au centre de la peau d'âne. Le musicien, accroupi à l'intérieur, joue de cet instrument avec les doigts ou la paume de la main, et parvient à en tirer certains effets musicaux. Un autre instrument ressemble beaucoup au pattshaing, mais, au lieu de tambours, il contient des tamtams, et les musiciens se servent de baguettes pour toucher ce clavier, qui donne des sons d'une douceur et d'une mélodie charmantes. Le reste de l'orchestre se compose de deux ou trois clairons à large pavillon, d'une misérable trompette d'un son, de cymbales, et quelquefois d'un immense tamtam; invariablement il y a des castagnettes de bambou qui battent fort bien la mesure, mais qui aussi se font par trop entendre.
Les Birmans ont en outre des instruments pour la musique spéciale de salon ou de concerts; les principaux sont la harpe et l'harmonica aux touches de bambou et quelquefois d'acier.
Nous avons vu à Amarapoura un de ces derniers instruments; c'était l'œuvre des augustes mains du roi Tharawady, qui, comme Louis XVI, était plus adroit mécanicien qu'habile monarque.
Enfin une longue guitare cylindrique à trois cordes, ayant la forme d'un caïman, dont elle porte d'ailleurs le nom, clôt la liste de l'instrumentation birmane.
Revenons au drame. Le sol, couvert de nattes, sert généralement de scène. Les personnages distingués se placent sur des estrades, la plèbe s'accroupit, se plaçant de son mieux dans tous les espaces libres. Au milieu de la scène il y a toujours un arbre, ou simplement une grosse branche d'arbre; comme l'autel dans les tragédies grecques, c'est le centre de l'action, c'est le seul décor; on a toujours répondu à mes questions à ce sujet que c'était en prévision du cas où l'on aurait une forêt ou un jardin à représenter; mais je suis convaincu que cet arbre avait une signification symbolique qui, avec le temps, s'est perdue.
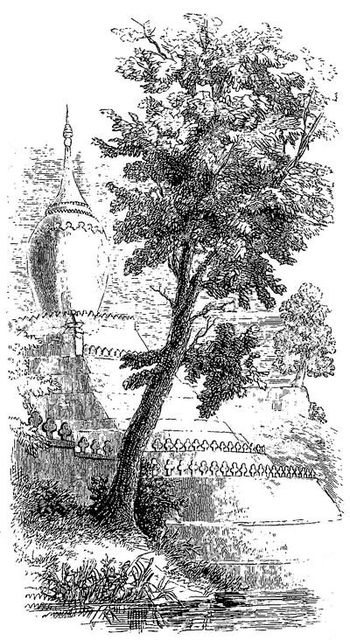
Pagode à Pagán.
L'éclairage, à l'huile minérale, consiste en quelques vases de terre qu'un des acteurs remplit de temps à autre et qui lancent leurs lueurs rougeâtres autour de l'arbre symbolique. L'orchestre, sur un des côtés de la scène, a près de lui une espèce de chevalet d'où pendent une foule de masques grotesques. Le coffre qui renferme les costumes de la troupe lui fait face; invariablement ce coffre fait fonction de trône à l'usage des rois, toujours très-nombreux dans ces drames.
De fait, rois, princes, princesses, ministres et courtisans sont les seuls personnages qui y figurent. Quant à l'intrigue, s'il y en a une, elle est très-difficile à découvrir. Le héros est le plus souvent un jeune prince, qui a toujours pour valet un bouffon, comme celui de nos anciennes comédies; le Crispin de Magwé remplissait parfaitement son rôle de comique, ainsi qu'en témoignaient les éclats de rire de l'audience. C'était le seul acteur digne de ce nom, et son jeu était souvent si hautement épicé, que pour le comprendre il n'était pas besoin de connaître la langue dont il se servait. L'interminable prolixité du dialogue dépassait toutes les bornes; je ne pense pas que personne pût comprendre ni ce qu'il signifiait ni sa raison d'être; ce qu'il y a de certain, c'est que l'action marchait si lentement qu'il eût fallu plusieurs semaines pour arriver au dénoûment.
Une partie du dialogue était chantée; dans ces moments, les attitudes, les gestes et certaines lamentations prolongées avaient un caractère très-comique, mais dont on se lassait bientôt. Des danseurs et des danseuses viennent souvent jouer des intermèdes ou même prendre part à l'action. Les rôles de femmes, dans les villes éloignées de la capitale, étaient joués par de jeunes garçons.
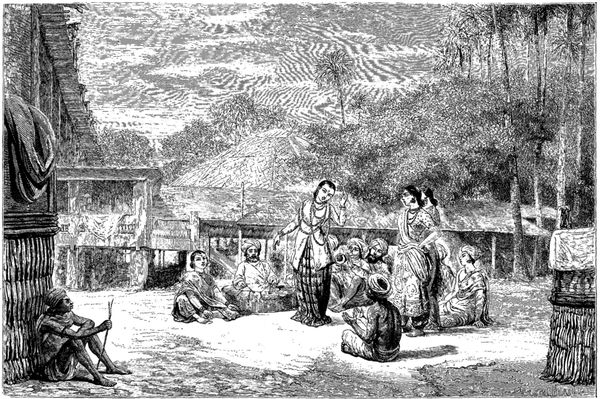
Représentation théâtrale dans le royaume d'Ava.—Dessin de W. Haussoullier et Hadamard d'après H. Yule.
Les marionnettes sont encore plus populaires que les drames: les représentations de ces acteurs de bois ont lieu sur des théâtres assez élevés, ayant souvent neuf mètres de développement, ce qui permet de transporter la scène selon les exigences du sujet; le plus communément, on voit un trône à un bout, c'est la cour; à l'autre extrémité des branches d'arbre représentent une forêt. Les pièces que jouent ces marionnettes sont, comme celles des acteurs vivants, très-prolixes, et elles m'ont paru avoir une tendance au surnaturel, car on y voit des princesses (p. 266) enchantées, des dragons, des esprits (hàts), des chariots volants, etc. Ces marionnettes jouent souvent aussi des mystères qui se rapportent à l'histoire de Gautama, et qu'on ne pourrait laisser représenter par des acteurs.
Sources de naphte; leur exploitation. — Un monastère et ses habitants.
La ville de Ye-nan-Gyong, que nous atteignîmes le 13, révèle la nature de son industrie et à la vue et à l'odorat; on y sent partout l'odeur nauséabonde du pétrole; la plage est couverte de vases de terre qui ruissellent d'huile; de toutes parts on voit fumer des poteries. Nous montâmes sur les collines qui entourent la ville; un sol de sable ou de pierre, à peine assez d'herbe pour ne pas accuser une stérilité absolue, çà et là quelques euphorbes rabougris, du bois pétrifié en abondance, tel est l'aspect désolé du pays.
Le 15 août fut consacré à visiter les mines; nos chevaux n'étaient pas mauvais; mais je n'en puis dire autant de leur harnachement. Après avoir chevauché pendant trois milles (cinq kilomètres) à travers des ravins et des collines escarpées de grès en pleine désagrégation, nous arrivâmes sur une hauteur au centre de l'exploitation. C'est un plateau irrégulier qui forme une espèce de péninsule au milieu des ravins.
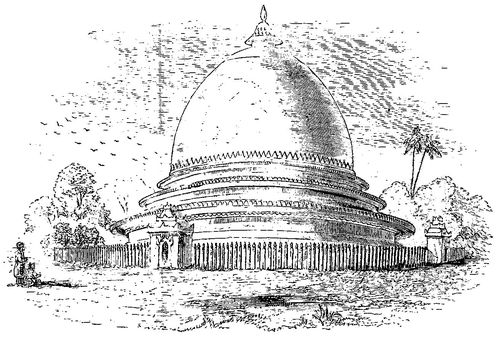
Dagobah ou pagode en forme de cloche.
Les puits sont, dit-on, au nombre de cent; mais il en est qui sont abandonnés. Leur profondeur est variable, suivant qu'ils sont percés à la partie supérieure du plateau ou sur ses flancs. Nous en avons mesuré plusieurs à l'aide de longues cordes qui servent à puiser l'huile, et nous avons trouvé cinquante-quatre, cinquante-sept, quatre-vingt-un et jusqu'à quatre-vingt-onze mètres. Cette exploitation occupe une surface d'environ deux cent soixante hectares.
Un treuil grossier, monté sur un tronc d'arbre, posé lui-même sur des branches fourchues, est tout le matériel employé. On laisse descendre un pot de terre, il se remplit d'huile, puis un ouvrier, homme ou femme, tirant la corde, descend la pente de la colline jusqu'à ce que le vase arrive à l'orifice du puits. Les Birmans se servent de cette huile pour l'éclairage; on l'emploie aussi pour préserver les bois de construction des atteintes des insectes; c'est souvent même un médicament. Ce pétrole, qui depuis quelques années et largement importé en Europe, sert à l'éclairage, au graissage des machines, et la substance solide est employée à la fabrication des bougies.
Cette huile, de couleur verdâtre, a la consistance de la mélasse; son odeur n'est pas désagréable quand on est en plein air, et qu'elle est en petite quantité.
Le travail dans ces puits, d'où s'échappent des gaz délétères, n'est pas sans danger, surtout quand on approche du niveau de l'huile. Le capitaine Macleod, qui vit travailler au percement de l'un d'eux, rapporte que les ouvriers ne restent au fond du puits que de quatorze à vingt-huit secondes; encore en sortent-ils très-épuisés.
Cette exploitation fournit par mois vingt-sept mille viss(quarante-cinq mille kilogrammes de pétrole), il en revient mille au roi, mille au seigneur du district, et environ neuf mille aux ouvriers. Par suite de la demande du marché européen, cette substance vaut actuellement, à Londres, de mille à onze cents francs la tonne. La production totale annuelle de tous les puits, y compris ceux de la région sud, est d'environ douze mille tonnes.
Dans la soirée j'allai avec le major Phayre faire une promenade dans les environs: un chemin bien entretenu nous conduisit, à travers des collines arides, jusqu'à un petit vallon ombreux s'ouvrant sur la rivière; il avait son monastère et sa pagode. Les écoliers du monastère s'attroupant autour de nous, un vieux poon-gyi[3]vint sous le zayat[4]comme s'il voulait nous parler. Ces moines n'adressent jamais la parole les premiers: c'est la seule classe dans le Pégu avec laquelle il soit agréable de parler, parce qu'ils ne sont jamais quémandeurs.
Nous invitâmes le vieux poon-gyià venir visiter les steamers; mais il nous refusa en lorgnant soupçonneusement un avocat de Penang (un bâton), que l'un de nous avait à la main. «Je crains d'être battu,» nous dit-il.
Ce peuple semble croire que parler birman implique une communauté de foi avec eux. On demandait invariablement à l'ambassadeur: «Est-ce que vous adorez les pagodes?» Comme en parlant au poon-gyi il avait employé (p. 267) les termes de respect qu'on emploie à l'égard des prêtres, un des assistants aux dents noires lui dit d'une façon assez impertinente: «Quoi! est-ce que vous adorez les poon-gyis; pourquoi alors n'avez-vous pas rendu à celui-ci les hommages que vous lui devez?—Parce qu'aujourd'hui n'est pas un jour de culte,» répliqua l'envoyé. Cette réponse excita un rire général dans tout l'auditoire.
La ville de Pagán. — Myeen-Kyan. — Amarapoura.
À mesure que nous approchons de Pagán, le fleuve semble grandir. La rive orientale est magnifique de végétation. Ce n'est qu'une succession continue de vallons richement boisés, de bouquets d'élégants palmiers abritant des villages; c'est un contraste frappant avec la rive opposée, qui ne présente qu'une série de collines stériles, dénudées, dont l'apparence est d'autant plus désolée que les îles qui surgissent à leurs pieds sont couvertes d'une épaisse verdure.
Nous voici enfin à Pagán; d'abord un dôme immense apparaît, c'est le Tsetna-phya; ensuite des pyramides éclatantes qui, étagées les unes sur les autres, surmontent des toitures resplendissantes de dorures; des temples sombres, étranges, avec leurs bases carrées, d'où s'élance un clocher en forme de mitre; puis enfin des coupoles blanches, noires, bizarres, fantastiques, se dessinant au milieu des maisons, des palmiers, des champs et des jardins.
Voici venir les canots de guerre, les parasols dorés, les rameurs qui hurlent, les danseurs frénétiques, la musique assourdissante; c'est le gouverneur de Pagán, le Myit-sing-woon, espèce de grand shérif de l'Irawady.
Les temples apparaissent de plus en plus nombreux, les villages se montrent de toutes parts; de tous côtés, sous des arbres majestueux, une population qui fourmille; enfin nous laissons tomber l'ancre devant Pagán, et, comme d'habitude, près du théâtre.
L'escorte du Myit-sing-woon était la plus nombreuse que nous ayons encore vue. Dans son canot il avait cinquante hommes armés d'épées; une vingtaine portaient des fusils de tout calibre, mais tous à deux coups, plusieurs même de ces équipages portaient un uniforme. Nous comptâmes trente canots, qui en moyenne avaient trente hommes à bord. Enfin environ deux cents cavaliers, montés sur des petits chevaux campagnards, parmi lesquels il y avait plus d'une jument suivie de son poulain, nous attendaient sur la plage. Notre mouillage était des plus pittoresques. Près de nous, sur le bord du fleuve, s'élevait un temple, petit, il est vrai, mais d'une construction très-originale: son dôme avait la forme d'un oeuf, le gros bout en l'air, et était surmonté d'une simple flèche.
Cet œuf pose sur une terrasse de chunamou chaux qui est faite avec des coquillages ou du corail blanc; elle descend jusqu'à la rivière par une série de murs en talus, dont les parapets sont couronnés d'un cordon de trèfle mystique. En arrière une châsse de bois sculpté et doré, et un theinen brique avec son clocher pyramidal, s'étagent l'un derrière l'autre. Ce thein est d'une richesse et d'un fini d'exécution rares actuellement chez les Birmans.
De la rivière, cet ensemble d'architecture était si fantastique, si étrange, qu'en le voyant, on aurait pu se croire dans un monde nouveau.
Pagán nous causa à tous un profond étonnement. Aucun des voyageurs qui nous avaient précédés ne nous avait préparés au spectacle de ruines aussi vastes, aussi intéressantes. C'est à Pagán, dans les décombres de la vieille cité, que le 8 février 1826, l'armée des Birmans, commandée par le malheureux Naweng-Chuyen (le roi du coucher du soleil), livra son dernier combat aux Anglais envahisseurs.

Intérieur d'une pagode.
Les ruines de Pagán couvrent, le long du fleuve, un espace de treize kilomètres de long sur trois kilomètres de large. Le nombre des temples ruinés ou en bon état est de huit cents, peut-être même de mille. Il y en a de toute espèce: pagodes en forme de cloche, en forme de bouton, en forme de potiron ou d'œuf; Dagobahs, Chaityas, Bo-phyas[5], tout s'y trouve réuni, avec toutes les variantes que comportent d'ailleurs ces différents types. Ces constructions, presque toutes sur le même plan, affectent la forme cubique: à l'intérieur une grande chambre avec des voûtes gothiques; à la principale entrée, grand porche qui fait saillie; à l'orient, deux portes latérales; le plan a la forme d'une croix; le bâtiment s'élève en terrasses successives pour se terminer par une flèche, le plus souvent une espèce de pyramide renflée vers le milieu. Ces constructions sont en briques revêtues (p. 268) de plâtre. Les murs intérieurs et les chapelles ont un revêtement pareil, richement décoré de fresques d'un travail soigné.
Tel est en général le type de ces pagodes, dont la superficie varie de quatre-vingts à huit cents mètres carrés.
Ce qu'il y a de plus remarquable sans contredit dans ces temples, ce sont les chapelles à idoles, colossales statues de neuf mètres qui se ressemblent toutes; la seule différence qui existe entre elles est dans leur attitude: les unes prient, les autres prêchent, celles-ci donnent leur bénédiction. Posées sur un piédestal en bois sculpté en lotus, elles font face à l'entrée des chapelles, qui toutes sont ornées de magnifiques grilles de sept mètres de haut: ces grilles en bois sont très-curieusement fouillées; des guirlandes de feuillage d'un fini précieux s'enroulent autour de chaque traverse; les voûtes sont treillissées et semées de rosaces d'or.
L'immense niche où se trouve la statue a parfois plus de quinze mètres d'élévation; tout autour court une dentelle de métal doré, soigneusement découpée: au sommet de la voûte, à l'abri des regards du spectateur, se trouve une fenêtre dont le jour est dirigé sur la tête et les épaules de l'idole, qui, couverte d'or, semble ruisseler de lumière. Ce rayonnement éclatant au fond d'une chapelle sombre saisit le spectateur et produit un effet étrange.
Ces pagodes sont, je crois, toutes construites en kucha-pukka, c'est-à-dire en briques cimentées de vase. On se représente difficilement des monuments de ce genre, atteignant une hauteur de soixante mètres; il faut dire que ces constructions sont presque des masses solides, si bien que les corridors et les voûtes ressemblent plutôt à des excavations qu'à de grandes nefs. Ces travaux sont d'ailleurs exécutés avec un tel soin, le joint des briques est si bien fait, qu'il est difficile d'introduire entre elles la lame d'un couteau. Toute cette maçonnerie est couverte de plâtre; la nature même de cette construction exige qu'il en soit ainsi.
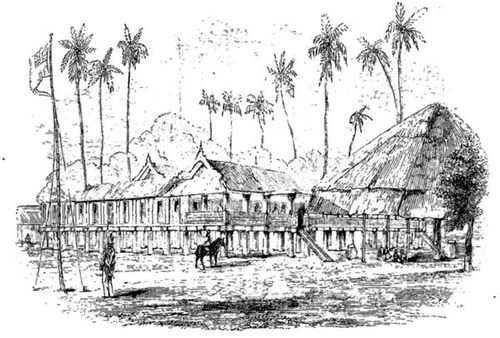
Maison de l'ambassade, à Amarapoura.
Là où le plâtre a résisté, les monuments sont en bon état; quand il a disparu, les monuments tombent en ruine. Il va sans dire que tous les ornements sont exécutés en plâtre; ils sont d'un goût et d'un fini qu'on rencontre rarement dans ce pays et dans les Indes.
Myeen-kyan, ville importante entre Pagán et la capitale du royaume, fait un grand commerce; c'est le principal marché à riz de la Birmanie. Les rues étaient très-animées: ici on battait le riz, là on le vannait, plus loin, on l'emballait et on le mettait à bord de grandes barques de cinquante à cent tonneaux, qui emportaient aussi des balles de coton destinées à la Chine. Celui que nous avons vu était sale et court de laine.
Les habitants se pressaient en foule pour voir les navires; ils regardaient par les sabords ouverts, questionnant, plaisantant sur tout ce qu'ils voyaient; qu'on fût à sa toilette ou non, ils ne se dérangeaient point.
Les eaux du fleuve étaient si hautes et inondaient tellement les champs et les prés, qu'il nous fut impossible de juger de l'importance du Kyend-wen, un des affluents de l'Irawady: nous remarquâmes au confluent de ces deux rivières un petit kyaung (monastère), bâti sur pilotis: il avait été construit, nous dit-on, pour les mariniers.
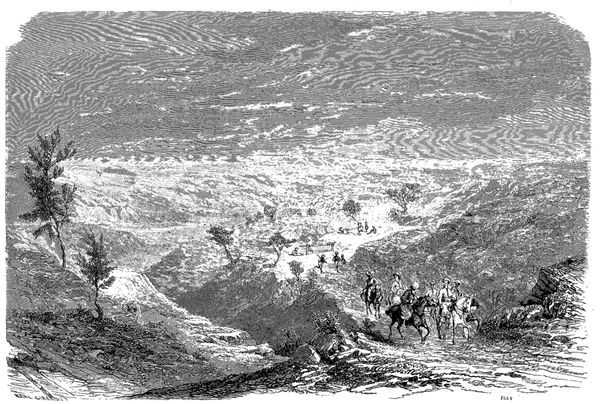
Vallée des puits de bitume.—Dessin de Karl Girardet d'après H. Yule.
Au delà de cette ville nous fûmes témoins de la fabrication indigène du salpêtre. Comme aux Indes, il se recueille ici sur le sol; pendant la saison sèche, on racle la terre à une profondeur de quinze centimètres environ; puis on met ce qu'on a ainsi ramassé dans des espèces de filtres d'osier garnis d'argile à l'intérieur et qu'on monte sur des châssis de bois. On les recouvre de balles de riz, puis on verse de l'eau sur le tout. Cette eau, passant lentement à travers l'appareil, vient tomber dans un vase en (p. 270) terre qui sert de récipient. On répète les lavages deux fois et on porte les eaux mères à la cuisson.
Celle-ci s'opère dans de larges vases peu profonds, juste assez élevés au-dessus du sol pour qu'on puisse faire un petit feu: ces chaudières sont en fonte de Chine, métal connu par ses qualités tenaces et ductiles. Le salpêtre vient se cristalliser sur les parois des vases, d'où on le retire en les raclant avec un couteau de bois.
La plus grande partie du salpêtre est vendue au roi; c'est un commerce libre; cependant, si on en vendait de grandes quantités pour l'exportation, il est probable qu'on l'arrêterait à la frontière. Ce qui ne se vend pas au roi sert à faire des pièces d'artifices, car les Birmans excellent dans la pyrotechnie.
Le 29 août, nous rencontrâmes une flotte de bateaux de guerre qui accompagnait une députation nouvelle envoyée à notre rencontre. Le chef vint abord, c'était Nan-ma-dau-woon, le gouverneur du palais de la reine; au commencement de la guerre, il était gouverneur de Dalla, et avait été à la tête de la députation envoyée à Calcutta. Il portait une longue robe d'organdi et avait sur l'épaule un tsal-wé[6] d'or à douze rangs. C'était le fonctionnaire le plus distingué que nous eussions rencontré. Son canot avec ses cinquante-six rameurs était un spécimen modèle du genre.
Le spectacle avait un grand caractère. La flottille de canots se divisa en deux bandes, l'une restant sur la rive droite, l'autre traversant la rive gauche; les vapeurs avançaient lentement pendant tous ces préparatifs; nous comptâmes trois cents canots; ils avaient en moyenne un équipage de trente hommes, le tout formant un total de neuf mille hommes, qui nous accompagnaient de leurs chants et de leur musique habituelle.
M. Spears, négociant anglais résidant depuis longtemps à Amarapoura, vint à bord avec Antonio Camaretta, Portugais de Goa, un des employés de confiance du gouvernement birman; il est actuellement receveur des douanes dans la capitale et maître de la garde-robe du roi.
Nous débarquâmes à Sagaïn, juste en face du vieil Ava; un bois épais, quelques pagodes blanches, quelques monastères en ruines, des remparts couverts d'herbes et de broussailles, indiquent seuls l'ancienne capitale du royaume. Aussitôt arrivés, le padre Abbona, prêtre piémontais, vint nous voir; nous eûmes de nombreux rapports avec lui dans la suite.
Le patron du canot de guerre qui avait amené le vieux woon, et qui était monté à bord avec lui, nous avait beaucoup amusés le long de la route. C'était un gaillard gros et gras, d'un aspect désagréable, qui se prélassait avec des airs d'importance, ainsi qu'il convient à qui possède un abdomen puissant et un putso battant neuf. Sa vanité subit ici un léger échec, et nous eûmes un curieux exemple de la manière dont cela se passe en Birmanie. Au moment du mouillage, plusieurs canots, qui auraient dû être au large, se trouvèrent gêner notre manœuvre. Un des chefs prononça quelques paroles, et tout aussitôt deux de ces licteurs nus qui suivent tout personnage de marque, et dont les insignes caractéristiques sont un long et vigoureux rotin et des chapeaux en laque rouge, se précipitèrent sur notre pilote, au moment où il débarquait dans toute sa gloire, le saisirent par sa houppe de cheveux, lui lièrent les pieds et les poings, et sans souci du putso neuf et de son importance, le jetèrent, près l'avoir fort malmené, sur un tas de briques situé derrière notre demeure.
Dans la soirée, nous explorâmes la ville et ses environs. Cette ville, qui plus d'une fois fut la capitale du royaume, est fermée par une enceinte en briques tombant en ruines et entourant, au milieu d'épais bouquets de magnifiques tamariniers, quelques rares maisons. Les boutiques, plus rares encore, ne contenaient rien d'intéressant.
Paysage. — Arrivée à Amarapoura.
Les chemins des environs de la ville auraient eu parfois un aspect tout anglais, n'étaient des haies de cactus qui nous rappelaient à la réalité. M. Oldham et moi, après avoir gravi fort péniblement environ trois cents marches très-roides, par un escalier ressemblant beaucoup à celui qui décorait le fronton du temple de la Renommée dans les livres de notre enfance, nous arrivâmes à un temple ruiné, qui lui-même ne nous paya pas de notre fatigue; mais du haut de ses terrasses nous eûmes une de ces vues qu'on n'oublie jamais. Il n'est rien sur les bords du Rhin qui puisse s'y comparer. Ici l'Irawady fait un coude brusque et s'infléchit presque à angle droit. Tantôt, étincelant comme une zone d'argent, il baigne des îles verdoyantes comme de sombres émeraudes, et semble se perdre dans les montagnes bleues qui apparaissent à l'horizon; tantôt il rayonne ardent sous les feux du soleil, comme un fleuve d'or liquide. Devant nous, Amarapoura, enveloppée d'une vapeur légère qui couvre ses maisons de clayonnage et ses pagodes de plâtre, de cette estompe mystérieuse qui permet à l'imagination de rêver de palais de marbre, de pagodes de porphyre et d'or. Derrière ses lagunes, c'est la merveilleuse Venise! À nos pieds des arbres splendides (il n'est pas d'arbres comme ceux de la Birmanie), d'où se détachent des pagodes, des temples éclatants de dorure; plus loin, large comme un lac, s'étend une nappe d'eau où se reflètent la profonde verdure des coteaux et les nuages blancs qui courent dans le ciel; puis encore le fleuve, que sillonnent les canots de guerre tout dorés et dont la musique et les chants arrivent jusqu'à nous; plus loin encore les collines nues, abruptes, désolées de Sagaïn, où, sur chaque mamelon, se dresse un sombre monastère ou un blanc Bo-phya; puis des îles, des temples, des villages, des collines nues, et, comme Cybèle, couronnées de tours, puis enfin de l'autre côté de l'Irawady, le vieil Ava, sombre (p. 271) forêt où surgissent encore quelques blanches pagodes ... splendide spectacle qui ne sortira jamais de ma mémoire!
En allant visiter la pagode de Khoung-moo-dau, nous traversâmes plusieurs villages habités chacun par des corps d'état distincts: dans l'un, des fabricants de papier; dans l'autre, des forgerons; un troisième ne renfermait que des marbriers. Ces derniers sculptent une quantité innombrable de gautamas en marbre. Ils polissent merveilleusement ces statues du Bouddha, se servant à cet effet d'une pâte faite avec du bois fossile. On demandait, pour un gautama d'un mètre de haut, deux cent trente-sept dollars; un petit gautama portatif, de vingt centimètres environ, tout rehaussé d'or, ne valait que vingt et un dollars.
30 août.—Vers midi arriva une autre immense flottille de canots de guerre; elle escortait le magwé-mengyi, qui venait au-devant de l'envoyé anglais. Ce fonctionnaire jouit d'une haute réputation de modération et d'honnêteté; il a la préséance sur tous les membres du hwlot-dau (conseil royal). Un certain air sensuel, combiné avec son air intelligent et rusé, le fait ressembler aux portraits de quelques rois du moyen âge.
L'entrevue fut très-cordiale; on causa de différents sujets, et enfin on vint à parler du système planétaire, que le major Phayre chercha à leur faire comprendre, sans y pouvoir réussir toutefois; c'était trop complétement opposé à la théorie des Birmans, qui admettent l'existence d'une montagne centrale (Myen-mo) dont la hauteur est de plusieurs millions de kilomètres, et autour de laquelle sont solidement attachées quatre grandes îles (l'Europe et l'Asie sont situées sur l'île du sud). Le soleil éclaire ces quatre terres en tournant autour de l'immense Myen-mo. Après quelques discussions sur ce thème, le woon-gyi, se tournant vers le major Phayre, lui demanda quels étaient les peuples qui croyaient à ce système.
«Les Anglais, les Français, les Portugais, les Américains, répondit celui-ci.
—Tous les blancs, alors. Il faudra que j'en parle au P. Abbona,» répondit le woon-gyi.
Dans la soirée M. Camaretta arriva avec une nombreuse suite de valets qui portaient une trentaine de plats d'argent massifs, contenant des ragoûts et des sucreries que le roi et la reine envoyaient à l'ambassade.
C'étaient les premiers spécimens de la cuisine indigène soumis à notre appréciation; aussi tous les plats furent-ils soigneusement dégustés. Il y avait, entre autres, une espèce de vol-au-vent de volaille et de porc, dont la pâte était de farine de riz, qui fut déclaré comparable aux meilleurs produits de l'art culinaire français. Les sucreries, préparées sous la direction de Son Altesse la princesse Pakhan, propre sœur du roi, étaient dignes d'une si haute provenance.
Partis le 1er septembre pour la capitale, nous trouvâmes le fleuve tellement débordé, qu'on fut obligé de faire jalonner devant nous le chenal par des canots de guerre, jusqu'à ce que, quittant l'Irawady, nous fîmes notre entrée dans le Myit-ngé ou lac d'Amarapoura, au milieu d'une forêt d'embarcations de toute espèce, parmi lesquelles apparurent bientôt les bateaux du roi. L'un d'eux était vraiment une embarcation royale; la proue représentait une tête de paon, et sur le pont s'étageaient les uns sur les autres de nombreux pavillons; le tout ruisselait d'or. Les tours et détours de la rivière étaient si fréquents que les collines de Sagaïn avaient l'air de danser autour de nous.
Enfin, après avoir traversé un dédale de canaux plus étroits les uns que les autres, si étroits que la Nerbudda avec ses tambours brisait les branches des arbres du rivage, nous arrivons au but de notre voyage, à cet interminable pont de bois qui traverse le lac pour aller rejoindre Amarapoura. Le pont et la berge étaient couverts de monde, et plus d'un curieux, pour mieux voir, n'avait pas craint d'entrer dans l'eau jusqu'à mi-corps.
Des éléphants nous attendaient au débarcadère, mais le major Phayre ayant préféré marcher, nous nous acheminâmes pédestrement entre deux haies de soldats d'assez piètre apparence, tous armés de sabres et de fusils du vieux modèle français. Les réguliers, ou pour mieux dire les quasi-réguliers, ceux qui sont de service dans la capitale, avaient des jaquettes rouges de drap grossier, des ceinturons en étain et de vastes chapeaux à grands bords, en forme de cloche; ces coiffures sont en bambou tressé et recouvert de laque verte ou dorée. Les irréguliers étaient vêtus chacun selon sa fantaisie. De temps en temps apparaissaient sur le second rang des pelotons de cavalerie. Les cavaliers, montés sur de maigres chevaux, armés de courtes lances et de dhas ou cimeterres, faisaient triste figure. Quelques officiers étaient splendides, au point de vue de la parade s'entend. Encastrés entre leurs pommeaux d'or prodigieusement élevés, avec d'immenses quartiers de selle en buffle doré ou couverts de dragons fantastiques, ils faisaient un effet merveilleux. Ce quartier de selle, qui a quelquefois un mètre de diamètre, est certainement ce qu'il y a de plus curieux dans l'accoutrement des cavaliers birmans; c'est peut-être un reste des anciennes armures.
Nous arrivâmes à notre résidence, située à environ trois kilomètres de notre flottille; ce qui n'était rien moins que commode; mais il nous fallut nous résigner. Les précédents règlent tout en Birmanie; le colonel Symes, le capitaine Canning, pendant leur séjour à Amarapoura, avaient demeuré là, ce fut raison suffisante pour nous y loger.
Notre habitation, dont la superficie était d'environ cinq cents mètres carrés, était entourée d'une palissade de bambous. À l'extérieur existaient des abris servant à environ six cents soldats placés là pour nous protéger, ou plutôt pour nous surveiller. Notre demeure, dans le fait, n'était rien autre qu'un large bungalow avec de nombreux pignons et non moins de larmiers, qui, ainsi que nous pûmes bientôt nous en assurer par expérience, laissaient facilement pénétrer l'eau dans les chambres. La charpente était en bois de teck, les murs et planchers en bambou.
(p. 272) Une immense chambre de plus de vingt-cinq mètres de long nous servait de salle à manger: de grands vases de Chine garnis d'arbres artificiels couverts de fleurs et de fruits la décoraient. Ces derniers imitant des mangues, des pêches, des ananas ou autres fruits, étaient bons à manger ou au moins destinés à l'être, car on les remplaçait tous les jours; c'étaient des sucreries ou des pâtes de fruits suspendues aux branches par des fils de fer. Les arbres, assez bien imités d'ailleurs, formaient une décoration agréable.
Le plancher de la salle était couvert de tapis chinois en feutre imprimé; nous avions aussi des tables, des chaises, un punka orné de grandes lanternes chinoises dans lesquelles on mettait tous les soirs de petites bougies indigènes en cire jaune, et qui n'éclairaient guère mieux que des veilleuses.

Types de grands seigneurs et hauts fonctionnaires birmans.—Dessin de Morin d'après H. Yule.
Le long de ce salon régnait une verandah ayant vue sur un grand portique, immense abri circulaire avec un toit conique supporté par un seul mât placé au centre. Sous cet immense parapluie se trouvaient et le théâtre, et les marionnettes, et la musique destinée à nos plaisirs, ou plutôt à ceux de notre garde d'honneur, car ils ne nous causèrent jamais que des insomnies.
Dans notre portique-théâtre et sur la verandah brillaient d'énormes jarres d'argent massif où deux hommes auraient logé sans peine; d'immenses cuillers, aussi en argent, permettaient de se désaltérer avec l'eau qu'elles contenaient: c'était d'un aspect vraiment royal.
Amarapoura, en pali, «la ville immortelle,» n'a aucune prétention à l'antiquité; elle a été fondée par Mentaragyi Phra, fils de ce grand Alompra, qui, vers le milieu du siècle dernier, affranchit la Birmanie du joug des Péguans. D'après le P. San-Germano, Mentaragyi prit possession de son palais le 10 mai 1783. La ville fut abandonnée par son successeur en 1822; cet acte fut considéré comme de mauvais augure; ce fut ce qui amena, disent les Birmans, les désastres de 1824-1826. Les résidences royales, à chaque changement, avaient toujours remonté la rivière, de Prome à Pagán, de Pagán à Panya, de là à Ava, puis à Amarapoura: cet abandon des antiques coutumes amena la mauvaise chance et les revers.
(La suite à la prochaine livraison.)
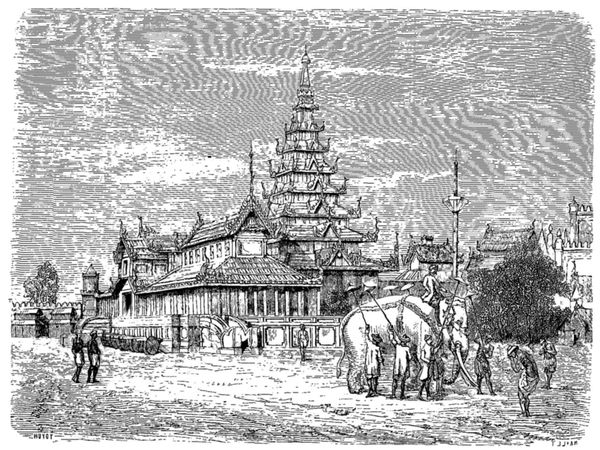
Le palais du roi et l'éléphant blanc.—Dessin de Navlet d'après H. Yule.
PAR LE CAPITAINE HENRI YULE,
DU CORPS DU GÉNIE BENGALAIS[7].
1855
Amarapoura; ses palais, ses temples. — L'éléphant blanc. — Population de la ville. — Recensement suspect.
Amarapoura est bâtie sur un terrain légèrement élevé au-dessus de la rivière et qui, dans la saison des pluies, forme une longue péninsule rattachée à la terre ferme par le nord. Des chaussées revêtues de briques, ou des ponts de bois d'une longueur énorme, la font communiquer avec les rivages est, sud et sud-ouest. Pendant la saison sèche l'Irawadi ne baigne que le faubourg occidental.
La ville proprement dite, placée au point le plus large de la péninsule, a la forme d'un carré dont chaque côté peut avoir seize cents mètres environ; un mur de briques de trois mètres cinquante centimètres à quatre mètres, garni de créneaux et appuyé sur des terrassements, l'entoure de toutes parts. Chacun des côtés du carré a trois portes et de treize à quatorze bastions. À environ trente mètres du mur, un fossé de cinq à six mètres de profondeur, avec une escarpe et une contrescarpe en briques, en défend les approches. Toutes ces défenses sont d'ailleurs de peu d'importance: il n'y a de canons nulle part, et, défendues par les Birmans, toutes ces fortifications n'offriraient pas plus de résistance que des chevaux de frise.
Les rues vont d'une porte à l'autre, et, se coupant à angles droits, divisent la cité en îlots rectangulaires.
Suivant le caractère propre à toutes les vieilles cités des Birmans, et qui se retrouve dans Pégu, Sagaïn, (p. 274) Toungoo, Tavoy, etc., le palais occupe le centre de la ville, et ses murs affectent un parallélisme parfait avec les remparts de la cité. Il y a trois enceintes, et de plus une haute palissade en troncs de teck, à laquelle vient s'ajouter un épais mur de briques. Du côté de l'est, où se trouve l'entrée publique, s'étend une esplanade d'environ cent vingt-cinq mètres, qui se termine par un autre mur en briques avec double porte. Chaque face du palais a une grille, confiée à la garde d'un officier qui, chargé de veiller à la sûreté du roi, prend le titre de commandant de la porte du nord, de la porte du sud, et ainsi de suite.
Après avoir franchi le dernier mur, on se trouve devant le Myé-nan (palais de terre), ainsi nommé à cause de son sol en terre battue: c'est la grande salle des audiences. Construite sur une terrasse en briques recouvertes de plâtre, de quatre-vingts mètres de long sur trois mètres de hauteur, sa façade est couronnée d'un triple pignon, et sur les ailes soutenues par des colonnettes s'étage un double toit; cette construction, tout en bois, est dorée. La salle d'audience a de dix-huit à vingt mètres de profondeur; à son extrémité se trouve le trône; au-dessus du trône, au centre du palais et de la ville, autant qu'aient pu y réussir les géomètres birmans, s'élève un élégant phya-sath (clocher de bois) semblable à ceux des monastères, et sur lequel brille un htee doré, privilége que le roi seul partage avec les établissements religieux. Le phya-sath aussi avait été doré, mais, lors de notre visite, il ne conservait plus de trace de son ancien éclat.
Au nord du palais, se trouve le palais du seigneur éléphant blanc, derrière lequel sont les appartements ordinaires de Sa Seigneurie. Près de sa demeure se trouvent les écuries où l'on renferme les éléphants vulgaires.
L'éléphant blanc actuel occupe sa haute position depuis plus de cinquante ans. Je croirais volontiers que c'est celui dont parle le P. San-Germano, et qui fut pris en 1806, à la grande joie du roi, qui venait de perdre celui qu'il possédait.
C'est un éléphant énorme; il a plus de trois mètres de haut, une tête superbe, des défenses magnifiques. Malheureusement son corps est long, efflanqué, mal fait. Il nous parut dans un mauvais état de santé. Son regard est faux et désagréable, et ses gardiens semblent se méfier de son caractère: ils nous ont toujours conseillé de ne pas nous approcher de sa tête; le petit anneau rougeâtre qui entoure son iris ressemble, dit-on, à un «cercle des neuf pierres précieuses» (talisman). À peu près uniforme, sa couleur rappelle celle des taches que l'on voit sur les oreilles et sur la trompe des éléphants ordinaires; en somme il mérite bien son nom d'éléphant blanc.
Ses paraphernalia royaux, qu'on déploie quand il arrive des visiteurs, sont magnifiques: son driving-hook[8], qui avait environ un mètre, était incrusté de perles dans toute sa longueur; ça et là cerclé de rubis, son manche était de cristal avec des ornements d'or. La tiare, de drap écarlate, ruisselait de gros rubis et de diamants splendides; son front était orné de «cercles des neuf pierres précieuses» qui détournent les mauvaises influences.
Quand il était en grand costume, comme les grands dignitaires birmans, comme le roi lui-même, il portait sur sa tête une plaque d'or où se lisaient tous ses titres, et entre ses yeux resplendissait un croissant de grosses pierres précieuses. À ses oreilles pendaient d'énormes glands d'argent, et il était harnaché de bandes écarlates tissées d'or et de soie et embossées d'or pur.
Il a un fief qui lui appartient en propre, un woon (ministre), quatre ombrelles d'or, et une maison composée de trente personnes. Avant d'entrer dans son palais, les Birmans ôtent leur chaussure.
On annonce souvent la prise d'éléphants blancs; il y a alors grand émoi à la cour; mais la plupart du temps, vérification faite, il se trouve que ce n'est de leur part qu'une prétention à ce titre, au grand regret du roi, qui saluerait la venue d'un véritable éléphant blanc comme la consécration par la nature de ses droits légitimes à la royauté; car il n'est pas sans quelques remords, paraît-il, au sujet de l'usurpation qui l'a placé sur le trône de son frère. En 1831 on avait pris un de ces éléphants suffisamment blanc pour qu'on lui assignât un apanage. Mais le gouvernement étant alors obligé de payer les dernières indemnités de la paix de Yandabo, on fut obligé d'y appliquer les revenus du nouveau Senmeng (seigneur éléphant). Une députation présenta en grande pompe, au pachyderme, une lettre du roi, écrite sur une longue feuille de palmier. Le roi le priait de ne pas s'offenser si on le privait de son revenu pour payer les kalàs (étrangers), et on lui donnait l'assurance que le tout lui serait remboursé avant deux mois.
Je n'ai pu m'assurer si les Birmans intelligents ont conservé leur antique superstition pour les éléphants blancs, ou s'ils ne voient là qu'une sorte d'attribut traditionnel de la royauté; quelque chose comme les chevaux café au lait qui conduisent la reine d'Angleterre quand elle ouvre ou proroge le parlement.
Devant le soubassement de la salle d'audience se trouvent une vingtaine de canons remarquables soit par leur grandeur, soit par leur exécution. J'y remarquai entre autres deux pièces de bronze de 24, que certains détails semblent désigner comme d'origine birmane, et qui font grand honneur à l'intelligence de ce peuple. Quelques pièces de petit calibre imitant des dragons hérissés, la gueule ouverte, les ailes éployées, sont d'un fini remarquable; ces dernières ont, dit-on, été prises aux Siamois.
Un peu plus loin on voit une énorme pièce d'artillerie amenée de l'Aracan, à la fin du dernier siècle, après la conquête de ce pays. Semblable à la Mons-meg d'Édimbourg, elle est formée de barres de fer longitudinales entourées de massifs cercles de fer, très-imparfaitement soudés. Cette pesante machine a environ huit mètres soixante-dix centimètres de long; son diamètre extérieur à la culasse est de quatre-vingts centimètres, mais son calibre n'est que de trente.
(p. 275) Immédiatement à la sortie du palais, on trouve le yoom-dau (maison de ville), et le tara-yoom, chambres de conseil ou de justice; à l'ouest du palais est l'anouk-yoom, où un magistrat spécial juge les délits des femmes du palais; non loin de là aussi est la prison publique: c'est, comme les maisons de la ville, un assemblage de huttes en nattes et de barrières de bambou. Les prisonniers sont obligés de se nourrir, de sorte que ceux qui ne peuvent payer ou attendrir leurs geôliers, meurent de faim. Ils sont très-maltraités. Le roi, il est vrai, a ordonné de nourrir les prisonniers et s'imagine que ses ordres sont exécutés, mais il n'en est rien. Un jour, en sortant de son palais, Sa Majesté avisa un bouffon très-activement occupé à piocher; à la demande du roi sur ce qu'il faisait: «Je cherche, répondit le bouffon, un de ces nombreux ordres qui émanent journellement du palais et du conseil suprême et dont on n'entend jamais plus parler.»
Les rues sont très-larges et assez propres par un temps sec; on n'y rencontre pas de ces mauvaises odeurs si insupportables dans les villes indiennes. Il n'y a cependant aucune police attachée au nettoyage des rues; les chiens sont les seuls êtres qui s'occupent de ce soin. L'écoulement des eaux se fait à la grâce de Dieu; aussi, quand il pleut, la boue arrive à une profondeur impraticable; il est même des quartiers de la ville dont elle interdit l'accès.
Amarapoura ne s'est jamais relevée de l'incendie qui, pendant les guerres civiles de 1831, la consuma complètement, à l'exception toutefois du palais du roi. Aussi la population y est-elle clair-semée; les habitations sont rares; on rencontre souvent de grands espaces déserts.
La plupart des maisons, construites en bambou, sont exhaussées sur des pieux. Le long des rues principales, à quelques pieds des maisons, court un rang de palissades bien faites et blanchies à la chaux; les pieux qui les soutiennent sont couronnés de pots de fleurs, et souvent entre la palissade et la maison fleurissent des arbustes.
Le yaja-mat (palissade du roi) a pour but d'empêcher la foule d'encombrer irrespectueusement le passage du monarque, et même de le voir; car il faut dire qu'en Birmanie «le droit qu'a un chien de regarder un roi» ne semble pas encore bien établi. Ce système de palissades donne une apparence de propreté à la ville; mais comme elles cachent les boutiques et les habitants, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus intéressant pour un étranger, elles jettent par cela même un grand caractère de monotonie sur tout l'ensemble. De fait, quand nous nous rendions au palais en grand apparat, n'eût-ce été de nos éléphants qui nous servaient de monture et nous permettaient de voir derrière les barrières, nous ne nous serions jamais doutés du nombre de personnes, hommes, femmes, enfants, occupés à nous épier.
Aux portes de la ville s'élèvent des corps de garde construits en bois et ouverts de toutes parts. Les portes semblent avoir été taillées au travers des bastions, et n'ont d'autres ornements que de grossières moulures en plâtre; ces bastions, blanchis à la chaux, rompent toutefois la monotonie que la couleur de la brique imprime au reste de la muraille. Au-dessus des portes s'élèvent des pavillons à triples toits pour les entrées principales et à doubles toits pour les autres; de moindres pavillons couvrent les bastions. Dans le passage des portes les plus fréquentées stationne une foule de petits détaillants dont le commerce consiste en sandales, peignes de bois, cuillers, ciseaux, crayons de stéatite, etc. Des échoppes de pareils articles se groupent aux angles des palissades du palais, et à sa principale porte on trouve la plupart des marchands de para-beiks (tablettes noires) et de crayons de stéatite, qui constituent tout le matériel à écrire des Birmans dans leurs transactions ordinaires.
Les demeures des princes, des ministres d'État et autres dignitaires occupent généralement les emplacements tracés par les rues rectangulaires qui divisent la ville. Ces palais, entre autres celui du prince héréditaire, sont vastes, construits en bois et semblables aux monastères, mais d'un style moins orné; leurs doubles et triples toitures (permises seulement à la famille royale) sont recouvertes de tuiles petites et minces. Les autres habitations sont faites de nattes de bambou encadrées de bois de teck, avec des pignons et des larmiers en teck et des toits de chaume. Ça et là, dans de larges espaces sous les remparts, on rencontre les greniers royaux.
On compte, suivant le major Allan, dans l'enceinte des murs, cinq mille trois cent trente-quatre maisons, ce qui donne un chiffre de vingt-six mille six cent soixante-dix âmes; toute la capitale, y compris les faubourgs, contiendrait dix-sept mille six cent cinquante-neuf maisons, qui pourraient fournir une population de quatre-vingt-dix mille âmes. Le woondouk nous apprit un jour que le nombre des habitants s'élevait à dix millions! nombre, suivant lui, fort exact, car il correspondait à celui des pièces d'étoffes distribuées lors de l'avénement du roi à chaque homme, femme et enfant d'Amarapoura; mais, pour nous, ce nombre fabuleux ne pouvait, hélas! que nous donner une idée approximative du chiffre effrayant des pots-de-vin prélevés par les fonctionnaires chargés de la fourniture des étoffes.
Le faubourg de l'ouest, qui couvre la péninsule au delà des murs d'Amarapoura, est de beaucoup le plus peuplé. Les rues y sont percées avec la même régularité que dans la ville, quoique moins larges, et sont animées d'une activité qui augmente à mesure qu'on s'éloigne du foyer royal; les principales sont garnies des mêmes palissades que dans la cité et près du fort; elles constituent le quartier qu'habitent les étrangers. On dit que les natifs ne peuvent, sans l'autorisation du roi, élever des demeures en briques ou pierres; du reste leurs habitudes et leurs préjugés les en éloignent, et comme cette prohibition ne s'étend pas aux étrangers, les quartiers qu'habitent ceux-ci, à l'exception des Chinois, sont en partie construits en briques. Ce sont des maisons à deux étages, assez basses et de médiocre apparence, percées d'étroites fenêtres et sans verandahs. Il n'y a qu'un marchand anglais, demeurant actuellement à Amarapoura, M. Thomas Spears, qui ait toujours su maintenir son crédit auprès des rois qu'il a vus se succéder, en se tenant à l'écart des intrigues (p. 276) locales. Quelques agents des maisons de Rangoun viennent habiter temporairement le quartier des étrangers. Nous vîmes plusieurs aventuriers français pendant notre séjour, mais on ne peut pas les considérer comme établis dans le pays. Nous devons citer particulièrement M. Camaretta, Portugais de Goa, qui demeure dans le pays depuis une trentaine d'années et a été employé par le gouvernement birman sous Tharawadi, père du roi actuel; il fut même nommé en 1839 shabunder (surintendant) du port de Rangoun. Il jouit d'une haute faveur auprès de Mendoon-Men, qu'il a connu enfant, et le poste de confiance qu'il occupe auprès de lui le rend l'objet de l'envie des employés birmans. Il paraît dévoué au roi, et s'il lui cache de désagréables vérités, au moins ne l'abuse-t-il point par de basses flatteries. Il est à cette heure akouk-woon ou receveur des douanes de la capitale, et jouit de l'estime des étrangers. Les Arméniens fréquentaient autrefois en grand nombre la cour birmane; on en compte actuellement une douzaine de familles qui s'occupent de commerce. Ils sont généralement ennemis de l'Angleterre et grands partisans de la Russie; mais on ne saurait dire s'ils sont les émissaires du tzar dans ces régions lointaines. Makertich, l'un d'eux, nous escorta de Maloon à la capitale. Gouverneur du district de Maloon, il remplit aussi le poste de kalâ-woon ou surintendant des étrangers de l'ouest.

Sculptures comiques dans le monastère royal, à Amarapoura.—Dessin de Lancelot.
À quelques exceptions près, les maisons d'Amarapoura ne sont que des huttes. Près de la rivière et là où le terrain est sujet aux inondations, elles sont bâties sur pilotis et s'élèvent au-dessus de l'eau comme les habitations des insulaires malais.
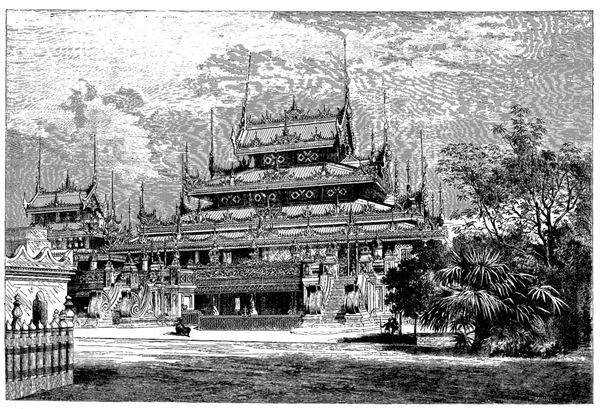
Vue du Maha-Toolut-Boungyot, monastère royal, à Amarapoura.—Dessin de Lancelot d'après H. Yule.
Le bambou est la seule matière employée dans ces constructions. Pilotis, murs, revêtement et poutres, planchers et toitures, chevilles et liens, ustensiles et mobilier, tout est bambou. L'emploi de cette canne défraye (p. 278) toute la fabrication, on pourrait dire toute l'industrie du pays: échafaudages, échelles, jetées et ponts, appareils de pêche, roues d'irrigation et écopes, rames, mâts et vergues, flèches et lances, chapeaux et casques, arcs, cordes et carquois, jarres à huile, jarres à eau, marmites, tuyaux de pipes, tuyaux à eau, boîtes à vêtements, boîtes de luxe, plateaux, instruments de musique, torches, balles, cordages, soufflets, nattes, papier, etc., tout cela n'est de même que bambou.
Le tissage des soies que la Chine importe à l'état grége occupe les bras d'une population nombreuse dans les faubourgs et dans la banlieue de la capitale, particulièrement des Munnipoorians ou Kathé, comme les appellent les Birmans. Cette race descend des infortunés qui furent enlevés de leur pays natal par les Birmans, au temps du roi Mentaragyri et de ses prédécesseurs; elle constitue la majeure partie de la population de la capitale, et se trouve répandue dans presque tous les districts de la Birmanie centrale. C'est une race opprimée; on en peut juger par ce mot que je recueillis de l'un d'eux: «Si un Birman a cinq enfants, on en prend un pour le service du roi; à un Kathé, on les prend tous les cinq!»
À part le bazar des soieries et celui où l'on vend les objets en laque, qui proviennent généralement de Pagán et de Nyoungoo, les magasins de cette capitale offrent peu d'intérêt pour l'étranger.
L'objet le plus remarquable du faubourg du nord est le Ye-nan-dau ou palais d'eau du roi. C'est un monument dans le style monacal, construit en bois, avec une pyasath ou flèche en bois; il s'élève sur pilotis du sein des eaux du lac intérieur. À l'époque de l'inondation il doit être d'un aspect très-pittoresque. C'est là que le roi siégeait jadis pour assister aux courses des bateaux de guerre, mais depuis la perte des provinces du bas Irawady, d'où provenaient les meilleurs rameurs, ces jeux sont tombés en désuétude.
Deux routes conduisent au Maha-myat-muni, le temple de la célèbre idole de bronze qui, en 1784, fut apportée de l'Aracan. Il est à environ trois kilomètres de la ville. Sur les routes qui y conduisent se presse la foule des adorateurs journaliers du dieu; le chemin est bordé sur toute sa longueur de boutiques de vêtements à bon marché, et surtout de marbriers et de fondeurs de cloches à qui les dévots assurent un débit considérable de leurs marchandises.
Une de ces routes est une chaussée remblayée, soigneusement entretenue et garnie de parapets en briques sur toute son étendue. C'est le long de cette chaussée qu'on rencontre les plus splendides modèles de l'architecture birmane et que les artistes de l'Indo-Chine ont déployé toutes les ressources du goût le plus luxueux.
Grâce aux photographies du capitaine Tripe, je puis donner au lecteur une idée assez exacte des plus remarquables d'entre ces constructions, le Maha-Toolut-boungyo (p. 277) et le Maha-comiye-peima (p. 281).
Ces deux monuments ont été construits, l'un par la reine douairière actuelle, l'autre par sa fille, la femme du roi régnant: ils sont modernes, ce qui explique leur parfait état de conservation, malgré la détérioration rapide de ces constructions tout en bois.
Dans leur enceinte sont de nombreux monastères et des chapelles; au centre se trouve un kyoung ou sanctuaire immense d'environ cent mètres de long; le premier et unique étage s'étale en forme de large terrasse sur laquelle les constructions dressent leurs quadruples toits. À partir du balcon, tout est doré; larmiers, balustres et toits sont couverts de sculptures. Mais c'est surtout dans deux petits bâtiments situés près du kyoung central que les artistes birmans ont déployé tout le luxe que pouvait suggérer leur imagination.
Dans le Maha-Toolut-boungyo, le sanctuaire conserve la forme affectée aux monastères, mais il est sculpté comme le serait une châsse d'ivoire, et il ruisselle d'or et de lumière. Les traverses du soubassement sont dorées, aussi bien que les escaliers et les parapets de briques qui conduisent à la terrasse, ce que je n'avais jamais vu.
Les larmiers, découpés en gigantesques couronnes impériales, sont supportés par des dragons fantastiques qui, la tête penchée, semblent ronger les pieux qu'ils enserrent de leurs griffes puissantes, tandis que leur queue se déroule flamboyante: il nous semblait les voir s'agiter.
Les quadruples toits, couverts de zinc, rayonnaient comme s'ils eussent été d'argent, et les murs incrustés de mosaïques, de verre et de dorure, étincelaient comme une mer de lumière couverte d'un filet d'or.
Les échelles même qui servent à monter d'un toit à l'autre pour les réparations quotidiennes étaient couvertes d'or et de verreries.
Le long du soubassement régnaient des sculptures assez originales, offrant les types de différentes races: des Birmans, des Chinois, un Anglais. Ce dernier, avec son chien et son fusil, formait une caricature qui ne manquait pas de vérité. À l'intérieur, on voyait aussi des scènes fort curieuses d'animaux conversant entre eux et nous rappelant les illustrations de La Fontaine par Grandville (voir page 276).
Le Maha-comiye-peima, dont le plan général ressemble à la construction dont nous venons de parler, nous fut annoncé comme plus fastueux encore par les Birmans; nous ne voulûmes pas les croire d'abord, mais il fallut nous rendre à l'évidence.
Dans ce monument, les trois clochers ne sont pas dorés, sans doute par suite des guerres civiles de 1852. Le contraste de l'harmonie éteinte du bois de teck avec les masses d'or produit un effet charmant. Les soubassements, au lieu d'être complètement dorés, sont incrustés de panneaux de laque écarlate, avec des bordures sculptées et dorées. Les piliers se rattachent les uns aux autres par des filigranes d'or en forme de croissant, d'un travail et d'un goût exquis. Les encorbellements qui soutiennent les larmiers des terrasses n'ont pas le style de ceux du Toolut-boungyo; ce sont des hommes à têtes d'animaux: éléphants, taureaux, etc. Ces statues, toutes dans différentes attitudes de danse, sont couvertes de dorures et de mosaïques en glaces et en cristaux.
(p. 279) Le balcon de la balustrade est merveilleux. Ce ne sont pas, comme d'ordinaire, des pilastres en bois tourné ou des panneaux sculptés, mais de larges bandes sculptées, s'enlaçant très-artistement les unes dans les autres; à leurs points de rencontre saillissent des sculptures représentant des êtres appartenant au monde des rêves, qui, si elles laissent à désirer au point de vue de l'exécution, n'en sont pas moins très-mouvementées; le long et au bas de ce balcon règne un larmier d'un goût exquis: il consiste en bandes sculptées qui, rappelant le travail du balcon, s'enroulent autour d'écussons.
Des serpents enlacés, écaillés de verres de couleur, avec des bouquets de fleurs en mosaïques de verre de glace, sortant de leur gueule, forment les rampes des escaliers, qui sont dorés. Les piliers sont couronnés de htees qui sont loin de produire l'effet des couronnes impériales du Toolut-boungyo. Les murs des étages supérieurs sont diaprés et fleuris de mosaïques en cristallerie; les larmiers et le faite des toits sont en bois sculpté d'une main-d'œuvre exquise.
On ne peut regarder ces kyoungs sans un profond sentiment d'étonnement. On se demande comment un peuple qui, au point de vue des instruments de travail, a si peu de ressources, en est arrivé à produire des monuments d'un goût et d'un travail aussi précieux.
L'idole colossale apportée du temple d'Aracan est un Gautama dans sa posture habituelle, c'est-à-dire accroupi sur un raja Palèn. Cette statue a environ trois mètres cinquante centimètres. Sa face est brillante et polie, mais le reste du corps n'a plus forme humaine, recouvert qu'il est d'une épaisse couche d'or en feuilles, don des fidèles.
Audience du roi. — Présents offerts et reçus. — Le prince héritier présomptif et la princesse royale. — Incident diplomatique.
Cependant les jours s'écoulaient, et nous étions entrés dans la mauvaise saison. Il pleuvait à torrents; la pluie pénétrait à flots dans notre résidence. Le tsare-dau-gyi (scribe royal), chargé de la surveillance, se contentait de sourire à nos observations et se remettait à fumer gravement son cigare. On l'avait sans doute choisi à cause de son impassibilité devant toute réclamation. Ce devait être un des membres de cet universel ministère des fins de non-recevoir qu'on retrouve dans tous les pays. Quand M. Edwards s'adressa au woondouk à ce sujet, celui-ci lui répondit en riant, qu'à Rangoun, les Anglais avaient logé l'ambassade birmane dans une résidence jouissant des mêmes avantages. Il ne faisait donc que s'en tenir strictement au précédent que nous avions établi.
Enfin, après d'ennuyeuses discussions d'étiquettes, notre entrevue avec le roi ayant été fixée au 13 septembre, ce jour-là, de grand matin, le Nan-ma-dau-Phra-Woon, le woondouk Moung-Mhon et le tara-thoongyi, grand juge et, de plus, joyeux compagnon, accompagné d'une suite d'officiers, vinrent nous prendre pour nous conduire au palais.
Ils étaient dans leurs robes d'apparat, et si singulièrement travestis que nous eûmes quelque peine à les reconnaître tout d'abord. Leur coiffure, grande mitre de velours écarlate, encerclée à sa base d'une couronne de clinquant, se repliait en arrière sous la forme d'une volute bizarre. Leur robe de même étoffe, à larges manches et brodée de brocart, ressemblait à une lourde chape de prêtre romain. Il est de bon ton, paraît-il, d'avoir la mitre très-serrée sur la tête, à peu près comme les coiffes des bonnets des paysannes normandes; chaque dignitaire avait à la main un instrument en ivoire ressemblant à un couteau à papier, et à l'aide duquel il ramenait son bonnet sur le front tout en repoussant les quelques cheveux qui s'échappaient de dessous sa coiffure. Le tsal-wé, avec le nombre de rangs que comporte le grade de chacun, et une trompe acoustique complétaient ce costume officiel.
Le temps s'était heureusement remis au beau. Les embarcations des navires de guerre, les vêtements rouges de nos soldats, les pavillons et les flammes qui flottaient au vent, les dignitaires birmans dans un canot de guerre tout doré avec leurs cinquante matelots qui ramaient en cadence; le blanc clocher d'Ananda se détachant du milieu de la verdure de magnifiques cotonniers et de palmiers élancés; au loin les montagnes du pays des Shans, étageant les unes sur les autres leurs rampes azurées: tout cet ensemble formait, pendant notre passage du lac, une scène très-belle et très-pittoresque.
En débarquant nous passâmes au milieu de soldats ayant l'air plus ou moins belliqueux; ce qui nous amusa beaucoup fut de voir ces guerriers juchés sur de petits tabourets (il avait beaucoup plu la veille et les rues étaient remplies de boue) et les officiers eux-mêmes accroupis sur des siéges, naturellement plus élevés, et ayant près d'eux leur boîte de bétel, leur crachoir, etc. Je ne remarquai pas un seul bel homme parmi tous ces disciples de Mars. Les femmes regardaient curieusement à travers les interstices des palissades qui garnissent toutes les rues; d'autres membres du beau sexe dominaient dans la foule, d'ailleurs silencieuse; il y en avait beaucoup d'agréables et qui étaient mises avec goût; mais elles ont en général l'aspect très-fatigué et de vilaines bouches. Enfin notre escorte, arrivée à l'entrée du palais, la baïonnette au bout du fusil, s'arrêta et se mit en rang pour nous laisser passer.
Au même instant arriva le cortége de l'héritier présomptif: incident, sans aucun doute, préparé de longue main pour déployer, par occasion, aux yeux des sujets birmans la majesté de leurs souverains. Le prince trônait sur une massive litière dorée, entouré de huit immenses parapluies d'or déployés au-dessus de lui. Aussitôt qu'il fut entré on ferma les portes sur lui; il nous fallut attendre.
Au bout de quelque temps, le woondouk ayant envoyé annoncer notre arrivée, nous entrâmes après nous être débarrassés de nos épées; nous étions obligés d'en passer par là; c'est la stricte étiquette du palais; les gardes du roi peuvent seuls entrer avec des armes, privilége interdit à l'héritier présomptif lui-même.
Les dignitaires, en passant par la porte d'entrée, Ywé-aau-yoo-Taga (la porte royale des élus), ôtèrent leurs chaussures et nous demandèrent inutilement d'en faire (p. 280) autant; puis, à mesure que nous approchâmes de la grille intérieure, ils firent quatre fois le shikho (acte de soumission qui s'exécute en mettant les mains sur le front et en inclinant la tête jusqu'à terre), nous engageant encore à les imiter: second refus de notre part.
Arrivés enfin à la salle d'audience, nous dûmes laisser nos souliers à la porte.
Les longues ailes de cette salle ressemblaient aux transepts d'une cathédrale. Devant nous s'étendait ce que nous pouvions considérer comme le chœur, où, au lieu d'un autel, se trouvait le trône, placé sous la grande flèche aux étages sans nombre qu'on aperçoit de tous les côtés de la ville. Cette espèce de chœur est entouré d'immenses colonnes, dont la base est recouverte de laque et d'ornements rouges. Il y a aussi des rangs de colonnes le long des transepts; à part la base des colonnes, fûts, chapiteaux, panneaux, tout ruisselle de dorures.
Le trône ressemble exactement à ceux qui, dans les temples, supportent les idoles de Gautama. Sa forme singulière rappelle assez deux triangles réunis par leur sommet: ces deux triangles représentent le feu et l'eau qui, dans la cosmogonie bouddhiste, sont les symboles de la destruction et de la régénération. Le mortel privilégié qui siége sur un trône de ce genre représente donc le maître de l'univers: telle est la modeste prétention du souverain d'Ava.
Ce trône, auquel le roi arrive par une porte de treillis doré, est garni de coussins et de carreaux de velours écarlate: c'est une espèce de mosaïque d'or, d'argent et de fragments de glaces. Tout autour se trouvent quelques niches, où l'on voit des statues représentant, dit-on, les progéniteurs de la race humaine, puis cinq bâtons dorés avec des pennons, autres emblèmes royaux.
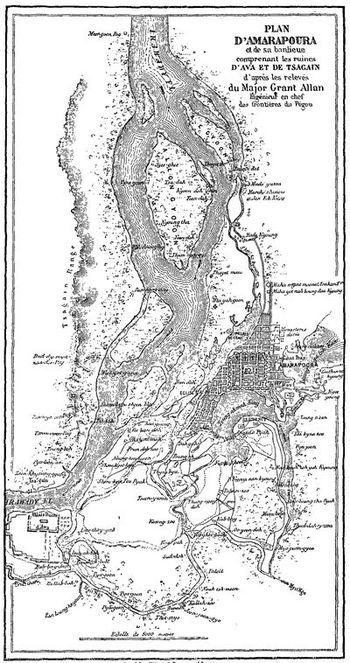
PLAN D'AMARAPOURA et de sa banlieue comprenant les ruines D'AVA ET DE TSAGAIN d'après les relevés du Major Grant Allan Ingénieur en chef des frontières du Pégou.
Nous étions accroupis sur des tapis anglais d'Axminster; le reste de la salle était simplement recouvert de nattes; seulement, plusieurs hauts dignitaires avaient leurs tapis particuliers. Il n'y avait personne devant nous, excepté une double rangée de jeunes princes vêtus de brocart d'or et d'argent et de putso (jupons) éclatants. Il y en avait quatre d'un côté, les fils du roi, cinq de l'autre, les fils de l'héritier de la couronne.
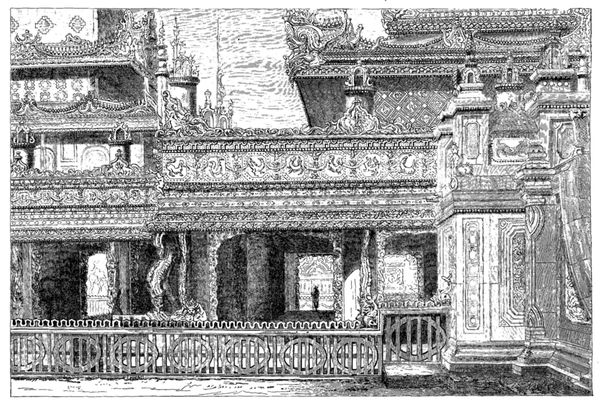
Détails intérieurs du Maha-comye-peyma, à Amarapoura.—Dessin de Navlet d'après H. Yule.
Celui-ci, l'Einshe-men lui-même, assis devant eux sur une espèce de litière sculptée, était vêtu de brocart d'or; sa mitre ressemblait à celle des autres officiers, elle était seulement beaucoup plus riche et couverte de pierreries. Il ne se tourna jamais vers nous, mais l'usage fréquent qu'il faisait d'un miroir témoignait assez de sa curiosité. (p. 282) Devant et autour de nous se trouvaient les ministres et quelques vieux princes du sang, à l'aspect sensuel et aux mâchoires saillantes. Leurs tiares constellées de joyaux et leurs vêtements de pourpre les faisaient ressembler à des abbés mitrés du moyen âge.
Dans les transepts, se tenaient une foule d'officiers inférieurs et plusieurs tsaubwas, princes Shans tributaires; nous fûmes frappés de l'aspect de ces derniers et de leurs manières beaucoup plus distinguées que celles des Birmans.
En s'accroupissant, l'ambassadeur posa la lettre du gouverneur général sur un tabouret doré, recouvert de mousseline. Chacun des officiers avait près de lui une espèce de petite étagère dorée avec des plateaux où se trouvaient du tabac, du bétel, du thé conservé et autres curieux condiments, le tout fort proprement arrangé dans des soucoupes d'or et accompagné de tasses en or et de bouteilles contenant de l'eau musquée.
Nous attendîmes pendant environ vingt minutes l'arrivée du roi; tout ce que nous apercevions nous intéressait au point de nous faire oublier la position incommode où nous nous trouvions faute de siéges.
Enfin un bruit de musique qui semblait venir des cours intérieures annonça l'arrivée de Sa Majesté: un détachement de soldats entra dans la salle d'audience, se plaça dans les entre-colonnements et s'agenouilla, chaque homme tenant son fusil entre les genoux, et ses mains croisées dans l'attitude de la prière.
Nous vîmes, à travers la grille dorée, le roi montant à son trône; il en gravissait lentement les degrés, se servant de son sabre à fourreau d'or comme d'une canne. Nous crûmes d'abord que c'était affaire d'étiquette, mais M. Camaretta nous assura que le vêtement du roi, couvert de pierreries, pesait plus de cinquante kilogrammes. La reine venait immédiatement derrière son époux.
Le roi resta un moment debout; puis, après avoir épousseté les coussins avec son éventail, s'assit à la gauche du trône. La reine se plaça à la droite du roi, un peu en arrière, lui présentant de temps à autre quelques-uns de ces menus objets, de ces articles indispensables à une personne de haut rang: la boîte à bétel, le crachoir d'or, etc. Entre Leurs Majestés s'élevait l'image sacrée d'une oie ou d'un cygne sur un piédestal d'or.
Après s'être servie de son éventail, et avoir éventé son mari, la reine se fit apporter par une de ses suivantes un cigare allumé qu'elle mit aussitôt dans sa royale bouche. Ce n'est pas manquer à l'étiquette, pour un étranger comme pour un sujet, que de fumer devant le souverain.
De la distance à laquelle nous étions du roi, il nous parut d'une taille assez forte. Ses traits, où se reflétait la physionomie nationale, quoique adoucie, indiquaient plus de distinction qu'on n'en trouve d'ordinaire chez ses sujets, et semblaient empreints de bonté et d'intelligence; ses mains étaient remarquables de finesse et de délicatesse. Sa longue tunique de soie claire disparaissait, à la lettre, sous la profusion de joyaux qui la décoraient. Sa coiffure ou couronne avait la forme d'une tiare, semblable à un morion hindou, s'élevant en pointe, terminée par un ornement haut de plusieurs pouces et relevé en forme d'ailes au-dessus de chaque oreille. Le front était orné d'une plaque d'or. Cette couronne s'appelle tharapeo.
Le costume de la reine était beaucoup moins majestueux, ce qui tenait sans doute au caractère de sa coiffure que peu de femmes auraient portée à leur avantage. Imaginez-vous un bonnet ajusté étroitement à la forme de la tête, cachant les cheveux et les oreilles, et se dressant en spirale recourbée en avant, comme la corne du rhinocéros, ou comme certaines volutes pétrifiées des collections minéralogiques, le tout accompagné de deux longues barbes tombant le long des joues. Le reste du costume de Sa Majesté avait quelques points de ressemblance avec celui de l'époque de la reine Élisabeth. Les manches et la taille paraissaient formées d'une série de morceaux d'étoffe tailladée, et le cou était entouré d'une collerette aussi tailladée et descendant jusqu'à la ceinture; au-dessus de la taille le corsage était plastronné de larges pierreries. La robe aussi bien que la coiffure était roide de diamants. La reine est la demi-sœur de son époux, comme l'a toujours voulu la coutume de temps immémorial, parmi les races royales de Birmanie, ainsi que chez celles d'Aracan et du Pégu, au temps de l'indépendance de ces contrées.
Parmi les jeunes filles qui se tenaient en arrière du trône, était la fille du roi, attifée à peu près comme la reine. Une autre charmante petite fille, les cheveux ornés de fleurs et qui regardait à la dérobée les kalàs ou étrangers, était l'enfant de l'héritier présomptif. Une fois le roi entré, nous nous découvrîmes, et au même moment toute l'assemblée des natifs se mit la face contre terre, les mains croisées sur le haut de la tête. Les deux rangées de petits princes agenouillés en file devant nous doublèrent leurs rangs, et les deux atwen-woons qui étaient à nos côtés se traînèrent, prosternés qu'ils étaient, jusqu'à la moitié de la distance qui nous séparait du trône, établissant ainsi un rempart entre le roi et nous.
Une dizaine de brahmanes en étoles et en mitres blanches ornées de feuilles d'or entrèrent alors dans les stalles voisines du trône et commencèrent un chant choral en sanscrit, bientôt suivi d'un chant pareil en birman: ce n'était, à proprement parler, qu'une litanie, ou énumération des dieux hindous, des sages et des créatures saintes dont on invoque la bénédiction et l'intercession en faveur du roi. Les chants terminés, notre ami le tara-thoongyi ou grand juge, qui était à notre gauche, lut au roi une adresse énonçant que les offrandes que Sa Majesté se proposait d'offrir à certaines pagodes de la capitale étaient prêtes, et un des fonctionnaires dit: «Qu'on les dédie!» Sur ce, les chants recommencèrent. Car, aussi bien que la cérémonie du A-beit-theit ou des lustrations solennelles, ils forment un préliminaire indispensable des offrandes aux pagodes qui inaugurent toujours l'ouverture d'une séance royale. La lettre du gouverneur général fut alors retirée de son enveloppe et lue à haute voix par un than-dau-gan ou receveur de (p. 283) la voix royale. Le même fonctionnaire lut également la liste des présents offerts au roi et à la reine. Le modèle de chemin de fer que sir Macdonald Stephenson avait remis à l'ambassadeur, pour cette circonstance, fut le seul des présents exhibé dans la salle, et ne causa pas peu d'intérêt aux Birmans.
Trois questions furent alors, suivant la coutume, faites à l'ambassadeur, comme venant du roi. Sa Majesté ne remua pas les lèvres, bien qu'elle parût intimer sa volonté en inclinant la tête. Ce fut un atwen-woon qui, en se détournant à moitié, demanda:
«Le roi d'Angleterre va-t-il bien?» Puis, sur la réponse affirmative de l'ambassadeur, le than-dau-gan répéta à haute voix: «En raison de la haute et parfaite gloire de Votre Majesté, le roi d'Angleterre est bien, et je souhaite, en toute humilité, qu'il en soit de même de Votre Majesté.»
Puis une série de demandes et de réponses ayant eu lieu entre l'atwen-woon et l'ambassadeur, le than-dau-gan, terrible paraphraseur, les interpréta à peu près de la sorte: «En raison de la haute gloire et excellence de Votre Majesté, il y a cinquante-cinq jours que ces étrangers ont quitté l'Angleterre (le Bengale, avait dit le major Phayre) et ils sont heureusement arrivés à tes pieds d'or et en toute obéissance, etc.
«La pluie et l'air ont été propices sur leur passage, et au delà comme en deçà des frontières ils n'ont trouvé que d'heureuses populations.»
Alors des présents nous furent offerts. Le major Phayre reçut une coupe d'or portant les signes du zodiaque relevés en bosse, un beau rubis, un tsal-wé à neuf rangs et un beau putso, les autres officiers eurent une coupe d'or simple, un anneau, un putso, ou un anneau et un putso seulement.
Enfin le roi, s'appuyant sur la reine, se leva pour partir; ils traversèrent le treillis doré qui formait le fond de la niche royale. La musique joua derechef, les portes se refermèrent, et l'on nous annonça que nous pouvions nous retirer: annonce accueillie avec plaisir, car l'attitude forcée dans laquelle nous siégions et à laquelle maints d'entre nous tentaient de se dérober, nous avait attiré plus d'une fois le visible déplaisir du vieux nanma-dau-woon.
En descendant du palais nous jetâmes un coup d'œil sur les danseurs et les jongleurs qui opéraient dans la cour; ensuite on nous invita à aller voir le seigneur éléphant blanc. Nous le contemplâmes casé dans un vaste appartement situé au nord de la salle d'audience; puis, suivant la même route que dans la matinée, nous arrivâmes à la résidence, quelque peu fatigués, vers les quatre heures.
15 septembre.—Le roi, par l'entremise du woondouk, nous a fait informer qu'il était charmé des présents que nous lui avions apportés, et surtout d'un candélabre en cristal coloré en rouge. Il désirait aussi savoir si quelqu'un d'entre nous pouvait mettre son maître des cérémonies à même de se servir de l'appareil photographique. Le major Phayre, vu les difficultés, suggéra que l'on pourrait envoyer un des familiers de la cour en apprendre la manipulation à Calcutta, ce qui eut lieu plus tard. Mais tous les efforts du capitaine Tripe, l'habile photographe attaché à l'ambassade, n'amenèrent qu'un résultat négatif. Cette incapacité de leurs artistes n'empêchait pas toutefois les Birmans de s'extasier devant les résultats obtenus par le capitaine Tripe, surtout quand il s'agissait de la reproduction de leurs monuments et de leurs monastères, si chargés de riches sculptures.
Leur goût, sous ce rapport, contraste avec l'inhabileté des Hindous à reconnaître même les portraits les plus ressemblants, les dessins aussi bien que les gravures européennes étant pour eux lettre close. Ce trait distinctif de l'aptitude des Indiens et des Birmans ne me paraît pas avoir jamais été signalé.
La coïncidence de notre arrivée avec celle de la pluie avait été fort remarquée, et, à ce propos, le roi fit observer, en daignant sourire, qu'il espérait que nous prolongerions notre séjour, car son royaume avait encore besoin d'eau.
17 septembre.—Ce jour fixé pour notre visite à l'Einshe-men, l'héritier présomptif, nous fournit une occasion de naviguer sur le lac. Accompagnés du woondouk et de quelques officiers, nous le traversâmes pour gagner la porte sud de la cité où nous attendaient des éléphants, ainsi qu'une escorte de quinze hommes de notre cavalerie irrégulière. Aux abords du palais du prince, le plus grand de la ville et le seul qui soit honoré d'un triple toit, se tenait un fort détachement du régiment Madeya, qui nous accompagna et forma la file de chaque côté de notre cortége.
L'ambassadeur fit avancer son tonjon jusqu'à la porte, et nous descendîmes de nos éléphants aussi près que la foule nous le permit; là nous fûmes reçus par un des woons du prince, sur l'avis que le woondouk lui donna de notre arrivée. Ce personnage, homme très-obèse, ne parut pas comprendre, ne répondit rien, et tout en mâchant son bétel se contenta de promener ses regards sur nous. À la fin il dit lentement: «Tous sont-ils arrivés? alors ouvrez la porte.» Les larges portes de bois roulèrent sur leurs gonds et le palais du prince nous apparut: construction immense, modestement ornée dans le style monastique et entourée d'une clôture palissadée. Les sons d'un orchestre nous arrivaient de l'intérieur, et à toutes les fenêtres, sous toutes les verandahs, se pressait une foule de têtes curieuses. Deux petits canons bien montés défendaient l'entrée.
Défilant entre deux lignes de fusiliers en jaquette verte, nous parvînmes à l'entrée de l'escalier où, suivant ce qui était convenu, nous laissâmes nos souliers. Parvenus au sommet, on nous fit d'abord passer le long de verandahs où dansaient des bayadères; puis nous pénétrâmes dans une salle grande, élevée, et si obscure que l'on n'y voyait rien au premier abord, mais nous y discernâmes ensuite une foule parmi laquelle se trouvaient des gens en uniforme armés de sabres à large pointe. Ni or ni couleurs n'ornaient les murs et les piliers de cette salle. Nous nous assîmes sur un tapis au centre, à une (p. 284) dizaine de mètres du mur du fond où se trouvait, à six pieds d'élévation, une porte à panneaux dont les interstices laissaient filtrer une lumière plus brillante.
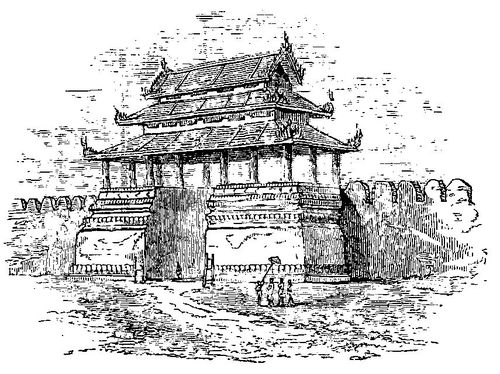
Une porte à Amarapoura.
Le bétel et l'eau à boire furent placés devant nous, et après un quart d'heure, que le silence, l'obscurité et notre position gênante nous firent paraître bien long, la porte glissa et nous laissa voir le prince et sa reine (ainsi qu'on l'appelle) s'asseyant sur le plancher surélevé de l'appartement intérieur, au ras de la porte.
Cette scène, vue d'un premier plan obscur dans la vive lumière de l'appartement intérieur, et encadrée par l'ouverture de la porte au milieu de laquelle ces deux illustres personnages étaient immobiles, nous fit l'effet d'un tableau, et d'un tableau d'un caractère aussi rare que singulier.
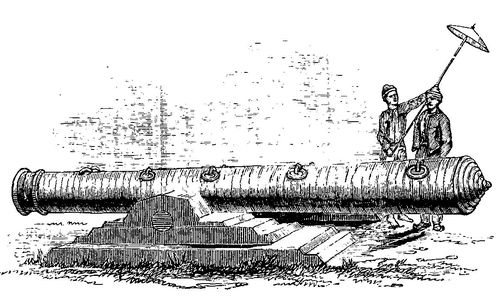
Canon birman.
Le prince, vêtu de brocart, coiffé d'une mitre chargée de joyaux et cachant complétement ses cheveux, nous apparut comme le type mogol le plus accentué, et nous fit une impression bien moins agréable que celle que nous avions gardée de son royal frère.
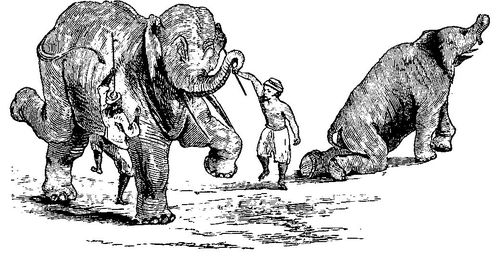
Danse des éléphants.
La princesse, habillée à la mode de sa parente, la grande reine, était coiffée et costumée d'une façon plus avenante que celle-ci. Ses oreilles ornées de joyaux étaient dégagées. C'était une jeune femme gracieuse et modeste, d'une physionomie aimable et intelligente, et qui semblait quelque peu décontenancée et gênée dans les plis encombrants de sa robe. Elle est la demi-sœur de son époux sans être la sœur de la reine.
Un silence de quelques minutes, pendant lequel l'assemblée parut les adorer, suivit leur arrivée, et lorsqu'une attente suffisante pour établir la dignité du prince se fut écoulée, un des woons se permit d'attirer l'attention de Sa Hautesse sur nous, en rampant vers la porte et en relevant la face pour saisir un signe. Le prince ne parut pas le remarquer, mais ensuite il se détourna et fit signe à un officier, plus rapproché de nous, de commencer. Le personnage prit alors sur un siége, où l'ambassadeur l'avait déposée, la liste des présents que le gouverneur général offrait au prince, et lut un discours préliminaire qui informait Sa Hautesse que l'ambassadeur arrivé à la cour apportait des présents pour l'Einshe-men, ajoutant que la reine d'Angleterre les lui offrait respectueusement. Sur quoi le major Phayre se leva et dit à mi-voix au woondouk que le lecteur devait rectifier ce sens de son discours. Après quelque échange de sourdes paroles, l'ambassadeur répéta: «Je quitte la salle si la rectification n'est immédiatement faite.» Alors le woondouk dit au lecteur: «Ce sont des présents royaux d'un roi, et vous ne devez pas vous servir du mot respectueusement.» L'officier rectifia sa phrase.
Pendant cet incident le prince, tout en conservant son immobilité, parut sensiblement ému; la sueur perlait sur son front. Le questionnaire d'étiquette épuisé, les présents distribués, le prince se leva, sa charmante compagne le suivit; les portes se fermèrent et les dérobèrent à notre vue. En somme cette cérémonie, dépourvue de la splendeur barbare de la séance royale, ne nous parut relevée que par la gracieuse apparition de la princesse. En traversant la cour, nous inspectâmes les canons que nous jugeâmes de fabrique européenne, quoi qu'en pût dire le woondouk; puis nous nous arrêtâmes sous un abri où nous attendaient des rafraîchissements auxquels nous fîmes mine de goûter. Là le woon du prince s'excusa du manque de convenance survenu pendant la lecture du discours, incident que l'on devait attribuer uniquement au lecteur habitué à la formule en usage. Le major Phayre, toutefois, exigea du woon la promesse que le pauvre diable serait réprimandé.
(p. 285) Le 20 septembre, je partis avec M. Oldham, qui se dirigeait sur l'Irawady pour visiter les couches de houille qui se trouvent situées à soixante-dix milles de la capitale. Le lendemain, le major Phayre eut avec le roi une entrevue, dont le major a bien voulu me communiquer les détails par écrit.
«Nous fûmes conduits, dit-il, dans la partie ouest du palais, et en approchant d'une allée qui paraissait devoir mener au jardin, je vis une foule de gens assemblés sous un bâtiment circulaire, où il y avait concours de danse et de musique. C'était la cour, et comme le roi était présent, je retirai mes souliers, et m'avançai en compagnie du woondouk, de M. Spears et de deux ou trois officiers birmans. En pénétrant dans l'assemblée, j'aperçus le roi assis sur un sofa exhaussé sur une estrade. On me fit avancer pour me placer parmi les ministres qui se tenaient à quelque distance du roi. Il y avait foule, et tout le monde était accroupi à terre, à l'exception des danseurs. Hors du bâtiment se tenaient les gardes en vestes rouges, avec leurs casques rouges en papier mâché, et leurs fusils, crosse à terre, entre leurs jambes croisées.
«On me fit savoir bientôt que le roi désirait me voir en particulier, et l'on me fit passer dans un autre appartement. Les gardes étaient groupés dans une verandah attenante. En entrant, je vis le roi mi-couché sur un sofa, habillé dans le costume du pays, avec un putso de soie, une ceinture de couleurs éclatantes, et une veste en coton, descendant à la hanche: sa tête était recouverte d'un simple bonnet.
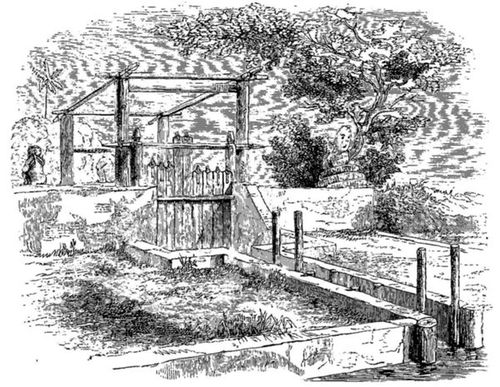
Canal d'irrigation dans le royaume d'Ava.—D'après une gravure de l'édition anglaise.
«À l'autre extrémité de la chambre, on voyait dans un vase une imitation de fleurs de lotus; à la gauche du roi, à quelque distance, une demi-douzaine de ses fils, bambins ou adolescents au-dessous de seize ans, se vautraient sur le tapis.
«Dans l'antichambre, une troupe de musiciens exécutait une douce musique sur des instruments à cordes. En m'asseyant près du vase à lotus, je m'aperçus que j'avais été suivi par un des awten-woons, et par quelques officiers et pages qui se blottirent dans un coin de la chambre, ce qui rendait l'audience aussi peu confidentielle que possible. Dès que nous fûmes assis, le roi leva la main et la musique cessa. Il me dit alors de regarder le vase au lotus, ce que je fis; et alors je vis les boutons s'épanouir et de l'un d'eux un oiseau s'échapper. Le roi sourit et paraissait s'attendre à ma surprise aussi bien qu'à mon admiration, sentiments que je ne manquai pas de manifester. Un de mes voisins me dit que chaque bouton avait contenu un oiseau prisonnier, mais qu'à l'exception de celui-ci, les autres avaient trouvé moyen de s'échapper.
«Alors commença une conversation par demandes et réponses, qui se suivirent, autant qu'il me souvienne, dans l'ordre suivant:
Le roi. Connaissez-vous la littérature birmane?
L'ambassadeur. J'en connais quelques ouvrages, Sire.
Le roi. J'ai entendu parler de vous il y a trois ans. Avez-vous lu le Mengula-Thoot?
L'ambassadeur. Je l'ai lu, Sire.
Le roi. L'avez-vous bien compris?
L'ambassadeur. Je l'espère, l'ayant lu dans une traduction birmane (l'original est en pali).
Le roi. Combien de préceptes contient-il?
L'ambassadeur. Trente-huit.
Le roi. Très-bien; vous les rappelez-vous?
«Et comme le major hésitait et cherchait à excuser (p. 286) son défaut de mémoire, le roi se mit à énumérer l'un après l'autre ces préceptes contre l'orgueil, la colère, les mauvaises pensées, etc., accompagnant le tout de commentaires et citations qui auraient mieux convenu à un prédicateur en chaire qu'à un souverain parlant au représentant d'une grande puissance, puissance voisine et redoutée.»
Religion bouddhique.
Pour bien comprendre l'importance des questions et des sentencieuses paroles adressées en cette occasion par Sa Majesté birmane à l'ambassadeur anglais, il est nécessaire de jeter un coup d'œil sur le bouddhisme, qui forme le fond des croyances religieuses du roi d'Ava et de la presque universalité de ses sujets.
Cette religion, qui compte encore, après vingt-cinq siècles d'existence, de deux cents à trois cents millions de fidèles, est née dans la vallée du Gange, six cents ans avant Jésus-Christ, lorsque Rome avait des rois et que l'Asie occidentale était soumise à Nabuchodonosor.
Gautama (le Bouddha) est un personnage historique, et quelle que soit l'idée de divinité que lui attribuent ses adorateurs, on doit l'admettre comme un grand et patriotique réformateur, qui s'éleva contre les pratiques extérieures des brahmanes, et leur substitua un code de morale plus pure.
Çakya-Mouni, Çakya-Sinha ou Gautama, le fondateur de cette doctrine, était le fils d'un souverain de Kapilawastu, petite principauté sise au nord du Gange, entre Gorakpour et Aoude, et descendant des Suryavas ou enfants du Soleil. Né en l'an 623 avant Jésus-Christ, sa jeunesse se passa dans les plaisirs. À vingt-neuf ans, la réflexion vint lui démontrer la brièveté de la vie humaine et l'illusion de ses joies; aussitôt il abandonna ses palais, ses jardins, son faste et ses plaisirs, son épouse et son enfant, pour adopter la vie de l'ascète mendiant. Pendant six ans, il se soumit à toutes les privations, et alors, après de profondes méditations à un endroit qui s'appelle encore aujourd'hui Bouddha-Gaya, il fut miraculeusement investi des attributs qui le constituèrent Bouddha ou être éclairé. Il consacra le reste de sa vie à parcourir les Indes, expliquant les lois de l'existence, la vertu des actions méritoires, et prêchant comme la fin de toute existence, la béatitude ou l'anéantissement absolu, rendu en sanscrit par le mot nirwana et en birman par celui de nigban. À l'âge de quatre-vingts ans, il mourut entre deux arbres de sâl, dans un bois à Kusinara, cinq cent quarante-trois ans avant Jésus-Christ.
Sans entrer dans l'exposition des diverses phases du bouddhisme, de ses doctrines et des spéculations métaphysiques de ses docteurs, on peut dire que cette religion se caractérise par sa tendance à faire mépriser à l'homme les choses extérieures et à l'inciter à atteindre, par ses propres efforts, par le seul développement de ses facultés morales et intellectuelles, jusqu'à l'état divin du nirwana.
L'existence d'un Être suprême et de sa providence ne paraît pas ressortir clairement et universellement des idées de Çakya et de ses apôtres. Ce qu'il y a de certain, c'est que ni les Birmans ni les Cingalais n'admettent l'Adi-Bouddha ou Être suprême des Népaulais et des anciens bouddhistes théistes de l'Inde.
La récompense et la punition se perpétuent dans la succession des existences qui passent par tous les degrés de la vie animée; c'est là vraiment la clef de voûte du système, bien qu'il n'y ait pas, ce semble, de juge ni de directeur moral. Un destin infaillible et inexorable, qu'on pourrait appeler la force opérante de la nature, régit la destinée ascendante ou descendante de toute créature, suivant le mérite ou le démérite de la série de ses existences passées. Ceux mêmes qui ont atteint le bonheur céleste en voient la fin et doivent recommencer les vicissitudes infinies de la transmigration. Anitya, Dukha, Anatta, le Passager, la Souffrance et l'Irréel, sont les conditions de toute existence, et le vrai bien est d'en être délivré par la conquête du nirwana, état qui peut être l'absorption dans la suprême essence, suivant les bouddhistes déistes, ou, suivant d'autres docteurs, le néant absolu; ce serait, d'après le savant sanscritiste Hodgson, le lieu et le mode dans lesquels vivent les éléments de toutes choses, en leur dernier état d'abstraction et purifiés de toutes les modifications particulières que nos sens et notre intelligence peuvent comprendre.
Le Bouddha est un être qui, dans le passé infini des âges, a conçu le désir d'atteindre ce suprême degré, afin d'acquérir la possibilité de délivrer d'autres créatures des misères de la continuité de l'existence. Il aurait pu atteindre sa liberté, il y a des myriades de siècles; mais son libre arbitre l'en a détourné, l'a entraîné dans le cours des existences successives, et par amour pour ses semblables il a accepté d'innombrables renaissances, enduré des souffrances et des afflictions et subi des épreuves comparables aux efforts qu'il faudrait pour arracher la terre à sa base. À chaque renaissance, son désir s'emploie à ces fins; à sa dernière renaissance dans la famille humaine et sous les signes manifestes de sa haute destinée, il embrasse la vie ascétique, atteint le but suprême et se trouve investi du pouvoir et de la sagesse d'un Bouddha. Alors les mondes innombrables de l'espace, la vue infinie du passé avec celle de toutes ses préexistences, aussi bien que celles des autres êtres, et même les pensées des hommes se dévoilent à la vue. Il est dégagé des passions et des émotions humaines. Il possède l'infaillible sagesse pour diriger les créatures dans les sentiers qui mènent au nirwana; la nature et ses influences, le ciel et ses habitants lui obéissent. Mais il est sujet à la souffrance, à la maladie, et, quand sonne son heure, à la mort; même après avoir acquis la qualité de Bouddha, il souffre jusqu'au trépas les peines terrestres que lui valent ses démérites antérieurs.
La vie normale de ses disciples est l'ascétisme et la mendicité. Ses conditions premières sont, comme dans l'Inde, la continence, la pauvreté, l'humilité; suivent l'abstraction du monde, l'amour de toutes les créatures vivantes, la pratique de certains préceptes moraux, et de nombreuses cérémonies rituelles.
(p. 287) Les ascètes bouddhistes ont droit à l'adoration des laïques. Ce sont de véritables moines, bien qu'ils assument parfois le caractère de prêtre, en accomplissant certaines cérémonies qui passent pour attirer des grâces sur ceux pour lesquels on les accomplit, en pratiquant certains devoirs, comme de lire quelques-uns des livres sacrés au peuple et d'instruire la jeunesse. Toutefois, leur principale affaire est, et a été dès l'origine, de travailler à leur propre rédemption.
La doctrine touchant les laïques est obscure; ils constituent néanmoins le complément nécessaire du système. L'ascète dépend d'eux pour sa subsistance, leur prêche la doctrine, et les reconnaît capables d'atteindre à quelques mérites et de s'élever dans l'échelle de la félicité future. Mais on n'atteint le but final qu'en adoptant la vie monastique.
Le culte des pagodes s'explique difficilement, bien qu'il ait pu prendre naissance à l'origine dans le respect dû aux reliques de Gautama ou de ses apôtres dont elles recueillirent les restes sacrés[9]. Mais à cette heure la pagode elle-même, indépendante de toute relique, semble être l'objet du culte. On offre à la pagode des fleurs, des cierges et des feuilles d'or, et ceux qui font acte d'adoration devant elle acquièrent des mérites qui porteront leurs fruits aussi sûrement que si le Bouddha était présent dans le symbole sacré.
La morale du bouddhisme, plus pure que celle du brahmanisme, a des maximes qui rappellent les préceptes de l'Évangile. En Birmanie, la réputation des moines tend à se maintenir sur un bon pied, et cependant leur système de morale n'influe guère sur le caractère du peuple. Ce qui prédomine, dans le système, est l'appel à la tendresse du cœur, et pourtant il n'y a pas de pays, si ce n'est peut-être la Chine demi-bouddhiste, où la vie soit sacrifiée plus aveuglément, plus cruellement, soit dans l'application des pénalités, soit dans la perpétration des crimes privés.
Visites aux grands fonctionnaires. — Les dames birmanes.
Le 24 septembre, l'ambassadeur accompagné du docteur Forsyth, du major Allan et de M. Edwards, rendit une visite de cérémonie aux quatre woon-gyis et au vieux Moung-Pathea, nan-ma-dau-woon ou contrôleur du palais de la reine mère, et que nous connaissions sous le nom de Dalla-Woon, d'après le poste qu'il occupait en qualité de gouverneur de ce district au commencement de la guerre. Nous voulûmes lui faire honneur en tant que chef de l'ambassade qui était allée à Calcutta, mais aussi à cause de l'estime que nous avions pour lui.
La première course fut pour le magwé-mengyi, le plus considéré des woon-gyis ainsi que le plus intelligent. Il vint à la rencontre de l'ambassadeur jusqu'au bas de l'escalier et l'introduisit dans la salle de réception que l'on avait évidemment décorée à notre intention. Des tapis recouvraient le plancher, et il y avait des chaises disposées autour d'une table qui occupait le centre de la pièce. Un large rideau de soie séparait cette partie de la salle de l'autre qui servait d'appartement aux femmes. Relevé par un de ses coins, ce rideau permettait de voir les dames de la famille accroupies sur des tapis.
Bon nombre de Birmans respectables par leur âge, et bien vêtus, siégeaient ça et là dans la salle et dans la verandah; à l'extérieur, il y avait une foule de gens respectueusement accroupis et qui paraissaient être des voisins que la curiosité avait poussés à assister à l'entrevue.
Peu d'instants après l'arrivée des visiteurs on servit le déjeuner. Deux bandes d'une longue étoffe remplaçaient la nappe; les plats, couteaux, fourchettes, tasses et soucoupes, aussi bien que le thé, étaient servis à l'anglaise, et un Indien, ancien domestique d'un officier, remplissait le rôle de majordome.
D'abord on servit pain et beurre, muffins et tartes; et comme les domestiques en rapportaient, le woon-gyi s'écria plaisamment: «Allons, allons, ils connaissent les mets anglais, qu'on apporte maintenant les mets birmans!» et nous pûmes compter cinquante-sept plats où les sucreries et les friandises les plus variées étaient accumulées à profusion.
À la demande du major Phayre, la femme du woon-gyi, dame d'un certain âge, fut priée de vouloir bien s'asseoir à table avec nous. On plaça une chaise à côté de l'ambassadeur; mais la respectable dame, qui n'avait pas l'aisance de manières de son mari, demanda qu'on l'écartât de la table avant de vouloir s'y asseoir, ce qui ne suffit qu'à demi pour la mettre à l'aise, car elle ne tarda pas à ajuster son vêtement de façon à pouvoir croiser ses jambes sous elle. Elle avait de fort belles bagues ornées de diamants de grand prix.
Le woon-gyi parlait volontiers et avec assez de gaieté, commençant par les questions d'usage chez les Birmans, sur l'âge des personnes présentes, si elles étaient ou non mariées, et il s'étonna fort que l'ambassadeur et le major Allan fussent restés garçons. «Quand vous vous marierez, dit-il, j'espère que vous amènerez vos femmes ici.»
Après le déjeuner, on apporta le dessert, à la birmane, dans une série de plateaux, remplis de petits plats en or et en argent, contenant des noix de bétel, du bétel préparé, du chunam, du thé confit et mariné, du gingembre salé en tranches minces, de l'ail frit, des noisettes dépouillées de leur coque et des noix de terre rôties. Les convives birmans semblèrent se délecter du bétel et du thé mariné plus que de toute autre friandise, et le vieux Camaretta en fit autant. Les cigares terminèrent la fête.
Notre seconde visite officielle fut pour le mein-loung-mengyi, qui emprunte son titre à un district septentrional du royaume. C'est un personnage, approchant de la soixantaine, édenté et d'assez pauvre mine. Sa vieille (p. 288) épouse, de manières plus simples et plus distinguées que lui, fit les honneurs d'un déjeuner à peu près pareil à celui qu'on nous avait servi chez le magwé-mengyi, et de temps à autre elle nous signalait certains plats. Ignorant la coutume de se serrer la main au moment où l'ambassadeur la quittait, elle lui mit amicalement la main sur l'épaule en l'assurant du plaisir que lui avait fait sa visite.
À quelques détails près nos autres visites ressemblèrent aux deux premières. Je dois mentionner seulement le déjeuner que nous offrit le pakhan-mengyi, parce que sa femme y assista, avec ses deux sœurs et sa mère. Leurs manières étaient aussi distinguées que réservées; plus jolies que ne le sont d'ordinaire les Birmanes, elles possédaient réellement la délicatesse et la grâce.

Jeunes dames birmanes.—Dessin de Morin d'après H. Yule.
Elles portaient le tamein national, jupe étroite en soie rayée, des jaquettes en fine mousseline blanche, et des ornements d'un éclat qu'auraient envié des femmes plus civilisées. Leurs cylindres d'oreilles étaient d'or; le cercle en était fermé et serti d'un diamant, rubis ou émeraude, entouré de brillants de moindre grosseur. Le collier était formé d'une étroite chaîne d'or, simple ou ornée de perles fines, et garnie de deux rangs de diamants, l'un fixe et l'autre en pendeloque. À leurs doigts scintillaient des bagues de prix; nous y remarquâmes notamment des rubis de la première grandeur.
Deux des dames présentes se ressemblent singulièrement, et étaient caractérisées par un front fuyant, type de la race d'Alompra. Elles étaient filles de Mekaramen, oncle du roi Tharawadi et que le colonel Burney signale, dans sa relation, comme très-curieux de tout ce qui se rapporte aux sciences européennes.
La vieille mère, femme très-disposée à la conversation, qui avait longtemps vécu à Rangoun et aimait à montrer l'habitude qu'elle avait acquise des manières anglaises, était la veuve de Moung-Shwé-Doung, autrefois le woong ou ministre de la princesse royale, actuellement régnante. Elle se rappelait fort bien Jan-Ken-ning (le major John Canning) pour l'avoir vu à Rangoun.
Parmi ces femmes, on nous en indiqua une d'un aspect charmant et tout féminin, comme étant la femme d'un tsaubwa, ou prince shan, de Monè. Elle était pour le moment dans la capitale «en congé.» Nous eûmes ainsi l'occasion de voir la haute société birmane en famille, et l'impression qu'elle nous laissa fut des plus favorables.
(La fin à la prochaine livraison.)
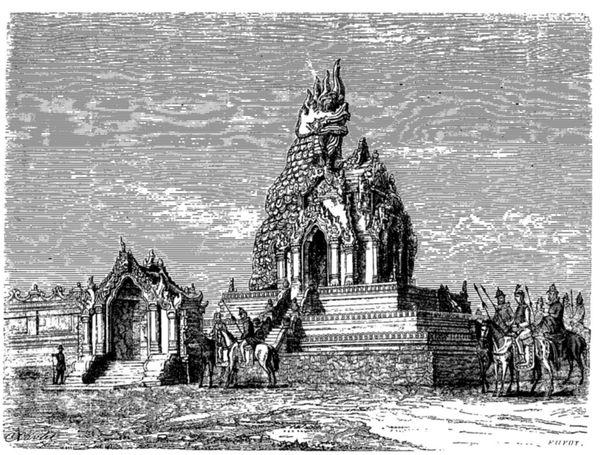
Le temple du Dragon. Dessin de Lancelot d'après H. Yule.
PAR LE CAPITAINE HENRI YULE,
DU CORPS DU GÉNIE BENGALAIS[10].
1855
Comment on dompte les éléphants en Birmanie.
Le 26 septembre, plusieurs d'entre nous allèrent voir dompter des éléphants, spectacle dont les Birmans sont aussi passionnément épris que les Espagnols le sont d'un combat de taureaux.
On a construit dans ce but une arène à l'orient de la ville, sur les bords d'un des lacs. Tout auprès s'élève, à l'usage du roi, un pavillon en bois ordinairement appelé le palais de l'Éléphant.
C'est là une des institutions fondamentales de Birmanie, et on en trouve des descriptions dans les livres des plus anciens voyageurs.
L'arène consiste en un enclos d'environ cent yards de diamètre et entouré d'un mur très-épais de vingt-cinq pieds de haut. À une vingtaine de pieds en dedans de cette première enceinte s'en trouve une seconde, formée de poutres massives, mais espacées de façon à permettre à un homme d'en traverser aisément les intervalles. Au centre de l'enclos s'élève un petit réduit, palissadé de même, destiné aux spectateurs. Le mur extérieur est percé de deux portes; leurs battants sont composés de deux lourdes pièces de charpente verticalement ajustées sur pivot et s'emboîtant, une fois fermées, dans une rainure creusée dans le seuil. Des battants de même nature sont disposés de distance en distance le long des faces (p. 290) parallèles du mur d'enceinte et de la palissade, de manière à former, à un moment donné, du couloir qui se trouve entre deux de ces portes, une cage de vingt pieds de long qui se ferme avec rapidité. Un escalier conduit au haut du mur, qui paraît être la place favorite des spectateurs de tout rang; c'est là que des places avaient été préparées pour les personnes de l'ambassade.
Une fois arrivés, nous vîmes un groupe d'environ deux douzaines d'éléphants femelles, les unes montées par leurs cornacs, les autres libres, réunies en une masse compacte dans la plaine, à quatre cents mètres environ de l'enclos, et gardant avec soin au centre de leur troupe deux éléphants mâles sauvages qu'elles avaient attirés. Ces femelles paraissaient fort bien comprendre leur rôle, et poussaient graduellement leurs victimes du côté de l'arène. Quand elles furent arrivées à l'entrée, une femelle avec son mahout (cornac) passa dans l'intérieur de l'enclos, suivie peu après par le plus grand des deux mâles. On ferma l'entrée et on dirigea le reste de la troupe vers une autre porte. Le nouveau captif était adulte, mais paraissait maigre et faible, suite naturelle d'une abstinence forcée. Il courut autour des palissades pour y chercher une issue; puis paraissant reconnaître le passage qui s'était fermé derrière lui, il s'élança de toutes ses forces contre ses poutres qui servaient de portes et, en s'agenouillant, il s'efforça de les arracher de leurs gonds. Les coups et les cris des gens qui se tenaient derrière la palissade, aussi bien que les aiguillons dont le perçaient ceux qui s'introduisaient entre les poutres, lui firent lâcher prise. Se retournant pour leur donner la chasse, il se précipitait la tête la première contre les poteaux dont les intervalles permettaient à ses persécuteurs de s'esquiver, et, de son choc puissant, ébranlait toute la construction, à la grande joie des spectateurs, mais non sans dommage pour lui-même. Après qu'on eut ainsi longtemps harcelé la pauvre bête pour abattre ses forces et son courage, et dès qu'il eut trahi son épuisement, un des principaux mahouts l'excita à le poursuivre et l'entraîna dans le couloir que formait le passage d'entrée. Les portes se fermèrent aussitôt, l'homme s'échappa au travers des poteaux et l'éléphant se trouva dans une cage qui ne lui permettait pas de se retourner. Alors on commença à lui attacher les jambes de derrière et à lui mettre des liens autour du cou. Afin de l'empêcher de s'en débarrasser, on lui jeta autour de l'oreille un nœud coulant, fait d'une corde de cuir, et dont l'extrémité retombait du côté opposé du cou. Toutes les fois qu'il essayait de saisir le collier avec sa trompe, le premier obstacle qu'il rencontrait était cette corde; en tirant dessus il se blessait, et son attention distraite permettait aux mahouts de continuer à le charger d'entraves. Pendant cette opération, le malheureux éléphant se ruait avec une vaine fureur sur les poteaux qui l'entouraient, les déchirant et les faisant voler en éclats avec ses défenses, labourant la terre et rugissant avec rage.
On lui ajustait un second collier et on le fixait fort et ferme, tandis qu'il était couché, haletant de fatigue: tout à coup il se redressa sur son train de derrière et retomba sur le flanc.... Il était mort!
On employa une autre méthode pour réduire le second éléphant, animal de moindre taille. À un signal donné, il fut abandonné par les femelles qui l'entouraient, et neuf ou dix mâles lui donnèrent la chasse, montés par des mahouts armés de lazzos en cuir. On parvint à lui en lier un à une de ses jambes de derrière, et on en fixa solidement les extrémités à un pieu fiché en terre. Il fut ainsi réduit au parcours d'un cercle d'environ quarante yards (trente mètres) de rayon. Les vieux éléphants commencèrent à l'assaillir, le chargeant à coups de trompe, le poussant et se le renvoyant jusqu'à ce que la fatigue commençât à le gagner. Deux éléphants l'entourèrent alors, leurs mahouts lui ajustèrent des liens autour du cou et le menèrent sous un abri où il fut attaché à des piquets pour y rester jusqu'à ce que le régime de la ration congrue lui fit comprendre la nécessité de l'obéissance.
Quelques jours plus tard, on nous amena, à la résidence, deux éléphants danseurs qui nous divertirent grandement. Un d'eux, jeune sujet de six pieds de haut, n'avait qu'une instruction incomplète; son art consistait à lever successivement ses jambes, au commandement de son mahout, et à marcher sur ses genoux, ou pour mieux dire sur les paturons de ses jambes de devant. À l'ordre qu'on lui donna de marcher comme les dames d'honneur du palais, il s'avança vers nous avec ses seules jambes de devant, traînant derrière lui celles de derrière (p. 284).
Le plus âgé, un vieux mâle, était plus versé dans son art. Son mahout lui hurlait à l'oreille des ordres auxquels l'éléphant répondait par un grognement d'assentiment d'un effet assez comique. Son pas le plus brillant consistait à lever une patte et à lui faire décrire un cercle avant de la remettre à terre. Les efforts des mahouts n'étaient pas ce qu'il y avait de moins divertissant; leurs danses, leurs cris, leurs encouragements, leurs applaudissements contrastaient plaisamment avec la maladresse de leur élève. À la fin il commença à remuer alternativement ses quatre pattes et à les jeter tantôt à droite, tantôt à gauche; la gravité de sa tête et de ses yeux, l'étrangeté de ses lourds mouvements complétaient le spectacle, qui eut un grand succès de rire parmi tous les assistants, Anglais, Bengalais et Birmans.
Excursions autour d'Amarapoura.
Pendant que le major Phayre, avec une patience ultra-diplomatique, et dans le désir d'atteindre enfin le but réel de sa mission, la conclusion d'un traité d'alliance et de commerce, se pliait complaisamment aux excentricités de la cuisine des Woongyis, et, ce qui était bien autrement méritoire, aux incessants examens métaphysico-religieux que lui faisait subir le roi, j'exécutai plusieurs excursions autour de la capitale, en compagnie de notre géologue, le docteur Oldman, que les Birmans qualifiaient du titre pompeux de professeur des roches. La première, dirigée au nord, nous conduisit successivement à Mengoun, sur la rive droite du fleuve, à Madeya, localité importante de la rive gauche, aux carrières de marbre blanc de Tsengo-myo, puis aux cavernes ou (p. 291) grottes de Malé, et enfin à la ville de Tsampenago, chef-lieu d'un canton fertile, borné à l'orient par la belle rangée de collines qui sépare l'Irawady du district des mines de rubis. De là nous redescendîmes le grand fleuve jusqu'au confluent du Myit-Nge, et pûmes contempler encore une fois, du haut d'un pic que nous évaluâmes à environ dix-sept cents pieds, le magnifique panorama qu'arrose cette petite et sinueuse rivière à son débouché dans les vastes plaines où dorment, au milieu de la plus épaisse verdure, Sagaïn et Ava, les vieilles capitales abandonnées.
Cette exploration permit au docteur de dresser une carte géologique de toute la section du bassin de l'Irawady comprise entre les 22e et 23e parallèles, et de recueillir, sur ces contrées, étudiées scientifiquement pour la première fois, des observations auxquelles mes lecteurs me sauront gré, à coup sûr, de faire quelques emprunts.
Mengoun, qui fut notre première étape, à seize kilomètres d'Amarapoura, porte dans le pays le surnom caractéristique de folie du roi Mentaragyi. Cet aïeul du roi actuel employa les trois derniers quarts d'un règne de quarante ans, les sueurs et les bras non rétribués de milliers de ses sujets, et des sommes incalculables, à entasser les unes sur les autres, jusqu'à une hauteur de cinq cents pieds, des masses énormes de briques et de mortiers: Pélion sur Ossa! On prétend qu'une prédiction avait lié la fin de sa vie avec celle de son œuvre architecturale; mais il laissa celle-ci inachevée, et vingt ans après lui, le terrible tremblement de terre de 1839 fit de son temple de Mengoun la montagne de débris que la photographie nous a permis de reproduire fidèlement (p. 203).
Vis-à-vis de ce témoignage du néant de l'homme et de ses œuvres, une pagode en miniature, proprette et sans félure, bien plus ancienne que le géant écroulé, rappelle involontairement l'apologue du chêne et du roseau.
Géologie de la vallée de l'Irawady. — Les poissons familiers. Le serpent hamadryade[11].
«La formation géologique du pays arrosé par l'Irawady est assez simple. Depuis le delta de la rivière, jusque dans le voisinage de la vieille capitale d'Ava, le cours de la rivière ne présente que des roches de formation tertiaire. Tantôt l'Irawady s'écoule dans des gorges formées par ces roches, comme au-dessus de Prome; tantôt le courant traverse des plaines étendues qui semblent desséchées comme des lits d'anciens lacs. La direction générale de ces roches suit le cours de ce fleuve, bien qu'en certains endroits leurs strates aient fait obstacle au courant, qui a dû percer des couches assez épaisses d'argile bleuâtre, entre des grès durs, et se faire un lit encaissé, comme on le voit au-dessus de Prome.
«Si tel est le caractère général du sol, il faut remarquer pourtant que les couches sont souvent disloquées, contournées et brisées.
«Appuyée sur les crêtes de ces couches bouleversées se trouve une série de strates de grès et de conglomérats, moins consolidées que les précédentes, mais aussi moins contournées. Souvent sablonneuses, quelquefois calcaires, ces strates sont chargées de fer introduit par voie de filtration. Ou y rencontre aussi d'innombrables ossements fossiles de mastodontes, d'éléphants, de rhinocéros, de tapirs, à cerfs, et de tortues.
«On peut fixer l'âge géologique des terrains les plus anciens à l'époque éocène. Les terrains modernes, par leur analogie et l'identité de leurs fossiles, paraissent devoir se rapporter à l'époque miocène.
«Près de la capitale, on rencontre des chaînes de roches métamorphiques et cristallines dans une direction nord et sud, et formant une série de collines distinctes. Il est à présumer qu'elles sont antérieures à la formation des couches tertiaires qui les entourent. Après s'être déposées, ces couches ont été bouleversées par des éruptions volcaniques qui, ayant brisé les roches anciennes, les ont sillonnées, par intervalles, de longues dykes, et ailleurs les ont recouvertes de leurs matières en fusion. Rien n'indique que ces formations trappéennes soient antérieures aux couches que l'on peut attribuer à l'époque miocène. Elles doivent sans doute leur origine aux mêmes forces souterraines qui, de nos jours, couvent et grondent encore sous le sol birman, qu'elles ébranlent de fois à autres, et qui en 1839 notamment, secouèrent, comme des gerbes de blé mûr, les gigantesques pagodes de Pagán et de Mengoun. Le même laboratoire incandescent d'où jaillirent, dans les anciens âges, les étincelants rubis du district de Momeit et les pépites d'or que roulent tous les cours d'eau de la Birmanie, entretient ces vastes réservoirs d'huile minérale qui font aujourd'hui la principale richesse du bassin de l'Irawady et ces volcans de vase bouillante qui chaque jour hérissent de cônes nouveaux la plaine de Membo (p. 301).
«En redescendant le fleuve, je fus témoin d'un incident qui m'étonna, je le confesse, plus que tout ce que j'avais pu voir encore dans cet étrange pays.
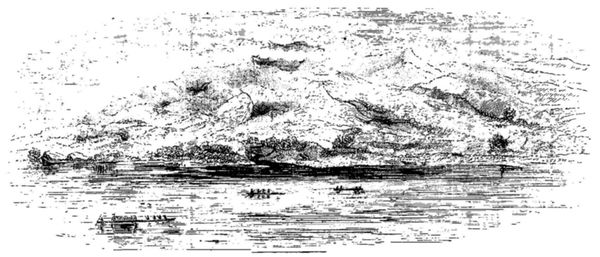
Rives de l'Irawady, près des mines de rubis.—D'après H. Yule.
«Arrivé à la proximité d'une petite île qui partageait le cours du fleuve, le pilote se mit à pousser de toutes ses forces le cri tet! tet! tet! tet! et comme je lui en demandai la signification, il me répondit tranquillement qu'il appelait les poissons. Effectivement je ne tardai pas à voir bouillonner l'eau sur les deux côtés du bateau, puis surgir à la surface une masse serrée de gros poissons au nez blanc, ressemblant, par la forme de la tête du moins, au chien de mer, et dont plusieurs atteignaient trois et quatre pieds de longueur. J'en comptai plus de quarante autour du bateau, dressant presque verticalement hors de leur élément une moitié au moins de leur corps, et tenant leur bouche aussi ouverte que possible. Les gens du bateau, prélevant des poignées de riz dans les plats préparés pour leur propre dîner, s'empressèrent de les présenter à ces hôtes singuliers, et chaque poisson, dès qu'il avait reçu sa portion, plongeait pour l'avaler, puis se hâtait de reparaître le long du bord. Les bateliers continuaient leur incessant tet! tet! tet! et se penchant par-dessus le plat-bord, caressaient de la main le dos de ces heureux poissons, absolument comme on (p. 292) fait à des chiens favoris. Cette scène se prolongea pendant une bonne demi-heure de navigation, et le seul effet produit par le contact des mains des bateliers sur leurs aquatiques convives, me parut être une surexcitation d'appétit et de familiarité. On me dit que, durant le mois de mars, il y a dans ces parages une grande fête et un grand concours de gens. Chacun s'efforce alors de capturer un poisson, non pour en faire une friture ou une matelote, mais pour lui rendre la liberté dès qu'on lui a décoré le dos d'une couche bien appliquée de feuilles d'or, ni plus ni moins que si c'était une idole. En effet, je remarquai sur plusieurs poissons des traces de dorure. Jamais spectacle ne m'a autant amusé et intéressé que celui-là. J'aurais bien désiré enrichir ma collection ichthyologique d'au moins un spécimen de ces hôtes privilégiés du fleuve. Mais au premier mot hasardé à ce sujet, tous les assistants, saisis d'horreur, crièrent au sacrilége, et je crus prudent de me tenir coi et muet sur ce point.
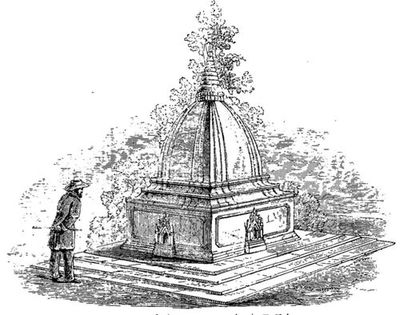
Petite pagode à Mengoun.—D'après H. Yule.
«... Le lendemain, comme je revenais de visiter un gisement de houille peu éloigné du fleuve, j'aperçus en travers du sentier un grand serpent de l'espèce des hamadryades (genre naja). Un homme de ma suite, porteur d'un fusil à deux coups, se disposait à faire feu sur la bête, quand tous ses camarades l'arrêtèrent par un concert de gestes et de cris. Le serpent, mis en éveil par le bruit, leva la tête, nous regarda un instant, puis s'évada sain et sauf. Je demandai avec assez d'impatience au chasseur pourquoi il n'avait pas tiré sur ce reptile; la réponse me frappa, comme venant à l'appui d'un fait avancé par le naturaliste Mason dans son livre sur Tenasserim[12]; fait que j'avais jusque-là révoqué en doute. Mes gens affirmèrent que si le serpent avait été blessé, (p. 294) il nous aurait fait face et nous aurait poursuivis; qu'il valait donc mieux l'avoir laissé aller paisiblement. L'animal avait bien trois mètres de longueur.»
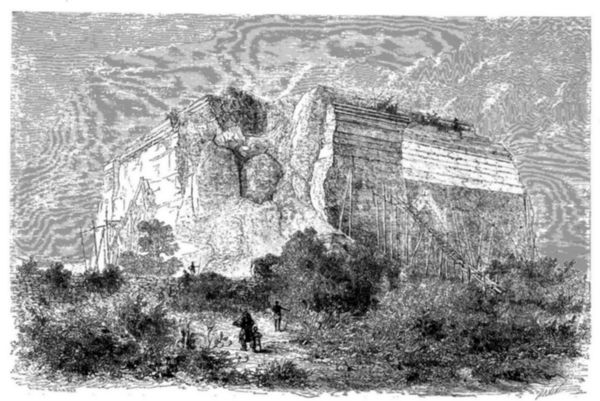
Grand temple de Mengoun, depuis le tremblement de terre de 1839.—Dessin de K. Girardet d'après H. Yule.
Les Shans et autres peuples indigènes du royaume d'Ava.
Ma seconde excursion fut dirigée au sud-est de la capitale, sur la frontière des petits États shans, tributaires d'Ava.
Les Shans ou Tais, comme ils se nomment eux-mêmes sont, de toutes les races indo-chinoises, la plus répandue et probablement la plus nombreuse. Entourant les Birmans du nord-ouest au sud-est, ils forment un chaînon continu depuis les confins du Munnipour (si tant est que les habitants de cette vallée ne soient pas de la même race) jusqu'au cœur du Yunan, et depuis la vallée d'Assam jusqu'à Bankok et à Cambodje. Partout ils professent le bouddhisme, partout ils ont atteint à un degré de civilisation assez élevé, et partout ils parlent une même langue sans grandes variantes, circonstance remarquable au milieu de cette diversité d'idiomes que l'on trouve parmi tant d'autres tribus, en dépit du voisinage et de la parenté. Cette identité caractéristique dans la langue des Shans, tendrait à prouver qu'il y a longtemps qu'ils ont atteint le degré de civilisation où ils sont arrivés, et que jadis ils ont dû constituer un peuple homogène, avant leur dispersion.
Les traditions siamoises, aussi bien que celles des Shans septentrionaux, ont gardé le souvenir d'un ancien royaume considérable fondé par leur race, au nord du présent empire birman, et le nom de «Grands-Tais» appliqué au peuple de ces pays vient corroborer la tradition. Des germes de désunion ont dû briser l'unité de cette race, la fractionner en petites principautés, et le royaume de Siam renferme peut-être, à cette heure, le seul État indépendant de cette famille. Tous les autres sont tributaires d'Ava, de la Chine, de la Cochinchine ou de Siam.
Les États, dont je parlerai sommairement, occupent une étendue de terrain que l'on peut comprendre en masse entre le quatre-vingt-dix-septième et le cent unième méridien, le vingt-quatrième et le vingtième degré de latitude. Ce territoire se termine à l'ouest par la chaîne qui forme la frontière orientale de la Birmanie pure. À l'est, il est borné par le Mekhong ou grande rivière de Cambodje; au nord, par la vice-royauté de Yunan: il comprend les Koshanpris ou neuf États shans qui, successivement, ont passé sous la domination des Chinois et des Birmans, et qui maintenant appartiennent aux premiers. Au sud, il joint, pendant quelque distance, le territoire des Karens rouges, et, à partir de là, le Mekhong forme la frontière des principautés tributaires de Siam.
La suzeraineté des Birmans est plus ou moins reconnue dans ces pays; dans les États contigus à la Birmanie propre, c'est une réalité active et tyrannique; vers l'est elle tend à se relâcher, et vers l'extrême orient et le nord-est, bien que ces États payent hommage à Ava, l'influence chinoise prédomine.
Toutes ces contrées sont sillonnées de chaînes de montagnes, dont la direction est nord et sud, comme celles des principales rivières, le Salouen et le Mekhong. Le Menam, ou rivière de Siam, prend sa source dans ces régions. Le caractère général de ces fleuves est torrentiel; ils sont profondément encaissés et sujets aux débordements.
Les montagnes sont habitées par des tribus plus ou moins sauvages et connues sous plusieurs dénominations. La plus considérable, peut-être, est celle des Laouos, que les Shans considèrent comme les restes sauvages des anciens aborigènes. On prétend que leur langue ne ressemble aucunement à celle des Shans. Quelque barbares qu'on les dise, ils paraissent adonnés à l'agriculture, soignant fort bien l'indigo, la canne à sucre et le coton, que leur achètent les marchands chinois du Kiang-hung, du Kiang-tung et des États limitrophes. Ils travaillent le fer, sont bons forgerons, et fabriquent des dhas ou sabres et des fusils à mèches. Ils sont de taille médiocre, mal bâtis et laids; ils ont le nez plat, le front bas et le ventre gros. Ces caractères feraient penser que les Laouos ne sont que le type dégénéré de la race des Shans, telle qu'elle existait avant d'avoir été modifiée par l'action de la civilisation bouddhiste. Les tribus les plus considérables, les plus sauvages et les plus indépendantes de ces Laouos, se trouvent dans la partie nord et ouest de Muang-Lem. Ils ne permettent à personne de pénétrer chez eux; et on dit qu'ils guettent, saisissent et décapitent les voyageurs, pour emporter leurs têtes en manière de trophées, comme font les Garows, les Kookis et autres sauvages, voisins de notre frontière du Sylhet.
La contrée habitée par les Karen-nis ou Karens rouges, qui se sont maintenus indépendants des Birmans et des Shans, comprend cette masse montagneuse qui sépare le Sitang du Salouen et s'étend entre la latitude de Toungoo et le vingtième degré trente minutes. On les croit de race shanne; cependant il ne m'a guère été possible de trouver d'autres preuves de cette parenté, que l'usage qu'ils font de la braie pour vêtement. On attribue leur dénomination de rouges à leur teint, qui, étant naturellement clair, rougit plus qu'il ne brunit à l'action du hâle; mais je crois que la couleur de leurs pantalons (p. 295) rouges est pour beaucoup dans ce surnom, les Shans portant le pantalon bleu.
Le nom que se donnent les Karen-nis est Koyas, et les Shans les appellent Niangs. Leur tradition veut qu'ils soient les descendants d'un corps d'armée chinois qui s'endormit et que l'armée laissa derrière elle dans une retraite. Il est singulier que les Kyens de Yoma-doung aient la même tradition sur leur origine, à la différence, toutefois, que l'armée était birmane et non chinoise.
Les Karens rouges sont de petite taille, avec des jambes grêles et de gros ventres; leur malpropreté est notoire. Ils vivent dans un état de société qui n'est cependant pas la sauvagerie, et bien des Shans se sont établis sur leur territoire, trouvant leur régime social plus doux que celui des Birmans. Leurs seuls actes religieux consistent à apaiser les esprits malins qui frappent de maladie, et les sacrifices qu'ils leur font sont considérables. Ils se servent, dans leurs transactions commerciales, d'une monnaie d'argent assez grossière et des poids en usage en Birmanie; leur agriculture est remarquable sous plus d'un rapport.
Tout leur pays est montagneux, et dans la partie sud de leur district il y a des pics de deux mille cinq cents mètres d'élévation. Leurs villages sont généralement situés sur des collines arrondies ou planes. La population est considérable. Dans une partie de leur pays, entre le Salouen et le Me-pon, on voit les cultures s'étendre jusqu'au sommet des coteaux, les vallées se dérouler en terrasses à la mode chinoise, les routes sillonner le pays, et les villages nombreux à ce point que d'un coup d'œil on peut en embrasser huit ou dix. Leur plus fort village est Ngouè-doung, dont les habitants sont en majeure partie des Shans fugitifs.
Ces Karens rouges sont la terreur des districts avoisinants de la Birmanie, où ils vont faire des razzias et enlever les habitants, qu'ils échangent comme esclaves contre des buffles et des bœufs chez les Shans siamois. Ce sont aussi les receleurs des esclaves que font entre elles les petites communautés karennes sur les frontières du côté de Toungoo. Les villes voisines leur payent redevance pour se garantir de leurs incursions, qui s'étendent assez loin pour forcer les habitants de Nyoung-Ynoué, à trente-deux kilomètres de leurs frontières, à se tenir constamment en garde contre eux.
Les principautés shannes peuvent être divisées en cis-salouennes et trans-salouennes. Le premier des États cis-salouens, en quittant le pays des Karen-ni, qui forme sa frontière sud, est celui de Mobyé.
Ce petit État, dans le voisinage des Karens rouges, a été tellement dévasté par eux, qu'il ne reste plus au tsauboua ou prince, que l'espace compris dans les murs de sa ville. À la fin, n'ayant pu obtenir de secours de son suzerain d'Ava, il cessa de lui payer tribut et transféra son allégeance à ses redoutables voisins.
Puis vient l'État de Mokmé ou Moung-mé, à cinq jours de marche de Moyé et à trois jours de la frontière des Karen-ni; il est tellement harassé par les razzias des Karens rouges, que tous les chefs de villages leur payent redevance. La ville de Mokmé peut contenir trois cent cinquante maisons.
À deux jours de marche nord de Mokmé se trouve la capitale de l'État de Moné, qui est le centre du gouvernement des Birmans sur les principautés shannes; aussi les Birmans y sont nombreux. Le territoire est assez étendu au delà du Salouen. La ville, qui est située à cinq cents mètres au-dessus du niveau de la mer, est la plus grande de toutes les cités shannes; elle peut contenir huit mille âmes. Elle est bâtie au pied des collines qui bordent la fertile vallée de Nam-toueen, tributaire du Me-pon. À cinquante-six kilomètres nord-ouest de Moné se trouve le Nyoung-Ynoué. C'est le plus occidental de tous ces États et ce fut jadis un des plus grands et des plus importants. Mais les déprédations des Karens rouges, la tyrannie des Birmans, les dissensions intérieures ont tellement réduit la puissance de son tsauboua, qu'elle ne s'étend guère que sur une centaine de familles.
La ville ne contient pas plus de cent cinquante maisons. Elle est située dans un bassin d'alluvion assez étendu et se trouve à cinq cent cinquante mètres au-dessus de la mer. L'ensemble de ce bassin paraît avoir été le lit d'un lac assez semblable à la vallée de Munnipour; il en reste des traces dans le centre de ce terrain, où se trouve un petit lac de vingt-deux kilomètres d'étendue, peu profond, et qui tend à se dessécher graduellement.
Bien que le nombre des habitations soit fort réduit sur le territoire du tsauboua, cependant la population de la vallée est considérable et paye un tribut direct à la cour d'Ava. On y cultive principalement le riz, la canne à sucre, le maïs, etc.
C'est dans ce district que se trouve le lac Nyoung-Ynoué, à la surface duquel flottent d'innombrables îles naturelles, formées de racines de roseaux et d'herbes entremêlées et recouvertes d'un peu de terre. Elles servent de bateaux de pêche; on y construit même des chaumières: elles tremblent sous les pieds, et, par un temps d'orage, tournent à tout vent; il y en a d'assez grandes pour qu'on y voie trois à quatre chaumières. Une énorme vieille femme, qui habitait un de ces îlots, où nous descendîmes pour déjeuner, s'amusa beaucoup de la peur que manifestait un homme de notre suite en mettant le pied sur ce sol mouvant.
Les tsaubouas de toutes ces petites principautés, même quand ils sont dans la dépendance la plus absolue de la Birmanie, tranchent de la royauté; ils épousent leurs demi-sœurs, ils ont, comme le Phra d'Ava, leur Einshe-men, leurs Atwen-woons, Thandaut-ens, Nakhan-gyis, etc. Leurs palais ont le triple toit, le htee sacré et le parasol blanc; en un mot, tous les insignes de la royauté.
Le pouvoir que les Birmans exercent sur ces principicules est en raison de la distance; les plus voisins du centre du royaume sont tyranniquement opprimés; les tributs qu'envoie le Kiang-hung, situé sur les frontières de Chine, est une simple affaire de forme. Les contingents que tous ces tributaires réunis doivent aux Birmans en temps de guerre, peuvent s'élever à vingt mille hommes.
Il est à remarquer que tous les voyageurs s'accordent (p. 296) à mentionner quel sentiment amer tous les Shans tributaires nourrissent contre les Birmans, et à signaler les éloges exagérés qu'ils donnent à la justice, à la modération et à la bonne foi des Chinois.
Ne pourrait-on pas appliquer à cette double appréciation la moralité d'un apologue bien connu:
Notre ennemi, c'est notre maître.
Les femmes chez les Birmans et chez les Karens.
Une des plus brillantes pages de l'histoire des missions modernes est celle qui raconte leurs succès chez les Karens du pays birman. Plus de cent mille membres de ces tribus éparses ont, depuis une trentaine d'années, été amenés à la connaissance de l'Évangile, et actuellement on compte dans leurs rangs environ vingt mille communiants, dont la foi naïve et simple, mais inébranlable, fait l'admiration des voyageurs chrétiens qui ont pu parcourir le pays. Ces faits sont connus, grâce surtout à une dame des États-Unis, à qui ses travaux missionnaires parmi les Karens de la Birmanie ont acquis une juste célébrité.
«Environ trente-cinq mille femmes karennes», dit Mme Mason, ont, nous en avons la douce espérance, renoncé à leurs superstitions pour embrasser la doctrine du Christ; mais parmi les Birmans on en trouverait tout au plus un millier qui aient subi l'influence de l'Évangile, et cependant la longue expérience que j'ai des mœurs du pays me donne la conviction que le pays birman ne pourra efficacement être entraîné dans les voies de la conversion que lorsque les femmes y seront entrées.
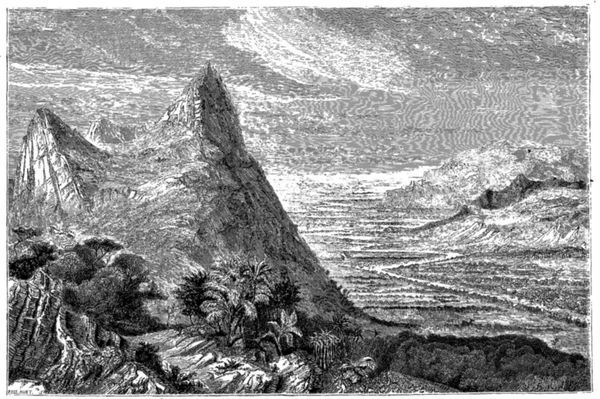
Vallée l'Irawady au confluent du Myit-Nge (voy. p. 291).—Dessin de Paul Puet d'après H. Yule.
«Ici, la femme ne ressemble en rien à ces créatures (p. 298) douces, timides et indolentes qui se renferment dans les zènanahs de l'Inde, tremblant à la voix ou sous le regard du maître, et n'exerçant sur ses déterminations aucune espèce d'empire. La femme birmane jouit au contraire d'une influence immense. Aux charmes de sa personne, elle unit en général l'énergie de la volonté, et c'est elle, en réalité, qui donne aux mœurs du pays leurs caractères les plus distinctifs. Il suffit d'un désir exprimé par la femme d'un chef de village, pour que le fier montagnard aille porter au loin le pillage et la mort, et dans la capitale même de l'empire on a vu des guerres désastreuses qui n'avaient pas d'autre cause que celle-là.
«La Société des traités religieux fournit ses traités, la Société biblique donne des Bibles, la Société des Missions envoie ses agents et construit des zayats (chapelles du pays); mais tout cela en vue des hommes, et qu'en résulte-t-il? Un Birman entre dans le zayat, écoute, réfléchit, revient encore, puis, après avoir bien pesé ses impressions, il dit un jour à sa famille: «Cette religion est la vérité; je suis décidé à adorer désormais le Jésus-Christ qu'elle prêche.» Mais à peine a-t-il laissé tomber ces mots, que sa mère se précipite sur lui, lui arrache sa touffe de cheveux, ou menace de se suicider; sa sœur le maudit, sa maîtresse l'injurie, ou bien, s'il est marié, sa femme lui jette l'enfant qu'elle nourrit, s'enfuit et va chercher ailleurs un autre mari. Nous, chrétiens, nous connaissons les promesses faites à celui qui, pour obéir à l'Évangile, abandonne mère, femme ou enfants, et cependant combien d'hommes parmi nous seraient résolus à confesser toujours Jésus-Christ, au prix de pareils sacrifices? Bien des Birmans, touchés par la prédication de la vérité, souffriraient, j'en suis sûr, la prison, et monteraient courageusement sur les bûchers plutôt que d'en renier la profession; mais se peut-il imaginer une épreuve plus intolérable que les persécutions malicieuses et incessantes d'une femme païenne, livrée aux emportements d'une colère qu'aucun frein moral ne vient réprimer?
«Chez les Birmans, les femmes, loin de vivre en recluses, comme dans d'autres contrées de l'Orient, fréquentent tous les lieux de réunion, et il est évident que ce sont elles qui donnent le ton partout. Pleines d'aisance et de grâce, polies, actives et très-rusées, elles exercent, surtout dans leur pays, une sorte de fascination presque irrésistible, et comme cette prépondérance même les rend souverainement hautaines et égoïstes, il est rare qu'elle n'aboutisse pas au mal. Aux régates, aux combats de taureaux, à la table de jeu, la femme tient toujours le premier rang. Elle s'occupe des affaires, elle fait le commerce, elle bâtit des maisons, ou du moins elle dirige toutes les opérations de ce genre; qu'on juge, d'après cela, du bien que cette partie de la population pourrait faire si son cœur était un jour gagné à la cause de la vérité. La femme peut être appelée l'éducateur du Birman. C'est elle qui apprend à l'enfant tout ce qu'il croit des sorcières et des esprits. C'est elle qui le mène chaque soir chercher dans sa robe du sable pour le porter à la pagode. C'est elle qu'on voit franchissant de longues distances et montant d'interminables escaliers pour déposer son offrande devant les idoles. C'est elle qui foule aux pieds le livre blanc (l'Évangile) et met la feuille de palmier entre les mains de son fils. C'est elle, comme je l'ai déjà dit, qui plus d'une fois a soufflé le feu de la révolte et qui, d'un mot, causera la ruine d'un empire.»
Fêtes birmanes. — Audience de congé. — Refus de signer un traité. — Lettre royale. — Départ d'Amarapoura et retour à Rangoun.
À mon retour, la capitale était animée par les apprêts des fêtes qui se succèdent dans ce moment de l'année, à l'occasion de la fin du carême bouddhiste. On fabriquait dans la ville toutes sortes d'offrandes. Dans les faubourgs, les potiers d'étain confectionnaient des quantités de reliquaires fantastiques et des lanternes énormes, contenant des chandelles de cire de plus de deux pouces d'épaisseur. Les offrandes les plus riches étaient promenées à travers la ville. Ici, un groupe de dévots transportait une gigantesque imitation de feuilles de ces palmiers que les poongys portent comme parasol. Elle était en papier aux couleurs brillantes, ornée de quantité de cahiers de feuilles d'or. Là, un autre groupe voiturait un tabernacle en clinquant, semblable aux tazéeas des mahométans shiites au Mohurrum; plus loin, un immense dragon de cent pieds de long au moins était très-adroitement manœuvré dans les rues; il serpentait et rampait, attaquant parfois les passants de ses défenses avec une férocité très-habilement imitée.
Il est peut-être utile de noter, à ce sujet, qu'une des plus grandes fêtes célébrées chez les Birmans tombe le 12 avril, date qui correspond au dernier jour de leur année civile et religieuse.
Pour laver les impuretés du passé et commencer la nouvelle année libre de souillure, le soir du 12 avril, les femmes ont coutume de jeter de l'eau sur chaque homme qu'elles rencontrent, et les hommes ont droit de leur riposter. On peut imaginer si cette licence engendre une gaieté folle, principalement parmi les jeunes femmes qui, armées de longues seringues et de flacons, entreprennent de jeter de l'eau sur chaque homme qui passe, et, à leur tour, reçoivent celle qu'on leur jette avec une parfaite bonne humeur. Mais il est défendu d'employer de l'eau sale, et il n'est personne, homme ou enfant, qui ait le droit de porter les mains sur une femme. Lors même qu'une femme refuserait de prendre part au jeu, elle ne doit point être molestée, car elle est supposée avoir pour excuse la maladie.
Je n'ai pas passé cet anniversaire sur le territoire d'Ava, mais je puis en parler d'après le témoignage de deux Anglais qui vinrent après nous à Amarapoura, et qui furent invités par un des woons à participer chez lui à l'amusement national.
À leur entrée dans la maison du haut et puissant fonctionnaire (un de nos vieux amis), les deux voyageurs reçurent chacun une bouteille d'eau de rose, dont ils versèrent une partie dans les mains de leur hôte, qui la répandit aussitôt sur ses vêtements, de la plus fine mousseline à fleurs. La dame du logis parut alors à la porte, (p. 299) donnant à comprendre qu'elle ne pouvait elle-même participer au jeu; mais, sur son invitation, sa fille aînée, une charmante enfant, encore dans les bras de sa nourrice, retira d'une coupe d'or un peu d'eau de rose, mêlée avec du bois de sandal, et en répandit sur son père ainsi que sur chacun des voyageurs. Ce fut le signal, et le jeu commença; les étrangers s'y étaient préparés en s'habillant tout de blanc.
Aussitôt une quinzaine de jeunes femmes se précipitant des appartements intérieurs dans la salle, et entourant le woon et les deux invités, les inondèrent sans merci. Si l'un d'eux se montrait contrarié d'avoir la face changée en gouttière, ces jeunes filles riaient de tout leur cœur. Les mêmes scènes se passaient au dehors. À la fin, tous les partners de ce jeu aquatique étant fatigués et complètement trempés, il fut loisible à chacun de rentrer chez soi pour changer d'habits.
Une heure après, nos compatriotes retournèrent à la maison du woon et furent régalés d'une danse et d'un spectacle de marionnettes, qui durèrent jusqu'à la naissance du jour. La nouvelle année était inaugurée.
... Nous touchions au terme fixé à Calcutta pour le retour de notre mission. Le major Phayre, comprenant que toute insistance pour obtenir du roi la ratification du fameux traité était désormais superflue, demanda son audience de congé. Elle fut fixée au 21 octobre.
Les souwars de la cavalerie irrégulière et la moitié des Européens nous escortèrent jusqu'au palais pour voir l'éléphant blanc; la musique nous accompagna, le roi ayant manifesté le désir de l'entendre. La réception eut lieu dans le même emplacement et avec les mêmes circonstances qu'auparavant; les bayadères du roi tournaient dans la myé-nan, et les belles musiciennes, avec leurs mitres en tête et leurs robes bariolées, jouaient sur leurs instruments dans les verandahs. Au bout de vingt minutes, le roi entra et se jeta, à moitié couché, sur un sofa. Il portait un simple tsal-wé de vingt-quatre rangs à la manière accoutumée. Après quelques minutes de silence, il demanda à l'ambassadeur: «Quand partez-vous?
L'ambassadeur. Sire, après-demain.
Le roi. Combien de jours vous faudra-t-il pour descendre le fleuve?
L'ambassadeur. Nous pourrions faire le trajet en trois jours, mais je désire m'arrêter à Pagán et dans d'autres localités.
Le roi (à l'atwen-woon). Veillez à ce que tout soit prêt et à ce que rien ne manque à leur bien-être.
L'atwen-woon. Les ordres de Votre Majesté seront portés sur le haut de notre tête.
Le roi (à l'ambassadeur). Avez-vous lu les livres et traités religieux que je vous ai envoyés?
L'ambassadeur. J'ai parcouru le Maha-radza-weug, Sire, mais je n'ai pas eu le loisir de l'étudier.
Le roi. Ne les mettez pas de coté, mais étudiez-les, vous en retirerez grand fruit.
L'ambassadeur. Je le ferai, Sire.
Le roi. Toute votre suite se porte bien?
L'ambassadeur. Oui, Sire.
Le roi. J'espère que vous n'avez manqué de rien depuis votre arrivée?
L'ambassadeur. Non, grâce à Votre Majesté.
Le roi. Si vous désiriez quelque chose, dites-le au woondouk, et il veillera à ce que vous soyez satisfait.»
L'ambassadeur ayant ensuite présenté quelques-uns des nôtres qui devaient rester dans le voisinage de la Birmanie comme inspecteurs ou commandants des frontières, le roi, de ce ton débonnaire et doucement sentencieux qui lui était propre, et que durent, sans aucun doute, posséder jadis Édouard le Confesseur en Angleterre et le bon roi Robert en France, déclara au major Phayre qu'il était bien heureux du choix que le gouverneur général avait fait de ces messieurs, «car, ajouta-t-il sagement, on devrait toujours placer sur la frontière des hommes judicieux et modérés. Il est aisé de se fâcher et difficile d'y remédier. La haine peut naître d'un seul mot, et cependant avec de l'attention on peut empêcher une querelle de s'élever. Il est aisé de se lier d'amitié pour quelque temps, mais il est difficile d'y persévérer. Tous nos soins tendront vers cet objet.»
L'ambassadeur. Sire, nous aussi, nous nous y efforcerons.
Le roi. Comme les deux États n'en font qu'un, si quelqu'un désirait venir des pays anglais dans mon royaume, serait-il libre de le faire?
L'ambassadeur. Certainement, Sire.
Le roi. Si vous pouvez me procurer quelques-unes des reliques bouddhiques qui se trouvent dans l'Inde, ainsi que les coffrets originaux qui les contiennent, écrivez pour m'en informer. Ce sont là des objets que nous vénérons.
L'ambassadeur. Je ferai tout mon possible pour satisfaire le vœu de Votre Majesté.
Le roi (à M. Camaretta). Voyez à ce que tout soit prêt pour le voyage.
(À l'ambassadeur). Désirez-vous me dire autre chose?
L'ambassadeur. Rien de plus que de remercier Votre Majesté de toutes les bontés qu'elle nous a témoignées depuis que nous sommes entrés dans son royaume.
Le roi. La reconnaissance honore les hommes, et ceux qui l'oublient, les Birmans les considèrent comme des êtres avilis. À présent, la capitale est bien boueuse; en été, la chaleur est gênante; l'hiver est la meilleure saison pour y venir. Je considère les membres de l'ambassade comme mes propres nobles, et plus tard s'ils revenaient ici, même sans le major Phayre, je serais heureux de les recevoir dans mon palais. Le kalâ-woon vous accompagnera jusqu'à la frontière, et j'espère qu'Allan, le commandant de Prome, et lui se lieront d'amitié.»
En ce moment M. Grant, notre artiste photographe, ayant apporté au palais le portrait de l'éléphant blanc, un des atwen-woons remit l'épreuve au roi, qui la regarda avec soin et dit: «C'est une gravure.» Quand on lui eut affirmé le contraire, il s'écria: «Les étrangers dessinent de vrais portraits; nos artistes ne dessinent que pour plaire. Qu'on apporte notre portrait de l'éléphant blanc.»
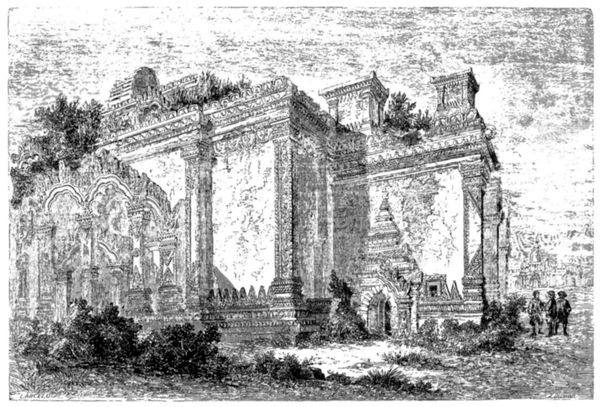
Temple ruiné de Pagán.—Dessin de Lancelot d'après H. Yule.
(p. 301) Le dessin de l'artiste birman fut apporté et offert à l'ambassadeur de la part du roi, qui, se levant alors brusquement de son sofa, disparut à travers les longues colonnades aux portes dorées. Ce fut la dernière fois que nous le vîmes.
Sa Majesté nous avait paru excitée et mal à l'aise pendant l'entrevue, montrant peu de sa vivacité habituelle. Constamment occupé à garnir sa bouche de pân qu'il rejetait bientôt, Mendoun-Men faisait allumer son cigare qu'il laissait éteindre pour de nouveau le faire rallumer. Avant notre sortie du palais, il nous fit dire par M. Camaretta qu'il souffrait du mal de tête, ce qui nous expliquait sa retraite précipitée.

Salces ou volcans de boue, à Membo.—D'après H. Yule.
Après son départ nous nous entretînmes avec les atwen-woons et goûtâmes de quelques rafraîchissements. Ces messieurs étaient très-polis, nous assurant qu'ils se sentaient malheureux de l'idée de notre départ; ce qui, je l'espère, n'était pas de leur part une politesse banale, mais un sentiment réel.
Le 21 octobre, les quatre woon-gyis vinrent déjeuner avec nous et nous faire leurs adieux. Ici nous récapitulerons leurs noms: le premier était le vieux Magwé mengyi, dont la physionomie rappelait celle des Médicis; puis le Mein-loung mengyi, vieillard corpulent et jovial, dont la figure rayonnait de cordialité. Le troisième, le pabéwoon, ou maître d'artillerie, connu sous le nom de Myadoung mengyi, était maigre, gravé de la petite vérole, fin et de belles manières; il nous accabla de questions sur notre artillerie, son calibre et la portée des pièces. Le dernier, le pakan-woongyi, était le plus jeune des quatre piliers de l'État; c'était un personnage bilieux d'aspect, avec de grands yeux noirs et des manières froides et compassées. Il avait été prêtre jusqu'au jour où le roi l'avait appelé à la cour.

Cônes volcaniques dans la plaine de Membo.—D'après H. Yule.
Ils restèrent avec nous jusqu'à midi et furent en général fort aimables. Les trois woon-gyis les plus âgés se montrèrent, comme toujours, gais, plaisants et de belle humeur. Le vieux seigneur de Mein-loung parut s'intéresser fort au progrès de la guerre de Crimée, et demanda même la permission d'écrire mes réponses à ses questions. Toutes se rapportaient à la distance de l'Angleterre à Sébastopol, à Saint-Pétersbourg, et de ces villes (p. 302) aux Indes, au nombre des navires de guerre, des hommes et des canons employés de part et d'autre. Un tsa-ye-gyi, ou secrétaire, se hâtait de transcrire mes réponses sur son noir agenda avec son crayon de stéatite, lorsque l'on nous annonça le déjeuner.
Le maître d'artillerie, de son côté, voulait surtout savoir pourquoi la guerre traînait en longueur et pourquoi nous la faisions. Comme je m'efforçais de lui expliquer que la puissance de la Russie s'étendait trop et menaçait la tranquillité de l'Europe, cette réponse provoqua une explosion de rires, dus, sans doute, à ce qu'ils en firent une application à leur usage et au nôtre.
Pendant ce temps le Magwé-mengyi eut une conférence particulière avec le major Phayre, relativement à la politique des frontières.
Enfin ils partirent en nous promettant d'envoyer sous peu la lettre royale sur laquelle, en vérité, nous ne comptions plus. On avait apporté à bord tous nos effets, et nous attendîmes jusqu'au coucher du soleil sans voir arriver cette missive. Alors l'ambassadeur ne jugea pas nécessaire de différer plus longtemps notre départ.
Le régiment birman, de garde à l'ambassade, et qui porte le nom de Leyta-gyoung, se forma pour nous escorter, mais nous n'avions pas gagné le lac que l'on nous annonça la venue de la procession chargée de la lettre royale; nous fîmes donc halte, mais avant qu'elle ne nous rejoignît, le soleil était couché.
La tête du cortége se composait de gens revêtus du plus fantastique costume de guerre, de quelques fantassins et de la musique. La lettre était portée par un makhangyi installé sur un éléphant caparaçonné d'un howdah doré et flanqué de deux grands boucliers d'or. Huit ombrelles dorées abritaient la lettre, qu'en ces occasions on ne confie pas à de hauts dignitaires, afin de rendre par là le respect que l'on témoigne à ce papier plus évident.

Paysans birmans en voyage.—D'après H. Yule.
Comme la nuit nous gagnait, et que nous avions plusieurs milles à franchir, l'ambassadeur proposa d'embarquer la lettre sur la chaloupe de la Zénobie, et de la suivre dans les canots des steamers qui se trouvaient sur le lac. On accepta; le woondouk prit le précieux papier des mains du vieux nakhangyi, et le remit à l'ambassadeur en lui disant: «Ceci est la lettre royale de Sa Majesté au gouverneur des Anglais.» L'ambassadeur la reçut, la passa au secrétaire, qui la déposa sur un plateau doré et la porta à bord de la chaloupe, où l'on arbora aussitôt le pavillon de la Compagnie des Indes.
L'enveloppe de ladite lettre, d'une apparence étrange, consistait en deux tubes d'ivoire longs de quinze pouces, enveloppés eux-mêmes dans un fourreau de velours écarlate et chargé de plusieurs sceaux représentant le paon et le palais sacré. L'ambassadeur en remit l'ouverture au moment où nous aurions quitté la frontière, et alors nous y vîmes que le roi avait évité toute allusion au traité qu'on avait présenté à sa signature, bien que le major Phayre eût espéré, d'après une conversation confidentielle avec le magwé-woongyi, que quelques mots d'explication auraient été donnés à ce sujet.
Le 22 octobre, nous dérapâmes enfin du mouillage où nous étions restés si longtemps, et notre petite flottille commença à descendre le fleuve. Le P. Abbona, MM. Camaretta, Spears, le vieil Arménien Makertich, le woondouk et le nanmadau Phra Woon insistèrent pour nous suivre au moins jusqu'à notre première station, où nous accompagna aussi le myo-woon d'Amarapoura, par ordre exprès de son souverain. Le bon vieux nanmadau Phra Woon, assis sur notre pont, ne cessait de compter les grains d'ambre de son petit rosaire, en répétant sans cesse d'une voix étouffée: Aneytya! Dokha! Anatta! mots palis qui expriment le caractère borné, transitoire, du bonheur terrestre, et le néant des affections humaines.
Une douzaine de bateaux de guerre nous fit ainsi cortége jusqu'au coucher du soleil, moment solennel où nous jetâmes l'ancre pour prendre un dernier congé de nos amis, dont les discours d'adieux nous touchèrent profondément. Le vieux Woon, s'essuyant les yeux avec (p. 303) les pans de son putso, nous déclara que sa femme ne se consolerait pas plus que lui du départ du major Phayre. «Je prierai Dieu journellement, ajouta-t-il, pour le major, pour le gouverneur général, pour votre souverain et pour vous tous enfin, demandant à sa toute-puissance de vous mettre à l'abri des maladies, des démons et de tous les malheurs possibles. Cette prière, je l'ai déjà faite ce matin avant de quitter la ville avec vous. Quand je vais y rentrer, le roi et la reine vont me demander, selon leur habitude, ce que vous avez dit et pensé. Que dois-je leur répondre?
—Que nous sommes tous on ne peut plus reconnaissants de la bienveillance dont Leurs Majestés ont comblé la mission pendant tout son séjour dans leurs États.» Telle fut la réponse du major, qui véritablement n'était que l'interprète fidèle des sentiments de tous ses compagnons. L'ancre fut ensuite levée et nous reprîmes notre voyage, non pourtant avant que le woondouk eût fait accepter à chacun de nous une énorme caisse de confitures birmanes.
La baisse des eaux avait donné au pays que nous traversions un aspect tout nouveau. Des îles étendues et de hauts bancs de sable s'élevaient en des endroits où, lors de notre arrivée, nous n'avions vu que des arbres à demi submergés et des maisons inondées. Le chenal du fleuve était néanmoins bien mieux défini, et le paysage sur l'une et l'autre rive plus frais, plus verdoyant, et plus fréquenté.
Le 23, dans la matinée, nous nous retrouvâmes devant les ruines de Pagán. La journée fut employée à visiter d'abord une manufacture de laque, principale industrie de ce district, puis à revoir en détail la grande pagode de Shwé-Zergoug qui s'élève non loin de là.
C'est un des temples les plus célèbres de la contrée. Tout Birman est tenu d'y venir en pèlerinage, au moins une fois en sa vie. Suivant le colonel Burney[13], il a été fondé par Nauratha Men-zan, quarante-deuxième roi de Pagán, vers l'an 1064 de notre ère, et fut achevé par un de ses généraux, qui monta sur le trône après un fils de Nauratha. On y garde dans une châsse un fac-simile d'une dent de Gautama; dent que le roi envoya chercher en Chine avec une grande armée. La sainte relique (une véritable défense d'éléphant), éludant l'invitation, tint à rester en Chine, et le roi de Pagán fut obligé de se contenter d'un miraculeux duplicata.
Après cette halte dans ce lieu que Karl Ritter appelle la Thébaïde birmane, nous dûmes encore nous arrêter le lendemain à Menhlà, chez le gouverneur Makertich, qui avait préparé, pour fêter notre passage, un festival où ne figurèrent pas moins de quatre-vingt-quinze jeunes filles, divisées en trois corps de ballets, chantant et dansant.
Le 27, au milieu du jour, nous passâmes devant les piliers qui marquent les frontières de la Birmanie britannique et du territoire que les guerres de 1824 et de 1852 ont laissé au royaume d'Ava; trois jours plus tard, le 30 octobre, nous rentrions à Rangoun.
Coup d'œil rétrospectif sur la Birmanie.
Ptolémée paraît être le premier géographe de l'Occident qui ait parlé d'une manière précise des contrées arrosées par l'Irawady. Sa Chersonèse d'or ne peut être cherchée ailleurs que dans la saillie formée par le delta du grand fleuve, et l'on doit, comme l'a fait le savant Gosselin, identifier avec Tenasserim la ville de Thinæ du géographe Alexandrin, retrouver sa Tugma metropolis dans la vénérable cité de Tagoung, et Tharra, ville centrale de la Chersonèse, dans la moderne Tharawadi, ou peut-être mieux encore dans Tharra-Khettara, un des anciens noms de Prome. À l'orient, sur les confins des Sinæ, Ptolémée place les tribus des Kakobæ et des Kadopæ, appellations différant bien peu de celles de Kakoos et de Kadouns que se donnent eux-mêmes dans leurs dialectes les Kakhiens et les Karens d'aujourd'hui. On voit qu'il est difficile d'être plus exact et mieux renseigné sur les régions de l'extrême Orient que ne l'était Ptolémée vers l'an 175 de notre ère.
Quant au nom de Chersonèse d'or sous lequel il les désignait à ses contemporains, on a rattaché son origine à la profusion de métal précieux répandu sur les édifices religieux de cette partie de l'Indo-Chine; mais il est plus probable qu'il est dû à quelque rapport exagéré sur les richesses minéralogiques de ces contrées; car la dorure des temples et même l'architecture religieuse n'y ont été introduites qu'avec les doctrines bouddhiques au commencement du cinquième siècle.
De Ptolémée, il faut descendre jusqu'à Marco Polo pour trouver dans un auteur européen une mention précise de ces mêmes régions. Le voyageur vénitien cite Pagán sous le nom chinois de Mien, grande et noble cité, capitale du royaume. Peu après le passage de Marco Polo, la vallée de l'Irawady subit le joug d'un détachement de la grande invasion mongole, et quand, à la faveur des discordes intestines qui brisèrent l'unité de l'empire fondé par les fils de Tchenkis, les Indo-Chinois repoussèrent leur domination, le nom d'Ava apparaît pour la première fois dans l'histoire.
Vers l'an 1500, le territoire birman ne rayonne guère que de trente à quarante lieues autour de cette métropole; puis, quatre-vingts ans plus tard, il est englobé tout entier, à titre de vasselage, dans les limites de l'empire du Pégu, qui couvre toute l'Indo-Chine, depuis le golfe du Bengale jusqu'aux rives du Cambodje. Deux siècles de luttes, de révoltes, de guerres, auxquelles se mêlent des aventuriers européens, naissent de cet état de choses; enfin vers 1750, les Péguans, après avoir assiégé et renversé Ava de fond en comble, mettent fin à sa dynastie nationale. Elle comptait une série de trente-neuf rois.
On sait comment, l'année suivante, un Birman de basse extraction, c'est-à-dire Shan ou Karen d'origine, recommença, à la tête d'une poignée d'hommes, la guerre de l'indépendance, et immortalisa son nom d'Alompra, par l'expulsion des étrangers et la reconstitution de la Birmanie dans une puissance et des limites qu'elle n'avait jamais possédées avant lui.
(p. 304) La suprématie de ce nouvel empire sur les autres États de l'Indo-Chine ne se soutint pas longtemps après la mort de son fondateur, survenue en 1760. Dès 1786, les Siamois firent éprouver plusieurs échecs au quatrième fils et successeur du grand Alompra. Puis, avec le siècle actuel naquirent, entre les gouvernements d'Amarapoura et de Calcutta, des dissentiments qui, dès 1824, se traduisaient en hostilités ouvertes. Deux ans après, la guerre se terminait sous les murs de la capitale birmane assiégée, par la cession aux Anglais des provinces d'Assam, d'Araccam, de Tavai et de Merghi: une moitié de l'empire! Vingt ans s'écoulèrent encore, et une violation inconsidérée de ce malheureux traité, par le huitième successeur d'Alompra, n'eut d'autre résultat que d'amener sa déposition, précédée de l'annexion du Pégu tout entier au territoire britannique. Depuis lors, les frontières sud de la Birmanie ne descendent pas au-dessous du dix-neuvième degré trente minutes de latitude.

Statue gigantesque de Bouddha, à Amarapoura.—Dessin de Lancelot d'après H. Yule.
Le roi actuel de ce pays déchu, l'ex-prince de Mengoun, que les Anglais aiment à proclamer comme le plus respectable descendant d'Alompra, n'est pas de force à reconstituer l'œuvre de son glorieux aïeul. C'en est fait du rôle historique de la Birmanie. Elle glisse rapidement sur la pente rapide où se précipitent, à l'heure actuelle, les mœurs, les institutions, les hommes et les choses de l'antique Orient. Il en est de ces vieilles sociétés, ayant pour base l'esclavage des multitudes et pour couronnement la déification d'un despote, fils du ciel ou descendant du soleil, comme de ces gigantesques idoles bouddhiques, imposées à l'adoration de la foule et dont le revêtement d'or ne sert qu'à voiler les irréparables félures et les raccordements de plâtre.
Traduit par F. de Lanoye.
Voir: Recherches sur la géographie des anciens, par R. F. J. Gosselin, vol. III, Paris, 1813.—Marco Polo, édition de la Société de géographie de Paris.—Voyages de César-Frédérick, dans Purchass, vol. II, 1717.—Id., de Nicolo Conti dans Romusio, vol. I, 340.—History of the Discovery and conquest of India by the Portuguese, London, 1695, vol. II, 134-8.—Valentin, Description of the Dutch east Indies, 1726, vol. V, p. 126.—Dalrymple, Oriental repertory.—Symes, Account of an ambassade to Ava, 1800, in-4.—Hiram Cox, Journal of a residence in the Burman empire, London, 1821, in-8.—J. Crawfurd, Journal of an ambassady to the court of Ava, 1829, in-8.—Burney, Journal to Ava, 1830.—Id. Historical Review of the political relations between the British government in India and the empire of Ava, 1834.—Rév. docteur Mason, Natural productions of Burma, Maulmain, 1850.—Colonel Hannay, A journey to the upper Irawady in 1835-36 (manuscrit).
I. Sous le titre Voyage d'un naturaliste, pages 139 et 146, on a imprimé: (1858.—INÉDIT).—Cette date et cette qualification ne peuvent s'appliquer qu'à la traduction.
La note qui commence la page 139 donne la date du voyage (1838) et avertit les lecteurs que le texte a été publié en anglais.
II. Dans un certain nombre d'exemplaires, le voyage du capitaine Burton aux grands lacs de l'Afrique orientale, 1re partie, 46e livraison, le mot ORIENTALE se trouve remplacé par celui d'OCCIDENTALE.
III. On a omis, sous les titres de Juif et Juive de Salonique, dessins de Bida, pages 108 et 109, la mention suivante: d'après M. A. Proust.
IV. On a également omis de donner, à la page 146, la description des oiseaux et du reptile de l'archipel des Galapagos représentés sur la page 145. Nous réparons cette omission:
1º Tanagra Darwinii, variété du genre des Tanagras très-nombreux en Amérique. Ces oiseaux ne diffèrent de nos moineaux, dont ils ont à peu près les habitudes, que par la brillante diversité des couleurs et par les échancrures de la mandibule supérieure de leur bec.
2º Cactornis assimilis: Darwin le nomme Tisseim des Galapagos, où l'on peut le voir souvent grimper autour des fleurs du grand cactus. Il appartient particulièrement à l'île Saint-Charles. Des treize espèces du genre pinson, que le naturaliste trouva dans cet archipel, chacune semble affectée à une île en particulier.
3º Pyrocephalus nanus, très-joli petit oiseau du sous-genre muscicapa, gobe-mouches, tyrans ou moucherolles. Le mâle de cette variété a une tête de feu. Il hante à la fois les bois humides des plus hautes parties des îles Galapagos et les districts arides et rocailleux.
4º Sylvicola aureola. Ce charmant oiseau, d'un jaune d'or, appartient aux îles Galapagos.
5º Le Leiocephalus grayii est l'une des nombreuses nouveautés rapportées par les navigateurs du Beagle. Dans le pays on le nomme holotropis, et moins curieux peut-être que l'amblyrhinchus, il est cependant remarquable en ce que c'est un des plus beaux sauriens, sinon le plus beau saurien qui existe.
Le saurien amblyrhinchus cristatus, que nous reproduisons ici, est décrit dans le texte, page 147.
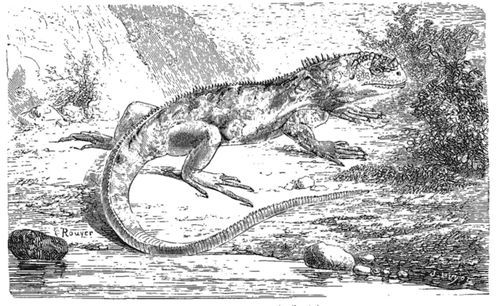
Amblyrhinchus cristatus, iguane des îles Galapagos.
IMPRIMERIE GÉNÉRALE DE CH. LAHURE
Rue de Fleurus, 9, à Paris
Note 1: Woondouk, ministre de second ordre. Dans le Hlwot-dau, grand conseil de la couronne, il y a quatre woon-gyi, assistés chacun d'un woondouk. Woon, gouverneur ou ministre; ce mot signifie littéralement fardeau. Woon-gyi, grand woon; woondouk, soutien du woon.[Retour au Texte Principal]
Note 2: Le htee est l'ornement en fer doré qui couronne le dôme de toutes les pagodes.[Retour au Texte Principal]
Note 3: Poon-gyi, grande gloire, nom qui, dans la Birmanie, sert à désigner les prêtres de Bouddha.[Retour au Texte Principal]
Note 4: Zayat, espèce de portique ou d'abri public, qui, servant aux voyageurs, aux promeneurs, etc., se trouve dans presque toutes les pagodes.[Retour au Texte Principal]
Note 5: Dagobahest le nom donné aux temples de Ceylan; il signifie, en sanscrit, réceptacle des reliques. On suppose généralement que notre expression de pagode est une corruption de ce mot. Chaitys désigne les temples bouddhistes; Bo-phyaest le nom des pagodes en forme d'œuf ou de potiron.[Retour au Texte Principal]
Note 6: Le tsal-wé, chaîne d'or à plusieurs rangs, est l'insigne qui distingue les nobles birmans; il se porte attaché sur l'épaule gauche, traverse la poitrine, et vient se fixer sur le dos, derrière le bras droit. D'après le major Phayre, ce serait une modification du fil ou cordon brahmanique des Hindous.[Retour au Texte Principal]
Note 7: Suite.—Voy. page 257.[Retour au Texte Principal]
Note 8: Sorte d'aiguillon à crochet qui remplacé le fouet du cocher entre les mains du mahout du cornac.[Retour au Texte Principal]
Note 9: Ce culte et l'adoration des reliques n'ont commencé que lorsque la pureté primitive de la doctrine bouddhique, toute spiritualiste à l'origine, était déjà très-altérée par suite de l'ignorance superstitieuse des populations. M. Barthélemy Saint-Hilaire a donné récemment, en France, une étude complète du bouddhisme. Beaucoup de détails curieux sur cette religion ont été réunis dans les notes de l'article Fa-hian, à la fin de notre volume des Voyageurs anciens.[Retour au Texte Principal]
Note 10: Suite et fin.—Voy. pages 257 et 273.[Retour au Texte Principal]
Note 11: Tout ce chapitre est emprunté au journal du docteur Oldman.[Retour au Texte Principal]
Note 12: Les natifs de Tenasserim décrivent un serpent venimeux, dont la taille atteint dix à douze pieds, et qui, d'une couleur plus foncée que la cobra commune, est presque entièrement noir. Je ne l'ai jamais rencontré, mais la description qu'on m'en a faite concorde assez avec le caractère générique des hamadryades pour m'autoriser à le regarder comme une variété du genre. «L'hamadryade, dit le docteur Crantor, est excessivement farouche, toujours prête à se jeter sur quiconque l'attaque et à poursuivre tout ce qui l'irrite.» C'est là un grand trait d'analogie avec le serpent de Tenasserim. Un Birman fort intelligent m'a raconté qu'un de ses amis étant venu à heurter un jour une nichée de ces serpents, battit immédiatement en retraite, mais il avait été aperçu et la mère furieuse se lança immédiatement à sa poursuite. L'homme s'enfuit de toutes ses forces à travers coteaux, vallons, clairières et halliers; la terreur lui donnait des ailes. Arrivé sur les bords d'une petite rivière, il n'hésite pas à s'y jeter, dans l'espoir de faire ainsi perdre sa piste à son terrible ennemi. Mais, hélas! en atteignant la rive opposée, il y retrouve la furieuse hamadryade, la tête haute, les yeux en feu et dilatés par la rage, toute prête enfin à enfoncer ses crochets mortels dans ses chairs palpitantes. Désespéré, il saisit son turban et, par un mouvement instinctif, le lance au reptile, qui, se jetant comme un éclair sur cet objet inanimé, le couvre de furieuses morsures, et trompe ainsi sa colère et sa vengeance; après quoi il regagne tranquillement son repaire. (Mason, Histoire naturelle de la Birmanie, p. 345.)[Retour au Texte Principal]
Note 13: Burney's journal to Ava, 1830.[Retour au Texte Principal]