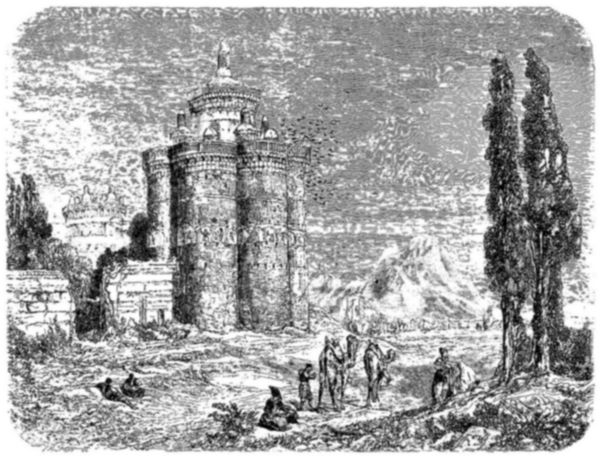
Pigeonnier près d'Ispahan.—Dessin de M. Jules Laurens.
Title: Le Tour du Monde; Perse
Author: Various
Editor: Édouard Charton
Release date: May 8, 2008 [eBook #25394]
Most recently updated: January 3, 2021
Language: French
Credits: Produced by Carlo Traverso, Christine P. Travers and the
Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
(This file was produced from images generously made
available by the Bibliothèque nationale de France
(BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)
Note au lecteur de ce fichier digital:
Seules les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées.
Ce fichier est un extrait du recueil du journal "Le Tour du monde: Journal des voyages et des voyageurs" (2ème semestre 1860).
Les articles ont été regroupés dans des fichiers correspondant aux différentes zones géographiques, ce fichier contient les articles sur la Perse.
Chaque fichier contient l'index complet du recueil dont ces articles sont originaires.
IMPRIMERIE GÉNÉRALE DE CH. LAHURE
Rue de Fleurus, 9, à Paris
PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION
DE M. ÉDOUARD CHARTON
ET ILLUSTRÉ PAR NOS PLUS CÉLÈBRES ARTISTES
1860
DEUXIÈME SEMESTRE
LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET Cie
PARIS, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, No 77
LONDRES, KING WILLIAM STREET, STRAND
LEIPZIG, 15, POST-STRASSE
1860
Un mois en Sicile (1843.—Inédit.), par M. Félix Bourquelot.
Arrivée en Sicile. — Palerme et ses habitants. — Les monuments de Palerme. — La cathédrale de Monreale. — De Palerme à Trapani. — Partenico. — Alcamo. — Calatafimi. — Ruines de Ségeste. — Trapani. — La sépulture du couvent des capucins. — Le mont Éryx. — De Trapani à Girgenti. — La Lettica. — Castelvetrano. — Ruines de Sélinonte. — Sciacca. — Girgenti (Agrigente). — De Girgenti à Castrogiovanni. — Caltanizzetta. — Castrogiovanni. — Le lac Pergusa et l'enlèvement de Proserpine. — De Castrogiovanni à Syracuse. — Calatagirone. — Vezzini. — Syracuse. — De Syracuse à Catane. — Lentini. — Catane. — Ascension de l'Etna. — Taormine. — Messine. — Retour à Naples.
Voyage en Perse, fragments par M. le comte A. de Gobineau (1855-1858), dessins inédits de M. Jules Laurens.
Voyages aux Indes Occidentales, par M. Anthony Trollope (1858-1859); dessins inédits de M. A. de Bérard.
L'île Saint-Thomas. — La Jamaïque: Kingston; Spanish-Town; les réserves; la végétation. — Les planteurs et les nègres. — Plaintes d'une Ariane noire. — La toilette des négresses. — Avenir des mulâtres. — Les petites Antilles. — La Martinique. — La Guadeloupe. — Grenada. — La Guyane anglaise. — Une sucrerie. — Barbados. — La Trinidad. — La Nouvelle-Grenade. — Sainte-Marthe. — Carthagène. — Le chemin de fer de Panama. — Costa Rica: San José; le Mont-Blanco. — Le Serapiqui. — Greytown.
Voyage dans les États scandinaves, par M. Paul Riant. (Le Télémark et l'évêché de Bergen.) (1858.—Inédit.)
Le Télémark. — Christiania. — Départ pour le Télémark. — Mode de voyager. — Paysage. — La vallée et la ville de Drammen. — De Drammen à Kongsberg. — Le cheval norvégien. — Kongsberg et ses gisements métallifères. — Les montagnes du Télémark. — Leurs habitants. — Hospitalité des gaards et des sæters. — Une sorcière. — Les lacs Tinn et Mjös. — Le Westfjord. — La chute du Rjukan. — Légende de la belle Marie. — Dal. — Le livre des étrangers. — L'église d'Hitterdal. — L'ivresse en Norvége. — Le châtelain aubergiste. — Les lacs Sillegjord et Bandak. — Le ravin des Corbeaux.
—Le Saint-Olaf et ses pareils. — Navigation intérieure. — Retour à Christiania par Skien.
L'évêché de Bergen. — La presqu'île de Bergen. — Lærdal. — Le Sognefjord. — Vosse-Vangen. — Le Vöringfoss. — Le Hardangerfjord. — De Vikoër à Sammanger et à Bergen.
Voyage de M. Guillaume Lejean dans l'Afrique orientale (1860.—Texte et dessins inédits.)—Lettre au Directeur du Tour du monde (Khartoum, 10 mai 1860).
D'Alexandrie à Souakin. — L'Égypte. — Le désert. — Le simoun. — Suez. — Un danger. — Le mirage. — Tor. — Qosséir. — Djambo. — Djeddah.
Voyage au mont Athos, par M. A. Proust (1858.—Inédit.)
Salonique. — Juifs, Grecs et Bulgares. — Les mosquées. — L'Albanais Rabottas. — Préparatifs de départ. — Vasilika. — Galatz. — Nedgesalar. — L'Athos. — Saint-Nicolas. — Le P. Gédéon. — Le couvent russe. — La messe chez les Grecs. — Kariès et la république de l'Athos. — Le voïvode turc. — Le peintre Anthimès et le pappas Manuel. — M. de Sévastiannoff.
Ermites indépendants. — Le monastère de Koutloumousis. — Les bibliothèques. — La peinture. — Manuel Panselinos et les peintres modernes. — Le monastère d'Iveron. — Les carêmes. — Peintres et peintures. — Stavronikitas. — Miracles. — Un Vroukolakas. — Les bibliothèques. — Les mulets. — Philotheos. — Les moines et la guerre de l'Indépendance. — Karacallos. — L'union des deux Églises. — Les pénitences et les fautes.
La légende d'Arcadius. — Le pappas de Smyrne. — Esphigmenou. — Théodose le Jeune. — L'ex-patriarche Anthymos et l'Église grecque. — L'isthme de l'Athos et Xerxès. — Les monastères bulgares: Kiliandari et Zographos. — La légende du peintre. — Beauté du paysage. — Castamoniti. — Une femme au mont Athos. — Dokiarios. — La secte des Palamites. — Saint-Xénophon. — La pêche aux éponges. — Retour à Kariès. — Xiropotamos, le couvent du Fleuve Sec. — Départ de Daphné. — Marino le chanteur.
Voyage d'un naturaliste (Charles Darwin).—L'archipel Galapagos et les attoles ou îles de coraux.—(1838).
L'Archipel Galapagos. — Groupe volcanique. — Innombrables cratères. — Aspect bizarre de la végétation. — L'île Chatam. — Colonie de l'île Charles. — L'île James. — Lac salé dans un cratère. — Histoire naturelle de ce groupe d'îles. — Mammifères; souris indigène. — Ornithologie; familiarité des oiseaux; terreur de l'homme; instinct acquis. — Reptiles; tortues de terre; leurs habitudes.
Encore les tortues de terre; lézard aquatique se nourrissant de plantes marines; lézard terrestre herbivore, se creusant un terrier. — Importance des reptiles dans cet archipel où ils remplacent les mammifères. — Différences entre les espèces qui habitent les diverses îles. — Aspect général américain.
Les attoles ou îles de coraux. — Île Keeling. — Aspect merveilleux. — Flore exiguë. — Voyage des graines. — Oiseaux. — Insectes. — Sources à flux et reflux. — Chasse aux tortues. — Champs de coraux morts. — Pierres transportées par les racines des arbres. — Grand crabe. — Corail piquant. — Poissons se nourrissant de coraux. — Formation des attoles. — Profondeur à laquelle le corail peut vivre. — Vastes espaces parsemés d'îles de corail. — Abaissement de leurs fondations. — Barrières. — Franges de récifs. — Changement des franges en barrières et des barrières en attoles.
Biographie.—Brun-Rollet.
Voyage au pays des Yakoutes (Russie asiatique), par Ouvarovski (1830-1839).
Djigansk. — Mes premiers souvenirs. — Brigandages. — Le paysage de Djigansk. — Les habitants. — La pêche. — Si les poissons morts sont bons à manger. — La sorcière Agrippine. — Mon premier voyage. — Killæm et ses environs. — Malheurs. — Les Yakoutes. — La chasse et la pêche. — Yakoutsk. — Mon premier emploi. — J'avance. — Dernières recommandations de ma mère. — Irkoutsk. — Voyage. — Oudskoï. — Mes bagages. — Campement. — Le froid. — La rivière Outchour. — L'Aldan. — Voyage dans la neige et dans la glace. — L'Ægnæ. — Un Tongouse qui pleure son chien. — Obstacles et fatigues. — Les guides. — Ascension du Diougdjour. — Stratagème pour prendre un oiseau. — La ville d'Oudskoï. — La pêche à l'embouchure du fleuve Ut. — Navigation pénible. — Boroukan. — Une halte dans la neige. — Les rennes. — Le mont Byraya. — Retour à Oudskoï et à Yakoutsk.
Viliouisk. — Sel tricolore. — Bois pétrifié. — Le Sountar. — Nouveau voyage. — Description du pays des Yakoutes. — Climat. — Population. — Caractères. — Aptitudes. — Les femmes yakoutes.
De Sydney à Adélaïde (Australie du Sud), notes extraites d'une correspondance particulière (1860).
Les Alpes australiennes. — Le bassin du Murray. — Ce qui reste des anciens maîtres du sol. — Navigation sur le Murray. — Frontières de l'Australie du Sud. — Le lac Alexandrina. — Le Kanguroo rouge. — La colonie de l'Australie du Sud. — Adélaïde. — Culture et mines.
Voyages et découvertes au centre de l'Afrique, journal du docteur Barth (1849-1855).
Henry Barth. — But de l'expédition de Richardson. — Départ. — Le Fezzan. — Mourzouk. — Le désert. — Le palais des démons. — Barth s'égare; torture et agonie. — Oasis. — Les Touaregs. — Dunes. — Afalesselez. — Bubales et moufflons. — Ouragan. — Frontières de l'Asben. — Extorsions. — Déluge à une latitude où il ne doit pas pleuvoir. — La Suisse du désert. — Sombre vallée de Taghist. — Riante vallée d'Auderas. — Agadez. — Sa décadence. — Entrevue de Barth et du sultan. — Pouvoir despotique. — Coup d'œil sur les mœurs. — Habitat de la girafe. — Le Soudan; le Damergou. — Architecture. — Katchéna; Barth est prisonnier. — Pénurie d'argent. — Kano. — Son aspect, son industrie, sa population. — De Kano à Kouka. — Mort de Richardson. — Arrivée à Kouka. — Difficultés croissantes. — L'énergie du voyageur en triomphe. — Ses visiteurs. — Un vieux courtisan. — Le vizir et ses quatre cents femmes. — Description de la ville, son marché, ses habitants. — Le Dendal. — Excursion. — Angornou. — Le lac Tchad.
Départ. — Aspect désolé du pays. — Les Ghouas. — Mabani. — Le mont Délabéda. — Forgeron en plein vent. — Dévastation. — Orage. — Baobab. — Le Mendif. — Les Marghis. — L'Adamaoua. — Mboutoudi. — Proposition de mariage. — Installation de vive force chez le fils du gouverneur de Soulleri. — Le Bénoué. — Yola. — Mauvais accueil. — Renvoi subit. — Les Ouélad-Sliman. — Situation politique du Bornou. — La ville de Yo. — Ngégimi ou Ingégimi. — Chute dans un bourbier. — Territoire ennemi. — Razzia. — Nouvelle expédition. — Troisième départ de Kouka. — Le chef de la police. — Aspect de l'armée. — Dikoua. — Marche de l'armée. — Le Mosgou. — Adishen et son escorte. — Beauté du pays. — Chasse à l'homme. — Erreur des Européens sur le centre de l'Afrique. — Incendies. — Baga. — Partage du butin. — Entrée dans le Baghirmi. — Refus de passage. — Traversée du Chari. — À travers champs. — Défense d'aller plus loin. — Hospitalité de Bou-Bakr-Sadik. — Barth est arrêté. — On lui met les fers aux pieds. — Délivré par Sadik. — Maséna. — Un savant. — Les femmes de Baghirmi. — Combat avec des fourmis. — Cortége du sultan. — Dépêches de Londres.
De Katchéna au Niger. — Le district de Mouniyo. — Lacs remarquables. — Aspect curieux de Zinder. — Route périlleuse. — Activité des fourmis. — Le Ghaladina de Sokoto. — Marche forcée de trente heures. — L'émir Aliyou. — Vourno. — Situation du pays. — Cortége nuptial. — Sokoto. — Caprice d'une boîte à musique. — Gando. — Khalilou. — Un chevalier d'industrie. — Exactions. — Pluie. — Désolation et fécondité. — Zogirma. — La vallée de Foga. — Le Niger. — La ville de Say. — Région mystérieuse. — Orage. — Passage de la Sirba. — Fin du rhamadan à Sebba. — Bijoux en cuivre. — De l'eau partout. — Barth déguisé en schérif. — Horreur des chiens. — Montagnes du Hombori. — Protection des Touaregs. — Bambara. — Prières pour la pluie. — Sur l'eau. — Kabara. — Visites importunes. — Dangereux passage. — Tinboctoue, Tomboctou ou Tembouctou. — El Bakay. — Menaces. — Le camp du cheik. — Irritation croissante. — Sus au chrétien! — Les Foullanes veulent assiéger la ville. — Départ. — Un preux chez les Touaregs. — Zone rocheuse. — Lenteurs désespérantes. — Gogo. — Gando. — Kano. — Retour.
Voyages et aventures du baron de Wogan en Californie (1850-1852.—Inédit).
Arrivée à San-Francisco. — Description de cette ville. — Départ pour les placers. — Le claim. — Première déception. — La solitude. — Mineur et chasseur. — Départ pour l'intérieur. — L'ours gris. — Reconnaissance des sauvages. — Captivité. — Jugement. — Le poteau de la guerre. — L'Anglais chef de tribu. — Délivrance.
Voyage dans le royaume d'Ava (empire des Birmans), par le capitaine Henri Yule, du corps du génie bengalais (1855).
Départ de Rangoun. — Frontières anglaises et birmanes. — Aspect du fleuve et de ses bords. — La ville de Magwé. — Musique, concert et drames birmans. — Sources de naphte; leur exploitation. — Un monastère et ses habitants. — La ville de Pagán. — Myeen-Kyan. — Amarapoura. — Paysage. — Arrivée à Amarapoura.
Amarapoura; ses palais, ses temples. — L'éléphant blanc. — Population de la ville. — Recensement suspect. — Audience du roi. — Présents offerts et reçus. — Le prince héritier présomptif et la princesse royale. — Incident diplomatique. — Religion bouddhique. — Visites aux grands fonctionnaires. — Les dames birmanes.
Comment on dompte les éléphants en Birmanie. — Excursions autour d'Amarapoura. — Géologie de la vallée de l'Irawady. — Les poissons familiers. — Le serpent hamadryade. — Les Shans et autres peuples indigènes du royaume d'Ava. — Les femmes chez les Birmans et chez les Karens. — Fêtes birmanes. — Audience de congé. — Refus de signer un traité. — Lettre royale. — Départ d'Amarapoura et retour à Rangoun. — Coup d'œil rétrospectif sur la Birmanie.
Voyage aux grands lacs de l'Afrique orientale, par le capitaine Burton (1857-1859).
But de l'expédition. — Le capitaine Burton. — Zanzibar. — Aspect de la côte. — Un village. — Les Béloutchis. — Ouamrima. — Fertilité du sol. — Dégoût inspiré par le pantalon. — Vallée de la mort. — Supplice de M. Maizan. — Hallucination de l'assassin. — Horreur du paysage. — Humidité. — Zoungoméro. — Effets de la traite. — Personnel de la caravane. — Métis arabes, Hindous, jeunes gens mis en gage par leurs familles. — Ânes de selle et de bât. — Chaîne de l'Ousagara. — Transformation du climat. — Nouvelles plaines insalubres. — Contraste. — Ruine d'un village. — Fourmis noires. — Troisième rampe de l'Ousagara. — La Passe terrible. — L'Ougogo. — L'Ougogi. — Épines. — Le Zihoua. — Caravanes. — Curiosité des indigènes. — Faune. — Un despote. — La plaine embrasée. — Coup d'œil sur la vallée d'Ougogo. — Aridité. — Kraals. — Absence de combustible. — Géologie. — Climat. — Printemps. — Indigènes. — District de Toula. — Le chef Maoula. — Forêt dangereuse.
Arrivée à Kazeh. — Accueil hospitalier. — Snay ben Amir. — Établissements des Arabes. — Leur manière de vivre. — Le Tembé. — Chemins de l'Afrique orientale. — Caravanes. — Porteurs. — Une journée de marche. — Costume du guide. — Le Mganga. — Coiffures. — Halte. — Danse. — Séjour à Kazeh. — Avidité des Béloutchis. — Saison pluvieuse. — Yombo. — Coucher du soleil. — Jolies fumeuses. — Le Mséné. — Orgies. — Kajjanjéri. — Maladie. — Passage du Malagarazi. — Tradition. — Beauté de la Terre de la Lune. — Soirée de printemps. — Orage. — Faune. — Cynocéphales, chiens sauvages, oiseaux d'eau. — Ouakimbou. — Ouanyamouézi. — Toilette. — Naissances. — Éducation. — Funérailles. — Mobilier. — Lieu public. — Gouvernement. — Ordalie. — Région insalubre et féconde. — Aspect du Tanganyika. — Ravissements. — Kaouélé.
Tatouage. — Cosmétiques. — Manière originale de priser. — Caractère des Ouajiji; leur cérémonial. — Autres riverains du lac. — Ouatata, vie nomade, conquêtes, manière de se battre, hospitalité. — Installation à Kaouélé. — Visite de Kannéna. — Tribulations. — Maladies. — Sur le lac. — Bourgades de pêcheurs. — Ouafanya. — Le chef Kanoni. — Côte inhospitalière. — L'île d'Oubouari. — Anthropophages. — Accueil flatteur des Ouavira. — Pas d'issue au Tanganyika. — Tempête. — Retour.
Fragment d'un voyage au Saubat (affluent du Nil Blanc), par M. Andrea Debono (1855).
Voyage à l'île de Cuba, par M. Richard Dana (1859).
Départ de New-York. — Une nuit en mer. — Première vue de Cuba. — Le Morro. — Aspect de la Havane. — Les rues. — La volante. — La place d'Armes. — La promenade d'Isabelle II. — L'hôtel Le Grand. — Bains dans les rochers. — Coolies chinois. — Quartier pauvre à la Havane. — La promenade de Tacon. — Les surnoms à la Havane. — Matanzas. — La Plaza. — Limossar. — L'intérieur de l'île. — La végétation. — Les champs de canne à sucre. — Une plantation. — Le café. — La vie dans une plantation de sucre. — Le Cumbre. — Le passage. — Retour à la Havane. — La population de Cuba. — Les noirs libres. — Les mystères de l'esclavage. — Les productions naturelles. — Le climat.
Excursions dans le Dauphiné, par M. Adolphe Joanne (1850-1860).
Le pic de Belledon. — Le Dauphiné. — Les Goulets.
Les gorges d'Omblèze. — Die. — La vallée de Roumeyer. — La forêt de Saou. — Le col de la Cochette.
Excursions dans le Dauphiné, par M. Élisée Reclus (1850-1860).
La Grave. — L'Aiguille du midi. — Le clapier de Saint-Christophe. — Le pont du Diable. — La Bérarde. — Le col de la Tempe. — La Vallouise. — Le Pertuis-Rostan. — Le village des Claux. — Le mont Pelvoux. — La Balme-Chapelu. — Mœurs des habitants.
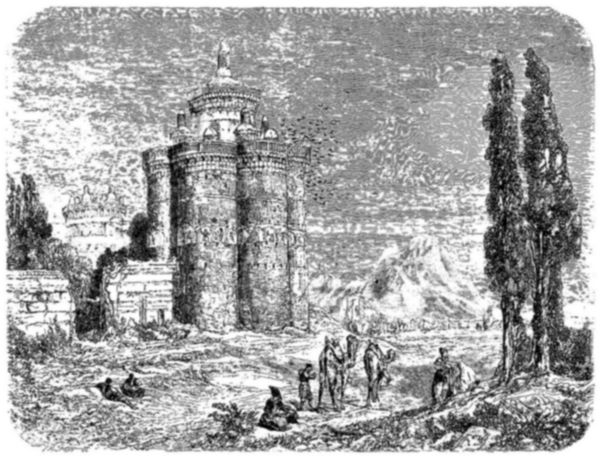
Pigeonnier près d'Ispahan.—Dessin de M. Jules Laurens.
PAR M. LE CTE DE GOBINEAU[1].
1855-1858
DESSINS INÉDITS DE M. JULES LAURENS[2].
Arrivée à Ispahan. — Le gouverneur. — Aspect de la ville. — Le Tchéar-Bâgh. — Le collége de la Mère du roi. — La mosquée du roi Les quarante colonnes. — Présentations. — Le pont du Zend-è-Roud.
..... À une heure de la ville, nous vîmes de loin apparaître le gouverneur, Tchéragh-Aly-Khan, sur un cheval turcoman blanc, superbement harnaché. Lui-même était vêtu d'un djubbèh ou robe couverte de cachemire, et à sa ceinture brillait un poignard enrichi de pierreries. Il s'arrêta d'abord pour faire ses compliments aux dames[3], ce qui nous parut extrêmement civilisé, et s'informa de leur santé avec beaucoup de (p. 018) grâce, puis, continuant sa route, arriva jusqu'à nous. Il y avait devant nous un état-major nombreux d'employés militaires et civils, beaucoup d'artilleurs, beaucoup de ghoulams (cavaliers d'escorte), bref, toute une cavalerie qui s'étendait à perte de vue sur deux ou trois lignes, et formait véritablement un spectacle d'une variété et d'une richesse merveilleuses.
Tchéragh-Aly-Khan est un fort bel homme, d'une figure intelligente et distinguée, et de la plus noble politesse. Après avoir rendu ses devoirs au ministre, il commença la conversation avec aisance et facilité, ce qui ne l'empêchait pas, tout le long du chemin, de voir ce qui se passait, et de donner de temps en temps des ordres qui s'exécutaient immédiatement sans cris et sans trouble. Par son origine, il appartient à une tribu nomade des environs de Kermanschah, et comme cette tribu est ancienne, il est bien né. Mais la fortune ne l'avait pas traité d'abord aussi bien que la naissance, de sorte qu'il se trouva lancé dans la vie avec beaucoup d'intelligence, d'esprit, d'ambition, et pas un sou. Il prit le parti que prennent tous ses compatriotes dans d'aussi graves conjonctures, il quitta son pays pour voyager, et devint domestique. Sa bonne étoile le fit entrer en cette qualité au service de Mirza-Taghy-Khan, alors membre persan de la commission de délimitation des frontières turco-persanes. Il remplit auprès de ce personnage les fonctions de sa charge, qui consistaient principalement à tenir le kalian (pipe d'eau); mais il trouva moyen de se faire connaître comme valant mieux que son emploi, et rendit des services qui appelèrent sur lui l'attention de son maître. Quand celui-ci devint premier ministre à l'avènement du roi actuel, Tchéragh-Aly-Khan fut élevé à une charge publique, et s'en acquitta avec beaucoup de distinction. Après la chute de son protecteur, il resta au service du roi, et nous le trouvions gouverneur d'Ispahan, c'est-à-dire à la tête d'une des plus grandes provinces de l'empire.
Tout en marchant de la sorte en grande ordonnance, nous sortîmes de la montagne et nous aperçûmes la ville au fond d'un amphithéâtre ouvert du côté du nord et de l'est, mais entouré de hautes montagnes vers l'ouest et le sud: ce premier coup d'œil est très-beau. Ispahan se présente environné de jardins et tout rempli de bouquets d'arbres que dominent les dômes d'un assez grand nombre de monuments. Mais au lieu de regarder en l'air, nous eûmes bientôt assez à faire de regarder à nos pieds. La foule devenait énorme; toute la population était sortie à notre rencontre; elle avait infiniment meilleure mine, et paraissait beaucoup moins frondeuse et moins triste qu'à Schyraz. Nous marchions dans des chemins abominables, ou plutôt dans un réseau de sentiers, les uns bas, les autres élevés, tous défoncés. Un lièvre partit dans nos jambes, à la grande satisfaction des gens du peuple et des ghoulams, dont plusieurs, malgré la gravité de la circonstance, ne résistèrent pas à la tentation, et coururent après.
Puis, nous franchîmes la porte, et là nous nous trouvâmes dans les champs cultivés, car cette porte s'ouvre sur un quartier qui n'existe plus que par ses ruines, au milieu desquelles poussent maintenant des légumes et des fruits. Nous arrivâmes au Zend-è-Roud, fleuve fameux où il y a, je crois, un peu plus d'eau l'été que dans le Manzanarès, mais guère davantage. Seulement il a la gloire de déborder en hiver et de se permettre quelquefois d'assez grands dégâts. Nous le passâmes sur un pont d'une architecture curieuse, et pas en trop mauvais état (voy. p. 21), puis nous entrâmes dans une longue avenue de platanes, avenue célèbre qui conduit au Tchéhar-Bâgh, et c'est dans cette réunion de palais que nous mîmes pied à terre. Nous étions logés dans un des plus beaux et des plus commodes, l'Imarêt-è-Sadr.
Ispahan est sans doute assez délabré. De six à sept cent mille habitants qu'il avait au dix-septième siècle, il n'en compte maintenant, dit-on, que cinquante à soixante mille; partant, les ruines y abondent, et des quartiers tout entiers ne montrent que des maisons et des bazars écroulés, où à peine quelques chiens errants se promènent. Tout a frappé cette ville depuis l'époque qui a mis fin à sa splendeur. Être prise d'assaut par une armée afghane est assurément une calamité au premier chef, et traverser toutes les phases de l'anarchie et de la guerre civile est peu propre à rien réparer. Malgré de telles destinées, Ispahan est encore une merveille. Cette réunion de palais, qu'on nomme le Tchéhar-Bâgh, et où nous étions logés, est probablement un lieu unique dans le monde; il n'est que la Chine dont les résidences impériales, avec leurs vastes jardins et leurs constructions multipliées, doivent peut-être beaucoup y ressembler. Je ne fais pas cette comparaison au hasard. Le style des plus anciens monuments d'Ispahan, l'ornementation, les peintures, portent le cachet évident du goût chinois, et rappellent les relations étroites que la conquête mongole et ensuite le commerce avaient créées entre les deux empires. Les longues avenues de platanes que décrit Chardin ont beaucoup souffert certainement, mais ce qui en reste porte témoignage de la beauté parfaite de ce qui a disparu. Le Tchéhar-Bâgh en contient encore de belles rangées qui sont comme un boulevard magnifique bordé de monuments dignes des arbres, et interrompues de distance en distance par de grands bassins d'eau formant autant de ronds-points. Le milieu des avenues est dallé, et, suivant l'usage des jardins persans, s'élève d'un pied environ au-dessus du sol, couvert de grandes herbes et de rares fleurs. Où l'on aperçoit bien que cette magnificence n'est plus que l'ombre du passé, c'est d'abord dans la solitude profonde de ces avenues que la population actuelle a désertées, et que d'ailleurs elle ne suffirait pas à remplir. Puis les eaux sont stagnantes dans les bassins où jadis elles couraient vives et fraîches; enfin, au lieu des jardins qui longeaient des deux côtés la chaussée principale et la séparaient des deux petites chaussées établies le long des bâtiments, on ne voit presque plus que des herbes, comme je l'ai dit, poussant désordonnées, et laissant encore apparaître ça et là quelques têtes de vieux (p. 019) arbustes à demi morts. Enfin les dalles de la chaussée sont en grande partie brisées ou ont disparu. Malgré cette désolation, il y a bien de la grandeur et de l'élégance dans ces restes du Tchéhar-Bâgh.
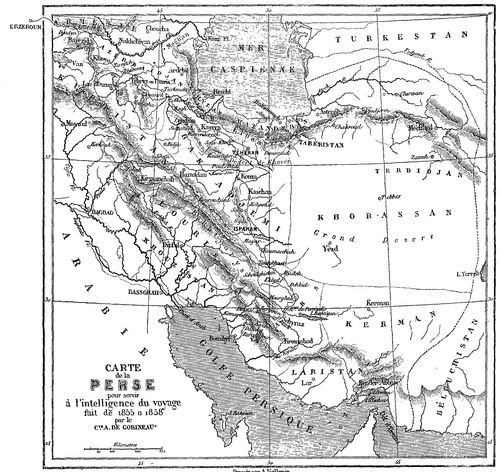
CARTE de la PERSE
pour servir à l'intelligence du
voyage fait de 1855 à 1858
par le Cte. DE GOBINEAU.—Dressée par A.
Vuillemin.
Plusieurs des édifices qui longent ce boulevard sont cependant en bon état. Ils ont échappé à la destruction et on les voit aussi jeunes que jamais. Il en est ainsi du collége appelé collége de la Mère du roi et fondé par une princesse Séfévy. Ce monument merveilleux a même conservé, et c'est presque un miracle, sa porte couverte de lames d'argent ciselées. Autant que je me le rappelle, celui qui a accompli ce beau travail a écrit son nom dans un coin, et il était de Tébryz. On ne peut rien admirer de plus élégant que cette orfévrerie grandiose. Les dessins se composent d'enroulements de feuillages et d'inscriptions arrangées à la façon arabe, c'est-à-dire de manière à fournir le principal motif d'ornementation. Je regrette de ne pas me souvenir du nom de l'auteur de cette œuvre pleine de goût et de talent. Il faut dire aussi que l'artiste travaillait pour une personne qui voulait témoigner grandement de son respect pour la science.
La princesse qui fit faire cette porte et le collége où nous allons entrer, se proposa de créer pour l'étude et la méditation un lieu d'asile où rien ne pût les troubler. Elle voulut que les yeux satisfaits laissassent à l'âme une pleine liberté et tinssent l'intelligence en joie. Par la splendeur de la porte qui devait conduire dans le sanctuaire, elle indiquait dès l'abord quel lieu charmant son collége devait être.
En effet l'entrée n'annonce rien de trop; quand on l'a franchie, on se trouve dans un petit préau dallé, où se tiennent des marchands de fruits et des kalians, toujours (p. 020) à la disposition des maîtres et des étudiants. De grands arbres projettent leur ombre sur l'arcade de la porte et sur les amoncellements de pêches, d'abricots, de melons, de pastèques et les monceaux de glace qui remplissent ce vestibule ouvert. De là on pénètre dans un grand jardin carré, formé de quatre massifs où dominent d'immenses platanes entourés de rosiers et de jasmins non moins énormes dans leur espèce. À l'extrémité des allées se présentent trois portes colossales qui donnent accès dans de vastes salles couvertes d'un dôme. Elles sont flanquées chacune de deux petits minarets terminés aussi en dôme, et le tout est revêtu d'émail bleu, brodé d'inscriptions koufiques et d'arabesques noires, blanches et jaunes. Pour se faire quelque idée de ses portes, il faut savoir que leur hauteur égale celle de nos plus hauts portails. Les quatre angles qui les réunissent sont formés de quatre corps de logis également revêtus d'émaux, mais beaucoup plus bas que les portes, et percés, comme des ruches d'une infinité de cellules. C'était là que, sans rétribution aucune, on logeait les étudiants accourus de toutes les parties du monde musulman pour entendre les savants professeurs; et une fois par semaine, la fondatrice venait, accompagnée de ses femmes, prendre le linge des habitants du collége et en apporter d'autre. Elle avait soin aussi de se faire rendre compte de tous les besoins de ses hôtes, voulant expressément qu'aucun souci, aucun ennui ne pût les distraire du but qu'ils avaient assigné à leur vie; et elle s'était donné pour tâche de leur en faciliter la poursuite autant qu'il était en elle. On ne peut s'imaginer, sans l'avoir vu, quel bijou est ce collége de la Mère du roi (voy. p. 24). C'est un vase d'émail, c'est un joyau au milieu des fleurs. Je comprends à merveille qu'on puisse s'y livrer avec passion à la vie contemplative; mais c'est bien le plus mauvais endroit du monde pour se convaincre que les biens terrestres ne sont rien; on dirait qu'il a été bâti pour prouver le contraire. Dans tous les cas, c'étaient et ce sont encore d'heureux savants que ceux dont l'existence s'écoule dans cet aimable séjour. Comme je l'ai dit en commençant, ce collége est en son entier, il n'y manque pas une brique; et quand on songe que tous les monuments d'Ispahan ont été un jour dans cet état parfait, on est comme ébloui d'une telle idée.
Il ne faut cependant pas s'imaginer qu'il y ait jamais eu un moment où cette grande capitale ne renfermât pas de ruines. Ce n'est pas une chose possible en Asie. Dans les contes qui nous parlent de Bagdad au temps des khalifes abbassides, à l'époque d'Haroun Arraschyd lui-même, il est question de quartiers ruinés, compris dans les limites d'une cité qui n'avait pas alors d'égale dans le monde musulman ni chrétien, à l'exception de Constantinople et d'Alexandrie. Shah-Abbas le Grand lui-même, si jaloux de la beauté de sa grande ville et qui l'embellit de tant de merveilles, s'il fut un infatigable constructeur de palais, de caravansérails, de mosquées et de colléges, se soucia peu de relever les édifices de ses prédécesseurs. Seulement il est clair que, de son temps, les monuments debout dépassaient en nombre ceux qui se dégradaient, et que les maisons en construction ou nouvellement construites l'emportaient sur celles qu'on laissait s'écrouler.
Il ne faut pas non plus se plaindre trop amèrement des ruines, quand toutefois elles sont contenues dans de certaines limites. Leur présence fait partie nécessaire de la physionomie d'une cité persane, et je n'ai pas, au point de vue du goût, un culte si passionné pour la régularité, la symétrie et la belle ordonnance, pour les alignements corrects, les trottoirs bien raccordés et les coins de rue irréprochables, que je sois en droit de pousser des soupirs bien profonds à la vue de quelques bâtiments écroulés.
La mosquée du roi est grande et noble. Son dôme d'émail bleu travaillé d'arabesques jaunes à grands ramages est d'une rare magnificence. Cependant le voisinage de la place ou meydan lui fait du tort. Ce grand quadrilatère est si étendu, que tous les monuments qui le bordent, et la mosquée du roi comme les autres, semblent petits. C'est là que se donnaient, sous les Séfévys, et que se donnent encore aujourd'hui, mais avec beaucoup moins de splendeur, les fêtes publiques. Les rois, comme Shah-Abbas, assistaient aux solennités du haut d'une porte immense, appelée Aly-Kapy. C'est un belvédère de dimensions colossales, où pouvaient tenir toute la cour, les grands officiers, les grands moullahs, les envoyés étrangers, les chefs des tribus nomades.
De cette vaste tribune on découvre non-seulement la cité, mais toute la campagne aux environs. C'est d'un aspect grandiose. Rien ne m'étonna autant, parmi les tableaux et les objets variés qui s'étendaient de toutes parts, que de voir, autour du dôme de la mosquée royale, certains grands échafaudages qui y avaient été attachés. L'explication qu'on m'en fit acheva de me confondre. Le roi a ordonné, il y a plusieurs années, de réparer cette mosquée et de lui rendre sa magnificence première. C'était la seule fois où l'on eût parlé de restaurer des monuments, et c'est une pensée qui fait d'autant plus d'honneur au roi, qu'elle est tout à fait nouvelle dans son pays. Mais malheureusement l'exécution rentrait un peu trop dans les habitudes nationales. Les mandataires royaux avaient bien fait élever des échafaudages, mais on ne travaillait pas; seulement on touchait régulièrement les sommes allouées. Probablement on les touche encore et on les touchera longtemps après que la mosquée n'existera plus.
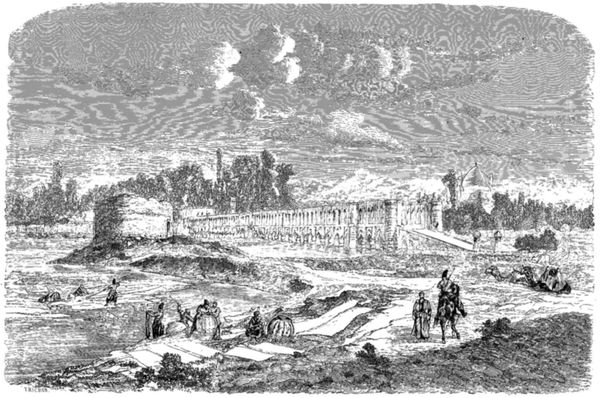
Pont d'Allah-Yerdi-Khan sur le Zend-è-Roud,
à
Ispahan.—Dessin de M. Jules Laurens.
Les palais d'Ispahan ont été décrits trop de fois pour que j'y revienne. Je remarquerais seulement que le Tchéhèl-Soutoun, ou les Quarante-Colonnes, un des plus anciens et des plus splendides, est doublement intéressant comme offrant les exemples les plus frappants de l'appropriation du goût chinois à l'ornementation persane, et contenant les peintures les plus remarquables qu'on puisse voir en Perse (voy. p. 25). Sur le premier point, il y a beaucoup d'intérêt pour l'histoire de l'art à observer comment les artistes des Séfévys s'y sont pris pour associer des motifs d'architecture et un certain style d'arabesques empruntés au palais de Nanking, avec ce que la haute antiquité leur avait traditionnellement livré de sujets assyriens et perses. L'effet est extrêmement riche (p. 022) et heureux, et c'est là qu'on peut s'assurer plus pleinement qu'ailleurs de cette grande vérité, qu'en fait d'art, les Persans d'aucun temps n'ont jamais rien inventé, mais qu'ils ont su tout prendre, tout garder, ne rien oublier, et fondre leurs acquisitions dans un ensemble si heureusement lié, qu'il a l'air de leur appartenir, et qu'on en jurerait, si l'analyse ne venait démontrer le contraire. Ce que les Persans ont possédé au plus haut degré, c'est l'esprit de compréhension, la puissance de comparaison, et une sorte de critique qui leur a permis de combiner avec bonheur des éléments parfaitement étrangers les uns aux autres. Je suis persuadé que c'est en étudiant les procédés de l'art persan que l'on arrivera à comprendre beaucoup de choses encore aujourd'hui parfaitement inconnues en ces matières. En se plaçant sur ce terrain, on pourrait pénétrer bien des mystères de l'origine de l'art byzantin et de l'art sarrasin. La Perse est comme un foyer où les idées et les inventions des pays et des pensées les plus lointains sont venues se confondre. À lui seul, le Tchéhèl-Soutoun me paraît fournir bien des révélations.
Pour ce qui est de la peinture, les grandes fresques murales qu'on y remarque, et qui représentent surtout des batailles, sont d'une beauté incontestable comme couleur. Pour le dessin de l'agencement des figures, c'est à peu près complètement le style de nos plus anciennes tapisseries, ou, pour mieux dire, nos plus anciennes tapisseries se sont faites d'après ce style-là. J'en verrais volontiers la source dans les œuvres de la basse époque sassanide. Ce temps a encore un droit de paternité sur ce travail maigre et sec, mais de paternité malheureusement éloignée, et jamais, depuis le troisième siècle de notre ère, on n'a revu dans l'Asie centrale les œuvres grandioses et magnifiques qui ont illustré le règne des premiers descendants d'Ardeschyr. Telles qu'elles sont, cependant, les peintures du Tchéhèl-Soutoun ne sont pas méprisables, et on en tiendra grand compte lorsqu'on aura compris à quel point l'histoire de l'art asiatique, et je dis l'histoire moderne tout autant que l'histoire antique, est indispensable et de première nécessité pour l'histoire de l'art européen.
Toujours au point de vue critique, je signalerai encore à Ispahan un petit palais qui emprunte à la date de sa construction un intérêt particulier. Ce palais est moderne. Il existe dans le Tchéhar-Bâgh depuis une quinzaine d'années environ, et c'est un vrai bijou. Il contient une salle carrée, éclairée par en haut, formée d'une galerie circulaire soutenue par des colonnes plaquées de miroirs ajustés en losanges, ayant au centre un bassin d'albâtre oriental garni d'une quantité de jets d'eau à filets très-minces, et le tout orné des peintures, des sculptures en bois, des émaux ordinaires. Dans le plan, cet édifice est irréprochable. Il reproduit les meilleurs modèles du seizième et du dix-septième siècle, qui sont restés les prototypes de l'art national. Seulement, dans l'exécution des détails, on sent partout que les constructeurs du palais n'ont eu à leur disposition que des ouvriers adroits, et point d'artistes véritables. La faute en est à la pauvreté actuelle du pays, qui ne permet pas souvent d'entreprendre rien de semblable. Il en résulte que peu de gens habiles peuvent se former, faute d'occasions. Mais le seul fait que de nos jours on a pu imaginer et créer cette jolie résidence, prouve suffisamment que le goût n'est pas mort, et que si la situation présente se soutient et que les fortunes puissent suivre le mouvement ascendant qu'on remarque en toutes choses, dans une cinquantaine d'années les bons artistes auront reparu, si toutefois la rage de l'imitation européenne et d'avoir des appartements soi-disant à notre mode ne vient pas tout gâter, ce dont il ne faudrait pas jurer.
Nous ne fûmes pas tellement absorbés par l'admiration du Tchéhar-Bâgh que nous ne prissions aussi le temps d'aller à Djoulfâ. Nous avions des raisons de premier ordre pour visiter ce faubourg où Schah-Abbas le Grand avait établi les Arméniens attirés par lui en Perse et auxquels il accorda de grands priviléges. Nous devions rendre nos devoirs à Mgr Tylkyan et également au délégué du patriarche schismatique.
Nous passâmes donc le pont du Zend-è-Roud, avec lequel nous avions déjà fait connaissance à notre arrivée, et nous nous rendîmes dans l'ancien couvent des jésuites français. Le gouvernement des Séfévys avait été très-généreux à l'égard de ces missionnaires. Il leur avait accordé des maisons et des jardins où les bons pères pratiquaient, avec leur intelligence ordinaire, d'excellentes méthodes de culture. Quand les malheurs qui ont accablé la Perse pendant le siècle dernier se furent déchaînés sur Ispahan, la mission en souffrit naturellement. Son influence fut perdue. Le désordre du temps rendait sa situation difficile; elle cessa de se recruter. D'autre part, la population chrétienne qui l'entourait et qui était uniquement composée d'Arméniens, fut dispersée. Tout périt. L'établissement fondé avec tant de peine disparut. Mais l'équité veut aussi qu'on remarque bien que les musulmans ne souffraient pas moins que les chrétiens au milieu de cette épouvantable anarchie, et, si Djoulfâ était frappé, Ispahan n'était pas en meilleur état. Enfin, la dynastie actuelle rétablit la paix, et, avec la paix, les envoyés de la propagande revinrent. Ils retrouvèrent les biens des jésuites. On les leur laissa prendre sans difficulté. Un petit troupeau assez faible se reforma autour d'eux, et aujourd'hui ils végètent, fort pauvres, mais tout à fait libres. Ce sont, comme je l'ai dit, des Arméniens catholiques ne sachant aucune langue européenne. Ils ignorent même le persan, et communiquent avec les autorités locales au moyen du turc. J'ai vu, entre leurs mains, l'ancienne bibliothèque des pères jésuites, qui m'a semblé intéressante, et j'ai regretté que le temps m'ait manqué pour la visiter en détail. Je dois avouer, à ma honte, que mes vénérables conducteurs ne paraissaient pas fort tranquilles sur mes intentions, et désiraient visiblement que j'abrégeasse mon séjour dans ce sanctuaire mystérieux. Ils ne savaient pas ce que contenaient ces volumes rangés sur deux tablettes depuis tant d'années sans que personne les eût jamais ouverts, mais ils se considéraient comme responsables du dépôt et n'aimaient pas à le laisser voir.
(p. 023) Un dîner à Ispahan. — La danse et la comédie.
Tchéragh-Aly-Khan et notre Mehmandar[4] nous annoncèrent qu'ils voulaient nous donner un dîner; mais, pour nous éviter la gêne des habitudes persanes, trop nouvelles pour nous, ils avaient l'intention de se régler sur notre mode. La chose convenue ainsi, on dressa le couvert au milieu du talar de notre palais. Bien qu'il dût y avoir une vingtaine de convives, la longue table se perdait dans l'immense espace. Comme d'ordinaire, le devant du théâtre était ouvert, soutenu par deux hautes colonnes peintes de couleurs vives; le grand voile d'usage, blanc, à dessins noirs, s'étendait en abat-jour sur la partie du jardin la plus rapprochée; nous avions vue sur un grand bassin d'eau courante et sur des massifs de platanes; de nombreux serviteurs bigarrés, vêtus, armés chacun suivant son caprice, et quelques-uns portant un arsenal complet, se tenaient par groupes au bas de la terrasse, ou circulaient dans le talar avec les plats, les kalians, ou bien servant.
La table avait été arrangée, avec l'aide de nos domestiques européens, un peu à la mode d'Europe, beaucoup à la façon persane: la ligne du milieu était occupée par une forêt de vases, de coupes, de bols de cristal bleu, blanc, jaune, rouge, remplis de fleurs; il y avait des fleurs partout; il y en avait à profusion. Pour nous, cet amoncellement de couleurs variées et désordonnées était un peu nouveau, mais non sans élégance; pour nos hôtes, la nouveauté consistait dans les cuillers et les fourchettes qui les attendaient et dont ils allaient faire l'épreuve. Ce dîner fut très-amusant: j'avais à côté de moi deux Persans, un frère d'Aly-Khan et un Ispahany; ils s'escrimaient de leur mieux à saisir quelque chose dans leur assiette avec les instruments inconnus dont on les avait gratifiés, et se complimentaient mutuellement lorsqu'ils avaient réussi à porter un morceau à leur bouche sans se piquer, ou même en se piquant. Ainsi que le prescrivaient les lois de la politesse, ils s'exclamaient à qui mieux mieux sur les avantages de notre méthode, sur ses mérites infinis, et sur la facilité avec laquelle ils la pratiquaient. Certains mets leur paraissaient surtout excellents, et parmi ceux-ci ils remarquèrent la moutarde: l'un d'eux en remplit son assiette et déclara qu'il n'avait jamais rien mangé de si bon. Comme, en somme, leur dîner se passait en une sorte de gymnastique qui ne devait pas les nourrir beaucoup, je les engageai tout bas à ne pas pousser la politesse plus loin et à se servir à leur guise, pour ne pas sortir de table affamés; ils firent beaucoup de façons, mais enfin ils adoptèrent un moyen terme: tenant de la main gauche leur fourchette en l'air, ils saisirent les morceaux avec la main droite, et remarquèrent que de même que la France et la Perse ne pouvaient que gagner à leur mutuelle amitié et à leur union, de même, en combinant les deux manières de procéder, on arrivait à la perfection. Ce qui est certain, c'est qu'ils dînèrent.
Au milieu du repas, on entendit un bruit argentin comme celui de petites sonnettes, et l'on vit entrer quatre jeunes garçons, habillés en femmes, avec des robes roses et bleues semées d'oripeaux; c'étaient des danseurs: ils portaient les cheveux longs, tombant sur les épaules et couverts de ces petites calottes dorées, appelées araktjyns, qu'on peut voir sur toutes les peintures persanes à sujets féminins. Ces danseurs n'étaient pas très-habiles, sans doute; mais je n'avais pas de point de comparaison, et ce spectacle me parut très-intéressant. On peut dire des Asiatiques, en général, qu'ils sont gracieux dans leurs mouvements. Pour les Persans surtout, c'est vrai, et particulièrement chez les enfants. Une des danses qu'on exécuta s'appelle la hératy, et s'accompagne d'un air portant le même nom et qui a beaucoup d'agrément; les musiciens, suivant l'usage, s'étaient assis par terre, dans un coin; l'un jouait d'une espèce de mandoline appelée târ, l'autre du dombeck, ou petit tambour à main, enfin un troisième du centour, instrument qui consiste en une série de cordes ajustées sur une table, et d'où l'on tire avec de petites baguettes des sons assez semblables à ceux de la harpe. Après la hératy, ce que nous vîmes de mieux, c'est une sorte de pantomime rhythmée, qu'on pourrait intituler la Journée d'une élégante. La jeune femme débute par se quereller avec son mari, puis elle a de l'humeur, puis elle boude, puis elle s'habille pour sortir, puis elle entre chez une de ses amies, à qui elle rend visite. On peut deviner que c'était un thème à déployer beaucoup de coquetterie d'allures et de gentillesse. Le jeune danseur chargé de ce rôle, ne s'en tira pas trop mal.
Après les danseurs vinrent les farces. Une troupe de comédiens joua des scènes populaires en patois d'Ispahan. On fut obligé de corriger et d'abréger beaucoup, car ces espèces de saynètes, qui représentent d'ordinaire les ruses des moullahs, les concussions des juges, les perfidies des femmes, les coquineries des marchands et les querelles de la canaille, sont composées avec une verve qui ne ménage rien et que rien n'arrête. Je doute que les tréteaux de Tabarin aient approché de cette liberté, et les plus virulents chapitres de Rabelais sont de l'eau de rose en comparaison. Cette fois, Tchéragh-Aly-Khan ne permit pas à la vivacité des acteurs de se donner carrière, et lorsqu'il les voyait s'échauffer et s'animer un peu, il intervenait; de sorte que tout resta dans les limites de la convenance. En somme, la soirée fut charmante, et nous fûmes très-satisfaits du dîner et du divertissement persans.
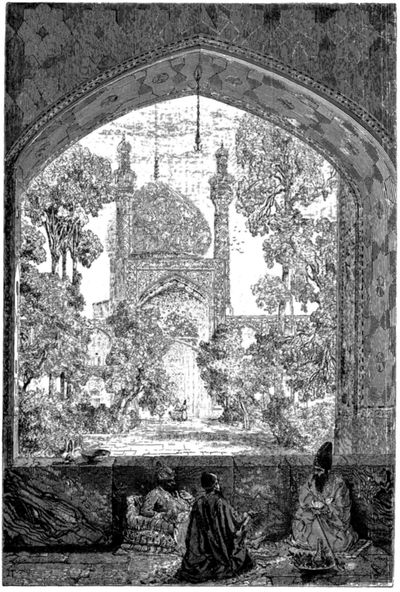
Collége de la Mère du roi, à Ispahan
(voy. p.
20).—Dessin de M. Jules Laurens.
Les habitants d'Ispahan.
Les habitants d'Ispahan, sans être tout à fait aussi mal famés que les Schyrazys, ne jouissent pas non plus d'une réputation très-brillante. On dit la lie du peuple de cette ville une des plus mauvaises de l'empire. Elle fournit à toutes les autres cités les plus rusés et les plus voleurs des courtiers. Pour exprimer leur opinion sur ce sujet, les Persans rapportent un hadys, une tradition (p. 025) sacrée dont l'authenticité n'est pas d'ailleurs à l'abri de toute critique. Son Altesse le Prophète, racontent-ils (Que le salut de Dieu soit en lui et qu'il soit exalté!), dit un jour: «O Seigneur du monde, faites que Bahreyn soit ruinée et qu'Ispahan prospère!» Il indiquait par là que Bahreyn étant une ville habitée par des gens bons et vertueux, il était à souhaiter qu'elle disparût pour que sa population se répandît dans le reste de l'univers et y portât l'exemple et la contagion de ses mérites. Mais Ispahan, au contraire, laissant beaucoup à désirer, quant aux qualités de ses habitants, il était bon que ceux-ci se confinassent chez eux, et, contents de leur prospérité, n'allassent pas troubler le monde.
Il y a à Ispahan beaucoup de gens instruits dans tous les genres, des marchands riches ou aisés, des propriétaires qui vivent en rentiers et ne recherchent pas les emplois publics, enfin tout un fonds d'existences calmes, tranquilles et honnêtes, qui est comme le reflet de l'ancienne splendeur de la capitale des Séfévys. À beaucoup d'égards, mais en plus grand, je crois que l'on pourrait comparer Ispahan à Versailles.
Je garde à cette cité déchue un très-tendre souvenir. Elle n'est pas belle comme le Caire, mais délicieuse comme un rêve, et si elle n'a pas le sérieux et la majesté grave d'une ville construite en pierres de taille, il faut convenir que ces immenses édifices peints, dorés, couverts d'émaux, ses murs bleus ou à grands ramages, qui reflètent les rayons du soleil, ses vastes bazars, ses jardins immenses, ses platanes, ses roses, en font le triomphe de l'élégant et le modèle du joli. Ispahan n'a pu être conçu et exécuté que par des rois et des architectes qui passaient leurs jours et leurs nuits à entendre raconter de merveilleux contes de fées.

Une peinture indienne dans le palais des
Quarante-Colonnes, à Ispahan
(voy. p. 20).—Dessin de M. Jules
Laurens.
Il n'est jamais agréable de laisser un lieu où l'on est bien, mais il est plus désagréable encore de passer de ce bon logis dans un autre plus mauvais. En quittant Ispahan, nous allions constater par nous-mêmes la distance qui sépare les monuments de sa grandeur des ruines de sa décadence.
D'Ispahan à Kaschan.
Le jour de notre départ nous ne fîmes que trois heures de marche, d'après le principe immuable qu'on ne doit jamais s'éloigner beaucoup au premier début d'un voyage.
La marche du lendemain fut aussi peu attrayante que celle de la veille. Jamais je n'ai vu désert si laid. Le ciel était couvert et le vent du sud-est, qui nous poursuivait, ne nous laissait ni la liberté de parler sans étouffer, ni la possibilité de nous entendre. Nous eûmes donc cinq heures de route fort désagréables. La nuit le fut plus encore. L'air était si singulièrement rafraîchi sur les hauteurs où nous nous trouvions, qu'enveloppés dans des couvertures de laine et des vêtements ouatés, nous étions transis de froid; pour comble d'agrément, le vent, ayant redoublé de furie, faisait un vacarme tel sous les tentes, que nous nous attendions à chaque instant à les voir emportées. Ce qui ne se réalisa pas pour nous arriva à nos Kavas arabes. Au petit jour, leur abri leur tomba sur la tête et on les tira avec peine de dessous l'amas de toile qui les étouffait. Pour s'habiller, il fallut poursuivre dans la plaine les vêtements dont le vent s'était emparé. Un des membres de la caravane fit le bonheur général par son obstination à rattraper à la course un faux-col que l'aquilon ne voulait pas lui rendre.
Décidément, il faisait moins que chaud, même de jour. Nous étions transportés soudainement dans un climat du Nord. Il n'y avait pas d'ailleurs trop à s'en plaindre. Les chevaux n'en marchaient que mieux. Après six heures, nous arrivâmes à Soôu et nous nous aperçûmes tout d'abord que notre veine d'infortune était épuisée pour quelque temps. C'est une charmante petite ville avec des constructions à plusieurs étages et un beau caravansérail. Le pays est très cultivé très-boisé.
(p. 026) Presque au sortir de Soôu, nous rencontrâmes la grande caravane d'Ispahan à Téhéran qui, changeant ses allures ordinaires, celles d'une sage lenteur, se mit à notre pas et ne nous quitta plus. Tout cela était irrégulier et avait besoin d'explications. Voici ce qui arrivait.
Le gouverneur d'Ispahan, Tchéragh-Aly-Khan, avait reçu l'annonce de son rappel. Il allait quitter sa ville, et ses bagages, confiés à la caravane, avaient été expédiés sur Téhéran. Mais, à peine parvenu à Gyat, cette caravane avait appris que deux cents cavaliers bakthyarys s'étaient réunis dans la montagne pour fêter les bonnes prises que le ciel leur adressait: d'une part, un envoyé européen avec des caisses de cadeaux destinés au roi.... et l'imagination, Dieu merci, pouvait se donner carrière sur la richesse de ce contenu! et de l'autre, les dépouilles du gouverneur d'Ispahan, sans compter les menus suffrages représentés par les biens des marchands de la caravane. Notre Mehmandar, heureusement, avait été également prévenu; et c'était là le motif de ses préparatifs militaires. À Soôu, on avait craint d'être attaqué la nuit, et l'on avait retenu le matériel des tentes afin de tout escorter ensemble; sur la route, même de jour, on redoutait une embuscade. Enfin nous arrivâmes à Kohroud sans avoir vu l'ennemi. Les Bakthyarys, informés de la bonne tenue de notre monde, reconnurent que l'affaire pourrait être plus chaude que fructueuse, et s'en retournèrent chez eux. Une fois à Kohroud, il n'y avait plus de risques à courir; on se trouvait hors du rayon de leurs courses.
Le pays que nous traversâmes avait été réellement créé par la nature pour les expéditions du genre de celle dont nous avions été menacés. Ce n'est que défilés, descentes, montées, passages rudes et étroits. Plusieurs fois, nous nous trouvâmes mêlés aux gens de la caravane, qui croyaient ne pouvoir se tenir trop près de nous. On y voyait des moullahs sur des ânes, des femmes voilées dans des paniers, des marchands, des gens de toute sorte sur leurs chevaux. Pendant ce temps, et malgré la gravité des circonstances, Aly-Khan chassait au faucon, ce qui était aussi une manière d'observer le terrain. Il prit quelques perdrix. Nous mîmes pied à terre et nous fîmes une partie du chemin en marchant, remarquant et cueillant au milieu des rochers et des pierres de la route toutes sortes d'herbes et de plantes aromatiques. Nous avions avec nous un enfant arabe d'une dizaine d'années, Azoub, joli et bien élevé, fils d'un négociant de Bagdad. Il donnait la main à ma fille, l'aidait dans les petites difficultés du chemin, en cherchant à causer avec elle. C'étaient des mots français coupant des phrases arabes, et des rires d'oiseaux connus des enfants de tous les pays. Ainsi nous arrivâmes à Kohroud.
Toute cette journée avait été très-fraîche. Les Persans, avec leur amour immodéré pour le froid, étaient enchantés et nous vantaient Kohroud. Sans nous insurger contre cette opinion, nous en tirions des pronostics douteux pour le repos de la nuit, et nous eûmes malheureusement assez raison, car toutes les précautions possibles furent impuissantes contre la rigueur de la température. Aussi le signal du départ ne nous trouva pas récalcitrants, et, tout transis, nous montâmes à cheval, enchantés de nous éloigner de cette zone glaciale.
Après trois heures de marche employées à tourner dans une espèce de labyrinthe descendant qui nous conduisait hors des montagnes, nous débouchâmes à l'entrée d'une plaine sans limites, vaste désert couvert de cailloux, où nous fûmes pris à partie par un soleil des tropiques. L'air était pour ainsi dire enflammé. On voyait miroiter l'atmosphère, comme il arrive vers la fin d'un bal, quand les bougies brûlent sans que la flamme remue. Mais il n'y avait pas à se plaindre, tout se passait suivant la règle: nous étions dans la plaine de Kaschan, un des lieux les plus brûlés et les plus brûlants de l'Asie. Pour distraction, nous avions à chercher des yeux la grande production du pays, les scorpions, et, en effet, on en voyait quelques-uns se promenant entre les pierres qui leur servaient de domicile.
Ainsi éprouvés par un changement de température beaucoup plus complet que nous ne l'avions désiré, nous sûmes d'abord un gré très-médiocre au Mehmandar et au gouverneur de Kaschan, Mirza-Ibrahim-Kan, d'une attention délicate dont le premier acte consista à nous faire faire neuf heures de marche sous l'œil de ce soleil. À la vérité, ce fut une marche triomphale. Tout ce qui possédait un cheval à Kaschan était venu au-devant de nous, et entre autres le fils du gouverneur, Mirza-Taghy-Khan, jeune administrateur de la plus belle espérance, mais peu chargé d'années: il n'avait que six ans.
Malgré la vue de tout le peuple de Kaschan, venu au-devant de nous, y compris la communauté juive, l'impatience nous prenait un peu d'une route aussi longue, quand, à la fin, nous arrivâmes, et la première vue de notre logis dissipa comme une fumée notre mécontentement. Des murmures nous passâmes à des sentiments de gratitude très-mérités. On nous avait fait éviter l'air brûlant de la ville et on nous mettait à une demi-heure de là dans un palais nommé Fyn et appartenant au roi.
Peu de jardins sont comparables à ceux de ce délicieux séjour. Les plus belles eaux, les plus limpides, les plus fraîches, y courent dans des bassins et à travers des canaux d'émail bleu. Il ne se peut rien voir de plus gai. Un de ces bassins est petit, profond de quatre à cinq pieds, peuplé de poissons rouges et encadré dans un pavillon de peinture. L'autre, carré, a bien cinquante pas de chaque côté et la même profondeur. Le tout avec les immenses platanes ordinaires et des fleurs à profusion. Au milieu du parc, une de ces constructions à jour que les Persans appellent koulah-é-ferenghy, un chapeau européen, parce que la toiture est en effet bombée et à larges rebords, nous donnait la fraîcheur de son ombre. Auprès, s'étendaient les vastes bâtiments du harem.
Kaschan. — Ses fabriques. — Son imprimerie, lithographique. — Ses scorpions. — Une légende. — Les bazars. — Le collége.
Le gouverneur nous avait fort engagés à voir Kaschan. En effet, nous n'y pouvions manquer, car Kaschan est une des grandes villes de l'empire.
(p. 027) Sa réputation est très-mélangée de bien et de mal, et il y a beaucoup de choses à en dire. C'est une des cités les plus manufacturières de la Perse. On y fabrique, à un bon marché extraordinaire, des soieries légères d'une si bonne teinture qu'on les lave sans inconvénient. On y fait aussi beaucoup de chaudronnerie, et, sous ce rapport, Kaschan partage avec Ispahan l'avantage de fournir la Perse occidentale de vases de cuivre de toutes les formes et de toutes les grandeurs, étamés ou non, simples ou gravés de figures et de fleurs. On y remarque entre autres des tasses et des plats couverts, de formes très-jolies, très-variées, et ornés de peintures bleues, rouges, vertes, simulant l'émail. L'inconvénient de ce genre de travail est de ne pas supporter l'eau. Mais l'effet en est agréable. Tout ce commerce est bien loin d'être aujourd'hui ce qu'il était il y a cent cinquante ans. Alors ce n'étaient pas seulement des soieries légères qu'on fabriquait à Kaschan, mais des damas, des étoffes brochées d'or et d'argent, surtout des velours d'une grande beauté. Ce qui ajoutait au singulier mérite de toute cette fabrication, c'était le bon marché extraordinaire des produits. Aujourd'hui il ne reste guère que l'échantillon de ce que les Kâschys ont su faire et pourraient faire encore.
S'ils ont une réputation de bons manufacturiers et d'ouvriers adroits, ils y ajoutent aussi celle d'être très-aptes à la littérature. Ils ont fourni beaucoup d'hommes remarquables dans la poésie, la philosophie, et surtout les sciences théologiques. Il y a à Kaschan une imprimerie lithographique qui produit d'assez bons ouvrages, et le nombre des hommes qui s'y occupent de cultiver leur esprit ne laisse pas que d'être considérable. Enfin, les Kâschys sont essentiellement gens de bonne compagnie. Mais, comme toute chose en ce monde a un revers, on les accuse d'être des guerriers plus que médiocres, et les anecdotes ne tarissent pas sur leur peu de vocation pour le maniement des armes. Jamais, dit-on, homme de guerre n'est sorti de leurs murs, et le gouvernement n'oserait pas composer un régiment de Kâschys. Kaschan est la ville favorite et comme la capitale des scorpions. En aucun pays de la Perse il ne s'en trouve autant. Ces insectes venimeux habitent dans tous les murs, y sortent de dessous toutes les pierres, à moins qu'on n'emploie des moyens particuliers pour s'en débarrasser. Ainsi, le gouverneur nous montra une maison qu'il venait de faire construire. Elle était fort belle, très-élégante et très-bien entendue; mais son principal mérite consistait en ce que les quatre coins avaient été soumis à un enchantement d'une telle force que jamais les scorpions ne pourraient y pénétrer sans qu'on le voulût. C'était assurément un avantage incontestable.
Il y a presque aux portes de la ville un vaste monticule formé par les décombres d'un édifice écroulé, qui est loin de jouir d'une si heureuse prérogative. Il a, tout au contraire, le privilége opposé, les scorpions y pullulent en telle abondance que si l'on y répand une goutte d'eau, à l'instant même on les voit accourir sortant de leurs trous par milliers. On raconte à ce sujet qu'un des anciens rois arabes, Schedad, célèbre dans la légende par sa puissance, sa richesse et surtout son orgueil, avait imaginé de faire un jardin qui effaçât les magnificences et les délices du paradis. Le jardin d'Irem, qu'il créa, fut, en effet, si beau que depuis des siècles il sert de point de comparaison aux poëtes et a donné lieu à des amplifications sans fin. Avoir un paradis, c'était un grand pas vers la qualité de Dieu; cependant cela ne suffisait point encore: pour faire bien les choses, pour les avoir complètes, il fallait un enfer. Qu'est-ce qu'une puissance qui ne peut pas châtier? Schedad ordonna donc aux génies, soumis à son obéissance de lui composer un enfer si parfait, si complet dans toutes ses parties, que l'imagination la plus exagérée ne pût y apercevoir ni défaut ni oubli. Tous les instruments de torture y furent collectionnés, la poix et le bitume y coulèrent en fleuves de feu, on y organisa des amas d'eaux bourbeuses pour les noyades et des précipices sans fond pour les chutes. Dans des ronces accumulées de façon à écorcher les pieds des passants, on lâcha toute la famille des serpents grands ou petits, n'importe, pourvu qu'ils fussent reconnus pour bien venimeux, et l'on commença à se féliciter d'avoir fait une œuvre au-dessus de toute critique, quand quelqu'un fit observer qu'il n'y avait pas de scorpions. Un enfer sans scorpions ne pouvant se tolérer, on envoya un grand diable courir le monde pour en rapporter une cargaison. Il fit de son mieux. Il en remplit ses sacs en Syrie, en Afrique, dans l'Asie Mineure, partout où cette gent pullule, et fier de s'être bien tiré de sa mission, il s'en revenait à tire-d'aile, quand il apprit que Schedad venait de mourir, et que les travaux de l'enfer étaient abandonnés. Les scorpions, si précieux un moment auparavant, devenaient pour le génie un fardeau inutile. Il ne crut donc pas devoir les porter plus loin. Il secoua ses sacs à l'endroit où il était alors, et s'en alla. C'était la butte de terre placée aux portes de Kaschan, et voilà pourquoi il y a tant de scorpions dans ce lieu. Tout s'explique.
Il faut dire aussi que le mal appelle le remède. Ce fut un homme utile à son pays, sans aucun doute, celui qui combina un charme capable de défendre l'accès d'un logis à ces bêtes hideuses; mais il a été dépassé par l'inventeur du moyen de rendre inoffensif leur mortel venin. On nous amena un de ces sorciers. Il avait très-mauvaise mine, soit dit en passant, et plutôt l'air d'un grand coquin que d'un bienfaiteur de l'humanité; mais enfin, le ciel l'ayant fait ainsi, peut-être n'en valait-il ni mieux ni pis. On lui apporta des scorpions noirs et des scorpions blancs. Il se mit à jouer avec eux et nous les montra suspendus en grappes à ses doigts. Ensuite, il se fit piquer au visage. Puis, passant à quelque chose de mieux, il tira d'une boîte une phalange: c'est une énorme et horrible araignée qu'on nomme dans la langue du pays Rotayl, et dont la piqûre est toujours très-mauvaise et quelquefois mortelle, et il se fit mordre encore par cette bête. Nous levâmes la séance, enchantés de ses talents, mais rassasiés de tout ce monde-là.
Pour changer le cours de nos idées, nous allâmes visiter les bazars, que nous trouvâmes très-actifs et très-vivants. Ce n'est pas un des moindres charmes des villes (p. 028) d'Asie que ces longues galeries couvertes, bordées de boutiques où toute la population se porte depuis le matin jusqu'au soir. Les boutiques de marchands d'étoffes toujours assiégées par des troupes de femmes, les ateliers de chaudronniers avec leur tapage étourdissant, les armuriers avec leur public de cavaliers, les libraires entourés de graves moullahs, les restaurateurs occupés du soir au matin à faire griller sur des charbons leurs appétissantes brochettes de kébab ou mouton rôti, et à cuire, dans des myriades de petits pots noirs, les soupes à la viande que les gens du peuple idolâtrent, tous ces attraits divers amènent un monde fou, au milieu duquel circulent lentement les hommes à cheval, les mulets et les chameaux chargés. Les Persans se passeraient de tout au monde plutôt que de cesser d'aller au bazar. Je n'en suis pas surpris, et, si j'étais à leur place, je penserais de même. C'est le domaine souverain de la conversation, de l'anecdote, du propos bon ou mauvais, et le grand réceptacle de tout ce qui se dit. Enfin c'est un lieu qui respire le désœuvrement et la bonne humeur d'un peuple heureux de n'avoir à faire que ce qu'il veut, et que la nature a cependant créé remuant.
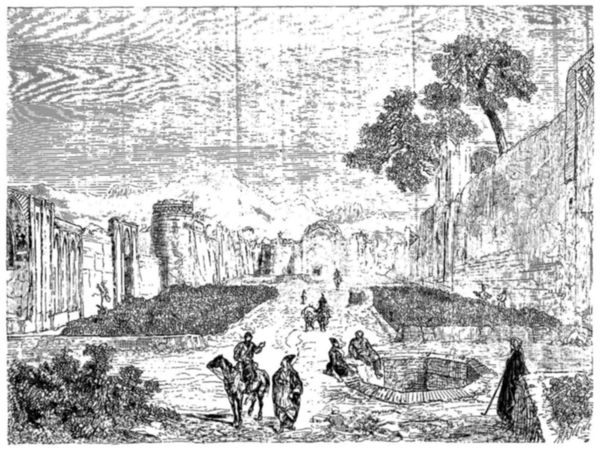
Entrée de Kaschan.—Dessin de M. Jules Laurens.
Nous admirâmes beaucoup aussi le collége. Je lui trouve le mérite d'être construit tout nouvellement. L'architecture en est bonne et curieuse. Les jardins (car, en Perse, la science est assez péripatéticienne et ne se passe pas de beaux ombrages) sont bien dessinés et bien entretenus. On nous dit que les professeurs étaient savants; sans avoir pu en juger, je n'ai pas de peine à le croire, vu la réputation littéraire de la ville.
De Kaschan à la plaine de Téhéran. — Koum. — Feux d'artifice. — Le pont du Barbier. — Le désert du Khavèr. — Houzé-Sultan. — La plaine de Téhéran.
Nous regrettâmes notre jardin de Fyn plus encore que l'Imarêt-è-Sadr d'Ispahan. Mais comme les regrets ne changent rien au train du monde, nous n'en partîmes pas moins de ce joli séjour, et nous fîmes dans le désert une journée que la sévérité des lieux et une chaleur raisonnable rendirent suffisamment austère. Nous marchâmes quatre heures, et nous arrivâmes à Schourab, très-triste endroit.
Le lendemain on ne fit que trois heures et demie jusqu'à Pamyngan.
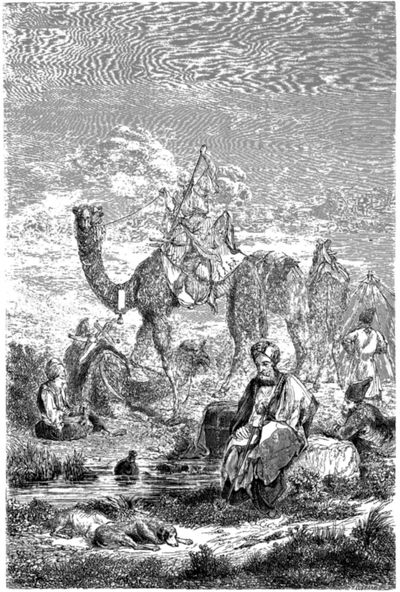
Une caravane persane au repos.—Dessin de M. Jules Laurens.
À Koum, tout nous parut fort bien. Les bazars sont vastes, et il y a de belles maisons avec de grands jardins. La ville a un certain air provincial qui ne déplaît pas. Koum est une ville sainte. Sa mosquée, fort grande, est ornée d'un dôme tout doré et de construction moderne très-élégante. C'est là qu'est enterré Feth-Aly-Schah, en compagnie de Son Altesse Fathmèh, sainte très-vénérée des Persans. À ce titre, Koum jouit d'une bonne réputation dévote. Nous avions nos tentes préparées dans un (p. 030) jardin assez délabré, rempli de chacals, mais agréable. Ce qui nous amusa infiniment, ce fut le feu d'artifice dont on nous régala le soir.
En Europe, un feu d'artifice est une espèce de représentation théâtrale que l'on trouve plus ou moins jolie, mais qui ne produit guère dans les assistants d'émotion bien vive. En Perse, où il s'en faut de beaucoup que l'art des artificiers soit poussé aussi loin que chez nous, un feu d'artifice passionne autant le public que les courses de taureaux en Espagne. On ne se tient pas à distance respectueuse. La foule veut être au beau milieu. Chacun s'empresse de prendre en mains un pétard, une chandelle romaine ou un soleil; j'ai vu des personnages graves, avec l'air d'hommes sages et les plus larges barbes au milieu du visage, se jeter avec frénésie dans l'entraînement universel et courir de côté et d'autre en secouant une pluie de feu qui les ravissait en extase. Il y a bien des moustaches roussies, des robes brûlées dans ces délicieuses parties; mais on n'y prend pas garde, et le souverain bonheur est là.
Les Persans tirent des feux d'artifice à propos de tout, et souvent à propos de rien. Les grands seigneurs les font très-compliqués; les pauvres se contentent de beaucoup moins, mais encore en veulent-ils. J'ai connu tel de nos gens qui portait toujours des fusées dans ses poches. Aussitôt qu'il avait un moment de loisir, il lançait sa fusée, et se pâmait d'aise.
À partir de Koum, le désert change d'aspect. Il a l'air plus rébarbatif de beaucoup que du côté d'Ispahan. De grandes roches apparaissant çà et là dans le paysage, lui donnent quelque faux air de ressemblance avec les environs du Mokkattam en Égypte. Nous allâmes coucher à Poul-è-Delak, ou le pont du Barbier.
C'est un pont d'une longueur assez considérable, jeté sur un cours d'eau saumâtre suffisamment large, mais peu profond. À l'autre rive se présente un caravansérail ruiné, et autour quelques masures; en face, un mamelon sur lequel étaient nos tentes. Le pays est triste, mais il a quelque chose de solennel et d'imposant.
Le lendemain, nous entrâmes dans ce qu'on appelle le désert de Khavèr, autrefois la mer de Khavèr ou d'Orient. La tradition veut qu'elle ait disparu le jour de la naissance du Prophète, et c'était une des marques qui devaient annoncer au monde ce grand événement. Il paraît certain qu'à une époque reculée, cette mer était en communication avec d'autres vastes amas d'eau qui s'étendaient dans l'ouest jusqu'au lac Zarèh, et tenaient la place occupée par les déserts de Yezd et de Kerman. L'hiver, c'est un marécage impraticable aux caravanes, qui longent alors le pied des montagnes à l'ouest pour gagner Ispahan. À la fin de juin, le terrain était complétement sec, c'était une boue raboteuse. Il y restait des flaques d'eau, baignant çà et là quelques buissons d'épines de chameau d'un vert pâle, et dans cette misère couraient de gros lézards gris, très-laids, mais se rendant encore plus ridicules par leur façon de porter la queue en l'air et légèrement penchée de côté.
Nous mîmes pied à terre à Houzé-Sultan. On n'y voit pas autre chose qu'un caravansérail en ruines, la maison de poste, et un grand puits dans une espèce de pyramide. La pyramide n'est pas mal et ne manque pas de caractère; mais l'eau ne vaut absolument rien. Du reste, pas un arbuste, pas un brin d'herbe, de la boue desséchée d'un côté, du sable de l'autre. Pour animer le paysage, il y avait une caravane au repos. Elle était presque uniquement composée de femmes et de moullahs. Tout ce monde s'en allait à Koum, non pas précisément en pèlerinage, mais pour y porter une quantité de grands coffres longs, étendus par terre au soleil et d'où s'exhalait une odeur fort étrange. C'étaient des morts. Les Persans ont une telle passion pour les Imans que, riches ou pauvres, dévots ou incrédules, ils ne se tiennent pas de se faire enterrer près des tombeaux de ces saints. Les plus riches aspirent à être envoyés à Kerbela pour avoir une demeure sur le fameux champ de bataille où furent massacrés les fils d'Aly par les partisans de Yésyd; d'autres se contentent de Mesched et y restent sous la protection de l'Iman Riza; enfin, les gens à fortune médiocre du nord-ouest vont à Koum, près de Baby Fathmèh ou Mme Fathmèh. C'est une passion universelle et, qui plus est, une mode; peu de personnes résistent à la fantaisie de stipuler dans leur testament que leurs héritiers les feront enterrer dans un des lieux sacrés.
Depuis peu, je pouvais remarquer la grande différence qui existe entre le début et la fin d'un voyage. Nous allions entrer dans deux jours à Téhéran, et on ne vivait plus comme naguère dans ce complet oubli de l'avenir, dans cette appréciation délicate et absolue du présent, qui est le commencement de la sagesse et le seul moyen d'être heureux. Entre Schiraz et Ispahan, le terme du voyage était si éloigné qu'on y songeait à peine et on n'en parlait pas. Toute la question était de savoir ce qui arriverait ou ce qui était arrivé dans la journée. Au plus on portait sa pensée sur le lendemain. Désormais, tout était gâté. On s'occupait bien moins de ce qu'on faisait que de ce qu'on ferait dans huit jours, et on ne jouissait plus de la vie présente. Il était donc temps d'en finir.
Nous eûmes bientôt un avant-goût de la sensation au-devant de laquelle se précipitaient tous les esprits.
Nous rencontrâmes le docteur Cloquet avec un secrétaire de la mission ottomane. Il nous sembla retrouver l'Europe dans la conversation d'un homme profondément attaché à son pays et dévoué au service du roi de Perse, dont il était, du reste, on ne peut plus apprécié. Ces messieurs avaient apporté leurs tentes, de sorte que notre camp fut encore augmenté cette nuit-là. Le pays n'était pas beaucoup plus beau que la veille, et il était tout aussi sévère. Kenarégherd a une grande réputation comme terrain de chasse, et c'est à bon droit, car son sol saturé de nitre est particulièrement bon à attirer le gibier; mais il n'a pas d'autre mérite. Les cours d'eau qui le traversent de manière à en faire, à certains moments de l'année, un grand marécage, sont saumâtres, et l'air y est étouffant.
Nous partîmes le lendemain matin de bonne heure. Différents membres de la mission avaient pris les devants. (p. 031) Je fis le chemin presque seul avec mon kaliandji et deux autres domestiques. Nos chameaux n'en pouvaient plus: tout marchait lentement.
Je traversai assez indifféremment une série de vallons et de collines qui se succédaient les unes aux autres, comme la veille, en se rassemblant, offrant toujours les mêmes caractères de stérilité et d'abandon; mais à un tournant, j'aperçus tout à coup une plaine immense, une vallée d'une largeur grandiose courant de l'est à l'ouest: c'était la plaine de Téhéran.
Au nord s'étendait une chaîne de montagnes dont les sommets étincelants de neige se relevaient à une hauteur majestueuse: c'était l'Elbourz, cette immense arête qui unit l'Hindou-Kousch aux montagnes de la Géorgie, le Caucase indien au Caucase de Prométhée; et au-dessus de cette chaîne, la dominant comme un géant, s'élançait dans les airs l'énorme cône pointu du mont Démavend, blanc de la tête aux pieds. On ne saurait rien imaginer de plus vaste ni de plus beau. À l'est, un soulèvement du sol, indépendant du reste, jeté dans la même direction, coupait en deux cette grande arène et venait expirer non loin du sentier que j'avais à suivre. À l'est encore et par derrière, commençaient, dans un lointain bleuâtre, ces plaines interminables qui touchent au Khorassan, conduisant à l'Indus, au Turkestan, à la Chine, à tout ce que l'imagination rêve et voudrait voir. Pas de détails qui arrêtent la pensée, c'est infini comme la mer, c'est un horizon d'une couleur merveilleuse, un ciel dont rien, ni parole ni palette, ne peut exprimer la transparence et l'éclat, une plaine qui, d'ondulations en ondulations, gagne graduellement les pieds de l'Elbourz, se relie et se confond avec ces grandeurs. De temps en temps, des trombes de poussière se forment, s'arrondissent, s'élèvent, montent vers l'azur, semblent le toucher de leur faîte tourbillonnant, courent au hasard et retombent. On n'oublie pas un pareil tableau.
J'avais beau chercher Téhéran, je ne l'apercevais nulle part. En avançant, mes yeux démêlèrent au loin l'emplacement de Rey, l'ancienne Rhagès de la Bible, et le sol tourmenté que couvrent les ruines immenses de cette ville célèbre; je vis ensuite Schahbdoulasym, dont le dôme doré brillait au soleil au travers des massifs de verdure qui entourent cette jolie bourgade; mais Téhéran se cachait. C'est que la capitale persane est comme enterrée dans un pli de terrain qui ne permet de la découvrir que lorsqu'on y arrive.
Téhéran. — Notre entrée dans la ville. — Notre habitation.
Cependant, à mesure que j'avançais, les détails que l'éloignement avait d'abord dissimulés se révélaient les uns après les autres. Une multitude de grands jardins apparaissaient de toutes parts; des cultures variaient l'aspect du désert; des kanats, grands aqueducs souterrains, traversaient au loin la plaine; des ruines de villages et de tours s'accroupissaient çà et là; des arbres isolés s'élevaient sur les bords de quelques cours d'eau perdus. Enfin, j'arrivai le dernier à notre station.
On nous avait assigné pour demeure un kiosque appartenant à un des princes du sang et qu'entourait un jardin très-soigné et tout en fleurs. Comme, à dater de ce moment, nous n'étions plus en voyage, une grande tente dressée devant la porte nous servait de salon de réception pour les visites qui allaient se succéder. Nous devions faire le lendemain notre entrée solennelle dans la capitale, et nous savions que le roi, très-désireux de voir la mission, avait renoncé, pour ne pas retarder ce plaisir, à un voyage projeté dans le Khorassan. Toutes les attentions que l'on avait eues pour nous sur la route nous répondaient d'avance que nous serions accueillis avec toute la pompe imaginable.
Afin de ne pas être pris au dépourvu, dès le point du jour nous étions en uniforme et prêts à recevoir nos hôtes. Nous vîmes bientôt arriver à la file la légation ottomane, les quelques Européens résidant à Téhéran, puis des officiers militaires ou civils qui venaient complimenter le ministre de la part du roi, du premier ministre et du ministre des affaires étrangères. La tente était pleine de Persans en robes de cérémonie, les uns arrivant, les autres partant. Les kaliandjis circulaient au milieu de la foule, portant ou emportant leurs pipes, et c'est un spectacle qui ne manque pas d'éclat que de voir en bon ordre, dans un talar, une douzaine de ces serviteurs ayant entre les mains de beaux kalians, à la carafe de cristal et à la tête d'or simple ou d'or émaillé. Les pischkhedmets avec le thé entraient quand ceux-là sortaient, ou plutôt les précédaient; c'était un va-et-vient continuel. Quant à la conversation, elle se composait de souhaits de bienvenue, de compliments sans fin, de remarques sur notre voyage, de plaisanteries et de beaucoup de rires. Rien n'était plus différent de ce qu'on suppose en Europe au sujet de la gravité orientale. Mais c'est en Turquie et dans le contact avec les Turcs qu'on prend de telles idées, et la nation ottomane n'est pas un miroir qui montre l'Asie, c'est un rideau qui la cache.
Vers midi on nous informa que tout était prêt; nous montâmes à cheval. Nous formions un véritable corps de cavalerie. Après une demi-heure de marche, nous arrivâmes à une vaste tente en soie où différents grands personnages de la maison du roi nous attendaient. Nous mîmes pied à terre pour recevoir les compliments dont ils étaient porteurs, et on nous fit asseoir en face d'une grande table couverte de fleurs et de sucreries. Autour de la tente étaient rangés les coureurs du roi avec leurs bonnets pailletés de forme bizarre, les yessaouls en robes rouges, des ferrachs sans nombre; plus loin, un corps de cavalerie régulière, le seul qui existe en Perse, et qu'on appelle les ghoulams de la garde. Il est composé de deux escadrons de lanciers; venaient ensuite des bataillons d'infanterie et une foule de curieux. Dans ces sortes d'occasions, les spectateurs ne sont pas tous volontaires; c'est le gouvernement qui les invite à venir, en donnant avis aux marchands du bazar et au corps des métiers d'avoir à honorer les hôtes qui lui arrivent en se portant à leur rencontre. En somme, la multitude officielle et non officielle était très-grande.
(p. 032) Quand les kalians eurent été de nouveau apportés et remportés, et le thé de même, on se remit en route. Le roi ayant envoyé des chevaux richement caparaçonnés pour le ministre et les principaux membres de la mission, avec les djélodars portant comme de coutume la couverture brodée sur l'épaule gauche, tout ce train s'ébranla, et au bout de trois quarts d'heure, allant d'ailleurs avec une lenteur extrême, nous entrâmes dans Téhéran par la porte Neuve. Nous aperçûmes tout d'abord, sur la place qui précède la porte, le piquet ou mât destiné à la haute justice. Ordinairement les têtes y sont attachées en plus ou moins grand nombre; mais ce jour-là il n'y en avait pas. Un fou, bien connu de Téhéran, était monté sur la plate-forme et criait de toutes ses forces: «Ali! Ali!» Pendant trois ans, j'ai rencontré journellement cet homme dans les rues, qu'il parcourt en hurlant le même mot sans jamais se reposer. Il est de l'espèce la plus inoffensive, et ne prend garde à personne. C'est un pauvre diable qui a perdu, jadis, une petite fille qu'il aimait tendrement, et sa raison n'a pas résisté à l'excès du chagrin. La foule était grande et compacte sur le Marché-Vert, que nous traversâmes ensuite. La baguette des ferrachs n'était pas de trop pour nous frayer un passage. C'étaient des cris, des rires, un mouvement à ne pas s'entendre, et cependant il était bien nécessaire de garder son sang-froid, vu l'état habituel des rues persanes: huit pieds de large, une ravine au milieu, et des trous profonds irrégulièrement semés tous les trois pas. En Europe, on se tuerait; en Perse, on n'en éprouve aucun inconvénient. Seulement, il faut avoir expérimenté cette vérité, qui, au premier abord, semble paradoxale, pour faire de gaieté de cœur une telle promenade avec tant de chevaux autour de soi et des cavaliers pareils pour les conduire.

Louty. Kurde pasteur. Derviche nomade. Bakthyary[5].
TYPES PERSANS.—Dessin de M. Jules Laurens.
La ville est longue; notre résidence est fort éloignée de la porte Neuve, de sorte que la cavalcade mit bien trois quarts d'heure, sinon une heure pour sortir de ce dédale. Une fois arrivés chez nous, on apporta de nouveau les kalians et de nouveau le thé, puis nos introducteurs prirent congé. Nous étions livrés à nous-mêmes.
Cte A. de Gobineau.
(La fin à la prochaine livraison.)
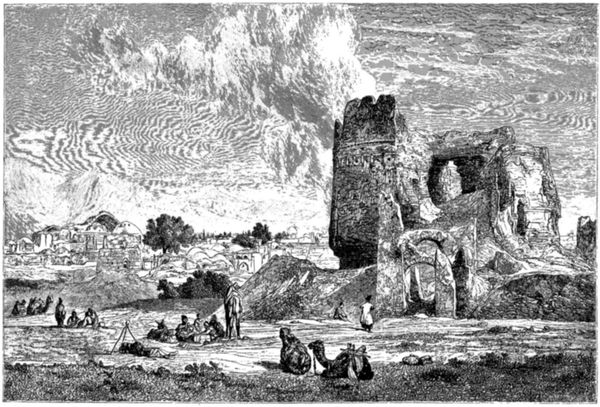
VOYAGE EN PERSE—Faubourg de Téhéran.—Dessin de M. Jules Laurens.
PAR M. LE CTE A. DE GOBINEAU,
(1855-1858)
DESSINS INÉDITS DE M. JULES LAURENS[6].
Une audience du roi de Perse.
Notre demeure, à Téhéran, est grande et belle. Assurément, ce n'est pas un monument de marbre. Il ne s'en fait pas en Perse. Mais elle est bien construite en briques crues avec des chaînes de briques cuites. Après avoir passé sous une voûte dans laquelle est pratiquée une chambre servant de corps de garde aux soldats qu'entretient chaque légation, on suit un corridor qui aboutit à une grande cour formant un carré long d'une assez belle étendue. Au milieu est une pièce d'eau en forme de T, le haut de la lettre longeant la façade; des deux côtés, une rangée de platanes et des massifs d'arbrisseaux et de fleurs. Le terrain est dallé de grandes briques carrées. Les bâtiments qui entourent la cour sont exhaussés de trois ou quatre pieds et composés d'un rez-de-chaussée seulement; c'est une série de chambres destinées pour la plupart aux gens de service. Au fond se présente le talar (la salle principale, le salon), percé de trois fenêtres à l'européenne et placé entre deux pavillons qui font saillie de chaque côté et sont ornés de niches garnies de stalactites dans le goût oriental. Les rebords des toits sont peints de couleurs brillantes et dentelés à la chinoise. De vastes terrasses en terre battue font le tour de la cour et recouvrent tous les bâtiments. Près du corps de logis principal, l'endéroun ou appartement intérieur, s'étend autour d'une cour séparée et longue un grand jardin, qui n'avait que le défaut de manquer d'arbres; mais on en pouvait mettre, et c'est ce que nous fîmes bientôt. Enfin, pour terminer la description de notre demeure, elle occupe un vaste emplacement dans le quartier le plus salubre de la ville. Elle possède de l'eau en abondance et est tout au plus à cinq minutes de la porte de Schymyran, qui conduit aux montagnes. Nous étions donc très-bien partagés.
La plus importante affaire était désormais d'obtenir l'audience du roi et de voir le premier ministre. Le souverain ne nous fit pas attendre. Le troisième jour de notre arrivée, ayant reçu ses ordres, nous nous rendîmes en gala au palais, précédés des coureurs et des ferrachs royaux. Nous fûmes d'abord introduits dans un salon où se trouvaient le ministre des affaires étrangères, Mirza-Say-Khan, le général en chef de l'armée persane, Azyr-Khan, le beau-frère du premier ministre, ancien ambassadeur à Pétersbourg, et deux ou trois autres personnes de marque. On nous offrit le kalian (pipe d'eau) et le thé. Après un instant de conversation, le grand maître des cérémonies, tenant un long bâton couvert d'émail et incrusté de pierreries, vint nous chercher. Il portait, comme le ministre des affaires étrangères, non pas le bonnet noir ordinaire, qui n'est pas d'étiquette pour les grands fonctionnaires lorsqu'ils paraissent devant le roi, mais un turban à forme haute et bombée, jadis en usage à la cour de Séfévys. Il avait aussi de longs bas rouges en mémoire de ce que, du temps de Djenghyz, une des marques distinctives des khans mogols de premier rang était de paraître devant le Khaghan sans ôter leurs chaussures; or, ces chaussures étaient des bottes rouges.
Après avoir traversé plusieurs cours et couloirs, nous arrivâmes à la porte d'un vaste jardin rempli de platanes, de fleurs et de bassins d'eau vive. Les bâtiments du palais, dont ce jardin est entouré, ont deux ou trois étages et sont ornés au rez-de-chaussée d'une série de peintures de grandeur naturelle, représentant des soldats réguliers, en uniforme rose, au port d'armes et le sourire sur les lèvres. Ce genre d'ornementation, qui rappelle beaucoup, par le style et les qualités de la peinture, les boutiques de la foire, n'est pas à l'abri de toute critique. On nous fit mettre là des galoches par-dessus nos bottes; c'est toujours le traité de Turkmantchay qui le veut, et au détour d'une allée, le grand maître des cérémonies s'arrêta; il se tourna vers un talar dont les colonnes étaient très-richement dorées et peintes, et s'inclina profondément en appuyant ses deux mains sur ses genoux et en les faisant glisser jusqu'aux pieds. Nous saluâmes à la manière européenne, et on nous fit quitter nos galoches, tandis que nos introducteurs quittaient leurs souliers pour marcher simplement sur leurs bas rouges.
Puis, élevant la voix au milieu de ce jardin, que nous vîmes alors bordé d'une haie de soldats, tandis qu'au pied du talar se tenaient des pages, des officiers, des domestiques de tous rangs, dans le plus profond silence, le grand maître des cérémonies proclama que Son Excellence le ministre de France demandait la faveur de s'approcher du roi. Bien entendu, cette requête fut beaucoup plus fleurie que je ne la donne ici, mais je ne me rappelle pas les termes exacts, et je me borne à en reproduire le sens.
Le roi, à ce qu'il paraît, car je ne voyais rien, fit un (p. 035) signe, et nous avançâmes; à quinze pas plus loin, nouveau salut, et alors j'aperçus Sa Majesté. Elle était assise sur un trône fort élevé, qui me parut très-brillant. Le monarque lui-même était richement habillé, mais j'eus à peine le temps de faire cette observation, car sur un nouveau signe, nous approchâmes davantage et nous montâmes les degrés d'un escalier bordé de serviteurs du palais, qui nous introduisirent d'abord sur un petit palier bas et orné de glaces, puis dans le talar même, en présence du roi.
Sa Majesté avait alors vingt-cinq à vingt-six ans. La figure de Nasreddyn-Schah est belle et noble. Il porte la barbe coupée très-court, et de longues moustaches qui rappellent celles du roi de Sardaigne. Il a de beaux yeux intelligents. Il parle vite et brusquement pour dissimuler, dit-on, une timidité très-réelle. Le ministre de France prit place sur un fauteuil en face du roi, à une douzaine de pas. Le reste de la mission se tint debout. Au milieu du salon étaient aussi debout trois ou quatre princes du sang, oncles du roi. L'un tenait le sabre orné de pierreries, l'autre le bouclier, l'autre la masse d'armes. Ces divers ornements du trône étincelaient de diamants, d'émeraudes et de rubis. Le roi lui-même, couvert de pierres précieuses, était vêtu d'un koulydjêh, espèce de tunique courte en soie de couleur claire bordée de perles. Il portait de larges bracelets de diamants; la boucle de son ceinturon était de même, son sabre en avait encore, et encore l'agrafe de l'aigrette épanouie sur son bonnet.
Sa Majesté parla beaucoup de l'Empereur et de la France, et montra une grande connaissance de la géographie de notre pays. En sortant de son audience, nous saluâmes aux mêmes places où nous avions salué en arrivant, et nous nous rendîmes chez le premier ministre, qui nous attendait dans une autre cour du palais.
Nouvelles constructions à Téhéran. — Température. — Longévité.
Autrefois, c'est-à-dire il y a trente ans, il était pour ainsi dire impossible de rester, même au printemps, dans la capitale. La fièvre ne manquait pas de saisir les résidents obstinés et en faisait prompte justice. L'air était empesté, l'eau mauvaise, et, quand on sortait des autres villes de Perse pour venir dans ces lieux décriés, on croyait aller à la mort. Tout s'est beaucoup amélioré. La ville, naguère sale et en décombres, s'est nettoyée et relevée; on y construit beaucoup, et de belles et grandes maisons; les bazars y deviennent magnifiques et nombreux. Il y a un an à peine que s'est élevé le caravansérail d'Hadjeb-Eddoouleh, que l'on peut appeler un des beaux monuments de la Perse, et qui pourrait être cité avec honneur à côté des plus élégantes constructions d'Ispahan. Enfin, le roi a fait bâtir autour du Marché-Vert, Meydân-ê-Sebz, au centre de la ville, d'élégantes galeries; cette place même, bien pavée, ornée d'un grand bassin carré, est rendue plus remarquable par la porte de la forteresse flanquée de deux tourelles couvertes du haut en bas de mosaïques en émail. Il ne se passe pas une année qui ne voie s'élever de toutes parts, au dedans et au dehors de la ville, de beaux édifices. Les ruines existeront toujours, puisqu'une ville persane sans ruines n'est pas possible, mais le terrain se déblaye, et la quantité d'eaux courantes et saines que le roi a fait venir de la montagne, a singulièrement amélioré les chemins. Les descriptions de Téhéran, publiées jusqu'à 1845, ne sont plus vraies.
Mais, comme pour lutter contre toutes les améliorations très-grandes et très-réelles qui se sont introduites sous le nouveau règne, le choléra, depuis huit ou neuf ans, fait de terribles ravages dans la Perse septentrionale, et principalement pendant l'été. Ce nous fut une raison de plus pour gagner la campagne.
Nous allâmes nous établir à Roustamabad, assez joli village à deux lieues au nord, très-voisin du palais de Niavérân, où le roi était fixé.
La Perse n'est pas cependant un pays malsain en lui-même. Le choléra est malheureusement un fléau qui se montre sous toutes les latitudes. Cependant, en Perse, il ne pénètre pas dans les montagnes, et comme les montagnes ne sont jamais bien loin, on peut le fuir en s'y réfugiant. La fièvre, il est vrai, est la souveraine de l'Asie; elle existe en Perse, et existe partout. Les indigènes la prennent aussi bien que les étrangers, et on ne peut trop deviner la cause de l'intensité de ce fléau. Il est seulement à observer que, comme le choléra, il se guérit généralement sur les hauts lieux. Mais si on a été touché une fois, on garde une grande disposition à retomber sous son empire. Les variétés de ce mal sont très-nombreuses, et depuis la fièvre du Ghylan, qui emporte le malade au troisième accès, jusqu'aux fièvres intermittentes qui durent pendant des années, il existe des nuances infinies, mais toutes détestables. Ceci mis à part, les affections d'autre nature sont rares, et la population présente des cas très-nombreux de longévité. J'ai vu souvent, dans les villages, des paysans qui n'avaient guère moins de quatre-vingts à quatre-vingt-dix ans. Les centenaires ne passent pas non plus pour introuvables. Je ne puis que répéter ici ce que j'ai déjà dit du sud de la Perse; tous les gens que j'ai observés dans les villes et dans les champs m'ont paru forts, bien portants et alertes.
Les nomades.
Les Persans aiment la locomotion. Les paysans eux-mêmes passent volontiers d'une province dans une autre. Il suffit qu'un villageois se trouve trop chargé de contributions pour qu'un beau soir il déménage. Il met son argent dans sa ceinture, sa femme sur un âne; le bœuf et le cheval portent le mobilier. On rencontre souvent des familles rustiques circulant ainsi dans l'empire. Elles sont bien accueillies par les nouveaux concitoyens qu'elles viennent chercher, et qui sont bien aises du secours de ces bras pour la culture d'une terre toujours trop vaste.
Mais ces hommes en quête d'une résidence ne sont que des voyageurs temporaires. Il existe une classe d'êtres qui fait d'un déplacement constant à peu près le but de sa vie. Ce sont les derviches, qui, n'ayant le plus souvent (p. 036) d'autre occupation, ne se bornent pas à parcourir la Perse, et vont, sans hésiter, à Calcutta, à Constantinople, au Caire, et cela d'autant plus aisément que leurs pérégrinations ne leur coûtent absolument rien. J'en ai vu et pratiqué beaucoup, et je les tiens, en général, pour très-intéressants à connaître. Il y a sans doute, parmi eux, bon nombre de vagabonds purs et simples; mais çà et là on rencontre une perle, et c'est assez pour leur donner de la valeur.
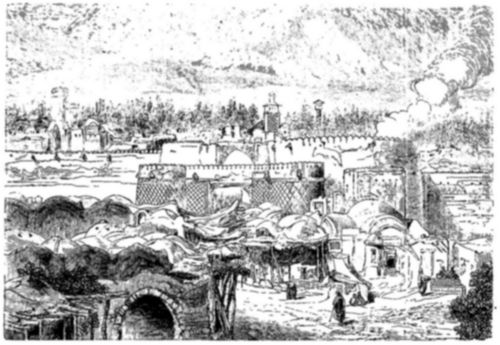
La porte de Schab-Abdoulazim.—Dessin de M. Jules Laurens.
À pied, ou monté sur un âne, le philosophe nomade se met en route, s'arrêtant où il veut pendant des mois, des années, ou traversant les villes, sans que rien ni personne l'arrête; dans les déserts, il se joint aux caravanes; dans les pays où il croit n'avoir pas besoin de protection, il va seul, et personne ne lui demande pourquoi. Un ruisseau coulant entre deux pierres, avec un saule au dessus, lui paraît offrir un repos agréable: il s'y assied et y demeure tant que ce séjour lui convient. J'ai rencontré ainsi, dans une masure en ruine, aux environs de Reï, l'ancienne Rhagès, un derviche venu de Lahore, qui passa là plusieurs jours. Le lieu lui avait semblé agréable. Un matin il disparut et je ne le revis jamais. Le but final de son voyage était, disait-il, Kerbela. C'était un homme d'une rare instruction, d'un langage recherché et fleuri, connaissant beaucoup les livres, ayant au moins soixante ans et l'expérience de beaucoup de catastrophes qu'il avait heureusement traversées. Son élégance était tout intellectuelle. Il était vêtu d'une robe de coton blanc tombant en lambeaux, les pieds et la tête nus, les cheveux flamboyants, la barbe grise en désordre, la peau calcinée et sillonnée de rides, mais l'air souriant et les yeux pleins de feu. Dans quelque lieu que ces gens s'arrêtent, ils racontent aux habitants, qui bientôt les entourent, ce qu'ils ont vu dans leurs pérégrinations, et les conclusions qu'ils ont tirées de toutes choses. Souvent ils font grande impression sur les esprits; et comme la religion est un des thèmes favoris de leurs entretiens et qu'ils y sont très-hardis, c'est à ces religieux errants qu'il faut attribuer ce mouvement continuel d'hérésies dont le monde musulman est tourmenté, surtout en Perse, et qui, à chaque moment, ranime, réveille, renouvelle ou apporte les notions de la théologie indienne au milieu de la loi du Koran.
Il est aussi d'autres voyageurs qui, d'après les idées européennes, paraissent plus dignes d'intérêt; ceux-là parcourent le monde oriental pour s'instruire. Ils sont assez nombreux. Rien ne les distingue extérieurement des derviches, si ce n'est qu'ils ne vont point la tête nue et ne portent point de longs cheveux. Ils sont peu curieux d'opinions théologiques ou de méditations sur les choses surnaturelles, ne s'occupent que des mœurs des pays qu'ils parcourent et des curiosités de l'art ou de la nature qu'ils peuvent y trouver. Mais les pèlerins les plus curieux que j'aie jamais rencontrés sont les derniers dont je parlerai ici.

Dans une cour, à Téhéran.—Dessin de M. Jules Laurens.
Deux pèlerins. — Le culte du feu.
Je fus abordé un jour par deux hommes de taille médiocre, d'un noir bleuâtre, maigres, et ayant, comme tous les gens du sud de l'Asie, qui n'appartiennent pas aux races militaires, l'air riant, doux et soumis. Ils me parurent, au premier abord, être des Beloutches. Mais je me trompais, car l'un d'entre eux se réclama auprès de moi de la qualité de Français, qu'il attribua aussi à son compagnon. L'aspect de ces soi-disant compatriotes n'était pas propre à soutenir la validité de leurs prétentions, je fus bien vite convaincu de leur sincérité. Ils portaient de longs bonnets pointus en feutre, semblables à ceux des Ouzbeks. Bien qu'on fût au mois (p. 038) de juillet, ils étaient vêtus des lambeaux graisseux de ces longues robes fourrées en peau de mouton que l'on fabrique à Bokhara, et leur saleté dépassait non-seulement tout ce qu'on peut voir, mais même tout ce qu'on peut imaginer. Explications faites, j'appris enfin que ces deux hommes, appelés l'un Kakscha et l'autre Mostanscha, étaient des Tamouls de Pondichéry. Ils prétendaient appartenir à la caste brahmanique et se donnaient pour agriculteurs. Dans leur opinion, le feu ayant créé toutes choses et ne pouvant dès lors être trop vénéré, ils avaient voulu faire acte de dévotion envers cet élément. Or, c'était une opinion courante parmi leurs compatriotes du pays de Pondichéry, qu'il existait quelque part dans le Turkestan un Atesch-Kédèh ou temple du Feu, d'une sainteté extraordinaire. De temps immémorial, l'usage d'y aller porter ses prières s'était maintenu, mais aucun de ceux qui avaient fait la route ne s'étant occupé de donner en détail l'itinéraire des pays traversés pour y arriver, personne ne savait autre chose de ce voyage, sinon que l'Atesch-Kédèh existait dans le Nord. Il paraît que ce renseignement suffisait aux fidèles; car, après bien d'autres, Kakscha et Mostanscha s'étaient mis en chemin.
Ils commencèrent par aller à Bombay, par terre, et de là, traversant le Kotch, ils arrivèrent aux bords de l'Indus. Ils remontèrent le fleuve, tantôt en cheminant sur ses rives, tantôt dans les embarcations là où ils en trouvèrent et où on voulut bien leur donner le passage gratis. Ils parvinrent ainsi jusqu'à Peschawer et, s'étant informés, ils apprirent qu'on ne connaissait pas d'Atesch-Kédèh dans le pays, mais qu'il n'était pas impossible qu'il y en eût à Kaschemyr. Ils partirent pour Kaschemyr. Dans cette ville, on leur dit que le culte du feu était inconnu ou du moins n'avait point de sanctuaire dans la vallée; mais qu'il était de notoriété publique que Balkh étant la mère des villes et ayant été fondée par Zerdescht ou Zoroastre, si un Atesch-Kédèh pouvait exister quelque part, ce devait être incontestablement là. Ils en tombèrent d'accord et partirent pour Balkh. Point d'Atesch-Kédèh; c'était à Bokhara qu'il fallait se rendre pour s'en éclaircir. Ils y allèrent et trouvèrent enfin, non pas ce qu'ils cherchaient, mais des renseignements positifs. On leur affirma que le sanctuaire de leur croyance existait à Bakou, sur la rive occidentale de la Caspienne, dans le pays des Russes (voy. notre premier volume, p. 125); et, en effet, les feux perpétuels que la nature y entretient sont un objet constant d'adoration de la part des sectaires.
Kakscha et Mostanscha reprirent leur route, sans avoir le moins du monde pensé à perdre patience, et s'acheminèrent vers Asterabad; mais c'était justement dans le temps que le gouverneur actuel de cette ville, Djafèr-Kouly-Khan, faisait une campagne longtemps différée, et devenue indispensable, contre les maraudeurs turcomans; de peur de tomber dans ce conflit et d'être faits esclaves d'un côté ou décapités de l'autre, les deux Tamouls se dirigèrent vers Mesched, et de là passèrent par Téhéran, où j'entendis leur histoire.
Je ne relève pas ce qu'il y a de singulier à voir le culte du feu et les Atesch-Kédèhs de la Perse en vénération sur la côte du Malabar et auprès de gens qui se prétendent de caste brahmanique; je constate seulement que cela est, et c'est une des marques les plus fortes que j'aie jamais rencontrées de la diffusion, et je puis ajouter de la confusion des idées persanes avec les idées hindoues. Pour achever ce récit, les deux pèlerins voyageaient avec une petite tente basse en toile blanche où l'on pouvait s'asseoir deux, mais non se tenir debout ni se coucher. Ils possédaient deux vases de cuivre pour faire cuire leurs aliments; car, circonstance particulièrement gênante dans une telle entreprise, il ne leur paraissait pas conforme à leurs devoirs religieux de rien manger qui eût été préparé par d'autres mains que les leurs, ce qui les privait naturellement des bénéfices de l'hospitalité commune. Leur mobilier était complété par un de ces jeux autrefois assez en vogue dans nos salons, et que l'on appelle un baguenaudier. Ils y paraissaient fort habiles, et les Persans prenaient plaisir à les voir faire. Ils avaient mis quatre ans pour arriver à Téhéran et prévoyaient, sans nul ennui, qu'à leur retour de Bakou, ils auraient à refaire exactement le même chemin et à voir s'écouler le même espace de temps avant d'arriver chez eux. Lorsqu'on leur eut expliqué qu'en passant par Ispahan et Schyraz pour s'embarquer à Bouschyr, leur voyage serait beaucoup plus rapide, ils ne parurent nullement touchés de cet avantage: un Asiatique comprend difficilement l'utilité de se hâter. Enfin, lorsqu'ils eurent passé une journée à répondre aux questions des gens de la maison joyeusement assis en cercle autour d'eux, et avec lesquels ils s'étaient mis tout d'abord sur le pied le plus amical, ils témoignèrent le désir de continuer leur route. On leur demanda quelle aumône pourrait leur être agréable et leur paraître généreuse, puisqu'ils avaient refusé toute nourriture, le kalian et même une tasse d'eau; ils se firent un peu prier et enfin répondirent que si, par l'effet d'une générosité surhumaine, dont leur cœur conserverait à jamais la mémoire, on voulait bien leur donner trente schahys, ils se considéreraient comme comblés. Trente schahys ne représentent pas tout à fait quarante sous.
C'est avec cette facilité, mais aussi cette patience, cette gaieté continuelle, cette curiosité douce, toujours portée à satisfaire celle d'autrui en se satisfaisant elle-même, que les Asiatiques circulent dans les pays les uns des autres, sans même savoir bien positivement où ils vont, ni souvent où ils sont. Les longs entretiens de tous les jours, de toutes les heures, où toutes les idées s'expriment, où tout se dit, où rien n'est considéré comme scandaleux quand la forme ne choque pas, exercent naturellement une influence irrésistible et donnent lieu à cette facilité de mœurs, à cette tolérance universelle dont l'Européen seul, avec ses opinions arrêtées, ses décisions tranchantes ou ironiques, est rigoureusement exclu, mais qui permet aux brahmanistes, aux musulmans, aux chrétiens, aux juifs arméniens de vivre pêle-mêle sans se choquer jamais, sauf les jours de crise politique.
(p. 039) La police. — Les ponts. — Le laisser aller administratif.
L'État persan n'existe pas en réalité, l'individu est tout. L'État? comment pourrait-il être, lorsque personne n'en prend aucun souci? La population, assez semblable, sous ce rapport comme sous beaucoup d'autres, à celle de l'empire romain, méprise ses gouvernants, quels qu'ils soient, bons ou mauvais, déprédateurs ou bien intentionnés. Incapable de fidélité politique et de dévouement, pleine d'adoration pour le pays en lui-même, elle ne croit à aucun moyen de le conduire. Aussi tout le monde pillant sans honte comme sans scrupule, et profitant à qui mieux mieux des deniers publics, il n'existe en fait que peu ou point d'administration. La police qui se fait dans les villes est assez bien entendue, il faut le reconnaître, ne serait-ce que pour la singularité du fait. De toute antiquité, les villes d'Asie connaissent et pratiquent l'excellent système de surveillance qui consiste à entretenir des gardiens de nuit dans chaque rue. On n'entend pas de tapages nocturnes; il n'y a pas de désordres publics. Mais, en dehors de ce point-là, tous les autres sont réduits à néant. Une partie de la population urbaine ne paye jamais d'impôt, soit que des priviléges abusifs que rien ne justifie, sinon le long usage, aient légitimé un prétendu droit, ou que, par de fausses mesures, l'autorité royale l'ait consacré, ou enfin que simplement les contribuables, n'étant pas en humeur de payer, chassent les percepteurs ou ne consentent pas à les recevoir. J'ai vu des villes se donner cette position commode, et les gouverneurs n'y pouvaient rien, faute de troupes, de ressources ou de bonne volonté. Mais personne n'y prend garde.
Autrefois, la viabilité était très-perfectionnée en Perse. Les rois sassanides avaient créé, dans les provinces du Sud principalement, de magnifiques routes, des ponts, des caravansérails en grand nombre. Les différentes dynasties musulmanes continuèrent ce système, et jusqu'à la fin des Séfévys, dans le premier tiers du siècle précédent, les travaux existants furent conservés avec soin, et çà et là augmentés. Mais, depuis lors, tout est détruit, tout a disparu. Dans l'empire entier il n'existe plus un chemin, pas même pour aller de Téhéran à la résidence d'été du souverain, qui en est à deux lieues. À la vérité, tant que dure la belle saison, la nature du sol et la sécheresse soutenue du climat permettent de s'en passer en beaucoup d'endroits. L'habitude et l'adresse font le reste.
Il y a encore quelques ponts, la plupart construits par des particuliers. Comme on ne les répare point, il est d'usage de les économiser, en ne passant dessus qu'en cas de nécessité absolue. Un honnête voyageur me disait que c'était pécher que d'user les ponts sans besoin. Un homme consciencieux traverse à gué, et les caravanes n'y manquent jamais.
Il n'y a pas de forteresses; il n'y a pas d'arsenaux sérieux; il n'y a pas un magasin public; l'administration, quant à son personnel, n'existe que pour fournir à une partie nombreuse, il est vrai, de la population, des prétextes pour vivre aux dépens de l'autre; l'armée cause plus de concussions qu'elle ne rend de services. Cependant elle est utile encore, car elle peut, dans bien des cas, maintenir l'ordre, et surtout elle a puissamment contribué à tenir en échec d'abord, à ruiner ensuite la puissance des tribus nomades. Mais, en somme, en disant du gouvernement de la Perse qu'il n'existe pas, on n'exagère que de bien peu.
Les amusements d'un bazar persan.
Je ne crois pas qu'il y ait de lieu au monde où l'on s'amuse plus continuellement que dans un bazar de Téhéran, d'Ispahan ou de Schyraz. C'est une conversation qui dure toute la journée sous ces grandes arcades voûtées, où la foule se presse perpétuellement aussi bigarrée que possible. Les marchands sont assis sur le rebord des boutiques, où les marchandises s'étalent avec un art d'exposition que nous avons imité et perfectionné. Les loutys coudoient la foule, le bonnet de travers, la poitrine débraillée, la main sur le gâmâ. Les aveugles chantent. Un raconteur d'histoire s'est emparé du chemin et hurle à pleins poumons les douleurs ou les attendrissements, ou les paroles édifiantes d'un roman. Là, passent des Kurdes avec leur turban énorme et leur physionomie sombre et sérieuse. Au milieu d'eux se glissent, semblables à des anguilles, des mirzas, l'encrier à la ceinture, gesticulant comme des possédés et riant à grands éclats; dans leur marche précipitée, ils tombent sur une file de mulets chargés de marchandises, qui sont arrêtés à leur tour par de longs chameaux venant en sens inverse. La question pour la foule est de passer au milieu de ce conflit; ce qui est certain, c'est qu'elle y passe. Un derviche avec ses cheveux épars, son bonnet rouge brodé en soie de couleur de maximes édifiantes, le corps à demi nu, la hache sur le dos, et faisant sonner une grosse chaîne de fer, s'entretient familièrement avec un moullah, marchand de livres, ou un tourneur qui lui fabrique un tuyau pour son kalyan. Là-dessus passe un gentilhomme afghan à cheval, suivi d'une troupe de ses stipendiés. C'est la figure dure, sauvage, intrépide des lansquenets, et c'est aussi leur air débraillé. Turbans bleus collés sur la tête, habits de couleur sombre déguenillés, de grands sabres, de grands couteaux, de longs fusils et de petits boucliers sur l'épaule, de vrais pandours, et dans toute cette cohue des troupeaux de femmes. Elles errent deux à deux, quatre à quatre, très-souvent seules, toutes uniformément couvertes d'un voile de coton, rarement de soie, gros bleu, qui les entoure depuis le sommet de la tête jusqu'aux pieds. Le visage est étroitement caché par une bande de toile blanche qui s'attache derrière la tête, par-dessus le voile bleu, et retombant devant jusqu'à terre, rend impossible d'apercevoir ni de deviner les traits. Un carré brodé à jour à la hauteur des yeux, leur permet de voir très-bien et de respirer à travers ce rou-bend ou lien de visage. Sous le voile bleu appelé tchader, qui est surtout destiné à envelopper depuis la tête jusqu'aux genoux de la personne, se met encore un vaste pantalon (p. 040) à pied qui contient les jupes et qu'on ne revêt que pour sortir (voy. p. 44). Ainsi calfeutrées, enfermées, les femmes cheminent en traînant leurs petites pantoufles à talons avec un balancement qui n'a rien de gracieux, et viennent s'accroupir au bas de la boutique des marchands d'étoffes, faisant déplier des monceaux de pièces de toile, des soieries, des cotonnades, discutant, comparant, ne se décidant pas, et enfin se levant et s'en allant maintes fois sans avoir rien acheté, comme cela se pratique dans d'autres pays encore, et tout cela sans avoir soulevé le moindre bout de leurs voiles.

Persane. Guerrier kadjar. Guerrier. Paysan. Bourgeoise
persane. Portrait d'un peintre. Moullah (prêtre, professeur). Chef
wahabite.
TYPES ET PORTRAITS PERSANS.—Dessin de M. Jules Laurens.
Et tandis que les marchands font assaut d'éloquence et de persuasion pour arrêter ces goûts si incertains et si changeants, tous les propos et les cancans de la ville débordent de boutique en boutique. Ici on parle politique et on blâme telle mesure récente du gouvernement ou telle résolution qu'on dit imminente. On raconte ce qui s'est passé la veille au soir ou le jour même dans le harem du roi et le point exact où en est la discussion de telle klanum avec son mari. La chronique scandaleuse court de bouche en bouche, peu voilée et s'exagérant tous les quarts d'heure. On emprunte de l'argent et on en prête. On retire telle pièce de vêtement qui était en gage depuis six mois et on va engager telle autre. On se querelle, on se menace, mais on ne se frappe pas, à moins de circonstances rares. C'est un tapage, des cris, des rires, des gémissements, des poussées à faire tomber les voûtes, et souvent aussi elles ne résistent pas. Car, bâties en briques crues en beaucoup d'endroits et cimentées à la grosse, elles s'écroulent avec fracas, surtout aux approches du printemps, et on ne peut nier qu'elles n'écrasent çà et là quelques causeurs.
Les fiançailles. — Le divorce. — La journée d'une Persane.
Les Persans, extrêmement réservés sur la partie féminine de leur propre famille, sont on ne peut plus goguenards à l'endroit des femmes qui ne leur sont pas parentes. Ils s'en donnent alors à cœur joie, et à les entendre on croirait qu'il n'y a de dames respectables dans l'Iran qu'autant qu'ils ont encore une mère, une femme et des sœurs.
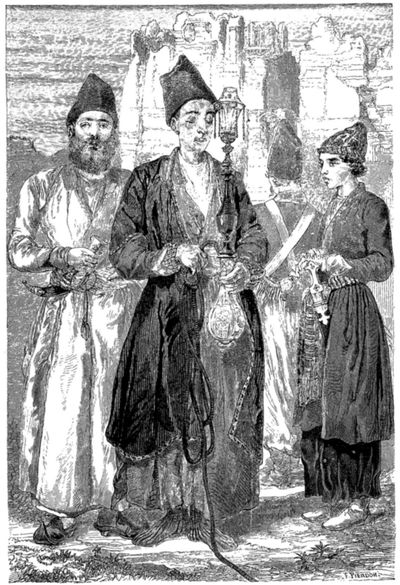
Ferach (homme de police publique ou privée). Kaliandji
(porteur de pipe). Soldat à l'européenne. Pichkadmeth (page).
GROUPE DE PERSANS.—Dessin de M. Jules Laurens.
Sans m'arrêter à ces rapports, probablement empreints de beaucoup d'exagération, je dois dire que les femmes persanes se marient très-jeunes. Dans les familles aisées, le père exige ordinairement du fiancé trente tomans pour le prix de l'épouse, c'est-à-dire 360 fr., ce qui n'est pas énorme, et le plus souvent cette somme est employée par les parents à l'usage de la jeune femme. Il n'y a donc pas lieu de dépenser d'éloquence pour plaindre le sort (p. 042) d'une victime vendue par un père barbare. Avant la cérémonie nuptiale, il s'écoule souvent plusieurs mois pendant lesquels le fiancé n'est pas censé être admis à voir sa future à visage découvert; mais, pour concilier sur ce point l'attitude que la coutume impose au père de famille et la légitime impatience du jeune homme, il est à peu près convenu que la mère de la jeune fille veut à celui-ci tout le bien possible, et par faiblesse lui fournit des occasions d'aller et venir dans la maison. Il en abuse et se livre à ce qu'on appelle le namzêd-bazy, ou la vie de fiancé, le jeu de fiancé. C'est-à-dire qu'il pénètre dans l'endéroun, saute par-dessus les terrasses, et entre et sort par les fenêtres à son gré.
D'ordinaire, les promis sont très-jeunes; l'homme a de quinze à seize ans; la fille de dix à onze. Mariés sur ce pied, on serait porté à croire qu'ils n'ont pas assez de raison pour conduire un ménage; mais la raison entrant peu en ligne de compte dans les affaires persanes, on admettra, sans trop d'indulgence, qu'ils sont déjà, sous ce rapport, à peu près aussi avancés qu'ils le seront jamais: de ce côté, il n'y a donc rien à dire. J'ai vu un ménage composé du père, de la mère, de la femme et du mari, livré à des angoisses extrêmes et tout le monde pleurant, parce que la jeune femme, âgée de quatorze ans, allait mettre au monde son premier-né. Le père déclamait contre sa femme, qui l'avait porté à exposer sa fille à un aussi grand danger. La mère perdait la tête d'inquiétude et courait çà et là, hors d'elle-même. Quant au mari, il s'était enfui dans un coin obscur pour échapper aux reproches qui pleuvaient sur lui de toutes parts et il pleurait à chaudes larmes. Quand les choses furent venues à bien par l'intervention des commères, il resta huit jours sans oser se montrer.
Dans les hautes classes, cette sorte d'enfantillage existe moins en réalité, mais on l'affecte. Car, à sept ou huit ans, un garçon épouse une femme pour avoir soin de lui. Elle lui appartient par un lien légal. Si, plus tard, elle ne lui plaît pas, il la répudie. C'est donc l'intérêt de celle-ci de tâcher de se l'attacher de bonne heure par la reconnaissance qui se forme très-vite, et qui néanmoins n'en est pas un lien plus solide.
Arrivée à vingt-trois ou vingt-quatre ans, il est assez rare qu'une femme n'ait pas eu déjà au moins deux maris et souvent bien davantage, car les divorces se font avec une excessive facilité; pas plus facilement toutefois que les mariages, car non-seulement on les conduit sans beaucoup de cérémonie, mais on a encore imaginé de les faire à terme, pour un an, six mois, trois mois et beaucoup moins; je n'ai pas besoin de dire que la considération publique n'a rien à voir avec ces sortes d'unions, qui sont jugées absolument comme on les jugerait en Europe. La différence est que rien ne fait scandale dans ce genre: la moralité asiatique ne blâme que ce qui s'affiche en public, et rien de ce qui se cache derrière les murailles de l'endéroun, où tout est permis.
Cette extrême facilité de faire et de défaire les alliances ne porte personne à avoir plusieurs épouses à la fois. On peut dire que les exemples de polygamie sont rares, et constituent presque des exceptions. Il y a telle ville, comme Démavend, par exemple, qui compte trois ou quatre mille âmes, où je n'ai trouvé que deux hommes ayant chacun deux femmes, et je dois dire qu'on ne leur en savait pas gré. Je parle des musulmans; car les nossayrys (ou Aly-Illays, sectaires) sont monogames. Ainsi, en admettant, comme on l'a dit, que la polygamie soit nuisible à la population, ce qui est un peu difficile à croire quand on voit les enfants de Feth-Aly-Schah donner à la troisième génération une tribu d'au moins cinq mille personnes, encore faut-il avouer que la polygamie ne saurait être comptable de la dépopulation de la Perse, puisqu'on peut dire presque à la rigueur qu'elle n'y existe pas. Il arrive quelquefois qu'un Persan, changeant de ville de temps à autre, aura une femme dans chacune de ces résidences, mais ces cas sont aussi des exceptions.
Les femmes sont très-rigoureusement cloîtrées dans l'endéroun, en ce sens que personne du dehors, aucun étranger à la famille n'y est admis. Mais, d'autre part, elles sont parfaitement libres de sortir depuis le matin jusqu'au soir et même depuis le soir jusqu'au matin dans beaucoup de circonstances. D'abord, elles ont le bain; elles y vont avec une servante qui porte sous son bras un coffret rempli des objets de toilette et des parures nécessaires, et elles en reviennent au plus tôt quatre ou cinq heures après. Ensuite, elles ont les visites qu'elles se font entre elles et qui ne durent pas moins longtemps. Puis elles ont leurs invitations pour les naissances, les mariages, les anniversaires, les fêtes publiques et particulières qui se renouvellent incessamment, sans compter les simples réunions plus fréquentes encore. Elles ont aussi les pèlerinages à des tombeaux situés à peu de distance dans de jolis paysages, auxquels elles sont fort exactes, et qu'elles ne voudraient pas négliger pour rien au monde.
J'ai rencontré des caravanes de pénitentes montées sur des mulets, sous la conduite d'un ou deux domestiques, et qui arrivaient du Mazenderan, c'est-à-dire de plus de quarante lieues. Elles paraissaient s'amuser beaucoup.
Il ne faut pas oublier que toutes ces femmes sont si exactement voilées et si semblables dans leurs vêtements extérieurs, qu'il est impossible à l'œil le plus exercé d'en reconnaître une seule. L'usage de prendre un mari pour faire un voyage en pèlerinage à Kerbela ou à la Mecque, lorsque le vrai mari ne peut accompagner sa femme, existe encore en Perse; mais, au retour, le mari par occasion cesse de rien être dans la famille.
Enfin, en mettant même à l'écart les invitations, le bain, les pèlerinages, les visites au bazar, les femmes sortent quand elles veulent, d'autant plus que les hommes restent très-peu au logis, et elles paraissent vouloir toujours sortir, car elles encombrent les rues en toute saison. À Dieu ne plaise que j'en conclue rien de défavorable et que je pense que cette perpétuelle locomotion, l'éducation très-libérale qu'elles reçoivent en certaines matières, la persuasion où elles sont qu'étant des êtres imparfaits elles ne sauraient être responsables de rien, enfin, l'incognito impénétrable qui les suit partout, les induisent à rien de fâcheux. Les Persans le prétendent, (p. 043) mais ils sont si médisants! et je n'en crois rien. Je me borne à trouver que cette licence sans liberté, cette absence complète d'éducation morale est d'un fâcheux effet pour les maris plus encore que pour les femmes, et leur ôte complétement, dès la jeunesse, le goût de la vie de famille et d'intérieur.
Les femmes sont absolument maîtresses dans ces maisons où elles restent si peu. Elles y sont servies par des domestiques des deux sexes, et on admet libéralement que l'endéroun peut rester accessible aux visiteurs qui n'ont pas plus de dix-huit à vingt ans. Aucune inconséquence ne choque dans ce pays, et lorsque en particulier on fait remarquer celle-ci aux Persans, ils en rient de tout leur cœur et vous font là-dessus deux mille contes plaisants; mais ils concluent bientôt sérieusement en disant que c'est l'usage.
Les femmes n'étant, comme je viens de le dire, responsables de rien, sont extrêmement colères et violentes. Le Prophète avait découvert qu'il leur manquait quelque chose dans l'entendement, et il s'empressa d'en conclure, comme elles l'ont trop bien retenu, que leurs faits et gestes n'avaient pas de conséquence. Plein de cette idée, il déclara même que le manquement le plus grave qu'on peut avoir à leur reprocher devrait être prouvé par quatre témoins oculaires. C'était à peu près donner l'impunité au sexe faible et lui montrer beaucoup d'indulgence.
Les femmes persanes ont pris le jugement du Prophète au pied de la lettre: il y a plus de maris à plaindre qu'il n'y a de femmes victimes. Elles ont surtout une tendance marquée à faire usage de leur pantoufle, et cette pantoufle, toute petite qu'elle soit, est construite en cuir très-dur et armée au talon d'un petit fer à cheval d'un demi-pouce d'épaisseur. C'est une arme terrible, dont j'ai vu les déplorables effets sur la figure labourée d'un malheureux mari qui s'était attiré la colère d'une petite dame de treize ans.
La journée d'un Persan. — Les visites. — Formules de politesses.
Les heures qui ne sont pas données au bazar sont absorbées par les visites. Comme partout ailleurs, il y en a de toutes sortes d'espèces, les visites de cérémonie, de convenance, d'affaires, de plaisir.
Quand on veut aller voir quelqu'un, on commence, le plus souvent, par lui envoyer un domestique pour s'informer de ses nouvelles et lui faire demander si tel jour, à telle heure, on pourra venir le voir sans le déranger. Dans le cas où la réponse est favorable, on se met en route et l'on arrive au moment indiqué, qui n'est jamais très-rigoureusement défini et qui ne peut pas l'être, vu la manière dont les Persans calculent le temps. Une heure après le lever du soleil est une bonne heure pour aller voir quelqu'un, parce qu'il ne fait pas encore trop chaud; ou bien encore à l'asr, c'est-à-dire tout le temps de la troisième prière, dont, par parenthèse, les Persans se dispensent très-souvent. Quand quelqu'un doit venir à l'asr, on peut l'attendre depuis trois heures de l'après-midi jusqu'à six heures, et il ne se trouve pas en retard. Comme le temps ne compte pour rien, être en retard ne serait d'ailleurs pas un tort, ou bien c'en est un que tout le monde partage.
On se met donc en route avec le plus de serviteurs possible, le djelodâr marchant devant la tête du cheval, la couverture brodée sur l'épaule; derrière le maître vient le kalyandjy avec son instrument. On chemine ainsi, au pas dans les rues et les bazars, salué par les gens de sa connaissance, donnant aux pauvres. Parmi ceux-ci il en est quelquefois d'espèce singulière. Ainsi un de mes amis se vit un jour accosté par une femme dont le voile tout neuf et le rou-bend d'une grande propreté indiquaient l'aisance. Elle lui demandait un schahy (un sou) d'une voix lamentable. Sur l'observation qu'il lui fit, qu'elle ne semblait pas en avoir besoin, elle lui répondit qu'en effet elle était riche, mais qu'ayant un enfant malade, elle s'était réduite pour ce jour-là à vivre de charités, afin d'obtenir par son humilité la miséricorde céleste. D'autres mendiants, d'espèce plus réelle, se lèvent tout droit sur votre passage, criant à tue-tête: «Que les saints martyrs de Kerbela et Son Altesse le Prophète et le Prince des croyants (Aly) élèvent Votre Excellence jusqu'au comble de la prospérité et de la gloire!» Quelquefois Son Excellence est un très-simple bourgeois, qui n'en donne pas moins son aumône, et qui en est remercié par une prosopopée digne de l'exorde. Si le passant est un chrétien, le mendiant ne souffle pas mot du Prophète ni de son monde, mais invoque à grands cris les bénédictions de Son Altesse Issa (Jésus) et de Son Altesse Mériêm (Marie), sur le magnifique seigneur, la splendeur de la chrétienté, qui viendra sans nul doute au secours du plus petit de ses serviteurs.
On arrive enfin à la porte où l'on doit s'arrêter et l'on met pied à terre. Les domestiques marchant en avant, on pénètre par différents couloirs toujours bas et obscurs, et souvent on traverse une ou deux cours jusqu'à la maison. Êtes-vous d'un rang supérieur, le maître du logis vient lui-même vous recevoir à la première porte. En cas d'égalité, il vous envoie son fils ou l'un de ses jeunes parents. Alors a lieu un premier échange de politesses: «Comment Votre Excellence ou Votre Seigneurie a-t-elle conçu la pensée miséricordieuse de visiter cet humble logis?» De son côté, on répond, en s'exclamant sur l'excès d'honneur qui vous est fait: «Comment daignez-vous ainsi venir au-devant de votre esclave? Me voici dans une confusion inexprimable; je suis couvert de honte par ces excès de bonté.»
En devisant ainsi, on arrive jusqu'à la porte du salon où l'on doit entrer. Ici on fait assaut de civilités pour ne pas passer le premier. Le maître vous affirme que vous êtes chez vous, que tout doit vous obéir dans cette pauvre demeure; vous vous défendez avec modestie, vous jurez d'être résolu à n'en rien faire, puis vous quittez vos chaussures, votre hôte en fait de même, et vous entrez.
Vous trouvez généralement réunis tous les hommes de la famille, qui sont là pour vous faire honneur. Ils se tiennent debout, rangés contre le mur. Ils s'inclinent à (p. 044) votre arrivée et vous répondent par un salut général. Puis le maître vous mène dans un coin de la salle, où il veut vous faire asseoir au haut bout, ce dont vous recommencez à vous défendre avec un surcroît de protestations. L'assistance sourit à cet aimable combat, qui prouve, de la part des deux acteurs, une excellente éducation. Enfin, vous prenez place et votre hôte également. Sur votre prière, ce dernier fait un signe à son monde, qui remercie et s'assoit de même. Quand chacun est casé, vous vous tournez d'un air aimable vers votre hôte et vous lui demandez si, grâce à Dieu, son nez est gras. Il vous répond: «Gloire à Dieu, il l'est, par l'effet de votre bonté!—Gloire à Dieu!» répliquez-vous.

Dans l'Endéroun (appartement intérieur).
Costumes
d'intérieur et de sortie.—Dessin de M. Jules Laurens.
Ensuite, vous vous inclinez vers le plus proche voisin, dont le rang d'ordre indique assez les droits particuliers à la considération, et, de la même manière, vous vous enquérez si, grâce à Dieu, sa santé est bonne. Sur une réponse qui est toujours affirmative et accompagnée d'un gloire à Dieu, d'un par l'effet de votre faveur, vous passez à un troisième, et ainsi de suite, tant qu'il y a d'assistants, ayant soin toutefois de nuancer votre question de manière à marquer une différence décroissante d'empressement, à mesure que vous descendez vers ceux qui sont placés le plus près de la porte. Là, vous ne faites plus guère de question, et une inclination aimable suffit.
Cette cérémonie ne laisse pas que de durer quelque temps. Quand elle est finie, vous revenez à votre hôte, et il n'est pas mal de lui redire avec un air de tête tout à fait caressant, et comme si vous ne l'aviez pas vu depuis quinze jours: «Votre nez est-il gras, s'il plaît à Dieu?» Ce à quoi il réplique du même ton: «Il l'est, grâce à Dieu, par l'effet de votre miséricorde!» J'ai vu répéter la même question trois et quatre fois de suite par des gens très-polis, et j'ai entendu citer avec éloge l'exemple du feu Iman Djumé, ou chef de la religion à Téhéran, qui, lorsqu'il allait chez quelques grands seigneurs, ne manquait jamais de demander des nouvelles de leur nez, non-seulement au maître du logis, mais encore à tous les domestiques, et ne remontait pas à cheval sans s'être assuré de la façon la plus aimable que le nez du soldat en faction à la porte était tel qu'on pouvait le désirer. Pour ce motif, ce grand dignitaire ecclésiastique était si populaire et si chéri de tout le monde, que sa mémoire est encore vénérée.

1. Vase à rafraîchir.—2. Debeh (poudrière)—3. Vase à
rafraîchir.—4. Petit couteau.—5. Agrafe.—6. Kamah (petit sabre).—7
et 9. Negare (baguettes et tambour).—8. Kandjar.—10. Debeh
(poudrière).—11. Gâteau.—12. Cuiller.—13. Vase.—14. Verre.—15.
Vase et plat.
CHOIX D'ARMES, D'INSTRUMENTS ET OBJETS DIVERS
PERSANS.—Dessin de M. Jules Laurens.
Enfin, après l'épuisement de cette question, il y a un moment de silence, et le maître de la maison y met fin en observant d'une façon générale qu'il est à remarquer que le temps médiocrement beau la veille est subitement devenu admirable, ce qui ne saurait s'attribuer qu'à la fortune étonnante de Votre Excellence. Les assistants ne manquent pas de relever la profonde vérité de cette observation, et quelqu'un se trouvera là pour dire que ce qui est excellent rend excellent tout ce qui l'approche ou l'entoure; que l'homme éminent en perfection doit être (p. 046) également entouré de perfections éminentes, et que partout où paraît Votre Excellence on ne saurait s'étonner de voir aussitôt régner l'équilibre complet des choses et le dernier degré du bien. Cette proposition soulève encore plus d'assentiments, et ce serait malheur qu'elle ne fût pas appuyée par une citation de quelque poëte.
On peut se confondre en démonstrations d'humilité, et il n'y a pas d'inconvénient à le faire. Mais il est mieux de répliquer que le temps ne s'est vraiment mis au beau que du moment où votre hôte a accepté votre visite, que ce n'est donc pas votre fortune, mais bien la sienne qui montre ici son ascendant, et, d'autant mieux, qu'un peu souffrant en montant à cheval, vous ne l'avez pas plutôt aperçu que vous vous êtes trouvé admirablement bien. Là-dessus, profitant du brouhaha qui s'élève pour applaudir au tour que vous avez donné à la conversation, vous amenez une anecdote qui ne manque jamais de porter les heureuses dispositions de l'assemblée à son comble. Votre hôte vous serre la main avec gratitude, vous lui serrez les mains avec tendresse, puis le kalian, le thé, le café, les sorbets circulent.
Je ne veux pas absolument faire l'éloge de cette manière excessive de comprendre la politesse; mais j'ai cru m'apercevoir que, spirituels comme sont les Persans, ils savaient facilement donner à tous ces compliments un peu exubérants une tournure qui allait à la plaisanterie; que de proche en proche, de ce terrain d'exagération, il sortait assez souvent des saillies et des mots qui ne manquaient ni de finesse ni d'agrément, qu'à force de subtiliser sur des absurdités, on rencontrait parfois des choses très-spirituelles, et enfin que, dans les occasions et avec des gens qui rendaient difficile ou impossible un entretien raisonnable, toutes ces occasions-là étaient, en définitive, moins plates, beaucoup plus animées et plus gaies que la conversation qu'on appelle chez nous de la pluie et du beau temps, bien que le fond en soit le même. Le plus grand mérite consiste donc dans la broderie, toute extravagante qu'elle soit, et peut-être parce qu'elle l'est.
Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'entre personnes qui ont quelque chose à se dire, ces formules se simplifient tout de suite; cependant, même d'ami à ami l'extrême courtoisie subsiste toujours, et cela dans toutes les classes de la société. J'ai vu des portefaix et des paysans se parler avec des égards qui semblaient bizarres pour nous. Les nomades seuls s'en dispensent. Aussi les Tadjyks les considèrent-ils comme des gens grossiers et indignes de vivre. Mais, je le répète, si, dans une réunion d'amis qui s'assemblent pour se réjouir, on ne se fait pas de ces interminables compliments, celui qui vous parle est toujours votre esclave; s'il a un bel habit ce jour-là, c'est toujours par l'effet de votre bonté, et s'il dit quelque chose qui plaise à la société, c'est par suite de votre miséricorde.
La peinture et la calligraphie persanes. — Les chansons royales. Les conteurs d'histoires. — Les spectacles: drames historiques.
La peinture est extrêmement déchue en Perse. Le roi Mohammed-Schah avait envoyé à Rome un artiste pour qu'il s'introduisît dans les secrets et les procédés de l'art européen, que les Persans reconnaissent volontiers comme très-supérieur au leur. Malheureusement le choix de l'étudiant ne paraît pas avoir été heureux. Le peintre n'a été frappé de rien et n'a rien compris. Le seul résultat de son voyage a été de rapporter une copie de «la Vierge à la chaise» qui a fait fortune, et est aujourd'hui reproduite partout.
Depuis longtemps on copie des gravures et des lithographies européennes.
Les Persans ont un goût singulier qui tient en quelque sorte aux arts du dessin, et qu'ils poussent jusqu'à la frénésie: c'est celui des beaux modèles de calligraphie. On donne cinq cents francs et au delà pour une ligne de la main d'un maître ancien, comme Émyry le derviche ou d'autres. Mais Émyry est le plus célèbre. Les maîtres modernes se payent naturellement moins cher, et sont cependant fort admirés. Tout le monde, d'ailleurs, tombe d'accord qu'on n'écrit plus aujourd'hui avec la même perfection et la même élégance que dans les siècles passés. Le style a changé. J'ai vu faire des folies pour des oeuvres anciennes, qui, en effet, étaient fort belles.
Les chansons jouissent d'une grande faveur, mais il faut qu'elles soient nouvelles, et les dernières connues ont surtout la vogue. Beaucoup sont satiriques et souvent politiques. Parmi celles qui ne traitent que des charmes de l'amour et du vin, un grand nombre a la plus auguste origine. Le roi, sa mère et les dames de l'endéroun royal en produisent sans cesse, qui sont aussitôt répétées dans le bazar et dans les autres endérouns. Mais si l'on change les paroles, il est rare que l'on fasse de nouveaux airs, et c'est pourquoi, au dire des personnes compétentes, la musique est entrée dans une phase de décadence. Peu de gens en savent la théorie, et on se contente d'apprendre par cœur certaines séries de chants qui permettent pleinement de se tenir au courant des nouveautés.
Dans toutes les rues, on rencontre des conteurs d'histoires ambulants. Autrefois, les cafés leur servaient surtout de théâtre, comme en Turquie. Mais les cafés, invention toute récente en Perse, ont été supprimés par l'Emyr-Nyzam, parce qu'on y parlait politique et qu'on y faisait trop d'opposition. Ils n'ont pas été rétablis depuis. Dans un emplacement assez vaste, près du Marché-Vert, on a construit une sorte de hangar en planches, ouvert de tous côtés et garni de gradins, de façon à pouvoir contenir deux ou trois cents personnes accroupies sur leurs talons. Au fond du hangar, s'étend une estrade. C'est là que depuis le matin jusqu'au soir se succèdent et les conteurs et les auditeurs. Les Mille et une Nuits sont considérées comme un recueil classique, fort beau assurément, mais vieilli. On leur préfère les Secrets de Hame, vaste collection en sept volumes in-folio, contenant les récits les plus bariolés, tous à la gloire des Imans. C'est la source où l'on puise de préférence. Mais on recherche aussi beaucoup les anecdotes plaisantes, les répliques ingénieuses, les récits qui contiennent quelques mauvais propos sur les moullahs et les femmes, le tout entremêlé de vers et quelquefois de chant. La population (p. 047) passe en grande partie sa vie à entendre ces récitations, qui ne coûtent pas cher aux oisifs, quand elles leur coûtent quelque chose.
Toutefois le charme qu'elles peuvent avoir, si grand qu'il soit, le cède complétement à celui des représentations théâtrales, avec lequel rien ne peut rivaliser. C'est une furie dans toute la nation; hommes, femmes et enfants ont les mêmes entraînements sous ce rapport, et un spectacle fait courir toute la ville. Dans tous les quartiers et sur toutes les places, se trouve une sorte d'auvent plus ou moins vaste destiné à cet usage. C'est là que se mettent certains personnages du drame, mais l'action se passe sur la place même, de plain-pied avec les spectateurs. Les femmes sont réunies en foule d'un côté et les hommes de l'autre, sans que ces deux parties de l'assemblée soient cependant très-rigoureusement séparées. Le spectacle est toujours un drame emprunté à la vie des Persans, l'histoire d'une persécution des califes abbassides. La plus célèbre de ces compositions est celle que l'on représente au mois de Moharrem et qui a pour sujet la mort des fils d'Aly et de leurs familles dans les plaines de Kerbela. Cette déclamation dure dix jours, et pendant trois ou quatre heures chaque fois. Ce sont des morceaux lyriques souvent fort beaux et très-pathétiques, ajustés les uns au bout des autres et récités avec passion. On n'y craint pas les longueurs, et les Persans n'ont jamais assez de la peinture détaillée des souffrances, des malheurs, des angoisses, des terreurs de leurs saints favoris. Toute l'assemblée sanglote à qui mieux mieux et pousse des cris de désolation. Chez le plus grand nombre ces démonstrations sont sincères, car il est difficile, en effet, de ne pas être ému, et j'ai vu des Européens saisis de tristesse; mais, pour quelques-uns, il y a affectation évidente, et ce ne sont pas ceux qui gémissent le moins haut.
De temps en temps, le moullah, qui est assis en face sur un siége élevé, prend la parole pour faire mieux comprendre à la foule combien les Imans ont souffert. Il entre dans les détails de leurs tourments, il paraphrase le drame, il maudit les califes oppresseurs et il entonne des prières. Aussitôt les auditeurs, et principalement les femmes, commencent à se frapper violemment la poitrine en cadence en chantant une sorte d'antienne et en répétant sans fin, avec des cris furieux: «Husseyn, Hassan!» Puis, l'entr'acte terminé, la pièce reprend. Bien que le fond soit le même depuis bien des années, on y change toujours quelque chose, et généralement on amplifie et développe les morceaux les plus pathétiques. Il n'est pas mal que les acteurs qui remplissent les rôles odieux fondent en larmes comme les spectateurs à l'idée de leur propre scélératesse. J'en ai vu un qui remplissait le rôle abominable du calife Yézyd et qui était tellement indigné de lui-même, qu'en proférant les menaces les plus atroces contre les saints Hassan et Husseyn, il pleurait au point de pouvoir à peine parler, ce qui portait à son comble l'émotion de la foule. Je ne sais si ces gens-là traitent une œuvre d'après les principes de Longin et autres critiques, mais il n'est pas possible de nier qu'ils produisent sur le public des effets dont nos plus beaux chefs-d'œuvre tragiques n'approchent pas. C'est le théâtre compris un peu à la manière des anciens Grecs.
Nous avons l'honneur, nous autres Français, de jouer un très-beau rôle dans la représentation de la mort des Imans, fils d'Aly. Un ambassadeur du roi Jean (quel roi Jean[7]? C'est ce qu'il n'est pas très-facile d'expliquer) se trouvait à la cour du calife Yézyd quand on lui annonça la famille sainte faite prisonnière à Kerbela. Il chercha à émouvoir le tyran en faveur de ces femmes et de ces enfants. N'ayant pu y réussir, et transporté d'indignation et de douleur, il se déclara musulman et schyyte et fut martyrisé.
J'ai parlé ailleurs des farces, ou saynètes. Je n'y reviendrai donc pas.
Épilogue. — Le Démavend. — L'enfant qui cherche un trésor.
J'ai passé quatre mois campé dans le désert au pied du volcan du Démavend. Nos tentes s'appuyaient à la jolie rivière de Lâr. Un tapis de hautes herbes et de fleurs agrestes s'étendait sous nos pieds. Des pics élancés touchaient le ciel de toutes parts. Nous n'avions d'autres visiteurs dans cette solitude profonde que des nomades qui, de temps en temps, passaient près de nous, dressaient leurs camps loin du nôtre et demeuraient là une ou deux semaines. Un jour des Alavends, tribu turque, vinrent planter trois ou quatre de leurs tentes noires de l'autre côté du ruisseau. Tandis que les hommes allaient chasser et que les femmes s'occupaient des travaux domestiques, un enfant de dix à douze ans, maigre, noirci par le soleil, à demi nu, ayant la figure la plus intéressante et la plus triste, s'approchait de la rive opposée à la nôtre. Il ne nous regardait pas, et tous les jours il revenait de même et ne nous regarda jamais. Il ramassait des pierres sur le bord, les tenait dans la main, et les considérait avec attention, puis les rejetait dans l'eau loin de lui. Quelquefois il examinait plus longtemps un de ces cailloux et, le mettant à part, il reprenait son travail et continuait à chercher. Le soleil torride, la pluie, le vent, le froid, rien ne le chassait, rien n'arrêtait son ardeur fiévreuse, et tant que le jour durait il ne se reposait pas. Il n'aurait pas cessé même la nuit, si une femme, sa mère sans doute, ou si son père n'était venu le chercher. On l'emmenait avec un peu de contrainte et il suivait à regret. Ce petit infortuné avait été frappé du soleil, et il avait perdu la raison; cet accident arrive fréquemment chez les nomades. Il ne songeait plus qu'à chercher un trésor de la nature duquel il ne pouvait rendre compte, mais pour lequel il oubliait tout ce qui au monde est réel.

Le Démavend.—Dessin de M. Jules Laurens.
J'oserai dire que cet enfant me représente un peu le génie dominant de l'Asie; dès l'aurore des âges, moins occupé de la vie positive et des choses matérielles que (p. 048) d'obéir à un élan qui le pousse d'une force merveilleuse vers l'inconnu. Il a sans doute ramassé dans le cours des ruisseaux bien des cailloux sans valeur, quelques-uns par hasard d'une merveilleuse beauté, mais plus souvent encore il a ramassé des monceaux de pierres auxquels il sentait qu'il ne devait pas s'attacher. Il a persévéré toujours, et toujours il persévère, et c'est là une puissance dont le reste du monde devrait être reconnaissant, puisqu'il lui doit, en somme, tout ce qu'il possède et a possédé jamais du haut domaine intellectuel[8],
Cte A. de Gobineau.
I. Sous le titre Voyage d'un naturaliste, pages 139 et 146, on a imprimé: (1858.—INÉDIT).—Cette date et cette qualification ne peuvent s'appliquer qu'à la traduction.
La note qui commence la page 139 donne la date du voyage (1838) et avertit les lecteurs que le texte a été publié en anglais.
II. Dans un certain nombre d'exemplaires, le voyage du capitaine Burton aux grands lacs de l'Afrique orientale, 1re partie, 46e livraison, le mot ORIENTALE se trouve remplacé par celui d'OCCIDENTALE.
III. On a omis, sous les titres de Juif et Juive de Salonique, dessins de Bida, pages 108 et 109, la mention suivante: d'après M. A. Proust.
IV. On a également omis de donner, à la page 146, la description des oiseaux et du reptile de l'archipel des Galapagos représentés sur la page 145. Nous réparons cette omission:
1º Tanagra Darwinii, variété du genre des Tanagras très-nombreux en Amérique. Ces oiseaux ne diffèrent de nos moineaux, dont ils ont à peu près les habitudes, que par la brillante diversité des couleurs et par les échancrures de la mandibule supérieure de leur bec.
2º Cactornis assimilis: Darwin le nomme Tisseim des Galapagos, où l'on peut le voir souvent grimper autour des fleurs du grand cactus. Il appartient particulièrement à l'île Saint-Charles. Des treize espèces du genre pinson, que le naturaliste trouva dans cet archipel, chacune semble affectée à une île en particulier.
3º Pyrocephalus nanus, très-joli petit oiseau du sous-genre muscicapa, gobe-mouches, tyrans ou moucherolles. Le mâle de cette variété a une tête de feu. Il hante à la fois les bois humides des plus hautes parties des îles Galapagos et les districts arides et rocailleux.
4º Sylvicola aureola. Ce charmant oiseau, d'un jaune d'or, appartient aux îles Galapagos.
5º Le Leiocephalus grayii est l'une des nombreuses nouveautés rapportées par les navigateurs du Beagle. Dans le pays on le nomme holotropis, et moins curieux peut-être que l'amblyrhinchus, il est cependant remarquable en ce que c'est un des plus beaux sauriens, sinon le plus beau saurien qui existe.
Le saurien amblyrhinchus cristatus, que nous reproduisons ici, est décrit dans le texte, page 147.
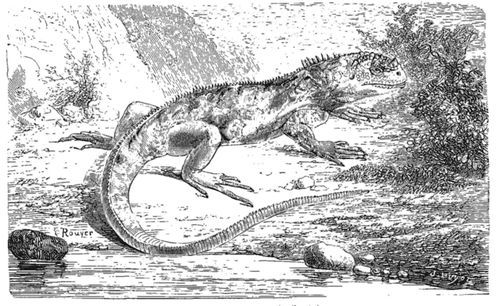
Amblyrhinchus cristatus, iguane des îles Galapagos.
IMPRIMERIE GÉNÉRALE DE CH. LAHURE
Rue de Fleurus, 9, à Paris
Note 1: M. le Cte A. de Gobineau, premier secrétaire de la dernière ambassade française en Perse, est auteur d'un volume intitulé: Trois ans en Asie (de 1855 à 1858) (Paris, Hachette). C'est à cet ouvrage estimé que nous empruntons, avec l'autorisation de M. de Gobineau, les pages qui suivent.—Nous croyons devoir rappeler que MM. Eugène Flandin et Pascal Coste ont publié depuis 1851: un Voyage en Perse (fait en 1840 et 1841); les Monuments de la Perse ancienne et les Vues pittoresques de la Perse moderne (Paris, Gide et Baudry).[Retour au Texte Principale]
Note 2: M. Jules Laurens, attaché par les ministères de l'intérieur et de l'instruction publique, comme peintre, à la mission en Orient de feu X. Hommaire de Hell, est parti de France pour l'Italie, la Grèce, la Turquie, les principautés danubiennes, et la Russie méridionale, en mai 1846; il a voyagé en Perse depuis le 6 novembre 1847 jusqu'au 15 mars 1849, et est rentré en France en juillet 1849.[Retour au Texte Principale]
Note 3: M. de Gobineau dit ailleurs que le groupe européen se composait, sans parler de sa famille et de lui, «du ministre, de deux secrétaires de la mission, d'un attaché, de deux drogmans, d'un peintre, d'une femme de chambre tourangelle, de cinq domestiques.»[Retour au Texte Principale]
Note 4: Personnage chargé par le gouvernement persan d'escorter ambassade pour lui faire honneur.[Retour au Texte Principale]
Note 5: Louty, Baktyary, noms de tribus; ils désignent habituellement des espèces de nomades assez mal famés.[Retour au Texte Principale]
Note 6: Suite et fin.—Voy. p. 17.[Retour au Texte Principale]
Note 7: Il est probable qu'il s'agit, non d'un roi français, mais du fameux prêtre Jean, prince tartare, suivant quelques auteurs, le grand lama suivant d'autres. On trouve une discussion remarquable sur ce mystérieux personnage dans l'introduction que le savant M. d'Avezac a mise en tête de la relation des Mongols et des Tartares, par le frère Jean du Plan de Carpin.[Retour au Texte Principale]
Note 8: «La Perse n'a fourni, en 1859, qu'un faible contingent de relations et de notices. C'est un pays qui a déjà été trop exploré pour donner lieu à des voyages de découvertes proprement dits, mais il n'est pas encore assez connu pour qu'il ne reste pas à en étudier la topographie, l'état économique, les institutions et les ressources. Une expédition russe, qui le parcourt en ce moment, promet une moisson plus riche que celle qu'avaient recueillie les précédents voyageurs. La grande échelle sur laquelle elle a été organisée, le mérite des hommes qui la composent ont permis un ensemble d'investigations auxquelles ne pouvait suffire un voyageur isolé. À la fin de septembre 1858, l'expédition avait atteint Hérat; elle avait jusqu'alors trouvé près du gouvernement persan le plus favorable accueil. À Hérat et aux environs, les voyageurs ont rencontré de nombreux restes d'antiquités. Partout se présentaient sur leur route des fragments de marbre et de serpentine travaillés, des briques émaillées et des vestiges d'inscriptions. Pendant le séjour de M. de Khanikoff à Téhéran, quelques-uns de ses compagnons avaient été faire dans les environs d'Astérabad une course qui n'a pas été sans profit pour l'histoire naturelle. Une partie de Mazandéran fut explorée, tant sous le rapport topographique que sous le rapport botanique et zoologique. On dressa, par des opérations géodésiques, un itinéraire détaillé d'Astérabad à Téhéran, en passant par Scharoud. Pendant leur séjour à Mechhed, les membres de l'expédition en étudièrent avec soin les monuments et explorèrent la riche bibliothèque de manuscrits que Iman Riza y a réunis. Tout le monde a entendu parler des célèbres mines de turquoises du Khoraçan. M. Gœbel y est descendu et s'y est livré à une exploration attentive du minerai qui fournit ces pierres précieuses. Le même naturaliste a visité Turbet, Cheïdari, Turmis, Kuchimisch, Sebswar et Kudjan ou Kabujan. Nous ne connaissons encore que d'une manière sommaire les richesses recueillies par l'expédition, mais ce qu'on nous en rapporte ne permet pas de douter que l'histoire naturelle n'ait beaucoup à gagner du voyage de M. de Khanikoff.» (Rapport de M. Alfred Maure sur le progrès des sciences géographiques pendant l'année 1859, lu à la grande assemblée générale annuelle de la Société de géographie de Paris.)[Retour au Texte Principale]