
Title: À travers l'hémisphère sud, ou Mon second voyage autour du monde. Tome 2
Author: Ernest Michel
Release date: September 2, 2008 [eBook #26511]
Most recently updated: January 4, 2021
Language: French
Credits: Produced by Adrian Mastronardi, Christine P. Travers and
the Online Distributed Proofreading Team at
https://www.pgdp.net (This file was produced from images
generously made available by the Bibliothèque nationale
de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)
Note au lecteur de ce fichier digital:
Seules les erreurs clairement introduites par le typographe ont été
corrigées.
Équateur, Panama, Antilles, Mexique, Îles Sandwich, Nouvelle-Zélande, Tasmanie, Australie.

PARIS
LIBRAIRIE VICTOR PALMÉ
(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE LIBRAIRIE CATHOLIQUE)
76, Rue des Saints-Pères, 76
| BRUXELLES | GENÈVE |
| Société belge de Librairie | Henri Trembley, Éditeur |
| Vandenbroeck, Directeur | Libraire-Éditeur |
| 8, Rue du Treurenberg, 8. | 4, Rue Corraterie. |
| 1888 | |
En ouvrant ce deuxième volume, le lecteur, dans une courte excursion à la République de l'Équateur, fera connaissance avec le pays qui a produit Garcia Moreno, le président à la foi inébranlable, à l'énergie indomptable. À travers l'isthme de Panama, il admirera les gigantesques travaux du canal.
À la Jamaïque, il sera frappé des résultats immenses obtenus par le génie colonisateur des races anglo-saxonnes qui ont presque centuplé le chiffre de la population, tandis que Cuba et les Antilles espagnoles, trop souvent déchirées par les guerres civiles et affaiblies par l'incurie du gouvernement, restent stationnaires au point de vue du nombre et de l'industrie.
Aux États-Unis, il trouvera partout le travail en honneur, et cette énergie qui fait mettre en valeur par le concours des immigrants de toutes les nations, les richesses minières, agricoles et pastorales de cette immense contrée.
(p. II) Dans les Sandwich il verra comment les populations indigènes de race polynésienne savent se gouverner elles-mêmes, et ne dédaignent pas les conseils de la femme capable que ce peuple élève parfois à la dignité de sénateur.
Dans la Nouvelle-Zélande, en Tasmanie, en Australie, il admirera l'énergie et le courage de ces jeunes colonies qui, en 50 ans, ont couvert le pays de routes et de chemins de fer, de moissons et de troupeaux. Il louera leur sens pratique et leur attachement à la loi morale. Non seulement certains abus de nos grandes villes ne sont pas tolérés, mais encore le travail du dimanche, le blasphème, les mauvais propos sont sévèrement punis. Le bonheur de la famille et de la communauté étant en raison de sa moralité, tout individu qui porte atteinte à cette moralité est considéré comme un ennemi public.
Le lecteur verra que la prise de possession du monde par nos rivaux nous laisse quelque chose à faire pour qu'au siècle prochain, notre race, qui occupe incontestablement aujourd'hui une large place dans la petite Europe, ne soit pas effacée à côté des Anglais, des Russes, des Chinois, des Allemands dans la possession et le gouvernement des autres parties du globe. Pour cela il verra bien vite que les hommes étant la matière première des peuples, il importe d'arrêter (p. III) au plus tôt notre stérilité systématique par de justes réformes dans les lois successorales, dans l'instruction et dans l'éducation, faisant effort pour nous affranchir de la routine sur bien des points, et nous débarrasser de nombreux préjugés.
Un moyen d'instruction des plus pratiques, comme nous l'avons indiqué dans la préface du premier volume, est celui des voyages autour du monde qu'il importe de populariser. Le jeune homme y prendra de bonne heure l'esprit d'initiative, il saura découvrir comme nos voisins les points où il est plus facile d'acquérir une fortune, et par l'observation de ce qui se passe chez les autres peuples, il saura s'approprier ce qui leur réussit, évitant les défauts et les vices qui les affligent.
Nous préparerons ainsi une génération plus énergique, et plus pratique, capable alors de servir encore une fois d'instrument entre les mains de la Providence pour ses desseins à travers le monde.
Dans le prochain volume nous verrons, par la comparaison de l'Australie avec la Nouvelle-Calédonie, par celle de Maurice avec l'île de la Réunion, par la situation que nous avons perdue en Égypte et par celle que nous conservons encore en Palestine, comment il faut se comporter pour le choix et le gouvernement des colonies afin qu'elles prospèrent, et la conduite à adopter (p. IV) vis-à-vis des autres peuples pour les dominer par la force morale plutôt que par celle des armes.
Nous espérons montrer ainsi à la jeunesse française, comme dans un tableau d'ensemble, ce qu'est le monde aujourd'hui, afin que, lorsque demain elle sera appelée à jouer son rôle, elle sache éviter les écueils, toucher juste, tirer parti des hommes et des choses pour elle, pour la civilisation et pour la patrie.[Table des matières]
République de l'Équateur.
République de l'Équateur. — Surface. — Population. — Histoire. — Quito. — Guayaquil. — Le cacao. — La résine. — L'ivoire végétal. — Le quinquina. — Le tamarin. — Le caoutchouc. — La guerre civile. — Le Guayaquil. — Les crocodiles et le jeu de la pezéta. — Arrivée à Panama.
La République de l'Équateur, ainsi appelée parce que Quito sa capitale se trouve précisément sous l'équateur, a une surface plus grande que celle de la France, 646,000 kilomètres carrés; mais elle a moins d'un million d'habitants. Après l'émancipation, elle se détacha de la Colombie, et depuis 1830, elle a déjà changé neuf fois sa constitution. Les révolutions, comme dans presque toutes les républiques de race espagnole, y sont à peu près périodiques et parfois sanglantes jusqu'à la sauvagerie. Il arrive souvent que les présidents sont fusillés ou assassinés. En 1877, l'archevêque même de Quito, Mgr Ignacio Checa, fut empoisonné le Vendredi saint en célébrant l'office divin, et on sait que le président Garcia Moreno, qui avait montré une grande énergie durant ses deux présidences, et qui avait acheminé le pays vers le véritable (p. 002) progrès, fut assassiné sur la place de Quito, à 1 heure de l'après-midi, le 6 août 1875.
Le pays est divisé en 11 provinces et gouverné par un président; des élections pour une Chambre de députés ont lieu de temps en temps.

Équateur.—Le Chimborazo.
Quito, la capitale, possède une population de 60,000 âmes. Elle est située sur les plateaux de la Cordillère des Andes, non loin du volcan le Chimborazo, à plus de 3,000 mètres d'altitude. On dit que les malades de la poitrine qu'on y envoie au début de la maladie y guérissent facilement; mais on ne peut y arriver que par 6 ou 8 jours (p. 003) de cheval. Les bateaux à vapeur remontent la rivière Guayaquil pendant 9 à 10 lieues, puis des 80 lieues qui restent, 30 peuvent être faites en voiture, et le reste à cheval. La diligence pour la partie carrossable ne part qu'une fois par semaine. Le prix d'un cheval pour Quito est d'environ 50 fr. pour tout le trajet.

Équateur.—Quito.—Couvent de Saint-François.
L'histoire de Quito remonte jusqu'au VIIIe siècle, lorsqu'il tomba au pouvoir du roi Caran Scyri, chef d'une puissante tribu. Ses descendants firent la conquête de divers autres royaumes limitrophes; mais le dernier, Scyri XI, n'ayant qu'une fille appelée Toa, la maria à Duchicela, fils aîné de Condorazo, roi de Puruha, et les deux royaumes n'en firent qu'un. La dynastie des Duchicela (p. 004) dura jusqu'en 1463 et tomba sous la domination de Huainacepac, roi des Incas, qui dominait au Pérou. On sait que le dernier roi de cette dynastie, Hatahualpa, fait prisonnier par les Espagnols, fut tué par eux après un jugement ridicule, dans lequel Pizarro et Almagro furent juges et partie.
C'est le 28 août 1883, à 6 heures du matin, que le canon du navire annonce notre arrivée à Guayaquil. C'est la deuxième ville de la république et son port principal. Elle compte 30,000 habitants. Je descends à terre et parcours les rues pour arriver à la place. Le tracé de la ville ressemble à celui des villes chiliennes: place centrale d'une quadra; la cathédrale en bois occupe un des côtés; à l'extérieur on la prendrait pour un théâtre. Les rues ont 10 mètres de large et se coupent à angle droit; les maisons sont en bois avec portiques aussi bien au rez-de-chaussée qu'au premier étage, pour préserver de la chaleur. Les Agostiniens fêtent leur patron. Dans les rues circulent des patrouilles de soldats habillés de rouge, de gris, de blanc ou déguenillés.
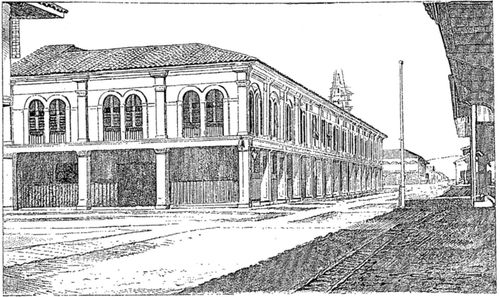
République de l'Équateur.—Guayaquil.—Collège des Frères de la Doctrine Chrétienne.
Les Sœurs de Charité soignent à l'hôpital 700 malades, dont plusieurs blessés dans la dernière bataille. Le Père Lafay, lazariste, après m'avoir fait visiter la ville, me conduit à la maison de la Mission. Comme la plupart des habitations des environs de la ville, elle est en bambou aplati et à doubles parois distancées d'un mètre et demi. Cette disposition permet à l'air de circuler, tamise la lumière et laisse une fraîcheur relative à l'intérieur. Le Père (p. 005) Clavery, visiteur pour l'Équateur, qui arrive de Quito, déjeune avec nous, et nous pouvons parler de la capitale, de l'intérieur du pays qu'il connaît à merveille, et même de Nice, où il a été le premier supérieur du grand séminaire.
Je vais ensuite faire visite à M. Malinowski, ingénieur polonais, qui a travaillé au chemin de fer transandin de la Oroya; à Mgr Verdier, évêque auxiliaire de Taïti, qui s'en va à San-Francisco pour rejoindre son diocèse, puis aux Sœurs des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, qui ont ici un pensionnat avec 100 élèves.
Au retour, je vois les quais encombrés de sucre, de cacao, qu'on chargera sur le navire. On sait que ce fruit est la matière première qui sert à former le chocolat. L'arbre qui le produit a besoin d'être planté à l'ombre; c'est pourquoi on aligne les plants sous des rangées de platanes; lorsqu'il est assez grand pour se faire ombre à lui-même avec ses feuilles un peu plus grandes que celles du châtaignier, on coupe les platanes. L'arbre atteint la taille de 5 à 6 mètres, et à l'âge de 5 ans il produit sur le tronc des fruits ayant la forme de concombres. On les cueille en les faisant tomber au moyen d'une lame en forme de croissant, fixée au bout d'un bâton. On ouvre le fruit, on en extrait les graines en forme de fèves rougeâtres, et on les fait sécher au soleil en les préservant de la pluie et de la rosée. Après 8 ou 10 jours on les met en sacs pour l'exportation. Le cacaotier, une fois planté, dure indéfiniment; on fait la récolte principale une fois l'an; une seconde récolte (p. 006) moins forte comprend les fruits qui repoussent. Un arbre donne en moyenne 25 livres de cacao, et on le vend ici actuellement 100 fr. les 46 kilogrammes.
J'aperçois aussi une quantité de barriques d'une résine jaune, transparente, que les pharmaciens emploient sous le nom de poix de Bourgogne, et le tagna ou ivoire végétal, sorte de petite noix de coco qui sert à faire les boutons ou autres objets pour lesquels on employait habituellement les dents d'éléphant.
La canne à sucre est cultivée ici, le café vient bien et sa qualité est excellente.
Le quinquina est aussi un bon produit du pays.
Les indigènes vont à la recherche des grands arbres qui le donnent, et lorsqu'ils les ont découverts par groupes plus ou moins considérables, ils les marquent. Cela suffit à leur assurer le produit de l'écorce qu'ils viendront chercher en son temps: Le meilleur est celui des racines et des branches tendres.
On récolte aussi beaucoup de tamarin, espèce de fruit ou fève aigrelette enfermé dans une gousse produite par de grands arbres. La pharmacie l'emploie comme rafraîchissant et astringent. On cultive aussi l'ananas qui est distillé.
Enfin, le caoutchouc donne un grand revenu. On calcule que chaque arbre en produit en moyenne 25 livres. On saigne la plante pour en recueillir le suc ou gomme élastique, et on peut la saigner, de nouveau après un repos de 3 ans. Son prix est actuellement de 300 fr. le quintal.

République de l'Équateur.—Hacienda del Melagro.—Plantation d'Ananas.
(p. 007) Le soleil, qui se couche derrière les collines et les forêts vierges de Guayaquil, est d'un effet très pittoresque. Un peu plus tard, lorsque les quais et les magasins qui le bordent seront éclairés au gaz, l'effet sera aussi des plus agréables.
Voyez-vous, à côté de la ville, ces quatre collines qui se suivent? me dit mon cicérone. C'est là qu'était Ventimiglia, il y a trois semaines, avec ses 4,000 soldats. Cet ambitieux, après avoir achevé le temps de sa présidence, afin de se maintenir au pouvoir, avait fait un coup d'État; mais le pays a voulu s'en débarrasser. Conservateurs et radicaux réunis ont formé deux armées qui se sont avancées jusqu'ici, au nombre de 7,000 hommes. La position ennemie paraissait imprenable; Ventimiglia avait fait couper sur les pentes de la colline les grands arbres épineux de la forêt, ce qui rendait l'accès très difficile, et ses soldats se tenaient au sommet derrière des remparts. Néanmoins, une belle nuit, les coalisés montent à l'assaut en silence et s'approchent à 50 mètres. Au cri de: Qui vive? ils répondent par une formidable décharge; les autres ripostent, mais finissent par lâcher pied, et Ventimiglia s'enfuit au Pérou sur un navire. Maintenant, les deux armées coalisées ont signé un accord, en vertu duquel elles se soumettront au gouvernement qui sortira des élections générales prochaines. Avant de partir, Ventimiglia, à la tête de 500 soldats, avait défoncé la banque nationale de l'Équateur et emporté 300,000 piastres. Moins hostile aux fous, voyant (p. 008) qu'ils recevaient des balles dans leur établissement, il autorisa leur transfert dans une autre maison. Au nombre de plusieurs centaines, ils sortirent donc en procession, portant chacun un objet de son choix et suivant les Sœurs de Charité dans leur nouvelle habitation. Les fous ici sont donc plus sages que les gouvernants. N'est-ce pas en effet une insigne folie de passer le temps à tuer les hommes dans un pays qui a tant besoin de bras! Espérons que le canal de Panama mettra cette riche contrée à portée de l'immigration européenne, et que bientôt le restant de la race espagnole pourra être noyé dans un ensemble d'étrangers plus sages qui imposeront au pays le sens chrétien pour qu'il jouisse de ses bienfaits. Je dis le sens chrétien, car dans un pays ou presque tout le clergé est corrompu, où le peuple s'amuse encore à voir éventrer des chevaux par des taureaux et des coqs s'écharper, il peut y avoir de la religiosité, du culte extérieur, mais il n'y a pas certainement de sens chrétien.

République de l'Équateur.—Hacienda a Jaguachi, près de Guayaquil.
Le 29 août, à 10 heures du matin, le navire se met en marche pour descendre la rivière.—Descendre est plus difficile en ce moment que remonter à cause de la marée, qui établit le courant inverse. Les bords du Guayaquil sont ravissants: les cocotiers, les bambous, les manguiers forment une forêt vierge impénétrable. On voit bien par-ci par-là quelques chalets qui indiquent l'élevage du bétail; mais la presque totalité de ces magnifiques terrains n'est pas utilisée. Le long du rivage nous voyons quelques crocodiles qui se chauffent au soleil (p. 009) dans la boue. Ils sont très nombreux ici, et vivent grassement des bancs de poissons qui remplissent la rivière. Ils déposent leurs œufs sur les bords et sous le sable pour que le soleil les fasse éclore. Heureusement, les galinassos en sont gourmands et en dévorent un grand nombre. On tire ici le caïman pour s'amuser, on utilise sa graisse comme remède pour les foulures des chevaux; mais on n'a pas encore appris à utiliser sa peau. Les Indiens sont habiles à les tuer avec un coutelas. Lorsqu'ils aperçoivent le crocodile, ils prennent un chapeau de paille et entrent dans l'eau jusqu'au cou. L'horrible bête s'avance pour engloutir la tête, mais l'Indien alors plonge, et pendant que le caïman mord le chapeau, lui, par-dessous, lui ouvre le ventre. Cette manière de tuer le crocodile est nommée le jeu de la pezéta, parce que l'Indien l'exécute à volonté pour une pezéta (1 fr.). Quelquefois, il va le chercher dans l'eau; il sait qu'au fond il n'attaque pas; il le touche sous le ventre, et pendant qu'il se relève, il passe dessous une corde, et sortant de l'eau, il le tire à terre, où il le tue à coups de rame ou de couteau.
Nous voici à Pûna, petit village à une des extrémités de la grande île de Pûna. Nous entrons dans le canal de Jambeli, et bientôt nous serons de nouveau dans la pleine mer.
Le 30 août, à 8 heures du soir, le navire arrive devant Tumaco. Belle rivière, superbe végétation; il en repart à 3 heures 1/2 du matin.
(p. 010) 31 août.—Grande bataille entre la baleine et le thrasher qui, quoique plus petit, semble vouloir vaincre. Nous voyons plusieurs baleines et des multitudes de thons. Le 1er septembre, à 9 heures du soir, nous arrivons à Buenaventura et en repartons à minuit. Le navire glisse sur des étoiles phosphorescentes.
2 septembre.—Mgr Plantier, évêque de Taïti, dit la messe à bord dans sa cabine.
3 septembre.—Navigation tranquille. Nous passons devant les îles des Perles, et ce soir nous serons à Panama.[Table des matières]

Panama.—Travaux du Canal.
Panama.
La ville de Panama. — La République de la Colombie. — Situation. — Surface. — Population. — Produits. — La Compagnie universelle du canal interocéanique. — Le personnel. — L'hôpital. — L'isthme. — Le canal et ses dimensions. — État des travaux. — Moyens d'exécution. — Le barrage du Chagre. — Le chemin de fer. — La ville et le port de Colon. — Résultat du percement de l'isthme.
D'après l'itinéraire distribué par la Pacific Steam Company, l'Islay devait arriver à Panama le 2 septembre. Nous n'abordâmes à ce port que le 3, à 5 heures du soir. Faute de fond, les navires s'arrêtent à l'île de Taboga, et nous transbordons sur un petit steamer qui, en vingt-cinq minutes, nous dépose au môle de Panama. Ce n'est pas petite affaire alors que de suivre le mouvement de ses bagages. Des noirs, des bruns les prennent à tort et à travers, et on a de la peine à les réunir.
Vue de la mer, la ville de Panama présente vin panorama magnifique. Elle occupe un petit monticule, formant presqu'île. Là s'accumulent les maisons et se détachent les clochers des nombreuses églises. Les palmiers, les cocotiers, les bananiers abondent comme dans les plus beaux pays de la zone torride.
À terre c'est autre chose; les maisons sont délabrées (p. 012) et plusieurs en ruine: l'herbe pousse partout, dans la saison des pluies; des dépôts de fumier par-ci par-là n'augmentent pas la salubrité de l'air; on me dit pourtant que la propreté a fait de grands progrès, et qu'il n'y a pas longtemps, tous les résidus étaient simplement jetés à la rue et y séjournaient. Une ville ainsi tenue engendrerait des miasmes et des maladies sous toutes les latitudes.
En ce moment, à la suite des travaux du canal, Panama, qui ne comptait dernièrement que 8,000 âmes, en a déjà 15,000. Au Grand Hôtel où je descends, on a la bonté de me donner une chambre formant coin, avec une fenêtre sur chaque façade; je comptais ainsi jouir du courant d'air, mais il y en a si peu ici, que les fenêtres n'ont même pas de vitres. Elles sont formées de simples planches massives dont le haut est découpé en persienne. J'avais la vue sur la mer et m'en réjouissais comme devant m'amener une brise pure et saine, mais la marée baissant, elle laisse à découvert des rochers sur quelques centaines de mètres, et les fumiers qu'on y dépose m'envoient des odeurs insupportables. S'il est vrai qu'on a fait déjà tant de progrès, il en reste à faire encore!
Le matin en me levant, je demande à prendre un bain. On m'envoie chez le perruquier. Il n'y a, en effet, que les perruquiers qui donnent des bains à Panama.

Panama.—La ville.
L'isthme de Panama se trouve dans l'État de Panama, un des 7 États confédérés de la Colombie. Cette république, au centre de l'Amérique, a une surface de (p. 013) 1,300,000 kilomètres carrés, et une population de 3,000,000 d'habitants. Elle confine au nord avec la mer des Antilles, au sud avec la république de l'Équateur et le Brésil, à l'est avec le Brésil et le Venézuéla, au nord-est la république de Costa-Rica, et à l'ouest le Pacifique. La capitale, Bogota, au centre du pays, est située à 3,000 mètres d'altitude, et compte 120,000 habitants. On l'atteint en remontant durant 8 jours le fleuve Maddalena, et en chevauchant durant 3 autres jours. L'intérieur du pays, dans les Andes, jouit d'un climat sain et tempéré, mais les côtes sont brûlantes et malsaines.
Les revenus varient entre 3 ou 4 millions de piastres. L'exportation atteint 35,000,000 de francs. Elle comprend l'or, l'argent, les pierres précieuses, le tabac; le quinquina, les bois de teinture, les résines, le caoutchouc, et les chapeaux dits de Panama. On exporte aussi une grande quantité de bananes: 1,500 à 2,000 tonnes par mois partent pour les États-Unis de l'Amérique du Nord. Il y a aussi de grandes plantations de cocotiers dont quelques-unes comptent jusqu'à 80,000 plants, rapportant une moyenne de 5 francs par plante.
La mer abonde en coraux, en nacre, tortues et poissons de toute sorte. Le bas des rivières est peuplé de caïmans. À Panama, dans les forêts vierges, on rencontre beaucoup de singes, et le paresseux, espèce de petit ours qui se meut très lentement mais qui ne lâche pas ce qu'il empoigne. On rencontre aussi le petit tigre, le serpent corail et beaucoup de scorpions. Parmi les oiseaux, (p. 014) on voit le perroquet, le cardinal, le canari, le merle, l'aigle, le condor et le paon.
Ma première visite fut pour les bureaux de la Compagnie. Ils occupent, sur la place, la grande maison qui était l'ancien Grand Hôtel. Sur la façade on lit: Compagnie universelle du canal interocéanique. M. de Lesseps a toujours travaillé pour le monde entier.
M. Dumarteau, directeur des travaux, me reçoit avec égards et me présente à M. le commandant Richier, agent général de la Compagnie, qui a la bonté de m'inviter à déjeuner.
Le mois d'août, qui est le plus mauvais de l'année, a encore éprouvé le personnel: sur 700 employés, 20 ont eu la fièvre jaune et le plus grand nombre les fièvres paludéennes. Au commencement de la saison des pluies, on peut presque prévoir quels sont ceux qui succomberont. Ce sont les buveurs et les noceurs. L'hôpital contient de 2 à 300 malades; ce chiffre n'est pas excessif pour 8 à 10,000 ouvriers.
La mortalité atteint environ 5%. La Compagnie déploie une sollicitude paternelle pour son personnel. Les employés débutent à 120 piastres par mois (600 fr.) plus 12% pour frais de logement. Les ingénieurs de section ont 417 piastres par mois. Après 2 ans, ils ont droit à un congé de 5 mois pendant lequel le traitement est payé en entier.
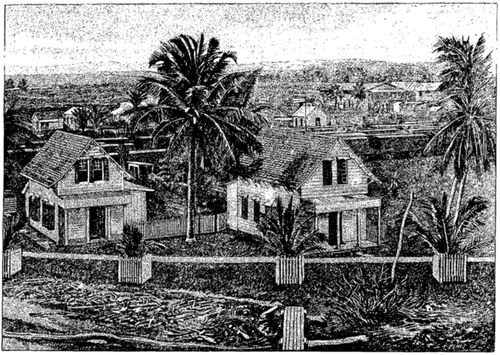
Panama.—Maison des employés du canal.
Dans les sections, sur la ligne, on a bâti des maisons pour le personnel. La Compagnie fait venir de France, le (p. 015) vin et l'eau de Saint-Galmier, et les cède à son personnel à prix coûtant.
À Panama, elle a formé pour ses employés un cercle avec billards et jeux divers. Les bureaux sont vastes, les fenêtres grandes et les plafonds élevés. Par intervalle, on les conduit en pique-nique aux îles des Perles ou ailleurs.
L'hôpital, bâti sur le versant d'une colline à 2 kilomètres de Panama, se compose d'un groupe de 12 maisons ou salles recevant séparément les divers genres de maladie. Ces 12 salles contiennent chacune 24 lits. Une maison est réservée aux employés: ceux-ci vont passer leur convalescence à l'île de Taboga, où l'air est pur et le climat sain. Les Sœurs de Charité, au nombre de 21, prennent soin des malades; le docteur en chef, avec lequel j'ai beaucoup causé, rend hommage à leur dévouement. La supérieure, qui m'a renseigné sur tous les détails du service, m'a paru une maîtresse femme remplie de tact. Les malades appartiennent à toutes les nations: Italiens, Américains, Anglais, Français, Allemands, nègres, et sont tous également bien traités. Les nègres souffrent, comme partout, de plaies aux jambes; les blancs sont facilement sujets à la fièvre paludéenne et à la dysenterie. Il y a eu quelques cas de fièvre jaune, mais à l'état endémique. Chaque section a aussi son médecin, ce qui en porte le nombre à 15.—500 ouvriers étaient en train d'entourer d'un superbe parc les bâtiments de l'hôpital. Près de là sont les écuries, dirigées (p. 016) par M. Trippier: la Compagnie possède, en ce moment 280 chevaux, mules et ânes, pour les divers services.
À la poste, je trouve de nombreuses lettres d'Europe; parents et amis vont bien, Dieu soit béni! mais j'ai moins de satisfaction par les renseignements des Compagnies de bateaux à vapeur. Celui qui va à San-Francisco ne part que le 12 septembre. Que faire pendant 8 jours sous le soleil de Panama? De plus, il arrive vers le 30 à San-Francisco, lorsque le steamer pour l'Australie est parti le 22, et que le suivant ne part que le 20 octobre. Que faire donc durant 20 jours à San-Francisco?
Je me décide à passer à Cuba, de là à Mexico et à la Nouvelle-Orléans, pour gagner San-Francisco par terre.
5 septembre.—M. Demarteau, qui se rend à Colon, veut bien m'admettre en sa compagnie, et le comte de Kérouan, inspecteur, m'explique minutieusement durant le trajet l'état des travaux.
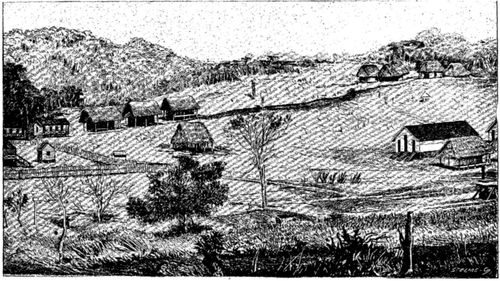
Panama.—Abattage de la forêt vierge.—Section 2.—Culebra.
Le tracé a 47 milles anglais, environ 80 kilomètres, et suit en grande partie la ligne du chemin de fer. Afin de ne pas être gêné pour le transport du matériel, la Compagnie du canal a acheté les 9/10 des actions de ce chemin de fer. On sait que, pour ce petit parcours, les voyageurs paient 25 dollars, ce qui a permis à la Compagnie primitive de réaliser d'importants bénéfices. Mais comme ce chemin est à voie unique; et qu'il; doit faire le service des voyageurs et des marchandises entre les deux océans, il est à craindre qu'à un moment donné il ne devienne insuffisant, (p. 017) surtout lorsque les travaux seront entrés dans la grande période d'exécution.
Pour le moment, la période de préparation touche à sa fin. La forêt vierge est coupée sur tout le parcours On abat les arbres et les lianes. Après la saison des pluies ils sèchent et on y met le feu. Presque partout on a poussé activement les voies ferrées destinées à la décharge des déblais. Dans une section, celle d'Imperador, dirigée par M. Jacquemain, on a déjà creusé le canal sur toute sa largeur à la profondeur de 1 mètre Le canal sera large de 100 mètres et profond de 8 mètres 1/2.
Le canal de Suez n'a que 7 mètres de profondeur, 100 mètres de large seulement dans les gares, et 140 kilomètres de long. Par contre, le canal de Panama, s'il est plus court, a des déblais plus durs et plus importants. On calcule que le quart sera roche dure ou demi-dure, et les talus varieront de 1 mètre jusqu'à 100 mètres au point culminant. Le terrain, en effet, sur la moitié de son parcours est ondulé, et quoique le tracé fasse plusieurs courbes pour éviter les collines, on ne peut faire à moins que d'en couper quelques-unes.
Nous voyons par-ci par-là fonctionner les excavateurs; ils sont de deux sortes: l'excavateur américain à une seule pelle, qui fonctionne comme les dragues marines. Le bout de la pelle est garni de trois pointes qui s'enfoncent dans le sol. La pelle se remplit de 2 mètres cubes de terre; élevée en l'air, on laisse tomber la paroi inférieure et la terre s'en va dans les wagons de décharge. Un excavateur (p. 018) peut ainsi enlever de 500 à 800 mètres cubes par jour. L'excavateur français est à godets sans fin, prenant la terre et la versant dans les wagons de décharge. Il remue à peu près le même nombre de mètres cubes que l'excavateur américain; l'un et l'autre coûtent environ 40,000 fr. Il y en a vingt-cinq en fonction en ce moment, mais le nombre en sera bientôt plus que triplé. Nous voyons aussi de nombreux ouvriers amener les wagons à main sur les petits rails mobiles: ce système rend bien des services.
Aux diverses stations, on a choisi un point élevé pour y construire les jolis chalets destinés aux employés. L'un d'entre eux, qui est dans notre wagon, emmène sa jeune épouse à la station qui lui est assignée. Il faut bien que ces anges du foyer aient leur part de peine et de courage dans ce grand travail qui honore notre pays. Les chefs en sont heureux, car jeune homme marié, jeune homme rangé; mais ils redoutent les dames aux pantalons.
À côté des chalets destinés aux employés, sont les cabanes de chaume à forme pyramidale en usage dans le pays. Elles servent d'habitation aux ouvriers. Près de là, les cantines, tenues par des hommes de confiance, leur fournissent le nécessaire à des prix raisonnables. Les tâcherons appartiennent à toutes les nations. Les ouvriers viennent en majorité des Antilles et gagnent de 5 à 6 fr. par jour. Ils travaillent presque tous à la tâche. On calcule qu'il faudra déplacer 100,000,000 de mètres cubes pour le canal; la moyenne du déplacement est de 5 fr. le (p. 019) mètre cube, ce qui fera un demi-milliard de francs. Jusqu'à ce jour, la Compagnie a émis pour 300,000,000 d'actions, sur lesquels un tiers est dépensé.
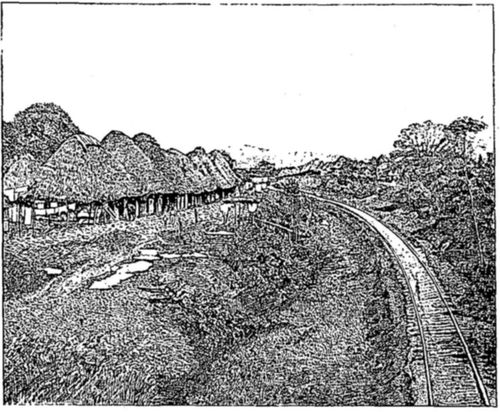
Panama.—Village indigène.
La Compagnie a passé avec des entrepreneurs divers de nombreux contrats pour l'excavation et le transport de millions de mètres cubes de terre dans un espace d'un à deux ans. Si les prévisions se réalisent, le canal sera achevé en 1888. Plusieurs, surtout parmi les Américains, pensent qu'il faudra vingt ans et un milliard et demi pour venir à bout de cette entreprise colossale. Quoi qu'il en soit, c'est déjà beaucoup qu'aujourd'hui on ne la déclare (p. 020) plus impossible et que la question se réduise aux chiffres d'argent et de temps.
Le travail le plus colossal sera le barrage du Chagre qui aboutit aujourd'hui au port de Colon. Cette rivière, lors des pluies diluviennes, s'élève de 18 à 24 pieds en quelques heures, et comme elle suit en partie le parcours du canal, il faut la déplacer et la rejeter vers Panama. On compte le faire au moyen d'un barrage qui sera le plus grand du monde et qu'on obtiendra par les millions de mètres cubes de déblais du canal.
La Compagnie a occupé gratuitement le terrain appartenant à l'État, mais elle a dû acheter tout celui qui appartenait aux particuliers. La moyenne des prix n'a pas dépassé 112 fr. l'hectare; il s'est élevé jusqu'à 500 fr. dans les parties plantées en bananes: on estime à environ 5 fr. le pied de bananier. Sur la route, nous en voyons des champs immenses avec des régimes dépassant le poids de 50 kilogrammes. On les coupe et on les expédie à New-York.
La Compagnie a en outre reçu comme gratification 600,000 hectares de terre qu'une commission d'arpenteurs va délimiter. Sur ces terres existent des mines d'or et de charbon.
À peine sortis de la région des collines, nous trouvons les marais, qui bordent la ligne du chemin de fer des deux côtés. Infailliblement, ils doivent engendrer les fièvres; on me dit que même les hirondelles en sont prises parfois et tombent, mais, l'accès passé, elles reprennent leur vol.
(p. 021) Le canal sera un vaste drainage qui recevra les rigoles latérales. Quand il sera achevé, la santé fleurira dans le pays. On pourra alors y cultiver la canne à sucre et toutes les plantes tropicales. Ceux qui jouiront de ces bienfaits penseront aux pionniers qui les leur auront procurés par le sacrifice de leur vie. Il en est ainsi pour tous les pays nouveaux. Il faut que l'homme soit semé, pour que la civilisation pousse dessus.
À la station de Buenavista, le tracé du canal quitte la ligne du chemin de fer et ne la retrouve qu'à environ 30 kilomètres plus loin, à la cité de Lesseps, près Colon. Là, des dragues creusent le port intérieur et on comble un marais qui fournira plusieurs hectares de terrain pour les quais et entrepôts.
Aussitôt que les nombreux excavateurs commandés seront arrivés et montés, la Compagnie pourra employer jusqu'à 40,000 ouvriers, et à mesure qu'on remplira les marais, et que le travail avancera, l'état sanitaire s'améliorera.
Colon, lui aussi, commence à prendre de grandes proportions par l'affluence des ouvriers.
Il en sera du canal de Panama comme de celui de Suez. Les plus intéressés, qui ne voulaient pas y croire et faisaient leur possible pour l'entraver, seront les premiers à en profiter, et un beau jour les journaux de tous les pays annonceront l'inauguration du grand canal interocéanique.
Ce sera un grand jour et comme l'aurore de la résurrection (p. 022) de l'Amérique centrale. En effet, ces pays, actuellement presque inabordables, seront alors accessibles à l'immigration européenne qui viendra et absorbera le noyau batailleur et sauvage de l'actuelle génération espagnole, et ces vastes contrées, qui se perdent aujourd'hui en révolutions périodiques, grandiront par l'application au travail et la mise à profit des immenses ressources du sol.
Les deux canaux de M. de Lesseps sont une œuvre providentielle de progrès et de paix. Comme les chemins de fer, ils auront contribué grandement à rapprocher les diverses branches de la famille humaine!
Après avoir laissé aux soins d'un agent de la Compagnie une caisse à expédier à la Société de Géographie de Lyon, je quitte M. Dumarteau et ses collaborateurs, tous si prévenants pour le voyageur, et à 6 heures du soir, je monte sur le Para, navire de 3,800 tonnes de la Royal-Mail, qui doit me porter à la Jamaïque, à Porto-Rico et à Saint-Thomas.
6 septembre.—Navigation par une mer houleuse. Des nuées de poissons volants accompagnent le navire.
7 septembre.—Navigation plus tranquille. Chaleur étouffante, 40°. Le soir, à 6 heures, nous arrivons devant Port-Royal, à l'entrée de la baie de Kingstown, capitale de la Jamaïque. L'officier de santé vient à bord et nous permet l'entrée.[Table des matières]
Les Antilles.
La Jamaïque. — Situation. — Surface. — Produits. — Température. — Histoire. — Population. — Justice. — Contributions. — Les coolies hindous. — Irrigation. — Chemins de fer. — Importation. — Exportation. — Main-d'œuvre. — Les Building Societies. — Les îles annexes. — La ville de Kingstown. — Le marché. — Une école professionnelle. — Une plantation de cannes à sucre. — Les campagnards. — La garnison.
Port-Royal ne contient maintenant que peu de maisons entourées de cocotiers. Elle était la capitale de l'île avant 1692; mais le 7 juin de cette année, un terrible tremblement de terre secoua la ville, et la mer soulevée la submergea. Des milliers de personnes périrent englouties dans les flots ou ensevelies dans les crevasses. Quelques-unes, après avoir été prises dans les fissures de la terre entr'ouverte, furent rejetées par des secousses postérieures et purent vivre encore de longues années. Port-Royal fut encore plusieurs fois reconstruite et plusieurs fois dévorée par les flammes. À la fin, ses habitants se transportèrent à Kingstown, à l'extrémité de la baie, et en firent la capitale.
Cette baie est vaste et sûre, mais peu profonde. On a creusé des canaux pour l'approche des navires, et un (p. 024) pilote est nécessaire. Nous laissons à gauche les bâtiments servant de lazaret, passons devant un fort, et accostons au môle à Kingstown. Partout la végétation est tropicale, les cocotiers élèvent leurs plumets même au-dessus du phare.
L'île de la Jamaïque est une des quatre grandes Antilles. Les trois autres sont Cuba, Haïti, Porto-Rico. Elle est située entre le 17° 43' et 18° 32' latitude nord et le 76° 11' et 78° 20' longitude ouest. Elle est distante d'environ 5,000 milles de l'Angleterre, 100 milles de Saint-Domingue, 90 milles de Cuba, 445 milles de Carthagène et 540 milles de Colon. Son nom est composé de mots indiens qui signifient eau et bois, deux choses qui abondent dans l'île. La longueur de Jamaïca, comme l'appellent les Anglais, est de 144 milles; sa largeur de 49; sa surface de 4,193 milles carrés, dont 646 seulement en plaines. Elle est divisée en trois comtés. La température est de 35° à 40° au bord de la mer, mais elle descend jusqu'à 15° ou 20° dans les montagnes qui couvrent presque toute l'île. Celles-ci atteignent au centre l'altitude de 7,360 pieds au pic des Montagnes Bleues. Dans les plaines, on cultive la canne à sucre; sur les coteaux, le café, et vers les sommets, le quinquina, espèce particulière qui vient ici en forme d'arbuste.
L'Île abonde en eaux minérales; les principales sources utilisées pour les bains sont: Bath, eaux sulfureuses, et Milk-river spring, eaux thermales salées.
La Jamaïque a été découverte le 3 mai 1494 par Christophe (p. 025) Colomb dans son deuxième voyage. Son fils Diego Colomb la gouverna après lui, mais par la suite, les Espagnols se montrèrent cruels envers les Indiens au point qu'en 60 ans ils firent périr 60,000 familles. L'île ne possédait plus que 4 à 5,000 habitants lorsque l'amiral Penn, le 3 mai 1655, s'en rendit maître au nom de l'Angleterre. On encouragea les plantations, on amena des nègres d'Afrique, et en 1673, un premier envoi de sucre fut fait en Angleterre. Le recensement de cette année donne pour l'île 4,050 hommes, 2,006 femmes, 1,712 enfants, 9,504 noirs, en tout 17,272 âmes.
En 1791, la population s'élève à 291,400 âmes, dont 250,000 esclaves. En 1871, la population compte 506,154 âmes, dont 13,101 blancs, 100,346 de couleur et 392,707 noirs. En 1881, la population atteint 580,804 âmes, soit une augmentation de plus de 74,000 en dix ans.
Conformément aux traditions anglaises, l'île est divisée en comtés et paroisses, et possède environ 2,000 électeurs. Elle est administrée par un gouverneur nommé par la Reine et assisté d'un Conseil. Les députés élus coopèrent à la formation des lois. La justice est rendue par des juges de paix, par les petty sessions dans les districts, avec droit d'appel à la Cour suprême.
Le terrain est frappé de contributions diverses selon le genre de culture; ainsi on paie 3 pence par acre de terrain planté en cannes à sucre, café, genièvre, arrowroot, blé, noisettes de terre, coton, tabac, cacao et légumes. (p. 026) On ne paie que la moitié de ce prix si le terrain est semé d'herbe de Guinée, qui est ici le meilleur foin. On paie 3/4 de penny pour un acre de terrain cultivé en piment ou destiné au pâturage; et 1/4 de penny pour un acre de terrain en bois. Le droit varie de 1 à 11 schellings par tête de bétail de trait; les chiens paient 5 fr. Les droits d'importation sont 6 pence par gallon de bière, 2 par livre de jambon, 4 par boisseau d'orge, 1 schelling par 200 livres de bœuf séché ou salé, 6 schellings par 100 livres de pain ou de biscuit, 2 pence par livre de chandelle, 10 schellings par tête de bétail, 3 schellings 1/2 par 100 livres de poisson séché ou salé, 8 schellings par 196 livres de farine, 2 schellings par gallon de vin.
Pour faciliter la culture de la canne à sucre, le gouvernement de l'île a eu recours aux coolies hindous. Il en existe maintenant une quinzaine de mille en Jamaïca. Tous les ans, un navire va les chercher aux Indes orientales, et ramène ceux qui, après 10 ans de séjour, demandent à être rapatriés. Le voyage et le retour sont aux frais du gouvernement. L'engagement est pour 10 ans, le coolie doit en passer 5 à la campagne. Pour les 5 autres, il pourra travailler où il voudra. Le propriétaire qui accepte le coolie doit lui fournir la nourriture, consistant en riz et poissons, et 1 schelling par jour. Pour les femmes, la nourriture et 9 pence par jour. Deux fois le mois, l'inspecteur passe dans chaque établissement qui occupe des coolies, pour voir comment ils se comportent et comment ils sont traités. S'ils sont légèrement (p. 027) malades, ils sont soignés à la ferme; s'ils le sont gravement, ils vont à l'hôpital. Après 10 ans, s'ils consentent à rester librement dans le pays, ils reçoivent une prime de 10 livres sterling. Ils sont plus intelligents que les noirs, et ceux qui se comportent bien se créent de bonnes situations.
Il y a déjà quelques petits tronçons de chemins de fer dans l'île. Les principales villes sont éclairées au gaz et fournies d'eau. On a même construit divers canaux d'irrigation, dont le principal, celui de Riocobre, compte au moins 60 kilomètres. Le service des prisons a été amélioré, les prisonniers sont séparés selon le degré de condamnation, et moralisés par le travail.
En 1881, l'importation a été de 1,392,668 livres sterling, et l'exportation de 1,178,594 livres sterling. Les articles principaux d'exportation ont été: le sucre pour 336,901 l. stg., le rhum pour 174,406 l. stg., le café pour 231,383 l. stg., le piment pour 87,843 l. stg., le bois de teinture pour 141,296 l. stg., les fruits pour 44,215 l. stg., le tabac pour 16,412 l. stg.
En 1881, étaient cultivées en canne à sucre 39,712 acres ou arpents; en café, 18,456 acres; en genièvre, 100 acres; en tabac, 408 acres; en cacao, 26 acres; en légumes, 51,363 acres; en herbe de Guinée, 120,443 acres; en pâturages, 253,470 acres; en prés et pâturages, 52,646 acres; en piment, 1,689 acres, soit un total de 538,313 acres de terre en culture.
La main-d'œuvre est, pour l'homme de peine, de 1 schelling (p. 028) 6 pence à 1 schelling 9 pence par jour. Les femmes se paient 1 schelling par jour. Le charpentier gagne 2 schellings 9 pence, le serrurier de 3 à 4 schellings. Une charrette et mule coûte 5 schellings par jour et 7 schellings avec 2 mules.
Le prix des objets de nourriture est de 3 pence la livre de pain, 2 pence 1/4 la livre de sucre, 6 pence la livre de bœuf, 9 pence la livre de volaille, 8 pence la livre de porc.
Comme dans toutes les colonies anglaises, il y a ici un grand nombre de building societies, qui ont pour but d'avancer l'argent nécessaire à la construction ou achat de maisons, remboursable mensuellement.
La Jamaïca permanent building Society, qui est une des principales, sur un prêt de 100 livres sterling, prend pour intérêt l. stg. 2-10-10 par mois durant 48 mois, ou bien l. stg. 2-6 durant 60 mois, ou l. stg. 1-17-1 durant 72 mois, et ainsi graduellement jusqu'à l. stg. 1-5-10 durant 120 mois.
Ces compagnies, tout en rendant un immense service aux habitants, qui trouvent par elles moyen de se former leur home, rapportent encore de beaux bénéfices, et il serait désirable de voir des sociétés semblables se former dans nos villes de France.
En 1881, il y avait dans l'île 53,635 hommes mariés, et 54,209 femmes mariées; les naissances se sont élevées à 21,340, soit 36 par 1,000 de la population; les morts ont été de 15,125, soit 26 pour 1,000.
(p. 029) La Jamaïque a comme annexes les petites îles Caïmans et les rochers Morant et Pedro. Le gouvernement, moyennant 50 l. stg. par an, permet aux personnes qui en font la demande, d'y recueillir le guano, les tortues et les œufs d'oiseaux marins.
La ville de Kingstown compte 38,000 habitants, ses rues ont 8 mètres de large et quelques-unes le double; les maisons sont en bois ou brique avec couverture en lames de bois; 600 maisons ont disparu dans le grand incendie du 11 décembre dernier, on les reconstruit et on fait les toitures en zinc.
Je descends à terre et parcours diverses rues: le gaz était remplacé par le clair de lune; c'est une bonne économie, car il coûte ici plus de 0 fr. 50 le mètre cube. La chaleur est suffocante, on voit partout derrière les persiennes sous les verandah, les gens étendus cherchant l'air respirable.
Les trottoirs sont couverts de portiques en bois.
Les Pères Jésuites desservent la mission.
Les Franciscaines du tiers ordre s'occupent d'instruction; elles ont 15 internes, 30 demi-pensionnaires et plus de 100 externes gratuites. Le parc, au centre de la ville, est fort gracieux. On y voit les statues des gouverneurs et autres hommes de mérite qui ont illustré le pays.
C'est samedi jour de marché, les halles sont fort animées. Plusieurs rues reçoivent le trop plein des vendeurs; ces bonnes gens portent au marché des mangos, des poires à beurre végétal, des bananes, diverses autres (p. 030) sortes de fruits tropicaux, des cannes, de la mélasse, des racines, des piments, des ananas, des légumes, etc. La viande a très bonne apparence.
Le Père Ryan a la bonté de me retenir à déjeuner. Sa maison est vaste et bien aérée, néanmoins le thermomètre, dans sa chambre, marque 37°. Les Pères ont le soin spirituel de 11,000 catholiques dans l'île, le reste de la population appartient aux diverses sectes protestantes. Le Père Dupon est depuis 35 ans dans l'île, où il est connu, estimé et aimé de tout le monde. Après une excursion à la campagne, au déjeuner on me sert les principaux fruits et légumes du pays, le tout assaisonné par du madère et le fameux rhum de la Jamaïque. Le bon Père veut me faire connaître une institution de création récente; c'est une maison d'instruction professionnelle qui vient d'être confiée à une congrégation de religieuses indigènes. À quelques milles dans la campagne, une maisonnette dans un vaste jardin reçoit 25 filles. Je les trouve en prières, mais leur temps est surtout occupé à apprendre les divers métiers réservés aux femmes. L'homme ne vit pas seulement de pain; mais il lui faut pourtant le pain, et les saints, toujours pratiques, se sont sans cesse préoccupés de fournir aux populations un gagne-pain nécessaire. Saint François Régis a introduit dans le Velay l'industrie des dentelles qui fait vivre tant de gens de la campagne, et dom Bosco fait de ses enfants des tailleurs, des menuisiers, des serruriers, etc.
La supérieure de la nouvelle Congrégation nous fait (p. 031) parcourir le jardin, où je vois le caféier, le cacaotier, le cocotier et tous les fruits tropicaux à côté des légumes européens. Puis le Père me conduit au tramway qui va hors la ville à plusieurs milles de distance. Là où il s'arrête, une voiture me prend et me conduit à 6 milles à Constant Spring, plantation de cannes que je désirais visiter. Sur la route les gens de la campagne forment une longue procession de va-et-vient. Les uns sont sur des chars, les autres sur des mules ou sur des ânes, le plus grand nombre à pied. Les femmes sont en majorité et portent sur la tête une corbeille ronde remplie de fruits qui leur rapportera environ un schelling, de quoi acheter sel, morue, et autres provisions qu'elles rapportent ensuite. Ces braves gens ont fait souvent 10, 15 et 20 milles, marchant parfois la nuit pour venir faire ces petits échanges. Ils sont de toutes les couleurs, du brun clair au noir obscur; les vêtements sont généralement blancs ou de couleurs voyantes, le tempérament est gai, on rit et on jase.
M. Georges, propriétaire de Constant Spring, a la bonté de me faire ouvrir l'usine qu'on répare en ce moment. Les cylindres, les chaudières, les clarificateurs sont semblables à ceux que j'ai décrit pour l'Infanta près de Lima[1], mais tout est ici sur une beaucoup plus petite échelle. En effet, M. Georges n'a que 220 acres plantées, lui produisant 220 tonnes de cannes, desquelles il tire (p. 032) 8% de sucre et 100 gallons de rhum (environ 400 litres) par tonne de canne. Il le vend en Angleterre au prix de 2 à 3 schellings le gallon; le droit et fret ne dépassent pas 7 à 8 pence par gallon.
Comme à l'Infanta, après la production du sucre, on lave l'usine et le résidu s'en va dans le distillateur qui reçoit 1,000 gallons à la fois, et donne 90 gallons de rhum, soit 9%.
M. Georges emploie de nombreux Hindous. Deux d'entre eux viennent de se quereller devant nous. Ils s'apaisent bientôt à la menace de se voir dénoncer à l'inspecteur. Le terrain étant pauvre, M. Georges est obligé d'engraisser ses cannes avec une préparation de guano qu'il importe d'Angleterre au prix de 55 l. stg. la tonne. La canne dure 3 ans et donne une récolte par an.
À mon retour, j'admire encore une fois la campagne verdoyante et par-ci par-là quelques magnifiques villas de riches marchands. Je salue M. Malabre, notre vice-consul, fais ma petite provision de rhum, et à 5 heures je suis à bord pour le dîner.
Le navire a chargé une collection de tortues qu'on porte en Angleterre pour la soupe des gourmets. Presque toutes ont plus d'un mètre de long: elles sont renversées sur le dos, et regardent avec des yeux languissants qui inspirent la compassion. Un grand nombre de négresses viennent nous offrir des paniers et des éventails en feuilles de palmiers. La couleur de leur peau est plus ou moins foncée: entre le blanc pur et le noir (p. 033) pur, on compte trois degrés désignés par des noms différents: le sambo, le mulâtre, le quarteron.
Le 9 septembre, à 9 heures du matin, le navire lève l'ancre. Nous parcourons en sens inverse la magnifique rade. Au loin sur la montagne, on aperçoit les blanches baraques du bataillon de soldats européens que l'Angleterre entretient dans l'île; le bataillon de soldats nègres commandé par des Européens est cantonné dans la ville. Les baraques du bataillon européen sont à 2,000 pieds sur le niveau de la mer et jouissent d'un climat plus sain et plus frais: c'est pratique.
L'île que j'ai vue si verte à cette saison des pluies est parfois bien aride à la saison sèche. Les pluies avaient lieu régulièrement en octobre, mais depuis le déboisement, elles sont moins abondantes; conserver les forêts sera toujours une sage précaution.
Toute la journée nous côtoyons l'île.[Table des matières]
Haïti et San-Domingo. — Port-au-Prince. — Les Nègres. — La révolution. — L'île Saint-Thomas et le groupe des Vierges. — Histoire. — L'esclavage. — La ville et le port. — La Royal-Mail. — Excursion dans l'île. — Une plantation de cannes. — Les ouragans. — San-Juan de Porto-Rico. — Navigation vers Cuba.
À la pointe du jour nous entrons dans l'immense golfe de Gonaïve au bout duquel est Port-au-Prince, capitale de la république d'Haïti. Cette île fut découverte le 6 décembre 1492, par Christophe Colomb, qui l'appela Hispaniola. En 1630, les Français y formèrent plusieurs établissements sur la côte nord, et en 1698, ils en formèrent d'autres à l'ouest et au sud. Les Espagnols en avaient occupé la plus grande partie à l'orient et l'appelaient San-Domingo. Au commencement de ce siècle les noirs, qui formaient la grande majorité de la population, se révoltèrent aussi bien contre les Français que contre les Espagnols et constituèrent les républiques d'Haïti et de San-Domingo. L'une et l'autre sont presque continuellement en révolution.
La république d'Haïti compte 24,000 kilomètres carrés et 550,000 habitants. La population a presque diminué de moitié depuis l'indépendance. La capitale, Port-au-Prince, (p. 036) a 25,000 habitants; ses maisons, étagées sur un coteau dont la mer baigne le pied, sont petites et couvertes en bois. On distingue le palais du gouvernement, qu'habite M. Salomon, président actuel. Il paraît que sa science gouvernementale n'est pas à la hauteur de celle de son grand homonyme, puisque, depuis 6 mois, il a révolution chez lui. Plusieurs villes, et entre autres Jacmel, sont aux mains des rebelles, qui vont en avant au cri de ôte-toi que je m'y mette. Ils ont acheté un navire pour transporter leurs adhérents, et, faute d'argent, le gouvernement ne peut en acheter un autre pour le leur opposer.
Vers 9 heures, le Para jette l'ancre devant Port-au-Prince. Trois navires de guerre stationnent devant cette capitale, probablement dans l'intention de porter les noirs à réflexion. Ils appartiennent à la France, à l'Angleterre, à l'Espagne. Il y a quelques commerçants étrangers à Port-au-Prince, mais il n'y a pas de propriétaires blancs. Les noirs, jaloux, et craignant de voir renaître leur influence, ont interdit à tous les étrangers le pouvoir d'acheter des immeubles dans l'île. Le docteur en chef vient à bord, coiffé d'un chapeau forme décalitre à demi écrasé: il met ses lunettes et lit les papiers avec un air d'importance. Plusieurs indigènes nous entretiennent longuement sur les tripots du gouvernement et sur les agissements des rebelles. Le nègre fuit le travail; quelques fruits dans la forêt lui suffisent; le gouvernement ne sait plus où lever des impôts.
(p. 037) La température est brûlante, la végétation magnifique. À 11 heures, le navire lève l'ancre et nous parcourons encore une fois le beau golfe de Gonaïve.
Le lendemain, le reste de la journée, nous avons toujours à tribord l'île d'Haïti, ancienne partie espagnole, aujourd'hui république de San-Domingo. Elle a une surface de 53,000 kilomètres carrés et une population à peine de 250,000 habitants. Le pays est en partie montagneux. Une chaîne de montagnes appelée Cibao la traverse; son pic le plus élevé atteint 2,274 mètres. L'exportation se réduit à un peu de café, de tabac et de bois de teinture; et pourtant cette île extrêmement fertile pourrait nourrir plusieurs millions d'habitants! Ceux qui prétendent que le nègre a assez d'aptitude pour bien gouverner ont ici un démenti. Pour peu qu'on les laisse à eux-mêmes encore un siècle, ils se réduiront à quelques milliers d'habitants vivant de fruits dans les bois.
La capitale, San-Domingo, compte 16,000 habitants; elle n'est pas en révolution aujourd'hui, elle le sera peut-être demain.
Les républiques de San-Domingo et d'Haïti professent la religion catholique.
Le 12 septembre nous côtoyons l'île de Porto-Rico, et vers le soir nous arrivons à Saint-Thomas.
Cette petite île, toute verdoyante en cette saison des pluies, est désolée par la sécheresse le reste de l'année. Avec Sainte-Croix et Saint-Jean, elle appartient au Danemark depuis environ deux siècles. Ces trois îles font partie (p. 038) du groupe des Vierges, découvert par Christophe Colomb dans son deuxième voyage en 1493. Il les appela ainsi en l'honneur des onze mille vierges martyrisées avec sainte Ursule. Colomb les trouva habitées par les Caraïbes, tribus sauvages qui faisaient des incursions dans les îles voisines pour saisir les paisibles Arrowauks et se nourrir de leur chair.
Les Espagnols, occupés à d'autres possessions importantes, négligèrent ces îles, et les Anglais et les Hollandais s'y établirent dès 1625. En 1650, Sainte-Croix passa aux mains des Français qui la vendirent aux chevaliers de Malte, puis elle repassa aux Français qui l'abandonnèrent en 1695, et quelques années plus tard la cédèrent au Danemark déjà établi à Saint-Thomas. Dans un édit signé par Iversen, gouverneur de Saint-Thomas, daté du 8 août 1672, je vois que tout travail du dimanche était puni d'une amende de 50 livres de tabac, et la non-assistance aux offices d'une amende de 25 livres. Il résulte de là que le tabac était le principal produit du pays. Pour se défendre contre les Espagnols, qui, de Porto-Rico, faisaient des incursions, le même décret oblige, sous peine d'une amende de 100 livres de tabac, chaque chef de famille à avoir une épée avec son fourreau, un fusil avec 2 livres de poudre et des balles. À l'approche de l'ennemi, le premier à l'apercevoir devra tirer trois coups de fusil si c'est de jour, un coup durant la nuit, et prévenir les voisins pour que tous se rendent au fort avec leurs armes.
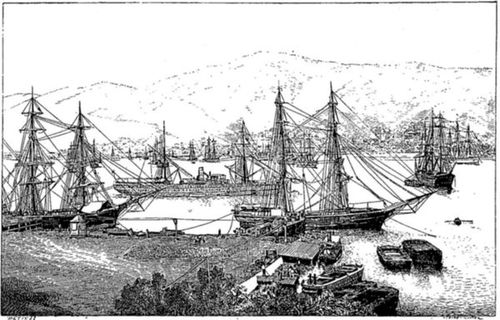
Antilles Danoises.—Île et ville de Saint-thomas.
(p. 039) Le dimanche après-midi, au son du tambour, chacun doit se rendre en armes à l'exercice militaire.
Des amendes on faisait trois portions: une pour le roi, l'autre pour l'Église, la troisième pour celui qui souffrait le dommage.
Au gouverneur Iversen succéda en 1679 Nicholas Esmit, élu par la Compagnie danoise des Indes occidentales. À cette époque le défaut de bras se faisant sentir, Christian V acheta en Afrique, du roi d'Aquambou, les deux forts de Frédéricksbourg et de Christianbourg sur la Côte-d'Or, et y envoya des navires acheter des esclaves pour Saint-Thomas. Dans le but d'aider la Compagnie, le roi ordonna à tous les propriétaires de voitures de Copenhague d'avoir pour 500 rix-dollars d'actions ou de payer un revenu de 60 rix-dollars. On importa beaucoup d'esclaves, et leur nombre s'éleva jusqu'à 30,000 pour les trois îles.
Les agents de la Compagnie se rendirent souvent coupables de bien des cruautés sur les côtes de Guinée, mais un de ces agents, nommé Schildérop, se fit si bien remarquer par sa bonté et sa justice qu'on venait de toute part à la côte pour le voir. Un vieux prince, demeurant à plus de 300 milles, lui envoya même sa fille avec beaucoup d'or et de diamants pour le prier de lui donner un petit-fils.
Dans leur nouvelle patrie, ces pauvres esclaves n'étaient pas toujours fort bien traités, et souvent ils se soulevèrent. Le décret publié par ordre du Conseil royal (p. 040) le 31 janvier 1733, dans les îles danoises, peut donner une idée de la situation. En voici la traduction:
1o L'esclave qui provoquera la fuite sera piqué trois fois avec un fer rouge, puis pendu.
2o Chaque esclave qui fuira perdra une jambe, et si le maître lui pardonne, il perdra une oreille et recevra 150 coups de lanière.
3o Chaque esclave qui, connaissant l'intention d'un autre esclave de prendre la fuite, aura négligé d'en donner avis, sera brûlé au front et recevra 100 coups de nerf.
4o Ceux qui donneront avis d'une fuite projetée recevront 10 dollars pour chaque esclave qui voulait fuir.
5o Un esclave qui fuit pour huit jours recevra 150 coups de nerf; s'il est absent douze semaines, il perdra une jambe; si l'absence est de six mois, il sera condamné à mort; à moins que le maître ne lui pardonne, auquel cas il perdra une jambe.
6o Un esclave qui vole pour la valeur de 4 dollars sera piqué avec un fer rouge, puis pendu. Si l'objet volé a une valeur moindre, il sera marqué au fer chaud et recevra 150 coups de nerf.
7o Les esclaves qui recevront des objets volés ou qui protègeront la fuite seront marqués au fer chaud et recevront 150 coups de nerf.
8o Un esclave qui lève la main pour frapper un blanc ou le menace sera piqué avec un fer chaud, puis pendu, si le blanc le demande. En cas contraire, il perdra la main droite.
(p. 041) 9o Un seul blanc est suffisant pour témoigner contre un esclave, et si un esclave est soupçonné d'un crime, il peut être mis à la torture.
10o Un esclave qui rencontre un blanc doit se tirer de côté jusqu'à ce qu'il soit passé; en cas contraire, il peut être fouetté.
11o Les esclaves ne pourront entrer en ville avec des couteaux ou des bâtons, ni se battre entre eux sous peine de 50 coups de nerf.
12o La sorcellerie sera punie du fouet.
13o Un esclave qui aura essayé d'empoisonner son maître sera piqué 3 fois avec un fer rouge et brisé sur une roue.
14o Un nègre libre qui recevra un esclave ou un voleur perdra sa liberté ou sera banni.
15o Toute danse, fêtes ou jeu sont défendus à moins de permission du maître ou de son agent.
16o Les esclaves ne pourront vendre aucune sorte de provisions sans la permission de leurs surveillants.
17o Aucun esclave des campagnes ne pourra se trouver en ville le soir après le son du tambour sous peine d'être conduit au fort et fouetté.
18o L'avocat du Roi reçoit l'ordre de faire strictement observer ces prescriptions.
Tant de cruautés soulevèrent les récriminations des missionnaires de toutes les religions et des personnes de cœur en général. Vers 1792, on avait déjà défendu l'importation officielle des esclaves. Elle continuait néanmoins; (p. 042) mais en 1848, à la suite d'une insurrection, le gouvernement donna la liberté à tous les esclaves dans les îles danoises. Les libérés, se refusèrent au travail, mais petit à petit ils l'ont repris et ils sont encore aujourd'hui la grande majorité des habitants de l'île.

Antilles Danoises.—Saint-Thomas.
Grand Cimetière.
Vue du port, la ville de Saint-Thomas présente l'aspect le plus pittoresque; elle semble escalader trois mamelons contigus l'un à l'autre. Le port, formé par la nature, est un des meilleurs et des plus sûrs. Sa qualité de neutre et de port franc, sa situation à l'entrée de la mer des Antilles, en font le point d'arrêt des steamers de toutes les grandes compagnies qui viennent ici faire du charbon. Les compagnies anglaises, françaises, espagnoles, allemandes y ont leur entrepôt. Les îles voisines avaient aussi l'habitude de venir s'approvisionner à Saint-Thomas des marchandises européennes, ce qui donnait une grande importance à son commerce, mais depuis que les grands steamers desservent directement (p. 043) toutes ces îles, ce commerce a baissé. La ville compte 17,000 habitants. La population française est représentée par cinq ou six Français d'Europe et quelques centaines de noirs des Antilles françaises. Les Pères Rédemptoristes belges desservent l'église catholique et plusieurs écoles; les catholiques sont au nombre de 11,000.
Le Para est parti hier pour l'Europe. J'ai transbordé sur l'Éden, de la même Compagnie, qui va à Vera-Cruz en faisant escale à Porto-Rico et à la Havane. La Royal-Mail dans ces parages, pour faire concurrence à la Transatlantique, Compagnie française, qui satisfait les passagers par la table et le vin, annonce qu'elle possède des cuisiniers français et qu'elle fournit le vin sur le prix du passage.
En effet, sur le Para, la cuisine et le vin étaient passables, mais sur l'Éden je trouve dans mon verre des résidus indiquant toute sorte d'ingrédients. Le Purser ou économe m'explique que c'est du bois de Campèche pour colorer les divers esprits et drogues qui forment le vin. La Compagnie serait donc plus dans la vérité en mettant dans ses prospectus qu'elle donne aux voyageurs non du vin, mais une drogue qui l'imite. Elle ferait même bien d'ajouter qu'après examen d'un chimiste, les matières qui la composent ne nuisent que modérément à la santé. Il est bon de savoir que si un passager voulait apporter son vin, les règlements de la Compagnie le lui défendent, sous prétexte qu'elle fournit elle-même les vins; mais ils sont fort chers et on en ignore la composition. Quant à la cuisine, sur le Para elle était demi-française, ici elle redevient anglaise; (p. 044) le cuisinier est un nègre. Le Don, navire de la même Compagnie, arrive d'Europe, et avant de continuer sa route sur Colon, il transborde sur trois autres navires les marchandises destinées aux diverses îles des Antilles, à la Guyane et aux côtes de l'Amérique centrale et du Sud. Ce n'est qu'après-demain que nous reprendrons, notre route. Mon temps se passe en études et en promenades.
Hier j'ai voulu gravir à cheval les collines de l'île. Après une heure de route j'étais au sommet, dominant un superbe panorama. Sur l'autre versant, l'île offre aussi tout autour de magnifiques baies, en sorte qu'on pourrait croire qu'elle a été disposée pour former un ensemble de ports.
La végétation est belle en ce moment. Je vois quelques fermes cultivant la canne à sucre, l'igname, la patate, la banane, plusieurs sortes de fruits tropicaux, et diverses qualités d'herbes fourragères. Enfin j'arrive au point d'où la mission brésilienne, dirigée par le baron de Teffé, a observé l'an dernier le passage de Vénus sur le soleil.
Là une terrible averse arrive, et comme je les sais fréquentes et courtes, je pousse mon cheval sous un fourré d'arbres; un Suisse qui est avec moi fait de même. Ce ne fut pas une averse, mais une succession d'averses, et nous fûmes bientôt trempés jusqu'aux os. Toutefois cette eau de pluie était tiède. Rentrés en ville nous tournons à gauche, et galopons vers une usine à sucre encore en construction. Elle est au centre d'une petite plaine d'alluvion plantée de cannes. Le mécanisme pour extraire le (p. 045) sucre et le rhum est le même que celui que j'ai décrit pour la Constant Spring près Kingstown, mais comme la plantation est ici plus petite, l'ensemble de l'usine est aussi sur une moindre échelle.
16 septembre.—À bord le capitaine passe en revue son personnel: 12 officiers, 16 matelots, 14 chauffeurs, 18 domestiques, en tout 60 personnes bien endimanchées. Il les envoie par groupes à l'office. À l'exception des officiers, tous sont noirs, sans excepter la femme de chambre.
Le lendemain le vent souffle et la pluie devient diluvienne; serait-ce un présage d'ouragan? C'est ordinairement vers l'équinoxe qu'ils se déchaînent sur ces îles, arrachant les arbres et démolissant les villes. La première île atteinte avertit les autres par télégraphe, et elles se préparent à recevoir la tempête en fermant hermétiquement portes et fenêtres. Si elles résistent au vent, la maison est sauve, si l'une d'elles est enfoncée, le vent s'engouffre et enlève la maison. Malgré mon esprit curieux, je n'ai pas grande envie d'être témoin de pareil spectacle; je me rappelle avec frayeur les deux typhons qu'il y a deux ans, dans ce même mois de septembre, j'ai vus au Japon, où ils firent périr une centaine de navires. J'espère aussi que je ne serai pas témoin d'un de ces tremblements de terre qui ont l'habitude de secouer ces îles.
Dans une visite aux Pères Rédemptoristes, le frère me donne de belles grappes de raisin qu'il détache de la treille du petit jardin. Il m'assure que ses vignes lui donnent (p. 046) une récolte tous les quatre mois, trois par an, mais les grappes sont en petite quantité. Je salue aussi le vice-consul, et le soir à 8 heures le navire lève l'ancre.
18 septembre.—À 7 heures du matin nous sommes à San-Juan de Porto-Rico. Cette capitale, vue de la mer, présente l'aspect le plus pittoresque: des forts et des canons de tous côtés; un pilote nous conduit devant la magnifique baie remplie de vase; les Espagnols n'ont jamais fait de curage. En face de la ville, de l'autre côté de la baie, on voit des faubourgs, des maisons de campagne, le tout dans des forêts de cocotiers. Dans le port je remarque un vieux vapeur à roue, navire de guerre espagnol.
L'île de Porto-Rico, une des grandes Antilles, a environ 12 lieues de large, 30 de long, une surface de 9,500 kilomètres carrés et plus de 700,000 habitants. C'est la plus florissante des îles espagnoles parce qu'elle n'est pas dévastée par la guerre civile. Le commerce est florissant; on exporte beaucoup de sucre, de café, de bois de teinture et des animaux.
San-Juan, la capitale, compte 35,000 habitants. Dans l'intérieur les routes font défaut. L'esclavage est aboli depuis 1873.
La pluie tombe serrée; aucun passager ne se décide à venir à terre et j'y vais tout seul. Je parcours la ville en tous sens; elle a l'aspect d'une ville espagnole et pas trop sale; les rues, assez étroites, sont en pente, et les grandes pluies les lavent; les maisons sont basses et couvertes en (p. 047) terrasses sur lesquelles on prend le frais durant la nuit. Elles servent aussi à ramasser l'eau de pluie emmagasinée dans les citernes. Il est curieux d'entendre ici les nègres et les mulâtres parler l'espagnol avec le même accent que ceux de Saint-Thomas et de la Jamaïque en parlant l'anglais et ceux de la Guadeloupe et de la Martinique en parlant le français. Si on marchait les yeux fermés, on pourrait, au simple accent dans ces trois langues, savoir si c'est un nègre ou un mulâtre qui parle.
Les officiers chargés de donner et de prendre la correspondance sont bientôt prêts, et nous revenons au navire, qui reprend aussitôt sa course. Nous côtoyons l'île, marchant à l'ouest. Vers le soir une pluie diluvienne nous inonde.
19 septembre.—Nous côtoyons l'île d'Haïti; la chaleur vers le milieu du jour est suffocante.
20 septembre.—Dès le matin nous apercevons l'île de Cuba.
21.—Nous côtoyons toujours Cuba, la mer est d'un calme parfait, les orages qui se déversent sur l'île ont un peu rafraîchi la température. À bord une famille qui retourne à Mexico, son pays natal, ne fait pas grand bruit; les quelques Anglais ne trouvent rien de mieux, pour occuper le temps, que de nous proposer des paris sur la vitesse du navire. Elle n'est pas grande, il est peu chargé; une partie de l'hélice est hors de l'eau, et nous filons moins de 10 nœuds.
(p. 048) Un jeune Espagnol, un Parisien, un Suisse et moi faisons, après chaque repas, plusieurs parties de bull: il faut bien ce mouvement pour digérer, sous ces latitudes, les viandes coriaces de la cuisine anglaise. Le Parisien, qui gagnait 12,000 fr. à Bruxelles comme ingénieur dans une fonderie de fer, va diriger des fonderies au Mexique, où on le paye 30,000 par an, avec l'espoir de future association.
Encore une nuit brûlante dans la cabine sans air, puis demain matin nous comptons arriver à la Havane.[Table des matières]
L'île de Cuba. — Situation. — Configuration. — Surface. — Histoire. — Population. — Produits. — Climat. — Importation. — Exportation. — La Havane. — La ville. — Les environs. — La Corrida de Toros. — La cathédrale. — La fièvre jaune. — Les œuvres charitables.
L'île de Cuba, appelée la Reine des Antilles, est située entre le 19° 49´ et le 23° 13´ latitude nord, et 67° 52´ et 87° 40´ longitude ouest du méridien de Cadix. Sa longueur du cap San-Antonio à celui de Maïsi est de 1,592 kilomètres, et sa plus grande largeur de 45 lieues, depuis le cap de Lucrecia jusqu'au cap de Crux. Sa surface est de 119,000 kilomètres carrés, et sa population de 1,500,000 âmes. Sur ce chiffre, 917,000 sont blancs, 9,500 étrangers, 22,300 Chinois, 25,300 colons, 275,000 de couleur et libres, et 202,000 de couleur et esclaves.
Christophe Colomb arriva dans l'île en octobre 1492, et la prit pour un continent. En 1511 son fils, Diego Colomb, gouverneur de San-Domingo, envoya Diego Velasquez à sa conquête; celui-ci y trouva le cacique Hatuey, réfugié de San-Domingo, qui fit brave résistance; mais à la fin il fut vaincu et condamné à mort.
Les 200,000 indigènes, Indiens de mœurs douces, (p. 050) furent bientôt exterminés, et les Espagnols se partagèrent les terres; Velasquez fonda les villes de Asuncion, Bayamo, Trinidad, Santo Espiritu, Santa Maria, Santiago de Cuba, et la Habana.
En 1589, l'île fut érigée en Capitania jeneral. Durant le XVe siècle, elle eut beaucoup à souffrir des flibustiers ou boucaniers, pirates anglais, français, hollandais, qui dévastaient les diverses îles des Antilles. En 1762, elle fut prise par les Anglais qui la retinrent neuf mois et la rétrocédèrent contre la Floride.
Cuba, à l'entrée du golfe du Mexique, entre l'Atlantique et la mer de Caribe ou des Antilles, longue et étroite, a la forme d'un arc. Elle est traversée par une chaîne de montagnes appelée Sierra del Cobre, dont quelques pics atteignent jusqu'à 8,000 pieds. De ces montagnes descendent de nombreuses petites rivières dont la plus grande, le Canto, est navigable jusqu'à Bayamo.
Le climat est chaud et humide. Durant la saison des pluies, qui dure de fin mai à fin octobre, le thermomètre varie de 24° à 28° Réaumur. Durant la saison sèche, il varie entre 17° et 21° Réaumur, soit 70° et 79° Farenheit. En 1867, le maximum a été de 35° Réaumur.
Les nuits sont un peu plus fraîches que le jour.
L'île de Cuba est l'endroit du monde où il tombe le plus d'eau. L'année maxima a eu 50 pouces 6 lignes castillanes; l'année minima 32 pouces 7 lignes. La moyenne annuelle pour la Havane est de 1m020. Le 18 juillet 1854, il en tomba en deux heures 71 millimètres; et dans la journée (p. 051) de l'ouragan du 22 octobre 1867, il en tomba 103 millimètres.
La moyenne annuelle des personnes tuées par la foudre est de neuf. Les ouragans sont souvent terribles. Ils ont lieu entre la moitié d'août et fin novembre. Les tremblements de terre ne se font sentir d'ordinaire que dans la partie méridionale.
Les maladies régnantes sont celles du tube digestif, le tétanos, la fièvre jaune ou vomito negro qui attaque surtout les étrangers et les habitants qui viennent de l'intérieur aux côtes. Il y a aussi de nombreux cas de fièvres intermittentes et de phtysie. On voit pourtant, surtout parmi les gens de couleur, bien des cas de longévité, ayant atteint 130, 140 et 150 ans.
Dans les rivières, on trouve des crocodiles qui ont jusqu'à huit mètres de long; la mer fournit d'énormes tortues.
Les principales productions sont la canne à sucre et le tabac; on récolte aussi un peu de café et de cacao, du maïs, du riz, de l'indigo, de l'igname, du caoutchouc, du coco, des bananes, du miel de la cire, et les divers fruits des tropiques. On coupe plusieurs qualités de bois de teinture et d'ébénisterie.
En fait de minéraux, l'île renferme du charbon, de l'aimant, de l'argent, du kaolin, et des minerais divers; mais on n'exploite que le cuivre et le fer. L'industrie est limitée au sucre et aux cigares. L'île est divisée en six provinces, mais les habitants ont l'habitude de la diviser en (p. 052) deux seules portions: la vuelta abajo au sud de la Havane, et la vuelta arriba, au nord.
Sous le rapport religieux, elle est divisée en deux diocèses: l'évêché de la Havane et l'archevêché de Santiago de Cuba.
Militairement, l'île est toute sous le commandement du capitaine général, et comprend sept districts ou sous-commandements.
Judiciairement, elle se divise en deux audiencias: celle de la Havane et celle de Puerto-Principe. Elles ont chacune plusieurs districts judiciaires confiés à des alcades majores ou juges de première instance qui ont pour délégués les juges municipaux ou juges de paix. Pour la marine, il y a un commandant général et cinq districts.
L'instruction publique compte à la Havane une université, et dans toute l'île un millier d'établissements scolaires.
Les chemins de fer en activité atteignent 1,660 kilomètres; les télégraphes 2,567 kilomètres. La Havane est bien desservie par le téléphone.
Plusieurs lignes de bateaux à vapeur mettent l'île en communication avec l'Europe et les États-Unis. En 1877, le nombre des navires entrés dans les divers ports de l'île a été de 1,669, comprenant 835,000 tonnes.
L'exportation en 1878 a atteint presque 71,000,000 de piastres (la piastre espagnole est de 5 fr.). Les principaux articles d'exportation sont le sucre, le tabac, le café, le rhum, le cuivre, la cire, le miel, le coton, les cuirs, l'huile (p. 053) de coco, les bois et les fruits. L'importation comprend la farine, les vins, l'huile, les liqueurs, le riz, le poisson salé, la viande salée, la quincaillerie, les machines, les papiers, les peaux et les objets de luxe. Les pays qui commercent le plus avec l'île sont dans l'ordre suivant: les États-Unis, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, les États hispano-américains, la France, la Russie, la Belgique, le Danemark et la Hollande.

Grandes Antilles.—Île de Cuba.—Entrée du port de la Havane.
C'est le 22 septembre, vers 3 heures du soir, que nous commençons à apercevoir le phare de la Havane, capitale de Cuba. Bientôt nous voyons les forts du sud, et le navire s'arrête pour prendre le pilote. L'entrée du port est étroite et boueuse; l'Espagnol ne sait pas plus nettoyer les ports que les rues et les maisons. Le port est superbe, vaste et parfaitement abrité: nous passons à côté d'un bassin flottant contenant un grand steamer en (p. 054) réparation; nous devançons un aviso de guerre, et allons mouiller non loin de cinq à six steamers des compagnies américaines et espagnoles. Le navire doit prendre du charbon et s'embosse au môle; trois douaniers montent à bord pour garder le navire, mais de nombreuses libations de Champagne les mettent bientôt en état de repos pendant qu'ailleurs on travaille....
Je descends à terre et rends visite au gouverneur civil pour lequel j'avais une lettre. Le concierge me dit: montez arriba; je monte et m'adresse au Chinois qui me renvoie au portier. Mais le gouverneur m'a vu et m'appelle. Il me fait bon accueil, m'offre un Alphonse XII, cigare exquis enveloppé dans du papier d'argent, et me dit: à la disposicion de Vousted.—J'aimerais voir, lui dis-je, les curiosités du pays, les monuments, les établissements d'instruction et de bienfaisance, une fabrique de cigares et une plantation de cannes à sucre.
—Nous n'avons pas de monuments; notre université est peu de chose, les hôpitaux sont loin; je vous procurerai une lettre pour visiter la plantation de cannes la moins éloignée, et vous l'enverrai à l'hôtel.
J'exprime ma reconnaissance à M. le Gouverneur; mais je n'ai pu le remercier pour la lettre promise, car je l'attends encore.
Je fais quelques emplettes et parcours la ville. Elle comprend 300 habitants, et dans la partie vieille, ressemble aux villes espagnoles. Les rues sont étroites, à peine six à sept mètres; mais au delà du parc central, (p. 055) dans la ville neuve, elles sont plus larges. Le Prado atteint même une quarantaine de mètres et est planté d'arbres. Les maisons sont généralement basses: un rez-de-chaussée et un étage; quelques-unes atteignent trois et quatre étages. Elles sont toutes couvertes en terrasses, sur la plupart desquelles on voit une roue à vent qui sert à tirer l'eau de la citerne. Quelques-unes ont le patio traditionnel. La ville nouvelle s'étend assez loin dans la campagne, par de beaux boulevards que parcourent les tramways. Des portiques abritent les magasins contre les rayons brûlants du soleil. Par-ci par-là de jolis squares, des statues de marbre et quelques fontaines; mais trop souvent aussi les urines et les ordures de toute sorte qui embaument par trop l'atmosphère.
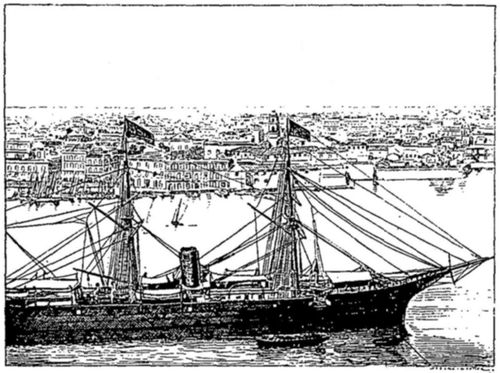
Grandes Antilles.—Vue générale de la Havane.
(p. 056) La race espagnole semble encore ignorer la propreté. Je descends à l'Hôtel central. Cet établissement nouveau a pour escalier un casse-cou, mais il aura bientôt un correctif: l'ascenseur. Les chambrettes sont propres, la nourriture saine, les prix modérés, les gérants aimables. Pour respirer, je monte sur la terrasse, d'où je domine la ville, et assez tard dans la nuit je vais chercher mon lit. Il est perfectionné. Dans le but de laisser tout le corps bénéficier de l'air, on couche sur une toile métallique élastique qui laboure les chairs. Le salon réunit quelques-uns des hôtes. Ils se dandinent sur les fauteuils-balançoires, pendant qu'en suivant le couloir, on peut, par les portes ouvertes, voir les autres étendus sur leurs lits.
Le lendemain je fus matinal. C'était dimanche et je me rends à la cathédrale; on peut compter les rares fidèles; L'édifice est à trois voûtes, soutenues par des piliers massifs en tuf. On y voit quelques jolis tableaux. Au maître-autel, du côté de l'Évangile, au-dessous d'un médaillon en marbre représentant Christophe Colomb, on lit cette inscription:
O RESTOS E IMAGEN DEL GRAN COLON!
MIL SIGLOS DURAD GUARDADOS EN LA URNA
Y EN LA REMEMBRANZA DE NUESTRA NACION!
O restes et portrait du grand Colomb!
Tu resteras mille siècles gardé dans l'urne
Et dans la mémoire de notre nation!
Christophe Colomb, après avoir été mis dans les fers, en récompense du nouveau monde qu'il venait de donner au roi d'Espagne, mourut à Valladolid, le 20 mai 1506. (p. 057) Ses restes mortels furent déposés dans le monastère des Chartreux (Cartujos), à Séville, d'où on les transporta à l'île de San-Domingo. En 1796, à cause des troubles qui ensanglantaient cette île, on les transféra à la Havane, dans la cathédrale.
Christophe Colomb crut avoir abordé aux Indes, et mourut dans la croyance que Cuba était l'extrémité orientale de l'Asie. Ce ne fut qu'en 1508 que Sébastien de Ocampo, après avoir fait le tour de Cuba, constata qu'elle n'était qu'une île.
Derrière la nef de gauche, on voit aussi dans la cathédrale une belle statue de marbre d'un jeune évêque mort à 42 ans, après cinq mois d'épiscopat. Il arrivait d'Espagne et paya bientôt son tribut à la fièvre jaune. À la sacristie un employé me montre les brillants ornements qui forment le trésor de l'église: ce sont des broderies en or sur drap d'or, d'argent, de satin et de velours.
Il paraît que les Havanais prennent fréquemment des bains, s'il faut en juger par les nombreuses affiches sur lesquelles on lit: Baños. En tous cas, dans les heures chaudes, on voit par les portes et les fenêtres ouvertes, les Havanaises se balancer dans leurs fauteuils, appelant à tout instant la négrita (petite esclave) pour leur donner ou leur prendre l'éventail. On m'avait remis une lettre pour les Sœurs du Sacré-Cœur. Elles demeurent au Cerro, dans le quartier de Buenos aires (bon air). En me rendant chez elles j'ai l'occasion de voir les environs de la ville. Ils sont parsemés de petites villas et on (p. 058) y rencontre parfois sous les grands arbres, les hommes de police ou gendarmes à cheval, se reposant à l'ombre. Dans la ville, on voit aussi aux coins des rues, des policemen en uniforme coutil bleu et chapeau panama: ils sont armés du sabre et portent le revolver; je leur préfère le petit bâton des policemen anglais et américains, car il représente la force morale. En tout cas, tant à la ville qu'à la campagne, tout le monde travaille comme si ce n'était pas dimanche; les mules et les bœufs tirent les chars et tous les magasins sont ouverts. Quand donc verrons-nous observer le Décalogue dans les pays catholiques?
Les Sœurs du Sacré-Cœur occupent un vaste bâtiment bien exposé et entouré d'un parc. Elles sont au nombre de 42 et instruisent 125 pensionnaires et un grand nombre d'externes gratuites. La supérieure est cubaine: elles viennent d'envoyer quelques Sœurs à Mexico pour une fondation.
Au retour, j'entre dans l'église de Monserrate et dans celle de la Merced. Les fidèles y sont un peu plus nombreux; les dames, la tête garnie d'un léger voile, se tiennent sur des pliants que leur apporte l'esclave. L'église de la Merced, desservie par les Pères Lazaristes espagnols, possède de belles fresques.
Des affiches annonçaient une grande Corrida de toros au cirque de Régla de l'autre côté de la baie. Je déplore devant le Père supérieur qu'on ne respecte pas plus les animaux qu'on ne respecte le dimanche. Le Père trouve (p. 059) que cela n'est que peccadille à côté des bals qui corrompent la jeunesse. Le soir, deux Suisses qui voyagent comme moi sur l'Éden, me racontent qu'ils sont allés voir la Corrida; que 3,000 personnes s'étaient entassées dans le cirque, après avoir payé 3 piastres par personne du côté de l'ombre et 1 piastre 1/2 du côté du soleil; qu'à chaque cheval éventré ce gracieux public applaudissait et menaçait un des toréadors qui était descendu de cheval parce que celui-ci refusait de marcher; qu'un jeune homme ayant voulu ramasser une banderole a reçu un coup de corne du taureau et a été tué net, etc., etc.
Les catholiques havanais, comme leurs parents, espagnols, trouvent tout cela bagatelle, et ajoutent pieusement que les chairs des taureaux ainsi tourmentés s'en vont aux hospices. À la Havane, on avait même démoli le vieux cirque et on se promettait de ne plus le reconstruire; mais d'honnêtes gens, qui souffrent de ne plus voir couler le sang, se proposent d'en refaire un nouveau et tout le monde ne trouve rien à redire du moment que les bénéfices seront pour les œuvres pies! Quand comprendra-t-on qu'avec l'argent qui est le produit du crime, on ne saurait faire des œuvres agréables à Dieu! il n'est bon tout au plus qu'à acheter le champ du sang: Hacel-dama! Dans les pays de race espagnole, on en est encore à ignorer que, exposer sciemment la vie pour amuser les gens est un crime, et que tourmenter les bêtes pour plaire aux badauds est contraire aux lois de la nature. Si j'étais gouverneur en pays espagnol, je considérerais comme mon (p. 060) premier devoir de convertir les cirques en écoles élémentaires, et si j'étais évêque, j'ordonnerais à chaque curé de lire en chaire, tous les jours, les versets de l'Ecclésiastique et des Proverbes, qui stigmatisent ceux qui se plaisent à tourmenter les animaux. Au reste, personne n'ignore qu'une bulle de Sixte V frappe d'excommunication les fauteurs de ces jeux sanglants.
Chemin faisant, j'entre dans une pharmacie dans le but de contrôler les renseignements divers que j'ai reçus sur la fièvre jaune. Elle a été très forte en août et dans les deux premières semaines de septembre. En ce moment elle est tombée à une moyenne de 12 cas par jour, et les médecins en guérissent un grand nombre.
Les Européens y sont plus sujets que les indigènes.
En effet, dans les zones tempérées, les poumons travaillent beaucoup plus que le foie; et celui-ci agit davantage dans la zone torride. Le nouveau débarqué, par le défaut d'équilibre dans ces deux fonctions, a bientôt la masse du sang corrompue. Les soldats espagnols ont aussi l'habitude de manger du fruit, et la digestion étant ici moins active, le corps se trouve engorgé et le sang se corrompt; Ajoutez à cela mille foyers d'infection, faute de propreté. Les médecins combattent la fièvre jaune par les diurétiques et les sudorifiques.
Après le déjeuner je vais au collège de Belem, dirigé par les Pères Jésuites. Ils ont 200 internes et autant d'externes. Dans les dortoirs, je vois les petites cellules habituelles avec plafond en toile métallique.
(p. 061) Je rends visite à M. José Solano y Granados, avocat, président du Conseil des Conférences de Saint-Vincent de Paul.
Il y a à la Havane 7 Conférences comptant ensemble 120 membres et visitant 160 familles pauvres. Les Conférences répandent aussi un almanach, dirigent une bibliothèque et ont fondé un orphelinat. M. Solano m'y conduit, et j'y trouve 35 petits bons hommes de 10 à 12 ans, bien éveillés et bien proprets, occupés aux études. Le défaut de bons chefs d'atelier fait qu'on n'a encore pu organiser les métiers, mais on espère y arriver. L'établissement est proprement tenu. Une inscription indique que la maison a été donnée par un curé; le directeur est un ingénieur distingué qui se dévoue à l'œuvre sans rémunération. Malgré cela l'œuvre coûte encore par an 5 à 6,000 piastres, qu'on obtient par souscriptions.
Je prie M. Solano de m'obtenir une carte d'entrée à la plantation de Toledo, située à 10 kilomètres, près de Marianao, et qui appartient à M. Duragnone.
Nous passons plusieurs heures à causer sur les choses du pays, et à 11 heures je m'endors sur ma toile métallique. Il avait été convenu avec trois autres passagers de l'Éden: un ingénieur français et deux Suisses, que celui qui s'éveillerait le premier vers 5 heures, éveillerait les autres, car il faut arriver à la gare pour le train de 6 heures.
Un des Suisses prend la lune pour le soleil et nous éveille à 4 heures. La lune en effet est ici extrêmement (p. 062) brillante, et il faut s'en garer, car elle engendre des ophtalmies. Nous passons notre heure à nous préparer tout en riant, et jasant sans pitié pour les passagers qui dorment. Nous leur rendons ainsi la pareille, car ils en avaient fait autant jusqu'à 2 heures du matin.[Table des matières]
Excursion à Marianao. — La plantation de cannes de Toledo. — Un orage. — 400 esclaves. — Culture de la canne. — Fonctionnement de l'usine. — Détails et prix. — L'administration espagnole dans la colonie. — Le papier-monnaie et la Banque espagnole. — Les autonomistes et les conservateurs. — Avenir probable. — Production du sucre et du café dans le monde entier. — Le tabac à la Havane. — La fabrique de cigares de Villar-Villar. — La fabrique de cigarettes de Diego Gonzales. — Le marché. — La presse. — Le départ. — Navigation dans le golfe du Mexique.
Les tramways marchent dès 5 heures. Nous prenons place dans une voiture des blancs. Il y en a à meilleur marché dans lesquelles peuvent monter aussi les nègres. À 6 heures nous étions dans le train, en route pour Marianao. Dans notre vaste wagon à l'américaine, à chaque station un cylindre tourne et marque le nom de la station prochaine. Nous parcourons la campagne semée de patates, d'igname et de maïs. On coupe ici le maïs trois fois l'année et la même racine repousse trois fois, donnant chaque fois un épi. Nous voyons aussi de nombreux palmiers géants dont quelques-uns ont leur grand plumet et d'autres l'ont perdu; on nous dit que c'est un ver rongeur qui les décapite ainsi. Par-ci par-là des Chinois labourent ou coupent les cannes. À 8 heures 1/2 nous arrivons à Marianao, mais le billet porte d'autres (p. 064) noms: Concha au départ et Sama à l'arrivée. Ces changements de nom déroutent parfois le voyageur. M. Marchand, l'ingénieur français qui m'accompagne, me raconte qu'à une gare d'Allemagne, ayant demandé un billet pour Aix-la-Chapelle, on lui donna un billet sur lequel était écrit Aaken. Il le refusait en déclarant qu'il ne voulait pas aller à Aaken, mais à Aix-la-Chapelle, et on eut de la peine à lui faire comprendre que Aaken n'était que la traduction allemande d'Aix-la-Chapelle.
À Marianao une voiture nous conduit d'abord chez M. Duragnone. Il occupe un fort beau château près du village. L'heure matinale ne lui permet pas de nous recevoir, mais il envoie un de ses domestiques à cheval pour donner ordre au concierge de nous laisser passer. On nous avait en effet parlé d'un nègre portier qui, fidèle à sa consigne, était aussi impitoyable que Cerbère.
Après une demi-heure de trot à travers une campagne verdoyante et par un chemin mal entretenu, nous arrivons à la plantation. Le nègre ouvre à deux battants et nous traversons les champs de cannes pour arriver à la ferme. Nous entrons d'abord dans un vaste bâtiment enfermant une cour de 60 mètres de côté. Il a un étage sur rez-de-chaussée et portiques tout autour.
La seule porte d'entrée est surmontée d'une tourelle portant une grosse cloche. C'est l'habitation des 400 esclaves qui travaillent à la ferme. Au centre un hangar couvre les lavoirs et la cuisine. Près de là, un immense tas de fumier répand une odeur infecte. J'interpelle (p. 065) l'assistant; il me dit que ce sont les balayures des bâtiments et que chaque deux dimanches les chars viennent les prendre.
Les esclaves sont aux champs; mais au premier étage 70 enfants de tout âge grouillent au soleil. Les uns sont nus, les autres plus ou moins vêtus. Je remarque une petite fille attachée par un pied à la balustrade, exactement comme nos paysans attachent les poulets avec une ficelle. Les plus petits sont dans des paniers ou sur des lits. Une vieille négresse soigne tout ce petit monde. On nous montre une salle, future école mixte de tous ces négrillons et négrillonnes.
Le rez-de-chaussée est divisé en plusieurs salles, ayant chacune à droite et à gauche un plancher surélevé qui sert de couche aux esclaves; ils s'y casent et forment leurs unions selon leurs sympathies. Ceux qui préconisent l'union libre n'ont qu'à venir voir ici à quoi elle réduit la famille, et à moins qu'ils n'aient perdu la raison, ils reculeraient d'horreur. Sur les toits et dans la cour je vois de nombreux gallinasos; c'est un vautour noir qui rend ici d'immenses services en avalant les ordures.
L'esclavage a été réglementé en 1868. À partir de cette époque, le ventre a été déclaré libre. Cette expression signifie que tout enfant né d'une esclave est libre. Tout esclave arrivé à l'âge de 60 ans devient libre. En 1888, tous les esclaves seront libérés. Dans l'intervalle, si le maître ne paie pas à l'esclave le salaire convenu, celui-ci peut s'adresser à l'autorité, qui lui donne la liberté.
(p. 066) Un peu au-delà de l'habitation, il y a l'infirmerie, occupée par 25 esclaves. Un infirmier et un partorero (accoucheur) y sont en permanence. Le docteur de Marianao y vient tous les jours.
Nous passons au compartiment des machines. Elles sortent en grande partie de l'usine Cail de Paris, et sont de fortes dimensions. Comme à l'Infanta près Lima, le tablier sans fin amène les cannes sous les cylindres; le jus, par la pression à vapeur, s'en va dans des réservoirs au haut de l'usine. De là, il descend dans des cuves diverses pour se purifier et se délivrer de l'eau et autres éléments étrangers; puis il passe dans 8 turbines qui font 800 tours à la minute et séparent le sucre de la mélasse. Celle-ci s'en va dans un immense réservoir au-dessous de l'usine et est vendue aux distillateurs qui en extraient le rhum.
Le mécanicien est un Catalan fort aimable. Il nous fait remarquer une nouvelle turbine que vient d'inventer un représentant des usines de Fives-Lille, résidant à Cuba. Elle consiste en une spirale se développant sur un cône de cuivre qui fait 1,500 tours à la minute: un couvercle qui l'emboîte est percé de trous et fait 500 tours à la minute; la pâte sucrée passe par le haut, parcourt la spirale, rejetant la mêlasse par les trous du couvercle, et le sucre purifié sort par le bas. Le premier essai a donné de bons résultats. Ce système épargne la nécessité de l'arrêt des turbines pour les dégarnir et les regarnir. L'usine n'emploie pas le noir animal; elle ne produit (p. 067) que le sucre jaune expédié aux raffineries d'Europe ou d'Amérique.
La vapeur est produite par onze générateurs ou chaudières de 40 pieds de long sur 5-1/2 de diamètre. L'usine travaille cinq mois de l'année et produit environ 30 tonnes de sucre par jour. On le met en pipes de 70 arobas chaque (l'aroba équivaut à 25 livres, environ 12 kilog.).
On en remplit environ 4,000 par an.
L'usine produit une moyenne annuelle de 66,000 quintaux de sucre. Il est vendu environ 5 fr. l'aroba sur les marchés de New-York.
En ce moment l'usine ne brille pas par l'ordre et la propreté, mais c'est l'époque où elle ne travaille pas.
Pour économiser l'eau, la vapeur est condensée et ramenée de nouveau à l'état liquide.
Le contre-maître ou directeur, grand gaillard aux épaules carrées, à la figure bronzée, veut bien me donner, sur la plantation divers renseignements. Elle embrasse 65 caballerias de terre. Cette mesure en usage dans le pays est un carré de 432 varras de côté, soit 186,624 varras carrées. La varra étant de 3 pieds espagnols, soit 0m,86, la caballeria correspond à 160,496 mètres carrés, soit un peu plus de 16 hectares.
Le terrain de la plantation n'étant pas de première qualité, ne donne qu'environ 600 chars de cannes de 150 arobas chaque, par caballeria. Cela fait 90,000 arobas ou 1,080,000 kilog. de cannes qui produisent 300 caisses de sucre de 16 arobas chaque, soit 4,800 arobas ou 57,600 kil.
(p. 068) De sorte que 1,080 tonnes de cannes donnent 57 tonnes 1/2, soit moins de 6%.
En divisant ces chiffres par 16, on trouve qu'un hectare de terre produit 67 tonnes de cannes et 3,600 kilog., soit un peu plus de 3 tonnes 1/2 de sucre.
Les bons terrains peuvent donner au maximum 700 chars de cannes de 150 arobas par caballeria. Le prix de la terre varie de 300 à 500 piastres or par caballeria. Les esclaves sont nourris et payés 6 piastres papier par mois, soit environ 10 sous par jour, puisque 2 piastres papier ne valent qu'une piastre or. La nourriture coûte de 1 fr. à 1 fr. 50 par esclave. Le matin à l'aube la cloche les appelle et on leur donne du café; à 11 heures, du riz ou du tajaco, viande salée qui vient de Montevideo, ou de la morue. Le soir, avant le coucher, ils mangent du maïs, des haricots noirs, ou quelque chose d'analogue.
On peut voir par ces chiffres que la plantation de cannes dans l'île de Cuba laisse au planteur de beaux bénéfices. Toutefois, l'excès de production et la concurrence de la betterave produisent en ce moment une complète stagnation.
La canne une fois plantée dure de sept à huit ans, selon les terrains. On la coupe une fois l'an. La deuxième et la troisième récoltes sont les plus abondantes. La canne doit être débarrassée de toute herbe; c'est pourquoi les esclaves la nettoient trois fois l'an par un léger labour à la pioche.
Nous nous proposions d'aller dans les champs pour (p. 069) voir au travail 250 esclaves, lorsqu'un déluge arrive et nous force à rester dans l'usine. Un quart d'heure après les pauvres esclaves arrivent complètement trempés; les surveillants aussi sont absolument inondés, eux et leurs chevaux.
Nous les suivons à l'habitation. Ils se rangent sous les portiques, en ligne de bataille. Le directeur arrive, un récipient de fer blanc à la main, et le présente aux lèvres de chacun et de chacune à tour de rôle. Il a soin de le retirer promptement après la première gorgée. À un signal donné, tout ce monde se disperse et s'en va dans les chambrées changer de linge. Je demande au directeur quel est le liquide qu'il vient de distribuer d'une manière si singulière. Il met sa main dans le seau de fer blanc et me présente son doigt à sucer. Naturellement je refuse, et mettant moi-même un doigt dans le seau, je le porte à la bouche, et je constate ainsi que le liquide est du rhum.
J'inspecte les chaudrons de la cuisine; un vieux nègre y plonge les haricots noirs, les morues et les ignames dans un état de propreté à peu près égal à celui de nos paysans lorsqu'ils préparent la nourriture aux vaches.
Le dimanche, les esclaves travaillent jusqu'à 9 heures du matin. Quelques-uns obtiennent ensuite la permission d'aller à la messe à Marianao.
Nous saluons ces braves gens, remercions le directeur et le mécanicien, et chemin faisant nous voyons sur le tronc de chaque palmier géant décimé par les vers, un (p. 070) énorme gallinaso, les ailes déployées, qui se sèche au soleil. On dirait autant de hampes surmontées de l'aigle impérial.
À Marianao, je laisse une carte à M. Duragnone pour le remercier de son obligeance, et nous reprenons le train qui doit nous ramener à la Havane. Je me trouve à côté d'un créole très distingué qui parle parfaitement le français. Je l'interroge sur les hommes et les choses du pays, et d'abord sur l'origine de ces sales petits billets de papier-monnaie qui à eux seuls suffiraient à propager la fièvre jaune. Il me dit que la banque espagnole, établie à Cuba, au capital de 4,000,000 de piastres, avait été autorisée à émettre des billets pour une égale somme. Plus tard, ayant porté son capital à 8,000,000, elle fut autorisée à élever son émission de papier à 16,000,000 de piastres; mais à l'époque de l'insurrection, le gouvernement ayant besoin d'argent, l'engagea à émettre pour son propre compte 40,000,000 de piastres, qui d'abord eurent cours au pair. Plus tard, voyant que le gouvernement se refusait à les rembourser, ils commencèrent à baisser, et ils perdent en ce moment 110%. Dans ces dernières années, on a établi un impôt dont le produit est destiné à l'amortissement de ce papier-monnaie; mais le gouvernement, toujours à court d'argent, ne cesse de l'employer ailleurs par des virements.
Après la Révolution, l'Espagne a accordé une certaine représentation aux habitants de Cuba. Ils envoient aux Chambres, à Madrid, une trentaine de députés et (p. 071) une douzaine de sénateurs. Le suffrage est restreint. Il faut payer un impôt de 25 piastres pour être électeur. Toutefois, tout cela est rendu illusoire par le pouvoir accordé au capitaine général, de suspendre la constitution toutes les fois qu'il en trouve la convenance. De plus, de nombreuses lois préexistantes à la constitution n'ont pas été abrogées, et le gouverneur les applique lorsque cela lui convient, bien qu'elles détruisent les garanties constitutionnelles.
Le pays est divisé en deux partis: les autonomistes et les conservateurs. Le premier est surtout composé de créoles qui réclament l'autonomie et voudraient être placés vis-à-vis de l'Espagne à peu près dans une situation analogue à celle du Canada à l'égard de l'Angleterre. Les conservateurs sont surtout des Espagnols qui préconisent l'assimilation et se perdent en distinctions subtiles entre assimilation et identité. Au fond, ils amusent le public en paroles, pour conserver le statu quo qui leur permet de s'enrichir.
Les impôts qui, avant la Révolution, s'élevaient à 13,000,000 de piastres, atteignent maintenant 35,000,000. Si le gouvernement né remplit pas ses caisses, les employés qu'il envoie ici font de rapides fortunes. Ils vont en jouir dans la mère patrie pour faire place à d'autres. On cite tel directeur de douanes qui, après 2 ans d'emploi, possédait 700,000 piastres. Dans le journal La Democracia historica du 25 courant, je lis le fait d'un nommé Carlos Urretia, inspecteur de police, qui avait autorisé (p. 072) les filles d'une maison publique à voler l'argent de ceux qui les visiteraient, leur promettant l'impunité à condition de partager avec lui. Ce brave homme, pris en flagrant délit, a été condamné à deux ans de presidio. Avec une pareille administration, un pays ne saurait prospérer. Mais le parti conservateur se moque des récriminations. Il a su former un corps de volontaires de 70,000 hommes dont il a soin d'exclure les autonomistes, et gare à qui lui résistera.
Il y a quelque temps, un capitaine général intelligent et honnête voulait donner une certaine satisfaction aux autonomistes. Il se vit bientôt cerné par 14,000 volontaires qui envahirent son palais et l'embarquèrent pour le renvoyer en Espagne. S'ils n'ont pas toujours été aussi violents, ils ont toujours réussi à faire déplacer tout capitaine général qui ne faisait pas assez bien leurs affaires. Si au moins ces volontaires couraient sus aux bandes de brigands qui en ce moment ravagent la campagne et rançonnent les propriétaires! Durant la Révolution, les Cubains avaient voulu se donner aux États-Unis; mais ceux-ci, qui sortaient à peine de la grande lutte qui avait abouti à l'abolition de l'esclavage, redoutaient l'entrée dans l'Union d'un pays à esclaves, et ils refusèrent. Dans quatre ans, cette question aura cessé d'exister, et au premier embarras de l'Espagne, si les Cubains renouvellent l'offre, elle pourrait bien être acceptée.
Combien mieux aimée eût été la mère patrie si, par une administration sage et honnête, elle s'était attachée le (p. 073) cœur de ses sujets de Cuba! Mais comment pourrait-elle donner au loin cette administration sage et honnête, puisqu'elle en manque elle-même dans son sein, et que les plaies dont elle afflige les colonies sont celles mêmes dont elle souffre à son tour depuis si longtemps!
Pendant que nous causons, le train approche de la ville, et je demande le prix des terrains à bâtir. Dans les faubourgs, ils se payent environ 20 fr. le mètre carré, et dans le centre à peu près 100 fr. le mètre carré.
Mais revenons à la canne à sucre, qui forme la richesse de l'île. Colomb, dans son second voyage, commença par porter des Canaries la canne créole. En 1795, Francisco Arango introduisit celle de Taïti. Puis on porta celle de Java, et en 1826 la cristalline de la Nouvelle-Orléans.
On calcule en ce moment, que tous les ans, dans le monde entier, on produit et on consomme 5,335,000 tonnes de sucre, dont 1,465,000 sont de sucre de betterave et 120,000 de maïs et autres grains.
Des 3,750,000 tonnes de sucre de canne, l'île de Porto-Rico produit 150,000 tonnes, Cuba 630,000 tonnes, les Philippines 200,000 tonnes, les Antilles françaises y compris la Réunion 150,000 tonnes, les Antilles anglaises y compris Maurice 200,000 tonnes, Java 200,000, le Brésil 200,000, la Chine 50,000, la Louisiane 100,000, et le reste divers autres pays.
Cuba produit aussi une quantité assez considérable de café. On calcule de la manière suivante la production du café dans le monde entier: le Brésil 176,000,000 de livres, (p. 074) Java 124, les îles Célèbes 1, l'Arabie 3, Sumatra 8, Ceylan 40, l'Équateur 1/5 de million, les Philippines 3, Vénézuéla 35, Nicaragua 2-1/2, Guatemala 120, les Antilles anglaises 8, les Antilles françaises et hollandaises 2, Cuba et Porto-Rico 30, Malabar et Missouri 5 millions.
Après le sucre, le tabac forme le principal revenu de Cuba. À la Havane, on rencontre à chaque pas des magasins remplis de ballots de tabac du poids d'environ 100 livres. Le prix varie de 50 à 200 piastres le quintal. Le meilleur vient de la Vuelta Abajo et sert à faire les cigares exquis de la Havane; le plus grossier s'en va en Allemagne. Le gouvernement français entretient ici un agent pour l'achat du tabac nécessaire à ses manufactures. Le consul est chargé des traites, et cela lui forme un boni moyen d'environ 30,000 fr. l'an ajouté à son traitement, qui est de 40,000 fr.
Je ne veux pas quitter la Havane sans visiter une fabrique de cigares et une de cigarettes. Chez Villar-Villar, Calle de la Industria, no 174, je trouve 200 ouvriers fabricant 62 sortes de cigares; les villares flor fina valent 500 piastres le 1,000, ce qui les met à 2 fr. 50 pièce; ils sont gros et longs de 18 centimètres. Les Londres de Corte valent 40 piastres le 1,000, les Rothschild flor fina valent 125 piastres le 1,000, les Victoria 110 piastres, les Damas ou petits cigares pour dames 38 piastres, etc. Il faut ajouter à cela le droit d'exportation qui est de 2 piastres le mille, et celui d'importation qui est de 25 fr. le kilog. en France et de 15 fr. en Allemagne, le port et le bénéfice du détaillant, (p. 075) etc. Les ouvriers sont payés à raison de 24 piastres le 1,000. Ils font une moyenne de 100 cigares de luxe par jour et gagnent ainsi de 12 à 15 fr. Nous les voyons à l'œuvre; ce n'est pas peu de chose que de former un cigare de luxe. Il faut choisir le tabac qu'on place à l'intérieur, et en poser les couches avec attention; puis choisir encore mieux la feuille qui les enveloppera. Cette feuille doit être sans défaut. Les jaunes clair couvriront les cigares destinés à l'Allemagne, les autres ceux qui vont en France et en Angleterre. Le difficile c'est de bien former la pointe. L'ouvrier colle avec une pâte de farine le dernier morceau, et lorsque c'est nécessaire, il perfectionne le bout avec ses lèvres. Le cigare est ensuite mesuré, coupé et passé à ceux qui opèrent le triage. Les côtes des feuilles sont jetées. Le tabac est employé à l'état naturel sans aucune sauce. C'est le même tabac qui sert aux divers cigares. Ce n'est que le poids, la façon et le luxe du paquetage qui en changent le prix. Dans l'entrepôt, nous voyons amoncelés 3,000 ballots de la récolte de 1883, contenant chacun 100 livres. Ils valent 200,000 piastres, soit 1,000,000 de francs. Tous les jours, des moricos baignent dans l'eau la quantité qui sera travaillée le jour même. Le tabac ordinaire doit être consommé dans l'année de la récolte. Le meilleur se conserve 2 ans. Réduit en cigares, il se conserve plus longtemps. Avant de nous quitter, M. Villar pousse l'amabilité jusqu'à nous remettre à chacun un villar flor fina, son plus cher et meilleur cigare. Je ne suis pas connaisseur, mais mes (p. 076) compagnons le trouvent délicieux, seulement vu sa grosseur et sa longueur (0m18) il dure trop longtemps et accumule au bout une trop forte quantité de nicotine.
À la fabrique des cigarettes de Diego Gonzales, Calle de la Reina, je trouve 400 Chinois. Les uns ont la queue, les autres l'ont coupée, quelques-uns portent la blouse nationale et de grosses lunettes.
Une machine à vapeur fait fonctionner les lames qui coupent le papier et le tabac: le papier est de 3 sortes: jaune en paille de blé, bleu en coton, et brun ou pectoral. Le tabac est coupé court et fin. Les Chinois le plient avec rapidité dans le papier et en replient le bout avec une espèce de dé en fer blanc. Ils sont payés à raison de 4 piastres papier la tarea de 6,100 cigarettes. Un homme peut faire en moyenne 1/2 tarea par jour. On a de la peine à surveiller ces célestiaux pour les empêcher de fumer l'opium et de parfumer ainsi leur travail. Une salle séparée est occupée par 50 femmes, elles font les cigarettes aussi bien et aussi vite que les hommes, et reçoivent le même salaire.
La caisse est toujours ouverte, chaque ouvrier peut à tout moment de la journée y porter son travail et en recevoir le montant. On fait tous les jours une moyenne de 180 tareas, soit plus de 1,000,000 de cigarettes. Elles sont mises en paquets de 12 et vendues à raison de 2 fr. 50 ou une piastre papier les 27 paquets.
Selon mon habitude, je me rends au marché principal. C'est un grand corps de bâtiments à portiques extérieurs. (p. 077) Sous ces portiques sont des magasins ou bazars surmontés de logements. La cour couverte est occupée par les vendeurs de viande, de fruits et de légumes. Cette disposition est défectueuse, parce que les magasins empêchent la circulation de l'air.
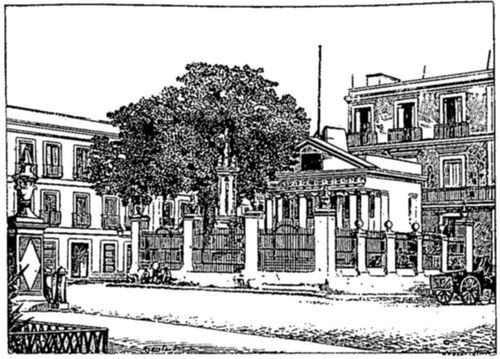
Grandes Antilles.—Cuba.—Plaza de Arme.—Statue de C. Colomb.—Chapelle où fut dite la première messe en Amérique.
Avant de quitter la ville, nous venons encore une fois à la plaza de Arme ou place centrale, voir la colonne surmontée d'une madone et portant sur le piédestal un buste de Christophe Colomb. Elle s'élève au-devant d'une chapelle dans laquelle en 1519 fut célébrée la première messe dans l'île.
Enfin je dis adieu à la Havane et monte sur une nacelle qui me ramène au steamer. L'odeur du port est nauséabonde: il reçoit tous les égouts de la ville; c'est (p. 078) pourquoi ses abords sont toujours les premiers visités par le vomito negro. La Supérieure du Sacré-Cœur me disait: «Nous n'avons plus perdu de sœurs de la fièvre jaune depuis que nous nous sommes éloignées du port.»
Nous passons encore à côté de beaux steamers qui vont à New-York; ils ont un double étage de cabines ouvrant sur un promenoir extérieur. Vers le commencement du mois, un d'eux, dans un cyclone, a eu le salon enlevé. Le déplacement de la cargaison avait couché le navire sur le flanc et le gouvernail avait été emporté. Le maître d'hôtel seul et un domestique ont perdu la vie. Après deux jours la tempête s'étant calmée, le navire a pu être remorqué et les passagers sauvés.
En quittant la terre, j'avais acheté un journal: la Democratia Historica. J'en cite un paragraphe pour donner le ton de la presse de ce côté des mers:
«Escribimos (harto lo sabemos) sobre un volcan de passiones: no importa. Siempre necessitan las grandes audacias de la libertad el fuego subterraneo de los pueblos, la sanguinaria rabia de los despotas, los immortales delirios de la fè republicana, factores tremendos de la sociedad moderna, labor genesiaca y épica que forma con sus convulsiones irascibles y sus imponentes calmas la corteza de la libertad y el granito de la democracia.»
«Nous écrivons (déjà nous le savons), sur un volcan de passions; peu importe. Les grandes audaces de la liberté nécessitent toujours le feu souterrain du peuple, (p. 079) la rage sanguinaire des despotes, les délires immortels de la foi républicaine, facteurs terribles de la société moderne, travail génésiaque et épique qui avec ses convulsions irascibles et ses calmes imposants forment l'écorce de la liberté et le granit de la démocratie.»
Nous arrivons à l'Éden une demi-heure en retard de l'heure du repas, et j'ai de la peine à exiger de mon nègre qu'il me serve à dîner. Le soir, M. Solano et ses amis Palacios et Caballero ont l'amabilité de venir passer la soirée sur le navire. M. Solano est avocat et m'apprend que, d'après les lois cubaines, le père peut disposer par testament de 1/5 de ses biens en faveur d'un parent ou d'un étranger, et qu'au surplus il peut encore donner à titre de préciput à un de ses enfants le 1/3 des autres 4/5.
La recherche de la paternité est permise, et si, de l'ensemble des faits, le juge est convaincu de la culpabilité, il condamne le séducteur à donner une dot à la mère et à reconnaître l'enfant, à moins qu'il ne préfère régulariser la position par le mariage.
Le lendemain, à 8 heures, nous sortons du port et suivons les côtes de l'île.
Le 26 septembre nous entrons dans le golfe du Mexique et naviguons au sud-ouest.
Le 27, même navigation, orages fréquents. De nombreux petits oiseaux se réfugient sur le navire et se laissent prendre avec facilité. Déluge durant la nuit.
Le 28, vers le soir, nous arrivons à Vera-Cruz.[Table des matières]
La République mexicaine. — Surface. — Constitution. — Population. — Les diverses branches ou familles indiennes. — Cause de leur dépérissement. — Revenus. — Dépenses. — Chemins de fer. — Télégraphe. — Poste. — Instruction publique. — Mines. — L'isthme de Tchuantepec. — Histoire. — Fernando Cortez et la conquête. — Fin de Montézuma, dernier empereur des Aztecas. — Les sacrifices humains. — Le vice-roi. — Fin tragique de deux empereurs.
La République fédérative mexicaine comprend un territoire de 1,920,000 kilomètres carrés, presque 4 fois la surface de la France. Elle compte 27 États; 5 vers le nord: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nueva-Leon et Tamaulipas; 4 sur le golfe du Mexique: Vera-Cruz, Tabasco, Campêche, Yucatan; 7 sur le littoral du Pacifique: Sinaloa, Xalisco, Colima, Michoacan, Guerrero, Oaxaca, Chiapas; 11 dans le centre: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosi, Guanajuato, Queretaro, Hidalgo, Mexico, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Aux 27 États il faut ajouter le district fédéral et le territoire de la Basse-Californie.
Ces États sont indépendants et confédérés. Le pouvoir exécutif est confié à un président de la République élu pour quatre ans et entouré de six ministres responsables. Le pouvoir législatif est exercé par le Congrès formé de (p. 082) deux Chambres: le Sénat et la Chambre des députés. Chaque État élit deux sénateurs pour quatre ans; ils se renouvellent par moitié tous les 2 ans. Les députés sont élus en raison de 1 pour 40,000 habitants et se renouvellent aussi par moitié tous les deux ans. Toutes les élections se font par le suffrage universel.
La constitution de 1857, qui régit le pays, commence ainsi:
«En el nombre de Dios y con la autoritad del Pueblo mexicano; los rapresentantes de los diferentes Estados, etc...»
Puis vient l'énumération des droits de l'homme, la définition et distribution des pouvoirs, etc.
Le pouvoir judiciaire est confié à une Cour suprême composée de 11 membres élus pour six ans. Viennent ensuite les tribunaux de district et de circuit. La noblesse est abolie, les Ordres religieux sont proscrits, l'instruction est laïcisée; l'Église est séparée de l'État.
Les Mexicains ont copié servilement l'œuvre de nos révolutionnaires, et, comme nous, ils ont donné jusqu'à ce jour le triste spectacle de continuelles révolutions, tombant alternativement du despotisme militaire dans l'anarchie.

Mexique—Indiens Apacas.
D'après le cens de 1879, la population compte 9,873,670 habitants. Sur ce chiffre, 48% sont du sexe masculin, et 52% du sexe féminin, 19% sont Européens ou Espagnols américains, 38% indigènes ou Indiens, 43% de race mêlée. Parmi les indigènes Indiens, la branche
En 1810, ils étaient 3,676,281. Ils sont restés presque, stationnaires pendant que la race mêlée a triplé, et que l'européenne a augmenté de 69%.
Plusieurs Mexicains semblent voir la cause de la future disparition des indigènes dans leur indolence, dans leurs mauvais logements et maigre nourriture; mais ceux qui emploient l'Indien savent que lorsqu'il est encouragé, il travaille plus que tout autre, et s'il est mal nourri, c'est qu'il est mal rétribue; s'il est mal logé, c'est que les propriétaires se soucient peu de le loger mieux. En un mot, l'Indien, s'il n'est pas relégué comme aux (p. 084) États-Unis dans ses Réservations, c'est que le propriétaire mexicain préfère l'utiliser et en tirer tout ce qu'il peut, en lui donnant le moins possible.
Dans plusieurs États et notamment dans la ville de Mexico, la mortalité excède les naissances. Pour Mexico on attribue le fait à l'infection de l'air causée par les égouts de la ville et les marais des campagnes. Depuis longtemps on propose le drainage de la vallée pour assainir la capitale.
Le revenu, d'après les dernières statistiques que m'a fournies le ministère de Formento (Travaux publics), a été:
La subvention de l'État pour les diverses lignes varie de 6,000 à 9,000 piastres par kilomètre.
Les lignes télégraphiques atteignent presque 17,000 kilomètres et ont expédié dans l'année 800,800 dépêches qui ont produit 400,000 piastres. La poste expédie 7,000,000 de lettres et plis et produit 600,000 piastres.
L'instruction publique comprend 2 élèves par 100 habitants. Les États-Unis ont 17-1/2 élèves par 100 habitants; l'Allemagne, le Danemark, la Suisse en ont 15; la France, les Pays-Bas 13; l'Angleterre et la Norwège 12; la Belgique 11; l'Autriche et l'Espagne 9; l'Irlande 8; la Hongrie 7; l'Italie 6; la Grèce et la République Argentine 5; l'Uruguay 3; le Portugal 2-1/2 et la Russie 2. Il n'y a que le Brésil, la Turquie, l'Équateur et le Vénézuéla qui en ont moins de 2.
Les mines, depuis la découverte du Mexique, ont donné plus de 15 milliards de francs. Dans presque tous les États on trouve l'argent, l'or, le cuivre, le plomb, mais faute de capitaux et d'initiative, l'exploitation se fait encore d'une manière imparfaite et primitive.
Les 14 Monnaies de la République depuis 1537 jusqu'à (p. 086) 1880 ont frappé pour 3 milliards de piastres d'argent et pour 118 millions de piastres d'or.
On sait que les États-Unis, n'ayant pu réussir à se rendre maîtres du canal de Panama, cherchent à le contrecarrer, tantôt en faisant croire qu'ils vont exécuter le canal de Nicaragua, tantôt en publiant qu'ils vont construire un chemin de fer à l'isthme de Tehuantepec pour transporter les vaisseaux d'un Océan à l'autre. Le gouvernement mexicain vient en effet de concéder à un général américain[2] la construction de ce chemin de fer, mais il doute fort lui-même que ce projet se réalise jamais.
Rappelons rapidement les faits principaux de l'histoire du Mexique. Il a été conquis par l'Espagnol Fernando Cortez. Son père lui faisait apprendre le latin à l'Université de Salamanca, mais le futur guerrier, préférant l'action à ce vieux langage, s'en alla à Naples servir sous Fernando de Cordoba. En 1511 il accompagna Diego-Velasquez à son expédition de Cuba. Là il se fit éleveur de bétail et fut mis en prison par le même Diego-Velasquez, gouverneur, pour intrigues d'amour. Il se sauva deux fois et finit par organiser pour son propre compte une expédition au Mexique. Il partit de la Havane le 10 février 1519 avec 508 soldats, 110 hommes d'équipage, 32 arbalétriers, 13 fusiliers, 209 Indiens et quelques Indiennes pour domestiques. Avec cette armée il devait (p. 087) conquérir un empire de 16,000,000 d'habitants. Le 12 mars, il arriva à Tabasco et en soumit les Caciques à la suite de trois batailles. Ces Caciques lui firent présent de 10 jeunes filles dont une, nommée Malintzin, et baptisée sous le nom de Marina, devint son épouse et sa plus fidèle coopératrice. Elle lui servit d'interprète et fit avorter les diverses conspirations qui le menacèrent. Le Jeudi-saint, 21 avril 1519, Cortez débarquait à Vera-Cruz. Organisateur aussi bien que militaire, Cortez fit nommer un Ayutamiento et légaliser son autorité. Les Indiens le reçurent amicalement et l'informèrent qu'ils étaient tributaires de Montézuma, le grand Empereur qui régnait à Mexico. Il mit toujours beaucoup de soin à se renseigner sur les choses du pays à mesure qu'il avançait. Ayant appris que Montézuma était en mésintelligence avec Ixtlixochitl, un de ses frères auquel il avait cédé une partie du royaume, il profita aussitôt de cette situation et s'allia avec Ixtlixochitl et se dirigea sur Mexico. Montézuma le reçut amicalement. Un personnage mystérieux, blanc, barbu et vêtu d'une soutane, qui avait prêché aux Mexicains une religion nouvelle et leur avait appris à mieux utiliser la terre et à extraire les métaux, leur avait prédit que des hommes blancs et barbus comme lui viendraient à la suite du temps et se rendraient maîtres de l'Empire. Cette tradition, qui se conservait aussi au Pérou, fut cause que Montézuma et les indigènes se soumirent facilement aux Espagnols. Toutefois Cortès, comme Pizarro au Pérou, jugea bon de faire l'empereur (p. 088) prisonnier. Il laissa le commandement à Pedro de Alvaredo pour aller combattre Panfilo de Navarez que le gouverneur de Cuba avait envoyé contre lui.
Au mois de mai, les Mexicains avaient l'habitude de célébrer une grande fête, et demandèrent à Alvaredo la permission de la faire selon l'usage. Celui-ci consentit, à condition qu'ils seraient sans armes; mais pendant qu'ils étaient au temple dans la nuit, il les fit tous tuer pour les voler. La population se souleva et chassa les Espagnols. Ceux-ci, en se retirant, tuèrent le malheureux Montézuma. Cortez réorganisa avec les Indiens ses alliés une armée de 250,000 hommes, et revint à Mexico qu'il attaqua avec une flottille de bateaux. Cette capitale était alors au milieu d'une lagune comme Venise. Les Mexicains firent une résistance héroïque, et Cortez n'en vint à bout qu'en démolissant les maisons pour remplir les canaux. Le 13 août 1521, il était maître de Mexico. Plus de 100,000 personnes périrent dans la bataille.
Cortez trouva au Mexique, comme Pizarro au Pérou, un peuple d'une civilisation avancée, ayant ses monuments, ses temples et ses arts: il est regrettable que les archives et la plupart des monuments de ces peuples aient été détruits par les premiers missionnaires, comme entachés de paganisme. Nous aurions certainement trouvé le point de jonction de cette race à la race égyptienne et phénicienne à laquelle sa civilisation semble empruntée. Tout ce que nous savons, c'est que diverses races s'étaient superposées, et que plusieurs dynasties s'étaient succédées. (p. 089) La plus puissante de ces races, celle qui finit par dominer les autres, fut celle des Aztecas. Les premiers habitants, les Toltecas, avaient une religion simple et naturelle. Ils adoraient un Dieu unique et créateur qu'ils appelaient Tloque Nahuaque, et lui offraient des copalli, offrandes d'oiseaux et de fleurs. Les Chichimecas vinrent ensuite, et peuple barbare, ils altérèrent la religion. Enfin les Aztecas, peuple guerrier, imposèrent leur culte. Leurs principales divinités étaient Huitzilopochtli, dieu de la guerre; Tlaloc, dieu de l'eau; Tezcatlipoca, dieu du ciel; Quelzalcoatl, dieu de l'air; Miclantuectli, dieu de l'année et des herbes; Ceuteotl, dieu du maïs; Tezcatzoncatl, dieu du pulche; Cuatlicue, déesse des fleurs. Ces dieux étaient représentés en statues de pierre, et on les voit aujourd'hui dans le musée de Mexico.
Les temples consistaient en deux tourelles ou petites chapelles situées au sommet d'une grande pyramide tronquée, construite en adobe; on y montait par un escalier central ou par un escalier en spirale. Le temple principal de Mexico était consacré au dieu de la guerre et au dieu du ciel, et se trouvait sur l'emplacement qu'occupe actuellement la cathédrale. Les prêtres chargés du culte étaient couverts d'un manteau noir. Ils portaient d'horribles figures sur les vêtements, avaient les cheveux épars, les mains et le corps souillés de sang. Les offrandes à la divinité n'étaient plus seulement l'encens, les fruits, les fleurs, les animaux et les danses, mais surtout les sacrifices humains. Ils avaient lieu en temps (p. 090) de sécheresse ou d'ouragan, avant de se mettre en guerre, au couronnement des rois, etc.
Les victimes étaient les prisonniers de guerre. Arrivés au sommet de la pyramide, on allongeait la victime sur une pierre, le prêtre lui ouvrait la poitrine avec un couteau de ixtli, lui arrachait le cœur qu'il offrait à la divinité, et jetait le corps au bas de la pyramide. Le peuple, à la vue du sang, commençait les danses, et chacun continuait à danser jusqu'à sa maison.
À la fête du dieu Tlaloc, on sacrifiait des petits enfants que des mères pauvres vendaient aux prêtres. À la déesse des fleurs, en avril, on n'offrait que des fleurs. Au dieu du ciel, en mai, on offrait des plumes, des animaux et des jeunes filles qui se consacraient au service du temple. À la fête du feu, tout le peuple se rendait à la montagne. On sacrifiait une victime humaine, et on distribuait le feu nouveau obtenu par le frottement de deux rameaux de bois.
En dehors de ces horribles sacrifices humains, imposés par la religion, la population aztèque avait des mœurs douces; les mères aimaient leurs enfants, les pères leur enseignaient les règles de morale, le respect et l'obéissance. Ils pleuraient longtemps leurs morts, et étaient très hospitaliers. Ils cultivaient la terre et exerçaient divers métiers. Les idiomes étaient nombreux, mais le nahuatl était le plus répandu.
Après la conquête, les vice-rois du Mexique ou Nouvelle Espagne gouvernent le pays jusqu'en 1810. Quelques-uns (p. 091) furent bons et capables, la plupart cruels ou insignifiants. L'histoire, durant cette période, est une suite de conspirations et d'intrigues. Les famines et les pestes se succèdent, les volcans font plusieurs éruptions, les Indiens se soulèvent de temps en temps. Mexico est inondé à plusieurs reprises.
En 1810, Miguel Hidalgo proclame l'indépendance du Mexique et abolit l'esclavage, mais l'Espagne ne reconnaît cette indépendance qu'en 1836. En 1822, Iturbide se fait proclamer empereur et est fusillé deux ans après. En 1864, Maximilien d'Autriche, amené par les troupes françaises, lui succède sur le trône. Il est fusillé en 1867, et l'Indien Juarez reprend son siège de président de la république. Aujourd'hui ce siège est occupé par le général Gonzales, et le général Porfirio Diaz est sur les rangs pour la prochaine élection. On le dit honnête et capable, et il est à espérer que, s'inspirant des éternels principes du vrai et du bien, il pourra inaugurer les véritables réformes, inspirer à la classe dirigeante ses devoirs de patronage, relever le peuple de la misère, mettre en honneur l'amour du travail, extirper les intrigues, la camorra, le pillage, fermer l'ère des révolutions, et ouvrir au pays une ère de paix et de prospérité. Il pourra ainsi développer ses immenses ressources, et prendre rang à côté des peuples prospères. Mais il est temps de reprendre mon journal de voyage.[Table des matières]
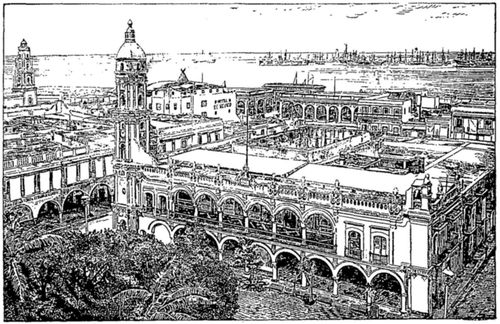
Mexique.—Vera-Cruz.—Vue de la rade.
Débarquement à Vera-Cruz. — Construction du port. — La ville. — La fièvre jaune. — Départ pour Mexico. — Le chemin de fer. — Orizaba. — Maltratta. — Le Citlaltepelt. — Le pulche. — Mexico. — Les hôtels. — La ville. — La cathédrale. — Les toros. — Les loteries. — Le Paseo.
C'est le 28 septembre, dans l'après-midi, que l'Éden arrive devant Vera-Cruz. Plusieurs navires sont à l'ancre, mais ils ne peuvent débarquer leurs marchandises, à cause du mauvais état de la mer.—Il n'y a point de port à Vera-Cruz. Une Compagnie française en construit un en ce moment. Il doit être achevé en 10 ans, et la Compagnie reçoit pour cela 10,000 dollars par semaine que lui paie le gouvernement de la République mexicaine. La houle vient d'enlever récemment une partie des travaux. Vue de la mer, Vera-Cruz offre un bel aspect. À terre, ses rues larges de 12 mètres et coupées à angle droit, ses maisons de pierre couvertes en terrasse, ses places, ses églises, la végétation qui l'entoure, en feraient une ville superbe, si on pouvait y trouver la propreté. Mais, faute d'égouts, tous les résidus des maisons s'en vont dans les rues, qui deviennent ainsi, des égouts ouverts. Les gallinasos (vautours noirs) s'y promènent par centaines, disputant aux chiens les balayures. La puanteur (p. 094) m'oblige à porter constamment au nez un mouchoir imbibé d'eau de Cologne. Une ville ainsi tenue doit engendrer la peste sous toutes les latitudes. Il y a en effet encore une trentaine de cas de fièvre jaune par jour, dont 50% sont mortels. Tant d'incurie n'empêche pas les habitants d'adopter les dernières découvertes; ils ont le téléphone et la lumière électrique. Ils seraient plus avisés s'ils avaient des égouts et des balayeurs. Je me rends aux bureaux des diverses Compagnies, afin de connaître la date des départs des navires pour Galvestown ou pour la Nouvelle-Orléans. Il n'y a point de départ fixe; les lignes régulières sont interrompues durant l'épidémie. Tout navire qui arrive d'ici à la Nouvelle-Orléans est tenu à 10 jours de quarantaine dans le Mississipi. Je commence à comprendre que je ne pourrai sortir du Mexique de ce côté et que je serai obligé de gagner les États-Unis par terre.
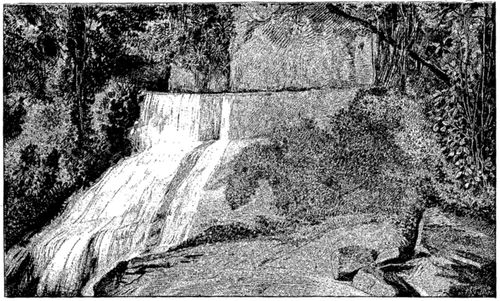
Mexique.—Sur la route d'Orizada.—Cascade.
À l'hôtel, après un mesquin souper, on nous place quatre dans une même chambre. Les lits se composent simplement d'une toile tendue, sur laquelle on s'allonge en se couvrant d'un drap. Les sons de la musique nous appellent sur la place: c'est l'heure où la population vient respirer l'air frais de la nuit. De belles Indiennes aux cheveux longs, noirs et lisses, se promènent à côté des dames, et des demoiselles. Les petites filles font au milieu du jardin des danses et des rondes avec les garçons de leur âge; insouciance des jeunes années! En rentrant, j'aperçois des promeneurs d'un nouveau genre: ce sont (p. 095) des crapauds qui se sentent chez eux dans ces rues immondes. Heureusement que les quatre habitants de la même chambre sont des compagnons de voyage: on peut ainsi prendre gaiement son parti de la situation. Nous fumons pour chasser les odeurs, nous nous aspergeons d'eau de Cologne et prenons notre repos. Il ne sera pas long. À 4 heures du matin, il faut se lever et se préparer pour aller au chemin de fer. Le train part vers 5 heures.
Le trajet de l'hôtel à la gare est assez court, 10 minutes à peine; mais la pluie est si torrentielle, que bientôt nous sommes trempés jusqu'aux os. Les employés refusent de me laisser prendre ma petite valise, et je ne puis changer mes vêtements. Il faut payer son billet 16 piastres, et bien des piastres encore pour supplément de bagages, la franchise n'étant que pour 30 livres. Nos vêtements sécheront au soleil aux fenêtres du wagon et sur la peau.
Enfin la locomotive siffle, et nous voilà en route. Il y a 422 kilomètres de Vera-Cruz à Mexico; mais, cette capitale se trouvant à 2,283 mètres d'altitude, il faudra gravir bien des montagnes. Aux abords de Vera-Cruz, nous voyons encore des dépôts d'immondices de toute sorte; puis viennent les champs, où paissent les bœufs et les chevaux. La végétation est tropicale.
Après avoir traversé une vaste plaine, nous abordons les montagnes. Nous marchons de surprise en surprise. Ici, la forêt vierge; là, la profondeur des ravins; plus loin, une cascade féerique: on est enchanté, ravi. Par-ci par-là, des villages, à cabanes de chaume, perdus dans la (p. 096) forêt. Nous voyons le caféier, la canne à sucre, le maïs, mais le tout assez négligé. On me fait remarquer la hacienda de Potrero, qui a 24 kilomètres carrés et qui vient d'être achetée pour 30,000 piastres (la piastre mexicaine varie de 4 fr. 50 à 5 fr.). Elle pourrait rendre des millions, si elle était cultivée avec intelligence, et ne rapporte rien. Les quelques Indiens qui y sèment le maïs qui les fait vivre paient au propriétaire une redevance de 10 piastres par an. C'est près de cette hacienda que j'ai vu un vol de sauterelles parentes de celles d'Égypte. Elles dévastent la terre et ne paient aucune redevance. Les indigènes les aiment peu: un de mes compagnons en avait pris une pour l'examiner; un Mexicain l'arrache brusquement de ses mains et la met sous ses pieds.
De temps en temps la locomotive fait entendre son sifflet bruyant: c'est pour mettre en fuite le bétail que le conducteur aperçoit sur la voie. Deux vaches pourtant demeurent immobiles, sans se douter du danger; la locomotive les heurte et les jette au loin hors des rails.
Les hommes sont coiffés d'un grand chapeau de feutre ou de paille à larges bords. Les femmes portent leur bébé attaché par une couverture derrière le dos. Par un brusque mouvement, les mères les ramènent en avant pour leur donner le sein, et les rejettent sur le dos de la même manière.

Mexique.—Environs d'Orizaba.—Huttes.
Nous voici à Orizaba, ville la plus importante de l'État de Vera-Cruz. Elle compte 35,000 habitants. De nombreux clochers et coupoles indiquent les églises. Quelques cheminées (p. 097) révèlent la présence de la vapeur: on me dit que ce sont des fabriques de sucre et des filatures de coton. Le train continue à s'élever par une pente de 4%, fait des tours et des détours, traverse des ruisseaux et des ravins. Aux cocotiers succèdent les pins et les chênes. Dans les gares, les femmes ne nous vendent plus la banane et autres fruits tropicaux, mais la poire, le raisin, la figue et les oranges.
Nous atteignons la plaine de Maltratta, bien cultivée, très habitée. De ce point, nous apercevons la voie se développant vers des pics inaccessibles, avec des ponts que l'on prendrait pour de légères passerelles. La pente atteint 6%, et une nouvelle machine est attelée à la première. À mesure que le train s'élève dans la forêt, la vue sur la plaine devient de plus en plus ravissante. Pour mieux jouir du coup d'œil, je me tiens sur la plate-forme; bientôt nous passons sur divers ponts suspendus à 1,000 et 2,000 pieds. Cet endroit est appelé Infernillo (petit enfer). Je le recommande aux amateurs d'émotions.
À Altalux, à 1,900 mètres d'altitude, je remarque les capucines, les daturas, les liserons, les roses et toutes les fleurs de nos jardins de Nice. Enfin, arrivés au sommet, à Boca del Monte, voici la plus grandiose des surprises: à notre droite, le Citlaltepelt élève à 19,000 pieds sa cime neigeuse. Ce volcan semble veiller comme un géant à la garde de la vallée de Mexico. La fraîcheur nous oblige à nous couvrir. À la canne à sucre, au café, on (p. 098) succédé l'orge, l'avoine, le maïs. Un Alsacien, employé à la gare, est dans le pays depuis notre expédition. Il me prend pour un ingénieur, et veut m'intéresser à des mines d'albâtre et à des mines d'argent qu'il prétend avoir découvertes. Nous entrons en effet dans le pays de l'argent. Bientôt nous rencontrons un embranchement qui va à Pachuca, où l'on exploite de nombreuses mines d'or et d'argent. La plaine est couverte de magnifiques aloès, bien alignés, bien cultivés, d'où l'on extrait le pulche, boisson du pays qui remplace le vin. Lorsque la plante est mûre, vers l'âge de 5 à 10 ans, on coupe le centre, et, durant 3 à 6 mois, le vide qui en résulte se remplit tous les matins, par la sève des feuilles, de 2 à 3 litres d'un liquide appelé agua miel ou eau douce. Ce liquide est légèrement purgatif. Un homme le fait passer dans des outres au moyen d'une espèce de pompe où il fait le vide en aspirant. On le met ensuite à fermenter durant 24 heures avec un peu de pulche vieux, et on l'expédie à Mexico, où il est vendu dans les pulcherias qui se trouvent à chaque coin de rue. Les Indiens s'enivrent facilement avec cette boisson, et se laissent ensuite aller à toute sorte d'excès et de crimes. Il y a des haciendas (fermes) de pulche qui rapportent jusqu'à 100 et 200,000 fr. par an. Le chemin de fer fait une recette de plusieurs milliers de francs par jour, seulement par le transport de cette boisson: J'ai voulu la goûter: elle n'a rien de séduisant. La couleur est celle du petit lait, l'odeur est nauséabonde, le goût révoltant. Pourtant, telle est la force (p. 099) de l'habitude, que même les riches du pays l'ont constamment sur la table et la préfèrent au vin.
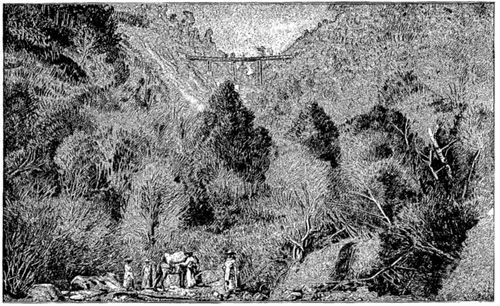
Mexique.—Chemin de fer de Vera-Cruz à Mexico.—Montagnes de Maltratta.—L'Infernillo.
À Boca del Monte, 18 soldats quittent le train pour rentrer à Vera-Cruz; 18 autres, venus de Mexico, prennent leur place: c'est l'escorte journalière. Les trains portent souvent de l'argent, soit qu'il provienne des droits de douane à Vera-Cruz, soit qu'il vienne des mines et prenne le chemin de l'Europe.
Malgré les précautions, le trésor n'a pas toujours pu être préservé. Parfois une entente entre les brigands et des employés du train a fait détacher au départ le wagon contenant l'argent: il est ainsi resté sur la voie, proie facile aux voleurs. Une autre fois, c'est un intrépide qui avait cloué un filet sous le wagon, et de là pendant la marche il put couper les planches, pénétrer dans le wagon et enlever les caisses d'or.
Dans les gares, nous trouvons des gendarmes campagnards. Ils portent un vêtement gris, grand chapeau de feutre, carabine, sabre, revolver, et aux reins une ceinture garnie de cartouches en forme d'ornements. Leur selle est toujours armée du lazo traditionnel. On les prendrait pour de redoutables brigands.
La plaine est couverte de fèves, de maïs et d'aloès. Plusieurs laissent pousser la tige de leur fleur, semblable à une immense asperge.
On voit par-ci par-là les vastes constructions des haciendas, et les petits ranchos en terre des cultivateurs. Ils ne pourraient être plus misérables. Enfin le train arrive (p. 100) à San-Juan de Teotihuacan. Là existe encore une de ces grandes pyramides en briques d'adobe, sur lesquelles les Indiens élevaient le petit temple où ils immolaient les prisonniers de guerre. Nous passons aussi près du sanctuaire de Guadalupe, mais la nuit ne nous permet pas de l'apercevoir. À 8 heures, nous entrons en gare de Mexico. La douane ne se contente pas de la visite faite au débarquement; à Vera-Cruz; elle visite encore une fois sommairement les effets. Une voiture me conduit à l'hôtel qu'on m'avait indiqué comme le meilleur. Les chambres sont vastes et bien meublées, mais la propreté laisse à désirer. J'en visite un autre, et y trouve de mauvaises odeurs; idem dans un troisième et un quatrième. Enfin, à 11 heures du soir, je trouve une chambre propre à l'hôtel Guardiola, remis à neuf.
Le 30 septembre, jour de dimanche, le travail est suspendu, les magasins sont fermés; seuls, ceux des Français sont ouverts. Tout le monde est endimanché. Les Indiennes couvrent leur tête d'un châle et en rejettent les bouts en arrière en guise de manta. Les señores portent leur costume national: grand et lourd chapeau de feutre conique à larges bords, garnis de glands et de galons d'or et d'argent; veste en velours et boutons d'argent, pantalons ayant en guise de passepoil une rangée de boutons d'argent. Les señoras ornent leur tête d'un voile noir semblable au pezote des dames génoises.
La rareté de l'air à l'altitude de 2,300 mètres rend la respiration difficile. Je monte avec peine les escaliers.
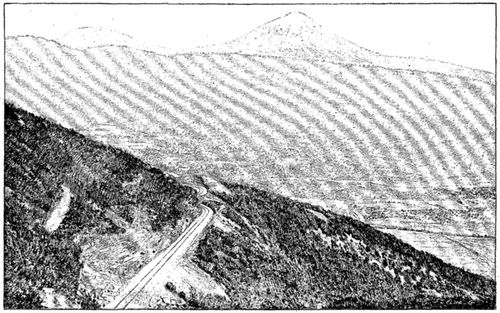
Mexique.—Chemin de fer de Vera-Cruz à Mexico.—Maltratta.—Le Citlaltepelt.
(p. 101) La cathédrale occupe l'emplacement de l'ancien grand temple indien. Ses 3 nefs sont séparées par des colonnes en style ionique. La coupole est ornée de fresques, le maître-autel consiste en une haute pyramide surchargée d'ornements.
Le chœur, dans la nef du centre, clôturé par des balustres en bronze doré, prend une grande partie de l'église. Cette disposition, fort commode pour les officiants, l'est très peu pour les fidèles. Pas de chaises: les dames portent un pliant, le peuple s'assied par terre.
La construction de cet édifice a duré un siècle, et a coûté 10,000,000 de francs. Attenante à la cathédrale est une autre église, avec laquelle elle communique. On y voit un tableau de la sainte Trinité, dans lequel les figures des 3 personnes sont identiques. Ce tableau se rencontre dans presque toutes les églises du Mexique. Cette seconde église est en style espagnol, surchargé de sculptures sur la façade et à l'intérieur. Les deux églises sont remplies de fidèles qui assistent dévotement à la messe.
La cathédrale occupe un des côtés de la place principale ou plaza de Arme. De l'autre côté s'élève le palais du gouvernement. C'est là que reçoit le président de la République. Le Sénat y tient ses séances, et dans les dépendances il y a les ministères, le musée, la Monnaie et la poste. Sur la place, joue la musique d'un régiment. Ces bons Indiens exécutent fort bien les symphonies espagnoles et les marches italiennes. En ville, les rues sont larges de 16 mètres environ et se coupent à angle droit. (p. 102) Elles changent ordinairement de nom à chaque quadra ou bloc. La propreté laisse à désirer. Les maisons sont en pierre ou en briques et à un ou deux étages avec patio, et quelques-unes sont fort jolies.
La ville s'étend sur un espace assez grand, et compte environ 200,000 habitants.
Dans l'après-midi, je parcours l'Alameda. Cette promenade ombragée se trouve dans toutes les villes de race espagnole. Sur tous les murs on voit de grandes affiches invitant les habitants à la corrida de toros. Aujourd'hui ce sont des amateurs, des étudiants en médecine qui tueront les toros, et les demoiselles de la ville couronneront les vainqueurs. Comment s'étonner qu'une population habituée à de pareils spectacles tombe dans la cruauté! Dans la rue, deux enfants, un de 10 ans et un de 11 ans, s'étaient pris de querelle et se battaient avec férocité. Pensez-vous que la foule se soit souciée de les séparer? Au contraire, elle prenait plaisir à les agacer, et n'a été contente que lorsqu'elle les a vus couverts de sang. Le sang, c'est son émotion de prédilection. Il ne faut pas s'étonner non plus si les querelles se vident souvent par des combats mortels. Le duel est au poignard, et les deux combattants succombent presque toujours au même instant.

Mexique.—Pulchero absorbant l'agua-miel pour faire le pulche.
Une autre plaie des nations de race espagnole est la loterie. Loterie d'État, loteries particulières, par l'appât du gain, dépouillent le pauvre peuple des quelques sous nécessaires à son existence. Rien d'étonnant alors que la (p. 103) mortalité excède les naissances, et que les 16,000,000 d'Indiens qui peuplaient le pays avant la conquête soient maintenant réduits à moins de 10,000,000.
Au Paseo, promenade publique, je remarque une belle statue équestre en bronze, et plus loin, la statue colossale de Christophe Colomb. Elle est flanquée de 4 moines assis aux angles du piédestal. La musique militaire joue sous un kiosque ses plus belles marches. Sous les allées d'eucalyptus défilent les landaus et les calèches, où s'étalent les riches toilettes des señoras et des señoritas mexicaines. Les cavaliers caracolent à leurs côtés. Leurs selles remontent sur le devant en un large pommeau, et en arrière forment un petit dossier. Elles sont posées sur une peau de chèvre, qui pend des deux côtés sur la croupe du cheval. Les rênes sont ornées d'argent; le mors est en argent massif, ainsi que les étriers. Ceux-ci sont garnis d'un cuir qui couvre le soulier, l'abrite de la pluie, et, en cas de chute, empêche le pied d'être pris. Les éperons, en argent massif, sont semblables à ceux des cavaliers du moyen âge. La promenade se prolonge fort loin, jusqu'au Castillo de Chapultepec. À gauche s'élève le volcan d'Ameca, actuellement éteint. Je rentre en ville, et finis ma journée par une visite au P. Mariscal, supérieur des Lazaristes.[Table des matières]

Mexique.—Propriétaires en costume national.
Excursion à Guadalupe. — Les faubourgs. — L'armée. — Le sanctuaire. — Les œuvres charitables. — L'administration ecclésiastique. — Les banques. — Le musée. — La pierre du Soleil. — La déesse de la terre Coatlicue. — Le dieu des morts Mictlanteuhtli. — Les pierres à jeu de paume. — Les chevaliers aigle et le messager du Soleil. — Quetzalcoalt, ou le sage mystérieux. — Les inscriptions. — Les urnes funéraires. — Les vierges ou prêtresses. — Manière de marquer le temps. — Le cycle ou xinhmopillé. — Chalchinhtlicue, déesse de l'eau. — Tlaloc, dieu du tonnerre. — La céramique. — Les bijoux. — L'écriture. — Le Sénat. — Le Conservatoire.
Le lendemain, à la pointe du jour, je me dirige vers la plaza de Arme, à la recherche du tramway pour Guadalupe. C'est de cette place que partent les voitures pour toutes les directions. Il y en a de 2 classes, qu'on distingue à la couleur: dans les unes, on paie un réal (12 sous); dans les autres, la moitié de ce prix.
À mesure qu'on s'éloigne du centre de la ville les rues sont moins propres, et les maisons en adobe. Ce sont les quartiers du bas peuple. Quelques rues ne sont pas pavées. Les églises abondent et les pulcherias aussi. Les porteurs d'eau ont deux seaux au bout d'un bâton, comme à Venise; mais le plus souvent ils portent sur le dos et sur la poitrine deux amphores en terre, suspendues à la tête au moyen d'une large courroie de cuir. Les femmes portent sur l'épaule ou sur la tête ces amphores (p. 106) de forme romaine, rondes ou longues, qui ne peuvent par elles-mêmes tenir debout. Devant les casernes, je vois de nombreuses femmes portant la nourriture aux soldats leurs maris. Il n'y a pas de conscription au Mexique: le recrutement se fait dans la rue. La police prend et enrôle de force les sujets qui lui semblent bons; et ces pauvres Indiens, mariés ou non, se trouvent tout à coup soldats sans y penser. Rien d'étonnant qu'en cas de guerre il faille une armée pour garder de tels soldats. En campagne, les femmes précèdent les troupes et préparent la nourriture de leurs maris.
Il en est autrement du corps des volontaires, qui s'équipent à leurs frais. Le soldat reçoit de 2 à 3 réaux par jour; le colonel, 270 piastres par mois; le commandant, 125; le capitaine, 70; le lieutenant, 60 piastres par mois.

Mexique.—Porteur d'eau.
Au sortir de la ville, je vois un champ de courses, puis des terrains marécageux. Par-ci par-là des animaux paissent tranquillement. Plus loin, quelques champs de maïs et d'orge. Enfin, après trois quarts d'heure de route sous une allée de poivriers, le tramway arrive au village de Guadalupe, que domine son sanctuaire renommé. La tradition rapporte qu'en décembre 1531, la sainte Vierge apparut quatre fois, dans le Cerro (colline) de Tepeyac, à un Indien appelé Juan Diego, et laissa son image imprimée sur son manteau. De nombreux miracles attirèrent bientôt la foule des Indiens vers cette image. En 1533, elle fut solennellement transportée à Guadalupe, à l'endroit qu'elle occupe actuellement. Un temple somptueux (p. 107) lui a été élevé. L'extérieur de cet immense édifice, avec ses cloches et sa coupole, est par trop massif; mais l'intérieur, en style corinthien, est de meilleur goût. On y voit quelques beaux tableaux et beaucoup de laides statues. Les ornements, blanc et or, sont d'un bel effet. L'image miraculeuse, au maître-autel, est sur fond jaune répandant des rayons d'or. La sainte Vierge, de grandeur naturelle, debout sur une demi-lune que supporte un ange, tient les mains jointes. Sa robe est rouge, son manteau bleu est parsemé d'étoiles d'or. Elle porte sur la tête une couronne d'or. Le regard est bienveillant; l'attitude, celle de la prière. Dans l'église, le chœur a la même disposition que celui de la cathédrale de Mexico, et occupe un grand espace. Les balustrades qui le séparent du public sont en argent massif. Lors de la spoliation de l'église, le gouvernement voulut les enlever; mais les Indiens menacèrent de prendre les armes, car ils aiment leur cher sanctuaire. Je les ai vus en effet, arrivant de toute part, priant avec dévotion sur le pavé de l'église et s'en retournant en famille après leur pèlerinage. Les nombreux ex-voto suspendus aux murs du temple indiquent qu'ici, comme ailleurs, la Mère des miséricordes se plaît, par son intercession, à préserver des dangers et à répandre le baume de la consolation dans les cœurs éprouvés. Ici ce sont des gens sauvés d'un naufrage; là, d'autres échappent à un incendie; plusieurs, dans des chutes dangereuses, n'éprouvent aucun mal; un grand nombre reviennent d'une maladie mortelle. Ces tableaux ne brillent pas (p. 108) par le côté artistique, ils sont parfois assez grotesques; mais, dans leur simplicité, ils disent bien la foi naïve et la reconnaissance intime de ceux qui les ont déposés.
Après mon pèlerinage, je me rends à un établissement de bains ferrugineux, situé près du village. L'eau est pompée au moyen de l'air chauffé.
Rentré en ville, je rends visite à M. Jésus Urpiaga, qui me renseigne sur les œuvres charitables du pays. Il n'est pas rare, dans les contrées de race espagnole, de trouver chez les hommes le nom de Jésus, comme on trouve chez les femmes celui d'Incarnacion, de Concepcion, d'Annonciacion, d'Assompcion, etc. Il y a quatorze Conférences de Saint-Vincent de Paul à Mexico, et une soixantaine dans la république. Elles comprennent ensemble un millier de membres actifs, 500 honoraires, secourent un millier de familles pauvres, visitent les prisons, catéchisent les enfants, réhabilitent les unions illicites, ensevelissent les cadavres, ouvrent des écoles et recueillent des orphelins. Ils pratiquent ainsi l'essence de la religion, qui se réduit à ceci: Aimez-vous les uns les autres; faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fît pour vous. Les jeunes gens ont leur cercle catholique, leur bibliothèque, et une petite imprimerie avec leur journal. Sous le rapport religieux, le Mexique est divisé en 20 diocèses; mais le clergé est insuffisant. Les prêtres disent souvent quatre à cinq messes par jour. Le dimanche, les curés s'en vont de village en village, et reçoivent pour chaque messe une aumône de cinq piastres.
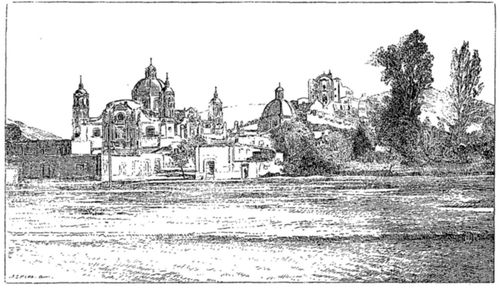
Mexique.—Sanctuaire et faubourg de Guadalupe.
(p. 109) Il y a quelques années, les biens de l'Église, qui étaient très importants, furent séquestrés, et les Communautés chassées. N'ayant su résister aux dangers de la richesse, elles s'opposaient aux réformes que réclamait le Saint-Siège.
Plus tard, les Sœurs de Charité aussi ont été renvoyées, en haine de la France. Notre funeste expédition n'avait pas suscité les sympathies du pays à notre égard. Mais les Sœurs de Charité ont emporté les regrets unanimes de la population. Elles faisaient ici ce qu'elles font partout: les œuvres charitables, avec simplicité et abnégation.
Outre les retraites et exercices spirituels, assez fréquents dans ce pays, j'ai remarqué une dévotion fort longue, qui consiste en exercices journaliers et prédications à l'église durant 36 jours. Ces exercices sont appelés el Desagravio, et ne peuvent servir qu'aux désœuvrés.
Dans l'après-midi, je fais ma visite aux banques. Jusqu'au jour où l'on aura unifié les monnaies, le voyageur est obligé de changer ses valeurs dans chaque pays. Il y a deux banques ici: une anglaise, la London Bank of Mexico and south America; l'autre, française, sous le nom de Banco méridional de Mexico. Cette dernière, de création récente, est sortie d'un traité passé entre le gouvernement mexicain et la banque franco-égyptienne.
Le capital social est de 6,000,000 de piastres, avec faculté de le porter à 20,000,000. La banque pourra commencer ses opérations avec 3,000,000 de piastres. Pour chaque million de piastres en caisse, elle est autorisée à (p. 110) émettre 3,000,000 de billets. La concession est pour 30 ans. La banque est obligée d'ouvrir au gouvernement un compte courant, dont l'intérêt ne pourra être moindre de 4% ni supérieur à 6% l'an. Le gouvernement, pour toutes ses opérations de banque, s'oblige, à conditions égales, à donner la préférence à la banque nationale. Le capital de la banque doit être exempt de tout impôt.
Elle prête et escompte avec un intérêt d'environ 1% par mois.
Le National Monte de Piedad, qui prête sur gages au taux de 1% par mois, est, lui aussi, autorisé à émettre des billets et à faire des opérations de banque.
Les journaux parlent d'un emprunt de 10,000,000 de piastres que le gouvernement se propose d'émettre aux États-Unis. L'intérêt serait de 9%, et l'émission à 80 fr., ce qui porterait l'intérêt à 13%. Un pays qui ne peut emprunter qu'à ce taux inspire peu de confiance, et n'évite la ruine que par la banqueroute.
M. l'abbé Hély veut bien me conduire au musée et se faire mon cicérone. Il est précepteur d'un jeune garçon dans une famille mexicaine. Il me présente son élève, qui, selon lui, n'avance pas assez rapidement dans les sciences; mais de la conversation que nous avons ensemble, je relève qu'il sait parfaitement ce qu'on paie chaque ouvrier dans ses diverses fermes, et les attributions de chacun: j'en conclus que, s'il n'a pas assez l'esprit scientifique, il a certainement l'esprit pratique.

Mexique.—Antiquités aztèques.—Calendrier.
Chemin faisant, M. l'abbé Hély me fait remarquer un (p. 111) immense disque en pierre, adossé à l'une des tours de la cathédrale. Son diamètre est de 3m35. Il fut découvert le 17 décembre 1790, en nivelant la place, et sera prochainement transporté au musée. Le baron de Humboldt calcule son poids à 24,400 kilogrammes. Comme, à plus de dix lieues à la ronde, on ne trouve point du porphyre dont il est formé, il faut supposer que les Aztèques ont eu des moyens mécaniques pour transporter de si loin un aussi grand poids. Les opinions sont divisées à son sujet. On ne sait donner d'explication bien nette aux nombreuses (p. 112) sculptures qui le couvrent. Les uns l'appellent un calendrier aztèque. Ils croient qu'il servait de cadran, et qu'il marquait, pour les prêtres, les jours de fête et de sacrifice. D'autres observent, que les éléments pour marquer le temps font défaut, et l'appellent pierre du soleil, croyant qu'il fut simplement un monument votif en l'honneur du soleil.
La cour du musée est garnie de dattiers. Au rez-de-chaussée, on fait des réparations: une quantité d'objets précieux sont entassés sans ordre, attendant d'être transportés dans les nouvelles salles. Je remarque une statue en pierre, de 2m57, découverte en 1790 sur la plaza mayor. La poitrine est celle d'une femme; son jupon est composé de couleuvres; elle a autour du cou un collier de mains et de bourses, qui renfermaient le copal qu'on offrait aux dieux. À la ceinture pend un crâne humain par devant, et un autre par derrière. Selon les uns, cette statue représente la déesse Teoyomiqui, qui recueillait les âmes des guerriers morts dans les batailles. On supposait que ces guerriers allaient au ciel habiter la maison du soleil, et qu'après quelques années ils se transformaient en colibris. D'autres pensent que cette statue représente la déesse Terre ou Coatlicue, et en donnent plusieurs raisons.
Un disque de basalte, de 1m20 de diamètre, porte sculptée l'image de Mictlanteuhtli, dieu des morts. Il porte des crânes humains. Les Aztèques appelaient mictlan l'endroit où se rendaient les défunts qui mouraient de mort naturelle. Mictlanteuhtli en était le seigneur, (p. 113) et sa femme s'appelait Mictecacihualt; ce qui correspond au Pluton et à la Proserpine des Grecs et des Romains. Les Mexicains se figuraient que cet endroit lugubre était situé au centre de la terre, et l'appelaient Tlaxico: ce qui signifie ombilic ou centre de la terre. Après la conquête, les Espagnols firent de ce disque une meule de moulin.
On remarque aussi 2 disques en pierre, de 90 et 81 centimètres de diamètre, avec un trou au milieu. Ces pierres servaient au jeu de paume. Les parties s'organisaient deux contre deux, ou trois contre trois. Les joueurs nus ne portaient que le maxtlatl, large bande à la ceinture. L'endroit où ils jouaient s'appelait Tlachco. La paume était en résine élastique, et les joueurs ne pouvaient la toucher qu'avec les muscles ou le coude; s'ils la touchaient avec la main, le pied ou la jambe, ils perdaient un point. Le joueur qui jetait la balle jusqu'au mur opposé gagnait un point; s'il parvenait à la faire passer par le trou du disque en pierre qui se trouvait au milieu du jeu, non seulement il gagnait la partie, mais il gagnait encore les vêtements de tous ceux qui étaient présents. Les rois jouaient aussi, et se défiaient, comme firent Montézuma II et Nazahualpilli. Plusieurs localités étaient tenues à un tribut annuel de pelotes, comme Tochtepec et Otatitlan. Le nombre atteignait jusqu'à 1,600: ce qui prouve combien ce jeu était répandu.
Un cylindre en pierre, de 8m28 de circonférence et 0m84 d'épaisseur, connu sous le nom de pierre du sacrifice, (p. 114) est le Cuanhxicalli de Tizoc. Il porte au centre l'image du soleil, auquel il était dédié. Sur la surface convexe du cylindre, on voit cinq groupes de deux personnes, représentant un même guerrier vainqueur, qui soumet, en les tenant par les cheveux, divers prisonniers représentant les peuples vaincus. Ce guerrier est Tizoc, septième roi du Mexique, qui régna de 1481 à 1486.
Au Mexique, un ordre de nobles, qui avaient pour patron le soleil, s'appelaient les chevaliers aigle.
À certains jours de fête, ils sacrifiaient sur cette pierre une victime humaine, qu'ils appelaient le messager du Soleil. Je traduis du P. Durand[3] les détails de ce sacrifice.
«Au son des instruments, ils amenaient un prisonnier de guerre, entouré de grands personnages. Il avait les jambes rayées de blanc, et la moitié de la figure peinte en rouge. Ses cheveux étaient ornés de plumes blanches. Il tenait d'une main un joli bâton garni de plumes; de l'autre, il portait une pierre au bout d'une corde, avec cinq plumets de coton. Sur le côté, il tenait un panier dans lequel étaient des plumes d'aigle, des morceaux d'ocre, des morceaux de plâtre, des morceaux de sapin résineux pour la lumière, des papiers, de la toile cirée. Toutes ces bagatelles, que portait le prisonnier, étaient ensuite déposées au pied de l'escalier du temple; et là, à voix haute entendue de tout le peuple, on lui disait: (p. 115) «Nous te prions d'aller devant le Soleil notre Dieu, de le saluer de notre part, et de lui dire que ses enfants les chevaliers ici présents le supplient de se souvenir d'eux. Qu'il daigne les combler de ses faveurs, qu'il reçoive ce petit présent que nous lui envoyons. Tu lui donneras ce bâton pour qu'il marche, cette pierre avec sa corde pour qu'il se défende, et tout le reste qui est dans le panier.» L'Indien, après avoir entendu cette ambassade, répondait qu'il l'agréait. Alors on le déliait, et il commençait à gravir les escaliers de la pyramide, au sommet de laquelle était le temple. Il faisait une longue pause à chaque marche. Arrivé au sommet, il montait sur la pierre Cuanhxicalli, qui portait gravées au centre les armes du Soleil. Là, tourné vers l'image du Soleil qui était dans le temple et de temps en temps vers le vrai soleil, il répétait son ambassade. Lorsqu'il achevait, 4 ministres du sacrifice montaient par 4 escaliers vers la pierre, lui enlevaient le bâton, la pierre au bout de la corde et le panier, et le prenaient par les pieds et par les mains. Alors le sacrificateur principal, avec son couteau, l'égorgeait, lui imposant d'aller avec son ambassade au soleil véritable, dans l'autre vie. Le sang coulait dans le bassin sur la pierre, et se répandait sur les armes du Soleil. À peine le sang avait-il cessé de couler, qu'on lui ouvrait la poitrine, et on arrachait le cœur, qu'on présentait au soleil, tenant la main levée jusqu'à ce que le pauvre prisonnier fût devenu froid. Telle était la fin du malheureux messager du Soleil.»
(p. 116) On voit aussi diverses autres statues et urnes. Une des pièces les plus curieuses est la couleuvre avec plumes. On croit qu'elle représente Quetzalcoatl, le dieu de l'air, dont le nom se compose de deux paroles mexicaines: quetzalli (plume fine) et coatl (couleuvre). Figurativement, quetzalcoatl (couleuvre avec plumes fines) s'applique à une personne recommandable par ses mérites. Selon les uns, ce personnage mystérieux est la planète Vénus; selon les autres, c'est cet homme blanc et barbu, vêtu d'une soutane couverte de croix. Nous avons dit que l'histoire toltèque l'enregistre comme ayant apparu chez eux, leur prêchant une religion nouvelle, l'amour du travail, le respect de la Divinité et la pratique de plusieurs autres vertus. Il leur enseigna à travailler les métaux et les pierres précieuses, leur montra les améliorations dans l'agriculture, et corrigea leur calendrier, leur enseignant à mieux compter le temps. Il leur prédit l'arrivée d'hommes blancs et barbus comme lui, qui se rendraient maîtres du royaume et détruiraient le culte ancien pour le remplacer par un semblable à celui qu'il leur prêchait. Cet homme extraordinaire fut déifié; il eut à Tula un temple somptueux, et, dans le Yucatan, on l'adora sous le nom de Kukulcan. À cause de ses connaissances astronomiques, il fut identifié avec la planète Vénus, et enfin il prit place dans l'Olympe azteca, comme dieu du vent.
Plusieurs ont cru voir saint Thomas dans ce Quetzalcoatl; mais, comme il a apparu vers le Xe siècle, d'autres pensent que c'était un missionnaire islandais. En tout (p. 117) cas, sa prédiction, très répandue au Mexique, contribua beaucoup, comme je l'ai déjà dit, à faciliter la conquête de ce pays aux envahisseurs espagnols. Ce fait prouve aussi combien Dieu, à travers les siècles, a eu souci de tous les peuples, en leur envoyant en temps opportun des sages ou des missionnaires, pour maintenir vivant le flambeau de la vérité. Les Juifs, qui par leur génie commercial étaient répandus sur tous les points du globe, portaient partout avec eux la vérité consignée dans leurs livres sacrés. Au surplus, les Chinois eurent un Confucius; les Persans, un Zoroastre; les Grecs, un Socrate; les Romains, un Cicéron. Les Américains du Nord et du Sud eurent aussi leur sage mystérieux, que mentionne l'histoire du Mexique et du Pérou.
Parmi les nombreuses statues en pierre, on en voit quelques-unes qui représentent des individus offrant des sacrifices, revêtus de la peau d'une victime humaine: preuve nouvelle de la vivacité de la tradition concernant la chute de l'humanité, la nécessité d'une réparation et le rachat par le sang d'une noble victime.
Nombreuses sont les sculptures de serpents. La plupart ont la figure d'une femme: ce qui ajoute encore aux traditions concernant les circonstances de la chute primitive. On voit aussi une croix en basalte, de 0m95 de haut et de 0m80 de large. Les premiers missionnaires qui pénétrèrent dans le pays affirment qu'ils y trouvèrent partout la croix en grande vénération. Parmi les nombreuses inscriptions, une rappelle une grande famine qui (p. 118) eut lieu de 1452 à 1434; une autre, l'achèvement du grand temple du Soleil, en 1487. Ces hiéroglyphes indiquent que Tizoc en prépara les matériaux et qu'Ahuitzolt en acheva la construction. Celui-ci, à l'occasion de sa dédicace, sacrifia 60,000 prisonniers de guerre. Son nom reste encore dans le pays comme synonyme de cruel et de méchant.
Les urnes funéraires sont de plusieurs dimensions, selon qu'elles devaient recevoir le corps entier, ou le crâne, ou les cendres. Elles portent presque toutes un hiéroglyphe, qui indique la date de la mort et le nom de la personne qu'elle renferme. Sur le couvercle on voit la figure de Mictlanteuhtli, seigneur chargé de recueillir les âmes des morts.
On peut remarquer les sculptures de quelques prêtresses ou religieuses. Elles faisaient des vœux temporaires ou perpétuels, et se vouaient au jeûne et à la pénitence. Elles demeuraient dans les annexes du temple. Toute faute contre l'honnêteté était punie de mort. Lorsqu'elles se présentaient pour être admises, on leur coupait les cheveux. Elles dormaient habillées, par modestie et pour être prêtes au travail. Ce travail, adapté à leur sexe, avait lieu dans de grandes salles. Elles gardaient le silence et tenaient les yeux baissés. Dans certaines fêtes, elles suspendaient le jeûne et mangeaient de la viande. Elles assistaient aux danses religieuses. À cette occasion, elles ornaient de plumes leurs pieds et leurs mains, et peignaient leur visage avec du fard. En temps de pénitence, (p. 119) elles se piquaient les oreilles, se peignaient la face avec le sang qui en sortait, et se lavaient dans un étang spécial.
Une pièce représente les quatre mouvements du soleil, ou les quatre saisons. Les prêtres mexicains, du haut de leurs pyramides, observaient les astres, et spécialement le soleil. Ils indiquaient les jours de fête et les heures du jour et de la nuit, et les annonçaient avec des instruments entendus à de grandes distances. Les quatre saisons étaient représentées par une croix formée avec des ailes de moulin à vent.
Un cylindre en basalte, de 0m41 de longueur et 0m16 de diamètre, représente le cycle mexicain. Les Aztèques avaient divisé le jour en plusieurs parties correspondant à nos heures. Leurs semaines étaient de cinq jours. Chaque cinq jours ils faisaient une fête. Quatre semaines formaient un mois de 20 jours, et 18 mois comprenaient 360 jours, auxquels ils en ajoutaient 5 pour former l'année entière. Le cycle ou siècle comprenait 52 ans. Le cylindre dont nous parlons représente un faisceau de cannes liées par des cordes, et signifie un cycle, dont le nom mexicain est xinhmolpillé, ou réunions d'années.
La fête principale des Aztèques était celle qu'on faisait le premier jour du siècle. Ils croyaient en effet qu'à la fin du cycle, le monde devait finir, et ils passaient la dernière nuit dans l'attente et la crainte. Ils rompaient leurs meubles et leurs bijoux, qu'ils croyaient désormais inutiles. (p. 120) Ils formaient une immense procession, que les prêtres conduisaient au mont d'Ixtapalapa, près de Mexico. À son sommet, sur la poitrine d'un prisonnier de guerre qu'ils sacrifiaient, ils frottaient l'une contre l'autre deux branches de bois sec pour allumer le feu nouveau qu'ils envoyaient à tous les temples, à toutes les maisons. On croyait ainsi que le monde allait durer un autre siècle, et ils se livraient durant plusieurs jours à des réjouissances publiques.
Parmi les nombreuses idoles et animaux mythologiques, on peut remarquer une déesse de l'eau, sculpture en pierre, haute de 1m45 et large de 0m75. Les Mexicains l'appelaient Chalchinhtlicue, et appelaient Tlaloc le dieu des éclairs et du tonnerre. Dans certains jours de fête, pour le rendre propice aux champs, on lui sacrifiait de petits enfants sur les monts ou près des lacs. Le dieu Chac-Moël est représenté dans la figure d'un grand sphinx, qui rappelle ceux de l'Égypte: preuve évidente, qu'à une époque donnée, il y a eu communication entre ces populations et celles des bords du Nil.
À l'étage supérieur, on voit les portraits de tous les vice-rois depuis la conquête; plusieurs objets ayant appartenu à don Miguel Hidalgo y Castilla, auteur de l'indépendance mexicaine; l'étendard de la conquête, que Cortez donna au capitaine général des Tlaxcatelcas, dans sa deuxième expédition contre Mexico; les héros de l'indépendance mexicaine; le portrait de Fernand Cortez; 176 pièces en christophle, ayant composé la vaisselle de (p. 121) l'empereur Maximilien; ses décorations, des armes indiennes, des armes ayant appartenu aux premiers Espagnols conquérants, etc.
Dans la collection des idoles trouvées dans les tombeaux du Yucatan, on remarque une différence sérieuse entre elles et celles des Aztecas: ce qui prouverait une différence entre les deux civilisations.

Mexique.—Antiquités aztèques.—Statue de Chac-Moël.
Parmi les objets en terre cuite, plusieurs rappellent, par leur forme, la céramique des Romains et des Étrusques. On voit des miroirs en obsidiana, espèce de verre; des bijoux d'or, d'argent et de cuivre, d'un goût parfait; des masques en bois, destinés à servir aux dieux ou aux défunts; des empreintes pour imprimer l'étoffe, semblables à celles des Chinois; des pipes à fumer, indiquant chez ces peuples l'usage du tabac; des ornements et amulettes (p. 122) en cristal de roche et autres pierres dures; des instruments de musique en forme de tambour; des armes en bois, en pierre, en os; des papiers en fibres d'aloès, en peaux, en tissus, sur lesquels divers hiéroglyphes traitent d'histoire, de géographie, de religion.
Les Mexicains ne connaissaient pas l'alphabet, et y suppléaient par des signes hiéroglyphiques: pour indiquer une conférence, ils plaçaient divers personnages avec la bouche ouverte et des langues tombant de la bouche: pour indiquer une direction, ils plaçaient une suite de pieds, etc. Ils faisaient aussi des plans ou mappes, et on voit un dessin de la ville de Mexico au milieu de la lagune.
Le musée de Mexico est excessivement intéressant: on peut y passer de longues heures sans se fatiguer. Les détails que je viens de donner sont extraits du petit catalogue qu'on vend à la porte.
À côté du musée historique, il y a un assez joli musée d'histoire naturelle.
Au Sénat, la salle est simple: les fauteuils sont en ébène et jonc. Les sénateurs s'y tiennent couverts et fument. Il y a deux tribunes: gauche et droite.
La Chambre des députés est dans un autre quartier de la ville. L'abbé Hély me fait visiter aussi le Conservatoire de musique, dirigé par un Français, M. Roblet. Il est installé dans l'ancienne université des pères jésuites. Le directeur a remis en honneur les belles sculptures en pierre qu'on avait recouvertes de plâtre.[Table des matières]
État pitoyable des logements du peuple. — Moyens d'y remédier. — Couper le mal à la racine vaut mieux que soigner les plaies. — La ferme de Tacubaja. — La foire. — La forêt de Chapultepec. — Le ministre de fomento. — L'Observatoire. — Le ministre du Chili. — Le ministre de France. — La colonie française. — Les Basques et les Barcelonnettes. — La chambre de commerce. — Les colonies de Chacaltepec et de Saint-Raphaël, et les théories fouriéristes.
Le 3 octobre, dans la matinée, M. Emmanuel Amour, jeune Mexicain élevé à Londres, vient me prendre à l'hôtel pour me conduire chez quelques familles pauvres. Ce n'est pas connaître un pays que de n'y voir que les grands; il faut savoir aussi comment vit le peuple, et aller le voir chez lui. Nous arrivons d'abord chez un brave homme qui tombe du mal caduc. Deux chambres pour lui, sa femme et ses nombreux enfants; les fenêtres donnent dans une cour, où la propreté laisse à désirer. L'escalier est un casse-cou, et le malheureux locataire est au lit pour l'avoir dégringolé. Un tel logement se paie 10 piastres (50 fr.) par mois.
Plus loin, nous entrons chez une pauvre veuve, qui vient d'envoyer à l'école ses nombreux enfants. Elle est aussi dans une cour et au rez-de-chaussée. Sa demeure se compose de deux chambres non pavées; les exhalaisons (p. 124) qui sortent de la bouche d'égout dans la cour la rendent infecte. Elle paie 8 piastres (40 fr.) par mois.
Dans un autre quartier, nous pénétrons dans une espèce de cité ouvrière. C'est une ruelle bordée de deux constructions en adobe à un seul rez-de-chaussée, et divisées en chambres ayant chacune une porte et une fenêtre. Chaque chambre sert à une famille entière. Faute de pavé, on étend par terre une vieille natte. La famille que nous visitons paie 6 piastres (30 fr.) par mois. Il est impossible que les familles conservent la santé et la moralité dans ces conditions. Le logement a une sérieuse influence sur ces deux grandes choses. Les peuples chez lesquels l'ouvrier a sa maison pourvue d'air et de lumière, et assez vaste pour permettre la séparation des parents et des enfants des deux sexes, ont une bien moins grande mortalité. Or les hommes sont le premier et le plus essentiel capital d'un peuple. Les gouvernements qui savent les faire vivre enrichissent le pays.
Quelle aberration de dépenser des millions pour aller, à grands frais, chercher en Europe quelques milliers d'émigrants, et de laisser mourir les centaines de mille enfants qui naissent dans le pays! Ne serait-il pas préférable de favoriser l'élan vers les sentiments humanitaires de la classe qui possède? Il faudrait aussi susciter des compagnies qui, comme les building societies de l'Amérique, construiraient pour les familles du peuple des logements sains. Elles en deviendraient propriétaires après un certain nombre d'années, moyennant une redevance (p. 125) mensuelle représentant l'intérêt et l'amortissement. Si les municipalités donnaient pour cela les terrains disponibles, chaque famille pourrait, au bout de 10 ans, posséder sa maison indépendante, composée de 4 à 5 pièces, avec cour et jardin, eau et lumière. L'intérêt et l'amortissement ne dépasseraient pas la moitié du loyer qu'elles paient maintenant: car les constructions en adobe ne sont pas chères.
Bien entendu qu'il faudrait que les lois permissent au père de laisser au plus digne de ses enfants ce foyer péniblement acquis, pour qu'il y conserve les traditions de la famille. Une liquidation forcée, qui, à la mort du père, obligerait les enfants à vendre la maison pour s'en partager les deniers, détruirait l'effet de la mesure.
M. Amour me conduit encore dans une proveeduria, cuisine économique où les familles pauvres visitées par sa Conférence viennent chercher la nourriture journalière. À côté de la cuisine, une école gratuite, dont la Conférence fait les frais, reçoit les petits garçons et les petites filles de ces familles. La charité catholique est très ingénieuse à panser les plaies qu'elle rencontre. Combien de peine et d'argent on s'épargnerait, si l'on était aussi ingénieux à remonter aux causes et à couper le mal à la racine! Ainsi, combien de malades de moins à soigner et de malheureux à secourir, par le simple assainissement des logements des familles du peuple!
M. Amour me présente à sa famille, qui a passé un hiver à Nice et se propose d'y revenir. Elle me fait bon (p. 126) accueil et me reçoit à sa table. Dans l'après-midi, il me conduit à quelques milles de distance, à Tacubaia, visiter une ferme appartenant à l'un de ses parents. Elle comprend une surface de 10 caballerias 1/2 (la caballeria équivaut environ à 16 hectares).
La maison a un seul rez-de-chaussée. Elle est entourée d'un superbe parc. Ses nombreuses pièces peuvent loger grandement toute une famille. La ferme nourrit 300 vaches, dont le lait se vend à Mexico environ 30 centimes le litre. On sème aussi du blé, du maïs, de l'avoine, des haricots, et l'on fait du pulche.
On emploie la charrue de bois et la charrue américaine. Je vois aussi diverses machines à nettoyer le blé. Le blé ne donne que 8 à 10%; mais, dans certaines vallées, comme la vallée San-Martino, près Puebla, il rapporte de 20 à 40%. Chaque plant d'aloès, appelé maguei dans le pays, rapporte par jour, durant trois mois, 3 litres de pulche, qu'on vend 1 réal le litre (60 centimes). La qualité fine vient des jeunes plantes de 4 à 5 ans, que l'on appelle maguei manzo. La deuxième qualité provient du maguei tlacique. Vingt-quatre hommes suffisent à travailler cette ferme. On y fait aussi des briques d'adobe et des briques cuites. Les familles des travailleurs, ici comme partout, n'ont qu'une seule chambre. Les hommes sont payés 3 réaux par jour, un peu plus de 1 fr. 50. La terre bien travaillée rapporte environ 10% net, quelquefois le 20 et 25% du capital.
M. Amour aurait voulu me faire visiter son hacienda, (p. 127) de San-Raphaël, à 40 lieues de Mexico. On s'y rend en deux jours à cheval; mais le temps me manque, et je dois me contenter de lui demander quelques détails. Cette hacienda comprend 18 lieues carrées. Elle est en tierra caliente (zone chaude). On y cultive la canne à sucre, et le produit est consommé dans le pays. Sur les 3,500 habitants qui vivent de la ferme, une centaine de petits enfants meurent tous les ans de la piqûre de scorpions venimeux. Les chambres qui servent de logement aux familles manquent de pavé.
Il y a foire à Tacubaja, et de nombreuses roulettes et autres jeux sont en activité. Au retour, nous entrons dans le parc de Chapultepec, au pied du Castillo. Ce petit château fut le palais de Montézuma, le dernier roi ou empereur des Mexicains. On voit là une superbe forêt d'ahuehuete, arbre de la famille des cyprès. Un d'eux a 5 mètres de diamètre, et de 40 à 50 mètres de haut. Le baron de Humboldt estime que ces arbres peuvent avoir 2,000 ans. Il est bien tard quand nous rentrons; mais il me reste encore du temps pour faire dans la soirée une conférence à une réunion de jeunes gens.
À mon retour à l'hôtel, j'entends les veilleurs pousser leurs sifflets d'heure en heure. Cet usage est commun à toutes les villes du Mexique. Les crécelles des Chinois et des Japonais sont ici remplacées par des sifflets.
Un ami m'avait donné une carte pour M. Domingo Gana, ministre plénipotentiaire du Chili auprès de la république mexicaine. Il m'accueille avec bonté, et (p. 128) m'offre de me présenter au ministre de fomento: c'est le nom qu'on donne ici aux travaux publics. Le ministre n'est pas à son bureau; mais son secrétaire me fournit plusieurs renseignements, et m'envoie à l'hôtel six volumes de documents officiels. Nous passons à l'Observatoire, où le directeur, M. Mariano de la Barcena, nous fait visiter l'établissement. Il me montre les plans projetés pour l'assainissement de la ville de Mexico. Il s'agirait de drainer la vallée au moyen d'un canal qui aboutirait dans la vallée voisine à travers un tunnel. La dépense prévue est de 10,000,000 de piastres (50,000,000 fr.). Ce travail débarrasserait Mexico de la fièvre typhoïde et autres infections résultant actuellement du défaut d'écoulement des égouts. Le lac Tecxoco, en effet, où ces égouts se déversent, n'est que d'un mètre et demi plus bas que le sol de la ville. Il ne faut pas oublier que cette capitale, comme Venise, avait été construite dans une lagune, pour se mettre à l'abri des incursions ennemies. M. de la Barcena m'envoie aussi à l'hôtel trois volumes des Annales de l'Observatoire et une lettre pour le gouverneur de Guanajuato. C'est dans cette ville que je dois m'arrêter, pour visiter les mines les plus importantes du pays. M. Gana me présente à sa famille et me retient à déjeuner. Je retrouve là cette bonne hospitalité que j'avais si bien appréciée au Chili.
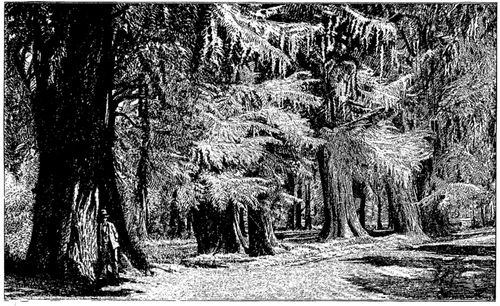
Mexique.—Bois de Chapultepec.
L'après-midi est employé aux visites d'adieux, et je passe la soirée chez M. Coutoly, notre ministre de France. Il m'apprend qu'il y a environ 10,000 Français au (p. 129) Mexique, dont 2,000 dans la capitale. Malgré les tristes souvenirs de l'expédition impériale, la colonie est sympathique au pays. Si nous savions profiter de cette sympathie entre les races latines, nous pourrions monopoliser le commerce et l'industrie de l'Amérique espagnole. Le plus grand nombre de colons viennent des pays basques et béarnais et de la vallée de Barcelonnette; ces derniers monopolisent dans presque tout le Mexique le commerce d'étoffes populaires. Quittant leurs troupeaux des Basses-Alpes, ils arrivent ici fort jeunes. Ils sont employés par un compatriote aux travaux les plus humbles, avec un salaire presque insignifiant; mais, si le sujet est appliqué et fidèle, il monte en grade et finit par être envoyé dans une autre ville, pour fonder un nouveau magasin en commandite.
Une des causes qui affaiblissent l'action de nos colonies à l'étranger, c'est la désunion. Les Français sont malheureusement divisés au dehors comme chez eux. M. Coutoly au Mexique a su créer l'union. Il installe en ce moment une chambre de commerce consultative, et tous les nationaux se groupent volontiers autour de lui. Il en sera toujours ainsi, lorsqu'un agent intelligent voudra s'occuper avec tact des intérêts dont il est chargé. M. Coutoly s'intéresse aussi au relèvement des deux colonies françaises de Chacaltepec et de Saint-Raphaël, situées sur le fleuve Palma, dans l'État de Vera-Cruz. En 1830, quelques fouriéristes, pour appliquer leurs doctrines phalanstériennes, achetèrent là un morceau de (p. 130) forêt vierge, et y amenèrent quelques paysans bourguignons séduits par leurs théories. Mais le fait prouva bientôt leur fausseté. Le chef de la colonie devint un petit tyran, qu'il fallut chasser; et ce n'est que lorsque ces bons paysans, rentrant dans les voies de la nature, travaillèrent librement pour eux et leur famille, qu'ils virent naître la prospérité.
Ces faits ne devraient pas passer inaperçus: ils feraient tomber le bandeau des yeux à ces personnes de bonne foi qui se laissent facilement séduire par des doctrines analogues à celles de Fourier.
Les mêmes maux et les mêmes utopies renaissent à travers les générations: il est toujours utile aux enfants de s'éclairer des essais faits par leurs pères, afin d'éviter les mêmes écueils.
Débarrassés des chefs phalanstériens, les colons rencontrèrent bientôt d'autres ennemis: les maladies et les voisins. Un Mexicain de bonne volonté leur vendit à Saint-Raphaël, de l'autre côté de la rivière, des terrains plus sains, et l'on eut deux colonies. Des gens malintentionnés ne cessaient de contester leurs propriétés. Un ancien préfet alla même jusqu'à faire assassiner un colon, nommé Bourillon, à la suite d'une contestation de limite. M. Coutoly comprit bientôt que, si ce crime restait impuni, c'était la ruine de la colonie: il obtint, non sans effort, que justice fût faite. L'assassin est au bagne, et les colons sont pleins d'espérance, d'autant plus qu'ils comptent que la régie française pourra faire avec eux un (p. 131) traité pour l'achat de leurs tabacs. Une difficulté plus grave provient de la zone dans laquelle se trouvent ces colonies. D'après une loi de l'État, aucun étranger ne peut acheter des terres à une distance moindre de 5 lieues des côtes, et de 20 lieues de la frontière nord. Or nos colonies sont dans la zone réservée. Une décision des Chambres pourra régulariser le fait, en tant que colonies créées par l'État. Notre ministre se propose de visiter prochainement ses compatriotes, accompagné du ministre de colonisation.
Puisqu'on dépense tant de millions à créer des colonies nouvelles, c'est bien le moins que l'on fasse quelque chose pour faire prospérer celles qui existent! M. Coutoly a été élevé en Allemagne, et en a rapporté des idées pratiques. Il a eu l'excellente pensée de demander au gouvernement mexicain communication des travaux publics projetés, afin de les faire connaître en France. Comme premier résultat, il a obtenu pour une Compagnie française la concession des travaux du chemin de fer de Vera-Cruz. Si tous nos agents diplomatiques en faisaient autant auprès des gouvernements chez lesquels ils sont accrédités, l'on verrait plus souvent les capitaux français employés à l'étranger au lieu de se perdre en spéculations de Bourse. Il ne nous manque ni l'intelligence ni l'énergie; et, si nous nous répandons peu, c'est que nous ignorons beaucoup. Que de jeunes gens trouveraient un emploi utile et lucratif dans ces entreprises à l'étranger! Nous aurions plus de travailleurs et moins de déclassés.[Table des matières]
Départ de Mexico. — Les lignes de chemins de fer. — La culture. — Queretaro et la fin tragique de Maximilien. — Arrivée à Guanajuato. — Trois étudiants journalistes. — Un journaliste français et la Commune de Paris. — La ville de Guanajuato. — Visite de la mine de la Cata. — Détails d'exploitation. — Situation de l'ouvrier. — Rendement. — La mine de Valenciana. — La hacienda de mineria de Saint-François-Xavier. — Détails de fonctionnement. — Une aventure à l'hôpital. — Les œuvres de charité.
Le 5 octobre, M. Marchand m'accompagne à la gare. Le train part à 6 heures du matin. Les quais sont encombrés de balles de coton et de blocs de marbre. La locomotive siffle, et me voilà en route. Les wagons sont les mêmes qu'aux États-Unis, longs et larges; ils ont water-closet et robinet d'eau. Mais on peut difficilement se promener, à cause du balancement. Plusieurs en éprouvent même le mal de mer. La plupart des lignes de chemins de fer ont été concédées à des Compagnies américaines. Le gouvernement mexicain leur paie une subvention de 6,000 dollars, soit 30,000 fr., par kilomètre, et la construction coûte souvent moins; mais cette subvention est donnée en bons reçus en paiement des droits de douane, et ces bons perdent en ce moment 20%. Deux lignes se dirigent vers le nord: le chemin de fer national à voie étroite, qui doit rejoindre à Laredo (Texas) la ligne des États-Unis. (p. 134) Cette ligne vient d'être ouverte jusqu'à Saltillo; mais les travaux sont en ce moment suspendus, faute de fonds. On espère néanmoins que, dans un an ou deux, la ligne sera complètement terminée. Une autre ligne à voie large, appelée chemin de fer central, va être ouverte jusqu'à Aguas-Calientes, station thermale. De là elle traverse la région minière de Zacatecas, et rejoint les lignes américaines à Paso del Norte, dans le Nouveau-Mexique. Cette ligne sera ouverte en juin prochain, et l'on pourra ainsi de Mexico aller en wagon aussi bien à New-York qu'à San-Francisco. Plusieurs autres lignes sont en construction entre les deux Océans. La ligne de Vera-Cruz doit rejoindre Manzanillo, sur le Pacifique. Une autre ligne doit unir le port de Tampico, sur l'Atlantique, à celui de San-Blas, sur le Pacifique. Le port de Guajama, dans le golfe de la Californie, sera mis en communication avec Tucson, dans l'Arizona, à travers le Sonora. Corpus-Christi, sur l'Atlantique, sera relié à Laredo. Plusieurs autres lignes sont concédées ou à l'étude. Dans peu de temps, un réseau complet permettra d'atteindre facilement tous les points de la vaste République et d'en exploiter les richesses. Il est probable que ces richesses seront mieux utilisées par la race anglo-saxonne de l'Amérique du Nord, plus active et plus entreprenante. Les Mexicains le craignent. Un d'eux me disait: «Les Yankees sont riches: ils viendront et achèteront nos terres, et peu à peu nous déposséderont; d'autant plus qu'ils aimeront changer les glaces et les chaleurs de New-York contre le (p. 135) climat de Mexico, tempéré et délicieux aussi bien en été qu'en hiver.» Ce Mexicain disait vrai: les Yankees sont en train de faire ainsi la conquête pacifique de l'immense pays de leurs voisins; mais elle est légitime. Dieu a donné à l'homme la terre pour qu'il la travaille et s'y multiplie, non pour la monopoliser en quelques mains, qui, jouissant au loin du fruit du travail de leurs paysans, laissent ceux-ci languir dans la misère. L'énergie et l'intelligence ne manquent pas aux Mexicains; elles sont assoupies ou dirigées vers l'assaut du pouvoir. Il est probable que l'émulation les réveillera et les poussera dans une meilleure direction. Les Mexicains ont peu de sympathie pour la race anglo-saxonne, froide et positive. Communicatifs et poétiques, ils se lient bien mieux avec les nations de race latine. Dans ces dispositions, il serait facile d'arriver, par des concessions de terre et de travaux publics, à des combinaisons qui permettraient aux Français, aux Italiens, aux Espagnols, de prendre part à l'exploitation des richesses du pays, sans en laisser le monopole aux Yankees. Mais il est temps de poursuivre ma route.
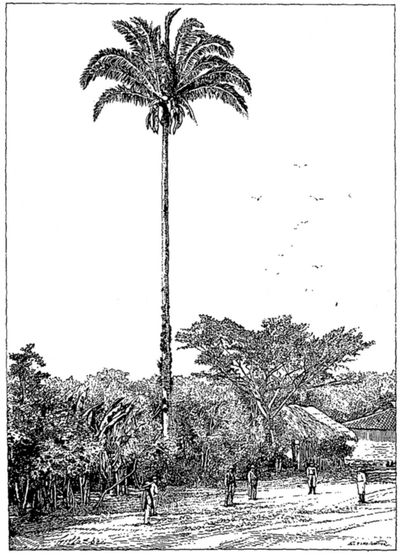
Mexique.—Environs de Cordoba.—Palmier Royal.
Le train suit la vallée de Mexico. Dans les marécages, je vois des buffles, et dans les prairies, des vaches et des chevaux. De vastes champs de maïs sont clôturés par des haies de cactus gigantea. On les appelle ici organos, parce qu'ils ressemblent à des tuyaux d'orgue. Je remarque aussi souvent d'énormes poivriers, qui atteignent ici les proportions d'arbres de haute futaie, et des champs de figues de Barbarie, qu'on appelle tuñas. (p. 136) Les indigènes les vendent au marché, s'en nourrissent, et en font une pâte concentrée, qu'ils appellent queso, ou fromage de tuña. Les villages ont tous leur église à coupole. Les rancherias sont de plus en plus misérables. Ce sont de pauvres maisons ou cabanes composées de terre, de paille, de pierres posées à sec, de vieilles traverses de chemin de fer, ou même d'un lambeau de toile. Les membres d'une famille y vivent pêle-mêle. Partout des troupes de baudets charrient le foin, la paille, le bois qui alimente le feu de la locomotive. Je vois même de pauvres Indiens faire concurrence aux baudets: ils s'en vont dans la forêt, et rapportent sur leurs épaules un long fardeau de bois, du poids de 18 arobas, presque 100 kilog., pour lequel on leur donne 2 ou 3 réaux.
À toutes les gares, toujours les mêmes gendarmes ruraux, armés jusqu'aux dents, et de nombreuses filles ou femmes qui vendent des fruits, des gâteaux, des confitures et autres plats du pays. Dans certaines gares on vend aussi des paniers, boîtes et autres travaux en paille, des petits ouvrages et des lazos en fils d'aloès.

Mexique.—Indienne vendant des tamales et des tortillas (plats indiens).
Nous traversons un terrain montagneux, et passons dans une seconde vallée. Mon baromètre anéroïde descend de 2,300 à 1,800 mètres; mais, par contre, le thermomètre, qui marquait 20° centigrades dans la vallée de Mexico, monte ici à 25°. À Ercoles, j'aperçois une fabrique de cotonnade. Plus loin, je vois de pauvres Indiens nus. Enfin la terre devient plus cultivée: nous approchons d'une ville. Les vergers ont des pommiers et des poiriers, (p. 137) à côté des orangers et des bananiers. Les paysans arrosent leurs légumes et leur maïs au moyen d'un trébuchet. Cet instrument primitif consiste en un levier formé d'une longue perche, qui porte à un des bouts un seau et à l'autre bout une grosse pierre pour faire contrepoids. Le seau est poussé par un homme dans le puits, où il se remplit, et versé dans une caisse, d'où l'eau s'échappe dans les rigoles.
Les coolies de l'Hindoustan, plus habiles, emploient les bœufs à tirer du puits de grandes poches de cuir ramenant 100 litres d'eau; le Yankee, plus industrieux, installe un moulin à vent, et économise ses bras, qui feront autre chose.
Parmi les légumes, je remarque un gros haricot, dont la plante a des feuilles semblables à celles du tabac: on l'appelle haba dans le pays. Le maïs est semé deux fois l'an: durant les six mois de pluies, d'avril à novembre, il pousse et mûrit; on le resème et on l'arrose durant les autres six mois, et on a ainsi deux récoltes l'an. Enfin voici Queretaro, avec ses nombreuses coupoles. Cette ville compte 60,000 habitants, et rappelle la mort tragique de l'empereur Maximilien. C'est le 19 juin 1867 qu'il fut extrait du couvent où il était prisonnier, et conduit sur le Cerro de las campanas, à 500 mètres de la ville. Il y fut fusillé avec le général Miramon. Le train passe près de cet endroit lugubre et suit sa route. Il traverse une plaine bien cultivée, où je remarque l'olivier de Provence, et des nuées de grives qui dévorent le maïs. Vers 5 heures (p. 138) nous arrivons à Silao. Le baromètre anéroïde marque 1,600 mètres d'altitude, et le thermomètre, 30°. Je prends l'embranchement de Guanajuato, et, deux heures après, je descends dans la capitale de l'État de ce nom. Elle est située au centre du principal district minier du Mexique. L'hôtel est petit et encombré: je ne puis obtenir qu'une chambre sans fenêtre; mais je n'ai pas le choix: il n'y a point d'autre hôtel convenable. Un torrent voisin reçoit les résidus de l'établissement et des autres maisons, et envoie des miasmes qui, à une moindre altitude, engendreraient certainement des maladies contagieuses.
Je passe la soirée avec trois jeunes étudiants qui sont venus ici fonder un journal, et j'ai la chance de leur acheter le premier exemplaire du premier numéro. Nous causons sur l'importance de la presse et sur la grande responsabilité des journalistes: ils prêchent le peuple, et peuvent l'éclairer ou le fourvoyer. J'indique à ces novices plusieurs publications où ils pourront puiser à bonne source, et je les quitte bien disposés à s'instruire pour instruire les autres. Ces jeunes gens ramènent à ma mémoire le souvenir d'un journaliste parisien avec lequel j'avais fait route dans les Antilles. Il brodait ses correspondances d'inventions multiples, affirmant ce qu'il n'avait jamais vu et les émaillant de doctrines qui m'étonnaient chez un homme sensé. À mes observations sur ce procédé, il répond qu'il écrit pour les badauds, et que peu lui importe la vérité, pourvu que le journal se vende. Quant aux doctrines, il ne croit pas un mot de ce (p. 139) qu'il écrit; son journal est radical et s'adresse aux imbéciles. Mon étonnement fut encore plus grand et je ne pus m'empêcher de lui dire qu'il jouait avec le feu, et que les communards qui avaient brûlé Paris n'étaient coupables d'autres choses que d'avoir pris au sérieux de tels journalistes qui au fond étaient les vrais incendiaires. Peut-on traiter d'un cœur si léger des choses si graves!
Le lendemain je me rends chez le gouverneur pour lui présenter la lettre que j'avais apportée de Mexico. Comme il n'est pas encore au bureau, j'utilise mon temps à visiter la ville. Elle est enclavée dans des montagnes qui laissent peu de plaine. Les rues sont étroites et les maisons entassées. Les quartiers ouvriers s'étendent sur les flancs escarpés; 80,000 habitants sont réunis dans un espace étroit, mais l'atmosphère est pure à 1,600 mètres d'altitude. L'air est raréfié et les distances s'effacent. Un objet placé à une lieue paraît rapproché à 1 kilomètre. En fait de monuments on agrandit l'Église de la Compañia. La coupole percée à jour est d'un superbe effet. La façade, en style baroque, surchargée de sculptures, est semblable à celles qu'on voit dans toute l'Amérique espagnole. Un grand théâtre est aussi en construction.
À 10 heures M. Manoel Muños Ledo, gouverneur de l'État de Guanajuato, me reçoit avec bienveillance. Apprenant que je désire visiter les mines, il me donne une lettre par laquelle il me recommande à Don Pablo Orozco, un des premiers ingénieurs du pays. M. Orozco regrette que ses occupations du samedi ne lui permettent pas de (p. 140) m'accompagner en personne, mais il appelle un domestique; il lui enjoint de seller ses deux meilleurs chevaux et de venir me prendre à l'hôtel.
Peu de temps après l'Indien ramène un superbe cheval richement harnaché. Les ornements de la selle et les étriers sont en argent massif, la selle porte le lazo traditionnel, le revolver, l'épée et la cravache. Je monte en selle et le domestique me suit sur un autre cheval à distance respectueuse. Cet Indien, fort poli, montre beaucoup de tact. Sur un signe il approche, répond à mes questions et retourne à sa place. Nous traversons la ville, et grimpons sur les flancs garnis de maisons de terre, misérables demeures des ouvriers, quelques-uns sont étendus à terre, ivres morts. Nous longeons un torrent et arrivons à la mine de la Cata, la plus riche en ce moment. Telle mine qui est aujourd'hui la plus riche peut devenir demain la plus pauvre par la perte ou le rétrécissement du filon. Nous trouvons le directeur au bureau, et comme la paye du samedi ne lui permet pas de m'accompagner, il me fait conduire par un employé. Nous arrivons à la mine à travers de petits sentiers. La porte en est soigneusement fermée. Au dehors, de nombreux ouvriers et ouvrières brisent les pierres pour séparer la partie qui contient le métal; nous pénétrons à l'intérieur à la lueur d'une torche composée d'une corde d'aloès détrempée dans une substance résineuse. Après une longue descente, les marches sont remplacées par des échelles. Nous parcourons des galeries, descendons dans (p. 141) des puits, passons dans des trous où j'ai de la peine à me faufiler; nous arrivons ainsi à de nombreux chantiers où les ouvriers, à l'aide de l'aiguille et du marteau, percent la roche et tirent la mine. La chaleur est intolérable. Après une explosion, les gaz qui se dégagent rendent la respiration difficile. Aussi ces pauvres ouvriers, à cette vie de taupes, sont bientôt épuisés. Leur sang s'appauvrit faute d'air et ils deviennent anémiques. La chaleur les force à travailler presque nus. Les divers chantiers sont confiés à un chef mineur qui, moyennant 40 à 45 piastres, doit faire un mètre de galerie de 4 mètres de diamètre. Celui-ci prend à sa solde d'autres mineurs, et ils gagnent de 4 à 5 fr. par jour. Le travail se continue la nuit par d'autres ouvriers travaillant dans les mêmes conditions. Les pierres sont portées à dos d'homme sur des wagonnets, à certaines galeries d'où elles gagnent le puits d'extraction. Les porteurs reçoivent 1 réal (60 centimes) par 25 arobas de 25 livres et gagnent de 4 à 5 réaux par jour. Les femmes qui font le triage des pierres reçoivent de 3 à 4 réaux par jour. Pour les mines, on emploie la poudre dans la roche sèche et dure, et la dynamite dans l'eau ou dans la roche poreuse. Une mine de dynamite produit l'effet de 10 mines de poudre et coûte environ 1 fr. 25. La mine de poudre coûte 45 centimes ou neuf centavos. Le minerai le plus riche contient 94 marcos par charge de 14 arobas; le marco équivaut à 6 réaux. La mine emploie un millier d'ouvriers et extrait une moyenne de 2,000 charges par semaine, (p. 142) donnant un produit de 7 à 8,000 piastres. Le minerai contient 45 grains d'or pour chaque marc d'argent. Les employés comptables, surveillants, contre-maîtres, reçoivent 20 piastres par semaine. La mine est en exploitation depuis 15 ans et atteint 400 mètres de profondeur. Trois puits d'extraction servent à ramener l'eau, les pierres et le minerai à la surface. Dans un, les poids sont montés par machine à vapeur. Les deux autres fonctionnent au moyen de 5 mules qui tournent une roue enroulant sur un cylindre la corde dont un bout monte pendant que l'autre descend. Pas de caisse d'épargne, pas de société de secours mutuels. En cas d'accident, l'ouvrier est soigné aux frais de l'administration. S'il reste estropié, il reçoit un secours une fois donné. S'il meurt, la famille reçoit une indemnité dont le minimum est de 15 piastres. Dans une telle situation, l'ouvrier est heureux d'avoir la foi! J'ai vu, par-ci par-là dans la mine, des statues et des autels près desquels il vient puiser la force de continuer son dur labeur. Au sortir de la mine j'offre un pourboire à l'ouvrier qui m'a précédé avec la torche, et à mon grand étonnement il le refuse. Le même fait se reproduit dans ma visite aux autres mines. À mon retour au bureau, le patron avait fait mettre de côté pour me l'offrir, un choix de pierres et de cristallisations les plus curieuses.
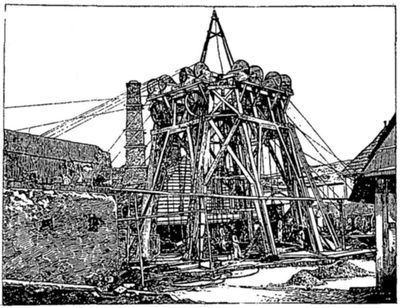
Mexique.—Guanajuato.—Puits d'extraction de la mine
Valenciana.
(600 mètres de profondeur.)
Nous reprenons nos chevaux et grimpons la montagne pour atteindre le puits principal de la mine la Valenciana, une des plus anciennes. Son exploitation remonte à 1740. Le patron nous accompagne. Nous traversons des (p. 143) montagnes de débris extraits depuis plus de 100 ans, qu'on trie à nouveau. Les moyens perfectionnés actuellement en usage permettent d'en extraire encore une certaine quantité de minerai. Le puits a 600 mètres de profondeur. Trois machines à vapeur de 30 chevaux chaque font tourner 16 cylindres sur lesquels s'enroulent des câbles d'acier qu'on change tous les deux ans. Comme il faut porter de très loin l'eau douce destinée à la chaudière, la vapeur qui a servi est recondensée et convertie en eau. Celle qu'on extrait du puits est trop saturée de matières minérales. Pour la boisson des ouvriers, on apporte aussi de loin des barils d'eau à dos de mulet. Ce sont des mules qui charrient aux diverses haciendas le minerai. (p. 144) On les voit défiler par centaines. Deux autres puits fonctionnent de la même manière. Ils ont 11 mètres de diamètre et un d'eux a 800 mètres de profondeur. Chaque câble monte son fardeau 8 fois par heure. La mine emploie un millier d'ouvriers et extrait par semaine 1,600 charges de minerai donnant à peu près 5,000 piastres. Le salaire est le même que dans l'autre mine. La paye se fait le samedi soir. Le repos du dimanche est respecté par tous les mineurs. Nous suivons divers sentiers dans la montagne et arrivons à la mine de Nopal. Là, comme partout, les employés sont armés de leur revolver. Le propriétaire me donne un guide et nous suivons un tunnel, puis nous descendons des milliers de marches et pénétrons dans de nombreuses galeries qui se ramifient en tous sens. Le puits d'extraction a 500 mètres de profondeur. Le minerai, les pierres et l'eau sont extraits au moyen d'un cylindre mu par la vapeur et deux cylindres mis en mouvement par des mules.
La mine est pauvre en ce moment; le minerai extrait ne donne qu'environ 2,000 piastres par semaine. On est à la recherche de meilleurs filons. Le métal riche est exporté, l'autre est envoyé à la Monnaie que l'État possède à Guanajuato et frappé en piastres mexicaines.
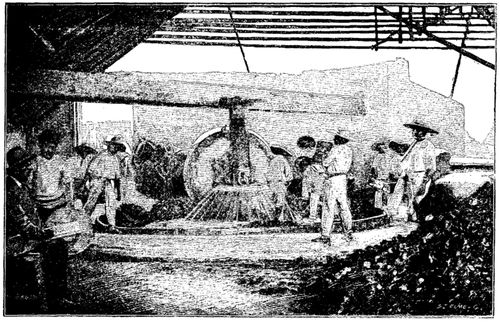
Mexique.—Guanajuato.—Molino de la Hacienda de San-Juan.—Broyage des minerais d'or et d'argent.
Quelques propriétaires de mines ont leurs haciendas; d'autres vendent leur minerai aux propriétaires d'haciendas de mineria. On appelle ainsi l'usine qui pulvérise le minerai pour en extraire le métal. Nous descendons la montagne et venons visiter la principale hacienda (p. 145) du pays: celle de San-Frances-Xavier. Comme la nuit approche, on me donne un garde pour m'accompagner. À la hacienda, je vois une centaine de mules pour mettre en mouvement les machines. Le minerai, par quantité de 500 quintaux par jour, est jeté dans des moulins pour être réduit en petits morceaux. De là il tombe dans une salle au dessous qui contient 50 arastras, ou lourdes pierres mues chacune par deux mules, sous lesquelles le minerai se pulvérise. Mélangé à l'eau, il forme une pâte terreuse qui va dans un réservoir et de là sur un séchoir en briques ou en ciment. On peut alors essayer le degré de richesse du minerai. Cette opération est faite par un essayeur public contrôlé par celui de la Hacienda. Le prix qui sera payé au propriétaire de la mine est basé sur ce degré de richesse établi par l'essayeur. La salle qui contient les 50 arastras s'appelle galera, parce qu'elle est tenue sous clef et que les ouvriers ne peuvent en sortir qu'à de certaines heures.
Après avoir séjourné sur le séchoir un certain nombre de jours, la pâte devenue malléable est portée au Lavadero. Là elle est mélangée avec le mercure, en espagnol azoque. Quatre meules tournent la pâte noyée dans l'eau, qui emporte les matières étrangères et laisse au fond le métal amalgamé avec le mercure. Cet amalgame est porté à l'azoqueria, salle où l'on sépare le mercure au moyen d'un philtre en peau. Le métal est ensuite posé dans le candelero, vase en fer enfermé dans une cloche de même métal entourée de charbons. La chaleur évapore le mercure (p. 146) restant, et cette vapeur est concentrée de nouveau au moyen d'un courant d'eau. Le métal pur reste ainsi dans le vase et on le prend pour l'envoyer à la Monnaie. Dans cet établissement de l'État, on sépare l'or de l'argent et on frappe les piastres. Le coût de l'opération est d'environ 3%. La quantité de mercure qui s'échappe dans chaque opération est calculée à 5%. À l'hacienda, les meilleurs ouvriers sont payés 4 piastres par semaine; les autres gagnent 4 à 5 réaux par jour. L'Hacienda de San-Xavier envoie à la Monnaie du métal pour environ 200,000 piastres par an.
Il est nuit close lorsque nous quittons l'établissement. Nous suivons des sentiers solitaires et pénétrons de nouveau dans les quartiers ouvriers. À l'approche des églises, nous entendons le chant des litanies; ces braves gens, après avoir reçu leur paye du samedi, clôturent la semaine par le salut.
À l'hôtel, je rencontre un jeune couple en voyage de noce. Ce sont des juifs de New-York, et en véritable juif, l'époux cherche à me vendre pour 40 piastres une Histoire des États-Unis qui en vaut 2.

Mexique.—Guanajuato.—Ateliers de la Hacienda de San-Juan.—Pulvérisation des minerais d'or et d'argent.
Le 7 octobre, jour de dimanche, les églises sont remplies de peuple, qui, faute de chaises, se tient accroupi par terre. À l'élévation plusieurs lèvent les mains en l'air en signe de supplication. Quel dommage qu'on laisse ensuite empoisonner ce bon peuple par le vino mescal. Cet extrait d'aloès distillé à 22 degrés, ajouté au spectacle des courses de toros, le rend féroce. Les affiches de la Corrida (p. 147) sont sur tous les murs. Au surplus des saltimbanques parcourent les rues avec musique, portant des placards où sont dessinées les scènes du combat pour entraîner les gens.
Ne pouvant visiter la Monnaie, je me rends à l'Hôpital. Je n'y vois pas l'ordre et la propreté qu'entretiennent dans ces établissements les Sœurs de Charité. Pendant que je parcours les salles, quelques jeunes gens m'abordent et m'interpellent ainsi: Es vousted dottor? Comme je sais que les Espagnols appellent dottor, aussi bien les avocats que les médecins, je réponds: si senôres. Ils me prient de me laisser conduire à l'inspection de quelques cas graves et difficiles pour connaître mon appréciation. Je vois alors que j'ai affaire à des étudiants en médecine; je n'ose reculer, et me décide à jouer mon rôle jusqu'à la fin. Le premier cas concerne un pauvre ouvrier qui a été frappé par une mine de dynamite. Les deux yeux sont crevés, la figure est horriblement noircie et déchirée, le bras droit amputé; mais le malade respire librement. «L'appareil respiratoire est libre, dis-je à ces jeunes gens, tout espoir n'est pas perdu. Ce que vous avez à craindre c'est la gangrène, il faut l'en préserver par l'acide phénique.»—C'est ce que nous faisons, répondent les élèves, contents de voir que mon avis coïncide avec le leur. Ils me conduisent dans une autre salle et me montrent un pauvre cordonnier qui a sur l'épaule une énorme excroissance de chair. En y appliquant le doigt on sent le battement égal à une forte palpitation. (p. 148) Un de mes fermiers avait eu la même maladie; trois docteurs voulurent l'opérer, mais il mourut par suite de l'hémorrhagie. Je crus donc pouvoir dire à ces bons étudiants: Gardez-vous de l'opérer; il pourra vivre ainsi encore des mois et des années. Ils répliquent: Le professeur hésite en effet beaucoup à tenter l'opération. Me voici donc sauvé encore pour cette fois. Le troisième cas concerne un pauvre ouvrier qu'on vient d'amener; il a reçu une balle dans le ventre; un morceau d'entrailles est sur le lit, un autre morceau sort du trou béant; la balle reste à l'intérieur: Tout ce que vous pouvez faire, c'est de lier l'intestin, le cas me paraît désespéré, les aliments ne pouvant plus suivre leur voie naturelle. Telle est leur opinion. Je respire enfin voyant qu'ils n'ont plus d'autres cas à me montrer; je leur dis adieu et m'en vais tout étonné de mon aventure, mais jurant qu'on ne m'y reprendra plus.
En fait d'autres œuvres, j'apprends qu'une Conférence de charité fait les frais de trois écoles réunissant 200 enfants; que les dames de charité entretiennent aussi plusieurs écoles de filles, qu'une loterie fait les frais de l'établissement des enfants trouvés, et que le curé a organisé une école d'arts et métiers. Le pays manque d'eau, soit pour l'irrigation, soit pour les besoins des mines. Le gouverneur m'avait parlé d'un projet de barrage pour recueillir les eaux des montagnes. On formerait ainsi un lac artificiel qui fournirait l'eau à un prix rémunérateur. Il désirait que ce projet fût signalé aux capitalistes étrangers. (p. 149) Il me remet aussi le mémoire imprimé concernant l'État libre et souverain de Guanajuato. Ce mémoire a été lu par lui à l'ouverture du dixième Congrès de cet État. J'y relève que l'État de Guanajuato a une population de 968,113 habitants, que le revenu en 1881 a été de 597,146 piastres, et les dépenses de 590,709 piastres; que l'État possède 433 écoles primaires instruisant 17,211 enfants; mais que 176,411 restent sans instruction; que les écoles secondaires et supérieures coûtent fort cher et donnent un petit nombre de médecins, d'avocats et d'ingénieurs. Chaque élève gradué a coûté à l'État 7,199 piastres pour les avocats, 5,185 piastres pour les ingénieurs, 7,094 piastres pour les médecins; que la bienfaisance administrative a été fort chère et insuffisante, et qu'il importe de s'en décharger sur la charité et l'initiative privée; que le registre civil pour 1881 accuse 21,047 naissances, 3,932 mariages et 34,032 décès. À ce propos, le gouverneur se réjouit de ce que la mortalité n'excède plus que d'un tiers les naissances, pendant que, les années précédentes, cet excédent atteignait la moitié et même les deux tiers. Parmi les maladies dominantes, je remarque la petite vérole. À l'article mineria, je vois qu'en 1881, dans l'État, 128 mines ont été dénoncées, et 114 enregistrées; que le nombre des mines actuellement en exploitation est de 52, et celui des haciendas de beneficio de 38. Les 602 hommes de troupes de ligne et les 430 cavaliers que l'État équipe pour la sûreté publique ont coûté 293,510 piastres.[Table des matières]
Départ de Guanajuato. — Silao. — La presse. — Lagos. — Route à Ojuelos et à San-Luiz de Potosi. — San-Luiz. — Le Gouverneur. — L'école de artes y oficios. — Le départ. — La femme du postillon. — Je suis seul voyageur. — Le brigandage. — Les villages de l'intérieur. — Un perroquet traître. — Les mendiants. — Une nuit à Chalca. — Un Barcelonnette. — Un ancien colonel garibaldien.
Dans l'après-midi, je quitte Guanajuato, et à la station de Silao je trouve la musique municipale jouant à la gare pour égayer les voyageurs. À 5 heures le train de Mexico entre en gare, et je m'y installe pour arriver le soir à Lagos, point extrême de la ligne en ce moment. Durant le trajet, je lis les nombreux journaux que j'achète un peu partout sur le parcours. On peut savoir par eux ce qui se passe dans les diverses villes.
Le dimanche, presque tous ces journaux impriment autant de poésie que de prose, et je constate qu'ici comme dans les autres nations latines, le rôle de la presse se réduit trop souvent à des personnalités et à des passions de parti. Après les avoir lus je sais toutes les intrigues et connais toutes les épithètes dont les adversaires se décorent; mais des vrais intérêts du pays, du commerce, de l'agriculture, de l'industrie, il en est rarement question. Dans quelques jours, lorsque j'aurai passé la frontière, (p. 152) le dernier des journaux américains me dira ce que rapportent les mines, ce que promet la récolte, combien de droits de douane ont été perçus dans la semaine, le prix des terres et leur rendement, leur situation, les machines et inventions nouvelles, etc.
Enfin, à 8 heures du soir, je suis à Lagos. Dans cette ville de 20,000 habitants, je ne trouve qu'une mesquine auberge où on m'installe dans une chambre à deux lits, ayant une seule porte pour toute ouverture. Après le souper, je me mêle aux promeneurs qui écoutent une assez bonne musique sur la place; puis je vais prendre mon repos à côté d'un Canadien, marchand de machines, mon compagnon de chambre. Ce repos ne sera pas long. Les trains de Mexico partent à 4 heures, et les diligences pour Guadalajara et Zacatecas partent d'aussi grand matin: on éveille les passagers à 3 heures, et ils ne ménagent pas le bruit.
À 6 heures du matin, je suis moi-même installé dans la diligence de San-Luiz Potosi. La distance de Lagos à Saltillo est d'environ 180 lieues. La diligence la franchit en six jours, par une moyenne de 30 lieues par jour. Le prix est de 40 piastres (200 fr.) mais les bagages paient presque autant. Pour un aroba (25 livres), le port est gratuit, pour chaque autre aroba on paie 6 piastres, plus d'un franc la livre.
La diligence est une grande voiture dont la caisse peinturlurée repose sur des lanières de cuir. Des rideaux de cuir ferment les côtés. À l'intérieur il y a trois sièges à (p. 153) quatre places chacun; le siège du milieu est mobile; une courroie mobile y sert d'appui aux passagers. Heureusement nous ne sommes pas au complet; 9 au lieu de 12. Sur l'impériale, le cocher ne veut personne que ses deux postillons, à cause des difficultés de la route. Les sacs de cuir contenant la malle pour les États-Unis encombrent le derrière de la voiture; 8 mules nous entraînent au grand galop. Elles reprennent bientôt le petit pas; nous sommes encore dans la zone des pluies. Les chemins sont des lacs ou des fondrières; nous avançons péniblement. Les champs de maïs sont clôturés par des haies de cactus gigantea. Les villages portent les traces des dernières guerres. Plus loin nous atteignons des collines arides. Nous montons au pas les raides pentes, mais nous dégringolons au galop les descentes à travers les rochers. Nos têtes heurtent contre la voiture ou les unes contre les autres; parfois les sursauts les envoient au plafond. Une dame, qui est pourtant indigène, s'effraye, et à tout instant, lorsque la voiture se penche à droite ou à gauche, elle se cramponne au voisin en criant: abajamos! abajamos! Nous tombons, nous tombons. Toutefois, la frayeur ne l'empêche pas de fumer sa cigarette.
Vers 11 heures, on nous fait déjeuner dans une petite auberge. J'y remarque une bonne vieille qui doit avoir au moins 110 ans; sa peau est un vrai parchemin. Je lui parle, elle répond avec grâce, tout en se voilant avec sa mante par modestie. Nous continuons notre route, aussi pénible que le matin, et vers 6 heures 1/2 du soir, nous (p. 154) arrivons à Ojuelos, petite ville de 5,000 habitants. On m'installe à l'auberge dans une chambre à deux lits, sans fenêtre. Toutes les chambres ouvrent sur la cour intérieure, où sont remisées les voitures. C'est un peu comme les auberges de la Chine.
Je demande un bain pour me délivrer de la poussière, on m'en promet un pour le matin, si je veux bien le prendre dans une cuve.
Le lendemain matin à 5 heures je cherche ma cuve, mais l'eau s'était enfuie par les douves mal jointes. À 6 heures nous remontons en voiture. La bonne humeur est générale. On lie bientôt amitié dans ces diligences comme entre compagnons de la même infortune. La zone des pluies est franchie, et la poussière que les roues envoient dans la voiture nous étouffe. Le nouveau conducteur me permet de m'installer sur l'impériale. J'y jouis d'une belle vue et d'un air respirable, mais bientôt le soleil a brûlé ce qu'il a pu atteindre de ma peau; elle tombera. Il n'est pas mauvais parfois de faire peau neuve. Les diverses haciendas que nous rencontrons ont des barrages qui leur permettent de recueillir dans de petits lacs artificiels l'eau nécessaire. Des vols de canards sauvages y prennent leurs ébats. De ma position élevée, je peux voir de nombreux lapins et lièvres près des buissons me regarder avec curiosité. Parmi les voyageurs, un Espagnol les tire de temps en temps, mais sans succès. Tous les passagers ont carabine, ou tout au moins revolver et coutelas. Je suis le seul qui, pour toute arme (p. 155) n'ai que mon couteau de poche, long de 7 centimètres. À 10 heures on me fait remarquer une croix. Elle est collée à une des parois de la chapelle élevée sur la Hacienda de Depetate. Cette croix rappelle la mort du général Ramon de Miramon, fusillé contre ce mur. Il était frère du général Miramon, fusillé à Queretaro avec l'empereur Maximilien. Vers 11 heures on nous descend à San-Antonio. À l'auberge, pour déjeuner, on ne nous donne que des os. La route suit toujours des montagnes arides; il me semble traverser les Castilles ou le département des Basses-Alpes, mais un département grand comme la France. À 3 heures 1/2 nous apercevons les nombreuses coupoles de San-Luiz de Potosi. Nous traversons la plaine, où le paysan arrose le blé au moyen de norias, et à 4 heures nous sommes dans cette capitale de l'État de San-Luiz de Potosi.
Ma première visite est pour le gouverneur. Il est au Conseil, et je remets à son secrétaire la lettre que j'avais apportée de Mexico. J'avais aussi une lettre pour M. Exiga, directeur de l'école de artes y oficios, et tout en me rendant chez lui, je visite la ville. La plaza de arme, où est mon hôtel, est digne d'une grande ville. Une belle statue de bronze y occupe le centre d'un magnifique square. Les maisons sont en adobe et à un rez-de-chaussée: quelques-unes ont un étage au dessus.
Les rues sont droites et larges dans la ville nouvelle, et étroites dans la vieille ville. Quelques églises, comme la cathédrale, sont vastes et belles; d'autres sont surchargées (p. 156) de dorures, de sculptures, et d'ornements de toute sorte à la manière espagnole. Partout l'image de la Trinité, consistant en trois figures d'hommes absolument semblables; et partout aussi ces laides statues habillées de chiffons de toutes couleurs. Un parc aux abords de la ville est assez vaste, mais entièrement négligé.
San-Luiz est une des villes importantes du Mexique. Après Mexico, qui compte 200,000 habitants, Léon en possède 100,000, Guadalajara 80,000, Guanajuato 70,000, et San-Luiz 50,000.
J'arrive enfin chez M. Exiga, qui a la bonté de me faire visiter son école. Elle réunit 130 garçons internes, répartis en 7 ateliers de serruriers, menuisiers, cordonniers, imprimeurs, etc. Ces enfants apprennent aussi le dessin linéaire et d'ornement, la tenue des livres, l'anglais, le français et la musique. L'Indien a de grandes dispositions pour la musique. Dans la cour, une quarantaine d'enfants exécutent de jolis morceaux sur des instruments à vent. Le maestro est un Indien qui est devenu une vraie célébrité dans son art. Cette école a été fondée par le gouvernement et vit à ses frais. C'est de l'argent bien employé.
Je prends rendez-vous avec M. Exiga pour la soirée.
À l'hôtel je trouve une lettre que m'envoyait M. Guttierez, gouverneur de l'État. Il me recommandait à M. Jésus Sanchez Lozano, jefe politico du district minier de Catorce, où j'espérais visiter encore quelques mines. Dans la soirée, M. Exiga me présente à plusieurs (p. 157) de ses amis, avec lesquels nous pouvons causer des choses du pays, et un peu tard je viens à l'hôtel chercher mon repos.
Le 10 octobre on m'éveille à 3 heures du matin. La voiture part à 4 heures. Je suis seul passager. Malgré la satisfaction d'être sans gêne dans la voiture, je ne puis me délivrer d'une certaine appréhension. Je suis seul et sans armes, livré à des postillons inconnus, armés de coutelas et de revolvers. Je dois ainsi traverser, par une route de plusieurs jours, un pays à peu près désert où les brigands viennent à peine de cesser leurs exploits! Mais, courage! en avant, à la bonne Providence! Dieu m'a conduit jusqu'ici, il me conduira bien jusqu'à la fin! Le postillon est déjà à son poste lorsque sa jeune femme arrive, lui porte sa couverture, allume sa cigarette et sa torche résineuse, et lui remet son déjeuner pour la route. La femme du peuple a bien du mérite, et sous les haillons bat souvent un noble cœur! Nous avançons dans les ténèbres, puis l'aube arrive, et avec elle le réveil de la nature. Les oiseaux gazouillent leur prière du matin, les sommets des collines se dorent, le berger pousse ses chèvres et ses brebis, les picadores à cheval mettent en route les mules et les baudets, et les jeunes filles s'en vont à l'eau avec leurs gracieuses urnes sur l'épaule. Les conducteurs ont tous coutelas et revolvers. Je remarque quelques charrettes conduites par des femmes, et cela me rassure. Après la guerre civile, le gouvernement s'est appliqué à détruire le brigandage. Les populations paisibles (p. 158) qui en souffraient s'y sont prêtées volontiers, en appréhendant elles-mêmes les malfaiteurs pour les consigner à l'autorité. Ceux qui ont échappé aux balles et à la prison sont pour le moment réfugiés dans les montagnes. Les routes que je parcours portent les traces de leurs exploits. Par-ci, par-là, je remarque des croix, et lorsque je demande au conducteur ce qu'elles signifient, il me répond invariablement: ladrones! Il veut dire qu'elles rappellent les massacres des voleurs. Tout le monde étant armé, le vol est précédé d'une lutte, et le voleur devient nécessairement assassin.
Le pays que nous traversons est un immense champ d'énormes cactus à figues de Barbarie. Les indigènes en prennent les feuilles, qu'ils passent au feu pour détruire les épines, et les donnent aux bœufs, qui en sont friands. Aux cactus succèdent les youcas, dont quelques-uns atteignent une hauteur considérable. On les dirait les géants du désert. Par-ci, par-là, quelques villages en adobe et quelques haciendas au bord d'un étang. Les paysans suspendent à l'air les bêtes qu'ils tuent, et malgré la chaleur du soleil, l'air, à cette altitude de 1,800 mètres, les conserve assez longtemps. Le gibier abonde et ravage les champs de maïs.
Vers midi on s'arrête dans un village pour déjeuner; je visite les pauvres habitations de terre, adressant la parole aux personnes que je rencontre. Les femmes sont craintives, les enfants curieux viennent voir l'étranger, les hommes répondent poliment à toutes mes questions. (p. 159) Dans une de ces pauvres cabanes, je trouve un perroquet; il me touche gentiment de la patte, monte par le bras sur l'épaule et sur la tête; mais le traître! il saisit mon beau chapeau de Panama, et d'un coup de son bec crochu lui fait un large accroc.
Dans l'après-midi le soleil devient plus chaud et la poussière fatigante. À Venado je vois une usine à coton. Pendant qu'on change les mules, je suis entouré de mendiants qui veulent tous leur petite monnaie, et s'en vont en bénissant l'étranger. Au moment où l'on jette le lazo à une mule, elle réussit à se sauver et part furieuse à travers le village, gagnant la campagne. On la rattrapera plus tard.
Le soir, vers 6 heures 1/2, j'arrive à Chalca, où je dois passer la nuit. Bientôt la diligence qui fait le service en sens inverse arrive aussi, et amène 1 Italien, 1 Français, 2 Américains, 1 capitaine et 1 gendarme mexicains. Il n'y a que deux chambres dans l'hôtel, et selon l'usage du pays, la porte sert de fenêtre. Je partage la mienne avec les deux Américains. Après le souper mon compatriote me raconte qu'il est de Barcelonnette et qu'il vient d'installer un nouveau magasin d'étoffes dans les environs. L'Italien est un ancien colonel garibaldien qui a fait la campagne des Vosges. Le gouvernement mexicain l'a nommé agent de colonisation et lui donne 300 piastres par mois pour qu'il cherche vers la frontière américaine les endroits les plus propices à l'établissement de colonies de race latine. Il en profite pour s'occuper de ventes (p. 160) de terrains. Il m'en cite quelques-uns comprenant plusieurs lieues carrées à des prix variant de 1 à 100 fr. l'hectare. Lorsqu'il découvre des terrains qui n'ont pas été enregistrés, dans le but d'éviter la contribution, il les signale au gouvernement, qui en reprend possession et les vend. Il collectionne aussi pour le compte du gouvernement des fossiles, tels que os de mastodontes et autres, destinés au musée de Mexico. Dans les environs de Chalca, une mine de plomb argentifère emploie en ce moment 500 ouvriers. Elle en employait 4,000 quand elle tenait les filons riches. Je quitte mes voyageurs et je m'en vais sur ma dure couche, car on m'éveillera à 3 heures du matin.[Table des matières]
Départ de Chalca. — Je fais un heureux. — La Hacienda de Solis. — Matehuala. — Les mines du district de Catorce. — La ville de Cédral. — La Hacienda de beneficio de Don Antonio Verume. — Un garçon qui veut apprendre l'anglais. — Le vin de Membrillo. — La Hacienda el Salado. — Les toiles d'aloès. — Les briques d'adobe. — On dompte un cheval sauvage. — La soirée et la nuit à la Hacienda la Ventura. — Un inconnu. — Le gibier. — Les fauves. — La ville de Saltillo. — Le chemin de fer. — Le chien des prairies. — Monterey. — Laredo. — Arrivée à San-Antonio.
Le 11 octobre, à 4 heures du matin, nous sommes en route, et je continue à occuper seul la voiture. Le conducteur est toujours accompagné d'un postillon et d'un gamin, apprenti postillon. Ce dernier gagne 1 fr. par jour, le postillon 2 fr., et le conducteur 5 fr. Le postillon et son aide sont souvent obligés de renouer les courroies cassées, de courir auprès des mules de devant, car il y a triple attelage. Ils regagnent le siège en grimpant par des petits bouts de fer attachés à la voiture, pendant qu'elle continue sa course et ses sursauts. Dans une de ses ascensions, le petit gamin est tombé il y a peu de temps, la roue lui a passé sur le bras; il le porte enveloppé. Il me demande la permission de se reposer par intervalles dans la voiture, ce que je lui accorde volontiers. Il est couvert de haillons et porte des semelles de cuir (p. 162) attachées aux pieds par des courroies. L'intérêt que je lui montre le rend confiant, et à un moment donné il me dit: io me voi a suya tierra: je m'en vais à votre pays, emmenez-moi.—Et que viens-tu y faire?—Je vous servirai et je pourrai vivre; ici les 20 sous que je gagne sont à peine suffisants pour payer la nourriture que je prends en route, et malgré le métier pénible et dangereux, je suis toujours déchiré; je ne puis arriver à m'acheter une paire de souliers; et ce disant il me montre ses haillons et ses pieds meurtris. J'avais un veston de laine que j'avais acheté dans les Pyrénées et qui avait déjà fait mon premier tour du monde. Il m'avait rendu bien service dans les plaines glacées du nord de la Chine. Je le lui donne; il le met à l'instant, il est dans la jubilation; mais je doute que son bonheur soit aussi grand que le mien. Il n'y a pas de joie comparable à celle de faire des heureux.
À 8 heures nous arrivons à une hacienda importante, appelée Solis, propriété d'un Espagnol. Je me dirige vers la maison du maître; la dame, qui se tient sur la porte, un bambin au bras, se sauve à mon approche. Je visite la chapelle et vois sur la place 12 hommes occupés à égrener du maïs en frottant les épis sur un cylindre formé de noyaux d'épis de maïs étroitement liés. Une machine mue par un seul homme égrènerait plus de maïs en moins de temps, et les 22 bras rendus ainsi disponibles seraient une nouvelle force productive. Je reviens au rancho où je dois déjeuner. Il est couvert en feuilles de (p. 163) youcas. Plusieurs images de saints tapissent les murs d'adobe. Sur le lit une petite harpe indique le goût de la musique chez les habitants. Une bonne vieille me sert quelques aliments primitifs; je lui demande combien d'ouvriers occupe la ferme, elle me répond: una maquina! C'est sa manière d'exprimer un grand nombre. Même réponse concernant les animaux, les bergers, etc. Heureusement un Indien, qui me paraît intelligent, est mieux au fait, et répond à plusieurs de mes questions. La ferme a 5 lieues de long; elle a vendu récemment 400 mules au prix de 34 piastres chaque. Le cheval non dompté se vend 12 piastres, et celui qui est dompté 48. Un bon âne vaut 20 piastres; les vaches se paient de 15 à 30 piastres, selon la quantité de lait. Une paire de bœufs de labour vaut 40 piastres; les moutons, 3 piastres. Les bergers chefs sont payés 120 piastres l'an; les pèones, hommes de travail, reçoivent 2 réaux (1 fr.) par jour. Une criada (bonne) est payée de 3 à 6 piastres par mois; la viande se vend. 1 réal la livre. Les travailleurs achètent à la boutique du patron tout ce dont ils ont besoin. Les prix sont calculés de manière qu'après avoir à peine mangé, le pèon reste avec ses haillons et n'a jamais le sou.
Mais les mules sont attelées et je reprends ma route, grimpant sur l'impériale pour éviter la poussière. Les cactus font place à une espèce d'acacia mimosa aux grandes branches. Elles avancent vers la voiture et m'ont égratigné plus d'une fois. Cet arbre donne un fruit dont le bétail est friand. Par-ci par-là quelques chiens des (p. 164) prairies et de nombreuses vipères. Elles se nourrissent d'un fruit rouge produit d'un cactus appelé nopali. Au loin se dessine la sierra de Catorce et un pic volcanique appelé el frai.
À 1 heure 1/2, nous arrivons à Matehuala, ville de 18,000 habitants; la place est plantée d'arbres et les rues assez propres. Le chef politique, M. Jésus Sanchez, me présente à un Français, haciendado ou propriétaire dans le pays. J'aurais voulu m'arrêter quelques jours pour visiter les nombreuses mines du district de Catorce. M. Sanchez m'en aurait fourni toutes les facilités, mais le steamer de San-Francisco pour l'Australie part le 20 octobre, et j'ai encore bien du chemin à faire. Le manquer serait se mettre dans la nécessité d'attendre un mois pour l'autre départ, et arriver dans l'hémisphère austral au moment où le soleil l'atteint de plus près. Je me contente donc de demander à M. Sanchez des renseignements verbaux, qu'il me fournit avec la plus grande obligeance.
Le district de Quatorce contient 45,000 habitants et possède 5 mines de plomb, d'argent et de cuivre. Chaque mine emploie de 200 à 800 ouvriers. Les contre-maîtres sont payés 2 piastres par jour, les ouvriers travaillent à tarea (à la tâche), et reçoivent tant par mètre de trou de mine, tant par mètre de galerie, etc. Il n'y a point de société de secours mutuels, mais les propriétaires prennent chaque jour une cuchara, moitié d'une corne de bœuf, de minerai qui est mis à part et vendu par intervalles. Le (p. 165) produit est confié à l'administration, qui le distribue aux ouvriers en cas d'accident ou de maladie, selon les besoins de la famille. Le gouvernement projette des lois d'assurance et d'économie obligatoire d'après le système allemand; mais avant d'économiser il faut avoir d'abord le nécessaire.
M. Sanchez m'engage à visiter, à Cédral, la Hacienda de Beneficio, de Don Luiz Antonio Verume, qui est la plus importante. Je m'y rends vers le soir, à mon arrivée dans cette ville. Le directeur a la bonté de m'accompagner lui-même et de me donner de minutieuses explications. Le minerai d'argent vient de la mine de Concepcion, et est traité de trois manières différentes, selon sa composition. Il donne environ 3 marcos 1/2 de métal par tonne de minerai. Le premier système est celui que j'ai décrit en parlant de la Hacienda de Saint-François-Xavier à Guanajuato. Il a été inventé il y a 300 ans par Médina, aux mines de Pachuca. Le deuxième système est employé pour le minerai plus riche. On le place dans un four, avec du charbon et certains ingrédients. Par l'action du feu le plomb s'oxyde et l'argent reste séparé.
Le troisième système, inventé par Alfonso Barba au Pérou, il y a 400 ans, est l'amalgamation chaude employée pour le minerai contenant des iodures et bromures. Ce système tient des deux premiers. Un quatrième système est employé à Sonora et ailleurs, et consiste à extraire l'argent en le convertissant en chlorure au moyen du sel. Le mercure employé ici provient des mines d'Almaden (p. 166) en Espagne. On le paie 50 piastres le quintal, et il perd de 10 à 12% dans chaque opération. Les ouvriers gagnent depuis 4 réaux jusqu'à 2 piastres par jour. Il y a 5 mines à Catorce; 3 sont en perte en ce moment.
Cédral compte 5,000 habitants. Sur le marché je vois des oranges et des citrons; mais à l'hôtel je ne puis obtenir de vin. On me donne un vin de membrillo (de coing) qui ressemble au vin cuit. Le garçon qui me sert me demande le nom anglais de chaque objet qui lui tombe sous la main. Il en connaît déjà plusieurs; décidément il veut se rendre aux États-Unis.
Après souper, je prends mon repos dans une chambre à quatre lits, où, pour cette fois, je suis seul.
Le lendemain matin à 4 heures j'éveille les conducteurs et postillons. Ils ont passé la nuit sous le portique, étendus par terre dans une couverture. Le garçon de la veille m'apporte une chandelle de suif, et commence à me demander comment s'appelle le chandelier en anglais, comment le bol, la cuillère, le sucre, le café: il tient à continuer sa leçon.
Peu après les mules nous ramènent au milieu du désert. Une odeur parfumée m'avertit que sous les buissons poussent des plantes aromatiques. Les matinées sont presque toujours brumeuses, mais vers 9 heures le soleil se montre. Il a bientôt séché la rosée, et la poussière devient intolérable. Toutes les fois que, dans un village ou à une hacienda, on change les mules, je profite du temps pour visiter les maisons et les ranchos. Ils (p. 167) sont toujours bien misérables. Quelques-uns ont pour toiture des feuilles d'aloès. Dans ces pauvres cabanes couchent la famille et les chiens pêle-mêle: le matin les femmes sont occupées à faire les tortillas; elles broyent entre deux pierres la graine de maïs et préparent dans un poêlon de petits ronds de pâte mince, comme le font les Bretons avec le blé noir. Des fours en adobe, à côté des ranchos, indiquent qu'on sait faire aussi le pain. Dans une rancheria[4], au-dessus d'un noria on a suspendu un mouton entier pour le dessécher à l'air.
Ces norias, tournés par des mules, ne montent que quelques petits seaux de cuir.
À 11 heures 1/2 on m'arrête pour le déjeuner à la hacienda el Salado. L'administrateur m'apprend qu'on y sème 800 fanegas de maïs par an (la fanega équivaut à 75 livres.) Cette culture se fait à métairie. L'an dernier le propriétaire a eu 20,000 fanegas pour sa part. L'hacienda nourrit aussi de nombreuses bêtes: 4,000 chevaux, 1,000 ânesses, 2,000 vaches. On vend 600 chevaux l'an, au prix moyen de 40 piastres. Les habitants qui vivent de la ferme sont environ 600. Ils n'ont point d'église, mais des écoles pour les deux sexes. Dans cette hacienda, je vois préparer le fil d'aloès. On prend la partie intérieure de la plante, on la presse avec une règle de fer contre un rouleau de bois, et on tire par un bout. La partie grasse de la plante est ainsi raclée, et reste la partie filandreuse, (p. 168) qui est séchée au soleil. D'autres ouvriers prennent ces fils et en font des ficelles et des cordes par un procédé primitif. J'en vois qui, avec ces ficelles, font une trame qu'ils étendent dans la cour et la tissent en toile grossière d'emballage. D'autres empilent les filaments, qu'ils recouvrent d'un morceau de toile. Ce sont des selles ou bâts pour les mules et les baudets. Un peu plus loin un Indien fait les briques d'adobe. Il mélange une terre argileuse à du fumier, pétrit le tout avec de l'urine de cheval, et met la pâte dans un moule. Il en résulte une brique large de 30 centimètres, longue de 45, épaisse de 10, assez semblable aux briques chinoises. Elle résiste à l'action de l'eau. Avec ces briques on fait toutes les constructions dans l'Amérique espagnole. Dans les haciendas, elles servent aussi à construire d'immenses cônes dans lesquels on enferme la récolte.
Trois Indiens s'en vont de maison en maison, de rancho en rancho, jouant de la mandoline, de la harpe et de la guitare; ceux qui les demandent les paient 5 fr. l'heure.
Nous continuons notre route, et au prochain relais je vois dompter un cheval sauvage. Un Indien se tient en croupe avec peine; l'animal, par de terribles sauts de mouton, cherche à le jeter à terre; un autre Indien, avec une habileté qui tient du prodige, le lace de loin, tantôt à une jambe, tantôt à une autre, et arrête son élan.
Vers le soir, nous arrivons à la hacienda la Ventura, pour y passer la nuit. Le soleil envoie de l'horizon ses derniers rayons qui transforment les nuages en montagnes (p. 169) de feu. Les bergers ramènent leur troupeau, et les chiens, leurs fidèles auxiliaires, poussent les retardataires. Les chevaux viennent s'abreuver à l'étang, qu'ombragent des saules séculaires. Un petit agneau qui s'égare me lèche la main; les poules, les canards et les oies cherchent leur perchoir; le cultivateur rentre sa charrue, les enfants se réunissent et commencent leurs chansons et leurs rondes. Les feux s'allument dans les ranchos et le son doux de quelques harpes se fait entendre. Ceux qui habitent la campagne connaissent le charme des soirées de la ferme à la belle saison. Je jette quelques sous aux enfants, qui courent et se précipitent pour les saisir, et je visite quelques ranchos. La belle scène de la nature a son revers lorsque je rentre à l'auberge. Bientôt la voiture qui vient de Saltillo arrivé et amène des voyageurs. Il n'y a que deux chambres, sans fenêtre, et nous sommes huit. À table, maigre souper; pas de vin et une mauvaise cerveza (bière) à 5 réaux la demi-bouteille. Heureusement, j'ai encore un peu de rhum que j'ai apporté de la Jamaïque. On me dit que la ferme appartient à un général ex-ministre de la guerre et que l'auberge est pour son compte. Si j'étais général et que je voulusse me mêler de faire l'aubergiste, je m'efforcerais de mieux traiter mes hôtes. Après le souper, un superbe clair de lune nous invite à sortir.
Près de la ferme, un moulin à vent, fabriqué à Sant-Antonio, sert à tirer l'eau d'un puits. On voit que nous approchons des États-Unis. Un Indien plein d'expérience (p. 170) et de bon sens me renseigne sur beaucoup de choses. L'hacienda a coûté 10,000 piastres à son propriétaire, il y a deux ans. Il en demande maintenant 40,000. Mon interlocuteur m'en fait le budget annuel: 1,000 fanegas de maïs à 3 piastres, 3,000 piastres; 500 moutons à 3 piastres, 1,500 piastres; 200 mules ou vaches à 20 piastres, 4,000 piastres; produit de l'auberge à une moyenne de 6 voyageurs par jour, à 2 piastres chacun, 4,000 piastres. Total 12,500 piastres. Déduire 2,500 piastres de frais annuels, reste net 10,000 piastres, soit 50,000 fr. Avec cela on peut vivre commodément à l'étranger, se promener au central Park à New-York, ou jouer au billard dans un café de Paris. Mais pendant ce temps le reboisement des collines ne se fait pas; les sources de la montagne ne sont pas utilisées, le défrichement ne se poursuit pas, la situation des pauvres Indiens gardiens de troupeaux ou semeurs de maïs ne s'améliore pas.
Le lendemain matin à 4 heures, au moment où la voiture se met en marche, un grand gaillard armé de coutelas et de revolver entre et s'assied en face de moi. Il s'étend sur son banc pour dormir. On m'avait pourtant dit qu'il n'y avait pas d'autres passagers; qui est cet étranger?—Je lui demande où il va; il me répond: À une hacienda. Pour la première fois dans ma route, j'ai un peu d'appréhension, mon dernier jour de voiture serait-il le moins heureux? Je surveille l'inconnu et attends l'aube avec impatience.
Lorsque le jour arrive, j'éveille l'étrange compagnon (p. 171) et lui demande divers renseignements. Il m'apprend qu'il est le chef de la poste et qu'il va visiter une station voisine. J'en profite pour me renseigner sur tout ce que je vois. Un Indien à cheval ramène au bout du lazo un teçon, espèce de porc épic. Je vois sur une charrette un jeune cerf, et j'apprends que cet animal abonde dans les environs: de temps en temps quelque carcasse de vache ou de cheval; ce sont les léopards, les petits lions d'Amérique et les ours qui les tuent et en font leur pâture. Mon compagnon me quitte et je continue ma route à travers des collines rocailleuses et désertes. L'immense plaine que je traverse depuis 6 jours est à 16 et 1,800 mètres d'altitude. Le thermomètre montait à 30° dans le jour et descendait à 20° durant la nuit.
Cette plaine ressemble à celle du Punjab dans l'Hindoustan. Mais là l'Hindou a creusé partout des puits par lesquels il arrose son blé, et la population s'est multipliée. Ici l'Indien n'est pas propriétaire, il ne peut penser à aucune amélioration; il languit et la population diminue.
Lorsqu'en un pays assez grand et assez riche pour nourrir dans l'abondance de nombreux millions d'habitants, on en voit languir un petit nombre, il faut croire que l'organisation sociale laisse à désirer. Avant la conquête espagnole, le Mexique nourrissait 16,000,000 d'habitants, et il n'y avait alors ni les voies de communication qui empêchent les famines, ni les machines perfectionnées qui multiplient l'action de l'homme. Le Mexique (p. 172) devrait nourrir maintenant dans l'abondance au moins 100,000,000 d'habitants, et il n'en contient que 10,000,000!
Le soir, à 5 heures, j'arrive à Saltillo, à l'hôtel Escoban.
Saltillo, à 1,500 mètres d'altitude, est dans l'État de Coahuila et contient 18,000 habitants.
La ville est assez bien tracée; une alameda fournit aux habitants une promenade ombragée. L'église est surchargée de sculptures; au marché je remarque de nombreux restaurants pour le peuple. Sur les murs, les perpétuelles affiches de Corrida de Toros.
J'espère enfin trouver un bain. On m'adresse à un établissement hors la ville. On s'y baigne dans un réservoir à eau courante.
Dans quelques mois les deux républiques de l'Amérique du Nord seront reliées par le chemin de fer. Le voyageur ne sera plus balloté durant de longues journées dans la diligence, mais je ne regrette pas ma course: elle m'a permis de voir et de juger sur place l'intérieur du pays.
14 octobre.—Le temps presse, et quoique je n'aime pas voyager le dimanche, je suis forcé de continuer ma route. À 5 heures du matin je trouve l'église encore fermée et le peuple attendant à la porte. À 6 heures je suis à la gare pour le départ. Cette gare est un simple wagon où l'on prend son billet; une tente sert de bureau pour l'enregistrement des bagages. Le tronçon de Monterey à Saltillo n'est ouvert que depuis un mois. La voie a Om93 (p. 173) de large; les traverses sont en sapin; les rails, en acier, y sont tenus par un clou.
La campagne est bien cultivée: les pommes, les poires et le raisin viennent à merveille. Les animaux s'effraient et fuient au passage des trains. Les premiers jours les Indiens en faisaient autant. Bientôt nous entrons dans une région montagneuse, et nous descendons rapidement. À Pescheria on me parle d'une grotte gigantesque des environs. D'après la description qu'on m'en fait, elle dépasserait en grandeur et en beauté la fameuse grotte Adelberg des environs de Trieste. Un jeune Français que je trouve dans le train m'apprend que son père est propriétaire d'une des 5 filatures de coton de Saltillo. Sa filature a 1,000 broches. Cette industrie est en progrès, mais les impôts sont en train de la ruiner.
Nous voyons encore quelques chiens des prairies; ils sont très habiles à chasser le lièvre. À cet effet, ils se réunissent par bandes. Les uns se postent comme nos chasseurs, et les autres font la battue. Lorsqu'un d'eux a saisi le gibier, il appelle et attend les autres pour le partage. Les zorra ou renards abondent aussi, et parmi les serpents, celui à sonnette est le plus commun.
La voie continue à descendre et traverse les cours d'eau sur des ponts de bois. À Santa-Cattarina, mon baromètre anéroïde ne marque plus que 500 mètres d'altitude, et je revois la canne à sucre. La sécheresse persiste ici comme dans tout le nord du Mexique. La récolte de maïs est perdue, le prix en doublera et la maigre (p. 174) pitance du peuple en sera encore réduite. Les wagons portent écrit en langue anglaise et en langue espagnole la défense de fumer. Tous les Mexicains fument, les Américains du Nord se plient à la consigne. J'ai déjà remarqué bien des fois le penchant à faire peu de cas de la loi chez les nations latines, et l'habitude contraire chez les Anglo-Saxons.
À Monterey, capitale de Nueva-Leon, j'aperçois, au pied d'une colline, une chapelle de Notre-Dame de Lourdes. Enfin, nous sortons des montagnes et abordons la plaine sans fin. Vers 7 heures du soir, à Laredo, nous atteignons le Rio-Grande, que nous traversons sur un pont de bois. Cette rivière m'a paru fort étroite et ment à son nom. La petite ville de Laredo est à cheval sur les deux rives; nous stoppons sur la rive des États-Unis de l'Amérique du Nord, et je change mon wagon contre un Pullmann sleeping-car. Le matin, quand je quitte mon lit, je me trouve à la gare de Sant-Antonio, capitale du Texas.[Table des matières]
États-Unis.
Le Texas. — Les progrès depuis l'abolition de l'esclavage. — Les Congrégations religieuses. — Prix des terres. — Les casernes. — Les Nègres et leur ostracisme. — Départ pour San-Francisco. — Les métiers d'un Yankee. — Les plantations de coton. — Les cliffs du Rio-Grande. — Les stations dans le désert. — La consommation de la bière. — Le Nouveau Mexique. — L'Arizona. — Les Mormons. — Les Chinois. — Le Rio-Colorado. — Yuma. — Indio. — Le désert du Colorado.
Le Texas appartenait au Mexique: il fut annexé aux États-Unis avec le Nouveau Mexique et la Haute-Californie, en 1848, à la suite d'une guerre acharnée qui amena les Américains du Nord jusqu'à Mexico. Le Texas est l'État le plus vaste des États-Unis; il comprend 170,000,000 d'acres ou 266,000 milles carrés, avec plus d'un million et demi d'habitants. Il nourrissait en 1881 plus de 14,000,000 d'animaux, dont 1,000,000 de chevaux, 5,500,000 moutons, 5,000,000 de bœufs et 2,000,000 de porcs. Depuis 1881, ce nombre a augmenté de plus de 4,000,000. Les États du Sud, si éprouvés par la guerre de sécession, ont non seulement retrouvé leur ancienne prospérité, mais l'ont augmentée. La culture du coton est plus que doublée et une grande partie est déjà filée sur place. Sur le Mississipi on utilise même les peaux de (p. 176) crocodile: je lis dans un journal une annonce qui en demande 5,000 à l'instant. L'ancien état de servitude pouvait bien enrichir un certain nombre de planteurs, mais tout état contre nature n'est jamais profitable. Depuis l'abolition de l'esclavage, un plus grand nombre de gens libres vivent sur ces états et y prospèrent.
Les maisons d'adobe ont fait place aux maisons de bois; les rues étroites, aux larges avenues plantées d'arbres et bordées de jardins. Nous sommes dans l'Amérique anglo-saxonne. Dans le quartier du commerce, on voit de beaux édifices en pierre; les abords de la ville sont semés de gracieuses villas. L'Anglo-Saxon ne veut de la ville que pour les affaires. Pour ses enfants, il préfère l'air bienfaisant des champs, et le jardin où ils prennent leurs ébats.
La petite ville de Sant-Antonio, qui ne comptait que 20,000 habitants en 1881, en a gagné 10,000 de plus en deux ans. C'est une ville en construction. On voit partout de hautes cheminées qui indiquent la présence de la vapeur.
Mon premier soin est de m'informer du moyen d'atteindre San-Francisco. J'apprends qu'une ligne, récemment ouverte, m'y conduira en quatre jours, moyennant 79 dollars et 11 dollars en plus pour le sleeping-car, je pourrai ainsi arriver la veille du départ de mon steamer. Le train part le soir; j'ai donc toute la journée pour Sant-Antonio. Je me dirige vers un changeur pour avoir de la monnaie du pays; c'est l'ennui du (p. 177) voyageur chaque fois qu'il passe une frontière. Comme je l'ai déjà observé, une monnaie de valeur identique pour le monde entier nous délivrerait des changeurs et de leurs spéculations.
À Sant-Antonio, je visite l'hôpital tenu par les Sœurs du Verbe Incarné, dont la maison mère est à Lyon, en France. Elles ont ici 60 novices et desservent de nombreuses écoles et hospices dans le Texas et ailleurs. L'hôpital est plutôt une maison de santé. On y paie une pension de 2 dollars et de 1 dollar 1/2 par jour. Les malades envoyés par la municipalité ne paient que 60 cens (3 fr.).
Les Ursulines tiennent un pensionnat. Les Sœurs de la Providence de Lorraine ont de nombreuses écoles. Sant-Antonio compte 12,000 catholiques irlandais, allemands, mexicains, français. Ils sympathisent peu les uns avec les autres, et il a fallu établir une église pour chaque nationalité. Celle des Français a dû être fermée faute de fidèles. Trop souvent à l'étranger le Français ne prend le chemin de l'église qu'à l'occasion des décès ou des naissances. Je me renseigne auprès de divers bureaux d'affaires. On m'offre des lots de 3, 10, 15, 20 et 200,000 acres au prix de 1 à 3 dollars l'acre (arpent). Les uns servent à la culture du coton, les autres à l'élevage des moutons, des bœufs et des chevaux.
C'est toujours la même nature que j'ai laissée au Mexique; la terre produit des cactus et des mimosas: toujours même sécheresse. Mais pendant que les propriétaires (p. 178) du Mexique restent les bras croisés ou creusent un puits pour y établir un noria avec quelques seaux de cuirs, ici on perce des puits artésiens qui fournissent l'eau en abondance. Les terrains arrosés se vendent plus cher: de 4 à 5 dollars l'acre, les spéculateurs les convertissent en prairies, achètent l'hiver les moutons à 1 dollar 1/2, les engraissent et les revendent le double au printemps. On m'offre aussi dans un Bureau de vente des terrains à fruits et légumes aux environs de la ville. On en demande de 15 à 20 dollars l'acre, y compris la petite maison en bois. Dans un de ces Bureaux je trouve un journal spécialement destiné aux éleveurs de moutons. Il y en a pour les éleveurs de gros bétail, pour les agriculteurs, etc.; toujours et partout en deçà du Rio-Grande, l'association sous toutes les formes fait profiter les uns de l'expérience des autres et multiplie les forces.
Ici, comme à Panama, les bains se prennent chez les perruquiers.
Un landau me conduit dans les environs aux barracks ou casernes. Il est un peu cher: 2 dollars l'heure, mais un nègre en livrée le conduit et un autre nègre sert de valet de pied.
Les États-Unis entretiennent un bon nombre de soldats sur la frontière mexicaine. À 4 milles dans la campagne, j'arrive à un immense bâtiment en pierre à un étage sur rez-de-chaussée. Dans la cour, je vois des fourgons, des affûts, des cordages, etc. Ce sont les chantiers et les magasins. Au milieu de la cour s'élève une haute tour qui (p. 179) sert probablement à observer les mouvements de l'ennemi. À côté de ce bâtiment, un joli parc est semé d'une vingtaine de cottages, demeure des officiers et de leurs familles. Les cottages des sous-officiers sont un peu plus loin et plus simples. Je tourne le parc et arrive aux baraques des soldats. On a creusé la terre à 3 mètres sur un hectare environ, et dans ce bas-fond on a élevé les baraques et les tentes du camp, probablement pour les mettre à l'abri des balles sinon des obus.
Au retour, mon nègre me conduit à la station. Ils sont nombreux les nègres au Texas. À Sant-Antonio, ils ont pour eux une église spéciale. Le Yankee, ordinairement si libéral, est intraitable lorsqu'il s'agit du nègre. Il a ruiné jadis les États du Sud pour l'affranchir, mais il ne le veut avec lui ni à l'église, ni au théâtre, ni en chemin de fer, ni au café. Une loi avait été faite pour le mettre sous ce rapport sur le pied d'égalité avec les blancs. Dans les divers États, les nègres avaient réclamé devant les magistrats le bénéfice de cette loi. Une décision de la Cour suprême, à Washington, vient de débouter les nègres, déclarant la loi inconstitutionnelle.
À 6 heures la locomotive siffle et nous emporte; elle traverse une partie de la ville en avertissant par sa cloche les habitants d'avoir à se garer; puis nous voilà dans les champs. Nous avons plus de 3,000 kilomètres de Sant-Antonio à San-Francisco. La locomotive les franchira en moins de 4 jours, à raison de 45 kilomètres à l'heure. Le train le plus rapide en Amérique est celui du Canada (p. 180) entre Coteau-station et Ottawa. Il parcourt 50 milles à l'heure, soit environ 80 kilomètres. Le train entre Londres et Bristol franchit en 2 heures la distance de 118 milles 1/4 qui sépare les deux villes, ce qui fait une vélocité de presque 100 kilomètres à l'heure.
Un Yankee prend place près de moi. Il va inspecter les restaurants qu'il tient dans les gares. C'est son métier actuel et ce ne sera pas le dernier. Il en a déjà fait plusieurs, et entre autres, celui d'armateur. Sans connaître un mot de français, il est allé au Havre avec un navire chargé de blé et de jambons, et l'a ramené plein d'émigrants. Il s'occupe aussi de plantations de coton dans le Texas, et en quatre temps, il me fait le budget de cette culture. Aux récoltes moyennes il faut 2 acres, au Texas, pour produire une balle de coton. Le labourage coûte 2 dollars, l'ensemencement 2 dollars, la main-d'œuvre, durant les quatre mois qu'exige la culture (avril, mai, juin, juillet) 30 dollars; la récolte 16 dollars; séparer les graines, emballer et envoyer au marché 4 dollars; assurance et courtage 3 dollars. Total: 57 dollars. Or, la balle vaut de 75 à 80 dollars, donc bénéfice net 18 à 23 dollars. Les années heureuses donnent 1 balle 1/2 pour 2 acres.
Le propriétaire qui ne peut assez surveiller son monde donne la récolte à moitié aux nègres; il leur fournit la terre, la graine et les bœufs. Le nègre met le travail et on partage; mais le nègre se fournit du nécessaire à la boutique que le propriétaire entretient sur la ferme. Or, celui-ci règle les prix de manière que le gros bénéfice lui (p. 181) reste. Lorsque le nègre vient chercher sa part du prix de vente, on lui ouvre le registre des avances en nature, et il lui reste bien peu à prendre. On procède à peu près de même dans les métairies à maïs.
La voie, ouverte en février dernier, a une largeur de 1m30. La Compagnie a reçu gratuitement les terrains qui la bordent, et elle les vend de 2 à 5 dollars l'acre.
On est commodément dans les lits des Pullmann-cars, mais les wagons américains sont suspendus d'une manière malheureuse. Comme je l'ai déjà dit, leur balancement, donne le mal de mer. Vers 5 heures on m'éveille pour jouir du paysage pittoresque. La voie longe le Rio-Grande et pénètre entre des cliffs, où des rochers à pic très élevés la surplombent. Nous traversons des tunnels et parcourons un pays très accidenté. À Eagle's nest (nid d'aigle) mon baromètre marque 350 mètres d'altitude et le thermomètre 30° centigrades. Les stations ont parfois quelques tentes, sous lesquelles on voit femmes et enfants; le plus souvent rien que la petite baraque des employés. À juger par les amoncellements de bouteilles vides qui les entourent, ils sont grands buveurs de bière. Dans l'Amérique du Nord, la consommation de la bière atteint 40 bouteilles par habitant; 24 en France, 51 en Hollande, 40 en Suède et Norwège, 39 en Suisse, 34 en Autriche, 115 en Angleterre.
Le combustible de la locomotive est le bois; les puits qui fournissent l'eau ont parfois 200 mètres de profondeur. On voit par-ci par-là des Chinois réparant la route. (p. 182) Ils ont tous un chapeau en jonc forme chinoise. Nous voyons des troupes d'antilopes et de nombreux lapins. À une station 12 cavaliers poussent devant eux un millier de bœufs. Ils ont bien du mal à les faire entrer dans l'enceinte par où ils passeront dans les wagons.

États-Unis.—New-Mexico.—Big-Bow, chef des Kiowas.
Nous quittons le Texas et entrons dans le Nouveau-Mexique. Des officiers avec leurs femmes descendent sur divers points pour rejoindre Fort Stockton, Fort Davis et autres forts d'où ils surveillent la frontière et les Indiens.
À Murphysville je cherche la ville; je ne vois que 4 baraques. Elle viendra plus tard. La voie continue à monter; à Marpha nous sommes à 1,400 mètres d'altitude. L'air est pur et frais. Le soleil se drape de nuages de feu (p. 183) et disparaît. Je reprends mon lit. Au Paso del Norte, un embranchement rejoint les lignes du Colorado. La nature est toujours la même: le désert et le bétail.
À Demening, nous prenons les voyageurs qui descendent de Denver (Colorado), par Santa-Fé. Parmi eux je distingue un Jésuite qui arrive de Monaco pour enseigner la philosophie au collège de Santa Clara (Californie). Il m'apprend que leurs Pères chassés de France sont venus fonder un collège à la Nouvelle-Orléans. À Demening, on quitte le Nouveau Mexique et on entre dans l'Arizona. Cet État voisin de l'Utah commence à être envahi par les Mormons. L'apôtre Cannon, dans une récente conférence à leur tabernacle, à Salt-Lake-City, a ainsi établi leur dernier recensement. Les Mormons sont dans l'Utah 127,294 membres, représentant 22,000 familles; 37,000 ont moins de 8 ans. Durant les six derniers mois, il y a eu en Utah 2,300 naissances, dont 1,200 du sexe masculin et 1,100 du sexe féminin, et 782 décès. Pendant la même période, le nombre des membres nouvellement admis a été de 23,040. L'Église compte 12 apôtres, 58 patriarches, 3,885 seventies, 11,000 anciens, 1,500 évêques et 4,400 diacres. Les Mormons sont 2,264 en Arizona et le double en Idaho; 81 missionnaires ont été désignés pour propager la foi des Saints des derniers jours en Europe et en Amérique. La polygamie a été recommandée.
Trois arrêts de 20 minutes à trois stations, le matin, vers midi, et le soir, donnent le temps de prendre les repas. Parfois la salle du restaurant n'est qu'un wagon à (p. 184) côté de la voie. La nourriture laisse à désirer: viandes dures, soupe au poivre et légumes sans sel. On paie de 75 cents ou 1 dollar par repas, selon les stations, vin à part. La moindre bouteille coûte 5 fr. L'Américain ne reste jamais plus de 10 minutes à ses repas. On n'ose rester à table quand tout le monde est parti, de crainte que le train ne vous laisse. Le long de la route on voit des affiches indiquant l'hôtel à prendre à Sacramento, à Los Angeles ou autre ville à 1,000 milles de là. Nous laissons un embranchement qui va à Silver-City. Son nom indique les mines d'argent. Plusieurs y ont fait de rapides fortunes. Nous atteignons une espèce de désert argileux. Le mirage est tel que les montagnes éloignées nous paraissent fort près, et comme détachées du sol. À Bensan, nous laissons un embranchement qui descend à Guaymas, dans le golfe de Californie. Une affiche demande 500 ouvriers pour travailler au chemin de fer. Trois wagons amènent 150 coolies chinois qui puent l'opium. À Tucson, un Américain déguisé en Indien vend des bâtons de cactus, des curiosités indiennes, et de prétendues graines de fleurs diverses à 10 sous la graine. Parmi ces graines je distingue des pois-chiches.
Le 18 octobre, à 6 heures du matin, en me levant, je vois le Rio-Colorado à la station de Yuma. Cette rivière sépare l'Arizona de la Californie. Des bateaux à vapeur poussés par une grande roue à l'arrière le remontent depuis le golfe de Californie jusqu'ici à 80 milles, et jusqu'à 300 autres milles au dessus. À Yuma nous prenons l'heure (p. 185) de San-Francisco en reculant nos montres de 2 heures.

États-Unis.—Yuma.—Indiens de l'Arizona.
Des affiches et des programmes, qu'on nous distribue à l'hôtel, recommandent la station de Yuma pour les malades. Ces programmes disent que le thermomètre ne descend l'hiver qu'à quelques degrés au dessous de 0, et que l'été il ne dépasse pas 107° Farenheit, soit 34° centigrades. Bon pour se faire rôtir! La voie descend, et à Indio, elle est à (p. 186) 100 pieds sous le niveau de la mer. Nous sommes dans un désert, qui a 70 milles de large et 140 de long. Nous le suivons pendant longtemps; la poussière trouve moyen de pénétrer et de nous suffoquer dans le wagon malgré les doubles vitres. Toujours du sable et quelques buissons comme entre la Sierra-Nevada et les Montagnes Rocheuses. La voie recommence à monter. Nous sommes à 300 mètres d'altitude, lorsque nous voyons devant nous de hautes montagnes avec des forêts de sapin blanchies de neige. À certaines stations, je remarque des groupes d'Indiens, les uns nus, les autres vêtus. Leurs cheveux sont longs, noirs et épars, leur peau est rougeâtre. Quelques-uns ont le coutelas à la ceinture. Tous ces Indiens de l'Amérique du Nord ne peuvent pas toujours se comprendre entre eux par la parole, car ils parlent 76 dialectes différents. Toutefois ils s'entendent toujours parfaitement par signes. Ils s'appellent le jour en faisant un feu de branches vertes sous une couverture. En retirant la couverture, la colonne de fumée qui s'élève est le signe de ralliement. La nuit, ils font un feu d'herbes sèches. Un cavalier galopant rapidement en rond est le signe d'un danger. Quand ils marchent, ils tracent sur le sable des figures d'animaux, qui disent à ceux qui suivent ce qu'ils auront à faire. Quand ils se rencontrent, ils peuvent se raconter par signe l'action des ennemis, les épisodes d'un combat, etc.
À Colton, nous laissons un embranchement qui s'en va à San Diego, sur le Pacifique.[Table des matières]
La Californie. — Los Angeles. — La production de l'or. — Les produits agricoles. — Le papier-monnaie. — La vallée de Yosemity et les arbres géants. — Oakland. — San-Francisco. — La baie. — La crise. — Le nouveau traité avec la Chine et la question chinoise. — Les coolies et l'opium. — La richesse des États-Unis. — La rémunération du travail et du capital. — Les divorces et les avortements. — Les monopoles et la concurrence. — La population. — Importation. — Exportation. — Revenus. — Dette. — Chemins de fer. — Les Américains ne nous aiment pas. — Les réformes nécessaires pour former un peuple fort et sérieux.
Vers le soir, nous traversons de belles fermes, puis viennent les vignes, les fruits et les légumes; nous sommes à Los Angeles. La salle du restaurant est toute enguirlandée de fleurs. Un groupe de francs-maçons de l'Est a visité l'Ouest, et on les a fêtés. La petite ville de Los Angeles a ses maisons en bois et plusieurs églises; elle compte 20,000 habitants. Les Lazaristes y ont un collège. Elle centralise les produits de la région; partout d'immenses entrepôts de blé et de laine. On cultive maintenant la terre en Californie. Au début on n'y cherchait que l'or. L'or a presque toujours été l'attrait providentiel qui a amené les hommes dans les contrées nouvelles. Sans lui on n'aurait jamais pensé à les peupler. L'or attire l'homme comme le sucre les fourmis; quand les fourmis ont mangé le sucre, elles restent et font leurs (p. 188) maisons. On calcule que l'or employé aux arts atteint maintenant 80,000,000 de dollars. Les mines d'or de Californie entre 1850 et 1860 ont produit 610,000,000 de dollars. De 1860 à 1870, 369,000,000 de dollars, et de 1870 à 1880, 193,386,000.
Mais si elle produit moins d'or, la Californie donne tous les ans plus de produits agricoles. En 1880, elle a donné presque 2,000,000 de boisseaux de maïs (le boisseau équivaut à 35 litres); 30,000,000 de boisseaux de blé; 1,500,000 boisseaux d'avoine, et 12,500,000 boisseaux d'orge; ce qui vaut bien des millions de dollars. Ajoutez à cela 2,000,000 de livres de fruits, sans compter le vin. La production en augmente tous les ans; ainsi, seulement dans les premiers mois de 1883, l'exportation des fruits a déjà dépassé 14,500,000 livres. Sur ce chiffre, Los Angeles entre pour presque 5,000,000 de livres.
On fait la guerre à l'argent et on veut le démonétiser, mais c'est plutôt aux petits chiffons de papier, qu'on voit encore dans plusieurs États, qu'il faudrait faire la guerre. Ils communiquent la gale, se déchirent, se brûlent, se perdent, et c'est surtout le petit peuple qui en souffre le plus, car il n'a pas de coffre-fort pour les préserver des rats. Sur 46,000,000 de dollars de papier-monnaie aux États-Unis, environ 17,000,000 ne sont plus rentrés et ont été considérés comme perdus. Cela fait un joli profit pour l'État, et il en est de même pour les banques.
Los Angeles est la capitale du Sud et semble appelée à un grand avenir.
(p. 189) Le 19 octobre, à 6 heures 1/2 du matin, lorsque je quitte mon lit, le train arrive à Madera. C'est de là que part tous les matins la diligence pour Josemity-Valley. J'ai déjà dit dans mon voyage aux États-Unis[5] que dans les environs de cette curieuse vallée on voit les fameux big trees, sequoia gigantea qui ont 400 pieds de haut et 35 pieds de diamètre.
Plus loin, à Merced, nous déjeunons dans un hôtel élégant. Ensuite la voie traverse une plaine sablonneuse et sillonnée de petits cours d'eau. Elle atteint enfin la rivière Sacramento, que remontent de nombreux steamers, dont la seule roue, de grande dimension, se trouve à l'arrière. Nous commençons à voir de nombreuses cheminées indiquant la présence d'une population industrieuse. Nous sommes à Oakland (terre du chêne). La ville s'est encore étendue vers la colline depuis que je l'ai vue il y a 2 ans. En quittant le train nous prenons place dans la salle d'attente du pier (môle), et bientôt nous passons au premier étage de l'immense ferry-boat qui en 20 minutes nous déposera de l'autre côté de la baie.
Cette baie a 60 milles de long et 3 de large. Elle est donc plus grande que celle de Rio-Janeiro, mais elle est loin d'être aussi gracieuse. Ses rives sont nues, et ses quelques îles, des rochers arides, pendant qu'à Rio les bords et les îles sont revêtus d'une végétation tropicale.
(p. 190) San-Francisco, sur une langue de terre, entre la baie et l'Océan, est presque toujours enveloppée de brumes. Nous commençons par apercevoir les mâts des nombreux navires, puis les clochers et les maisons. À 2 heures 1/2 nous débarquons à Market street. Je dépose mes bagages au Palace-Hôtel, et je cours à la banque. J'y arrive au moment où l'on allait fermer la porte, mais assez à temps pour obtenir l'argent dont j'ai besoin pour atteindre l'Australie.
L'Américain est si pratique pour tout ce qui concerne l'argent, que je trouve dans un journal, sur un petit carré, la méthode pour calculer les intérêts depuis le 4 jusqu'au 20%. Une note au dessous dit: Coupe ce carré et colle-le dans ton chapeau.
Je passe ma soirée à voir les amis que j'avais connus il y a 2 ans. À la poste, je trouve de nombreuses lettres, et comme le navire part le lendemain, je n'ai que la nuit pour les lire et y répondre. Après 6 jours de diligence et plusieurs jours de railway, j'aurais bien voulu me reposer quelques jours, ou tout au moins quelques nuits; mais on ne fait pas toujours ce que l'on veut, et le plus souvent ce que l'on peut. Le travail est pour cette vie, l'éternité pour le repos.
Le lendemain, je parcourus encore une fois, avec plaisir, San-Francisco, cette immense et riche capitale de la Californie que j'ai décrite dans mon premier tour du monde. Je l'avais laissée sur une crise; elle en sort maintenant. Avant le chemin de fer, son port desservait (p. 191) une partie de l'intérieur; la voie ferrée lui a supprimé ce transit. Les mines ont été en partie délaissées. Malgré cela, son agriculture a fait face à tout, et le pays devient de plus en plus prospère. On cite plusieurs individus qui possèdent plus de 100,000,000 de dollars.
Une autre crise est à craindre par le manque de main-d'œuvre. En effet, depuis quelques mois est entré en vigueur le nouveau traité avec la Chine. En vertu de ce traité, ne peuvent venir aux États-Unis que les Chinois voyageant pour étude ou agrément, et les commerçants. C'est l'exclusion des coolies. On les déteste parce qu'ils font baisser les salaires, parce qu'ils restent Chinois, économisent et emportent l'argent.
L'immigration, qui l'an dernier atteignait encore près de 8,000 individus, est descendue de ce fait, cette année, à quelques centaines. Comment continuera-t-on à faire les chemins de fer et à ramasser les récoltes?
Les salaires sont assez chers et augmenteront encore.
On paie un journalier de 1 à 2 dollars par jour, un briquetier gagne de 2 à 3 dollars; les maçons, les peintres, les forgerons, de 3 à 4 dollars; les cordonniers, les tailleurs, 16 dollars par semaine; les garçons de ferme reçoivent de 20 à 30 dollars par mois, logement et nourriture en sus.
On cultive toujours plus les fruits et la vigne; je lis dans un journal l'avis d'un propriétaire indiquant qu'il a plus de pommes qu'il n'en peut recueillir, et invite le public à aller les prendre. Les pieds de vigne se plantent (p. 192) par millions, j'apprends avec plaisir que parmi les plus grands planteurs figurent plusieurs Français. Mais qui vendangera dans 3 ans?
On fait de grands efforts pour amener l'immigration européenne. En vertu de la loi d'homestead, tout individu qui déclare vouloir devenir citoyen américain reçoit gratuitement 160 acres de terre, à la condition qu'il y séjourne et la cultive pendant 5 ans. Les Compagnies des chemins de fer vendent leurs terres de 2 à 5 dollars l'acre; mais les immigrants sont attirés en route par d'autres États qui se les partagent. Le parti démocrate voudrait donc rappeler les Chinois.
Ceux-ci, au reste, cherchent à passer de contrebande. L'autorité chinoise n'est pas difficile à donner des certificats de commerçants; elle en donne aux vendeurs de fruits, de légumes et d'allumettes, et la police à San-Francisco est embarrassée. En somme, la question chinoise a changé de face, mais elle reste debout. Je ne puis voir un Chinois qui ne pue l'opium. À ce propos, je ne sais comprendre comment l'Angleterre, qui a été assez généreuse pour se mettre à la tête de la croisade contre l'esclavage, continue à empoisonner un peuple de 450,000,000 d'habitants avec sa drogue des Indes, et cela pour un simple gain matériel. En 1843, l'Angleterre importait, de contrebande, en Chine, 26,000 caisses d'opium. Après qu'en 1860, nous l'avons aidée à obtenir la libre entrée de l'opium, moyennant un droit de 30 taels (230 fr.) par picul (60 kilog. 1/2), l'importation a pris des proportions (p. 193) effrayantes. En 1873, elle atteignait 52,000 caisses au prix moyen de 3,200 fr. la caisse, et en 1881, elle représentait une valeur de 37,592,000 taels, environ 270,000,000 de francs. Je sais qu'il y a des âmes généreuses en Angleterre qui protestent contre cet empoisonnement d'un peuple qui est le quart de la race humaine. Je souhaite que leur action aboutisse bientôt à la suppression du scandaleux trafic, car si Dieu parfois paie tard, il paie toujours et il paie juste! Ce n'est jamais impunément qu'on viole la maxime de l'Évangile: Ne faites pas à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fît.
Les États-Unis se vantent d'être plus riches que la Grande-Bretagne. Leur richesse en terres, capitaux, chemins de fer, est évaluée à 50 milliards de dollars (250 milliards de francs) pendant que celle du Royaume-Uni n'atteint que 40 milliards. Par contre, la richesse en Angleterre atteint 1,160 dollars par tête d'habitants et seulement 995 dollars en Amérique. Quant à la rémunération du travail, d'après le Times de Londres, elle serait la suivante: Dans la Grande-Bretagne, sur 100 parts, 56 vont au travail, 21 au capital, et 23 au gouvernement; en France 41 vont au travail, 36 au capital et 23 au gouvernement; aux États-Unis 72 parts vont au travail, 23 au capital et 5 au gouvernement. Le gouvernement est donc 5 fois meilleur marché ici qu'en France et en Angleterre. En effet, presque pas d'armée, presque pas de marine. Ces milliers de bras qui languissent dans nos casernes et qui coûtent si cher sont employés ici au travail productif. (p. 194) Mais tout n'est pas parfait, et il y a aussi des taches de ce côté de l'Océan. Les divorces se multiplient dans une proportion effrayante, et la plaie des avortements criminels continue à s'étendre dans les États de l'Est. Sur les journaux, on voit des annonces comme celles-ci: Divorces, M. X..., rue ..., no ..., Attorney-at-laws, avis gratuits, 18 ans d'expérience...; affaires traitées légalement et sans bruit. Dans la ville de Philadelphie, on a découvert dernièrement 65 fœtus dans la maison d'un seul médecin!
Le suffrage universel, malgré une connaissance des affaires du pays plus répandue ici dans le peuple qu'en Europe, porte des fruits de corruption. Après la guerre de sécession, on a créé des impôts indirects et une armée de fonctionnaires pour les percevoir. Ceux-ci sont à la discrétion des gouvernants, et d'autre part le besogneux sera partout et toujours plus ou moins à vendre. Les grandes Compagnies de télégraphe, de chemins de fer, des eaux, du gaz, etc., et les banques font sentir le poids de leur monopole un peu partout. Heureusement on sait encore lutter dans ce pays. On est peu habitué à tout attendre du gouvernement, et la presse et la parole sont mises largement à profit contre les exploiteurs. Déjà on espère se débarrasser ici du joug des deux anciennes Compagnies de chemin de fer du Pacifique. La Central-Union et la South-Pacific s'étaient étendues; leurs tarifs étaient si exorbitants que les marchandises du Japon prenaient le chemin de l'Europe pour venir à New-York. Une troisième compagnie, la Northern-Pacific, a ouvert sa (p. 195) ligne, et une quatrième ligne directe de Saint-Louis à San-Francisco va être inaugurée incessamment. La Northern-Pacific refuse de se liguer avec les autres et la concurrence va faire son œuvre.
La population des États-Unis, qui en 1870 comptait 33,000,000 de blancs, 5,000,000 de nègres et 63,000 Chinois, en 1880 compte 43,000,000 de blancs, 7,000,000 de nègres et 100,000 Chinois. Ceux-ci ont donc augmenté en 10 ans de 66%; les noirs de 34% et les blancs de 29%. En suivant la même progression, en 30 ans on dépassera 100 millions. L'État de Californie, qui a presque la surface de la France, figure actuellement dans la population pour un peu moins d'un million. Pour tous les États-Unis en 1882, l'importation a atteint en chiffre rond 767 millions de dollars, et l'exportation 800,000,000 de dollars. Le revenu a été de 403,000,000 de dollars, et la dépense, sauf l'intérêt de la dette, de 186,000,000 de dollars. La dette, qui dépassait encore 2 milliards de dollars en 1870, est réduite de plus de 1/2 milliard de dollars en 1882.
Pour servir de comparaison nous plaçons le tableau ci-dessous pour 1882 en dollars et en chiffres ronds:
| dette publique | revenu | dépenses | importation | exportation | |
| Angleterre | 4,000,000,000 | 429,000,000 | 427,000,000 | 2,137,000,000 | 1,491,000,000 |
| France | 4,683,000,000 | 712,000,000 | 714,000,000 | 987,000,000 | 722,000,000 |
| Allemagne | 1,340,000,000 | 900,000,000 | 620,000,000 | 719,000,000 | 774,000,000 |
| Autriche | 1,107,000,000 | 47,000,000 | 47,000,000 | 259,000,000 | 286,000,000 |
| Italie | 2,000,000,000 | 440,000,000 | 435,000,000 | 266,000,000 | 239,000,000 |
| Russie | 4,000,000,000 | 503,000,000 | 524,000,000 | 410,000,000 | 429,000,000 |
Sur 265,000 milles de chemins de fer qui, en 1882, sillonnent le monde entier, les États-Unis en possèdent (p. 196) 118,000, presque la moitié. L'Europe en possède 106,000, l'Asie 14,000, l'Afrique 3,000, l'Australie 6,000, l'Amérique du Sud 7,000, l'Amérique Centrale 1,000, toute l'Amérique du Nord 128,000. En Europe, l'Allemagne en possède 22,000, l'Angleterre 18,000, la France 17,000, la Russie 14,000, l'Autriche 12,000.
J'ai trouvé ici les dernières nouvelles de France, tant de l'intérieur que de Madagascar et du Tonkin. Je remarque qu'aucun des journaux ne nous est sympathique. Comment en serait-il autrement? Les Américains du Nord sont des Anglais et des Allemands, et d'autre part nos divisions intérieures et la succession de nos ministères, qui passent comme devant une lanterne magique, sont peu faits pour nous concilier le respect de l'étranger. Quand aimerons-nous notre pays avant notre parti, et quand prendrons-nous pied sur une base stable! Le jour où nous reviendrons au Décalogue. Ce jour-là, nous rétablirons l'autorité paternelle par une plus grande extension de la portion disponible et nous passerons de la famille instable à la famille souche qui donne les nombreux rejetons pour l'armée, le clergé, les arts et la colonisation; nous rétablirons la protection de la femme par une situation assurée à la veuve et par la punition des séducteurs; nous rétablirons le respect de la divinité par la sanctification du septième jour; et, à côté, des droits de l'homme, nous mettrons l'inscription de ses devoirs, les uns et les autres sous la proclamation des droits de Dieu.
(p. 197) Mais il faudra rendre plus forte l'éducation de nos enfants en les habituant de bonne heure aux luttes de la vie et au sentiment du devoir. Les familles s'en déchargent trop sur les pensionnats, qui ne se préoccupent que de les préserver du danger en les enfermant dans des murs. Les Corporations enseignantes sont faites pour aider, non pour suppléer la famille, et l'enfant qui n'a vu que des murs jusqu'à vingt ans, n'a appris qu'à les haïr. Sans expérience de la vie, plein d'illusions, il fera presque certainement naufrage. Cela est d'autant plus naturel qu'au moment où il aurait le plus besoin des conseils des instituteurs et de l'appui des parents, vers vingt ans, lorsque les passions bouillonnent, il est envoyé dans une grande ville pour les études supérieures, et là les parents lui manquent, et du collège il ne conserve que le souvenir de la contrainte. Le jeune libéré se livre donc aux caprices de son âge, et ce n'est qu'à trente ans qu'il commence à comprendre qu'il doit se faire sa place dans la société en devenant sérieux. Au même âge, l'Anglais et l'Allemand reviennent d'Australie ou d'Amérique rapportant une fortune.
Je quitte mes amis et rentre à l'hôtel pour répondre à mes nombreuses lettres avant de mettre encore le Pacifique entre moi et l'Europe.[Table des matières]
Les îles Hawaï.
Départ de San-Francisco. — Navigation vers les îles Sandwich. — Le navire La Zelandia. — Manière d'occuper le temps. — Arrivée à Honolulu. — Les îles Hawaï. — Surface. — Population. — Gouvernement. — Les femmes sénateurs. — Impôts. — Les plantations de canne. — Importation. — Exportation. — Navigation. — Droits de douane. — Revenus. — Changement de dynastie. — Los Missions. — Le volcan Kilaouea. — Le monument du capitaine Cook. — La végétation. — Les habitations. — Les Canaques. — Mœurs et coutumes. — Les écoles. — L'hôpital.
Le soir du 20 octobre 1883, à 4 heures 1/2, j'interromps la rédaction de mes nombreuses lettres, et j'arrive au navire La Zelandia de la Pacific Mail-Steamship-Company. Ce steamer, long de 340 pieds, large de 42, et très peu profond, jauge 3,000 tonnes. Les premières sont à l'avant, ce qui leur évite la secousse et le bruit de l'hélice. Comme j'arrive le dernier, j'ai de la peine à obtenir une cabine sur le pont. Celle qu'on me donne a 2 mètres de large, 2 de long, 2 de haut, et je la partage avec un gros capitaine américain et protestant qui fait régulièrement, soir et matin, sa prière à genoux. Lorsque les adieux sont finis et que les nombreux amis accompagnant des voyageurs ont quitté le bord, je compte à table environ 70 passagers de première, tous Allemands, Anglais et Américains; (p. 200) je suis le seul Français. À minuit, la malle anglaise, qui arrive de Londres pour l'Australie, est installée à bord, le canon se fait entendre et on part. Je revois encore une fois les golden gates, ces portes d'or à l'entrée de la rade que j'avais vues il y a deux ans, lorsque je me dirigeais vers le Japon. Bientôt après, nous voilà en haute mer avec un roulis désagréable.
Le lendemain le roulis augmente et tous les passagers souffrent plus ou moins. Le service de la table, comme celui du navire, est fait par des blancs et des jaunes; la moitié sont Américains, la moitié Chinois. Les cuisiniers sont tous Chinois et la nourriture est meilleure que sur les navires anglais, mais les cabines sont inhabitables. La partie du pont réservée aux passagers est encombrée de caisses d'oignons qui exhalent une odeur nauséabonde.
C'est dimanche: à 10 heures commence le service religieux dans le salon. Personne n'est forcé de s'y rendre, mais presque tous les passagers, jeunes et vieux, hommes et femmes, y assistent avec recueillement. À défaut de ministre, le capitaine lit un chapitre du prophète Zacharie, récite des prières, auxquelles on répond, et on entonne des chants exécutés avec ensemble et gravité. Le premier est un hymne dans lequel l'homme reconnaissant sa misère a recours à Notre-Seigneur; j'en retiens le refrain:
Nothing in my hand I bring;
Simply to thy Cross I cling:
Naked come to Thee for grace;
Foul, I to the Fountain fly;
Wash me, Saviour, or I die.
(p. 201) Je ne porte rien dans mes mains;
Simplement j'adhère à ta Croix:
Nu, je viens te demander grâce;
Impur je me sauve à la Fontaine;
Lave-moi, mon Sauveur, ou je meurs.
Après ce cantique, le capitaine lit un chapitre de saint Luc et recommence des prières, puis on finit par le cantique de la mer:
From rock and tempest, fire, and foe
Protect us wheresoever we go.
Thus evermore shall rise to Thee
Glad hymns of praise from land and sea.
Des rochers et des tempêtes, du feu et de l'ennemi
Protège-nous, partout où nous allons.
Ainsi de plus en plus s'élèvera vers toi
Un hymne joyeux de louange de la terre et de la mer.
22-23 octobre. La mer devient, de plus en plus houleuse, les vagues déferlent furieuses sur le flanc du navire et souvent inondent le bord; pas un bateau à l'horizon; par-ci par-là quelques baleines. Nous avons 2,103 milles à parcourir pour rejoindre Honolulu; nous filons 12 nœuds et nous faisons une moyenne de 300 milles par 24 heures.
Le quatrième jour, les estomacs se sont habitués au balancement; la vie renaît à bord, le soir on organise même un grand bal. Plus d'une fois les valseurs et les polkeurs ont roulé les uns sur les autres, mais la gaieté est générale et de bon ton. D'autres soirs, le bal est remplacé par le concert ou par des lectures: espèce de déclamation. On fait le possible pour se garer de la monotonie. (p. 202) Durant le jour, je fais quelques parties au bull[6] pour donner au corps le mouvement nécessaire, et je passe de longues heures à rédiger mon journal de voyage.
En approchant d'Honolulu, on exige de chaque passager qui y débarque une cotisation de 2 dollars, destinée à l'hôpital du pays.
Le 28 octobre, de grand matin, le sifflet de la machine nous apprend qu'on aperçoit la terre; on se lève à 6 heures et l'on voit bientôt le diamant-point, rocher nu qui s'avance dans la mer. Nous pénétrons dans la baie en sondant le milieu d'une double rangée de bouées qui marquent la route. Des deux côtés la mer déferle sur des rochers à fleur d'eau. À 7 heures, le canon annonce l'arrivée. M. Trousseau, médecin français au service du gouvernement des îles Hawaï, vient à bord pour les formalités d'usage; à 7 heures 1/2 on sert le déjeuner et à 8 heures nous sommes à terre.
Les îles Hawaï, plus connues en Europe sous le nom d'îles Sandwich, sont situées entre le 19° et 23° latitude nord et entre le 155° et 161° longitude ouest. Elles sont au nombre de 8, dont voici les noms et la surface: Hawaï, avec 4,210 milles carrés; Maui, avec 270; Oahu, avec 600; Kauaï, avec 590; Molokaï, avec 270; Lanaï, avec 150; (p. 203) Niihau, avec 97; et Kahoolawe, avec 63 milles carrés. La population, pour toutes les îles, atteint le chiffre de 75,000 habitants, ainsi répartis: 10,000 blancs, 15,000 Chinois, et le reste indigènes. Il faut ajouter un settlement de 300 mormons et quelques nègres.
Le gouvernement est monarchique-constitutionnel avec deux Chambres siégeant ensemble. Dans la Chambre des nobles, les membres sont nommés par le roi et les femmes peuvent en faire partie; les femmes de la famille royale en font partie de droit. La Chambre des représentants est élue au suffrage universel. Est électeur tout indigène prouvant qu'il a payé sa taxe ou impôt. Cet impôt est une capitation de 3 dollars par personne, plus 2 dollars pour les routes, et 2 pour les écoles. La propriété et les marchandises paient tous les ans un impôt calculé sur 3/4% ou 0 fr. 75% de leur valeur; les marchandises paient cette taxe en plus des droits de douane. Cela, avec divers autres droits de patente, timbre, amendes, etc., fait à l'État un revenu d'environ 5,000,000 de dollars par an, soit 25,000,000 de francs. Pas d'armée: 200 ou 300 soldats à peine, équipés à la prussienne, et pas de marine. La dette était à peu près nulle, mais la dernière législature a voté un emprunt de 2,000,000 de dollars pour frais d'immigration. On importe des milliers de Portugais des Açores, qui sont de très bons planteurs de canne à sucre. Les principales ressources du pays sont le riz, que les Chinois cultivent à merveille, et la canne à sucre, dont toutes les plantations sont aux mains (p. 204) d'Anglais, d'Allemands et d'Américains. Un traité passé avec les États-Unis a exempté, durant 7 ans, des droits d'entrée, les sucres et les riz hawaïens, envoyés dans l'Amérique du Nord; et comme ces droits sont de 2 sous 1/2 par livre, cela a fait la fortune des planteurs. Le traité expire cette année; on ignore s'il sera renouvelé.
La main-d'œuvre est bien rétribuée; les ouvriers, dans les plantations, reçoivent 25 dollars par mois, pendant qu'à Cuba, au Brésil et autres contrées à sucre, la main-d'œuvre esclave coûte fort peu, et que dans les colonies anglaises la main-d'œuvre des coolies importés de l'Hindoustan coûte à peine la moitié de ce qu'on paie aux îles Hawaï. Au Pérou, les Chinois reçoivent dans les plantations de 2 à 3 fr. par jour.
La canne à sucre ici est très productive: elle donne 60% de jus, et ce jus est lui-même fort riche; il donne 22% de sucre jaune, ce qui fait environ 120 kilog. de sucre par tonne de cannes. Dans certains endroits où le terrain est sec, on arrose la canne, et dans ce but on a creusé plusieurs puits artésiens. La même racine ne dure que deux ans et donne deux récoltes: après il faut la replanter. Dans les grandes plantations, on replante 3,000 acres par an. La plupart des planteurs ont leurs machines et fabriquent leur sucre: les petits planteurs donnent leurs cannes à des propriétaires d'usines qui extraient le sucre et partagent le produit.
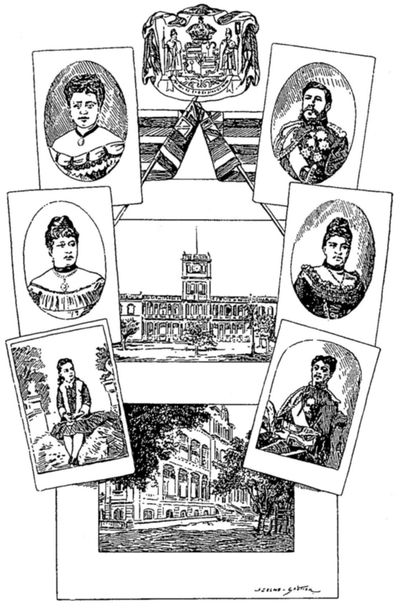
Îles Sandwich.—Famille royale.—Palais du Roi. Palais du gouvernement et des Chambres.
Quatre puissances: l'Angleterre, la France, les États-Unis (p. 205) et le Portugal, ont ici un consul qui est en même temps commissaire pour leur gouvernement. Notre consul, M. Feer, me remet les états de la douane, d'où je relève qu'en 1882 l'importation a atteint la valeur de 4,974,510 dollars, et l'exportation, 8,229,016 dollars; 5,475 passagers sont arrivés dans les îles, et 2,598 en sont partis. Des 200 navires jaugeant 88,976 tonneaux arrivés ici, 124 sont américains, 44 anglais, 16 hawaïens, 11 allemands et 1 français; 4 de diverses nations. Les droits de douane ont atteint 505,390 dollars, dépassant de 82,198 dollars les entrées de l'année précédente.
Les missionnaires protestants ont été les premiers à pénétrer dans les îles Hawaï; les missions catholiques sont venues ensuite, et ont été confiées aux Pères des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, connus plus communément sous le nom de Pères de Picpus.
Actuellement, le tiers de la population est catholique. Depuis l'arrivée des Européens en 1753, on compte 7 rois. Les cinq premiers portaient le nom de Kamehameha, et le sixième, Lunalilo, n'a régné qu'un an, mourant sans descendants et sans désigner d'héritiers. Dans cette situation, on a procédé à l'élection d'une nouvelle dynastie, et a été élu Kalakaua I, roi actuel, qui occupe le trône depuis 9 ans.
Plusieurs steamers font le service entre les îles, et on peut ainsi visiter à l'île Hawaï la plus grande des huit, le volcan Kilaouea, qu'on dit le plus important du monde. Les anciens indigènes y plaçaient le séjour de leur déesse (p. 206) Pélé. En 1880-81, il a jeté une si grande quantité de lave qu'une partie de l'île en a été couverte. Cette île possède aussi 2 pics d'environ 14,000 pieds d'altitude: le Mannokea et le Mannoloa.
C'est aussi dans cette île que fut massacré par les indigènes, en 1779, le célèbre navigateur capitaine Cook. Un monument en son honneur a été élevé à Kealakekua-bay, à l'endroit du sinistre événement.
Honolulu, la capitale, est située au sud de l'île Oahu. Elle compte 16,000 habitants. La végétation est si puissante qu'elle cache les maisons; on dirait une ville noyée dans la verdure. Les acacias, les tamarins, les palmea gigantea atteignent des proportions colossales; une forêt de cocotiers jette ses hauts plumets dans les airs. Je parcours la ville; les rues sont larges et droites; les maisons, en bois, en tuf, en ciment, n'ont qu'un rez-de-chaussée, rarement un étage; la plupart sont entourées de superbes jardins et garnies de portiques et vérandahs d'où pendent les plantes grimpantes. Quelques-unes des plus jolies appartiennent à des Chinois. Ces fils du Céleste Empire connaissent le confortable et ne manquent pas de goût. Le palais du roi, en bois, à deux étages, entouré de portiques et surmonté d'une tour, est d'un bel effet; le palais du Parlement est aussi de bon goût, et adapté au climat.

Îles Sandwich.—Volcan de Kilaouea.
Les indigènes, à terre, vendent des oranges, des bananes et des travaux en coquillages ou en graines de caroube. Les femmes portent une espèce de robe de chambre, les (p. 207) hommes veste et pantalon. Les deux sexes aiment à orner leur tête et leur cou de couronnes et de colliers en plumes d'oiseau et fleurs de chrysanthème. Leur couleur est bronzée, le plus grand nombre sont gras, ont les lèvres grosses, les yeux noirs, le regard bienveillant, le nez et le front réguliers.
C'est dimanche: les magasins sont fermés, le travail suspendu. Ces prétendus pays sauvages ne donnent pas le scandale, habituel chez les nations catholiques de l'Europe, de la violation du troisième commandement. L'Église est vaste et remplie de fidèles. Je remarque quelques Chinois au milieu des blancs et des indigènes; les Portugais des Açores sont presque noirs. Les chants, exécutés par des voix d'hommes et de femmes, sont très harmonieux; le sermon est en langue indigène. Monseigneur Hermann, vicaire apostolique, me reçoit avec bonté, et me donne des détails sur ces contrées qu'il évangélise depuis de nombreuses années. Les missionnaires sont aimés; on trouve qu'ils vivent bien mesquinement à côté du confort des ministres protestants: mais ils ont aussi du superflu dont les pauvres profitent; c'est plus évangélique. Je visite l'école des Sœurs des Sacrés-Cœurs. Je les avais vues à l'œuvre à Lima et à Guayaquil. Elles ont ici 80 pensionnaires, 100 externes payantes, 120 gratuites. Des Frères américains instruisent à peu près autant de garçons.
Les indigènes sont intelligents, leur mémoire est prodigieuse. Ils apprennent rapidement la musique et l'arithmétique, (p. 208) mais ils ne vont guère au-delà d'une certaine limite.
Ils saisissent difficilement les idées abstraites et les notions géographiques. Pauvres gens! ils n'ont jamais vu que leur petit coin de terre!
Par contre, ils sont fort hospitaliers; ils partagent volontiers avec les autres ce qu'ils possèdent, et s'il n'y a pas de riches parmi eux, il n'y a aussi pas de pauvres.

Îles Sandwich.—Femmes indigènes prenant leur repas.
Les blancs, en achetant leurs terres, finissent par les déposséder et les réduisent à la condition de domestiques; l'introduction des liqueurs leur a été fatale, comme partout chez la race indienne. Une loi défendait de leur vendre des boissons enivrantes, mais les Chinois leur en vendaient fort cher et de mauvaise qualité en contrebande. C'est pourquoi la prohibition vient d'être abrogée.
M. Feer, notre consul, m'apprend encore beaucoup de choses sur le pays; entre autres, qu'il contient une quinzaine de Français.

Îles Sandwich.—Pavillon de la Reine Douairière à Honolulu.
L'hôpital est situé au milieu d'un vaste et riche parc (p. 209) où des vols de merles se promènent sans crainte sur les pelouses. Un Trustee, ou administrateur, arrive en même temps que moi et me conduit à la visite des diverses salles. Au rez-de-chaussée sont les Chinois; ils paient 60 cents (3 fr.) par jour. J'en vois un grand nombre avec le berri-berri, maladie qui fait enfler les jambes et rend la marche impossible. Cette maladie, que les Japonais appellent caké, n'attaque pas les blancs, ni les Polynésiens; elle est spéciale à la race jaune; elle sévit pourtant parfois dans le nord du Brésil.
Les indigènes sont reçus gratuitement.
La maladie dominante est la syphilis, importée par les blancs. Je remarque un pauvre Portugais qui se meurt de la fièvre typhoïde. Il y a de nombreux lépreux, mais ils ne sont pas là. On les a relégués à une autre île, dans un établissement spécial. Au premier étage sont les femmes, et dans un pavillon annexe les Européens et les Américains. Ceux-ci paient 1 dollar 1/2 par jour. Les frais sont couverts par les pensions, par les dons, les souscriptions et les subventions de l'État.
Les administrateurs sont nommés partie par le gouvernement, partie par les souscripteurs.
J'aurais encore voulu parcourir la campagne, visiter une plantation, mais l'heure du départ approche et je me rends au navire, qui lève l'ancre à 2 heures.[Table des matières]
Navigation vers la Nouvelle-Zélande. — Curieux problème dans une succession. — Deux bébés à la recherche du ciel. — Une éclipse totale du soleil. — Les Saints et les Morts. — Passage de l'Équateur. — Une visite de l'Océan. — La visite réglementaire. — La manœuvre du feu. — Le service religieux. — L'île Tutuila et l'archipel des Navigateurs. — Une Cour d'assises. — Une tempête sous le tropique. — Scènes comiques. — Le 180e parallèle et la semaine de 6 jours. — Arrivée en Nouvelle-Zélande.
Jusqu'ici nous avions marché au sud-ouest par une seule ligne droite. La boussole avait marqué tout le temps 40°; maintenant nous prenons la direction du sud, et la boussole est sur le 10°. Nous avons 5,600 milles d'ici à Auckland; nous comptons les parcourir en 12 jours. La mer continue à être désagréable.
Pour occuper le temps, on relit les vieux journaux. L'un d'eux raconte que dans le Kentucky, un testateur a laissé à sa femme enceinte, au moment de sa mort, la moitié de ses biens, et l'autre moitié à sa fille, si elle accouchait d'une fille; mais si le nouveau-né était un garçon, la mère aurait 1/3 et l'enfant les 2/3. Or, après la mort du père, 2 jumeaux sont venus au monde, un garçon et une fille; la mère réclame d'une part la 1/2 puisqu'elle a une fille, et 1/3 puisqu'elle a un garçon, mais le curateur du garçon réclame pour son protégé les 2/3, et (p. 212) celui de la fille la moitié. Quel est le Salomon qui résoudra ce problème?
Je trouve aussi par-ci par-là des poésies, dont quelques-unes ne manquent pas de grâce; j'en insère une qui m'a paru délicieuse de grâce et de sentiment.
WHERE IS HEAVEN?
Two little children, weeping sore,
Went wandering, sorely down the street,
Poor waifs upon life's stormy shore
With shivering forms and naked feet.
And when they met me, as they saw
Their woe had touched my sympathies,
The oldest turned to me and cried:
"Oh, do you know where Heaven is?
"Our father died a year ago,
And mother told us, when he died,
That he had crossed a river deep,
And Heaven was on the other side.
And when we asked her where he was,
She always said: "In Heaven, I know";
And told us we could go to him.
O, tell us, tell us, where to go!
"Dear mother died a week ago,
And Robbie cries for her all day.
We want to go where mother is,
Is Heaven so very far away?"
O, plaint of little sorrowing hearts!
Earth's universal cry is this,
That you' ve so learned to ask:
Who knows, who knows, where Heaven is?
Poor little seekers after Heaven!
Poor little waifs on life's bleak shore!
Some day your feet will find the way
That gives you back your lost once more.
(p. 213) The only answer I can give
To any question such as this
From those who miss a mother's face
Is: Heaven is where that mother is!
OU EST LE CIEL?
Deux petits enfants pleurant amèrement,
Vinrent rôdant pleins de chagrin dans la rue.
Pauvres épaves sur la plage tempétueuse de la vie!
Couverts de haillons et les pieds nus.
Et quand ils me rencontrèrent et qu'ils virent
Que leur misère avait éveillé mes sympathies,
Le plus âgé se tourna vers moi et dit:
«Oh! savez-vous où est le ciel?
«Notre père est mort il y a un an,
Et notre mère, nous dit, quand il fut mort,
Qu'il avait passé une rivière profonde,
Et que le ciel était de l'autre côté.
Et quand nous lui demandâmes où il était,
Elle répéta toujours: il est au ciel,
Et ajouta que nous pourrions aller à lui,
Oh! dites-nous, dites-nous où il faut aller!
«Chère mère est morte il y a une semaine,
Et Robbie crie après elle tout le jour.
Il nous faut aller où est notre mère,
Est-il bien loin, bien loin, le ciel?»
O plainte de petits cœurs désolés!
Est-ce là le cri universel de la terre
Pour que vous ayez appris à demander:
Qui sait, qui sait où est le ciel?
Pauvres petits chercheurs après le ciel!
Pauvres petites épaves sur la sombre plage de la vie!
Un jour vos pieds trouveront la voie
Qui vous rendra ce que vous avez encore une fois perdu.
La seule réponse que je puisse donner
À toute question comme la vôtre,
De la part de ceux qui ont perdu leur mère,
C'est que le ciel se trouve où cette mère est!
(p. 214) 30 octobre.—Après une forte pluie, la mer, si houleuse depuis notre départ, se calme à notre grande joie; la chaleur devient suffocante: nous sommes par 161° 50´ longitude est, et par 13° 1´ latitude nord.
À 2 heures, le soleil brille dans toute sa splendeur, puis sa lumière diminue, et peu à peu il se fait presque nuit. Nous le regardons à travers les verres bleus du sextant; l'ombre de la lune passe dessus. À 2 heures 1/2 l'éclipse est totale, puis le disque lunaire sort vers l'est, et à 3 heures la clarté première est rétablie. Combien de générations dans les anciens âges n'ont pas connu l'explication de ce phénomène!
1er novembre.—Tous les Saints et le lendemain les Morts.—C'est le jour où les églises se remplissent dans les pays catholiques et où on visite les cimetières: Sancta et salubris cogitatio pro defunctis orare! Ici notre église est la voûte du ciel et le cimetière l'océan, où reposent aussi beaucoup de nos frères! Dans la nuit, entre les Saints et les Morts, nous passons l'Équateur, cette ligne imaginaire dont on parle toujours et qu'on ne voit jamais; nous la sentons pourtant à la chaleur suffocante et humide.
2 novembre.—À midi, l'affiche journalière porte 1° 17´ latitude sud. Le soir, les marins se déguisent en minstrels et organisent une procession burlesque. Le roi et la reine de l'Océan, aux longs cheveux d'étoupe avec une couronne d'or, sont précédés par des hallebardiers, par des hommes à cheval, par une suite de peuple. Au son de (p. 215) la trompette, ils font le tour du navire et arrivent au salon. Là, après des chants de minstrels, le roi prononce une adresse aux passagers et à lord et lady Roseberry.
L'orateur est un peu gêné, mais ne manque pas d'esprit. Je remarque les égards qu'il a pour la noblesse. «J'ai vu, dit-il, que vous commenciez à vous ennuyer, et je suis sorti de mes profondeurs pour vous faire une visite et vous parler des merveilles de mon domaine..., etc.»
La procession reprend son chemin, et on tire les chevaux de jonc et de chiffons par la tête et par la queue, jusqu'à ce qu'ils se démontent, en chantant des couplets bouffes. Tout le monde rit, tout le monde est content: on fait une quête et on récompense tous ces bons marins qui ont pensé aux passagers.
3 novembre.—C'est jour de conseil et d'inspection. Le capitaine parcourt toutes les cabines. Que ne peut-il les rendre plus grandes! J'éviterais de laisser porte et fenêtre ouvertes pour respirer, et aurais moins de chauds et froids à soigner. Je pense que cette nécessité de vivre au courant d'air, ou de manquer d'air, compromettra bien des santés.
Dans l'après-midi, on fait la manœuvre du feu; tout l'équipage s'ébranle, chacun court à son poste, armé de la ceinture de sauvetage; les pompes fonctionnent, et on inspecte les embarcations.
Le 4 novembre, jour de dimanche, à 10 heures 1/2, la cloche tinte-tinte...; le salon se pare en fête, les rideaux et les tapis verts cèdent la place aux rideaux et aux tapis (p. 216) bleus, les passagers arrivent et se placent au centre. Ceux de 2e classe viennent au 2e rang; les matelots et les domestiques se rangent sur les côtés. Le capitaine entre, et le service commence par ce cantique:
Jesus Lover of my soul
Let me to Thy bosom fly
While the gathering waters roll
While the tempest still is high;
Hide me, O my Saviour, hide
Till the storm of life is past
Safe into the heaven guide
O receive my soul at last!
Jésus, l'amant de mon âme,
Laisse-moi fuir vers ton sein
Pendant que les eaux qui m'enserrent roulent,
Pendant que la tempête gronde encore fort;
Cache-moi, ô mon Sauveur, cache-moi
Jusqu'à ce que l'orage de la vie soit passé!
Sûr guide pour la vie,
Oh! reçois à la fin mon âme!
Le capitaine lit les prières et le public répond, puis on lit l'épître et l'évangile du jour; on récite plusieurs psaumes et le Te Deum, et on termine par ce cantique:
Lead kindly Light amid the encircling gloom
Lead Thou me on;
The night is dark, and I am far from home
Lead Thou me on!
Conduis-moi, ô bénigne Lumière, à travers les ténèbres qui m'entourent;
Conduis-moi toi-même.
La nuit est obscure, et je suis loin de mon chez moi;
Conduis-moi toi-même!...
Vieux et jeunes, riches et pauvres, sont recueillis et pénétrés de l'esprit de prière. Durant le reste du jour, le (p. 217) piano et l'orgue ne retentissent que de chants sacrés; l'Anglais et l'Américain sont si sévères pour le repos dominical, qu'ils s'interdisent même d'écrire.
Le 5 novembre, à 3 heures du matin, nous passons en vue de Tutuila, une des îles de l'archipel des Navigateurs, ou îles Samoa, qu'il y a quelques années, l'Allemagne voulait s'annexer. L'Angleterre a fait alors ce qu'elle voudrait faire en ce moment avec la France, à propos du Tonkin et de Madagascar; elle a si bien manœuvré, que l'annexion n'a pas eu lieu.
L'Angleterre considère le monde comme son domaine; elle est jalouse qu'on en prenne quoi que ce soit; elle espère, avec le temps, s'annexer encore ce qu'elle ne possède pas. Il faut dire, par amour de la vérité, que jusqu'à présent c'est la nation qui sait le mieux se répandre, et mieux se faire toute à tous pour soumettre les populations des divers points du globe.
Le soir, quelques passagers organisent une Cour d'assises avec juges, jurés, avocats, secrétaire, témoins, etc. Lord Roseberry est le défenseur de l'accusé. Un Juif est traduit à la barre et accusé d'avoir négligé son devoir pour s'occuper de la femme de chambre (stewardess), en sorte que l'eau a pénétré dans le salon et a mis en danger les passagers. Les témoins à charge et à décharge sont nombreux, et les dépositions souvent très bouffonnes. Il résulte des témoignages, que le crime de négligence doit être écarté; mais reste le crime d'avoir fait la cour à la femme de chambre. Le condamné invoque le témoignage de son (p. 218) évêque, prouvant qu'il voulait se marier; on lit les lettres amoureuses et on appelle l'évêque. Comme les autres témoins, il prête serment sur les évangiles. À quelle église appartenez-vous?—À l'église des latter day's saints, connue sous le nom d'église mormonne.—Êtes-vous marié?—Oui, 25 fois spirituellement..., etc.—Un Chinois est appelé à témoigner en langue chinoise, et l'interprète doit traduire, mais le Chinois refuse de parler, et il faut le renvoyer. Plus tard, interrogé par le capitaine sur la raison qui l'avait empêché de parler, il répond: «J'ai vu que tout le monde se rendait ridicule, et je n'ai pas voulu me rendre ridicule.» Les Chinois n'aiment pas la plaisanterie. On voit que ceux qui dirigent les débats appartiennent au barreau: ils ont perruque et manteau rouge ou noir. Enfin le pauvre prisonnier réussit à prouver qu'il voulait épouser la fille de chambre, et il est relâché pour procéder à l'hyménée.
C'est une manière agréable et innocente d'occuper le temps et de rompre la monotonie des longues journées de navigation.
Le 6 novembre, nous naviguons près l'archipel des Amis. Par 21° latitude, à la hauteur des Fiji, une horrible tempête s'élève et grandit à mesure que nous avançons vers le tropique. Cette fois, le Pacifique ment à son nom. Il est beau de voir le navire soulevé sur des montagnes et précipité dans les vallées entre les vagues, mais les estomacs sont peu à l'aise. Une pluie diluvienne nous empêche de sortir, et tantôt c'est une vieille dame qui dégringole (p. 219) l'escalier, ou un autre passager qui est jeté sur son voisin. Vers le soir, une armée de marsouins vient parader autour du navire, faisant en l'air des sauts de 5 à 6 mètres.
Le 7 novembre, la tempête continue, mais moins forte. Nous sommes par 26° latitude sud; nous avons passé le tropique. Le vent est nord-est et enfle les voiles; nous filons 14 nœuds. Dans la nuit, le vent change tout à coup et souffle au nord-ouest; les vagues inondent les cabines de droite. Les passagers se sauvent en chemise au salon, criant après les domestiques. Scène amusante, mais quelques-uns sont jetés sur le piano et sur les chaises; l'un d'eux perd même un ongle du pied. La mer a voulu, elle aussi, jouer son rôle pour rompre la monotonie.
Le lendemain, le soleil reparaît, mais le navire danse toujours. Je commence à avoir assez d'élasticité pour me promener quand même. Vers 3 heures, nous passons le 180° parallèle et nous sautons un jour. Au lieu de compter jeudi, nous passons d'emblée au vendredi. Notre semaine n'a ainsi que six jours, mais le jour enlevé a été réparti sur tous les jours du voyage depuis le départ de l'Europe. En venant vers l'ouest, tous les jours s'allongeaient de 20 minutes, et arrivés aux Antipodes, nous sommes obligés d'enlever le jour ainsi disparu, pour retrouver le même calendrier qu'au départ.
La mer devient de plus en plus furieuse, les vagues s'amoncellent, se heurtent, écument, se pulvérisent; le ciel s'obscurcit, l'éclair déchire les nues, la pluie tombe à (p. 220) torrents, et l'eau inonde le navire. Excellent pour les amateurs d'émotions!
Le jour suivant, l'Océan redevient pacifique, le soleil reparaît. La tempête, comme le beau temps, ne saurait durer! Un jeune homme recueille les diverses communications des passagers pour rédiger le journal du voyage. C'est l'usage sur les steamers de la Compagnie. Un autre passager ouvre une souscription pour offrir un souvenir au capitaine; il a été on ne peut plus aimable et serviable; il n'a rien de la morgue britannique.
Nous n'avons vu que deux ou trois voiliers durant les trois semaines de traversée.
Plus tard, lorsque les îles de l'Océanie seront plus peuplées, cet Océan sera moins solitaire.
Enfin, cette nuit, nous espérons entrer dans le port d'Auckland, et j'arrête ici mon journal de voyage pour aller boucler ma malle, car je compte quitter le navire.[Table des matières]
La Nouvelle-Zélande.
La Nouvelle-Zélande. — Situation. — Surface. — Configuration. — Population. — Gouvernement. — Récoltes. — Bétail. — Poissons. — Mines. — Climat. — Pluie. — Instruction publique. — Industrie. — Assistance publique. — Caisse d'épargne. — Importation. — Exportation. — Navigation. — Les terres publiques. — Manière de les acquérir. — La poste. — Le télégraphe. — L'armée.
La Nouvelle-Zélande a été ainsi nommée par Tasman, navigateur hollandais, qui la découvrit le premier. Elle fut visitée par Cook, qui débarqua à Poverty-Bay le 8 octobre 1769, en revenant de Taïti, où il avait été envoyé pour observer le passage de Vénus sur le soleil.
Cette contrée, située entre le 34° et 48° latitude Sud et le 166° et 179° longitude Est, se compose de deux îles appelées île Nord et île Sud. Il y en a aussi une troisième, plus petite, appelée Stewart, et quelques autres moins importantes.
La surface de cette colonie est presque égale à celle de la Grande-Bretagne et Irlande; elle comprend 100,000 milles carrés, soit 64,000,000 d'acres ou arpents. Le détroit de Cook, qui sépare les deux grandes îles, facilite la navigation le long des côtes. Si l'on considère les deux îles réunies, la configuration est celle de l'Italie (p. 222) renversée, moins la vallée du Pô; l'île du Nord offre la même forme de botte avec son talon.

Nouvelle-Zélande.—Types Maori de la classe supérieure.
L'île du Nord a une surface de 44,000 milles carrés, et jusqu'en 1876 elle était divisée en 4 provinces: Auckland, Taranaki, Hawke's Bay et Wellington. L'île du Sud a une surface de 55,000 milles carrés et comprenait les 5 provinces de Nelson, Mareborough, Canterbury, Otago et Westland; mais, depuis 1876, ces provinces ont été divisées en 63 comtés: 32 dans l'île Nord et 31 dans l'île Sud.
La Nouvelle-Zélande est traversée par une chaîne de montagnes, comme l'Italie par l'Apennin.
La hauteur des montagnes va en s'abaissant vers le bout de la botte, et dans l'île Nord, à part quelques pics et volcans, elle n'atteint qu'une hauteur de 1,500 à 4,000 pieds; mais, dans l'île Sud, la chaîne appelée Alpes du Sud atteint jusqu'à 12,000 pieds. Elle a ses neiges perpétuelles et ses nombreux glaciers.
(p. 223) Les Anglais trouvèrent ici les Maoris, belle race polynésienne, qui parle la même langue que les habitants de Haïti et des îles Hawaï. Le Maori est généralement plus grand que l'Anglais: il a les bras plus longs, mais les jambes plus courtes et la poitrine très développée; il porte plus de poids que l'Anglais, mais il résiste moins que lui à la fatigue.

Nouvelle-Zélande.—Chef Maori.
Les missionnaires protestants, venus en 1814, obtinrent en 1839 la signature de la plupart des chefs, comme reconnaissant la suzeraineté de la reine d'Angleterre; mais ils disaient à ces Maoris que, par le traité, ils donnaient l'ombre à la reine et gardaient la réalité. Ceux-ci le crurent, mais plus tard, lorsqu'ils virent qu'on prenait plus que l'ombre, ils se révoltèrent. Ils furent alors soumis par les armes, et les frais de cette guerre, qui s'élevèrent à 100 millions de francs, pèsent encore lourdement sur la colonie. Cette race va en diminuant: d'après le dernier recensement, elle ne compte plus qu'environ 42,000 individus, pendant que la population blanche, d'après le recensement de 1882, atteint le chiffre de 517,707. Durant la même année, on compte 3,600 mariages, soit 7 pour mille de la population; (p. 224) 5,701 décès, soit 11,19 par mille; 19,000 naissances, soit 37,32 par mille; 10,945 immigrants, et 7,456 émigrants. Les hommes sont de 1/5 plus nombreux que les femmes; les naissances illégitimes n'atteignent que 2%. Il y a en outre 5,000 Chinois et 16 Chinoises; ils sont généralement diggers ou chercheurs d'or; quelques-uns sont jardiniers, cuisiniers et chasseurs de lapins.
Le gouvernement est le self-government, et le self-administration localisé. Le pouvoir exécutif est aux mains d'un gouverneur nommé par la reine aux appointements annuels de 7,500 l. stg. Il choisit ses ministres et se guide d'après leurs avis. Par son droit de veto il participe au pouvoir législatif, mais, depuis 29 ans qu'existe la Constitution, il n'en a été fait usage que six fois. Le pouvoir législatif s'exerce par la Chambre haute, ou Conseil législatif, composé de 49 membres nommés à vie par le gouverneur, et par la Chambre des représentants ou députés, élus pour 3 ans. Ceux-ci tiennent les cordons de la bourse et sont en réalité les maîtres. Est électeur, tout individu âgé de 21 ans, né ou naturalisé sujet britannique, ayant depuis 6 mois une propriété de 25 l. stg. (625 fr.), ou qui est depuis un an dans la colonie, et depuis les derniers 6 mois dans le district électoral. Tout Maori qui paie une contribution, ou qui possède une propriété de 25 l stg., est électeur et vote pour ses représentants maoris, qui sont au nombre de quatre. Les électeurs sont tous éligibles, s'ils ne sont coupables de crime ou de banqueroute, ou salariés du gouvernement.

Nouvelle-Zélande.—Phormium Tenax (Chanvre indigène).
(p. 225) Sous le rapport religieux, le septième des habitants est catholique; les autres 6/7 protestants de diverses communions. Les catholiques sont répartis dans les trois diocèses d'Auckland, Wellington et Dunedin; la plupart des Maoris sont catholiques.
Les villes sont gouvernées par les Mayors (maires) élus chaque année par les chefs de famille, y compris la veuve, et entourés de leur conseil municipal. Les routes sont construites et entretenues par des Road-Boards, conseils spéciaux par district; et les Central ou local Boards of Health ont des pouvoirs étendus pour prendre toutes les mesures en faveur de la santé publique. Le siège du gouvernement a été transporté d'Auckland à Wellington, point plus central.
Les îles de la Nouvelle-Zélande sont verdoyantes et en partie encore couvertes de forêts; plusieurs variétés d'arbres donnent un bois solide, fin et estimé. Tels sont: le manuka, le totara, le kauri, le black-birch, le kowhaï et le mataï. D'autres donnent d'excellentes écorces à tanner ou pour teintures, tels que: le Hinau (Eleocarpus dentatus), le tawhero (Weinmannia racemosa), le tanhai et le tanekaha (Phyllocladus trichomanoides). La terre à l'état naturel est couverte de fougères ou d'un buisson appelé titree, ou de flax (phormium tenax), dont les Maoris tirent une espèce de chanvre que les colons ont amélioré par l'emploi des machines. En 1881, on en a exporté 1,307 tonnes, évaluées à 25,285 l. stg.
Il y a encore 10,000,000 d'acres en forêts; 12,000,000 (p. 226) d'acres sont propres à l'agriculture et 42,000,000 au pâturage. L'herbe indigène est dure, mais on sème l'herbe européenne, qui pousse très bien; les fruits et les légumes d'Europe prospèrent, ainsi que les moutons et le bétail.
Sous le rapport géologique, les terrains d'alluvion comprennent environ 1,500 milles carrés, le tertiaire marin 18,000, le secondaire 5,000, le palœzoïque 26,000, le schisteux 15,000, le granitique 6,000 et le volcanique 15,000 milles carrés.
En 1882, il y avait 366,000 acres cultivées en blé, et la récolte était estimée à 8,300,000 boisseaux. La production moyenne est de 24 boisseaux par acre: un boisseau suffit à ensemencer une acre. Pour l'avoine, la production moyenne est de 28 boisseaux par acre; de 22 pour l'orge, et de 5 tonnes 1/2 pour les pommes de terre.
En 1881, il y avait 13,000,000 de moutons dans la colonie, 161,000 chevaux et 700,000 bœufs ou vaches; mais le nombre a augmenté depuis et augmentera encore très rapidement à la suite des envois de viande congelée en Europe. La laine exportée dépasse 60,000,000 de livres par an, et une partie est filée dans la colonie. De fréquentes expositions agricoles régionales aident à l'amélioration des races. La laine de la Nouvelle-Zélande est une des plus estimées, et la viande de mouton est aussi bonne ici qu'en Angleterre.
Parmi les produits de la colonie, il faut ajouter l'huile des baleines, qui abondent en ces mers; les peaux de phoques, et les diverses sortes de poissons qui, importés (p. 227) d'Europe et d'Amérique, se sont multipliés dans les lacs et les rivières. La mer donne des poissons analogues à ceux qu'on trouve entre Madère et le Portugal; on en compte environ 200 espèces, dont 40 se vendent au marché.
Le gibier importé d'Europe: faisans, lièvres, lapins, se sont multipliés à l'infini. Il est regrettable que les indigènes, pressés par la faim, aient anéanti le moa, oiseau presque aussi grand qu'une girafe.
Le règne minéral est, lui aussi, bien représenté. On exploite en ce moment plus de 100 mines de charbon qui, en 1881, ont donné 337,000 tonnes; mais elles deviennent de jour en jour plus productives. On estime que certaines d'entre elles contiennent plus de 140 milliards de tonnes. L'or se trouve dans le quartz, et certains quartz exceptionnels ont donné jusqu'à 600 onces d'or par tonne; mais on le trouve aussi dans les terrains d'alluvion, qui s'étendent sur 20,000 milles carrés. Le lit des rivières, le gravier de certaines vallées et certains ciments, faciles à extraire, en fournissent aussi beaucoup. L'or exporté de la Nouvelle-Zélande jusqu'au 31 décembre 1881 s'élève à 9,822,755 onces, de la valeur de 38,461,423 l. stg.
On trouve aussi l'argent, le cuivre, le fer, le plomb, le chrome, l'antimoine, le zinc, le manganèse, plusieurs sortes de pétrole, des marbres, de belles carrières de pierres de construction, et des pierres à ciment et chaux hydraulique.
Le climat est un peu meilleur que celui d'Angleterre. (p. 228) La moyenne thermométrique est de 57° Farenheit dans l'île Nord et de 52° dans l'île Sud; pendant qu'elle est de 51° à Londres et à New-York, La quantité de pluie annuelle est de 40 à 50 pouces dans les deux îles, mais pendant que sur la côte Est elle est de 25 pouces à Christchurch, elle est de 112 pouces à Hokitika, sur la côte Ouest. Là pression atmosphérique, entre le 37° et 46° latitude sud décroît de 29,981 à 29,804 pouces, et la moyenne est de 29,919 pendant qu'elle est de 30,005 dans la même latitude nord. Les vents ouest prédominent. Une vingtaine de stations envoient plusieurs fois par jour à Wellington le résultat de leurs observations, et elles sont publiées dans les journaux pour servir aux agriculteurs et aux navigateurs. Un service intercolonial met aussi les observatoires de la Nouvelle-Zélande en communication avec ceux de l'Australie et de la Tasmanie.
Il y a en Nouvelle-Zélande 911 écoles publiques, avec 2,143 professeurs et 68,000 élèves des deux sexes; 15,000 environ fréquentent les écoles privées, et 7,000 sont instruits dans leur famille; 80% des enfants entre 5 et 15 ans fréquentent les écoles; le nombre des personnes qui savent lire et écrire en 1881 est de 71% de la population.
Pour l'industrie, en 1881, 1,643 établissements emploient 17,938 personnes. Le sol et construction de ces établissements est évalué à environ 50,000,000 de francs, et les machines et installations, à 40,000,000 de francs.
Trente-sept hôpitaux soignent dans l'année environ 15,000 malades. Il y a aussi 7 hôpitaux de fous, un établissement (p. 229) pour les aveugles et un pour les sourds-muets.
L'excès de l'immigration sur l'émigration oscille entre 2,000 et 40,000 par an.
Le revenu ordinaire et extraordinaire, en 1881, est de 3,757,493 l. stg. La dépense dans la même année est de 3,675,797 l. stg. La dette publique a environ 30,000,000 l. stg. Déduction faite d'environ 2,000,000 pour amortissement, reste une charge de 51 l. stg. par habitant et une rente de 2 l. stg. 1/2 par an et par tête.
La caisse d'épargne postale en 1881 a reçu plus d'un million de l. stg. (25,000,000 fr.) de dépôts, et les déposants sont au nombre de 1 sur 10, pendant qu'en Angleterre ils ne sont qu'en proportion de 1 sur 19. Les sommes déposées dans la caisse d'épargne postale atteignent 1,232,788 l. stg. Celles déposées dans les autres caisses d'épargne, 316,727 l. stg., soit un total de 1,549,515 l. stg., soit une moyenne de 3 l. stg. 1 sh. 10 den. (77 fr.) par déposant.
La Nouvelle-Zélande est le premier pays qui ait essayé par l'État un système d'assurance sur la vie, dont tout le profit est distribué aux assurés. En 1882, le nombre d'assurés s'élève à 19,456, et les sommes assurées à 6,507,528 l. stg.
L'importation, en 1881, a atteint le chiffre de 7,457,045 l. stg., et l'exportation, celui de 6,060,866 l. stg. Dans ce chiffre, la France entre pour 18,014 l. stg. à l'importation, et 51,464 l. stg. à l'exportation.
Les principaux articles exportés sont: la laine pour (p. 230) 2,909,760 l. stg., l'or pour 996,867 l. stg., les produits agricoles pour 1,114,253 l. stg., le suif pour 120,611 l. stg., la gomme Kauri pour 253,778 l. stg., et le bois de construction pour 71,328 l. stg.
Le tonnage des navires entrés dans les ports de la Nouvelle-Zélande en 1881 s'élève à 461,285 tonnes, celui des navires sortis, à 438,551 tonnes. La Steam-ship Pacific Cy reçoit du gouvernement une subvention annuelle de 32,500 l. stg. pour la poste entre Auckland et San-Francisco: et on vient de voter une subvention annuelle de 20,000 l. stg. pour une ligne directe mensuelle avec Londres.
Les terres publiques ou crown-lands sont administrées par le ministre des terres, aidé de 11 bureaux des terres pour les 11 districts territoriaux. Sur les 64,000,000 d'acres que comprend la Nouvelle-Zélande, 14,000,000 ont été vendus ou réservés pour les écoles et autres services publics; 16,000,000 appartiennent aux Maoris ou aux Européens qui les ont achetés d'eux, et 34,000,000 restent disponibles. Sur ce chiffre, 15,000,000 sont couverts d'herbe ou de fougères, 10,000,000 sont en forêts, et 9,000,000 sont des lacs, rochers ou sommets de montagnes.
Les terres publiques sont divisées en trois classes: les terres de villes et villages, vendues aux enchères par lots de 1/4 d'acre, sur la mise à prix de 7 l. stg. 1/2; les terres suburbaines dans le voisinage des villes et villages dont les lots, de 2 à 15 acres, sont vendus aux enchères sur la mise, à prix de 3 l. stg. l'acre; les terres rurales, soit (p. 231) agricoles, pastorales ou forêts, qui sont vendues à un prix qui varie, selon les districts, depuis quelques schellings jusqu'à 2 l. stg. l'acre.
Auckland et les districts de Westland ont adopté le système de l'Homestead. La terre est donnée à l'immigrant, qui n'a qu'à payer le montant du mesurage; il doit résider 5 ans sur la terre, y élever une maison et cultiver, le 1/3 dans les 5 ans, s'il s'agit de terre libre; et le 1/5, s'il s'agit de forêts. Toute personne au-dessus de 18 ans peut, dans le district d'Auckland, choisir de 75 à 50 acres, selon la qualité de la terre, et toute personne au-dessous de 18 ans, de 30 à 20 acres; toutefois, une même famille ne peut obtenir plus de 200 acres de terre de première qualité ou 300 de seconde qualité. Il en est à peu près de même en Westland.
Il y a plusieurs autres manières d'acquérir la terre. On peut l'acheter aux enchères, ou par contrat ordinaire sur demande faite au Bureau des terres. Dans ce système, le prix des terres est de 4 l. stg. 1/2 l'acre pour les terres suburbaines, de 1 l. stg. pour les terres d'agriculture ou de pâturage. Une personne ne peut acheter ainsi plus de 20 acres de terre suburbaine, plus de 320 acres de terre agricole, et non moins de 500 ni plus de 5,000 acres de terre à pâturage. Les paiements sont échelonnés en 10 demi-annuités pour les terres suburbaines, en 20 demi-annuités pour les terres agricoles, et en 30 demi-annuités pour les terres de pâturage. L'acheteur peut toujours se libérer d'avance.
(p. 232) Sur les terres suburbaines, l'acheteur est tenu de transférer sa résidence dans le mois de l'achat, et d'y demeurer pendant 4 ans. La résidence est obligatoire pour 6 ans sur la terre d'agriculture et de pâturage; mais sur cette dernière on a un an de temps pour s'y installer. L'acheteur doit, en outre, s'il s'agit de terre suburbaine, cultiver au moins 1/10 la première année, 1/5 la deuxième année, et en 4 ans il doit avoir cultivé les 3/4, clôturé le tout et fait des améliorations correspondant au moins à 10 l. stg. par acre.
Dans les améliorations sont compris les constructions, clôtures, drainages, plantations d'arbres, prix de la culture, etc. Pour la terre rurale, s'il s'agit de terre libre, l'acheteur doit cultiver 1/20 la première année, 1/16 la deuxième année, et en 6 ans, il doit cultiver 1/5 et faire des améliorations correspondant à 1 l. stg. par acre. Sur la terre de pâturage, l'acheteur n'est tenu qu'au séjour de 6 ans; il n'est pas obligé aux améliorations. Après 10 ans, il peut payer la solde et obtenir la propriété définitive.
Pour les terrains aurifères, l'acheteur ne peut obtenir plus de 320 acres, et il doit y faire certaines améliorations, mais il n'est pas tenu d'y séjourner. Il paie une rente en demi-annuités de 2 sh. 1/2 par acre, et devient acheteur définitif en payant le prix attribué par la loi à des terrains analogues. Après 3 ans il peut demander l'échange de sa terre, et alors il paie à raison de 1 l. stg. 1 sh. par acre la terre qu'il reçoit en échange, échelonnant les (p. 233) paiements en 15 demi-annuités. Il reste aussi propriétaire définitif s'il paie simplement sa rente durant 17 ans consécutifs.
Les terres à pâturage sont aussi louées aux enchères, en lots pouvant contenir 5,000 moutons ou 1,000 têtes de gros bétail. Le gouvernement se réserve le droit de résilier le bail moyennant avertissement préalable d'un an, dans le cas où la terre devrait être vendue ou louée pour terre agricole. Ces locations sont faites pour 21 ans et au dessous. Toute personne qui occupe déjà des terres publiques pour 20,000 moutons ou 4,000 têtes de gros bétail ne peut louer ou acheter un autre lot, excepté pour l'acquisition d'une terre par hypothèque (mortgage).
Une autre combinaison permet de louer pour 21 ans, avec le droit perpétuel à renouveler. Trois ans avant l'échéance, le locataire déclare s'il veut renouveler en payant un loyer calculé à 5% de la valeur de la terre, fixée par expert, sous déduction de toutes les améliorations faites durant le premier bail. S'il ne veut renouveler, le bail est mis aux enchères, et le nouveau locataire doit payer à l'ancien le montant des améliorations.
Si le gouvernement avait besoin de reprendre la terre ainsi louée, il devrait rembourser toutes les améliorations, au prix fixé par expert.
En 1882, le gouvernement a vendu sur paiement immédiat à 1,257 acheteurs, 195,390 acres de terre, pour agriculture; à 271 acheteurs; 1,482 acres de terre suburbaine, et à 704 acheteurs, 303 acres de terre urbaine. Il a vendu (p. 234) par paiements échelonnés, à 497 acheteurs, 74,336 acres de terre d'agriculture; à 9 acheteurs, 24,634 acres de terre de pâturage, et à 198 acheteurs, 1,189 acres de terre de village. Il a reçu pour location de champs aurifères, 7,600 l. stg.; pour location des terres pastorales, 182,880 l. stg., et pour autres locations, 5,500 l. stg. Il a ainsi retiré des terres une somme de 535,607 l. stg.
En 1870, le parlement vota un emprunt de 10,000,000 de l. stg. pour les travaux publics et l'immigration. Depuis, 2,000 kilomètres de chemins de fer ont été ouverts, et environ le double de routes carrossables. On a organisé sur un bon pied les phares et les ports. Le télégraphe dessert tout le pays et a transmis, en 1882, 1,500,000 dépêches. La poste a transmis en 1882, 12,000,000 de lettres à 0 fr. 10 pour la colonie et l'Australie, et presque autant d'imprimés. On a amené de l'eau sur les champs aurifères pour le lavage, et 4 navires arrivent tous les ans d'Angleterre, pleins d'immigrants; 1,400 hommes suffisent à la force armée, mais, en cas de nécessité, 10,000 volontaires sont prêts à marcher, outre un millier de pompiers organisés militairement.
C'est beaucoup de progrès en 40 ans, et ce progrès augmentera encore tant que le peuple continuera à rester attaché aux principes religieux et au respect de l'autorité, qui ont fait sa force.
Mais après cet aperçu sur l'ensemble de la colonie, il est temps de reprendre mon journal de voyage.[Table des matières]
Arrivée à Auckland. — La tempête. — Le dimanche. — Le Père Mac Donald. — Catholiques et protestants. — La ville. — Los faubourgs. — Le parc du gouverneur. — L'hôpital. — Le dominion. — Les salaires. — L'intérêt. — Le baron de Hübner. — Mgr Luck et son diocèse. — Les Sœurs de la Miséricorde. — Départ pour Tauranga. — La baie. — La ville. — Excursion à Ohinemutu. — Les fermes. — Le cocher irlandais. — Le Gate-Pa. — La forêt d'Oropi. — La mid-way-house. — Les naissances et la mortalité. — Le vin correctif de l'alcoolisme. — Les gorges de Mangorewa.
Le 11 novembre, à 2 heures du matin, le Zealandia arrive à l'entrée de la baie d'Auckland; la nuit est obscure et le vent souffle avec violence; la pluie tombe à torrents. Le capitaine trouve prudent de jeter l'ancre et d'attendre le jour. À 6 heures on lève l'ancre, et on marche lentement le long de la baie, fort agitée; c'est après bien des coups de sifflet de la machine, précédés du coup de canon, que nous avons pu apercevoir le canot du pilote; il arrive armé de sa ceinture de sauvetage et prend sa place au gouvernail.
La ville se dessine à nos yeux, émergeant de la verdure sur un ensemble de collines, des deux côtés de la baie. Les nombreuses églises et la Court-House dominent les maisonnettes cachées dans les arbres; mais, au-dessus de tout, un immense moulin à vent semble veiller comme (p. 236) un géant protecteur sur la cité. Au loin, sur une colline entourée de prairies et de forêts, le plus vaste et le plus bel édifice est l'hôpital public. À 7 heures nous sommes devant le môle ou wharf, mais le pilote refuse de l'aborder; il craint que la violence du vent n'y pousse si fort le navire, que le wharf lui-même ne soit emporté. Nous jetons deux ancres et dansons sur place. Elles ne suffisent pas à nous protéger, et nous allions dériver vers un banc de sable, lorsqu'un prompt mouvement de la machine nous ramène à flot; le télégraphe ou signal, qui communique de la passerelle à la machine, est brisé; un officier se tient debout vers la chaudière, reçoit par signes les commandements et les transmet au machiniste. Malgré la pluie, la foule s'est assemblée sur le môle, et attend avec anxiété la fin de nos péripéties. Enfin, vers les 10 heures, le vent souffle moins fort, et le pilote juge bon d'aborder. Nous suivons la manœuvre avec émotion; les cris succèdent aux cris pour les divers commandements et s'efforcent de dominer le bruit du vent. On va, on court, on revient, l'émoi est général. Au moment de toucher au môle, le commandant semble perdre son sang-froid britannique; il trépigne et crie sans cesse au pilote go ahead, mais sa crainte est exagérée, tout se passe pour le mieux et bientôt on sera à terre. Les passagers se disent adieu: plusieurs restent en Nouvelle-Zélande. Pendant trois semaines compagnons de la même infortune, ils se considèrent tous comme une même famille. On salue les officiers et on porte ses effets à la douane. C'est (p. 237) le dimanche: les petits bagages passent, les autres seront visités demain. Le vent enlève les parapluies, et l'eau tombe en déluge, on va quand même: time is money. J'ai beaucoup de peine à trouver une voiture pour déposer mes bagages à l'hôtel: is sunday. C'est dimanche! Enfin je peux en raccrocher une moyennant un double prix. La poste est fermée et les boutiques aussi; impossible de trouver des timbres poste. Je prie le maître de l'hôtel de m'en faire chercher, car je veux profiter du départ du navire le Zealandia, qui s'en va à Sidney dans la nuit. Le maître de l'hôtel me répond qu'on a 6 jours de la semaine pour envoyer les lettres, mais que le dimanche on va à l'église et on ne travaille pas. Un peuple qui a un tel respect de la loi divine est un peuple d'avenir, un futur grand peuple!
Je m'en vais donc à l'église. La petite cathédrale en planches d'Auckland, malgré le mauvais temps, est remplie de fidèles; le Révérend Mac Donald célèbre la grand'messe, les chants, exécutés par des voix d'hommes et de femmes, sont harmonieux.
Après la messe, je salue le bon Père à la sacristie. Une dame, qui est venue de la campagne, à 8 milles, vient le saluer aussi. Elle me prend pour le commandant de l'Éclaireur, aviso de guerre français arrivé hier ici de Taïti, et m'invite à une soirée dansante. Elle est d'origine française, et ne veut pas laisser passer un navire français sans lui faire les honneurs de la société néo-zélandaise. Je dissipe son erreur; elle maintient quand même (p. 238) son invitation. L'Éclaireur, sorti des chantiers de Toulon en 1878, a 78 mètres de long et 12 de large; il porte 8 canons de 15 centimètres, a une machine de 450 chevaux et un terrible éperon. Le capitaine du Zealandia me l'avait montré dans la baie, et mon émotion fut grande lorsque je lui vis lever le drapeau pour nous saluer. Oh! que j'aurais voulu rencontrer ce drapeau dans toutes les mers aussi souvent que le drapeau britannique! Le R. Mac Donald m'invite à déjeuner; j'accepte d'autant plus volontiers qu'à l'hôtel on m'avait dit que le dimanche le lunch remplacerait le dîner et que le soir on n'avait que le thé, attendu que les domestiques devaient assister au service divin. En France, les catholiques s'imposent le maigre le vendredi; en Italie, le vendredi et le samedi; en Espagne, on ne fait maigre ni le vendredi, ni le samedi. Ici, les protestants ont leur privation le dimanche, et elle a pour cause le désir d'épargner, au septième jour, le travail aux domestiques.
En entrant chez les Pères Missionnaires, un bruit strident et étrange se fait entendre à la porte, et ne cesse que lorsque le concierge est venu s'interposer; un perroquet au blanc plumet monte la garde, et il s'en acquitte aussi bien que le meilleur des chiens. C'est le cockotou d'Australie.
Le R. Mac Donald me présente à un autre prêtre anglais et me parle volontiers du Concile du Vatican, auquel il a assisté, et de divers personnages français qu'il a connus dans ses deux voyages en Europe. Il est ici depuis (p. 239) 28 ans, et son frère s'occupe de l'évangélisation des Maoris depuis 32 ans; il me parle beaucoup de Mgr Pompalier, évêque français qui le premier a porté ici le catholicisme.
Il me dit qu'ici, comme dans presque tous les pays nouveaux, protestants et catholiques vivent en bons rapports, et s'estiment, non selon le plus ou moins de vérité qu'ils possèdent, mais selon le degré de vertu qu'ils pratiquent. Ceux qui ont plus reçu sont évidemment tenus à plus, et la foi ne se donne pas. Je me rappelle que, voulant un jour expliquer à un compatriote que j'avais rencontré dans l'Extrême-Orient, une de nos vérités catholiques qui me paraissait claire comme le jour, je m'étonnais que celui-ci, pourtant nature droite et sincère, ne pût la comprendre; mais il me fit cette observation: «En fait de foi, on ne croit pas ce qu'on veut, mais on croit ce qu'on peut.» Cela me rappela la réponse du cardinal Manning à ses compatriotes. Ils l'accusaient d'avoir changé de religion et lui disaient: Comment se fait-il que vous étiez auparavant fervent protestant et que vous êtes maintenant fervent catholique? Dans une brochure adressée à ses anciens coreligionnaires, le pieux prélat leur dit: «Je ne peux vous donner d'autre réponse que celle de l'aveugle de l'Évangile: Avant je ne voyais pas, à présent je vois. Pourquoi Dieu ouvre-t-il les yeux aux uns plus, aux autres moins? C'est son secret. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est le Créateur et Rédempteur de tous les hommes, (p. 240) qu'il les aime tous comme un Père aime ses enfants, et qu'il cherche le salut de tous; mais à chacun il proportionne le fardeau en raison de ses forces.»
Après le déjeuner, le bon Père me montre les habitants de son jardin: le cockotou dont j'ai parlé qui fait mille exercices à son commandement, une tortue qui se promène sur le vert gazon, et une espèce de gros merle blanc et noir qui siffle comme le merle et parle comme le perroquet. Saint Jean avait aussi sa colombe.
Je parcours la ville: la partie centrale réservée aux affaires n'est pas grande: là sont les banques, les compagnies d'assurance et de navigation, la poste, les principaux magasins; mais la ville destinée aux habitations s'étend au loin sur plusieurs collines. Les rues sont larges et plantées de chêne. Nous sommes en effet à Auckland (terre du chêne). Les gentils pavillons qui les bordent sont tous entourés d'un jardin où brillent toutes les fleurs de l'Europe. Les vérandahs qui les ornent prouvent que le climat est chaud en été. Ces pavillons sont la plupart construits en bois et couverts en zinc, en bois, ou en ardoise. Dans le centre, on ne peut plus construire qu'en pierre, en briques ou en ciment, pour diminuer les incendies.
Plus loin, ce ne sont plus des pavillons, habitation de la classe aisée, mais des maisonnettes en bois, habitation de l'ouvrier. Elles sont petites, mais elles ont leur jardin, et l'ouvrier a aussi son home (son chez soi). Des building societies (sociétés de construction) achètent de (p. 241) vastes terrains, y tracent des rues, bâtissent des maisons de diverses grandeurs et les louent ou plutôt les vendent, puisque après le paiement de quelques annuités comprenant l'intérêt et l'amortissement, le locataire reste propriétaire. Ces sociétés, tout en faisant de bonnes affaires, rendent service à la classe ouvrière et à la société. L'ouvrier qui a sa maisonnette et son jardin voit ses nombreux enfants grandir et se développer en bonne santé, pendant que les familles ouvrières entassées dans les mansardes de nos grandes villes donnent une génération sans force et sans énergie; et la plupart des enfants meurent en bas âge.
J'arrive à la maison du gouverneur: elle est en bois et fort simple, mais entourée d'un superbe parc, ouvert au public, le dimanche. Au milieu des chênes séculaires, je vois de magnifiques araucarias, des lauriers-cerises, des lauriers-roses et des lauriers-tins; le cyprès, le saule, le magnolia, l'eucalyptus et tous les arbres et arbustes qui ornent nos parcs d'Europe, le tout encadré dans cette belle pelouse que les Anglais portent partout avec eux.
Près de la High school (haute école), je rencontre le Révérend Mac Donald, qui fait sa promenade à cheval et me met sur le chemin de l'hôpital. Je descends une colline et en remonte une autre, je laisse à droite de superbes vaches paissant dans la prairie, et parcours à gauche les allées ombragées d'une magnifique forêt, appelée le dominion (le domaine), parce qu'elle est réservée au public. Les Anglais, dans le tracé de leurs villes, ont (p. 242) toujours soin de réserver de vastes emplacements pour la récréation du peuple. C'est fort sage; car le petit peuple ne peut se payer l'agrément d'une villa, et la santé du public est en raison de la salubrité de l'air qu'il respire.
Enfin, j'arrive à l'hôpital, vaste édifice en ciment à deux étages sur rez-de-chaussée, dominant la ville et la baie. Le jeune docteur qui le dirige me conduit à la visite de l'établissement. Les salles ne sont pas grandes, mais elles sont nombreuses et ornées de plantes et de fleurs. On peut loger 150 malades. On en a 90 en ce moment. La propreté est irréprochable; je remarque un ascenseur destiné à descendre dans les caves les corps des décédés; des fauteuils roulants pour les rhumatisants, et une salle pour les convalescents. Trop souvent, dans les hôpitaux de nos grandes villes européennes, les convalescents sont renvoyés pour faire place à d'autres. Obligés, pour vivre, de reprendre le travail avant d'en avoir les forces, ils retombent bientôt dans un état pire, et retournent à l'hôpital, auquel ils occasionnent de nouveaux frais. Les administrations des hospices feraient donc une économie bien entendue, et en même temps une œuvre humanitaire, en établissant dans chaque hôpital une salle pour les convalescents dont on essaierait les forces grandissantes aux travaux de la maison et du jardin, avant de les lancer dans la société, où ils sont obligés de reprendre leur travail quotidien.
Le jeune docteur fait appeler deux Français qui sont (p. 243) en ce moment dans l'établissement: un est de Saint-Malo, et l'autre de Nantes. Venus ici comme matelots, ils y sont restés parce qu'ils y ont trouvé la vie large et facile: occupés dans les champs à garder les vaches, ils étaient logés, nourris, et recevaient 6 schellings par jour (7 fr. 50); ils sont légèrement atteints de la poitrine.
Les gages sont élevés dans ce pays: le moindre ouvrier gagne 6 à 8 schellings par jour; les capitaux sont encore plus chers.
Les banques donnent 6% sur dépôts compte courant, mais elles prêtent à 1% par mois; on prête sur hypothèque à 10%, et comme les terres ne rapportent ordinairement qu'environ 8% malheur au farmer (propriétaire) qui est obligé d'emprunter! Comme en Europe, le fruit de ses travaux ira au capitaliste!
En quittant l'hôpital, je parcours diverses collines et je vois partout les familles se diriger vers les églises. La cloche tinte; il est 6 heures 1/2; l'office commence chez les diverses communions protestantes: celui des catholiques a lieu à 7 heures. J'arrive à Saint-Benedictus, la principale église catholique, desservie par les Bénédictins. Elle est en bois, vaste, et à trois nefs. Son autel est fort simple et se distingue peu de plusieurs églises protestantes, qui adoptent aussi les chandeliers et les cierges. À la tribune, les chants sont exécutés, comme à la cathédrale, par des voies d'hommes et de femmes; on chante les vêpres, et après les vêpres on donne le salut; le recueillement est parfait. Il est bien tard lorsque j'arrive à (p. 244) l'hôtel pour le thé. Je passe la soirée chez le Révérend Mac Donald à parler des hommes et des choses du pays, et à 10 heures je m'en vais au Zealandia donner un dernier adieu aux passagers et aux officiers. Je trouve là le baron de Hübner qui vient de visiter la Nouvelle-Zélande et s'en va à Sidney: il occupera probablement la cabine que j'ai laissée disponible. Ce bon observateur nous a déjà fait connaître, par sa Promenade autour du monde, les États-Unis, le Japon et la Chine; il donnera probablement encore au public ses impressions sur les colonies océaniennes et sur les Indes orientales qu'il va visiter.
Enfin, je reviens dans la petite cellule du Star hôtel, chercher un repos d'autant mieux mérité que toutes mes courses depuis le matin ont eu lieu avec la pluie sur le dos. Aux fenêtres, pas de persiennes; à 4 heures le jour me réveille, à 5 heures je complète ma correspondance, et un peu plus tard, je me rends chez Mgr Luck, évêque catholique d'Auckland; il demeure à la campagne, à une des extrémités de la ville. Ce bon bénédictin me reçoit avec bonté; il voudrait me retenir chez lui et me fait l'historique de son diocèse, qui a eu bien des péripéties. Il a 12 prêtres pour les 16,000 catholiques répartis dans toute la partie nord de l'île du Nord formant son diocèse, et un seul prêtre pour les 30,000 Maoris, qui sont la plupart catholiques. Point de petit séminaire, pas de séminaire; la grande difficulté est le recrutement d'un clergé sérieux. Ses compatriotes sont, comme la plupart des (p. 245) Anglais, sujets à l'alcoolisme. Pour l'instruction des jeunes filles, 39 Sœurs de la Miséricorde irlandaises lui rendent de grands services. Elles ont 6 maisons et un noviciat. Nous en visitons deux, attenantes à l'habitation épiscopale. Dans une, 30 internes et 40 externes reçoivent l'instruction; dans l'autre, à côté, 80 orphelines apprennent le travail manuel propre à leur sexe. La plupart sont envoyées par le gouvernement, qui a donné le terrain et fournit un secours annuel de 12 livres par orpheline. Nous parcourons les dortoirs, les classes, les ouvroirs: ils sont en bois, bien éclairés, bien aérés, et entourés d'un parc gracieux qui domine la baie. Pour les garçons, Monseigneur n'a qu'une école, confiée à 2 laïques, s'occupant de 70 élèves; les autres vont aux écoles protestantes, nombreuses et bien tenues. Monseigneur attend les Frères Marianites de Lyon, qui pourront relever les écoles de manière à recevoir tous les élèves catholiques. Il espère par là arriver au petit, et plus tard au grand séminaire.
Monseigneur a la bonté de me conduire à son école de garçons, puis chez le consul de France; un bon Écossais qui ne parle qu'anglais, et aux divers bureaux des compagnies de navigation où je dois me renseigner. Ensuite, il m'emmène chez lui pour le dîner, et je le quitte pour me rendre au bateau qui doit me conduire à Tauranga.
Il est 5 heures du soir lorsque ce petit bateau à vapeur quitte le wharf (môle). Le directeur de la Compagnie Mac Gregor, avec lequel j'étais venu depuis San-Francisco, (p. 246) a la bonté de m'accompagner, il me recommande au capitaine. Nous parcourons la belle et vaste baie, admirant encore une fois le superbe panorama de la ville. Je remarque un monsieur à la figure tatouée de hiéroglyphes depuis le menton jusqu'au front; il porte mac-farlane et chapeau haut de forme. On me dit que c'est un chef maori, un de leurs principaux orateurs. Je l'aborde et l'interroge, il est fort aimable et très poli, mais il ne connaît que quelques mots d'anglais et la conversation est difficile. Après le dîner, le salon se convertit en un dortoir où une vingtaine de passagers couchent sur étagères les uns au-dessus des autres.

Nouvelle-Zélande.—Chef Maori.
La mer est extrêmement agitée: ce petit bateau est ballotté comme une coque de noix. On a de la peine à se tenir dans son lit; mais ma fatigue était si grande, que je me réveille le matin, me rappelant, comme dans un rêve, d'avoir fait de continuels efforts pour ne pas être jeté à bas.
À 10 heures du matin, nous entrons dans la gracieuse baie de Tauranga, avec deux heures de retard.
La petite ville de Tauranga compte 4,000 habitants; elle se compose de quelques maisons de bois, parmi lesquelles (p. 247) 2 hôtels, plusieurs boutiques, une église protestante et une cabane en planche servant d'église catholique. Je quitte ici un brave garçon de Lyon; il était venu comme marin, mais il connaissait le métier de boulanger; son esprit d'économie lui permit de prélever un petit pécule sur ses gages élevés, et il est maintenant chef boulanger dans une ville naissante, élevant dans l'aisance une nombreuse famille. Les objets de luxe sont chers, mais le nécessaire à la vie, en moyenne, ne dépasse pas les prix de l'Europe; le pain vaut 6 sous la livre et la viande 10 sous.
À 11 heures je monte dans un break que conduit un robuste Irlandais. J'ai pour compagnon de voyage deux photographes, qui s'en vont sur le lac Taupo prendre les meilleures vues de ce paysage enchanteur. Nous traversons une riche contrée parsemée de fermes. Le fern (fougère) et le titree (buisson de bruyère) est remplacé par un beau gazon vert que broutent les vaches et les chevaux. Les habitations des farmers occupent toujours le monticule dominant; une petite rivière porte ses eaux limpides et murmurantes à travers ces fermes prospères. Mais la population est encore peu nombreuse, et plus loin, les fougères et les titrees couvrent seuls le terrain. Assis à côté du cocher, je cause avec lui: l'Irlandais est communicatif, il prend même volontiers la plaisanterie. Mon cocher est ici depuis 9 ans, et je lui demande s'il se trouve mieux qu'en Irlande. Oui, me dit-il, j'y ai meilleure nourriture. En Irlande, je travaillais une (p. 248) ferme près de Dublin avec mon père et mes frères, et on nous donnait pour cela 6 livres chaque 6 mois. À peine arrivé à Auckland, je recevais 4 livres par semaine comme cocher; j'ai pu bientôt économiser assez pour me mettre patron; mais là je n'ai pas réussi, et j'ai fait faillite. Mon frère alors, qui exploite un hôtel à Ohinemutu et entretient cet omnibus, m'a pris à son service et me paie 4 livres par semaine. Un autre de mes frères a gagné une vingtaine de mille livres aux goldfields (champs d'or) de Thames, près Auckland, et continue à y faire de bonnes affaires en spéculant sur les actions. J'ai encore trois autres frères en Amérique, un à Chicago, un à New-York, et un en Californie: ils ont tous prospéré et élèvent chacun une nombreuse famille.
La route est d'abord excellente; à défaut de pierres, on la charge de coquillages qui couvrent la plage et forment une chaussée très dure; mais dans l'intérieur les coquillages font défaut et la boue commence. Nous arrivons au Gate-Pa où, en 1864, les troupes britanniques, prises d'une panique, s'enfuirent devant les Maoris, abandonnant leurs officiers, qui tous périrent de la main de l'ennemi. Le lendemain, lorsque les troupes revinrent, elles trouvèrent le colonel Booths blessé mortellement; les Maoris avaient mis sous sa tête un coussin d'herbe, et un bassin d'eau à son côté, sans toucher ni à sa montre, ni à sa chaîne. Je doute que des Européens civilisés en eussent fait autant envers leur ennemi. Un peu plus loin nous entrons dans la superbe forêt d'Oropi: (p. 249) elle est ce que les siècles l'ont faite. De gigantesques squelettes d'arbres morts se tiennent à côté d'autres à la fleur de la vie; les lianes s'entrecroisent, les parasites poussent partout: quelques-uns enlacent tellement les arbres, qu'ils les étouffent et végètent à leur place; quelques arbres ont plus de 2 mètres de diamètre, j'en ai vu un à demi brûlé qui avait de 7 à 8 mètres de diamètre. Mais tout est en désordre; la vie est à côté de la mort; les Maoris n'ont pas fréquenté les cours de l'École forestière. Cette forêt, comme le reste de l'île, leur appartenait, et ce n'est qu'à la suite de la dernière guerre que le gouvernement l'a confisquée avec la plupart de leurs terres.
La route suit un terrain onduleux, monte et descend des collines; par-ci, par-là on a fait une chaussée avec des fascines, mais les trous sont nombreux et les sursauts aussi. Nos quatre robustes chevaux ont de la peine à nous sortir de la boue, et la pluie ne discontinue pas. Vers le milieu de la forêt, nous nous arrêtons à une baraque appelée Mid-way house. Il est 4 heures, et je n'ai pas mangé depuis le matin; l'appétit fait trouver délicieux le modeste repas. Cet endroit solitaire doit être très sain; nous y voyons une douzaine de petits enfants de l'hôtesse: les familles sont prolifiques dans les pays nouveaux et l'aisance générale prolonge la vie. Les décès, qui sont de 21,6 par mille en Angleterre, n'atteignent que 17,59 en Queensland, 16,22 en Tasmanie, 15,52 en Victoria, 12,15 en Nouvelle-Zélande. Le petit livre indicateur (p. 250) qu'on m'a remis à Tauranga dit à propos de cet endroit par un N. B. et entre parenthèses. (Even good Templars may drink here with the greatest impunity; it is so very retired!) Même les bons Templiers (sorte de francs-maçons) peuvent boire ici avec la plus grande impunité; l'endroit est si caché!
Ainsi toute la lecture de la Bible et la plus stricte observation du dimanche n'arrivent pas à extirper de ces populations la plaie de l'alcoolisme! Je crois qu'on y arriverait plus facilement en favorisant la culture de la vigne, de manière à rendre le vin abordable au peuple comme boisson journalière. Le vin mêlé à l'eau est la plus saine et la plus fortifiante des boissons. Le corps humain a besoin pour les fonctions digestives d'une certaine quantité d'alcool; si on ne la lui donne innocente par le vin dans les repas journaliers, il la prendra à intervalles par des drogues malfaisantes. Les temperance hôtels, qu'on rencontre partout ici, comme en Angleterre, et dans lesquels on ne boit que de l'eau, seraient mieux nommés intemperance hôtels, car tempérance indique juste milieu; et le rien est aussi intempérant que le trop. À part quelques heureuses exceptions, l'excès provoque l'excès, et l'alcoolisme n'est pas une plaie spéciale au Maori. Les pays vinicoles sont ceux qui ont le moins d'ivrognes: le corps qui a eu le nécessaire recourt plus difficilement au superflu. À l'heure actuelle l'Australie produit d'excellent vin, et on le vend encore ici à 7 fr. la bouteille; le moindre vin français vaut 10 fr. la bouteille; il est donc (p. 251) inabordable. Les nombreux coteaux de la Nouvelle-Zélande pourraient fournir assez de vin pour que, même à un prix rémunérateur pour le viticulteur, l'habitant puisse le boire à moitié prix de la bière, à la condition que la régie ne perçoive pas le double et le triple du prix du coût.
Une heure après avoir quitté la Mid-way house, nous pénétrons dans les magnifiques gorges de Mangorewa. La petite rivière se brise avec fracas de précipice en précipice, et des murailles de rochers s'élèvent à pic à 50 mètres de haut. Enfin, après 18 milles, nous quittons la forêt, et quelques milles après, à 9 heures 1/2 du soir, nous sommes à Ohinemutu, sur le lac Rotorua.[Table des matières]
La tradition des Maoris sur leur venue en Nouvelle-Zélande. — Rangatiki et son chien Potaka. — Hinemou et Tutanekai. — Le lac Rotorua. — Les eaux thermales. — Un Pa. — Les Maoris, leurs vêtements, leur nourriture. — Mœurs et usages. — L'anthropophagie. — La carved-house. — Tiki et Maui et le récit de la création. — Raïnga et la route du ciel. — Les ministres protestants et le traité de Waïtangi. — Les Pères Maristes. — La forêt de Tikitapu. — Le lac Rotakakahi. — Waïroa. — Les femmes Maoris et le tabac. — Costumes et jeux. — L'école. — Un examen de géographie. — L'instruction. — La cascade. — La haka ou danse indigène. — Le lac Tarawera. — Le Té Tarata ou terrasse blanche. — Le lac Rotomahana. — Les geysers. — Le repas. — La Aukapuarangi ou terrasse rouge. — Un bain bouillant. — Retour à Waïroa et à Ohinemutu.
La tradition des Maoris est qu'ils seraient venus en Nouvelle-Zélande dans de grands canots, sous la conduite d'un certain chef qui, à la suite de querelles, voulut quitter les îles malaises, son pays natal. Ils conservent le nom des divers canots et rapportent les faits et gestes des tribus qui en sont sorties. En tenant compte de leurs récits, on peut croire que leur migration remonte à 20 générations, c'est-à-dire à peu près au XVe siècle.

Rangatiki, chef Maori.
Pour ce qui concerne la découverte de cette région des lacs, la tradition maori dit qu'un certain Rangatiki, chef du canot Arawa, venu lui aussi avec les autres de Hawaïki (p. 254) (qu'on suppose être Sumatra)[7] débarqua à Maketu et commença à explorer la contrée avec les siens et Potaka, son chien favori. Mais celui-ci disparut bientôt et ne reparut qu'après deux jours. Il était malade, et on s'aperçut qu'il avait eu une indigestion de poissons. Son maître comprit donc que Potaka avait découvert une mer, et suivant ses traces, on arriva au bord d'un lac qu'on nomma Rotoïti (petit lac). Là, comme le chien, le maître et les siens se gorgèrent d'un petit poisson appelé inanga. Poursuivant plus loin, ils arrivèrent à un autre lac qu'ils appelèrent Rotorua (second lac). Dans l'île Mokoïa, qui s'élève au milieu, de ce lac, ils trouvèrent une tribu dont le chef, Kawaarero, leur fit bon accueil, mais leur proposa bientôt de manger le chien. N'ayant pu l'obtenir, il surprit un beau jour le pauvre Potaka et le mangea en (p. 255) secret. Mais Rangatiki, à la suite d'une incantation, apprit le fait et le reprocha à Kawaarero, qui s'indigna en le niant. Rangatiki appela le chien en témoignage «Potaka tawhiti e kai hea koe?» (mon cher Potaka, où es-tu?) Et le chien répondit en aboyant dans le ventre de Kawaarero. Celui-ci fut donc tué à l'instant, et sa tribu mise en pièces. Rangatiki avec les siens s'établirent à leur place. Plus tard, une jeune fille appelée Hinemoa, attirée par les sons de la flûte du jeune Tutanekai, traversa le lac à la nage et vécut heureuse avec lui; de là le nom d'Ohinemutu, donné à l'endroit, nom qui signifie la jeune fille qui traverse à la nage.

Hinemoa, jeune fille Maori.
La vue du lac Rotorua est gracieuse, le paysage est verdoyant. Des vapeurs sortent de tous côtés, s'élevant dans les airs comme d'une terre en feu. Partout des sources bouillantes et des trous brûlants. Une petite presqu'île s'avance dans le lac; elle était beaucoup plus grande, mais une bonne partie a disparu sous les flots. Ce qui reste est occupé par une vingtaine de whares, cases ou cabanes maoris. Elles ont à la façade principale une porte et une fenêtre et sont couvertes d'une espèce de paille longue, de la famille (p. 256) des genêts. Quelques-unes ont une cheminée, la plupart n'en ont point. Le Maori cuit ses aliments dans l'eau chaude ou à la vapeur des sources qui l'entourent. Ces braves gens ont l'air bien constitué, figure riante, peau brune donnant sur le rouge, lèvres un peu épaisses, yeux noirs et pétillants, belles dents blanches.

Un Pa ou village maori.
Ils sont vêtus à l'européenne, mais la plupart ont les pieds nus et quelques-uns entourent leur corps simplement avec une couverture ou un châle multicolore. Les femmes aussi bien que les hommes ont de beaux cheveux noirs; les veuves les coupent courts comme les hommes en signe de deuil. Les femmes mariées se tatouent les lèvres et le menton, les chefs se tatouent plus ou moins artistement toute la figure avec un os de poisson. Leur nourriture consiste en pommes de terre, en porc et poissons. L'anthropophagie commença à diminuer (p. 257) chez eux dès que le capitaine Cook introduisit ici le cochon, vers la fin du siècle dernier. L'homme qui a faim et qui n'a rien à mettre sous la dent s'attaque nécessairement à son semblable. Il y a deux ans, les survivants de la mission Flatters, à bout de force dans le Sahara, convinrent que chaque matin un d'eux serait tiré au sort et servirait de nourriture aux autres. La mission Greeley au pôle nord a donné les mêmes exemples.

Maoris ou Néo-Zélandais.
Plusieurs Maoris jettent leurs lignes primitives dans les eaux du lac et en retirent de belles carpes d'importation anglaise. Elles s'y sont tellement multipliées que parfois, à la suite de l'explosion d'une cartouche de dynamite, la surface du lac en est couverte, et elles deviennent ainsi la proie facile du Maori, insouciant de leur destruction. Garçons et filles, hommes et femmes se baignent en costume d'Adam et d'Ève, sans se douter de la moindre inconvenance; j'avais remarqué le même fait au Japon. Lorsqu'il fait froid, au lieu de se baigner dans le lac, ils se plongent dans les bassins d'eau minérale. Cette eau est ici alcaline, (p. 258) là sulfureuse, ailleurs arsenicale. Les blancs s'en servent contre les rhumatismes et les maladies de foie. Au milieu du Pa (settlement ou établissement) s'élève la Carved house, maison sculptée: c'est une cabane plus grande que les autres, tapissée de boiseries sculptées; elles représentent des monstres ou figures d'hommes et de femmes tirant leur langue et ayant deux coquillages brillants en guise d'yeux. Presque toutes les cabanes maoris ont à l'entrée une de ces caricatures qui, probablement, dans leur ancienne religion, devaient figurer des dieux protecteurs.
Actuellement ils sont tous chrétiens et la plupart catholiques; mais leur ancienne religion conservait, comme au reste chez tous les peuples, les traces de la tradition des vérités primitives communes au genre humain. Ainsi leur récit de la création raconte qu'une divinité bienfaisante appelée Tiki visita la terre au début de son existence, et forma avec ses mains un homme en terre rouge pétrie avec son sang, et le mit à sécher contre une haie; en séchant la vie vint en lui, et Tiki fut content de (p. 259) son œuvre. Il forma de la même manière le corps d'une femme et le mit à sécher au soleil, et en séchant la vie vint en elle. Ce premier couple se multiplia et remplit la terre; mais cette génération fut si méchante que Tiki décida de la détruire au moyen d'un déluge qui mit toute la terre sous l'eau. Alors vint une autre divinité appelée Maui, qui, avec ses trois frères, se mit à pêcher. Un des frères, avec un grand hameçon formé de la mâchoire d'un de ses ancêtres, prit quelque chose pour laquelle il fallut les efforts de tous les pêcheurs pour la mener à fleur d'eau; or, c'était la Nouvelle Zélande, qu'ils fixèrent sur un bâton, et le monde recommença de nouveau.

Nouvelle-Zélande.—Types Maoris de la classe supérieure.
Les Maoris croyaient aussi à l'immortalité de l'âme, et plaçaient la route du ciel à travers Raïnga, grotte qui se trouve au cap nord de l'île Nord. Après une bataille, ils croyaient entendre le bruit des âmes qui passaient à l'autre monde sur un bâton formé de racines de pohutukawa, arbre qui croît en ces lieux. Les grands chefs ne pouvaient y passer qu'en laissant là un de leurs yeux, destiné à devenir une nouvelle étoile dans le firmament. Les méchants allaient à Po, lieu de souffrance où vont tous les mauvais esprits.
Ils conservaient aussi le souvenir d'un certain Tawaki, homme de bien, qui traversa la terre en guérissant, les malades et qui fut enlevé au ciel sans mourir, et de là il veille sur les mortels qui l'invoquent. Probablement cette tradition se rapporte à Élie, et leur vient du peuple juif, avec lequel il dut y avoir communication.
(p. 260) Ohinemutu se compose de trois hôtels, et de quelques écuries.
Après avoir visité les environs et pris un bain d'eau minérale, je pars avec une famille de Tasmanie pour Waïroa. La route traverse d'abord une plaine de 3 milles de long. Le gouvernement y a tracé une future ville et construit un bain, une Court house, et le logement d'un médecin. Les terrains ont été lotisés et vendus pour 89 ans selon la méthode anglaise, au profit des Maoris propriétaires. Les enchères ont élevé les prix jusqu'à plus de 50,000 fr. de rente annuelle, mais, faute d'habitants, les pauvres Maoris n'ont pas encore vu le premier sou.
Un clergyman chevauche avec sa fille pour visiter les environs: on me dit que c'est un évêque protestant. Les ministres protestants sont venus ici en 1814, et ils ont si bien manœuvré, qu'en 1840 ils ont obtenu que la plupart des chefs signent à Waïtangi (eau des pleurs) un traité qui les rendait sujets de la Grande-Bretagne. Les missions catholiques sont venues en 1837 avec les Pères Maristes.
Nous laissons à droite les geysers de Whakarewarewa, qui envoient leur vapeur vers le ciel, et entrons dans la superbe forêt de Tikitapu. Les merles y font entendre leur sifflet monotone et mille sortes d'oiseaux les accompagnent de leurs chants mélodieux. Des pigeons sauvages et des faisans au superbe plumage s'élancent à tout instant à l'approche de notre voiture. Les parasites entourent les arbres, les lianes s'entrecroisent, l'aubépine est en pleine floraison, ainsi que le titree. Les Maoris coupent (p. 261) des arbres séculaires, des rimu, des tawa et des miro, et y creusent de superbes canots longs de 8 à 10 mètres. Lorsque nous quittons la forêt nous sommes au bord du lac Tikitapu (lac bleu) superbe nappe d'eau azurée, dans laquelle ne vit aucun poisson. Les Maoris tiennent ce lac pour sacré et croient qu'un dragon divin en fait sa demeure. Un bourrelet de terre sépare le lac Tikitapu du lac Rotokakahi (lac vert). Celui-ci est à 70 pieds en contre-bas du premier. Sur ses bords croît en quantité le wharangi, espèce de buisson que le bétail mange avec avidité mais dont souvent il meurt. Au milieu du lac Rotokakahi s'élève une petite île pittoresque appelée Motutawa. Ses eaux se déversent dans le ravin par une petite rivière qui à Waïroa se précipite d'une trentaine de mètres en gracieuse cascade.

Maoris ou Néo-Zélandais.
À midi 1/4, nous arrivons à Waïroa au Rotomahana hôtel. Une quantité de Maoris nous entourent et nous saluent gracieusement. Les jeunes filles portent leurs petits frères ou sœurs sur le dos, enveloppés dans un châle; les femmes fument la pipe et nous demandent du (p. 262) tabac. Mon compagnon, qui connaît un peu le langage maori, leur dit: «Katahi taku mea whakama ko te wahine kïa kaï païpa» Je suis honteux de voir les femmes fumer.—Then don't look, répondit l'une d'elles en parfait anglais: (alors n'y regarde pas). Maka a tu te païpa, jette ta pipe, ajoute l'Anglais; no fear, répliqua la femme: (pas de crainte).—Engari me hoko he hopi kana he tupeka, continua l'Anglais (il est mieux d'acheter du savon que du tabac).—Kahore! répliqua la femme avec un rire moqueur, et les autres criaient: Kapaï te tupeka (le tabac est bon) no good te hopi (le savon n'est pas bon).
Le tabac et l'alcool sont la perte de ce pauvre peuple si bon et si simple. Quoi d'étonnant? l'Anglais lui-même a tant de peine à s'en défendre! Les hommes comme les femmes chez les Maoris portent un seul pendant d'oreille; c'est une longue pierre de jade ou une dent de requin tenue avec de la cire d'Espagne, ou un paquet de plumes attaché à l'oreille avec un fil de laine, ou simplement de la ficelle. Or, souvent son poids allonge hors mesure l'oreille qui le porte et le trou où passe la ficelle s'agrandit. Un autre ornement des deux sexes est aussi un collier portant au centre en pierre verte l'image grotesque d'un homme ou d'une femme ayant pour yeux deux haricots rouges. Une quantité de jeunes filles vêtues de rose, de rouge, de vert, avec des robes à volant, comme des danseuses, jouent dans le chemin avec des garçons ou d'autres jeunes filles en jetant des boutons contre un clou (p. 263) planté à terre. Cette bande joyeuse nous suit à la Carved house, maison sculptée dans le genre de celle d'Ohinemutu, mais plus petite. Une vieille femme y fait des tapis de plumes de faisans et de pigeons qui ressemblent assez à de magnifiques peaux d'animaux. Elle en demande fort cher; le moindre coûte 4 livres (100 fr.) il y en a même un grand de 50 guinées (plus de 1,300 fr.). Bon pour les amateurs! C'est avec ces tapis que les anciens chefs couvraient leurs épaules comme d'un manteau royal. On veut me vendre des massues sculptées, et autres armes indigènes en bois, mais elles sont fort chères quoique bien intéressantes. Nous avons de la peine à nous tirer hors de la troupe joyeuse des Maoris pour prendre notre lunch.

Maoris ou Néo-Zélandais.
Après le repas, nous visitons l'école. Une vingtaine de garçons et de jeunes filles de 7 à 15 ans occupent divers bancs. Une jeune femme de 30 ans, avec sa gravité britannique, a toute la peine du monde à faire tenir tranquille cette jeunesse nerveuse. Son père, vieillard à barbe (p. 264) blanche, vient souvent à son aide. L'école est une simple cabane de bois. Plus pratiques que dans nos pays, les colons de la Nouvelle-Zélande gardent leurs millions pour un meilleur emploi que celui d'élever des palais scolaires dans tous les villages. Par contre, ils répandent l'instruction à profusion et le nombre d'écoliers, quoique dans un pays où 500,000 âmes occupent une surface plus grande que celle du Royaume-Uni, dépasse le nombre de 15 par 1,000 habitants, pendant qu'il n'est que de 13 en Angleterre. Il est vrai qu'on ne les fatigue pas comme dans nos vieux pays. Deux heures d'école le matin et deux heures le soir leur apprennent autant que les longues journées de classe dans nos pays d'Europe. L'attention de l'enfant ne pourrait se prolonger au-delà d'une certaine limite; passé cette limite, forcer la nature c'est du temps perdu.

Jeune fille Maori de la classe supérieure.
Les parents sont obligés d'envoyer à l'école leurs enfants depuis 7 jusqu'à 15 ans: les parents négligents sont punis par les boards of schools, qui ont pour cela des pouvoirs discrétionnaires. Par une permission spéciale du board, on peut envoyer l'enfant dès l'âge de 5 ans et l'y laisser jusqu'à 17. La plupart des écoles sont mixtes, et certes c'est là un inconvénient, mais grandement tempéré par la forte idée du devoir que les Anglais inculquent dès la plus tendre enfance. Dans beaucoup d'endroits, le (p. 265) même maître fait l'école pendant une semaine dans un village et pendant une autre semaine dans le village voisin. Or, souvent les distances sont grandes, mais le maître peut se payer un cheval: il reçoit environ 3,000 fr. l'an. La maîtresse d'école nous dit que 70 enfants sont inscrits, mais que le plus grand nombre sont actuellement avec leurs parents dans le bush (forêt) à quelques milles de distance, pour la semaille des pommes de terre et du maïs. Elle nous montre les cahiers des élèves, dont quelques-uns prouvent l'aptitude du Maori pour la calligraphie. La seule langue enseignée est l'anglais. On passe un petit examen de lecture, puis le maître interroge sur la géographie.—Où se trouve le Congo?—la Tamise?—Et les élèves en indiquent la situation sur la carte.—Où est la Chine?—Un enfant la montre du doigt;—Qu'est-ce qu'on y récolte pour l'exportation?—Un autre répond: Le thé et la soie.—Où se trouve Mauritius?—Un élève en désigne la place—Qu'est-ce qu'on y récolte?—La canne à sucre, qui donne le rhum et le sucre.—Un maître italien aurait demandé à propos de la Chine quels sont ses meilleurs poètes; un maître espagnol, si on y élève de farouches taureaux pour les courses, et un maître français, si on y a proclamé les droits de l'homme. Avant de quitter l'école, la maîtresse prend place à l'harmonium et les élèves nous (p. 266) chantent en bonne mesure et avec harmonie des cantiques anglais et des chansons maoris. Je remarque les nombreux tableaux qui tapissent les murs; ce sont des cartes géographiques, des dessins d'animaux pour l'histoire naturelle, des groupes bibliques pour l'enseignement de l'Ancien et du Nouveau Testament; l'enfant apprend bien plus facilement par les yeux.

Élève Maori.
Pendant ce temps, la pluie s'est calmée. Je n'ai pas encore vu un jour sans pluie depuis que je suis en Nouvelle-Zélande, et la région des lacs que je visite, avec ses nuages, sa verdure et ses pluies, me rappelle le Catherine-Lock d'Écosse, ou le Windhermere du Cumberland.
Nous profitons de l'éclaircie pour visiter la cascade. À 3 heures, les enfants quittent l'école et nous suivent tous, chantant les chansons indigènes sur une cantilène analogue à celle des chansons arabes. Nous pénétrons dans un vallon profond où croissent les arbres séculaires. Les parois en sont abruptes et glissantes; les deux miss tasmaniennes et leur frère sont à leur aise dans l'étroit sentier aussi bien que les indigènes; mais une vieille dame de Christchurch, qui est de la partie, ne peut tenir debout, et je lui sers de bâton. Après 10 minutes de descente, nous arrivons au fond, et admirons la superbe cascade qui tombe avec fracas dans un bassin. (p. 267) De là l'eau se déverse par des branches multiples dans le torrent, et va se perdre dans le lac voisin. En remontant nous faisons collection de fougères et de mousses qui tapissent le sol, et allons visiter la vieille église de la mission. C'est une baraque de planches couverte de lierre. Ces plantes pénètrent même dans l'intérieur, où elles pendent en lianes. De la fenêtre de l'église on jouit d'une vue délicieuse sur la forêt, la montagne, et sur le lac Tarawera.

Élève Maori.
Dans la forêt, je suis bientôt arrêté par les lianes; je visite le cimetière, que les Maoris placent toujours dans un endroit élevé. Le Pa (agglomération) de Waïroa est catholique comme la plupart des Pa maoris. À 6 heures, nous rentrons à l'hôtel. Là, les enfants qui nous avaient suivis nous demandent leur rétribution comme guides; mon compagnon leur distribue une quantité de petite monnaie, et les miss leur portent deux corbeilles de morceaux de pain. Celui-ci est bientôt dévoré, et les pence volent en l'air pour jouer à pile ou face. Après le dîner, je demande à voir une haka (danse indigène). Plusieurs s'offrent à l'exécuter moyennant le prix courant, qui est d'un schelling par danseur ou danseuse. J'avais entendu dire que souvent ces danses dégénèrent en scènes scandaleuses, et je préviens mes danseurs qu'ils n'auront rien s'ils manquent à l'honnêteté. Ils m'introduisent dans une de leurs whares (cabanes); je me courbe pour passer par la petite ouverture. Un feu au milieu de la case a servi à cuire les aliments; mais la fumée n'a d'autre issue (p. 268) que la porte et aveugle les habitants. On le pousse au dehors et on allume deux bougies placées à terre dans deux souliers servant de chandeliers. Les danseurs s'alignent et un d'eux commence à battre la mesure en frappant de ses deux mains contre ses genoux; puis il bat du pied droit par terre en cadence, allonge les bras en avant, gesticule des mains, porte les deux bras à droite, puis à gauche, puis en l'air et en bas, continuant la mesure par le son de la voix et le battement du pied; les autres font de même, en sorte qu'on dirait autant de mannequins mus par une seule machine. Après plusieurs reprises de ce jeu fantastique viennent les grimaces, les contorsions de la bouche et des yeux. Craignant que l'excitation n'arrive trop loin, j'arrête le haka et laisse les danseurs et les danseuses jouir en paix de leur petit salaire.

Té Tarata ou White Terrace (Terrasse Blanche) à Rotomahana.
Le lendemain, à 6 heures, le tamtam nous réveille, et une 1/2 heure après, le déjeuner est servi. À 7 heures, nous nous acheminons vers le lac Tarawera. Sophia et Kate, les deux guides choisis par les Maoris, nous précèdent. Une d'elles, Sophia, porte la médaille de sauvetage; elle a plongé et pêché un vieillard un jour où le canot a chaviré dans le lac Rotomahana. Nous sommes 10 visiteurs. Arrivés au bord du lac, 6 prennent place dans un canot anglais et 4 dans l'autre moins grand. Le premier a 6 Maoris et le deuxième 4, chacun avec une longue rame, et nous voilà en route. Le lac Tarawera a 8 à 10 milles de long; les rives que nous quittons sont verdoyantes et les montagnes boisées. Plus loin, la nature est moins (p. 269) vivante. Les deux canots font une espèce de régate et jouent à se devancer. Le nôtre a une voile; le vent souffle froid et vif, et nous arrivons les premiers à Tahunatorea, autre Pa maori. Là, nous laissons nos canots européens, et après avoir mis nos effets dans deux canots maoris (troncs d'arbre creusé) qui nous suivront par la petite rivière, nous traversons un isthme d'un mille de large pour arriver au lac Rotomahana. Du haut de la colline nous voyons la Té Tarata ou terrasse blanche. De ce point, elle n'offre rien de surprenant; mais après avoir descendu la pente et pénétré sur son domaine, nous sommes ravis. Nous marchons sur des filigranes de stalactites, à travers mille bassins grands et petits; taillés avec la précision d'un artiste et remplis d'une eau azurée (p. 270) comme le ciel du Japon. On dirait que le grand Architecte s'est plu à orner ce magnifique parc de ce superbe monument. Il est plus large à la base: environ 150 mètres, et va en se rétrécissant au sommet, élevé de 100 pieds sur le niveau du lac. Nous pataugeons dans l'eau, qui devient de plus en plus brûlante à mesure que nous approchons du sommet. Là, un petit cratère de 10 mètres de diamètre et de 50 pieds de profondeur est tantôt vide et on descend au fond, tantôt il se remplit d'une eau bouillante à briser tous les thermomètres. Alors, si le vent du nord-est vient à souffler, une colonne d'eau s'élève jusqu'à 200 pieds de haut, et retombe en superbes nappes d'argent; c'est comme les geysers du Yellowstone Park dans l'Amérique du Nord. Tous les objets qu'on place sur la terrasse sont bientôt pétrifiés. Nous redescendons et parcourons un terrain rempli de geysers moins grands. Je remarque un petit cratère qui lance de la vapeur comme la machine d'un grand navire et fait un bruit qu'on prendrait pour celui d'une immense scierie à vapeur. Un peu plus loin, la terre bout à chaque pas et soulève une sorte d'argile fine que les Maoris mangent volontiers. J'en goûté et n'y trouve que le goût du sulfate de fer. La vapeur fuse de tous les côtés, on ne peut faire un trou en terre avec le parapluie sans qu'il en sorte de l'eau bouillante ou de la vapeur. La terre est pour sûr une grande marmite.

Vue générale du lac bouillant de Rotomahana.
Ce n'est pas sans danger qu'on marche, sur ces volcans plus ou moins actifs; le guide me crie à tout instant: Follow the path, ne quittez pas le sentier. Plusieurs ont (p. 271) trouvé la mort dans quelques-uns de ces trous, où ils ont été bouillis en un clin d'œil.
Pendant notre excursion, les canotiers ont cuit le riwai (pommes de terre) à la vapeur du volcan. L'hôtelier nous avait fourni deux boîtes de conserve de langues de bœuf, et nous dévorons nos provisions avec le même appétit que les Maoris. Ceux-ci partagent notre nourriture, mais refusent le sel: ils ajoutent que l'habitude du sel rendait le blanc immangeable au temps où ils se plaisaient à le croquer.

Lac de Rotomahana.—La Otukapuarangi ou Pink-Terrace (Terrasse Rose).
Après le repas, nous entrons dans les petits canots maoris. Il est impossible d'y tenir debout, nous y marchons à genoux pour gagner notre place, et nous nous (p. 272) asseyons sur nos talons. Le moindre mouvement de travers mettrait facilement sans dessus dessous ces troncs d'arbre. Nous traversons ainsi le lac Rotomahana (lac chaud). Je tiens une main dans l'eau. Elle change de température à tout instant, selon que nous approchons ou que nous nous éloignons d'une source bouillante. Ce lac n'est pas grand, un quart d'heure suffit aux pagaies des Maoris pour atteindre l'autre bord. Là, laissant les ladies sur la grève, les hommes grimpent seuls la Otukapuarangi ou pink terrace (terrasse rose). Elle est ainsi nommée parce que les stalactites ont une belle couleur rose écaille. Les visiteurs les couvrent de leurs noms; une couche de stalactite transparente recouvre bientôt ces noms, et les caractères demeurent ineffaçables. La Pink terrace est moins grande que la précédente; ses bassins remplis d'eau azurée sont moins nombreux, mais la couleur de ses stalactites est délicieuse. Elle ressemble à l'intérieur de gros coquillages. Au sommet de la terrasse, nous entrons dans la forêt voisine, pour quitter nos habits, et nous prenons notre bain dans les bassins. L'idée de prendre un bain après un copieux repas m'avait paru singulière, et je ne m'y étais soumis que pour faire comme les autres; mais dans ces bains chauds, je comprends que si j'avais eu mon premier appétit, j'aurais été tenté de manger un morceau de ma chair parfaitement bouillie. Aussi notre bain ne fut pas long, et nous reprenons nos vêtements pour venir inviter les dames à s'y rendre à leur tour. Pendant qu'elles sont en train de se bouillir, nous visitons (p. 273) les nombreuses sources plus ou moins brûlantes des environs, et remontons au sommet pour voir le gracieux petit lac bleu qui domine la terrasse. Les stalactites y croissent au fond en forme d'arbres; mais la vapeur qui sort de l'eau nous empêche de les voir bien distinctement. Je recueille quelques beaux morceaux de pierre rouge et les offre aux deux jeunes miss tasmaniennes. Elles avaient déjà accepté une collection de fougères, mais elles refusent ce dernier présent, disant: It is not allowed (ce n'est pas permis). En effet, une affiche que j'avais lue à l'hôtel disait qu'il était défendu aux visiteurs d'emporter des stalactites. J'ai remarqué souvent cet esprit d'obéissance à la loi dans la race anglo-saxonne; c'est là toute sa force. Il est impossible de faire de l'ordre public, lorsque chacun se permet en particulier un petit désordre.
Enfin, vers 2 heures nous quittons ces lieux enchanteurs et prenons le chemin du retour. Les Néo-Zélandais appellent les terrasses de Rotomahana, l'endroit le plus merveilleux du monde. Sans aller si loin, on peut dire que c'est là un ensemble de phénomènes des plus curieux qu'on puisse voir sur la terre[8].
À notre retour, nous voyons près la grande terrasse une multitude de poules sauvages, de canards et autres oiseaux aquatiques qui se prélassent dans l'eau thermale. (p. 274) Nous suivons dans nos canots indigènes la petite rivière qui unit les deux lacs. Après avoir salué la tribu des Maoris qui nous avait conduits dans les canots du pays, nous reprenons sur le Tarawera nos canots européens. Le lac Tarawera s'est mis de mauvaise humeur et pousse de grosses vagues. La pluie, qui n'était pas encore tombée, menace de nous inonder. Nos rameurs s'animent par la cantilène des chansons nationales, et après une heure d'héroïques efforts, ils nous déposent à l'autre bord.
À l'hôtel, nous retrouvons la même multitude de Maoris jouant aux sous avec la même insouciance. Nous prenons notre repas et rentrons le soir à Ohinemutu.[Table des matières]
Sulphur-point. — Les bains du gouvernement. — Perdu et retrouvé. — Les geysers de Whakarewarewa. — La fin de Komutumutu. — Le geyser de Waïkiti. — Les sépultures. — Le divorce. — Route vers Taupo. — Le Waïkato. — Un cocher concurrent. — Débourbés par les Maoris. — Le Tangariro et sa légende. — Le lac de Taupo. — Les bains de M. Lofley. — À la recherche de la cascade Huka. — Le Crow's nest. — Les rêves au bord du lac. — Taniwha, l'homme aux cheveux rouges.
Je passe ma matinée à rédiger mon journal de voyage, et dans l'après-midi je vais à Sulphur-point, visiter les bains du gouvernement. Ils sont encore en construction. Tout y est simple comme dans les pays nouveaux.—Des conduits en bois amènent l'eau de deux sources sulfureuses et alcalines. Une est appelée Priest Source, parce qu'un ministre protestant y a été guéri de son rhumatisme; l'autre, Rachel Source. Que vient faire ici Rachel? c'est ce qu'on n'a pas su m'expliquer. Les bains pour les messieurs et les bains pour les dames consistent en de petites piscines de 7 à 8 mètres de côté; l'établissement est une baraque en planches. Je m'avance vers les bords du lac à un groupe de sources plus ou moins liquides (la terre bout ici comme l'eau), plus ou moins brûlantes, et je me figure qu'en suivant les bords du lac vers l'ouest, je dois rejoindre Ohinemutu. Géographiquement (p. 276) j'avais raison, mais pratiquement c'était autre chose. Je passe à travers les champs de fougères et j'évite les marais et les trous d'eau bouillante; mais bientôt j'arrive aux titrees, qui me barrent le chemin. J'espère que cette barrière franchie, je retrouverai le bord du lac et quelque sentier. Je fais donc de grands efforts, et je perce à travers les titrees; mais leur champ n'a point de fin. Par-ci par-là des marais, des trous d'où sort une vapeur sulfureuse, et des étangs bouillants. La nuit approche, l'eau tombe à torrents, je suis trempé jusqu'aux os. Il est bien vrai qu'en Nouvelle-Zélande il n'y a ni reptiles, ni fauves; mais quoi qu'il en soit, la perspective de passer la nuit dans ces buissons détrempé d'eau ne me sourit pas. J'ai un moment de panique; puis la raison me dit que le mieux est de retourner en arrière. Après d'héroïques efforts, je reviens au point de départ et je bénis Dieu d'être sorti de ce mauvais pas. Il est toujours dangereux dans les pays nouveaux de quitter les sentiers. Il est bien tard quand j'arrive à l'hôtel. On s'y était fort peu ému sur mon compte; on pensait que j'avais l'âge de raison.
Le lendemain, la matinée se passe à écrire et l'après-midi à visiter les geysers de Wakarewarewa. Ils sont à trois milles de Ohenimutu, vers la colline. Je suis cette fois une route carrossable, mais c'est celle de Taupo. Je suis obligé de la quitter à un point donné, pour me diriger vers les vapeurs qui s'élèvent des geysers. Toutefois je ne sors pas des sentiers tracés et j'arrive à travers mille (p. 277) trous béants où bouillonnent l'eau et la boue, au bord d'une petite rivière. Je la traverse sur une passerelle de madriers, et j'atteins une vingtaine de whares ou cases maoris. Ils se sont établis là probablement pour économiser le feu qui doit cuire leurs aliments. Un jeune Maori me fait lire le règlement qui assigne tant de schellings à la station et tant au guide, puis me conduit aux geysers à travers les bassins et les trous d'eau bouillante. La terre est si mobile, qu'à tout instant on croit la voir manquer sous ses pas. Dans un de ces trous, Komutumutu, chef des Puja qui occupaient la station, fit bouillir la tête d'un ambassadeur que lui envoyait le chef de la tribu voisine. Celui-ci, après avoir vainement attendu son envoyé, comprit ce qu'il en était advenu. Il tomba avec sa tribu sur les Puja, et fit bouillir la tête de Komutumutu dans le même trou. Le guide me conduit au geyser de Vaïkiti, qui projette de l'eau à une douzaine de pieds. Lorsque le vent souffle du nord-ouest, l'eau s'élève à 30 ou 40 pieds. Mon cicérone me montre sa case; elle est à louer. La case voisine est louée moyennant 5 schellings par semaine à deux Anglais qui prennent ici les bains thermaux. Je veux en essayer un, mais avec peu de profits; j'en sors tout excité. Les eaux minérales sont un agent puissant avec lequel il ne fait pas bon badiner. Elles ont toujours tué plus de monde qu'elles n'en ont guéri. Mon Maori me parle du Père Mac Donald, qui est leur prêtre. Il attend sa venue pour bénir son mariage qui a eu lieu le mois dernier. Le Concile de Trente n'ayant pas été publié (p. 278) ici, le simple consentement mutuel suffit à la validité du mariage. Le Père Mac Donald étant le seul prêtre pour les 30,000 Maoris du diocèse d'Auckland, ne peut guère passer qu'une fois l'an dans chaque Pa pour les mariages et les baptêmes. Une petite case maori est surmontée d'une croix de bois; c'est la chapelle catholique.
À l'occasion des décès, les Maoris ont l'habitude de pleurer longtemps leurs morts, dans une cérémonie qu'ils appellent tangi, mais après les larmes ils se livrent à un copieux repas (kaï) qui finit souvent par la haka (danse).
La femme qui n'est pas bien traitée par son mari quitte le toit conjugal et s'en va chez un autre. Le mari infidèle est bafoué par la tribu dans un charivari appelé tana. C'est le divorce de ce pays. La veuve, comme je l'ai dit, coupe ses cheveux en signe de deuil.
On m'avait dit qu'en l'absence du prêtre, le plus ancien des Maoris, le dimanche, lisait l'évangile et l'épître à la Carved house et présidait à l'office. Je m'y rends donc à l'heure indiquée et par une forte pluie; mais je ne trouve là que quelques Maoris lisant un journal en leur langue. Ils me disent que presque tous leur coreligionnaires sont au bush (forêt) pour les semailles, et qu'il n'y a point d'office. Je remarque à la muraille les portraits de l'empereur Alexandre de Russie et d'Abdul Azis de Turquie. Les Maoris présents savent fort bien me dire qu'ils ont été tous les deux assassinés. Au sortir de la Carved house je vois dans un bassin d'eau minérale des jeunes (p. 279) gens et des jeunes filles en costume de mère nature. Ils y sont si habitués qu'ils n'y trouvent, pas le moindre inconvénient et n'y supposent même pas une malice. Il est regrettable que cette, race si intelligente, hospitalière et chevaleresque, aille en s'éteignant. Les Maoris étaient 100,000 lorsque les premiers missionnaires protestants abordèrent l'île en 1814, et se maintinrent aussi nombreux, malgré, les guerres incessantes de tribu à tribu. Mais ils diminuent à mesure que les blancs augmentent. Ils disent eux-mêmes que, comme le rat anglais a détruit le rat indigène, il faut que le Maori finisse par disparaître devant le blanc. Il est vrai, en effet, que le rat anglais introduit par les navires s'est multiplié, et a voué une guerre à mort au rat noir indigène, qui a presque disparu.
Le reste de la journée se passe à écrire et à boucler ma malle, car demain je compte partir pour le lac de Taupo. Je ferai route avec la famille tasmanienne et la vieille dame que j'ai eues pour compagnes de voyage à Vaïroa et à Rotomahana.
Le 19 novembre, malgré la pluie de la nuit, à 6 heures du matin la voiture attelée de quatre chevaux est à la porte de l'hôtel.
Le char peut tout juste contenir quatre personnes, et nous y sommes six. La vieille dame de Christchurch et les deux, miss occupent le siège du fond; leur oncle, leur frère et moi le siège en face. Impossible de placer quelqu'un à côté du cocher; les malles occupent le (p. 280) siège et la pluie les inonde; nous-mêmes nous n'en sommes en partie préservés que par les toiles cirées qui forment les parois de la voiture.
Claque le fouet, et en avant! Nous traversons une plaine de fougères, gravissons des coteaux pour en redescendre d'autres; toujours les titrees et les fougères. Par-ci par-là quelque belle forêt, des montagnes et des rochers à la forme bizarre, et en général une nature sévère et triste.
À 11 heures nous traversons sur un pont de bois la rivière Vaïkato. Les pluies l'ont grossie et elle roule à travers les rochers une masse d'eau bruyante et verdâtre d'un bel effet. À quelques pas de là, à Ateamuri, nous sommes à moitié chemin. Les chevaux ont déjà fait leurs 28 milles (le mille anglais est de 1,600 mètres) et ils prennent leur avoine. Nous laissons les dames dans la voiture, car la pluie continue, et nous mangeons notre sandwich dans une baraque faite d'herbes aquatiques; 5 chiens et 4 chats, tous plus maigres les uns que les autres, demandent à partager notre mince repas. Un jeune Neo-Zélandais que j'avais laissé à l'hôtel nous rejoint avec un buggi (petite voiture légère pour une seule personne et le cocher). Après une heure de repos, on attelle de nouveau, et nos chevaux ont encore 28 milles à faire dans une route détrempée d'eau, avec des rampes continuelles. Les pauvres bêtes n'en peuvent bientôt plus, et une d'elles, se refusant à tout service, empêche les autres d'avancer. Nous la reléguons derrière la voiture, et plus (p. 281) loin nous la confions à un homme qui va à Taupo. Souvent les roues enfoncent d'un côté jusqu'au moyeu et la voiture est près de tourner. Il faut alors descendre et pousser les roues, en pataugeant dans la boue. M. Lewis, malgré sa barbe blanche, est du plus grand secours; il ne craint ni la pluie ni la grêle qui nous flagelle par moment; son jeune neveu, garçon de 13 ans, tient la bride du cheval d'avant et prête son aide comme un cocher consommé. Une des jeunes miss daigne même, dans les moments critiques, salir ses gants aux rayons de la roue; mais le plus grand secours nous vient du cocher du petit buggy qui suit derrière nous. Il laisse le cheval aux soins de son voyageur, et à tout instant il aide à son confrère, soit en renouant une courroie cassée, soit en harcelant les chevaux, ou en poussant la voiture. J'apprends que les deux voitures appartiennent à deux maîtres différents qui parcourent la même route, et sont nécessairement en concurrence. J'admire donc l'esprit de fraternelle charité qui pousse un cocher à aider l'autre en retardant lui-même sa course. Dans des conditions semblables, plus d'un cocher d'Europe se serait réjoui de voir son concurrent dans la boue, et l'y aurait laissé patauger: le résultat aurait été peut-être la perte des chevaux et la ruine du concurrent, et en tous cas un appauvrissement pour la communauté. Or, le bien-être général profite à tous.
J'admire encore plus le sang-froid de notre cocher; il n'a pas quitté un instant les guides, faisant de son mieux avec paix et calme. Pas un juron, pas le moindre signe (p. 282) d'impatience; c'est du christianisme en pratique. Même patience et même charité chez les voyageurs; ils font tous leurs efforts pour aider la voiture à sortir de la situation, et jamais une plainte ne vient sur leurs lèvres. Enfin nous arrivons à un Pa (établissement maori) et ce sont encore ces braves gens qui nous tirent d'embarras. Ils n'ont point de chevaux; le seul qu'ils possèdent vient de partir; un d'eux court le rappeler. On l'attelle, et avec ce renfort nous suivons péniblement notre route; montant à pied toutes les rampes et poussant à la roue. Mais tout le monde est content, car tout le monde fait son devoir. On admire partout les progrès étonnants qu'a faits la jeune colonie de la Nouvelle-Zélande dans un temps très court. Le secret de cette réussite est dans l'ensemble des vertus dont j'ai un échantillon sous les yeux.
Enfin, vers 7 heures, nous apercevons une colonne de vapeur; nous rentrons encore une fois dans la région de la terre brûlante. Du sommet de la dernière rampe nous apercevons avec bonheur l'immense nappe d'eau du lac de Taupo. À 8 heures, nous sommes à l'hôtel. Notre premier soin est de nous changer de la tête aux pieds; une partie de mes effets n'a pu échapper à l'eau nonobstant son bon emballage. Durant le souper, malgré la fatigue, on passe en revue les épisodes les plus émouvants de la journée, et on est aussi content que si on avait eu le meilleur temps du monde. Les péripéties dans les voyages ont aussi leur charme!
(p. 283) Un grand feu dans la nuit a séché nos habits, et le matin, à 8 heures, après le déjeuner, on se dispose à explorer la contrée.
Le lac de Taupo a 25 milles de large et 30 de long; il est entouré de collines arides et de montagnes boisées. Au fond, le Tangariro, immense volcan couvert de neiges, couronne le tableau. Sa partie supérieure est conique, comme celle du Vésuve de Naples; comme lui il envoie dans les airs des nuages de fumée blanche. C'est une des grandes cheminées de la terre. Il a 7,000 pieds de haut, et le Ruapehu, à côté de lui, élève ses trois pics neigeux à 9,200 pieds.
Les Maoris, comme tous les peuples, ont des légendes pour expliquer les phénomènes que la nature met sous leurs yeux. À propos du Tangariro et des sources thermales, ils racontent que Ngatoroirangi, un grand chef venu de l'autre monde, arriva ici de Hawaïki, avec sa sœur, qui portait le feu sacré, et Auruhoe, une esclave bien-aimée. Pour explorer la contrée, il monta sur le Tangariro, suivi de son esclave; mais celle-ci fut bientôt saisie par le froid, et Ngatoroirangi appela sa sœur pour porter à la hâte du feu à son secours. Elle courut si vite qu'elle laissa tomber partout des étincelles qui brûlent encore, et ne put arriver que lorsque Auruhoe avait déjà rendu le dernier soupir. Ngatoroirangi en fut si furieux, qu'il prit le feu et le jeta dans le cratère du Tangariro, où il continue à brûler.
L'hôtel où j'écris ces lignes est une des cinq ou six maisons (p. 284) de bois qui forment le village de Tapuwaeharuru, sur la rive nord du lac de Taupo. C'est l'embryon d'une future ville ou station thermale. Une maison est occupée par le bureau de poste et télégraphe. Ce bureau, comme tous ceux de la contrée, reçoit et transmet l'argent par dépêche, prend les dépôts de la caisse d'épargne, reçoit les assurances sur la vie. On trouve là, affiché, le Journal officiel, les règlements pour l'arrivée gratuite des immigrants, les allotissements et les ventes de terre, les imprimés pour les déclarations de naissance, de décès, etc. On évite ainsi une armée d'employés qui sont ailleurs la plaie administrative.
Une maison abrite les 20 policemen qui parcourent les routes de leur station; puis un autre hôtel, quelques écuries, et c'est tout pour le moment. Un petit bateau à vapeur parcourait le lac, il permettait aux touristes d'en visiter les plages et la petite île de Motutaïko, mais il ne faisait pas ses frais, et il est maintenant remplacé par un shooner, petit navire à voile.
À 9 heures, je pars avec le jeune Néo-Zélandais de Wellington, et après deux milles de chemin nous arrivons à la source d'eau thermale de M. Edward Lofley. Ce bon Anglais a 40 ans environ, et habite cette solitude depuis dix ans avec sa femme et ses enfants. Il l'a gracieusement ornée de pins, d'eucalyptus et de roses. J'y vois des fraisiers en fleur et des cerises en bouton; il me dit que les unes et les autres seront mûres à la Noël. Au Chili, qui est à peu près sous la même latitude, et dans le (p. 285) même hémisphère, j'avais laissé le printemps au mois d'août, et ici je le retrouve à peine en novembre.
Nous prenons un bain: un ruisseau coule à côté, et on peut passer de l'eau douce à l'eau minérale, du chaud au froid. Enfin nous demandons à M. Lofley de nous indiquer la route pour nous rendre à la cascade Huka, sur le Waïkato. Il nous conduit au sommet d'une haute berge et il nous dit: Prenez ce sentier, vous trouverez un vallon, vous le suivrez, puis vous passerez le long d'un mur en terre pendant 400 pas; au bout du mur vous tournerez le dos à la montagne, marchant droit devant vous jusqu'à un précipice, vous le tournerez à droite, et vous serez arrivé. Puis il ajoute: Si avec cela vous ne trouvez pas, c'est que vous êtes des imbéciles. C'est raide!
Heureusement, mon Zélandais est plus habitué que moi aux déserts de ces contrées; il s'oriente, pose des marques sur ses pas; trace des croix et marche avec attention. Aucun détail ne lui échappe; ici des pieds de chevaux ont laissé des traces fraîches; là il reconnaît des pieds de Maoris. À une intersection, il évite un sentier par le seul fait qu'une araignée l'a barrée par un de ses fils; ce fil, me dit-il, prouve que depuis quelque temps personne n'a passé par là. Enfin nous trouvons le vallon et le mur, pataugeons dans l'eau et nous orientons en tournant le dos à la montagne. Nous traversons des champs de fougères parsemés de genêts en fleur et d'un autre buisson épineux à fleurs jaunes, importé (p. 286) d'Écosse. On l'a introduit pour faire des haies, mais il s'est répandu dans toute la contrée avec une telle rapidité, qu'il en est devenu le fléau.
Nous arrivons au précipice. Il est effrayant: l'eau murmure à 200 mètres en bas et on ne voit que les arbres tapissant les parois. Je remarque quelques magnifiques arbres fougères, si abondants dans ce pays; ils sont moins nourris que ceux de l'Himalaya, mais plus élevés; ils atteignent parfois 7 à 8 mètres de haut. Après une heure de marche, nous voyons le Waïkato rouler ses eaux bleues avec fracas au contre-bas d'une berge haute de plus de 100 mètres. Elle est presque à pic, mais nous en dégringolons quand même, et arrivons sur le bord. L'eau passe dans un canal étroit qu'elle s'est taillé dans le roc: elle roule sur une pente rapide en mille tourbillons et, après un parcours de 200 mètres de rapides, elle tombe en cascade de 30 pieds de haut. Nous admirons longtemps ce jeu de la nature, et nous amusons à jeter des branches de bois qui disparaissent dans le gouffre sans reparaître ensuite. J'ai pu en saisir la raison. Le bois, d'abord précipité, revient à la surface pour être entraîné par l'eau; mais un reflux se forme au pied de la chute et repousse l'objet sous la chute elle-même qui le pulvérise alors sous son poids comme sous une forte enclume. J'ai pu ainsi comprendre comment les hommes et les canots qui glissent sous la chute du Niagara ne reparaissent plus; ils s'en vont en poussière.
Revenant sur nos pas, nous refaisons la route en sens (p. 287) inverse, nous aidant des marques laissées en venant. Depuis le matin à 8 heures, nous n'avons rien mangé et avons toujours marché. Nous demandons un lunch, on ne peut nous servir que du pain et de la confiture. C'est peu réconfortant.
Nous poussons plus loin visiter un geyser appelé Crow's Nest, à cause de sa forme en cône, ressemblant à un immense nid de corbeaux.
N'ayant plus été menacés ici de passer pour des imbéciles, nous nous tenons moins sur nos gardes et nous nous égarons. Nous marchons longtemps au milieu des pierres ponce dont le sol est parsemé, et nous nous dirigeons vers les vapeurs qui, par-ci par-là, sortent du sol. Ce sont des eaux bouillantes, de la boue que l'on prendrait pour de la chaux lorsque les maçons la détrempent: partout trous et crevasses menacent de nous engloutir. Je ne puis appuyer mon ombrelle sans qu'elle fasse sortir de l'eau bouillante et de la vapeur; s'il était nuit notre position serait critique. Enfin nous retrouvons le Crow's Nest. Il est tranquille en ce moment. Ces geysers ont leurs caprices, tantôt ils travaillent et tantôt ils se reposent. Après une longue attente, du trou béant qui a 3 mètres de diamètre s'élève une colonne d'eau à 40 pieds de hauteur et elle retombe avec fracas en nappes d'argent sur le cône de pierre ponce qui entoure l'ouverture. L'opération recommence à chaque 2 minutes, montre en main. Il est près de 5 heures lorsque je rentre à l'hôtel.
Je viens de marcher toute la journée, et pour pitance (p. 288) je n'ai eu qu'un peu de pain, de la confiture et un verre d'eau. On ne m'y reprendra plus!
La nourriture de l'hôtel aussi n'est pas de première qualité. Un peu de viande, des pommes de terre et le thé perpétuel: c'est le thé de l'Himalaya, qui agite autant que le café, et empêche de dormir. Le tourment est double lorsque l'air des montagnes donne un appétit dévorant! Si l'estomac est peu content, par contre les oreilles jouissent à loisir. Les deux miss se mettent au piano; l'une accompagne et l'autre chante: les Tasmaniennes s'en tirent certainement mieux que les Anglaises; moins de dureté dans le jeu, plus d'expression dans le sentiment. Elles n'ont aucune de ces tresses empruntées qui forment des montagnes sur la tête de nos dames ou demoiselles d'Europe. La fraîcheur de leur teint est un plus bel ornement que les cheveux étrangers. Durant la route j'avais aussi remarqué que si elles avaient eu les talons ridicules de nos Européennes, elles n'auraient pu marcher durant plusieurs kilomètres, et auraient été un embarras de plus au lieu d'une aide. Est-ce la nécessité, ou une plus forte dose de raison qui rend les gens plus naturels et plus pratiques dans les colonies?

Bords du lac de Taupo.—Famille Maori.
Le lendemain, mon Néo-Zélandais s'en va à Waïrakei, à 8 milles de distance, voir certains geysers dans le genre de ceux de Crow's Nest, et de ceux de Rotomahana. Il m'invite à le suivre, mais j'ai promis de ne plus me laisser prendre à ces excursions fatigantes lorsqu'on n'a pas le moyen de restaurer ses forces. Je préfère rêver sur les (p. 289) bords du lac. Le vent a chassé les nuages, le Tongariro et le Ruapehu apparaissent dans toute leur majesté. En me baignant dans le lac, j'ai craint d'y rester gelé; mais en sortant, la réaction me rend rouge comme un homard et le vent a bientôt séché ma peau. Après le déjeuner je rédige mon journal, et je m'en vais en inspection auprès des cases maoris des bords du lac. Ces braves gens vendent leur terre à 1 ou 2 livres l'acre, et cet argent s'en va bientôt au cabaret, ou plutôt au bar. Là, on boit debout et on s'en va, car le cabaret n'est en usage ni en Angleterre, ni dans ses colonies. Hommes et femmes boivent et fument, fument et boivent, puis gesticulent, jasent, font des contorsions à n'en plus finir, et pourtant la loi défend de vendre des liqueurs enivrantes aux Maoris! Ici le maître du bar ne sait résister à la tentation, d'autant plus qu'il vend un schelling le verre de bière coloniale et un (p. 290) schelling le verre à liqueur de vin européen ou colonial.
Les bords du lac sont gracieux, surtout au point où en sort la rivière Waïkato. La pelouse est verte, mais l'herbe ne pousse pas. Le terrain est sablonneux ou volcanique et la contrée sera toujours pauvre. L'agriculture n'y fleurira jamais, et le bétail assez peu; mais la nature donne toujours quelques compensations. Ainsi cette région volcanique pourra quand même prospérer par le concours des malades qui viendront demander la santé aux nombreuses sources minérales.
Le vent continue à souffler, et le lac roule de grandes vagues: il est habituellement en tempête, et les Maoris disent que Taniwha, homme terrible, aux cheveux rouges, qui habite dans la caverne de Motutaïko, est toujours affamé, et met le lac en courroux pour chavirer les canots et dévorer les hommes. Ils refusent même d'approcher d'un certain point plus dangereux, qu'ils appellent le trébuchet de l'homme rouge. Il s'agit probablement là de l'action de quelque volcan sous-marin ou de quelque tourbillon (whirlwind). Le soir, nous avons à table un jeune lord irlandais, accompagné d'un docteur anglais. Ils viennent de traverser la Tasmanie et l'île du sud pour arriver ici. L'Anglais déclare qu'au mois de mai, auquel correspond ici le mois de novembre, il n'a jamais eu plus froid en Angleterre qu'il n'a eu ici sur la route. Il est vrai que tout le monde s'accorde à dire que la saison est retardée cette année, et que ces pluies perpétuelles n'ont pas lieu tous les printemps.[Table des matières]
Départ pour Napier. — Un surveyor. — Un repas au désert. — La future ville de Tarewera. — Un Pa à 2,600 pieds. — La boîte aux lettres aux bords des chemins. — Le port et la ville de Napier. — Les missions catholiques. — Un typhon entre Napier et Wellington. — Port Nichelson et la ville de Wellington. — La corde de sauvetage. — Mgr Redwood et les Pères Maristes. — Le Musée. — L'Observatoire. — Le kea et ses méfaits. — Trois jeunes éleveurs français. — La famille en Nouvelle-Zélande. — Les méthodes d'enseignement. — Les œuvres catholiques. — Les Chambres. — L'Athenœum. — L'élection du mayor. — La Wellington meat preserving Cy, et la prochaine concurrence aux éleveurs européens. — Un jeune colon bordelais.
Le 22 novembre, à 5 heures 1/2 du matin, on nous sert le déjeuner. L'heure est un peu matinale pour les œufs et le beefsteack, mais il faut faire provision, car nous ne rencontrerons pas de maisons en route, et nous avons 50 milles à faire. À 6 heures nous sommes en voiture. J'ai toujours pour compagnons de voyage la famille de Tasmanie, la vieille dame de Christchurch et un jeune homme de Wellington. Les deux miss, pour jouir de la vue, occupent le siège à côté du cocher, celui-ci relègue à l'arrière, sur les bagages, le petit aide, enfant de 12 ans; mais, vu la pluie, les passagers se serrent un peu plus et le prennent avec eux dans la voiture.
C'est la Sainte-Cécile, et nous n'avons pour musique que la pluie battante et les sursauts de la voiture dans (p. 292) une route défoncée. Heureusement, les ressorts d'acier sont remplacés par des lanières de cuir, sans quoi la voiture se serait déjà brisée bien des fois.
Nous traversons des plaines et des collines parsemées de pierres ponces que recouvre la fougère ou le titree. La contrée est pauvre et déserte.
Vers midi nous arrivons au coude d'une rivière. Là, le cocher donne l'avoine aux chevaux et nous mangeons nos sandwich. Au bord de la rivière, une tente est occupée par un surveyor (architecte) qui lève les plans de la contrée; le gouvernement se propose d'en vendre les terres aux enchères. Un cavalier qui nous suit lui emprunte un chaudron qu'il suspend au bout d'une branche, allume le feu, tire de son sac le thé et le sucre et nous en offre bientôt une tasse. Il passe ensuite au bout d'un bois un morceau de mouton qu'il grille sur le feu. Une demi-heure lui a suffi pour préparer et consommer son repas, et il repart à cheval. Il parcourt le pays et achète des moutons pour la Freezing sheep Company qui vient de se former à Auckland. Plusieurs milliers sont déjà en route pour Cambridge, près Auckland, d'où ils rejoindront l'usine à congélation.
Après une heure de repos, on attelle, et nous continuons notre route. Le paysage devient bientôt plus riant; aux plaines nues succèdent les collines boisées, et nous ne tardons pas à voir les premières stations de moutons. Plus loin, nous apercevons aussi des vaches et des mules; et peu à peu à la fougère succède la verte pelouse des (p. 293) herbes européennes. Cette herbe est semée en automne sur les cendres de la fougère. Celle-ci repousse durant plusieurs années, mais peu à peu finit par disparaître. Les jeunes pousses d'une certaine qualité sont utilisées par les colons, qui les mangent en guise d'asperge. Au Japon j'avais aussi mangé les pousses du bambou, dont le goût rappelle celui du champignon.
Nous traversons un joli vallon où gronde le bruit de la cascade Runanga, et vers 5 heures 1/2 nous arrivons à la future ville de Tarewera, au bord de la rivière. Je dis future ville, car pour le moment je n'y vois que le bureau de poste et télégraphe et un hôtel. Comme la ville existera tôt ou tard, les lots de terrain à bâtir s'y vendent déjà à 40 livres l'acre.
Le maître de l'hôtel est un Danois, qui a commencé par être militaire dans le pays. Il recevait 9 schellings par jour comme constabulary (militaire) de 1re classe. Cette paye ne lui suffisant pas à élever sa nombreuse famille, il s'est fait aubergiste, et a pu construire et payer sa petite maison. Il emploie en ce moment plusieurs Maoris à divers travaux. Il les dit très rusés (cunning), et ajoute qu'il est bon d'avoir les yeux bien ouverts en traitant avec eux. Après le souper je descends au bord de la rivière, qui coule paisiblement sous l'ombre des pins séculaires. Au salon, je trouve les journaux qui m'apportent les télégrammes d'Europe. Même au milieu de ces montagnes perdues, je sais ce qui s'est passé hier à Londres, à Paris et dans les divers pays des Antipodes.
(p. 294) Le lendemain, matin à 5 heures 1/2, déjeuner; à 6 heures, départ. La nature devient de plus en plus gracieuse. Les collines boisées rappellent certaines parties de la Suisse. Les lacets du chemin ressemblent parfois à ceux du col de Tende; des véroniques énormes et mille autres buissons que nous cultivons dans nos jardins couvrent ici les bords de la route. Je remarque le cabbage-tree (arbre choux) espèce d'énorme youka, et le rapu, que les Anglais appellent flax, et dont les Maoris tirent un chanvre qui sert à les habiller. Les Européens l'utilisent aussi, et on l'exploite en grand pour la fabrication des cordes et de la toile grossière.

Nouvelle-Zélande.—Femme Maori.
À Toranga Kuma, la route atteint 2,600 pieds d'altitude, et la vue est magnifique. Près de là un Pa ou settlement maori a éparpillé ses whares ou petites cabanes entourées de poules et de cochons. Comme l'Européen, le Maori brûle maintenant ses forêts, et sur la cendre il (p. 295) sème le gazon qui nourrira ses chevaux. On voit partout les troncs à demi brûlés, cadavres de ces magnifiques forêts qui auront bientôt disparu.
Nous passons à côté d'une maison de bois perchée sur un pic. Elle servait de fort aux troupes dans la dernière guerre. Les Maoris aussi savaient parfaitement organiser leurs camps retranchés au moyen de nombreuses rangées de palissades d'où ils faisaient feu sans s'exposer. Nous descendons dans une riante vallée, et à une station (nom que l'on donne ici aux fermes des éleveurs), une bonne Danoise quitte une troupe de joyeux bébés et monte en voiture.
Les bébés se multiplient comme les moutons dans ces stations, et rendent moins dur l'isolement des habitants. Plus d'un jeune homme qui a fait ses études à Oxford ou à Cambridge ne dédaigne pas ici la charrue, et passe de longues heures à cheval pour surveiller ses nombreux troupeaux. Le genre de vie est dur, mais éminemment moralisateur. Il donne l'aisance et aboutit à la richesse sans risque pour la vertu.
Un cavalier suit la voiture, et de temps en temps il prend dans une boîte, fixée au bout d'un piquet, un portefeuille en cuir contenant la correspondance du district. La veille, il a lui-même laissé ce portefeuille qui lui est renvoyé avec les réponses. J'avais déjà remarqué des boîtes à lettres au bord du chemin à un arbre de la forêt, et par-ci par-là de grands rouleaux de fils de fer au pied des poteaux télégraphiques: provision pour les réparations. (p. 296) Heureux pays celui où l'on peut confier ainsi sans danger le bien public à la bonne foi publique!
Après avoir passé la rivière Moka sur un long pont de bois, à côté d'une jolie cascade, nous gravissons une colline, du sommet de laquelle nous apercevons au loin l'immense plaine azurée de l'Océan. Un peu plus loin, nous arrivons à une pauvre cabane où l'on nous sert du thé et un peu de porc pour notre lunch. Cette mesquine demeure est tapissée des illustrations des temps modernes, y compris Gambetta. Le propriétaire, éleveur de chevaux, a payé la terre 30 schellings l'acre.
La voiture atteint bientôt le lit d'une rivière, et le suit pendant longtemps, traversant cinquante-deux fois le courant d'eau aux nombreux détours. Enfin, nous aboutissons à la plaine parsemée de petites cabanes entourées de jardins. À 5 heures, nous passons sur un long pont de bois, jeté sur la baie ou port de Napier, et traversons une colline pour aboutir à la ville au bord de la mer.
Napier est une charmante petite ville de 5 à 6,000 habitants. Elle est divisée en 3 sections: le port pour les navires, la ville basse sur une langue de terre entre la mer et une lagune; là, sont les magasins, les hôtels, les comptoirs et les banques; la ville en colline, où demeure la population aisée, est parsemée de grands et de petits pavillons en bois. Ils sont entourés de jardins où s'épanouissent les roses et toutes les fleurs de nos jardins d'Europe. Je remarque aussi la vigne, le poirier, le pommier, et en général tous nos arbres fruitiers. L'église catholique (p. 297) est desservie par le Père Reynier, mariste, depuis 34 ans dans le pays. Il est resté 9 ans à Rotorua avec les Maoris. Le Père Forest, un des fondateurs de la congrégation des Maristes, venu ici des premiers, il y a 42 ans, est au lit, et le médecin interdit les visites. Il y a 1,600 catholiques à Napier; les écoles sont tenues par des Sœurs et par des Frères. Des collines on jouit d'une vue splendide. À 2 heures, par une forte pluie, je monte sur le petit vapeur qui nous conduit au Ringarooma stationnant au large.
À 3 heures nous prenons la pleine mer. Elle est en courroux. Le Southern Cross, autre steamer plus petit, a mis deux jours à tourner le cap East. Le Ringarooma, plus important (1,096 tonnes) a été plus heureux; mais vers le soir, un terrible typhon arrive du sud, et nous saisit de face. Le navire, constamment couvert par les vagues, semble naviguer entre deux eaux, la nuit est affreuse, je me demande à tout instant si le navire ne va pas s'en aller en miettes par la violence des lames.
Nous devions arriver à Wellington le lendemain matin. C'est à peine si nous pouvons y aborder à 6 heures du soir. Toutefois, le navire a été obligé d'interrompre son voyage. Au lieu de suivre sur Hobart et Melbourne, il s'en va au dock réparer ses voies d'eau. Il a été plus heureux que le Triumph, navire de 3,000 tonnes, appartenant à la Show Savill and Albion Cy, qui vient d'échouer au pied du phare à l'île Tiritiri, non loin d'Auckland; et que le Tasman qui a coulé avant-hier à pic, près du Cap (p. 298) Pilar en Tasmanie. Dans les deux naufrages, aucun passager ni aucun matelot n'a péri.
À peine descendu à terre, je rends visite à Mgr Redwood qui m'accueille paternellement. À l'Occidental Hotel, grande construction en bois, on me donne une chambre au 2e étage. Je vois avec étonnement dans le couloir une longue corde à nœuds à côté de chaque porte, et j'en demande la destination. C'est, me dit-on, pour qu'en cas d'incendie vous puissiez vous sauver par la fenêtre.—Quoique peu fort en gymnastique, je pourrai encore avec une corde descendre deux étages par la fenêtre; mais les dames?—Si le malheur arrivait, ajoute-t-on, elles ne seraient pas plus embarrassées que vous.
Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande, s'étend gracieusement sur les bords de la vaste baie appelée Port Nicholson. Peuplée d'environ 22,000 habitants, elle est bâtie sur collines. Pour la partie réservée aux affaires on a empiété, et on empiète toutes les fois qu'on en a besoin, sur la baie, au moyen de jetées et de remplissages.
Wellington est aussi chef-lieu de la province Nord de l'île du Nord.
Mgr Redwood me présente au Père Yardin, un des plus anciens Pères maristes de la mission. Ce bon Père veut bien me conduire au Musée et me présenter au directeur, le Dr Hector, bien connu dans le monde savant. Il centralise, par le télégraphe, les données du réseau des Observatoires de Nouvelle-Zélande, Tasmanie et (p. 299) Australie, et les communique à la presse. Il fait passer sous mes yeux les divers bulletins qui sont comme l'histoire du temps dans ces colonies. Ils servent à prévoir presque à coup sûr les tempêtes. Les bulletins du dimanche font régulièrement défaut; c'est le jour que le Seigneur s'est réservé, me dit-il, et tout travail doit s'arrêter ce jour-là. On ne marchande pas avec le Souverain Maître. Au musée je remarque de belles gravures maoris sur bois et une quantité d'instruments de l'âge de pierre. Ils sont identiques à ceux que j'ai vus dans les musées de Suède et de Norwège. Parmi les oiseaux indigènes, je vois le huia, gros merle noir avec le bout de la queue blanche, il parle comme le perroquet; le kiw ou apteria mantelli, sans queue, avec le bec long et fin et manteau poilu; le kakapo [stringops habroptilus], perroquet vert de la forme et de la grosseur d'une poule, et le kea, autre sorte de gros perroquet à bec crochu. Il est devenu le fléau des éleveurs. Il était herbivore; mais, depuis l'introduction du mouton, il a pris goût à sa chair, et spécialement au gras des rognons; il plante ses griffes dans la laine du mouton et fait son repas pendant que sa victime saute à droite et à gauche en bêlant, et finit par succomber à une mort lente.
Le Père Yardin me parle de trois jeunes compatriotes venus ici du centre de la France. Ils ont apporté 250,000 fr., qu'ils ont placés à la Banque, et se sont engagés comme bergers. Lorsque après quelques mois, ils ont bien connu le métier d'éleveurs, il ont loué une petite (p. 300) ferme, puis ils l'ont achetée. Ils ont loué de vastes terrains à côté, et viennent de les acheter. Depuis cinq ans à peine dans le pays, ils possèdent déjà plus de 8,000 acres de bonne terre avec des milliers de moutons, chevaux et bétail. Ce fait prouve que le Français, s'il le veut, peut réussir comme l'Anglais; mais à la condition que, comme l'Anglais, il reçoive dans la famille une éducation assez forte, pour qu'à vingt ans on puisse sans danger lui mettre 250,000 fr. dans les mains, et avec la presque certitude de les voir décupler en dix ans.
Le Père Yardin, qui a beaucoup approché et beaucoup connu les colons de la Nouvelle-Zélande, en fait le plus grand éloge. Les familles, soit catholiques, soit protestantes, sont bien unies: les frères aiment les sœurs et celles-ci se disputent le dernier bébé pour l'amuser. Le père trouve dans ses nombreux enfants des aides pour faire prospérer de nombreuses fermes. Il établit ses garçons en leur donnant soit une ferme, soit une somme qui leur permettra de se créer une situation dans l'industrie. Les emplois administratifs, quoique rétribués à 400 ou 500 fr. par mois, sont considérés comme n'aboutissant à rien.
Après la mort du père, le fils aîné prend son lieu et place; la mère et les sœurs lui obéissent comme au chef de famille. Les sœurs, même les aînées, le consultent pour le mariage. Le choix de l'épouse se fait non pour la dot, car il n'y a pas de dot ici, mais pour les qualités et la sympathie. C'est là la première garantie du bonheur dans les (p. 301) ménages. Les époux suivent la loi de la nature, et n'ont pas peur que le pain manque jamais à leurs nombreux enfants, mais ils ne craignent pas de leur inculquer de bonne heure l'amour du devoir, l'esprit du travail, et de leur en donner l'exemple.
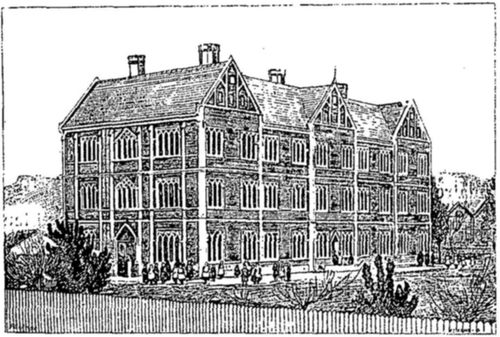
Wellington.—Collège des PP. Maristes.
Le Père Yardin me montre la Bible traduite en maori par les ministres protestants. Au jugement de la Sœur Joseph, la plus savante en langue maori, c'est un travail colossal et d'une exécution parfaite. Les ministres protestants sont venus ici bien avant les missionnaires catholiques, et le Père me dit qu'un grand nombre d'entre eux ont bien souffert et beaucoup travaillé.
Le Père Le Menant des Chesnais m'avait invité à déjeuner à la paroisse Sainte-Marie. Le Père Yardin veut bien m'y accompagner. Le Père Le Menant a réuni un (p. 302) petit musée et une bibliothèque qu'il destine au Collège que les Maristes vont construire à Wellington. Comme je sais qu'ils ne se recrutent pas assez pour suffire à tous les besoins, je lui demande s'ils auront assez de professeurs. Il me dit qu'avec le système anglais ils peuvent obtenir un bon résultat avec moitié moins de personnel. Dans les sciences, on donne peu de temps à la théorie et beaucoup à la pratique dans les laboratoires. Le latin est enseigné en trois ans, comme on enseigne les autres langues vivantes au moyen de manuels de conversation. Par les tableaux on apprend, autant et plus vite, par les yeux. Il serait désirable que nos Comités d'instruction primaire et secondaire envoient des personnes compétentes, sérieuses, peu amies de la routine, examiner les meilleurs tableaux en usage en Allemagne, en Angleterre et en Amérique, pour en faire profiter nos écoles libres. Ce travail serait plus utile que l'impression de nombreux volumes de controverse.
Aux États-Unis, j'avais remarqué les albums de géographie qui, en quelques semaines, au moyen des yeux, peuvent apprendre aux enfants ce qu'il nous faut des années pour leur faire entrer dans la tête.
Le Père Le Menant est de son temps; il s'est mis à l'œuvre, a étudié la géologie, la chimie et autres sciences modernes, au nom desquelles on prétend attaquer la vérité. Il fait des lectures ou conférences publiques fort goûtées des protestants et des catholiques. Sa dernière conférence à Auckland avait été présidée (p. 303) par le Maire, un protestant, qui applaudit à tous les arguments par lesquels il démolissait les doctrines des matérialistes et des libres-penseurs; mais il fit des réserves sur l'observation du conférencier, que les défaillances des catholiques ne prouvent rien contre la vérité du catholicisme. Une religion sérieuse, dit-il, doit pouvoir se faire observer. Ainsi, me disait le Père, quoique persuadés souvent de la fausseté de leur doctrine, les protestants sont toujours arrêtés par le trop grand nombre de catholiques qui observent le décalogue moins bien qu'eux.
Le Père Yardin me conduit chez les frères Maristes de la doctrine chrétienne. Le directeur est lyonnais; il me dit qu'on ne lui demande pas s'il est étranger ou s'il a le diplôme pour enseigner. Tout ce qu'on lui demande chaque année, c'est le nombre d'élèves qui fréquentent son école. Il y a 3,000 catholiques à Wellington et les Frères instruisent 250 enfants. Les Sœurs irlandaises, à côté, ont autant d'élèves.
De la plate-forme de l'école, nous voyons au loin, à Té Haro, sur la colline, l'hôpital des fous, l'hôpital civil et une prison en construction. Les prisonniers sont employés à charrier et à empiler eux-mêmes les briques pour construire leur cage. C'est sage et économique. Le soir, j'assiste à une conférence de Saint-Vincent de Paul. Il n'y a pas de pauvres à secourir dans ce pays; le gouvernement les empêche de débarquer, et ceux qui tombent malades sont toujours secourus à domicile par le gouvernement (p. 304) ou reçus sans formalité dans les hôpitaux; il ne reste à nos confrères qu'à faire face aux besoins imprévus de quelque passant ou de quelque pauvre honteux.
M. Knorpp, ingénieur des chemins de fer, me remet une lettre pour M. Smith, chef du matériel roulant du railway à Christchurch, et une autre pour M. Maxwell, directeur général des chemins de fer. M. Knorpp a vu à Nice la culture de l'olivier et m'apprend qu'on vient de l'introduire à Auckland avec l'oranger, comme on a introduit la vigne à Napier. Les colons ont aussi importé des abeilles de Naples et elles se sont beaucoup multipliées. Un Italien essaie en ce moment avec succès la culture des vers à soie. Ils ne s'endorment pas, les colons de la Nouvelle-Zélande.
La Chambre des députés est éclairée à l'électricité; les tribunes et l'ensemble est, en petit, ce qu'est la Chambre des Communes à Londres. Je peux en dire autant de la Salle du Sénat à côté; mais ici, pas d'illumination; les sénateurs se réunissent de jour et les députés qui le veulent peuvent assister à leurs séances. Comme à Londres, je remarque le buffet et le cellier et une magnifique bibliothèque. Au rayon des livres français, je vois: Voltaire, Victor Hugo, Diderot et la collection de nos auteurs révolutionnaires. Rien d'étonnant à ce que les Néo-Zélandais aient mauvaise opinion de nous. Je désigne au bibliothécaire les ouvrages de Frédéric Le Play; il en prend note pour les demander aussitôt.
(p. 305) À l'Athenœum, j'assiste à l'élection du Mayor(maire). Elle a lieu chaque année: Est électeur tout householder, chef de maison, y compris la veuve. Tout se passe dans le plus grand ordre. Le maire reçoit 300 l. stg. d'appointements.
Nous parcourons de nombreuses salles de lecture; les unes sont pour les abonnés, qui paient une guinée par an, les autres gratuites; les unes pour les messieurs, les autres pour les dames. Une bibliothèque gratuite prête les livres à domicile pour une semaine. Les journaux et revues de tous les pays sont à la disposition du public. Il y a même une salle pour les jeux d'échecs, où le silence est de rigueur.
M. Burnes me conduit à la visite de Wellington meat preserving Cy et le manager ou directeur, M. Wright, son ami, a la bonté de me faire parcourir l'usine en m'expliquant tous les détails. Une machine de 60 chevaux à 3 chaudières comprime l'air froid dans 5 chambres contenant chacune 300 moutons. Ces bêtes sont réunies et tuées à un village voisin. Le train les emmène à côté de l'établissement, et ils passent du wagon aux crochets des chambres réfrigérantes. L'air comprimé se répand pour rétablir l'équilibre, et l'évaporation qui en résulte produit le froid, qui descend à plusieurs degrés sous le zéro. Ce système est bien plus simple et plus économique que celui du refroidissement par l'évaporation de l'éther: l'éther ou tout autre produit chimique coûte, tandis que l'air ne coûte rien. Après 24 heures de séjour dans (p. 306) les salles, les moutons sont complètement gelés, et on les met à part jusqu'à l'arrivée du navire qui les doit recevoir. Dans le navire, on maintient la congélation par le même procédé, et la machine qui fait marcher l'hélice sert aussi à comprimer l'air. À Londres, les moutons sont maintenus en congélation toujours par l'air comprimé, et envoyés au marché au fur et à mesure des besoins. Le coût de la congélation et du fret est de 4 pence la livre, et le prix de vente à Londres, jusqu'à présent, est de 6 pence (0,60) la livre ou 1 fr. 20 le kilog. Il ne reste donc que 2 pence ou 0 fr. 20 la livre, pour le prix de la viande, que retire l'éleveur, mais, comme le prix courant du mouton à Londres est de 2 fr. 50, et qu'on sait parfaitement que le boucher vend à ce prix le mouton de la Nouvelle-Zélande qu'il fait passer pour mouton anglais, les Compagnies se proposent, si l'abus continue, d'établir elles-mêmes des magasins de détail dans les principales villes du Royaume-Uni et d'Europe afin de réaliser pour l'éleveur le bénéfice énorme que le boucher prend pour lui-même. La Compagnie n'a que 3 mois de date: elle n'achète pas les moutons; ils sont gelés, transportés et vendus pour compte des éleveurs. Elle espère congeler 5 à 6,000 moutons par mois, soit de 60 à 80,000 l'an. Une autre Compagnie à Auckland, une à Dunedin, une à Oomaru et une à Bluff en font autant, et plusieurs autres sont en formation aussi bien ici qu'en Australie. La Nouvelle-Zélande possède 13,000,000 de moutons, dont 8,000,000 sont tous les ans passés au chaudron pour suif, faute de débouchés. (p. 307) Elle pourra donc facilement exporter quelques millions de moutons par an, et ils sont aussi bons que ceux d'Angleterre. L'Australie possède 70,000,000 de moutons et pourra en exporter aussi un grand nombre, menaçant l'éleveur européen. Les truites et saumons importés de Californie se sont aussi rapidement multipliés. On pourra les congeler et les exporter. Les lapins, les lièvres et les faisans pourront être exportés en boîtes.
Dans la République Argentine, j'avais vu ces mêmes Anglais entreprenants commencer leurs opérations sur le même pied. On peut donc croire qu'à bref délai l'Europe verra, pour la viande, la même révolution qui a eu lieu pour les grains.
Nos cultivateurs n'ont pu soutenir la concurrence américaine pour les blés, et ont transformé leurs champs en prairies, où paissent les moutons et les bœufs; mais bientôt le mouton et le bœuf d'Amérique et de l'Océanie feront baisser considérablement le prix de la viande, et les tarifs protecteurs, odieux au peuple lorsqu'ils touchent aux objets d'alimentation, seront impuissants à conjurer le fait.
Que reste-t-il donc à faire au propriétaire et au cultivateur français? Il n'a qu'à suivre le courant. La rapidité des voies de communication et les découvertes journalières font que le champ d'action n'est plus la petite France ou la petite Europe, mais le monde entier. Le Français, s'il veut être de son temps, doit semer le blé en Amérique et élever le mouton en Australie, où les (p. 308) terres sont encore entre 25 et 100 fr. l'hectare. Plus tard, il les paiera plus cher, car les prix tendent inévitablement à s'équilibrer. Si un jour il dispose du Tonkin et de Madagascar il devra en faire autre chose que d'y tenir quelques marins et soldats. Or, pour cela il est indispensable de revenir à la famille stable et de rétablir l'autorité paternelle par une plus grande liberté testamentaire, comme chez les peuples prospères. Le père de famille ne craindra pas les nombreux rejetons, lorsqu'il saura qu'il peut assurer le foyer à l'un d'eux qui perpétuera son nom, et que les autres se répandront dans le monde entier. Toutefois, en rétablissant le père de famille dans sa dignité et dans son droit naturel, il sera indispensable de le fortifier dans le sentiment du devoir par la lecture des Livres saints; car il aura une plus forte responsabilité.
Avant de quitter Wellington, je rends visite à M. Cheymol, un des rares Français en Nouvelle-Zélande. Ce jeune Bordelais voulait de bonne heure se rendre aux colonies, mais tous ses efforts pour obtenir des renseignements sérieux en France furent vains. Il lisait les bulletins de la Propagation de la Foi et il eut la pensée de s'adresser au Père Forest en Nouvelle-Zélande. Celui-ci lui répondit: Si le travail ne vous fait pas peur, et si la vertu est votre compagne, vous ferez fortune. Il vint, importa les vins français et fit bientôt fortune; mais un navire qu'il avait fait venir de Bordeaux arriva au moment de la faillite de la Banque de Glascow, et à la suite de la crise financière sa fortune s'est trouvée compromise. Il est en train de la (p. 309) rétablir. Sans ce contretemps, il aurait réussi à détourner en faveur de Bordeaux l'importation des vins français qui se fait en grande partie par Londres.
À 6 heures, je monte sur le Wanaka, petit vapeur de 500 tonnes qui doit me conduire à Littletown. Le pavillon est en berne, le directeur de la Compagnie vient de mourir à Dunedin. Cette Compagnie, appelée Union steamship Company of New Zealand, possède une trentaine de bateaux à vapeur de 100 à 2,000 tonnes. Elle fait le service des côtes et le service intercolonial entre la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie, l'Australie et les îles Fiji.[Table des matières]
Départ de Wellington. — Les projets de confédération. — Littletown. — L'assurance par l'État. — Christchurch. — La loi morale. — Les écoles. — Les Sœurs du Sacré-Cœur de Lyon. — Le Musée. — Le Canterbury-College. — L'enseignement laïcisé. — Le Jardin public. — La ferme-école à Lincoln. — Saint André et les Écossais. — Akaroa et la colonie française. — Route vers Dunedin et la plaine de Canterbury. — Timaru. — Oomarti. — Palmerstown. — La baie de Vaïtati. — Port-Chalmers. — Dunedin. — La ville. — Le Musée. — Les écoles catholiques. — Départ pour Lawrence.
Je parcours encore une fois la vaste baie ou Port Nicholson, et bientôt nous sommes en pleine mer. Elle est calme, ce qui est fort rare sur ces côtes; et j'en profite pour lire les nombreux journaux de la colonie. Ils s'occupent tous de la conférence qui se réunit en ce moment à Sydney. Elle est composée des représentants des cinq colonies d'Australie: Victoria, Nouvelle-Galle du Sud, Australie du Sud, Australie de l'Est et Queensland, de ceux de Tasmanie et de la Nouvelle-Zélande et des îles Fiji. Le but de la Conférence est de s'entendre sur les moyens de réaliser une confédération entre les colonies, et de procéder à l'annexion de la Nouvelle-Guinée, des Nouvelles-Hébrides, des îles Loyalty, de l'archipel des Amis, et en général de toutes les îles océaniennes encore (p. 312) inoccupées. Ils veulent ainsi empêcher que la France ne prenne possession des Nouvelles-Hébrides pour y emmener ses récidivistes. Or, ceci est plutôt un prétexte, et le véritable but des colons est d'assurer à leurs enfants et petits-enfants ces vastes possessions, où ils pourront se répandre et se multiplier à loisir. Ils disent que pour peu la Nouvelle-Zélande a failli être française et qu'il faut aviser à temps pour que ce qui est arrivé à la Nouvelle-Calédonie ne se reproduise pas pour d'autres îles océaniennes. Je ne vois rien dans leurs raisonnements qui indique l'orgueil ou la vantardise; ils considèrent même la grande responsabilité que les annexions projetées feront peser sur eux; mais ils ajoutent: Quoi de plus grand et de plus noble que de prendre possession de ces immenses terres où ne végètent que quelque sauvages, pour y établir un peuple nombreux et chrétien qui servira le Créateur?—La gloire de Dieu, le bien des peuples; nobles pensées qui devraient toujours être le mobile des nations et de ceux qui les gouvernent! Pourquoi n'en ferions-nous pas autant?
Le 29 décembre au matin, nous apercevons à notre droite une rangée de montagnes aux cimes neigeuses: ce sont les Alpes de l'île du Sud. Partout où la nature a formé un port, les Anglais placent une ville.
Littletown, port de Christchurch, se développe gracieusement sur les collines qui entourent la baie. Ses rues sont larges de 20 mètres. Sa population n'est encore que de 2 à 3,000 âmes, mais elle augmente rapidement. (p. 313) On voit au loin les cabanes des éleveurs; partout la fougère a été remplacée par les ray-grass.
À la gare, je vois affichés les plans et conditions de nombreux lots de terrains que le gouvernement met aux enchères. Pour les terres de pâture, la mise à prix est environ de 1 livre (25 fr.) l'acre. Pour les lots urbains, le prix varie de 2 à 40 l. stg. l'acre. Je lis aussi à la gare les tableaux indiquant les conditions de l'assurance sur la vie. Le gouvernement assure à meilleur marché que toutes les autres compagnies. Ainsi pour assurer 500 l. stg. à la mort, les compagnies australiennes font payer une annuité de 10 à 13 schellings à l'individu âgé de 25 ans, et 22 l. stg. 09 sch. à celui qui en a 50. Le gouvernement néo-zélandais les assure moyennant une prime de 8 l. stg. 18 sch. et 20 l. stg.
Pour assurer 1,000 l. stg., soit 25,000 fr. à la mort, les compagnies australiennes font payer une annuité de 21 l. stg. 6 sch. à 25 ans et de 44 l. stg. 16 sch. à 50 ans, et le gouvernement, 17 l. stg. 17 sch. et 40 l. stg. 15 sch.
Ainsi, un individu qui, âgé de 25 ans, paie au gouvernement 5 deniers, soit 50 cent, par jour, et 1 sch. 1 pen. 1/4, soit 1 fr. 32 cent, par jour s'il a 50 ans, et ainsi en proportion entre ces deux âges; à sa mort, ses héritiers reçoivent 500 l. stg., soit 12,500 fr.
Le gouvernement garantit le paiement sur ses revenus, partage le bénéfice entier entre les assurés et leur prête à 7% jusqu'à concurrence de 90 % de la valeur de leur police. Les colons ont bientôt compris les avantages de (p. 314) cette combinaison, et les sommes assurées s'élèvent déjà à plus de 6,000,000 de l. stg., soit 150,000,000 de francs. Le revenu annuel est de 140,000 l. stg. et le fond de réserve, de 410,000 l. stg. Le boni distribué aux assurés pour les premiers cinq ans dépasse 12,000 l. stg., soit 300,000 fr. À toutes les gares, à tous les bureaux de poste, le colon peut s'assurer, et par une économie journalière, laisser à sa veuve et à ses enfants de quoi commencer l'industrie ou la ferme qui leur permettra de vivre dans la paix et l'abondance.
À midi 1/2, je pars pour Christchurch. On retrouve avec bonheur les chemins de fer lorsqu'on a voyagé de longues journées entassé dans les diligences, et qu'on quitte les petits bateaux des côtes orageuses.
Le train traverse un tunnel et entre dans les magnifiques plaines de Canterbury. Ce sont des terres d'alluvion que les colons ont drainées; elles rapportent de 20 à 80 pour 1 dans le blé, et donnent de 16 à 20 tonnes de pommes de terre par acre. Aussi ces terres de choix, qui n'ont coûté que quelques schellings, il y a peu d'années, sont vendues actuellement jusqu'à 50 l. stg. l'acre.
La terre est divisée en paddock, où paissent les vaches et les moutons. Ceux-ci semblent perdus dans l'herbe haute; aussi s'engraissent-ils rapidement. Lorsqu'un paddock est dévoré, on passe les animaux dans le paddock voisin, et l'herbe repousse bien vite au premier. Je puis comparer ces plaines fertiles à nos plaines arrosées par le Var.
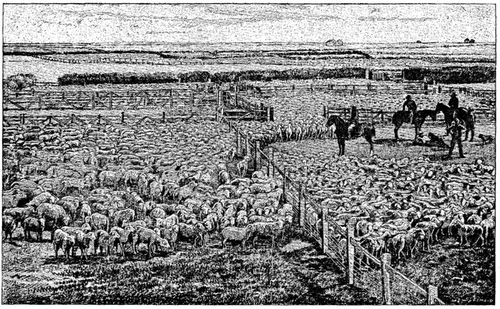
Warika station.—Canterbury.—Lieu où l'on réunit les moutons pour les laver et les tondre.
(p. 315) Vingt-cinq minutes après mon départ, je suis à Christchurch. C'est la capitale de la province de Canterbury, partie nord de l'île Sud. Elle se développe dans la plaine en larges rues de 20 mètres. J'y vois les cabs à deux roues de Londres, les tramways à chevaux, les tramways à vapeur, de magnifiques constructions en pierre ou en ciment et beaucoup d'églises. Cette ville a été fondée par des colons, qui se proposaient d'y conserver dans sa pureté l'Église anglicane, mais bien d'autres communions sont venues ensuite, et chacune a son église. Quelle que soit la forme de son culte et le détail de ses croyances, l'Anglais met toujours Dieu avant tout. Ici comme dans les autres villes, je trouve la Freethought-hall, salle des libres-penseurs; les loges maçonniques à côté des salles de la Salvation Army (armée du salut), mais aucune association ne prend le caractère athée et personne ne trouve mauvais qu'on punisse ceux qui violent la loi de Dieu. Tous les jours les Cours condamnent à l'amende et à la prison les ivrognes, les blasphémateurs, ceux qui tiennent en public des mauvais propos, ou qui violent le repos du dimanche. Une femme traduite à la barre pour avoir prononcé des jurons chez elle dans une dispute avec son mari, protestait que son domicile était inviolable et que personne n'avait le droit de s'ingérer dans ce qu'elle y faisait ou disait. Elle fut néanmoins condamnée à 20 sch. d'amende, ou à défaut à 7 jours de prison, parce que ses jurons avaient été entendus de la rue. Tous les journaux enregistrent journellement ces faits sans qu'aucun d'eux (p. 316) pense à taxer les juges d'intolérance; ils trouvent tout naturel que la justice punisse comme ennemis publics tous ceux qui cherchent à introduire la démoralisation dans la communauté.
M. Smith, directeur du matériel du chemin de fer, me confie à un de ses amis, M. Gresson, pour me faire visiter une station d'éleveurs. M. Maxwell, directeur général des chemins de fer, a la bonté de mettre à ma disposition un billet gratuit de 1re classe pour tous les chemins de fer, durant le temps de mon séjour en Nouvelle-Zélande. On ne saurait mieux accueillir l'étranger qui vient étudier le pays. Merci à ces messieurs.
Le Père Ginety, mariste irlandais, me fait visiter ses écoles. Il a confié celle des garçons à 3 institutrices et à 2 instituteurs laïques. Il s'en trouve bien. Il est d'avis que la femme réussit mieux que l'homme auprès des garçons au-dessous de 12 ans. J'avais constaté le même fait en Pologne et au Brésil, où les Sœurs de Charité ont aussi des écoles et des orphelinats de garçons. Trois cents élèves sont inscrits. Plusieurs ont de nombreux milles à faire pour arriver de la campagne; ils ont 2 heures 1/2 de classe le matin et autant le soir. Au premier cours, on enseigne le dessein et le français.
Au couvent du Sacré-Cœur (congrégation de Lyon) la supérieure me fait visiter le vaste établissement. Il vient à peine d'être achevé et a coûté 250,000 francs. Les Sœurs ont une cinquantaine d'externes payantes, autant de pensionnaires et 200 gratuites. On leur confie beaucoup (p. 317) d'élèves protestantes et juives. Elles jouissent de l'estime publique de toutes les communions, et la supérieure à son tour fait le plus grand éloge de la droiture des protestants de ce pays. L'internat est l'exception; les parents ne se séparent des enfants que lorsqu'ils habitent, au loin, la campagne. Lorsqu'ils ne sont qu'à quelques milles, ils préfèrent les envoyer à l'école le matin pour revenir le soir. Les élèves apprennent la langue anglaise, le français, le latin, l'histoire, la géographie, la musique, le dessin, la broderie et la couture. Les Sœurs sont obligées de faire apprendre le latin, dans leur noviciat de Lyon, aux sujets destinés à la Nouvelle-Zélande, car l'instruction est considérée ici comme incomplète sans les premiers éléments de cette langue morte. Du haut de l'établissement, on jouit d'une vue superbe sur les Alpes, constamment blanches de neige. L'eau dessert toutes les parties de la maison. Elle provient d'un puits artésien et monte sous les toits par le simple jeu d'une pression atmosphérique, causée par l'eau même pressée sous une petite cloche en fer. Les élèves ici, comme dans tous les pays anglais, ont l'habitude du bain ou douche journalière.
Je vois quelques beaux tableaux exécutés par les élèves. Le vaste jardin de l'établissement est divisé en trois parties, une grande prairie centrale pour les vaches; aux bords un verger et un potager; puis une allée tout autour, plantée d'arbres d'agrément.
Le musée est le plus complet de la Nouvelle-Zélande. (p. 318) Dans de vastes et nombreuses salles sont rangés les divers sujets du règne animal, du règne végétal et du règne minéral, et les principaux produits de tous les pays. Parmi les bois indigènes, on voit d'énormes planches de pins rouges, de pins blancs, de pins noirs, le totora, le black birch (fagus fusca) d'un beau rouge qui sert à faire des meubles et aux Maoris pour creuser leurs canots. On remarque les collections des cotons, des laines, des soies; des modèles de bassins de radoub, des machines employées dans les mines, et tout ce qui, en ce genre, peut faciliter l'instruction du public. La collection des objets indiens des îles Fiji, des îles Samoa et des Maori est aussi bien remarquable. Dans une salle on a réuni la copie des meilleures statues grecques et romaines, mais la pièce la plus curieuse est un moa monstre, deux fois plus grand qu'un homme. On sait que cet immense oiseau était naturel de ces îles, et que les indigènes l'ont détruit pour s'en nourrir.
Le directeur du Canterbury-College me fait parcourir l'établissement: 5 grandes classes ont leurs bancs en amphithéâtre et une salle, vaste comme une église, sert à la collation des grades. Les élèves aussi bien que les professeurs sont en costume: toge noire et toque, et aussi bien les élèves masculins que féminins, car bien des jeunes filles prennent ici leurs grades (importation américaine!)
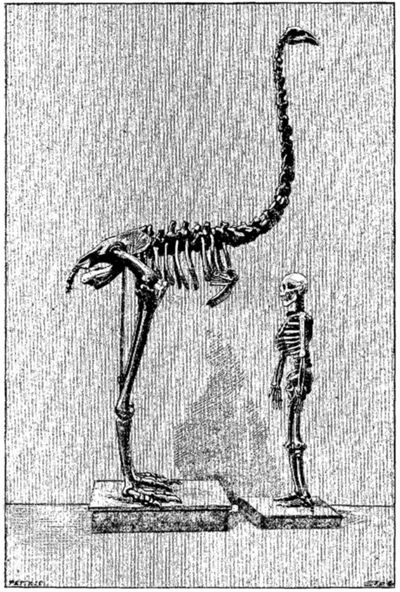
Squelette de Moa et de Maori.
Les frais des écoles sont considérables; un simple maître élémentaire reçoit de 3 à 5,000 francs par an; (p. 319) mais les ressources sont prises sur les terres réservées pour cet objet. Dans tout établissement nouveau, le gouvernement retient une partie de terres qu'il loue et en affecte les revenus aux écoles. Ces terres s'améliorent et donnent avec le temps un plus fort revenu à mesure que la population augmente. On a débattu longuement et fortement dans ces colonies la question de savoir s'il fallait ou non enseigner la religion dans les écoles: tout le monde était d'accord sur l'indispensable nécessité de la religion; mais quelle croyance enseigner au milieu de l'infinie variété de doctrines dans les communions protestantes? On s'est donc abstenu, laissant le soin de cet enseignement à la famille et aux divers clergés. Bien des protestants déplorent cette décision, et pour en conjurer les effets ils multiplient les sunday's schools (écoles dominicales). Les catholiques se sont empressés d'établir, pour leurs enfants et à leurs frais, des écoles où la religion est enseignée, mais ils se plaignent de ce que, obligés de contribuer à l'enseignement public et de payer leurs propres écoles, ils paient deux fois. Le même fait se reproduit dans l'Amérique du Nord.
Le soleil est radieux, j'en profite pour parcourir le vaste et beau jardin public. Les pervenches, les roses, les mimosas sont en fleurs et parfument l'atmosphère. Une rivière entoure le jardin, et les membres du Rowing-club s'y exercent à ramer. Sous les bouquets de pins et d'eucalyptus, les oiseaux gazouillent leurs amours; il est beau le printemps! parmi les fleurs et les fruits les (p. 320) plus beaux sont les troupes de bébés qui courent et se roulent sur la verte pelouse. Plus loin, les grands garçons font la traditionnelle partie de criket.
Les boutiques ouvrent à 9 heures et ferment à 6; il reste donc assez de temps pour les jouissances de la famille.
Le directeur du Canterbury-College m'avait remis une lettre pour le directeur de la ferme-école ou école d'agriculture. Elle est située à 12 milles, à Lincoln. Le chemin de fer m'y mène en 1 heure. Un vaste et superbe édifice gothique reçoit 5 professeurs et leurs familles et loge une quarantaine d'élèves. Ceux-ci paient 1,000 fr. de pension par an, et travaillent eux-mêmes la ferme; 241 acres sont occupées par les blés, avoines, orges, maïs et autres sortes de grains, et 400 acres reçoivent les nombreuses variétés d'herbes et de racines. On élève de 12 à 1,500 brebis et moutons de toute race; une centaine de vaches et gros, bétail dans leurs variétés, une centaine de porcs et 14 chevaux de labour.
Les élèves apprennent les mathématiques, la chimie, la physique, la biologie, la géologie, et l'art vétérinaire. Ils traient les vaches, préparent le beurre et le fromage, labourent, sèment, récoltent. Les plus travailleurs reçoivent une indemnité; le cours est de 3 ans. On donne peu à la théorie, beaucoup à la pratique. Voici comment sont réparties les heures de travail durant la semaine: agriculture, leçons 2 heures; travail manuel dans la ferme et au laitage, 17 heures; chimie, leçons 2 heures, laboratoire (p. 321) 3 heures 1/2; sciences naturelles, leçons 2 heures, laboratoire 1 heure 1/2; mathématiques, leçons 4 heures; science vétérinaire, 1 heure; horticulture, 2 heures 1/2; maréchalerie et serrurerie, 1 heure; charpenterie et menuiserie, 1 heure 1/2; examens, 2 heures; total 40 heures de travail par semaine outre les heures d'étude. Durant la 2e et 3e année, les élèves ont 2 heures par semaine pour les levés des plans, et 1 heure pour la tenue des livres. Ils ont chacun leur chambre à coucher, et une autre chambre à deux pour l'étude; le bain est quotidien. Les élèves ferrent les chevaux et réparent les charrues; ils composent et essaient les fumiers, tondent les moutons. Passant ainsi de la théorie à la pratique, ils ne peuvent devenir que d'excellents fermiers, tels qu'il les faut dans ces pays. Ici, en effet, la main-d'œuvre est chère et il faut que le maître ne craigne pas d'employer ses bras.
La moitié des terres est encore inoccupée; celui qui arrive avec un capital de 50 à 100,000 fr. peut bientôt le décupler, mais à la condition de travailler non seulement de sa tête, mais aussi de ses mains.
Avec le directeur je parcours la maison, les musées, les laboratoires; je vois la collection des machines à chevaux et à vapeur, et les celliers où l'on prépare le beurre et le fromage au moyen de machines américaines. Le lait est tenu sous l'eau dans des vases en fer-blanc pour en extraire la crème. Le colon dans ces pays jeunes n'a pas de préférence, pas de routine; il prend les derniers perfectionnements (p. 322) où il les trouve, aussi bien en Amérique qu'en France, en Allemagne et ailleurs. Les journaux et revues le tiennent au courant des découvertes, et il se hâte toujours, d'en profiter. Les potagers, les vergers, quoique récents, sont magnifiques; la ferme ne date que de 5 ans, et a déjà atteint un degré élevé de perfectionnement.
Quand je rentre, le soleil éclaire de ses derniers rayons les blanches cimes des Alpes. À l'hôtel, on me fait dîner dans une chambre à part; la salle à manger est occupée par 65 convives, membres de la société écossaise, qui fêtent saint André leur patron. Un grand highlander en costume national joue de l'outre et appelle les convives; les mets sont nationaux et rappellent la mère patrie; la société ne date que de 2 ans et compte déjà 200 membres. À la fin du repas on porte un toast à la reine, un à la mère patrie, un aux dames et amis absents, etc.; la gaieté est générale et de bon ton. Un orateur conclut son speech en disant: Si Dieu nous a bénis et si nous avons prospéré, c'est que nous avons appris à garder le 7e jour, à respecter les Livres saints, et aussi (c'est avec regret que je le nomme) parce que nous savions par cœur notre petit catéchisme. Une triple salve d'applaudissements prouve que c'était bien là la pensée de tous les convives.
Les chansons nationales se prolongent jusqu'à 11 heures, puis chacun rentre chez soi.
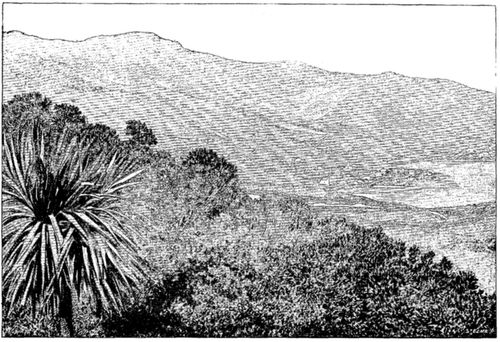
Nouvelle-Zélande.—Akaroa, ancienne colonie française.
J'aurais voulu me rendre à Akaroa, visiter l'ancienne (p. 323) colonie française; elle n'est qu'à une journée de Christchurch; mais les bateaux n'y vont que 3 fois par semaine; je dus donc y renoncer. C'est en 1840 que le capitaine Langlois abordait ici avec un vieux baleinier, le Comte-de-Paris, nolisé par la compagnie Nanto-Bordelaise. Il venait pour prendre possession de l'île au nom de la France; mais les Anglais l'avaient précédé de trois jours. Il débarqua quand même une trentaine de Français, dont quelques-uns ont prospéré; mais ils sont restés 40 ans en face de ces superbes plaines de Canterbury sans les cultiver; et que pouvaient-ils faire laissés à eux-mêmes. Avec nos idées étroites et notre défectueuse organisation de la famille, il est probable, qu'entre nos mains, la Nouvelle-Zélande n'aurait pas encore le demi-million d'habitants qu'elle a aujourd'hui. Dans 50 ans, nous n'avons pu réussir à jeter 300,000 Français sur l'Algérie qui est à nos portes, et dans le même espace de temps les Anglais en ont mis 3,000,000 en Australie, sans compter les autres colonies, et 10,000,000 dont s'est accrue la mère patrie!
Le matin, à l'hôtel, je vois entre les mains du garçon un menu de la veille avec des poésies écossaises à chaque mets; je le prie de me le remettre, et il s'y refuse. C'est le seul que j'aie pu saisir, me dit-il, je le garde; il ne serait pas facile d'en avoir un autre: l'Écossais n'est pas libéral, il ne donne que ce que l'on peut prendre sans lui. J'ignore s'il dit vrai, mais je hâte mon déjeuner, et à 8 heures je suis à la gare, en route pour Dunedin. Pas (p. 324) d'enregistrement de bagages, on les confie bona fide et on les reprend de même, sans attendre l'ouverture des salles. Pas de cantonnier au passage à niveau; une simple grande affiche, Stop! Crossing railway, look after the engine (arrête; traverse de chemin de fer, regarde après la machine) et après cela que chacun se garde, il en coûte cher de garder tout le monde!
La voie est étroite (3 pieds), les wagons sont longs, à 6 roues, et plusieurs ont les bancs sur les côtés.
J'ai encore pour compagnons de voyage la famille tasmanienne. Le bon oncle ne cesse de dire à ses nièces et à son neveu: Look at beautiful scenery! Regarde la belle nature! et il jouit de leur plaisir. La voie suit la longue plaine de Canterbury et traverse de temps en temps, sur de longs ponts de bois, des rivières qui ressemblent à notre Var. Elles seront endiguées plus tard. Le blé, qui est déjà récolté en Australie, est ici encore en herbe; les prairies sont magnifiques: nous voyons aussi quelques champs de fèves en fleur, des betteraves à sucre et des pommes de terre. De loin en loin quelque village aux petites cabanes de bois; le plus souvent une simple cabane aux stations marque la place de la future ville. Nous avons toujours à notre droite la chaîne des Alpes aux blanches cimes, mais le mont Cook qui dépasse 3,000 mètres d'altitude reste caché dans les nuages. À Timaru, nous revoyons la mer, et par ses galets et ses alentours, la plage me paraît fort semblable à celle de Nice.
(p. 325) Plus loin, à Oomaru, j'aperçois de vastes entrepôts de grains et de laine, et une grande filature. Les colons sont déjà bien avant dans l'industrie; j'ai vu partout des tanneries, des brasseries, des verreries, briqueteries et fabriques de faïence, etc.
À Oomaru nous entrons dans une région montagneuse. La voie passe à travers mille riantes collines par des tunnels, des talus et des ponts. De temps en temps elle débouche sur la mer et la suit sur des rochers qui la surplombent. Nous voyons de belles carrières de pierre tendre. Partout les chevaux, les bœufs et les moutons regardent le train avec étonnement. Nous traversons Palmerstown, gracieuse ville en amphithéâtre, et arrivons à la jolie petite baie de Vaïtati. Là une langue de terre s'avance en mer en gracieuses découpures comme à Saint-Hospice, près de Villefranche-sur-Mer. La région ici est boisée et augmente le pittoresque. À 7 heures nous sommes à Port-Chalmers, port de Dunedin. Il est à l'entrée d'une baie longue et étroite qui se prolonge jusqu'à Dunedin, durant plusieurs milles; on y creuse un canal en ce moment, pour permettre aux grands navires d'arriver jusqu'au bout. Actuellement ils sont obligés de s'arrêter à Port-Chalmers: le Glascow de la Nouvelle-Zélande. On y construit, en effet, de beaux navires en bois et en acier. À 7 heures 1/2 nous entrons en gare à Dunedin. Cette capitale de la province d'Otago a été fondée en 1848 par les presbytériens, qui y ont élevé une magnifique cathédrale. Elle compte aujourd'hui, avec les (p. 326) faubourgs, plus de 42,000 âmes. Elle a conservé plus qu'ailleurs son caractère religieux. C'est dimanche; pas un magasin ou un Bar ouvert, pas un train de chemin de fer; j'ai de la peine à l'hôtel à faire cirer mes souliers. J'ai entendu bien souvent mes compatriotes trouver cela insupportable; ils ne regardent pas au grand acte de foi qui en est le mobile, et qui appelle sur ces peuples la bénédiction du souverain législateur!
Au reste, si l'on ne se livre pas à nos joies bruyantes, on ne dédaigne pas les délassements. Je trouve les familles se promenant au jardin public avec leurs nombreux enfants, et le musée est ouvert entre les offices, de 2 à 5 heures.
Les catholiques ne sont venus ici que depuis 12 ans; ils sont déjà 5,000 dans la ville et 18,000 dans le diocèse. L'évêque, Mgr Moran, a dix-huit prêtres pour les besoins du culte, et construit en ce moment une magnifique cathédrale gothique, qui sera le plus beau monument de Dunedin.
L'église actuelle est une construction provisoire. À 11 heures, elle est remplie de peuple pour la grand'messe. Deux Pères maristes y prêchent une mission. Un bon vieillard parle plus d'une heure pour prouver que la mission est la plus grande grâce que Dieu puisse accorder aux fidèles sur la terre; mais, à moins d'être sous le charme d'un Mermillod ou d'un Père Félix, la force d'attention est limitée chez l'homme, et, après un certain temps, la fatigue détruit la bonne impression des premiers (p. 327) moments. Comme résultat pratique, je vois que les chanteurs et les chanteuses sourient et jasent probablement d'autre chose que de la retraite. Saint François de Sales, qui se faisait tout à tous, ne dépassait jamais les 20 minutes dans ses sermons.
La ville de Dunedin est construite partie en plaine (quartier des affaires) et partie en colline. Ces collines ont des pentes de 30° à 45° d'inclinaison, et immédiatement le colon a adopté les tramways de San-Francisco, qui les gravit par un câble sans fin circulant sous la voie. Le char l'atteint au moyen d'une pince qui est dans une rainure, le prend et le quitte à volonté pour marcher ou s'arrêter. Les rues sont larges de 20 mètres. Les rues transversales, plus ou moins en plaine, ont des tramways à chevaux et des tramways à vapeur.
On a réservé de vastes emplacements sur les collines pour la récréation du public. D'importants faubourgs s'y élèvent de tous côtés et donnent ainsi à la ville une grande étendue au milieu des bois et des jardins.
Ce système, généralement adopté ici, donne des villes beaucoup plus saines que dans le système des grandes agglomérations sur un espace restreint. La mortalité n'est que de 12 pour mille, pendant qu'elle est de 24 à Paris et de 21 à Londres. L'inconvénient des distances est atténué par le bon réseau de tramways de toute sorte. L'Anglais ne peut se passer du jardin, où sa nombreuse progéniture a besoin de prendre ses ébats, et, en tout cas, il veut son home, sa maison indépendante, son chez-lui.
(p. 328) Dans la ville basse s'élèvent de superbes maisons de pierre en style renaissance comme à Glascow. Ce sont les banques, les hôtels, les grandes maisons de commerce. Les collines sont réservées aux cottages, mais on y voit aussi quelques beaux châteaux en style gothique, rappelant les châteaux d'Écosse. Dunedin peut servir de modèle pour la construction des villes en colline.
Le musée se compose d'une seule vaste salle avec deux rangs de galeries. Les objets étrangers et indigènes y sont bien classés. Parmi les phoques du pays je distingue le seal éléphant (phoque éléphant), d'une grosseur extraordinaire. Son cuir est très solide et d'un grand prix. Tous les quartz, sables, graviers, ciments et pierres aurifères du pays ont été groupés en une belle collection avec les noms des localités et la quantité d'or qu'elles contiennent. Une collection d'insectes en verre montre en grand la forme et la construction des insectes microscopiques ou microbes des dernières découvertes. Les matières premières, les objets manufacturés sont aussi classés de manière à instruire facilement le public.
Je remarque deux énormes squelettes fossiles de moa et une belle collection d'armes et objets naturels de la Nouvelle-Guinée. Au-delà du musée, le jardin botanique s'étend sur la plaine et la colline boisée.
Mgr Moran a la bonté de me faire visiter ses écoles. Il y a ici 6 Frères irlandais s'occupant de 250 garçons. Il en a encore 14 autres dans les diverses stations du diocèse. À côté des Frères, les Sœurs dominicaines (p. 329) irlandaises ont un pensionnat avec une trentaine d'élèves et 200 à 300 externes. Quelques Sœurs, parlent le français et l'enseignent dans la high school (haute classe). Elles enseignent aussi la musique, le dessin et l'italien. Une grande élève a même la bonté, de chanter avec goût et expression une chanson française en l'honneur de l'étranger.
Le consul français, ici comme à Auckland et à Wellington, est anglais: je voulais me renseigner auprès de lui sur les Français habitant la contrée, mais il est absent. Je m'adresse donc à un Français qui tient un hôtel; il me dit que les rares nationaux dans le pays sont des échappés de la Nouvelle-Calédonie ou des marins déserteurs, et qu'il ne veut pas les connaître. Quant à lui, il est un des chefs de la Maçonnerie, mais il laisse sa femme aller à l'église et son fils chez les Frères. Il n'entretient aucune relation avec les Loges françaises, parce qu'elles sont athées.
Je rends visite à M. Perrin, directeur du New-Zealand Tablet. Il est Irlandais, mais descendant de Français. Ses ancêtres, huguenots, se réfugièrent en Irlande après la révocation de l'édit de Nantes. Il a un frère ministre protestant et un oncle juge en Irlande. Lui-même est un converti; il était ministre protestant. Enfin, je prends le tramway et grimpe sur les collines, d'où l'on a une vue magnifique sur la baie, sur la ville et sur la mer. La région ressemble fort à l'Écosse, mais le climat est moins rude; toutefois, on a assez souvent la neige et la glace (p. 330) durant l'hiver et assez de pluie dans les autres saisons. Le climat devient plus froid à mesure qu'on avance vers le sud.
Un ami de Londres m'avait remis une lettre pour un jeune ménage qui est venu élever des moutons en Otago. J'aurais voulu les voir à l'œuvre, mais il est à 150 milles d'ici et il faut y aller en voiture et à cheval. J'en aurais profité pour voir les beaux lacs de Wakatipu, Hawea, Wanaka, qui occupent ces régions; mais cela m'aurait pris une quinzaine de jours, et il me reste encore bien du chemin à faire. J'y renonce donc et pars pour Lawrence visiter un goldenfield (terrain aurifère).[Table des matières]
Route vers le Sud. — Facilités aux émigrants. — De Milton à Lawrence. — La cabane du pionnier. — Les diggers chinois à Waïtahuna. — Le quartier chinois à Lawrence. — La cabane d'un avare. — L'école. — Une station de moutons dans la région des lacs. — Le lapin fléau public. — Les goldfields du Gabriel Gully. — M. Perry et sa nouvelle méthode. — Un dépôt de cemen aurifère. — Route à Invercargill. — Bismarck et ses informations. — La ferme d'Edendale et la New-Zealand loan Cy. — Un clerc méfiant. — Cherté de la main-d'œuvre. — La ville d'Invercargill. — Le presbytère. — La prison. — Route vers Bluff. — Le steamer Le Manipoori. — Réflexions sur la Nouvelle Zélande. — Le 8 décembre en mer. — Le service du dimanche. — Une dernière tempête.
Le 5 décembre, à 5 heures du matin, je rédige mon journal de voyage, et à 8 heures je suis à la gare. Le train se dirige vers le sud, traverse la ville et passe les faubourgs. Au sortir d'un grand tunnel, nous sommes au marché aux bestiaux; de grands troupeaux de bœufs et de moutons arrivent de toute part. Une usine pour les geler est en face du marché. Pauvres moutons! il y a peu de temps on les faisait bouillir pour le suif, aujourd'hui on les gèle; j'ignore si, sur les deux procédés, ils ont une préférence.
Un peu plus loin, à Mosgiel je vois une grande filature de laine et une filature de drap. Nous suivons une riante vallée que sillonne une blonde rivière, le Taïri. On la (p. 332) prendrait pour le Tibre. Elle se jette bientôt dans un petit lac. À droite, de petites montagnes ont leur cime couverte de neige fraîchement tombée; partout le laboureur emploie les dernières machines d'Europe et d'Amérique, partout les moutons et les bœufs paissent dans des compartiments séparés par des haies vives ou par des barrières en bois ou en fil de fer.
À 10 heures nous sommes à Milton, où je dois prendre l'embranchement de Lawrence. Pendant qu'on prépare le train, je lis le règlement pour les immigrants, affiché ici comme dans toutes les gares et bureaux de poste. Le prix du passage d'Angleterre à la Nouvelle-Zélande pour un homme marié au-dessous de 45 ans, ou pour un homme seul au-dessous de 35 ans, est de 5 livres (125 fr.). La femme mariée au-dessous de 45 ans, et la femme seule au-dessous de 35 ans, a le passage gratuit. Il en est de même pour la veuve au-dessous de 35 ans et sans petits enfants. Les enfants jusqu'à un certain âge ont le passage libre. Pour les autres personnes, le prix du passage est de 14 livres 7 schellings. Les parents et amis peuvent, payer ici le passage pour les personnes qu'ils désirent faire venir.
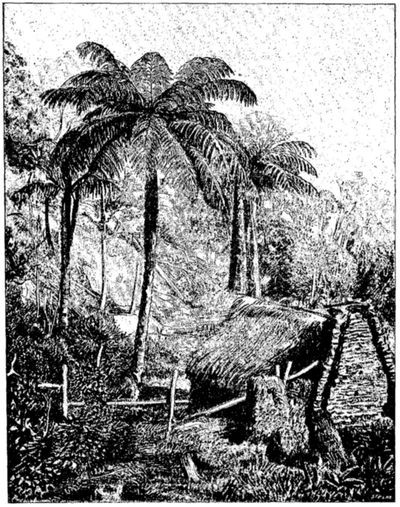
Nouvelle-Zélande.—La hutte du pionnier.
Je remonte en wagon. Sur cet embranchement les voitures ressemblent à des wagons-salons. La voie suit une petite rivière et s'engage dans un labyrinthe de collines qu'il contourne et escalade dans tous les sens. Par-ci par-là le vert gazon anglais et quelques maisons de fermiers entourées de jolis parcs. Plus loin, quelques cabanes (p. 333) en mottes de terre, couvertes en chaume; c'est le pionnier qui arrive avec un peu d'argent. Lorsqu'il a pu payer à l'État le premier terme du loyer, il empile quelques mottes de terre et fait sa maison; il couche sur sa malle et perce de plusieurs trous le tonneau de bière et la caisse des provisions qu'il suspend en l'air pour servir de pigeonnier. Bientôt les poules lui donneront des œufs, les oies, les canards, et les agneaux de la chair. Après la première récolte, il pourra se payer un lit, et après la première vente d'animaux, il se construira une maisonnette en planches, qui deviendra plus tard le château. Ces rudes travailleurs qui ont gagné la fortune à la sueur de leur front sont souvent les meilleurs conseillers dans les communes, les législateurs les plus sensés dans le Parlement.
Vers midi nous sommes à Waïtahuna, où les Chinois commencent à bouleverser le sol pour y chercher l'or. Ils viennent de louer à un particulier une quantité d'acres de terrain à 50 livres l'acre, à condition de remettre en son premier état la terre cultivable, après avoir lavé le sol intérieur. Le Chinois est le plus patient des diggers. Un peu plus loin, j'en vois un grand nombre occupés à laver dans le ruisseau, pour la troisième fois, un gravier que les Européens ont déjà lavé plusieurs fois. Ils ont quitté ici leur costume national; toutefois ils conservent la queue, qu'ils enroulent sur la tête et cachent dans leur chapeau: les enfants s'amusent à la leur tirer lorsqu'ils la voient pendante. Quelques-uns se marient (p. 334) dans le pays; ils font de bons époux, mais ils restent païens. Par-ci par-là quelques champs parsemés de sorel, herbe rouge qui indique la pauvreté du sol.
Les colons y ont multiplié pendant de longues et successives années les récoltes de grains, et ils ne peuvent maintenant les obtenir de nouveau qu'en engraissant la terre par le fumier.
À midi 1/2 je suis à Lawrence, et je me rends chez le Père O'Leary, pour lequel Mgr Moran m'avait remis une lettre. Il est très patriote, a habité deux ans la Normandie et parle assez bien le français. Comme tout bon Irlandais, il sympathise avec notre nation et m'accueille en frère. Pendant que le dîner se prépare, il me conduit visiter le quartier chinois. Il est situé à 20 minutes de la ville et occupé par 200 ou 300 Chinois, entassés dans des cabanes de bois ou dans des huttes de terre. Il y a aussi plusieurs communions chez eux; je vois deux églises. Dans celle des Confuciens, il n'y a sur l'autel que la tablette du sage, et sur les parois sont tapissées ses sentences. L'église des Bouddhistes a sur l'autel un gros Bouddha, vases de fleurs, chandeliers et encensoirs, comme dans nos églises.
Le Père me fait remarquer sur la route une petite cabane en zinc, grande comme une cabine de bateau à vapeur; là vit pauvrement un digger anglais, qui a amassé des milliers de livres sterling, et qui prête son or aux banques et à la commune. L'auri sacra fames est encore de nos jours, et fleurit surtout dans les pays de l'or.

Nouvelle-Zélande.—Station de moutons dans l'île du sud.
(p. 335) Au retour, nous visitons l'école, vaste salle en bois qui a coûté 1,000 l. stg. Le jour elle sert d'école aux garçons et aux filles, et le dimanche d'église pour la messe. Les enfants sont environ 80, confiés à un jeune ménage qui reçoit pour cela 200 l. (5,000 fr.) par an et le logement.
Il y a un millier d'habitants à Lawrence et 5 églises. Chaque communion veut avoir la sienne. Les 200 ou 300 catholiques de l'endroit ont la messe deux fois par mois: une autre fois, le Père va la célébrer dans un village plus loin, et le premier dimanche du mois, dans un village à 40 milles.
Le Père a occupé le poste de la région des lacs et me donne des renseignements sur la station que j'aurais voulu aller visiter. Elle comprend un terrain de 30 milles de long sur 15 milles de large (le mille est de 1,600 mètres.)
Elle a été louée au gouvernement pour 10 ans, et pour peu de chose, par une société de trois personnes: une d'elles n'a jamais quitté l'Angleterre, mais elle a envoyé son fils, qui a appris ici le métier et est maintenant le gérant de la société. À l'échéance on a renouvelé le bail pour 10 ans, mais les enchères ont fait quadrupler le prix, qui dépasse aujourd'hui 1,000 l. l'an. Il y a plus de 30,000 moutons dans la station, sans compter les bœufs et les chevaux. À la fin du bail, le nouveau locataire, s'il y a changement, doit indemniser le premier locataire pour les maisons, les haies et autres améliorations.
Les lapins ont causé beaucoup de pertes à la station en (p. 336) dévorant l'herbe des brebis. Les deux paires importées ici d'Angleterre, il y a 12 ans, par un amateur de chasse, se sont tellement multipliées, qu'en 1881 on a exporté de la Nouvelle-Zélande environ 9,000,000 de peaux de lapins; ils sont si nombreux dans certains districts qu'on peut presque marcher sur eux. On les détruit l'hiver avec de l'avoine imbibée d'eau empoisonnée. Combien de nos chasseurs seraient contents ici! Il en est de même pour les lièvres dans certains districts, et les faisans abondent également.
Après le dîner, le bon Père fait atteler son cheval et nous nous dirigeons vers les goldfields, à une lieue de distance, sur les bords du Gabriel-Gully. Cette petite rivière est le premier endroit en Nouvelle-Zélande où l'or ait été trouvé accidentellement, par un nommé Gabriel, pendant qu'il gardait les moutons. Le sol est partout bouleversé, il a été tourné, lavé et relavé plusieurs fois.
Nous arrivons à un endroit où une compagnie lave pour la sixième fois les sables lavés par d'autres, et en obtient de grands bénéfices par la méthode hydraulique. Le directeur, M. Perry, arrive en même temps et m'explique tout le mécanisme. Ce monsieur est d'Oxford; l'Université ne lui a pas donné le diplôme, mais la nature l'a fait ingénieur; il vient de trouver un système appliqué ici pour la première fois et qui a une grande importance. Une chute d'eau, qui descend de 400 pieds, est amenée de la montagne par de grands tubes de 0m30 de diamètre; le dernier tube est resserré, en forme de lance, et (p. 337) jette l'eau avec une telle force qu'il démolit en quelques minutes autant de terrain que plusieurs hommes pourraient en remuer en un jour. L'eau emporte la terre et entraîne le gravier; celui-ci vient frapper contre la bouche d'un tube excessivement épais, et une autre colonne d'eau le prend en travers avec une telle force qu'il le rejette dans une conduite vis-à-vis, faisant fonction de siphon. Le sable et le gravier remontent ainsi de l'autre côté du vallon à 40 pieds de hauteur, et parcourent un canal en planches large d'un mètre, long de 20 mètres. Le fond de ce canal est recouvert d'un drap parsemé d'obstacles en fer; contre ces obstacles, le sable aurifère s'arrête. Chaque deux jours on le recueille et on le lave dans des petits bassins pour avoir l'or pur. Cette méthode est si économique, qu'un vingtième d'once par tonne rend le travail rémunérateur, pendant qu'il faut au moins 1/2 once par tonne dans l'ancien système. Il est vrai que l'eau emporte une partie de l'or et que les pierres rejetées ne donnent pas l'or qu'elles peuvent renfermer.
À quelques pas de là 3 compagnies creusent une espèce de ciment bleuâtre aurifère concentré sur un petit espace et d'une épaisseur d'environ 100 mètres. On peut difficilement s'expliquer ce dépôt singulier. On suppose que c'est le résultat d'une morraine. Il est tellement bouleversé qu'il offre en ce moment le spectacle de certains glaciers de la Suisse. Les éboulements sont fréquents et ont enseveli ou blessé bien des hommes. Le ciment graveleux est porté sous des pilons, et le sable aurifère (p. 338) est ensuite lavé dans des bassins: M. Perry voudrait employer là son système hydraulique, mais les 3 compagnies ne peuvent se mettre d'accord et persévèrent dans l'ancien emploi de la pioche et de la poudre, très coûteux par la main-d'œuvre. Nous grimpons sur une élévation où sont parsemées les maisonnettes des ouvriers; elles ont toutes leur potager et leur verger.
Durant le jour il a plu, neigé et soufflé un vent glacial; on se trouve bien alors le soir près du feu et plus tard sous la couverture.
Le lendemain matin, à 6 heures 1/2, je quitte Lawrence et reviens à Milton pour descendre vers Invercargill. La voie suit une plaine bien cultivée et sillonnée par une blonde rivière. Par-ci par-là, on voit encore quelques terres couvertes de la dure herbe indigène, mais elle fait place peu à peu à l'herbe européenne que sème le colon. Les petits villages se succèdent; une cabane sert de station, le chef de gare commande les mouvements et les exécute, pousse les wagons ou tourne l'aiguille. Par-ci par-là, de hautes cheminées indiquent la présence de manufactures; ce sont des poteries, des moulins, des tanneries, des filatures, etc.
Chemin faisant, je lis les journaux des diverses villes d'Otago. Les ministres protestants ne sont pas toujours d'accord entre eux, et des comptes rendus qu'ils donnent au public, je vois que dans leurs réunions ils n'emploient pas toujours les termes parlementaires. Je lis aussi une lettre par laquelle le prince de Bismarck, au moyen du (p. 339) consul allemand, demande des renseignements sur la congélation de la viande, le coût, le résultat, et le prix auquel la viande congelée reviendrait en Allemagne; c'est de la sollicitude pour le peuple. Une autre lettre du consul allemand de Londres avertit les éleveurs que leur habitude d'empaqueter la laine dans le jute nuit à la marchandise. Des fibres de jute restent dans la laine et forment des taches sur les tissus, après la teinture; il les prie d'aviser, en adoptant une autre méthode; c'est de la sollicitude pour les filateurs et les tisseurs.
À Mataura, je vois une gracieuse petite ville croissante. Je remarque que presque partout les colons ou le gouvernement ont conservé aux diverses localités les noms maoris. À 3 heures 1/2 je m'arrête à Édendale pour visiter la ferme de la New-Zealand Loan Cy. Cette compagnie avait acheté une immense étendue de terre vierge à bas prix; une livre l'acre et au dessous. Il la vend maintenant, par parcelles, de 6 à 12 livres l'acre. En attendant l'acheteur, elle l'utilise par des prairies et des semailles. Près de la gare, je visite la fabrique de fromage; 400 vaches remplissent tous les jours 2 énormes caisses de lait échauffé à la vapeur, et on en retire environ 700 livres de fromage par jour, exporté au prix de 9 pences (18 sous) la livre. À la ferme, le manager (directeur) est absent et j'ai de la peine à recevoir de son clerc quelques renseignements. Il me dit que son chef reçoit 300 livres (7,500 francs), logé et nourri, qu'ils sèment principalement l'avoine et des navets pour (p. 340) engraisser les moutons; qu'un acre (arpent) donne en moyenne de 60 à 70 boisseaux, vendus à deux schellings 1/2, et que presque tous les travaux sont donnés à forfait. On paie environ 6 schellings pour labourer une acre de terrain; le charron qui répare les machines est logé, nourri, et reçoit 40 schellings par semaine.
Le labourage se faisait à la vapeur, mais le charbon est cher (32 schellings la tonne) et l'avoine bon marché; on est revenu à la charrue à chevaux. Il y a en ce moment un millier de têtes de gros bétail sur la ferme et de 8 à 10,000 moutons. J'ai demandé bien d'autres détails, pour arriver à faire le budget de la dépense et du revenu, mais à mes questions le clerc répond un peu embarrassé I don't know (je ne sais pas). Or, comme il est impossible qu'un teneur de livres ignore ces détails, j'ai vu qu'il y a encore ici des gens ou des compagnies méfiants. Aux États-Unis, ces détails sont imprimés dans des prospectus répandus à profusion dans les hôtels et dans les gares.
Je parcours les champs et suis la manœuvre des bergers qui poussent soit les bœufs, soit les moutons dans de nouveaux paddocks (compartiments de prairies). Il est curieux de voir comment leurs chiens bien dressés font les trois quarts de la besogne, en aboyant et courant sus aux animaux dans la direction marquée.
J'entre dans un bush (fourré) et j'y vois une telle quantité de lapins que, sans le chien qui les poursuit et les pousse dans les tanières, je crois que j'aurais pu en (p. 341) prendre quelques-uns par la queue. Le long du chemin, ils ont tellement percé la terre au-dessous des haies vives, qu'elles sont presque démolies. Pour s'en défaire, non seulement on les empoisonne, mais on voit souvent de nombreuses annonces sous le nom de rabbits exterminator, indiquant divers engins de destruction à leur adresse. Je remarque que la plupart des chemins sont de belles avenues de 20 mètres de large; naturellement la chaussée actuelle en occupe à peine les 3/4 vers le milieu et sur le reste pousse l'herbe; mais plus tard, lorsque le pays sera plus peuplé, on n'aura pas besoin de recourir à l'expropriation pour élargir les voies de communication.
À 6 heures je remonte dans le train, et je me trouve avec divers farmers (propriétaires cultivateurs) qui parlent de leurs affaires. Ils viennent d'amener à Woodland une quantité de moutons. Une nouvelle usine à congélation y a été établie, et je vois à ses abords de nombreux troupeaux qui attendent leur tour. Malgré la cherté du fret, qui, avec le prix de la congélation, revient à 4 pence (0 fr. 40 la livre), il reste encore environ 2 pence ou 0 fr. 20 la livre au farmer; il s'en réjouit parce qu'il a en sus la peau et le suif, et qu'avant cette invention il n'avait que le suif. Les rognons ne peuvent se conserver par la congélation, et on les met en boîtes suivant l'ancien procédé. À 0 fr. 20 la livre, un mouton donne encore souvent 25 fr. au fermier. Ces messieurs se plaignent de la cherté de la main-d'œuvre. Un ouvrier de ferme reçoit (p. 342) 60 l. stg. (1,500 fr.) par an, logé et nourri, et travaille le moins qu'il peut. Si son voisin lui offre quelques schellings de plus, il change de maître; mais ils n'ajoutent pas qu'eux en font précisément autant lorsque la main-d'œuvre abonde. La fameuse loi de l'offre et de la demande a été inventée par les économistes anglais, et ce sont eux aussi qui ont trouvé la théorie que le travail est une marchandise. Ils sont donc malvenus à se plaindre si, lorsqu'elle est rare, elle augmente de prix.
Mais nous voici à Invercagill vers 8 heures du soir. À l'église catholique on prépare les chants des prochaines fêtes de Noël. J'entends l'exécution de la messe de Palestrina habituelle au Vatican et à Saint-Pierre. Les voix d'eunuques sont avantageusement remplacées par celles de femmes. En Angleterre et en Amérique, cette musique classique des basiliques de Rome est la musique ordinaire, et je regrette qu'elle ne se généralise pas chez nous; elle a des notes admirables qui pénètrent l'âme.
Au presbytère, un bon prêtre irlandais est occupé à écrire un article à un journal qui vient d'attaquer la France. Nature ouverte et confiante comme le Français, l'Irlandais est bientôt avec lui à son aise, nous causons sur les choses du pays et sur celles de l'Europe. Ces bons Pères voudraient bien avoir ici une Conférence de Saint-Vincent de Paul, mais les pauvres manquent. Ils disent qu'il n'y a qu'un seul pauvre en Nouvelle-Zélande et qu'on n'a jamais pu le trouver. Je réponds qu'il reste les (p. 343) prisons et les hôpitaux à visiter, et les enfants à instruire le dimanche.
Le 7 décembre, de bon matin, je parcours la jeune ville d'Invercargill. Elle contient environ 8,000 âmes, y compris les faubourgs. Deux grandes avenues de 40 mètres de large se coupent à angle droit et s'étendent sur plusieurs milles, les autres rues ont 20 mètres de largeur. D'après le tracé, la ville peut aisément contenir plusieurs centaines de mille âmes. Pour le moment, la plupart des carrés destinés aux futures constructions sont des jardins ou des prairies, mais plus tard on trouvera la régularité et l'aisance sans encourir les fortes dépenses qu'exigent les démolitions et rectifications. C'est le système américain, sagement prévoyant.
Les églises, les banques et les hôtels occupent la plus grande partie de la ville. Il y a 5 ou 6 banques, 7 à 8 églises, et 15 à 20 hôtels. La plupart de ces constructions sont en pierre ou en béton, et c'est là de l'économie bien entendue, car la maison de bois, si elle coûte moins cher, exige plus d'entretien, une plus forte prime d'assurance, dure moins, et est souvent la proie des flammes.
Les montagnes environnantes ont leur cime blanchie de neige. Hier, il nous semblait être en Écosse, la pluie, la grêle, le soleil, alternaient sans cesse; mais il ne faut pas que je médise trop du climat, j'ai trouvé ici les premières cerises.
À l'Athenœum je vois une belle bibliothèque, une salle de lecture pour les hommes, une pour les femmes, et un (p. 344) commencement de musée. Les 400 abonnés paient 1 l. stg. (25 fr.) l'an.
Le directeur de la prison veut bien me faire visiter son établissement; il occupe le milieu d'une vaste cour entourée de murs. Les prisonniers sont d'un côté, les prisonnières de l'autre, avec séparation complète. Chaque prisonnier a sa petite cellule pour la nuit; le jour il travaille à la chaussée des chemins ou à d'autres travaux communaux. Sa santé s'en trouve mieux, la moralité y gagne et la caisse municipale aussi. Ce système devrait être adopté partout; le mélange des prisonniers finit de gâter ceux qui ne sont pas entièrement mauvais; et le prisonnier qui ne travaille pas s'ennuie et se déprave.
La paresse est même un appât pour quelques-uns qui se trouvent heureux d'être ainsi sans rien faire, nourris aux frais du public. Parmi les cellules, j'en remarque une dont les parois sont entièrement rembourrées; elle est destinée aux fous. Le directeur me dit qu'il en reçoit en moyenne un par semaine. La plupart sont des bergers; ils restent des semaines et des mois en face de leurs brebis, sans voir personne, ils lisent et relisent livres et journaux, et en perdent souvent la raison. L'homme n'est pas fait pour vivre seul! Une autre source de folie est l'alcoolisme. Un pays où la vigne pousse peut toujours s'en débarrasser en favorisant cette culture. Le jour où l'ouvrier aura à tous ses repas sa demi-bouteille de vin à 5 sous, il ne sentira plus le besoin de s'enivrer.
À 11 heures je suis à la gare, j'y rencontre 4 Hindous (p. 345) avec leurs toges et leurs turbans. Un d'eux, avec une belle toge rouge doublée de pelisse, est un respectable vieillard à barbe blanche et à longue chevelure: c'est un docteur de Bombay; les autres sont de Lahore en Punjab. Ils sont venus visiter le pays, mais ils s'empressent de le quitter, ils le trouvent trop froid et lui préfèrent les plaines plus chaudes de l'Australie. En ce moment, ils se rendent à l'exposition internationale de Calcutta organisée par le gouvernement des Indes sous la direction d'un Français, M. Joubert, qui a parfaitement réussi.
Dans le train, je retrouve encore la famille de Tasmanie qui revient du lac Wakatipu, et rentre chez elle.
La locomotive nous emporte à travers plaines et collines, prairies et forêts, et à midi 1/4 nous sommes à Bluff, où le Manipoori, steamer de 2,000 tonnes, chauffe pour nous passer en Tasmanie. Je m'installe dans ma cabine et j'écris ces pages sur la table du Smoking room (salle à fumer).
À 6 heures du soir le navire lève l'ancre et il passe entre les rochers rapprochés qui enserrent la baie, et bientôt après il est dans le détroit de Fovean, qui sépare l'île Sud de l'île Stevart. Il n'y a qu'environ 300 pêcheurs sur cette île. Le soleil couchant l'illumine de ses derniers rayons de feu et je suis longtemps de l'œil ces côtes qui s'éloignent, en repassant dans mon esprit tout ce que j'ai vu. Il y a 40 ans, il n'y avait en Nouvelle-Zélande que 100,000 sauvages, occupés à se faire la guerre de tribu à tribu; aujourd'hui 517,000 habitants, dont plus de la moitié (p. 346) nés dans le pays; 165 villes et villages, dont quelques-uns avec 30 et 40,000 âmes; le pays sillonné de routes et de chemins de fer, avec postes, télégraphe, banques, caisses d'épargne, assistance publique et toutes les institutions des peuples les plus civilisés. Comment un si grand résultat a-t-il pu être obtenu en si peu de temps? Les observateurs ne peuvent se passer d'en chercher les raisons. L'Angleterre, instruite par la triste expérience du siècle dernier avec l'Amérique du Nord, a laissé à ses colonies de l'Océanie la pleine et entière liberté de choisir leur constitution. Le peuple qui est arrivé ici était formé en grande partie de cadets de vieilles familles anglaises où le respect à l'autorité et l'attachement à la religion sont en honneur. La famille est fortement constituée et la transmission intégrale du foyer en assure la perpétuité. Le pays se gouverne par lui-même, et il est capable de ce gouvernement parce que les citoyens ne restent pas étrangers à la chose publique. L'autorité est autrement comprise ici que dans d'autres vieux pays de l'Europe. Tout en la respectant religieusement, les citoyens contrôlent avec rigueur ceux qui en sont investis, les dénoncent par la presse, et ceux-ci ne sont pas longtemps soufferts dès qu'ils manquent à leur devoir; les abus ne sauraient ainsi se prolonger. Peu faiseurs de théories, mais très pratiques, les hommes de ces pays nouveaux essaient timidement les divers systèmes, les acceptent ou les répudient selon les résultats. Il est bien vrai que certaines doctrines subversives commencent à (p. 347) se faire jour, et on parle dans certains journaux de nationalisation de la terre. Certes, empêcher que la terre ne devienne le monopole de compagnies puissantes, ou tombe aux mains de quelques familles, c'est juste et légitime; mais aller dans l'extrême opposé serait entrer dans la période de souffrance. Heureusement on sait combattre dans ce pays; et à peine cette théorie a paru qu'elle a été démolie par la presse, les réunions et les associations. Qu'on le veuille ou non, la vie est une lutte entre le bien et le mal, et ces pays seuls trouvent une paix relative où les bons, comprenant leur devoir, agissent sans relâche pour refouler le mal et faire triompher le bien.
Nous avons 930 milles entre Bluff et Hobart en Tasmanie; le navire les franchira en trois jours. Aujourd'hui la mer est tranquille et la navigation sans accidents. C'est le 8 décembre, grande fête pour les catholiques. J'ai pour temple l'Océan et la voûte du ciel!
Je partage ma cabine avec un ingénieur, propriétaire d'une usine à gaz, près Dunedin. Il me dit que le charbon de la côte ouest de la Nouvelle-Zélande est le meilleur charbon du monde. Une tonne produit 10,700 pieds cubes de gaz et 1,486 livres de coke; et la force éclairante est de 18 bougies par 5 pieds cubes; le prix du gaz en Nouvelle-Zélande varie de 10 à 12 schellings les mille pieds cubes.
Le 9 décembre, dimanche, à 10 heures 1/2, la cloche appelle les passagers au salon: ils s'y rendent tous, au (p. 348) nombre de 40 environ. Le capitaine entonne un chant, puis récite les prières; ensuite il lit le chapitre lv d'Isaïe et le chapitre lvi des Actes des apôtres. On récite des psaumes et le Te Deum, et on finit par un cantique. Jeunes et vieux, hommes et femmes sont recueillis et pénétrés du désir d'invoquer Dieu, de le remercier et de lui rendre gloire.
La navigation continue paisible; quelques oiseaux voltigent autour du navire. Le soir, après le dîner, à 7 heures 1/2, second service en tout semblable à celui du matin.
10 décembre.—La nuit a été affreuse, un vent du sud prend le navire en travers et le balance horriblement; la plupart des passagers sont souffrants. Vers minuit nous espérons arriver à Hobart.[Table des matières]
Tasmanie.
Le naufrage du Tasman. — Le tremblement de terre des îles de la Sonde et les phénomènes qui en résultent. — Arrivée à Hobart. — La ville. — Les environs. — Cascade-hill. — Une brasserie. — Mgr Murphy et le Père Beechenor. — Les Sœurs de la Présentation. — Une tombe française. — Population catholique. — Le musée. — Queen's dominion. — Le lawn-tennis. — De Hobart à Lanceston. — Les fonderies d'étain. — Les mines de Mount-bischoff. — Les écoles. — Un tremblement de terre. — Le clergé irlandais et les fidèles. — La Salvation army. — La Tasmanie. — Situation. — Histoire. — Surface. — Population. — Climat. — Constitution. — Produits. — Importation. — Exportation. — Banques. — Système agraire. — Immigration. — Bétail. — Chemin de fer. — Poste. — Télégraphe. — Instruction publique. — Revenu. — Dette. — Les indigènes. — Épisodes et extinction.
Le 10 décembre, vers 6 heures du soir, nous apercevons l'île Maria, et nous nous dirigeons vers le cap Pilar. Sur les 8 heures nous laissons à gauche l'île South Bruni et entrons dans la Storm-bay. Il y a quelques jours, le Tasman, steamer de la Tasmanian steam navigation Company, y a coulé à pic, brisé par un rocher: les passagers et les matelots se sont sauvés sur les chaloupes.
À 9 heures, le soleil couchant met le ciel en feu; on dirait une aurore boréale. Le même phénomène se produit en Australie: les savants pensent que c'est encore le résultat du bouleversement occasionné par le terrible (p. 350) tremblement de terre qui a eu lieu il y a quelques mois dans les îles de la Sonde.
À droite et à gauche, les rochers à pic ont un aspect sévère et triste. À 10 heures nous quittons la haute mer pour entrer dans la rivière Derwent, et à 11 heures le navire jette l'ancre devant Hobart. Il est trop tard pour se rendre à terre, je dors dans ma cabine.
Hobart, capitale de l'île et colonie de Tasmanie, compte environ 20,000 habitants. Ses rues sont larges et grimpent ou contournent les collines. La partie réservée aux affaires a de superbes édifices en pierre: le palais de ville, la poste, le musée, et divers établissements de banque sont de petits monuments. Les églises sont nombreuses et quelques-unes fort jolies.
Une magnifique statue de John Franklin, qui a été gouverneur de la colonie en 1840, et qui s'est perdu ensuite à la recherche du pôle nord, orne le milieu d'un joli square au centre de la ville. Ce qui forme le charme principal, c'est l'éparpillement des cottages sur les collines, et les belles forêts d'eucalyptus qui couvrent les monts environnants, et surtout le mont Wellington, qui les domine tous.
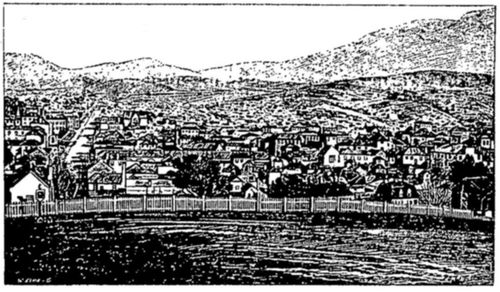
Tasmanie.—Hobart, capitale de la colonie.
Hobart est à cette partie de l'hémisphère sud, ce que Nice et Cannes sont pour notre vieux continent; les médecins y envoient les malades de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, et même des Indes et de l'Angleterre. Le climat est tonique et tempéré, la nature riante. Les environs sont gracieux et les jardins en fleur; le blé mûrit, (p. 351) le foin est coupé, les fèves montrent leurs premières gousses, les cerisiers leur fruit rouge, les figuiers, les poiriers, les vignes, les boutons de leurs fruits. Décembre correspond au mois de juin de chez nous; c'est bien là la végétation de notre mois de juin dans le midi de la France. À une lieue de la ville, à Cascade-hill, je trouve une immense brasserie; le directeur me la fait visiter en m'expliquant les diverses opérations dans les nombreux étages où nous montons par l'ascenseur. Il me fait goûter la bière: on en fait 300 gallons par jour (le gallon est d'environ 4 litres 1/2), et de deux sortes; la bière genre allemand, qu'on vend 1 schelling le gallon, et la bière anglaise, plus forte, qu'on vend 3 schellings le gallon, ou 8 schellings les 12 bouteilles. Je poursuis ma course dans les vallons et à travers les forêts; les hirondelles courent après l'insecte; un gentil petit oiseau à queue rouge ne (p. 352) s'effraie pas du promeneur, le torrent murmure à l'ombre des mimosas en fleur; c'est ravissant, je m'assieds sur l'herbe et je rêve un instant au bonheur.
À mon retour, je traverse de belles prairies en colline, où paissent les vaches, les chevaux et les brebis; je vois de grandes plantations de houblon et de framboises; je laisse à gauche une ancienne scierie, transformée en hôpital des fous, et je rentre en ville rendre visite à l'évêque de Tasmanie.
Mgr Murphy, vénérable vieillard qui a été pendant 25 ans évêque à Hyderabad dans l'Hindoustan, m'accueille avec une bonté paternelle, et apprenant que je m'occupe d'œuvres charitables, me dit: Restez ici, vous dînerez avec moi, et je vous mettrai en relation avec le P. Beechenor, doyen de Lanceston, qui vient d'arriver, il est lui aussi homme d'action, et vous vous entendrez facilement. À l'heure le dîner est servi. Je suis content de causer en italien avec le bon P. Beechenor, élève du collège de Propaganda fide, à Rome.
Sur les 115,000 habitants que compte l'île de Tasmanie, 25,000 sont catholiques et presque tous: Irlandais: il y en a 5,000 à Hobart: Le Père me fait visiter la cathédrale, qu'il a construite pendant qu'il était curé ici; c'est un beau et vaste édifice gothique en pierre; la voûte est en bois, les tours sont encore à construire. À côté de la cathédrale, nous visitons le couvent des Sœurs de la Présentation de Cork en Irlande.
La Mère Maria Francesca Xavier Murphy, sœur de l'évêque, (p. 353) les a conduites ici, et à l'heure actuelle elles ont 3 écoles à Lanceston, 6 à Hobart et un grand nombre en d'autres stations de l'île. Une croix de marbre blanc dans le petit cimetière des Sœurs, à côté de la cathédrale, marque l'endroit où repose la dépouille mortelle de la Mère Xavier Murphy. De sa tombe elle encourage encore ses compagnes par le souvenir de ses vertus. Le couvent est au centre d'un gracieux jardin, les Sœurs y instruisent 25 pensionnaires et 200 externes. Elles réunissent les grandes élèves et me prient de leur faire subir l'examen de lecture en langue française; le gouverneur, qui doit assister à leur grand examen, aime qu'elles aient une bonne prononciation. Le P. Beechenor me conduit à l'ancien cimetière catholique, au-dessus du palais épiscopal. Aujourd'hui un nouveau cimetière hors la ville réunit dans des compartiments séparés les morts de toutes les communautés. Au milieu des monuments funéraires, le Père me fait remarquer une pierre sur laquelle je lis ces paroles: «Expédition autour du monde. Corvettes l'Astrolabe et la Zélée. À la mémoire de Coupil (Ernest-Auguste), dessinateur; Couteleng (Jean-Marie-Antoine), charpentier; Archier (Honoré-Antoine-Étienne), 2e maître de manœuvre; Bernard (Pierre-Léon), matelot de 2e classe; Baudoin (Jean-Baptiste-Désiré), matelot de 3e classe; Daniel (Alexandre), matelot, décédés à Hobart-Town, janvier, février, mars, 1840. Hommage d'un prince marin comme eux qui a voulu sauver de l'oubli les noms de ses compatriotes morts dans l'accomplissement d'une (p. 354) mission glorieuse pour la France, septembre 1866. Finistère, février. 1881.»
Cette inscription, placée sur une table: de bois par le fils du prince de Joinville, à son passage ici en 1866, fut renouvelée, sur pierre en 1881, par les soins du capitaine du navire de guerre le Finistère.
Bonne et patriotique pensée, celle de relever aux yeux de la postérité l'honneur de ceux qui ont bien servi le pays!
En fait d'écoles de garçons, il n'y a à Hobart qu'une école dirigée par deux laïques et fréquentée par 55 élèves. Il serait pourtant utile d'aboutir à un petit et grand séminaire pour le recrutement du clergé: toutefois, quelques-uns pensent qu'il est encore préférable pour le moment d'envoyer le clergé d'Irlande, où il se recrute dans les meilleures classes de la société. Il y a 18 prêtres, pour le diocèse de Tasmanie. Les Sœurs de la Présentation ont encore en ville un orphelinat, avec 35 élèves: la moitié sont pensionnées par le gouvernement. Elles apprennent à tenir une maison, et à 18 ans elles se placent ou se marient.

Tasmanie.—Forêt d'eucalyptus.
Dans ma visite au Musée, je remarque une belle collection, d'objets ethnographiques appartenant à la race des indigènes de Tasmanie et des habitants des diverses autres îles de l'Océanie. Une voiture nous conduit à la belle promenade de Queen's-Dominion. Elle contourne une colline boisée d'eucalyptus. On voit au loin le Betlehem-Wall, rocher abrupte en forme de fer à cheval et (p. 355) qu'on prendrait pour le fameux roc de Saint-Jeannet, sur le Var. Ici, les jeunes gens jouent leur partie de lawn-tennis; plus loin ce sont les hommes puis les demoiselles; le plus souvent, jeunes gens et jeunes filles font la partie ensemble. Il n'y a pas ici sur ce point la même rigueur que dans notre pays, mais la tenue est convenable et digne; le moindre badinage inconvenant serait une cause d'exclusion immédiate. Il est aussi d'usage dans ce pays que les jeunes gens et les jeunes filles avec leurs parents fassent de fréquents pique-nique à la campagne; la jeunesse a par là occasion de se voir et de se connaître, et moins que chez nous le mariage est une loterie.
La maison du gouverneur ressemble à un château d'Écosse. Vient ensuite le jardin botanique, qui étage ses buissons de fleurs sur la rive du Derwent; et continuant à contourner la colline, je rentre en ville par les faubourgs qui s'étendent au loin.
Ma soirée se passe à lire les journaux du pays et à causer avec un Américain, en tournée de placement de marbre du Vermont sur l'Atlantique; il en vend partout au prix de 2 dollars 1/2 jusqu'à 40 dollars le pied cube. Pourquoi les Italiens ne viennent-ils pas placer ici leur marbre de Carrare, bien supérieur?
Le lendemain, à 5 heures du matin, j'écris mon journal, et à 8 heures je suis à la gare, en route pour Lanceston. La distance est de 133 milles, et la voie traverse l'île du sud au nord. Les rails sont espacés à 3 pieds 1/2; les (p. 356) wagons ont leurs bancs sur les côtés. Nous suivons d'abord la rivière Derwent pendant plusieurs milles; ses tours et détours multiples sont fort gracieux; de pittoresques presqu'îles s'y dessinent sous toutes les formes. Les vertes prairies alternent avec les mimosas ou des champs d'églantiers en fleurs. À droite et à gauche la double chaîne de montagnes qui traversent l'île laisse voir leurs rochers, tantôt à pic, tantôt boisés. Plus loin, nous traversons la rivière sur un long pont de bois et nous pénétrons dans la forêt d'eucalyptus. Nous contournons des vallons par des courbes serrées, grimpons des collines pour les redescendre; nous sommes dans un labyrinthe ravissant. Par-ci, par-là, la cabane de quelque pionnier; les cantonniers aussi brûlent une partie de la forêt et sèment leur blé. Us remplacent la fougère et l'herbe dure indigène par la belle herbe européenne que broutent les moutons. Enfin, après un long tunnel nous entrons dans une région plus plate; le terrain est encore ondulé, les moutons et les bœufs paissent sur les verts mamelons, mais plus loin le bassin s'élargit et s'aplatit. Les gares sont des cabanes couvertes en lames de bois. Quelques stations portent le nom de Jéricho, Jérusalem et autres lieux de Palestine; les villages ont parfois à peine quelques maisonnettes à côté de la modeste maison d'école en planches. Les amateurs de paysage seraient ici contents. Les fermes deviennent plus nombreuses, puis nous apercevons les maisons de campagne, qui indiquent l'approche d'une ville; à (p. 357) 1 heure 3/4 nous sommes à Lanceston, capitale du Nord.

Tasmanie.—Forêt d'eucalyptus à Cora Fine River, sur le chemin de fer d'Hobart à Lanceston.
Elle compte 12,000 habitants: ses rues ont 15 mètres de large et s'étendent en plaine sur les bords de la rivière Tamar; les collines environnantes sont couvertes d'eucalyptus et parsemées de gracieux cottages. Un joli square au centre de la ville est orné d'une belle fontaine en bronze; les bébés y jouent à loisir sur la verte pelouse.
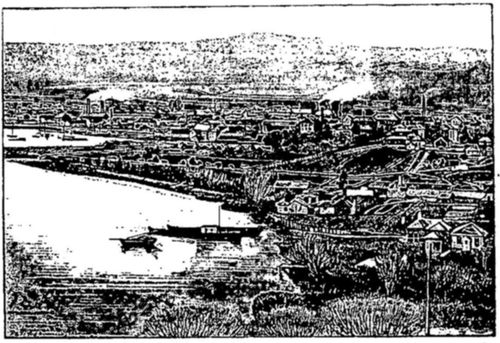
Tasmanie.—Ville et Port de Lanceston.
C'est à Lanceston qu'on fond l'étain des fameux dépôts d'alluvion du Mount-Bischoff. Ils furent découverts par le colon James Smith, et une compagnie fut formée en 1873 au capital de 60,000 liv. stg. en 12,000 actions de 5 l. stg. Le tiers des actions a été libéré, les deux autres tiers ne sont libérés que d'une l. stg., et pourtant ces actions sont maintenant cotées à 60 l. stg. chaque. À la fin décembre 1882, la quantité d'étain retirée s'élevait à (p. 358) 15,604 tonnes, vendues à Londres au prix d'environ 85 l. stg. la tonne. La fonderie que je visite à Lanceston comprend plusieurs fours de fonte et divers chaudrons de raffinage. Neuf heures suffisent à la fonte du minerai; le charbon est tiré de New-Castle (Australie); l'opération du raffinage demande 5 heures. On raffine en ce moment environ 250 tonnes par mois, et le minerai donne une moyenne de 73% d'étain pur. Plus loin, je visite une autre fonderie où les propriétaires de diverses mines et dépôts d'alluvion viennent fondre leur minerai moyennant un certain prix.
Je voulais voir les mines d'or de Beaconfield, sur le Tamar, à quelques lieues de Lanceston. Un petit navire y conduit tous les matins, mais le steamer qui va à Melbourne ne s'y arrête pas pour prendre les voyageurs, et je ne pouvais retourner à temps pour l'atteindre à Lanceston. Je passe donc une partie de la journée à rédiger mon journal, et rends visite au P. Gleeson, curé de cette ville. Il me conduit aux écoles; les Sœurs instruisent 200 élèves; les garçons ont pour maîtres 2 laïques et ne sont que 70. Le bon Père m'invite à dîner, et pendant le repas, la maison se met à danser comme un navire sur l'eau; c'est un tremblement de terre. Le Père me fait remarquer que tout le mortier du plafond a été enlevé pour éviter de le recevoir sur le nez. Ces tremblements sont si fréquents que le Père, par précaution, dort dans le jardin, sous les planches légères d'une petite cabane. Il me raconte qu'il a fait durant la semaine 115 lieues à (p. 359) cheval pour visiter les nombreuses familles des campagnes, entendre les confessions, faire le catéchisme, etc. Le clergé est rétribué par les familles et les entoure du plus grand soin; à leur tour, les familles tiennent à ce que leur curé aie le nécessaire, et il en résulte une union et une solidarité fécondes en bons résultats. Voyez, me dit le bon Père, que je ne manque de rien; je suis dans une aisance convenable; j'ai mon cheval et ma voiture, et il me reste toujours assez pour faire des aumônes.
En rentrant, j'entends une fanfare avec tambour et grosse caisse. Des curieux la suivent, et je fais comme eux. On parcourt plusieurs rues et on arrive à une grande salle en planches pouvant contenir 2,000 personnes. Bientôt, elle se remplit et la représentation commence. C'est la Salvation army (armée du salut).
Les chefs ont une espèce d'uniforme militaire. On commence par un chant rapide dont le refrain revient après chaque couplet:
The Lamb, the Lamb, the bleeding Lamb
I love the sound of Jesus' name
It sets my spirit all in flame
Glory to the bleeding Lamb.
L'Agneau, l'Agneau, l'Agneau sanglant!
J'aime le son du nom de Jésus;
Il met mon esprit en flamme.
Gloire à l'Agneau sanglant!
Le chef récite ensuite le Pater d'un ton solennel, et lit le chapitre de l'Évangile de saint Marc relatif à l'aveugle de Jéricho; puis il le commente d'une manière fort pratique: (p. 360) «Pécheurs, ouvrez les yeux, le Seigneur vous appelle, quittez la voie du mal, rentrez dans le chemin des élus; ivrognes, revenez à la tempérance; impudiques à la pureté; ennemis, réconciliez-vous; vous êtes faits pour le bonheur, le bonheur n'est que dans la vertu.» Pendant qu'il parle, un jeune homme crie de temps en temps: Alleluia! probablement pour exciter l'attention. Le public commence par rire, puis il écoute et s'émeut.
Les chants recommencent:
Jesus, the name high over all
In hell, or earth, or sky;
Angels and men before Thee fall
And devils fear and fly.
Jésus, nom au-dessus de tout,
Dans les enfers, sur la terre et au ciel,
Les anges et les hommes devant Toi se prosternent,
Les démons craignent et s'enfuient.
Un jeune homme bat la mesure en agitant une écharpe; quelques chanteurs la marquent avec leurs bras. Vient ensuite la confession publique. Un monsieur s'avance et déclare que depuis 25 ans il s'était éloigné du bien, lorsque l'armée du salut l'a ramené sur le chemin de la vertu. Sa maison était un enfer; il arrivait ivre, battait sa femme et ses enfants; maintenant, il a quitté l'ivrognerie, et sa maison a retrouvé la paix et la joie des justes: il engage le public à s'enrôler dans l'armée du salut. Un vieillard à barbe blanche lui succède; il raconte sa misérable existence et sa conversion par l'armée du salut; et ainsi de suite plusieurs viennent confesser (p. 361) leurs péchés. Arrive aussi le tour des femmes et des jeunes filles; elles sont plus timides; quelques-unes hésitent, mais finissent toutes par confesser qu'elles étaient malheureuses loin du droit sentier, et que l'armée du salut leur a redonné le bonheur en les ramenant à Dieu et à sa loi. La jeune femme du chef, vêtue de noir, semble plus fortement convaincue. Dans un speech émouvant, elle parle de la brièveté de la vie, de l'heure incertaine de la mort; adresse un pressant appel à la jeunesse, puis elle entonne un cantique de repentir et de componction. Plusieurs s'inscrivent et montent sur l'estrade à côté des anciens. Après une quête et la prière du soir, l'assemblée se disperse. Le tout présente un ensemble moitié sérieux, moitié comique, et on se demande lequel des deux prendra le dessus? Plusieurs pensent que cette manière de parodier la prédication ne peut que faire tort aux prédicateurs de l'Évangile; d'autres affirment que les intentions des adeptes étant droites, il est probable qu'ils sont agréables à Dieu. Ils ajoutent que, devant juger l'arbre par le fruit, on ne peut le trouver mauvais, puisque les adeptes gardent les commandements, et qu'à leur appel bon nombre de pécheurs quittent leur mauvaise voie. On pourrait dire ce que Nicodème disait au Conseil des anciens: «Laissez-les faire, car leur œuvre est de Dieu ou des hommes; si elle est des hommes, elle s'éteindra d'elle-même sous le mépris public.»
Les Apôtres aussi vinrent un jour au Seigneur et lui dirent: «Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les (p. 362) démons en votre nom, et qui ne nous suit pas, et nous l'en avons empêché. Mais Jésus leur répondit: Ne l'en empêchez point; car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom et qui puisse incontinent mal parler de moi; car, qui n'est pas contre vous est pour vous (Marc, IX, 37).»

Tasmanie.—Town Park à Lanceston.
Je vois par les journaux qu'à la suite de ces prédications un si grand nombre de filles perdues sont venues à repentance que l'armée du salut, aidée par des dames charitables, a loué à Lanceston une maison pour les recevoir et les occuper à un travail utile. Elle en a fait de même à Melbourne, où elle a d'abord loué puis acheté deux maisons dans les faubourgs pour y recueillir les Madeleines.
En ville je demande à l'hôtel, dans les magasins, aux personnes du peuple, ce qu'ils pensent de l'armée du salut: (p. 363) It is a little funny (c'est un peu burlesque) dit-on généralement, mais il y a du bon. On dit des choses justes, et plusieurs en sont frappés et se corrigent.
Je vois partout des gens portant ostensiblement à la boutonnière un ruban bleu; c'est la confrérie du blue ribbon. Comme les Nazaréens, ils prennent l'engagement de ne jamais rien boire de ce qui peut enivrer: ils sont déjà plus de 20,000.
Avant de quitter la Tasmanie, il est bon de dire ce qu'a été et ce qu'est cette colonie.
L'île de Tasmanie est située entre le 40° 15' et 43° 45' latitude sud; et entre le 144° 45' et le 148° 30' longitude est. Elle est séparée de l'Australie par le détroit de Bass, large de 120 milles. Le Pacifique la baigne à l'Est et l'océan Indien à l'ouest. Tasman, navigateur hollandais, qui la découvrit, l'appela d'abord Terre de Van Diémen, du nom du gouverneur de Batavia; au XVIIe siècle; plus tard, avec plus de justice, elle fut appelée du nom de son inventeur, Tasmania. Sa plus grande longueur est de 230 milles et sa plus grande largeur de 190. Sa surface est de 24,000 milles carrés, soit 4,000 milles carrés de moins que l'Irlande. Elle compte plus de 16,000,000 d'acres ou arpents. L'île est montagneuse; quelques pics atteignent jusqu'à 2,000 mètres. Elle a plusieurs lacs sur les hauts plateaux d'où coulent ses rivières. Les principales sont le Derwent, sur lequel se trouve Hobart, la capitale. Son estuaire forme un des plus beaux ports de l'hémisphère sud; vient ensuite dans le nord la rivière Tamar, sur laquelle (p. 364) se trouve Lanceston; elle a 45 milles de long. Le Davey et le Huon dans le sud sont aussi navigables, et dans le détroit de Bass seulement, se déversent 16 rivières; 55 îles entourent la Tasmanie et font partie de la colonie; elles sont surtout habitées par des métis qui vivent de la pêche de la baleine. L'île est divisée en 16 comtés et en 32 districts électoraux; elle a 21 municipalités élues.

Tasmanie.—Fougères arborescentes.
Le climat est très sain, la mortalité n'est que de 14 par 1,000. La moyenne barométrique de ces trente-cinq dernières années a été de 29,821 et la moyenne thermométrique de 55,41 Farenheit; la moyenne des jours de pluie 12, et la moyenne d'eau 2 pouces. Les vents dominants sont le nord-est et le sud-ouest, avec une force moyenne de 64 liv. par pied carré. L'hiver, la neige couvre ordinairement ses montagnes.
(p. 365) La colonie de Tasmanie, comme celle de la Nouvelle-Galle du sud et du Queensland, a commencé par les convicts. Les premiers criminels y arrivèrent de Sydney en 1803 avec le capitaine Bowen, qui s'établit à Risdon, sur le Derwent, un peu au-dessus du lieu où s'élève aujourd'hui la ville de Hobart. La population, au 31 décembre 1882, comptait 122,500 habitants, sur lesquels 64% savent lire et écrire, et 8% lire seulement.
Le gouvernement est constitutionnel. Un gouverneur, nommé par la reine, reçoit de la colonie 3,500. l. stg. l'an, plus 1,000 l. stg. pour frais de représentation. Le Conseil exécutif comprend les ministres de la Couronne, passés et présents: ils ont le titre d'honourable. Le cabinet comprend quatre ministres salariés; les deux chambres sont électives; elles s'appellent le Conseil législatif et l'Assemblée. Le Conseil législatif est composé de 16 membres, qui sont élus pour 6 ans; ils doivent être nationaux ou naturalisés, et avoir 30 ans d'âge. Les électeurs du Conseil législatif doivent être nationaux ou naturalisés, avoir 21 ans, et posséder une propriété d'un revenu de 750 fr. l'an, ou payer un loyer de 5,000 fr. pendant au moins cinq ans. Sont aussi électeurs les avocats, avoués, médecins, officiers de terre et de mer en retraite, et les ministres du culte en fonction.
L'Assemblée est composée de 32 membres, élus pour cinq ans; ils doivent avoir 21 ans, être nationaux ou naturalisés. Les électeurs de l'Assemblée doivent avoir 21 ans, être nationaux ou naturalisés, posséder une propriété (p. 366) de la valeur de 1,250 fr. ou occuper une maison rapportant 175 fr. l'an, ou payer un loyer 175 fr. l'an, ou gagner un salaire de 2,000 fr. l'an qui ne soit pas payé par semaine, ou avoir une profession libérale ou être officier de l'armée ou de la marine en retraite.
Les électeurs inscrits pour le Conseil législatif sont au nombre de 3,380; ceux inscrits pour l'Assemblée sont 16,420.
Les principaux produits sont l'étain, l'or, la laine, le blé, l'avoine, l'orge, les pommes de terre, les bois de construction, le houblon, les fruits et conserves de fruits, l'huile de baleine, etc.
L'étain et l'or exportés dans les cinq dernières années atteignent 2,278,625 l. stg., et la laine 2,449,921 l. stg. L'extension que prend l'industrie minière, où les ouvriers sont payés 10 à 12 schellings par jour, a fait un peu délaisser l'agriculture. Néanmoins, elle fournit encore aux besoins de la colonie, et a exporté l'an dernier pour 23,726 l. stg. Le bois de construction exporté en 1881 atteint la valeur de 56,605 l. stg; 668,846 livres de houblon ont été récoltées en 1881, et on en a exporté pour 23,663 l. stg. Les conserves de fruits exportées en 1881 atteignent la valeur de 194,566 l. stg. Dans la même année, dix navires, occupés à la pêche de la baleine, ont rapporté 316 tonnes d'huile, évaluées à 22,120 l. stg. La Tasmanie possède aussi du charbon, du shale ou charbon à pétrole, des pierres de construction, des ardoises, des marbres, de la terre glaise, du fer, du sable à verre, du plomb argentifère. (p. 367) L'industrie comprend des brasseries, des briqueteries, fabriques de souliers, pulvérisation des os, fabriques de chandelles, de savons, de voitures, d'habits, de fromages, tanneries, teintureries, chapelleries, poteries, scieries, imprimeries, fonderies, filatures de laine. Le gouvernement donne des prix pour l'encouragement et la diffusion de l'industrie. L'importation pour 1881 a atteint 1,431,444 l. stg., et l'exportation 1,555,576 l. stg. Dans la même année, 694 navires, avec un tonnage de 192,024 tonnes, sont entrés dans les ports de la Tasmanie.
Il y a 5 banques dans la colonie. Le revenu de la propriété urbaine et rurale est estimé à 714,112 l. stg.; l'accroissement annuel est d'environ 19%.
Pour utiliser les terres de la Couronne, on a adopté le système de sélection. Chaque sélecteur peut choisir 320 acres de terre au prix de 1 l. stg. l'acre, payable en 14 ans. S'il se libère d'avance, on lui tient compte de l'intérêt à 5% l'an. Le sélecteur est tenu d'occuper la terre personnellement ou par représentant jusqu'à complet paiement.
Le gouvernement favorise l'immigration de plusieurs manières. Chaque résident en Tasmanie a le droit de désigner tous les ans 20 adultes qu'il désire amener dans la colonie en payant le prix du passage fixé à 125 fr. pour chaque homme, à 75 fr. pour chaque femme, et à 150 fr. pour chaque couple marié. Ces immigrants doivent être sains de corps et d'esprit, ne pas dépasser (p. 368) 40 ans, ou 45 s'ils sont mariés, et appartenir aux classes d'agriculteurs, ouvriers ou domestiques. Les enfants accompagnant leurs parents, et au-dessous de 3 ans, ne paient aucun droit de passage. Ceux entre 3 et 12 paient moitié prix; au-dessus de 12 ans ils paient comme les adultes. Ces immigrants doivent être examinés et approuvés par l'agent d'immigration à Londres.
L'immigrant ainsi importé s'oblige à rester 4 ans au moins dans la colonie, et s'il quitte avant, il doit payer au bureau d'immigration le 1/4, la 1/2, le 1/3, ou tout le prix de passage, fixé à 18 l. stg., selon qu'il quitte la 1re, 2e, 3e ou 4e année.
Les immigrants qui arrivent à leurs frais ont droit de demander une surface de terre de la valeur de 18 l. stg. pour chaque personne au-dessus de 15 ans, et de la valeur de 9 l. stg. pour chaque enfant.
Tout immigrant venu en 1re ou 2e classe a droit de choisir gratuitement dans l'année 30 acres de terre pour lui, 20 pour sa femme, et 10 pour chaque enfant. Après 5 ans de séjour, l'immigrant reçoit le titre de propriété, et, s'il meurt avant, son droit passe aux héritiers, pourvu que sur la terre on ait fait des améliorations correspondant à 1 l. stg. par acre.
En 1882, il y avait en Tasmanie 28,000 chevaux, 130,000 bœufs, 2,000,000 de moutons, 2,000 chèvres, 50,000 porcs, 5 mules et 8 ânes. Les mérinos de Tasmanie sont fort renommés; quelques-uns de ces béliers se vendent jusqu'à 600 guinées, plus de 15,000 fr. La Tasmanie (p. 369) est reliée à l'Australie par un câble sous-marin. Plusieurs steamers vont chaque semaine d'une île à l'autre, et de Tasmanie en Nouvelle-Zélande. Le réseau de chemin de fer continue à s'étendre. On dépense tous les ans de fortes sommes pour multiplier les routes. La poste et le télégraphe unissent au centre les plus petites localités.
L'instruction est obligatoire; les parents sont obligés d'envoyer les enfants à l'école sous peine de 50 fr. d'amende, à moins qu'ils ne soient malades, empêchés, ou instruits chez eux. L'enseignement des écoles publiques est unsectarian, c'est-à-dire qu'on ne donne aucun enseignement religieux. Les catholiques, tout en payant la contribution afférente à l'enseignement, ont leurs écoles privées, où leurs enfants reçoivent aussi renseignement religieux.
Le revenu de la colonie pour 1884 est estimé à 572,378 l. stg., et provient en grande partie des droits de douane. La dépense est estimée à 503,531 l. stg. La dette publique est de 2,391,500 l. stg., soit 18 l. stg. 1/2 par tête d'habitant.
Les naturels de l'île sont complètement éteints. La dernière indigène, Lalla Rookh, est morte il y a 3 ans. Il est bon de mentionner ici leur triste histoire. Après Tasman, l'île fut visitée le 4 mars 1772 par le Français Marion de Fresnes. Il fut reçu à coup de pierres et de lances, et une décharge des matelots tua plusieurs sauvages. Le capitaine Cook la visita en 1777, et y laissa des (p. 370) porcs, des vignes, des oranges, des pommes, des prunes, des oignons et des pommes de terre. Cook donne la description de leurs femmes nues et tatouées, avec leurs têtes rasées, vivant comme des bêtes.
Le capitaine Flinders, en 1798, fut aussi mal reçu, mais le capitaine de Surville, qui aborda à Doubtless-bay, eut de la nourriture et de l'eau.
L'introduction des criminels rendit la condition des indigènes encore plus misérable. Les évadés s'étaient formés en troupes de vrais, bandits, connus sous le nom de bushrangers, pillant et massacrant aussi bien les blancs que les noirs. Les indigènes prirent en haine les blancs, et ne pouvant leur résister ouvertement, les prenaient en détail en embuscade.
Le gouverneur faisait des proclamations qui ne servaient à rien, car les noirs ne savaient pas lire. Il prit alors le parti de les exhiber en peinture. On y voyait des noirs tuant des blancs à coup de lance et les pendant aux arbres; puis des femmes blanches donnant leurs soins à des enfants noirs. Ceci ne produisit guère plus d'effet. Les bushrangers commettaient des crimes horribles, et les noirs, sous la conduite de deux des leurs, Jack et Mosquito, prenaient leur revanche sur tout ce qu'ils trouvaient de blancs, sans épargner femmes et enfants. Des soldats furent envoyés à leur poursuite; ils surprirent une réunion de noirs durant la nuit et en tuèrent un grand nombre. Un soldat prit un enfant et dit: Si tu n'es pas méchant maintenant, tu le seras un jour. (p. 371) Et il lui brisa la tête contre un arbre. La lutte devint féroce. Jack et Mosquito furent pris couverts de blessures et pendus. Mais la guerre ne finit point pour cela: 3,000 blancs partirent en campagne et étaient arrivés à cerner les noirs, lorsqu'un individu se mit à crier: Voilà, voilà du bruit dans ce buisson, feu! feu! On se rassemble, on fait feu, et on s'aperçoit qu'on a tué une pauvre vache qui paissait paisiblement. Pendant ce temps les noirs purent s'enfuir en masse, et les choses étaient à recommencer. Alors, un nommé Robinson, mécanicien, demanda l'autorisation d'aller sans armes auprès des noirs pour les engager à faire la paix. On se moqua de lui, mais on le laissa aller. Ceci se passait en 1830. Les pauvres noirs se mouraient de faim, car leurs plantations étaient dévastées.
Il prit avec lui deux noirs, visita les tribus de quelques îles, et obtint leur acquiescement. Il retourna en Tasmanie, vit les tribus les unes après les autres, faillit plusieurs fois être tué; mais il fut toujours préservé. Lorsqu'il arriva à la dernière tribu, la plus féroce, il était accompagné de deux blancs et de quelques noirs. À leur approche, 150 chiens donnent l'éveil, la tribu est sur pied et en armes; Montpeliata, leur chef, lève sa lance longue de 6 pieds, les femmes portent aussi des paquets de lances. Robinson s'arrête et attend son sort. Son compagnon lui dit: Je pense que nous serons bientôt dans la résurrection,—je le crois aussi, fut sa réponse.
Les guerriers s'avancent et Montpeliata crie aux étrangers: (p. 372) Qui êtes-vous?—Nous sommes des amis. Où sont vos armes?—Nous n'en avons point. Le sauvage se ravise et dit: Où sont vos piccaninnies (vos pistolets)?—Nous n'en avons point. À ce moment, se fit une pause solennelle; un mot du chef et les guerriers allaient se jeter sur les étrangers et les transpercer. Quelques-uns des leurs le comprennent et s'enfuient.—Revenez ici, crie Montpeliata. Ce fut le premier rayon d'espoir. Les femmes à leur tour se mettent à jaser et le chef se dirige vers elles. Une consultation s'en suit, et les femmes lèvent trois fois les mains en l'air poussant le cri de paix. Les lances tombent, on se tend les mains, on s'embrasse. Robinson retourne à Hobart, on le fête, on le proclame pacificateur et libérateur de la colonie. Il avait obtenu, en effet, par la force morale, ce que les armes n'avaient pu obtenir.
Les noirs furent transportés à l'île Flinders par les soins du gouvernement. Cette île a 40 milles de long sur 18 de large. Les transportés reçurent toutes sortes d'attentions et tout le nécessaire à la vie: ils avaient leurs huttes, leurs jardins, leurs missionnaires, leurs juges. Néanmoins ils s'éteignaient rapidement et mouraient de nostalgie; ils voyaient de loin leur pays et soupiraient après le retour. Ils furent bientôt réduits à 50 personnes: 22 femmes, 12 hommes et 16 enfants; et on les transporta à Oyster cove, près de Hobart; mais là encore ils occupaient l'ancien local des convicts, ce qui était bien fait pour rappeler leur captivité. M. Clarke, un de leurs (p. 373) catéchistes, s'était fait leur père. Après sa mort, la tristesse saisit encore plus les malheureux survivants. En 1854, ils n'étaient plus que 3 hommes, 11 femmes et 2 enfants. On leur laissait donner des alcools et des liqueurs; c'était leur poison. Une de ces malheureuses se plaignait en ces termes: «À l'île Flinders, nous avions des amis; nous n'en avons plus ici; là, on prenait soin de nous, ici on nous jette à l'écume de la société (faisant allusion aux convicts). Il serait mieux que quelqu'un vienne nous lire et prier avec nous; par contre, nous sommes tentés de boire et personne ne s'occupe de nous.»
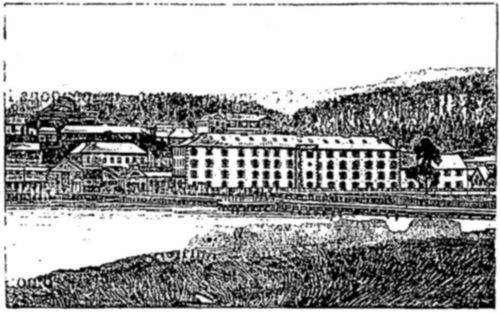
Tasmanie.—Port Arthur.—Ancienne prison des convicts.
Bientôt il ne resta plus que deux survivants: le roi Billy et sa femme. Celui-ci était un habile pêcheur de baleines, mais lorsqu'il recevait sa paie, il s'empressait de s'enivrer. Il mourut à la fin du choléra en 1869. La dernière survivante, Truganina ou Lalla Rookh, fut recueillie (p. 374) par Mme Dandridge. Elle racontait souvent les épisodes tragiques des dernières guerres, et comment elle avait vu périr toute sa race. Elle mourut elle-même à la fin, il y a 3 ans. Triste histoire, qui est en train de se reproduire pour toutes les races de l'Océanie!
14 décembre.—À 5 heures du matin je rédige mon journal, et à 10 heures je suis sur le Flinders, navire de la Tasmanian Cy, qui doit me transporter à Melbourne. Les cabines sont au complet. Le steamer quitte lentement et avec précaution le quai où il était amarré; la rivière forme bientôt un détour dangereux. Nous descendons le fleuve dans ses tours et détours parsemés d'îles gracieuses. La contrée est tantôt en plaine, tantôt accidentée, tantôt couverte de gazon, tantôt boisée d'eucalyptus. Vers 2 heures nous apercevons à gauche la cheminée fumante des mines de quartz aurifère de Beaconfield; puis la rivière s'élargit, et à son embouchure un promontoire me rappelle celui d'Antibes.
À 2 heures nous sommes en pleine mer, elle est fort houleuse; tous les passagers sont malades et gardent le lit. La tempête dure toute la nuit, mais le matin de bonne heure nous apercevons la grande terre: c'est l'Australie![Table des matières]
Australie.
L'Australie. — Situation. — Surface. — Histoire. — Les convicts. — Les explorateurs. — Les chemins de fer. — Le télégraphe. — Les banques. — Journaux. — Gouvernement. — Population. — Conformation. — Géologie. — Minéraux. — Faune. — Bétail. — Produits. — Exportation. — Importation. — Agriculture. — Religion. — Instruction publique. — Armée. — Marine. — Navigation. — Revenu. — Dépense. — Les indigènes. — Races, origine, croyances, mœurs et usages.
On comprend sous le nom d'Australasie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie et les îles adjacentes. Nous avons fait connaître la Nouvelle-Zélande et la Tasmanie. Nous allons parler de l'Australie. Elle est la plus vaste des îles du globe. Sa plus grande longueur est de 2,400 milles, sa plus grande largeur de 1,971 milles.
L'étendue de ses côtes est de 7,750 milles; sa surface de 3,000,000 de milles carrés, soit environ 2,000,000,000 d'arpents. Elle est 26 fois aussi vaste que la Grande Bretagne et l'Irlande, presque 6 fois aussi grande que l'Hindoustan, et de 1/5 seulement plus petite que l'Europe.
Elle est située au sud-est de l'Asie, entre le 10° 39' et 39° 11'-1/2 latitude sud; et entre les méridiens 113° 5' et 153° 16' longitude est de Greenwich. Elle est baignée au nord par les eaux du détroit de Torres qui la sépare de la (p. 376) Nouvelle-Guinée, par l'océan Indien et les eaux du golfe de Carpentaria, et la mer d'Arafura. Au sud, elle confine au détroit de Bassus qui la sépare de la Tasmanie, et à l'océan Pacifique sud; à l'est, elle est baignée par l'océan Pacifique, et à l'ouest par l'océan Indien.
En jetant les yeux sur la carte, on voit qu'on peut la diviser en 3 parties: l'Est, qui comprend les 3 colonies de Victoria, Nouvelle-Galle du Sud et Queensland; le centre, qui comprend la colonie du Sud-Australie et son territoire du nord; l'Ouest, qui comprend la colonie de l'Australie-Ouest. Si on divise le sol en 100 parties égales, Victoria en comprend 3, la Nouvelle-Galle du Sud 10, Queensland 23, l'Australie du Sud 30 et l'Australie Ouest 34. La distance qui sépare l'Australie de la France est d'environ 11,000 milles (le mille marin est de 1,852 mètres).
L'Australie fut d'abord visitée au xvie siècle par les Portugais, qui l'appelèrent Java la Grande; des cartes manuscrites en langue portugaise, portant la date de 1531 et 1542, en font foi. En 1606, le Portugais Fernand de Quiros l'aperçut et l'appela Terra Australia, et dans la même année, Louis Vaez de Torres, qui faisait partie de la même expédition, passe par le détroit qui porte son nom. Vinrent ensuite les Hollandais qui l'appelèrent Nouvelle-Hollande. En 1770, le capitaine Cook à son tour y aborda et en prit possession en hissant le pavillon anglais.
Le premier établissement fut formé à Botany-Bay dans la Nouvelle-Galle du Sud en 1788. En 1803, le lieutenant Bowen amena des convicts de Sydney en Tasmanie. En (p. 377) 1825, on forma à Moreton-Bay un autre établissement qui devint en 1859 la colonie de Queensland. En 1829, on commença un établissement nouveau à Swan-River (Australie Ouest) qui fut colonie pénitentiaire de 1851 à 1868.
Victoria ou Port Philipp fut colonisé par les Tasmaniens en 1835, et déclaré colonie indépendante en 1851. On y avait essayé une colonie pénitentiaire dès 1803. L'Australie du Sud fut colonisée par des émigrants anglais en 1836.
Depuis le comte Philipp en 1788, jusqu'à Frank Hanu en 1881, de nombreux explorateurs ont parcouru le pays dans tous les sens, et plusieurs ont péri victimes de leur patriotisme. Parmi les plus célèbres, on cite: le capitaine Barker, sir George Grey, Ludwig Leichhardt, qui dans la seconde expédition ne revint plus; Sir Thomas Mitchell, Kennedy, Gregory, Stuart et Burke. Ce dernier, en 1860, partit de Melbourne et réussit à atteindre le golfe de Carpentaria, après avoir traversé toute l'île. À son retour à Cooper Creek, dont il avait fait son lieu de ravitaillement, il trouva que ses compagnons avaient quitté la place 7 heures avant, en emportant les provisions. Il mourut de faim, lui et ceux qui l'accompagnaient, à l'exception de King, qui fut trouvé exténué, vivant de racines avec les sauvages.
Les nombreuses expéditions qui furent envoyées à la recherche de Burke aidèrent beaucoup à la découverte du pays.
En 1862, Stuart traversa l'île du nord au sud, depuis (p. 378) Adélaïde jusqu'au golfe de Van Diémen. Quelque temps après le gouvernement de l'Australie du Sud établit sur cette route une ligne télégraphique de 2,000 milles. Elle se soude à Port Darwin au câble qui passe par Java, et se rallie aux Indes. De divers points de cette ligne télégraphique, à différentes époques, d'autres explorateurs s'acheminèrent vers l'ouest, traversant à des latitudes différentes toute l'Australie Ouest. D'après leur récit, un désert pierreux s'étendrait au centre, entre l'Australie Ouest et l'Australie Sud; ils ont aussi rencontré des lacs nombreux. Le reste est du bon terrain, propre à la culture et à l'élevage. Le gouvernement de l'Australie du Sud construit en ce moment un chemin de fer, le long du télégraphe, entre Adélaïde et Port Darwin; les travaux se poursuivent des deux côtés, et dans quelques années, la locomotive traversera la grande île, non seulement du sud au nord, mais en plusieurs autres directions. En 1881, le gouvernement de Queensland a fait étudier une ligne qui irait de Roma au centre de la colonie, jusqu'au golfe de Carpentaria. Les explorateurs purent conduire avec eux un petit char. Une grande discussion agite en ce moment la colonie. Des compagnies proposent d'exécuter ces lignes de railway, moyennant la cession d'une quantité de terres, d'après le système américain, mais la population ne veut pas que les railways servent à enrichir quelques compagnies, et insiste pour que l'opération soit faite directement par la colonie.
Melbourne, capitale de Victoria, est déjà reliée par un (p. 379) railway à Sydney, capitale de la Nouvelle-Galle du Sud, et le sera bientôt à Adélaïde, capitale de l'Australie du Sud. Sydney sera aussi, sous peu de temps, reliée à Brisbane, capitale du Queensland, et de nombreux tronçons ont déjà franchi les montagnes Bleues et s'avancent de toutes parts vers l'intérieur. Les lignes ouvertes atteignent déjà environ 10,000 kilomètres. Plus de 60,000 kilomètres de lignes télégraphiques servent aux communications; 22 banques, entre capital et dépôts, opèrent sur une somme de cent millions de livres sterling, soit 2 milliards 1/2 de francs. La presse compte 640 journaux.
En fait de gouvernement, chaque colonie est indépendante. Elle a à sa tête un gouverneur nommé par la Reine et payé par la colonie. Suivant le système des gouvernements constitutionnels, le pouvoir est exercé par le conseil des ministres; ceux-ci doivent avoir la confiance des Chambres. Les deux Chambres, appelées Conseil législatif et Assemblée, sont toutes deux élues dans quelques colonies. Dans d'autres, l'Assemblée seule est élue et les membres du Conseil législatif sont nommés par le gouverneur; celui-ci a le droit de dissoudre l'Assemblée et d'opposer son veto, au nom de la Reine, aux lois qui ne lui sembleraient pas conformes à la justice ou à l'utilité publique.
La population, qui était de 1,000 personnes à Botany-Bay en 1788, atteint aujourd'hui près de 3,000,000. Le plus grand nombre sont d'origine anglaise et irlandaise; viennent ensuite les Allemands, et environ 40,000 Chinois. (p. 380) Les naissances dépassent de deux tiers le montant des décès. Elles atteignent une moyenne de 36 par 1,000 pendant qu'elles ne sont que 35 par 1,000 en Angleterre. Les décès sont de 14 par 1,000 pendant qu'ils sont de 22 par 1,000 en Angleterre. Les mariages atteignent le chiffre de 7 par 1,000. L'excès des immigrants sur les émigrants est d'une moyenne annuelle de 20,000.
Le climat est tempéré dans le sud, chaud vers le nord. Le manque de hautes montagnes et de grandes rivières rend le pays sujet à des sécheresses qui occasionnent parfois de grandes pertes de bétail.
Quant à la conformation et à la géologie, l'Australie est un immense plateau élevé à 2,000 pieds environ sur le niveau de la mer vers l'est, et de 1,000 pieds vers l'ouest, avec une bande de terrain plat entre ce plateau et la mer. Vers le sud-est, il y a une surélévation qui constitue les Alpes australiennes, dont les pics les plus élevés atteignent 2,300 mètres ou 7,000 pieds. Les rivières qui partent de ces montagnes convergent généralement à l'ouest, où le plateau est moins haut. Vers l'intérieur, les eaux pluviales se ramassent dans des lacs généralement salés; là le sol est un composé de désagrégations granitiques qui forment un désert sablonneux. La bande de terre plate entre la mer et les plateaux est généralement granitique. Le granit forme aussi la base des Alpes australiennes.
Dans certains endroits, le granit est remplacé par des stratifications palœzoïques, la plupart en forme de schiste et presque verticales. Vers l'est et le sud, dans la bande (p. 381) de terre plate, on trouve des bassins de charbon, gisant sur les rocs plus anciens granitiques et palœzoïques. Sur le bord de cette bande de terre, on voit généralement une pierre sablonneuse en stratifications obliques. Dans l'intérieur, les laves volcaniques tertiaires, les sables, les marnes, sont communes et bien fournies de fossiles.
Vers le sud, la terre est formée de roches tertiaires représentant tous les dépôts européens depuis l'éocène.
Dans le granit australien, on trouve des veines riches en minerai, et spécialement en or. On rencontre aussi l'étain emporté et lavé par l'eau dans les dissolutions de granit. Dans le Sud-Australie, on trouve de riches veines de sulphide de cuivre dans des rocs qui sont, probablement de l'âge cambrian. On ne remarque en Australie aucune trace indiquant qu'elle ait participé à l'âge de glace; on pense généralement qu'elle est de formation récente et qu'elle est sortie de l'Océan à la suite de bouleversements volcaniques. Des fossiles d'animaux, on conjecture que le climat a dû être anciennement plus chaud.
Pour la faune, l'Australie présente la spécialité des marsupiaux, dont le kanguroo et l'opossum sont les principales variétés parmi les cent dix connues. Il y a aussi 24 espèces de chauves-souris, un chien sauvage, 30 espèces de rats et souris, et une grande variété de baleines, de phoques et de marsouins. Les marsupiaux, qui sont les plus anciens mammifères, ont laissé des fossiles qui prouvent qu'ils ont atteint anciennement jusqu'à la grosseur (p. 382) du rhinocéros. Il y a 630 espèces d'oiseaux, dont le plus grand est l'Ému ou autruche australienne. Plusieurs, comme l'oiseau à lyre, le dindon des forêts et divers perroquets, sont spéciaux à l'Australie. On compte plus de 60 espèces de serpents, la plupart venimeux.
Cent quarante espèces de lézards, parmi lesquels l'iguana atteint de vastes proportions. Les insectes de toute qualité sont nombreux, mais spécialement les moustiques.
En fait de produits, l'Australie abonde en minerais d'or, de cuivre, d'étain et autres métaux. L'or a été d'abord découvert en mai 1851 en Nouvelle-Galle du Sud, puis en Victoria, en Queensland et dans les autres colonies. On calcule que les mines d'or d'Australie ont déjà produit plus de 70 millions d'onces, évalués à environ 277 millions de livres sterling, presque 7 milliards de francs. Dans ce chiffre, la colonie de Victoria entre pour 2/3.
On trouve aussi le charbon en grande quantité au-delà des montagnes Bleues et à Newcastle (New South Wales). On en découvre beaucoup en Queensland. Dans ces deux colonies, il y a aussi de grandes quantités d'étain.
La laine forme le produit principal de l'Australie; elle est la meilleure connue. Il y avait plus de 60,000,000 de moutons dans le pays en 1882, sans compter les 2,000,000 de la Tasmanie et les 13,000,000 de la Nouvelle-Zélande. Il y avait en outre plus d'un million de chevaux sans compter les 25,000 de Tasmanie et les 180,000 de la Nouvelle-Zélande. (p. 383) Les bêtes bovines atteignaient le chiffre de 7 millions 1/2 et dépassaient 122,000 en Tasmanie et 700,000 en Nouvelle-Zélande.
Le nombre des porcs atteignait 500,000 et était d'environ 50,000 en Tasmanie et 200,000 en Nouvelle-Zélande.
On exporte beaucoup de suif, des peaux, de la viande congelée ou conservée en boîtes, de blé, de coton, de tabac, de sucre et de vin.
L'exportation pour 1882 atteint environ 43,000,000 de l. stg., plus de 1 milliard de francs. L'importation s'élève à la même date à environ 54,000,000 de l. stg. pour la seule Australie.
L'agriculture se développe aussi tous les jours. En 1881, il y avait environ 7 millions d'arpents de terre cultivée, dont la moitié à peu près en blé, donnant 31 millions 1/2 de boisseaux. Environ 400,000 acres ou arpents donnaient 10 millions de boisseaux d'avoine; 152,000 acres en orge produisaient environ 3,000,000 de boisseaux; 174,000 acres en maïs produisaient environ 6,000,000 de boisseaux; 38,000 acres d'autres céréales diverses donnaient 615,000 boisseaux; 109,000 acres de pommes de terre produisaient 355,000 tonnes; 770,000 acres en foin donnaient 887,000 tonnes; 15,000 acres en vignes donnaient 1,654,000 gallons de vin (le gallon équivaut à environ 4 litres 1/2). Il y avait eu en plus 598,000 acres semées en herbe, et 1,237,000 acres en produits divers. Le blé donnait une moyenne de 9 boisseaux 1/2 l'acre, l'avoine 26, (p. 384) l'orge 19, le maïs 34, les pommes de terre 3 tonnes 1/2, le foin 1 tonne 1/6.
La quantité de terre de la Couronne aliénée jusqu'en 1880 dépassait 80,000,000 d'acres ou arpents. Le prix varie de colonie à colonie; la moyenne atteint presque 1 l. stg. La terre restant disponible comprenait environ 2 milliards d'arpents.
Sous le rapport religieux, les 2/3 de la population sont protestants. Parmi eux, les plus nombreux sont les épiscopaliens, qui ont 12 diocèses; puis viennent les presbytériens, les wesleyens méthodistes, les congrégationnalistes, les luthériens et protestants allemands, les baptistes, les juifs, les méthodistes primitifs, les bibliques, l'Église du Christ, les unitariens, les presbytériens libres, etc. Les catholiques romains forment environ le 1/3 de la population; ils sont gouvernés par 2 archevêques: Sydney, et Melbourne, et par 11 évêques, siégeant dans les villes ci-après: Adélaïde, Armidale, Ballarat, Bathurst, Brisbane, Queensland nord, Goulbourn, Maitland, Perth, Port Victoria, et Sandhurst. Il y a aussi quelques mahométans, des confuciens et des payens. Les églises et les chapelles sont partout fort nombreuses, chaque congrégation voulant avoir la sienne. L'instruction religieuse ayant été bannie de l'enseignement officiel, on y supplée au moyen de nombreuses écoles dominicales qui font sentir leur action bienfaisante.
L'enseignement supérieur est donné dans les 3 universités de Sydney, Melbourne, Adélaïde, qui confèrent les (p. 385) grades universitaires comme en Europe. Il y a un collège militaire à Sandhurst; des musées et des écoles techniques à Sydney et à Melbourne. L'instruction secondaire a de nombreux collèges officiels et libres: l'enseignement primaire est libre pour le maître et obligatoire pour l'élève. On compte en outre plusieurs sociétés scientifiques, parmi lesquelles la Société royale de New-South-Wales est la principale. Chaque ville un peu importante a sa bibliothèque publique. Il y a dans toutes les capitales de superbes jardins botaniques et des musées bien complets pour toutes les branches de l'histoire naturelle.
L'astronomie possède 3 observatoires bien aménagés à Sydney, Melbourne, Adélaïde. À Melbourne, le télescope, un des plus grands du monde, a une lentille de 4 pieds de diamètre. Les observations météorologiques sont recueillies par ces observatoires et par de nombreuses stations dans toutes les autres colonies, y compris la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande. Elles sont échangées par le télégraphe, et transmises tous les jours au public par la presse. Il y a enfin des sociétés de géographie, d'agriculture, d'horticulture et autres pour l'avancement de ces diverses branches.
Les capitales sont défendues du côté de la mer par des batteries, et des bateaux torpilles. La colonie de Victoria a 3 navires de guerre, parmi lesquels un cuirassé, et elle vient d'en acheter d'autres; Sydney en a un, et Adélaïde en a acheté un récemment. Tous ces navires, y compris celui de la Nouvelle-Zélande, sont maintenant réunis à (p. 386) Hobart (Tasmanie) pour les manœuvres. Du côté de la terre, la défense repose sur des volontaires plus ou moins nombreux dans les diverses colonies.
Cinq compagnies de navigation font le courrier d'Europe en Australie. L'Oriental and Peninsular part d'Angleterre 2 fois le mois ainsi que l'Oriental. La première touche aux Indes à Colombo, la seconde va directement par Suez touchant à Naples, les lettres par cette voie ne mettent pas plus de 31 jours d'Australie à Londres. La British India part une fois par mois de Brisbane, passe par le détroit de Torres et touche à Batavia; la Pacific American part de San-Francisco chaque vingt-huit jours, touche à Auckland et arrive à Sydney; les Messageries maritimes partent de Marseille chaque 28 jours et arrivent en Australie, par Aden, Mahé, Réunion, Maurice. Le prix moyen du passage, en première classe, est de 1,600 fr.; la durée du trajet de 31 à 45 jours. Il y a en outre plusieurs autres Compagnies transportant voyageurs et marchandises, soit dans des bateaux à vapeur, soit dans des bateaux à voiles. En 1880, le nombre de navires ayant touché aux ports d'Australie, Tasmanie et Nouvelle-Zélande s'est élevé à 2,375, avec un tonnage de 277,191 tonnes. Dans ce chiffre, les steamers étaient 630 avec un tonnage de 76,257 tonnes, et les navires à voiles 1,745, avec un tonnage de 200,934 tonnes.

Indigènes australiens.
En 1880, le revenu total pour les colonies australiennes s'est élevé à 17,069,015, l. stg. parmi lesquelles 6,179,405 (p. 387) provenaient des contributions, timbre et droits fiscaux. La dépense s'élevait à 18,680,340 l. stg. (soit presque 1/2 milliard de fr..) Les contributions atteignaient une moyenne de 2 l. 6 s. par tête d'habitant, la recette 6 l. 7 s., la dépense 6 l. 19 s.
La dette publique des colonies ensemble s'élevait à 89,910,249, l. stg., soit 33 l. stg. 0 s. 8 1/4 pence par tête d'habitant.
Après cet aperçu général sur l'ensemble des colonies australiennes, il est bon d'ajouter quelques renseignements sur les indigènes.
On suppose qu'ils sont encore au nombre de quelques centaines de mille dans l'intérieur. Dans les endroits colonisés, ils ont disparu. Les squatters en emploient quelques-uns comme domestiques ou bergers: les femmes font un bon service, les hommes excellent à dompter les chevaux. La police les emploie à traquer les convicts évadés dans la forêt, et dans cet exercice ils réussissent à merveille. On a voulu en faire des soldats, et les employer à poursuivre d'autres indigènes, mais il a fallu y renoncer, parce qu'ils ne leur faisaient jamais quartier et tuaient tout ce qu'ils trouvaient.
Les indigènes d'Australie appartiennent à deux types différents qui se sont plus ou moins croisés; l'un est le type indo-européen: on le reconnaît aux cheveux lisses, aux coutumes et surtout à leur mode de parenté identique à celui des tribus de Télégu et de Tamil dans l'Hindoustan; on le retrouve aussi chez les Indiens de (p. 388) l'Amérique du Nord. D'après ce système, les enfants de mon frère sont mes enfants, pendant que les enfants de mes sœurs sont mes neveux et nièces; mais les petits-enfants de mes sœurs comme ceux de mes frères sont mes petits-enfants.
Si je suis femme, les enfants de mes sœurs sont mes enfants, et les enfants de mes frères sont mes neveux et nièces; les petits-enfants de mes sœurs et de mes frères sont mes petits-enfants. Tous les frères de mon père sont mes pères, mais toutes les sœurs de mon père sont mes tantes. Toutes les sœurs de ma mère sont mes mères, mais tous les frères de ma mère sont mes oncles. Les enfants des frères de mon père sont mes frères et sœurs; il en est de même pour les enfants des sœurs de ma mère, mais les enfants des sœurs de mon père et ceux des frères de ma mère sont mes cousins. Si je suis un homme, les enfants de mes cousins sont mes neveux et nièces, mais les enfants de mes cousines sont mes enfants.
L'autre type est celui des nègres, caractérisé par les cheveux crépus; toutefois, ils n'ont pas les grosses lèvres des Africains. On suppose que les Arabes ont fourni un large contingent à l'Australie; on trouve en effet dans la plupart des tribus l'usage de la circoncision et aucune d'elles n'adore les idoles. Les Australiens sont grands, généralement bien faits, ont une belle démarche, mains et pieds petits, superbes dents. Les femmes sont plus petites et moins belles, et leur condition est misérable. On ne trouve en Australie aucune trace d'architecture; (p. 389) l'indigène vit en plein air ou se loge dans des cabanes en écorce d'eucalyptus; il sait pourtant faire des paniers, des filets, des armes consistant en boomerangs, casse-tête de diverses formes, hachettes de pierre, flèches et arcs, écus et lances. Il vit de chasse et de pêche. Dans les guerres, il mange l'ennemi; il pratique la polygamie.
À l'arrivée des Européens, les tribus avaient chacune leurs lois et leur territoire qu'elles ne pouvaient dépasser. Celles de la côte, obligées de faire place aux blancs et ne pouvant se réfugier en arrière, périrent pour la plupart de faim ou de la petite vérole.
Les tribus sont généralement divisées en clans, et chaque clan a son totem ou enseigne; c'est le plus souvent un des animaux de la contrée qui sert d'enseigne: le kanguroo, l'ému, le chat, le chien, un serpent, etc.
Les mariages entre personnes du même clan et du même sang sont défendus. Celui qui veut se marier doit s'adresser à un autre clan, et il est obligé de donner une sœur en échange pour la femme qu'il prend. Il peut prendre autant de femmes qu'il a de sœurs à donner. S'il n'a point de sœurs, il doit aller au loin et enlever une femme dans une autre tribu. Pour le mariage, on consulte les vieillards du clan; on ne consulte jamais la fiancée; les parents et les deux clans s'assemblent à l'occasion du mariage et font, un corroborée (fête) avec chants et danses. La fiancée est conduite à la cabane du fiancé, elle marque son consentement en allumant le feu dans la cabane de l'époux. Ils dorment à distance pendant (p. 390) les 5 premières nuits; ensuite les invités rentrent chacun dans leur quartier. Il est défendu à la belle-mère de parler au beau-fils comme à celui-ci de lui adresser la parole. Les Australiens sont très jaloux de leurs femmes; elles sont chargées de préparer la nourriture et de fournir les légumes; l'homme doit fournir le gibier et le poisson. Lorsque le mari a deux femmes qui se querellent, il remet un bâton à chacune et les force à se battre; si elles refusent, il les bat lui-même toutes les deux.
La justice est réglée par les vieux. S'il y a 2 coupables, ils se placent à distance et se tirent mutuellement une flèche; si un seul est coupable, celui à qui il a fait tort lui administre un certain nombre de coups de bâton. Les garçons et les filles ne peuvent jouer ensemble; l'incontinence avant le mariage est punie de mort.
La propriété particulière est inconnue, tout ce qu'on possède est propriété du clan. La mère s'éloigne de la maison pour les couches, elle est assistée par des amies; lorsqu'elle rapporte l'enfant, le père lui donne un nom et combine déjà les fiançailles avec les vieux du clan; mais souvent l'enfant meurt faute de soins et quelquefois la mère le tue pour se soustraire aux peines et soucis de l'élevage. Selon l'usage des Juifs, la veuve passe à son beau-frère; s'il n'y a pas de beau-frère et qu'elle ne choisisse un autre mari, elle devient la propriété publique. Pour les funérailles, ils font généralement peu de cérémonies; ils creusent la terre, et y déposent le cadavre (p. 391) tantôt couché, tantôt debout avec les genoux ramassés à la poitrine.
Les maladies dominantes sont celles du foie et de la poitrine. Depuis l'arrivée des blancs, il faut y ajouter l'ivrognerie et les maladies vénériennes. Ils croient aux mauvais esprits, et pratiquent beaucoup de sorcelleries; ils sont persuadés que la maladie a toujours pour cause le mauvais vouloir d'un sorcier. Le gras humain, l'os d'ému et des cheveux, le tout mêlé ensemble, forme un charm. L'os entre dans le corps de la victime et la rend malade. Ces charm sont cause de beaucoup de guerres et de morts. Ils croient en un Être suprême créateur de toute chose, qui n'a eu aucun commencement et n'aura pas de fin; ils l'appellent Norallie; ils disent qu'il est marié et qu'il a un fils unique excellent; ils croient que la femme de Norallie punira à son heure tous les méchants. Ils racontent que le cours de la rivière le Murray a été formé par la fuite d'un grand serpent, et que ce grand serpent a été tué par Norallie. Ils croient que Norallie habitait la terre, mais l'homme l'ayant dégoûté par ses méfaits, il s'en est allé dans l'autre monde. Un jour, il revint, et voyant que l'homme détruisait le gibier, il appela les animaux et leur dit de se garer des hommes; dès ce jour, animaux et oiseaux devinrent sauvages et difficiles à prendre. Ils excellent à soigner les blessures, et emploient pour cela de la terre et quelques herbes.
Le langage varie selon les tribus, mais, il a presque toujours la même construction; il est de source arienne, (p. 392) et comprend beaucoup de mots venant du sanscrit. Ils n'ont pas de chiffres au-delà de cinq. Pour exprimer un plus grand nombre, ils disent beaucoup. Ils manquent des lettres f v s et z. Dans les déclinaisons des noms, les cas sont formés par la variation de la terminaison. Pour dire mon père, la tribu de Titnie à Fowlers-bay dit Mumma; la tribu Maroura, sur le lac Darling, dit Guia Kambïa; la tribu Meru, sur le Bas-Murray, dit Pita; la tribu Narrinyeri dit Nanghaï; la tribu Tatiara à Border-Town dit Mamee.
Pour donner une idée des sons, je mets ici la traduction du Pater dans le langage parlé sur la rivière Darling.
«Ninnana combea, innara inguna karkania, Munielie nakey, Emano pumum culpreatheia, ona kara canjelka, yonangh patua, angella, Nokinda ninnana kilpoo, yanie Thickundoo wantindoo ninnanna Illa ninnanna puniner, thullaga, Thillthill Chow norrie morrie munda, lullara munie. Euelpie.»
Ils ont une certaine poésie, et un vrai talent d'imitation. Voici le refrain de leur chanson, à leur première vue de la locomotive:
«Voyez-vous la fumée en kapunda?
La vapeur, souffle en mesure,
Se répand rapide et blanche comme la gelée.
Elle court comme une eau courante,
Elle frappe comme une baleine qui crache.»
(p. 393) Dans plusieurs tribus, les jeunes gens ne sont admis aux privilèges accordés aux hommes, parmi lesquels celui du mariage et le droit de manger certaines sortes d'aliments, qu'après avoir passé par certaines épreuves ayant pour but de fortifier leur courage. Parmi ces épreuves, une consiste à arracher une dent incisive, l'autre à tatouer le dos; mais la plus pénible est la dépilation. Pour la première de ces épreuves, on choisit les jeunes gens en âge voulu; le vieux médecin place l'extrémité d'un bâton contre une incisive, il bat avec une massue sur l'autre bout et la dent saute. Pour la dépilation, on place le patient à terre, et le vieux médecin lui arrache un à un tous les poils, en s'accompagnant d'un chant monotone. Après l'opération, qui doit être endurée sans pousser un cri, le patient est proclamé guerrier, et prend place à côté de ses compagnons d'armes. Toutefois, plusieurs meurent à la suite de ces cruelles épreuves.
Les divers gouvernements ont essayé de civiliser ces malheureuses populations, mais sans résultat; il y a encore quelques établissements où ils sont reçus et instruits par les missionnaires, et dans l'intérieur il y a de nombreuses stations où on leur distribue des couvertures et des aliments aux frais de la colonie; mais le résultat de ces efforts n'est pas grand. Les indigènes prennent les défauts des civilisés bien plus que les qualités, et périssent par l'abus des liqueurs, du tabac, et par les maladies vénériennes. On peut prévoir le temps où il sera (p. 394) des indigènes de l'Australie ce qui a été de ceux de la Tasmanie; ils ne vivront plus que dans la mémoire des anciens, et par l'histoire. Mais il est temps de reprendre mon récit de voyage.[Table des matières]
Port-Philipp. — Melbourne. — La ville. — Les faubourgs. — Le téléphone. — La colonie de Victoria. — Situation. — Surface. — Rivières, lacs, montagnes. — Population. — Religion. — Armée. — Marine. — Terres. — Revenu. — Dépenses. — Bétail. — Navigation. — Exportation.-Importation. — Produits. — Poste. — Télégraphe. — Chemins de fer. — Banques. — Caisse d'épargne. — Écoles. — Usines. — Mines. — Églises. — Agriculture. — Les parcs. — Le jardin zoologique. — Leledale. — Le vignoble de Saint-Hubert. — Les sauterelles. — Retour à Melbourne. — Départ pour Ballarat. — Geelong. — L'eucalyptus. — Une condamnation sévère. — La loi morale et la loi divine. — Struggle for life. — Les trois bébés retrouvés.
C'est le 15 décembre 1883 au matin, que j'arrive à l'entrée de Port-Philipp. Cette immense baie a 32 milles de long sur 22 de large; l'entrée n'a que 2 milles. À droite, je vois construire des batteries en terre, à gauche s'élèvent les beaux hôtels de Quen's cliff, station de bains qu'on atteint de Melbourne par 4 heures de railway. Des bouées marquent le canal sud où passent les grands navires; ceux d'un faible tirant suivent un canal au centre: plusieurs phares indiquent la route pendant la nuit. Un peu plus loin, un navire échoué indique la présence de bancs de sable. Nous dépassons plusieurs voiliers, et, après 2 ou 3 heures, nous laissons à droite 2 navires de guerre et à gauche Williamstown où s'arrêtent les steamers de gros tonnage. Nous pénétrons dans le Yarra-Yarra, (p. 396) rivière tortueuse qu'on est en train de draguer; ses rives sont couvertes d'usines, dont quelques-unes fabriquent les engrais et exhalent une odeur insupportable. On projette un canal pour atteindre en ligne droite Melbourne et éviter les nombreux détours de la rivière; à 10 heures 1/2 notre navire jette l'ancre devant la douane dans la capitale de Victoria.
C'est une ville d'environ 300,000 âmes, qui rappelle les plus belles capitales européennes; les divers palais de ville, les nombreuses banques, le palais de justice, l'Université, le Musée, le Palais de l'Exposition sont des monuments de premier ordre. La ville est bâtie sur deux collines; ses rues ont 99 pieds de large et se coupent à angle droit: de nombreux et vastes parcs séparent les divers quartiers: d'innombrables faubourgs s'étendent au loin et, par leurs parcs et leurs églises, ressemblent à autant de petites villes.
C'est samedi; à 2 heures presque tous les magasins ferment. Dans Collin's street je vois une très belle statue de Burke, le grand explorateur qui a fini d'une manière si tragique. Près de là, un vaste marché couvert, de belle architecture, réunit les fruits et légumes du printemps à côté de tous les joujoux et jouets, des perroquets de toutes sortes, des collections de chiens en cage, etc. Entre Collin's street et Bourke street, 5 ou 6 longues galeries ou passages couverts étalent dans de vastes magasins les plus riches étoffes, et tous les produits de l'industrie européenne.
(p. 397) Je fais quelques visites dans les faubourgs; les chemins de fer et les omnibus facilitent la circulation; une compagnie de tramway va installer le système de la ficelle continue qui fonctionne à San-Francisco. À peine je sors de la ville, je vois partout des parties de criket ou de lawn-tennis. De jolis petits pavillons entourés de gracieux jardins sont la demeure des gens d'affaire qui quittent la ville aussitôt qu'ils sortent du bureau ou du comptoir.

Palais de ville à Melbourne.
À la poste, des jeunes filles répondent au guichet. À chaque coin de rue, ce sont aussi des jeunes filles qui servent dans les bar. Des inconvénients sérieux se sont produits, et un mouvement se forme dans l'opinion publique pour demander la suppression des filles dans les (p. 398) bar. Les fils du téléphone enserrent la ville de toute part; le soir, la lumière électrique alterne sur certains points avec le gaz.
Au centre de la ville et près du port, je remarque d'immenses entrepôts de laine dans des édifices en pierre à 5 étages. À l'imprimerie du gouvernement, j'achète l'Australian handbook, recueil statistique officiel qui vient de paraître, et d'où j'extrais les renseignements ci-après.
Victoria, la plus petite du territoire, une des plus jeunes parmi les colonies australiennes, est pourtant celle qui a fait le plus de progrès.
Elle a commencé par un établissement de convicts. En 1835, les squatters John Batman et Pascoe Fawkner arrivant de Tasmanie, s'établirent sur le terrain qu'occupe aujourd'hui Melbourne. Bientôt Sir Thomas Mitchell les rejoint, arrivant par terre de Sydney et amenant du bétail. La fertilité de la contrée qu'il traversa lui fit donner le nom d'Australia felix. Le pays se peupla si vite qu'en 1851 il obtint d'être séparé de New South Wales, pour être érigé en colonie indépendante, sous le nom de Victoria. Peu après, de riches dépôts d'or furent découverts et attirèrent de nombreux diggers de tous les points du globe. Les diggers, traités trop rudement par la police, se révoltèrent à Ballarat, en 1854; le sang coula des deux côtés, mais à la fin, les abus qui avaient été la cause de ce désordre cessèrent. En 1855, on obtint une nouvelle constitution avec gouvernement responsable.
(p. 399) La colonie de Victoria s'étend sur un terrain de 87,884 milles carrés, soit 56,245,660 acres ou arpents. Elle a pour limites, au nord et à l'est, la rivière Murray depuis les springs dans Forest hill, jusqu'au cap Howe; à l'ouest, elle confine avec la colonie du Sud Australie sur une ligne longue de 242 milles, près le 141° méridien de longitude Est, depuis le Murray jusqu'à la mer. Au sud, elle a pour limite l'océan Pacifique et le détroit de Bassus. Une rangée de montagnes traverse la colonie; elles portent le nom d'Alpes australiennes vers l'est, et de Pyrénées vers l'autre extrémité: le Bogong, pic le plus élevé, atteint 6,100 pieds. De nombreuses rivières arrosent la colonie; la principale est le Murray, qui est en même temps la plus importante de toute l'Australie; sa longueur est de 1,300 milles; 158 lacs sont répandus ça et là, et leur surface varie depuis 57,000 jusqu'à 40 acres; quelques-uns sont salés.
La population en 1882 atteignait le chiffre de 906,225 âmes. Sur ce chiffre on compte 12,000 Chinois, et à peine 780 indigènes. Par rapport à la densité, on compte 10, 31 habitants par mille carré. Quant à la nationalité, je relève que nous sommes tout au bas de l'échelle dans toutes les colonies australiennes. Nous avons 1,042 Français en Victoria, 1,205 en Nouvelle Galle du Sud, 261 en Queensland, 213 dans l'Australie du Sud, 21 dans l'Australie de l'Est, 28 en Tasmanie, 614 en Nouvelle-Zélande, soit 3,384 Français sur 3 millions 1/2 d'âmes qui peuplent ces colonies.
(p. 400) Pour la religion, en Victoria, 210,070 habitants sont catholiques romains, 4,472 juifs, 11,563 païens, les autres sont protestants de diverses sectes. L'armée compte 3,000 volontaires avec 117 canons, et la marine 372 hommes et 58 canons.
Pour les terres, Victoria a aussi le système de sélection. Le nombre d'acres que chaque personne peut choisir est fixé à 320, au prix de 20 schellings payables en 20 ans, à 1 sch. par an; le sélecteur doit cultiver le dixième de son terrain, améliorer le reste jusqu'à concurrence de 20 sch. par acre, et résider 5 ans sur la terre.
Le revenu en 1882 était de 5,592,362 l. stg.; la dépense de 5,145,764 l. stg. La terre vendue dans la même année comprend 441,443 acres, ayant réalisé 598,079 l. stg.
La terre cultivée comprenait 2,040,916 acres.
Le bétail s'élevait à 280,274 chevaux, 1,287,088 têtes bovines, 10,174,246 moutons, 237,917 porcs.
Les 1,218 bureaux de poste avaient timbré 28,877,977 lettres et 12,383,928 journaux. Les navires entrés dans les ports de la colonie étaient au nombre de 2,089 avec 1,349,093 tonnes; 2,079 étaient sortis, jaugeant ensemble 1,341,791 tonnes. L'importation s'est élevée à 18,748,081 l. stg., et l'exportation à 16,193,579 l. stg. Dans ces chiffres, la laine figure pour 108,029,246 livres, du prix de 5,902,624 l. stg.; le suif pour 13,722,240 livres, du prix de 189,304 l. stg.; les peaux pour 136,105 l. stg.; blé, farine, pain et biscuits pour 3,457,390 boisseaux, de la valeur, de 966,487 l. stg. La dette publique en 1882 était (p. 401) de 22,103,202 l. stg. L'or extrait dans la même année était de 898,535 onces, du prix de 3,594,144 l. stg.
Les 1,355 milles de chemin de fer avaient donné 1,781,078 l. stg. Les 336 bureaux télégraphiques avaient expédié 1,418,769 dépêches.
Les 12 banques, avec un capital de 9,432,250 l. stg., capital versé, avaient un asset de 31,248,586 l. stg., et liabilities pour 25,496,305 l. stg. Les 222 caisses d'épargne avaient reçu, de 122,584 déposants, 3,121,246 l. stg.; 776 sociétés de bienfaisance (friendly societies) comptaient 51,399 membres. Les 58 villes et villages possédaient une propriété imposable de 34,559,353 l. stg., avec un revenu de 458,781 l. stg. Les 2,417 écoles avaient 257,388 élèves inscrits. Sur les 135 élèves de l'Université de Melbourne, 73 avaient été gradués. Le nombre des personnes arrêtées avait été de 26,423, sur lequel 616 avaient passé devant le jury et 402 condamnées. Le nombre des usines était de 2,469, celui des mines de 4,149; on comptait 3,518 églises et chapelles.
Pour l'agriculture, 969,362 acres cultivées à blé avaient donné 8,751,474 boisseaux; 5,732 acres de vignes avaient donné 516,763 gallons de vin, 3,377 gallons d'eau-de-vie, outre 15,543 quintaux de raisin vendus pour la table. Le phylloxéra ayant fait son apparition, une loi prescrit l'arrachement des vignes attaquées et des vignes non attaquées, dans un rayon de 3 milles. Le propriétaire est indemnisé du montant de la récolte d'une année pour l'arrachement des vignes attaquées, et du montant de (p. 402) la récolte de 3 années pour les vignes non attaquées.
Le dimanche, tous les magasins, tous les bureaux, y compris la poste, sont fermés; c'est le bon jour pour visiter les œuvres catholiques. Il y a 70,000 catholiques à Melbourne et plusieurs paroisses; une superbe cathédrale est en construction. Mgr l'archevêque me reçoit avec bonté; c'est un bon vieillard un peu fatigué: les Pères Jésuites, les Carmes, les Sœurs de la Merci et de la Providence, tous Irlandais, ont de nombreux collèges, couvents, orphelinats. J'ai vu aussi une association de jeunes gens sous le nom de Young men Christian Association, et la Société des filles de Marie. À la cathédrale, j'entends une messe chantée par des voix d'hommes et de femmes d'un très bel effet.
Les parcs sont vastes et bien tenus; partout des joueurs d'organini, des vendeurs de glace ou de statuettes, tous Italiens. Au jardin zoologique, je remarque une belle collection de cocotoes, perroquets indigènes à belle crête, de nombreux kanguroos, des opossums, des chats sauvages, des ému ou autruche australienne, le dingo ou chien sauvage, le cassowary, immense dindon; l'oiseau à lyre, le pavo cristatus blanc, le pigeon couronné de la Nouvelle-Guinée, le démon de Tasmanie ou sarcophilus ursinus, petit chien noir et affreux qui tue les moutons; l'aigle sifflant et plusieurs aigles indigènes, de superbes tigres du Bengale, des lions d'Afrique, des ours de Bornéo, des alpaca et llamas de l'Amérique du Sud.
Le jardin est arrangé avec beaucoup de goût: au centre (p. 403) il y a un rond-point avec bancs et tables pour les pique-niques. Dans un des compartiments on a eu la bonne pensée de dresser quelques cabanes des anciens habitants; ce sont des écorces d'eucalyptus inclinées; on y a placé des armes, lances, casse-têtes, boomerangs, les totem ou insignes du clan, les filets, paniers, nattes et autres instruments fabriqués par les Australiens indigènes, et on a ajouté: Telle était la ville de Melbourne il y a 40 ans!
Je me rends aux divers faubourgs de Richmond, Kiew, Brighton, Authorn, etc.; ils ont tous leurs parcs et de magnifiques avenues.
Le 17 décembre, la journée se passe à visiter le palais de l'exposition, les jardins, les musées, les faubourgs et divers personnages. Je suis heureux de trouver une banque française: le Comptoir d'escompte de Paris; M. Phalampin, qui en est le directeur, est plein de bonté pour moi et me renseigne sur beaucoup de choses concernant le pays. Plusieurs des grandes maisons de commerce en Australie sont entre les mains de Belges. Ce sont des jeunes gens envoyés ici par l'Institut commercial d'Anvers. Cette école supérieure de commerce choisit tous les ans les élèves les plus distingués et leur donne 500 fr. par mois durant 3 ans, à condition qu'ils s'établissent à l'étranger dans le pays de leur choix pour étudier et faire le commerce. Tous ces jeunes gens réussissent, souvent ils deviennent chef de grandes maisons et demandent les marchandises belges. Ils sont ainsi bien plus utiles à leur (p. 404) pays que s'ils étaient restés chez eux pour passer quelques années dans la caserne.
Nous n'avons point de consul en ce moment à Melbourne; le chancelier me met en relation avec M. de Castella, qui possède dans le district de Leledale le vignoble le plus important de l'Australie. M. de Castella est de Fribourg (Suisse française), mais par son éducation et ses relations il appartient encore plus à la France; il veut bien m'emmener à son vignoble. Le chemin de fer nous fait bientôt franchir les 40 milles qui séparent Leledale de Melbourne; la contrée est ondulée. Au sortir de la zone des faubourgs, nous entrons dans les forêts d'eucalyptus qui couvrent la plus grande partie de l'Australie. De Leledale à Saint-Hubert, nous avons encore 7 à 8 milles et la voiture de M. de Castella nous prend à la gare pour nous déposer bientôt après chez lui.
Sur un petit mamelon qui domine la propriété, s'élève la maison du maître, flanquée d'une tour pittoresque. Un joli parc au-devant avec ses bouquets d'arbres et ses pelouses parsemées de corbeilles de fleurs. À côté, un superbe verger et fruitier réunit les légumes et les fruits de l'Europe. Derrière la maison, à une certaine distance, sont les ateliers, les caves et les pressoirs. De nombreux bébés viennent au-devant du papa, et j'arrive enfin à la reine du foyer, Mme de Castella, mère de huit enfants. L'aîné est en ce moment à Bordeaux pour suivre la vendange. Il se propose d'étudier ensuite la viticulture en Champagne, sur le Rhin et en Hongrie.
(p. 405) Les vignes sont de toute beauté; je compte jusqu'à 20 et 30 grappes sur chaque cep. Ici sont les chasselas suisses, là les ceps venus de l'Hermitage, sur le Rhône; ailleurs ceux de Bourgogne, ceux de Bordeaux, de Champagne et ceux du Rhin. Chacun donne un vin analogue au pays d'origine. 500,000 pieds sont déjà en rapport, et on continue la plantation. Le défoncement se fait par une triple charrue, et on plante les boutures à 2 mètres de distance en tous sens. On les plantait auparavant à 1 mètre, mais la vigne prenant un grand développement dans ce pays, le premier système rapporte autant que le second et épargne la moitié de main-d'œuvre. Les pampres sont étendus sur fil de fer, et le terrain nettoyé à la charrue deux ou trois fois l'an. Le phylloxéra n'a pas encore paru, mais l'oïdium se voit quelquefois; on le prévient par l'emploi du soufre. Un ennemi bien plus dangereux est la petite sauterelle; lorsque la grappe est encore jeune, elle se pose sur sa tige et en ronge l'écorce; la grappe tombe par son propre poids et le raisin est perdu. M. de Castella compte que ces malheureuses petites bêtes lui ont fait perdre, dans une seule année, plus de 50,000 gallons de vin. Après avoir essayé, mais en vain, plusieurs moyens de s'en débarrasser, il finit par placer dans ses vignes 300 dindons; ceux-ci furent de précieux auxiliaires tant que le raisin était vert; mais, dès qu'il fut mûr, ils préférèrent le raisin aux sauterelles, et on eut deux destructeurs au lieu d'un. Heureusement les sauterelles ne sont pas tous les ans si nombreuses. La grosse (p. 406) chenille est aussi parfois un ennemi à redouter. Ce n'est pas sans peine qu'on se fait vigneron dans les colonies, lorsqu'on ne l'a pas été d'abord dans la mère patrie. On marche par tâtonnements, on perd du temps et souvent les produits: écoutons plutôt M. de Castella lui-même. Dans une brochure qu'il adresse à la Société philomathique de Bordeaux, il dit: «Pour nous éclairer sur le choix à faire parmi tant de méthodes, nous nous mîmes à lire tous les livres sur le vin, que nous pûmes nous procurer: Chaptal, Pellicot, le comte Odart, d'Armailhac, Guyot, Vergnette, Lamotte, et d'autres encore. Malheureusement, notre manque d'éducation viticole préalable nous empêchait souvent de les comprendre, et notre expérience était trop restreinte pour nous mettre à même de choisir parmi tant d'enseignements divers ce qui convenait à chacun de nous, selon le climat et la nature des cépages.» Durant plusieurs années, le vigneron inexpérimenté fut obligé de passer à l'alambic une grande partie de sa récolte. Quelquefois ce fut le hasard qui vint à son aide et voici comment il le raconte lui-même dans sa brochure: «À plusieurs reprises des tonneaux de vin blanc placés à l'écart à la vendange se trouvèrent oubliés et ne furent pas remplis en même temps que les autres: L'un d'eux, un fût de 20 hectolitres environ, fut trouvé en vidange cinq semaines après qu'il avait été rempli de moût, le vin en était parfait; et, conservé longtemps, à dessein, il demeura un des meilleurs de ma cave. Par degré, à chaque vendange, je prolongeai l'intervalle entre (p. 407) le jour d'entonnement du moût, et le jour du remplissage jusqu'à la bonde.»
Néanmoins, tant de persévérance et de sacrifices étaient encore loin de recevoir leur récompense. Les Australiens aimaient le vin alcoolisé, la plupart des vignerons le droguaient avec de l'alcool et du sucre, et la réputation des vins coloniaux était tombée si bas que «douze ans après que j'avais commencé à planter, dit encore l'auteur de la brochure, la vigne était devenue une propriété si mauvaise que le coût d'arrachement était calculé dans toute évaluation de terre cultivée en vignes.»
Enfin des jours meilleurs arrivèrent pour les vignerons, grâce à la persévérance des plus intelligents.
À l'exposition universelle de Melbourne, l'empereur d'Allemagne avait offert un prix composé de 7 surtouts d'argent doré, d'une valeur de 25,000 fr., qui devait être adjugé à celui des exposants australiens dont le mérite artistique et industriel serait le mieux démontré par les hautes qualités de son produit. Le jury alloua ce prix à M. de Castella pour les vins de Saint-Hubert. Plusieurs autres récompenses, à diverses expositions, suivirent cette première distinction; les acheteurs se multiplièrent, et aujourd'hui c'est non seulement d'Australie, mais de Londres que M. de Castella reçoit des commandes de vin.
La moyenne de rendement est de 40 hectolitres par hectare et le coût du travail de 150 fr. par hectare et par an. Le prix du vin varie entre 15 et 35 schellings par caisse de 12 bouteilles.
(p. 408) La soirée se passe à bercer les gentils bébés à la balançoire et en causeries diverses, sous le ciel étoile. Le lendemain nous visitons la cave. Elle est à 2 étages et couvre 2,000 mètres carrés. Tout y est combiné pour diminuer la main-d'œuvre. Les charrettes apportent les paniers sous une bascule qui les prend et les déverse dans une machine à broyer. Le jus passe au tamis et s'en va dans les cuves; 25,000 kilos par jour sont ainsi broyés: Après 8 à 10 jours, le vin s'en va dans d'immenses fûts par des tuyaux en caoutchouc, et celui du pressoir est mis à part. Par ce système, le vigneron évite la nécessité de soutirer fréquemment les vins pour enlever le déchet. Il ne les soutire qu'une fois en 2 ans, les clarifie pour, mettre en verre, et les vend après 6 mois de bouteille. La cave renferme à l'heure actuelle pour plus d'un million de francs de vin. J'en déguste les diverses variétés; ils correspondent aux noms qu'ils portent: Hermitage, Bordeaux, Rhin, etc.; mais ils sont naturellement un peu plus forts à cause du climat plus chaud.
M. de Castella emploie une quarantaine d'ouvriers qu'il traite en bon père de famille; je le vois ordonner une distribution de vin, et il rend heureux son jardinier en lui remettant une belle pipe neuve. Même à Saint-Hubert, je trouve un Piémontais que M. de Castella emploie comme charron: il n'y a pas un coin du globe où je n'aie trouvé ces enfants des Alpes les plus endurants parmi les travailleurs.

Forêt de fougères arborescentes.
M. de Castella ne cultive pas seulement la vigne; sa (p. 409) propriété compte 1,500 hectares, il en loue une partie au prix d'environ 25 fr. l'hectare, nourrit 3,000 moutons, et sème de l'avoine qui produit de 30 à 40 hectolitres à l'hectare. En ce moment, il projette une industrie nouvelle, la préparation du lait concentré.
L'aimable propriétaire aurait voulu me retenir encore un jour pour me conduire chez son frère, qui a un vignoble près de là, et me faire visiter dans les environs de belles cultures de houblon tenues par les indigènes de race croisée; mais je dispose de peu de temps, et j'ai déjà organisé pour le lendemain une excursion à Ballarat.
Je prends donc congé de Mme de Castella; Monsieur m'accompagne en voiture avec plusieurs enfants. Nathalie, jeune fille de 10 ans, tient les rênes, et bientôt, au point où je trouve la diligence, je donne le dernier adieu à M. de Castella et à ses enfants. Je souhaite mille bénédictions à cette bonne famille, et poursuis ma route dans le nouveau véhicule. J'y trouve deux familles qui reviennent d'une excursion aux montagnes voisines couvertes de sassafras et de fougères arborescentes. Apprenant que je suis Français, les deux maris me prient sérieusement de faire mon possible pour que mon pays n'envoie pas les convicts en Océanie. Les journaux les ont tellement effrayés, que sur ce point ils ont presque perdu leur calme raison. Je les rassure de mon mieux, et leur fais observer que l'Australie avec ses colonies si prospères a pourtant eu les convicts pour point de départ. Nous traversons de nouveau les belles, forêts d'eucalyptus dans (p. 410) leurs innombrables variétés, et descendons à Leledale 2 heures avant l'arrivée du train. J'en profite pour visiter la ville. Avec ses 350 habitants elle est plutôt une ville future. Il y a presque autant d'églises que de maisons. J'en vois une qui porte pour titre Leledale Tabernacle, serait-ce pour des Mormons? Au sortir de la ville, je m'assieds près d'un grand arbre pour écouter le chant d'une bergère qui pousse ses vaches devant elle; ce doit être une Irlandaise. Enfin, le sifflet de la locomotive se fait entendre, et quelques heures après je suis à Melbourne.
Le 20 janvier, à 6 heures 1/2 du matin, je monte en chemin de fer en route pour Ballarat. La voie suit la baie jusqu'à Geelong, second port de Victoria. Après Melbourne c'est là qu'on embarque le plus de laine et de suif. La route ensuite pénètre dans les forêts d'eucalyptus; cet arbre a de nombreuses variétés: les uns sont blancs et perdent l'écorce, c'est l'eucalyptus globolus qu'on a propagé en Europe. Le bois en est léger, peu compacte et impropre à tout usage; le string bark, par contre, a une rude écorce qu'on détache pour la toiture ou les parois des maisons du pionnier; son bois est très dur et bon pour la construction; les autres variétés ont chacune leur spécialité pour l'emploi du bois ou de la feuille. Celle-ci est distillée et donne une huile qu'on dépure, on l'emploie beaucoup comme désinfectant, et pour combattre les maladies des voies respiratoires. On le prend par intervalles de 4 heures, à la dose de 6 gouttes, sur un morceau de sucre, ou bien réduit en teinture et (p. 411) par quelques gouttes délayées dans 1/4 de verre d'eau; ou bien encore par aspiration, en mettant quelques gouttes dans l'eau bouillante versée dans un plat. On le couvre d'un linge et on passe la tête dessous pour respirer la vapeur.
On l'emploie aussi pour la composition d'un baume excellent pour les plaies. Au milieu de tous ces eucalyptus, je lis les journaux du jour.
Pendant que j'étais à Melbourne, on venait de condamner à 12 mois de prison avec travaux forcés, un certain Samuel Nathan, propriétaire de maisons, pour le fait d'avoir loué des chambres meublées à des filles légères. Le jugement disait que c'était là travailler à la démoralisation de la communauté et à la perte des jeunes gens. Je m'attendais à voir les journaux protester et crier à l'intolérance. Au lieu de cela, je trouve dans leurs colonnes une lettre par laquelle le chef de police félicite le policeman qui a fait le procès-verbal, et les journaux, non seulement applaudissent, mais ils ajoutent qu'il ne suffit pas d'éloigner ces malheureuses que la société repousse, et qui sont forcées de porter plus loin leur triste industrie; mais qu'il faut encore couper le mal à la racine en obligeant tout séducteur à réparer sa faute en épousant sa victime. Qu'on est loin de ces idées dans d'autres pays!
Une des plaies des pays anglo-saxons, c'est la manie des paris durant les courses de chevaux. On voit en Angleterre, pour les courses du Derby, le Parlement suspendre (p. 412) ses séances, et on dirait que les Anglais se transforment dans ces occasions en autant de Chinois. Ici les honnêtes gens et le gouvernement font des efforts pour diminuer ce mal. En Victoria, non seulement on condamne les organisateurs de sweeps qui recueillent des sommes à parier sur tel ou tel cheval; mais la poste a même la faculté d'ouvrir toute lettre qu'on suppose contenir une correspondance à propos de sweeps.
Tous les jours les journaux donnent le compte rendu des séances des tribunaux. J'y lis toujours une quantité de condamnations à l'amende ou à la prison contre les blasphémateurs, les teneurs de mauvais propos, les insulteurs de femmes, et contre ceux qui vendent ou qui travaillent le dimanche.
Tout Australien trouve bien naturel que les tribunaux prennent souci de la morale publique et de la loi divine; il sait que toute violation de l'une ou de l'autre ne peut être qu'au préjudice de toute la communauté. Dans une occasion, un témoin s'est refusé à prêter le serment en justice, en protestant qu'il ne savait ce que c'était; mais il revint bientôt à d'autres sentiments et s'exécuta lorsqu'il se vit menacé de deux jours de prison pour mépris de la Cour. Les condamnations pour mauvais traitement des animaux sont aussi assez fréquentes.
Un journal, sous le titre de Struggle for life (lutte pour la vie), fait une curieuse statistique pour savoir qui du riche ou du pauvre vit plus longtemps. Il trouve que sur 1,000 personnes nées dans les familles aisées, après 5 ans (p. 413) il y en a encore 943 en vie; pendant que sur 1,000 personnes nées dans les familles pauvres, il n'en reste plus que 655. Après 50 ans, il reste des premiers 557 et des seconds 273. À 70 ans, les riches sont encore 235 et les pauvres 65. La moyenne de la vie, parmi ceux qui sont nés dans l'aisance, est de 65 ans, et celle de leurs frères pauvres est de 32 ans.
Depuis 3 jours les journaux sont remplis de dépêches, à propos de 3 enfants égarés dans la forêt, et aujourd'hui ils chantent victoire: les bébés sont retrouvés.
Le fait s'est passé à Stawell, petite ville de 7 à 8,000 âmes, à 176 milles de Melbourne; 3 petites filles de 6, 4 et 3 ans s'étaient égarées dans les bois. Les premières recherches n'ayant donné aucun résultat, et la population s'apitoyant sur le sort des parents et des enfants, le maire convoqua les personnes de bonne volonté. Tous les travaux sont suspendus pour que chacun puisse prêter son aide; les écoles mêmes sont fermées, afin que les enfants les plus grands aident à la recherche. On forme un plan, on se partage les quartiers et 3,000 personnes, hommes et femmes, les uns à cheval, les autres à pied, partent dans toutes les directions, à la recherche des égarées. Le soir, la plupart sont rentrés, mais sans les enfants. Le lendemain on combine un plan nouveau, les bandes s'éparpillent davantage, et enfin la grande cloche annonce que les enfants sont retrouvées; une voiture les ramène enveloppées dans des couvertures et a peine à fendre la foule pour arriver aux parents. Tout le monde est dans (p. 414) la jubilation. Voici ce qui s'était passé: 5 enfants, dont 2 garçons, jouaient au bord de la forêt et cueillaient des fleurs lorsqu'une discussion s'éleva à propos d'un bouquet et sur le chemin à prendre au retour. Les 2 garçons revinrent à la maison, les 3 petites suivirent une autre direction qu'elles croyaient la bonne. Les garçons rapportèrent que leurs compagnes avaient pris une fausse direction; mais, on en fit peu de cas. Ce n'est que le lendemain que l'on se mit à la recherche. L'aînée des petites filles prit les deux autres, une à chaque main, et continua à marcher droit devant elle. Lorsque la nuit arriva, elles posèrent leur chapeaux et s'endormirent sur l'herbe en regardant la lune qui était, disaient-elles, sur un grand arbre. Le lendemain, lorsque le jour parut, elles continuèrent à marcher; elles arrivèrent à une maison inhabitée et trouvèrent un pommier; l'aînée cueillit des pommes et en donna à ses petites compagnes; puis arrivée à un ruisseau, elle prit de l'eau dans son chapeau et leur en donna à boire. Elles continuèrent ainsi à marcher pendant le jour, et à dormir la nuit sur l'herbe, lorsqu'elles furent rejointes par un policeman à 11 milles (environ 17 kil.) du point de départ. Il est beau de voir, cet esprit de solidarité qui pousse toute une population à quitter ses travaux pour se mettre à la recherche de ces 3 petits êtres![Table des matières]
Ballarat. — Une distribution de prix. — À la visite d'une mine d'or. — Le cheval Charlee. — Creswick. — La mine d'or alluviale de Mme Berry. — Les salaires. — Arendale et l'ouvrier gentleman. — Le lac Windermere. — Le lac Burumbeet. — Huit kilomètres à travers les paddocks. — La station d'Ercildonne. — Un mérinos de 200 livres. — Les enchères chez Samuel Wilson. — Au galop avec un apprenti. — Départ pour Sydney. — Les vacances de Noël. — Un propriétaire et le jury. — Un vélocipédiste imprudent. — Encore l'eucalyptus. — Wodonga. — Albury. — Les Fallon's-Cellars. — La famille Frère. — La villa Saint-Hilaire. — Un laboureur apprenti. — On se fait maçon et menuisier. — Dix-huit kilomètres à cheval. — Coût et produit d'une vigne. — La nouvelle loi agraire. — Budget d'un squatter débutant. — Les colons allemands. — Pour cantonnier une lanterne et un drapeau. — Un run de 600,000 moutons. — Arrivée à Sydney.
Ballarat, la ville de l'or, date de 1851, époque où le premier or y fut découvert. Elle compte déjà environ 40,000 habitants. Elle est divisée en deux: Ballarat est et Ballarat ouest, ayant chacune sa municipalité. Les rues sont larges et flanquées de beaux hôtels et de riches maisons de banque. En quittant les quelques rues destinées aux affaires, on entre dans de belles avenues de 40 mètres de large, plantées de chênes, d'eucalyptus, de peupliers, et bordées de gracieuses maisonnettes entourées de jardins fleuris. La cathédrale catholique, l'hôpital, l'orphelinat sont de beaux monuments. Je me dirige vers l'habitation de l'évêque, située au bout de la ville, (p. 416) dans un splendide jardin. Mgr Moore n'est pas chez lui, il préside la distribution des prix au couvent de Lorette; je m'y rends aussitôt. Les parents remplissent la vaste salle décorée de dessins, de broderies et tapisseries exécutés par les élèves. La fête commence par la récitation d'un compliment à Monseigneur, puis une réunion de grandes jeunes filles vêtues de blanc s'avance et récite une petite pièce; une autre troupe d'élèves plus petites, vêtues de jaune, montrent leur talent musical dans l'exécution d'un morceau à 16 mains; ensuite arrive la 3e division, qui subit l'examen de catéchisme, enfin les bébés-fillettes, puis les bébés-garçons montrent aussi leur petit savoir par des fables et poésies.
Le nombre d'élèves est de 120; il n'y a point d'internat; ils sont bien l'exception dans ces colonies, et elles ne s'en trouvent que mieux.
Monseigneur m'adresse à une personne qui me donne des lettres pour visiter tout ce qu'il y a d'intéressant dans le pays et dans les environs. Sans lettres, on risquerait de ne point être reçu.
Je me rends d'abord à la mine connue sous le nom de Band and Albion Consols Cy. C'est une des plus importantes et située non loin de la ville. Je vois en passant une grande filature de laine et partout des puits de mines avec leur machine à vapeur, et un grand échafaudage pour l'extraction du minerai. Arrivé à l'usine, guidé par un agent de la Compagnie, je revêts un costume en toile cirée, chapeau idem et grosses bottes; puis je passe sur (p. 417) la cage qui doit me descendre au fond du puits. Ce n'est pas sans émotion que je me vois précipiter dans les ténèbres, sentant l'eau couler de tous côtés. Je me rappelle qu'il y a 3 jours, 4 ouvriers ont été jetés au fond de ce même puits, et y ont trouvé la mort par une simple inadvertance de celui qui fait fonctionner la machine. Mais je ranime ma confiance dans mon bon ange et j'arrive au fond à 700 pieds de profondeur. Là on allume une bougie, et nous marchons par l'eau et par la boue dans une infinité de galeries pour trouver la veine où travaillent les ouvriers. Ils emploient la poudre, et dans les endroits humides la dynamite; ils faisaient usage, pour le percement, d'une machine à vrille, mais on y a renoncé: la Compagnie a aussi éclairé la mine à l'électricité pour quelque temps, mais elle trouvait son emploi trop cher, et ne se sert plus que de bougies. Les ouvriers sont en petit nombre en ce moment; la veine est peu productive; 3 escouades de 40 hommes chacune se succèdent chaque 8 heures; ils gagnent environ 50 fr. par semaine. Ils paient 6 pence par semaine à la caisse de secours mutuels, et en cas de maladie ou de blessures occasionnées par la mine, ils reçoivent 25 fr. par semaine pour la première année, et 15 schellings durant les 6 mois suivants. La mine a déjà donné 22 tonnes d'or. C'est avec bonheur que je reviens à la surface, et que je revois le soleil. Mon cicérone me montrant le directeur, qui est un colosse, me dit: Il a déjà eu pour sa part plus d'or qu'il ne pèse. Les 20,000 actions de 1 l. stg. chaque (p. 418) ont valu jusqu'à 10 l. et donné un dividende de 2 sch. par semaine. Nous visitons l'usine. Le minerai porté à la surface est pilé sous des marteaux et grillé pour le délivrer du soufre et de l'arsenic, puis tourné dans des tonneaux avec le mercure qui l'amalgame. On sépare un oxyde de fer qui est vendu pour couleur, puis l'or séparé du mercure par évaporation est passé au creuset et réduit en lingots. On pile en ce moment 150 tonnes de minerai par jour.
En quittant l'usine, je vois qu'il ne me reste que peu de temps pour me rendre à la gare et prendre le train. J'aperçois une voiture arrêtée, et j'y prends place, priant le conducteur de me conduire à la gare: je l'avais pris pour un cocher; il était marchand ambulant. À tout instant il parle à son cheval, go on my Charlee; la grosse bête est alourdie par la graisse pendant que son maître s'amaigrit à crier après elle en termes polis. À la fin, voyant mon impatience et ma crainte de manquer le train, il crie: get up, rascal Charlee, will you? (Allons donc, vilain Charles, veux-tu?) À ce gros mot, Charlee comprend que son maître se fâche, il prend le galop, et bientôt je suis à la gare. Là, je veux payer, mais le maître de Charlee refuse, et ajoute: «Je ne suis pas cocher, c'est pour vous rendre service que je vous ai conduit.»
Le train se met en marche, et après une demi-heure il me dépose à Creswick. Je venais de visiter à Ballarat la meilleure mine d'or dans le quartz; je voulais visiter dans les environs de Creswick une mine d'or alluviale. (p. 419) On m'avait signalé celle connue sous le nom de Mme Berry comme la plus importante.
Il est trop tard pour y aller le soir même; mais le comptable, qui a habité l'Égypte et parle bien le français, combine l'excursion pour le lendemain matin à 5 heures, en autorisant un de ses clercs à m'accompagner. Il reçoit 50 l. stg. par semaine pour tenir les comptes de la Compagnie; il a un associé et 5 clercs.
Le 21 décembre 1883, à 5 heures du matin, la voiture est à la porte. Nous suivons la plaine, traversons villes et villages encore en plein sommeil, et arrivons vers les 6 heures à la mine de Mme Berry. Chemin faisant, nous en voyons plusieurs, les unes en activité, les autres abandonnées. Une d'elles a déjà coûté plus de 1,000,000 sans qu'elle ait encore rien rapporté. L'eau est en si grande quantité que les pompes ne suffisent pas à la sécher; 29 ouvriers y ont été noyés récemment.
À la mine de Mme Berry, le manager est encore au lit, mais il nous passe la clef; nous revêtons l'uniforme de mineur et descendons dans l'abîme à 400 pieds de profondeur. Un contre-maître nous conduit dans les galeries, à la faible lueur de nos bougies; partout on répare l'étayage; on emploie de fortes poutres, mais la poussée est telle qu'elles ne durent que 5 ans.
Arrivés au chantier, nous voyons la boue et le gravier que les ouvriers mettent en wagonnets. C'est le lit d'une ancienne rivière; elle a 200 mètres de large et contourne une colline. Pour l'atteindre, on a dû percer une croûte (p. 420) de basalte, traverser une couche alluviale, puis une autre stratification de basalte. Quand et comment ces bouleversements se sont-ils produits? C'est aux géologues à le rechercher. On tâtonne pour suivre le lit de la rivière; on perce des trous avec une vrille à diamant, et souvent on manque le bon côté seulement de quelques pas. Tous ces terrains qui produisent maintenant tant d'or étaient la propriété d'un Français; sa femme ne se plaisant pas en Australie, il les a vendus pour 30,000 l. stg., à une compagnie, et celle-ci la loue par lots à d'autres compagnies moyennant une somme fixe et le 7me-1/2 de l'or produit. La mine de Mme Berry a été ouverte il y a 4 ans, et est ainsi nommée du nom de la femme du premier ministre qui assistait à la cérémonie d'ouverture. Elle donne en ce moment 500 onces d'or par semaine. Depuis son origine, elle a donné 51,053 onces, de la valeur de 210,095 l. stg., plus de 5,000,000 de francs. Les actions étaient de 25 fr., et les actionnaires ont déjà reçu en dividendes environ 200 fr. Les 26 mines de Creswick et les 8 mines de Clunes près de là ont déjà donné 1,460,224 onces, de la valeur de 5,931,899 l. stg.; 6 mines sont maintenant en activité à Creswick et 4 à Clunes: les autres sont épuisées. L'or d'Australie est un des meilleurs connus, et l'or de la mine de Mme Berry est le meilleur or de l'Australie. 150 ouvriers travaillent jour et nuit dans les galeries, se remplaçant par escouades de 50.
Après avoir parcouru de longues galeries et passé par de nombreux petits trous, nous revenons au puits; mon (p. 421) conducteur me fait remarquer que le mécanisme qui fait fonctionner la pompe est le même qui envoie l'air au fond des galeries, et il ajoute: si la pompe se dérangeait et cessait de fonctionner, nous serions bientôt noyés.
La cage nous remonte à la surface, et nous grimpons sur un immense échafaudage, sur lequel reposent 3 grandes caisses de fer. La boue et le gravier de la mine y sont versés et lavés; l'eau emporte les parties terreuses; l'or, plus lourd, est retenu dans une petite caisse; on l'obtient ainsi facilement sans aucun recours à l'amalgamation par le mercure. Le produit journalier est d'environ 100 onces. La Compagnie paie 1,100 l. stg. de salaires par semaine.
Au retour, mon cicérone me montre une jolie petite ville bien tracée qui renferme déjà 500 habitants et possède 6 églises. C'est Arendale. Elle appartient à un des ouvriers mineurs. Il a acheté un Paddock (enclos de terrain à paître les animaux), y a tracé la ville et construit des chalets pour les ouvriers mineurs; il les leur loue assez cher; son entreprise a réussi et il est maintenant un seigneur. Nous le rencontrons en effet à Creswick; le clerc me présente à lui, ce n'est plus un ouvrier que j'ai devant moi, mais un parfait gentleman à chapeau haut de forme, bottes vernies, et habit à la dernière mode. Nous faisons route ensemble jusqu'à Ballarat; il cause bien et rend volontiers service. Apprenant que j'ai encore un peu de temps à passer à Ballarat, il appelle un cocher et lui dit: Vous allez conduire ce Monsieur au jardin public (p. 422) et lui ferez faire le tour du lac. Cette promenade m'a paru charmante: il me semblait faire le tour du lac d'Enghien.
À 11 heures, je suis à la gare, et le train me conduit à travers une plaine tantôt cultivée, tantôt boisée. Après quelques kilomètres; nous laissons à gauche le lac Windermere. Son homonyme en Angleterre est encadré de vertes collines, pendant qu'ici je ne vois que des plaines. Après une demi-heure, je descends à la gare de Burrumbeet, sur les bords d'un grand lac salé. Là, je demande au chef de gare la station d'Ercildonne, appartenant à M. Samuel Wilson.—Marchez tout droit devant vous, me dit-il, dans la direction de ce pic; après 5 milles vous trouverez la maison au pied de la colline. C'est donc 8 kilomètres à pied qui me restent à faire. Je prends bon courage, traverse les paddocks et saute les barrières; de temps en temps des vols de pies à plumage noir et blanc font entendre leurs cris désagréables; c'est ici un animal sacré; on serait mal venu de le tuer, car il détruit beaucoup d'insectes. L'herbe est haute et belle; bien souvent quelques beaux lièvres partent à mes pieds, éveillés par le bruit de mes pas. J'en vois un à demi-dévoré par un aigle. Ce roi des airs fond sur sa victime endormie et de son bec crochu lui perce le crâne, puis y prend sa nourriture.

La tonte des moutons.
Je remarque aussi quelques trous de lapins, mais on s'en défend par le poison et par certains pièges. On tend même des filets pour les empêcher de pénétrer dans la (p. 423) propriété durant leurs migrations. Elles ont lieu pendant la nuit et par troupes; ils se dirigent généralement vers le nord. Le gouvernement donne aux trappeurs une prime de tant par 100 peaux; avant, il payait tant pour chaque queue, puis pour chaque paire d'oreilles. La multiplication de ce petit animal est effrayante; il est rusé, se tient sous terre, et il n'est pas aisé de le combattre. Le lièvre par contre produit peu, se tient sur terre, et n'est point rusé; on pourrait, avec de l'avoine empoisonnée, les détruire tous dans une nuit sur une propriété.
(p. 424) J'arrive à une maisonnette isolée; la fermière est en train de mettre son pain au four; elle m'indique ma route; je passe près d'un petit lac aux bords boisés. Deux cents moutons sans queue et sans laine se reposent à l'ombre. On coupe toujours la queue aux moutons en Australie, et la tonte commence en octobre.
Plus loin, je remarque de beaux blés et de belles avoines qu'on coupe pour foin. Les haies des paddocks sont partie en bois, partie en fil de fer très épais: ces haies coûtent 1,500 fr. le mille de 1,600 mètres. Le long de la haie, à un mètre ou deux de distance, on a tracé un double sillon destiné à arrêter le feu. En cas d'incendie, l'herbe brûlerait, mais la haie serait préservée. Enfin, j'arrive dans un vaste parc garni de pièces d'eau, rocailles, saules pleureurs et fleurs de toute sorte. Vers le haut du parc un petit château disparaît presque sous la verdure; j'aperçois de loin un groupe de dames, mais elles s'éclipsent à mon arrivée. Je demande le manager; on me conduit à sa maison, qu'entoure un charmant jardin; je lui présente une lettre d'introduction, et je demande à visiter la propriété. Il m'offre d'abord un petit lunch, puis me donne quelques détails. M. Samuel Wilson et sa famille sont en ce moment en Angleterre; il vient d'acheter à Londres une maison pour 50,000 l. stg. et une propriété pour 200,000 l. stg. Il a donné 30,000 l. stg. pour l'université de Melbourne et a reçu le titre nobilier de Sir, Il possède 4 stations (c'est le nom qu'on donne aux terres destinées à l'élevage du bétail) en Victoria et 2 en (p. 425) Queensland; ces deux dernières ont plus de 200,000 moutons. La station de Ercildonne est la plus petite des quatre de Victoria; elle compte 26,000 acres et possède 40 mille moutons. Elle est célèbre par ses mérinos. On sait que ces moutons étaient passés en Espagne et venaient des Argoli mouton sauvage de Colchis et de Milète. Pendant longtemps, l'Espagne défendit sous les peines les plus sévères l'exportation des mérinos; mais en 1765 l'Électeur de Saxe en reçut en cadeau du roi d'Espagne quelques-uns de ses meilleurs. Une partie de cette race fut plus tard achetée en Saxe et transportée en Tasmanie, d'où ils sont passés en Australie. Leur laine est la plus fine connue; on la file pour de la soie, et on la paie à Londres jusqu'à 5 schellings la livre. La propriété expédie annuellement à Londres de 4 à 500 balles de laine de 250 à 300 livres chaque, et en obtient un prix de 16 à 17,000 l. stg. Tous les ans, M. Wilson met aux enchères une centaine de ses béliers qui se vendent de 100 à 400 l. stg. chaque; un d'eux a atteint le poids de 198 livres 1/2. Pour les enchères, les acheteurs trouvent les moutons séparés et numérotés, et une vaste salle où ils prennent leur lunch aux frais du vendeur. Des brochures à couverture en maroquin sont distribuées d'avance dans toutes les directions; elles portent l'historique de la propriété, les prix et la photographié des principaux béliers.
Je demande au manager de me faire visiter la propriété: il me conduit à travers le parc; j'ajoute que nous ne manquons (p. 426) pas de parcs en Europe et que je suis venu pour voir les moutons. Il me dit qu'il n'a pas de chevaux, qu'il n'a pas de voiture: mais bientôt après, passant devant les écuries, je lui montre de nombreux chevaux et voitures. Je comprends enfin à son embarras que Madame a réception et que probablement les chevaux et véhicules sont pour les dames qui se sont éclipsées le matin. Il finit par me donner un apprenti. C'est un jeune homme qui a déjà passé une année dans une station de bœufs: il passe un an dans cette station de moutons pour apprendre le métier, puis il prendra en Queensland une station à son compte. Nous montons à cheval et arrivons aux écuries des béliers: ils ont chacun leur petit compartiment, le pavé est en linteaux espacés pour laisser passer par dessous tout le fumier; les moutons ont là carottes et avoine en abondance et peuvent sortir à volonté pour brouter l'herbe dans un paddock d'une acre par tête. Ils sont recouverts d'une toile pour préserver la laine des taches et de la poussière, car ils figurent généralement dans les expositions et rapportent au maître des médailles d'honneur.
Chemin faisant, le jeune apprenti m'apprend que 6,000 moutons environ sont vendus tous les ans à la station; que les moutons donnent de 8 à 9 livres de gros suif par tête, de 4 à 13 livres de laine, et qu'ils ont souvent une maladie aux pieds qu'on soigne avec une composition d'arsenic passée au pinceau.
Nous galopons à travers plaines et collines et arrivons (p. 427) aux paddocks des vaches et des bœufs. Ils sont 300 et me paraissent de forte taille. Tous les paddocks étant clôturés, les bergers sont superflus; il suffit de quelques hommes pour faire le tour des haies et voir si elles sont en bon état. Ces hommes sont nourris et reçoivent de 6 à 7 sch. par jour, autant que pour une semaine en Angleterre.
Nous voyons en route de fort belles récoltes de blé et d'avoine; elles sont la propriété de divers selecteurs qui, en vertu de la loi, sont venus choisir leur 320 acres sur la propriété pendant qu'elle n'était encore que louée.
Enfin j'arrive à la station pour le départ, et le soir, à 11 heures, je suis à Melbourne.
Le 22 décembre, à 6 heures du matin, je pars pour Sydney; la voie passe par Albury, où je dois visiter le vignoble de M. Fallon, le plus célèbre de la Nouvelle-Galles du Sud; il a pour manager un Français, M. Frère. On multiplie les trains, mais ils sont tous encombrés; tout le monde part en vacances. Ce sont les Christmas Holidays (vacances de Noël). Le chemin de fer accorde l'aller et retour pour le simple prix d'aller. À la sortie des faubourgs, je remarque encore quelques paddocks bien verts, puis nous entrons dans la forêt d'eucalyptus. Cet arbre est joli dès qu'il est jeune, mais il enlaidit en vieillissant; sa couleur verte est sombre; de loin, on le prendrait pour l'olivier.
Les journaux sont remplis de détails sur l'organisation des volontaires, l'achat de torpilles, construction (p. 428) de batteries; est-ce contre les futurs récidivistes qu'on monte un si grand appareil? C'est dépasser le but. L'Australie du Sud a eu bonne récolte de blé calculée à 5,000,000 de l. stg.; elle pourra en exporter 540,000 tonnes. Cette jeune colonie compte aussi 15,000 blue ribbons, ou associés de ruban bleu, qui s'engagent à s'abstenir de toute boisson enivrante. Je lis aussi une curieuse aventure d'un grand propriétaire qui demandait 30,000 l. stg. pour une bande de terre que le chemin de fer enlevait à sa propriété; le jury lui a alloué 230 l. stg. Il a obtenu alors un nouveau jury en basant sa demande d'indemnité sur le morcellement de la propriété; le 2e jury lui accorde 260 l. stg. Il a voulu un 3e jury auquel il soumettait la demande d'indemnité pour le danger d'incendie par les étincelles de la locomotive. Ce 3e jury a perdu patience et, calculant les avantages et les dommages, a déclaré ce propriétaire débiteur de 60 l. stg. envers la Compagnie du chemin de fer, bien entendu les frais à la charge du demandeur. Il est probable qu'il ne demandera pas un 4e jury.
À Melbourne, un jeune freluquet est conduit devant le magistrat pour avoir marché sur les trottoirs avec le vélocipède; il est condamné à 5 l. stg. d'amende; il donne pour excuse que le premier ministre en fait autant.—«Qu'on me le dénonce, dit le magistrat, et je le traiterai de la même manière.»
À 1 heure 1/2 j'arrive à la station de Wadonga, la dernière de Victoria; au-delà du Murray, la station d'Albury (p. 429) est déjà en Nouvelle-Galles du sud. L'écartement des rails n'est pas le même dans les deux colonies; il faut changer de train. À 2 heures je suis à Albury, distant de 190 milles de Melbourne et de 384 de Sydney. La station est aussi belle que celle de nos grandes cités. La ville naissante compte de 4 à 5 mille habitants: elle a de belles rues, de larges avenues, beaucoup d'églises et beaucoup de banques. Je rencontre George Frère, jeune homme de 18 ans, aimable et prévenant. Il me fait visiter les caves de M. Fallon. Elles contiennent 300,000 gallons dans des fûts de 80 hectolitres; le prix est de 6 schellings le gallon. J'en déguste plusieurs qualités, de blanc et de rouge, et les trouve excellentes. Après une visite au Cricket ground, où le jeune Frère est intéressé à une partie, il me prend dans sa voiture et me conduit chez ses parents à la campagne. Elle est à 9 kilomètres d'Albury; la route est pittoresque; nous grimpons de petites collines, passons devant une chapelle catholique et arrivons à Saint-Hilaire. Les époux Frère, auxquels M. Phalampin m'avait recommandé, m'accueillent comme un compatriote; ils ont chez eux un jeune ménage en vacances de Noël: c'est l'ancien instituteur de la ville voisine qui a appris à George l'anglais et la géométrie. Les bonnes Sœurs du couvent d'Albury ont aussi aidé à son instruction, et sa mère l'a complétée. Le jeune George à 18 ans parle déjà 3 langues: le français, l'anglais et l'allemand. Malgré ces visiteurs, il y aura encore place pour moi dans la maison. Les jardins qui l'entourent sont garnis (p. 430) de fleurs et de fruits; on y voit même un olivier très prospère. La propriété compte 90 hectares, dont 50 sont déjà plantés en vignes et en plein rapport.
Les époux Frère sont venus ici il y a 10 ans. Le mari avait été engagé comme directeur du vignoble de M. Fallon, avec de très beaux appointements. Il a appelé son frère, et tout en dirigeant le vignoble de M. Fallon, ils cultivent la terre qu'ils ont achetée pour leur propre compte. Tous les travaux sont faits par eux; ils ont bâti leur maison, et construisent en ce moment une grande cave. Voyant que, sans être reçu maçons, ils réussissaient dans la maçonnerie, ils ont fait leur menuiserie. Elle ne gagnerait pas le prix de perfection, mais elle mériterait certainement celui d'application. M. Frère, sans avoir jamais connu la charrue, a pourtant commencé à déchirer la terre; les difficultés surgissaient de tous côtés. D'abord les chevaux avaient été habitués aux sons anglais et M. Frère ne parlait que le français; il a fallu refaire leur instruction, et durant l'intervalle les pousser au moyen d'une longue perche. Lorsque les chevaux ont su obéir, il a fallu apprendre à se faire obéir par la charrue.
Saint-Hilaire se trouve sur un monticule; on n'a pour boire que l'eau de la pluie et pour les animaux l'eau d'une mare. Durant les étés chauds, la mare sèche et il faut aller puiser l'eau au Murray, à 10 kilomètres. Mme Frère, à son tour, ne reste pas inactive; elle a pris à sa charge la préparation de la nourriture et l'entretien (p. 431) de la maison. Rien n'a jamais manqué aux travailleurs de bonne volonté; elle sait même le soir charmer leur repos par l'harmonie du piano, en accompagnant le violon du jeune George. Celui-ci, tout en travaillant à son instruction, trouvait encore le temps d'aider à son oncle et d'apprendre avec lui les divers métiers de charpentier, menuisier, laboureur et maçon. Maintenant les jours les plus durs sont passés, et la fortune va entrer dans cette famille. Elle ne pourra tomber en meilleures mains, car on n'apprécie bien que ce qui a bien coûté: elle sera la récompense méritée du travail et de la vertu. Rien d'étonnant à ce que la famille Frère soit honorée et aimée dans le pays. Que n'avons-nous partout à l'étranger de telles familles! elles feraient connaître et aimer la France!
Tout en causant minuit arrive. Le lendemain, c'est dimanche. À 6 heures du matin, George et moi, sommes à cheval, en route pour Albury. Nous avons 18 kilomètres, aller et retour, pour avoir la messe. À la chapelle voisine, on ne la dit qu'une fois par mois. Les mouches sont insupportables; elles s'attaquent aux yeux. George sort de sa poche une espèce de filet, en usage dans le pays; il le passe à mon chapeau, et le balancement des ficelles éloigne ces ennuyeux insectes. En Provence, on emploie un filet analogue pour en préserver les mulets.
Chemin faisant, George m'explique les propriétés des diverses sortes d'eucalyptus; le white-box à feuille ronde (p. 432) n'est bon qu'à brûler, le string-bark, par sa première écorce sert à faire des toitures; sa seconde écorce est employée à former des cordes; son bois est très dur et très résistant au sec, mais pourrit à l'humidité: le red-gum, par contre, se conserve aussi bien sous terre et dans l'eau, qu'au sec. Nous voyons des vols de merles, de perroquets et des laphing-jakal (oiseau riant), espèce de geai qui imite les éclats de rire de l'homme. Ils se mettent à deux sur une même branche pour faire leur partie de rires; il est défendu de les tuer, parce qu'ils détruisent les serpents et surtout l'iguana, terrible lézard de 4 à 5 pieds de long. Des lièvres fuient devant nous, on les laisse en paix, mais on prend les corbeaux et on les empale pour éloigner les autres; ils sont grands mangeurs de raisin.
À notre retour, M. Frère me donne plusieurs détails sur le pays. La main-d'œuvre est généralement payée 2 l. stg. par semaine à la ville et 1 l. stg. et nourriture à la campagne. Le chemin de fer paie ses ouvriers 1 sch. (1 fr. 25) l'heure, et ils travaillent 8 heures par jour. Les conducteurs de locomotive en arrivant aux stations trouvent leur nourriture chaude, et leur lit préparé.
La température à Saint-Hilaire atteint quelquefois 46° à l'ombre en janvier, et descend jusqu'à 4° centigrades en juillet. La terre que M. Frère a payée 4 l. stg. l'acre, soit 250 fr. l'hectare, il y a 5 ans, vaut maintenant 10 l. stg. l'acre, soit plus de 625 fr. l'hectare. Il a adopté un système de plantation fort économique et qui lui a bien (p. 433) réussi dans la terre rouge. Il fait un labour simple à 30 centimètres, et plante les boutures de vignes dans un trou profond de 50 centimètres au moyen d'une barre de fer; il remplit le trou avec une pâtée de terre, de fumier de poule et de cendre: le tout adhère bien aux sarments et ceux-ci, ne pouvant se développer de côté, poussent leurs racines au fond. La plantation dans cette forme coûte entre premier et deuxième labour 3 l. stg. par arpent. Son entretien est de 2 l. l'acre par an. Après trois ans, avec le prix d'achat à 4 l., elle a coûté 13 l. l'acre, et donne 60 gallons l'acre; à la quatrième année elle donne 120 gallons, la cinquième année et les années suivantes 200 gallons, et dure en moyenne 35 ans. Elle coûte alors 5 l. par an pour labourage, bêchage autour du cep, attachage, taille, etc. Pour la taille on ne laisse que deux yeux et 8 à 9 branches, selon la force de la vigne. On vend le moût à la récolte de 1 sch. 3 deniers à 1 sch. 1/2 le gallon. Si on veut faire la dépense de la cave et des tonneaux, après un an, on vend le vin 3 sch. le gallon. Dans le premier cas, on a de 250 à 300 sch. l'acre, et 600 sch. dans le second cas. M. Frère fait sa spécialité de la fabrication du champagne.
Le pays fournit aussi de grandes ressources à l'éleveur de moutons. Une loi nouvelle sur la vente et location des terres de la couronne est maintenant en discussion au Parlement à Sydney. Le projet sera certainement modifié, mais ses principales dispositions seront maintenues. Ce projet de loi divise la contrée en (p. 434) trois zones: la zone agricole à l'est, la pastorale à l'ouest, et la zone intermédiaire. Dans la première, toute personne âgée de 16 ans peut choisir 648 acres, en déposant 2 sch. par acre, en clôturant sa propriété, et y résidant pendant 5 ans. Après 3 ans, il paiera 1 sch. 1/2 pendant 15 ans, après quoi il sera propriétaire définitif. Il peut le devenir avant, en soldant le prix, et dans ce cas on lui tient compte de l'intérêt. Dans la deuxième zone, on peut choisir jusqu'à 2,500 acres. Dans la troisième, on peut louer pour 15 ans jusqu'à concurrence de 10,000 acres pour un loyer annuel de 2 pence (20 cent.) par acre.
Mon interlocuteur croit que le jeune homme qui arrive avec une cinquantaine de mille francs peut assez bien réussir. Pour cela, il doit placer son argent à la banque qui lui en donne un bon intérêt; s'en aller sur une station pour au moins six mois, afin de bien apprendre le métier: louer dans la 3e zone 10,000 acres et y placer 1,000 brebis qui lui coûteront 10 francs l'une en moyenne, et lui donneront 5 francs de laine par an. Les agneaux augmenteront le troupeau, et la cinquième année il pourra avoir 4,000 moutons qui lui donneront 20,000 francs de laine; alors l'augmentation du troupeau sert à faire face aux frais d'entretien, et paie la dépense. Il pourra ensuite acheter des terres dans la 2e zone. Bien entendu un tel jeune homme ne doit pas arriver avec gants et badine, mais bien décidé à travailler même de ses mains. Pour faire le squatter en seigneur, il faut avoir facteur, domestiques, (p. 435) etc., et au moins 20,000 moutons pour faire les frais. Une bonne station de 40,000 moutons demande 40,000 acres de bonne terre, et coûtera, moutons compris, environ 2,000,000 de francs; mais ce capital rapportera de 15 à 20% l'an. La plupart de ces squatters vivent en Angleterre, laissant la direction à un manager auquel ils donnent de gros; appointements, ou qu'ils mettent en participation. La contrée est pleine de ressources pour les travailleurs et pour les capitaux.
L'heure du départ est arrivée. La famille Frère m'accompagne à 3 milles à Ettamogah, gare la plus voisine. Chemin faisant, on me montre l'endroit où se sont groupées plusieurs familles allemandes protestantes, et un peu plus loin, plusieurs familles allemandes catholiques, formant ainsi 2 colonies distinctes. Le gouvernement allemand envoie des inspecteurs sur tous les points du globe pour lui rendre compte de l'état des colons. Le dernier inspecteur leur a fait venir ici, sur leur demande, un pasteur et un maître d'école allemand. Je demande à mon tour à M. Frère quelle est des deux colonies catholique et protestante celle qui réussit le mieux; il me répond que pour l'honneur de la vérité il doit dire que les protestants réussissent mieux, parce qu'ils sont plus travailleurs; il fait exception pour 2 familles catholiques qui, étant aussi travailleuses, sont arrivées à la prospérité. À la gare d'Ettamogah, je ne vois ni cantonnier, ni employé, le personnel coûte cher, et on l'économise le plus possible. Un drapeau et une lanterne forment tout l'ameublement; lorsque (p. 436) des voyageurs veulent monter dans le train, ils agitent le drapeau, et le train s'arrête; de nuit ils agitent la lanterne. S'il n'y a point de voyageurs, le train continue sa route.
Avec beaucoup de peine, je peux obtenir un lit dans le Sleeping car, les numéros sont presque toujours retenus d'avance. Ces lits sont moins commodes que dans les wagons américains. J'ai pour compagnon de voyage un colon de Bâle. Il est père de 10 enfants, et a essayé divers métiers dans la colonie. Actuellement il s'est uni à 2 autres Allemands et a loué pour 20 ans un run de 825,000 acres. Il est situé en Queensland à 70 milles de Charlesville. Le loyer est de 30,000 l. (750,000 fr.) pour les 20 ans, échelonné en 3 paiements. Il a commencé, il y a 2 ans, avec 29,000 moutons, et 5,300 vaches. Il a maintenant 40,000 moutons et 9,000 têtes bovines; il espère atteindre le chiffre de 600,000 moutons. Le vaste terrain n'est pas clôturé, et il lui faut un berger par 10,000 moutons. En qualité de manager (intendant), il reçoit une paye élevée; les autres associés ne mettent que le capital. Son fils aîné reste sur la station, et sa fille aînée tient la maison. Lui-même est très souvent au run (station). Il me raconte que la vie y est très pénible; ils sont fréquemment obligés la nuit de monter à cheval pour chasser les chiens sauvages et les porcs qui effraient le bétail et tuent les moutons. La fortune qui arrive au bout d'un si rude métier est bien gagnée. Mon colon vend les moutons gras sur place, de 6 à 7 schellings. Chaque mouton lui donne en moyenne (p. 437) 5 livres de laine; il vend les jeunes bœufs à Sydney à 11 l. stg., mais il a 1 l. 1/2 de frais de transport. Nous continuons à traverser les forêts d'eucalyptus; mon compagnon sait me dire où le terrain est bon, où il est médiocre, où il est mauvais, et où on le vend pour 1 ou 3 ou 4 l. l'acre. Vers la nuit nous voyons briller dans la forêt par-ci, par-là, les incendies de l'herbe sèche, puis nous prenons le lit, et le lendemain nous nous réveillons à Sydney. Le train, trop chargé à l'occasion des vacances de Noël, avait dû être scindé en deux, d'autant plus que sur certains points, la ligne monte jusqu'à 2,000 pieds d'altitude. J'attends donc la deuxième moitié du train pour avoir mes bagages et me rends à l'hôtel.
Pages
Préface I
Chapitre Ier.—République de l'Équateur.
République de l'Équateur. — Surface. — Population. — Histoire. — Quito. — Guayaquil. — Le cacao. — La résine. — L'ivoire végétal. — Le quinquina. — Le tamarin. — Le caoutchouc. — La guerre civile. — Le Guayaquil. — Les crocodiles et le jeu de la pezéta. — Arrivée à Panama. 1
Chapitre II.—Panama.
La ville de Panama. — La République de la Colombie. — Situation. — Surface. — Population. — Produits. — La Compagnie universelle du canal interocéanique. — Le personnel. — L'hôpital. — L'isthme. — Le canal et ses dimensions. — État des travaux. — Moyens d'exécution. — Le barrage du Chagre. — Le chemin de fer. — La ville et le port de Colon. — Résultat du percement de l'isthme. 11
Chapitre III.—Les Antilles.
La Jamaïque. — Situation. — Surface. — Produits. — Température. — Histoire. — Population. — Justice. — Contributions. — Les coolies hindous. — Irrigation. — Chemins de fer. — Importation. — Exportation. — Main-d'œuvre. — Les Building Societies. — Les îles annexes. — La ville de Kingstown. — Le marché. — Une école professionnelle. — Une plantation de cannes à sucre. — Les campagnards. — La garnison. 24
Chapitre IV.
Haïti et San-Domingo. — Port-au-Prince. — Les Nègres. — La révolution. — L'île Saint-Thomas et le groupe des Vierges. — Histoire. — L'esclavage. — La ville et le port. — La Royal-Mail. — Excursion dans l'île. — Une plantation de cannes. — Les ouragans. — San-Juan de Porto-Rico. — Navigation vers Cuba. 35
Chapitre V.
L'île de Cuba. — Situation. — Configuration. — Surface. — Histoire. — Population. — Produits. — Climat. — Importation. — Exportation. — La Havane. — La ville. — Les environs. — La Corrida de Toros. — La cathédrale. — La fièvre jaune. — Les œuvres charitables. 49
Chapitre VI.
Excursion à Marianao. — La plantation de cannes de Toledo. — Un orage. — 400 esclaves. — Culture de la canne. — Fonctionnement de l'usine. — Détails et prix. — L'administration espagnole dans la colonie. — Le papier-monnaie et la Banque espagnole. — Les autonomistes et les conservateurs. — Avenir probable. — Production du sucre et du café dans le monde entier. — Le tabac à la Havane. — La fabrique de cigares de Villar-Villar. — La fabrique de cigarettes de Diego Gonzales. — Le marché. — La presse. — Le départ. — Navigation dans le golfe du Mexique. 63
Chapitre VII.—Le Mexique.
La République mexicaine. — Surface. — Constitution. — Population. — Les diverses branches ou familles indiennes. — Cause de leur dépérissement. — Revenus. — Dépenses. — Chemins de fer. — Télégraphe. — Poste. — Instruction publique. — Mines. — L'isthme de Tehuantepec. — Histoire. — Fernando Cortez et la conquête. — Fin de Montézuma, dernier empereur des Aztecas. — Les sacrifices humains. — Le vice-roi. — Fin tragique de deux empereurs. 81
Chapitre VIII.
Débarquement à Vera-Cruz. — Construction du port. — La ville. — La fièvre jaune. — Départ pour Mexico. — Le chemin de fer. — Orizaba. — Maltratta. — Le Citlaltepelt. — Le pulche. — Mexico — Les hôtels. — La ville. — La cathédrale. — Les toros. — Les loteries. — Le Paseo. 93
Chapitre IX.
Excursion à Guadalupe. — Les faubourgs. — L'armée. — Le sanctuaire. — Les œuvres charitables. — L'administration ecclésiastique. — Les banques. — Le musée. — La pierre du Soleil. — La déesse de la terre Coatlicue. — Le dieu des morts Mictlanteuhtli. — Les pierres à jeu de paume. — Les chevaliers aigle et le messager du Soleil. — Quetzalcoalt, ou le sage mystérieux. — Les inscriptions. — Les urnes funéraires. — Les vierges ou prêtresses. — Manière de marquer le temps. — Le cycle ou xinhmopillé. — Chalchinhtlicue, déesse de l'eau. — Tlaloc, dieu du tonnerre. — La céramique. — Les bijoux. — L'écriture. — Le Sénat. — Le Conservatoire. 105
Chapitre X.
État pitoyable des logements du peuple. — Moyens d'y remédier. — Couper le mal à la racine vaut mieux que soigner les plaies. — La ferme de Tacubaja. — La foire. — La forêt de Chapultepec. — Le ministre de fomento. — L'Observatoire. — Le ministre du Chili. — Le ministre de France. — La colonie française. — Les Basques et les Barcelonnettes. — La chambre de commerce. — Les colonies de Chacaltepec et de Saint-Raphaël, et les théories fouriéristes. 123
Chapitre XI.
Départ de Mexico. — Les lignes de chemins de fer. — La culture. — Queretaro et la fin tragique de Maximilien. — Arrivée à Guanajuato. — Trois étudiants journalistes. — Un journaliste français et la Commune de Paris. — La ville de Guanajuato. — Visite de la mine de la Cata. — Détails d'exploitation. — Situation de l'ouvrier. — Rendement. — La mine de Valenciana. — La hacienda de mineria de Saint-François-Xavier. — Détails de fonctionnement. — Une aventure à l'hôpital. — Les œuvres de charité. 132
Chapitre XII.
Départ de Guanajuato. — Silao. — La presse. — Lagos. — Route à Ojuelos et à San-Luiz de Potosi. — San-Luiz. — Le Gouverneur. — L'école de artes y oficios. — Le départ. — La femme du postillon. — Je suis seul voyageur. — Le brigandage. — Les villages de l'intérieur. — Un perroquet traître. — Les mendiants. — Une nuit à Chalca. — Un Barcelonnette. — Un ancien colonel garibaldien. 151
Chapitre XIII.
Départ de Chalca. — Je fais un heureux. — La Hacienda de Solis. — Matehuala. — Les mines du district de Catorce. — La ville de Cédral. — La Hacienda de beneficio de Don Antonio Verume. — Un garçon qui veut apprendre l'anglais. — Le vin de Membrillo. — La Hacienda el Salado. — Les toiles d'aloès. — Les briques d'adobe. — On dompte un cheval sauvage. — La soirée et la nuit à la Hacienda la Ventura. — Un inconnu. — Le gibier. — Les fauves. — La ville de Saltillo. — Le chemin de fer. — Le chien des prairies. — Monterey. — Laredo. — Arrivée à San-Antonio. 161
Chapitre XIV. — États-Unis.
Le Texas. — Les progrès depuis l'abolition de l'esclavage. — Les Congrégations religieuses. — Prix des terres. — Les casernes. — Les Nègres et leur ostracisme. — Départ pour San-Francisco. — Les métiers d'un Yankee. — Les plantations de coton. — Les cliffs du Rio-Grande. — Les stations dans le désert. — La consommation de la bière. — Le Nouveau Mexique. — L'Arizona. — Les Mormons. — Les Chinois. — Le Rio-Colorado. — Yuma. — Indio. — Le désert du Colorado. 175
Chapitre XV.
La Californie. — Los Angeles. — La production de l'or. — Les produits agricoles. — Le papier-monnaie. — La vallée de Yosemity et les arbres géants. — Oakland. — San-Francisco. — La baie. — La crise. — Le nouveau traité avec la Chine et la question chinoise. — Les coolies et l'opium. — La richesse des États-Unis. — La rémunération du travail et du capital. — Les divorces et les avortements. — Les monopoles et la concurrence. — La population. — Importation. — Exportation. — Revenus. — Dette. — Chemins de fer. — Les Américains ne nous aiment pas. — Les réformes nécessaires pour former un peuple fort et sérieux. 187
Chapitre XVI.—Les îles Sandwich.
Départ de San-Francisco. — Navigation vers les îles Sandwich. — Le navire La Zelandia. — Manière d'occuper le temps. — Arrivée à Honolulu. — Les îles Hawaï. — Surface. — Population. — Gouvernement. — Les femmes sénateurs. — Impôts. — Les plantations de canne. — Importation. — Exportation. — Navigation. — Droits de douane. — Revenus. — Changement de dynastie. — Les Missions. — Le volcan Kilaouea. — Le monument du capitaine Cook. — La végétation. — Les habitations. — Les indigènes. — Mœurs et coutumes. — Les écoles. — L'hôpital. 199
Chapitre XVII.
Navigation vers la Nouvelle-Zélande. — Curieux problème dans une succession. — Deux bébés à la recherche du ciel. — Une éclipse totale du soleil. — Les Saints et les Morts. — Passage de l'Équateur. — Une visite de l'Océan. — La visite réglementaire. — La manœuvre du feu. — Le service religieux. — L'île Tutuila et l'archipel des Navigateurs. — Une Cour d'assises. — Une tempête sous le tropique. — Scènes comiques. — Le 180° parallèle et la semaine de 6 jours. — Arrivée en Nouvelle-Zélande. 211
Chapitre XVIII.—La Nouvelle-Zélande.
La Nouvelle-Zélande. — Situation. — Surface. — Configuration. — Population. — Gouvernement. — Récoltes. — Bétail. — Poissons. — Mines. — Climat. — Pluie. — Instruction publique. — Industrie. — Assistance publique. — Caisse d'épargne. — Importation. — Exportation. — Navigation. — Les terres publiques. — Manière de les acquérir. — La poste. — Le télégraphe. — L'armée. 221
Chapitre XIX.
Arrivée à Auckland. — La tempête. — Le dimanche. — Le Père Mac Donald. — Catholiques et protestants. — La ville. — Les faubourgs. — Le parc du gouverneur. — L'hôpital. — Le dominion. — Les salaires. — L'intérêt. — Le baron de Hübner. — Mgr Luck et son diocèse. — Les Sœurs de la Miséricorde. — Départ pour Tauranga. — La baie. — La ville. — Excursion à Ohinemutu. — Les fermes. — Le cocher irlandais. — Le Gate-Pa. — La forêt d'Oropi. — La mid-way-house. — Les naissances et la mortalité. — Le vin correctif de l'alcoolisme. — Les gorges de Mangorewa. 235
Chapitre XX.
La tradition des Maoris sur leur venue en Nouvelle-Zélande. — Rangatiki et son chien Potaka. — Hinemou et Tutanekai. — Le lac Rotorua. — Les eaux thermales. — Un Pa. — Les Maoris, leurs vêtements, leur nourriture. — Mœurs et usages. — L'anthropophagie. — La carved house. — Tiki et Maui et le récit de la création. — Raïnga et la route du ciel. — Les ministres protestants et le traité de Waïtangi. — Les Pères Maristes. — La forêt de Tikitapu. — Le lac Rotakakahi. — Waïroa. — Les femmes Maoris et le tabac. — Costumes et jeux. — L'école. — Un examen de géographie. — L'instruction. — La cascade. — La haka ou danse indigène. — Le lac Tarawera. — Le Té Tarata ou terrasse blanche. — Le lac Rotomahana. — Les geysers. — Le repas. — La Aukapuarangi ou terrasse rouge. — Un bain bouillant. — Retour à Waïroa et à Ohinemutu. 253
Chapitre XXI.
Sulphur-point. — Les bains du gouvernement. — Perdu et retrouvé. — Les geysers de Whakarewarewa. — La fin de Komutumutu. — Le geyser de Waïkiti. — Les sépultures. — Le divorce. — Route vers Taupo. — Le Waïkato. — Un cocher concurrent. Débourbés par les Maoris. — Le Tangariro et sa légende. — Le lac de Taupo. — Les bains de M. Lofley. — À la recherche de la cascade Huka. — Le Crow's nest. — Les rêves au bord du lac. — Taniwha, l'homme aux cheveux rouges. 275
Chapitre XXII.
Départ pour Napier. — Un surveyor. — Un repas au désert. — La future ville de Tarewera. — Un Pa à 2,600 pieds. — La boîte aux lettres aux bords des chemins. — Le port et la ville de Napier. — Les missions catholiques. — Un typhon entre Napier et Wellington. — Port Nichelson et la ville de Wellington. — La corde de sauvetage. — Mgr Redwood et les Pères Maristes. — Le Musée. — L'Observatoire. — Le kea et ses méfaits. — Trois jeunes éleveurs français. — La famille en Nouvelle-Zélande. — Les méthodes d'enseignement. — Les oeuvres catholiques. — Les Chambres. — L'Athenœum. — L'élection du mayor. — La Wellington meat preserving Cy, et la prochaine concurrence aux éleveurs européens. — Un jeune colon bordelais. 291
Chapitre XXIII.
Départ de Wellington. — Les projets de confédération. — Littletown. — L'assurance par l'État. — Christchurch. — La loi morale. — Les écoles. — Les Sœurs du Sacré-Cœur de Lyon. — Le Musée. — Le Canterbury-College. — L'enseignement laïcisé. — Le Jardin public. — La ferme-école à Lincoln. — Saint André et les Écossais. — Akaroa et la colonie française. — Route vers Dunedin et la plaine de Canterbury. — Timaru. — Oomaru. — Palmerstown. — La baie de Vaïtati. — Port-Chalmers. — Dunedin. — La ville. — Le Musée. — Les écoles catholiques. — Départ pour Lawrence. 311
Chapitre XXIV.
Route vers le Sud. — Facilités aux émigrants. — De Milton à Lawrence. — La cabane du pionnier. — Les diggers chinois à Waïtahuna. — Le quartier chinois à Lawrence. — La cabane d'un avare. — L'école. — Une station de moutons dans la région des lacs. — Le lapin fléau public. — Les goldfields du Gabriel Gully. — M. Perry et sa nouvelle méthode. — Un dépôt de cemen aurifère. — Route à Invercargill, — Bismarck et ses informations. — La ferme d'Edendale et la New-Zealand loan Cy. — Un clerc méfiant. — Cherté de la main-d'œuvre. — La ville d'Invercargill. — Le presbytère. — La prison. — Route vers Bluff. — Le steamer Le Manipoori. — Réflexions sur la Nouvelle-Zélande. — Le 8 décembre en mer. — Le service du dimanche. — Une dernière tempête. 331
Chapitre XXV.—Tasmanie.
Le naufrage du Tasman. — Le tremblement de terre des îles de la Sonde et les phénomènes qui en résultent. — Arrivée à Hobart. — La ville. — Les environs. — Cascade-hill. — Une brasserie. — Mgr Murphy et le Père Beechenor. — Les Sœurs de la Présentation. — Une tombe française. — Population catholique. — Le musée. — Queen's dominion. — Le lawn-tennis. — De Hobart à Lanceston. — Les fonderies d'étain. — Les mines de Mount-bischoff. — Les écoles. — Un tremblement de terre. — Le clergé irlandais et les fidèles. — La Salvation army. — La Tasmanie. — Situation. — Histoire. — Surface. — Population. — Climat. — Constitution. — Produits. — Importation. — Exportation. — Banques: — Système agraire. — Immigration. — Bétail. — Chemin de fer. — Poste. — Télégraphe. — Instruction publique. — Revenu. — Dette. — Les indigènes. — Épisodes et extinction. 349
Chapitre XXVI.—Australie.
L'Australie. — Situation. — Surface. — Histoire. — Les convicts. — Les explorateurs. — Les chemins de fer. — Le télégraphe. — Les banques. — Journaux. — Gouvernement. — Population. — Conformation. — Géologie. — Minéraux. — Faune. — Bétail. — Produits. — Exportation. — Importation. — Agriculture. — Religion. — Instruction publique. — Armée. — Marine. — Navigation. — Revenu. — Dépense. — Les indigènes. — Races, origine, croyance, mœurs et usages. 375
Chapitre XXVII.
Port-Philipp. — Melbourne. — La ville. — Les faubourgs. — Le téléphone. — La colonie de Victoria. — Situation. — Surface. — Rivières, lacs, montagnes. — Population. — Religion. — Armée. — Marine. — Terres. — Revenu. — Dépenses. — Bétail. — Navigation. — Exportation. — Importation. — Produits. — Poste. — Télégraphe. — Chemin de fer. — Banques. — Caisse d'épargne. — Écoles. — Usines. — Mines. — Églises. — Agriculture. — Les parcs. — Le jardin zoologique. — Leledale. — Le vignoble de Saint-Hubert. — Les sauterelles. — Retour à Melbourne. — Départ pour Ballarat. — Geelong. — L'eucalyptus. — Une condamnation sévère. — La loi morale et la loi divine. — Struggle for life. — Les trois bébés retrouvés. 395
Chapitre XXVIII.
Ballarat. — Une distribution de prix. — À la visite d'une mine d'or. — Le cheval Charlee. — Creswick. — La mine d'or alluviale de Mme Berry. — Les salaires. — Arendale et l'ouvrier gentleman. — Le lac Windermere. — Le lac Burumbeet. — Huit kilomètres à travers les paddocks. — La station d'Ercildonne. — Un mérinos de 200 livres. — Les enchères chez Samuel Wilson. — Au galop avec un apprenti. — Départ pour Sydney. — Les vacances de Noël. — Un propriétaire et le jury. Un vélocipédiste imprudent. — Encore l'eucalyptus. — Wodonga. — Albury. — Les Fallon's-Cellars. — La famille Frère. — La villa Saint-Hilaire. — Un laboureur apprenti. — On se fait maçon et menuisier. — Dix-huit kilomètres à cheval. — Coût et produit d'une vigne. — La nouvelle loi agraire. — Budget d'un squatter débutant. — Les colons allemands. — Pour cantonnier une lanterne et un drapeau. — Un run de 600,000 moutons. — Arrivée à Sydney. 415
Note 1: Voir À travers l'Hémisphère sud, 1er vol., Palmé.[Retour au texte principal.]
Note 2: Dans les deux Amériques, lorsqu'on dit Américain tout court on désigne toujours un sujet des États-Unis de l'Amérique du Nord.[Retour au texte principal.]
Note 3: Historia de las Indias.[Retour au texte principal.]
Note 4: On appelle ainsi une réunion de ranchos ou habitations des paysans.[Retour au texte principal.]
Note 5: Voir le Tour du monde en 240 jours, librairie du Patronage Saint-Pierre, à Nice.[Retour au texte principal.]
Note 6: Jeu en usage sur tous les navires des deux océans. Il consiste à lancer dans certains carrés numérotés des cerceaux de corde, celui des deux partis qui a le plus vite atteint le chiffre 100 gagne, mais s'il le dépasse, il doit atteindre la case supérieure qui le fait reculer de 10 points, et en ajouter d'autres, jusqu'à ce qu'il atteigne sans le dépasser, le chiffre 100.[Retour au texte principal.]
Note 7: La presqu'île de Malacca, qui s'avance au loin dans la mer et où se trouve la jonction des races jaune et blanche, semble être le point d'où sont parties les diverses migrations qui ont peuplé les îles du Pacifique, y compris le Japon. Quelques expéditions auraient même atteint l'Europe, et les Basques semblent en être les témoins par leur langage d'origine birmane.[Retour au texte principal.]
Note 8: Depuis ma visite, la région de Rotomahana a été complètement bouleversée en 1887 par une éruption qui a fait périr presque tous les habitants de Waïroa et des environs.[Retour au texte principal.]