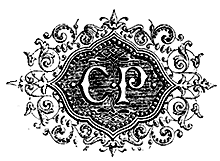
Title: Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse (3/9)
Author: duc de Raguse Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont
Release date: September 17, 2009 [eBook #30013]
Most recently updated: October 24, 2024
Language: French
Credits: Produced by Mireille Harmelin, Valérie Auroy, Rénald
Lévesque (html version) and the Online Distributed
Proofreaders Europe at http://dp.rastko.net. This file was
produced from images generously made available by the
Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica)
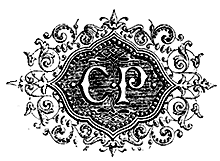
PARIS
PERROTIN, LIBRAIRE-ÉDITEUR
41, RUE FONTAINE-MOLlÈRE, 41
1806-1807
SOMMAIRE.--Arrivée à Raguse.--L'amiral Siniavin à Cattaro.--Le pacha de Bosnie Kosrew.--Retour en Dalmatie.--Population de la Dalmatie. Détails: moeurs et habitudes.--Attaque de Corzola par les Russes.--Déclaration de guerre des Turcs contre les Russes.--Préparatifs d'une expédition en Turquie.--L'amiral Siniavin aux Dardanelles.--Habileté de Sébastiani.--Première idée de construction des routes.--Rapidité d'exécution.--Catastrophe de Selim.--L'amiral Siniavin revient à Cattaro.--Il entretient des intelligences en Dalmatie.--Le Pandour Danèse.--Mille Russes débarqués à Poliza--Révolte des habitants.--Moeurs et usages.--Une élection à coups de pierres.--Le knès.--Le général Launay achète les prisonniers vingt francs par tête.--L'envoyé d'Ali-Pacha de Janina: son histoire.--Paix de Tilsitt.--Remise des bouches de Cattaro par Siniavin.--Attitude des Bocquais.--Le vladiza de Monténégro: son portrait--Reprise des travaux de route.--Travaux des Romains comparés.--Population de la Dalmatie du temps des Romains.--Moyens financiers d'exécution appliqués aux travaux.--Clausel remplace Lauriston.--Marmont est créé duc de Raguse.
J'arrivai le 2 août à Raguse. Les Russes étaient rentrés à Cattaro, les Monténégrins et les Bocquais dans leurs villages. Un traité de paix, signé entre la France et la Russie le 20 juillet à Paris, ordonnait la remise de l'Albanie vénitienne à l'armée française et l'évacuation de Raguse. Tout semblait donc devoir se pacifier promptement; il ne me restait plus qu'à m'occuper des besoins de l'armée, qui étaient immenses.
L'administration de l'armée d'Italie avait été chargée de faire vivre les troupes françaises en Dalmatie: on ne peut exprimer sa conduite coupable envers ces pauvres soldats, dont le sort est toujours de devenir victimes de ce que l'armée renferme d'abject. Un commissaire des guerres, appelé Volant, envoyait de Venise des blés gâtés, qu'un autre coquin de commissaire, nommé Vanel, partageant sans doute avec lui, recevait à Zara. Le pain était infect, les hôpitaux étaient dans le plus grand abandon, les casernes sans fournitures; tout était dans l'état le plus déplorable; plus du quart de l'armée était aux hôpitaux, où la mortalité était effrayante: c'était pire que ce que j'avais trouvé deux ans et demi avant en Hollande.
L'Empereur me donna toute l'administration. Nous pourvûmes à nos besoins par nos propres moyens; des fonds suffisants nous furent envoyés régulièrement; la Bosnie donnait à bon marché le bétail dont nous avions besoin; la Pouille nous envoya des blés, et en quelques mois tout rentra dans l'ordre. La mortalité diminua très-sensiblement, le nombre des malades devint plus modéré, enfin il finit par être dans la plus faible proportion avec l'effectif des troupes. Je n'entrerai pas dans le détail de ce que je fis alors, ce récit serait de peu d'intérêt; mais je dirai cependant un mot sur les hôpitaux, pour raconter des faits dont la connaissance peut être utile et qui s'appliquent à des circonstances qui peuvent se représenter.
À l'armée, les grands accidents sanitaires, si je puis m'exprimer ainsi, sont presque toujours le résultat de la disproportion des moyens de traitement avec le nombre des malades. Les malades mal soignés ne guérissent pas; leur nombre augmentant toujours, il y a encombrement, et il en résulte des maladies épidémiques: alors se manifestent les accidents, chaque jour plus effrayants, qui détruisent une armée entière.
La première condition est donc de proportionner le nombre des lits des hôpitaux au nombre présumé des malades, et de placer les établissements à portée des troupes, pour dispenser des évacuations, dont les résultats sont toujours funestes, et qu'il ne faut autoriser que quand la guerre les rend nécessaires: les administrations militaires sont toujours prêtes à les provoquer, mais le général doit les refuser, quand les mouvements de l'ennemi et ceux de l'armée ne les rendent pas indispensables.
Les motifs véritables de ces évacuations intempestives sont d'abord de se débarrasser et de mettre à la charge des autres la besogne qu'on devrait garder pour soi; ensuite, d'avoir un moins grand nombre d'établissements, afin de diminuer le prix de la journée d'hôpital: charlatanisme commun à toutes les administrations pour plaire au ministre; comme si les évacuations, indépendamment des intérêts de l'humanité, n'étaient pas un supplément de dépense bien supérieur à l'économie apparente.
D'après ces habitudes coupables, on n'avait établi qu'un seul hôpital à Zara. Cet hôpital ayant été bientôt plein, les malades reçurent des soins imparfaits et ne sortirent pas de l'hôpital: l'encombrement arriva bientôt. Une longue maladie entraîne toujours une longue convalescence: ainsi, les soldats guéris étaient faibles en sortant de l'hôpital; une longue route dans un pays aussi difficile, sous un climat brûlant, les exténuait, et, arrivés à leur corps, ils retombaient malades, étaient de nouveau envoyés à Zara, où ils mouraient.
Je changeai tout ce système: les maladies légères étant généralement guéries par des secoure prompts, je fis établir de petits hôpitaux à une distance des corps telle, qu'en un jour les malades pouvaient y arriver: cette disposition prévint tout encombrement. Avec un peu d'industrie, toutes les localités fournissent des ressources pour quarante ou cinquante hommes malades. Les maladies légères, n'étant pas aggravées par un premier défaut de soins et une longue route, étaient promptement guéries; les soldats sortant de l'hôpital faisaient place à d'autres malades qui venaient y recevoir les mêmes soins; les soldats guéris, rejoignant immédiatement leurs régiments, n'étaient pas exténués par une longue route de retour, et, leur guérison étant définitive, la mortalité disparaissait.
Au moyen de ce système, l'année suivante, l'armée, qui avait reçu de jeunes soldats et dont l'effectif s'était élevé de plus de cinq mille hommes, n'eut jamais à la fois, à l'époque des plus fortes chaleurs, plus de cinq cents hommes aux hôpitaux; et cependant le relevé du mouvement général a constaté que les hôpitaux avaient reçu plus de dix mille individus. Cette multiplication d'hôpitaux avait élevé le prix de la journée d'hôpital; mais devant cette économie précieuse et réelle, l'économie de maladies et de malades, devait-on compter une légère augmentation de dépense?
Malgré la paix avec les Russes, signée par M, d'Oubril, le 20 juillet, on ne prenait aucune disposition pour nous faire la remise de Cattaro. L'amiral Siniavin avait répondu à mes communications d'une manière vague et incertaine; il devait, au surplus, attendre les ordres de sa cour pour exécuter un traité qui n'était pas encore ratifié. Cependant le bruit de la continuation de la guerre se répandit; l'amiral russe recevait, chaque jour, des renforts; des troupes de terre arrivaient de Corfou, sous les ordres du général Padapopoli. Ces dispositions ne paraissaient guère pacifiques. En supposant la paix, on soupçonnait les intentions de l'amiral Siniavin; on lui croyait des passions contre nous; on redoutait qu'il ne livrât Cattaro aux Anglais, comme les Autrichiens le lui avaient livré à lui-même: d'un moment à l'autre les Anglais pouvaient arriver et entrer dans les forts; tout était incertitude et obscurité.
Dans cet état de choses, je me hâtai de faire travailler aux fortifications de Raguse, et on construisit, avec la plus grande activité, un fort au sommet de Saint-Sergio, et un autre dans une première position. Je fis réunir de grands approvisionnements, afin d'être libre dans mes mouvements. Je me mis en rapport et en relations d'amitié avec les commandants turcs de la frontière, avec l'agah de Mostar, Hadgi-bey du Tovo; le pacha de Trébigne et le vizir de Bosnie, pour assurer des vivres à l'armée, si leur secours devenait nécessaire. Je reprochai au pacha de Trébigne d'avoir laissé les Monténégrins franchir son territoire pour se porter sur Raguse, et de n'avoir pas empêché des sujets grecs de son pachalik de se joindre à eux. Je fis des cadeaux d'armes et de canons de montagne à ceux qui me parurent bien disposés, et avec lesquels j'eus de bons rapports. Il s'établit, dès ce moment, entre le pacha de Bosnie et moi des relations véritablement amicales. Il avait été pacha d'Égypte; il en avait ramené de beaux chevaux, dont il me fit présent: je lui donnai cent fusils de munition et deux pièces de trois, avec lesquelles il combattit les Serviens. Ce pacha, Méhémet-Kosrev-Pacha, a été depuis capitan-pacha, et c'est son vaisseau que Canaris a fait sauter d'une manière si héroïque; aujourd'hui (1829) il est séraskier, c'est-à-dire chef suprême de la nouvelle armée turque, et l'homme de confiance de Mahmoud.
Je pressais sans cesse l'amiral de me remettre les bouches de Cattaro; mais, ses réponses, toujours dilatoires, montrant sa mauvaise foi, je devais m'en défier, et préparer d'avance les moyens d'en détruire les effets.
Je réunis des approvisionnements pour pouvoir les jeter à Cattaro au moment même où nous entrerions, et une artillerie convenable pour armer immédiatement la côte. En supposant l'amiral mal disposé pour nous, mais loyal, il pouvait nous remettre les bouches de Cattaro en présence des Anglais; ceux-ci auraient mis des obstacles à l'envoi par mer de ce qui était nécessaire à la défense du golfe. Je devais prévoir aussi la continuation de la guerre, et alors il pouvait être utile de rapprocher des bouches de Cattaro des moyens d'attaque, pendant le moment où les hostilités étaient suspendues et où la navigation n'éprouvait aucun obstacle.
À deux lieues environ de l'entrée du golfe de Cattaro, dans le pays de Raguse, une échancrure dans la côte forme un port presque fermé, où des bâtiments sont parfaitement en sûreté. Ce port s'appelle Molonta. J'y envoyai, sur de petits bâtiments, des approvisionnements en biscuit, eau-de-vie, riz, et une quinzaine de pièces de gros calibre, avec leurs armements et munitions. J'occupai en force le Canali, partie du pays de Raguse couvrant le port de Molonta, et mes avant-postes furent placés à la frontière de l'Albanie, attendant le moment où les portes de Castelnovo me seraient ouvertes.
Les négociations n'avançaient pas. Si, par sa résistance, l'amiral outre-passait ses ordres, une menace pouvait le décider; ou bien, si les hostilités devaient recommencer, l'offensive prise me serait utile. Je me décidai donc à agir: je fis embarquer pendant la nuit, à Molonta, sur des barques à rames, toute l'artillerie mise en dépôt; elle fut débarquée à la pointe du jour à la Punta d'Ostro, pointe ouest de l'entrée du golfe. Je déclarai en même temps que cette disposition ne devait point être regardée comme un acte d'hostilité, mais comme une opération préparatoire à la prise de possession des bouches, et dont l'objet était de mettre d'avance la côte en état de défense.
Aussitôt le matériel débarqué, je m'occupai de faire construire une grande batterie pour battre et fermer l'entrée. Si la guerre commençait, c'était la première opération du siége de Castelnovo. Les Russes, trouvant mauvaise cette entreprise, et en vérité ils avaient raison, vinrent tirer du canon sur mes travailleurs; mais les travaux continuèrent, et en cinq jours ma batterie fut achevée. L'amiral ne changea pas de langage, et déclara au contraire qu'il avait l'ordre de garder les bouches de Cattaro: c'était annoncer la continuation de la guerre. J'étais en pleine opération quand je reçus, avec la nouvelle que l'empereur de Russie avait refusé de ratifier le traité d'Oubril, l'ordre de rentrer en Dalmatie et de me tenir en observation devant les Autrichiens, après avoir pourvu à la défense de Raguse. Cet ordre positif, impératif, était commandé par les circonstances, et rendait impossible l'accomplissement des projets dont j'avais déjà commencé l'exécution. Je ne pouvais retirer mon matériel que du consentement de l'amiral. J'envoyai à son bord pour lui déclarer que, l'armement fait ayant été uniquement destiné à la défense des bouches sur la remise desquelles j'avais dû compter, et les circonstances ayant changé, je consentais à retirer mon artillerie de la Punta d'Ostro, à condition qu'il n'y mettrait aucun obstacle; il en prit l'engagement, et l'on se mit à la besogne. Quand les batteries furent démontées, et les canons dans des barques, il avait changé d'avis. Je fis jeter les canons à la mer, et emporter par terre les poudres, les boulets, et tout ce qui était de nature à être transporté facilement: le reste fut détruit.
Ce début de campagne ne valait rien; mais j'espérais voir Siniavin se décider à agir offensivement, et pouvoir saisir une occasion d'obtenir un succès assez marqué sur lui pour garantir Raguse d'un nouveau siége, avant d'exécuter le mouvement rétrograde qui m'était ordonné sur Zara: elle se présenta effectivement bientôt.
Je me retirai sur Raguse-Vieux, où j'avais des approvisionnements considérables et presque toute ma flottille. Je pris position à une lieue en avant de cette ville, et j'attendis les événements. Combattre des Monténégrins n'était rien pour moi: c'était à des troupes russes que je voulais avoir affaire, et, pour cela, il fallait qu'elles se missent en campagne.
Une partie de l'escadre russe croisait déjà entre Raguse et Raguse-Vieux; des bâtiments étaient stationnés au milieu du golfe. Cette escadre se composait de vingt-deux bâtiments de guerre, dont dix ou onze vaisseaux de ligne: l'amiral, avec le plus grand nombre des vaisseaux, était encore dans les bouches. Des troupes de débarquement venues de Corfou, réunies à des détachements formés avec l'équipage des vaisseaux, élevaient les forces qu'il pouvait mettre à terre à sept mille hommes environ. Les espérances de succès formées par Siniavin étaient partagées par ses soldats, et la conquête de Raguse et de toute la Dalmatie leur paraissait certaine. Le capitaine du génie Boutin, officier plein de talent, qui depuis a péri malheureusement dans une mission en Asie, et dont la mort fut vengée d'une manière éclatante par lady Stanhope, ayant été arrêté avant le commencement des hostilités par un bâtiment de guerre russe, et conduit à l'amiral, réclama hautement sa liberté comme ayant été pris contre le droit des gens, et avant la déclaration de la guerre. Siniavin la lui rendit en lui disant que, dans peu de jours, il regretterait le don qu'il lui faisait. Cette confiance de l'ennemi était tout mon espoir, et je ne négligeai rien pour l'augmenter, sans toutefois atténuer celle de mes troupes.
Le 26 septembre, je me retirai à Raguse-Vieux. J'envoyai d'abord des détachements contre des Grecs, sujets turcs, qui cherchaient à intercepter ma communication avec Raguse, et je plaçai sur les hauteurs de Breno le 5e régiment pour contenir ceux de Trébigne, qui menaçaient d'aller de nouveau piller les faubourgs de Raguse, brûler les moulins, détruire l'aqueduc et couper les eaux. Lorsque ce régiment parut, tout rentra dans l'ordre.
Le 27, les Bocquais et les Monténégrins, au nombre de mille environ, vinrent attaquer nos avant-postes. Ils furent repoussés, et je défendis de les poursuivre.
Le 29, je fus informé de l'arrivée d'un nouveau régiment russe venant de Corfou. Cet événement et notre retraite avaient singulièrement enorgueilli les Russes et tourné la tête aux Monténégrins, Bocquais et Grecs, sujets turcs, dont le nombre avait presque doublé; ils parlaient de piller Raguse et la Dalmatie. Enfin un corps russe assez nombreux avait pris position au col de Débilibrick, en avant de la vallée de la Sottorina. C'est ce que j'attendais pour agir offensivement. Si les Russes restaient, j'espérais les battre. S'ils se retiraient sans combattre, ils détruiraient l'opinion qui s'était déclarée pour eux et la confiance de leurs partisans. J'ignorais alors la force précise des Russes; les renseignements des prisonniers, après la bataille, m'ont donné les moyens de dresser un état régulier qui porte leur force au nombre que j'ai déjà fait connaître. Quant à celle des paysans armés, on peut estimer qu'il y avait quatre à cinq mille Monténégrins, trois mille Bocquais et deux mille Grecs, sujets turcs. Ainsi j'avais devant moi sept mille Russes et environ neuf mille hommes de troupes irrégulières. On sait, au reste, ce que valent ces dernières troupes. La moitié se montre à portée; un quart seulement se bat avec courage dans les rochers et résiste; mais cependant la masse occupe toujours plus ou moins, et deviendrait redoutable dans un moment de désordre.
Deux heures après avoir reçu la nouvelle de la sortie des Russes, je me mis en marche.
Je laissai au camp, devant Raguse-Vieux, les hommes malingres ou mal chaussés, et avec eux des officiers et sous-officiers, de manière à en faire une espèce de réserve. Les soldats déposèrent leurs effets, se chargèrent de vivres et de cartouches, et je me mis en route, dans la nuit du 29 au 30, avec cinq mille neuf cents baïonnettes. J'espérais avoir mon avant-garde au jour, en arrière d'un rassemblement de douze à quinze cents montagnards placés en deçà du pont de la Liouta. Une pluie survenue et la difficulté des chemins retardèrent mes colonnes, et le jour nous trouva encore à une lieue de l'ennemi. Lorsque nous fûmes en présence, je le fis attaquer par un bataillon de voltigeurs, commandé par le colonel Planzone, et composé des compagnies des troisième et quatrième bataillons, des 5e, 23e et 79e régiments, et soutenu par un bataillon de grenadiers des mêmes régiments, conduit par le général Lauriston. Le 79e resta en réserve. L'ennemi ne tint pas, et se retira sur de plus grandes hauteurs. Nous l'y joignîmes, et nous découvrîmes distinctement la ligue russe, établie sur le col de Débilibrick.
Je réunis les deux bataillons d'élite sous les ordres du général Lauriston, et lui ordonnai de suivre le plateau situé au dehors des grandes crêtes, de chasser deux ou trois mille paysans qui y occupaient une position assez forte, et de tourner ainsi celle des Russes. Je le fis soutenir par le 11e régiment, sous les ordres du général Aubrée. J'ordonnai au 79e d'attaquer de front, et je gardai en réserve le 23e sous les ordres du général Delzons, et deux bataillons de la garde royale italienne, sous les ordres du général Lecchi. Le 18e régiment d'infanterie légère, lancé d'abord sur les montagnes, fut rappelé pour suivre le mouvement, devenir réserve et prendre part au combat du lendemain.
Les troupes se mettaient en mouvement lorsque les Russes disparurent. Les paysans, forcés dans leur position, laissèrent soixante hommes sur la place, et se retirèrent sur une dernière position, plus forte et plus élevée, que nous ne pûmes attaquer faute de jour. Un de mes aides de camp, le capitaine Gayet, qui servait depuis longtemps avec moi, périt malheureusement ce jour-là, en se rendant à une colonne pour y porter des ordres; il tomba entre les mains des Monténégrins, qui lui coupèrent la tête. Je le regrettai beaucoup.
Le lendemain, 1er octobre, l'ennemi avait disparu de la position où il s'était retiré la veille au soir; le 11e l'occupa. Le régiment d'élite suivit la dernière crête et arriva au sommet de la montagne, sur la croupe de laquelle Castelnovo est bâti, tandis que le 79e régiment, soutenu par le 23e, celui-ci par le 18e léger, et ce dernier par la garde italienne, débouchait dans la vallée. Le régiment d'élite avait à combattre une nuée de paysans précédant un bataillon russe. L'attaque des voltigeurs n'ayant pas réussi, le bataillon de grenadiers marcha, ayant à sa tête le général Launay, et enleva la position. Le 11e marchant dans un étage inférieur, eut à combattre deux bataillons russes et une grosse troupe de paysans. Il les aborda franchement: un combat à la baïonnette s'engagea, et plus de cent Russes et cent cinquante paysans y périrent. Les Russes se retirèrent avec précipitation sur le gros de leurs troupes, qui se trouvaient dans la plaine.
Pendant les événements de la gauche, la tête du 79e régiment était arrivée à l'entrée du bassin de Castelnovo. La vallée, d'abord étroite, s'élargit tout à coup. C'est là que plus de quatre mille Russes nous attendaient en bataille. Il était impossible de prendre une formation régulière sans combattre; il fallait gagner un peu d'espace. Le 79e, après s'être réuni, autant que le terrain pouvait le permettre, se précipita sur la ligne russe et la fit rétrograder en partie. Ce régiment entier se trouva en tirailleurs, mais le courage des soldats suppléait à l'empire de la discipline et d'une bonne formation; il tenait ferme contre un nombre très-supérieur, tandis que le 23e à la tête duquel marchait le général Delzons, approchait. Quand la tête eut débouché, je chargeai le général Lauriston de rallier le 79e, et de le porter sur les hauteurs à gauche, pour couvrir le flanc du 23e, et empêcher les deux bataillons russes, qui descendaient la montagne et n'avaient pu être suivis à cause de la difficulté du terrain, de les occuper. Un feu très-vif de ce régiment prépara la charge ordonnée au 23e, et exécutée aussitôt qu'il eut été formé en colonnes par sections. Les bataillons prenant leur distance en marchant, cette charge, conduite avec vigueur par le général Delzons, avait pour but de couper la droite de l'ennemi et de tourner son centre. La première position emportée, la droite des Russes se retira, homme par homme, dans les montagnes en arrière. Le centre se replia d'abord sur une hauteur, immédiatement après attaquée et enlevée, et enfin sur une troisième, où il tint ferme. La gauche et une réserve s'y rallièrent. Pendant ce combat, le 18e d'infanterie légère, sous les ordres du général Soyez, avait débouché et s'était formé en colonnes. Je lui ordonnai de passer à la gauche du 23e et de marcher droit sur Castelnovo pour tourner l'ennemi, tandis que le 23e ferait une nouvelle attaque, et je gardai en réserve le 79e et la garde. Ces mouvements s'exécutèrent aussitôt; mais, soit que l'ennemi sentit son danger imminent, soit que l'attaque du 23e eût été trop vive, il se replia en toute hâte, et le 18e ne put atteindre que la queue de sa colonne, au lieu de tomber sur son flanc, comme je l'avais espéré, et de le couper en grande partie. Quinze cents hommes seraient tombés en notre pouvoir, si un défilé à passer n'eût retardé la marche du 18e de dix minutes environ. Il arriva cependant encore à temps pour écraser par son feu la colonne russe, mise en fuite et cherchant son refuge, partie dans la mer et sur les canots de l'escadre envoyés pour la recueillir, et partie dans la plaine protégée par le feu du fort espagnol. Un quart d'heure après, il ne restait pas un seul Russe hors de l'enceinte de Castelnovo, et les paysans armés avaient disparu. Le feu des vaisseaux et du fort soutint l'embarquement des troupes russes, mais sans nous faire souffrir.
Depuis six mois, les Bocquais, excités par les Russes, n'avaient pas cessé de nous insulter. Pendant la suspension des hostilités, ils avaient attaqué nos avant-postes. J'avais fait tous mes efforts pour les rappeler à leur devoir et leur faire sentir leur véritable intérêt. Ils n'en avaient tenu compte, ils croyaient mes démarches inspirées par la crainte. Les Grecs, sujets turcs du voisinage, s'étaient joints à eux. J'avais porté mes plaintes au pacha de Trébigne; il m'avait répondu qu'il abandonnait les rebelles à ma vengeance. Je me décidai à faire un exemple sévère.
Je donnai l'ordre de brûler plusieurs villages et tous les faubourgs de Castelnovo: c'était punir la rébellion dans son foyer même, et, le lendemain, cet ordre fut exécuté. Je fis épargner la maison d'un habitant qui avait, quelques mois auparavant, sauvé la vie à un Français. On y plaça un écriteau pour faire connaître le motif de cette exception. Le 2 octobre, au moment où je faisais incendier les beaux faubourgs de Castelnovo, malgré le feu de la flotte ennemie, mille à douze cents paysans et quelques Russes vinrent attaquer les postes de ma gauche, les surprirent et les obligèrent à se replier. Le nombre des ennemis augmentant, je dus y faire marcher des troupes. J'employai dans cette circonstance la garde italienne, désespérée de n'avoir pas combattu la veille. Soutenue par un bataillon du 79e et quelques autres détachements, l'ennemi fut chassé de toutes parts, laissant deux cents morts sur la place, et tout rentra dans le silence. Ainsi l'ennemi, qui comptait mettre à feu et à sang Raguse et la Dalmatie, n'avait pas pu défendre son territoire et ses propres foyers.
On peut évaluer la perte de l'ennemi, dans ces trois affaires, pour les Russes, à trois cent cinquante hommes tués et six à sept cents blessés; nous leur fîmes, en outre, deux cent onze prisonniers. Les paysans perdirent quatre cents hommes tués et plus de huit cents blesses. Nous eûmes vingt cinq hommes tués et cent trente blessés. La faiblesse de cette perte fut due à la vigueur de nos attaques et à la célérité de nos mouvements.
J'avais atteint mon but et montré à ces peuples barbares ma supériorité sur les Russes. Je me retirai le 3, en plein jour, à la vue de l'ennemi. Rentré à Raguse-Vieux, mes troupes reprirent le camp qu'elles avaient quitté cinq jours auparavant. La terreur des ennemis était telle, que pas un paysan n'osa me suivre. Les troupes revinrent plus tard à Raguse et à Stagno, afin d'accélérer les travaux de défense; une brigade resta à Raguse-Vieux pour y protéger la flottille. Peu de jours après, cette flottille, profitant d'un vent frais et favorable, traversa le golfe en présence d'une partie de l'escadre, mouillée à une portée de canon. La marine russe, à cette époque, était malhabile; elle ne put pas appareiller assez promptement pour lui barrer le passage, et la flottille arriva heureusement, ayant reçu quelques décharges des vaisseaux ennemis, mais de loin et de nul effet.
Je fis travailler sans relâche aux ouvrages extérieurs, commencés à Raguse. Par le système que j'avais adopté, on est complétement maître de cette magnifique position maritime, qui, comme on va le voir, est la plus belle du monde.
Près de Raguse, presque en face de la ville, et parallèlement à la côte commence une suite d'îles très-rapprochées entre elles, qui forment, avec la terre ferme, un canal de huit lieues de longueur et d'une largeur de mille à quinze cents toises. Mer intérieure et rade fermée, toutes les flottes imaginables pourraient y être en sûreté contre les gros temps, contre l'ennemi, et y manoeuvrer sans gêne. Au moyen des diverses passes entre les îles, d'une navigation facile, mais d'une défense aisée, à cause de leur peu de largeur, on peut entrer et sortir par tous les vents. En face de Calamota, la première de ces îles, est le golfe d'Ombla; il est perpendiculaire à la côte et forme comme une rivière. Sa largeur est de trois à quatre cents toises; l'eau y est d'une grande profondeur, et son entrée est défendue par l'île de Daxa, que je fis armer et fortifier avec soin. Le val d'Ombla forme ainsi une rade intérieure, dans laquelle aucune force maritime ne peut pénétrer de vive force. Au fond coule une rivière sortant d'un rocher, dont l'eau est si abondante, que son action se fait sentir au loin et fort avant dans la mer. La plus grande escadre et la plus nombreuse flotte pourraient y faire l'eau nécessaire à leurs besoins dans une seule journée. Enfin, en se rapprochant de Raguse, et perpendiculairement au val d'Ombla, est le port de Gravosa; la nature l'a creusé, et on peut, comme dans la meilleure darse, y armer ou désarmer une grande escadre. Ce port est couvert par la montagne de San Sergio d'un côté, et, de l'autre, par une langue de terre qui tient à Raguse et le sépare de la grande mer. La rive extérieure de cette presqu'île est complétement escarpée. Raguse a encore, et indépendamment, son port de commerce, couvert par l'île de Lagroma. L'imagination ne conçoit pas une localité maritime plus complète et plus belle. Aussi l'Empereur avait-il sur Raguse les projets les plus étendus: cette ville devait devenir notre grande place maritime dans les mers de l'Orient, et être disposée pour satisfaire aux besoins d'une nombreuse escadre, qui y aurait habituellement stationné.
Je passai le mois d'octobre tout entier à mettre la dernière main aux affaires de Raguse; on compléta les approvisionnements. Les deux forts de la montagne, faisant la sûreté de Raguse, rendus défensifs, furent armés, et je couvris l'île de Daxa de batteries. Les îles de Calamota, de Mezzo et Jupana furent également armées, et la place elle-même reçut un complément d'armement. Quand je quittai Raguse, quatre-vingt-quatre pièces de gros canon étaient en batterie dans la place et dans les forts, et cent quatre-vingt-deux dans l'arrondissement.
J'avais fait mettre en état de défense Stagno, occupant l'isthme entier: cette ville se trouve le point de station et de communication entre la Dalmatie et Raguse, par la navigation intérieure 1. Je fis construire un autre fort sur la montagne au-dessus de Stagno. L'île et la place de Corzola, qui, par leur situation, commandent le détroit entre cette île et la presqu'île de Sabioncello, et rendent maître de la navigation extérieure, furent mises en état de défense.
Je donnai des instructions détaillées au général Lauriston pour tous les cas qu'il me fut possible de prévoir; je fixai les limites de son arrondissement jusques et y compris Stagno, Corzola et Sabioncello, et je lui laissai trois beaux régiments formant quatre mille cinq cents hommes, les 23e, 60e et 79e. Je me mis en route le 1er novembre, après m'être fait devancer par les autres troupes, composées des 5e et 11e de ligne, 18e léger, et de la garde italienne. J'inspectai en passant les travaux de Stagno, ainsi que ceux de Corzola, et je me rendis à Spalatro, point central où j'établis mon quartier général. Voici la manière dont je conçus la défense de la Dalmatie.
La difficulté des communications rendait extrêmement importante la conservation de la navigation intérieure, c'est-à-dire entre les îles et la terre ferme. Je mis les fortifications de l'île de Lésina en bon état: c'était un point de relâche précieux à conserver, et bon à enlever à l'ennemi. L'île de Brazza fut armée et occupée: on a vu ce que j'avais fait pour assurer la communication avec Raguse. Le fort Saint-Nicolas de Sebenico, défendant l'entrée de cette magnifique rade, fut armé. Je fis mettre en bon état de défense, et réunir des approvisionnements de toute espèce et considérables à Klissa, à Knin et Stagno. Klissa garde le débouché des montagnes, et présente une position inexpugnable à peu de distance de Spalatro, où j'aurais rassemblé l'armée dans le cas d'un débarquement considérable, chose possible à prévoir alors, et à redouter; car la guerre n'avait pas éclaté encore entre la Porte et les Russes, et le général Sébastiani, ambassadeur à Constantinople, m'avait annoncé à plusieurs reprises qu'un corps de dix mille hommes était embarqué dans les ports de la mer Noire et allait passer les Dardanelles, et je savais, d'autre part, qu'on l'attendait à Corfou.
Knin était destiné à servir d'appui à l'armée dans le cas de mouvement de la part des Autrichiens. Enfin, j'avais fait fortifier Opus, sur la Narenta, pour en assurer le passage et faciliter la marche par terre sur Stagno et sur Raguse. La défense était donc simplifiée autant que possible, et je m'étais réservé tous les points d'appui utiles. Pour compléter le système, et ne pas risquer de voir tomber entre les mains de l'ennemi des villes maritimes qu'il aurait pu ensuite armer et défendre, je fis ouvrir les remparts et détruire les fortifications de Spalatro et de Trau: plus tard, je fis servir ces démolitions à l'embellissement de ces villes.
Je plaçai mes troupes de la manière suivante; Le 81e régiment à Zara, le 18e léger à Sebenico, le 5e à Trau et Castelli, le 11e à Klissa et Spalatro, la garde à Spalatro, et le 8e léger à Macarsca; enfin, à Signe, ma cavalerie, composée de trois cent cinquante chevaux du 24e chasseurs, montés sur de petits chevaux bosniaques, cavalerie qui me rendit de grands services.
Je pouvais ainsi, en moins de deux journées, rassembler mes troupes, les porter dans toutes les directions, et elles étaient établies convenablement pour leur santé et leur bien-être. Une fois cantonnés et reposés, ces corps reprirent leur instruction, et, en peu de temps, redevinrent, les 18e et 11e, ce qu'ils avaient été, c'est-à-dire aussi beaux que jamais; et les autres, se piquant d'honneur, furent bientôt dignes de leur être comparés. Nous passâmes l'hiver dans cette position.
L'empereur Napoléon gardait Braunau comme gage des bouches de Cattaro, et le gouvernement autrichien se trouvait ainsi toujours victime de la mauvaise foi qu'avait montrée son commissaire en remettant les bouches aux Russes. Afin de terminer cette affaire, les deux gouvernements projetèrent une opération combinée de Français et d'Autrichiens pour prendre Cattaro; on devait réunir des moyens communs et égaux pour faire le siége de Castelnovo et de Cattaro. M. le comte de Bellegarde m'écrivit par le major d'Albeck, pour me faire les propositions relatives à cette opération, et m'envoya l'état de l'équipage de siége qui y serait employé. Je n'eus qu'à accéder à ses propositions, mais les circonstances dispensèrent de l'exécution.
L'Empereur se trouvait jeté dans un grand mouvement; les trônes s'écroulaient ou s'élevaient en sa présence, et cette petite affaire en resta là: l'opération, d'ailleurs, était très-difficile, les Russes ayant des forces maritimes telles, qu'on ne pouvait songer à leur disputer la mer.
Les Dalmates nous avaient accueillis avec plaisir et bienveillance; mais ils changèrent bientôt de sentiment. Le mécontentement, déjà fort sensible à cette époque, augmenta et finit plus tard par la révolte.
La population de la Dalmatie s'élevait alors à environ deux cent cinquante mille âmes. Presque toute catholique, à peine y comptait-on un dixième de la religion grecque. Cette population se divise en deux parties bien distinctes: la population du littoral et celle de l'intérieur.
Les villes sont peuplées, en presque totalité, d'Italiens, qui sont venus y chercher fortune. Vivant assez misérablement, quoique pleins de vanité et d'orgueil, les uns occupent de petits emplois ou se livrent à quelque petit commerce; d'autres cultivent un petit héritage qui se compose de vignes et d'oliviers. En général, ces Italiens transplantés sont peu recommandables; la corruption vénitienne avait laissé chez eux de profondes traces, et la vénalité en toutes choses, constamment la même jusqu'à notre arrivée, avait contribué à maintenir et à empirer cet état des moeurs.
Une grande partie des habitants de la côte et des îles se livre à la navigation; elle fournit à la conduite de cinq ou six cents bâtiments, presque tous employés au cabotage. Ces marins, en général assez médiocres, sont loin de valoir ceux des bouches de Cattaro. Beaucoup d'entre eux sont aussi propriétaires. Les campagnes qui avoisinent la mer sont les plus belles; le climat et la nature des terres comportent là une culture plus riche que dans l'intérieur. Cette partie de la Dalmatie ressemble beaucoup à la Provence quand elle était moins riche. L'intérieur est très-misérable, uniquement habité par les descendants des anciens Slaves qui l'ont conquise. Une culture rare, une grande quantité de mauvais bestiaux chétifs, forment toute leur richesse. Leurs forêts consistent en bois ravagés et réduits en broussailles par la volonté même des habitants, dans le but de s'affranchir des corvées que leur exploitation nécessitait pour le service de la marine vénitienne, et onze cent mille chèvres broutent les arbres et les empêchent de grandir.
De chétives cabanes, où toute une famille est réunie et couchée autour du même foyer; des rivières dont le cours est obstrué, dont les rives sont malsaines; d'autres qui ont creusé leur lit à pic dans des rochers de vingt à trente pieds de haut; des mines de charbon fort riches qui ne sont pas exploitées, et des plaines de cinq ou six lieues de pierres, sans aucune végétation, surmontées par des montagnes de sept à huit cents toises d'élévation, composées de rochers entassés, nus et dépouillés: tel est le spectacle que présente l'intérieur de la Dalmatie. Mais ce pays, si triste et si pauvre, est habité par une population belle, valeureuse et susceptible d'enthousiasme; ignorante, simple, confiante, capable de dévouement pour ses chefs; mais, comme tous les Barbares, elle ne comprend pas les abstractions; pour la remuer, il faut frapper ses sens et la soumettre à une action matérielle. Cette population, paresseuse comme toutes celles dont la civilisation est reculée, abuse de sa force, et les femmes y sont employées aux travaux les plus pénibles, tandis que les hommes se livrent au repos ou à leurs plaisirs. Elle est imprévoyante; elle consomme en sept ou huit mois ce qui pourrait la faire vivre un an, et, à chaque printemps, elle éprouve la famine et vit d'herbes et de lait de chèvre. Cependant la force et la beauté des individus frappent tous les étrangers. Cette beauté et cette force tiennent à diverses causes. Le régime auquel la population est soumise et la misère font périr tous les enfants faibles et mal constitués; il n'y a que les forts et les robustes qui résistent. Chaque génération subit donc une espèce d'épuration obligée qui donne lieu à la production d'une race haute et vigoureuse. Cette observation s'applique à tous les peuples barbares; elle explique cette taille et cette beauté qui frappent d'admiration tous les voyageurs.
Les prêtres séculiers, occupant les emplois de curés et de vicaires, y étaient d'une grande ignorance et jouissaient de peu de crédit. Il en était tout autrement des moines franciscains, possédant onze couvents et desservant beaucoup de paroisses. Ces moines faisaient beaucoup de bien et exerçaient sur les esprits une grande puissance.
De ce tableau succinct on doit tirer les conséquences suivantes. Le littoral, privé de navigation, souffrait de notre occupation, tandis que les villes et le pays en général gagnaient à notre présence. Mais les moeurs des montagnards les rendaient susceptibles d'être remués, soit par leurs chefs anciens dépossédés, soit par les intrigues des Autrichiens, des Russes et des moines, soit enfin par mille préventions dont nous étions l'objet, préventions que les rivalités du pouvoir et l'esprit faux et bizarre du provéditeur et de l'administration italienne fomentaient, au lieu de les combattre. Quoique l'armée française répandît beaucoup d'argent, et malgré l'amélioration du sort de la province, les passions et les intrigues étaient contre nous. Les passions l'emportent souvent sur les intérêts. Il y avait donc dans le pays de nombreux éléments de troubles.
Je n'ai dit qu'un mot de Corzola et de son importance. Cette petite place servait de refuge à nos bâtiments, protégeait puissamment notre cabotage, et rendait maître du détroit et du mouillage, d'où l'ennemi aurait pu l'intercepter. Corzola, située dans l'île qui porte son nom, à l'extrémité la plus voisine de la presqu'île de Sabioncello, n'est distante de la terre ferme que de quatre-vingts toises; elle ne tient à l'île que par un isthme. Ses fortifications se composent d'un bon rempart revêtu en maçonnerie, de vingt-quatre à quarante pieds de haut, et flanqué de cinq grosses tours, armées de canons. Le diamètre de la place ne dépasse pas cent cinquante toises.
Au delà de l'isthme, une hauteur commande la place. Je l'avais fait occuper par une bonne redoute; la place, pourvue de vivres et de munitions, était armée de seize bouches à feu de gros calibre, et la garnison dépassait cinq cents hommes. C'était un poste dans lequel un homme de coeur pouvait tenir au moins pendant quinze jours devant toutes les forces ennemies. Il fallait une succession d'efforts pour le prendre: 1° débarquer; 2° s'emparer de la redoute; 3° amener du gros canon; 4° faire brèche; enfin employer un nombre de jours qui pouvait être augmenté de la défense plus on moins longue de la redoute. Sûr d'arriver à temps si ce poste était attaqué, tandis que de Raguse Lauriston aurait envoyé à son secours par Sabioncello, je serais passé, sous la protection du canon de Corzola, dans cette place; tout était prévu et préparé dans ce but; la lâcheté ou la trahison du commandant déconcerta mes mesures.
Le 9 décembre, Siniavin parut inopinément devant Corzola, avec son escadre et quelques troupes de débarquement. Le 10, il somma la place et débarqua dans l'île. Le 11, il donna l'assaut à la redoute, joncha de ses morts le champ de bataille, et fut repoussé. Le 11 au soir, le chef de bataillon Orfengo, qui commandait, retira les troupes de la redoute, et, le 12, ayant été à bord de l'amiral, il signa une convention qui lui remettait la place et faisait transporter la garnison en Italie. J'avais reçu le 12, à neuf heures du soir, à Spalatro, la nouvelle de la présence des Russes; à minuit, j'étais en marche pour m'y rendre avec les troupes placées sous ma main, et, le lendemain, j'appris la reddition à Macarsca. Orfengo jouissait d'une bonne réputation, de l'avancement lui était promis; j'avais donc tout lieu de compter sur lui. Je le fis arrêter et traduire devant un conseil de guerre, qui le condamna à quatre ans de prison. Confié à la gendarmerie pour être transporté en France, il s'évada à son passage à Trieste, et passa au service de Russie. Je souhaite, pour la gloire de l'armée russe, qu'elle ne fasse pas souvent de pareilles acquisitions.
Immédiatement après la prise de Corzola, l'amiral embarqua ses troupes et vint mouiller dans nos canaux intérieurs, en face de Spalatro. L'île de Brazza était trop étendue pour pouvoir être défendue; aucun fort n'y avait été construit; en conséquence, j'en retirai la faible garnison, et j'abandonnai l'île à l'ennemi. Lesina se trouvait menacée, mais là une bonne défense était préparée; l'ennemi ne fit aucune tentative pour s'en emparer, il se contenta de gêner nos communications maritimes pendant quelque temps. Bientôt après, l'amiral retourna avec son escadre dans la rade de Cattaro, et rappela à lui la portion qu'il avait laissée devant nous. Alors je fis réoccuper l'île de Brazza.
Dans le courant de janvier, une lettre du général Sébastiani m'annonça la déclaration de guerre des Turcs contre les Russes: c'était un événement immense pour moi, il changeait toute ma position. Je n'avais plus à redouter l'arrivée du corps russe de dix mille hommes qui m'avait été annoncé. Tout semblait, au contraire, me promettre d'autres chances. Sélim, connaissant la faiblesse des armées turques, leur infériorité vis-à-vis des armées européennes, demanda un corps auxiliaire français pour être réuni à l'armée du grand vizir. Ce corps devait être de vingt-cinq mille hommes, et la mission qu'il avait à remplir ne pouvait regarder que mes troupes et moi.
Un corps de vingt-cinq mille hommes de bonnes troupes, mené sagement et réuni à l'armée turque, aurait donné à cette armée une tout autre importance; c'eût été une belle marche, digne d'être vantée, que celle d'une armée partant de la Dalmatie pour aller faire sa jonction avec la grande armée, en passant par la Valachie. Sébastiani m'en prévint; il désirait beaucoup l'exécution de ce projet, il le pressa tant qu'il put, et me provoqua à commencer ce mouvement, si mes instructions m'y autorisaient; mais il n'en était rien.
L'Empereur consentait à cette coopération et en appréciait tout l'avantage; cependant il voulait auparavant qu'un traité de subsides et d'opération fût signé. On réunit à Bassano les troupes nécessaires pour me compléter. L'Empereur m'ordonna de me mettre en mesure de marcher; mais cette affaire traîna beaucoup, et elle n'était pas encore terminée quand la catastrophe de Sélim arriva. Toutefois cette espérance me souriait. Je fis reconnaître avec soin les points de la Dalmatie offrant le moins de difficultés pour déboucher en Bosnie et faire une route pour y arriver. Ce fut le commencement de ces travaux mémorables exécutés depuis dans toute la province. Je fis partir sur-le-champ, pour se rendre auprès du général Sébastiani, six officiers d'artillerie et du génie. Ce nombre s'augmenta beaucoup quelques mois plus tard. J'envoyai aussi directement un officier à Viddin, auprès de Passwan-Oglou; un autre à Routschouk, auprès de Moustapha-Bairactar, ce même Turc dont la célébrité est justifiée par son courage, son dévouement à Sélim et sa mort héroïque. Ils étaient chargés d'offrir, de ma part, des secours en artillerie, en munitions, en officiers, et d'annoncer ma prochaine entrée en Turquie pour les appuyer avec trente mille hommes aussitôt après avoir reçu les Firmans du Grand Seigneur.
Moustapha-Bairactar se trouva être un homme moins civilisé que les Turcs qui occupent aujourd'hui de grands emplois. Son ignorance en géographie était fort grande; il demanda à l'officier que je lui envoyai si, en venant de Dalmatie, il avait dû passer la mer. Ces deux chefs ne réclamèrent aucun secours.
La guerre entre la Turquie et la Russie avait multiplié mes rapports avec les pachas. J'entrai en communication avec le célèbre Ali-Pacha de Janina. Celui-là fit beaucoup de demandes. Je lui envoyai tout ce qu'il désira en matériel, et, de plus, un détachement d'artillerie, commandé par un officier.
L'amiral Siniavin, parti de Cattaro, depuis un mois, avec toute son escadre, excepté deux vaisseaux, des frégates et des bâtiments légers restés dans nos parages, avait fait sa jonction avec l'escadre anglaise.
Le 27 mars, une lettre de Sébastiani m'annonça le départ de Constantinople du ministre d'Angleterre, et l'arrivée de l'escadre anglaise devant cette ville le 21 février. Les Dardanelles avaient été forcées. On considéra cette action comme extraordinaire; mais c'est un prodige qui se renouvellera toujours, tant que ce passage ne sera armé que de gros canons immobiles, qui ne peuvent tirer qu'un seul coup chacun contre une escadre marchant avec un vent favorable.
L'amiral Dukwort, arrivé avec son escadre devant Constantinople à la pointe du sérail, menaça de brûler la ville, et, comme il était maître de le faire, puisque cette ville était sans défense, il pouvait en résulter une révolution ou un changement de politique complet. À la suite d'une pareille entreprise, il y avait tout à redouter. Ces nouvelles étaient déjà fort anciennes. Mais, le 29 avril, de nouvelles dépêches de Sébastiani, en date du 4, vinrent m'apprendre les heureux événements qui s'étaient passés.
Sébastiani avait soutenu et développé l'énergie du sultan. Par de feintes négociations, il avait fait gagner du temps, et, en peu de jours, toute la côte avait été couverte d'artillerie. Alors on refusa de traiter. Les Turcs étaient revenus de leur effroi, et, les moyens moraux, les seuls favorables aux Anglais dans leur entreprise, se trouvant usés, il n'y avait plus aucune proportion entre les moyens matériels d'attaque et de défense.
On s'occupait aussi à armer les Dardanelles, afin d'en rendre le passage plus difficile. L'amiral anglais craignit les dangers du retour, et se hâta de partir. Un des gros boulets de pierre, lancé par cette artillerie barbare, mais gigantesque, du détroit, rencontra le grand mât d'un vaisseau de ligne anglais et l'abattit d'un seul coup.
L'énergie des Turcs et la rapidité avec laquelle on créa la défense firent, dans le temps, beaucoup d'honneur à Sébastiani. Il fut secondé puissamment dans l'exécution des travaux par les officiers que j'avais envoyés auprès de lui, parmi lesquels étaient deux de mes aides de camp, MM. Leclerc et Fabvier. Le dernier, homme d'une grande résolution, a acquis, depuis, à divers titres, une assez grande réputation. Avec eux était un autre officier, également de mon choix, et devenu, lui aussi, bien autrement célèbre, le colonel Foy.
J'ai parlé des difficultés de communication que la Dalmatie présentait: rien ne peut en donner l'idée. Elles rendaient les marches longues, pénibles, empêchaient de porter des corps organisés et en état de combattre sur le point où ils étaient nécessaires. Les transports des vivres et des munitions présentaient les plus grands embarras. Enfin les troupes, dans leur marche, étaient toujours dépourvues d'artillerie, de cet auxiliaire si puissant à la guerre.
Du temps des Vénitiens, tout était pour le mieux: maîtres de la mer et réduits sur terre à une guerre constamment défensive, ne communiquant qu'au moyen de leurs vaisseaux avec la Dalmatie, toutes les villes maritimes fortifiées étaient autant de têtes de pont par lesquelles ils pouvaient déboucher. Les ennemis à combattre étaient les Turcs et les Autrichiens, mais particulièrement les premiers. Le pays étant impraticable, les Turcs n'avaient aucun moyen de pénétrer avec du canon, à moins de travaux énormes, et, n'étant jamais maîtres de la mer, ils ne pouvaient bloquer les places maritimes, de manière que, quoique assiégées, ces places pouvaient être ravitaillées, et leurs garnisons conservaient toujours la liberté de sortir quand la défense ne pouvait plus se prolonger. Les transports à exécuter le long du littoral se faisaient au moyen de la mer, que personne ne pouvait leur disputer. Une route longitudinale leur était donc inutile: ils l'auraient eue qu'ils ne s'en seraient pas servis. Voilà la position des Vénitiens; elle était l'inverse de la nôtre. La mer ne nous appartenait pas; il ne nous fallait donc que peu de places maritimes, mais de très-fortes et exigeant un grand siége, et placées de manière à servir, au besoin, d'appui et de refuge à notre marine; les autres villes devaient être ouvertes et démantelées. Nous ne pouvions pas faire nos transports par mer; il nous fallait donc des chemins. Nous avions à redouter une armée de débarquement et des révoltes; il nous fallait donc pouvoir nous mouvoir par l'intérieur avec des troupes nombreuses, réunies, pourvues de matériel et munies de canons.
Ces réflexions me frappèrent aussitôt après mon arrivée en Dalmatie; mais je n'entrevoyais pas alors la possibilité de remédier à cet état de choses. Le repos laissé par l'ennemi, la disparition de l'amiral Siniavin et sa station dans le Levant, la douceur du climat dont on jouit, même au milieu de l'hiver, sur le littoral, l'utilité d'entretenir l'activité des troupes, et la répugnance que j'ai toujours eue à les fatiguer de manoeuvres quand elles sont instruites, tous ces motifs me donnèrent la pensée d'entreprendre ces travaux, sauf à les quitter si la guerre nous faisait prendre les armes, ou à augmenter leur développement si notre repos se prolongeait. J'eus recours à ces idées de gloire et d'avenir auxquelles j'avais trouvé mes soldats si sensibles dans mes travaux du camp de Zeist; je parlai de l'utilité dont seraient pour le pays de semblables travaux, de la reconnaissance publique qui en serait le prix. Je leur rappelai l'exemple des armées romaines, habituées à employer ainsi leurs loisirs. J'étais aimé de mes troupes, et un mot de moi, un désir, étaient des lois pour elles. La manifestation de semblables sentiments allait droit au noble coeur de ces braves soldats, et ils manifestèrent l'empressement le plus vif à commencer ces travaux.
Je ne voulais pas qu'il en résultât pour l'armée d'autres inconvénients qu'un peu de fatigue. En conséquence, le sort des soldats fut amélioré sous le rapport de la nourriture pendant la durée des travaux. Je répartis les ateliers à portée du cantonnement de chaque régiment, afin d'éviter des bivacs ou des déplacements pénibles. Chaque portion de route reçut le nom du régiment qui l'avait faite, et ce nom, ainsi que ceux du colonel et des officiers supérieurs, furent gravés sur le rocher. Ces idées de gloire, d'avenir et de postérité sont si utiles à développer dans les troupes! Les portions de route éloignées, qu'il fallait faire pour joindre celles qui s'exécutaient à portée des cantonnements, furent construites par les habitants sous la conduite d'officiers et de soldats désignés à cet effet. Je parlerai en particulier de ces travaux faits par les Dalmates. Avant de rendre compte de la direction de ces routes et des obstacles qu'elles présentaient, il est nécessaire de faire la description du pays.
La grande chaîne des Alpes, qui forme le réservoir de l'Europe, et dont le point culminant est en Suisse et en Tyrol, se divise et s'étend en plusieurs branches suivant différentes directions. L'une d'elles, marchant de l'ouest à l'est, sert de limite au nord de l'Italie et forme les Alpes Noriques. Arrivée en Carinthie, elle tourne subitement au sud ou sud-sud-est, et forme les Alpes Juliennes. C'est la chaîne que l'on traverse pour aller d'Italie en Carniole. Cette chaîne continue dans la même direction jusqu'en Grèce. Elle sépare constamment les eaux de l'Adriatique des eaux du Danube et de la mer Noire. Elle arrive en Albanie, près de Pristina. Là une autre chaîne se détache et court à l'est. Celle-ci forme la chaîne du mont Hémus et du Balkan, et se prolonge, par ses rameaux, jusqu'à la mer et au Bosphore de Thrace. Avant le dernier cataclysme qui ouvrit aux eaux ce passage, elle se rattachait par là à la chaîne des montagnes de l'Asie Mineure, au Caucase et au Thibet. Toutes les chaînes secondaires, qui, de la grande chaîne, se détachent et courent vers l'ouest ou le sud-ouest, sont ses contre-forts, et forment les montagnes de la Dalmatie et de l'Albanie.
Les sources des rivières de Dalmatie déterminent les points par lesquels passent les sommets de la grande chaîne. On sait que cette chaîne est d'abord à peu de distance de la Dalmatie, et qu'elle s'en éloigne en se prolongeant. Ainsi la Dalmatie se compose du même nombre de bassins et d'autant de chaînes de montagnes secondaires qu'il y a de rivières qui la coupent, et qui portent leurs eaux dans l'Adriatique, et ces chaînes, pour la plupart, se relèvent en approchant de la mer et se terminent par de très-hautes montagnes.
La première rivière est la Zermagna. Elle sert de délimitation entre la Dalmatie et la Croatie. Elle prend sa source très-près de la frontière. Sur sa rive droite sont les hautes montagnes de la Croatie; sur la rive gauche et jusqu'à la Kerka, le pays est légèrement ondulé.
La seconde est la Kerka. Cette rivière prend sa source à peu de distance de la Zermagna, passe au pied de la forteresse de Knin, vient à Scardonna et se jette dans le golfe de Sebenico. Cette rivière a peu d'eau pendant une partie de l'année; mais elle s'est creusé un lit de trente pieds de profondeur. Ses bords escarpés offrent des obstacles qui, considérés sous des rapports militaires, pourraient entrer puissamment dans les calculs d'un général, et servir utilement dans des mouvements d'armée. Les eaux de la Kerka contiennent des substances calcaires qu'elles déposent constamment. La suite des siècles a formé un barrage près de Scardonna. Il en résulte une des plus belles cascades de l'Europe, non par l'élévation, qui est assez peu considérable, mais par l'étendue, le développement et l'abondance de ses eaux dans la saison pluvieuse.
Vient ensuite la Cettina. Elle court d'abord du nord au sud, et ensuite tourne à l'ouest, traverse des montagnes ardues et élevées, et se jette dans la mer à Almissa. Une partie du pays, compris entre la Kerka et la Cettina, est couverte par des montagnes de rochers élevés, pelés et difficiles.
La quatrième rivière est la Narenta. Elle prend sa source dans l'Erzegowine, à vingt lieues de la Dalmatie. C'est un véritable fleuve par la masse de ses eaux; sa vallée, fort large, serait d'une grande richesse si les eaux étaient aménagées. Elle forme maintenant d'immenses marais là où les Romains avaient de belles campagnes bien cultivées.
Telles sont les quatre rivières qui traversent la Dalmatie.
Les routes construites eurent pour objet de rendre praticable pour des voitures le passage d'un bassin dans l'autre. Les Autrichiens avaient fait une seule route, celle du pont de la Zermagna, et qui va de la frontière de la Croatie à Zara; tout le reste était en projet.
Mes premières constructions eurent pour but deux objets: 1° établir la communication entre Zara, Scardonna, Sebenico, Trau et Spalatro, et 2° partir du pont de la Zermagna et de Knin, passer dans la vallée de la Cettina, et mener au meilleur débouché de la frontière pour pénétrer en Bosnie.
La première de ces roules passait par les cantonnements de l'armée; les troupes se trouvaient à portée d'y travailler; elle fut faite avec rapidité et succès, malgré les grandes difficultés locales. On peut en juger par un exemple: les murs de soutènement de la descente de la montagne de Trau ont de vingt à vingt-deux pieds d'élévation, dans une partie de leur développement. En moins de six mois on arriva à Spalatro par une route construite d'après les principes, avec double empierrement et des cordons.
On fit également en même temps, mais au moyen de réquisitions de paysans, une route pour aller de la vallée de la Cettina à Cresmo, débouché en Bosnie. Au moyen des troupes, on construisit aussi une route dans la largeur de la Dalmatie, et qui, partant de la frontière turque, et passant par Signe et Clissa, aboutissait au littoral à Spalatro. C'est dans ce bassin magnifique, l'un des plus beaux lieux de la terre, qu'une très-grande ville, Salona, l'une des plus belles de l'empire romain, était bâtie; c'est là qu'un empereur philosophe, dégoûté des grandeurs et de la puissance, avait choisi le lieu de sa retraite.
Pendant ces travaux, les troupes de la garnison de Raguse construisaient, de leur côté, une route de Raguse à Stagno, et partout l'émulation était égale.
Au nombre des rivières de la Dalmatie, on en compte encore deux dont j'ai omis de parler, parce qu'elles ne jouent aucun rôle dans la configuration du pays. La rivière de Salona sort toute formée du milieu d'un rocher; son cours est seulement d'une demi-lieue; mais elle roule beaucoup d'eau et se jette dans le golfe de Spalatro. Cette rivière produisait les truites célèbres que Dioclétien, dit-on, préférait à l'empire; elles sont encore délicieuses, mais je doute qu'aujourd'hui on les achetât à ce prix. La rivière d'Ombla, près Raguse, est une rivière souterraine qui se jette dans la mer en sortant des rochers. On a des motifs de croire que c'est l'embouchure de la rivière de Trébigne qui disparaît dans les montagnes. En général, tous ces pays calcaires sont remplis de ces phénomènes; les eaux, s'y frayant passage au milieu des rochers, disparaissent et reparaissent, sans qu'on puisse suivre leur cours avec certitude.
Quelquefois ces phénomènes s'accompagnent de circonstances fort singulières. La chaîne de montagnes placée entre la Cettina et la Narenta est fort élevée et se termine par le Biocovo, montagne de sept à huit cents toises de hauteur, dont le pied occidental est baigné par la mer; à l'est, elle est liée à une suite de hauteurs, dont les dispositions forment un bassin immense et sans issue. Il y a un lac; au fond de ce lac sont des gouffres par lesquels les eaux arrivent pendant la saison des pluies et viennent se joindre à celles que les pentes des montagnes amènent journellement. Chaque année ce lac se vide aux trois quarts, et l'on cultive immédiatement le terrain découvert. Mais, chose extraordinaire! quelquefois le lac se vide entièrement, et ce n'est jamais qu'après un automne et un hiver extrêmement pluvieux.
Voici mon explication: les gouffres, n'étant pas placés dans la partie la plus basse du lac, sont insuffisants pour enlever toute l'eau qu'il contient; d'ailleurs ils ne peuvent jamais donner issue qu'à la même quantité d'eau, à peu près, qu'ils ont amenée, et il reste toujours en surplus celles qu'amènent les pluies et les pentes des montagnes environnantes, sauf l'évaporation. Quand l'année a été très-pluvieuse, les eaux du lac s'élèvent davantage. Alors, si l'on suppose que, dans le Biocovo, il existe un syphon communiquant avec la mer, et que, dans ces années d'exception, le niveau du lac dépasse le niveau du coude du syphon, celui-ci est aussitôt rempli, il fonctionne, et, sa courte branche aboutissant au point le plus bas du lac, celui-ci est mis à sec. Cette explication satisfait l'esprit sur le phénomène, et semble ne laisser rien à désirer. Autre singularité: le lac souterrain, recevant les eaux, conserve aussi les poissons, et les pêcheurs placent leurs filets aux voragines ou gouffres, à l'arrivée de l'eau comme à son départ.
Je reviens à la construction des routes. La partie que j'ai décrite fut faite comme par enchantement. Ces travaux me donnèrent beaucoup de popularité. Les peuples aiment à voir l'action de la puissance, quand elle est salutaire ou glorieuse; ils aiment à voir leurs chefs parler à l'imagination par leurs actions. Les Dalmates disaient et répétaient, dans leur langage rempli d'images: «Les Autrichiens, pendant huit ans, ont fait et discuté des plans de routes sans les exécuter; Marmont est monté à cheval pour les faire faire, et quand il en est descendu elles étaient terminées.» Je me rendis à Raguse, pour faire l'inspection des travaux ordonnés, et je fus content de l'état dans lequel je trouvai toute chose.
Le 20 avril, d'après l'ordre de l'Empereur, et à la demande du général Sébastiani, je préparai l'envoi à Constantinople de cinq cents canonniers et sapeurs. Des firmans du Grand Seigneur me parvinrent pour autoriser leur entrée en Bosnie. Je ne perdis pas un moment pour l'exécution de cette importante mesure; mais, au moment de mettre la troupe en marche, les firmans ne se trouvèrent pas en règle; ils ne portaient que le nombre de trois cents hommes. Ensuite le pacha, par une sollicitude dont je ne pus admettre la nécessité, voulait que les canonniers marchassent par détachement de douze à quinze. Il en résulta une discussion qui fit perdre beaucoup de temps.
Enfin, le 6 juin, le détachement entra en Bosnie, pourvu de tout ce dont il pouvait avoir besoin, ayant l'argent nécessaire à sa dépense pendant toute sa route, et sous le commandement du sous-chef de mon état-major, le colonel Delort. Le pacha de Bosnie le reçut avec beaucoup d'égards et de soins; mais, après avoir dépassé Traunich, la nouvelle de la catastrophe de Sélim étant parvenue, et le commandant du détachement ayant reçu une lettre de Sébastiani qui lui prescrivait de rentrer en Dalmatie, il revint sur ses pas. On ne savait pas quel système politique suivrait Mustapha, successeur de Sélim. Les institutions nouvelles, et conformes aux usages des peuples civilisés, étaient l'objet des préventions et de l'animadversion des Turcs, et l'aliment de leurs passions contre tous les Européens. Il était sage de faire rétrograder le détachement désiré, demandé par le gouvernement. Appelé par l'opinion, il pouvait être utile; mais, dans la circonstance présente, il ne pouvait être qu'un embarras et l'occasion d'un danger. Par mesure de prudence, et pour protéger son retour, je me rendis à la frontière avec des troupes aussitôt que je connus les événements, et je serais allé à sa rencontre et l'aurais dégagé si des insurrections en Bosnie eussent fait commettre contre lui quelque hostilité.
Depuis quelque temps, Siniavin était revenu à Cattaro; il avait établi une croisière sur nos côtes devant Spalatro, et il la renforçait tous les jours. Enfin une grande partie de l'escadre arriva le 5 juin avec des troupes de débarquement. Il avait établi des intelligences dans le pays. Les Autrichiens n'avaient pas cessé de fomenter le mécontentement. Le provéditeur, par sa folle vanité et ses fausses mesures, prêtait son appui aux mécontents. Nos ennemis les plus déclarés s'étaient emparés de son esprit en flattant ses passions et son orgueil. Sans le savoir, il s'était mis entre leurs mains. Ses agents, les hommes de sa confiance, conspiraient, et cependant il ne voulut jamais le croire. Il n'était sans doute pas leur complice, car il fut rempli de terreur au moment où l'insurrection éclata; mais ses yeux étaient fascinés.
Un colonel de Pandours, nommé Danese, travaillait activement, avec les Russes et les moines, à amener un soulèvement au profit des Autrichiens. Sa famille avait de l'influence dans le pays; sa haine contre l'ordre établi, son dévouement aux Autrichiens, étaient connus. La levée de la légion dalmate avait mécontenté, parce qu'on avait étendu la conscription aux villes. Du temps des Autrichiens, jamais les levées de soldats n'avaient souffert de difficultés; à la vérité, les villes en étaient exemptes. Aujourd'hui il en était autrement, et les habitants des villes communiquaient leur mécontentement aux habitants de la campagne, quoique la mesure dont ils se plaignaient fût une mesure de justice en faveur de ces derniers. Ainsi va le monde, souvent on sert avec passion, et contre ses propres intérêts, les passions et les intérêts des autres.
L'amiral débarqua immédiatement mille hommes environ dans le comté de Politza. Aussitôt les habitants se révoltèrent, prirent les armes, et tous ceux des environs de Spalatro en firent autant. Quelques soldats périrent et furent assassinés. J'étais à Zara, et j'en fus informé sur-le-champ. Je me rendis tout de suite à mon quartier général; mais déjà, à mon arrivée, les Russes s'étaient rembarqués, et mon chef d'état-major, le général Vignolle, avait marché à eux avec le 8e léger et le 11e. Ils s'étaient retirés sans l'attendre, et il occupait même déjà une partie du comté de Politza. J'achevai de tout soumettre et d'y rétablir l'ordre.
L'ennemi occupa Almissa, ville entourée de vieilles fortifications et défendue par un vieux fort qui la domine. L'accès en est très-difficile: la Cettina nous en séparait, il fallut manoeuvrer et arriver par la cime des montagnes. Cette opération exécutée, les Russes se rembarquèrent après avoir perdu quelques hommes, tués, blessé, ou prisonniers.
Le comté de Politza, situé dans une vallée délicieuse, mais très-élevée, est hors de toutes les communications, et le chemin qui y conduit est très-difficile à parcourir et très-facile à défendre. L'isolement de cette localité, joint aux moyens que la nature a donnés à ses habitants pour se soustraire à l'obéissance, est sans doute la cause des priviléges que les Vénitiens leur avaient donnés: ils ne payaient aucun impôt, se gouvernaient eux-mêmes, nommaient leurs magistrats et ne fournissaient ni soldats ni matelots. On voulut leur enlever ces priviléges, et on les mécontenta. Assurément, la vue de ce petit pays parlerait en faveur du système de son administration: rien de mieux réglé, rien de plus soigné que leur culture, rien de plus joli que leurs villages. Cette vallée renferme une immense quantité de cerisiers portant de petites cerises sauvages, des marasques, employées à faire la liqueur si célèbre de Zara, appelée marasquin.
Les magistrats de Politza sont annuels. Il y a douze comtes qui commandent chacun un village, et l'élection du grand comte se fait par toute la population assemblée, dans un des endroits les plus larges de la vallée. On se rassemble là à jour fixe. Le grand comte dont l'exercice finit dépose dans un lieu indiqué une boîte de fer renfermant la charte des priviléges. Le plus ambitieux et le plus hardi va la prendre sous une grêle de pierres: quand il s'en est emparé, s'il a pu le faire vivant, il est reconnu grand comte.
Ce mode d'élection en vaut bien un autre; il suppose au moins, dans le dépositaire de l'autorité, de la décision, du courage et du bonheur, trois grands éléments de succès dans ce monde. Je remarquerai, à cette occasion, que le titre porté par le chef de Politza, dans la langue illyrienne knès, est le même que portent les princes russes. On l'a traduit ici par comte, titre modeste; les Russes l'ont traduit par prince par orgueil; mais c'est à tort, car, excepté les princes russes descendant de Rurik et de Jagellon, presque tous les autres sont originairement des Tartares, décorés de ce titre par le caprice des czars, au moment où ils arrivaient à Moscou. Knès veut dire chef, et chef d'un petit territoire.
Après avoir rétabli la paix dans cette petite contrée, je m'étais rendu à la frontière de Bosnie avec des troupes, pour attendre le retour de mes canonniers; mais les désordres de la province n'étaient pas finis. Les Russes débarquèrent de nouveau à Macarsca et dans le Pridvorié. Ils eurent l'imprudence de s'éloigner de la mer, pour donner confiance aux habitants des villages qui, en assez petit nombre, prirent les armes. Le général Delzons, avec le 8e léger, les attaqua sans perdre un moment, et leur prit ou tua deux cents hommes: les révoltés se dispersèrent. Je fis faire une enquête extrêmement étendue et circonstanciée. Je la confiai à un officier de choix, qui mit, dans ce travail important, autant de sévérité que de lumières, de soins et de conscience. Les véritables coupables furent punis, et depuis ce temps la province fut tranquille.
Je raconterai ici deux anecdotes, pour montrer dans quelle aberration tombent quelquefois les juges militaires, par de fausses idées d'humanité, et en quoi consiste la justice aux yeux de barbares corrompus.
Au moment où la révolte éclata, un soldat du 11e régiment reçut, à bout portant, un coup de fusil dans la grande rue de Castel-Vecchio, au coin d'une rue qui conduit à la mer. Ce soldat blessé, conduit à l'hôpital, désigne, avant de mourir, le lieu où il a été atteint, et donne le signalement de celui qui l'a blessé; il était vêtu de telle et telle manière, et portait une balafre à la joue gauche. D'un autre côté, on avait arrêté dans la même rue un Dalmate dont toutes les circonstances de l'habillement, de la taille et du signalement correspondaient à la description faite par le soldat; de plus, il avait entre ses mains un fusil déchargé et venant de faire feu. La commission militaire, par un caprice impossible à expliquer, condamna le coupable aux galères. Il fallait frapper d'une salutaire terreur une population insurgée; il fallait faire un exemple sur les véritables coupables. Or la condamnation aux galères ne signifiait rien pour l'exemple. Je fis venir la commission militaire pour lui demander ses motifs; et, comme elle ne put rien répondre de raisonnable, je fis fusiller le coupable de ma propre autorité. Je vois d'ici bien des fronts se rembrunir en lisant ce récit; eh bien, quoi qu'on puisse dire, dans la position où j'étais, ce devoir m'était imposé; et, dans de pareilles circonstances, il faut savoir le remplir en engageant toute sa responsabilité.
Voici l'autre fait. J'avais pris à mon service un Dalmate d'une grande et rare beauté, natif de Spalatro. Sa taille et son costume le rendaient vraiment remarquable. Au milieu de l'instruction de la procédure, il alla trouver le capitaine rapporteur et lui dénonça un curé du voisinage. Il circonstancia de la manière la plus positive et la plus détaillée son accusation. Le curé fut arrêté, interrogé; il tomba de son haut en entendant les charges portées contre lui et se justifia d'une manière catégorique. Confronté avec son accusateur, celui-ci fut confondu. Je lui demandai d'expliquer le motif de son action; il me répondit: «J'ai vu chercher des coupables, j'ai cru faire plaisir en en indiquant.» Voilà comme ces gens-là conçoivent la justice. Je le chassai ignominieusement, comme on peut le supposer.
Après ces événements, les Russes, réunis aux Monténégrins, attaquèrent le pacha de Trébigne et envahirent ses terres. J'avais fait destituer le pacha de Trébigne, dont la conduite avait été hostile envers nous, et le nouveau, appelé Suliman, nous était tout dévoué. Les Monténégrins, au nombre de trois mille, soutenus par quatre cents Russes et du canon, vinrent mettre le siége devant la petite forteresse de Clobuk. J'envoyai de Raguse le général Launay, avec mille hommes d'infanterie, au secours du pacha. Il marcha, soutenu de deux mille Turcs, dégagea Clobuk et fit prisonniers les quatre cents Russes. Ce fut la cavalerie turque qui les prit, et ils étaient sa propriété. Plusieurs eurent la tête coupée, et le général Launay se hâta de se rendre propriétaire des malheureux qui restaient en donnant un louis par homme. Il en sauva ainsi un bon nombre. Les Turcs, ensuite au désespoir de les avoir vendus, venaient offrir au général Launay trois à quatre louis pour les ravoir et se donner le plaisir de couper des têtes. Mais, on le devine, le général Launay ne se livra pas à cet horrible trafic, et ces malheureux prisonniers conservèrent la vie.
Sur ces entrefaites, un envoyé du pacha de Janina arriva chez moi, et m'apporta un sabre en présent de la part de son maître. Il allait en mission en Pologne pour trouver l'Empereur. Cet envoyé, nommé Méhémet-Effendi, avait eu une étrange destinée. Il était Romain et prêtre quand nous l'avions trouvé à Malte, lors de la prise de cette ville, où il remplissait les fonctions d'inquisiteur. Il nous avait suivis en Égypte, et nous l'avions employé dans l'administration. Ne trouvant pas, dans cette carrière, les avantages qu'il s'était promis, il avait voulu revenir en Europe, et s'était embarqué avec deux officiers français, aujourd'hui officiers généraux, Poitevin, du génie, et Charbonnel, de l'artillerie. Un corsaire les prit et les conduisit à Janina, où ils furent mis en prison. Un jour le ci-devant inquisiteur annonça qu'il avait eu une vision; que Mahomet lui était apparu, et lui avait prouvé que la religion chrétienne était fausse et que la vérité était dans la sienne, et il déclara en même temps, dès ce moment, qu'il voulait adopter l'Alcoran. On le mit aussitôt en liberté. Il eut des emplois près d'Ali-Pacha et parvint à la faveur. Quand il se présenta chez moi, son maître venait de le charger de négociations auprès de Napoléon. Le vizir avait jugé la paix prochaine, et prévu que l'Empereur se ferait céder Corfou et les Sept-Îles. Ali-Pacha envoyait Méhémet pour les demander, et son unique argument, pour convaincre Napoléon, était celui-ci: Ali-Pacha aime les Français; un général français viendra commander à Corfou; le voisinage engendrera des querelles, et l'on dira à tort qu'Ali-Pacha n'aime pas les Français. Pour prévenir une pareille injustice, il vaut mieux lui donner l'île, à Ali-Pacha. Méhémet-Effendi joignit l'Empereur au moment où il venait de signer la paix. Les conditions en étaient encore secrètes. Il lui fit sa demande et l'appuya du puissant argument que je viens de développer, et l'Empereur répondit: «Mais comment prendre Corfou? Je ne l'ai pas.--Mais Votre Majesté l'aura, dit le renégat.--Comment le prendre?» répliquait l'Empereur; et il ne sortait jamais de cet argument, qui ne le compromettait pas. Méhémet-Effendi en fut pour ses frais de voyage, et retourna vers son maître. On m'a assuré que ce malheureux était depuis retourné à Rome, où il avait fait pénitence publique.
Je reçus, le 21 Juillet, la nouvelle de la paix signée le 8, à Tilsitt, entre Napoléon et l'empereur Alexandre. Une amitié sincère semblait devoir unir les deux adversaires, si longtemps ennemis.
Peu après, me parvint l'ordre d'envoyer les renseignements les plus circonstanciés sur la Turquie d'Europe, sur sa population et les revenus de ses différentes provinces, sur ses communications et les opérations militaires que sa conquête rendrait nécessaires. Enfin l'Empereur me fit demander un plan de campagne pour deux armées qui déboucheraient, l'une de la Dalmatie, et l'autre de Corfou. C'était me créer de grandes espérances. J'avais étudié le pays avec tant de soins, je m'étais fait fournir des itinéraires et rendre des comptes si détaillés par tous les officiers que j'avais fait voyager par diverses routes, que, dès le 1er août, je fus à même d'envoyer à l'Empereur une grande partie des mémoires demandés. Tout annonçait la conquête de la Turquie d'Europe et son partage; tout me promettait une campagne brillante. Les divisions de réserve se formaient en Italie; je recevais l'ordre de tout préparer pour recevoir une escadre de quinze vaisseaux à Raguse; tout enfin prenait une attitude conforme à mes voeux; mais rien ne se réalisa. Sans la tournure que prirent les affaires d'Espagne, il en aurait été autrement. Toutefois j'ai passé trois années de ma vie à rêver et à espérer des opérations en Turquie, tantôt pour secourir ce pays comme allié, tantôt pour le conquérir. À cette époque, je rêvais la grande guerre comme on rêve le bonheur dans sa jeunesse, et le bonheur, comme il arrive souvent, se faisait bien attendre.
Au commencement d'août, je reçus des ordres pour prendre possession de Cattaro, et un officier russe arriva à mon quartier général, porteur de ceux adressés à l'amiral Siniavin. Pour cette fois, tout le monde était sincère; les choses se firent vite, et avec tous les égards et toutes les attentions possibles. Dès le 12 août, les troupes françaises occupèrent Castelnovo et Cattaro. Je donnai l'ordre au général Lauriston de présider à la prise de possession, et je me rendis à Raguse, en attendant le départ des Russes. Ils l'exécutèrent promptement, et j'allai visiter ces lieux, dont le nom a retenti pendant trois mois dans toute l'Europe.
Les Bocquais, depuis l'affaire de Castelnovo, étaient restés tranquilles. Ils avaient compris que leur intérêt, comme leur devoir, était d'attendre silencieusement la fin de la lutte pour savoir à qui ils appartiendraient, ils reçurent bien les troupes françaises, et cherchèrent, par un bon accueil, à faire oublier leurs torts passés. Je ne fis aucune récrimination, cela ne servait à rien; seulement, j'ordonnai de restituer aux Ragusais les bâtiments que les Bocquais leur avaient pris à Gravosa, dans le port, contre le droit des gens, en leur faisant rembourser les droits exigés par les Russes. Je me suis bien trouvé de cette indulgence: depuis cette époque, la conduite des habitants de presque toute cette province n'a pas cessé un seul jour d'être bonne et pacifique.
Je pourvus à la défense de la rade en faisant établir des batteries à son entrée, mettre dans un état convenable les fortifications de Cattaro et de Castelnovo, et j'organisai la province le plus économiquement possible. Rien ne serait plus en rapport avec les moeurs des habitants de ce pays, en l'appliquant à la marine, que cette admirable organisation croate, tout à la fois élément de la défense et de la sûreté du pays, et principe de civilisation; mais il aurait fallu beaucoup de temps et de dépense pour l'exécuter. Je n'avais d'ailleurs pas mission de le faire, et le gouvernement avait, à cette époque, sur cette organisation, les idées les plus fausses; il n'en connaissait ni le secret ni les contre-poids. Je me contentai donc de donner une organisation civile et judiciaire indispensable, et je cherchai à faire de bons choix.
L'évêque du Monténégro me demanda une entrevue. Je la lui accordai, et nous nous rencontrâmes à peu de distance de Cattaro. Nous parlâmes du passé, et je lui demandai pourquoi il nous avait fait la guerre. Il me répondit que, placé sous la protection de la Russie, comblé de bienfaits par elle, il avait cru de son devoir de lui obéir; mais aujourd'hui le nouvel état de choses changeait sa condition et lui imposait d'autres devoirs. Il m'assura que le peuple du Monténégro vivrait en bon voisin, ne donnerait lieu à aucune plainte, et qu'il ambitionnerait de posséder les bonnes grâces de mon souverain. Son discours, sans lui faire prendre des engagements formels, me laissa supposer la pensée de se mettre un jour sous la protection de la France. Je n'attaquai pas cette question; la proposition devait venir de lui. Plus tard, quand je crus qu'il allait la faire, il avait changé. Le gouvernement russe n'avait sans doute jamais cessé d'attacher beaucoup de prix à l'influence qu'il exerçait sur ces contrées. Je lui promis, de notre côté, un bon voisinage, mais à charge d'une réciprocité dont il me réitéra l'assurance; et, là-dessus, nous nous séparâmes. Ce vladika, homme superbe, de cinquante-cinq ans environ, d'un esprit remarquable, avait beaucoup de noblesse et de dignité dans les manières. Son autorité positive et légale était peu de chose dans son pays, mais son influence était sans bornes.
Après avoir pourvu aux besoins de cette province et organisé son administration, j'ordonnai une levée de six cents matelots pour la flottille et la marine de Venise, ce qui s'exécuta sans difficulté. Cette population, composée de quarante-cinq mille habitants, entretient quatre cent cinquante bâtiments patentés, dont un certain nombre fait la grande navigation. Je mis ce pays et son administration sous les ordres et l'inspection du général Lauriston, et je rentrai en Dalmatie.
En arrivant à Spalatro, j'appris un crime horrible qui m'affligea beaucoup, commis pendant mon absence et presque sous mon nom. Un certain général Guillet, né en Savoie, ayant servi autrefois, en qualité de garde du corps, le roi de Sardaigne, avait été mis sous mes ordres à l'armée de Dalmatie. Les brigades de mon corps d'armée étant données, je l'avais chargé du commandement de l'arrondissement de Spalatro. Cet homme était rempli d'intelligence, de finesse et de perspicacité; rien ne lui échappait; il savait tout ce qui se passait. Il m'avait été fort utile pendant la guerre par ses rapports. En partant pour Cattaro, je l'avais chargé de recevoir des Russes l'île de Brazza. Pendant les derniers mois de la guerre, cette île avait été la place d'armes de l'ennemi; de là étaient parties ses intrigues, secondées par plusieurs habitants, ses agents dévoués. Bien plus, ces mêmes habitants avaient armé des corsaires et fait plusieurs prises sur nous. Il fallait faire un exemple. Je donnai l'ordre au général Guillet de faire une enquête aussitôt qu'il serait maître de l'île (personne n'y était plus propre que lui), de faire arrêter les principaux coupables et d'attendre mon retour. Au lieu de cela, le général Guillet fit arrêter, non les plus coupables, mais les plus riches; et, pour donner aux détenus une idée de son autorité, il fit fusiller, sans jugement, un des hommes arrêtés, accusé d'avoir armé un corsaire; puis il mit les autres en liberté pour de l'argent. À mon arrivée, tout le monde était silencieux et dans la stupeur; mais de pareils torts devaient venir enfin à ma connaissance. On devine mon indignation. Le général Guillet, interrogé, se renferma dans une dénégation absolue. Je fis appeler les hommes mis en liberté; ils me déclarèrent ce qui s'était passé et les sommes données à un aide de camp du général Guillet, qui avait disparu au premier mot prononcé sur cette affaire. Je déclarai au général Guillet qu'il allait être traduit devant un conseil de guerre si, à l'instant, l'argent n'était pas rendu. Il ne se le fit pas répéter deux fois. L'argent ayant été restitué en ma présence, je renvoyai de l'armée ce misérable. L'Empereur le fit rayer du tableau des officiers généraux, et, depuis, il a servi dans les douanes.
Le repos qui survint, les loisirs dont je jouissais, et la probabilité de les voir se prolonger quelque temps, me donnèrent l'idée d'entreprendre la continuation de la grande communication longitudinale de la Dalmatie, de Knin à Raguse, ouvrage gigantesque sans doute, mais que d'autres achèveraient après moi si je n'avais pas le temps de le terminer. Des paysans seuls pouvaient être employés à son exécution. La longueur des travaux et leur durée probable, les localités par lesquelles cette route devait passer, obligeant à des bivacs continuels, auraient fatigué les troupes. Les constructions sont fort de mon goût; mais cependant, avant tout homme de guerre, je voulais conserver mes soldats pour combattre quand le moment serait venu; car, dans ce temps-là, il ne fallait qu'un peu de patience: on était bien sûr de voir la guerre arriver.
On connaît la pauvreté et la paresse des Morlaques. En leur imposant l'obligation de travailler, je ne leur faisais aucun mal. Le plus grand nombre manque toujours de subsistances avant la récolte; en les appelant au travail, il fallait leur donner des vivres: ainsi c'était améliorer leur position. Bien plus, le travail, étant une chose d'habitude, finit par entrer dans les goûts et devient nécessaire à l'homme qui y est accoutumé. Des paysans, après avoir travaillé pendant quelques années pour l'État, trouveraient beaucoup plus doux ensuite de travailler pour eux-mêmes afin d'améliorer leur sort. C'est une éducation qui les dispose à devenir meilleurs.
Je fis faire dans la province un recensement général des hommes en état de travailler. Tous y furent compris sans exception, n'importe leur classe. Tout le monde eut la permission de se faire remplacer; ainsi l'on ne demandait aux gens riches que de l'argent. La totalité des hommes propres au travail se trouva être de douze mille. Je les divisai en deux bandes: une moitié remplaçait l'autre dans les travaux de quinze en quinze jours. Les ateliers, autant que possible placés à portée des communes qui fournissaient les ouvriers, étaient cependant souvent à une ou deux marches. La route fut entreprise dans tout son développement. Le jour de l'arrivée des ouvriers, un ingénieur donnait à ceux de chaque commune une tâche raisonnable pour les travaux de la quinzaine, et des sapeurs, ainsi que quelques officiers et sous-officiers de différents corps, servant de piqueurs, dirigeaient les travaux. Chaque homme recevait un pain de munition ou deux rations par jour, c'est-à-dire plus de pain que jamais aucun Dalmate n'en a mangé chez lui. Quand la tâche était faite, ils retournaient chez eux; si au bout de quinze jours elle n'était pas terminée, ils restaient malgré l'arrivée de leurs camarades; mais aussi, quand ils devançaient l'époque fixée, ils quittaient les ateliers avant les quinze jours expirés, en emportant la totalité du pain de la quinzaine, sorte de prime d'encouragement et récompense de leur zèle. Elle suffisait, car l'activité était telle, que les ateliers étaient toujours déserts pendant deux ou trois jours. Les trois jours de temps ainsi conquis leur faisaient un plaisir extrême, impossible à exprimer.
Deux directions différentes pouvaient être choisies dans le tracé de la route: suivre le littoral en partant de Spalatro, et passer par les villes d'Almissa et de Macarsca; ou bien, de Knin entrer dans la vallée de la Cettina, passer par Signe, traverser la Cettina à Tril, et arriver sur la Narenta en franchissant le col de Touriate et suivant cette vallée déserte qui aboutit à Vergoratz et passe en arrière de la Vrouilla et du Biocovo. La première direction, plus convenable pour les habitants et plus en rapport avec les besoins usuels, aurait eu le défaut, en suivant le bord même de la mer, d'être soumise à l'action des vaisseaux placés dans le canal. Par conséquent, elle eût été impraticable quand on n'aurait pas été maître de la mer. Or c'était précisément pour ce cas que la route était faite. La raison militaire devait donc l'emporter. La direction de l'intérieur fut préférée, et la route exécutée entièrement jusque bien au delà de la Narenta, tandis que de Raguse on s'était avancé au delà de Stagno. À l'exception d'une petite lacune, la route jusqu'à Raguse était terminée, quand, en 1809, nous sommes entrés en campagne contre les Autrichiens, et que nous avons quitté les outils pour prendre les armes. Lorsqu'un gouvernement éclairé possède des pays pauvres et barbares, il doit se hâter de faire exécuter, par corvées, les grands travaux d'utilité publique. Il avance ainsi l'époque de leur civilisation et de leur richesse, sans appauvrir momentanément les habitants; car alors le temps qu'on leur enlève n'a aucune valeur pour eux. Plus tard il en serait tout autrement. L'État ne serait pas assez riche pour les payer, et l'on n'exécuterait pas les travaux utiles. Cependant il arrive un moment où, les avantages que la société en retire étant supérieurs aux frais, alors, et à de certaines conditions, les particuliers s'en chargent comme spéculation; mais c'est que le pays est devenu riche et a acquis une grande prospérité par la succession des temps et le développement de l'industrie. Or la création de la richesse est d'abord singulièrement favorisée par la facilité des communications.
Le bien procuré par ces travaux à la Dalmatie sera toujours apprécié davantage, et une civilisation plus précoce en sera nécessairement le résultat. Dans l'ordre des idées, il faut, pour civiliser des barbares, les réunir, et multiplier leurs rapports entre eux. Les routes y servent merveilleusement et en sont le premier moyen. Les habitants, d'abord contraires à ces travaux, s'y seraient refusés s'ils l'avaient pu; mais, quand ils furent terminés, ils en reconnurent l'utilité, et me demandèrent l'autorisation d'ouvrir de nouvelles communications avec leurs seuls moyens: je la leur donnai sans difficulté, comme on l'imagine. L'empereur d'Autriche, visitant cette province en 1817 ou 1818, les vit avec admiration; il dit naïvement au prince de Metternich, qui me l'a répété, ces propres paroles: «Il est bien fâcheux que le maréchal Marmont ne soit pas resté en Dalmatie deux ou trois ans de plus.»
On aura une idée de la nature de ces travaux et de leur difficulté par le fait suivant. Après le passage de la Cettina, la route suit le flanc d'une montagne, et les murs de soutènement, dont la hauteur varie de cinq à vingt pieds, n'ont pas moins de huit lieues de longueur. À l'approche de la Narenta, il a fallu percer des rochers avec la mine, et quarante mille kilogrammes de poudre ont été employés à cet usage. Enfin, pour traverser les marais de la Narenta, on a dû construire des ponts pour l'écoulement des eaux et faire une digue de vingt pieds de base, de huit pieds de hauteur et de vingt-deux mille mètres de longueur. Certes, les Romains n'ont rien fait de plus beau, de plus difficile et de plus admirable: le souvenir des travaux des armées romaines et mon expérience m'ont conduit à penser que leurs célèbres travaux ont été faits comme cette dernière route; les soldats romains n'ont pas exécuté eux-mêmes tout ce qu'on leur attribue: ils ont fait travailler les habitants des lieux où ils étaient stationnés, comme nous l'avons fait chez les Dalmates: seulement, ils faisaient les ouvrages d'art et surveillaient les travaux. En pensant au petit nombre de soldats dont étaient composées les armées romaines et à l'étendue des communications dont on leur attribue la construction, c'est la seule explication raisonnable.
Après avoir ouvert les fortifications des villes maritimes placées hors d'un bon système de défense, je fis servir ces travaux à leur embellissement. Spalatro, un des lieux dont les restes donnent la plus haute idée de la grandeur romaine, eut, sur le port, un magnifique quai de plusieurs centaines de toises et un beau jardin public.
Un empereur philosophe, dégoûté du pouvoir et des grandeurs humaines, veut se retirer du monde, vivre en solitaire, et l'ermitage qu'il se bâtit est assez vaste pour contenir aujourd'hui la moitié de la population d'une ville de neuf mille âmes! Et cet ermitage se compose d'un palais de la plus belle architecture, quoiqu'on y reconnaisse déjà cependant le commencement de la décadence de l'art. Que sommes-nous donc, nous autres modernes, à côté d'une pareille puissance et d'une semblable grandeur? Mais nous trouvons une compensation dans une idée consolante: l'existence sociale actuelle est plus dans les intérêts de l'humanité. Si nous ne sommes pas supérieurs aux anciens pour les productions qui dépendent de l'esprit et de l'imagination, ils sont bien au-dessous de nous pour ce qui tient à la découverte des mystères de la nature, et dans les arts et les sciences qui influent sur le bien-être des hommes en général. Nos doctrines morales, bienfait du christianisme, sont plus belles, sans altérer en rien l'énergie des hommes dans ce qu'elle peut avoir d'utile et de louable; cette religion sublime est venue adoucir nos moeurs et plaider la cause de l'humanité et du malheur. La faiblesse a aujourd'hui des droits qui balancent l'action brutale de la force, et celle-ci, la première de toutes les lois à l'origine des sociétés, ne règle plus uniquement la destinée des hommes.
Ces travaux exécutés, et mes loisirs me permettant de parcourir la Dalmatie dans toutes les directions, il n'y a pas une ville, pas un village que je n'aie traversé, pas un chemin que je n'aie parcouru, pas une montagne dont je n'aie su le nom. Aujourd'hui même, après vingt-deux ans, les noms reviennent en foule à ma mémoire. Si ce pays devient l'objet de soins particuliers, il pourra atteindre une grande prospérité. Du temps des Romains, la Dalmatie avait quatre à cinq millions d'habitants; aujourd'hui, elle n'en a que deux cent cinquante mille, la vingtième partie! Des mines de charbon de terre pourraient être exploitées avec facilité et beaucoup d'avantage; l'Italie en manque dans toute son étendue, et le mont Promina, placé à deux lieues de Dernis et à quatre lieues de Scardona, où les plus forts bâtiments peuvent arriver, n'est qu'un amas de combustibles au-dessous du sol. Des sondages exécutés à la profondeur de plusieurs centaines de pieds le prouvent. J'avais l'intention, quand j'étais gouverneur des provinces illyriennes, de le faire exploiter; mais mes destinées m'enlevèrent à ces intérêts en me jetant dans des combinaisons éloignées.
On me demandera avec quelles ressources j'ai pu faire exécuter de si grands travaux. J'avais à ma disposition quelques centaines de mille francs qui ne furent pas nécessaires pour les services auxquels ils étaient destinés, et je les consacrai aux ouvrages d'art et aux indemnités données aux soldats. L'entrepreneur des vivres fournit, sur ma demande, les rations de pain nécessaires aux paysans; et il n'est pas bien sûr, grâce à tous les bouleversements qui ont eu lieu, qu'à l'heure qu'il est il en ait reçu le prix. En somme, ces travaux eussent été l'objet des plus grands éloges officiels s'ils avaient été faits par suite d'ordres du gouvernement; mais ce n'avait été qu'un passe-temps pour moi et un moyen d'occuper mes loisirs. Ils auraient coûté plusieurs millions s'ils eussent été exécutés par les moyens ordinaires de l'administration, et la totalité de la dépense ne s'est pas élevée à un seulement.
À la fin de décembre, le général Lauriston, nommé gouverneur de Venise, quitta l'armée de Dalmatie et fut remplacé par le général Clausel.
À cette époque, je fus élevé à la dignité de duc. Le nom qui me fut donné, rappelant des services rendus, ajouta encore à la valeur de cette récompense.
RELATIFS AU LIVRE DIXIÈME
LE PRINCE EUGÈNE À MARMONT.
«Brescia, 26 juillet 1806.
«Je m'empresse de vous adresser, monsieur le général Marmont, une lettre pour M. de Siniavin, amiral russe. Vous voudrez bien la lui faire parvenir le plus promptement possible. Je vous envoie copie du traité renfermé dans la lettre, lequel traité a été signé à Paris le 20 juillet 2. L'Empereur me charge de vous écrire de fournir au général Lauriston les moyens d'occuper les bouches de Cattaro en force. Vous devrez lui fournir tout ce que vous pourrez en poudre, munitions, biscuits, etc... Vous avez dans les eaux de la Dalmatie une division de chaloupes canonnières commandée par le capitaine de frégate Arméni, qui est parti de Venise, spécialement destiné pour Raguse et l'Albanie. Le blocus de Raguse l'a empêché de se rendre à sa destination. Profitez du premier moment pour l'y envoyer. Vous sentez parfaitement que, dès que les Anglais auront connaissance de ce traité, ils bloqueront Cattaro. Vous avez donc à peu près quinze jours pour vos communications avec Cattaro. L'intention de Sa Majesté étant que les forts d'Albanie soient mis sur-le-champ en état de soutenir un siége s'ils étaient attaqués, vous pourrez vous faire mettre sous les yeux les instructions que j'avais envoyées au général Lauriston, et dont le général Charpentier a envoyé copie au général Vignolle. Je fais diriger sur Cattaro, de Venise et d'Ancône, des blés et des farines, ainsi que quelques munitions; mais il vaut toujours mieux ne pas y compter. D'ailleurs, nous vous avons déjà fait des envois considérables de poudre, et vous pourrez facilement en faire passer cent milliers à Cattaro, d'autant que je pourrai vous les remplacer facilement. Quoique, dans le traité, l'Empereur reconnaisse l'indépendance de Raguse, on ne doit pas l'évacuer avant d'avoir reçu des ordres bien positifs à cet égard; mais on peut leur promettre que, les articles du traité exécutés par les Russes et les Monténégrins, rentrés dans leurs montagnes et tranquilles, on abandonnera le pays.
«Je vous préviens que l'Empereur met infiniment d'importance à la position de Stagno; il me charge de vous écrire que vous ordonniez au général Poitevin de tracer un bon fort à cette position et d'y faire travailler promptement. L'Empereur veut que ce fort coupe la presqu'île de Sabioncello, de manière que la presqu'île appartienne toujours au maître de ce fort, et que l'ennemi, en s'emparant de la presqu'île, ne puisse pas même s'emparer de la seule communication qui existera entre la Dalmatie et Cattaro. Vous voudrez bien m'en envoyer les plans avec un rapport, afin que je puisse le soumettre à Sa Majesté. Je pense qu'il sera convenable que, sans perdre de temps, vous vous rendiez à Raguse, afin de concerter avec le général Lauriston tous les moyens pour l'occupation de Cattaro.
«Vous pourrez, après le départ des Russes, faire menacer sous main les Monténégrins que, s'ils ne se tiennent pas tranquilles, vous êtes prêt à leur donner une bonne leçon; mais que, s'ils se conduisent bien, ils ne peuvent que s'en bien trouver.»
LE PRINCE EUGÈNE À MARMONT.
«Monza, 2 août 1806.
«Je reçois, monsieur le général en chef Marmont, plusieurs lettres de Sa Majesté. Je transcris littéralement tout ce qui vous concerne:
«Mon intention n'est pas qu'on évacue Raguse. Écrivez au général Marmont qu'il en fasse fortifier les hauteurs; qu'il organise son gouvernement et laisse son commerce libre; c'est dans ce sens que j'entends reconnaître son indépendance. Qu'il fasse arborer à Stagno un drapeau italien; c'est un point qui dépend aujourd'hui de la Dalmatie. Donnez-lui l'ordre de faire construire sur les tours de Raguse les batteries nécessaires et de faire construire au fort de Santa-Croce une redoute en maçonnerie fermée. Il faut également construire dans l'île de Cromola un fort ou redoute. Les Anglais peuvent s'y présenter: il faut être dans le cas de les y recevoir. Le général Marmont fera les dispositions qu'il croira nécessaires; mais recommandez-lui de laisser les troisième et quatrième bataillons du 5e et 23e à Raguse; car il est inutile de traîner loin de la France des corps sans soldats. Aussitôt qu'il le pourra, il renverra en Italie les cadres des troisième et quatrième bataillons. Si cela pouvait se faire avant l'arrivée des Anglais, ce serait un grand bien. Écrivez au général Marmont qu'il doit faire occuper les bouches de Cattaro par le général Lauriston, le général Delzons et deux autres généraux de brigade, par les troupes italiennes que j'ai envoyées et par des troupes françaises, de manière qu'il y ait aux bouches de Cattaro six ou sept mille hommes sous les armes. Ne réunissez à Cattaro que le moins possible des 5e et 23e régiments; mais placez-y les 8e et 18e d'infanterie légère et le 11e de ligne, ce qui formera six bataillons qui doivent faire cinq mille hommes, et, pour compléter six mille hommes, ajoutez-y le 60e régiment. Laissez les bataillons des 5e et 23e à Stagno et à Raguse, d'où ils pourront se porter sur Cattaro au premier événement. Après que les grandes chaleurs seront passées et que le général Marmont aura rassemblé tous ses moyens et organisé ses forces, avec douze mille hommes, il tombera sur les Monténégrins pour leur rendre les barbaries qu'ils ont faites. Il tâchera de prendre l'évêque, et, en attendant, il dissimulera autant qu'il pourra. Tant que ces brigands n'auront pas reçu une bonne leçon, ils seront toujours prêts à se déclarer contre nous. Le général Marmont peut employer le général Molitor, le général Guillet et ses autres généraux à cette opération. Il peut laisser pour la garde de la Dalmatie le 81e.--Ainsi le général Marmont a sous ses ordres, en troupes italiennes, deux bataillons de la garde, un bataillon brescian et un autre bataillon qui y sera envoyé ce qui, avec les canonniers italiens, ne fait pas loin de deux mille quatre cents hommes. Il a, en troupes françaises, les 5e, 23e et 79e, qui sont à Raguse, et qui forment, à ce qu'il paraît, quatre mille cinq cents hommes; le 81e et les hôpitaux et détachements de ces régiments, qui doivent former un bon nombre de troupes. Il a enfin les 8e et 18e d'infanterie légère, et les 11e et 60e de ligne.--Je pense qu'il faut que le général Marmont, après avoir bien vu Zara, doit établir son quartier général à Spalatro, faire occuper la presqu'île de Sabioncello, et se mettre en possession de tous les forts des bouches de Cattaro. Il doit dissimuler avec l'évêque de Monténégro; et, vers le 15 ou le 20 septembre, lorsque la saison aura fraîchi, qu'il aura bien pris ses précautions et endormi ses ennemis, il réunira douze à quinze mille hommes propres à la guerre des montagnes, avec quelques pièces sur affûts de traîneaux, et écrasera les Monténégrins.--L'article du traité relatif à Raguse dit que j'en reconnais l'indépendance, mais non que je dois l'évacuer.--Des quatre généraux de division qu'a le général Marmont, il placera Lauriston à Cattaro et Molitor à Raguse, et leur formera à chacun une belle division.--Il tiendra une réserve à Stagno, fera travailler aux retranchements de la presqu'île et au fort qui doit défendre Santa-Croce, ainsi qu'à la fortification du Vieux-Raguse et à des redoutes sur les hauteurs de Raguse.--Demandez les plans des ports et des pays de Raguse.»
«Sa Majesté s'étant expliquée dans le plus grand détail, je me borne à vous recommander l'exécution de tous ses ordres, ci-dessus transcrits.»
LE GÉNÉRAL LAURISTON À MARMONT.
Rade de Castelnovo, 11 août 1806.
«Je viens, mon cher Marmont, de parler à M. l'amiral Siniavin, et suis convenu avec lui de la manière dont se ferait la remise des places et forts des bouches de Cattaro. Je n'ai pu arrêter le jour, parce que M. l'amiral ne peut rien décider sans le conseiller d'État Saukowsky, qui est chargé de toute la partie civile. M. Saukowsky est incommodé à Cattaro; j'ai fait sentir à l'amiral que sa maladie ne devait retarder en rien l'exécution du traité de paix, et lui ai donné mon opinion sur la conduite à tenir avec les habitants, et les proclamations à faire. J'aurai demain à midi la réponse de M. Saukowsky; je déterminerai alors le jour, en laissant le temps aux troupes russes de s'embarquer, et aux vaisseaux de sortir du port après notre mise en possession des forts.
«Il faut, mon cher général, arriver ici tout de suite avec des forces suffisantes; les esprits sont agités, inquiets; les Russes mêmes ont des craintes pour eux: avec des forces, on leur en imposera tout de suite. Je crois cependant que les Russes augmentent beaucoup dans leurs récits, et veulent peut-être nous faire peur. Il ne faut pas compter trouver ici ni grains, ni boeufs, ni vin; il faut absolument tout apporter; les habitants craignent beaucoup que nous ne mettions des contributions. Cependant ils ne se refuseront pas à nous donner, en payant, ce qu'ils pourront avoir, et sans doute ils prendront, dès ce moment, la plus grande confiance.
«J'ai regardé en entrant la Punta d'Ostro, le Scoglio de l'autre côté, et les côtes voisines. Les Russes ont fait à Porto-Rose une batterie; ils ont travaillé à Castelnovo et au fort Spagnola. Je crois que dans le premier moment, il n'est pas très-nécéssaire d'occuper la Punta d'Ostro et le Scoglio; ils sont placés de manière que les Anglais ne pourront s'y établir, et qu'il y faut faire de bons ouvrages à cause de leur isolement. Mais la batterie de Porto-Rose, celles de Castelnovo, défendent le mouillage, et les chaloupes canonnières seront placées à merveille, sous la protection de Castelnovo et du fort Spagnola, dont les mortiers doivent bien battre la rade.
«Ce sont les premières observations que j'ai pu faire ce soir, je les rectifierai demain. Mais je crois toujours qu'il ne faut pas se presser d'occuper la Punta d'Ostro.
«J'ai rencontré M. de l'Épine; il m'a demandé ce qu'il avait à faire; je lui ai dit que je n'en savais rien; mais je crois que tu peux dire à M. de Bellegarde que, d'après le traité de paix, la remise des bouches de Cattaro doit se faire aux Français: cela les inquiétera beaucoup sur les suites.»
LE PRINCE EUGÈNE À MARMONT.
«Milan, 16 août 1806.
«Je profite, mon cher colonel général, du départ du courrier pour me rappeler à votre souvenir. Il y a longtemps que je n'ai reçu directement de vos nouvelles, et je désire que vous en soyez moins avare. Nous n'avons rien de nouveau ici.
«Les avis de Paris disent que la paix avec la Russie y a fait infiniment de plaisir, et qu'on paraît beaucoup compter sur celle de l'Angleterre. On fait grand bruit, dit-on, de la rigidité qui a été ordonnée dans l'examen de la comptabilité des armées. Ceci n'est point amusant pour ceux qui, comme vous et moi, commandent en chef et n'ont rien à se reprocher, parce qu'il en résulte des retards dans les payements, et des mécontentements fâcheux. L'Empereur s'en est expliqué, à ce qu'il paraît, très-vivement dans un comité particulier. Il a parlé de n'épargner ni les généraux ni leurs amis, voulant, a-t-il dit, voir cesser toutes les dilapidations commises dans la campagne de l'an XIV; mais, après ce grand tapage, l'Empereur a parlé des récompenses qu'il destine à ses généraux de la grande armée, et je vous répète avec plaisir ce qui a été dit à votre égard, que vous n'auriez plus rien à désirer après la distribution de ces récompenses. Votre conduite au sac de Pavie, en l'an V, a été citée avec éloge. Voilà les nouvelles, mon cher colonel général. Je suis flatté de tout ce qui se rapporte à vous. Donnez-moi de vos nouvelles, et croyez à mes anciens sentiments.»
LE PRINCE EUGÈNE À MARMONT.
Monza, 8 septembre 1806.
«Je m'empresse de vous prévenir, monsieur le général en chef Marmont, que la Russie n'a pas ratifié le traité de paix. Ainsi nous devons nous considérer comme en guerre avec elle. Sa Majesté espère que vous aurez pu profiter du temps pour vous organiser, armer et fortifier Raguse. C'est un point très-important dans les circonstances actuelles, puisque l'on croit que la Russie va déclarer la guerre à la Porte et marcher sur Constantinople. L'intention de Sa Majesté est que vous laissiez au général Lauriston trois généraux de brigade et un bon corps de troupes; que vous fassiez travailler jour et nuit aux fortifications de Raguse et à son approvisionnement, ainsi que de Stagno, par où nous pouvons communiquer avec cette place. Nous sommes si loin, qu'il est impossible de vous envoyer des instructions pour chaque événement. Sa Majesté me charge de vous dire que le centre de défense de Dalmatie est Zara, où il faut centraliser tous vos magasins de vivres, de munitions de guerre et d'habillement, de sorte qu'une armée supérieure, n'importe de quel côté elle vienne, se portant pour envahir la Dalmatie, si elle parvenait à se rendre maîtresse de la campagne, vous puissiez, à tout événement, conserver Zara par-dessus tout et pouvoir vous y enfermer. Des ouvrages de campagne et des retranchements faits autour vous défendront dans cette place jusqu'à ce que Sa Majesté puisse vous secourir. Il ne faut pas disséminer votre artillerie à Spalatro et sur les autres points; il ne faut y laisser que le strict nécessaire pour la défense de la côte. Du reste, la France est dans la meilleure union avec l'Autriche; on ne prévoit aucune expédition contre la Dalmatie. C'est seulement une instruction générale que donne Sa Majesté, et pour vous servir dans l'occasion et à tout événement. Vous ferez partir sur-le-champ M. de Thiars pour se rendre près de Sa Majesté. Si vous trouvez le moyen d'écrire par le canal de quelque pacha ou autrement au général Sébastiani, il est urgent de lui faire savoir que le traité avec la Russie est non avenu, et que tout porte à faire croire à Sa Majesté que la Russie veut attaquer la Porte.
«J'ignore si l'amiral russe est prévenu que le traité de paix n'est pas ratifié. Il serait à désirer que vous pussiez le savoir avant lui, parce que, maître du secret, ainsi que le général Lauriston, vous pourriez agir comme vous le jugeriez convenable.»
LE PRINCE EUGÈNE À MARMONT.
«Monza, 24 septembre 1806.
«Comme je présume, monsieur le général Marmont, que vous n'avez pas encore pu vous mettre en possession de Cattaro, je m'empresse de vous prévenir qu'il n'est plus temps de le faire. Il est probable que l'ennemi va se renforcer et se mettre en mesure de toutes manières. La Prusse fait des armements considérables; il ne serait pas impossible que la guerre vînt à éclater avec cette puissance. L'Autriche proteste de sa neutralité et de sa ferme résolution de n'être pour rien dans ces armements: cependant, vu votre éloignement, vous devez vous comporter suivant les circonstances. Votre point d'appui doit être Zara; et, si le cas arrivait, il faudrait agir pour votre défensive d'une manière isolée. Il ne faut pas dans ce moment changer de dispositions avec l'Autriche, la provoquer d'aucune manière, ni lui donner aucune alarme. Mais, si les circonstances changeaient, vous réuniriez vos troupes sur la frontière d'Autriche, vous pourriez inquiéter les frontières de Croatie, les attaquer même, pousser des partis; vous obligeriez l'ennemi à se tenir en corps d'armée devant vous; il faut réunir à Zara une quantité de munitions de toute espèce; et, si vous veniez à être attaqué par des forces supérieures, Zara doit être votre réduit; vous y établiriez un camp retranché de manière à attendre dans cette position le résultat des opérations générales. Si l'Autriche ne divisait pas ses forces et ne se présentait pas devant vous, vous devriez alors l'attaquer pour l'obliger à un corps d'observation et produire ainsi une puissante diversion à l'Isonzo. Dans ces suppositions, vous ne devez laisser à Raguse qu'une garnison suffisante. Comme dans cette partie la guerre ne doit plus être que défensive, je vous prie de rapprocher la garde royale de Zara. Peut-être sera-t-elle dans le cas de recevoir une nouvelle destination. Je vous envoie un chiffre, ainsi qu'au général Lauriston. Il peut arriver que, par les circonstances, les communications soient totalement coupées par terre, alors il faudrait communiquer par mer; vos points de correspondance seraient Venise, Volano, Ravenne et Rimini. Je ne cite pas Ancône, car il ne serait pas surprenant que ce port vînt à être bloqué. Le général Vignolle pourrait en temps de guerre envoyer des états de situation en chiffres. Vous pourriez également commencer à m'écrire quelquefois en chiffres, pour essayer ce moyen de correspondance et être assurés que nous nous entendrons bien.
«Je vous préviens que tout ceci est une instruction générale pour vous seul, dont vous ne vous servirez que dans le cas bien éventuel d'une guerre avec l'Autriche.
«Je vous transmets littéralement les instructions de Sa Majesté que je reçois à l'instant. Je présume que, sans faire de bruit, vous allez prendre vos dispositions en vous rapprochant tout doucement de la Dalmatie.
«L'intention de Sa Majesté est que le général Lauriston reste à Raguse. Vous pouvez y laisser le 79e, le 23e, les chasseurs brescians, les chasseurs d'Orient et deux généraux de brigade, avec le nombre de compagnies d'artillerie nécessaire, de manière à lui faire un corps d'environ trois mille hommes.
«Tout ceci, je vous le répète, n'est qu'hypothétique, et je m'empresserai toujours de vous prévenir de ce qui pourrait arriver de nouveau.
«Je vous prie de me dire par votre première lettre où vous comptez établir votre quartier général en attendant les événements qui pourraient vous faire concentrer vos forces.
«Je vous recommande encore la légion dalmate. Vous m'obligerez beaucoup de pousser le général Miloscwitz qui dort volontiers. Cette légion vous sera utile dans tous les cas, car elle ferait le service de bonnes troupes dans les îles.
SÉBASTIANI À MARMONT.
«Constantinople, le 11 octobre 1806.
«Une rupture paraît inévitable entre la Russie et la Sublime Porte; tout annonce que l'armée russe du Dniester entrera bientôt en Moldavie et en Valachie, et la plus grande partie de ses forces agira sans doute contre l'armée française en Dalmatie. Quoique la guerre ne soit pas encore déclarée entre l'empire russe et l'empire ottoman, et qu'il soit possible encore que les choses s'arrangent, vous devez cependant être préparé à cet événement. Je vous informerai exactement de tout ce qui pourra vous intéresser.»
LE GÉNÉRAL LAURISTON À MARMONT.
«Raguse, 11 novembre 1806.
«Général, j'ai l'honneur de vous faire part que MM. les comtes de Bellegarde et de l'Épine se sont rendus à Raguse pour conférer avec moi sur les mesures d'exécution à prendre pour l'attaque de Cattaro. Ils m'ont adressé une note pour me faire part de la convention qui a été passée entre M. de la Rochefoucauld et M. le comte de Stadion, par laquelle il doit être fourni un nombre égal de troupes françaises et autrichiennes, ainsi qu'une répartition égale de tout le matériel et moyens nécessaires; je leur ai fait la réponse dont j'ai l'honneur de vous envoyer copie ci-jointe.
«Mais, pour que rien ne retarde l'exécution dans le cas où vous recevriez les ordres, j'ai cru devoir, sans prendre de détermination fixe, me concerter avec eux sûr l'ensemble des mesures d'exécution. Elles doivent vous être portées par M. le major autrichien Dalbert, qui sera autorisé à recevoir de vous les changements et les observations que vous croirez devoir y faire.
«Cet officier se rend auprès de Son Altesse Impériale l'archiduc Charles pour lui faire part des réponses évasives des agents russes, qui ne trouvent plus d'autres raisons à donner que l'occupation des États de Raguse par les Français.»
LE MAJOR GÉNÉRAL À MARMONT.
«Varsovie, le 29 janvier 1807.
«Sa Majesté a appris avec peine, général, la prise de l'île de Curzola; la garnison vient de débarquer dans le royaume de Naples. Faites redemander le commandant de Curzola et faites-en un bon exemple, s'il est coupable.
«Sa Majesté part cette nuit pour rejoindre l'avant-garde de son armée et chasser les Russes au delà du Niémen. L'infanterie russe ne vaut pas la nôtre, et, dans les affaires qu'il y a eu, il n'y a point d'exemple qu'elle nous ait fait ployer.
«Un courrier, parti de Constantinople le 2 janvier, arrive à Varsovie. Le 30 décembre, la Porte avait déclaré solennellement la guerre à la Russie, et, le 29, leur ambassadeur était parti avec cinq à six cents personnes, Grecs ou autres, attachées à la Russie. Il règne à Constantinople un grand enthousiasme pour cette guerre.
«L'armée du général Michelson, forte de trente mille hommes, avait dix mille hommes à Bucharest; les Turcs avaient quinze mille hommes. Il y a eu quelques escarmouches de peu de conséquence. Vingt régiments de janissaires sont partis de Constantinople: on annonce que vingt autres sont partis d'Asie pour passer en Europe. Déjà près de soixante mille hommes étaient réunis à Razof: l'aswan-Oglou en a vingt mille. Le courrier dit que, dans toute la Turquie, on déploie la meilleure volonté. Vous connaissez, général, les Turcs de l'Asie, mais ceux d'Europe sont meilleurs; ils sont plus accoutumés au genre de guerre européen et ils ont souvent eu des succès. Il est possible que l'armée de Michelson arrive au Danube; mais le passera-t-elle? on ne doit pas le croire.
«L'intention de l'Empereur, général, est que vous envoyiez cinq officiers du génie et autant de l'artillerie à Constantinople. Vous écrirez au pacha de Bosnie, à celui de Scutari, afin qu'ils vous envoient des firmans que ces officiers sont arrivés. Envoyez des officiers d'état-major aux pachas de Bosnie et de Bucharest; aidez-les de tous vos moyens, comme conseils, approvisionnements et munitions dont vous pourrez disposer. Il serait possible que la Porte demandât un corps de troupes, et ce corps ne peut avoir qu'un objet, celui de garnir le Danube. L'Empereur n'est pas très-éloigné de vous envoyer vingt-cinq mille hommes par Widdin, et alors vous rentreriez dans le système de la grande armée, puisque vous en feriez l'extrême droite; et vingt-cinq mille Français qui soutiendraient soixante mille Turcs obligeraient les Russes, non pas à laisser trente mille hommes, comme ils l'ont fait, mais à y envoyer une armée du double, ce qui ferait une grande diversion pour la grande armée de l'Empereur; mais tout cela n'est encore qu'hypothétique. Ce que vous pouvez faire dans le moment, général, c'est d'envoyer vingt et trente officiers si les pachas vous les demandent; mais ne donnez point de troupes, à moins que ce ne soit quelques détachements, à cinq ou six lieues des frontières pour favoriser quelques expéditions. Sa Majesté me charge de vous dire que vous pouvez compter sur les Turcs comme sur de véritables alliés, et vous êtes autorisé à leur fournir ce que vous pourrez en cartouches, poudres, canons, etc., s'ils vous le demandent.
«Un ambassadeur de Perse et un de Constantinople se rendent à Varsovie, et, quand vous recevrez cette lettre, ils seront déjà arrivés à Vienne. Ces deux grands empires sont de coeur attachés à la France, parce que la France seule peut les soutenir contre les entreprises ambitieuses des Russes. Dans cette grande circonstance, les Anglais hésitent et paraissent vouloir rester en paix avec la Porte. Cette dernière puissance s'est servie pour cela de la menace de transporter quarante mille hommes jusqu'aux portes d'Ispahan, et nos relations sont telles avec les Perses, que nous pourrions nous porter sur l'Indus; ce qui était chimérique autrefois deviendrait assez simple dans ce moment où l'Empereur reçoit fréquemment des lettres des sultans, non des lettres d'emphase et trompeuses, mais dans le véritable style de crainte contre la puissance des Russes, et portant une grande confiance dans la protection de l'empire français.
«Vous devez publier que vous n'attendez que les firmans de la Porte pour passer sur le Danube et marcher à la rencontre des Russes. Il est très-utile que cela se redise dans le pays; cela intimidera les Russes, qui, soldats et officiers, craignent les armées françaises.
«Telle est la situation des affaires.
«Envoyez des officiers au général Sébastiani pour correspondre avec lui. L'éloignement de la Dalmatie à Varsovie est tel, que vous devez beaucoup prendre sur vous. Bien entendu que les détachements français ne s'éloigneraient jamais à plus de deux lieues au delà des frontières.
«L'Empereur a ordonné au général Andréossi d'envoyer à Widdin un officier de son ambassade pour servir de correspondance intermédiaire avec Constantinople; mais cela n'empêche pas que vous aurez à envoyer de votre côté. Quand vous lirez cette lettre, il est vraisemblable que l'Empereur sera maître de Koenigsberg, de Grodno et de tout le cours du Niémen.
«Il y a un fort près de Raguse qui paraît influer sur la défense de cette place, et il est possible que le général Sébastiani obtienne qu'il soit remis entre nos mains; écrivez-lui à cet égard.
«Jusqu'à cette heure, nous paraissons toujours assez bien avec l'Autriche, qui paraît comprendre qu'elle a beaucoup à gagner avec la France et à perdre avec les Russes. Les Autrichiens craignent les Français, mais ils craignent aussi les Russes. Il paraît qu'ils ont vu de mauvais oeil l'envahissement de la Valachie et de la Moldavie.
«Il est bon que des officiers français parcourent les différentes provinces de la Turquie. Ils feront connaître tout le bien que l'Empereur veut au Grand Seigneur; cela servira à exalter les têtes, et vous en obtiendrez des renseignements utiles et que vous nous transmettrez.
«En deux mots, général, l'Empereur est aujourd'hui ami sincère de la Turquie, et ne désire que lui faire du bien; conduisez-vous donc en conséquence. L'Empereur regarde comme l'événement le plus heureux dans notre position celui de la déclaration de guerre des Turcs à la Russie; car déjà des recrues, destinées pour l'armée qui nous est opposée, ont été envoyées à celle de Michelson. Le Bosphore est aujourd'hui fermé. L'escadre de Corfou, par cela seul, cesse d'être redoutable. L'Empereur a un bon agent à Iéna; écrivez-lui. Sa Majesté remarque que vous ne vous entremettez pas assez dans les affaires des pachas de Bucharest, de Bosnie et de Scutari, avec lesquels vous devez fréquemment correspondre.»
L'AMBASSADEUR DE FRANCE À MARMONT.
«Constantinople, le 28 janvier 1807.
«Mon général, nous sommes au moment de voir arriver devant cette ville une escadre anglo-russe. Je ne pense pas que les Dardanelles offrent une résistance bien longue dans le mauvais état où se trouvent les fortifications qui en défendent l'entrée. C'est à présent que j'éprouve une vive affliction par le retard des officiers d'artillerie et du génie que vous avez la bonté d'expédier. S'ils m'étaient parvenus il y a un mois, nous aurions eu le temps de tout préparer aux Dardanelles et dans cette capitale, qui se trouve elle-même fortement menacée. Ses moyens de défense sont faibles, et l'entrée même du port, si aisée à défendre, offrirait, dans l'état actuel, peu de résistance. La flotte est fortement compromise; cependant le Divan a pris la résolution courageuse de la résistance, et a rejeté des propositions humiliantes qui lui ont été faites par l'Angleterre. Puisse cette noble fermeté être couronnée par d'heureux succès! La position naturelle de Constantinople est très-forte contre les forces navales. Ou fait à la hâte quelques ouvrages que l'ignorance de ceux qui les exécutent rend bien faibles. Cependant ils peuvent encore offrir aux projets des ennemis un obstacle assez grand pour rassurer cette population contre la première épouvante. Les Anglais, n'ayant point de forces de terre, ne peuvent point faire la conquête de Constantinople, dont la population s'élève à plus de huit cent mille âmes; mais ils peuvent compromettre le sort de l'escadre turque et des établissements maritimes. D'ailleurs, n'avons-nous pas à craindre aussi que les ministres, effrayés, ne cèdent enfin et ne se soumettent aux volontés des Russes et des Anglais. Je sais que la ruine de Constantinople n'entraînerait pas celle de l'empire, et que deux armées françaises, placées en Pologne et en Dalmatie, lui assurent l'existence et l'indépendance qui lui ont été promises par Sa Majesté. Mais la crainte peut fermer les yeux sur ces vérités. Je ferai pourtant tous mes efforts pour éclairer sur leurs véritables intérêts les ministres d'un État dont Sa Majesté veut la conservation et la prospérité.
«Ali-Pacha, dont les forces sont assez considérables pour résister sur les côtes de l'Épire aux Russes et à leurs partisans, manque de boulets du calibre de douze et de seize, ainsi que de poudre. Je vous prie en grâce de faire tous vos efforts pour lui en envoyer le plus que vous pourrez, soit par terre, soit par mer, et même, s'il est possible, de lui expédier quelques officiers d'artillerie. Ce pacha, dont l'amitié pour la France ne s'est jamais démentie, mérite tout votre intérêt. Il est le seul boulevard à opposer aux Russes dans l'ancienne Grèce; son fils vient de recevoir le commandement de la Morée.
«Je joins ici une copie du manifeste de la Sublime Porte contre la Russie; je vous adresse également un état des forces de terre de l'empire ottoman. Le nombre en est considérable; mais vous savez que ce ne sont point là des armées, mais des fractions de population qui s'arment. On ne saurait qu'applaudir à l'énergie que déploie en ce moment la Turquie, et j'espère que son alliance avec la France la fera sortir triomphante de cette lutte. Vous êtes appelé, mon général, à être son appui. En attendant que vous puissiez arriver avec les forces qui sont à votre disposition, cherchez à lui donner les secours partiels dont elle a besoin pour vous attendre.
«Les événements se succèdent avec rapidité, et je pense que Sa Majesté prendra promptement des mesures capables de détruire les projets sinistres des Anglo-Russes. Je ne forme plus qu'un voeu: c'est celui de vous revoir bientôt et de recevoir un commandement dans votre armée, ne fût-ce que d'une compagnie de grenadiers; je le préférerais de beaucoup à mon ambassade, où je fais cependant tout ce que je peux pour bien servir l'Empereur, et où j'ai peut-être un peu réussi.
«Vous avez sans doute appris la prise de Belgrade par les Serviens. Cette place s'est rendue faute de munitions de bouche. Je ne crois pas l'Autriche étrangère à cet événement. Je crois que le pacha d'Erzeroum et les princes des Abares attaquent dans ce moment Tiflis, la Géorgie et toute la chaîne du Caucase. Paswan-Oglou, Moustapha-Baïractar et Cassan-Pacha font assez bonne contenance sur le Danube, et même ont dû agir offensivement en Valachie. Les dernières nouvelles que nous en avons reçues portent que quarante mille hommes avaient déjà passé le Danube pour attaquer les Russes.
«J'apprends dans ce moment qu'un accommodement a eu lieu entre les Serviens et la Sublime Porte. Les Serviens ont promis de rentrer dans leurs foyers, de rendre Belgrade et de livrer leur artillerie. Leurs députés partent dans trois jours avec cette espèce de convention. Vous connaissez, mon général, mon amitié et mon dévouement pour vous: ils ne se démentiront jamais.»
LE GÉNÉRAL SÉBASTIANI À MARMONT.
«Constantinople, le 1er février 1807.
«Mon général, M. Arbutnot a quitté brusquement Constantinople, et nous a laissé pour adieux la menace de revenir dans quinze jours nous réduire en poudre.--Il a emmené avec lui ses négociants, auxquels il n'a pas même laissé le temps de prendre leurs femmes et leurs enfants.--Aujourd'hui le Grand Seigneur m'a fait écrire pour vous demander vingt officiers d'artillerie et quatre du génie: c'est beaucoup, mais ils en ont grand besoin; et je vous prie d'en envoyer le plus que vous pourrez et le plus tôt possible.--Agréez mon dévouement et mon attachement.»
SÉBASTIANI À MARMONT.
«Au palais du Divan, à Constantinople,
le 4 février 1807.
«Monsieur le général, Sa Hautesse désire que vous lui envoyiez vingt officiers d'artillerie et quatre officiers du génie pour être employés à fortifier et défendre Constantinople, les Dardanelles, Smyrne, Salonique, le Bosphore et quelques parties de la Grèce. Le danger est pressant et réel. Je présume bien que vous n'avez pas vingt officiers d'artillerie disponibles pour cet envoi, mais des officiers d'état-major et d'infanterie, instruits, rempliront le même but. Le Grand Seigneur espère que vous lui prêterez ce secours, dont il a le plus pressant besoin. Il fait expédier deux Tartares et des ordres à tous les pachas pour faciliter l'arrivée de ces officiers. Il est inutile que je vous entretienne sur l'utilité dont ils pourront être: Votre Excellence le sent comme moi.»
SÉBASTIANI À MARMONT.
«20 février 1807.
«Mon général, neuf vaisseaux anglais ont déjà passé les Dardanelles; le reste de l'escadre suit. Le vent favorisant l'arrivée de la flotte anglaise à Constantinople, je m'attends à la voir paraître dans la nuit. Les Turcs ont résisté tant qu'ils ont pu. Vous sentez, mon général, que ma position est difficile. Je cherche au moins à faire tirer encore quelques coups de canon ici; il faut se défendre jusqu'à extinction de moyens.--Agréez tout mon attachement.
«P. S. Je vous prie de faire passer cette lettre à M. de Talleyrand.»
SÉBASTIANI À MARMONT.
«Constantinople, le 4 mars 1807.
«Mon général, nous avons amusé les Anglais avec des négociations pendant tout le temps qui a été nécessaire pour mettre cette capitale en état de défense; mais, dès que les ouvrages ont été terminés, la Porte a signifié à l'amiral Duckworth qu'elle ne pouvait accéder à aucune de ses demandes, et qu'elle voyait sans crainte ses vaisseaux devant Constantinople. Pendant qu'on travaillait ici, on faisait porter aussi des troupes dans la presqu'île de Gallipoli, et M. Goutaillaux y était envoyé pour élever des batteries capables de rendre leur retour très-dangereux. L'amiral anglais l'a senti, et il a fait voile; j'apprends dans ce moment qu'il a jeté l'ancre à Nagara, mouillage situé dans le détroit des Dardanelles et à une lieue des Châteaux, en remontant vers Constantinople. Leclerc va partir pour s'y rendre: nous allons faire tous nos efforts pour chasser l'escadre anglaise et rendre le passage des Dardanelles insurmontable.
«Le Grand Seigneur a fait à Sa Majesté la demande de cinq cents hommes en grande partie canonniers, destinés à la défense de cette capitale. Si vos instructions vous permettent de les faire partir sur-le-champ, je vous prie de ne pas y apporter le moindre retard. Vous sentez combien leur arrivée consolidera le système de réunion des deux cours, et combien elle donnera de sécurité au gouvernement turc, qui déploiera alors de grands moyens contre les Russes sur le Danube et en Géorgie.
«Des ordres sont partis de la part de Sa Hautesse pour tous les pachas, afin de préparer les vivres nécessaires au passage de cette troupe, qui s'opérera par cinquante hommes par jour, afin qu'ils puissent voyager à cheval et arriver promptement ici: il leur sera fourni même des habits turcs, s'ils le veulent, pour leur voyage seulement, leurs officiers recevront toutes sortes de distinctions.
«Sa Majesté l'Empereur a établi à Widdin M. Mériage, adjudant-commandant et secrétaire d'ambassade à Vienne; sa mission, comme vous devez le savoir, est d'établir une correspondance entre votre armée et la droite de la grande armée impériale, par la Servie. Je crois que vous êtes à la veille de cueillir des lauriers, vous sentez combien je le désire.
«Les puissances barbaresques ont reçu ordre du Grand Seigneur d'inquiéter dans toute la Méditerranée le commerce anglais. Le pacha de Bagdad leur fermera Bassora et par conséquent le golfe Persique; j'espère que nous parviendrons à leur rendre dangereuse la navigation des côtes de l'Arabie.
«Mon général, nous avons couru ici des dangers. Si l'amiral anglais, le lendemain ou le surlendemain de son arrivée, avait tenté l'entrée du port, nous ne pouvions lui opposer aucune résistance, et sa réussite était complète. Nous aurions reçu notre logement aux Sept-Tours. Cette perspective ne nous a point effrayés, et notre fermeté a été couronnée par un résultat heureux.
«J'espère de vous donner bientôt des nouvelles qui vous feront plaisir.»
SÉBASTIANI À MARMONT.
«Constantinople, le 31 mars 1807.
«Mon général, la Porte consent au passage des troupes, et j'en ai rendu compte au ministre des relations extérieures depuis quinze jours: la seule différence qu'il y aura dans l'arrangement de cette affaire, c'est que la Sublime Porte désire que la demande du passage des troupes lui soit faite par Sa Majesté, et qu'elle craint trop l'opinion de ses peuples pour la faire elle-même. Du reste, des ordres ont été donnés pour la formation des magasins de vivres, et j'ai mis tant de soins et de célérité dans cette négociation, que ma réponse pour le ministre est partie trois jours après l'arrivée du courrier qui m'avait été expédié pour cet objet. Si les pouvoirs nécessaires pour cette stipulation m'avaient été envoyés, tout serait déjà terminé: j'ai mandé au ministre qu'il pouvait m'envoyer un traité rédigé sur cette affaire, et que j'espérais qu'il ne souffrirait aucune difficulté. Le gouvernement ottoman se trouve aujourd'hui dans une position à désirer plus que jamais votre appui sur le Danube. La prise de l'île de Ténédos par les Russes et les mouvements des Serviens, qui paraissent vouloir se joindre à l'armée de Michelson, donnent à la Porte les plus vives inquiétudes. Je viens d'expédier un courrier à M. le prince de Bénévent, pour lui faire connaître la position actuelle de cet empire et le besoin qu'il a d'être secouru promptement. Au reste, ici tout est arrangé pour votre entrée, et tout dépend maintenant de notre cour, dont j'attends les ordres avec impatience. J'ai demandé, mon général, à être appelé à votre armée pour y commander une division; je vous prie d'appuyer ma demande: vous connaissez mon dévouement pour vous; comptez sur mon zèle à faire tout ce qui peut vous être agréable: mes sentiments pour votre personne sont inaltérables.
«P. S. Je vous enverrai Leclerc aussitôt que j'aurai reçu les pouvoirs nécessaires pour terminer l'affaire de l'entrée de vos troupes. Les pachas de Bosnie et de Scutari ont reçu ordre de vous seconder de tous leurs moyens, et même de se réunir à vous pour combattre les Monténégrins et Cattaro.
«J'ai été fort content de votre docteur drogman: il s'est conduit avec esprit et intelligence.»
LE MAJOR GÉNÉRAL À MARMONT.
«Finkenstein, le 3 avril 1807.
«Je m'empresse de vous faire connaître, général, qu'une dépêche du 3 mars de Constantinople arrive à l'instant. L'Empereur reçoit la nouvelle officielle que les Anglais ont été obligés d'évacuer le Bosphore, et qu'en six jours de temps cinq cents pièces de canon ont été mises en batterie devant le sérail. Un grand nombre de troupes s'est porté au détroit que les Anglais ont repassé; mais une escadre turque, supérieure en nombre, s'est mise à leur poursuite, ce qui est une mauvaise opération que le général Sébastiani ni le Grand Seigneur même n'ont pu empêcher, tant est grande l'effervescence du peuple à Constantinople. Dans cette situation des choses, le Sultan a demandé cinq cents canonniers français: le général Sébastiani a dû vous écrire et le firman doit vous être arrivé. L'ordre de l'Empereur, général, est que sur-le-champ vous fassiez partir tout ce qui vous reste d'officiers d'artillerie et d'officiers du génie, avec un corps de six cents hommes d'artillerie, sapeurs et ouvriers, bien complet, pour se rendre à Constantinople: une partie de ce corps pourrait partir de Raguse.
«Par votre dernier état de situation, vous avez quatre compagnies d'artillerie du 2e régiment, une du 8e régiment, deux compagnies de sapeurs, ainsi que cinquante ouvriers.
«L'intention de Sa Majesté est que, sur ces cinquante ouvriers, vous en fassiez partir vingt-cinq; que vous fassiez partir les deux compagnies de sapeurs, qui feront environ cent soixante-dix hommes. Vous ferez partir de Raguse une compagnie du 2e régiment, complétée à cent vingt hommes, en choisissant dans l'infanterie des hommes beaux et forts. Vous ferez partir une compagnie d'artillerie de la Dalmatie, que vous ferez également compléter à cent vingt hommes, de la même manière que ci-dessus. Vous ferez partir deux compagnies d'artillerie italienne, que vous ferez compléter chacune à cent hommes par les troupes italiennes, en choisissant des hommes forts et beaux. Ces quatre compagnies formeront donc quatre cent quarante hommes, qui, joints aux cent soixante-dix sapeurs ou ouvriers, feront les six cents demandés par le Grand Seigneur.
«Vous y joindrez une douzaine d'officiers d'artillerie et de génie, Français et Italiens, ayant soin que, parmi les officiers d'ouvriers, il y en ait un habile, et de bons artificiers. Vous ferez armer de bons fusils et vous ferez bien équiper tous ces hommes. Vous ferez partir avec eux pour trois mois de solde, et plus si vous avez de l'argent. Vous ferez donner à chaque homme trois paires de souliers. Il est à désirer que les ouvriers emportent avec eux les outils les plus précieux, qu'on ne trouverait pas à Constantinople. Les officiers du génie et d'artillerie auront l'attention d'emporter, autant qu'ils pourront, les livres qui pourraient leur être utiles suivant les circonstances.
«Vous ferez connaître à la Porte que, si elle veut d'autres troupes, vous lui en enverrez sur sa demande directe. Effectivement, général, l'Empereur vous autorise à envoyer jusqu'à la concurrence de quatre à cinq mille hommes, ainsi qu'à les mettre en mouvement et à les faire passer sans ordre ultérieur de Sa Majesté. Mais cependant, pour cela, il faut que vous ayez une réquisition fort en règle signée du général Sébastiani, et que le pacha sur le territoire duquel vous ferez passer ces troupes ait un firman bien en règle de la Porte.
«Il vous restera en Dalmatie, ainsi qu'à Raguse, assez d'artillerie. Vous ferez compléter les compagnies qui vous resteront à cent vingt hommes, en prenant des hommes dans l'infanterie. Je donne d'ailleurs des ordres pour que le vice-roi d'Italie fasse passer sur-le-champ en Dalmatie douze officiers d'artillerie et douze officiers du génie. Ainsi n'épargnez pas les officiers du génie et d'artillerie pour les envoyer à Constantinople, où il ne saurait trop y en avoir: avec la direction de nos officiers, tous les soldats français sont artilleurs.
«Si vous avez de l'argent, général, l'Empereur ordonne que vous fassiez passer, par les troupes que vous envoyez à Constantinople, deux cent mille francs en or au général Sébastiani, qui seront employés aux besoins des troupes, l'intention de Sa Majesté n'étant point qu'elles soient, en aucune manière, à charge à la Porte. Si vous n'avez pas d'argent, faites-le-moi connaître, afin que je prenne des mesures en conséquence.
«L'intention de l'Empereur est, général, que tout ce que je viens de vous ordonner parte vingt-quatre heures après la réception des ordres.
«Vous pouvez envoyer trois à quatre officiers d'état-major si vous en avez que vous croyiez pouvoir être utiles dans ce pays. Si vous aviez un bon général de brigade qui désirerait aller à Constantinople, envoyez-le avec les six cents hommes.
«J'observe que, sur le dernier état de situation de votre armée, vous avez plus d'officiers d'artillerie, du génie et d'état-major qu'il ne vous en faut. Vous pouvez donc envoyer, si vous le jugez convenable, tout ce qui n'est point strictement nécessaire. À quoi vous servent cinq colonels ou chefs de bataillon? Un à Raguse et un en Dalmatie vous suffisent.»
LE PRINCE EUGÈNE À MARMONT.
«Milan, le 24 mai 1807.
«J'ai soumis à Sa Majesté, monsieur le général Marmont, les projets que m'avait adressés le général Poitevin pour les travaux à faire cette année aux fortifications de la Dalmatie. Sa Majesté ne veut et ne connaît en Dalmatie d'autre place forte que Zara. Je fais connaître au général Poitevin les ordres de l'Empereur à cet égard, et je m'empresse de vous en prévenir.
«Je vois avec beaucoup de peine, monsieur le général Marmont, que le décret de Sa Majesté pour la formation d'une légion dalmate ne s'exécute pas. Il n'y a encore que trente-sept à trente-huit hommes, y compris les officiers que j'ai nommés, tandis que cette légion devrait être portée à quatre mille hommes. Vous devez sentir de quelle importance il serait, dans les circonstances actuelles, que ce décret de Sa Majesté reçût son exécution. Si les troupes françaises qui sont en Dalmatie venaient à partir pour une expédition, cette légion seule pourrait vous fournir du monde pour garder vos places et votre littoral. Veuillez bien, je vous prie, vous occuper des moyens qui pourraient faciliter la levée de cette légion, vous en entendre avec le provéditeur, et me faire connaître quels sont les obstacles qui s'y opposent. Il est vraiment ridicule que, dans un pays où les Autrichiens ne se gênaient pas pour faire marcher les hommes à coups de bâton, nous ne puissions rien obtenir par les mesures les plus douces, et, pour ainsi dire, par des politesses. Quoi qu'il en soit, Sa Majesté a ordonné la formation de cette légion; elle y compte, et il est important qu'elle se forme. Mettez-y donc, je vous prie, tous vos soins et tout votre intérêt. Je saisis avec bien du plaisir cette occasion de vous renouveler l'assurance de mes sentiments; et sur ce, monsieur le général Marmont, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.»
LE MAJOR GÉNÉRAL À MARMONT.
«Tilsitt, le 8 juillet 1807.
«Je vous expédie un courrier, général, pour vous faire connaître que la paix est faite entre la France et la Russie, et que cette dernière puissance va remettre en notre pouvoir Cattaro. Vous devez, en conséquence, faire vos dispositions pour prendre possession de cette place aussitôt que les ordres seront parvenus. Vous ne devez pas, général, attaquer les Monténégrins, mais, au contraire, tâcher d'avoir avec eux des intelligences et de les ramener à nous pour les ranger sous la protection de l'Empereur; mais vous sentez que cette démarche doit être faite avec toute la dextérité convenable.
«Aussitôt que le mois d'août sera passé, c'est-à-dire les chaleurs, les ordres sont envoyés pour que les troisièmes bataillons des régiments de votre armée complètent ceux que vous avez en Dalmatie, de manière à porter chaque compagnie à cent quarante hommes et chaque bataillon à douze cent soixante.
«Raguse doit définitivement rester réunie à la Dalmatie; vous devez donc faire continuer les fortifications et les mettre dans le meilleur état.
«Occupez-vous essentiellement à obtenir des renseignements, soit par des officiers que vous enverrez, soit de toute autre manière, que vous enverrez directement à l'Empereur, pour lui faire connaître, par des officiers sûrs:
«1° Géographiquement et administrativement, ce que vous pourrez obtenir sur la Bosnie, la Macédoine, la Thrace, l'Albanie et la Grèce?
«2° Quelle population turque, quelle population grecque? Quelles ressources ces pays offriraient en habillements, vivres, argent, pour une puissance européenne qui posséderait ce pays? Enfin quel revenu on pourrait tirer de suite, au moment de l'occupation, car les rêves des améliorations sont sans base?
«Le second mémoire sera un mémoire militaire.
«Si deux armées européennes entraient à la fois, une par Cattaro et la Dalmatie, dans la Bosnie, l'autre par Corfou, dans la Grèce, quelle devrait être la force de toute arme pour être sûr de la réussite? Quelle espèce d'arme est la plus avantageuse? Comment passerait l'artillerie? Comment pourrait-on la remonter? Comment se recruterait-on? Quel serait le meilleur temps pour agir? Tout ceci, général, ne doit être regardé que comme calcul hypothétique. Tous ces rapports doivent être envoyés par des hommes de confiance qui puissent arriver à bon port. Faites connaître aux Russes que la paix est faite, et envoyez-leur des ampliations de la notice ci-incluse. Faite tenir très-secrète la prise de possession des forteresses; faites seulement dire aux croisières russes que vous leur donnerez tous les secours qu'elles demanderont.
«La Russie a accepté la médiation de la France pour faire sa paix avec la Porte. Tenez-vous toujours dans la meilleure amitié avec le pacha de Bosnie, auquel vous ferez part de ce qui se passe; mais néanmoins vous resterez dans une situation plus froide et plus circonspecte que ci-devant. Envoyez des officiers; faites tout ce qui sera possible pour bien connaître le pays.»
LE GÉNÉRAL LAURISTON À MARMONT.
«Raguse, le 10 août 1807.
«Général, la prise de possession des bouches de Cattaro a été faite ce matin à six heures; la forteresse Spagnola nous a été remise, elle est en notre pouvoir, le pavillon français flotte sur ses remparts. La ville de Castelnovo, celle de Cattaro, et, Budua, ne nous seront remises que le 12, parce qu'il faut déblayer beaucoup de magasins que les Russes emportent, et beaucoup qu'ils nous laissent et qui étaient déposés dans les casernes.
«Il paraît que l'évêque de Monténégro est disposé à rester tranquille et à vivre en bonne intelligence avec nous. Nous verrons lorsque nous serons à Cattaro, parce que ce sont les Monténégrins qui approvisionnent la ville en légumes, bois.
«M. Baratinsky, commandant russe, m'a encore prié de vous demander la grâce des Dalmates qui demandent à se soumettre, et spécialement du supérieur de la maison d'éducation illyrique à Almissa. Je ne conçois pas le motif de la désertion de ce dernier, qui m'avait paru, dans le temps de mes tournées, un homme tranquille.
«J'aurai l'honneur de vous écrire ces jours-ci, je me servirai de petits bâtiments lorsqu'il n'y aura rien de signalé.
«Je crois, général, qu'il serait bon d'établir à Raguse-Vieux une compagnie de voltigeurs qui aurait un poste intermédiaire à Glinta; l'on pourrait correspondre alors avec trois ou quatre hommes marchant ensemble.»
LE PRINCE EUGÈNE À MARMONT.
«Milan, le 27 décembre 1807.
«Sa Majesté, au moment de son départ, monsieur le général en chef Marmont, m'a chargé de vous écrire pour vous recommander d'avoir continuellement les yeux sur Corfou. Sa Majesté présume que les Anglais peuvent avoir des projets sur cette île; elle vous charge particulièrement de correspondre le plus souvent possible avec le général César Berthier, afin d'être parfaitement au courant de tout ce qui pourrait être tenté contre cette possession. Vous sonderez les dispositions d'Ali-Pacha à notre égard; mais, comme on doit peu se fier à lui, Sa Majesté veut que vous envoyiez un courrier au général Sébastiani à Constantinople, afin d'obtenir de la Porte l'ordre précis à Ali-Pacha d'accorder le passage de vos troupes, dans le cas où elles seraient nécessaires pour secourir cet établissement important.»
1808-1809
SOMMAIRE.--Retour à Raguse.--Renversement de la république de Raguse.--Moeurs intimes de la noblesse.--Craintes de l'Empereur sur Corfou.--Les franciscains.--De la vraie force.--Le père gardien.--Le protectorat.--Jalousie du vice-roi.--Secours à Hadgi-Bey.--Révolution de Constantinople.--Intrigues à Pastrovicchio.--Instructions de l'Empereur.--Composition de l'armée autrichienne: vingt-cinq mille hommes et vingt-quatre pièces.--Diversion opportune.--Le duc de Raguse commence les hostilités.--La Zermagna.--L'ennemi poussé sur Obrovatz.--La bataille de Sicile perdue par le vice-roi.--Quartier général à Benkovatz.--L'archiduc Jean, enhardi, écrit témérairement au duc de Raguse de capituler.--Succès de la grande armée à Ratisbonne, et marche de Napoléon sur Vienne.--Le vice-roi reprend l'offensive.--Le duc de Raguse rentre en opération.--Clausel dirigé sur le mont Kitta.--Combat de Gradshatz.--Le duc de Raguse est blessé.--Arrivée devant Gospich.--Le duc de Raguse attaque.--L'ennemi, vaincu, bat en retraite.--Les journées de Gospich sont les mêmes que celles d'Essling: 21 et 22 mai.--L'ennemi est battu à Ottochatz.--L'archiduc va rejoindre Giulay.--Résumé de cette partie de campagne.
Au commencement de l'année 1808, j'allai à Raguse, pour y faire une inspection; les circonstances m'obligèrent de changer l'ordre établi dans ce pays et d'en détruire le gouvernement.
Cette petite république s'était mise sous la protection des Turcs, auxquels elle reconnaissait une espèce de suzeraineté. Orcan, second empereur des Turcs au quatorzième siècle, leur accorda la patente qu'ils sollicitèrent de lui. Il l'a signée, en apposant au bas sa main trempée dans l'encre. Par suite de cette protection, les Ragusais avaient cédé au Grand Seigneur une double lisière de terre pour les séparer de la Dalmatie et des bouches de Cattaro, et ne pas être en contact avec les Vénitiens.
La population de l'État de Raguse ne s'élevait pas au delà de trente-cinq mille âmes, et son territoire se composait d'une langue de terre allant des bouches de Cattaro à la Dalmatie, et de quelques îles. Un corps de noblesse, dont l'ancienneté dépasse de beaucoup celle des plus vieilles maisons de l'Europe, possédait la souveraineté de temps immémorial. Plusieurs familles font remonter, avec les droits les plus évidents, leur origine au huitième siècle: elles sont contemporaines de Charlemagne; leur filiation est bien établie; dès ce même temps, elles étaient riches et puissantes. Telle est la famille Gozze, dont l'ancêtre, lorsqu'il vint s'établir à Raguse et fut admis au partage de la souveraineté, était un seigneur bosniaque très-riche en bestiaux. On conçoit l'orgueil de cette aristocratie.
L'organisation politique, en rapport sur plusieurs points avec le gouvernement vénitien, consacrait un grand conseil où tous les nobles, âgés de vingt et un ans, étaient admis; ce conseil décidait de toutes les grandes affaires; un conseil de dix formait le gouvernement avec le recteur. Celui-ci demeurait au palais, jouissait des honneurs du gouvernement, recevait les étrangers, etc.; mais il changeait tous les mois. La simplicité du chef de la république eût pu nuire à sa dignité; aussi ne pouvait-il jamais sortir du palais pendant le jour, excepté pour les processions solennelles, où il était revêtu de tous les attributs de son pouvoir.
La bourgeoisie de Raguse, recommandable par ses moeurs et son instruction, se composait presque entièrement de capitaines de commerce ou d'hommes retirés des affaires. Les nobles ragusais ne naviguaient pas; mais ils avaient tous des intérêts dans les bâtiments de commerce. Les tribunaux étaient choisis, pour un temps fixe, parmi les nobles, ainsi que les délégués des administrations des différents districts.
Les habitants de la campagne, attachés à la glèbe, dépendaient des nobles auxquels les villages appartenaient. Jamais on n'a vu un pays plus heureux, plus prospère par une louable industrie, une sage économie et une aisance bien entendue. Chacun avait sa propre maison et n'était pas réduit à loger chez un autre; maison petite, mais propre, meublée convenablement avec des meubles achetés en France ou en Angleterre. Chaque famille avait aussi sa maison de campagne, soit à Gravosa, soit au val d'Ombla, à Malfi ou à Breno. Quelques familles riches en avaient eux qu'elles habitaient suivant les saisons.
Ce territoire, si borné, était cultivé admirablement. Pas un pouce de terre n'était négligé. Pour en augmenter la surface, on bâtissait des terrasses partout où cela était possible. Les moeurs étaient très-douces dans toutes les classes, chez les paysans heureux et laborieux, chez les bourgeois qui avaient beaucoup voyagé et où il y avait de l'aisance, et chez les nobles dont l'éducation était faite ordinairement à Sienne, à Bologne, ou dans quelque autre ville de l'Italie, d'où ils rapportaient dans leur patrie des moeurs polies et beaucoup d'instruction. L'habitude d'une situation élevée et du pouvoir leur donnait le ton et les manières des plus grandes villes et des gens les plus considérables de nos pays. Les femmes y participaient tellement, que les dames de Raguse auraient pu être comparées et confondues avec les plus grandes dames de Milan et de Bologne. Des savants, illustres comme le père Boscovich, des littérateurs d'un ordre distingué, et de mon temps l'abbé Zamagna, faisaient l'ornement et les délices de cette ville. Le véritable territoire des Ragusais était la mer; un pavillon neutre leur donnait le moyen de l'exploiter avec beaucoup d'industrie et de bénéfices.
Cette petite population entretenait deux cent soixante-quinze bâtiments, qui tous faisaient la grande navigation et allaient dans tous les ports de l'Europe, quelquefois aux Antilles, et dans l'Inde.
C'est cette heureuse population à laquelle nous sommes venus enlever brusquement la paix et la prospérité. Sa douceur était telle, qu'ayant été traitée avec équité et désintéressement par les délégués d'un pouvoir oppresseur, elle n'en a jamais voulu aux individus qui ont été involontairement les agents de leur infortune: c'est tout au plus s'ils en voulaient à l'auteur de leurs maux. Je parle de la population en masse; car, pour le corps de la noblesse, si elle n'en voulait pas aux généraux, elle savait bien quels sentiments elle devait à l'Empereur.
J'ajouterai un mot sur les moeurs intérieures. La noblesse se divisait en deux fractions, toutes les deux égales en droits, mais non en considération. Les dénominations de Salamanquais et Sorbonnais, servant à les distinguer, datent probablement de l'époque des guerres entre François Ier et Charles V, et dépendaient sans doute du lieu où on avait étudié, et du souverain qu'on servait. Les premiers, plus considérés et en général plus riches, passaient pour très-intègres: dans leurs fonctions de juges, ils étaient incorruptibles. On accusait les autres de vénalité, et le plus grand nombre était fort pauvre. Il est impossible d'exprimer le mépris des Salamanquais pour les Sorbonnais. Égaux en droits, votant dans la même salle, sur les mêmes questions, ils ne se saluaient pas dans la rue. Un Salamanquais épousant une Sorbonnaise devenait lui-même Sorbonnais, à plus forte raison ses enfants; et tous étaient reniés par leur famille. En 1666, le grand conseil était assemblé dans le palais quand un tremblement de terre le fit crouler: beaucoup de familles furent éteintes. Le corps de la noblesse fut recruté par des bourgeois, et les nouveaux nobles furent réputés Sorbonnais.
En général, les nobles étaient fiers et durs envers les bourgeois, particulièrement les Sorbonnais; et les bourgeois eux-mêmes, à l'exemple des nobles, se divisaient en deux confréries, celle de Saint-Antoine, et celle de Saint-Lazare. La première traitait l'autre avec dédain, tant les amours-propres sont ingénieux à créer des distinctions dans le but d'humilier autrui.
Avec cette exaltation des amours-propres, les malheurs causés par notre présence furent sentis moins vivement, parce que cette même présence confondait beaucoup les nuances, objet de désespoir pour le plus grand nombre.
J'avais montré beaucoup d'égards aux chefs du pays, à tout ce qu'il y avait de gens distingués et remarquables; mais je ne pouvais pas leur rendre ce qu'ils avaient perdu. Ils s'agitèrent, dans la mesure de leurs forces, cherchèrent partout, à Vienne, à Pétersbourg, à Constantinople, des appuis. Lors de la paix de Tilsitt, ils crurent leur conservation stipulée, et les paroles les plus indiscrètes des nobles amenèrent des projets de réaction et de vengeance contre les amis des Français. On fit circuler une liste de cinquante-quatre familles destinées à être bannies. Cette découverte m'inspira de l'indignation, et je la témoignai hautement. Les sénateurs, effrayés, désavouèrent la liste, mais n'en continuèrent pas moins leurs intrigues, seulement avec plus de prudence et de mystère. Ils s'adressèrent au pacha de Bosnie, et lui envoyèrent des cadeaux pour le décider à agir dans leur intérêt auprès du Grand Seigneur. Le pacha garda les cadeaux, se moqua d'eux, et m'informa de leur démarche.
Un ordre de l'Empereur, transmis par le vice-roi, avait prescrit aux bâtiments ragusais de prendre le pavillon du royaume d'Italie. Cette mesure, exécutée à Constantinople par ordre de l'ambassade de France, fut ordonnée à Raguse par une proclamation affichée. Le gouvernement fit arracher les affiches. Il y eut alors lutte ouverte entre nous et ce gouvernement, et il fallut se résoudre à le détruire; un arrêté suffit pour cela. Je défendis aux sénateurs de s'assembler, et j'établis des autorités nouvelles. Je fis choix d'un homme capable pour diriger l'administration du pays; je constituai un tribunal, des juges de paix, tous les pouvoirs indispensables, et, en même temps, j'organisai les rouages administratifs les moins dispendieux possible; je m'occupai de beaucoup de choses utiles, et des écoles spécialement. Enfin je pris possession des archives et du palais.
Je donnai beaucoup de fêtes aux dames de Raguse; on s'habitua à ce nouvel ordre de choses comme on s'habitue à tout; et, après un séjour de quelques mois, je rentrai à Zara.
À cette époque, l'Empereur eut la crainte de voir les Anglais faire le siége de Corfou, et je reçus l'ordre de me préparer à aller, dans ce cas, à son secours. À cet effet, je me mis en rapport avec tous les pachas de l'Albanie; j'arrêtai un projet d'opérations, et préparai quelques moyens. Heureusement les craintes ne se réalisèrent pas. Les Anglais, maîtres de la mer, la longueur de la route, la nature des chemins et la nécessité de passer toujours d'un bassin dans un autre, auraient rendu l'opération très-difficile, et la marche longue et pénible. Tout se borna à l'envoi d'un convoi de poudre et de quelques officiers, et cet envoi fut l'occasion d'un événement malheureux, L'adjudant-commandant Bailleul et trois officiers avaient voyagé jusqu'à Antivari fort paisiblement. Arrivés dans cette ville, des Turcs leur cherchèrent querelle et les massacrèrent. Je demandai la tête des coupables, et le pacha de Scutari prit l'engagement de les livrer; mais il n'en fit rien. Je réclamai le passage pour un bataillon italien; mais, après une réponse évasive, un refus formel fut donné, par suite, dit le pacha, des ordres du Grand Seigneur. Ainsi nous dûmes renoncer à rien envoyer par terre. Des envois de poudre eurent lieu par mer. Quelques-uns parvinrent; d'autres furent pris.
J'avais été à même de remarquer la grande influence des franciscains en Dalmatie. Ces moines, fort éclairés, et infiniment supérieur sous tous les rapports au reste du clergé de la province, habitent onze couvents. Charitables, zélés dans l'exercice de leurs devoirs, ils desservent un grand nombre de cures. Rien n'était plus utile que de les gagner; car les avoir pour amis, c'était donner au gouvernement toute la force morale qui leur était propre. Découvrir où est la force dans un pays et la séduire, voilà, pour des conquérants, ce qui constitue l'art de gouverner sans tyrannie. La force ne se déplace pas à volonté: elle existe parce qu'elle existe; elle change de mains suivant les temps, suivant les siècles, mais surtout suivant la manière dont les lumières et les richesses sont réparties; car ce sont les deux éléments qui la constituent.
Je fis donc ma cour aux moines franciscains. Je ne voyageais jamais sans aller loger de préférence chez eux quand un de leurs couvents était à portée. J'y trouvais mon compte de toutes les manières, car j'étais toujours reçu avec empressement. Les moines, malgré leur humilité apparente, ne manquent pas d'orgueil et sont très-sensibles aux égards des dépositaires de l'autorité. Plusieurs d'entre eux étaient remarquables par leur esprit et leur courage. Le père..., gardien du couvent de Signe, fit à cette époque une action digne d'admiration, et qui honore son caractère et sa foi.
La Dalmatie est sujette aux tremblements de terre, et ces accidents ont causé quelquefois de grands désastres. Le bourg de Signe en porte encore les traces. Un tremblement de terre a détruit ses fortifications, et leurs débris amoncelés en perpétuent le souvenir. À l'époque dont je parle, le père gardien de Signe prêchait dans l'église de son couvent, où toute la population s'était rassemblée. Tout à coup une secousse se fait sentir. Tout le monde s'empresse de se lever pour fuir. Le prédicateur, sans s'émouvoir, et d'une voix de tonnerre, s'écrie: «Impies que vous êtes, vous tremblez, et vous êtes dans la maison de Dieu!» Chacun se rassit, et le prédicateur continua son sermon. Un semblable trait a manqué à la gloire de Bossuet.--Peu après, je le fis nommer provincial de son ordre.
Du temps du gouvernement vénitien, les moines étaient dans l'usage de choisir un protecteur qu'ils prenaient toujours parmi les nobles vénitiens. Devenu leur patron, c'était lui qui faisait valoir leurs réclamations, et, pour prix de cette protection, ils priaient pour lui. Me trouvant si bienveillant pour eux, ils m'offrirent cette dignité. Je l'acceptai avec empressement. Je donnai à chacun de leurs couvents un portrait de l'Empereur; mon nom fut prononcé chaque jour dans leurs prières, et ils me délivrèrent une pancarte qui, en consacrant cette dignité en ma personne, me donne le droit de mourir dans les habits de l'ordre de Saint-François. Je ne crois pas que j'userai de ce privilége; mais un autre avantage plus réel et plus actuel en résulta pour moi. Du jour où je fus protecteur des franciscains, j'eus, par cela même, plus d'autorité sur l'esprit des paysans dalmates que par le commandement dont j'étais investi et le nombre de mes soldats.
Cette nomination, dont chacun peut juger le motif et l'esprit, mécontenta le vice-roi d'Italie, qui la regarda comme une usurpation du pouvoir. Le vice-roi prit le nom de l'Empereur pour m'exprimer son mécontentement. La Gazette de Milan publia un article assez désagréable pour moi, ou il était dit que l'Empereur seul, restaurateur du culte, était protecteur de la religion. Je n'étais pas le protecteur de la religion; j'étais le protecteur de quelques pauvres moines, réclamant un appui auprès du souverain, ou plutôt auprès de l'administration. Je laissai passer l'orage; je conservai ma dignité, si singulièrement jalousée, et je continuai à profiter du bien qui en résultait pour le gouvernement et le pays.
Il était toujours question d'opérations en Turquie; quelques symptômes autorisaient encore des espérances. Cependant, la situation de l'Espagne prenant trop de gravité, on ne pouvait sérieusement penser à entreprendre une conquête qui pourrait entraîner plus tard d'autres guerres. Mon séjour se prolongerait donc probablement en Dalmatie.
Afin de rendre supportable la carrière agitée et errante que j'ai menée, j'ai toujours eu pour principe de m'arranger dans chaque circonstance comme si je devais passer ma vie dans la situation présente. Cette habitude m'a toujours procuré des jouissances, du bien-être, et m'a préservé de l'ennui. À l'époque dont je parle, j'imaginai de consacrer ma vie à un travail d'étude régulier et journalier.
J'avais constamment avec moi une bibliothèque choisie de six cents volumes; dans les moments de repos, au milieu de mes campagnes, ces livres étaient mes délices et ceux des officiers qui m'entouraient. Je recommençai l'étude de l'histoire, et je lus avec plus de méthode et plus de fruit qu'autrefois.
Un abbé romain, appelé Zelli, homme d'une grande instruction et d'un esprit très-remarquable, occupait un poste dans l'instruction publique. Je me liai intimement avec lui, et il me fit un cours complet de chimie. Cette science a souvent absorbé mes loisirs, et c'est lui véritablement qui me l'a apprise. Je fis aussi un cours complet d'anatomie. Mon chirurgien en chef, Fabre, homme d'un grand talent, qui plus tard m'a sauvé la vie peut-être, mais au moins le bras, voulut bien s'en charger Enfin une année entière, sauf quelques absences, consacrée à une étude de dix heures par jour, a contribué puissamment au peu que je sais.
L'Empereur, à cette époque, attachait beaucoup de prix à obtenir la soumission des Monténégrins. Nous étions en état de paix et de bonne intelligence, mais ils n'avaient pas renoncé à leur indépendance. L'Empereur, il est vrai, ne leur demandait pas de devenir sujets comme les Dalmates, mais il voulait d'eux un acte qui leur fît réclamer sa protection. Cette question délicate, entamée plusieurs fois avec le vladika, n'aboutit jamais à un succès complet. Il donnait des espérances, mais ne finissait rien. Il lui fallait du temps, disait-il, pour préparer les esprits; il répondait toujours que, si l'Empereur faisait la guerre aux Turcs, il pouvait compter sur toute la population du Monténégro. Enfin il consulta l'assemblée; l'avis fut d'attendre la réponse aux demandes faites à leur égard à Saint-Pétersbourg. J'envoyai un consul pour résider auprès des Monténégrins; je choisis un officier de la légion dalmate appelé Tomich, homme très-intelligent. Mais l'archevêque, tout en l'accueillant avec égards, s'opposa à ce que sa résidence habituelle fût dans le Monténégro, il me demanda de fixer sa demeure à Cattaro; il viendrait le trouver dans son couvent de Czettin toutes les fois qu'il aurait quelque chose à traiter. Après avoir prodigué ses protestations et dit même qu'il priait pour l'empereur Napoléon et son armée de Dalmatie, il me laissa entrevoir sa répugnance à l'acte qu'on réclamait. Indépendamment des rapports de religion, des habitudes anciennes existant entre lui et la Russie, des bienfaits qu'il en avait reçus, de ceux qu'il pouvait espérer encore, il convenait mieux à sa politique d'avoir pour protecteur un souverain dont les États étaient à trois cents lieues de lui qu'un souverain dont les possessions étaient contiguës avec son territoire. Dans une position comme la sienne, on veut un appui, un bienfaiteur, un patron, le chef d'un système, mais on ne veut pas un maître, et c'est un maître qu'on se donne quand c'est d'un souverain puissant et placé comme l'était Napoléon par rapport au Monténégro qu'on réclame la protection. Les négociations continuèrent jusque bien avant dans l'année 1808; et, dans l'espérance de les mener à bien, je fis préparer pour le vladika de riches cadeaux, entre autres choses un portrait de Napoléon entouré de fort beaux diamants, et je laissai ébruiter à dessein ces préparatifs; mais tout cela n'aboutit à rien.
Des intrigues autrichiennes et des conseils venus de Pétersbourg vinrent compliquer cette affaire. Le ton et les manières de l'archevêque changèrent après l'arrivée d'un courrier venu de Vienne. J'écrivis à l'Empereur pour l'en prévenir et lui dire que, s'il prévoyait une rupture, soit avec les Russes, soit avec les Autrichiens, il fallait profiter de la paix pour soumettre ce pays par la force. Je lui demandais huit jours et sept à huit mille hommes. De Czettin, le grand couvent de ces cantons, j'aurais fait une forteresse pour dominer tout le pays après la conquête. Pour servir de point de sûreté aux troupes françaises, j'y aurais établi leurs magasins. Afin d'affaiblir la population, j'y aurais levé un fort régiment. Ce régiment, formé en Italie, aurait reçu plus tard une destination plus éloignée; enfin je proposais, à la manière des Romains et de Charlemagne, de transporter hors de son pays une partie de la population, et de l'envoyer, par exemple, posséder et défricher les bruyères du camp de Zeist, autour de la pyramide; mais aucun de ces divers projets ne convint à l'Empereur.
Une dernière proposition du vladika à l'assemblée générale, de se mettre sous la protection de l'Empereur, fut encore renouvelée, mais seulement pour la forme et avec mollesse. Combattue par ses amis mêmes, elle fut rejetée à l'unanimité. Les rapports de l'archevêque avec Vienne devinrent chaque jour plus fréquents, et ses dispositions pour nous moins favorables. Il fit aussi la paix avec son ennemi éternel, le pacha de Scutari. Celui-ci, de son côté, avait fait quelques armements depuis le massacre d'Antivari, et son refus de donner passage à des troupes françaises pour Corfou. On parla d'invasion de sa part dans les bouches, avec l'appui des Monténégrins. L'alarme s'en répandit dans la province; mais tout cela était absurde, au moins pour le moment. Je calmai les esprits en envoyant quelques renforts de troupes dans la partie des bouches qui confine au pachalik de Scutari, dans le comté de Pastrovicchio.
J'eus dans le même temps à me mêler d'une petite affaire de la frontière. Un Turc, nommé Hadgi-Bey, possesseur de trente-deux villages, fort dévoué aux intérêts de la France, fut en discussion, les armes à la main, avec ses frères. Pendant une absence, ils se révoltèrent. À son retour, il se mit à la tête de ceux qui lui étaient restés fidèles, et il les combattit. Après diverses chances favorables et contraires, la fortune l'abandonna, et il fut forcé de se réfugier dans son fort d'Uttovo. Il s'y défendait depuis six mois, et il était au moment de se rendre faute de vivres: sa reddition, c'était sa mort; il invoqua mon secours. Je crus de mon devoir de le sauver. Je ne voulais pas décider entre lui et ses frères; mais lui donner les moyens d'attendre la décision du pacha dont il dépendait. Je lui envoyai le général Delaunai avec un bataillon du 79e régiment et un grand convoi de vivres. Le général avait défense de commettre des hostilités contre les ennemis de Hadgi-Bey, s'ils ne s'opposaient pas à sa marche. Tout se passa pacifiquement; ils se retirèrent à notre approche. Hadgi-Bey fut sauvé et bien approvisionné; et le pacha de Bosnie, informé de mes motifs, me remercia. Mais les approvisionnements s'épuisèrent, et il fallut de nouveau venir à son secours. Alors ses frères essayèrent de résister. Il fallut revenir encore plus tard. Je ne pouvais pas laisser périr un homme dont j'avais soutenu les intérêts avec tant de constance, car on s'attache plus par les bienfaits accordés que par les services reçus; en agissant ainsi, on défend son propre ouvrage. Cette fois, je chargeai de l'opération le général Clausel, avec un détachement considérable et l'autorisation de négocier un arrangement convenable pour assurer la paix de cette famille. Il y parvint, et la tranquillité fut rétablie sur cette frontière. Je sollicitai le titre de pacha à deux queues auprès de la Porte, pour Hadgi-Bey. Il fut promis sur-le-champ et donné quelque temps après. L'existence de Hadgi-Bey et de tous les seigneurs turcs de la Bosnie et de l'Erzegovine rappelle celle des seigneurs français au moyen âge.
Dans le courant du mois d'août 1808, je reçus la nouvelle d'une révolution en Turquie. Moustapha-Beïractar, parti de Routschouk, arriva avec ses troupes à Constantinople, pour replacer Sélim sur le trône; mais, au moment où il entrait dans le sérail, le cadavre de son maître lui fut présenté. Sélim déposé et remplacé par Mahmoud, actuellement régnant, Beïractar fut nommé grand vizir. Il s'occupa des réformes qui avaient fait succomber Sélim sous le poids des mécontentements; mais, peu de mois après, il périt lui-même, à la suite d'une insurrection des janissaires. On se rappelle avec quel courage il finit. Quand il vit la partie désespérée, il laissa envahir son palais, et, au moment où il le vit entièrement rempli d'insurgés, Beïractar mit le feu aux poudres rassemblées et sauta avec eux. Ce furent là ses funérailles, et elles en valent bien d'autres.
J'avais remarqué le changement graduel du vladika et des Monténégrins envers nous. Au commencement de septembre, leur inimitié se montra à découvert. Des intrigues avaient été ourdies par eux dans les comtés de Pastrovicchio, situés à leur frontière. Celui de Braiki refusa tout à coup l'obéissance et donna refuge à divers assassins poursuivis. Des troupes furent envoyées pour rétablir l'ordre; les habitants résistèrent et prirent les armes, soutenus par trois cents Monténégrins. Il y eut un combat où justice fut faite, mais chèrement. Le général Delzons, qui s'y rendit, au lieu de prendre avec lui une force convenable, se fit accompagner seulement de deux cents hommes. Cette correction, infligée avec des moyens trop faibles, lui coûta cinquante hommes tués ou blessés. Le vladika, après avoir dirigé ces machinations, s'excusa en déclarant ne pas être le maître. Cette insurrection, fomentée par lui, avait éclaté sans ordre et plus tôt qu'il n'aurait voulu; mais c'était le symptôme certain d'une guerre prochaine avec l'Autriche.
Mon hiver fut consacré tout à la fois aux soins de l'administration, à continuer mes études avec ardeur, et à faire les dispositions pour entrer en campagne, car tout annonçait une levée de boucliers prochaine de la part de l'Autriche. Ne voulant pas être pris au dépourvu, je préparai ce qui était nécessaire pour remplir convenablement la tâche qui me serait imposée. Je reçus aussi les instructions de l'Empereur: elles m'enjoignaient principalement de ne laisser en Dalmatie que la quantité de troupes absolument indispensable, afin d'augmenter d'autant le nombre de celles avec lesquelles j'entrerais en campagne. Cette disposition était trop dans mes intérêts pour ne pas m'y conformer.
La première chose à faire était d'assurer l'approvisionnement des places destinées à être gardées et défendues: en Albanie: Cattaro, Castelnovo et Raguse; en Dalmatie: Zara, Klissa, Knim, et le fort San Nicolo de Sebenico. Tout étant disposé pour évacuer les autres postes, on ouvrit les remparts qui les défendaient. Les pièces de gros calibre, retirées d'avance des batteries de mer ouvertes, furent mises en sûreté.
Le 60e régiment tout entier, un bataillon d'infanterie légère italienne, le quatrième bataillon de la légion dalmate, et tout ce qui n'était pas valide dans l'armée, renforcés d'un nombre convenable de canonniers et de sapeurs, furent destinés à former toutes ces garnisons. La modicité des garnisons, dont la force suffisait cependant à l'indispensable, rendit les approvisionnements suffisants pour six ou huit mois, ce qui, en présence des événements probables, me donnait beaucoup de sécurité. J'avais prévu, de longue main, l'époque où j'irais chercher la guerre, si la guerre ne venait pas me chercher. Dans l'un et l'autre cas, les places ne devaient pas avoir de fortes garnisons. Pour remédier à cet inconvénient obligé, j'avais institué des gardes nationales. En accordant des distinctions, j'engageai les jeunes gens des meilleures familles à se mettre à leur tête. Quelques éloges piquèrent leur amour-propre, et j'étais parvenu à faire de cette troupe un corps de milice en état de servir.
Les garnisons des places eurent ainsi, pour corps auxiliaires, un bon bataillon à Cattaro, deux à Raguse, et un à Zara, sans qu'il en coûtât autre chose que des armes et un supplément de vivres pendant les jours de service. Knim renfermait un approvisionnement extraordinaire, destiné à nourrir l'armée pendant qu'elle serait rassemblée sur la frontière. J'avais de bons soldats, dévoués, braves, instruits; mais mon matériel était nul. Mon artillerie se composait seulement de douze bouches à feu. J'avais assez de chevaux pour les traîner, mais non pour transporter leurs approvisionnements. Je n'avais pas un cheval de trait pour les vivres; je n'avais rien de ce qui appartient aux ambulances: il fallut tout créer avec les moyens du pays.
La Dalmatie possède une grande quantité de petits chevaux de bât; tous les transports se font par leur moyen. Le recensement en porta le nombre au delà de quatre-vingt mille. J'ordonnai une levée de deux mille chevaux. Mille furent consacrés à porter des munitions, mille aux ambulances et aux vivres, et on construisit des caisses pour renfermer les munitions, les objets de pansement et les vivres. La charge consommée, le cheval devait être consacré à transporter des blessés. Je levai un corps de mille Pandours, espèce de gendarmes de la Dalmatie, pour l'escorte, la surveillance, et la conservation de ces deux mille chevaux, qui avaient aussi leurs propres conducteurs. Les rations de vivres étant composées en partie de biscuit et en partie de riz, les soldats purent porter, sans se fatiguer, huit jours de vivres. Après avoir formé les garnisons ainsi que je l'ai indiqué, et laissé les places entre les mains d'officiers capables, à la fin de mars, je réunis, dans les environs de Zara, de Benkovatz et d'Ostrovitza, l'armée prête à entrer en campagne. Sa force était de neuf mille cinq cents hommes d'infanterie, formés en deux divisions: première division commandée par le général Montrichard, deuxième division par le général Clauzel, et composées des régiments suivants: 8e et 18e d'infanterie légère, 5e, 11e, 23e, 79e, 81e d'infanterie de ligne, quatre cents chevaux, douze pièces de canon.
L'armée autrichienne en présence, plus du double de la mienne, se composait, il est vrai, de troupes d'une qualité fort inférieure, de dix-huit bataillons, tous croates, forts chacun de douze cents hommes, savoir: les quatre bataillons du régiment de Licca, et deux bataillons de chacun des sept autres régiments. La cavalerie avait quatre escadrons de dragons légers, de sept cents chevaux, et l'artillerie vingt-quatre bouches à feu. Ces troupes étaient sous les ordres du général Stoisevich. J'avais de plus à combattre la population entière, qui, par son organisation, est soumise aux dispositions militaires, s'arme, se meut, et exécute tout ce qui lui est prescrit.
Cette organisation de la population me donnait la certitude qu'après avoir obtenu des succès, après avoir conquis le pays, je ne recevrais aucun secours des habitants, et ne trouverais que des villages abandonnés et des maisons désertes. La difficulté de ma position et mon isolement devaient m'empêcher de négliger aucun secours. J'essayai, par la politique, une petite diversion qui me réussit et me fut utile alors, mais qui, plus tard, me causa quelques embarras. Lors de la paix de Sistow, conclue entre les Autrichiens et les Turcs, en 1791, une langue de terre bordant le pied des montagnes dans la vallée de l'Unna, et située sur la rive gauche de cette rivière, fut cédée par la Porte à l'Autriche. Ce territoire, très-fertile, fort habité, et d'une longueur de vingt lieues environ, est défendu par la forteresse de Czettin, dont les Autrichiens, commandés par le général Devins, ne s'emparèrent qu'après trois semaines de tranchée ouverte. Une question de souveraineté pour les Turcs est en même temps une question de propriété; car, comme ils répugnent à vivre sous une domination chrétienne, quand le Grand Seigneur cède un territoire, souvent (en Europe du moins) ceux qui l'habitent abandonnent leurs champs et se retirent. Il en fut ainsi à l'époque dont je parle: alors le Grand Seigneur promit aux habitants des confins dépossédés de leur donner ailleurs des terres équivalentes; mais, en Turquie comme dans beaucoup d'autres pays, les souverains ne tiennent pas toujours leurs engagements, et ces malheureux ne reçurent rien. Les terres cédées, distribuées aux Croates, furent mises en valeur, et de jolis villages y furent bâtis.
L'homme aime la justice, et garde toujours au fond du coeur le sentiment énergique de ses droits. La force et la violence peuvent seules l'empêcher de les faire valoir; mais, quand l'occasion devient favorable, il l'entreprend souvent avec énergie. Les Turcs protestèrent constamment contre une paix dans laquelle ils avaient été sacrifiés, et se prétendaient toujours propriétaires légitimes des lieux cédés. Dix-huit ans n'avaient pas apporté la moindre altération à leurs dispositions à cet égard. Ces Turcs étaient les capitaines de la frontière, espèce de seigneurs féodaux, habitant des châteaux défensifs et rappelant les seigneurs français du moyen âge.
Instruit de cet état de choses, j'engageai le consul de France à fomenter le mécontentement. Il pourrait amener des hostilités sur la frontière, et les hostilités ne pourraient être qu'à mon profit. Pour des barbares, dont la prévoyance ne va pas jusqu'au lendemain, l'occasion était belle. Toutes les troupes croates en état de combattre avaient pris les armes, et étaient sorties de leurs villages: les postes fortifiés, situés en vue les uns des autres, appelés chardaks, étaient confiés à des invalides; la forteresse de Czettin elle-même était occupée par des vieillards. Les Turcs ne purent résister à la tentation. Un beau jour, ils envahirent sur tous les points toutes les terres contestées; ils égorgèrent les Croates surpris dans leurs postes, et brûlèrent les villages. Toute la population se réfugia dans l'intérieur; mais, par suite de cet esprit de justice dont je parlais tout à l'heure, ces Turcs si violents, si emportés, s'arrêtèrent d'eux-mêmes à l'ancienne frontière. Cette invasion jeta un grand effroi dans le pays. Le général Stoisevich détacha deux bataillons pour le protéger et prévenir de nouveaux malheurs, précisément peu de jours avant le moment où je devais entrer en campagne.
L'Empereur m'avait donné pour instruction de rassembler mes troupes aussitôt que la guerre serait certaine, et d'entrer en campagne dès qu'elle serait déclarée, afin de faire diversion en faveur de l'armée d'Italie. Depuis un mois, mes troupes étaient réunies sur la frontière, et prêtes à marcher. Les hostilités ayant commencé en Italie, je me décidai à en faire autant de mon côté, mais avec réserve et prudence, car je ne pouvais déboucher qu'après des succès préalables de l'armée d'Italie. En effet, si, une fois arrivé dans le coeur de la Croatie, j'avais appris que cette armée était battue, il aurait été aussi difficile de m'y soutenir que fâcheux de revenir sur mes pas. Mon mouvement devait être fait avec vigueur et décision; mais, vu la faiblesse de mon corps d'armée, ce ne pouvait être qu'un mouvement secondaire et subordonné à ceux de l'armée d'Italie.
La Zermagna sépare la Croatie de la Dalmatie. La grande route, qui traverse la Croatie, aboutit à la haute Zermagna. Par là seulement pouvait agir un corps d'armée. Mais, dans cette situation, tous les corps ennemis, qui étaient placés sur la basse Zermagna, étant maîtres de la franchir, menaçaient la communication de l'armée avec Zara. Afin de la couvrir, je donnai ordre de couler tous les bateaux de la partie inférieure de la rivière, et de rompre les ponts situés dans le reste de son cours.
J'envoyai de ce côté le général Soyez, avec sa brigade, tandis que la masse de mes troupes se portait en avant de Knim. L'ennemi, profitant des gués de la partie supérieure, se présenta en forces. Le général Soyez le repoussa; mais, le voyant s'accroître devant lui, il crut prudent de se rapprocher de moi. J'arrivai sur ces entrefaites à son secours avec une brigade. Je donnai l'ordre au colonel Cazeaux et au chef de bataillon Jardet, du 18e, de culbuter ce qu'ils avaient devant eux et de poursuivre l'ennemi jusque dans Obrovatz, l'épée dans les reins. Cet ordre ne fut que trop ponctuellement exécuté: tout céda, tout plia devant le bataillon commandé par Jardet; quatre cents hommes furent tués, blessés ou pris. Mais, cet officier s'étant précipité, avec la tête de son bataillon, jusque dans Obrovatz même, situé au pied de l'escarpement, le feu vif des Autrichiens, placés sur les rochers de la rive opposée, fut si meurtrier, que la queue du bataillon ne put pas suivre la tête. Celle-ci, mêlée avec les Croates, était descendue jusque dans la ville. Remonter en plein jour, c'était impossible à cette fraction de troupes. Comme la brigade placée en arrière n'attendait que le retour du bataillon pour avancer, Jardet crut bien faire de lui envoyer l'ordre de faire son mouvement sur-le-champ, tandis qu'il attendrait la nuit pour le rejoindre avec les soixante ou quatre-vingts hommes qu'il avait près de lui. Le bataillon arriva; mais, après son départ, les Croates, dispersés dans les montagnes, revinrent et firent prisonniers Jardet et son détachement. Cet officier, de la plus haute distinction et fait pour arriver à tout, en qui j'avais une confiance sans bornes, me fut, heureusement, bientôt rendu par un échange. Je le pris près de moi: devenu mon premier aide de camp, il fut tué à la bataille de Lutzen, quatre ans après.
L'ennemi avait réuni ses troupes sur le mont Kitta, appuyé à la Zermagna et couvert par un de ses affluents. Cette position était retranchée, et il avait ses réserves placées dans le fond de la vallée et près de la grande route qui conduit à Gradschatz. Une forte avant-garde de cinq à six mille hommes occupait le plateau de Bender; en avant de la position défensive, trois bataillons, deux de Sluin et un d'Ottochaz, formaient une première ligne assez mal soutenue. Le 1er mai, je la fis attaquer par les voltigeurs du 8e et un bataillon du 11e, pour m'approcher davantage de la masse des forces ennemies et juger de sa position, en faisant rentrer ainsi tout ce qui en était détaché. Culbuter cette ligne fut l'affaire d'un moment; on la jeta en partie dans un ravin, et on lui tua beaucoup de monde. Une réserve d'environ mille hommes vint à son secours et partagea sa défaite. Je fus à même de juger la manière dont l'ennemi était établi et d'apprécier la force de sa position. Il était trop tard pour continuer l'action, et je remis au lendemain à l'attaquer.
Pendant la nuit, une pluie épouvantable, un vrai déluge, comme on en voit dans le Midi, vint gonfler les rivières. Il n'était plus possible de tenter l'attaque projetée. La Zermagna seule présentait un obstacle insurmontable. Il fallait attendre que ses eaux fussent écoulées. Mais, le soir du 2 mai, une lettre du vice-roi, qu'un aviso avait apportée à Zara, me parvint. Il m'annonçait le mauvais début de la campagne en Italie, sa retraite sur la Piave et peut-être sur l'Adige, par suite de la perte de la bataille de Sacile. Il était très-heureux pour moi que ces importantes nouvelles me fussent arrivées avant d'avoir livré un grand combat, dès lors sans objet. Je me décidai à me retirer le lendemain, à me rapprocher de mes ressources et de mes vivres, et je revins à Benkovatz, où j'établis mon quartier général. Le bataillon de Pandours, organisé pour l'escorte des subsistances, se livra à quelques désordres, qui furent promptement punis. Cette sévérité en prévint de nouveaux.
Des montagnes de la Croatie étaient descendues des bandes qui couraient au milieu des cantonnements et désolaient le pays entre la Zermagna et la Kerka. Je profitai de ce moment de repos pour leur donner la chasse et pour en purger le territoire.
Les succès des autrichiens obtenus au commencement de la campagne en Italie, la conquête du Frioul et le gain de la bataille de Sacile avaient donné une grande confiance à l'archiduc Jean. Il m'écrivit pour me proposer d'évacuer la Dalmatie, motivant sa lettre sur l'impossibilité d'être secouru et mon entier isolement. Il m'accorderait, ajoutait-il, les meilleures conditions, en raison de la réputation de mes troupes et par considération pour moi. Je crus qu'il était au-dessous de moi de répondre à cette lettre.
Le 11 mai, je reçus une lettre du vice-roi, accompagnée des bulletins de la grande armée, annonçant le succès de Ratisbonne et la marche de Napoléon sur Vienne. Par suite de ce mouvement, le vice-roi allait reprendre l'offensive et marcher sur le Frioul. Ses succès cette fois ne pouvaient pas être incertains, et j'étais sûr, en marchant moi-même, de le rencontrer. Je résolus de ne pas attendre un moment pour agir, et, dès le surlendemain, 13, j'entrai en opération.
Je laissai la division Montrichard en observation devant le grand débouché de la Zermagna, et je la plaçai de manière à pouvoir en même temps soutenir au besoin, par un détachement, la division Clausel. Je dirigeai celle-ci immédiatement sur les positions que j'avais reconnues quinze jours avant, et au pied desquelles nous avions déjà combattu. L'ennemi avait laissé environ quatre à cinq mille hommes sur la basse Zermagna. La masse de ses troupes était divisée en deux portions: l'une tenait en forces le mont Kitta, clef de la position; l'autre était dans la vallée avec toute son artillerie et sa cavalerie. Ses dispositions étaient tout à la fois offensives et défensives. Si nous avions éprouvé un échec au mont Kitta, la colonne de la vallée aurait débouché avec tous ses moyens organisés, tandis que le corps placé du côté d'Évernich, dans les montagnes bornant la basse Zermagna, serait descendu, aurait passé cette rivière et coupé ma communication avec Zara. Ce plan était bien conçu, et, si un revers complet dans notre attaque eût été suivi de ce mouvement, notre position serait devenue embarrassante; nous ne pouvions plus de longtemps penser à déboucher.
Le mont Kitta offre une magnifique position. Son développement est assez grand, et plusieurs pitons forment comme autant de redoutes. Son pied est couvert et défendu par un affluent de la Zermagna, qui, ce jour-là, était heureusement guéable.
Deux régiments de la division Clausel, le 8e léger et le 23e, furent chargés d'enlever la position. Elle fut emportée après une vive résistance. Je m'y rendis aussitôt, et j'appelai à moi le 11e et le régiment de chasseurs à cheval, monté sur des chevaux bosniaques. Le 8e s'étant abandonné à la poursuite des troupes battues qui se retiraient par les hauteurs, le 23e suivit. Je le fis arrêter, et je renforçai la position avec le 11e, placé sur le revers et caché de manière à ne pas être aperçu.
Le général Stoisevich vit, de la vallée où il était, l'événement arrivé aux troupes du mont Kitta; il savait le prix de sa possession, soit qu'il se bornât à la défensive, soit qu'il se décidât à essayer de l'offensive: aussi voulut-il le reprendre et profiter du moment où, par l'entraînement du succès, les troupes victorieuses s'éloigneraient du lieu où elles avaient vaincu, sans avoir assuré suffisamment sa conservation. Ayant mis en mouvement immédiatement au moins quatre mille hommes du corps de la vallée, il se plaça à leur tête et gravit directement le mont Kitta, en se dirigeant par la ligne la plus courte sur ses sommités.
Je lançai quelques troupes en avant, avec ordre de rétrograder pour l'encourager dans son mouvement. Le général Stoisevich marchait avec une nuée de tirailleurs en avant de la colonne. Au moment où il croyait atteindre son but et saisir la victoire, le 11e régiment se montra et marcha à la baïonnette contre cette infanterie essoufflée, fatiguée; en même temps, mes trois cents chasseurs ayant fait une charge sur ce qui s'était le plus avancé, huit cents hommes, cinquante officiers furent faits prisonniers, et avec eux le générai Stoisevich commandant cette armée. La colonne rétrograda aussitôt dans la vallée et fit sa retraite sur Popina, où des retranchements très-considérables avaient été préparés.
Ce début de campagne était de bon augure. J'envoyai en toute hâte les prisonniers à Zara, et, comme je ne leur donnais qu'une faible escorte, je les dirigeai par Knim, Oerais et Sebenico: ainsi constamment couverts par la Kerka, leur sûreté, pendant leur marche, ne fut jamais compromise. Les pertes de l'ennemi, dans cette affaire, dépassèrent trois mille hommes tués, blessés ou prisonniers. Un assez grand nombre de soldats, en outre, jeta ses armes pour fuir plus facilement dans les rochers et échapper à la cavalerie, d'où il suit que ce combat affaiblit l'ennemi d'environ quatre mille hommes.
Le lendemain, je marchai sur Popina. La division Montrichard et l'artillerie s'y rendirent par la vallée, tandis que je m'y portai par les montagnes avec la division Clausel. Les retranchements étaient placés au point ou la route quitte les bords de la rivière. Un développement suffisant, de bons appuis, rendaient l'attaque difficile. À peine étais-je occupé à reconnaître le point le plus faible, que je vis l'ennemi s'ébranler pour opérer sa retraite; je le suivis sans retard. La prise du général Stoisevich contribua sans doute beaucoup au changement de système.
Je fis poursuivre l'ennemi avec toute l'activité possible par mon avant-garde. Marchant avec elle, j'avais donné l'ordre au reste de l'armée de presser son mouvement pour me soutenir. Je rencontrai l'arrière-garde ennemie à une lieue et demie de Gradschatz. Elle essaya de nous arrêter pour favoriser le retour de la colonne d'Évernich qu'elle couvrait; mais, culbutée, elle se retira jusque dans la plaine, où l'armée était rassemblée.
Nous marchions sur le revers des montagnes au pied desquelles coule la Zermagna. Le corps de quatre à cinq mille hommes, qui les occupait, dut se diriger directement sur Gospich, par suite de la retraite précipitée de l'arrière-garde. C'était à Gospich, au surplus, que l'ennemi comptait rallier toutes ses forces et combattre de nouveau. Ce corps se trouvait ainsi sur le flanc des troupes qui me suivaient. Leur voisinage m'obligeant à marcher réuni, et quelques engagements en ayant imposé au général Clausel, commandant la colonne, ce général ralentit la marche des troupes, tandis que moi, comptant sur leur prochaine arrivée, je m'étais engagé avec trois bataillons seulement. J'eus à soutenir un combat extrêmement difficile. L'ennemi n'avait pas moins de dix mille hommes autour de Gradschatz. D'abord tout à fait sur la défensive, il s'aperçut fort tard du peu de monde qu'il avait devant lui; et c'est alors seulement qu'il marcha sur nous. Mes troupes étaient si bonnes, qu'on pouvait ne pas compter les ennemis; d'ailleurs le moindre mouvement rétrograde pouvait avoir les plus grands inconvénients; aussi me décidai-je à ne pas reculer d'un pas, et, pour soutenir la résolution de mes troupes, je me tins dans le lieu le plus exposé. Je reçus un coup de feu à la poitrine. Quoiqu'on se battît de très-près, ma blessure fut légère. Je prêtais le flanc droit à l'ennemi, la balle vint de côté frapper en glissant sur ma bretelle et ricocha. Les officiers placés près de moi, au bruit qu'ils entendirent, me crurent tué. La commotion avait été forte, et cinq minutes après je me trouvais mal.
Heureusement la nuit était entièrement close, et le combat finissait. Je me rappellerai toute ma vie l'effet produit dans cette petite armée par la nouvelle de ma blessure. Chacun éprouva une alarme très-vive et montra un intérêt touchant. Indépendamment de l'attachement des soldats pour leur chef, ils sentaient bien qu'un changement de commandement, dans une situation aussi difficile et au commencement d'une opération présentant d'aussi grands obstacles, pourrait être funeste. Aussi une grande joie se peignit sur toutes les figures quand je reparus à cheval le lendemain. Quelles douces acclamations! il me semble encore les entendre. Digne récompense des plus grands dangers et des souffrances les plus pénibles.
Le 18, au matin, l'ennemi avait évacué Gradschatz. Il opérait sa retraite sur Gospich, où tout annonçait qu'il avait l'intention de résister.
Je passai le 18 et le 19 à Gradschatz.
Pendant ces deux journées, un convoi de vivres et de munitions, escorté par une partie de la garnison de Zara, me rejoignit, ainsi que tout ce qui était resté en arrière. Je renvoyai les hommes du 60e avec des prisonniers, en faisant mes adieux à la Dalmatie. Le 20, nous continuâmes notre mouvement sur Gospich, et, le 21, nous arrivâmes de bonne heure en vue de cette ville.
Indépendamment des colonnes d'Évernich et d'Obrovatz, il était arrivé du Banat deux bataillons de renfort. Toute la population avait pris les armes; ainsi nous trouvâmes là tout à la fois beaucoup de troupes devant nous et des localités très-favorables à la défense.
Gospich est situé à la réunion de quatre rivières. De quelque côté qu'on se présente, il est nécessaire d'en passer deux. Ces rivières sont très-encaissées, et leurs bords sont à pic; on ne peut les passer que devant les chaussées; une seule était guéable. Je me décidai à ne pas attaquer de front Gospich, mais à tourner sa position pour menacer la retraite de l'ennemi. Pour atteindre ce but, le bassin étant peu large, il fallait passer une des rivières à la portée du canon des batteries ennemies, situées de l'autre côté de la Licca, ou traverser des montagnes de pierre, extrêmement âpres, où les Croates auraient pu, à chaque pas, faire résistance. L'ennemi occupant la rive opposée de cette rivière, l'en chasser était nécessaire pour rétablir le pont coupé la veille. Deux compagnies de voltigeurs passèrent à gué et remplirent cet objet. L'ennemi ne croyait pas possible le mouvement qui s'exécutait; il était peu en forces sur ce point. Ces compagnies occupèrent deux pitons situés près de la rivière. À peine eurent-elles pris position, que l'ennemi déboucha derrière nous, par le pont de Bilai, et se porta sur la division Montrichard, qui marchait derrière la division Clausel. J'avais fort serré mes troupes pour rendre cette marche de flanc moins longue, et elles étaient mal formées pour combattre. Je sentis toute l'étendue de la crise, et voici les dispositions que je pris pour y remédier.
Je donnai l'ordre au général Clausel de faire passer au général Delzons, avec le 8e régiment, la petite rivière placée devant nous, afin d'occuper les mamelons dont les voltigeurs s'étaient emparés, et de les défendre avec la plus grande opiniâtreté. Je fis prendre lestement les distances, par la queue de la colonne, à la division Montrichard, avec laquelle j'allais combattre. Le général Montrichard, sans manquer de bravoure personnelle, perdait toute son intelligence dans le danger; et, vu les circonstances, je commandai moi-même ce jour-là sa division. L'ennemi marcha à nous avec lenteur, ce qui nous donna le temps de nous former et de nous mettre en position. Après y être resté quelques moments pour juger des intentions de l'ennemi, je reconnus qu'il était formé en trois colonnes. Celle du centre devançant un peu les autres, je la fis attaquer sur-le-champ par le 18e régiment. À sa tête était le générai Soyez. J'ordonnai ensuite l'attaque de la colonne de droite de l'ennemi par le 79e, à la tête duquel marchait Montrichard.
Les charges du 18e furent brillantes. Tout céda devant ce brave régiment; tout fut culbuté, et l'ennemi perdit cinq pièces de canon sur six qui avaient débouché. Le général Soyez y fut gravement blessé. Le 5e régiment marcha sur la colonne de gauche de l'ennemi et la fit replier. Pendant ce temps, le 79e ayant suivi la droite de l'ennemi, s'était réuni à notre centre, après avoir dépassé un mamelon isolé, comme on en trouve beaucoup dans ce pays, mamelon auquel l'ennemi s'était appuyé, et qui coupait notre ligne. L'ennemi présentant de nouvelles troupes, je plaçai en réserve le 81e et un bataillon du 11e, que je détachai de la division Clausel. L'ennemi fit alors un grand effort sur la droite; le 79e le reçut avec sang-froid et vigueur, et le 81e, l'ayant chargé immédiatement après, le précipita dans la Licca, où plus de deux mille hommes se noyèrent, et douze cents tombèrent entre nos mains. Le feu de douze pièces de canon, placées de l'autre côté de la Licca, protégea la retraite du reste des troupes qui avaient passé la rivière pour nous attaquer. Le général Launai fut gravement blessé dans cette circonstance.
Pendant que cette action se passait à ma gauche, l'ennemi avait détaché six bataillons pour attaquer le régiment d'infanterie légère, mis en position pour protéger la reconstruction du pont et faciliter à l'armée les moyens de déboucher. Ce régiment, à la tête duquel se trouvait le général Delzons, était si bien posté et avait mis une telle énergie dans sa défense, que l'ennemi fut constamment repoussé dans toutes ses attaques directes. Il voulut tourner la position; mais le 11e régiment était à portée: je l'envoyai au secours du 8e avec ordre de prendre l'offensive et de menacer la retraite des forces ennemies en les tournant comme elles tournaient le 8e. Le succès le plus complet couronna cette manoeuvre. L'ennemi fut repoussé, mis en déroute, et laissa entre nos mains cinq cents prisonniers.
Pendant la nuit, on s'occupa de rétablir le pont. Mon intention était de traverser la rivière avant le jour avec toutes mes forces, pour me trouver le plus tôt possible sur la communication de l'ennemi, ne supposant pas qu'il retardât un seul instant à commencer sa retraite. Mais les travaux du pont exigèrent plus de temps que je ne l'avais pensé, et le transport de six à sept cents blessés fut tellement difficile, qu'à midi les troupes n'étaient pas encore en état d'exécuter leurs mouvements.
Cependant l'ennemi avait fait une démonstration offensive en remontant la Licca avec quatre ou cinq mille hommes. Cette confiance de sa part semblait devoir résulter de l'arrivée prochaine des secours qu'amenait le général Knesevich; on le disait arrivé à peu d'heures de marche.
Ma position devenait embarrassante. D'un côté, l'armée était divisée par un ruisseau difficile à passer, et l'ennemi semblait attendre que les trois quarts l'eussent franchi pour tomber sur le reste. Une fois au delà du ruisseau, il fallait renoncer à toute idée de retraite. Si les renforts annoncés à l'ennemi défendaient les marais d'Ottochatz, il était difficile de forcer ce passage, ayant une armée en queue, et avec tous mes embarras. Se soutenir quelque temps entre Gospich et Ottochatz était absolument impossible, et mes blessés, mes équipages et mon artillerie mettaient un grand obstacle à tous mes mouvements.
D'un autre côté, repasser le ruisseau, c'était renoncer à l'offensive; c'était ajourner d'une manière indéfinie notre jonction avec l'armée d'Italie; c'était, enfin, consacrer l'opinion d'une défaite, après avoir remporté la veille une victoire complète. Mais le général Knesevich arrivant, il était peut-être possible de le battre séparément. Au pis aller, les soldats avaient pour six jours de vivres dans leurs sacs, et, si les circonstances devenaient aussi difficiles qu'on pouvait l'imaginer, en sacrifiant mon artillerie, en abandonnant mes blessés, et en faisant des marches forcées, je pouvais espérer de faire ma jonction avec les troupes de l'armée d'Italie, à travers les hautes montagnes.
Les deux partis étaient extrêmes. Je choisis le plus honorable; je persistai dans ma première résolution, et la fortune sourit à ma confiance.
La division Montrichard passa le ruisseau sans être inquiétée, et, aussitôt après l'arrivée de mes troupes à l'entrée de la plaine, l'ennemi se disposa à la retraite; il rappela le corps qui avait remonté la Licca, et vint se former devant nous avec sept bataillons et toute son artillerie, afin de battre les débouchés par lesquels nous sortions des montagnes.
Le général Delzons, avec le 23e, gagna autant de terrain qu'il put sur le bord du ruisseau; soutenu par le 5e et le 18e, il se porta en avant, et donna à toute l'armée le moyen de déboucher et de se former. L'ennemi tenta à deux reprises de nous rejeter sur le ruisseau au moyen de sa cavalerie, mais sans succès; et, enfin, il se décida à la retraite par la route d'Ottochatz.
Telle fut la bataille de Gospich, où nous combattîmes pendant deux jours avec une grande infériorité de nombre, dans les localités les plus difficiles. Nous fûmes complétement victorieux, grâce à la grande valeur des troupes. Pendant les mêmes journées, les 21 et 22 mai, se livrait sur la rive gauche du Danube, le terrible combat d'Essling. Le 23, nous entrâmes à Gospich par le pont de la route d'Ottochatz. Toute la population avait abandonné la ville: quelques officiers d'administration seuls étaient restés; je leur remis une trentaine de blessés incapables de supporter même le mouvement du brancard, et je pris les moyens nécessaires pour assurer le départ de tous les autres.
Les hommes légèrement blessés à la partie supérieure du corps continuèrent la route à pied. Ceux plus maltraités, qui ne pouvaient pas marcher, mais qui pouvaient monter à cheval, furent placés sur des chevaux de bât, dont les charges de vivres ou de munitions avaient été consommées; quant aux autres blessés, on les plaça sur des brancards, portés par les prisonniers qui se relayaient à tour de rôle. Aucun blessé, excepté ceux en très-petit nombre dont le transport, de quelque manière qu'il fût exécuté, eût occasionné la mort, ne fut abandonné; ils suivirent l'armée, et furent déposés dans les hôpitaux de Fiume à leur arrivée dans cette ville.
Le 24, je continuai mon mouvement sur Ottochatz, et, le 25, nous arrivâmes devant cette ville. Elle est environnée d'eau et de marais, et la route la traverse. Les ponts étant coupés, l'arrière-garde ennemie y était encore. Une communication praticable donnait les moyens de la tourner par la droite. L'ennemi, qui le savait, plaça un corps de troupes appuyé aux marais et aux montagnes pour barrer cette communication. Je le fis attaquer par le général Delzons avec les 8e et 23e. L'ennemi fut battu et culbuté, mais le général Delzons fut blessé.
Arrivé sur les hauteurs d'où on apercevait la grande route, nous vîmes sept à huit mille hommes avec l'artillerie et les bagages. Le général Montrichard avait l'ordre de suivre mon mouvement: s'il fût arrivé sans retard, comme il l'aurait dû, nous serions descendus des montagnes et nous aurions achevé la destruction de ce corps d'armée; mais je n'osai me commettre avec aussi peu de forces. Ce malheureux Montrichard ne pouvait jamais marcher ni rien terminer: sans un seul ennemi devant lui, et couvert par des lacs et des marais, il avait perdu son temps à manoeuvrer. Sans son incroyable incapacité, un brillant succès aurait terminé cette campagne d'une manière éclatante.
Arrivé à l'embranchement des routes de Croatie et de Fiume, l'armée ennemie se dirigea sur Carlstadt et alla rejoindre le général Giulay, auquel j'eus plus tard affaire en Styrie. Je me dirigeai par Segna sur Fiume et Laibach. De ce moment nous n'eûmes plus d'ennemis en présence. En quatorze jours d'opérations, j'avais livré une bataille et trois combats; l'ennemi était affaibli de six à sept mille hommes tués, blessés ou pris, et j'avais prouvé que mes soldats étaient aussi vaillants et aussi braves qu'instruits et vigoureux.
Cette petite armée, prise dans les hôpitaux, et, si j'ose le dire, dans les charniers de la Dalmatie, était devenue une troupe d'élite. C'est avec cette réputation que, plus tard, elle vint prendre place dans les rangs de la grande armée à Wagram. Au surplus, je puis, sans m'écarter de la vérité, dire ici que toutes les troupes que j'ai commandées, même à la fin de nos désastres, ont toujours été bonnes. Pour les rendre telles en France, il faut seulement s'en occuper, et, dans les circonstances difficiles, montrer l'exemple. Cette conduite est le plus éloquent de tous les discours.
Arrivé au col de Segna, la vue de la mer produisit sur tous les soldats une agréable surprise. On se sentait hors de peine, et nous avions devant nous des récompenses à espérer, mais aussi bien d'autres travaux à exécuter. Cette petite armée avait un feu sacré que rien n'a jamais pu éteindre.
De Fiume, j'écrivis au provéditeur de la Dalmatie pour lui faire connaître le résultat de la courte campagne que nous venions de faire. Cette nouvelle fit un effet prodigieux dans la province, et les Dalmates, qui dans leurs chants habituels célèbrent la gloire à l'imitation des anciens bardes, se hâtèrent de composer des chansons qui sont devenues nationales; ils les chantent encore aujourd'hui, et nos actions et nos noms y sont consacrés.
Tous les Dalmates qui m'avaient accompagné retournèrent chez eux et y furent reçus en triomphe. Je n'oubliai pas d'écrire au provincial des franciscains pour lui témoigner ma satisfaction de la conduite de ses moines: c'est à eux que nous avions dû la profonde tranquillité dont la province avait joui pendant tout ce temps.
RELATIFS AU LIVRE ONZIÈME.
CLAUSEL À MARMONT.
«Raguse, 7 janvier 1808.
«Mon général, les sénateurs s'assemblent souvent depuis mon arrivée. J'ai reçu d'eux deux lettres que j'ai l'honneur de vous transmettre. La dernière contient des doléances, des griefs, et ressemble assez à un petit manifeste. Ce matin, j'ai dit au minor Contiglio que je les engageais à s'occuper à l'avenir, et seulement, des affaires administratives, intérieures et municipales, et, pour tout le reste, d'attendre les événements.
«Il est vrai que le pavillon italien est arboré: c'est d'après mon ordre, celui de Saint-Blaise n'étant déjà plus lorsque je suis arrivé.
«Les sénateurs font ce qu'ils peuvent pour empêcher que les bâtiments de commerce ne prennent le pavillon italien. Je fais ce que je dois pour qu'ils l'arborent tous.
«Les autres plaintes sont sans fondement et sans preuves.
«Le sénat députe M. Caboga vers Sa Majesté l'Empereur. Je ne puis permettre son départ qu'autant que vous l'autoriserez, et je ne permets plus qu'on s'assemble pour de pareilles députations sans votre assentiment. Il y a un envoyé à Paris; pourquoi ne pas s'en servir?
«Les sénateurs craignent la perte de leur puissance; ils ont pour eux raison; car la majeure partie est et sera bien misérable, puisque les concussions, les dettes, etc., etc., ne pourront plus se faire impunément.
«Je partirai demain pour Cattaro, et je ferai mettre les dispositions de votre arrêté à exécution. Les bâtiments, dont la prise n'aura pas été jugée légale, et ceux pris depuis la paix de Tilsitt, seront bientôt remis aux anciens propriétaires.
«Le sénat va vous envoyer un député pour obtenir la permission de faire partir Caboga pour Paris. Le choix, comme vous le voyez, pouvait être meilleur, quoique pas plus utile.
«Le sénat, qui a réfléchi tout le jour et délibéré, me fait prévenir qu'il écrit aux comtes pour savoir ce qu'ils pourront fournir en marins pour la levée demandée.»
NAPOLÉON À MARMONT.
«Paris, le 20 janvier 1808
«Monsieur le général Marmont, votre aide de camp m'apporte votre lettre du 9 janvier.--J'ai déjà écrit depuis longtemps à Sébastiani pour que la Porte prenne des mesures telles, qu'en cas de siége de Corfou vous ayez passage pour un corps de huit mille hommes, qui se rendrait à Butrinto. J'ai à Corfou des moyens de transport, et votre armée, que vous pourriez porter jusqu'à douze mille hommes, et qui serait composée de trois divisions, passerait en peu de jours à Corfou pour se joindre à la garnison et jeter les Anglais dans la mer.--La Porte a ordonné également que des Tartares fussent placés depuis Butrinto jusqu'à Cattaro pour que les officiers venant de Corfou arrivent rapidement aux bouches, et que, de même, non-seulement les officiers que vous expédierez puissent faire ce trajet avec la même rapidité, mais encore pour que quelques envois de poudre, que vous pourrez faire passer par terre, soient protégés. Commencez par expédier par terre cinquante mulets chargés de poudre, chaque mulet portant deux barils, ce qui fera un total de cent barils ou dix milliers. Moyennant vos négociations de Scutari et de Bérat, vous pourrez facilement obtenir le libre passage. Écrivez à cet effet.--Faites également partir plusieurs petits bateaux chargés de poudre, qui iront le long des côtes, et réussiront à passer à Corfou à travers la croisière ennemie. Il est probable que, sur cinq bateaux, chargés de trois milliers de poudre chacun, il en arrivera trois ou quatre. Si vous aviez moyen de faire passer aussi quelques affûts, soit de siége, soit de côte, soit de place, faites-le: il paraît qu'ils en ont besoin.--Envoyez régulièrement, au moins tous les quinze jours, un de vos officiers à Corfou. Que le général César Berthier vous en envoie un des siens aussi tous les quinze jours. Par ce moyen, vous aurez toutes les semaines des nouvelles de Corfou, et cette grande quantité d'officiers, passant et repassant, prendra une connaissance parfaite des localités.--J'approuve fort l'envoi d'un agent à Bérat. Il faut connaître à fond cette route, dont le détail, lieue par lieue, m'intéresserait beaucoup.--Je ne conçois pas ce que vous me dites que la Dalmatie ne peut pas fournir de chevaux; elle en fournissait plusieurs milliers aux Vénitiens.--Tenez un agent près l'évêque des Monténégrins, et tâchez de vous concilier cet homme.--J'ai, je crois, un consul à Scutari; mais il ne m'écrit pas souvent. Exigez qu'il vous écrive tous les jours. Envoyez-moi des renseignements sur les golfes de Durazzo et de la Vallona. Des bricks ou même des frégates peuvent-elles y entrer? Comme vous êtes le maître d'y envoyer des ingénieurs et des marins, envoyez-y; recueillez les renseignements que des gens du pays pourraient vous fournir, et faites-moi passer des croquis et des mémoires qui me fassent bien connaître ce que c'est que ces deux golfes.--Je suppose que, dans le cas où une escadre de douze ou quinze vaisseaux arriverait à Corfou ou à Raguse, les mesures sont prises pour la mettre à l'abri de forces supérieures. Répondez-moi cependant sur cette question.--Je vois avec plaisir que vous n'avez pas de malades.--J'ai ordonné au vice-roi de vous envoyer encore deux mille hommes pour renforcer vos cadres.--Le ministre de la guerre m'a fait connaître que vous demandiez le général Montrichard; il est parti pour prendre service sous vos ordres.»
NAPOLÉON À MARMONT.
«Paris, le 9 février 1808.
«Monsieur le général Marmont, je reçois votre état de situation du 15 janvier. Comment arrive-t-il que vous ne me parlez jamais des Monténégrins? Il ne faut pas avoir le caractère roide; il faut envoyer des agents parmi eux, et vous concilier les meneurs de ces pays.»
NAPOLÉON À MARMONT.
«Paris, le 10 février 1808.
«Monsieur le général Marmont, la conduite que tiennent les Ragusains est inconcevable. Mon consul David a dû vous faire connaître que le prétendu sénat de Raguse avait écrit et envoyé des présents au pacha de Bosnie On m'écrit la même chose de Constantinople. Faites arrêter trois des principaux membres, et faites saisir les registres de ce sénat. Faites-leur bien connaître que le premier qui tiendra une correspondance avec l'étranger sera considéré comme traître et passé par les armes.»
NAPOLÉON À MARMONT.
«Paris, le 18 février 1808.
«Monsieur le général Marmont, je reçois votre lettre du 1er février. J'approuve ce que vous avez fait relativement au sénat de Raguse; mais, ce qui est le mieux, c'est que vous envoyiez en surveillance dix des principaux membres à Venise et à Milan, afin de préserver ces malheureux d'excès qui pourraient les conduire à l'échafaud.»
LE MINISTRE DE LA GUERRE À MARMONT.
«Paris, le 7 mars 1808.
«Général, il a été rendu compte à Sa Majesté que, d'après les ordres que vous aviez donnés, le payeur de la guerre du royaume d'Italie, qui se trouve à l'armée que vous commandez, avait été contraint de prélever, sur les fonds qui lui avaient été faits pour les dépenses de la solde et des masses des troupes italiennes, une somme de quatre cent soixante-treize mille deux cent quatre-vingt-deux francs pour les dépenses de l'artillerie, du génie, des approvisionnements, et dépenses diverses.
«Sa Majesté m'a ordonné de faire connaître à Votre Excellence qu'elle désapprouvait les mesures que vous avez prises dans cette circonstance. Elle m'a chargé de vous prévenir que les fonds pour les travaux de l'artillerie, du génie, et pour les approvisionnements de siége ayant été déterminés par les décrets de S. A. I. le prince vice-roi d'Italie, on ne pouvait, en aucune manière les outre-passer, avant d'avoir pris de nouveaux ordres.
«L'Empereur, qui porte un oeil attentif sur toutes les dépenses de ses armées, a remarqué que celles de l'armée de Dalmatie étaient considérables, et que cette armée coûtait plus qu'une autre qui aurait le double de sa force.
«Sa Majesté veut que l'administration de l'armée que vous commandez, général, soit plus régulière, et qu'en aucune manière il ne soit fait de violation de caisse.
«En transmettant à Votre Excellence les ordres de l'Empereur, je la prie de vouloir bien prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'ils reçoivent leur prompte et entière exécution.
«Je la prie aussi de m'accuser la réception de cette dépêche.»
NAPOLÉON À MARMONT.
«Paris, le 20 mars 1808.
«Monsieur le général Marmont, j'ai vu avec peine ce qui est arrivé à l'île de Lurin-Grande le 24 février. Je conviens que cette île est trop éloignée pour y mettre des Français. Mais pourquoi n'y mettriez-vous pas quatre-vingts ou cent Dalmates qui empêcheraient aux vaisseaux et frégates d'y débarquer et d'insulter les habitants? Il faut que les Français et les Italiens proprement dits soient toujours réunis, mais les Dalmates peuvent être disséminés dans les îles. Envoyez-y des fusils pour armer des gardes nationales qui seconderont les Dalmates, et deux pièces de canon de fer de six, ce qui sera un armement suffisant pour mettre ces îles à l'abri d'une insulte.»
LE PRINCE EUGÈNE À MARMONT.
«Milan, le 28 mars 1808.
«Je vous adresse, monsieur le général Marmont, une lettre que j'ai reçue hier soir, qui m'a été envoyée pour vous. J'ai voulu vous l'adresser par une occasion sûre; j'ai voulu en profiter pour vous faire agréer mes compliments sur la nomination que je présume qu'elle renferme, puisque les lettres que je reçois en même temps de Paris m'annoncent que Sa Majesté vous a nommé duc de Raguse. J'espère que vous me connaissez assez pour être bien persuadé que, parmi tous les compliments que vous recevrez, aucuns ne seront plus sincères que les miens.»
MARMONT À NAPOLÉON.
«Zara, 30 mars 1808.
«Sire, j'ai reçu, il y a deux jours, une lettre du ministre de la guerre, qui m'exprime le mécontentement de Votre Majesté sur diverses dispositions de fonds italiens et sur l'administration de l'armée de Dalmatie. Comme l'objet de tous mes efforts est de remplir les intentions de Votre Majesté et de justifier ses bontés, je suis profondément affligé des reproches qui me sont faits.
«J'ai adressé au ministre un récit pur et simple de l'état des choses, et j'ose dire qu'il fait disparaître jusqu'aux prétextes de la plus légère accusation.
«Éloigné de Votre Majesté depuis près de trois ans, privé du bonheur de faire la guerre, lorsque presque toute l'armée combattait sous vos yeux, je ne trouvais de consolation, dans mon cruel éloignement et ma douloureuse inaction, que dans la pensée où j'étais que je faisais, dans le poste obscur qui m'était assigné, tout ce qui dépendait de moi, pour le meilleur service de Votre Majesté, et rien ne pourrait m'être plus pénible que de perdre l'espoir de la convaincre que toutes mes actions ont tendu uniquement vers ce but.»
MARMONT AU MINISTRE DE LA GUERRE.
«30 mars 1808.
«Je viens de recevoir la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire le 7 mars, et qui m'exprime le mécontentement de Sa Majesté sur les dispositions qui ont été faites sur les fonds italiens.--Je crois que le récit pur et simple doit suffire pour me justifier, et je vous supplie de mettre ma lettre sous les yeux de Sa Majesté.
«Depuis l'entrée des Français en Dalmatie jusqu'au mois de mai, il n'a jamais été donné un sol par le gouvernement italien pour le service de l'artillerie en Dalmatie. Cependant Zara n'avait aucune espèce d'armement, et il a fallu tout faire, tout construire; et, malgré des dépenses considérables, cette place n'a pas encore l'armement convenable. Puisque ce n'est qu'au mois de juin 1807 que les fonds mensuels ont commencé à être faits, il a bien fallu trouver un moyen de payer les travaux qui avaient été exécutés pendant les seize mois précédents.
«Les travaux des fortifications, exécutés antérieurement à mon arrivée, ou postérieurement, dans les forts de Lésina, Sebenico et de Knim, ont été conformes aux dispositions que Sa Majesté avait arrêtées, et dont le directeur du génie avait connaissance. L'exécution de ces travaux a rendu l'armement nécessaire; et, comme l'artillerie n'avait pas de fonds, il a fallu l'en pourvoir. Voilà pour les travaux de l'artillerie en Dalmatie.
«Le 2 août 1806, le prince Eugène m'écrivait une lettre dont voici quelques extraits:
«Sa Majesté me charge de vous écrire que son intention n'est pas qu'on évacue Raguse; que vous devez faire fortifier ses hauteurs.»--Il m'écrivit, le 26 juillet: «L'Empereur me charge de vous écrire qu'il met infiniment d'importance à la position de Stagno; que vous devez ordonner au général Poitevin de tracer un bon fort à cette position, et d'y faire travailler promptement. L'Empereur veut que ce fort coupe la presqu'île de Sabioncello, de manière, etc., etc.; que vous devez faire faire un fort à Santa-Croce, un fort dans l'île de la Croma.»--Il m'écrivit, le 8 septembre: «Sa Majesté me charge de vous écrire de faire travailler nuit et jour aux fortifications de Raguse et de Stagno.»
«Le prince de Neufchâtel m'écrivait, le 8 juillet 1807: «Raguse doit définitivement rester réunie à la Dalmatie; vous devez donc faire continuer les fortifications et les mettre dans le meilleur état.»
«Les intentions de Sa Majesté étaient bien formelles, bien manifestées; et, malgré ma demande et mes sollicitations, il n'a jamais été fait, en l'an 1806, pour les fortifications dans l'État de Raguse, que soixante-dix-sept mille francs, dont six ou sept mille étaient déjà dépensés à mon arrivée, et dix-neuf mille trois cents francs seulement depuis le 1er janvier 1807 jusqu'à ce moment, quoiqu'il fallût plus de trois cent mille francs pour exécuter (quoique d'une manière provisoire), les ordres qui m'étaient donnés.
«J'ai pris possession des places des Bouches. Il fallait armer la côte; il fallait mettre en ordre Cattaro. On n'a fait aucune espèce de fonds pour cet objet, quoi que j'aie pu demander et dire. Cependant les travaux étaient urgents. Il y a peu de jours que Sa Majesté me faisait l'honneur de m'écrire: «Je suppose que dans le cas où une escadre de douze à quinze vaisseaux arriverait à Cattaro ou à Raguse, les mesures sont prises pour la mettre à l'abri de forces supérieures. Répondez-moi cependant sur cette question.»
«J'ai cru devoir, par suite de cette lettre, augmenter les dispositions défensives des rades de Raguse et de Castelnovo, et on les exécute en ce moment. Voilà pour les travaux du génie.
«En résultat, on n'a fait, jusqu'au mois de juin 1807, aucuns fonds pour les travaux de l'artillerie en Dalmatie, et, jusqu'à ce moment, il n'a pas encore été fait pour l'État de Raguse et de l'Albanie le quart des fonds qui étaient nécessaires au génie pour exécuter les travaux d'urgence qui étaient ordonnés d'une manière pressante. Il fallait cependant pourvoir aux dépenses des uns et des autres.
«Pendant la guerre avec les Russes, nos communications étaient entièrement interceptées dans nos canaux. Les troupes ne pouvaient donc suivre que la communication par terre. Or cette communication est rendue difficile par la Narenta et la Cettina, deux rivières fortes et sur lesquelles il n'y avait aucun moyen de passage organisé; il a fallu y faire construire des ponts de bateaux; et sans doute j'aurais été inexcusable si, dans le cas du siége de Raguse, je n'avais pu aller à son secours faute de pouvoir passer ces rivières. L'exemple de la marche du général Molitor ne peut être présenté en opposition avec ce que je dois attendre. Il est arrivé à Spalatro, à Stagno par mer, et il n'aurait jamais pu secourir Raguse si les Russes eussent alors occupé les canaux, comme ils l'ont fait depuis, et dont ils ne sont jamais sortis pendant 1807 jusqu'à la paix.
«À l'égard des approvisionnements de siége, puisqu'on avait fait un bon fort à Lésina, puisqu'on avait mis en très-bon état de défense Stagno, puisqu'on avait fortifié Knim et que je devais être en garde contre l'Autriche, que Lésina pouvait être bloqué, comme il l'a été en effet pendant six mois de suite, il fallait bien y mettre des approvisionnements pour les garnisons qui devaient les défendre.
«À l'égard de ce que Votre Excellence ajoute que Sa Majesté trouve que l'armée de Dalmatie coûte plus qu'une autre qui aurait le double de sa force, je désirerais que Sa Majesté daignât motiver son opinion. J'ai la conscience que, dans aucune armée, il n'y a plus d'ordre que dans celle-ci, parce que je me suis occupé avec soin de surveiller toutes les parties de l'administration; et, à cet égard, je n'ai que des témoignages de satisfaction à donner à l'ordonnateur en chef Aubemon. Si Sa Majesté veut se faire représenter les marchés qui étaient passés avant mon arrivée et ceux qui ont été faits postérieurement, elle s'assurera que l'administration est arrivée progressivement à être plus économique de trente pour cent environ.
«Lorsque je suis arrivé, au mois de juillet 1806, la viande coûtait à l'État trente quatre centimes la ration: elle est aujourd'hui à vingt-deux centimes trois quarts.--De mauvais pain, à la même époque, était à quarante et un centimes la ration, et aujourd'hui d'excellent pain coûte vingt-sept à vingt-huit centimes. Les fournitures extraordinaires sont payées en argent aux corps, sur revues et comme solde, au pris de quinze centimes, fixées par Sa Majesté, et on ne perd jamais une occasion de réduire les prix, quand la chose est possible.
«Les seules dépenses qui ont été un peu fortes ont été les transports par mer, que j'avais cru pouvoir ordonner pour soulager les conscrits venant d'Italie, fatigués, exténués par une route pénible et affaiblis par les longues maladies qu'ils ont éprouvées cet été: cette dépense, à l'avenir, n'aura plus lieu.
«Une autre dépense qui peut paraître considérable, et qui vous a été soumise, est celle qui a rapport aux officiers envoyés à Constantinople, aux officiers et aux courriers envoyés à la grande armée pendant 1807, aux canonniers mis en marche pour Constantinople, aux officiers envoyés dans toute la Turquie pour faire des itinéraires et des reconnaissances; mais cette dépense ne pouvait pas être moindre, et tous ces mouvements ont été précisément ordonnés, et l'état qui a été adressé à Votre Excellence porte l'indication des individus qui ont été chargés de cette mission et des dépenses qu'a occasionnées chacune d'elles.
«Je n'ai jamais eu ni traitement extraordinaire, ni fonds à ma disposition, et l'argent pour ces dépenses n'a pu être pris que purement et simplement dans la caisse de l'armée, au surplus, légitimement, puisque j'y étais autorisé par une lettre du prince de Neufchâtel dont j'ai eu l'honneur de vous envoyer copie.
«Il n'y a eu de violation de caisse, à l'armée de Dalmatie, qu'à la fin de l'été 1806; alors l'administration de l'armée de Dalmatie dépendait de celle d'Italie; on ne faisait aucune espèce de disposition de fonds, ce qui faisait manquer tous les services à la fois et qui jetait partout un désordre épouvantable.
«Depuis quinze ou seize mois que le ministre Dejean fait les fonds directement, tout marche avec ordre et régularité, parce qu'il prévoit tous nos besoins et qu'il y pourvoit.
«Je désire vivement que Sa Majesté se fasse rendre un compte détaillé de l'administration de l'armée de Dalmatie; j'ose croire qu'elle aura lieu d'en être satisfaite; et, si elle daigne remarquer que, par suite de cette bonne administration, elle n'a jamais eu plus de sept cents malades à la fois à l'hôpital, et que la mortalité a été presque nulle, quoique neuf mille hommes aient passé à l'hôpital pendant l'année, elle trouvera que les dispositions ont été bien ordonnées, que la surveillance a été constante, et que nous avons fait la première de toutes les économies, celle des hommes.
«Au surplus, comme le premier but que je me propose, le plus ardent de tous mes désirs, est de suivre précisément les intentions de Sa Majesté, je vous supplie de me dire quelle conduite je dois tenir à l'avenir, lorsque les ordres que je recevrai ne seront pas d'accord avec les moyens d'exécution.»
NAPOLÉON À MARMONT.
«Bayonne, 8 mai 1808.
«Monsieur le général Marmont, la solde de l'armée de Dalmatie est arriérée parce que vous avez distrait quatre cent mille francs de la caisse du payeur pour d'autres dépenses. Cela ne peut marcher ainsi. Le payeur a eu très-grand tort d'avoir obtempéré à vos ordres. Comme c'est le Trésor qui paye ces dépenses, ce service ne peut marcher avec cette irrégularité. Vous n'avez pas le droit, sous aucun prétexte, de forcer la caisse. Vous devez demander des crédits au ministre; s'il ne vous les accorde pas, vous ne devez pas faire ces dépenses.»
NAPOLÉON À MARMONT.
«Bayonne, 16 mai 1808.
«Monsieur le général Marmont, il y a beaucoup de désordres dans l'administration de mon armée de Dalmatie. Vous avez autorisé une violation de caisse de près de quatre cent mille francs. Cependant le crédit mis à votre disposition pour les travaux du génie et de l'artillerie était de quatre cent mille francs. C'est une somme considérable. Comment n'a-t-elle pas suffi? La Dalmatie me coûte immensément; il n'y a aucune régularité, et tout cela met dans les finances un désordre auquel on n'est plus accoutumé. Le payeur est responsable de toutes ces sommes; j'ai ordonné son rappel; il faut se dépêcher d'envoyer tous les papiers qui pourront établir ses comptes. Mais tout cela ne justifie pas la dépense. Vous n'avez pas le droit de disposer d'un sol que le ministre ne l'ait mis à votre disposition. Quand vous avez besoin d'un crédit, il faut le demander.»
MARMONT À NAPOLÉON.
«5 juin 1808.
«Sire, j'ai reçu hier au soir la lettre que Votre Majesté m'a fait l'honneur de m'écrire le 16 mai. J'ai trop souvent éprouvé la bonté de Votre Majesté pour ne pas recourir avec confiance à son indulgence, si le reproche qu'elle fait du désordre à l'administration de l'armée de Dalmatie était fondé; mais, comme je crois être certain que cette administration ne mérite pas de blâme, je supplie Votre Majesté de suspendre son opinion. Elle aura bientôt, pour la fixer, le rapport de M. Firino, qui possède sa confiance. Il a vu avec détail tous nos établissements. Je souscris d'avance au rapport qu'il doit avoir l'honneur de vous adresser. Ce rapport comprendra toutes les branches de l'administration: ainsi il présentera à Votre Majesté le tableau complet de la situation des choses depuis l'entrée des Français en Dalmatie.
«Votre Majesté remarquera qu'à mon arrivée à cette armée tout était désordre, confusion et misère; que l'ordre date seulement des premiers mois de mon commandement; et qu'en réduisant successivement le prix des fournitures faites à l'armée de trente pour cent nous avons toujours marché d'amélioration en amélioration. Je ne m'étendrai pas davantage sur l'administration générale. La diminution d'un tiers du prix des fournitures, la santé et le bien-être des troupes, sont des faits qui parlent assez d'eux-mêmes. Je demanderai seulement à Votre Majesté la permission d'entrer dans quelques détails sur l'emploi des fonds qui, d'abord, auraient été destinés à la solde; et je les distinguerai en fonds français, fonds italiens, et par année.
«Je commencerai d'abord par prier Votre Majesté d'observer qu'il n'y a eu de violation de caisse qu'à mon arrivée à l'armée, c'est-à-dire il y a deux ans. À cette époque, tous les services se trouvaient abandonnés, les hôpitaux encombrés, et l'administrateur de l'armée d'Italie, qui alors était chargé de l'administration de la troupe, n'avait fait aucuns fonds. Il fallait cependant pourvoir à ses besoins: il fallait soigner trois mille cinq cents malades, et assurer la subsistance des troupes.
«L'Empereur acceptera qu'il faut faire vivre la troupe avant de la payer; et, lorsqu'il y a impossibilité de le faire autrement qu'avec de l'argent comptant, lorsque l'on est à six cents lieues de l'autorité, il faut bien pourvoir aux premiers besoins par quelque moyen qu'il soit. Ces violations de caisse se sont élevées, pendant trois mois environ, à la somme de trois cent trente mille francs. Les comptes ont été envoyés au ministre: la dépense est légitime, parce qu'elle a été faite pour l'entretien des troupes, d'après les bases fixées par les règlements.
«Si les fonds n'ont pas été faits d'avance, la faute en est à l'administrateur de l'année d'Italie. Le ministre a eu immédiatement connaissance des dispositions que les circonstances avaient rendues indispensablement nécessaires: c'était à lui à y remédier.
«Postérieurement à cette époque, il n'y a eu aucune violation de caisse, parce que le ministre, qui a pris alors connaissance de nos besoins, a fait régulièrement les fonds convenables.
«Cette somme de trois cent trente mille francs, dont l'emploi irrégulier est au moins le plus légitime possible, forme la plus grande partie du déficit de la caisse française, le reste va être expliqué d'une manière aussi naturelle.
«J'ai reçu à différentes reprises l'ordre de Votre Majesté d'envoyer des officiers en Turquie, ensuite des canonniers, des courriers à Constantinople. À la paix, sous divers prétextes, j'ai dû faire voyager et résider auprès du pacha des officiers pour étudier et connaître le pays. Les ordres devaient être exécutés sans retard, sans délai. Et où prendre les fonds, si ce n'est dans la caisse du payeur? J'aurais été coupable si j'eusse retardé d'un moment l'exécution des ordres de Votre Majesté. Ainsi ses ordres justifient suffisamment la légitimité de la dépense.
«Mais ces dépenses sont régulières, car, lorsque je reçus les premiers ordres de Votre Majesté, j'écrivis au prince de Neufchâtel, alors ministre de la guerre, de mettre à ma disposition les fonds nécessaires pour l'exécution de ces mêmes ordres; il me répondit que je pouvais prendre dans la caisse du payeur les sommes nécessaires, lui en envoyer l'état, et qu'il régulariserait ces dépenses par des fonds spéciaux.--Cette formalité a été rigoureusement remplie; les états des avances mentionnées ont été adressés au ministre, avec l'inventaire des noms des officiers, de leurs destinations, des sommes qu'ils ont reçues, etc., etc. Le ministre possède tous ces documents, mais n'a pas fait de fonds; je ne saurais être coupable de cette omission. C'est sur la copie de la lettre du ministre que le payeur a fait les avances, et ce titre semblait devoir être réputable pour lui. S'il n'y eût pas déféré, aucun des ordres de Votre Majesté n'aurait pu être exécuté. Ces dépenses ont été faites pendant l'année 1807.
«À la paix de Tilsitt, j'ai dû prendre possession des bouches de Cattaro. Les Russes avaient fait travailler à Castelnovo. J'ai trouvé cette place en bon état de défense, et nous n'y avons rien fait. Mais ils avaient abandonné Cattaro, et il y avait quelques travaux, quoique peu chers, mais urgents à exécuter; j'ai fait avancer quelque argent pour cet objet sur les fonds qu'il était probable que le génie recevrait pour cette place. J'ai fait des demandes, on n'y a pas fait droit, et la caisse française se trouve à découvert à cette occasion de quelque argent.
«Pendant les mois qui viennent de s'écouler, Votre Majesté m'a donné successivement divers ordres que j'ai exécutés ponctuellement, leur exécution était pressante, et pour lesquels il n'a été fait aucuns fonds. Ainsi, par exemple, j'ai reçu l'ordre d'envoyer par terre de la poudre à Corfou; les dix milliers que j'ai fait transporter ont coûté dix-huit mille francs, somme énorme, sans doute, mais nécessaire, parce que telle est la nature des choses. L'officier qui a conduit ce convoi a eu des difficultés inouïes à surmonter, et il a fallu une patience, un courage et une persévérance dignes des plus grands éloges pour qu'il pût réussir dans sa mission, malgré l'argent qu'il a dépensé. J'ai envoyé de la poudre par lui, il a fallu fréter un bâtiment; cependant, si j'eusse différé et que Corfou eût été attaqué, quels reproches n'eussé-je pas mérités! Et où prendre l'argent nécessaire si ce n'est dans le trésor de l'armée?
«Votre Majesté m'a écrit qu'il était possible qu'une armée nouvelle vînt, soit aux Bouches, soit à Raguse, et que sans doute elle y trouverait sûreté et protection. Jusqu'ici nous avions eu seulement dans nos travaux la défense des terres. La situation des choses changeant, il a fallu de nouvelles batteries et de l'argent pour les construire. Les localités ne sont pas telles ici, qu'on puisse remettre aux derniers jours à exécuter de semblables travaux, attendu que, quelque moyen qu'on emploie, il faut du temps, vu l'escarpement des rochers; et quels regrets n'eussé-je pas éprouvés si, faute de prévoyance, j'eusse compromis le sort d'une de nos flottes! Les dépenses de ces batteries ont été réduites autant que possible; mais le génie, n'ayant point de fonds, la caisse française en a fait l'avance.
«En exécution des ordres du ministre, de donner aux Russes tous les secours qu'ils demanderaient, j'ai fait donner quelque argent à plusieurs reprises à un officier russe, qui commande deux bâtiments de guerre stationnés dans les Bouches, depuis huit mois, et imputé sur la solde de son emploi. Agissant ainsi, j'ai cru suivre les intentions de Votre Majesté; et le ministre, qui me les avait notifiées, n'a fait aucuns fonds, ni pour faire face à cette dépense lorsqu'elle pourrait avoir lieu, ni pour la rembourser, quoiqu'il fût instruit qu'elle ait été faite!
«Quoique je n'aie pas, en ce moment, entre les mains les documents qui peuvent me donner les moyens de fournir à Votre Majesté un état détaillé des fonds, je puis assurer que l'exposé ci-dessus est exact.
«Sire, il en résulte qu'en 1806 les violations de caisse ont été nécessitées par le besoin de faire vivre l'armée et d'entretenir les hôpitaux, attendu qu'il n'avait pas été fait des fonds convenables pour ces services;
«Qu'en l'an 1807 et 1808 il n'a pas été donné un sol irrégulièrement par l'administration de l'armée, et que les dépenses ont été toujours en diminuant jusqu'à environ trente pour cent;
«Qu'en l'an 1807 il a été fait une avance d'environ cent cinquante mille francs pour des dispositions qui m'ont été spécialement ordonnées, et cela en vertu d'une autorisation du ministre, et que les comptes lui en ont été rendus à différentes époques; qu'il a été avancé une faible somme pour les travaux urgents de Cattaro;
«Enfin qu'en l'an 1808 il a été avancé l'argent nécessaire pour le transport des munitions à Corfou, qui m'avait été ordonné, ainsi que l'établissement d'une bonne défense maritime à Raguse et aux Bouches.
«Quant aux fonds italiens, voici à quelle occasion ils ont été employés.
«Lors du commencement de la guerre avec la Prusse, j'ai reçu l'ordre de faire travailler jour et nuit, de fortifier Raguse de manière à la mettre à l'abri d'attaque. Malgré cela, il ne fut fait pour cette place que soixante-dix et quelques mille francs, lorsqu'il en fallait le triple pour établir une défense provisoire. Cependant les circonstances étaient pressantes; la situation de l'Autriche était équivoque; la guerre pouvait éclater avec cette puissance; et, forcé de rester en Dalmatie, je pouvais me trouver dans l'impossibilité d'aller promptement au secours de Raguse, qui pouvait être attaquée par les Russes et par l'expédition de M. de Bellegarde.--Il fallait donc donner à Raguse tous les moyens qui dépendaient de moi pour résister le plus longtemps possible. Mes demandes d'argent étaient infructueuses à Milan. Devais-je donc, seul, isolé, hésiter à donner des secours pour ces travaux lorsqu'il s'agissait de la conservation d'une place à laquelle Votre Majesté attache de l'importance; lorsqu'il s'agissait de plus encore, de l'honneur des troupes françaises?
«Les mêmes motifs qui m'ont fait donner de l'argent pour les travaux du génie à Raguse m'en ont fait donner pour les travaux en Dalmatie. Je ne sais par quelle raison on lui a si longtemps refusé tout secours. Depuis l'entrée des Français jusqu'au mois de juin 1807, c'est-à-dire pendant quinze mois, quelque chose que j'aie écrit, il n'a pas été accordé un sol pour ces travaux dans cette province.
«Je supplie Votre Majesté de considérer ce que je devais faire lorsque les événements pouvaient me réduire à défendre Zara. Fallait-il laisser cette place désarmée? Fallait-il, par une coupable insouciance, trahir mes devoirs envers Votre Majesté, envers l'armée, et être moi-même l'artisan de son déshonneur? Si les trésors italiens ou français n'eussent pu y parvenir, je n'aurais pas hésité à engager tout ce que je possède pour satisfaire au besoin des circonstances et du moment, sûr de la justice et des bontés de Votre Majesté envers ceux qui la servent avec dévouement.
«Sire, l'amour de mes devoirs est la passion qui m'anime dans tous les instants de ma vie; et votre satisfaction de ma conduite est la plus douce récompense que je conçoive et que j'ambitionne. Mon malheur serait à son comble si mes efforts constants n'aboutissaient plus à ce but. Puisque telle est votre volonté, sire, à l'avenir, quels que soient les événements, je m'abstiendrai de faire aucune disposition de fonds qui contrarie celles du trésor public; et, si Votre Majesté trouve convenable de me donner des ordres dont l'exécution exige des dépenses, je la supplie d'ordonner en même temps que les moyens soient mis à ma disposition, soit par des fonds généraux, soit par des fonds spéciaux.»
LE MINISTRE DE LA GUERRE À MARMONT.
«Paris, le 26 septembre 1808.
«Général, j'ai mis sous les yeux de Sa Majesté les détails qui m'ont été adressés par Votre Excellence relativement à l'emploi des fonds qui avaient été tirés de la caisse du payeur des troupes italiennes pour acquitter les dépenses du génie et de l'artillerie de l'armée que vous commandez.
«Sa Majesté a reconnu que les travaux relatifs au service du génie résultaient des ordres qu'elle a effectivement donnés à Votre Excellence, et qu'ils avaient été commandés par les besoins impérieux de l'armée. Elle a également reconnu que les dépenses que ces travaux ont occasionnées concernaient le royaume d'Italie. En conséquence, elle a ordonné que les dépenses dont il s'agit resteraient à la charge de l'Italie.
«J'ai fait part des intentions de l'Empereur à Son Altesse Impériale le vice-roi, et tout paraît réglé à l'égard de ces dernières dépenses.
«Il ne reste plus, en ce qui a rapport à mon ministère, que les avances pour les dépenses extraordinaires qui ont déjà été faites et les fonds particuliers que Votre Excellence a réclamés pour les dépenses qui pourront être nécessaires à l'avenir.
«L'Empereur, auquel j'en ai rendu compte, ne m'a point encore fait connaître ses intentions.
«Aussitôt que j'aurai reçu la décision de Sa Majesté, je m'empresserai de la communiquer à Votre Excellence.»
NAPOLÉON À MARMONT.
«Saint-Cloud, le 20 octobre 1808.
«Monsieur le général Marmont, indépendamment du compte que vous me rendez, il est nécessaire que vous correspondiez directement avec le ministre de la guerre et que vous lui rendiez compte de toutes les affaires, non par le canal de votre chef d'état-major, mais directement. Dans cette disposition sont compris les rois d'Espagne et de Naples et le vice-roi d'Italie, comme commandant mes armées.»
LE MINISTRE DE LA GUERRE À MARMONT.
«Paris, le 21 octobre 1808.
«Monsieur le duc, c'est par ordre exprès de Sa Majesté Impériale que j'ai l'honneur de prévenir Votre Excellence des intentions de l'Empereur concernant les rapports qui doivent exister dorénavant entre les commandants en chef de ses armées et le ministre de la guerre. Sa Majesté a décidé que Votre Excellence, en qualité de commandant en chef de l'armée de Dalmatie, m'écrirait à l'avenir directement, et non par le canal du chef de l'état-major, pour tous les objets relatifs au service; ce qui n'empêchera point l'état-major de me donner également toutes les explications nécessaires sur les détails et de m'envoyer des rapports comme à l'ordinaire. Sa Majesté me charge, à cette occasion, de faire connaître à Votre Excellence que sa responsabilité ne peut être à couvert qu'autant qu'elle m'aura écrit en ma qualité de ministre de la guerre. L'Empereur ajoute à cette occasion que, quoi que Votre Excellence puisse lui écrire directement, cette responsabilité ne serait point couverte par là, tellement que, dans aucun cas, Votre Excellence ne peut se dispenser d'écrire au ministre, même en écrivant à l'Empereur.
«Ces nouvelles dispositions, qui rendront mes relations avec Votre Excellence plus particulières et plus fréquentes, seront, par cela même, d'autant plus agréables pour moi, et je mettrai toujours de l'empressement à lui en donner des preuves. Je me plais à croire que Votre Excellence voudra bien les envisager de la même manière et apporter aussi, dans nos communications, la confiance qui peut les rendre utiles au bien du service et satisfaisantes pour chacun de nous.»
MARMONT À NAPOLÉON.
«3 janvier 1809.
«Sire, accusé dans mes intentions, traduit devant l'opinion publique dans le journal officiel de Milan, j'ose en appeler à Votre Majesté, et je la supplie de me permettre de lui présenter un narré fidèle des faits.
«Il y a deux ans et demi, Sire, que je suis en Dalmatie, et j'ai eu le temps d'étudier et de connaître les moeurs et le caractère de ses habitants. Il ne m'a pas fallu longtemps pour voir la grande influence dont jouissent les moines franciscains, leur grande autorité et l'importance dont ils sont. Ils desservent la moitié des paroisses de la province, ils sont instruits, tandis que les prêtres séculiers sont d'une ignorance absolue. Le peuple les aime, les estime, et ils méritent ces sentiments par leur conduite envers lui.--Enfin il m'a paru démontré qu'ayant les moines dans vos intérêts, le peuple de la province vous serait toujours fidèle, quelque circonstance qui survînt, et que, au contraire, si les moines avaient une opinion différente et que vous eussiez la guerre avec l'Autriche, la population se soulèverait, et, au lieu de nous donner les secours que nous avons droit d'attendre d'elle, nous causerait beaucoup d'embarras.
«Cette double considération aurait suffi pour me faire traiter avec égards et un soin tout particulier l'ordre des Franciscains, mais elle n'est pas la seule qui m'ait dirigé: tous les chrétiens catholiques de la Bosnie sont desservis par deux couvents de cet ordre; une grande partie de ceux de l'Albanie l'est par des moines semblables, et ils correspondent tous entre eux. Si l'ordre de Saint-François est content en Dalmatie et qu'il soit traité avec égards et soins par la première autorité, celle surtout qui peut avoir action dans les provinces turques limitrophes, les moines de Bosnie et d'Albanie sont alors dans l'espoir d'un heureux avenir; ils vous sont dévoués, et dès lors les chrétiens sont à votre disposition absolue, chose, qu'il ne faut pas se dissimuler, qui n'existerait pas sans cela, attendu que l'Autriche, depuis longtemps, a jeté de profondes racines parmi eux. Enfin les moines franciscains de la Dalmatie me paraissent, pour le moment, le meilleur moyen et le plus sûr pour obtenir de la province tout ce qu'elle doit à son souverain, spécialement sous le rapport de la conscription, pour former une opinion favorable et établir des relations utiles dans toutes les provinces limitrophes de la Turquie.
«D'après ces observations, j'ai cru qu'il était de mon devoir de chercher à faire revenir les moines de l'opinion qu'ils avaient conçue de nous, et j'y suis parvenu. Ces moines sont, je crois, aujourd'hui, par suite de mes démarches, tels que les intérêts de Votre Majesté le commandent; ceux d'une des deux provinces religieuses qui les composent m'ont prié d'être leur protecteur, c'est-à-dire leur patron et leur intercesseur auprès du gouvernement; c'est un usage établi ici de temps immémorial et constamment suivi chez eux, comme chez tous les autres moines, que de s'en choisir ainsi.--C'est un usage qui existe également aujourd'hui encore à Venise et dans presque toutes les villes d'Italie, ainsi que Votre Majesté pourra s'en convaincre en jetant les yeux sur la note ci-jointe, faite de mémoire par des Italiens dignes de foi, pour ce qui regarde l'Italie, et sur mes propres recherches, faites il y a longtemps, pour ce qui concerne la Dalmatie.
«Cependant il paraît que ce témoignage de respect des moines franciscains en Dalmatie a blessé le prince vice-roi; s'il blâme la chose en soi, elle ne devrait plus subsister dans aucune des villes d'Italie et de Dalmatie; s'il ne la blâme qu'en moi, j'ignore à quel titre; car je ne suis pas dans une catégorie particulière. Il semble qu'on voudrait accuser mes intentions lorsque le premier acte que j'ai fait a été de donner à chacun des couvents le portrait de Votre Majesté. On semble m'accuser de sortir de ma place lorsque précisément, il y a quinze jours, ayant découvert par hasard que, selon l'ancien rituel en usage à Venise, on comprenait mon nom dans les prières publiques de toutes les églises de la province, comme commandant de l'armée, j'ai fait écrire circulairement pour le défendre, en motivant cette disposition sur l'inconvenance qu'il y a de prononcer jamais le nom d'un sujet avec celui de son souverain. Enfin, Sire, c'est un homme qui vous porte un attachement et un dévouement sans bornes depuis quinze ans, et qui donnerait jusqu'à la dernière goutte de son sang pour votre personne, qu'on suppose vouloir vous manquer de respect. Sire, si j'étais dans l'erreur, peut-être la pureté de mon coeur et de mes sentiments mériterait-elle quelque ménagement, et peut-être aussi alors vous seul, Sire, devriez-vous être juge si les inconvénients d'une leçon publique donnée à un de vos premiers fonctionnaires, leçon qui doit diminuer la considération dont il jouit, et l'influence qu'il n'emploie que pour voire service, sont balancés par les avantages qu'elle promet.
«J'ai eu toujours, Sire, pour le prince Eugène le respect que je dois à votre auguste famille; je me suis étudié à lui plaire, et je ne puis découvrir ce qui peut lui avoir inspiré des sentiments si peu bienveillants pour moi. Puisqu'ils sont tels, je me tairai envers lui, afin de ne pas les aigrir. Je laisserai mettre dans le Rigio dalmate la rétractation qu'il a ordonnée, afin de ne pas établir une lutte scandaleuse. Mais c'est à Votre Majesté, toujours juste dispensatrice de l'éloge et du blâme, et qui fixe l'opinion du monde, c'est à ses pieds que j'apporte mes réclamations avec respect et soumission.»
LE PRINCE EUGÈNE À MARMONT.
«Milan, le 27 janvier 1809.
«Je m'empresse de vous annoncer, monsieur le général Marmont, que les affaires d'Espagne sont terminées. Sa Majesté va se rendre bientôt à Paris, et sa garde, ainsi qu'une partie de ses troupes, rétrogradent déjà en ce moment. Je vous envoie les derniers journaux et les bulletins.
«L'Empereur m'écrit de son quartier général de Valladolid, en date du 14 janvier, et me charge de vous envoyer les instructions suivantes:
«La maison d'Autriche fait des mouvements. Le parti de l'impératrice paraît vouloir la guerre; nous sommes toujours au mieux avec la Russie, qui, probablement, ferait cause commune avec nous.
«Si les Autrichiens portaient des forces considérables entre l'Isonzo et la Dalmatie, l'intention de Sa Majesté est que son armée de Dalmatie soit disposée de la manière suivante:
«Le quartier général à Zara avec toute l'artillerie de campagne. Les 8e et 18e d'infanterie légère, les 5e et 11e de ligne pour la première division; les 23e, 60e, 79e, 81e pour la deuxième division, formant, avec les escadrons de cavalerie, l'artillerie et les sapeurs, un total de dix-sept mille hommes.
«Les dispositions pour le reste de la Dalmatie et de l'Albanie seront les suivantes:
«Tous les hôpitaux, que l'armée peut avoir, concentrés à Zara. On laisserait à Cattaro deux officiers du génie, une escouade de quinze sapeurs, une compagnie d'artillerie italienne, une compagnie d'artillerie française, le premier bataillon du 3e léger italien, qui va être porté à huit cent quarante hommes par les renforts qu'on va lui envoyer par mer, et les chasseurs d'Orient, ce qui fait environ douze cents hommes. Un général de brigade commandera à Cattaro. Il devra former un bataillon de Bocquais des plus fidèles pour aider à la défense du pays.
«On laisserait à Raguse un général de brigade, une compagnie d'artillerie française, une compagnie d'artillerie italienne, un bataillon français, le quatrième bataillon du régiment dalmate, deux officiers de génie, et une escouade de quinze sapeurs, ce qui fera à Raguse un total de quatorze à quinze cents hommes.
«Il suffira de laisser à Castelnovo deux cents hommes pour la défense du fort. Il faut s'occuper avec soin d'approvisionner ce fort, Cattaro et Raguse pour six ou huit mois de vivres. Il faudra y réunir également les poudres, boulets et munitions en quantité suffisante pour la défense de ces places pendant le même temps.
«Avec le reste de votre armée, c'est-à-dire avec plus de seize mille hommes, vous prendrez position sur la frontière pour obliger les Autrichiens à vous opposer d'égales forces, et vous manoeuvrerez de manière à opérer votre jonction avec l'armée d'Italie.
«En cas d'échec, vous vous retirerez sur le camp retranché de Zara, derrière lequel vous devez pouvoir tenir un an. Il faut donc, à cet effet, réunir dans cette place une quantité considérable de biscuit, farines, bois, etc., et la munir de poudres, boulets, et tout ce qui sera nécessaire à sa défense.
«Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans celui de l'offensive, vous devriez laisser à Zara une compagnie de chacun de vos régiments, composée des hommes malingres et éclopés, mais commandés par de bons officiers; vous laisseriez en outre un régiment pour la garnison de Zara, et, avec le reste, vous prendriez part aux opérations de la campagne. Bien entendu que ce régiment assisterait aux batailles qui seraient données avant la jonction, laquelle une fois opérée, ce régiment rétrograderait pour venir assurer la défense de Zara et de la province.
«Vous laisseriez dès le commencement, à Zara, trois compagnies d'artillerie, un officier supérieur avec quatre officiers du génie, et une compagnie de sapeurs. L'officier général qui resterait en Dalmatie doit organiser, de son côté, un bataillon composé de gens du pays les plus fidèles. L'instruction à donner aux commandants de Zara, Cattaro et de Raguse doit être de défendre le pays autant que possible, mais de se restreindre à la défense des places du moment qu'il y aurait un débarquement et que l'ennemi se présenterait trop en forces. Si les bouches de Cattaro, Raguse et Zara étaient bloquées, ils devraient correspondre avec Ancône et Venise par mer, et ils pourraient être assurés qu'avant huit mois ils seraient dégagés. Il est donc indispensable de munir ces places de poudres, boulets, biscuits, farines et autres approvisionnements. L'intention de Sa Majesté est que les troupes ne soient pas disséminées: elles ne doivent occuper que la pointe de Cattaro, Castelnovo, Raguse et Zara. Dans le cas où l'armée de Dalmatie se porterait en Allemagne, il faut préparer des mines pour faire sauter les châteaux fermés qu'il peut y avoir dans le pays, et qui donneraient de la peine à reprendre quand l'armée rentrera. Les gardes nationales seront suffisantes pour garder la côte pendant tout le temps que l'armée marchera contre l'ennemi, dont les forces, occupées ailleurs, ne pourront d'ailleurs rien tenter de ce côté.
«Ceci est une instruction générale qui doit servir dans tous les temps, quand vous ne recevriez point d'ordre toutes les fois que les courriers seraient interceptés, et que vous verriez les Autrichiens se mettre en hostilité, chose cependant qu'on a peine à croire. Sa Majesté a vu, par vos derniers états, qu'il y a à Raguse et Cattaro quatorze mille quintaux de blé, ce qui fait des vivres pour quatre mille hommes pendant plus d'un an. Cet approvisionnement est suffisant. Celui de Spalatro et de Sebenico serait porté sur Zara, ce qui ferait cinq mille quintaux à Zara, c'est-à-dire pour cinq mille hommes pendant cent jours, plus le biscuit, qui rendrait cet approvisionnement suffisant; mais il faut avoir soin que ce blé soit converti en farine, afin de n'éprouver aucun embarras ni obstacle dans les derniers moments. À tout événement, ce serait une bonne opération de réunir à Zara dix mille quintaux de blé, en faisant en sorte cependant que les fournisseurs soient chargés de la conservation, et que cela ne se garde pas.»
(Par duplicata.)
LE PRINCE EUGÈNE À MARMONT.
«Milan, le 8 mars 1809.
«Je vous adresse ci-joint un extrait d'un rapport, en vous priant de prendre des renseignements sur son contenu. Sa Majesté désire également que vous fassiez reconnaître les frontières de la Croatie et la position qu'il faudrait prendre pour tenir en échec le plus grand nombre de forces possible, et si peut-être le travail de quelques fortifications sur la ligne des frontières ne serait pas utile. Sa Majesté me charge expressément de vous dire que l'armée de Dalmatie est destinée à contenir une force autrichienne un tiers plus forte qu'elle, et que, si vous restiez inactif sur Zara, vous seriez nul pour l'armée d'Italie.
«Les dernières nouvelles annoncent l'arrivée de onze nouveaux régiments à Laybach, Klagenfurth, Villach; il y a de grands magasins sur l'Isonzo: tout est à la guerre. Ils paraissent vouloir prendre l'offensive et se diriger particulièrement sur l'Italie et le Tyrol. Prenez donc vos mesures pour obliger là une diversion et tenir en échec le plus de monde possible.»
LE PRINCE EUGÈNE À MARMONT
«Milan, le 14 mars 1809.
«Par mes précédentes, monsieur le général Marmont, je vous ai envoyé les instructions de Sa Majesté et je vous ai fait connaître ses intentions; je vous ai également prévenu que tout était à la guerre et que les Autrichiens faisaient de grands mouvements de troupes. Aujourd'hui, je m'empresse de vous prévenir que Sa Majesté a terminé tous ses préparatifs en Allemagne; tout est également bien disposé en Italie, et, le 20 mars, les armées de Sa Majesté seront en présence sur tous les points: cependant Sa Majesté n'a pas l'intention d'attaquer. Sa Majesté me charge de vous faire connaître que vous devez vous porter sur les frontières de la Croatie et y choisir et tracer même un camp retranché, afin de tenir en échec une force au moins égale à la vôtre. Il est probable que vous aurez déjà réuni vos troupes disponibles. Je vous dirai que la Russie est franchement avec nous. Les Autrichiens avaient compté sur l'alliance de cette puissance, ou au moins sur sa neutralité; ils s'aperçoivent un peu tard de leur erreur. Je vous préviens que j'ai l'ordre de Sa Majesté de garder ici tous les officiers qui devaient rejoindre la Dalmatie: le général Vignolle est compris dans cet ordre. J'attends avec impatience de vos nouvelles, et l'avis des dispositions que vous aurez prises.»
LE PRINCE EUGÈNE À MARMONT.
«Milan, le 20 mars 1809.
«Toutes les nouvelles que je reçois portent que les Autrichiens se réunissent à Laybach et Klagenfurth; les troupes croates et la Licca sont en mouvement. On y dit qu'il y a un rassemblement à Bihatsch et à Novi sur Lunna. J'attends toujours de vos nouvelles. Vous me parlez sans doute de cette dernière réunion. Vous avez sans doute fait en ce moment toutes vos dispositions et effectué la réunion de vos troupes. En conséquence, vous prendrez de suite position sur la frontière autrichienne, de manière à la menacer au moindre événement, et, comme je vous le marquais dans ma lettre du 14, vous pouvez faire travailler à quelques redoutes pour former un camp retranché: il est essentiel d'assurer toujours votre communication avec Zara. La guerre ne peut tarder à être déclarée; vous devez vous attendre à recevoir aussitôt l'ordre d'envahir tout le pays et de marcher à la rencontre des Autrichiens, à moins qu'ils n'aient devant vous un corps plus considérable que le vôtre. Tenez-vous donc prêt au premier signal, et tenez-moi exactement informé de vos dispositions comme de tout ce qui se passe en face de vous.»
LE PRINCE EUGÈNE À MARMONT.
«Trévise, le 18 avril 1809.
«Vous avez sans doute reçu, monsieur le général Marmont, ma lettre du 10, par laquelle je vous prévenais des hostilités.
«L'armée d'Italie était sur les deux rives de l'Adige et peu de force dans le Frioul. J'ai été obligé de faire retirer le corps du Frioul et de faire avancer des divisions pour soutenir le mouvement, qui a été fort bien jusqu'à Sacile, où j'avais la ligne de la Livensa. L'ennemi, étant très en force à Pordenone, et le général Chasteler, avec une armée, ayant pénétré dans le Tyrol et marchant sur Trente, j'ai été obligé de livrer bataille le 16 avril pour au moins l'arrêter sur ce point: le résultat n'a pas été à mon avantage. Je me suis replié en arrière de la Piave, sans cependant être inquiété par l'ennemi. Le temps affreux qu'il fait depuis quelques jours est ce qui me contrarie le plus. Je suis, la journée du 18, à Trévise, avec mes postes sur la Piave.
«Une partie de l'armée se porte dans le Tyrol, au-devant de l'ennemi.
«J'ai cru devoir vous prévenir de ce qui se passe à l'armée d'Italie, pour votre direction.»
LE PRINCE EUGÈNE À MARMONT.
«Ébersdorf, 1er mai 1809.
«Il est essentiel que vous m'écriviez tous les jours, afin que je sois exactement informé de tout ce qui se passe autour de vous. Vous recevrez successivement les troisième et quatrième bataillons des régiments qui composent votre armée; vous vous occuperez de leur amalgame au fur et à mesure de leur arrivée.
«Vous avez reçu, j'espère, tous les bulletins de la grande armée. L'Empereur, après avoir surmonté toutes les difficultés que les hautes eaux du Danube avaient fait naître, a enfin établi le grand pont. Tout fait présumer qu'il se passera bientôt des événements importants. L'armée d'Italie a, comme vous l'avez vu par l'ordre du jour de l'Empereur, heureusement établi sa jonction, et, à l'exception de deux divisions d'infanterie et une de cavalerie, qui sont à Gratz sous les ordres du général Macdonald, tout le reste est concentré à Neustadt.»
LE PRINCE EUGÈNE À MARMONT.
«Vicence, 3 mai 1809.
«Je vous ai fait connaître, ces jours derniers, monsieur le général duc de Raguse, les heureux et brillants événements de la grande armée. L'armée d'Italie a repris l'offensive et l'armée autrichienne est forcée à la retraite. Depuis deux jours elle fuit. Il est instant que celle de Dalmatie commence son mouvement et que ses efforts contribuent à la défaite totale des ennemis. Vous voudrez donc bien les attaquer et les pousser avec la plus grande vigueur, au reçu de cette lettre. Nos avant-postes sont sur la Brenta. Je marcherai au moins par journée d'étape; et, si nos mouvements peuvent s'accorder, comme je n'en doute pas, l'armée autrichienne peut être entièrement détruite; mais il n'y a pas un instant à perdre, et je crains les retards que la mer pourra mettre dans la transmission de cette lettre. J'espère que l'armée de Dalmatie pourra recueillir la portion de gloire à laquelle elle a droit de prétendre.»
LE PRINCE EUGÈNE À MARMONT
«Conegliano, 9 mai 1809.
«Je m'empresse, monsieur le général duc de Raguse, de vous prévenir que l'armée a effectué hier de vive force le passage de la Piave, où elle était arrivée le 6 au soir. Cette opération, exécutée sous le feu de l'ennemi qu'il a fallu combattre depuis le point du jour jusqu'à la nuit, a mis son armée dans le plus grand désordre, et je le fais poursuivre avec la plus grande vigueur. Deux généraux prisonniers, trois tués, seize pièces d'artillerie, des pontons, beaucoup de prisonniers, sont les fruits de cette journée.
«Je pense que cette lettre ne vous trouvera plus en Dalmatie et que vous aurez commencé votre mouvement; j'espère que nous ne tarderons pas à nous donner la main. L'Empereur a dépassé Braunau et marche droit sur Vienne. Il était le 1er mai à Braunau.»
MARMONT AU PRINCE EUGÈNE.
«Fiume, 28 mai 1809.
«Monseigneur, je ne perds pas un instant pour avoir l'honneur de rendre compte à Votre Altesse Impériale que j'arrive en ce moment à Fiume avec mon avant-garde. L'armée y sera réunie demain. Comme elle est extrêmement fatiguée, elle y séjournera après-demain, et le jour suivant je me rendrai à Lippa. Je vous demande de me faire connaître vos intentions. Je demande également à Votre Altesse Impériale de donner des ordres pour qu'il me soit envoyé sur les points qu'elle jugera convenable de l'artillerie, des munitions d'infanterie attelées, et la cavalerie qu'elle me destine. Je n'ai ici que six pièces de campagne dont les munitions sont toutes épuisées, et le peu de cartouches d'infanterie qui me reste est porté par des chevaux de bât qui ne peuvent plus suivre. Quant à la cavalerie, il me reste environ 100 chevaux qui pouvaient servir en Dalmatie et en Croatie, mais qui ne peuvent plus compter sur le théâtre sur lequel je vais entrer.
«J'espère que Votre Altesse Impériale a reçu la lettre que j'ai eu l'honneur de lui écrire de Gradchatz, par laquelle je l'instruisais du début de notre campagne, de la défaite des Croates au mont Kitta, de la prise du général Stoisevich, commandant en chef, et de l'affaire de Gradchatz.
«Depuis, l'ennemi, ayant rassemblé les troupes qui n'avaient pas donné, reçut des renforts de deux bataillons du Bannat, d'un bataillon hongrois, et, ayant ordonné à tous les paysans de la Licca de se réunir à l'armée, livra bataille à Gospich avec des forces presque doubles des nôtres. Beaucoup de circonstances rendaient sa position extrêmement avantageuse et la nôtre très-critique; l'affaire a été fort longue, fort chaude et très-meurtrière, mais très-glorieuse pour l'armée.
«L'ennemi a été battu sur tous les points et a perdu, de son aveu, plus de deux mille hommes tués, pris, blessés ou noyés dans la Licca. Le lendemain, l'ennemi étant tourné fit ses dispositions de retraite. Il l'aurait effectuée avec beaucoup de pertes si le nombre de nos blessés et le défilé que nous avions à passer nous avaient permis de marcher avec plus de vitesse. Il s'engagea cependant un combat dans la soirée du 22, où il fut battu et poursuivi. Dans la nuit il disparut.
«Le lendemain, nous entrâmes à Gospich, où je déposai les blessés qui ne pouvaient être transportés que sur des brancards. Le 24, nous sommes partis de Gospich, et depuis nous n'avons rencontré l'ennemi qu'à Ottochatz, où ses bagages et son artillerie auraient été entièrement pris, et son arrière-garde détruite, si le général Montrichard, par une lenteur inouïe, ne s'était pas trouvé à trois heures en arrière. Cependant l'ennemi a éprouvé dans cette affaire une très-grande perte et a été poursuivi avec vigueur.
«De là, l'ennemi a pris la route de Carlstadt, et nous celle de Fiume, où nous sommes arrivés. Les trois généraux de brigade employés à l'armée ont été blessés. Le général Delzons seul pourra reprendre du service sous peu. Les deux autres ont été blessés très-gravement. Je demande avec instance à Votre Altesse Impériale de me donner des généraux de brigade, si elle en a de disponibles.
«L'ennemi a eu dans cette campagne plus de six mille hommes hors de combat, son général pris et trois pièces de canon. Excepté un léger repos à Gradchatz, nécessaire pour attendre l'artillerie, nous avons, depuis notre entrée en campagne, combattu ou marché tous les jours, pendant douze ou quatorze heures; enfin nous arrivons prêts à entrer en ligne et nous sommes au comble de nos voeux.
«J'aurai l'honneur d'adresser, sous deux jours, à Votre Altesse Impériale un complet détail de mes opérations.»
MARMONT À NAPOLÉON.
«Fiume, 29 mai 1809.
«Sire, j'ai eu l'honneur de rendre compte à Votre Majesté de l'entrée en campagne de votre armée de Dalmatie, de la défaite de l'armée ennemie au mont Kitta, de la prise du général Stoisevich, commandant en chef, et du combat de Gradchatz.
«Je dois maintenant à Votre Majesté le rapport des opérations qui ont suivi.
«L'artillerie et les vivres que j'attendais de Dalmatie m'ayant joint le 19, je me mis en marche le 20 pour Gospich. Le 21, de bonne heure, j'arrivai à la vue de Gospich. L'ennemi y était renforcé des colonnes d'Abrovats et d'Évenik, qui étaient fortes de trois à quatre mille hommes, et qui ne s'étaient pas encore battues. Il avait reçu de plus deux régiments du Bannat, et avait fait réunir toute la population en armes. Ses forces étaient doubles des nôtres.
«La position de l'ennemi était belle. Gospich est situé à la réunion de quatre rivières, de manière que, de quelque côté que l'on se présente, il est nécessaire d'en passer deux. Ces rivières sont très-encaissées; on ne peut les passer que vis-à-vis les chaussées, et, dans cette saison, une seule d'elles est guéable. Je me décidai à ne pas attaquer de front Gospich, mais à tourner sa position, de manière à menacer la retraite de l'ennemi.--Pour atteindre ce but, il fallait passer une des rivières à la portée du canon des batteries ennemies, établies de l'autre côté de la Licca, ou traverser des montagnes de pierres extrêmement âpres et difficiles, où les Croates auraient pu résister avec avantage. L'ennemi occupant la rive opposée de cette rivière, il fallait l'en chasser, afin de pouvoir rétablir le pont qu'il avait coupé. Deux compagnies de voltigeurs du 8e régiment, commandées par le capitaine Bourillon, ayant passé ce gué, remplirent cet objet, attendu que l'ennemi, comptant sur sa position, était peu en force. Elles occupèrent deux pitons qui touchaient la rivière.
«À peine ce mouvement fut-il exécuté, que l'ennemi déboucha par le pont de Bilay et marcha sur la division Montrichard, qui suivait la division Clausel. Je donnai l'ordre immédiatement au général Clausel de faire passer au général Delzons, avec le 8e régiment d'infanterie légère, la petite rivière qui était devant nous, afin d'occuper les mamelons dont s'étaient emparés les voltigeurs, et de les défendre avec le plus d'opiniâtreté possible s'il y était attaqué. Je lui donnai également l'ordre de rapprocher un peu les autres régiments de la division, de manière à soutenir la division Montrichard, avec laquelle j'allais combattre l'ennemi, qui débouchait.
«L'ennemi marcha à nous sur trois colonnes. J'eus bientôt disposé toute la division Montrichard, et, après être resté en position pour bien juger du projet de l'ennemi, je me décidai à faire attaquer la colonne du centre par le 18e régiment d'infanterie légère, à la tête duquel marchait le général Soyez, tandis que le 79e régiment, que commandait le colonel Godart, et avec lequel se trouvait le général Montrichard, contenait la droite de l'ennemi.
«La charge du 18e régiment fut extrêmement brillante; il est impossible d'aborder l'ennemi avec plus de confiance et d'audace que ne le fit ce brave régiment. L'ennemi fut culbuté, perdit cinq pièces de canon. Dans cette glorieuse charge, le général Soyez fut blessé d'une manière très-grave. Je fis soutenir immédiatement le 18e régiment par le 5e régiment, sous les ordres du colonel Plauzonne, qui marcha sur la colonne de gauche de l'ennemi et la fit replier.
«L'ennemi, s'opiniâtrant, envoya de puissants renforts, qui exigèrent de notre côté de nouveaux efforts. Le 79e régiment, qui avait suivi la droite de l'ennemi, s'était réuni à notre centre en faisant le tour d'un monticule qui la séparait. Je plaçai en deuxième ligne le 81e régiment, sous les ordres du général Launay et du colonel Bonté, et en réserve un bataillon du 11e régiment, que je détachai de la division Clausel.
«L'ennemi ayant fait un nouvel effort, le 79e régiment le reçut avec sa bravoure ordinaire, et un bataillon le chargea, tandis que le 81e régiment en faisait autant.
«Cette charge fut si vive, que l'ennemi se précipita dans la rivière et s'y noya en grand nombre. Tout ce qui avait passé devait être détruit si douze pièces de canon de l'ennemi, placées sur l'autre rive de la Licca, n'avaient mis obstacle à ce qu'on le poursuivit davantage.
«Cet effort termina la journée à notre gauche. Le général Launay, qui marchait à la tête du 79e et du 81e, y fut grièvement blessé.
«Pendant que ces affaires se passaient, l'ennemi détacha six bataillons pour attaquer les positions qu'occupait le 8e régiment. Ce corps, un des plus braves de l'armée française, que commande le colonel Bertrand, et que le général Delzons avait très-bien posté, résista avec beaucoup de vigueur et de persévérance. Après plusieurs tentatives inutiles pour enlever la position de vive force, l'ennemi s'occupa à le tourner. Il allait être en péril lorsque j'ordonnai au général Clausel d'envoyer au général Delzons les trois bataillons du 11e régiment, sous les ordres du colonel Bachelu, pour, non-seulement soutenir et assurer le 8e régiment, mais encore pour prendre l'offensive et menacer la retraite de tout ce corps ennemi qu'il avait tourné.
«Le général Delzons fit le meilleur emploi de ces forces, et le 11e régiment soutint, dans cette circonstance, son ancienne réputation, et, en moins de trois quarts d'heure, l'ennemi perdit de vive force ou évacua toutes ses positions.
«Ce succès mit fin au combat.
«Pendant la nuit, on s'occupa avec la plus grande activité à rétablir le pont, qui avait été coupé. Mon intention était de le passer avant le jour avec toutes mes forces, pour me trouver le plus tôt possible sur la communication de l'ennemi, ne supposant pas qu'il retardât un seul instant sa retraite.
«Les travaux du pont furent plus longs que je ne l'avais pensé, et le transport de cinq cents blessés fut tellement difficile, qu'à midi les troupes n'étaient pas encore en état d'exécuter leur mouvement. D'un autre côté, l'ennemi avait fait un mouvement offensif, avec quatre ou cinq mille hommes, en remontant la Licca. Cette confiance de l'ennemi semblait devoir provenir de l'arrivée prochaine du secours qu'amenait le général Cneswich, que l'on disait à peu d'heures de marche. Ma position devenait embarrassante: l'armée était divisée par un ruisseau extrêmement difficile à passer. L'ennemi semblait se disposer à tomber sur la partie de l'armée qui passerait la dernière. Une fois le ruisseau passé, il fallait renoncer à toute retraite si les renforts annoncés à l'ennemi défendaient le marais d'Ottochatz. Il était difficile, ayant une armée en queue, de pouvoir les passer et de se soutenir entre Gospich et Ottochatz, faute de vivres, et cinq cents blessés, des équipages et l'artillerie mettant un grand obstacle à nos mouvements, et les dernières nouvelles de l'armée d'Italie n'étant que de Vicence.
«D'un autre côté, repasser le ruisseau était renoncer à l'offensive et ajourner d'une manière indéfinie notre jonction avec l'armée d'Italie; c'était changer en une opinion de défaite une victoire complète remportée la veille. Il était possible que, si le général Cneswich arrivait, il fût battu séparément; enfin les soldats avaient encore six jours de vivres dans leurs sacs, et, si les circonstances devenaient aussi critiques qu'on pouvait l'imaginer, je pouvais encore, en détruisant mon artillerie, m'approcher assez de l'armée d'Italie pour être dégagé par elle.
«Les deux partis étant extrêmes, je choisis celui qui était le plus honorable, et je persistai dans ma première résolution. La fortune sourit à ma confiance: la division Montrichard passa le ruisseau sans être inquiétée; et, aussitôt que la tête de mes colonnes se montra à l'entrée de la plaine, l'ennemi se disposa à la retraite, rappela les troupes qui avaient passé la Licca et vint se former devant nous avec sept bataillons et une grande quantité d'artillerie, pour battre les débouchés par lesquels nous devions arriver des montagnes dans la plaine.
«Le général Delzons, à la tête du 23e, gagna autant de terrain qu'il put sur les bords du ruisseau; et à peine le colonel Plauzonne, qui commandait la brigade du général Soyez depuis sa blessure, eut-il formé les 5e et 18e régiments, qu'il marcha à l'ennemi et le força à la retraite.--Nous gagnâmes dans un instant assez de terrain pour former l'armée sans danger.
«Ce combat est fort honorable pour le colonel Plauzonne et pour le 5e régiment. La nuit qui survint nous empêcha de profiter de ces succès, et, au jour, nous ne vîmes plus l'ennemi.
«Le 23, nous entrâmes à Gospich. Le 24, nous marchâmes sur Ottochatz, où était encore l'arrière-garde de l'ennemi, forte de six bataillons, l'artillerie et les bagages. Les ponts étaient coupés; nous tournâmes tous les marais d'Ottochatz; et le général Delzons, à la tête du 8e régiment d'infanterie légère, soutenu par le 23e, de la division Clausel, chassa l'ennemi de toutes les positions qu'il occupait pour couvrir la grande route. Ce combat fut brillant pour le 8e régiment comme tous ceux qui l'avaient précédé. Le général Delzons, selon son usage, conduisit cette affaire avec beaucoup de talent et de vigueur. Il y a reçu une blessure qui, j'espère, ne l'empêchera pas de reprendre bientôt du service. Si le général Montrichard, par une lenteur inouïe et contre tout calcul, ne s'était pas trouvé de trois heures en arrière, l'arrière-garde de l'ennemi était évidemment détruite, l'artillerie et les bagages pris.
«Dans la nuit, l'ennemi s'est retiré en toute hâte sur Carlstadt; quelques bagages sont encore tombés entre nos mains.
«Le 26, nous sommes entrés à Segna, et, le 28, à Fiume, où l'armée se rassemble le 29, et d'où elle partira, le 31, pour se joindre à l'armée d'Italie.
«L'ennemi, dans cette courte campagne, a eu environ six mille hommes hors de combat et un très-grand nombre de déserteurs. Nous avons combattu ou marché tous les jours pendant douze heures; et les soldats, au milieu des privations, des fatigues et des dangers, se sont toujours montrés dignes des bontés de Votre Majesté. Je devrais faire l'éloge de tous les colonels, officiers et soldats, car ils sont tous mus du meilleur esprit; mais je ne puis dire trop de bien des colonels Bertrand, Plauzonne et Bachelu, qui sont des officiers de la plus grande capacité.
«L'armée a fait une grande perte dans les généraux Launay et Soyez, blessés grièvement; et le jour où ils lui seront rendus sera pour elle un jour de fête. Je dois aussi beaucoup d'éloges au général Clausel, et je dois me louer du général Tirlet, commandant l'artillerie, du colonel Delort et du chef des ambulances.
«Nous avons eu, dans ces trois dernières affaires, huit cents hommes tués ou blessés.»
1809
SOMMAIRE.--Arrivée de l'armée de Dalmatie à Laybach.--Le général Rusca mal informé.--Réflexions sur la bataille d'Essling: situation critique de la grande armée.--L'archiduc Charles.--Anecdote.--Le général Giulay défend la Drave.--Manoeuvres du duc de Raguse pour passer cette rivière.--Le général Broussier.--Le 84e dans le faubourg de Gratz.--Deux bataillons contre dix mille hommes.--Devise inscrite sur l'aigle de ce régiment.--L'Empereur ordonne au duc de Raguse de se rapprocher de Vienne.--Après le passage du Simmering, le duc de Raguse devance son armée.--L'Empereur dans l'île de Lobau.--Fautes de l'armée autrichienne.--Police de l'armée confiée à Davoust.--L'ennemi évacue Enzersdorf.--Napoléon est vainqueur à la droite et au centre.--L'armée d'Italie fait face à gauche.--L'ennemi est contenu, et la bataille gagnée.--Retraite de l'archiduc.--Réflexions et critique.--L'Empereur dresse sa tente au milieu du corps du duc de Raguse.--Statistique de la bataille.--L'Empereur parcourt le champ de bataille.--Le duc de Raguse marche à l'avant-garde à la poursuite de l'archiduc.--Marche sur Znaïm.--Il passe la Taya.--L'armée autrichienne se découvre tout entière.--Position de Tisevich.--L'ennemi demande un armistice.--Arrivée de l'Empereur.--Il ordonne de l'accepter.--Visite à l'Empereur dans sa tente.--Longue conversation.--Le duc de Raguse est nommé maréchal.--Le corps du duc de Raguse est dirigé sur Krems.--Bernadotte quitte l'armée.--Camp à Krems.--Affaire d'Oporto.--L'Empereur affecte de l'ignorer.--Anecdote.--Négociation de paix.--Attentat de Schoenbrunn.--La paix est signée par surprise.--Le duc de Raguse précède l'Empereur à Paris.--Il est nommé gouverneur des provinces illyriennes.
Arrivé à Laybach le 3 juin, je trouvai dans cette ville des détachements appartenant aux régiments de l'année de Dalmatie. Je les incorporai quelques jours après, et les pertes de la campagne furent à peu près réparées. En ce moment, un corps autrichien, commandé par le général Chasteler, sortait du Tyrol: il était complétement isolé, et sa position difficile et dangereuse. Je ne négligeai rien pour lui barrer le passage; mais, malgré mes espérances, je n'y pus parvenir. Le 4, à midi, je reçus une lettre du général Rusca, datée de Villach. Il m'annonçait l'arrivée, devant lui, du corps de Chasteler, fort de huit à neuf mille hommes, et me prévenait qu'il se retirait lui-même sur Klagenfurth, où il se renfermerait s'il était nécessaire.
Ce corps ennemi, se trouvant en arrière de l'armée française, manoeuvrait pour lui échapper et rejoindre sa propre armée. De Villach, il pouvait prendre trois différentes routes. Je devais donc me placer de manière à lui couper celle qu'il aurait choisie. Ces routes sont: 1° par Klagenfurth et Marbourg; 2° par Afling, Krainbourg et Laybach; 3° par Tarvis, Caporetto et Goritz. Je me portai immédiatement en avant de Laybach, et poussai une avant-garde jusqu'au pied du Klöbel. J'étais ainsi en mesure d'arriver, en quelques heures, sur la Drave et à Klagenfurth, de défendre la seconde de ces trois routes si l'ennemi la préférait, et pas très-éloigné pour l'atteindre encore s'il marchait sur Trieste.
Le 5, je reçus une lettre du général Rusca, datée du 4 de Klagenfurth; son mouvement sur cette ville était effectué, et il m'annonçait que l'ennemi ne l'avait pas suivi.
Le 6, une lettre du général Caffarelli, commandant à Trieste, me prévenait qu'une avant-garde ennemie avait paru à Caporetto, et que probablement c'était sur lui que l'ennemi se dirigeait. Il me rappelait qu'il y avait trois mille prisonniers de guerre à Adelsberg. Rien ne me paraissait encore concluant. Le 6 au matin, une lettre du général Rusca, datée de Klagenfurth le 5, à cinq heures du soir, me confirmait l'avis que l'ennemi n'avait fait aucun mouvement de Villach. Toutes les apparences étaient alors que l'ennemi prendrait la route de l'Isonzo. Je me rapprochai de Laybach, et portai une division sur Ober-Laybach, sans cependant m'abandonner à un mouvement décidé. Ces dispositions, d'après les faits ci-dessus, étaient les seules raisonnables; mais mes calculs étaient erronés, parce que les rapports qui leur servaient de base étaient faux. Le général Rusca était bien mal informé; car, au moment où il m'écrivait de Klagenfurth, le 5, à cinq heures du soir, il avait l'ennemi à ses portes, qui l'attaquait à six et le bloquait à sept. Un officier que je lui avais envoyé en avait été témoin. Caché chez un maître de forges de sa connaissance, au milieu des postes ennemis, il avait vu détruire et brûler, à neuf heures du soir, le pont de Kirschensteuer sur la Drave. Cet officier m'ayant rejoint le 6 dans la journée, je partis pour retourner sur mes pas; mais le général Chasteler avait hâté son mouvement et disparu quand j'arrivai sur la Drave. Si le général Rusca s'était fait éclairer avec plus de soin; si, lorsque placé à Krainbourg et au pied du Loibl, j'attendais si impatiemment de ses nouvelles, il m'eût prévenu de l'instant où l'ennemi avait quitté Villach, je serais arrivé à Kirschensteuer avant lui, et, après avoir passé la Drave, je lui aurais barré le chemin. Des troupes telles que les miennes, grandies par la campagne qu'elles venaient de faire, en présence de soldats harassés, coupés et découragés, auraient probablement détruit complétement le corps de Chasteler en un seul combat.
J'éprouvai un véritable chagrin de voir des espérances si bien fondées s'évanouir; mais il n'y avait pas de ma faute, et l'Empereur, quelque regret qu'il en éprouvât, en jugea de même. Revenu à Laybach pour y faire reposer mes troupes, je reçus l'ordre d'y rester pendant quelque temps, afin de couvrir Trieste et la frontière d'Italie contre tous les corps qui pourraient se présenter.
Les succès immenses, obtenus par la grande armée à l'ouverture de cette campagne, avaient été un peu balancés par les revers d'Essling. Le passage du Danube, effectué avec trop de confiance, avait failli amener la ruine et la destruction de l'armée. En ce moment, le prince Charles a eu entre ses mains la destinée de l'armée française: il pouvait la détruire; mais il lui paraissait si admirable, si extraordinaire de n'avoir pas été battu, qu'il doutait presque de sa victoire quand il ne tenait qu'à lui de la rendre décisive. Qu'on se figure la situation terrible de l'armée française: elle était divisée en deux par le Danube, qui est si large devant Vienne; les deux portions ne pouvaient communiquer qu'au moyen d'une navigation rare et incertaine; la partie placée sur la rive gauche du fleuve, écrasée par le combat le plus opiniâtre, le plus meurtrier, n'avait dans l'île de Lobau ni munitions pour se battre ni espace pour se mouvoir. Elle avait devant elle, au delà d'un bras du fleuve, de la largeur, pour ainsi dire, d'un ruisseau, les forces ennemies, victorieuses et bien fournies de toutes choses. Si l'armée autrichienne eût effectué le passage dans l'île de vive force, et elle le pouvait certainement; si, en outre, un corps de douze ou quinze mille hommes eût passé le Danube à Krems, et que la population de Vienne se fût révoltée, comme elle y était disposée, tout ce qui était rassemblé dans l'île, devenue si célèbre, le corps de Masséna, celui de Lannes, la cavalerie de la garde, toutes les troupes eussent été incontestablement prises ou détruites, et on peut apprécier les conséquences qui en seraient résultées. Mais l'Empereur exerçait sur les facultés morales de l'archiduc une action incroyable, une espèce de fascination. L'anecdote suivante en est bien la preuve. Je la tiens de deux généraux, le comte de Bubna et le baron de Spiegel, qui servaient près de l'archiduc Charles en qualité d'aides de camp, et qui étaient investis de sa confiance.
L'archiduc était entré en campagne sous les meilleurs auspices. L'armée française, au moins la grande masse de ses forces, et particulièrement les troupes qui avaient fait les campagnes de 1805, 1806 et 1807, étaient en Espagne et en Italie. Le corps seul de Davoust, fort de trente mille hommes environ, et quelques autres troupes, organisées à la hâte dans les dépôts de France, se trouvaient en Allemagne. Ainsi les alliés faisaient le fond de l'armée française par leur nombre. Sans vouloir les traiter injustement, on sait combien ces troupes sont médiocres. L'archiduc, entré en campagne avec une belle et nombreuse armée, bien pourvue, bien outillée, marchait avec la confiance que lui donnait son immense supériorité; et cette confiance était universelle. Tout à coup, sur le champ de bataille de Ratisbonne, on fait un prisonnier français. On le questionne: il annonce l'arrivée de l'Empereur à l'armée, et dit qu'il est en personne à la tête de ses troupes. On refuse de le croire; mais un second, puis dix, quinze, vingt prisonniers, disent la même chose. Dès ce moment, me dit-on, dès l'instant où la chose fut constatée, l'archiduc qui, jusque-là, avait montré du sang-froid et du talent, perdit la tête, ne fit plus que des sottises. «Et moi, ajoutait Bubna, pour lui faire retrouver ses facultés, pour le remettre, je lui disais: «Mais, monseigneur, pourquoi vous tourmenter? Supposez, au lieu de Napoléon, que c'est Jourdan qui vient d'arriver.» Cette histoire fort gaie n'est jamais sortie de ma mémoire. Elle ne fait pas trop valoir le maréchal Jourdan; mais Bubna avait choisi son nom parce que l'archiduc avait fait la guerre contre lui pendant deux campagnes et l'avait toujours battu.
La nouvelle de l'approche de l'armée de Dalmatie fit, à la grande armée, une heureuse diversion aux chagrins causés par les malheurs d'Essling. On fit valoir ses succès, et on parla de ce corps, avec raison, comme d'une troupe d'élite et de son arrivée comme d'un renfort puissant.
Je reviens à mes opérations.
Un séjour à Laybach d'une douzaine de jours me donna le moyen de recevoir une partie de ce qui me manquait. Cinq cents chevaux de différents corps me furent donnés, et mon artillerie se composa de vingt-quatre bouches à feu. J'avais conservé une partie des moyens de transport organisés en Dalmatie; et mes petits chevaux de bât donnèrent à mon corps d'armée une physionomie particulière quand il se trouva encadré dans la grande armée. Mes approvisionnements de guerre étaient si complets en partant de la Dalmatie, qu'après la campagne, après la bataille de Wagram, après les deux combats de Znaïm, quand l'armistice fut conclu, il me restait encore des munitions apportées de Zara.
Pendant mon séjour à Laybach, le corps d'armée commandé par le général Giulay, et formant l'aile gauche de l'armée d'Italie, se porta sur Marbourg pour défendre la Drave, rivière large, rapide, qui présente de grands obstacles; et ce corps, renforcé de toutes les troupes qui, de la Croatie, s'étaient retirées devant moi, s'élevait alors à trente-cinq mille hommes.
La division Broussier, de l'armée d'Italie, avait reçu l'ordre de couvrir la grande armée de ce côté. À cet effet, elle occupait l'entrée des gorges voisines de Gratz, à travers lesquelles coule la Muhr. Ayant reçu l'ordre de chasser le général Giulay des positions qu'il occupait et de me rapprocher de la grande armée, je me mis en mouvement le 20 juin. J'allais me retrouver sur mon terrain et manoeuvrer dans une province que j'avais parcourue dans tous les sens, quatre ans plus tôt, à la tête d'un autre corps d'armée.
Toute l'armée de Giulay était rassemblée à Marbourg. Passer la rivière de vive force sur ce point étant impraticable, je me contentai seulement de reconnaître l'ennemi et d'opérer une forte diversion pour lui cacher mon véritable point de passage.
Après avoir réuni mes troupes à Windisch-Feistriz, je marchai avec mon avant-garde sur Marbourg. Giulay passa la Drave et déploya ses forces en avant de la rivière. Lui livrer bataille dans cette position n'entrait pas dans mes projets. Si je le battais, je ne pouvais le poursuivre, la rivière et la ville étant là pour le protéger; et, puisque j'avais à faire ma jonction avec une division de l'armée d'Italie, il était sage d'attendre qu'elle fût opérée pour le combattre. Je manoeuvrai donc devant l'ennemi, qui, de son côté, montrait de la prudence et même de la timidité. Mais, pendant ces démonstrations, je disposai tout pour me rendre, par une marche forcée, à Volkenmarkt, où il y a un pont sur la Drave. Ce pont avait été en partie brûlé, mais on pouvait assez promptement le réparer. Il fallait seulement y arriver avant l'ennemi et l'occuper pour pouvoir exécuter les travaux nécessaires.
Au moment où je montrais mes têtes de colonne entre Windisch-Feistriz et Marbourg, trois compagnies de voltigeurs et cent ouvriers charpentiers, choisis dans les troupes, une compagnie de sapeurs et des officiers intelligents se mettaient en route pour Volkenmarkt, en passant par Gonobitz, Windischgratz et Bleiberg. Ils avaient l'ordre de marcher le plus rapidement possible et de prendre des voitures pour faciliter leurs transports. Quand ils eurent pris l'avance, tous les bagages de l'armée suivirent, et l'armée ensuite, en marchant en colonnes renversées. Je disparus tout à coup aux yeux de Giulay, qui, au lieu de me suivre dans les montagnes, repassa la Drave et la remonta pour la défendre.
Mes troupes prirent position à Volkenmarkt, où l'ennemi n'avait personne. Le pont fut réparé, et il y eut une telle activité dans ces travaux et dans mon mouvement, que mon corps d'armée avait déjà passé la rivière, mon avant-garde avait descendu la Drave et occupait déjà Lavamunde lorsque les éclaireurs de Giulay s'y présentèrent.
Je fis courir le bruit de ma marche sur Marbourg, et ordonnai de préparer des vivres pour mes troupes dans cette direction: ruse que tout le monde emploie et qui produit toujours quelque effet. Giulay rassembla ses troupes pour défendre la vallée et m'attendit. Pendant ce temps, je marchais encore en colonnes renversées, mon arrière-garde se portant sur Volsberg et Voitzberg, tandis que mon avant-garde, placée à Lavamunde, couvrait mon mouvement.
Nous traversâmes rapidement ce massif de montagnes et la haute montagne de Pach, et nous arrivâmes comme par enchantement dans le bassin de la Muhr. Je communiquai immédiatement avec le général Broussier, qui avait évacué Gratz avec sa division, pris position au pont de Gösting, à l'entrée des gorges, et l'engageai à mettre sa division en mouvement sur la rive droite de la Muhr, afin de se réunir à moi pour aller combattre l'ennemi, qui se rassemblait à Vildon.
Le général Broussier, en exécutant ce mouvement, vint me trouver de sa personne à Liboé, où j'étais arrivé avec la division Clausel. Je ne pus déboucher au même moment, parce que le général Montrichard, par suite de son incroyable ineptie, s'était arrêté et se trouvait ainsi à une marche en arrière. Instruit de cette halte si inopportune, je lui envoyai ordre sur ordre de venir me joindre. Il marcha la nuit, mais il causa cependant un retard de plus de douze heures.
Le général Broussier, en faisant le mouvement que je lui avais prescrit, avait envoyé deux bataillons du 84e pour bloquer le fort de Gratz et occuper les portes de la ville. Une vive fusillade avait été entendue le matin à Gratz. Le général Broussier m'en rendit compte sans en expliquer la cause. La chose était claire pour moi: le régiment ne s'était pas amusé à fusiller avec la citadelle; l'ennemi était donc rentré dans Gratz, et Giulay y avait dirigé une partie de ses forces. Je renvoyai, sans perdre un moment, le général Broussier à sa division, avec ordre de rétrograder et de marcher, par la rive gauche, au secours de ce beau régiment, si fort compromis. Une défense héroïque donna le temps au général Broussier d'arriver pour le dégager.
Accablé par dix mille hommes, il s'était retranché dans le long faubourg de Gratz, du côté de la Hongrie, et jamais l'ennemi ne put l'y forcer. De fréquentes sorties déconcertèrent ses attaques; de nombreux prisonniers tombèrent entre ses mains, et les munitions de ces derniers lui servirent à combattre: deux drapeaux furent pris. Jamais fait d'armes comparable n'a brillé d'un pareil éclat. Après quatorze heures de combat, les troupes du général Broussier ayant paru, l'ennemi laissa la retraite libre au 84e régiment.
Ce régiment, un de ceux de mon corps d'armée de Hollande, acquit en cette circonstance une gloire dont je jouis beaucoup. L'Empereur le combla de récompenses, et fit inscrire sur son aigle, en lettres d'or: «UN CONTRE DIX,» devise qu'il a conservée jusqu'au licenciement de l'armée, et dont il n'a cessé de se montrer digne.
Dans la journée du 26, toutes les troupes de Giulay prirent position à Gratz, appuyées au fort et à la rivière. Je rejoignis le même jour, au pont de Gösting, le général Broussier avec mes troupes. Je disposai tout pour attaquer le 27; mais, l'ennemi ayant opéré sa retraite dans la nuit, nous trouvâmes, le matin, toutes ses positions évacuées. Il se retira en Hongrie, par la route de Gleisdorf et de Fürstenfeld.
En 1805, j'avais mis le fort de Gratz en état de défense, et je m'en étais félicité. En 1809, j'en gémis, car il mettait les plus grands obstacles à mes communications. On ne pouvait passer le pont, traverser les places, se mouvoir au milieu des rues sans recevoir des coups de fusil du fort. Les habitants mêmes perdaient assez de monde, tant le commandant montrait d'ardeur à tirer sur les officiers et les soldats, au risque de blesser les citoyens. Mais ces ennuis ne furent pas de longue durée. Je laissai les troupes nécessaires au blocus, et, le 28, je me mis à la poursuite de Giulay, dont j'attaquai l'arrière-garde à Gleisdorf.
De là, nous nous portâmes sur Feldsbach. Au moment où ce mouvement s'exécutait, je reçus l'ordre de me rapprocher de Vienne, de faire évacuer tous les hôpitaux de Gratz, de renvoyer sans retard la division Broussier, et d'être rendu moi-même avec mes troupes, le 4 juillet au soir, sur le bord du Danube. Je revins à Gratz avec la division Montrichard, et je fis partir pour Vienne jusqu'au dernier malade ou blessé de l'hôpital de cette ville.
Cette opération terminée, je me mis en marche avec cette division, en suivant la division Broussier, tandis que la division Clausel se rendait à Neustadt par Friedberg. Tout ce mouvement s'exécuta avec rapidité: une fois de l'autre côté des montagnes, je devançai mes troupes, et je me rendis à Vienne et à l'île de Lobau pour voir l'Empereur.
Je le trouvai dans toute sa grandeur militaire. S'il avait ouvert la campagne avec peu de troupes et de faibles moyens, les ressources de son esprit et l'énergie de sa volonté lui avaient créé des forces immenses. L'état de situation de l'armée, réunie pour passer le Danube, et qui, le surlendemain, combattit à Wagram, état de situation que j'ai vu, montrait en présence sous les armes cent quatre-vingt-sept mille hommes, dont cent soixante-quatre mille sabres ou baïonnettes, et sept cents pièces de canon.
La leçon que Napoléon avait reçue lui avait profité. Des moyens de passage assurés, à l'abri de toute entreprise et de tout accident, avaient été préparés. Le général Bertrand, commandant le génie de l'armée, avait conduit tous ces travaux avec habileté. Le véritable Danube était passé, et cette vaste île de Lobau rassemblait la plus grande population militaire que l'on eût jamais vue réunie sur un même point: un bras du fleuve très-étroit restait seul à franchir.
L'ennemi avait dû juger nos moyens de passage, le point sur lequel il devait s'effectuer en raison des localités et des travaux préparés, et cependant il n'avait rien fait pour les empêcher, pour les contrarier, ni même pour nous arrêter au moment où nous déboucherions. Une partie de ses troupes seulement était à portée du Danube; la masse de ses forces, réunie en arrière, devait occuper une position reconnue, belle et forte: disposée en arc de cercle, elle commandait la campagne et se trouvait couverte par un ruisseau. C'était un combat en champ clos, où l'on se donnait rendez-vous. L'archiduc était apparemment résolu d'avance à livrer la bataille à nombre égal; car, s'il eût voulu l'ajourner, ou bien combattre deux ou trois contre un, il en était le maître.»
Si, à une demi-portée de canon du Danube, et particulièrement à Stadt-Enzersdorf, il eût fait élever de fortes redoutes en face de notre point de passage, et qu'il les eût fait soutenir par plusieurs lignes de troupes, jamais nous n'aurions pu déboucher. L'affaire se serait réduite à un combat opiniâtre, où probablement nous aurions été vaincus, puisque, soutenue par les secours de l'art, la masse des forces autrichiennes aurait eu affaire seulement à une partie des nôtres, l'espace manquant à l'armée française pour déboucher et se former.
Je vis l'Empereur au moment où il rentrait de l'inspection de ses préparatifs. Il était glorieux de cette campagne, et avec raison; car rien ne fut plus admirable que son début et plus étonnant que l'étendue de ses succès avec la faiblesse de ses moyens. Il passait légèrement sur les événements d'Essling, et se contentait de rendre hommage à la valeur des troupes, à leur grande impassibilité et au courage héroïque qu'elles avaient montré. Il se complaisait alors dans l'idée de la force de son armée et se montrait, avec raison, confiant dans l'avenir. Je l'ai toujours vu extrêmement sensible à l'étalage de sa puissance. Quand ses sens étaient frappés par la vue d'une grande quantité de troupes, il ressentait une impression toujours vive qui influait sur ses résolutions. Un homme de sa supériorité aurait dû être à l'abri d'un semblable enivrement; ses sens n'auraient pas dû avoir cet empire sur son esprit; car, avant de les voir, il connaissait à quel nombre se montaient ses soldats. Il me parut content de la campagne que je venais de terminer et m'en parla brièvement. Je reçus l'ordre d'établir mes troupes sur la rive droite et de couvrir les ponts de l'île de Lobau.
J'éprouvai un bonheur très-grand à venir prendre ma place dans ce grand mouvement; mais aussi que je me trouvai petit! Combien le rôle d'un chef suprême devenu un lieutenant est facile! Tout lui est aisé; il n'a rien ou fort peu de chose à prévoir; il n'a aucune résolution embarrassante à prendre; il n'est pas forcé de consacrer le temps du repos à des combinaisons, à des réflexions qui souvent fatiguent et agitent mille fois plus que les marches et les combats. Cette responsabilité morale, la grande charge du commandement, cette décision obligée de chaque jour, avec toutes ses conséquences, bonnes ou mauvaises, voilà la grande difficulté du commandement en chef. La solution exige deux grandes qualités: assez d'intelligence pour bien combiner l'emploi de ses moyens, et un caractère plus fort que l'intelligence, pour tenir fermement à la résolution prise: le caractère doit dominer l'esprit.
J'ai commandé de petites et de grandes armées; j'ai commandé aussi des corps de la grande armée, et je n'ai trouvé aucune parité entre ces deux situations. Il est infiniment plus facile de commander quarante mille hommes sous l'autorité d'un chef suprême que dix mille hommes seul, en agissant pour son propre compte et sous sa propre responsabilité.
Après avoir mis hors ligne le commandement de ces grandes masses qui dépassent cent mille hommes, j'ajouterai que les trop petites armées particulièrement présentent de grandes difficultés. Les moyens étant très-restreints, le moindre échec a les plus graves conséquences: c'est alors qu'on est forcé d'agir de manière à ne jamais rien compromettre. Avec trente mille hommes, au contraire, quand cette force est relative à celle de l'ennemi et au rôle que l'on doit jouer, on est dans une meilleure condition. Il y a facilité dans le commandement et matière à combinaisons. Je fixe à ce nombre les conditions du commandement proprement dit, et je classerais ainsi les différentes fonctions d'un général suivant le nombre des soldats qu'il a sous ses ordres. Avec douze mille hommes, on se bat; avec trente mille, on commande; et avec les grandes armées on dirige. Quand les armées dépassent certaines bornes, le général en chef n'est plus qu'une providence qui intervient pour parer à un grand accident; son action se fait sentir seulement d'une manière générale; elle ne devient immédiate que dans une circonstance décisive, imprévue et irréparable, où il doit changer de rôle et redevenir soldat.
Davoust avait la police de l'île de Lobau; son caractère se montra, dans cette circonstance, avec toute sa sévérité sauvage. Il avait défendu aux habitants du pays, sous peine d'être pendus, de pénétrer dans nos camps, et souvent cet ordre a été exécuté à la rigueur. Un de mes domestiques ragusais, resté au pont avec ma voiture, lui parut suspect: il aurait été expédié, malgré ses représentations, si un de mes officiers ne s'était pas trouvé là pour le réclamer.
Me voilà donc rendu à la grande famille militaire, au milieu de ce mouvement gigantesque où les destinées du monde se décident, et où l'objet de tous mes voeux était de figurer.
Toutes les troupes étaient réunies dans l'île de Lobau; elles n'étaient séparées du terrain occupé par l'ennemi que par un bras du fleuve extrêmement étroit. Diverses sinuosités formaient des points de passage plus ou moins favorables. Le meilleur de tous est à la tête de l'île, au point où elle divise le cours du fleuve. C'était là que le passage, en mai, s'était effectué. De ce côté, les villages de Gross-Aspern et d'Essling, où l'on combattit si vivement les 21 et 22 mai, une fois occupés, donnaient l'avantage de couvrir le passage et d'assurer les moyens de déboucher. Cette fois, on en choisit un nouveau et on se contenta de tout préparer pour faire des ponts à l'ancien, afin d'ouvrir cette seconde communication aussitôt après avoir exécuté le passage de vive force et dès que l'ennemi aurait été éloigné.
En se rapprochant du Danube, et à l'endroit où il va rentrer dans le lit principal, le même bras présente un autre point de passage assez facile. En occupant les points saillants par des batteries de gros calibre, en occupant aussi une ou deux autres petites îles inférieures, on prenait des revers sur toute la campagne et, par conséquent, on pouvait donner une protection efficace aux troupes qui passeraient les premières. On choisit cet endroit, et on établit de fortes batteries à embrasures sur tous les points avantageux.
L'ennemi avait fait quelques travaux, non pour empêcher le passage, mais pour la sûreté de son avant-garde et pour donner le temps à l'armée de se rassembler. Avec d'autres intentions, il aurait pris pour point d'appui le Danube même. Des redoutes à distance convenable se seraient flanquées et soutenues. Essling, Gross-Aspern et Stadt-Enzersdorf auraient été retranchés avec soin, et cette ligne, appuyée au Danube et soutenue par toute l'armée, aurait présenté une barrière insurmontable. Au lieu de cela, l'archiduc se contenta de retrancher légèrement Gross-Aspern et Enzersdorf, de faire quelques flèches et d'occuper le château de Sachsenhausen, poste isolé, placé au delà de Enzersdorf; mais il ne fit rien en arrière et laissa l'armée dans les camps, où elle était dispersée. Les troupes autrichiennes, placées près du Danube, n'étaient donc que des troupes d'observation; les ouvrages occupés étaient destinés seulement à leur sûreté particulière et à présenter momentanément une première défense, pour retarder les mouvements de l'armée française et donner le temps de se réunir sur le champ de bataille reconnu et choisi d'avance pour combattre.
Nos batteries eurent bientôt mis en feu la petite ville d'Enzersdorf, dont les défenses misérables n'avaient aucune valeur et ne présentaient aucun abri. Quatre ponts ayant été jetés, à deux heures du matin, dans la partie inférieure de l'île, l'armée française déboucha sans rencontrer aucun corps ennemi. Enzersdorf tourné fut évacué, et le bataillon placé dans le château de Sachsenhausen, ne s'étant pas retiré assez tôt, fut fait prisonnier.
L'évacuation d'Enzersdorf fit retirer l'ennemi des postes retranchés à sa droite et de Gross-Aspern; alors l'armée autrichienne, réunie sur le plateau choisi pour livrer bataille, plaça sa droite à Gerarsdorf, son centre à Wagram et sa gauche à Neusiedl. Le centre et la gauche étaient couverts sur leur front par la rivière marécageuse le Rusbach. Mais, peu au-dessus de Neusiedl, la gauche était sans appui et pouvait être tournée; tandis que la droite, placée au bas d'un amphithéâtre, était très-forte et libre dans ses mouvements. Le point d'attaque le plus favorable était donc, par notre droite, sur la gauche de l'ennemi.
L'armée française employa toute la journée à passer les ponts, à faire évacuer les positions avancées de l'ennemi et à se former dans la plaine. À six heures du soir, elle avait sa droite à Gleisendorf, son centre à Raschdorf et sa gauche à Gross-Aspern.
En ce moment, l'Empereur, supposant à tort que l'armée autrichienne n'était pas encore formée, donna l'ordre au vice-roi de faire attaquer par le général Macdonald le centre de l'ennemi dans la direction de Wagram. Cet ordre avait été donné négligemment, sans que l'Empereur parût en sentir toute la conséquence. Macdonald en prévit sans hésiter le résultat. Il avait reconnu avec soin l'ennemi et pu juger que cette attaque isolée serait sans succès. Il engagea le vice-roi à faire cette observation à l'Empereur; mais celui-ci ne put jamais s'y résoudre, et l'ordre de marcher fut réitéré. Macdonald se mit en mouvement, ses troupes atteignirent le haut du plateau; mais elles y furent si vigoureusement reçues, qu'elles redescendirent rapidement et dans la plus grande confusion. Les Saxons, après une attaque pareille, eurent un sort semblable.
Cette attaque, mal conçue, faite mal à propos, ne fut qu'une forte échauffourée. Si l'ennemi eût suivi les troupes dans leur retraite précipitée, il est impossible de deviner les conséquences qui auraient pu en résulter. De plus, elle avait été mal calculée: car, en supposant le succès, l'heure avancée et les localités n'auraient pas permis d'en profiter.
Pendant la journée du 5, j'étais resté au pont avec mon corps. J'en partis deux heures avant le jour pour venir prendre ma place de bataille. Elle me fut assignée au centre, à la gauche d'Oudinot. L'armée était dans l'ordre suivant: À la droite Davoust, ensuite Oudinot, l'armée de Dalmatie, l'armée d'Italie, les Saxons et le corps de Masséna. Davoust eut la mission de tourner la gauche de l'ennemi, d'enlever le village de Neusiedl, qui l'appuyait, et de le refouler sur son centre. Davoust exécuta ce mouvement avec correction, méthode et vigueur. Le corps du prince de Rosenberg, qui lui-même avait pris l'offensive et attaqué celui de Davoust, fut chassé de ses positions et forcé de se replier. Le corps de Hohenzollern vint pour le soutenir; mais le corps de Davoust était en entier monté sur le plateau, et, s'étant formé perpendiculairement à la ligne de bataille de l'ennemi, celui-ci fut obligé de perdre du temps et du terrain pour faire un changement de front en arrière, et Davoust avança d'autant. Il fut ensuite puissamment secondé par l'attaque d'Oudinot, qui marcha sur le centre de l'ennemi, composé du corps du général Bellegarde, en liant sa droite avec la gauche de Davoust; et, après avoir enlevé la position qui était devant lui, il emporta le village de Wagram.
J'avais engagé mon artillerie pour soutenir Oudinot dans son mouvement, l'envoyai demander à l'Empereur l'autorisation de suivre le mouvement général en appuyant, la gauche d'Oudinot. Il répondit à mon aide de camp qu'il me laissait juge de ce qu'il convenait de faire et maître de mes mouvements; mais, un instant après, il le fit rappeler: il avait changé d'avis, et lui ordonna de me dire de rester en position, qu'il était de bonne heure, et que, plus tard, je pourrais être plus nécessaire.
Il était onze heures du matin. Pendant que nous étions vainqueurs à la droite et au centre, notre gauche était fort maltraitée. Par la direction de notre nouvelle ligne de bataille, nous avions fait un changement de front partiel, l'aile droite en avant. Il devint entier par la déroute de notre gauche.
Masséna était venu occuper Adlerklau, laissant la division Boudet à Gross-Aspern pour la sûreté des ponts, et s'était placé en seconde ligne, derrière les Saxons. L'ennemi, après avoir beaucoup renforcé sa droite, en ajoutant au corps de Hiller, que commandait le général Klenau, celui de Kolowrat se mit en mesure de faire, comme nous, un changement de front, l'aile droite en avant. Il descendit des hauteurs de Gerarsdorf, prit en flanc et aborda avec vigueur notre gauche; et les Saxons prirent la fuite d'une manière honteuse.
Le corps de Masséna étant écrasé et rejeté sur le Danube et sûr les ponts, l'ennemi fut au moment d'y pénétrer. La circonstance était critique. L'Empereur ordonna à l'armée d'Italie de faire face à gauche, et la fit soutenir par cent pièces d'artillerie et la cavalerie de la garde, ainsi que par plusieurs divisions de cavalerie de réserve. Ce feu d'artillerie imposant arrêta l'ennemi. Macdonald, ayant reçu ordre de charger l'ennemi avec deux divisions, se porta en avant, sous un feu épouvantable, avec une vigueur peu commune, et ne cessa, malgré les pertes qu'il éprouvait, de gagner du terrain. Enfin l'ennemi fut culbuté et mis en déroute. En ce moment, Bessières, commandant la cavalerie, eut son cheval tué, et lui-même fut blessé.
Cette cavalerie de la garde, si nombreuse, si bonne, si à portée de compléter le succès, ne s'ébranla pas. Si elle eût chargé, on faisait vingt mille prisonniers. On accusa beaucoup, dans le temps, le général Walter; le général Nansouty ne parut pas non plus exempt de reproches. Bref, le moment fut manqué, et, en cas pareil, il ne se retrouve plus.
L'ennemi alors effectua sa retraite; la droite ne tint plus que pour donner le temps à la gauche d'arriver. Les trois quarts de ses forces prirent la direction de Korneubourg, et le reste celle de Nikolsbourg.
On peut tirer diverses conclusions de ce qui précède. D'abord l'archiduc a eu divers projets qui se sont succédé et ont contrarié l'exécution du dernier. Une bataille décisive a été son but, puisqu'il a renoncé à combattre partiellement l'armée française au moment où elle passait le fleuve, afin de l'empêcher de déboucher. On ne peut mettre en doute qu'il ait voulu livrer une bataille défensive, puisqu'il s'est placé dans une position reconnue d'avance. Mais, dans ce cas, il aurait dû prévoir qu'il fallait y construire quatre ou cinq bons ouvrages pour couvrir sa gauche, la partie la plus faible de sa position. S'en étant aperçu trop tard, il changea subitement sa bataille défensive en bataille offensive au moment où l'armée française, entièrement réunie et toute formée, se trouvait en sa présence sur la rive gauche. Une fois l'offensive résolue, on peut s'étonner que l'archiduc ait imaginé de la prendre à la fois sur les deux ailes. Il n'était pas dans les règles d'attaquer ainsi une aussi forte armée. Au surplus, cette résolution paraît avoir été prise si tard, que les ordres ne purent pas arriver en même temps aux deux extrémités de l'armée, à cause de l'inégale distance qui les séparait du quartier général. L'ordre d'attaquer à la pointe du jour arriva à la gauche dans la nuit, et il put être exécuté; mais, parvenu à la droite seulement à six heures, il ne put l'être qu'à huit.
On peut difficilement s'expliquer ce qui a décidé l'archiduc à se priver du concours de forces imposantes qui n'agirent pas. Le corps du prince de Reuss, placé au Bisamberg, en vue de la bataille, n'y prit aucune part; huit mille hommes restèrent devant Nussdorf pour se mettre à l'abri d'un passage du fleuve qui ne pouvait être tenté. Des hussards suffisaient pour éclairer cette partie du terrain. Sept mille hommes de troupes, aux ordres du général Soustek, étaient à Krems tout aussi inutilement. Ainsi, sans compter le corps de l'archiduc Jean, il y avait plus de vingt-cinq mille hommes à portée en mesure de prendre part à la bataille, et qui n'ont pas combattu, on ne sait pourquoi.
L'armée autrichienne se composait des corps suivants, et formés dans l'ordre ci-après: À droite, le corps de Hiller, commandé par le générai Klenau, ensuite Kolowrat, puis Bellegarde; après lui Hohenzollern; enfin, le corps de Rosenberg. Au Bisamberg, celui de Reuss, l'archiduc Jean venant de Presbourg, une réservé de cavalerie et de grenadiers aux ordres du prince Jean Lichtenstein, et des landwehrs devant Nussdorf et sur le bord du Danube jusqu'à Krems.
L'archiduc Charles s'est beaucoup plaint de son frère l'archiduc Jean; une discussion publique s'est élevée entre eux. L'archiduc Jean était en position devant Presbourg, sur la rive droite du Danube, et menaçait de marcher sur Vienne, masquée seulement par le faible corps de troupes italiennes commandé par le général Baraguey-d'Hilliers. L'ordre lui fut donné de repasser rapidement les ponts, et de se porter sur la droite de l'armée française; mais il ne parut pas pendant la bataille: voilà la cause des débats survenus entre les deux frères. Arrivé avant le jour sur la March, une halte intempestive, pour faire la soupe pendant qu'on se battait, autorise l'accusation portée contre lui. Le 6, à trois heures du soir seulement, ses coureurs arrivèrent dans les environs de Wagram, et causèrent l'alerte dont je parlerai plus tard. Quinze mille hommes de bonnes troupes et cinquante pièces de canon, arrivant inopinément sur le champ de bataille et prenant le corps de Davoust à revers, pouvaient nous donner assez d'embarras en menaçant nos ponts d'aval. S'ils s'en fussent emparés, et si, en même temps, le mouvement sur Aspern, qui a été si près de réussir, avait eu un plein succès, l'armée française courait les plus grands périls. Mais, il faut le dire, toute l'armée française n'avait pas été engagée: il restait trente-cinq mille hommes de bonnes troupes fraîches, mon corps, et la garde. Nous étions donc en mesure de recevoir l'archiduc Jean et plus forts qu'il ne fallait pour le battre.
Voilà la vérité sur cette affaire, dont le retentissement s'est fait sentir en Europe. En réduisant la question à celle du concours possible de l'archiduc Jean le 6 au matin, il est incontestable qu'il a eu tort et qu'il ne devait pas rester jusqu'à onze heures sur la March.
On a critiqué aussi le point de retraite choisi par l'archiduc; mais, au moment où la retraite commença, en raison de la position respective des deux armées, on ne pouvait pas en prendre un autre. Si, avant l'action, la Bohême a été considérée comme devant de préférence recevoir l'armée battue en cas de malheur, on peut s'en étonner, bien que la position de l'armée autrichienne sur le flanc de l'armée française et menaçant sa ligne d'opération, présentât des avantages; mais les ressources qu'offre la Bohême ne peuvent pas être comparées à celles que renferme la Hongrie pour prolonger indéfiniment la guerre. En renonçant à la Hongrie, on renonçait à un grand avantage, celui d'avoir un pays sans fond pour se retirer, où l'ennemi, en avançant, rend à chaque pas sa position plus difficile et son retour plus périlleux. En choisissant la Bohême, l'armée autrichienne, en quelques marches, allait se trouver acculée aux frontières septentrionales de la monarchie, sans que l'armée française qui l'aurait poursuivie se fût éloignée de sa propre frontière.
À une heure, la bataille était gagnée et l'ennemi en pleine retraite. Les dernières charges faites sur lui au commencement de son mouvement rétrograde nous coûtèrent un de nos officiers de cavalerie les plus distingués, le général Lasalle, un de nos compagnons d'Italie et d'Égypte, homme doué d'un rare coup d'oeil, d'un admirable instinct militaire et d'une grande vigueur.
Trois ans plus tard, son émule de gloire, mais dont les facultés intellectuelles étaient plus hautes, le général Montbrun, eut le même sort.
L'Empereur vint se reposer dans la position du centre, que j'occupais, et y fit élever sa tente. Mes troupes étaient formées en colonnes et les armes en faisceaux. Tout à coup la plaine entière se trouve couverte de fuyards: plus de dix mille hommes, chacun marchant pour son compte, se précipitent dans la direction du Danube; des hussards, des cuirassiers, des soldats du train avec leurs attelages, etc., présentant ainsi le plus horrible spectacle. Mon corps d'armée court aux armes; nous attendons ce qui va arriver de cette bagarre, et nous nous disposons à bien recevoir l'ennemi. J'eus lieu d'être content de l'attitude de mes troupes, et je jouis de leur indignation au spectacle qu'elles avaient sous les yeux. Cette foule insensée s'écoula, s'arrêta derrière nous, et l'ennemi ne parut pas. Des coureurs du corps de l'archiduc Jean avaient jeté une terreur panique parmi des soldats en maraude et d'autres occupés à abreuver les chevaux.
Les terreurs paniques sont un triste symptôme de l'état moral d'une armée. Il en est arrivé quelquefois dans les armées françaises; mais ce n'est jamais dans leur bon temps. L'armée d'Austerlitz et celle d'Iéna n'en ont pas offert d'exemple.
Les paniques sont toujours la preuve d'un grand relâchement dans la discipline, d'un défaut de confiance et d'une altération dans les vertus militaires. Jamais les troupes que j'ai commandées n'ont présenté un pareil spectacle, excepté un seul régiment à Lutzen, comme je le raconterai en son temps; et encore était-ce un régiment de nouvelle formation qui venait de me rejoindre, et dans l'obscurité de la nuit.
L'Empereur me donna ordre de déployer mes troupes et de les faire camper en carré autour de sa tente. Ainsi gardé, il pouvait reposer avec sécurité.
Telle est la célèbre bataille de Wagram, la plus grande bataille des temps modernes en nombre d'hommes combattants, réunis ensemble sur le même terrain à la vue de l'observateur. Il y avait trois cent mille hommes dans les deux armées, et, de l'extrémité d'une aile à l'extrémité de l'autre, deux lieues et demie de distance environ. On peut se figurer la beauté et la majesté de ce spectacle. Nous avions sept cents pièces de canon attelées, et l'ennemi en avait cinq cents. Ainsi douze cents bouches à feu se sont fait entendre en même temps dans cette espèce de champ clos. Nous avons consommé, pendant la bataille, quatre-vingt-quatre mille coups de canon et eu vingt-sept mille hommes hors de combat.
Assurément la bataille a été gagnée, et l'ennemi ne l'a pas contesté. Nous l'avons forcé à se retirer; ses attaques ont été infructueuses; nous nous sommes emparés de tout le terrain sur lequel il a combattu. Ainsi, ce qui constitue une victoire, nous l'avons obtenu, et cependant, chose bizarre! nous n'avons pas fait un prisonnier, excepté des blessés abandonnés sur le champ de bataille. Nous n'avons pris que sept canons à l'ennemi, pas un drapeau, et lui, battu, nous a, au contraire, pris neuf bouches à feu.
Ce fut donc une victoire sans résultat. Les temps où des nuées de prisonniers tombaient entre nos mains, comme en Italie, à Ulm, à Austerlitz, à Iéna, étaient passés. C'était une bataille gagnée, mais qui en promettait plusieurs autres à livrer.
Le lendemain, l'Empereur monta à cheval, et, suivant son usage, parcourut une partie du champ de bataille; il visita celui de Macdonald. Je n'ai jamais compris l'espèce de curiosité qu'il éprouvait à voir les morts et les mourants couvrant ainsi la terre. Il s'arrêta devant un officier blessé grièvement au genou, et il eut l'étrange idée de faire faire devant lui l'amputation par son chirurgien Yvan. Celui-ci eut peine à lui faire comprendre que ce n'était pas le lieu, qu'il n'en avait pas la possibilité en ce moment, et il invoqua mon témoignage à l'appui du sien.
Je quittai l'Empereur pour aller me mettre à la tête de mes troupes, dirigées sur Wolkersdorf. En arrivant au pied des hauteurs de Gerarsdorf, l'Empereur rencontra Macdonald. Il le félicita de son action de la veille, lui fit une espèce de réparation pour le passé, et l'embrassa en lui disant: «C'est maintenant à la vie et à la mort entre nous.»
Le 7, j'établis mon camp à Wolkersdorf, où était le quartier général. Là je reçus l'ordre de partir le 8 pour faire l'avant-garde de l'armée dans la direction de Nikolsbourg. Mon corps d'armée fut augmenté de la division bavaroise, commandée alors par le général Minucci, en remplacement du général de Wrede, blessé, et d'un corps de cavalerie de cinq mille chevaux, commandé par le général Montbrun. Cette faveur me dédommageait de n'avoir pas combattu sérieusement à Wagram.
Masséna suivait l'armée ennemie par la route de Hollabrunn et de Znaïm. Davoust fut chargé de me soutenir. Oudinot suivit la même direction. L'armée d'Italie resta près de Vienne pour observer l'archiduc Jean. Je me mis en route le 8 de bonne heure, et je me portai à Wolkersdorf. L'ennemi avait de l'avance, et, jusqu'à ce bourg, je ne trouvai que des traînards. J'en ramassai beaucoup. Là j'appris qu'une forte colonne de l'armée autrichienne, et dont le corps de Rosenberg faisait l'arrière-garde, avait quitté la grande route, pris à gauche, et s'était dirigé sur Laah. Aucun corps n'avait continué sur Nikolsbourg.
Comme c'était l'ennemi que j'allais chercher et non Nikolsbourg, j'envoyai deux cents chevaux seulement à trois lieues sur la grande route pour m'éclairer, et je pris celle que l'ennemi avait suivie. Je rencontrai une forte arrière-garde que je chassai devant moi. Je ne pus la poursuivre comme je l'aurais désiré, parce que le général Montbrun ne m'avait pas encore rejoint, et je pris position à Mitlebach. Le lendemain matin, je me portai sur Paysdorf et sur Stadet, par lesquels s'étaient dirigées les troupes que j'avais combattues la veille. Je trouvai à Stadet douze cents chevaux, deux bataillons de chasseurs et cinq pièces de canon. Ces troupes furent culbutées, dispersées; nous fîmes trois cents prisonniers, et je continuai mon mouvement sur Laah, où j'espérais trouver l'ennemi plus en force et avant qu'il eût pu passer la Taya.
Rien dans le monde ne peut exprimer la chaleur que les troupes éprouvèrent pendant cette journée; beaucoup de soldats restèrent en arrière, et le mal fut augmenté par l'ivrognerie et le désordre. La Moravie est riche en vins: d'immenses caves renferment toujours la récolte de plusieurs années. Celles de Stadet furent forcées, et l'ivresse, ajoutée à la chaleur et à la fatigue, anéantit, pour ainsi dire, dans un moment, toute l'infanterie de mon corps d'armée.
Je trouvai seulement à Laah quelques troupes de cavalerie légère qui se retirèrent à mon approche, et j'aurais pu passer la Taya le même jour si mes troupes eussent été en ordre; mais je n'avais pas avec moi le quart de mon monde, et il fallut nécessairement attendre sur le bord de la rivière, après avoir pris poste de l'autre côté pour conserver cette multitude de ponts qu'il fallait passer.
Je réunis les officiers pour me plaindre du manque de surveillance. Je vis dans les bivacs toutes les compagnies l'une après l'autre, et j'exhortai les soldats, quand nous étions si près de l'ennemi, à ne pas retomber dans des fautes semblables. Je publiai un ordre extrêmement sévère, et, pour imposer une salutaire terreur, je fis juger et exécuter deux soldats coupables d'insubordination. Enfin j'attendis impatiemment le crépuscule pour marcher sur Znaïm, point sur lequel toutes les colonnes de l'armée ennemie se dirigeaient, et où je craignais de ne plus trouver qu'une arrière-garde.
Je reçus dans cette journée une lettre du maréchal Davoust, arrivé avec son corps à Wülfersdorf; il me demandait des nouvelles et m'annonçait qu'il était prêt à me soutenir si j'avais besoin d'appui. Je l'informai de ce qui s'était passé et du mouvement que j'allais faire sur Znaïm, lieu de réunion et de passage de toutes les colonnes de l'armée ennemie. Je me contentai de lui exposer les faits sans l'appeler à moi ni lui demander de secours, et je fis mal. La destruction de l'armée autrichienne, et par suite celle de la monarchie, ont peut-être tenu à cette circonstance. On concevra mes motifs, et ils paraîtront excusables. Je n'avais réellement devant moi que des forces inférieures, et il y a une sorte de pudeur à ne pas demander des secours quand on n'en a pas besoin; il y a même une espèce de ridicule à agir autrement: je venais de rejoindre la grande armée, et je tenais à honneur de ne pas me montrer faible et craintif.
Je ne parle pas de la conséquence qu'aurait eue pour moi l'arrivée de Davoust, qui, par son grade, m'aurait commandé; jamais pareille pensée n'est venue à mon esprit, et jamais une question d'amour-propre n'est entrée en balance, à mes yeux, avec les intérêts dont on m'avait chargé. J'ai toujours eu trop de conscience, j'ai toujours été trop avare du sang de mes soldats pour avoir fait jamais pareil calcul; je crus devoir attendre, pour réclamer le secours qu'on m'offrait, jusqu'au moment où le besoin m'en paraîtrait évident.
D'un autre côté, Davoust, placé à regret en seconde ligne, fut enchanté de ma réponse; il se crut autorisé à quitter la route que j'avais suivie et à marcher sur Nikolsbourg, où, par une singulière manoeuvre, après avoir fait un crochet que rien n'explique, et passé la Taya, le prince de Rosenberg s'était reporté.
Toutefois, quel que fût le coupable, de l'Empereur, de Davoust ou de moi, je restai complétement isolé.
Le 10, à la pointe du jour, je passai la Taya, et je marchai sur Znaïm en remontant la rive gauche. Montbrun, avec toute sa cavalerie, formait mon avant-garde. Arrivé à trois quarts de lieue de Znaïm, il rencontra quelques tirailleurs d'infanterie qui occupaient des vignes que nous avions à traverser, et il me demanda deux bataillons d'infanterie pour les en chasser. Je jugeai la chose plus sérieuse, et je marchai moi-même avec une division. En approchant de la hauteur en face de Znaïm, qui, de ce côté, cache la ville et forme, avec la montagne sur le revers de laquelle elle est bâtie, le bassin de Znaïm, je vis des troupes d'infanterie arriver à la course pour l'occuper et la défendre: il pouvait y avoir de cinq à six mille hommes.
Chaque moment de retard devait ajouter à la difficulté; je fis attaquer cette position par la division Clausel, soutenue à gauche et en échelons par la division bavaroise, gardant en réserve la division Claparède (le général Claparède avait remplacé le général Montrichard). Le 8e d'infanterie légère et le 25e de ligne furent seuls engagés; ils suffirent pour emporter la position, en chasser l'ennemi et lui enlever deux drapeaux du régiment de l'archiduc Charles. La hauteur que nous attaquions communiquait avec une plaine découverte qui se prolongeait en arrière de Znaïm, et, à cinq cents toises sur ma droite, elle était terminée et bordée par un bois. Le général Montbrun appuya sur la droite le mouvement de mon infanterie, prit position à l'entrée de la plaine, couvert à droite par le bois dont je viens de parler, et il s'établit sur plusieurs lignes avec sa nombreuse cavalerie et son artillerie.
Arrivé à cette position, je découvrais Znaïm en face de moi, et, de l'autre côté de la Taya, sur la route d'Hollabrunn, une immense quantité de troupes, d'artillerie et de bagages. Je me trouvais ainsi derrière l'armée autrichienne. Znaïm était occupé. On apercevait, en arrière de Znaïm, sur la route de Bohême, beaucoup de troupes et d'artillerie, et les colonnes passaient le pont de la Taya pour suivre le mouvement général de rassemblement qui s'opérait sur cette ville.
En ce moment, je regrettai vivement de n'avoir pas appelé à moi le maréchal Davoust. S'il eût été là pour me soutenir, je me serais emparé de Znaïm, et, me mettant ensuite en bataille en face du pont, tandis que lui aurait chassé tout ce qui était en arrière de la ville, il m'aurait couvert contre ces troupes. Alors l'armée autrichienne était gravement compromise; elle n'avait plus de retraite; elle aurait été obligée de remonter la Taya par des chemins et un pays difficiles. Le moins qui eût pu lui arriver, c'eût été de perdre tout son matériel et d'être complétement désorganisée. Mais la fortune en avait décidé autrement. J'envoyai officiers sur officiers à Davoust; il s'était lancé sur Nikolsbourg; il ne pouvait plus me rejoindre dans la journée.
Je ne pouvais renoncer cependant à faire une tentative. Si l'ennemi n'était pas en force derrière Znaïm, je pouvais, quoique seul, essayer le mouvement que la présence de Davoust eût rendu infaillible. Avant de le commencer, je voulus bien connaître la force de l'ennemi sur le plateau. Je donnai l'ordre à Montbrun de s'avancer dans la plaine et jusque derrière la ville, s'il le pouvait. Montbrun, après avoir fait replier ce qui était devant lui et enlevé trois cents hommes à l'ennemi, rencontra, à un mille environ, des forces très-considérables, qu'il estima à quarante mille hommes de toute arme. Dès lors, il crut ne pas pouvoir, sans un grand danger, s'éloigner davantage, tandis que moi je ne pouvais tout à la fois occuper les hauteurs défensives, dont j'étais en possession, et opérer sur Znaïm et sur le pont. Il fallut se résigner à un rôle défensif.
Devant d'aussi grandes forces, ce rôle n'était pas sans danger; mais, fort de l'ardeur de troupes victorieuses, et calculant que l'ennemi ne connaissait pas ma force et devait me croire soutenu, je m'y décidai. Tout mon front était couvert par un escarpement facile à défendre. Je fis occuper, créneler et retrancher deux fermes à ma droite, qui appuyaient ma cavalerie; occuper, par de l'infanterie légère, la lisière du bois placé à la droite de ma cavalerie; couronner tout le plateau par mon artillerie, dont le feu atteignait à la grande route; enfin occuper en force le village de Tisevich. Ce village était placé en flèche au-dessous de ma position, en avant de mon front, qu'il prenait de revers sur tout son développement. Il avait en outre action sur le pont, par lequel l'armée autrichienne défilait. Masséna, à environ deux lieues de nous, la suivait, et son canon répondait au nôtre.
Une brigade bavaroise, commandée par le général Becker, était chargée de la défense de Tisevich. L'ennemi, que la possession de ce village gênait beaucoup, dirigea sur lui des attaques. Les Bavarois le reçurent d'abord avec vigueur; mais il fallut bientôt aller à leur secours. J'envoyai en renfort un régiment de la seconde brigade. Il fut insuffisant. En moins de deux heures, toute la division bavaroise y fut employée. Fatigué de tant de mollesse, je la fis remplacer par un seul régiment français, le 81e, composé de deux bataillons, et telle est la supériorité des troupes françaises sur les autres troupes, que ce brave régiment suffit seul pour défendre, pendant cinq heures, le village contre les efforts constants des Autrichiens. Ce village fut pris en partie et repris plusieurs fois, et enfin conservé. Les troupes autrichiennes hâtaient leur retraite et s'empressaient de repasser le pont en défilant sous le feu de notre artillerie. À la fin de la journée, voyant beaucoup de désordre, je lançai du village de Tisevich les chevau-légers bavarois, qui causèrent une grande confusion et ramenèrent un bon nombre de prisonniers.
La nuit survint, et je gardai toutes mes positions, où je me fortifiai de nouveau. Plusieurs officiers généraux, sous mes ordres, étaient d'avis de s'éloigner pendant la nuit; mais je n'eus garde d'y consentir. Nous retirer, c'était nous avouer battus, et nous étions vainqueurs. L'armée allait être effectivement pelotonnée devant nous le lendemain; mais Masséna serait arrivé, et Davoust aussi de son côté. Je tins bon, et je fis bien.
À neuf heures du soir, le lieutenant général de Fresnel, émigré français au service d'Autriche, se présenta aux avant-postes et vint de la part de M. de Bellegarde, mais, dans le fait, envoyé par l'archiduc, pour proposer un armistice. Je lui fis répondre que, n'étant pas autorisé à en conclure, j'allais rendre compte de sa proposition à l'Empereur. Combien sont grands les jeux de la fortune! Le même général, auquel le généralissime autrichien s'adressait pour obtenir l'armistice qui a sauvé sa monarchie, placé, quelques mois auparavant, aux confins de la Dalmatie, à deux cent cinquante lieues, avait été sommé de se rendre, au commencement de la guerre, par l'archiduc Jean. Ce rapprochement, après une si longue marche et tant de difficultés vaincues, avait quelque chose de satisfaisant pour moi.
Le lendemain matin, 11 juillet, toute l'armée ennemie avait passé la Taya: ses troupes occupaient Znaïm en force; elles voyaient le pont, le village de Tisevich, et étaient appuyées par des lignes multipliées, formées à la gauche et en arrière de Znaïm. Comme elle allait opérer sa retraite, je réunis mes troupes et les portai en avant pour la prendre en flanc quand le mouvement serait commencé. Masséna voulut déboucher du pont, mais la tête de sa colonne, à peu de distance de la rivière, chargée par les cuirassiers autrichiens, fut renversée; lui-même, jeté dans un fossé, faillit être pris. Davoust arrivait avec son corps; j'allais être soutenu et je ne risquais plus rien. La situation de Masséna me décida alors à marcher sur Znaïm, et j'allais y pénétrer quand l'Empereur arriva et m'envoya dire d'annoncer que j'étais autorisé à traiter d'un armistice. Des officiers traversèrent la ligne des tirailleurs pour l'annoncer, et le feu cessa de part et d'autre. Chacun garda le terrain qu'il occupait; et, dans la soirée, le prince de Neufchâtel et le prince de Lichtenstein signèrent un armistice qui remettait entre nos mains les citadelles de Brunn, de Gratz, et donnait à l'armée française pour arrondissement tout le pays qu'elle occupait, et de plus les cercles de Znaïm, de Brunn, et les comitats de Presbourg et d'OEdenbourg, en Hongrie.
Cet armistice était le gage de la paix. L'ennemi, dans les deux combats de Znaïm, perdit cinq à six mille hommes, dont quinze cents prisonniers, deux drapeaux et six pièces de canon. J'eus mille à douze cents hommes hors de combat.
L'Empereur établit sa tente sur le plateau où j'avais combattu. Je mis mon quartier général au-dessous de cette position, dans un petit village appelé Hangsdorf.
Le lendemain matin, 12 juillet, j'allai voir l'Empereur: il était radieux. Je lui parlai avec détail des combats de la veille et de l'avant-veille. Il loua la vigueur et la résolution que j'avais montrées, mais me blâma avec raison de n'avoir pas appelé plus tôt Davoust. Il entra ensuite dans le détail de ma campagne, depuis mon entrée en Croatie. S'occupant à en faire la critique, il me demanda les motifs des diverses opérations. La justification en était facile, car j'avais toujours agi avec système et calcul; et je crois pouvoir dire aujourd'hui, après tant d'années écoulées, que cette campagne, eu égard aux difficultés et au peu de moyens mis à ma disposition, mérite, de la part des gens de guerre, quelques éloges. Ses conclusions m'étaient favorables et mes réponses le satisfaisaient; mais il semblait prendre à tâche de me trouver en faute et le chercher avec ardeur. Ma conversation, en me promenant avec lui devant sa tente, dura plus de deux heures et demie. Il y rentra pour travailler avec Berthier.
J'étais accablé de fatigue et mécontent. De retour dans la misérable cabane que j'avais choisie pour asile, je commençais, après m'être étendu sur la paille, à raconter à mon chef d'état-major, le général Delort, pour lequel j'avais beaucoup d'amitié, la singulière et fatigante conversation que je venais d'avoir avec l'Empereur, quand Alexandre Girardin, aide de camp du prince de Neufchâtel, le même qui a été premier veneur de Charles X, entra chez moi et me dit: «Mon général, voulez-vous bien me permettre de vous embrasser?--Tant que vous voudrez, mon cher Girardin, lui répondis-je; mais il y a du mérite à embrasser une aussi longue barbe et un homme aussi sale.» Et immédiatement après il ajouta: «Voilà votre nomination de maréchal.»
J'étais à mille lieues d'y penser, tant cette conversation avec l'Empereur m'avait laissé une impression pénible: c'est tout au plus si je le compris. Chose incroyable! je n'en éprouvai pas alors une joie très-vive. À l'époque de la création des maréchaux, j'avais été fort affecté de ne pas être nommé: depuis je m'étais accoutumé à placer dans mon esprit le commandement au-dessus de la dignité; et, comme c'était la gloire qui me touchait avant tout, j'étais particulièrement sensible aux moyens de l'acquérir. Je fus content, mais sans être transporté. Quelques jours après, je reconnus l'immense pas fait comme existence, à la différence des manières des généraux avec moi, et comme occasion de gloire, par l'importance des commandements que ma nouvelle position m'assurait pour l'avenir.
Mon corps d'armée fut dirigé sur Krems; on m'assigna, pour le faire vivre, le cercle de Korneuburg, et de ma personne j'établis mon quartier général dans le beau château de Graveneck, situé à peu de distance du lieu où je fis camper mes troupes.
À cette époque, Bernadotte quitta l'armée. Son corps, à Wagram, avait on ne peut plus mal fait, et c'était tout au plus si lui-même s'était conduit en homme de coeur. Il osa attribuer le gain de la bataille à ses Saxons, qui avaient fui honteusement. L'Empereur en fut irrité et blessé. Un ordre du jour, communiqué seulement aux commandants des corps d'armée, fut publié, et le censurait avec sévérité, mais avec justice. L'Empereur lui donna l'ordre de quitter l'armée et de se rendre à Paris, sous prétexte de santé.
Mon corps d'armée fut augmenté d'une division de troupes de la confédération, d'une belle division de cuirassiers et d'une brigade de cavalerie légère. J'établis un magnifique camp à quelque distance de Krems, et je fis construire des baraques régulières en paille, dans la forme de nos tentes de toile. Ce camp présentait un très-beau coup d'oeil. Les soldats y furent dans l'abondance et y jouirent du plus grand bien-être. L'Empereur, qui n'avait pas vu ces troupes depuis plusieurs années, vint les passer en revue. Il leur témoigna une grande satisfaction, leur accorda beaucoup d'avancements et les combla de récompenses. Ces récompenses méritées, données aux compagnons de nos travaux, sont plus douces pour un chef que celles qui lui sont propres. J'en éprouvai beaucoup de bonheur.
J'avais un logement à Vienne; j'allais souvent dans cette ville, et, quand je m'y trouvais, je me rendais le matin à la parade de Schoenbrunn pour y faire ma cour à l'Empereur. Les maréchaux déjeunaient avec lui après la parade, et là, on se livrait, pendant une heure ou deux, à une conversation animée et spirituelle. Comme le plus jeune, je fus chargé de lire un jour toutes les dépêches relatives à la bataille de Talaveyra, livrée et perdue récemment en Espagne. Napoléon était furieux contre son frère, et contre Jourdan, son conseil.
Effectivement, cette bataille fut donnée sans aucun calcul et avec la plus grande inutilité; mais l'événement et les circonstances qui s'y rattachent ont été assez importants, et j'ai connu assez bien ce qui s'est passé, pour pouvoir consigner ici mes souvenirs et en faire un récit succinct.
L'Empereur, rappelé d'Espagne, où il se trouvait, par la nouvelle des préparatifs des Autrichiens, quitta l'armée au moment où elle était à la poursuite de l'armée anglaise. Celle-ci, après avoir repassé l'Esla, se retira sur la Corogne. Sa retraite fut pénible, et, comme elle manquait de tout et qu'une armée anglaise est accoutumée à ne manquer de rien, elle souffrit plus qu'une autre, et arriva dans le plus grand désarroi devant cette ville. Le deuxième corps d'armée, commandé par le maréchal Soult, était chargé de la poursuivre. Tous ceux qui ont été témoins des événements prétendent que l'occasion était belle pour la détruire; mais Soult fit là comme partout: il hésita, et l'occasion lui échappa. Après le rembarquement de l'armée anglaise, il eut l'ordre d'entrer en Portugal et d'en faire la conquête. Rencontrant des milices et des rassemblements de paysans, il les battit et s'empara d'Oporto; en continuant sa marche sans retard, il serait entré à Lisbonne.
J'ignore quel mauvais génie l'inspira et le fit s'arrêter; mais, chose tout à la fois singulière et certaine, c'est qu'il rêva la couronne de Portugal. Soult, doué de très-peu d'esprit, fort passionné, a une ambition sans bornes: sa réputation de finesse est fondée sur son habitude de dire toujours le contraire de sa pensée, et encore cette finesse et cette ruse disparaissent quand ses passions parlent, car alors son intelligence s'obscurcit au point de le faire tomber dans des aberrations incroyables. On a vu des généraux rêver des couronnes après de longues guerres, dans les temps de désordre et d'anarchie, et lorsqu'ils commandaient des troupes sans patrie, des mercenaires que l'habitude, l'intérêt et l'esprit de bande attachaient uniquement à leurs chefs; mais, dans un temps d'ordre et de discipline, avec un souverain auquel l'Europe était soumise, avec une armée nationale, et lorsque le chef de l'État était avant tout le chef des soldats, vouloir lui forcer la main pour s'emparer d'une couronne, c'est une pensée qui n'est jamais venue à personne, avant d'être entrée dans la tête du maréchal Soult.
Il eut donc la fantaisie de devenir roi de Portugal et de se faire demander par les Portugais à l'Empereur. Arrivé à Oporto et joint par quelques intrigants portugais, il s'occupa à réunir dans cette ville une assemblée pour faire prononcer la déchéance de la maison de Bragance et demander à l'Empereur un nouveau souverain: bien entendu que le choix tomberait sur lui. Le bruit de cet étrange projet se répandit dans l'armée et y produisit, comme on l'imagine, l'effet le plus fâcheux. Soult n'était pas aimé, et ses ennemis relevaient avec d'autant plus de plaisir le ridicule et la folie de son entreprise. On ne parlait plus que du roi Nicolas. Le maréchal donna un ordre du jour à l'occasion des bruits qui couraient, et cet ordre du jour, en cherchant à donner une explication raisonnable, les confirma.
Il résulta de tout cela une sorte de désorganisation de l'armée, toute au profit de l'ennemi. Un nommé Argenton, adjudant-major du 18e régiment de dragons, alla trouver les Anglais, et annonça qu'il était envoyé par un comité composé des principaux généraux pour faire connaître le mécontentement de l'armée, le désir qu'elle éprouvait de rentrer en France, et pour s'entendre sur l'évacuation du Portugal. Le prétendu comité demandait à l'armée anglaise d'avancer et de suivre l'armée française, qui à son approche se retirerait. Argenton était spirituel; il convainquit les généraux anglais, eut des passe-ports pour franchir les avant-postes, annonça qu'il reviendrait avec des pouvoirs, revint sans les avoir, parce que, dit-il, la prudence l'avait commandé, retourna, et, au milieu de ses allées et venues, au milieu de la division de l'armée et de la désorganisation occasionnée par tant d'intrigues et de l'incroyable préoccupation de Soult, les Anglais passèrent le Duero sans rencontrer un seul de nos postes, et vinrent surprendre Soult à Oporto au milieu d'un baisemain. Le maréchal sortit de cette ville sous les coups de fusil de l'ennemi: une demi-heure plus tard, il aurait été fait prisonnier.
Cette sortie d'Oporto, où toutes les administrations et tous les embarras de l'armée s'étaient établis, fut une déroute. Pour comble de malheur, l'ennemi s'empara du point de retraite, du pont d'Amarante, et Soult fut contraint de diriger l'armée sur Montalegre. Mais la route n'était pas praticable aux voitures; il fallut donc abandonner bagages et artillerie, quatre-vingts pièces de canon, et se retirer avec le personnel et les chevaux, en passant par un véritable trou d'aiguille. Argenton, surpris au moment où il revenait de l'armée anglaise, fut arrêté; on trouva sur lui des passe-ports anglais. Conduit prisonnier, il s'échappa, rejoignit l'armée anglaise, passa en Angleterre, et vint débarquer sur la côte de Boulogne, où il fut fusillé. La promptitude de son exécution autorisa à croire que sa mort, bien méritée assurément, avait pour objet de cacher quelque mystère.
J'ignore quels moyens Soult prit pour expliquer une si triste et si déplorable campagne, dont toutes les fautes lui étaient personnelles et dont quelques-unes étaient criminelles. Il envoya son aide de camp, Brun de Villeret, à l'Empereur, pour lui expliquer ces étranges événements. Un des arguments du maréchal, argument dont il s'est servi en me parlant lui-même pour se justifier de ce qui s'était passé alors, était qu'il avait voulu ajouter une force morale à la puissance des armes. L'Empereur hésita s'il ferait justice de Soult; mais il réfléchit au scandale qui naîtrait de la publicité: l'effet lui en parut devoir être pire que la punition ne serait salutaire, et il se décida à tout ignorer vis-à-vis du public.
Cependant son juste mécontentement l'emporta sur le calcul, comme il arrivait souvent chez lui; et, longtemps après, voyant le général Ricard, chef de l'état-major de Soult, se présenter timidement à son audience, il l'apostropha en présence de deux cents personnes, et lui dit qu'il méritait la mort pour avoir trempé dans une semblable félonie.
Avant d'être informé des événements d'Oporto, l'Empereur avait ajouté au commandement de Soult celui des cinquième et sixième corps, afin de mettre de l'ensemble dans les mouvements, et Soult se trouva ainsi investi d'un très-grand pouvoir au moment où il en était le moins digne et où il redoutait les plus rudes châtiments. D'un autre côté, en sortant de Portugal, Soult avait fait le tableau le plus triste de l'état de son corps d'armée dans un rapport à Joseph. Ce rapport fut intercepté par Wellington: celui-ci savait d'ailleurs à quoi s'en tenir sur l'état du deuxième corps, dont il avait pris ou vu détruire tout le matériel. Aussi, quand, placé dans la vallée du Tage, en position à Talaveyra et se disposant à marcher sur Madrid, on lui fit le rapport que le corps de Soult se portait sur ses derrières, passait le col de Baños et marchait sur le Tiétar pour le prendre à revers, il rit de son entreprise.
Ce ne fut que la veille du jour où l'armée allait le joindre, lorsqu'elle passait le Tiétar, qu'il sut que ce n'était plus le deuxième corps détruit et hors d'état d'agir, mais une armée de cinquante mille hommes en bon état, prête à l'écraser. Il ne perdit pas un moment pour repasser le Tage et se couvrir par cette rivière. Ne pouvant plus se rendre au pont d'Almaraz, placé sur la grande communication, il passa le fleuve à celui de l'Arzobispo, plus à portée. Joseph, qui savait à jour fixe le moment de l'arrivée de Soult, ne devait pas s'avancer jusqu'à Talaveyra, et encore moins attaquer les Anglais dans une telle position. S'il était pressé de revenir sur Madrid pour couvrir cette ville contre l'armée espagnole en marche pour s'y rendre, un faible corps sur l'Alberche suffisait pour observer les Anglais, retarder leur marche et donner le temps à Soult d'arriver. S'il était tranquille sur Ceusta, il fallait rester à portée de l'armée anglaise pour tomber sur elle à l'instant où elle décamperait; et enfin, s'il voulait absolument combattre, il fallait attaquer les Anglais avec plus d'ensemble, d'une manière moins décousue. Mais tout fut absurde, jusqu'au choix de l'officier que Joseph chargea d'aller rendre compte des événements à l'Empereur. Il confia cette mission à Carion Nisas, poëte de profession, militaire par hasard, triste avocat pour une pareille cause. Il ne sut pas rendre compte de la manière dont les troupes étaient formées. Il ne sut pas dire comment les attaques avaient été conduites. L'humeur de l'Empereur en augmenta au point que je l'ai vu rarement exprimer son mécontentement en termes aussi durs.
Pour achever l'épisode de la campagne d'Espagne, je dirai que l'armée anglaise, ayant passé le Tage au pont d'Arzobispo, dut se retirer par le chemin de Mezza da Ibor, au milieu de montagnes roides et impraticables. L'infanterie anglaise, étant séparée de son canon pendant plus de huit jours, et le Tage guéable à Almaraz, Soult, avec une armée si supérieure et si bien outillée, se trouvant d'ailleurs si près, pouvait détruire les Anglais. S'il eût passé le Tage, il forçait l'ennemi à la retraite et à abandonner tout son matériel; il le rejetait en Portugal dans un état complet de désorganisation, et fixait le destin de la guerre. Mais le caractère des hommes, règle constante des habitudes de leur vie et de leur manière d'être, se retrouve toujours dans les grandes occasions, et Soult, pour son malheur et pour celui de son armée, ne put échapper au sien en cette mémorable circonstance. Il se trouva sans résolution au moment d'agir et sans force au moment du danger, et la présence d'une armée si belle, que le hasard avait réunie un moment et placée dans une situation si favorable, ne servit qu'à montrer de nouveau et son incapacité et la fortune de Wellington.
La fête de l'Empereur arriva. Elle fut célébrée dans tous les corps d'armée et à Vienne avec une grande pompe. L'Empereur donna beaucoup de récompenses, et, entre autres, il fit princes Masséna et Davoust, et leur donna d'énormes dotations. Il était constamment occupé à stimuler les ambitions, et, à mesure que l'un s'élevait, il créait un échelon de plus pour donner l'envie d'y arriver et prévenir le sommeil dans le poste où l'on était arrivé. Pourvu du titre de duc et de maréchal d'Empire, l'ambition semblait devoir être satisfaite; mais il fallait à l'instant voir le néant de ce que l'on possédait; car c'est ainsi que l'ambitieux envisage sa situation quand il n'est pas arrivé au dernier terme. Aussi, pour tout le monde, dans toutes les situations, c'étaient des accès d'une fièvre dont chaque jour augmentait l'activité.
À cette époque, les Anglais firent sur Anvers une expédition, commandée, si je ne me trompe, par lord Chatam. Ils y employèrent des forces considérables, et, malgré cela, échouèrent. Cependant rien n'était préparé de notre côté pour la défense, et la résistance de Flessingue, poste avancé d'Anvers, avait été nulle. Le général Monet s'y était mal conduit. Je n'en éprouvai aucune surprise: je l'avais jugé un mauvais officier, beaucoup plus occupé à s'enrichir en faisant la contrebande qu'à remplir ses devoirs. Un bombardement de deux jours le fit capituler. Dans l'état où était Flessingue, avec les travaux exécutés, cette place pouvait facilement tenir pendant quinze jours de tranchée ouverte.
La reddition subite de Flessingue ouvrit l'Escaut à l'ennemi. Anvers était sans garnison; mais il renfermait tout le personnel d'un grand port: beaucoup d'ouvriers, le fond de plusieurs équipages, et ensuite les équipages mêmes des vaisseaux qui devaient s'y réfugier et quitter leur station dans la rade de Flessingue. Le conseil des ministres envoya Bernadotte pour commander à Anvers, et mobilisa beaucoup de gardes nationales qui furent dirigées sur ce point. Le choix de Bernadotte déplut à l'Empereur. Sa conduite à Wagram lui avait laissé une profonde impression de mécontentement. Il révoqua ce choix aussitôt, et remplaça Bernadotte par le duc d'Istrie, alors à Paris, par suite de la légère blessure reçue à Wagram. La défense d'Anvers s'organisa. Les Anglais mirent une grande lenteur dans leurs mouvements; les maladies, si communes dans le pays en cette saison, ravagèrent leur armée, et ils durent assez promptement songer à la retraite.
L'Empereur en éprouva une grande joie; il se livra à un mouvement d'orgueil légitime. La majesté de l'Empire lui semblait suffire pour rendre son territoire inviolable: la terre seule de France rejetait d'elle-même l'étranger qui osait la souiller. Cela était vrai, cela sera toujours vrai, quand le patriotisme des Français ne sera pas neutralisé par leurs divisions, quand un sentiment unique animera toute la nation, quand surtout, en défendant son gouvernement, elle croira défendre ses richesses, son bien-être et sa liberté.
L'Empereur s'égayait beaucoup, à cette époque, sur le compte des marins. Ceux-ci avaient toujours prétendu que la navigation de l'Escaut présentait de grandes difficultés pour les vaisseaux de ligne. Les bancs au-dessous d'Anvers empêchaient, disait-on, de les armer avant d'être arrivés dans la rade: enfin il était prudent de se servir de chameaux 3 pour descendre les vaisseaux jusqu'au lieu de leur armement. Ce mode de transport, de tout temps en usage en Hollande, avait été proposé pour Anvers. «Eh bien, disait Napoléon en riant de tout son coeur, voyez les beaux effets de la peur! L'escadre de l'amiral Missiessi était dans la rade de Flessingue, prête à mettre en mer, armée, approvisionnée, ayant son eau à bord; l'apparition des Anglais a produit un effet tel, que l'escadre, dans cet état, a remonté l'Escaut par un vent peu favorable, en louvoyant sans s'échouer, et elle s'est si bien trouvée de ce mouvement, que quelques vaisseaux ont dépassé Anvers et sont entrés dans le Rupel, un de ses affluents. À quelque chose malheur est bon: les Anglais nous auront appris toute la valeur et toutes les propriétés de cet établissement maritime.»
Note 3: (retour) Les chameaux sont deux corps creux ou grandes caisses, dont un côté a la courbure de la muraille d'un vaisseau, de manière qu'ils s'appliquent sur ses flancs immédiatement. Ils sont descendus à la hauteur de la quille du vaisseau au moyen de l'eau dont on les remplit. On les lie au vaisseau avec des cordages, et ils font corps avec lui. On vide l'eau avec des pompes; ils soulèvent le vaisseau et diminuent son tirant d'eau.
À l'occasion de la descente des Anglais, j'offris à l'Empereur et je fis remettre par son ordre, au ministre de la guerre, un travail fort circonstancié, fait pendant mon séjour en Hollande, sur la défense de la Zélande et sur les moyens de communication possibles entre les îles, malgré des forces maritimes supérieures.
L'éloignement de Napoléon pour Bernadotte datait d'une époque antérieure. Celui-ci avait plus d'une fois trempé dans des intrigues plus ou moins coupables envers lui. Sa grande mobilité le faisait fréquemment changer de langage; on l'accusait de fausseté, et je l'ai souvent défendu auprès de l'Empereur de ce tort apparent, en l'attribuant au déréglement de son imagination. Les événements de Wagram avaient éveillé l'antipathie de Napoléon. Peu de temps après l'époque à laquelle je suis arrivé dans mes récits, la fortune appela Bernadotte à devenir l'héritier de la couronne de Suède. À cette occasion, l'Empereur lui exprima l'opinion qu'il avait de lui d'une manière si plaisante, que je ne puis me refuser à consigner ici cette anecdote. Bernadotte, avec ses manières agréables, son ton de Gascon, avait été en rapport avec beaucoup d'officiers suédois prisonniers, à l'époque où il commandait à Hambourg. Ces officiers avaient conservé de lui le souvenir le plus favorable. Quand, plus tard, les Suédois cherchèrent un successeur au trône, ils pensèrent à lui. Par là, leur but de se soustraire à l'influence de la Russie était atteint; ensuite, comme maréchal français, ils supposèrent cette démarche agréable à l'Empereur. Enfin, Bernadotte étant placé dans une sorte d'opposition, on crut, avec raison, qu'il ne serait pas l'esclave de son ancien maître. Tel fut le secret de sa nomination.
L'Empereur n'en avait pas eu le moindre avis. Bernadotte ne s'en doutait pas davantage. Bien plus, Bernadotte, alors très-mal avec Napoléon et soupçonné de nouvelles intrigues, était l'objet d'une sorte de surveillance de la police; aussi se conduisait-il avec circonspection. Au milieu de ses préoccupations, un étranger demande à lui parler. Cet individu, qu'il ne connaît pas, lui annonce que les États de Suède l'appellent à succéder au roi Charles XIII. Il ne comprend rien à ce discours, croit à une mystification, et se fâche. L'autre, fort étonné, se justifie par les papiers dont il est porteur. Bernadotte court à Saint-Cloud, où était l'Empereur, le fait sortir du conseil, et lui communique ce qu'il vient de recevoir. L'Empereur n'en revient pas, refuse d'y croire, et à deux reprises lui dit que c'est une plaisanterie. «Cependant, lui répond Bernadotte, les lettres sont authentiques.--Cela est vrai, réplique Napoléon; cela paraît certain; je ne puis mettre obstacle au succès de leur demande: il est trop honorable pour la France et pour moi de voir les peuples venir choisir leurs souverains parmi mes généraux. Ainsi acceptez; mais tout ce que je puis vous dire, c'est qu'ils font un mauvais choix.»
Napoléon voulut cependant alors établir dans le public l'opinion qu'il avait contribué à l'élévation de Bernadotte. Mais je l'ai entendu moi-même souvent exprimer son indignation et son mépris de la conduite de Charles XIII, en déshéritant son sang, et dire: «Il fallait bien remplacer Gustave-Adolphe, puisqu'il était fou; mais c'était son fils qu'il fallait appeler à lui succéder.»
Les négociations de paix avançaient. L'Empereur m'envoyait souvent chercher pour me parler des provinces autrichiennes qu'il avait l'intention de se faire céder. Les ayant parcourues et habitées, je les connaissais fort bien. Je lui appris tout le parti qu'on pouvait en tirer. Il m'annonça son désir de m'y renvoyer avec des pouvoirs sans limites, pour faire de ce pays, en le plaçant hors de l'empire et du royaume d'Italie, un poste avancé destiné à couvrir ses États, qui serait gouverné et administré sous l'autorité du général qui y commanderait. Il voulait créer ainsi une frontière toute militaire, comme l'étaient dans le moyen âge les margraviats; et il me dit en riant: «Et vous serez margrave.»
Dans une de ces conversations, il m'entretint de ma position domestique. Il n'aimait pas ma femme: il connaissait ses torts envers moi; il me parla de divorce, en développa les motifs, me le présentant comme un élément nécessaire à un grand avenir pour moi; il m'y engagea de la manière la plus vive. J'appréciais ces motifs comme lui; mais un sentiment de justice et de bonté, naturel à mon coeur, me fit résister à ses instances. J'avais aimé ma femme; elle m'avait donné sa jeunesse; je savais de quel prix étaient pour elle les jouissances de l'orgueil et de la vanité. Le changement de sa situation, le malheur et l'humiliation qui en seraient la suite, la mettraient au désespoir. Je croyais la toucher par cette conduite généreuse, et en trouver le prix dans ses soins et un attachement véritable. Le commerce de la vie doit se composer d'indulgence réciproque. De bonne heure j'ai mis du prix aux souvenirs: comment en retrouver d'agréables si on se sépare de ceux avec lesquels l'on a passé ses premières années? Je crus donc devoir me refuser à un parti qui aurait eu une si grande influence sur ma destinée, l'aurait embellie et consolée. Dieu sait le prix que j'ai retiré d'une conduite si délicate! Je repousse aujourd'hui les souvenirs les plus pénibles de ma vie. Je ne parlerai plus qu'une fois de cette malheureuse union; mais je le ferai avec détail, à cause des débats publics qu'elle a occasionnés, et l'on saura quelle masse de chagrins une mauvaise femme peut accumuler dans le coeur d'un honnête homme.
Au moment où l'Empereur signait la paix, il prévoyait de nouvelles guerres qui devaient le ramener dans ces mêmes contrées. Il n'avait pas alors l'idée de ce mariage dont les résultats devaient être si funestes pour lui par la folle confiance qu'il lui inspira. Il m'engagea à étudier le pays occupé par l'armée, afin de pouvoir un jour me servir des connaissances que j'aurais acquises. Je fis donc une tournée fort intéressante. J'allai voir Presbourg et ses environs, le cours de la March. Je visitai le champ de bataille d'Austerlitz et la citadelle de Brunn, et je rentrai chez moi en revenant par Znaïm. Plus tard, je me rendis à Saint-Pölten, position indiquée pour combattre en avant de Vienne, et je reconnus la rive gauche du Danube depuis Moelk jusqu'à Krems.
Un armistice de deux mois avait rétabli complétement l'armée. Mon corps, renforcé de tous mes troisième et quatrième bataillons, et d'un grand nombre de recrues, était augmenté d'une belle cavalerie; mais la paix, alors d'accord avec la politique de l'Empereur, devait avoir lieu. Elle fut hâtée par l'attentat commis sur lui, et qu'un simple hasard et la présence d'esprit du général Rapp firent échouer. Cet événement a été raconté par tout le monde, et je n'en dirai qu'un mot. Il était le produit d'un fanatisme patriotique dont toutes les têtes de la jeunesse allemande étaient enflammées. Napoléon en fut très-effrayé, et on le tint secret alors, autant que possible.
Les négociations de la paix n'avançaient pas; Napoléon, comptant sur l'ascendant qu'il exerçait sur les chefs de l'armée autrichienne, imagina de demander à l'empereur François de le mettre en rapport avec le prince Jean Lichtenstein, en ce moment commandant de l'armée. L'empereur François y consentit; il chargea le prince Jean d'aller écouter les propositions de Napoléon, et de les lui rapporter, sans lui donner aucun pouvoir pour signer. Le prince Jean, d'ailleurs brave soldat, mais homme d'un esprit peu étendu, ne put résister aux cajoleries dont Napoléon savait faire un emploi si habile: il se laissa décider à signer des arrangements provisoires dont la valeur ne devait être réelle qu'après l'approbation de son souverain. Mais à peine était-il parti pour se rendre à Holitsch, où était l'empereur François, Napoléon annonça la paix comme faite, et fit tirer cent coups de canon. L'opinion publique la réclamait, et il n'était plus au pouvoir de l'empereur d'Autriche de s'y refuser; de façon que cette paix fut, pour ainsi dire, escamotée et faite par surprise.
C'est le 14 octobre que cet acte sans exemple eut lieu, et, le 15, je me mis en route pour Paris, où je n'avais pas paru depuis le couronnement, c'est-à-dire depuis près de cinq ans. J'allai jeter un coup d'oeil sur mes affaires, et me disposai à repartir promptement pour aller prendre le gouvernement des pays cédés par l'Autriche, et réunis à l'Istrie et à la Dalmatie. Ces diverses provinces composèrent un corps d'État appelé provinces illyriennes, sorte de réminiscence d'un grand nom de l'antiquité. Je laissai le commandement de mon corps d'armée au général Clausel, pour le ramener et l'établir dans les cantonnements qu'il devait occuper, et je précédai, à Paris, le retour de l'Empereur.
RELATIFS AU LIVRE DOUZIÈME
LE GÉNÉRAL RUSCA À MARMONT.
«De Villach, le 3 juin 1809.
«Monseigneur, je suis avec trois mille hommes posté sur la Drave, à Villach, pour surveiller les mouvements de l'ennemi, qui tente de sortir du Tyrol et se jeter en Croatie par Laybach et Agram. Je ne suis pas bien fort pour m'opposer à son projet; je tâcherai néanmoins de lui faire du mal.
«Ayant appris que Votre Excellence se trouvait à Laybach, je me suis empressé de l'instruire des tentatives de l'ennemi, qui, voulant exécuter ce projet, ne pourrait le faire que par la route d'Arnolstein et Wurzenberg, et de là à Laybach. Si j'étais forcé de Villach, et obligé de me replier sur Klagenfurth, ensuite, si je puis compter d'être appuyé par Votre Excellence, je me dirigerai sur Marbourg. Je m'empresserai d'expédier un officier en poste pour prévenir Votre Excellence des mouvements de l'ennemi, s'il se dirigeait sur Laybach ou Klagenfurth.
«Le courrier porteur de la présente ne pouvait passer avec sûreté par Tarvis, je le fais rétrograder sur Klagenfurth, et de là à Laybach.
«P. S. On fait l'ennemi fort de huit à neuf mille hommes.»
LE GÉNÉRAL RUSCA À MARMONT.
«Au quartier général de Klagenfurth,
le 4 juin 1809.
«Mon général, j'ai évacué Villach ce matin, et me suis rendu à Klagenfurth. Les mouvements de l'ennemi m'ayant fait connaître qu'il cherchait à me jeter dans la Drave, je me suis empressé de former une colonne et me mettre en marche, après avoir dû soutenir une fusillade que l'ennemi voulait prolonger pour exécuter son projet.
«Comme l'ennemi pourrait se diriger sur Laybach, j'ai cru devoir prévenir Votre Excellence de ces mouvements.
«Il m'est difficile de pouvoir connaître à fond ses opérations: 1° par la difficulté de la langue; 2° par la presque impossibilité de trouver des espions.
«Si j'étais fort, je l'attaquerais; mais, dans l'état où je me trouve, je ne pourrai le faire sans danger. Je resterai à Klagenfurth et me défendrai.
«Je prie Votre Excellence de me faire connaître si elle doit se diriger sur ce point.»
NAPOLÉON À MARMONT.
«Schoenbrunn, le 5 juin 1809.
«Monsieur le général Marmont, je suppose que vous êtes arrivé à Laybach, que là vous recevrez votre artillerie et un régiment de cavalerie, et qu'en même temps vous veillerez sur toute la frontière et sur toute la ligne de communication.--J'ai nommé généraux de brigade les colonels Bertrand, Bachelu et Plauzonne. Présentez-moi des chefs de bataillon de mérite pour les remplacer.--Vous pouvez garder un de ces nouveaux généraux de brigade: envoyez-moi les deux autres ici.»
LE GÉNÉRAL RUSCA À MARMONT.
«Au quartier général de Klagenfurth,
le 5 juin 1809.
«Mon général, la dépêche de Votre Excellence, en date d'hier, m'a été rendue ce matin, et je m'empresse de lui rendre compte que l'ennemi, depuis hier, ne s'est plus montré. Je vais envoyer une reconnaissance pour connaître s'il fait quelque mouvement sur Klagenfurth.
«Son point de réunion était hier à Villach; le mouvement qu'il a fait, et ensuite des renseignements que j'ai eus, m'en donnaient l'assurance.
«Il faut cependant se méfier et prévenir le parti qu'il peut prendre, sachant que Votre Excellence est à Laybach, et qu'il peut être arrêté s'il se dirige sur ce point. Il doit être instruit de la position de votre armée, et il serait possible qu'il se jetât, par Tarvis, sur Caporetto et Gorice.
«J'oserai même croire que c'est le seul parti qui lui reste. Si Votre Excellence fait surveiller les mouvements de l'ennemi sur Plez, elle aura le temps de le rejoindre sur Gorice.
«De mon côté, je fais tout mon possible pour avoir des renseignements.
«Mais, dans ce pays, il est très-difficile de pouvoir réussir, même avec beaucoup d'argent.
«Si j'avais des forces, je prendrais l'offensive et le presserais d'une manière vigoureuse; mais je n'ai que trois mille quatre cents hommes, officiers compris et tous recrues. Si Votre Excellence pouvait m'envoyer cinq mille hommes, nous pourrions nous tirer cette épine.
«Des petits corps de troupes isolés filent continuellement par les hauteurs de Gemüd, par la Styrie, et vont rejoindre l'armée ennemie.
«Je fais surveiller Saint-Veit, pour être averti s'il faisait quelque mouvement par là; mais je pense qu'il ne s'écartera pas des trois routes de Klagenfurth, d'Arnoldstein par Vutzenberg, et celle de Tarvis pour Caporetto.
«Voilà les détails que je puis donner à Votre Excellence; en attendant ses dispositions, je me maintiendrai à Klagenfurth, poste qui me garantit d'un coup de main.»
LE GÉNÉRAL RUSCA À MARMONT.
«Au quartier général de Villach,
le 5 juin 1809, à deux heures après
midi.
«Mon général, j'ai reçu la dépêche de Votre Excellence, datée d'hier au soir; j'avais déjà mandé ce matin, par mes dépêches, que je crois également que l'ennemi pouvait encore se porter de Tarvis sur Gorice. Une reconnaissance est partie ce matin, et, comme la course qu'elle a à faire est très-longue, elle ne rentrera que ce soir; j'aurai soin d'informer Votre Excellence de tout ce qui parviendra à ma connaissance.
«Si j'avais assez de forces, j'attaquerais l'ennemi, et, si Votre Excellence peut disposer de quelques forces, je l'obligerai ou de rentrer dans le Tyrol, ou le pousserai entre deux feux.»
LE PRINCE EUGÈNE À MARMONT.
«OEdenbourg, le 6 juin 1809.
«J'ai reçu, monsieur le général Marmont, les différentes lettres que m'a apportées votre aide de camp; il m'a appris qu'à son passage à Klagenfurth il avait rencontré le corps du général Rusca, qui se repliait de Villach sur cette ville, forcé par le général Chasteler, qui était débouché du Tyrol avec environ six mille hommes et qui cherchait à se rallier au prince Jean. Votre aide de camp m'a également dit que le général Rusca vous avait demandé du renfort; je ne doute pas que vous n'ayez profité de cette occasion pour joindre l'ennemi, si vous avez été averti assez à temps. Dans tous les cas, je marche sur le prince Jean, qui cherche à rallier ses corps épars sur la Raab, Sa Majesté m'ordonnant cette opération. Je désire que vous y coopériez; ainsi, si le général Chasteler est parvenu à passer, il faut que vous le suiviez, et faire en sorte de le joindre, s'il est possible; vous pouvez prendre avec vous le général Rusca, car je pense que les derrières de l'armée sont libres, du moment où le général Chasteler a passé; vous laisseriez quelques troupes dans le fort de Laybach, avec ordre au commandant de tenir le plus possible, et vous approvisionneriez ce fort pour plusieurs jours. Dans le cas où le général Giulay chercherait à faire un mouvement sur votre droite pour se jeter sur Laybach, vous vous y reporteriez vous-même et vous pourriez l'attaquer avec avantage. Enfin, si tous les corps autrichiens opéraient leur jonction avec le prince Jean, vous manoeuvreriez toujours pour tenir en échec le plus de forces possible, ce que vous feriez alors avec d'autant plus de facilité, que, me portant moi-même sur l'armée autrichienne avec des forces imposantes, je l'oblige à me faire face, et vous vous trouvez naturellement placé sur son flanc. Je serai, le 9, sur la Raab, et, si l'ennemi manoeuvre, je suivrai ses mouvements; agissez donc vous-même d'après cela. Ainsi votre premier mouvement doit être de vous porter sur-le-champ à Marbourg, où le général Chasteler se sera naturellement dirigé. Vous pourrez communiquer par votre gauche avec Macdonald, qui doit s'avancer jusqu'à Furstenfeld, mais qui laisse un petit corps d'observation à Gratz. Je communique moi-même avec lui, et j'aurai de cette manière promptement de vos nouvelles.
«P. S. Vous laisserez un officier supérieur à Klagenfurth. Sa Majesté a désigné cette place comme le grand dépôt de l'armée d'Italie; elle a même ordonné d'y placer les canons sur les remparts, et le général Chasseloup y est pour l'armement. Vous ordonnerez qu'on y réunisse tous les traînards ou hommes isolés, et qu'il ne parte aucun détachement, à moins qu'il ne soit formé en bataillon de marche.»
LE GÉNÉRAL RUSCA À MARMONT.
«Au quartier général de Klagenfurth,
le 12 juin 1809.
«Monsieur le duc, le général Chasteler est parvenu à s'échapper, mais sans chanter victoire. Sept cents prisonniers, quinze officiers, dont un major, sont en notre pouvoir. Les environs de cette place ont été couverts de huit cents blessés ou morts. Le général Schmidt, avec trois mille hommes, ne doit son salut qu'à la fuite précipitée qui l'a rendu aux pénates tyroliens. Deux mille paysans se sont dispersés dans les bois, ayant jeté leurs armes, avec quinze cents de leur troupe de ligne. Le général Schmidt ne s'est pas arrêté un instant à Villach, et ne s'est cru en sûreté qu'au fort de Saxembourg, où s'est dirigée sa bande en pleine déroute. Il allait, dit-il, en passant à Villach, prendre des renforts pour redescendre. Voilà, monsieur le duc, le résultat de la journée du 6, dans laquelle je ne pus disposer que de douze cents hommes pour ne pas exposer la place de Klagenfurth.
«Notre communication, par la route de Leoben, avec le quartier général n'a été interceptée que pendant quarante-huit heures.
«Si j'avais reçu un renfort de trois à quatre mille hommes, la bande du Tyrol aurait été entièrement détruite.
«On remarque tous les jours des hommes égarés dans les bois depuis Klagenfurth jusqu'à Villach.
«J'ai reçu la demande de Votre Excellence de deux cents chevaux de selle. J'en ai fait part à la régence, qui m'a répondu que, si l'on trouvait dans la province des chevaux propres à l'arme de la cavalerie, elle était portée à satisfaire aux désirs de Votre Excellence. Cette réponse ne m'a pas surpris, n'ayant pu moi-même en trouver une quinzaine pour l'escadron de chasseurs royaux qui ont été démontés.
«À l'égard des fourgons, il y en a eu huit disponibles sur les quatre-vingt-seize que Son Altesse Impériale le prince Eugène, général en chef de l'armée d'Italie, a requis à la province de la Carinthie. Le défaut d'ouvriers fait que, de longtemps, cette fourniture ne sera remplie, malgré mes sollicitations continuelles. Je m'empresserai de satisfaire aux désirs de Votre Excellence à l'égard de ces derniers, lui faisant expédier les premiers terminés. Je la prie néanmoins de m'en faire donner l'ordre par le chef de l'état-major de l'armée d'Italie.
«J'ai envoyé à Villach M. le général Bertoletti, qui a ouvert la communication par Tarvis, Caporetto et Ponteba. Malgré cela, je compte faire passer les prisonniers par Laybach, parce qu'ils connaissent trop les environs de Villach et de Tarvis, et pourraient s'échapper. Ce général me mande que Schmidt, rentré par Saxembourg dans le Posterthal, se réorganise, et que, renforcé par les troupes du chef de brigands Saint-Vert, et par un autre général nommé Pul, qui a douze cents hommes avec lui, il tentera de s'ouvrir un passage.
«Voilà, monsieur le duc, les renseignements qui sont à ma connaissance.
«P. S. Je prie Votre Excellence d'excuser si je me sers de ce papier, n'en trouvant pas d'autres. Je suis forcé, par le départ du petit bataillon qui escorte les prisonniers jusqu'à Laybach, de tenir deux portes de la place fermées. Je supplie Votre Excellence de les faire escorter de Laybach à Udine par les troupes de son armée, et donner les ordres que ce bataillon me rentre.
«Je compte à cet égard sur ses bontés.»
LE MAJOR GÉNÉRAL À MARMONT.
«Schoenbrunn, le 13 juin 1809,
à dix heures du soir.
«L'Empereur, monsieur le général Marmont, reçoit la lettre que vous avez écrite au vice-roi en date du 1er juin, ce qui est vraisemblablement une erreur; car elle devrait être du 11. Les dates sont de la dernière importance. Sa Majesté espère que vous vous serez mis aux trousses du général Chasteler, si vous avez pu le couper, et que vous l'aurez suivi pour l'empêcher de se porter sur Gratz. Le vice-roi vous a écrit pour que vous mainteniez la communication sur cette ville, et que vous vous portiez sur Marbourg et Pétau, et partout où serait l'ennemi. Vous pouvez même, général, marcher sur Gratz. Cependant, éloignés comme nous le sommes, ceci est plutôt une direction générale qu'un ordre positif, et les circonstances doivent décider vos mouvements.
«Le vice-roi, avec la plus grande partie de son armée, est au milieu de la Hongrie, où partout il a forcé l'ennemi à la retraite.»
MARMONT AU PRINCE DE NEUFCHATEL.
«Cillex, 19 juin 1809.
«Monseigneur, j'ai reçu hier la lettre que Votre Altesse Sérénissime m'a fait l'honneur de m'écrire le 14 au soir. J'étais parti la veille de Laybach, ainsi que j'avais eu l'honneur de vous en rendre compte. J'espère que je serai demain à Marbourg de bonne heure, si l'ennemi n'y est pas assez en force pour mettre obstacle au passage de la Drave, chose que j'ignore encore; dans le cas contraire, je serai obligé de remonter cette rivière, ce qui retarderait mon arrivée de deux jours.
«J'ai rencontré avant-hier les avant-postes du général Zach, qui est sur la route d'Agram, à ce qu'il paraît, avec quatre ou cinq bataillons croates. Ces avant-postes ne s'étant pas retirés assez vite, une trentaine d'hommes ont été sabrés et pris.
«J'ose espérer que la lettre que j'ai eu l'honneur d'adresser à Votre Altesse Sérénissime le 10 me justifiera dans l'esprit de Sa Majesté sur l'opinion du défaut d'activité qu'elle a conçue sur mon compte. J'ai été en mouvement quatre heures après que j'eus reçu la nouvelle de la présence du général Chasteler; mais, la route qu'il devait prendre étant incertaine, j'ai dû, avant de m'éloigner beaucoup de Laybach, attendre des renseignements sur lesquels j'avais droit de compter. Ce n'est pas le silence du général Rusca qui m'a induit en erreur, ce sont les fausses nouvelles qu'il m'a données une heure avant d'être attaqué et bloqué.
«Permettez-moi de joindre à cette lettre une notice rapprochant les dates des événements et de mes mouvements.
«Je n'ai reçu qu'hier les deux lettres dont Sa Majesté m'a honoré, et les différents ordres et instructions que vous supposiez qui m'étaient parvenus.
«Je n'ai reçu encore ni l'artillerie ni la cavalerie qui m'ont été annoncées.»
LE MAJOR GÉNÉRAL À MARMONT.
«Schoenbrunn, le 19 juin 1809,
trois heures après midi.
«J'ai mis sous les yeux de l'Empereur, monsieur le duc, votre lettre de Laybach du 10, par laquelle vous annoncez que le 17, à trois heures du matin, vous vous mettez en marche pour Gratz: Sa Majesté espère que vous serez arrivé le 19 ou le 20. Vous êtes autorisé à garder le général Broussier. L'intention de l'Empereur est que vous marchiez vivement sur Giulay et Chasteler, pour les battre et ensuite faire rendre la citadelle de Gratz.»
LE MAJOR GÉNÉRAL À MARMONT.
«Schoenbrunn, le 19 juin 1809.
«Je vous ai envoyé plusieurs fois, monsieur le duc, l'ordre de marcher sur Gratz, et, à la distance où vous êtes, vous n'aviez pas besoin de cet ordre pour agir. L'Empereur trouve que vous avez commis une faute en laissant intercepter la communication avec Gratz, car, le 18, les avant-postes du général Broussier ont été attaqués: nous ignorons ce qui se sera passé. Toutefois, général, l'intention de l'Empereur est que vous marchiez sans délai sur Gratz et que vous culbutiez les corps de Giulay et de Chasteler, qui y sont. Si le général Broussier est obligé d'évacuer Gratz, son instruction lui prescrit de se retirer sur Bruck. Sa Majesté est étonnée que vous restiez tranquille et que vous n'envoyiez pas chaque jour un officier de votre armée avec des nouvelles, quand les plus grandes choses vont se décider et que vous avez sous vos ordres le meilleur corps d'armée. Vous sentez, général, qu'à la distance où vous êtes et avec votre grade, ce n'est point un ordre littéral qui doit vous faire mouvoir, mais la masse des événements.»
LE MAJOR GÉNÉRAL À MARMONT.
«Schoenbrunn, le 25 juin 1809, midi.
«Je reçois, monsieur le général Marmont, votre lettre du 23, où Sa Majesté voit que vous aurez été au plus tard aujourd'hui à Gratz. Vous aurez pris des mesures pour faire rendre la citadelle; c'est un poste important à avoir, et vous aurez battu le corps du général Giulay, s'il est auprès de vous. Ces opérations faites, il faut, général, vous tenir prêt à faire un mouvement important, conformément aux ordres que vous en recevrez. Si le château de Gratz est pris, vous pourrez y laisser une garnison et vous occuper de suite de le réapprovisionner.»
LE MAJOR GÉNÉRAL À MARMONT.
«Schoenbrunn, le 25 juin 1809, dix heures du soir.
«L'Empereur, monsieur le général Marmont, espère que vous serez arrivé à Gratz aujourd'hui 25, que vous aurez attaqué l'ennemi avec le général Broussier, et que vous l'aurez poursuivi pour le détruire.
«Le général Broussier a avec lui cinq ou six cents hommes qui appartiennent aux autres corps de l'armée d'Italie, quinze cent mille cartouches et la réserve de cavalerie de l'armée d'Italie. Sa Majesté me charge de vous faire connaître qu'elle désire que vous fassiez partir tout cela pour Bruck, de là à Neustadt et de là à Vienne, ainsi que les munitions d'artillerie que l'on pourra se procurer indépendamment de ce qui appartient aux divisions qui sont à Gratz.--Instruisez-moi des ordres que vous donnerez à cet effet.
«Comme Sa Majesté espère recevoir dans la journée de demain, 26, des nouvelles sur votre situation, elle les attendra pour vous envoyer de nouveaux ordres, ce qui ne doit point cependant vous empêcher de prendre la forteresse et de faire du mal à l'ennemi.»
MARMONT AU PRINCE DE NEUFCHATEL.
«27 juin 1809.
«Monseigneur, je viens de recevoir la lettre que Votre Altesse Sérénissime m'a fait l'honneur de m'écrire le 25 au soir.
«Un événement aussi étrange qu'imprévu m'a empêché d'arriver le 25 devant Gratz, ainsi que je vous l'avais annoncé: le général Montrichard, sans motif et sans prétexte, a trouvé convenable de ne pas marcher le 25; et, comme je l'attendais pour déboucher, mon mouvement a été d'abord suspendu, et j'ai éprouvé sur son compte les plus vives inquiétudes. De nombreux officiers que j'avais envoyés m'ont enfin appris qu'il était resté sur les montagnes de Pack. Je l'ai fait partir dans la nuit, mais il était trop tard pour qu'il n'y eût pas un jour de perdu. Je profite de cette occasion pour supplier Votre Altesse Sérénissime d'obtenir de Sa Majesté le changement du général Montrichard; c'est la dixième fois qu'il compromet le sort de l'armée par sa conduite irréfléchie et son insouciance: c'est un de ces hommes qui ne peuvent que causer des événements malheureux à la guerre. J'ai été au moment de lui ôter sa division et d'en donner le commandement provisoire au général Delzons; mais j'ai pensé qu'il était plus convenable d'attendre les ordres de Sa Majesté.
«Aussitôt que j'ai su que le général Broussier s'était retiré de Gratz, je lui ai écrit pour l'engager à y rentrer, à y laisser les troupes qui étaient nécessaires pour bloquer la citadelle, et à s'approcher de l'ennemi. Je l'ai prévenu que je comptais l'attaquer le 26 à Wildon, supposant que ses principales forces se trouvaient là. Le général Broussier, supposant que l'ennemi n'avait personne dans Gratz, se contenta d'envoyer deux bataillons du 84e régiment pour bloquer la citadelle et tenir les portes de la ville, et il marcha avec le reste de sa division sur Wildon, dans le voisinage duquel il me trouva avec la division Clausel.--Il me dit qu'il avait entendu une très-vive fusillade pendant la nuit, qui lui faisait penser que le 84e régiment était engagé d'une manière sérieuse, et il ajouta qu'il avait vu de nombreux bivouacs sur la gauche de la Muhr.
«Je supposai alors que l'ennemi avait formé le projet de s'emparer de nos ponts, chose qui aurait été extrêmement fâcheuse pour nous, puisqu'elle nous aurait empêchés de passer la rivière et de communiquer avec Vienne. J'envoyai en conséquence le général Broussier en toute hâte pour garder le pont de Viesselburg et soutenir le 84e. Apprenant plus tard que la chose était très-sérieuse et que le 84e régiment, qui avait rencontré de très-grandes forces ennemies à Gratz, était bloqué dans une partie du faubourg, je marchai avec la division Clausel pour soutenir la division Broussier.
«Trois bataillons qu'envoya d'abord le général Broussier, culbutèrent tout ce qui se trouva d'ennemis, et le brave 84e régiment, qui pendant quatorze heures avait résisté seul à presque toute l'armée ennemie, et sans communication fait beaucoup de prisonniers, pris deux drapeaux, fut délivré.--Cette affaire termina la journée.
«Il paraît, d'après le rapport des prisonniers, que presque toute l'armée se trouve réunie à Gratz avec le général Giulay. Je vais l'attaquer ce matin, et j'espère le faire avec succès. Le général Broussier vient de me faire savoir que son intention n'était pas de marcher aujourd'hui; je ne puis supposer qu'il persiste dans cette résolution. Il récuse mon autorité, prétendant n'avoir rien reçu qui le mît à mes ordres. Comme par la circonstance, la nature des choses et le texte de vos lettres, il me paraît qu'il s'y trouve, je vous prie, monseigneur, de lui faire connaître d'une manière formelle les ordres de Sa Majesté, afin qu'il s'y conforme sans tiraillements.
«La connaissance parfaite que j'ai du fort de Gratz m'autorise à vous assurer qu'il y a impossibilité absolue de le prendre sans gros canons, et je n'ai ici pas même des pièces de douze.»
NAPOLÉON À MARMONT.
«Schoenbrunn, le 28 juin 1809,
neuf heures du matin.
«Monsieur le duc de Raguse, le 27, vous n'étiez pas à Gratz. Vous avez fait la plus grande faute militaire qu'un général puisse faire. Vous auriez dû y être le 23 à minuit, ou le 24 au matin. Vous avez dix mille hommes à commander, et vous ne savez pas vous faire obéir; au fond, votre corps n'est qu'une division. Je crois que Montrichard n'est pas grand'chose; mais vous avez mauvaise grâce à vous plaindre. Que serait-ce si vous commandiez cent vingt mille hommes? D'ailleurs, une désobéissance formelle serait criminelle; c'est un malentendu, et comment peut-il y en avoir quand on n'a que dix mille hommes? Marmont, vous avez les meilleurs corps de mon armée: je désire que vous soyez à une bataille que je veux donner, et vous me retardez de bien des jours. Il faut plus d'activité et plus de mouvement qu'il ne paraît que vous vous en donnez pour faire la guerre.--Vous aurez peut-être, enfin, battu aujourd'hui Giulay. Il est bien nécessaire que je puisse savoir à quoi m'en tenir, où vous êtes, et où se ralliera l'ennemi autour de Gratz. Il est important qu'il soit dispersé de manière qu'il ne puisse pas se réunir de bien des jours.»
LE MAJOR GÉNÉRAL À MARMONT.
«Schoenbrunn, le 28 juin 1809.
«J'ai mis, monsieur le général Marmont, votre lettre du 27 sous les yeux de l'Empereur. Sa Majesté ne comprend pas et n'approuve pas vos dispositions; vous deviez être le 24 à Gratz, et vous n'y êtes pas le 27. Sa Majesté me charge de vous dire que ce qui convient à la guerre est de la simplicité et de la sûreté, et la simplicité et la sûreté de vos mouvements voulaient que vous allassiez directement à Gratz: là, vous vous seriez trouvé sur la droite de la Muhr, vous auriez eu des nouvelles de l'ennemi: c'est l'avantage des grandes villes; alors, le 26, vous auriez pu prendre un parti convenable. Au lieu de cela, vous vous êtes porté sur Wildon, n'ayant pas la facilité de vous porter sur les deux rives de la Muhr, et vous avez perdu deux jours, ce qui nuit beaucoup aux projets de l'Empereur, en retardant l'instant de la grande bataille que Sa Majesté veut livrer à l'ennemi. Quant au général Montrichard, Sa Majesté n'en a pas une très-grande opinion; mais elle ne peut croire que, s'il avait eu des ordres positifs, il n'eût pas marché. Sa Majesté pense donc que les ordres ont été mal donnés. Faites-moi connaître ce qui en est, car, si le général Montrichard n'a pas exécuté votre ordre, Sa Majesté le fera traduire à un conseil de guerre.
«L'Empereur suppose qu'aujourd'hui vous serez maître de Gratz, que vous aurez suivi le général Giulay. Il est probable que, si vous avez une affaire, le fort de Gratz se rendra. Toutefois, général, l'intention de l'Empereur n'est pas que vous vous éloigniez en poursuivant l'ennemi, et vous devez vous mettre en mesure d'attendre ses ordres. Quand l'Empereur saura comment les choses se sont passées, son projet est de vous donner l'ordre de vous reployer à grandes journées sur Vienne.
«Ce n'est pas la réserve de cavalerie que je vous avais demandée, c'est la réserve d'artillerie que le général Broussier avait dit avoir, et qui portait quinze cent mille cartouches d'infanterie. Faites filer de suite sur Vienne cette réserve de munitions, et faites partir également sur-le-champ, pour Vienne, deux compagnies du 8e régiment d'artillerie à pied; faites-leur faire de grandes journées.
«Aussitôt que vous n'aurez plus absolument besoin du général Broussier et de ses troupes, envoyez-le sur Neustadt, route de Vienne. Si cependant les événements de la journée d'aujourd'hui vous avaient conduit à cinq ou six lieues sur la route de la Hongrie, et que le général Broussier fût plus près d'OEdenbourg, vous le dirigeriez sur cette ville et m'en préviendriez.
«Sa Majesté trouve que vous avez manoeuvré de manière à donner tout l'avantage sur vous à l'ennemi. Vous deviez être à Gratz avant lui, et, comme vous n'avez qu'un petit corps, y arriver le 23: telle est l'opinion de Sa Majesté.»
(Par duplicata.)
MARMONT À NAPOLÉON.
«Gratz, 29 juin 1809.
«Sire, je suis coupable puisque Votre Majesté me condamne; mais, si de faux calculs m'ont trompé, je n'ai pas un seul moment été distrait de mon devoir, et mon ardeur n'a pas été un instant ralentie. Je puis assurer Votre Majesté que nous n'avons jamais marché moins de dix à douze heures par jour.
«Sire, Votre Majesté, en m'adressant ses reproches, pénètre en même temps mon coeur de reconnaissance pour la bonté avec laquelle ils sont exprimés. Ils ajoutent, s'il est possible, aux regrets que j'éprouve d'avoir eu le malheur de lui déplaire. Je payerai volontiers au prix de tout mon sang le bonheur de vous satisfaire à l'avenir.»
MARMONT AU MAJOR GÉNÉRAL.
«Gratz, 29 juin 1809.
«Monseigneur, je reçois la lettre que Votre Altesse Sérénissime m'a fait l'honneur de m'écrire hier 28.--Peut-être qu'un jour Sa Majesté jugera mes opérations avec moins de sévérité, et il n'y a rien que je ne fasse pour l'obtenir. Je vous supplie, en attendant, de lui faire assurer que l'ennemi était à deux marches de Gratz, lorsque j'en étais à six, et qu'ainsi il était toujours le maître d'y arriver avant moi; et que, de plus, j'avais des ponts à rétablir, dont le travail a exigé près de vingt-quatre heures.
«J'ai eu l'honneur de vous rendre compte de notre entrée à Gratz, le 27. Je comptais marcher sur l'ennemi, le 28, avec mes forces réunies; mais, l'ennemi ayant pris différentes directions et ignorant de quel côté étaient les principales forces, je l'ai fait suivre par de fortes avant-gardes, jusqu'à six ou sept lieues d'ici, pour avoir des nouvelles certaines. Il résulte des renseignements qui m'ont été donnés que l'ennemi, ayant marché toute la nuit du 26 au 27 et toute la journée du 27, est arrivé le soir à Guas: il y était encore le 28, mais il paraissait disposé à en partir. Des troupes, commandées par le général Zagh, se sont retirées par Saint-Georges, et le général Kursurich s'est porté sur Feldbach. Le général Giulay était de sa personne à Guas. Le bruit, généralement répandu parmi les habitants et parmi les troupes, est que l'ennemi se porte en Hongrie, et que, de Guas et Feldbach, il doit sortir sur Furing et Saint-Gothard; il est également annoncé à Fuistenfeld. J'ai pensé que, vu l'éloignement de l'ennemi et les nouveaux ordres qui me sont annoncés, je ne devais pas marcher sur Guas, où d'ailleurs sans doute je ne trouverais plus personne: car, puisque l'ennemi n'a pas voulu me combattre à Gratz, où toutes les circonstances locales étaient à son avantage, il ne le fera nulle part.--Mais, pour me mettre à même de l'attaquer, s'il se rapproche dans sa marche, et, dans tous les cas, pour lui fermer le chemin de Vienne, j'ai cru devoir marcher parallèlement à lui, et je me rends ce soir à Gleinderford, qu'il occupe déjà depuis hier, ou je pourrai aller chasser l'ennemi de Feldbach, s'il y est encore, et, dans tous les cas, voir ce qui se passe sur les bords du Raul. Aussitôt que le mouvement de l'ennemi sera plus décidé et que j'aurai la nouvelle que Guas a été évacué, je donnerai l'ordre à la division du général Broussier de se porter sur Neustadt, ainsi que vous me le prescrivez. En attendant, je la laisse à Gratz. C'est sans doute par erreur que le général Broussier a rendu compte qu'il existait quinze cent mille cartouches dans le parc de réserve de l'aile droite de l'armée d'Italie. Il n'y a dans ce dépôt de munitions, y compris celui de sa division, que cent quatre-vingt mille cartouches.
«Je puis affirmer à Votre Altesse Sérénissime qu'il n'y a aucune espérance d'avoir le château de Gratz, si on ne l'assiége sérieusement. J'ai ordonné des travaux, des mines; j'ai envoyé chercher quatre pièces de gros calibre à Laybach; mais il faut du temps pour en obtenir les effets. J'ai également fait demander de la poudre qui me manque. Le commandant du fort paraît un homme très-déterminé à se défendre et au-dessus de toute considération; car, ce qui est sans exemple, il canonne et fusille constamment les maisons, places et rues; et les habitants en sont encore plus victimes que les soldats. Il y en a déjà eu un certain nombre de tués et blessés; mais, quant à nous, il nous gêne beaucoup par la grande quantité d'obstacles qu'il met à nos communications. Je laisse, pour commencer les travaux du siége, deux bons ingénieurs de mon corps d'armée avec une compagnie de sapeurs.
«Votre Altesse Sérénissime me donne l'ordre d'envoyer deux compagnies d'artillerie à pied à Neustadt. Je la prie de me dire si je dois aussi y envoyer mon matériel, car il ne me restera plus personne pour le servir. J'ai trouvé le moyen d'organiser dix-sept bouches à feu, et six m'arriveront d'Italie dans deux ou trois jours. Les compagnies de canonniers que j'ai sont insuffisantes pour le service de ces bouches à feu, d'autant plus quelles fournissent un détachement de cent vingt hommes pour la conservation, la garde et la conduite des munitions portées par des chevaux de bât, seul moyen de transport que nous ayons encore aujourd'hui et qui, s'il venait à disparaître, nous mettrait dans le plus grand embarras. Cet ordre serait déjà exécuté si sa conséquence immédiate n'était pas la désorganisation absolue du peu d'artillerie que nous avons, et je supplie Votre Altesse Sérénissime de vouloir bien représenter à Sa Majesté la situation difficile dans laquelle nous sommes à cet égard.
«Les hommes des différents corps qui étaient ici sont en route pour Neustadt.»
LE MAJOR GÉNÉRAL À MARMONT
Schoenbrunn, le 29 juin 1809, midi.
«L'Empereur, monsieur le duc, a reçu votre lettre du 27 au soir, par laquelle vous lui annoncez que le général Giulay a fait sa retraite sur Rachesbourg, et que vous marchez, le lendemain, 28, à sa poursuite. Sa Majesté me charge de vous dire qu'elle est mécontente de ce que vous ayez perdu une seule heure pour marcher à sa poursuite, ce qui vous aurait mis dans le cas d'attaquer au moins son arrière-garde. Il parait que vous ne vous êtes mis en mouvement que vingt-quatre heures après qu'il a effectué sa retraite, et c'est vous mettre hors de la main de l'Empereur, sans avoir l'espoir d'entamer ce corps ennemi.
«Vous ne devez pas ignorer, général, que le destin des armées et celui des plus grands événements dépend d'une heure. Ainsi vous manquez le corps du général Giulay comme vous manquez celui du général Chasteler.
«L'Empereur, général, ordonne que vous dirigiez sur-le-champ le général Broussier, avec les troupes à ses ordres, par la route la plus courte sur Vienne. L'intention de Sa Majesté est que, avec votre corps d'armée, vous reveniez à grandes journées sur Vienne, aussitôt que vous aurez éloigné le corps du général Giulay. Si vous pouvez prendre le château de Gratz, vous y laisserez une garnison, ce qui serait fort avantageux pour maintenir nos communications. Si vous ne le pouvez pas, vous laisserez une arrière-garde pour bloquer le château, et vous donnerez pour instruction au commandant de n'évacuer la ville qu'un ou deux jours après votre départ. Il faut, général, que vous marchiez à grandes journées, afin d'arriver à Vienne dans quatre à cinq jours; il est essentiel que vous soyez rendu à six lieues de cette ville le 4 juillet. Vous aurez soin de faire toutes les démonstrations comme si vous marchiez en avant, afin d'en imposer le plus que vous pourrez à l'ennemi. Dans cet intervalle, vous ferez vos efforts pour prendre le château de Gratz. Vous aurez soin de prévenir le général Garrau, à Bruck, de votre mouvement, afin qu'il protége autant qu'il pourra la route de Bruck à Klagenfurth. Je n'ai pas besoin de vous recommander de faire évacuer les hôpitaux de Gratz sur Bruck, et de ne laisser dans cette ville aucun embarras.
«Le vice-roi a envoyé le général Macdonald pour couper au général Chasteler la route entre Wesperin et Bude. Il paraît que, quant à Giulay, il se dirige sur la Croatie.
«La ligne de communication de votre corps d'armée doit être sur Vienne, et tout ce que vous aurez laissé sur vos derrières doit rejoindre Klagenfurth ou Vienne, de manière que, si l'ennemi s'emparait de la Styrie et de la Carniole, vous ne puissiez rien y perdre. Klagenfurth et Laybach conserveront seuls des garnisons.»
LE MAJOR GÉNÉRAL À MARMONT.
«À l'île Napoléon, le 3 juillet 1809,
huit heures du matin.
«Vous devez, monsieur le général Marmont, être le 5 au matin dans l'île Napoléon; vous laisserez une arrière-garde de cavalerie et quelques hommes d'infanterie à Neustadt; vous ordonnerez au commandant de cette arrière-garde de pousser des partis sur le Simering, et vous lui direz qu'il doit se mettre en communication avec le général Garrau à Bruck. Il devra également pousser des partis sur OEdenbourg, afin de pouvoir être instruit de ce qu'il y aurait d'important.
«Ayez soin, monsieur le général Marmont, de m'envoyer un aide de camp à l'avance, pour me prévenir où vous serez.»
ORDRE.
«Du camp de l'île Napoléon, le 2 juillet 1809,
onze heures du soir.
TITRE PREMIER.
1.
«Le 4, à l'heure que nous désignerons, le général Oudinot fera embarquer un général de brigade et quatre ou cinq bataillons de voltigeurs, formant quinze cents hommes, au lieu qui sera indiqué, par le capitaine de vaisseau Baste pour s'emparer du Hausl-Grund. Le capitaine de vaisseau Baste, avec huit bateaux armés, marchera devant et protégera leur débarquement par une vive canonnade en enfilant les batteries ennemies, qui, en même temps, seront canonnées par nos batteries.
2.
«Le général Bertrand donnera des ordres pour que le 5, à six heures du soir, il y ait quatre bacs près du lieu où l'on doit jeter le pont de l'embouchure, avec des marins et agrès nécessaires à la navigation, et avec un treuil et une cinquenelle. Aussitôt que le débarquement qui doit avoir lieu sera exécuté, conformément à l'article 1er, le général Oudinot fera placer huit cents hommes dans ces quatre bacs et les dirigera pour débarquer au pied de la batterie ennemie. Au même moment, une cinquenelle sera jetée; ces quatre bacs s'y attacheront et serviront à transporter des troupes à chaque voyage qu'ils feront en se servant de cette cinquenelle.
3.
«Le capitaine des pontonniers fera établir son pont, qu'il devra construire en deux heures, et, immédiatement après, le général Oudinot débouchera avec son corps, chassera l'ennemi de tous les bois, viendra porter une de ses divisions jusqu'à la Maison-Blanche, une autre sur Mulheiten.
«Le chemin le long et le plus près de la rivière sera mis en état pour pouvoir être la communication de l'armée, si cela était nécessaire. On travaillera à une tête pont, et, le plus tôt possible, le général Oudinot établira sa droite à Mulheiten, sa gauche à la Maison-Blanche, ayant trois ponts sur le petit canal. La plus grande partie de sa cavalerie sera sur Mulheiten. Le général Oudinot aura avec lui de quoi jeter deux ponts sur haquets de dix toises chacun. Dans cette position, il recevra des ordres. L'Empereur sera dans l'île Alexandre.
4.
«Le capitaine de vaisseau Baste s'emparera de l'île Rohr-Tsith et enverra des barques pour flanquer la droite. Deux pièces de canon seront débarquées à terre pour faire une batterie qui battra le Zanet et flanquera toute la droite. Il fera soutenir cette batterie par deux cents marins armés de fusils.
TITRE II.
5.
«Un quart d'heure après que la canonnade aura commencé sur la droite, et après que la fusillade se sera fait entendre, le duc de Rivoli fera partir les cinq bacs, portant dix pièces de canon, avec mille coups à tirer, dans des caissons, et quinze cents hommes d'infanterie, lesquels doubleront l'île Alexandre, et iront débarquer le plus haut qu'ils pourront. Une cinquenelle sera jetée; les bacs y seront attachés, et serviront à porter des hommes, des chevaux, des caissons et des canons.
6.
«Aussitôt que les bacs auront doublé l'île Alexandre, le pont d'une pièce descendra jusqu'à soixante toises de l'île Alexandre, et là sera abattu et placé. Aussitôt tout le reste du corps du duc de Rivoli passera sur ce pont.
7.
«Immédiatement après que le pont d'une pièce sera descendu, les radeaux fileront, et un pont sera construit vis-à-vis l'île Alexandre. Le duc d'Auerstädt sera chargé de faire construire ce pont, ses troupes devant passer dessus.
8.
«Au même moment, le pont, sur pontons, sera jeté par-dessus l'îlot, vis-à-vis l'île Alexandre, et aussitôt l'artillerie du duc de Rivoli et sa cavalerie passeront sur ce pont.
9.
«Le duc de Rivoli se placera selon les circonstances; il se tiendra sous la protection des batteries de l'île Alexandre jusqu'à ce que le général Oudinot ait pris le bois et que les ponts soient faits. Le duc de Rivoli fera la gauche de l'armée. La première position sera sous la protection des batteries de l'île Alexandre; la deuxième, sous la protection des batteries de l'île Lannes; la troisième, dans Enzersdorf.
10.
«Le corps du prince de Ponte-Corvo, la garde et l'armée du prince Eugène, passeront immédiatement après sur les différents ponts et formeront la deuxième ligne. L'Empereur leur désignera, au moment, les ponts sur lesquels ils doivent passer.
11.
«L'armée doit être placée de la manière suivante le plus tôt possible:
«Trois corps eu première ligne: celui du duc de Rivoli à la gauche, celui du général Oudinot au centre, celui du duc d'Auerstädt à la droite.
«En deuxième ligne, le corps du prince de Ponte-Corvo à la gauche, la garde; le corps du duc de Raguse et la division Wrede au centre; l'armée du prince Eugène à la droite. Chaque corps d'armée sera placé, une division faisant la gauche, une le centre et une la droite.
12.
«Le 5, à la pointe du jour, toutes les divisions seront sous les armes, chacune ayant son artillerie, l'artillerie de régiment, dans l'intervalle des bataillons.
13.
«Les cuirassiers, en réserve sous les ordres du duc d'Istrie, formeront la troisième ligne.
14.
«En général, on fera la manoeuvre par la droite, en pivotant sur Enzersdorf, pour envelopper tout le système de l'ennemi.
TITRE III.
15.
«Le duc de Rivoli aura ses quatre divisions d'infanterie; il laissera un régiment badois aux ordres du général Reynier. Sa cavalerie sera commandée par le général Lasalle, qui ne recevra d'ordre que du duc, et, qui aura sous lui les brigades Piré, Marulaz et Bruyère.
16.
«Le général Oudinot aura ses trois divisions d'infanterie et la brigade de cavalerie légère du général Colbert. Il laissera deux bataillons, formés des compagnies du centre, aux ordres du général Reynier.
17.
«Le corps du duc d'Auerstädt sera composé de ses quatre divisions d'infanterie, de la brigade de cavalerie du général Pajol et de celle du général Jacquinot, sous les ordres du général Montbrun; plus, d'une des deux divisions de dragons de l'armée d'Italie, celle du général Pully ou du général Grouchy, ce qui fera neuf régiments de cavalerie.
18.
«Le prince de Ponte-Corvo aura son corps.
19.
«La garde sera augmentée du corps du duc de Raguse et de la division Wrede.
20.
«L'armée d'Italie formera le corps du prince Eugène.
21.
«Les cuirassiers formeront une réserve à part, sous les ordres du duc d'Istrie.
TITRE IV.
De la défense de l'île.
22.
«Le général de division Reynier sera chargé du commandement de l'île; il prendra le service le 4 à midi; il donnera le commandement des différentes îles et postes détachés aux officiers d'artillerie les plus anciens ou les plus propres employés dans les batteries desdites îles.
23.
«Le général Reynier aura sous ses ordres:
«1° Un régiment de Bade que fournit le corps du duc de Rivoli;
«2° Les deux bataillons que fournit le corps du général Oudinot;
«3° Deux bataillons saxons que fournira le corps du prince de Ponte-Corvo;
«4° Le bataillon du prince de Neufchâtel.
«Le bataillon de Neufchâtel et un bataillon badois seront placés dans la tête de pont, dans laquelle il y aura six pièces de canon en batterie. Ce mouvement ne se fera que pendant la nuit du 4 au 5.
«L'autre bataillon badois mettra vingt-cinq hommes dans l'ile Saint-Hilaire, vingt-cinq hommes dans l'île Masséna, deux cents hommes dans l'île du Moulin, vingt-cinq dans l'île Lannes, vingt-cinq dans l'île Espagne et vingt-cinq dans l'île Alexandre, ce qui fera trois cent vingt-cinq hommes. Le reste sera en réserve pour se porter partout où il sera nécessaire.
«Des deux bataillons du corps du général Oudinot, un sera placé à la tête de son pont, et l'autre à la tête des grands ponts du Danube.
«Des deux bataillons saxons, l'un sera placé en réserve; l'autre aux grands ponts du Danube.
24.
«Toutes les batteries des îles et la garde de tous les ponts seront sous les ordres du général Reynier. Il fera exécuter les changements et fera transporter les pièces où les circonstances, pendant la bataille, pourront les rendre nécessaires.
TITRE V.
Des bâtiments de guerre.
25.
«Il y aura deux bâtiments de guerre armés de pièces de canon en station entre Stadelau et la rive gauche, tant pour inquiéter l'ennemi que pour prévenir de ce qui viendrait à leur connaissance et des entreprises que l'ennemi voudrait faire contre le Prater, ou tout autre point de la rive droite, et pour arrêter les brûlots qu'il voudrait envoyer. Deux autres bâtiments armés seront placés entre Gross-Aspern et notre pont pour inquiéter ce que l'ennemi a dans les îles et observer ses mouvements.
«Le reste des barques armées se tiendra sur notre droite pour protéger la descente et toute notre droite.»
LE GÉNÉRAL MONTBRUN À MARMONT.
«Hohen-Ruppersdorff, le 8 juillet 1809.
«Mon général, d'après les ordres que j'ai reçus hier, je suis venu prendre position ici et fais éclairer le pays le long de la March. Le parti qui a été dirigé sur Marchek a trouvé beaucoup de blessés à Schoenkirchen; il y en avait aussi beaucoup à Genserndorff, où la reconnaissance a trouvé trois cents chevaux ennemis, près desquels elle est restée en présence jusqu'à la nuit. L'officier qui la commandait m'a rapporté que les habitants et les déserteurs lui avaient assuré que dix-neuf escadrons, tant hussards que dragons, avaient de passer la March, soit à Marchek, soit en descendant cette rivière dans la direction de Presbourg. Mes régiments, qui ont bivaqué la nuit dernière à Spanberg et à Erdpress, ont poussé des reconnaissances sur Dürnkrut, Leuterstall et Enzersdorf. On n'a pu aller jusqu'au premier endroit, parce qu'on a trouvé l'ennemi à moitié chemin de Spanberg à Dürnkrut. L'officier qui les commandait a appris par les habitants, et ce qui m'a été confirmé par des déserteurs, que le quatrième corps de l'armée autrichienne, commandé par le comte de Rosenberg, composé en partie des régiments de Ferdinand, Lichtenstein, Blankenstein et Stipsitz, de deux divisions de hussards d'insurrection et des deux régiments d'infanterie de Wokazowitz et Starrey, qui avaient souffert beaucoup, s'étaient retirés par Dürnkrut. Au village d'Enzersdorf, nous avons trouvé un hôpital où il y avait beaucoup de blessés; hier, nous en avons ramassé une grande quantité, ainsi que de traîneurs, dans tous les villages où ma division et mes détachements ont passé. D'après tous ces renseignements, je dois supposer que le corps de Rosenberg descend la March et que les autres corps font leur retraite par les routes de Nikolsburg, Znaïm et Horn. Il serait bon cependant qu'on observât le cours de la March depuis Dürnkrut jusqu'à son embouchure, afin d'éviter les coups de main que pourraient faire sur les derrières de l'armée les dix-neuf escadrons dont il est fait mention. J'ai prévenu le général Grouchy, qui, d'après les ordres de Son Altesse, doit rester à Ruppersdorff, de tous les renseignements que j'ai obtenus, pour qu'il ait à se conduire comme il l'entendra le mieux.
«Je pars à l'instant pour me rendre aux derniers ordres que j'ai reçus de Son Altesse, et marche sur Nikolsbourg par la grande route de Vienne. Je pousserai aujourd'hui la brigade du général Colbert aussi loin que je le pourrai; demain, j'espère rencontrer l'arrière-garde ennemie, ainsi que ses bagages; je les ferai poursuivre de manière à ce qu'il nous en reste au moins une partie. Il ne dépendra pas de moi que vous ne soyez content de ma division.»
LE MAJOR GÉNÉRAL À MARMONT.
«Wolkersdorf, le 8 juillet 1809,
trois heures après midi.
«Je reçois à l'instant, monsieur le duc, votre lettre de Wüllfersdorf, à midi. Comme il est trois heures, vous aurez eu d'autres renseignements sur l'ennemi, qui paraît effectivement se retirer en Bohême. L'Empereur vous laisse maître de marcher sur Znaïm si, par ce moyen, vous croyez vous trouver plus près de la gauche de l'ennemi. Le duc d'Auerstädt, avec son corps d'armée, se met en marche; il sera, vers huit heures du soir, à Wüllfersdorff. Dans quelque direction que vous soyez, donnez de vos nouvelles au duc d'Auerstädt. Le duc de Rivoli était ce matin de bonne heure à Stockerau; si l'ennemi était sur la route de Znaïm, il l'aura poursuivi, et il sera probablement cette nuit à Hollabrunn. La rivière qui est devant vous à Znaïm n'est rien; elle est partout guéable. L'Empereur vous recommande de bien conserver les manutentions et les magasins. Vous ne nous avez pas envoyé les lettres de la poste: il faut les enlever partout. Il y a à Znaïm une fabrique de tabac très-importante; il faut la conserver, d'autant mieux qu'on en manque à Vienne.»
LE MAJOR GÉNÉRAL À MARMONT.
«Wülfersdorf, le 10 juillet 1809,
neuf heures et demie du matin.
«Je vous préviens, monsieur le duc, que le maréchal duc d'Auerstädt est arrivé hier à Nikolsbourg et qu'il part aujourd'hui pour se diriger sur Znaïm. Le duc de Rivoli s'est battu hier à Hollabrunn avec l'arrière-garde ennemie. L'Empereur n'a point encore de nouvelles de votre arrivée à Laah; Sa Majesté en attend d'un moment à l'autre; elle va partir dans une heure ou deux, à la tête de sa garde, pour se diriger de votre côté. Ainsi nous aurons demain, du côté de Znaïm, des forces imposantes pour y combattre l'ennemi s'il prend position; mais on a plus lieu de penser qu'il se retire en Bohême.»
NAPOLÉON À MARMONT.
«Laah, le 11 juillet 1809,
deux heures du matin.
«Monsieur le général Marmont, l'officier de génie italien que vous avez expédié est arrivé à minuit. Il a donc mis six heures pour faire cette mission: depuis, il n'est arrivé personne. Cet officier pouvait s'égarer; les règles de la guerre voulaient que vous en envoyassiez trois à demi-heure de distance les uns des autres. Je n'ai trouvé à Laah aucun commandant, aucune garnison, pas même un poste à vos ponts; cependant, si les hussards qui rôdent dans la plaine étaient venus les brûler, votre retraite eût été compromise: vous n'avez pas appris cette insouciance en servant avec moi. Comment n'avez-vous pas laissé des postes de cavalerie pour jalonner la route et pour que vos nouvelles arrivassent promptement? Le duc d'Auerstädt avait ordre de vous appuyer; vous l'avez si peu pressé de venir à vous, qu'il s'est porté à Nikolsbourg, c'est-à-dire à deux journées de vous: heureusement qu'hier je l'ai fait venir ici. La lettre que vous lui écrivez n'est pas assez pressante; il est tout simple qu'aucun général n'aime à venir en seconde ligne. Je monte à cheval avec toute la cavalerie; mais il est déjà deux heures du matin; ayez soin de ne rien engager de sérieux jusqu'à ce que je sois à portée de vous. Le général Oudinot, qui a pris une direction à gauche, a dû vous envoyer un officier pour avoir des nouvelles. Envoyez-moi quelqu'un qui connaisse bien votre position et celle de l'ennemi. Quel est le village pris et repris? Faites-m'en un croquis que vous m'enverrez en route.»
MARMONT À NAPOLÉON.
«Quartier général de Znaïm, 11 juillet 1809.
«Sire, j'ai reçu la lettre que Votre Majesté m'a fait l'honneur de m'écrire; je crois pouvoir me justifier des reproches qu'elle contient.
«L'uniformité des rapports m'a autorisé à croire que l'armée ennemie avait dépassé Znaïm, et que, tout au plus, une simple arrière-garde s'y trouvait: j'ai pu croire, d'après ce qui m'a été affirmé, que deux régiments de cavalerie et deux régiments d'infanterie, ainsi qu'on le disait, occupaient seulement la ville de Znaïm, se disposant à la retraite, ayant entendu le canon le 9, presque dans la direction de cette ville. L'ennemi ne m'a d'abord présenté que de la cavalerie, ensuite quelques tirailleurs. Plusieurs de ces tirailleurs pris ne m'ont parlé que de quatorze bataillons de grenadiers, qui venaient d'être envoyés ici pour protéger la retraite, et j'ai dû me croire assez fort pour les battre.
«Ce n'est qu'après deux heures de combat que j'ai pu juger que l'ennemi avait environ trente mille hommes, divisés par la rivière, et que le maréchal Masséna marchait à eux.
«Dans cette situation, je me trouvais encore à même d'obtenir les plus grands succès sans secours.--Plus tard enfin, les mouvements de cavalerie m'ont donné l'occasion de voir encore trente mille hommes à une lieue de moi, et j'ai jugé alors que le concours du général Davoust était nécessaire, et je lui ai écrit en toute hâte. J'aurais cru manquer à mes devoirs de le faire plus tôt, puisque j'aurais influé sur les combinaisons de Votre Majesté par une alarme prématurée. J'ai envoyé trois officiers au général Davoust, et l'officier de génie italien était le premier. Ainsi je n'ai négligé aucun moyen de lui donner de mes nouvelles.
«Une fois maître de la position que j'avais attaquée, j'ai dû la conserver, parce que tous les mouvements de l'ennemi indiquaient évidemment l'intention de se retirer, parce que ma position était bonne, et que je pouvais, pendant cinq à six heures, soutenir tous les efforts de l'armée ennemie, ma gauche étant appuyée à la rivière dans un endroit qui n'est pas guéable et où les rives sont escarpées: mon front, couvert par un ravin extrêmement facile à défendre et par un village offensif et défensif; ma droite, par deux fermes qui sont voûtées, que j'ai fait créneler, qui sont deux forteresses et qui sont placées précisément à la distance convenable pour soutenir et rendre inexpugnables les quatre mille chevaux que j'ai; enfin la ferme la plus à droite, étant appuyée par un bois très-vaste, complète tout le système de défense. En dernier lieu, je devais toujours faire entrer en balance le concours du maréchal Masséna, dont j'avais vu le feu, et la terreur d'un ennemi qui se retire, qui est tourné, et la vigueur des troupes que je commande.
«Quant à ce qui regarde la communication, Sire, voilà ce que j'ai fait. J'ai laissé le 7e régiment de chasseurs à Laah, jusqu'à huit heures du matin, partie au pont de Ruhauf et partie à Schonau sur la route de Nikolsbourg, et il n'a quitté cette position que quand j'ai connu officiellement que l'avant-garde du maréchal Davoust était arrivée à Nikolsbourg, et que les postes du 1er dragons occupaient le cours de la rivière; enfin, Sire, j'ai eu constamment deux escadrons occupés à observer les bords de la Taya, depuis la position que j'occupe jusqu'à deux lieues en arrière de nous.
«Sire, j'espère que Votre Majesté agréera avec bonté l'exposé de ces faits, et qu'il rétablira dans son opinion autant ma prudence que mon désir de bien faire.
«J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Majesté le croquis qu'elle m'a demandé.»
LE MAJOR GÉNÉRAL AU MARÉCHAL MARMONT.
«Au camp devant Znaïm, le 12 juillet 1809.
«L'Empereur ordonne, monsieur le maréchal, que vous fassiez partir, demain 12, la division bavaroise du général de Wrede, pour se rendre, à petites journées, à Lintz. Vous lui ordonnerez de traverser le cercle d'Ober-Manhartsberg, et, en y passant, d'installer l'intendance et le commandant de la province dans la principale ville. Le général commandant cette division verra M. l'intendant général, qui fera partir avec lui l'intendant qu'il aura désigné; quant au commandant, l'adjudant-commandant Maucune est nommé à cet emploi. Vous prescrirez aussi à la division de Wrede de laisser, en passant, un bataillon au chef-lieu de la province.
«L'Empereur remet sous les ordres de M. le maréchal duc d'Auerstädt la division de cavalerie légère du général Montbrun tout entière. J'en ai prévenu ce général, et je lui ai prescrit de prendre sur-le-champ les ordres du duc d'Auerstädt, ayant un mouvement à faire dès ce soir.
»Sa Majesté, monsieur le maréchal, ordonne que vous preniez le commandement du cercle de Vienne, sur la rive gauche du Danube qui confine à la March. Vous établirez votre quartier général dans le chef-lieu de ce cercle, et vous ferez baraquer votre corps d'armée par division, à une ou deux lieues de distance. Vous commencerez demain votre mouvement; faites-moi connaître l'itinéraire de votre marche.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU PRINCE DE NEUFCHÂTEL.
«14 juillet 1809.
«Monseigneur, quoique mes rapports journaliers vous aient fait connaître dans le plus grand détail les événements qui viennent d'avoir lieu, je crois de mon devoir de vous rendre un compte qui en présente l'ensemble.
«Le 7, je reçus l'ordre de me porter en avant avec mon corps d'armée, augmenté de la division bavaroise et de la cavalerie légère du général Montbrun, pour marcher à la recherche de l'ennemi par la route de Nikolsbourg. Arrivé à Wüllersdorf, j'y acquis la certitude que très-peu de troupes ennemies y avaient passé, et qu'au contraire la masse de ses forces était dirigée sur Znaïm. Je me mis en marche pour me porter sur cette ville, à une lieue et demie de laquelle j'arrivai le 10, à onze heures du matin. Tous les rapports qui m'avaient été faits s'accordaient à m'annoncer que l'armée ennemie avait dépassé cette ville, et que je n'y trouverais plus qu'une arrière-garde.
«Je vis bientôt paraître, sur les hauteurs qui couvrent le bassin de Znaïm, six à sept mille hommes d'infanterie qui voulaient m'en disputer la possession. Je les fis immédiatement attaquer par la division Clausel, soutenue par la division bavaroise, ayant en réserve la division Claparède.
«Le 8e régiment d'infanterie légère, soutenu du 23e, chargea avec tant de vigueur et de confiance l'ennemi, que, dans peu d'instants, il fut forcé à la retraite. Le général Delzons conduisait cette charge avec son habileté ordinaire. La cavalerie du général Montbrun culbuta toute la cavalerie ennemie qui était sur la gauche, et nous arrivâmes bientôt sur les bords du ravin qui borde la plaine.
«J'aperçus alors bien distinctement dix à douze mille hommes de troupes autrichiennes dans le bassin, et un corps de vingt à vingt-cinq mille sur la rive droite de la Taya, qui n'avait pas eu le temps de passer cette rivière. Déjà différents indices me faisaient soupçonner le voisinage du maréchal Masséna par la route de Stokerau.
«Je pensai que la fortune m'offrait la plus belle occasion possible, et que je pouvais détruire l'armée ennemie en battant ce que j'avais devant moi, en coupant les ponts, et livrant tout ce qui était de l'autre côté de la rivière au maréchal Masséna.
«Je fis mes dispositions d'attaque; mais, avant de les faire exécuter, je crus utile de bien faire éclairer ma droite, et j'ordonnai un mouvement offensif à la cavalerie du général Montbrun. Ce mouvement nous découvrit près de quarante mille hommes de l'armée ennemie, avec tout le parc d'artillerie qui était en avant de Znaïm. La présence d'une force aussi considérable me fit renoncer à attaquer l'ennemi; mais, fort de l'opinion qui soutient les armées victorieuses, assuré de l'ignorance de l'ennemi sur mes véritables forces, je pris avec sécurité position sur les bords du ravin. Je fis retrancher deux fermes qui servaient d'appui à ma droite, couvraient ma cavalerie, et j'occupai le village de Tisevich, qui était en avant de mon front et me donnait action sur les ponts de la Taya, et je fis garnir d'une nombreuse artillerie toutes les hauteurs.
«L'ennemi voulut bientôt nous faire évacuer le village, et l'attaqua avec beaucoup de vigueur. Il fut défendu avec opiniâtreté par le général bavarois Becker, commandant la deuxième brigade. Mais, après un certain temps, de nouveaux secours lui furent nécessaires pour conserver une partie du village dont l'autre lui avait été prise par l'ennemi. Le combat se soutint avec des alternatives de revers et de succès, et la moitié du village fut prise et reprise trois fois de suite; mais la fortune fut fixée quand le 81e régiment marcha au secours du général Becker.
«Je dois beaucoup d'éloges à la manière vigoureuse dont ce général s'est conduit, et je dois beaucoup de louanges au colonel Bonté à la défense qu'il a faite pendant ces événements.
«L'ennemi, après de fréquentes charges sur le village, se trouvant en désordre, j'ordonnai au général comte Preiken, qui commande les chevaux bavarois, de déboucher et de charger l'ennemi. Cette charge, faite avec beaucoup de vigueur, eut pour résultat ce que je devais en attendre, et l'ennemi perdit un bon nombre de prisonniers.
«L'ennemi dirigea plusieurs colonnes sur d'autres points de ma ligne, mais sans succès; et, après un combat de neuf heures, nous restâmes maîtres des positions dont nous nous étions emparés.
«Le lendemain, l'ennemi se disposa à la retraite. Lorsque je vis déboucher sur les bords de la Taya l'avant-garde du maréchal Masséna, je me portai en toute hâte sur les flancs de l'armée ennemie, espérant pouvoir l'entraver dans son mouvement. La disproportion de mes forces avec celles de l'ennemi m'obligeait à attendre que, d'un côté, le corps du maréchal Masséna eût fait des progrès, et que, de l'autre, celui du maréchal Davoust fût en liaison avec moi. L'ennemi, qui s'aperçut de mon projet, vint m'attaquer, et il en résulta un combat où l'ennemi, malgré les avantages du nombre, ne put nous faire céder le terrain. Mais Votre Altesse Sérénissime en est aussi bien instruite que moi, puisqu'elle y a assisté sur le soir.
«Sa Majesté m'ordonna de marcher sur Znaïm, afin d'aider au mouvement du maréchal Masséna, et nous allions entrer dans cette ville lorsque je reçus l'ordre de faire cesser le feu.
«Les résultats de cette journée sont d'avoir pris deux drapeaux, deux mille hommes à l'ennemi; d'avoir retardé sa marche, de manière à ce qu'elle aurait pu être combattue avec avantage si la générosité de l'Empereur n'eût fait accorder une suspension d'armes à l'ennemi.
«L'ennemi a perdu plus de trois mille hommes tués ou blessés dans ces deux journées. Nous avons eu seize cents hommes hors de combat. Parmi les blessés se trouvent le général de division Claparède, les généraux de brigade Delzons et Bertrand. C'est la deuxième fois dans la campagne que le général Delzons est blessé.
«Je ne saurais trop me louer des généraux, officiers et soldats. Mais je dois particulièrement des éloges aux généraux Clausel et Delzons.»
LE MAJOR GÉNÉRAL AU MARÉCHAL MARMONT.
«Schoenbrunn, le 17 juillet 1809.
«Je vous préviens, monsieur le maréchal, que l'intention de l'Empereur est que votre corps d'armée prenne la dénomination de onzième corps.
«Je donne l'ordre au général Lariboissière de faire les dispositions nécessaires pour y attacher trente pièces d'artillerie; correspondez à cet égard avec lui.
«Le prince vice-roi m'a annoncé qu'il vous avait envoyé tous les troisièmes et quatrièmes bataillons qui étaient à l'armée d'Italie, et dont les premiers bataillons étaient sous vos ordres. Faites-moi connaître si tous ces bataillons sont arrivés, et envoyez-m'en la liste, ainsi que l'état de situation.
«Je donne l'ordre à la brigade de cavalerie légère du général Thiry, composée du 1er régiment provisoire de chasseurs, d'un régiment de chevaux légers wurtembergeois et du 25e régiment de chasseurs, de se rendre de Presbourg auprès de vous, pour faire partie de votre corps d'armée. Le prince vice-roi vous fera donner avis de sa marche.
«Je donne l'ordre aux généraux Bertrand et Lariboissière de réorganiser les équipages de pont, et, par suite de cette disposition, votre corps d'armée aura une compagnie de pontonniers avec trois pontons sur trois haquets munis de leurs poutrelles, madriers, ancres, cordages, etc., de manière à pouvoir jeter un pont de vingt toises.
«Le général Bertrand est chargé aussi d'organiser sur-le-champ le service du génie et d'attacher à votre corps d'armée une compagnie de sapeurs, le nombre d'officiers du génie nécessaire, et six mille outils sur des chariots attelés.
LE MAJOR GÉNÉRAL AU MARÉCHAL MARMONT.
«Schoenbrunn, le 17 juillet 1809.
«L'Empereur ordonne, monsieur le maréchal, que vous portiez votre quartier général à Krems, et que vous fassiez camper votre corps d'armée, par deux divisions, aux environs de cette ville. Sa Majesté vous recommande de former des magasins et d'utiliser toutes les ressources du cercle dont Krems est le chef-lieu, pour l'approvisionnement de votre armée. Elle verrait avec plaisir que vous établissiez à Krems un atelier d'habillement pour reformer l'habillement de vos troupes. Vous mènerez avec vous la division de cuirassiers commandée par le duc de Padoue, qui est maintenant à Stokerau; vous la cantonnerez dans tout le cercle, en choisissant les lieux les plus favorables pour son établissement, et vous emploierez tout pour la mettre en état. Je joins ici un ordre pour cette division.
«Je vous préviens aussi, monsieur le duc, que l'intention de Sa Majesté est qu'on ait soin d'établir des hôpitaux de convalescence dans les lieux où sont placées les divisions. Les divisions doivent camper; les administrations doivent être avec elles, et Sa Majesté recommande expressément que l'on s'occupe de remonter la cavalerie et de se mettre dans le meilleur état possible.
«Je n'ai point reçu vos états de situation, depuis la bataille; je vous prie de me les faire adresser.»
NAPOLÉON AU MARÉCHAL MARMONT.
«Schoenbrunn, le 24 juillet 1809.
«Mon cousin, je ne conçois pas que vous fassiez dépendre la construction de vos camps de savoir si vous conserverez ou non les quatrièmes bataillons; c'est tout à fait de l'enfantillage. Faites camper sans délai vos troupes et faites-les exercer, c'est le meilleur moyen de maintenir parmi elles l'ordre et la discipline; et les mois d'août et de septembre sont les plus favorables pour le campement. J'irai dans huit jours passer la revue de votre corps; faites que je voie les camps en bon état.»
NAPOLÉON AU MARÉCHAL MARMONT.
«Juillet 1809.
«Mon cousin, le 25e régiment de chasseurs, qui fait partie de votre corps d'armée, a, au dépôt de cavalerie de Klosterneubourg, cent cinquante hommes à pied. Il vous est facile de faire acheter des chevaux à un prix raisonnable, sur les confins de la Bohême, pour monter ces hommes. Occupez-vous de cela, et tâchez de procurer à ce régiment, qui n'a que quatre cents chevaux à l'armée, une centaine de chevaux, ce qui, avec les deux cents qui lui viennent d'Italie, le porterait à sept cents chevaux.»
LE MARÉCHAL MARMONT À MARET.
«28 juillet 1809.
«Monsieur le comte, je ne reçois qu'en ce moment la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire le 23 juillet, et je ne perds pas un moment pour y répondre. Je commence d'abord par vous remercier du sentiment qui l'a dictée, et je m'empresse de vous donner les renseignements que vous me demandez.
«Il y a dix généraux qui comptent en ce moment à mon corps d'armée, dont deux généraux de division et huit généraux de brigade. Le général de division Claparède, le général de brigade Delzons, le général Soyez, le général Thiry, sont les seuls qui, jusqu'ici, aient reçu des titres. Les autres méritent tous d'en recevoir, et j'ai la conviction intime que, dans aucun corps de son armée, Sa Majesté n'a de plus braves généraux et de plus dévoués à sa personne. Voici leurs noms:
«Le général de division Clausel est un officier de la plus grande distinction, et auquel je ne saurais donner trop d'éloges pour sa conduite dans la campagne que nous venons de faire pendant tout le temps qu'il a servi sous mes ordres.
«Le général de brigade Tirlet, commandant l'artillerie. C'est un officier rempli du zèle le plus ardent, qui a fait toutes les campagnes d'Égypte, qui est déjà fort ancien général de brigade, et dont tous les cadets ont été faits généraux de division et revêtus de titres. Je n'ai jamais eu, depuis six ans qu'il sert avec moi, que des éloges à lui donner.
«Le général Launay a été blessé très-grièvement à l'affaire de Gospich, où il s'est comporté de manière à mériter beaucoup d'éloges; il est un des plus anciens généraux de l'armée française.
«Les trois autres généraux sont MM. Bertrand, Bachelu et Plauzonne, que Sa Majesté a promus il y a deux mois. Ils sont tous les trois des officiers de la plus grande distinction.
«Le général Delzons et le général Soyez ont reçu précédemment le titre de baron et une dotation de quatre mille francs. Je vous les recommande pour y faire ajouter ce que les bontés de l'Empereur voudraient leur accorder. Ce sont des officiers de fortune et des plus braves que je connaisse. Le général Delzons, entre autres, est un officier de la plus grande capacité. Le général Soyez a été blessé à l'affaire de Gospich d'une manière très-grave. Le général Delzons l'a été plus légèrement, mais deux fois, l'une à l'affaire d'Ottochatz, et l'autre devant Znaïm.
«Je finirai par vous prier de recommander aux bontés de Sa Majesté l'adjudant général Delort, qui remplit les fonctions de chef d'état-major de mon corps d'armée, qui est, pour ainsi dire, le plus ancien colonel de l'armée, et mon premier aide de camp Richemont, officier de la plus grande valeur et digne des bontés de l'Empereur.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU PRINCE DE NEUFCHÂTEL.
«14 août 1809.
«Monseigneur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 11 août.
«Je n'ai point eu l'intention de changer les dispositions ordonnées par l'Empereur; mais bien, au contraire, d'exécuter, fidèlement et ponctuellement, ce qui a été prescrit par l'ordre du jour dont j'ai l'honneur de vous envoyer copie.
«Il est accordé aux soldats, dans les cantonnements, seize onces de viande, vingt-quatre onces de pain de munition, quatre onces de pain de soupe, une bouteille de vin, et une ration d'eau-de-vie.»
Et, comme il n'est pas possible que l'intention de Sa Majesté soit que les troupes campées soient moins bien traitées que les troupes cantonnées, mais que, au contraire, il me paraît clair que sa volonté est qu'elles reçoivent cet accroissement de nourriture pendant tout le temps qu'elles seront nourries par le pays, j'ai cru devoir ordonner l'application au camp de l'ordre relatif aux cantonnements. J'ajouterai que les troupes de mon corps d'armée sont arriérées de trois mois de solde, et que, si elles ne recevaient pas un accroissement de nourriture, elles souffriraient beaucoup et seraient loin de se refaire, ne pouvant rien acheter pour mettre à l'ordinaire tant qu'il ne sera pas possible de leur faire le prêt régulièrement.
«Ces considérations et le texte de l'ordre de Sa Majesté m'ont décidé à vous adresser ces représentations et à vous demander de me faire connaître les ordres de l'Empereur.»
NAPOLÉON AU MARÉCHAL MARMONT.
«Schoenbrunn, le 29 août 1809.
«Mon cousin, allez voir Presbourg, la position de Theben, Marcheck, Augern, et remontez la March jusqu'à Göding. De là, allez à Nikolsbourg et Brunn, visitez la citadelle de Brunn, et revenez par Znaïm sur Krems. Cette tournée est convenable pour bien observer la nature du terrain entre les monts Krapacks et la March; suivez la chaîne des Krapacks, aussi loin que vous le pourrez, jusqu'aux postes ennemis. Reconnaissez bien Presbourg et le terrain depuis Presbourg jusqu'à Marcheck et le long de la March.»
LE MAJOR GÉNÉRAL AU MARÉCHAL MARMONT.
«Schoenbrunn, le 6 septembre 1809.
«Je vous préviens, monsieur le maréchal, que l'Empereur partira d'ici, le 8, à quatre heures du matin, et se rendra, par la rive droite du Danube, à l'abbaye de Gottweig, où Sa Majesté déjeunera. Sa Majesté passera ensuite le Danube à Mautern, et se tendra au camp de Krems, où elle verra toutes les troupes qui sont sous vos ordres, infanterie, cavalerie, artillerie, tant la cavalerie légère que la grosse cavalerie. Donnez, en conséquence, monsieur le duc, tous les ordres nécessaires pour cet objet, et, à cet effet, vous ferez reployer tous les postes.
«Je vous préviens en même temps que Son Altesse Impériale le prince vice-roi d'Italie se rendra demain, 7, pour passer une revue détaillée de la troisième division de cuirassiers. Donnez vos ordres pour que tout soit prêt pour cette revue.»
(Par duplicata.)
LE MAJOR GÉNÉRAL AU MARÉCHAL MARMONT.
«Schoenbrunn, le 10 septembre 1809.
«L'Empereur ordonne, monsieur le maréchal, que vous placiez la division de cuirassiers aux ordres du général duc de Padoue, savoir les derniers postes à la distance de dix lieues de Stokerau, le long du Danube, sur la route de Krems, sur celle de Bohême et sur celle de Znaïm. Le général commandant la division placera son quartier général à deux lieues au plus de distance de Stokerau, et il ne devra avoir aucune troupe à Stokerau.
«Je donne l'ordre à M. le maréchal duc de Reggio de retirer ce qui appartient à la division de cuirassiers du général Saint-Germain et à toute autre espèce de cavalerie, pour les pousser sur la route de Brunn et sur la March.
«Sa Majesté ordonne aussi, monsieur le duc, que vous fassiez faire, par un officier d'état-major, une reconnaissance de Krems à Lintz par la rive gauche du Danube, de Krems à Znaïm, et de Krems à Stokerau. Cette reconnaissance devra être faite sur l'échelle de trois lignes pour cent toises, et il faudra avoir soin d'y faire connaître la nature des chemins, leur voie et celle des montagnes.»
1809--1810
SOMMAIRE.--Le duc de Raguse à Paris.--Conversations intimes.--Le duc Decrès.--L'Empereur à Fontainebleau.--Pouvoir du gouverneur des provinces illyriennes.--Le cardinal Fesch.--Les provinces illyriennes.--Régiments frontières.--Les faiseurs de Paris.--Les pachas turcs.--Expédition d'Isachich et de Bihacz.--Reddition de Czettin.--Administration.--Le blocus continental; son influence.--Garde nationale.--Système de contributions directes.--Emprunt à Trieste.--Ponts et chaussées.--Instruction publique.--Régie des tabacs, poudres et salpêtres.--Inspection des régiments frontières.
Je revenais content, satisfait, après avoir été nommé maréchal avec le suffrage de l'armée. La campagne avait été glorieuse, et véritablement elle était une des plus belles qu'eût faites l'Empereur, si l'on songe à la nature et à la faiblesse des moyens dont il avait disposé à son début. C'était toujours le grand capitaine, objet de l'étonnement du monde. Il n'était tombé encore dans aucune des aberrations qui ont marqué la fin de sa carrière. Si, comme politique et comme souverain, on pouvait l'accuser, je ne l'avais pas vu assez longtemps, et j'avais surtout perdu de vue la France depuis trop d'années, pour juger sainement les changements qui s'étaient opérés en lui et dans la situation des choses. Mon admiration pour sa personne était toujours la même. J'arrivai à Paris avec ces sentiments, peu en harmonie avec ceux du public. Certes, on appréciait cette campagne de 1809; on était satisfait de la paix; mais on était blasé sur la gloire militaire. On voulait du repos, on désirait plus de liberté, une existence plus calme, et on voyait l'avenir encore chargé de tempêtes. Je retrouvai mes amis avec grand plaisir; ils me revirent avec joie; mais j'étais surpris de leur froideur et de leur calme sur les questions politiques. Un d'eux surtout m'étonna à un point impossible à exprimer; les paroles qu'il m'a dites, il y a bientôt trente ans, retentissent encore à mon oreille, et je ne puis m'empêcher de les consigner ici.
Le duc Decrès, ministre de la marine, était mon compatriote; nous avions des alliances communes; j'avais navigué à son bord dans la traversée d'Égypte. C'était un homme de beaucoup d'esprit. Nous nous étions convenus et liés intimement. Je ne ferai pas l'éloge de son caractère passionné et vindicatif; je connais plusieurs traits de lui blâmables; mais, personnellement, j'ai toujours eu à me louer de ses procédés envers moi. Il me vit bien satisfait, bien ardent dans mes récits. Après m'avoir laissé dire, après m'avoir écouté, il prononça ces propres paroles: «Eh bien, Marmont, vous voilà bien content, parce que vous venez d'être fait maréchal. Vous voyez tout en beau. Voulez-vous que moi je vous dise la vérité, que je vous dévoile l'avenir? L'Empereur est fou, tout à fait fou, et nous jettera tous, tant que nous sommes, cul par-dessus tête, et tout cela finira par une épouvantable catastrophe.»
Je reculai deux pas et lui répondis: «Êtes-vous fou vous-même de parler ainsi, et est-ce une épreuve que vous voulez me faire subir?
--Ni l'un ni l'autre, mon cher ami: je ne vous dis que la vérité. Je ne la proclamerai pas sur les toits; mais notre ancienne amitié et la confiance qui existe entre nous m'autorisent à vous parler sans réserve Ce que je vous dis n'est que trop vrai, et je vous prends à témoin de ma prédiction.» Et là-dessus, il me développa ses idées en me parlant de la bizarrerie des projets de l'Empereur, de leur mobilité et de leur contradiction, de leur étendue gigantesque, que sais-je? Il me présenta un tableau que les événements n'ont que trop justifié. Plus d'une fois, depuis la Restauration, j'ai rappelé à Decrès notre conversation et son étonnante, mais bien triste prédiction.
L'Empereur arriva et fut s'établir à Fontainebleau. Je m'y rendis plusieurs fois et j'y restai quelques jours pour connaître ses intentions sur les provinces illyriennes et recevoir ses instructions. Une organisation provisoire fut faite. Elle m'investissait de tous les pouvoirs, et me transmettait l'autorité du souverain. On me donna divers agents principaux. D'abord un intendant général pour l'administration proprement dite, sous mon autorité, au moyen des décisions et des arrêtés que je prendrais sur ses rapports. Cet intendant était chargé des finances, de l'intérieur, de la police, des douanes, etc. Un commissaire général de justice exerçait, également sous moi, les fonctions de ministre de la justice. Je ne devais correspondre qu'avec un seul ministre, celui des finances, pour toutes les affaires de l'Illyrie, et avec le ministre de la guerre pour l'armée française qui y était placée. En un mot, j'étais, dans toute l'étendue du terme, un vice-roi dont le pouvoir n'avait pas de bornes.
Aucun de mes actes, pendant tout le temps de mon séjour en Illyrie, n'a été l'objet d'une désapprobation. Je rendrai compte, dans ces Mémoires, des principales circonstances de mon administration. L'Empereur me donna, en partant, pour instruction générale, de faire pour le mieux. Je pense avoir rempli cette tâche, puisque j'ai tout à la fois tiré le plus grand parti de ce pays sous le rapport des ressources, ménagé les habitants, fait régner l'ordre et la justice, et laissé chez eux des souvenirs honorables, dont j'ai reçu de grandes marques, et qui, plus d'une fois, ont été pour moi, dans d'autres temps, le motif de véritables consolations et des plus douces jouissances.
Lors de mon séjour à Fontainebleau, l'Empereur avait de fréquents débats avec son oncle, le cardinal Fesch. Pendant l'été qui venait de s'écouler, Napoléon s'était porté aux derniers actes de violence contre le saint-père, ce pontife vénérable qui l'avait sacré, et dont le concours, en cette solennelle circonstance, avait servi si puissamment à sa grandeur aux yeux des peuples. Au milieu de la nuit du 5 au 6 juillet, le pape avait été fait prisonnier. Aux heures mêmes de cette mémorable bataille de Wagram, au moment où Napoléon, ce puissant monarque, déployait les forces immenses qu'il avait rassemblées, ses agents faisaient, par ses ordres, la guerre à un vieillard, retranché dans son palais, à un vieux prêtre, dont toute la force, tous les moyens de résistance, étaient placés dans ses droits et dans l'opinion des peuples. Grand contraste! mais grave sujet de réflexions. Cinq ans ne s'étaient pas écoulés, et le glorieux souverain, que la raison et la justice ne gouvernaient plus, était tombé, tandis que le vieux prêtre était remonté sur son trône.
Fesch, devenu cardinal, avait repris avec ardeur les sentiments propres aux gens d'Église: il fut, dans tous ces temps, un des plus zélés défenseurs des droits du pape, et il l'a témoigné par une résistance constante, énergique et honorable pour son caractère. Il savait, il est vrai, que la sévérité de l'Empereur envers lui aurait des bornes, et effectivement elle n'a jamais dépassé les paroles et les menaces. Un jour, à Fontainebleau, Fesch disputait avec aigreur, comme cela lui était assez habituel: l'Empereur se fâcha et lui dit qu'il lui allait bien de prendre ce ton hypocrite, à lui, libertin, incrédule, etc. «C'est possible, c'est possible, disait Fesch; mais cela n'empêche pas que vous ne fassiez une injustice, vous êtes sans raison, sans droits, sans prétexte; vous êtes le plus injuste des hommes.» À la fin, l'Empereur le prend par la main, ouvre sa fenêtre et le mène sur le balcon.--«Regardez là-haut, lui dit-il, voyez-vous quelque chose?--Non, lui dit Fesch, je ne vois rien.--Eh bien, sachez donc vous taire, reprit l'Empereur, moi je vois mon étoile; c'est elle qui me guide. Ne comparez plus vos facultés débiles et incomplètes à mon organisation supérieure.»
On retrouve sans cesse, comme je l'ai remarqué, et comme je le remarquerai encore, le besoin qu'avait Napoléon de chercher à rattacher au ciel son origine. Le jour même où cette scène eut lieu, Duroc, qui en avait été témoin, me la raconta, et j'eus la pensée que Decrès pouvait bien avoir raison.
Je partis de Paris le 4 novembre, et je me rendis sans retard en Illyrie. Je m'arrêtai quelques moments à Milan, pour y voir le vice-roi et m'entendre sur divers objets à régler pour la rétrocession de la Dalmatie et de l'Istrie au gouvernement français. J'arrivai à Laybach le 16 novembre.
La ville de Laybach est bien inférieure en population, en richesses et en importance à Trieste; mais elle fut choisie pour la résidence du gouverneur, à cause de la proximité de la frontière d'Autriche et de l'avantage que cette position lui donne comme poste d'observation. J'habitais de ma personne, l'hiver seulement, Trieste, dont le climat est plus doux et la résidence plus agréable. Pendant ce temps, je m'occupais d'une manière particulière des intérêts de cette ville.
Les provinces illyriennes, agrégation de provinces, les unes autrefois vénitiennes et les autres autrichiennes, diffèrent entre elles par le climat, par le langage, par la nature de leur population enfin par toutes les circonstances qui constituent la diversité des peuples. Leur longueur du nord au sud est de deux cent trente lieues. Leurs frontières, au nord, contiguës au Tyrol, se terminaient au sud à la frontière du pachalik de Scutari. Composées du bailliage de Lientz et de Lillion, dans le Tyrol, du cercle de Villach, en Carinthie, de la Carniole, du comté de Goritz, de Trieste, de la Croatie civile et militaire, sur la rive droite de la Save; de l'Istrie vénitienne et autrichienne, de Fiume, de la Dalmatie, de l'État de Raguse et de la province des Bouches de Cattaro, leur population approchait de deux millions d'âmes et se composait d'Allemands, d'Illyriens, d'Italiens, d'Albanais, enfin d'individus de tous les pays, réunis à Trieste. Il y a donc autant de moeurs diverses que de provinces, autant de produits différents que de localités, et surtout les diverses manières d'exister n'ont aucun rapport entre elles. Ainsi les lois et l'organisation ne pouvaient pas être uniformes, et le même régime ne pouvait convenir aux Croates militaires qui gardent les frontières, aux négociants de la ville de Trieste, aux seigneurs de la Carniole, aux mineurs d'Idria et de Bleiberg, et aux matelots de la Dalmatie et de l'Albanie.
La première chose à faire en arrivant était de rétablir l'ordre en Dalmatie. Les Autrichiens, pendant la campagne, avaient fait une invasion dans le plat pays. Le général Knesevich y était entré, et ses troupes avaient occupé tout l'espace compris entre la Zermagna et la Cettina; mais elles n'avaient pas passé cette dernière rivière. Après avoir bloqué Zara, Knim, Klissa et le fort San Nicolo, elles firent prendre les armes contre nous à une partie de la population, séduite par l'espérance d'être traitée plus doucement. Plusieurs agents de l'administration se joignirent à eux; d'autres, restés fidèles, furent arrêtés et conduits en Hongrie. J'envoyai des troupes et des instructions pour faire tout rentrer dans l'ordre, et je punis par le bannissement les employés qui nous avaient abandonnés. Je réclamai les autres qu'on refusait de me rendre, et, afin d'assurer leur retour, j'écrivis au maréchal Macdonald, encore à Gratz, pour lui demander de faire prendre des otages dans cette ville. Cette menace les fit rendre à la liberté. Tout ce qui n'avait pas été envahi était resté tranquille, preuve du bon esprit de la province. Parmi les individus dont la fidélité appela sur eux la colère des Autrichiens, se trouvaient des moines de Saint-François, les mêmes qui, dans d'autres temps, avaient été les promoteurs de la révolte. J'avais donc bien fait de chercher à m'emparer de leur affection, et de mettre à profit leur influence.
Un des premiers actes de mon administration fut de déterminer les divisions territoriales et administratives. Je cherchai la règle à suivre, persuadé qu'en toute chose il y a un principe générateur qui domine la matière. Quand on l'a trouvé, tout est facile: quand on ne le connaît pas, on marche au hasard, et rien n'est coordonné. Ce devoir à remplir m'inspira les réflexions suivantes:
Les divisions administratives doivent varier suivant les localités. À l'exception des très-grandes villes, où l'accumulation de la population multiplie à l'infini les affaires, ce n'est pas le nombre des administrés qui doit servir de règle, mais l'étendue du pays qu'ils habitent. Un administrateur doit pouvoir recevoir, en cas d'urgence, dans les vingt-quatre heures, des nouvelles de ce qui se passe dans le pays qui lui est confié. Suivant la nature du pays, les arrondissements doivent donc être plus ou moins étendus: dans un pays de montagnes, plus petits que dans un pays de plaines; et, dans un pays traversé par de grandes routes, plus grands que dans un pays qui en est privé. Après ce principe, il en est un autre aussi évident. Dans beaucoup de pays, on a borné les cercles et les provinces par les rivières: rien n'est plus absurde. Les rivières, bornes naturelles des États, ne doivent pas être employées aux divisions de l'intérieur. Elles servent de limites aux États: 1° parce qu'elles sont des barrières; 2° parce que chaque État veut profiter des avantages qu'elles apportent par la navigation; 3° parce que c'est un tracé permanent qui n'est pas sujet à contestation. Mais, si, dans un cas, elles servent à diviser, dans l'autre elles doivent réunir. Les intérêts des habitants des deux rives d'un fleuve sont toujours les mêmes; leurs rapports sont multipliés et constants, leurs affaires de tous les moments. Il est donc contraire à la raison de faire ressortir de deux administrations différentes les habitants des deux rives, et les divisions d'administration doivent être circonscrites par bassins, et non se terminer aux bords des rivières.
Ces réflexions m'ont porté à examiner la division de la France en départements, souvent admirée, on ne sait pourquoi: elle a été faite par caprice, sans système, sans principe; on a peine à concevoir jusqu'à quel point on ignorait la règle à suivre. Lyon, par exemple, était frontière de trois départements, et son faubourg de la rive gauche du Rhône n'appartenait pas anciennement au même département que la ville.
Je fis donc ma division territoriale d'après ces principes, en conservant toutefois, autant que possible, les divisions déjà existantes; car rien ne contrarie autant les populations que de changer leurs habitudes sans nécessité.
J'eus à m'occuper promptement des régiments frontières. Grand admirateur de cette organisation remarquable, tout à la fois utile à un peuple barbare par la direction qu'elle lui donne dans le développement de ses facultés, économique pour la défense de la frontière, satisfaisante pour la police et le maintien du bon ordre, et bonne pour le gouvernement qui entretient une véritable et excellente armée, toujours au complet, toujours prête à marcher, et presque sans frais en temps de paix, j'en avais parlé souvent à l'Empereur, et lui en avais fait goûter les avantages. Cependant les faiseurs de Paris, accoutumés à porter des jugements absolus, sans prendre la peine de rien étudier, et convaincus que le développement de l'intelligence humaine date seulement de leur époque, ne veulent pas comprendre que la législation et les institutions, chez tous les peuples, doivent varier de mille manières: bizarres aujourd'hui, elles ont été, dans le temps de leur création, l'expression des besoins publics. Les faiseurs dont je parle prennent pour terme unique de comparaison la France, qu'ils connaissent seule et souvent fort mal. Ils trouvaient monstrueuse la réunion des pouvoirs entre les mains des mêmes individus: ils criaient au scandale, à la violation des principes; ils demandaient la suppression de cette organisation, qui seule donnait du prix à ce pays nouvellement cédé.
Leurs clameurs arrivèrent jusqu'à moi, et je vis toute l'étendue du péril. Si elles eussent été écoutées par Napoléon, c'en était fait de la Croatie, l'anarchie y régnait; une partie de la population passait en Autriche, et les troupes françaises eussent été écrasées de service pour satisfaire aux nécessités de la frontière. Je rédigeai un mémoire où je fis de mon mieux le tableau de l'organisation frontière, des changements qu'elle avait subis, et de la perfection à laquelle elle était arrivée. Les mêmes mains réunissaient tous les pouvoirs; mais il y avait un contre-poids, et des précautions étaient prises pour empêcher l'abus. Je fis voir les avantages immenses qu'en tiraient les services publics, en ménageant une population pauvre, à laquelle on peut demander des travaux, des services militaires, et les produits de sa chétive industrie, mais non de l'argent qu'elle n'a pas. Enfin, je fis remarquer l'harmonie de ses lois tout à la fois dans l'intérêt du souverain et des sujets. Ce mémoire, rédigé en deux jours, et envoyé à l'Empereur par estafette, fut lu aussitôt, et une réponse immédiate m'annonça qu'aucun changement ne serait apporté à l'organisation des régiments croates, que si je le jugeais nécessaire. Je devais les réorganiser, et j'étais autorisé à nommer à tous les emplois vacants, soit en prenant les sujets dans les troupes, soit en les choisissant dans l'armée française. Cette importante besogne fut promptement terminée.
Je nommai colonel du premier régiment (licca) le lieutenant-colonel Slivarich, venu du service d'Autriche: il me parut le plus digne. Les cinq autres régiments furent donnés à des officiers de l'armée française, dont je faisais un cas particulier. Je mis à peu près autant d'officiers français que d'officiers croates, et, de ce moment, les uns et les autres, suivant leurs mérites, furent traités également. L'union s'établit parmi eux; un grand amour du service, une émulation louable, s'empara de leurs esprits, et les officiers croates, afin de se montrer dignes de l'armée dont ils faisaient partie maintenant, déployèrent une activité qu'ils n'avaient jamais connue. Les soldats, fiers de leur nouvelle destinée et des soins dont ils étaient l'objet, regardés dans l'armée autrichienne comme inférieurs aux autres, purent être comparés aux meilleures troupes connues.
J'avais souvent annoncé ce résultat à l'Empereur sans le persuader: en quittant les provinces, je lui prédis qu'à la première guerre il en tirerait un grand parti. À son retour de Russie, il reconnut la vérité de mon assertion: il n'avait jamais eu, me dit-il, de soldats plus braves et meilleurs sous tous les rapports. Cette organisation, véritable chef-d'oeuvre, mérite d'être connue; ceux qui en seront curieux pourront eu lire les détails dans la relation d'un voyage que j'ai publié en 1837.
Des magasins de subsistances, habituellement formés en Croatie, préparent les secours nécessaires dans les années de disette, et donnent le moyen au gouvernement autrichien de faire des avances de cette nature aux Croates. L'année précédente avait été mauvaise; l'invasion des Turcs, au commencement de la campagne, sur une lisière très-fertile, invasion accompagnée d'un incendie général, avait causé de grandes pertes et diminué les moyens de subsistance. Il fallait pourvoir tout à fait à la nourriture de cette population dépossédée de ses terres et de ses maisons, et s'élevant à vingt-cinq mille individus. La chose, peu facile en elle-même, devint embarrassante surtout par la difficulté d'en faire comprendre la nécessité à une espèce de fou que l'on m'avait donné pour intendant général, un conseiller d'État nommé d'Auchy. Cet homme, capable autrefois, mais alors abruti par la débauche et tombé fort bas, était d'une fiscalité incroyable: des peuples placés dans des circonstances particulières et devant plutôt recevoir que donner blessaient sa raison. Je parvins cependant à pourvoir aux besoins de cette population. Mais une autre question s'élevait, et celle-ci était assez délicate. Les Turcs voisins de la frontière avaient envahi le territoire croate, et un peu à mon instigation. Le consul de France à Traunik, David, les y avait poussés: cette diversion alors était dans notre intérêt. Aujourd'hui mon rôle avait changé: gouverneur de l'Illyrie, j'étais chargé des intérêts des Croates; mon devoir me commandait de les protéger, de leur faire rendre justice, et l'acte dont ils avaient été victimes était en lui-même très-irrégulier. Je n'hésitai pas; j'écrivis au pacha, au chargé d'affaires de France à Constantinople, au consul de France en Bosnie, pour réclamer la restitution des terres envahies, ainsi que la remise du fort de Czettin, enlevé par surprise. Le pacha promit de donner l'ordre; mais son ordre ne fut pas exécuté, comme il arrive toujours dans cette province quand le vizir commande une chose qui déplaît aux habitants. Le consul de France répugnait à faire des démarches trop vives en opposition avec le langage qu'il avait tenu quelques mois auparavant. Des ordres de Constantinople furent envoyés, mais ils furent reçus comme ceux du pacha.
Je réitérai mes plaintes et mes demandes auprès du vizir. Ce n'était plus mon ami Khosrew-Pacha, qui eût fait, probablement sans fruit, au moins toutes les démarches possibles pour me satisfaire. Son successeur me déclara son impuissance; il avait, quant à lui, disait-il, rempli son devoir complétement; je devais maintenant m'adresser directement aux capitaines de la frontière.
L'empire ottoman, en Europe, ressemble beaucoup à l'état où était la France à la fin de la seconde race et au commencement de la troisième; tout est anarchie, et la province de Bosnie est celle où l'on retrouve davantage l'exemple de la féodalité du moyen âge. Deux espèces de pachas existent en Turquie: premièrement, ceux qui se sont élevés eux-mêmes à ce pouvoir par le brigandage, la révolte et des usurpations successives, d'abord d'un petit territoire, ensuite d'un plus grand, puis d'un plus étendu, et qui ayant obtenu à Constantinople, par la corruption, des titres de possession légitime, ont fait disparaître ainsi le scandale de leur rébellion. Ces pachas-là sont puissants chez eux, et n'obéissent guère au Grand Seigneur, qui ne leur donne des ordres que rarement; de ce nombre sont: le pacha de Scutari; Méhémet-Ali, pacha d'Égypte; et autrefois Ali-Pacha de Janina, et Djezzar-Pacha à Acre. Ensuite viennent les pachas de cour, envoyés dans les provinces soumises. Officiers de la Porte, ils viennent résider, pendant quinze mois, souvent pendant deux ans et demi, quelquefois pendant trois ans, sont respectés et reçus avec égards, touchent un tribut plus ou moins considérable, ordinairement assez léger, mais restent étrangers à tout ce qui regarde la province, et ne sont obéis en rien. Ils cèdent leur place à d'autres, qui sont traités de même, et la province est entre les mains des propriétaires des fiefs, ou timariotes, des possesseurs des châteaux fortifiés. Quand leurs intérêts communs sont en souffrance, ces derniers se réunissent et y pourvoient. Ainsi, dans les pachaliks, où les pachas sont les maîtres, les pachas n'obéissent pas au Grand Seigneur, et, là où les pachas sont soumis au Grand Seigneur, ils sont sans pouvoir dans les provinces qu'ils sont censés gouverner. Les pachas de Bosnie sont dans cette dernière catégorie. Je crus devoir faire quelque démonstration pour appuyer mes réclamations auprès des capitaines de la frontière. En conséquence, je réunis trois ou quatre mille hommes d'infanterie, huit cents chevaux et vingt pièces de canon à Szluin; j'y établis mon quartier général et j'entrai en communication avec les capitaines turcs. Ceux-ci, réunis à Isachich, amenèrent environ dix mille hommes, en grande partie composés de cavalerie, et ils discutèrent entre eux ce qu'il y avait à faire dans la circonstance.
Le consul de France, David, dont j'avais jusque-là constamment eu à me louer, et reconnu le zèle et la capacité, se conduisit mal en cette occasion. Au désespoir d'être forcé de tenir un langage qui le mettait en contradiction avec lui-même, il ne voulait pas comprendre que souvent la politique commande des actions réprouvées par la stricte équité et défendues à un homme privé, dans son intérêt bien entendu; que les devoirs varient suivant les circonstances. Il engageait sous main les Turcs à la résistance, et croyait ainsi mettre fin à mes instances, et conserver à ses protégés les terres dont ils s'étaient enrichis. Il aurait dû mieux juger ma position. Faire rendre justice aux Croates était pour moi une chose vitale, un moyen à saisir avec empressement pour me faire connaître à eux, et montrer l'efficacité de la protection de la France; rétrograder eût été nous perdre gratuitement dans leur esprit.
Ces manières de voir opposées produisirent une négociation difficile; car, au moment où je menaçais les Turcs, celui qui devait me seconder, et qui publiquement tenait le même langage, disait secrètement tout le contraire. Les pourparlers et les discussions durèrent un mois. Un de mes aides de camp résidait auprès de cette espèce de congrès et pressait sa décision. Je montrais une grande longanimité pour prévenir une fausse interprétation de mes mouvements, empêcher le peuple de Bosnie de croire à un commencement de guerre avec la Porte, pour bien établir enfin que ce n'était qu'une discussion de frontière. Plus je montrais de patience, et plus les capitaines turcs se rassuraient. Comme les Turcs ne cèdent jamais qu'à la nécessité et à la nécessité du moment, ils ne supposent pas qu'on puisse être inspiré par un autre sentiment. En conséquence, ne me voyant pas agir, ils ne crurent pas à des hostilités de ma part. Malheureusement cette opinion était partagée par le consul de France, qui eut l'indiscrétion de la leur laisser voir, et dès lors le parti de ne pas céder fut arrêté entre eux. Ils renvoyèrent mon aide de camp et ils répondirent, par l'organe d'Hadgi-Ali, que leurs droits aux terres envahies étaient incontestables, parce que le Grand Seigneur ne les avait pas indemnisés, que, par conséquent, ils les gardaient. Quant aux menaces d'employer la force contre eux, ils savaient parfaitement que je n'oserais jamais les exécuter. C'était me mettre dans la nécessité de les attaquer immédiatement.
Dès le lendemain, au soleil levant, je sortis de mon camp et je marchai à eux. Le spectacle offert par mes diverses colonnes descendant des montagnes était fort imposant; derrière moi marchait toute cette population dépossédée. L'armée des Turcs se composait de dix mille hommes, la plus grande partie formée de cavalerie. Ils avaient construit trois redoutes dans lesquelles ils avaient mis une quinzaine de bouches à feu, dont plusieurs sans affûts étaient en batterie sur des rouleaux. Quelques volées de canon mirent en désordre cette masse confuse; les plus braves se jetèrent sur notre infanterie et se firent tuer. Tout s'éparpilla; nous prîmes les redoutes, l'artillerie, et nous tuâmes environ deux cents hommes. Notre perte fut de cinq hommes.
Je marchai sur Isachich, lieu de rassemblement des capitaines. Les habitants l'avaient évacué. Isachich, avec les hameaux environnants, formait un total d'environ quinze cents maisons. La peine du talion étant la plus juste, les représailles toujours naturelles et opportunes avec des gens semblables, et l'unique moyen d'assurer le repos de l'avenir, je donnai ordre à tous les Croates qui me suivaient de se rendre dans les maisons abandonnées, d'en enlever ce qui était transportable et de quelque prix, et ensuite de mettre le feu partout.--Jamais ordre ne fut exécuté plus consciencieusement et avec plus de joie. Ayant pris la meilleure maison pour mon logement, le lendemain matin, dix Croates attendaient impatiemment, avec des torches, le moment où j'en serais sorti pour y mettre le feu, et tremblaient qu'elle n'échappât à l'incendie. Il est bon et utile de servir l'intérêt des siens; mais qu'on se les attache bien davantage encore en servant leurs passions! Ce pillage et cet incendie, commandés aux Croates, nous conquirent leur affection plus que toutes les faveurs possibles, et la circonstance contribua puissamment à donner à cette population le bon esprit qu'elle a conservé pendant tout le temps de notre domination.
Après avoir fait ce terrible exemple, je me rendis devant Bihacz, ville fortifiée, boulevard de la province, capitale de la Croatie turque. Au moyen d'un pli de terrain qui permettait d'approcher de la place, j'établis des batteries d'obusiers et de petits mortiers de huit pouces. Avant de commencer le feu, j'envoyai aux habitants de cette ville, où s'étaient réfugiés les principaux capitaines, auteurs de tout ce qui s'était passé, un parlementaire avec une lettre, pour leur faire connaître mes intentions. Je venais de leur prouver que jamais mes menaces n'étaient vaines; ils devaient juger combien peu je les redoutais. J'étais prêt à cesser mes hostilités si j'obtenais justice, c'est-à-dire la reconnaissance de nos droits, la libre possession des terres reprises et le repos de la frontière. La terreur régnait partout; aussi ma lettre fut-elle reçue avec reconnaissance et comme moyen de salut. Le capitaine Hadgi-Ali, principal auteur de la résistance, et qui, sur la foi du consul David, avait joué le principal rôle dans cette affaire et m'avait répondu la lettre insolente citée plus haut, crut de son devoir de se dévouer pour apaiser ma colère s'il fallait une victime. Il proposa de se rendre de sa personne dans mon camp afin d'implorer ma miséricorde. La proposition fut agréée. Il se présenta aux avant-postes, accompagné de deux autres députés. Un de mes interprètes alla le recevoir et me l'amena. L'action de ce capitaine était généreuse, car il croyait s'exposer au plus grand danger. Il connaissait l'interprète, et, aussitôt qu'il le vit, il lui dit: «Nicoletto (c'était son nom), parlez-moi franchement, dites-moi la vérité, j'ai assez de courage pour l'entendre: le maréchal demande-t-il ma tête?»--Nicoletto le rassura. J'exigeai une reconnaissance écrite de nos droits, signée de tous les capitaines de l'arrondissement. J'aurais pu obtenir des otages; cette garantie me parut superflue. Je demandai la remise de la forteresse de Czettin; mais ils me déclarèrent et me prouvèrent que la chose était hors de leur pouvoir, le capitaine qui l'occupait n'étant pas avec eux ni dans leur union, et je les crus.
Les tschardaks ou postes fortifiés ayant été replacés, les Croates rentrèrent en possession de leurs biens. La paix fut donc rétablie dans cette partie de la frontière, et n'a pas été troublée depuis. Il était difficile de rentrer de vive force dans Czettin si les Turcs eussent voulu s'y défendre. Un équipage de siége, dont je n'étais pas pourvu, eût été nécessaire. Cette opération m'aurait entraîné dans des dépenses et des travaux supérieurs à mes moyens. Czettin avait résisté aux Autrichiens pendant vingt jours de tranchée ouverte, et les mêmes Turcs de la frontière avaient battu seuls le général Devins. Ne perdant pas un moment et profitant de la terreur causée par les événements d'Isachich et de Bihacz, je crus pouvoir arriver à mes fins. En conséquence, aussitôt mon arrangement terminé, j'écrivis au capitaine qui occupait Czettin la lettre suivante:
«Vous avez été informé des événements d'Isachich et de la soumission des habitants de Bihacz. Je vous préviens qu'à l'instant même je me mets en marche contre vous. Si demain, en arrivant devant la forteresse de Czettin, je la trouve occupée par vos gens, je ne m'amuserai pas à en faire le siége, mais je détruirai toutes vos possessions et mettrai à feu et à sang votre territoire.»
Le lendemain matin, je trouvai le fort évacué par les Turcs, tout le matériel intact, les canons en batterie sur les remparts, et les magasins remplis de vivres et de munitions. Les postes furent rétablis sur cette partie de la frontière comme sur l'autre, et tout rentra dans l'ordre.
Les Croates trouvèrent, dans notre autorité, une protection efficace à laquelle ils n'étaient pas accoutumés. Sous le gouvernement autrichien, on leur donnait toujours tort dans toutes leurs discussions, tant ce gouvernement craignait de se brouiller avec ses incommodes voisins. Ma règle de conduite fut d'être de la plus scrupuleuse justice, mais de soutenir avec énergie les Croates toutes les fois qu'ils auraient raison. Ce qui venait de se passer prouvait, aux uns et aux autres, ma résolution et mon pouvoir; et, depuis ce moment, une parole de moi suffit toujours pour tout terminer.
Les Croates, relevés à leurs propres yeux, étaient devenus fiers, et les Turcs disaient d'eux qu'ils avaient pris la peau française. Parmi ceux-ci, mon nom était resté un objet de terreur. Je l'ai ouï dire il n'y a pas très-longtemps à plusieurs personnes revenant de ce pays. Il est devenu populaire comme moyen de crainte; et quand une mère veut faire taire son enfant qui pleure, elle lui dit: «Tais-toi, ou Marmont va venir.» C'est ainsi qu'autrefois, en France, on menaçait de l'ogre les petits enfants.
Je le répète, la manière dont cette affaire fut traitée a eu une grande influence sur l'esprit des Croates; elle leur a donné, pour ainsi dire, une nouvelle existence auprès des Turcs. J'ai raconté ici cette petite campagne, parce qu'elle concerne les Croates, dont je viens de parler si longuement. Mais cette courte expédition n'eut lieu qu'au commencement du printemps. Un mouvement de troupes au milieu de l'hiver, dans des pays difficiles et pauvres, dépourvus de moyens de cantonnement, aurait été trop pénible. Mes réclamations auprès du pacha furent faites immédiatement; mais la réunion des troupes, les menaces et l'exécution n'eurent lieu qu'au mois de mai.
Une partie de l'hiver fut employée à prendre connaissance de l'administration, à décider tout ce qui pouvait être réglé. Je ne trouvais aucun concours utile dans la personne de M. d'Auchy; au contraire, ses prétentions et son extrême nullité multiplièrent les obstacles. Cependant je parvins à exécuter diverses choses utiles. Après avoir pourvu aux premiers besoins de l'administration, je m'occupai d'une opération urgente, résultant de la séparation de ces provinces avec l'Autriche, c'est-à-dire du tarif de douanes. Un comité d'hommes experts en cette matière fut chargé de faire un projet d'après les bases suivantes:
1° Établir, à l'entrée des provinces illyriennes, des droits assez forts pour donner le plus de revenus possible, et assez faibles pour que la contrebande n'y soit pas encouragée. Cette dernière considération était d'une grande importance, vu l'immense développement et l'étendue du contour des provinces, comparé à leur surface et à leur richesse.
2° Favoriser d'abord l'industrie propre des provinces illyriennes, ensuite celle de la France, puis celle du royaume d'Italie, et enfin celle du royaume de Naples.
3° Établir un droit de transit pour les marchandises entrant en Autriche ou en sortant, dont Vienne est le lieu de consommation présumé ou le point de départ, et le calculer de manière à ce qu'il ne puisse pas élever le prix des marchandises assez pour faire prendre au commerce une autre direction.
4° Augmenter le droit de transit, pour les objets manufacturés en Autriche, en raison du voisinage des provinces illyriennes, et, par conséquent, de la dépendance dont ils étaient de nos communications, mais sans courir risque de les repousser.
J'envoyai le projet du tarif, avec l'indication des bases ci-dessus, au consul de France à Trieste, M. Maurice Séguier, un des hommes les plus distingués, les plus instruits, les plus spirituels et les plus agréables que j'aie jamais connus. Il communiqua ce travail aux négociants les plus éclairés, et nous parvînmes à faire assez promptement et avec succès ce travail, très-difficile de sa nature.
Je pris connaissance des ressources sur lesquelles on pouvait compter; les résultats étaient fort tristes; les revenus ne pouvaient pas s'élever pendant l'année 1810, en raison des pertes occasionnées par la guerre, à plus de cinq millions; et nos dépenses, en y comprenant les troupes françaises destinées à y rester, et dont la force avait été fixée à vingt-quatre bataillons et douze escadrons, devait s'élever à dix-neuf millions. Diverses améliorations pouvaient faire espérer de porter ces revenus de douze à quatorze millions pour les années suivantes; mais il devait toujours rester un déficit, qui, dans ce cas, serait réduit à cinq millions. Nous avions, comme ressources extraordinaires, les domaines de la Carniole, dont l'étendue formait le cinquième de la province, les riches mines de mercure d'Idria, et celles de plomb de la Carinthie. Mais, d'un côté, les biens se composaient en partie de droits féodaux dont la suppression était posée en principe, et l'on ne pouvait pas vendre un objet dont la valeur était au moment d'être réduite. D'ailleurs, l'Empereur disposa de ces biens pour en faire des dotations, ainsi que des mines de Bleiberg; et, quant à celles d'Idria, il les prit pour doter l'ordre des Trois-Toisons, dont il avait décrété la fondation en mémoire de la conquête de Vienne, répétée deux fois, et de celle de Madrid. Ainsi nous étions réduits aux plus minces ressources. Nos embarras étaient encore augmentés par la présence du papier-monnaie, laissé par les Autrichiens, et de la monnaie de cuivre, dont nous étions inondés. L'Istrie, la Dalmatie, Raguse et Cattaro s'en trouvaient exemptées, ce qui compliquait notre position. On ne pouvait brusquement mettre hors de la circulation le papier-monnaie, parce que l'argent était rare et insuffisant pour servir aux moyens d'échange. Afin de rapprocher le moment où l'on pourrait s'en passer et accélérer le retour de la monnaie effective, j'établis la valeur du florin en papier beaucoup au-dessous du cours de Vienne, soit pour les échanges de particulier à particulier, soit pour le payement dans les caisses publiques. Chacun s'empressa d'envoyer son papier à Vienne et d'en faire venir de l'argent, et, dès le mois de mars 1810, je pus prendre un arrêté qui le mettait hors de cours.
Nous fixâmes aussi, par un tarif, la valeur des monnaies de cuivre et de billon; mais, l'évaluation avant été mal faite, et les monnaies arrivant d'Autriche chez nous, il fallut faire un nouveau tarif pour les maintenir à leur juste valeur.
Tous les tribunaux des provinces illyriennes, la Dalmatie et l'Istrie exceptées, ressortissaient autrefois du tribunal d'appel de Vienne. Depuis la séparation et jusqu'à l'organisation de l'ordre judiciaire, il y eut suspension de justice, ce qui fut une grande calamité. Tout était dans le chaos, et la confusion s'augmentait encore par les exigences de l'Empereur, qui demandait des choses impossibles. Il voulait qu'on trouvât de l'argent pour tous les besoins, et cependant son premier acte avait été de déterminer que, pour l'an 1810, les impôts ne seraient pas changés, en ordonnant, d'un autre côté, qu'on appliquât sur-le-champ à ce pays les principes de l'administration française, principes entièrement différents.
Les travaux les mieux faits, les recherches les plus consciencieuses, démontrèrent l'impossibilité d'obtenir, à l'avenir, plus de douze millions de revenus des provinces illyriennes, vu les circonstances dans lesquelles elles étaient placées, c'est-à-dire avec la cessation du commerce et la distraction des domaines et des mines. Nous opérâmes sur cette base, et, de prime abord, nous doublâmes les contributions établies dans les provinces nouvellement cédées. Quant à la Dalmatie, on ne put rien changer à ce qui existait. Toutes les terres de l'intérieur, primitivement concédées à titre de fiefs, payaient autrefois au gouvernement la dîme en nature comme redevance; l'administration italienne ayant rendu les Morlaques propriétaires, la dîme forma l'impôt. Changer chez cette population, dans l'état de misère où elle était, l'impôt eu nature en impôt en argent, quelque faible que fût ce dernier, était tout à fait impossible: aussi je conservai l'ordre de choses établi; mais, au lieu d'avoir une nuée d'employés, et d'embarrasser l'administration de beaucoup de magasins, je fis affermer la dîme par arrondissement.
Le sel était un des plus grands revenus de l'Illyrie, et par la consommation propre de ses habitants, et par les ventes faites aux Turcs. J'ordonnai tout de suite que le payement du sel vendu aurait lieu en argent, et cette disposition fit rentrer quelques sommes dans les caisses publiques. Un contrôle bien entendu établit l'ordre dans cette administration et la plaça à l'abri de la fraude.
Les douanes étaient une grande affaire: le blocus continental, idée fixe de l'Empereur, exigeait impérieusement qu'on s'en occupât. Ce malheureux système, cette combinaison funeste, cause et prétexte de tant et de si criantes injustices, dont l'idée gigantesque avait quelque chose de séduisant pour une imagination comme celle de Napoléon, devenait monstrueuse et absurde dans son application; absurde, car l'Empereur, seul intéressé à l'établir contre le voeu et le besoin de toute l'Europe, pouvant seul en obtenir des résultats favorables, était obligé d'y déroger par des licences, autre scandale, autre infamie. Du jour où l'Empereur, par l'action du despotisme le plus violent exercé sur tous les princes de l'Europe, eut dérogé à son système par des exceptions à son profit, il transforma une idée grande en une misérable spéculation financière, faite aux dépens de ses propres alliés. Aucune raison politique ne justifiant plus alors la mesure la plus tyrannique qui fut jamais, elle mettait le comble à l'humiliation de tous les souverains de l'Europe, et ils durent chercher à s'en affranchir. Mais, par rapport à ses propres sujets, vit-on jamais monstruosité plus grande? Ces licences donnaient le privilége du commerce à un petit nombre d'individus, au détriment de tous ceux de leur classe; faisaient intervenir, dans l'expédition de chaque navire, le gouvernement, qui partageait le profit du commerce par le prix qu'il faisait payer la licence. Sans admettre une liberté illimitée du commerce, question d'une tout autre nature, et en admettant le droit d'en restreindre l'étendue et d'en modifier l'exercice, le gouvernement ne peut intervenir que par des règles générales, laissant à chacun, dans ses actions, la même liberté qu'à son voisin. Avec les licences, un individu corrupteur, mal famé, sans crédit, mais protégé, fait scandaleusement sa fortune; et l'honorable négociant, dont le crédit embrasse le monde, qui a répugné à employer des moyens réprouvés par la délicatesse pour obtenir une faculté qui lui est refusée, végète et consomme ses capitaux au lieu de les faire fructifier.
L'injustice était entre les individus, entre les villes, elle était partout; et, pour compléter le tableau de ce temps d'aberration et de folie, il faut rappeler deux faits dont il y a eu beaucoup d'exemples: des denrées coloniales confisquées, vendues publiquement, confisquées de nouveau et vendues encore; et la confiscation d'objets apportés par des bâtiments munis de licence, mais absents pendant que la mobile législation des douanes avait changé. Ce système, si fatal et si funeste, fut au moment d'être abandonné: on peut en juger par les demandes que l'Empereur fit adresser partout. À la fin de juillet 1810, il posa la question de savoir si l'admission des marchandises coloniales avec des droits extrêmement élevés ne valait pas mieux que la répulsion et la confiscation. Cette question, débattue avec soin, nous amena à conclure pour l'affirmative dans notre réponse. Si la résolution eût été conforme, elle rendait la vie à ce malheureux pays, et particulièrement à Trieste, monument admirable des effets de la liberté du commerce; mais il n'en fut rien. Au contraire, on exagéra toutes les mesures déjà si rigoureuses; et l'Europe, constamment insultée, avilie par le mépris de tous les droits et de toute équité, se disposa à rompre ses chaînes.
L'orgueil a toujours été un des traits les plus marquants du caractère de Napoléon; aussi tous les actes qui mettaient sa puissance en relief lui causaient de grandes jouissances. Cette action constante qu'il exerça pendant quelque temps sur tous les points de l'Europe, à l'occasion du système continental, a eu pour lui un grand charme et une grande séduction, indépendamment des calculs de la politique; mais il oubliait que, par la nature des choses, l'action de la force doit seulement être passagère; sa durée ne peut avoir qu'un temps borné, elle s'use d'elle-même: elle s'use par les intérêts; elle s'use par l'opinion, son auxiliaire indispensable. La puissance, pour être durable, doit être fondée sur la raison, et son action réglée par la modération et la justice. Et combien les flatteurs de Napoléon, qui l'ont précipité ou maintenu dans cette voie, en caressant sa passion dominante, ont eu d'influence sur sa destinée à la fin de sa carrière! Ces flatteurs sont les auteurs véritables de la catastrophe qui l'a englouti.
La forme des provinces illyriennes, dont la largeur est dans plusieurs parties très-petite, et qui se trouvent ainsi avoir une frontière d'une immense étendue, comparée à sa surface, me détermina à mettre en dehors du système continental le pays au sud de Fiume; ainsi le pays enveloppé par les douanes se composa des provinces acquises, plus l'Istrie. Les points d'observation spéciaux lurent les ports de mer et les côtes. L'étendue de celles-ci, ne pouvant être défendue par le faible corps d'armée d'Illyrie, réduit de beaucoup par l'impossibilité de l'entretenir avec les ressources du pays, me détermina à m'occuper de l'établissement d'une garde nationale garde-côtes, depuis Trieste jusqu'à Cattaro. Il en existait déjà une excellente à Raguse, à Cattaro et à Zara: je m'occupai particulièrement de celle de Trieste et d'Istrie, et je réussis au delà de mes espérances. Je développai une émulation extraordinaire dans toute cette population: l'admission dans la garde nationale fut une distinction, et, quelques priviléges plus honorifiques qu'utiles y ayant été attachés, tous les gens riches y arrivèrent en foule. Ils s'habillaient à leurs frais. Une caisse établie dans chaque compagnie, au moyen d'une légère contribution levée sur les hommes aisés, donna même les fonds nécessaires pour habiller ceux qui étaient pauvres. Tous les hommes furent exercés à la manoeuvre du canon et au maniement du fusil. Je fis armer les villes de Capo-d'Istria, Pirano, Rovigno, Pola, etc., etc., et on leur confia des batteries que, dans l'occasion, ils servirent avec intelligence et courage. Pola, à cause de sa belle rade, eut quarante pièces de canon; et, comme les gardes nationales auraient été insuffisantes et que ce point avait d'ailleurs une grande importance, je leur adjoignis deux compagnies d'artillerie de l'armée. Les gardes nationales de service recevaient le pain, et, quand elles quittaient leurs communes pour le service, elles avaient la solde de l'armée.
Jamais je n'ai vu nulle part, en aucun temps, une garde nationale si digne d'être comparée aux troupes de ligne. On peut faire des hommes ce qu'on veut. Tout est dans la manière de s'y prendre; et, quand on ne réussit pas, l'autorité a toujours tort. Je trouvai à Rovigno un ecclésiastique encore jeune, qui semblait regretter d'être prêtre, et je lui demandai pourquoi il avait choisi cet état. Il me répondit: «Hélas! monsieur le maréchal, les idées changent suivant les temps: autrefois, tout le monde voulait être prêtre, comme aujourd'hui tout le monde veut être garde national.»
J'organisai ainsi, depuis Trieste jusqu'à Fiume, un corps de deux mille cinq cents hommes qui servait à merveille, ne me coûtait presque rien et m'assurait la défense des côtes. La totalité des gardes ainsi organisés à Trieste, en Istrie, en Dalmatie et en Albanie, s'élevait à une force d'environ dix mille hommes.
Je me trouve naturellement conduit à raconter ce que je fis pour délivrer l'Istrie de l'oppression exercée sur elle depuis un grand nombre d'années par une bande de brigands sous laquelle elle gémissait.
Depuis trente à quarante ans, des voleurs, au nombre de cent cinquante au moins, cantonnés entre Rovigno et Pola, dans les bois qui couvrent cette partie de la province, faisaient trembler toute la population des environs. Sous les Vénitiens, une faible guerre, rendue peu efficace par l'argent distribué à propos, leur était faite. La proximité de la frontière de la Croatie donnait d'ailleurs aux coupables le moyen d'échapper aux poursuites. Sous le gouvernement autrichien, ils s'étaient un peu modérés, et la mollesse des autorités avait fait leur salut. Quand l'Istrie appartint au royaume d'Italie, les désordres anciens avaient recommencé dans tous leurs excès. C'était à cet état de choses que j'avais à remédier.
Le désordre était tel, que les habitants du sud de l'Istrie et de Rovigno n'auraient pas osé sortir de leurs villes si, d'avance, ils n'avaient pris l'engagement de payer, chaque année, aux brigands une contribution dont la quotité était proportionnée à leur fortune. Un homme voulait-il s'affranchir de cette dépendance, sa campagne était infailliblement brûlée. Une fois la taxe acquittée, chacun pouvait aller et venir librement; ses biens, sa famille et sa personne étaient constamment respectés. On s'était soumis à cette espèce de souveraineté de fait, en payant une somme modérée, plutôt que d'attendre sa sûreté de la protection d'une autorité dont l'impuissance était démontrée.
Mon devoir était de faire disparaître ce scandale, qui rappelait la Turquie; mais j'avais à vaincre, pour ainsi dire, la résistance des habitants, effrayés de se brouiller avec les brigands, et de faire courir des risques à leurs habitations et à leurs personnes si l'autorité, comme il était arrivé tant de fois, n'atteignait pas son but.
Je formai plusieurs détachements de troupes, sous le commandement d'officiers choisis. J'ajoutai à chacun d'eux des détachements de gardes nationales, composés d'hommes sans propriétés, moins exposés que d'autres à la vengeance des brigands, et connaissant bien le pays.
Toutes ces colonnes étant mises sous les ordres d'un officier supérieur, on commença la chasse. Au moment même où on poursuivait les brigands, je fis placer des soldats dans toutes les maisons des villages à portée, dont les habitants étaient, pour la plupart, complices des brigands. Ordre rigoureux fut donné de les retenir tous, hommes, femmes, enfants, jusqu'à la fin des opérations.--Par ce moyen, les brigands perdirent à la fois les avis et les vivres qu'ils tiraient de ces villages ainsi que les refuges qu'ils pouvaient y trouver dans un cas pressant. Abandonnés ainsi à eux-mêmes et privés de tout secours étranger, ils ne pouvaient plus se défendre ni subsister. Une commission militaire en permanence jugeait immédiatement les hommes saisis. La chasse dura trois semaines environ. Soixante et quelques de ces misérables furent pris et pendus sur le lieu même de leurs exploits; une douzaine se soumirent, donnèrent des sûretés, et le reste disparut. Depuis, et tant que dura le régime français, on n'en entendit plus parler. Cette province devint aussi sûre que le reste de l'Illyrie.
Je complétai l'organisation civile des provinces en établissant, à l'instar de la France, une administration des contributions directes, et en faisant faire la répartition de l'impôt fixé pour l'année suivante.
Quoique le pays soit cadastré depuis Marie-Thérèse, cette opération était difficile à la suite d'un si long temps; chaque propriété avait, pour ainsi dire, changé de nature. L'impôt du timbre et de l'enregistrement fut adopté et une régie des domaines créée; mais on ajourna la perception de l'impôt de l'enregistrement jusqu'à là publication du Code civil. Une règle unique est indispensable, et alors il y avait autant de lois et de coutumes que de provinces. Ces divers changements promettaient de l'argent pour l'avenir, mais ne nous en donnaient pas pour le moment. Nos besoins étant extrêmes et d'une urgence impossible à exprimer, je fis un emprunt de cinq cent mille francs à Trieste. Couvert aussitôt, ce fut une ressource momentanée. J'établis une administration des postes et un service régulier pour toute l'étendue des provinces. J'avais, deux fois par semaine, des nouvelles des points les plus éloignés.
Enfin je créai un corps des ponts et chaussées, composé des meilleurs ingénieurs civils des villes et de la province de Carniole, et je mis à sa tête un ingénieur nommé Blanchard, envoyé de France, homme fort capable. Je m'occupai aussi de l'instruction publique, et j'établis deux écoles centrales, une à Laybach et l'autre à Zara, et huit lycées dans les principales villes; deux écoles d'arts et de métiers; des écoles primaires dans toutes les communes. L'instruction enseignée dans les écoles supérieures comprenait le latin et le français, les mathématiques et la physique; et, avec le temps, les écoles de Laybach et de Zara auraient reçu plus de développement. Un assez grand nombre de bourses fut créé, et le tout établi si économiquement, que l'ensemble de l'instruction publique, hors des écoles primaires, ne s'élevait pas, en y comprenant les bourses, au delà de deux cent cinquante mille francs.
Pour achever l'indication sommaire des établissements faits alors, je parlerai encore d'une régie intéressée pour la vente des tabacs, d'une entreprise pour la fabrication des poudres, et des salpêtrières dans toutes les villes. Notre situation devant nous porter aux économies, je fis répartir chez les cultivateurs solvables douze cents chevaux d'artillerie et d'équipages, avec obligation de les représenter au moment du besoin, ou d'autres de même valeur. Cette mesure, en usage en Prusse de tout temps, avait déjà été pratiquée en France, après la paix de Lunéville. Il n'y en a pas de plus utile. On devrait toujours y revenir, car elle donne des moyens d'armement très-prompts. Elle réserve pour le service du gouvernement et utilise pour le pays des chevaux qui, à la fin des guerres, n'ont aucune valeur au moment où ils sont vendus. N'en retrouva-t-on que la moitié au moment où on les réclame, il y aurait encore pour l'État un grand bénéfice de temps et d'argent.
Aussitôt que la saison et les affaires la permirent, je commençai une inspection de détail dans les régiments frontières, et un voyage dans le reste des provinces. Je vis les Croates, compagnie par compagnie, je pourvus à leurs besoins, je satisfis à leurs demandes, et je laissai ce peuple content d'appartenir à son nouveau souverain; il n'avait pas perdu au change, et il le sentait. Il devait conserver ses institutions, auxquelles il tenait beaucoup, et il était l'objet de soins plus empressés et d'une protection plus efficace; et puis le nom français alors était si grand!
J'avais fait traduire en illyrien nos ordonnances sur les manoeuvres. Afin de les faire apprendre aux Croates, j'attachai momentanément deux bons instructeurs français, pris dans les régiments français, à l'état-major de chaque régiment croate. Une instruction normale fut donnée, et un officier et deux sous-officiers par compagnie venaient, sous les yeux des colonels, apprendre à servir eux-mêmes d'instructeurs. J'attachai aussi à chaque régiment français des officiers et sous-officiers croates, pour y être instruits. Dans le cours de l'été, les régiments croates acquirent l'instruction nécessaire pour servir et manoeuvrer avec les troupes françaises, et les Croates, fort intelligents, apprirent assez vite tous les commandements français, pour les faire eux-mêmes et les exécuter. Dès lors, tous les commandements eurent lieu en notre langue, chose indispensable pour des troupes qui devaient servir avec nous.
De bonne heure, j'avais pensé à étendre nos relations de commerce avec la Turquie, et, pour les favoriser, j'avais donné l'ordre de construire un grand lazaret à Costanitza. Le confluent de la Culpa dans la Save m'avait d'abord paru un emplacement plus avantageux, comme pouvant servir également aux marchandises venant par eau et par terre; mais, ces dernières étant de beaucoup les plus nombreuses et devant le devenir davantage encore, leur intérêt particulier dut prévaloir. Le commerce avait déjà les habitudes de Costanitza, et il ne faut pas changer la marche du commerce sans nécessité. Les travaux, conduits avec activité, furent terminés dans la campagne. Cependant un entrepôt secondaire fut établi à Sissek.
J'allai voir aussi les Croates, dont j'avais vengé la querelle et qui rebâtissaient leurs demeures: elles y gagnèrent, comme il arrive toujours en pareil cas; des ingénieurs présidèrent à leurs travaux, et leurs habitations furent réunies par masses de vingt à vingt-cinq maisons. Les régiments étant autorisés à venir à leur secours, des bois leur furent fournis gratuitement; on leur abandonna un certain nombre de journées de travail qu'ils devaient à l'État. L'ouvrage, très-régulièrement exécuté, fut terminé avant la mauvaise saison.
Je réformai une disposition de l'état civil des Croates contraire aux intérêts de la population. Les mariages, trop précoces et autorisés dès l'âge de douze à quinze ans, furent défendus avant seize ans pour les filles et dix-huit ans pour les hommes. J'avais obtenu de l'Empereur d'envoyer deux cents enfants croates, fils d'officiers et de sous-officiers, en France, pour y être élevés, aux frais de l'État, dans nos lycées et nos écoles. Cette disposition fut reçue avec joie et reconnaissance. Je fis faire les choix sous mes yeux. Les jeunes gens partirent sans retard en deux détachements, à pied et conduits par des officiers. Peut-être un jour la France retrouvera-t-elle les fruits de ces soins!
Après avoir visité ainsi la Croatie et revu les champs de bataille où l'année précédente j'avais combattu, je revins par Segna, Fiume, Trieste, Gorizia, Villach et Laybach.
Trois vaisseaux et une frégate nous avaient été cédés par les Russes. L'Empereur voulait, avec un de ces vaisseaux et la frégate, faire le fond de la marine d'Illyrie; les matelots étaient faciles à fournir, mais où était l'argent pour les payer? car l'Empereur se refusait à reconnaître la disproportion existante entre les charges qu'il nous imposait et nos ressources; son esprit présentait déjà, et fréquemment, les contradictions extraordinaires qui depuis ont été toujours en augmentant.
Avant ce temps, il était toujours d'accord avec lui-même: quand il voulait la fin, il voulait les moyens; mais alors il ordonnait l'une sans s'occuper des autres. Il fallait donc nécessairement lui désobéir, ou dans le résultat ou dans le choix des moyens. Je fis visiter le vaisseau; trouvé hors d'état de naviguer par la commission de marine chargée sous mes ordres du service, on le démolit; mais la frégate fut armée au moyen de nouvelles levées, et ces levées fournirent aussi l'équipage du vaisseau le Rivoli qui était à Venise. La frégate alla le joindre et passa à la solde de l'Italie. La flottille de l'Illyrie se trouva seulement composée de deux goëlettes, deux bricks, dix chaloupes canonnières et vingt péniches; elle se divisait en trois stations suffisantes à la protection de nos côtes.
RELATIFS AU LIVRE TREIZIÈME
LE MINISTRE DE LA GUERRE AU MARÉCHAL MARMONT
«Paris, le 11 décembre 1809.
«Monsieur le maréchal, j'ai reçu la lettre que Votre Excellence m'a adressée de Laybach le 25 de novembre, et je me suis empressé de la mettre sous les yeux de Sa Majesté.
«Par cette lettre, monsieur le maréchal, vous demandiez des ordres prompts pour la réorganisation des régiments croates, que Votre Excellence présumait avec raison devoir être conservés au service de l'Empereur.
«Sa Majesté veut, en effet, que les troupes croates soient immédiatement réorganisées; mais elle m'ordonne de vous faire connaître que, pour effectuer cette organisation, Votre Excellence n'a besoin de recevoir aucun ordre de sa part, et que vous devez, de suite, donner tous ceux qui seront nécessaires pour remplir cet objet.
«Sa Majesté vous autorise spécialement, monsieur le maréchal, à faire donner des armes aux soldats croates et à nommer leurs officiers. Elle entend toutefois qu'avant de les armer Votre Excellence se soit assurée qu'on peut le faire avec confiance.»
LE MINISTRE DE LA GUERRE AU MARÉCHAL MARMONT.
«Paris, le 21 décembre 1809.
«Monsieur le maréchal, l'intention de l'Empereur est que Votre Excellence administre ce pays, en touche les revenus, et les fasse servir à l'entretien des troupes. Sa Majesté vous recommande cependant, monsieur le maréchal, de ne rien faire, pour les finances que de concert et par le canal de M. le conseiller d'État d'Auchy.
«Je vous préviens en même temps, monsieur le maréchal, que l'intention de Sa Majesté est que le commandant de la Dalmatie s'adresse à Votre Excellence pour tout ce qui aura rapport au bien du service et aux besoins des troupes stationnées dans celle partie des provinces illyriennes.»
LE MARÉCHAL MARMONT À D'AUCHY.
«1er janvier 1810.
«Monsieur l'intendant général, depuis sis semaines que j'ai rejoint l'armée, il ne m'a pas été difficile de démêler vos sentiments et de remarquer votre conduite. Mais j'espérais que de bonnes manières, et les égards particuliers que je vous ai montrés suffiraient pour vous ramener à des idées plus saines. Puisque le contraire est arrivé, je dois avoir une explication avec vous.
«Il est possible que vous ayez raison de vous plaindre de votre destination, de vous trouver employé d'une manière inférieure à vos droits et à vos talents; mais, quelle que soit votre position personnelle, elle ne vous permet pas de vous exprimer sur le compte de l'armée française comme vous le faites dans vos conversations habituelles: le texte de tous vos discours est l'injustice et l'arbitraire des militaires, et vos passions vous emportent au point de ne pas voir que vous scandalisez ceux mêmes que vous croyez qui y applaudissent.
«Où sont les actes arbitraires? Où sont les injustices? L'armée française ne mérite que des éloges, et mon corps d'armée, en particulier, est un modèle d'ordre, de discipline et de subordination, comme les généraux qui la commandent sont l'exemple de l'honneur et de la délicatesse. S'il y avait des abus, c'est moi que vous devriez en entretenir, et non de nouveaux sujets de l'Empereur, dont l'opinion n'est pas encore fixée, et que, sans doute, vous n'engagez pas ainsi à nous aimer.
«Croyez-vous donc bien servir l'Empereur en cherchant à nous rendre odieux? Non, monsieur, non; vous ne pouvez pas prendre une marche qui soit plus nuisible aux intérêts de Sa Majesté.
«Vous avez établi en principe de persécuter ceux qui ont de la déférence pour nous. Eh mais, monsieur, quelle erreur vous égare, et dans quel pays des généraux qui méritent l'estime et la confiance publique ne doivent-ils pas recevoir des témoignages de déférence? Vous avez menacé de destituer de vos employés par le seul motif qu'ils sont venus quelquefois chez moi. Vous avez traité injustement des hommes parce qu'ils ont montré de l'empressement à me donner des renseignements sur le pays. Vous avez suspendu pour plusieurs mois, après l'avoir menacé de destitution, un ingénieur, parce qu'il a accompagné le général Bertrand, aide de camp de Sa Majesté, dans une reconnaissance sur la Save. Vous avez menacé de destitution un autre ingénieur, s'il se rendait auprès du général Guilleminot, chargé de fixer les frontières, lors même que votre autorité sur eux est incertaine, n'ayant encore d'autre attribution que les finances.
«Mais, en vérité, monsieur, quel est l'esprit qui vous conduit? Y a-t-il guerre civile, et avons-nous des intérêts autres que ceux de l'Empereur?
«Il y a trente-six jours que les troupes françaises occupent Carlstadt. Le pays est dépourvu d'effets de casernement, et je vous ai écrit pour en faire acheter. Vous avez donné des ordres et des moyens à M. Koermelitz, administrateur. J'étais autorisé à espérer que tout serait promptement en ordre. À mon arrivée ici, rien n'est acheté, aucun marché même n'est fait, et les troupes sont dans l'état le plus minable.
«Je suis justement indigné de l'ineptie de M. Koermelitz; et, trouvant dans M. Litardi, auditeur au conseil d'État, un jeune homme plein d'intelligence, de zèle, et muni de votre confiance, je le charge d'établir le casernement. Immédiatement on éprouve les meilleurs effets des mesures qu'il a prises, et, au lieu d'applaudir, vous censurez, vous menacez, vous déclarez que rien de ce que M. Litardi a fait acheter ne sera payé, et vous renvoyez à M. Koermelitz, dont je suis autorisé à soupçonner beaucoup la probité, pour l'examen des fournitures faites à l'hôpital. Ainsi les troupes doivent être victimes de vos passions.
«N'aurai-je donc aucune action sur l'administration du pays? Ma seule qualité de chef de l'armée, et ma présence sur le lieu même, quand vous êtes à quarante lieues, auraient dû vous faire déférer avec empressement à ce que j'avais ordonné, et qui intéresse aussi puissamment la conservation des soldats. Mais, puisque j'ai d'autres pouvoirs, votre conduite est bien plus étrange.
«Monsieur l'intendant général, rien ne peut être plus fatal aux intérêts de l'Empereur, à la tranquillité et au bien-être du pays, que la division que fait naître votre amour-propre froissé. Élever autel contre autel, c'est préparer l'influence de l'Autriche, puisque c'est organiser des partis dont elle saura bien faire usage. Il n'y a et ne peut y avoir qu'un seul point de ralliement, c'est le premier magistrat délégué par l'Empereur.
«J'espère donc que vous ferez cesser une lutte qui ne pourrait offrir que du scandale et nuire aux intérêts de Sa Majesté. Je ne vois pas, d'ailleurs, quels avantages elle pourrait vous promettre; car, quelque répugnance que m'inspirent de pareilles discussions, je saurai, s'il le faut, les soutenir; mais je préférerai toujours vivre en bonne intelligence avec vous, si vous voulez y concourir. Je le désire même vivement, attendu que le bien du service de l'Empereur le commande.
«Je vous adresse un paragraphe d'une lettre du ministre de la guerre, en date du 21 décembre. Il vous fera connaître les intentions de Sa Majesté. En conséquence, je vous prie de vouloir bien, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, ne prendre aucune disposition et ne donner aucun ordre sur les choses de quelque importance dans l'administration des provinces illyriennes, sans m'en avoir rendu compte, et sans avoir pris mon assentiment et mon approbation.»
LE MINISTRE DE LA GUERRE AU MARÉCHAL MARMONT.
«Paris, le 1er janvier 1810.
«Monsieur le maréchal, j'ai eu l'honneur de prévenir Votre Excellence, par ma dépêche du 27 décembre, que, d'après les ordres de Sa Majesté, les troupes qui se trouvaient dans la Croatie devaient être mises sur le pied de paix.
«Par suite de nouveaux ordres de Sa Majesté, cette disposition s'applique à toutes les troupes qui composent l'armée d'Illyrie.
«Je vous prie, monsieur le maréchal, de vouloir bien ordonner toutes les dispositions nécessaires pour la mise sur le pied de paix de toutes les troupes que vous commandez.
«En conséquence de ces dispositions, les officiers généraux qui font partie de l'armée d'Illyrie ne recevront plus, à compter du 1er janvier, présent mois, le supplément de guerre, et ne jouiront, indépendamment de leur solde, que d'un traitement extraordinaire de six mille francs, pour les généraux de division, et de trois mille francs pour les généraux de brigade, le tout par année.
«Les adjudants-commandants ne toucheront plus le supplément de guerre, et ceux qui sont chargés des fonctions de chefs d'état-major, dans les divisions, ne recevront que cent cinquante francs par chaque mois.
«Les bataillons du train ne recevront que la solde déterminée pour le pied de paix.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU DUC DE FELTRE
«Laybach, 9 janvier 1810.
«Monsieur le duc, le colonel Leclère, aide de camp de Votre Excellence, est arrivé et m'a remis les dépêches dont vous l'aviez chargé pour moi. Je vais m'occuper sans retard de l'exécution des dispositions qui sont contenues dans les arrêtés de l'Empereur et dans vos lettres. Votre Excellence s'adressant à moi comme gouverneur général des provinces illyriennes, je crois devoir en remplir sur-le-champ les fonctions, quoique je n'aie pas encore reçu ma nomination.
«La lettre de Votre Excellence du 27 décembre m'annonce que l'intention de l'Empereur est que les troupes qui sont en Croatie soient mises sur le pied de paix, et que je fasse cesser les fournitures arbitraires qui pèsent sur les habitants.
«J'ai l'honneur de vous assurer qu'il n'y a aucune fourniture arbitraire depuis longtemps; que les réquisitions faites en Croatie n'ont eu pour objet que des services réguliers, et n'ont eu lieu, à l'entrée des troupes, que parce que M. l'intendant général n'avait pris aucune disposition pour les faire vivre et pourvoir à leurs besoins.
«Votre Excellence, ne me parlant que de la Croatie, me fait soupçonner que l'Empereur n'a eu pour objet, dans ce qu'il prescrit, que le redressement de torts qu'il croyait exister, et non la mise sur le pied de paix, qui semblerait dans ce cas devoir regarder tout mon corps d'armée. J'attends donc de nouveaux ordres, qui sans doute lèveront bientôt mon hésitation à cet égard.
«J'ajouterai à ce qui précède une observation dont je demande à Votre Excellence de peser l'importance. Si les troupes sont sur le pied de paix et qu'on n'ordonne pas leur solde en papier au cours déterminé et fixé par M. d'Auchy, qui est celui du marché, il est impossible que les troupes vivent, attendu qu'elles recevraient moins de dix sous pour un franc. Le cours fixé et suivi étant de cinq florins pour un, M. d'Auchy a refusé de payer à ce taux et a rendu compte au ministre des finances, qui n'a pas encore répondu. Je demande à Votre Excellence d'obtenir de Sa Majesté une décision qui fixe notre situation: et, puisque les troupes ne peuvent pas recevoir d'argent, il me paraît indispensable, pour qu'elles puissent subsister, qu'on leur donne des vivres en nature, et encore seront-elles très-misérables, ou du papier à sa valeur réelle et au cours fixé par M. d'Auchy, tel enfin que la caisse publique le reçoit.
«Il me reste une autre demande à adresser à Votre Excellence: c'est que, comme les provinces cédées par l'Autriche, et qui font la presque totalité des ressources de l'Illyrie, au moins pour le moment, ne pourraient pas donner, de plusieurs mois, les moyens de payer les troupes en argent, et que le papier n'a pas cours en Dalmatie, il serait nécessaire de donner un secours en numéraire pour les deux régiments qui sont dans cette province, et qui sont depuis longtemps sans aucune solde. Il y a un fonds de près d'un million à Venise, fait au commencement de la guerre pour l'armée de Dalmatie, qui, n'ayant pu le recevoir, n'en a pas disposé.»
LE MINISTRE DE LA GUERRE AU MARÉCHAL MARMONT.
«Paris, 13 janvier 1810.
«Monsieur le maréchal, j'ai soumis à l'Empereur la demande que vous me faisiez de quinze mille fusils pour armer les régiments de Croates que vous formez en ce moment, en priant Sa Majesté de me faire connaître ses intentions à cet égard.
«Sa Majesté me charge de vous mander qu'elle trouve cette demande bien prématurée et bien hasardée, et qu'elle pense qu'il faut ajourner cet armement jusqu'à ce que l'on connaisse bien les dispositions des Croates et que l'on en soit bien sûr. Sa Majesté craint que d'en agir autrement ce serait peut-être agir avec légèreté, et elle a voulu que son observation à ce sujet fût communiquée à Votre Excellence.
«Cependant l'Empereur vous autorise, si vous êtes bien assuré que les Croates ne se serviront pas contre nous des armes qu'on pourrait leur donner, à faire armer tout au plus une compagnie par régiment, mais sans excéder le nombre de mille hommes armés: vous pourrez tirer ces mille fusils de la place de Zara ou de celle de Venise.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU DUC DE FELTRE.
«Laybach, 24 janvier 1810.
«Je reçois la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire le 6 janvier en conséquence d'une lettre adressée au ministre des finances par M. d'Auchy, dans laquelle il se plaint que l'administration des troupes qui occupent les provinces illyriennes était confiée à plusieurs ordonnateurs. Cet état de choses était le résultat de la présence de l'armée d'Italie. Les réquisitions dont on se plaint n'ont été faites que par elle, et elles ont cessé au moment même de son départ.
«L'armée d'Illyrie est depuis longtemps, à l'exception des fourrages, fournie par entreprise.
«J'ai eu l'honneur de rendre compte à Votre Excellence de sa situation, particulièrement des troupes que je commande, qui, sans aucune solde depuis longtemps, seraient sans moyen de subsister si je n'avais pas fait continuer la fourniture de vivres de campagne jusqu'à ce qu'un mois d'appointements et quinze jours de solde et de masse d'ordinaires aient été donnés aux officiers et soldats.»
LE MARÉCHAL MARMONT À SÉGUIER.
«Laybach, 2 février 1810.
«Monsieur le consul général, j'ai l'honneur de vous adresser un projet de tarif de douanes qui a été rédigé pour les provinces illyriennes. Je désire que vous en preniez connaissance et que vous consultiez, sans éclat, les négociants qui vous inspireront le plus de confiance pour avoir leur opinion sur ce travail. Je désire enfin que vous cherchiez à reconnaître si l'application des principes que j'ai posés est bien faite. Ces principes sont:
«1° D'établir à l'entrée des provinces illyriennes des droits assez forts pour donner le plus de revenu possible et assez faibles pour que la contrebande offre peu d'avantages. Cette considération est d'une grande importance, attendu que l'étendue des provinces illyriennes ne permet pas une parfaite surveillance.
«2° Favoriser d'abord l'industrie des provinces illyriennes, ensuite celle de la France, puis celle du royaume d'Italie, et enfin celle du royaume de Naples.
«3° Établir un droit de transit pour les marchandises qui entrent en Autriche et qui en sortent, dont la consommation ou le départ est présumé être Vienne, et calculer le prix des marchandises de manière à ce que les négociants ne trouvent pas avantage à faire prendre une autre direction à leurs marchandises.
«4° Augmenter ce droit de transit pour les objets manufacturés en Autriche, en raison du voisinage des provinces illyriennes, et, par conséquent, de la dépendance où elles sont de nos communications.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU DUC DE FELTRE.
«Trieste, 6 février 1810.
«Je viens de recevoir la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire, le 25 janvier, et qui m'annonce que l'Empereur est dans l'intention de ne donner aucun secours pécuniaire à l'armée d'Illyrie, et qu'elle doit s'entretenir par les ressources du pays.
«Sa Majesté aura reçu peu après le budget des provinces illyriennes, présentant le tableau exact des recettes et des dépenses, et elle aura été à même de juger combien ces provinces sont loin, au moins pour cette année, d'être en état de fournir aux besoins des troupes qui ont été désignées pour les occuper. Quoique je sois autorisé à croire qu'en ce moment Sa Majesté est parfaitement au fait de la véritable situation des choses, je vous demande de mettre sous ses yeux le résumé suivant.
«Le décret du 25 décembre 1809 détermine que les impositions dans les provinces illyriennes seront, dans l'an 1810, les mêmes qu'avant l'entrée des Français.
«Le tableau général des recettes et des dépenses présente, comme résultat disponible, cinq millions de francs environ, en comprenant comme recette un million d'économies qui doit résulter des suppressions à faire en Dalmatie et de celles qui seront la conséquence de la mise en activité de l'organisation projetée; et cependant les dépenses doubles, occasionnées par l'établissement des intendants, sans la suppression des capitaines de cercles, et les réformes à faire en Dalmatie, ne pourront cesser d'avoir lieu que lorsque Sa Majesté aura fait connaître sa volonté, ordonné les suppressions, et prescrit l'organisation qu'elle veut donner aux provinces illyriennes.
«Quelle que soit la promptitude avec laquelle arrivent les ordres, et quelque diligence que nous mettions à les exécuter, il est probable que, pour l'année 1810, les économies, évaluées à un million, n'arriveront pas à plus de six cent mille francs; de manière que l'on peut regarder comme certain que, malgré les bases établies, les produits nets n'iront pas cette année à cinq millions, et les provinces illyriennes ont besoin, pour leur administration, pour l'entretien de vingt-quatre bataillons, ainsi que l'a fixé Sa Majesté, de l'état-major de l'armée et des places; enfin la solde des officiers, sous-officiers et soldats des régiments frontières, de dix-huit à dix-neuf millions. Ainsi le déficit est certainement cette année, et d'après les bases ci-dessus, de treize à quatorze millions.
«Plusieurs circonstances rendent encore douteuse la rentrée de la totalité des revenus. Les consommations extraordinaires qui ont eu lieu dans le pays, les réquisitions qui ont été faites pendant six mois, l'entretien presque à discrétion d'une bonne partie de l'armée d'Italie en Carinthie et à Gorrizia pendant près de trois mois; enfin la chute du papier qui bouleverse les fortunes, et les suppressions prochaines d'une grande partie des droits féodaux dont le principe est consacré dans le décret de l'Empereur; tous ces motifs doivent faire craindre que les impôts ne soient payés que d'une manière incomplète; mais au moins ils autorisent à éloigner l'idée d'une augmentation dans les impôts pour cette année, idée qu'au surplus Sa Majesté a rejetée d'elle-même.
«À ces causes de la faiblesse des revenus, il faut ajouter que les révoltes qui ont eu lieu en Dalmatie ont réduit à rien les revenus pendant l'année 1809, tandis que l'organisation est restée la même, et qu'il est dû huit à dix mois d'appointements à tous les employés de la justice et de l'administration;--que l'état de blocus a fait émettre à Zara, tant pour les travaux de la place que pour le payement des troupes italiennes et de la flotte, une somme de trois cent mille francs en billets de siége, dont l'état a été envoyé au ministre des finances, et dont le royaume d'Italie n'a pas encore opéré le remboursement;--que la circulation de ces billets, qui éprouvent une perte assez considérable, embarrasse et gêne l'administration à Zara;--enfin que la cession au royaume d'Italie des salines du pays, faisant disparaître le peu d'industrie commerciale de la Dalmatie par la destruction des moyens d'échanges avec les Turcs, diminuera le produit des douanes, et enlève encore au trésor public un revenu de sept cent mille francs, tandis que les salines de l'Istrie portent à l'Italie un revenu net de cinq millions, en laissant seulement à l'Illyrie les charges de l'administration de ces deux provinces.
«En conséquence de toutes ces causes réunies, on doit conclure que les revenus nets des provinces illyriennes ne s'élèveront pas et ne peuvent s'élever, pour cette année, à cinq millions.
«Ces revenus, rapprochés du chiffre des dépenses que j'ai eu l'honneur d'exposer à Votre Excellence, tant pour l'administration du pays que pour l'entretien des troupes, telle que leur force a été déterminée par Sa Majesté, et la solde des officiers et sous-officiers des régiments frontières, etc., etc., s'élevant à une somme de dix-huit à dix-neuf millions, présenteront un déficit de treize à quatorze millions.
«Mais, si l'on doit conclure un déficit aussi considérable pour l'année 1810, il est facile d'envisager une amélioration certaine et très-forte dans la recette de l'année suivante.
«Un cinquième des domaines de la Carniole appartient à l'Empereur. L'administration de ces biens a été jusqu'ici très-vicieuse, les régisseurs en consommaient presque tous les revenus. L'opinion du pays à leur égard n'est pas équivoque et les accuse de la plus grande infidélité. Lorsque les domaines seront affermés, les produits tripleront infailliblement. Le désir d'améliorer l'administration m'avait fait former le projet de hâter le moment où ce régime sera établi; mais plusieurs raisons s'opposent à un changement immédiat.
«L'Empereur est dans l'intention de supprimer plusieurs droits féodaux; ainsi les domaines, dont les revenus se composent en partie de ces droits, ont une valeur variable, et personne ne peut souscrire des engagements à la veille de changements dont il ne connaît pas l'importance.--D'un autre côté, l'extrême rareté de l'argent, ou plutôt sa disparition absolue, rendant le moment actuel peu avantageux pour établir des fermages, il faut ajourner à plusieurs mois les changements qu'une bonne administration rend cependant nécessaires.
«L'exploitation des mines n'est certainement pas portée au point où elle peut être, et, après des recherches, des observations et des changements utiles, on peut raisonnablement espérer une augmentation de produits et par conséquent de revenus.
«Les bois sont administrés sans ordre, mais il faut du temps pour établir un système régulier.
«L'an prochain, les plaies de la guerre étant en partie cicatrisées, il sera naturel d'établir des impôts sur le sel, sur d'autres objets de consommation, et l'impôt sur le sel peut produire plusieurs millions.
«Enfin, si on ajoute les résultats de l'économie qu'il est probable que l'on pourra apporter avec le temps dans la perception de plusieurs impôts, on est autorisé à espérer une augmentation de revenus considérable, et je ne pense pas les évaluer alors trop haut en les portant à douze ou quatorze millions.--Dans ce cas, il ne resterait plus qu'un déficit de quatre à cinq millions.
«Il résulte de ce qui précède que la cause de la pauvreté des finances des provinces illyriennes est immédiate et qu'elle nous frappe aujourd'hui; tandis que celle de sa prospérité est nécessairement ajournée après l'exécution des dispositions qui doivent la faire naître, et que le temps est indispensable pour en obtenir l'effet, et le résultat satisfaisant ne pouvant pas, vu l'importance des changements, devoir être attendu avant une année.
«Tels sont, monsieur le duc, les principaux traits du tableau que j'avais à vous soumettre. Je vous le présenterai avec plus de détail, lorsque j'aurai reçu les renseignements que j'ai demandés, jusqu'ici infructueusement à M. l'intendant général, et je ne doute pas qu'ils ne confirment en tout point ces aperçus généraux.
«D'après l'exposé de notre situation, Votre Excellence peut juger de la gêne que nous éprouvons aujourd'hui. Les troupes ne sont pas payées depuis le 1er novembre. Les officiers, comme les soldats, sont dans le plus extrême besoin et souffrent beaucoup. Trois mille francs, que nous avons donnés avec beaucoup d'efforts à chaque bataillon, servent à peine à assurer la subsistance du moment. Sa Majesté jugera sans doute que des secours considérables nous sont nécessaires cette année; mais, comme ses intérêts et sa volonté sont la règle de toutes mes actions, elle aura lieu de reconnaître, j'espère, que je ne néglige aucune occasion de les rendre moins nécessaires chaque jour. Si l'intendant général veut y concourir avec zèle et plus d'activité, j'espère que nous approcherons au moins du terme indiqué par l'Empereur. Mais il faut le temps indispensable à tout changement, et particulièrement dans les circonstances difficiles où nous sommes.
«Je n'ajouterai plus qu'un mot, c'est que, les caisses des régiments frontières ayant été emportées par les colonels au moment de la remise du pays, ce ne sera qu'après la récolte que les régiments toucheront la plus grande partie des revenus qui forment leur dotation; que, jusqu'à cette époque, il faut que la solde mensuelle soit faite aux officiers, sous-officiers, prêtres, employés, etc., etc., par la caisse générale des provinces illyriennes, et qu'il serait extrêmement fâcheux que, dans les premiers mois qu'ils servent Sa Majesté, et au moment où doit se former l'opinion de leur bien-être à venir, ils éprouvassent du retard dans leur payement. Leur sort dans les six premiers mois influera beaucoup sur la conduite de toute leur vie.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU MINISTRE DE LA GUERRE.
«3 mai 1810.
«Monsieur le duc, j'ai eu l'honneur de rendre compte à Votre Excellence des négociations entamées par Surulu-Pacha avec les capitaines rebelles nos voisins; que le capitaine Vakup avait restitué le terrain envahi et s'était engagé à ne jamais troubler la frontière; que le capitaine de Bihacz tergiversait, ainsi que Hassan-Aga de Pekey, les deux principaux rebelles.
«Le 27 avril, il arriva un nouveau firman du Grand Seigneur, et de nouveaux ordres du vizir de Bosnie, qui furent lus à Roustan-Bey, capitaine de Bihacz, qui promit de s'y soumettre et de signer le lendemain les mêmes engagements que le capitaine de Vakup. Le pacha fit des dispositions pour se rendre à Kruppa, où il espérait amener Hassan-Aga au même point. Le lendemain, 28, Roustan-Bey changea d'avis, refusa toute espèce d'arrangement, et partit pour se rendre chez lui. Le pacha, voyant qu'il avait affaire à des gens sans parole et sans foi, et les troupes qui lui avaient été promises n'étant pas arrivées, et n'ayant qu'une simple escorte trop faible pour pouvoir soumettre Roustan-Bey, est parti pour Traunik, en me faisant prévenir qu'il ne pouvait plus rien et qu'il s'en remettait à Dieu.
«Le 29, Roustan-Bey surprit un de nos postes du régiment d'Ottochatz, et brûla le village de Neblue. Les rapports d'hier m'annoncent qu'il marche contre le capitaine de Vakup, pour le forcer à rentrer dans sa ligne; le capitaine de Vakup, qui ne veut pas manquer à ses engagements, et qui est peu en état de lui résister, m'en fait prévenir, afin que je mette à l'abri les terres du régiment de Licca et que je lui donne à lui-même des secours qui vont lui devenir extrêmement nécessaires.
«Telle est la situation actuelle des choses.
«Il y a trois partis à prendre dans cette circonstance: ou rester en position comme j'y suis, ou retenir les troupes françaises et abandonner les Croates à eux-mêmes, ou en imposer aux rebelles par un exemple.
«Premièrement, je ne puis rester dans la situation où je me trouve, car les troupes, accumulées, souffrent, et cette situation exige des frais. D'ailleurs, l'intendant général, ne faisant rien pour accroître nos revenus, quelque chose que nous ayons arrêté ensemble et quelque instantes que soient mes sollicitations pour leur exécution, il devient très-urgent de renvoyer deux régiments en Frioul. Ainsi il faut donc penser à évacuer promptement la Croatie; mais faut-il le faire sans avoir d'autres garanties de la tranquillité publique? Je ne le pense pas.
«Si presque en présence de l'armée française les Turcs viennent brûler les villages, ils le feront avec bien plus de confiance lorsqu'ils n'auront à combattre que les Croates armés en petit nombre, qui ont une étendue de pays de quarante lieues à défendre, et dont la frontière est tellement déchiquetée par les invasions des Turcs, qu'il faudrait le double de monde de ce qu'elle exige ordinairement pour être tenue avec la même sûreté.
«Mais quel serait le résultat infaillible de ce parti? D'un côté, les rebelles ne mettraient plus de bornes à leur insolence et à leurs prétentions; les capitanats de Vakup et d'Ostrerezza seraient dévastés pour avoir été obéissants envers le Grand Seigneur et s'être conduits en bons voisins envers nous, et forcés probablement à se réunir à eux pour renouveler l'invasion du régiment de Licca. Tous les vagabonds et les bandits de la Bosnie, certains de l'impunité, viendraient se réunir à Roustan-Bey pour accroître ses forces, et les autres capitaines des confins, qui, jusqu'ici, ont été fidèles, auraient peut-être bien de la peine à résister aux efforts de leurs populations, qui seraient jalouses des avantages des autres, attendu que cette guerre est une guerre de propriété, et qui a pour but de procurer des champs à cultiver.
«De l'autre côté, les Croates, qui sont si satisfaits, qui attendent toutes sortes de biens du nouvel ordre de choses, qui sont si fiers d'appartenir à l'Empereur, qui ont de si bonnes dispositions à l'aimer et à se dévouer à son service, n'auraient plus aucune espèce de confiance en nous ni dans la sollicitude du gouvernement pour eux, et plus de vingt-cinq mille individus, qui sont sans asile, qui n'ont pas un pouce de terre pour pourvoir à leur subsistance, seraient forcés d'émigrer et de passer en Autriche.
«Je le demande à Votre Excellence, quelle perte! quelle désorganisation du pays! quel effet funeste dans l'opinion! et tout cela pour avoir encore une guerre interminable, et qui nous forcerait à revenir ici dans un mois.
«Si, au contraire, j'en impose aux rebelles immédiatement en déployant mes forces, qui sont toutes rassemblées, tout rentre dans l'ordre, et il est rétabli pour toujours. Le capitaine de Vakup est préservé et nous reste attaché; la population des autres capitanats, qui pourrait avoir envie de remuer, malgré le capitaine, rendra grâce à la sagesse de leurs chefs, qui, jusqu'ici, les ont maintenus en amitié avec nous.
«Je fais rétablir en peu de jours les redoutes et les retranchements qui défendent toute la frontière, et qui permettent aux Croates de la garder avec peu de monde.
«Et quel inconvénient peut avoir ce parti? Cette affaire est étrangère au Grand Seigneur, puisqu'il a donné deux firmans pour rétablir la paix de la frontière et nous rendre le terrain usurpé.
«Cette affaire n'est pas celle du vizir, car il n'a cessé de donner des ordres, des exhortations, et de faire des menaces. Enfin, elle n'est pas celle de la province; car je sais, à n'en pouvoir douter, que toute la Bosnie s'est constamment prononcée contre cette usurpation, et que, en dernier lieu, les cinquante principaux personnages de cette province venus en députation ont mis tout en usage pour nous faire rendre justice.
«C'est donc une affaire qui regarde deux misérables insensés, et quelques brigands qui se croient invincibles, parce qu'il y a un an ils ont massacré des vieillards et des enfants.
«Je pense donc, monsieur le duc, qu'il n'y a pas à balancer, et que je dois rétablir l'ordre par la force; et, quoique cette disposition soit contraire au texte de mes instructions, cette circonstance me paraît être une de celles où, vu l'éloignement, un général investi de la confiance de son souverain ne doit pas craindre d'engager sa responsabilité. En conséquence, je vais me porter avec tous mes moyens réunis devant le régiment d'Ottochatz, faire rétablir les redoutes, corps de garde retranchés, et la ligne des postes, qui doivent mettre à l'abri ce régiment, et, s'il le faut, brûler quelques villages pour obtenir de Roustan-Bey la promesse qu'il ne troublera plus la frontière. Mes forces sont tellement considérables, que non-seulement il ne peut pas y avoir de résistance, mais à peine l'apparence d'un combat.
«Je suis disposé à croire que, lorsqu'il me verra bien décidé à user de rigueur envers lui, il me dispensera de le faire en me donnant toutes les garanties que je pourrai désirer, et qu'il fera évacuer Czettin. S'il n'en avait pas la puissance, après avoir rétabli les postes retranchés sur cette position de la frontière, j'en serais quitte pour bloquer ce fort, qui, après peu de jours, se rendra, faute de subsistance.
«Enfin, il est évident que l'intention de l'Empereur est que je me défende, et que je prévienne de nouveaux envahissements. Or le moyen que je vais prendre est le seul qui puisse conserver au régiment de Licca le pays dans la possession duquel il est rentré, et terminer une petite guerre sur tout le développement de notre frontière, qui, en continuant davantage, prendrait chaque jour plus de consistance.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU MINISTRE DE LA GUERRE.
«Zleim, 9 mai 1810.
«Monsieur le duc, j'ai eu l'honneur de vous rendre compte des motifs qui m'ont déterminé à employer les moyens de rigueur pour forcer les Turcs à restituer le territoire envahi.
«J'ai voulu auparavant tenter encore auprès du capitaine de Bihacz des moyens de conciliation, mais tous mes efforts ont été sans succès. Le 5, il attaqua mes postes. Il y eut de part et d'autre un homme de tué et quelques blessés. Voulant mettre un terme à tant d'extravagance, j'ai marché sur lui le 6.--Comme plusieurs assez grands villages dépendent de lui, il avait réuni environ douze cents hommes d'infanterie, huit cents cavaliers, et huit pièces de canon.
«Nous avons dispersé cette foule en un moment, tué cinquante hommes, et pris ses huit pièces. Je n'ai eu qu'un seul homme tué, et neuf blessés. Le village d'Isachich, qui était un des principaux repaires de ces brigands, a été incendié, ainsi que le village de Glokot, qui appartenait à un des hommes les plus influents du parti du capitaine de Bihacz.
«Cet acte de sévérité a produit l'effet que j'en attendais, et a répandu une grande terreur. Je me suis porté ensuite sur la ville de Bihacz, qui est fortifiée, et, après avoir placé devant cette ville quatre obusiers et quatre mortiers, j'ai écrit, non au capitaine, mais aux capitaines principaux, tous de cette ville, pour leur demander s'ils ne voulaient pas enfin renoncer aux droits qu'ils s'étaient arrogés d'insulter notre territoire, et de piller les Croates. Ils se sont rendus devant moi pour m'exprimer les regrets du passé, et promettre de ne jamais donner aucun sujet de plainte. Ils ont signé cette promesse en renonçant, s'ils y manquaient, à leur place, au payement de leurs émoluments, et ils ont imploré ma clémence. J'envoie cette promesse au pacha, qui est un tuteur fort important. Cette leçon, et la garantie qu'ils m'ont donnée, me paraissent suffisantes pour assurer la tranquillité. Je me suis retiré, et je crois pouvoir assurer Votre Excellence que de longtemps la tranquillité de cette partie de la frontière ne sera troublée par les habitants.
«Les régiments d'Ottochatz et d'Ogulim ont recouvré toutes les terres qu'ils avaient perdues. Des quatre régiments qui avaient été envahis, il ne reste plus que le territoire de Czettin, qui fait partie du régiment de Zleim. Hassan-Aga de Pekey, qui le commande, n'était pas sous les ordres du capitaine de Bihacz. Ce qui le regarde n'est pas encore terminé, mais je suppose qu'il est dans une grande terreur. Je me rendrai chez lui, afin de le forcer également à la restitution.
«Une chose qui m'a prouvé que je ne m'étais pas trompé sur l'esprit de la province, c'est qu'il n'est pas venu au secours du capitaine de Bihacz un seul homme étranger à son territoire. Ainsi le vizir sera content de la punition infligée à ceux qui ont méprisé ses ordres. Les grands de la Bosnie le seront également, parce qu'ils ont vu leurs conseils méprisés, et les capitaines voisins se loueront beaucoup de n'avoir pas trempé dans tous ces brigandages. Enfin, je ne puis exprimer le bonheur des Croates.
«Je saisis cette circonstance pour répéter à Votre Excellence combien je suis satisfait de l'esprit qui règne parmi les Croates. Je puis vous assurer que personne n'y pense plus à l'Autriche, et que les Croates éprouvent un juste sentiment d'orgueil d'appartenir à Sa Majesté.
«Je ne doute pas qu'avec quelques mois de soins je ne parvienne à en faire des troupes meilleures que toutes celles qui ne sont pas françaises. Plus je les vois, plus je m'en convaincs, et plus je suis persuadé que cette armée croate est ce que les provinces illyriennes renferment de plus précieux.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU MINISTRE DE LA GUERRE.
«Carlstadt, 12 mai 1810.
«Monsieur le duc, j'ai l'honneur de rendre compte à Votre Excellence du succès des moyens de rigueur employés envers les habitants du capitanat de Bihacz, et du rétablissement de la tranquillité sur les frontières des régiments d'Ottochatz et d'Ogulim. Il restait à la rétablir de même sur la frontière du régiment de Zleim et à reprendre le fort de Czettin, qu'Hassan-Aga de Pekey et ses gens avaient annoncé vouloir défendre jusqu'à la dernière extrémité.
«J'ai marché sur Czettin le 9, après m'avoir fait précéder de lettres convenables dans les différents territoires qui avaient fait alliance entre eux, et qui se composaient d'Ostrokaz, Sturlitz, Radruch, etc. J'ai bivaqué le 9 à une lieue de Czettin, et le 10 au matin, à l'instant où je me suis présenté devant cette place, je l'ai trouvée évacuée. L'utile exemple d'Isachich et de Glokot a répandu une telle terreur parmi les Turcs, qu'ils ont subitement abandonné la place, la laissant pourvue de son artillerie et de vivres pour un long siége. C'est le même fort qui, il y a vingt et un ans, défendu par sept cents hommes, a arrêté l'armée autrichienne de vingt-cinq mille hommes, commandée par le général Devintz, pendant trente-sept jours. La tranquillité est ainsi complétement assurée, et le régiment de Zleim a recouvré leur territoire. Je puis affirmer à Votre Excellence que ces Turcs, qui, sur cette frontière, ont le surnom de méchants, et qui, grâce à l'extrême faiblesse du gouvernement autrichien, étaient en possession de se livrer à tous les excès, ne seront de longtemps tentés de les renouveler.
«En conséquence, je mets en route dès aujourd'hui les 5e et 81e régiments pour Udine, afin de soulager la caisse des provinces illyriennes. Je me rends moi-même à Laybach pour voir, avec M. d'Auchy, à prendre les mesures nécessaires pour faire face aux besoins du service. Pendant l'été, et lorsque j'aurai atteint ce but, je reviendrai en Croatie pour visiter sur les lieux chaque consigne des régiments croates, et pouvoir, avec connaissance de cause, ordonner tout ce que le bien du service de Sa Majesté et l'intérêt des régiments croates commandera.
«Les événements qui viennent de se passer ont donné occasion à huit cents individus grecs de se rendre sur notre territoire avec leurs bestiaux, demandant des terres et leur incorporation dans les régiments. J'ai pris des dispositions pour assurer leur établissement.
«J'ai aussi donné l'ordre que tous les habitants qui avaient été expropriés par l'invasion des Turcs, dont les maisons ont été incendiées, et qui étaient épars sur les territoires, fussent réunis en divers camps de quatre à cinq cents âmes, où l'on réunira les matériaux nécessaires pour construire des villages qui offriront, lorsque les bataillons de campagne seront absents du pays, les moyens à la population de se défendre contre les Turcs.
«Cette opération pourra être faite l'an prochain, et, pour qu'elle ne soit en rien à charge aux habitants, on fera dans le courant de l'année, pour être exécuté l'an prochain, le projet des échanges nécessaires des parties de terres pour que les habitants de chaque village soient au centre de leurs propriétés.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU DUC DE FELTRE.
«Laybach, 15 mai 1810.
«Monsieur le duc, je viens de recevoir la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 5 mai, et qui renferme une copie d'une lettre de Son Excellence le ministre des relations extérieures, relative aux réclamations de l'ambassadeur d'Autriche sur une notification faite au commandant du cordon autrichien, portant qu'on allait raser les maisons des sujets de la Croatie autrichienne, sur la rive droite de la Save, et qu'on ne souffrirait pas que, sous quelque motif que ce fût, ils vinssent avec leurs bestiaux sur le territoire illyrien.
«Je vais avoir l'honneur de rendre compte à Votre Excellence de cet objet.
«D'abord il n'a été fait aucune notification qui annonce qu'on va faire raser les maisons des sujets autrichiens sur la rive droite de la Save. Il est possible que quelque officier croate illyrien, dont plusieurs portent déjà plus de haine aux Autrichiens que nous ne l'avons jamais fait, se soient permis, dans quelque discussion, des menaces; mais, si elles ont été faites, ce sont des bruits populaires, qui n'auraient pas dû prendre crédit auprès des autorités autrichiennes, ou tout au moins sur lesquels on n'aurait dû réclamer qu'en désignant les coupables pour les faire punir. Si nous voulions écouter les bruits d'agression et les menaces faites à nos Croates, nous aurions bien d'autres plaintes à former.
«Il y a deux circonstances qui peuvent cependant avoir causé les réclamations de l'ambassadeur d'Autriche; mais je pense que ces deux circonstances ont été mal présentées, et que nous n'avons rien fait que nous ne dussions faire. Les voici:
«Le 2e régiment banat, qui appartient à..., avait sa douzième compagnie sur la rive gauche de la Save, et, par conséquent, cette compagnie se trouve séparée de son régiment, et appartient aujourd'hui à l'empereur d'Autriche. Cette compagnie a eu la prétention de couper, pour sa consommation, du bois dans les forêts du 2e régiment banat, comme ayant fait partie de ce régiment, chose qui est évidemment inadmissible, puisque les dotations des régiments ne sont qu'un revenu public, et les domaines qui en font partie des propriétés particulières dont la possession a été cédée avec la souveraineté à l'Empereur.
«La compagnie de la rive gauche est venue en armes pour couper du bois; il a fallu réunir des troupes et employer la menace de la force pour la contraindre à se retirer. Je ne pense pas que la légitimité de ce qui a été fait de notre côté puisse être révoquée en doute. Voici l'autre événement:
«Lors de la prise de possession des régiments, plusieurs officiers autrichiens, des généraux, et, entre autres, le général Knedevich, employèrent toutes sortes de moyens pour alarmer les Croates militaires sur leur sort futur, les séduire et les décider à quitter le pays. Un certain nombre de Croates du 2e régiment banat, le plus voisin de l'Autriche, fut entraîné par cette suggestion et passa la Save. Depuis ils ont réclamé la jouissance et la disposition de leur propriété aux termes du traité de paix; mais je ne pense pas qu'ils soient compris dans les dispositions qu'il renferme. En effet, le traité de paix a eu pour objet de conserver aux citoyens leurs droits, mais non de leur en donner de nouveaux. Le traité de paix n'a pas pu rendre propriétaires des gens qui ne l'étaient pas, au moins d'une manière absolue.
«1° D'après les lois en vigueur dans la Croatie militaire, aucun individu croate ne possède; les familles seules collectivement sont propriétaires. Ainsi les individus isolés ne peuvent, dans aucun cas, rien réclamer: tout est en commun, administré par le chef de famille, les revenus annuels répartis également. Un individu échappé de la famille ne peut donc réclamer de propriété.
«2° Un chef de famille ne peut vendre une partie de sa propriété qu'avec la permission de son colonel, et lorsque cette partie est surabondante à ses moyens de subsistance; mais, dans aucun cas, il ne peut vendre ni posséder terre qui est jugée nécessaire à l'entretien de la famille.
«3° Enfin, lorsqu'une famille s'éteint, le bien retourne à l'Empereur, les familles croates ne possédant qu'au titre de service militaire qu'elles prêtent au souverain.
«Il me paraît donc bien évident que les habitants de la Croatie militaire ne sont pas dans les catégories des autres citoyens, et qu'ils sont possesseurs de fiefs avec quelque modification, et que l'article du traité de paix, ne pouvant pas changer leur qualité, ne leur donne pas le droit d'emporter ce qu'ils possèdent; si le principe contraire était constaté, il n'y aurait pas de raison pour qu'il restât une seule famille dans les régiments, attendu que, l'empereur d'Autriche ayant beaucoup de terres à disposer dans les régiments frontières qui lui restent, les habitants qui voudraient aller s'y établir auraient le double avantage d'une existence semblable à celle qu'ils quitteraient, et d'emporter les capitaux qui seraient le produit de la vente de leurs biens qu'ils auraient laissés; en conséquence, j'ai refusé de permettre à des émigrés des régiments banats de jouir des terres qu'ils ont abandonnées. J'ai considéré celles-ci comme acquises au gouvernement et destinées à former de nouveaux établissements. Cet objet me paraît d'une si haute importance, et ce que j'ai ordonné me paraît si conforme aux règles de la justice et aux droits positifs de l'Empereur, qu'avant de changer les dispositions que j'ai prises je prie Votre Excellence de mettre mes observations sous les yeux de Sa Majesté et de me faire connaître sa volonté.
«Quant à la Croatie civile, il n'y a eu aucune espèce de mesure prise pour contrarier les habitants, qui sont sur la rive gauche, dans la jouissance de leurs biens. Ils disposent des cultures à leur gré et emportent les productions sans que l'autorité y mette aucun obstacle.
«La réclamation ci-dessus me semble être le résultat du mauvais esprit qui a longtemps animé les autorités autrichiennes de la rive gauche. Il y a eu de fréquentes discussions et de mauvais procédés de leur part. Les Autrichiens ont arrêté nos barques, et les mesures prises ont forcé les autorités de la rive droite à user de représailles. À mon arrivée à Carlstadt, il y a un mois, j'envoyai un officier au général Hiller pour lui représenter combien un tel état de choses était affligeant et combien il était désirable qu'il cessât; que, de mon côté, j'aimais mieux être accusé de pousser trop loin l'esprit de modération que de contribuer à présenter un contraste aussi frappant avec l'intime harmonie qui existait entre nos souverains, et que j'avais donné l'ordre de relâcher les bâtiments arrêtés, et prescrit aux autorités françaises de ne laisser échapper aucune occasion de prouver aux autorités autrichiennes l'intention de vivre en bons voisins.
«Ce procédé semble avoir été apprécié par le général Hiller; car la paix la plus parfaite règne maintenant sur la frontière. Cet état de choses est depuis longtemps connu à Vienne. Votre Excellence en aura l'assurance par l'extrait ci-joint de la lettre que j'ai reçue de M. Otto.
«J'ose donc espérer que la conduite que j'ai tenue dans ces différentes circonstances recevra l'approbation de Sa Majesté.
LE MARÉCHAL MARMONT AU MINISTRE
DU TRÉSOR PUBLIC.
«Laybach, 17 mai 1810.
«Monsieur le comte, Votre Excellence a déjà été entretenue plusieurs fois par M. l'intendant général de la réclamation de l'armée d'Illyrie sur le taux auquel elle a reçu les bancozettel et à compte de ce qui lui était dû par la grande armée sur les mois de novembre et de décembre 1809. M. l'intendant général m'a fait part que vous lui aviez répondu que l'Empereur ne voulait pas que les bancozettel fussent donnés au taux des arrêtés qu'il avait pris pour l'expulsion des papiers; mais le taux du franc pour un florin ici est chose tellement injuste, que je crois de mon devoir d'en entretenir de nouveau Votre Excellence.
«En effet, nous sommes dans une catégorie différente de la grande armée, attendu que le papier a été beaucoup plus bas ici et beaucoup plus longtemps qu'en Allemagne; il a été déprécié ici par la publication d'un ordre légal, qui a sur-le-champ fixé dans le commerce et chez les marchands le taux auquel on devait le recevoir, et comment un officier ou un soldat aurait-il pu forcer un habitant à prendre pour un franc le même florin que l'autorité publique ne voulait recevoir, par ordre patent, dans les coffres de l'État que pour onze, dix et même neuf sous.
«En Allemagne, une semblable dépréciation n'a pas eu lieu, et la fixation du franc pour un florin était une raison de crédit. Enfin, lorsque les troupes françaises en Allemagne éprouvaient une perte sur le papier beaucoup moindre que la nôtre, elles étaient nourries chez l'habitant et jouissaient de toutes les faveurs qui résultent du séjour en pays conquis. Ici, la paix étant faite, elles ne recevaient aucun secours du pays et étaient traitées comme elles l'auraient été en France.
«L'extrême misère dans laquelle s'est trouvée l'armée a forcé les corps et quelques individus à toucher du papier par à bon compte et en valeur nominale et sans taux déterminé.
«Si la décision de Sa Majesté reçoit son extension dans toute sa rigueur, plusieurs corps sont ruinés pour longtemps, d'autres sont endettés, et cela parce que l'administration a fait une chose illégale en autorisant des payements dans une forme qui ne devait pas être consacrée, et qui, s'ils n'avaient pas en lieu, devraient être faits aujourd'hui en argent.
«Je vous demande, monsieur le comte, d'être encore auprès de Sa Majesté notre avocat, notre défenseur, et d'obtenir une fixation, sinon conforme aux arrêtés de M. d'Auchy, au moins une qui soit à une moins grande distance de la vérité. Enfin, si la chose était impossible, d'autoriser que les à bon compte reçus soient reversés dans le Trésor public. Par ce moyen, le Trésor des provinces illyriennes, qui recevrait cependant ce papier à un taux très-supérieur à la valeur réelle qu'il avait lorsqu'il l'a donné, partagerait ainsi avec les officiers et les corps la perte qui, aujourd'hui, n'est supportée que par ces derniers.»
LE MINISTRE DE LA GUERRE AU MARÉCHAL MARMONT
«Paris, 18 mai 1810.
«Monsieur le maréchal, par ma lettre du 10 du courant, je vous ai fait connaître que j'avais fait passer à l'Empereur une copie de celle que Votre Excellence m'avait écrite le 3.
«Cette lettre portait que Surulu-Pacha, ayant renoncé à obtenir, par des voies amiables, l'entière restitution des terrains usurpés sur les Croates par des sujets de la Porte, et qu'un des capitaines turcs de la frontière ayant brûlé le village croate de Nebluee, Votre Excellence croyait devoir prendre le parti de se porter avec tous ses moyens devant la ligne du régiment d'Ottochatz, afin de la couvrir et d'être en mesure d'incendier quelques villages, s'il le fallait, pour amener Rustan-Bey, capitaine de Bihacz, à ne plus inquiéter cette frontière.
«Sa Majesté voit avec peine, monsieur le maréchal, que des troupes françaises soient engagées contre les Turcs, et elle veut que l'on n'emploie contre eux que les Croates; ceux-ci doivent suffire. Les hostilités partielles qui ont eu lieu de peuple à peuple n'étant d'ailleurs qu'une chose ordinaire, il ne faut point que votre corps d'armée y intervienne et que le sang français coule mal à propos. Votre Excellence peut mettre parmi les Croates quelques officiers français et de l'artillerie; mais elle doit s'en tenir là et ne point y mêler de son infanterie.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU MINISTRE DE LA GUERRE.
«Laybach, 20 juin 1810
«J'ai trouvé à mon arrivée ici des jeux établis par autorité supérieure, et par ordre écrit, à Trieste, à Laybach, à Gorizia et Fiume. Peu après, je reconnus le mauvais effet de ces jeux, et je les défendis à Laybach, à Gorizia et à Fiume, et cette défense a été suivie ponctuellement. J'avais pensé qu'ils pouvaient rester sans inconvénient à Trieste, comme dans les grandes villes maritimes de France et d'Italie, qui rassemblent toujours un grand nombre d'aventuriers; mais, dès que l'intention de Sa Majesté est qu'ils cessent, l'ordre de le faire va être donné immédiatement.
«Un régiment français a commis quelques désordres en Croatie, dit-on. Celui qui a fait le rapport a pris cette nouvelle sans doute dans l'ordre du jour de l'armée qui l'a publiée; mais il aurait dû en même temps rendre compte de la punition, car le même acte la consacre. Votre Excellence trouvera ci-joint cet ordre du jour, en date du 15 mai, qui ordonne l'évaluation dès pertes et leur payement au compte du 23e régiment. Au surplus, ces pertes, d'après les états présentés par les chefs de famille, et sur lesquels assurément rien n'est oublié, montent à cinq cent quatre-vingt-six florins, et, comme la discipline des troupes que je commande est un de mes premiers soins, et qu'elles ont à juste titre laissé partout une belle réputation à cet égard, il est probable que ce dernier désordre n'aurait pas eu lieu si ce régiment n'eût pas été sans solde depuis le commencement de l'année et s'il ne lui eût pas été dû alors plus de cent quatre-vingt mille francs pour 1810, malgré mes plaintes continuelles à M. d'Auchy, qui pendant cinq mois n'a pas envoyé un sol aux troupes en Dalmatie, tandis qu'il gorgeait d'argent ceux des fournisseurs qui lui faisaient la cour et par de grands titres flattaient sa vanité.
«Votre lettre, monsieur le duc, annonce des plaintes pour d'autres exactions. Je désirerais les connaître, afin de pouvoir y répondre.
«Tel est l'exposé sincère des faits. Sa Majesté pourra juger si ceux qui portent ces accusations près d'elle ont plus en vue le bien de son service que de me faire perdre ses bonnes grâces; elle pourra juger avec quelle perfidie on a exagéré des torts qui étaient déjà réprimés, et combien sont mensongères les conséquences qu'on en tire, puisque la malveillance n'a pu découvrir aucun fait impuni. Elle pourra juger enfin si j'ai fait ce que j'ai pu pour son service lorsqu'elle saura que le peu de bien qui a été fait ici m'appartient ou par moi-même ou par mes poursuites incessantes auprès de l'intendant général pour l'obtenir lorsque son concours était nécessaire pour atteindre ce but; que c'est moi qui ai rédigé plus des trois quarts des arrêtés qui consacrent ces dispositions; que les routes, qui étaient infestées de plusieurs centaines de brigands, commencent à être sûres, quoique je n'aie pas de gendarmerie, et qu'elles le seront, dans peu, plus qu'à aucune époque elles ne l'ont été; que j ai fait former partout de bons hôpitaux, de bons établissements pour les troupes, où elles sont aussi bien que dans les meilleures villes de France; que les dispositions que j'ai prises pour l'assiette des logements dans toute l'Illyrie, en soulageant les habitants, leur assurent le payement de ce qui leur est dû; lorsqu'elle se rappellera que j'ai fait rentrer vingt-cinq mille habitants dans la jouissance des biens dont ils avaient été expulsés, et assurer pour toujours le repos de la frontière; que je suis parvenu, par mes soins, à animer du meilleur esprit les Croates militaires, malgré les intrigues des Autrichiens; que j'ai fait garnir toute la côte d'Istrie de batteries, organisé sur cette côte deux mille hommes de gardes nationales habillés, qui rivalisent de zèle et d'instruction avec les troupes de ligne, et les rendront bientôt superflues dans cette partie; que pareil établissement est commencé en Dalmatie, à Raguse et à Cattaro, et sera couronné des mêmes succès aussitôt que j'aurai des armes à leur donner, etc.
«Quoique je ne me dissimule pas combien il reste à faire, je pourrais cependant encore ajouter le détail de beaucoup de choses utiles faites ou commencées; mais je craindrais de fatiguer Votre Excellence. Cet exposé fera d'ailleurs partie du rapport général que je vous dois.
«Je me bornerai donc à vous assurer que je n'ai négligé aucuns moyens pour faire aimer le gouvernement de l'Empereur, ce que je regarde comme mon premier devoir; que jamais habitant n'a demandé une chose juste, et qui fût en mon pouvoir, qu'il n'ait été satisfait sur-le-champ; et, si je n'ai pas obtenu encore d'aussi grands résultats que je l'aurais désiré, c'est que les circonstances sont difficiles, que le bien vient lentement, et que je n'ai trouvé en M. d'Auchy qu'obstacle et difficulté, lorsque j'avais lieu de m'en promettre aide et secours; mais certes il n'y a que les passions les plus aveugles et les plus haineuses qui puissent présenter le tableau qui a été mis sous les yeux de Sa Majesté.
«L'Empereur aura des serviteurs plus capables que moi; il n'en aura jamais qui soient plus fidèles, plus zélés, et qui aient des intentions plus pures; car je n'ai de passions que celle de mes devoirs envers lui et du bien public. Mais, j'ose le dire ici, l'aliment dont ce zèle a besoin, et dont il ne saurait se passer, c'est l'estime de Sa Majesté, l'idée qu'elle apprécie mes efforts, et que les insinuations calomnieuses que l'envie et la haine ont déjà si souvent dirigées contre moi sont sans effet près d'elle.»
1810
SOMMAIRE.--Rétablissement du commerce de Trieste avec le Levant.--Bailliages du Tyrol.--Députation des provinces illyriennes au couronnement.--Emploi du temps.--Noblesse de la Carniole.--Le prince d'Auersberg.--Chasse à l'ours.--La Louisen-Strasse.--Le prince Dietrichstein.--Les tribunaux.--Relations avec l'Autriche.--Projet de fortification pour les provinces illyriennes.--Mines d'Idria.--Lac de Zirknitz.--Le duc de Raguse demande et obtient un congé.--Aurelio d'Amitia.--La reine de Naples.--Prétentions à une découverte scientifique.--Départ pour Paris.--Accouchement de l'impératrice.--Affaires d'Espagne.--Masséna.--Le général Foy.--Le duc de Raguse est nommé commandant de l'armée de Portugal.
J'avais pensé de bonne heure à établir une branche importante de commerce entre Trieste et la Turquie, par la Croatie. Le blocus continental privait la France de coton, et les nouvelles manufactures pour la fabrication des étoffes de cette espèce souffraient beaucoup par la disette et le prix des matières premières. Les transports étant au plus bas prix en Turquie, on pouvait peut-être rivaliser avec les transports par mer. En effet, des transports effectués à travers des pays fertiles, mais incultes, qui fournissent sans frais la nourriture des bestiaux qui les traversent; le peu de valeur des chevaux de bât employés; la sobriété des sujets turcs et le bas prix de leur entretien, me firent supposer qu'avec des soins mon plan était exécutable. Il fallait d'abord commencer par assurer une protection spéciale aux caravanes. Les Turcs, dont c'était l'intérêt, s'en occupèrent et y parvinrent. De mon côté, je m'occupai de leur donner toute espèce de facilités et de sûreté en Illyrie. D'abord un grand lazaret avec d'immenses magasins; puis des transports de voitures à bon marché pour aller de Costanitza à Trieste, car on ne pouvait recevoir et laisser conduire cette multitude de chevaux de bât, qui n'auraient pas trouvé dans la route des terrains abandonnés où ils pussent paître, et encore moins payer leur consommation. Je fis faire tous les calculs, rédiger un mémoire circonstancié, et j'envoyai ces propositions à l'Empereur, qui les adopta avec empressement. Il restait à empêcher les cotons envoyés de Constantinople à Vienne par la mer Noire et le Danube, d'entrer en France par Strasbourg. Cette nécessité fut comprise: un droit de deux cents francs par quintal, mis à la douane de Strasbourg, remplit cet objet, et dès lors l'Illyrie fut la route naturelle des cotons qui venaient de Smyrne et étaient destinés pour la France.
Ces transports très-longs exigeaient de grands capitaux, et, pour faciliter le crédit des négociants français, une ville d'entrepôt était nécessaire. Trieste se trouvait être naturellement cette place; elle fut déclarée telle, et reçut tous les priviléges qui en découlent. Je communiquai ces projets aux négociants de Trieste, dont l'existence se trouvait ainsi ranimée. Tout avait été si bien prévu pour l'exécution, et de si bonne heure, que, dès le mois de septembre 1810, les premières balles de coton arrivèrent à Trieste. Dans le cours de l'année 1811, soixante mille balles y furent emmagasinées; le nombre s'augmenta et arriva depuis jusqu'à deux cent mille par an. Ce transport et ce commerce ont été d'un puissant secours pour l'industrie française pendant ce temps de souffrances et de misère; ils ont été le salut et la fortune de Trieste et de tous les pays qu'ils traversaient; ils ont enfin diminué puissamment pour eux les calamités qu'entraînait après lui le système continental.
Pendant la tournée dont je viens de rendre compte, je donnai l'ordre de prendre possession de deux bailliages du Tyrol, cédés par la Bavière aux provinces illyriennes, ceux de Liante et de Lillion. Cette réunion complétait ces provinces comme frontière militaire de cette partie de l'empire.
À mon passage à Villach, une maison d'éducation de femmes, connue sous le nom de Congrégation des vierges, établissement reconnu utile et jouissant des faveurs de l'opinion publique, était dans une grande détresse: je m'en fis rendre compte; je pourvus à ses besoins et j'assurai sa conservation. Je rentrai enfin à Laybach, après une absence de plus de deux mois.
J'ai oublié de rendre compte de l'envoi d'une députation des provinces illyriennes pour complimenter l'Empereur, hommage d'usage en pareille circonstance, mais qui avait alors un but particulier d'utilité, vu le grand éloignement de la France de ce pays, et la différence de ses moeurs. Un reflet de l'éclat du trône impérial et de Paris devait frapper les nouveaux sujets qui n'avaient qu'une idée confuse de notre grandeur. En conséquence, je multipliai beaucoup les députés. Chaque province eut son représentant, et chaque régiment croate fut considéré comme une province.
Le colonel Slivarich, seul des colonels sortant du service d'Autriche, et auquel j'avais confié le commandement du 1er régiment, fut chargé de présider lui-même la députation militaire des six régiments.
Je choisis pour chef de la députation M. Calafatti, dalmate fort considéré, homme d'esprit, auquel j'avais confié l'intendance de Trieste et de l'Istrie. Son mérite particulier et la situation de sa famille m'avaient fait déroger en sa faveur au principe, suivi toujours en cas pareil, de choisir les députés ailleurs que dans les employés du gouvernement.
Ceux qui composaient cette députation étaient au comble de la joie et du bonheur. Calafatti surtout l'exprimait avec un enthousiasme difficile à peindre; il emmenait sa femme et sa fille, c'était le grand événement de sa vie et un triomphe auquel s'associait sa famille entière. L'infortuné! et que sommes-nous en présence de l'avenir! Combien nos voeux sont souvent indiscrets! Ce léger triomphe devait être la cause de la perte des siens et du malheur de sa vie.
Il se trouva à la fête si tristement célèbre du prince de Schwarzenberg, ambassadeur d'Autriche, donnée à l'occasion du mariage de Marie-Louise; et sa femme et sa fille y périrent; lui-même, blessé grièvement, eut les pieds entièrement brûlés; et, après avoir passé plusieurs mois en danger de mort, il est resté estropié le reste de ses jours.
Dans le nombre des députés, se trouvait un nommé Zanovich, que nous avions tiré des cachots de Venise, et trouvé sous les plombs à notre entrée dans cette ville. Lui et toute sa famille ont eu la plus singulière destinée; exemple marquant de l'influence de l'organisation sur les facultés: j'ai raconté ailleurs les circonstances extraordinaires qui la concernent.
Pendant tout ce voyage, je n'avais pas perdu un moment de vue toutes les affaires d'administration. Chaque jour, une estafette m'apportait le travail courant sur lequel je prononçais. De retour à Laybach, je rentrai dans ma vie habituelle, à la fois vie d'affaires et de plaisirs, car je menais de front les uns et les autres avec une grande facilité.
Ma manière d'exister était très-régulière, et j'employais bien mon temps; je ne me laissais pas absorber par des détails minutieux. On ne peut mener une grande besogne qu'en faisant travailler les autres, en employant des hommes capables, et en gardant pour soi le soin de donner la direction, de fixer les principes, et de juger l'ouvrage. En se bornant à ce rôle, le seul qui convienne à un grand pouvoir, on a le temps de réfléchir et de penser, la tête est toujours fraîche, c'est-à-dire en possession de toutes ses facultés. Tout aboutissait à moi; indépendamment des travaux extraordinaires tenant à l'organisation, j'avais à régler journellement ce qui tenait aux finances, à l'intérieur, aux douanes, à la justice, à la marine, qu'une commission dirigeait; à la guerre pour les troupes croates, à la guerre pour ce qui concernait l'armée française, etc. Eh bien, jamais je n'ai remis au lendemain à terminer ce que je devais faire le jour même; et chaque jour, avant trois heures, mon travail étant fini, toutes mes décisions prises, toutes mes signatures données, depuis ce moment jusqu'au soir je m'occupais de promenades, de chasses, de fêtes et de plaisirs de toute espèce.
La province de Carniole est habitée par beaucoup de noblesse très-ancienne et très-fière. Je m'occupai à lui plaire; et, comme je la traitais avec distinction et qu'elle n'avait rien de plus à prétendre, elle fut bientôt à moi et satisfaite de son sort. Bref, aucun pays réuni à la France n'a montré plus promptement et plus constamment de bons sentiments pour nous, malgré l'affection héréditaire et si marquée que ses habitants portent, avec tant de raison, à la maison d'Autriche; et, je crois pouvoir le dire sans orgueil et avec vérité, la cause en est dans la justice, les égards et la fermeté avec lesquels ces peuples ont été traités.
Plusieurs seigneurs autrichiens, entre autres le prince d'Auersberg, vinrent pour me recevoir dans leurs belles possessions, et celui-ci dans le duché de Gottsche. Nous y chassâmes l'ours: cet animal y est commun; nous en trouvâmes plusieurs, aucun ne fut tué. Je dirai, à la honte de plusieurs compagnons de chasse, entre autres d'un intendant français, que des ours passèrent près d'eux et qu'ils n'osèrent pas les tirer. Cette chasse a, en France, la réputation d'être dangereuse; là, elle n'inspire aucune crainte. Quand il a le moyen de fuir, l'ours ne cherche pas à attaquer le chasseur. Les sangliers sont très-rares dans ce pays, et leur chasse passe pour périlleuse; et en France, où elle est commune, personne n'a jamais eu l'idée d'y attacher aucun mérite: on redoute, dans chaque pays, ce que l'on ne connaît pas, et les craintes disparaissent quand on observe de plus près les objets qui les inspirent. Il en est de cela comme de beaucoup d'autres choses dans le monde:
Toujours bâtons flottants,
De loin c'est quelque chose, et de près ce n'est rien.
Le prince Dietrichstein, un des plus grands seigneurs de l'Autriche, vint aussi à Laybach au nom de la compagnie de la route Louise (Louisen-Strasse), dont il était un des plus forts actionnaires. Cette route traverse la Croatie et va de Carlstadt à Fiume. D'une haute importance pour la Hongrie, elle sert à exporter ses produits. Ouvrage magnifique, elle a été un objet de patriotisme de la part de ses principaux actionnaires. Un décret impérial avait fait à cette société la concession d'un péage: il fallait faire reconnaître ce droit par le nouveau gouvernement, et le lui conserver; c'est ce que le prince Dietrichstein venait solliciter. Indépendamment de la justice de sa réclamation, il y avait un autre motif pour l'accueillir: les travaux n'étaient pas tout à fait achevés, et il y avait encore quelques capitaux à y dépenser. Je me fis rendre compte, avec un grand détail, de tout ce qui avait rapport à cette affaire, et, au bout de six semaines, elle fut éclaircie et entendue. Je confirmai la concession par un arrêté, et il y fut ajouté quelques dispositions qui parurent équitables. Tout fut fait en moins de deux mois. Si on veut comparer la marche des affaires chez nous avec celle qu'on suit à Vienne, nous en avons ici les moyens. On peut s'étonner qu'un pays puisse subsister avec la lenteur qui règle un grand nombre des actes de son administration. On se garantit sans doute ainsi des surprises et des erreurs, on s'épargne l'obligation de revenir sur des décisions prises; mais d'autres inconvénients plus grands et impossibles à développer ici en sont les conséquences nécessaires.
En 1814, ce pays est revenu à l'Autriche. Les changements apportés à la concession primitive, relative à la route Louise, durent être l'objet d'un nouvel examen de la part de l'administration autrichienne. Eh bien, en 1819, je fus à Vienne, et je trouvai le prince Dietrichstein sollicitant cette affaire, dont on s'occupait depuis cinq ans, et qui, grâce aux renvois éternels d'une direction à l'autre, n'était pas encore terminée.
Nous étions en discussions continuelles sur la frontière de la Save avec les autorités autrichiennes. Elles contrariaient fréquemment la navigation sous divers prétextes. Après mille réclamations et mille pourparlers, je ne trouvai d'autre moyen que la voie des représailles. Elle me réussit comme elle réussira toujours toutes les fois qu'on ne les exagère pas. Il y eut aussi des intérêts froissés par des possesseurs riverains opposés pour des pâturages; mais tout se termina enfin à l'amiable. J'envoyai mon chef d'état-major pour quelque temps à Agram auprès du général Hiller. Nous nous entendîmes avec lui, comme aussi avec l'évêque d'Agram, pour qu'il donnât à l'évêque de Laybach le pouvoir d'administrer la partie de son diocèse placée sur la rive droite de la Save.
J'organisai une compagnie de réserve à Laybach, composée d'anciens officiers et d'anciens soldats autrichiens licenciés. Je proposai à l'Empereur de lever un régiment de trois bataillons, afin d'employer beaucoup d'officiers nés dans les provinces. Ils avaient quitté le service autrichien et en demandaient en France. Cette proposition ayant été accueillie, ce régiment, connu sous le nom de régiment d'Illyrie, fut très-promptement organisé et envoyé en Italie. Je reçus l'autorisation d'y placer un tiers d'officiers français, ce qui, avec les placements déjà exécutés dans les régiments croates, donna un grand avancement et un grand mouvement à mon corps d'armée.
Deux choses produisaient un véritable état de souffrance dans ce pays: le manque d'argent, et le retard apporté dans l'organisation des tribunaux. Mais, malgré mes représentations, rien ne revenait de Paris. Je fus obligé de former provisoirement un tribunal à Carlstadt, composé de civils et de militaires, pour assurer le cours de la justice en Croatie. Quant à l'argent, comme les nouveaux impôts n'étaient productifs qu'en partie, et qu'on ne retirait pas les troupes, je fis sur les principales villes un emprunt de un million cinq cent mille francs, à la garantie desquels j'affectai des rentes foncières dont la province de Carniole était propriétaire. L'Empereur blâma cette mesure. Je lui demandai quel pouvoir il me supposait, quels moyens il m'attribuait, pour faire face à des besoins aussi positifs avec des moyens aussi faibles, et dont l'insuffisance lui avait été démontrée. Je lui prouvai, non pas sans humeur, que, si je n'eusse pas pris cette mesure, tout serait tombé en dissolution. J'eus gain de cause. La plus grande partie des troupes françaises eut l'ordre de passer en Italie; je les remplaçai, pour la garde des places de Raguse, Zara, Carlstadt, etc., par quatre bataillons croates mis en activité, et qui se relevaient à des époques fixes.
Je disposai tout pour organiser avec le temps en Dalmatie deux régiments à l'instar des Croates. C'était la seule manière de civiliser cette province et d'en tirer parti. Tout le littoral était destiné à recruter la légion dalmate, et la marine devait rester sous une administration civile. L'intérieur, ce qu'on nomme la Morlachie, formerait le territoire des deux régiments; la garde nationale et la gendarmerie seraient chargées de la police du littoral, et, en attendant la formation des régiments, les Pandours, réorganisés, devaient être la force territoriale de ces cantons et former leur noyau. Les Pandours furent formés en dix compagnies; chaque compagnie avait son territoire, cinq officiers, et cent à deux cents hommes de la population lui étaient adjoints. Les dédoublements successifs auraient fourni les cadres nécessaires. En attendant, près de deux mille hommes étaient déjà ensemble et dans l'esprit de l'organisation que je méditais. Le temps n'a pas permis d'y apporter plus de développement.
L'empereur d'Autriche m'en a parlé plusieurs fois, et je l'ai fort engagé à former des régiments dans son intérêt, comme dans celui de la province; mais la considération que les Dalmates étaient actuellement propriétaires, et avaient reçu les terres qu'ils possédaient sans condition, l'avait retenu jusqu'alors, à ce qu'il m'a dit. Celles des Croates leur avaient été, au contraire, données à titre spécial de services militaires. On voit quel poids a dans son esprit le droit de chacun de ses sujets, et quelle équité préside à ses décisions.
Le lycée de Laybach était entre les mains d'hommes distingués et capables. Je ne négligeai aucun soin pour ajouter à renseignement qu'on y recevait. Je lui donnai un jardin botanique pour servir à l'instruction des élèves.
Un évêché grec fut établi en Dalmatie. Les Dalmates de ce rite dépendaient de l'évêque de Monténégro, et je crus utile et politique de les soustraire ainsi à son influence. Le siége en fut placé dans un couvent situé au milieu de la Kerka, près de Sebenico. Un journal du gouvernement, traduit en quatre langues, fut publié, et j'établis une censure pour les livres. Cette mesure, commandée par les besoins de la société, était plus particulièrement en harmonie avec le mode du gouvernement d'alors et les moeurs de cette époque, et on a payé cher depuis la fantaisie d'y renoncer; mais ses instructions étaient de laisser à la publication des ouvrages la plus grande liberté possible, et je ne crois pas qu'elle ait été une seule fois dans le cas d'exercer son veto et de faire sentir l'action de son pouvoir aux écrivains.
J'eus soin aussi des officiers mutilés et des veuves des officiers morts au service d'Autriche pendant la dernière campagne. Je fis liquider leurs pensions sur le taux de la législation d'Autriche. L'Empereur devait prendre les charges du pays en l'acquérant, et récompenser loyalement des services rendus à l'État dont ce pays avait fait partie. Je fis faire aussi un travail sur les médailles de Joseph II et de Marie-Thérèse, données pour actions d'éclat à quelques soldats croates, et je sollicitai leur échange contre des croix de la Légion d'honneur. Il était politique de faire disparaître des distinctions autrichiennes, et équitable de rendre à de braves soldats un signe d'honneur mérité au prix de leur sang. Le courage qui se fait remarquer dans l'accomplissement du devoir doit être honoré, qu'il ait été employé ou non à notre profit, et le nouveau souverain s'honore lui-même et fait acte de haute justice en traitant avec faveur et bienveillance les anciens défenseurs du pays qu'il vient d'acquérir.
Les provinces illyriennes avaient été épuisées par la guerre, et le bétail y était devenu fort rare. Le gouvernement autrichien accorda la libre sortie de douze mille boeufs de Hongrie, et aussi une sortie illimitée des grains: ces secours furent un grand soulagement.
Depuis le mariage de Napoléon, je trouvais de meilleurs procédés dans les autorités autrichiennes, une facilité plus grande à s'entendre avec nous, et les rapports de la frontière étaient devenus aussi faciles que pacifiques. Ces autorités trouvèrent en moi les mêmes dispositions bienveillantes. Des billets faux, imités de ceux de la banque de Vienne, se répandirent tout à coup en Autriche; on reconnut qu'ils venaient d'Illyrie, et j'en reçus l'avis. La police se mit en campagne et découvrit l'atelier: les coupables reconnus furent punis suivant toute la rigueur des lois. Le gouvernement autrichien avait sollicité l'admission d'un commissaire pour être témoin de la procédure et assister au jugement; je le refusai comme contraire à notre dignité, mais la justice n'en fut faite qu'avec plus de sévérité.
À cette époque, les mesures de rigueur redoublèrent contre les marchandises anglaises: on les brûla impitoyablement dans tous les lieux où l'on put en découvrir, et ces actes, tout rigoureux qu'ils étaient, ne présentaient pas au moins les circonstances d'iniquité si odieuses auxquelles la confiscation des marchandises coloniales avait donné lieu, ainsi que je l'ai remarqué précédemment.
L'Empereur s'occupa de la sûreté des provinces illyriennes, et me demanda un projet de fortification. Par la réunion des bailliages du Tyrol, on a pu juger son intention: il voulait faire de ces provinces la frontière militaire complète de l'Italie contre l'Autriche. Tout me parut devoir se réduire à deux places, en outre de celles que j'ai indiquées en parlant de la défense du Frioul: l'une entre Tarvis et la Ponteba, à Malborghetto, et l'autre à Caporetto. Ces deux places auraient défendu et fermé les débouchés des montagnes dans la plaine du Frioul. Pour garder les bords de la Save, il aurait fallu une bonne place à Krainbourg; elle aurait fermé la vallée et gardé las deux débouchés qui viennent de Villach et de Klagenfurth, et une à Laybach pour appuyer une armée qui aurait défendu le passage de la Save. La place de Krainbourg, me paraissant plus importante, était celle que j'avais proposé de construire, sauf à s'en tenir seulement au château de Laybach et à établir au besoin un camp retranché sur les belles positions qui se lient à son assiette. Un fort occupant les défilés en avant d'Adelsberg aurait complété la défense de cette frontière: mais notre puissance a été si passagère, qu'à peine a-t-on eu le temps de concevoir et de préparer les projets.
L'Empereur insistait pour fortifier Trieste. Le fort qui couvre la ville pouvait être armé sans grandes dépenses; mais l'idée d'envelopper la ville par un système de forts détachés m'a toujours paru une entreprise d'un succès douteux et exigeant des moyens supérieure au but qu'on voulait atteindre.
J'allai visiter les mines de mercure d'Idria, dont la célébrité est fort grande. Découvertes en 1497 par un paysan, elles ont depuis été constamment exploitées. Une population de trois mille âmes environ est consacrée aux travaux. Ses produits sont annuellement de un million cinq cent mille francs de vif-argent, et le revenu net ne dépasse pas cinq cent mille francs. Le principal débouché pour le placement du mercure est l'Amérique, où on l'emploie dans l'exploitation des mines d'or. Le mercure ayant la propriété de s'amalgamer avec l'or et l'argent, ces métaux, dans leur gangue, sont réduits en poussière que l'on jette dans le mercure. Tout ce qui n'est pas or ou argent se sépare. Reste le mercure ainsi combiné à l'or et à l'argent. On place le tout dans des fours à réverbère; le mercure se volatilise; l'or et l'argent restent purs au fond du fourneau. Le mercure volatilisé est recueilli; et, sauf quelque perte, il sert de nouveau. Les Espagnols étaient autrefois en possession d'acheter la totalité des produits; mais leurs besoins ont beaucoup diminué par la découverte et l'exploitation des mines de mercure d'Almaden, en Andalousie, plus considérables que celles d'Idria. L'Empereur affecta le produit des mines d'Idria à l'ordre des Trois-Toisons d'Or, qui a existé seulement en projet.
L'administration de ces mines, mal conduite, était fort chère, comme il arrive toujours chez nous en pareil cas. Je réclamai qu'elle fût abandonnée à l'administration des provinces, sauf à livrer, chaque année, une quantité de mercure déterminée. Nous aurions ainsi développé leur exploitation, et le trésor de l'Illyrie y aurait trouvé un puissant secours, après avoir satisfait à la délégation faite sur lui en faveur de l'ordre des Trois-Toisons; mais l'Empereur ne voulut pas entendre à cet arrangement.
Ces mines sont belles et curieuses. L'exploitation eu est bien entendue. On en tire divers oxydes de mercure et on y fabrique du cinabre. La population, entièrement composée de mineurs, est aisée; mais combien elle achète cher son bien-être par les infirmités précoces qui l'accablent! Quelques années d'un travail suivi dans ces mines suffisent pour affecter le système nerveux et produire quelquefois un tremblement continuel dans tous les membres.
Je profitai du voisinage pour aller voir deux choses curieuses de ce pays: la grotte d'Adelsberg et le lac de Zirknitz. La Carniole a la même constitution que la Dalmatie; tout est calcaire ou grès. Les rivières creusent leur lit profondément, traversent les montagnes, disparaissent et surgissent de nouveau. Des grottes immenses et caverneuses d'une grande profondeur semblent les temples des Titans. Des stalactites et des stalagmites superbes, produites par les dépôts des infiltrations, forment des colonnes et des monuments d'une architecture bizarre. La grotte d'Adelsberg, par sa profondeur, par son étendue et la variété des formes de ses parvis et de ses divisions, est une des choses les plus remarquables en ce genre, et, quand elle est illuminée, comme lorsque je la visitai, elle offre un coup d'oeil dont il est impossible de faire une description exacte et de donner une juste idée.
À quelque distance d'Adelsberg et sur la route de Laybach, près du château de Cobentzel, sort de la montagne une rivière qui se perd plus loin et forme ensuite la Laybach. La grotte qui lui donne issue est si élevée, la forme des rochers est telle, qu'il s'y produit des effets d'acoustique extraordinaires. Une planche tombant sur le sable fin et humide occasionne un bruit comparable à celui que produit l'explosion d'une pièce de vingt-quatre.
J'allai voir le lac de Zirknitz, situé dans cette partie des montagnes. Celui-ci, comme les lacs de Dalmatie, se vide en partie pendant l'été, quelquefois complétement. Tant qu'il n'est pas descendu à un certain niveau, on ne peut rien prédire de l'avenir; mais, quand il a baissé à un point qu'on a observé, sa disparition a toujours lieu le quatrième jour. Ce phénomène excitait l'admiration et l'étonnement de ceux qui me le décrivaient. Je crois en avoir trouvé l'explication.
Le lac de Zirknitz communique évidemment avec un lac souterrain beaucoup plus grand que lui. Un banc les sépare au-dessous de leur niveau commun. Tant que ce niveau reste au-dessus du banc, il y a communication entre les deux lacs, et l'abaissement qui constitue le phénomène est incertain. Quand le niveau disparaît, les deux lacs sont isolés, c'est-à-dire le lac qui est à la superficie du sol n'est plus alimenté par le lac souterrain; et alors, comme il existe une proportion constante entre la quantité d'eau qu'il renferme et les gouffres par lesquels elle s'écoule, l'eau disparaît toujours au bout d'un même temps de trois jours et quelques heures 4
Note 4: (retour) M. Arago a parlé longuement du lac de Zirknitz, dans l'Annuaire du bureau des longitudes, page 210, année 1834. L'explication qu'il donne du phénomène est analogue à celle du duc de Raguse. Les détails qu'il ajoute, concernant les produits du lac, sont très-curieux: «Immédiatement après la retraite des eaux, toute l'étendue de terrain qu'elles couvraient est mise en culture, et, au bout d'une couple de mois, les paysans fauchent du foin ou moissonnent du millet et du seigle là où quelque temps auparavant ils pêchaient des tanches et des brochets.«On a remarqué, parmi ces diverses ouvertures du sol, des différences singulières: les unes fournissent seulement de l'eau; d'autres donnent passage à de l'eau et à des poissons plus ou moins gros; il en est d'une troisième espèce par lesquelles il sort d'abord quelques canards du lac souterrain.
«Ces canards, au moment où le flux liquide les fait pour ainsi dire jaillir à la surface de la terre, nagent bien. Ils sont complétement aveugles, et presque entièrement nus. La faculté de voir leur vient en peu de temps; mais ce n'est guère qu'au bout de deux ou trois semaines que leurs plumes toutes noires, excepté sur la tête, ont assez poussé pour qu'ils puissent s'envoler. Valvasor visita le lac de Zirknitz en 1687: il y prit lui-même un grand nombre de ces canards, et vit les paysans pêcher des anguilles (mustela fluvialilis) qui pesaient deux ou trois livres, des tanches de six à sept livres; enfin des brochets de vingt, de trente et même de quarante livres.» (Note de l'Éditeur.)
Toutes les branches de l'administration marchaient aussi bien que possible; l'ordre judiciaire seul était en retard. L'organisation projetée était à Paris depuis longtemps et ne pouvait pas en sortir. Je réclamais chaque jour davantage. On sent plus que jamais l'importance et le besoin de l'action de la justice, au moment où on en est privé. J'étais réduit à intervenir quelquefois dans des affaires particulières, à cause de l'urgence (chose si fâcheuse!), et de donner des arrêts de surséance. Je pris le parti d'envoyer à Paris M. Heim, secrétaire du gouvernement, homme actif et distingué, pour représenter l'état des choses; mais, plus tard, je sentis qu'il fallait faire connaître à l'Empereur et à ses ministres d'une manière spéciale les besoins généraux de ce pays autrement que par des lettres, et je sollicitai pour moi-même un congé qui me fut accordé peu après.
Au commencement de janvier survint un événement fort extraordinaire. Un nommé Wilhelm-Aurelio d'Amitia, né à Stuttgard, arriva sur la côte de Dalmatie sur un brik sicilien de quatorze canons. S'étant fait mettre à terre pendant la nuit, il s'annonça aux autorités comme ayant des dépêches à me remettre, et demanda à être conduit auprès de moi. Amené en poste à Laybach par un officier, il me déclara qu'il était au service de la reine de Sicile et qu'il arrivait de Palerme. Il n'avait ni dépêches ni pouvoirs; mais assuré, disait-il, d'en avoir aussitôt qu'il en aurait besoin; dévoué au roi et à la reine de Sicile, et connaissant leur situation malheureuse, il s'était décidé à venir s'informer s'il n'existait pas quelques moyens de rapprochement entre eux et l'Empereur. Il me dit que les Anglais, par suite de leurs outrages envers la cour de Sicile, étaient devenus l'objet de son animadversion; il ne doutait pas, si l'Empereur déterminait, par un traité, une indemnité convenable, qu'elle ne se résolût à déclarer la guerre aux Anglais, à soulever le pays et faire mettre bas les armes aux huit mille hommes de cette nation qui s'y trouvaient: enfin à livrer Messine aux Français. Il ajouta: «La reine ne peut penser que l'Empereur reste toujours son ennemi, lui qui vient d'épouser sa petite-fille.» Il prenait l'engagement de rapporter le plus promptement possible les pouvoirs nécessaires pour conclure l'arrangement, si Napoléon était disposé à y donner les mains. Quoique l'arrivée de cet homme sur un bâtiment de l'État donnât une sorte d'autorité à sa mission, comme il était possible qu'il fût un espion envoyé par les Anglais pour voir le nombre des troupes existantes en Illyrie, je défendis toute communication entre lui et les étrangers. Il était possible que l'Empereur voulût tirer parti de ces ouvertures. Je lui en rendis compte, et, en attendant sa réponse, je retins le voyageur, que je logeai convenablement au château de Laybach, bien traité et gardé avec soin.
Cette mission et ces projets étaient dans le génie de Caroline, dont la légèreté était aussi grande que la violence. Sa déclaration de guerre aux Anglais ne pouvait être autre chose qu'un massacre, de nouvelles vêpres siciliennes, mais cette fois à notre profit. En réponse à mon rapport, je reçus l'ordre d'envoyer cet homme à Paris. Il monta en chaise de poste et y fut conduit par un officier de gendarmerie. L'Empereur n'eut pas foi à sa mission: elle était cependant bien réelle. Mis au Temple à son arrivée, il y est resté prisonnier jusqu'à la Restauration.
La preuve de la vérité de sa mission est tout entière dans ce qui se passa quelque temps après à Palerme. Les Anglais, informés des intrigues ourdies contre eux par Caroline, prirent de grandes mesures de sûreté. La première fut d'embarquer cette princesse pour Constantinople et de la renvoyer en Autriche. Tout le monde peut se rappeler ces événements, arrivés au mois de mars, précisément deux mois après le départ d'Amitia pour l'Illyrie.
J'avais fait de grands efforts, ainsi qu'on a pu en juger, pour amener les Monténégrins à se mettre sous la protection de la France. Les apparences avaient d'abord paru favorables; mais le temps avait beaucoup diminué les probabilités. Quoique la paix régnât entre eux et nous, on ne pouvait cependant se faire illusion sur les mauvaises dispositions de l'archevêque et mettre en doute que ces barbares, à la première occasion difficile, nous causeraient des embarras. Je crus devoir profiter du repos dans lequel nous étions pour les détruire ou les soumettre; j'en fis de nouveau la proposition à l'Empereur, et j'en fixai l'exécution au printemps. Cette fois, il l'agréa, et je préparai ce qui était nécessaire; mais mon départ de l'Illyrie empêcha le projet de se réaliser.
Il existait, dans le régiment d'Ogulim, une horrible maladie, dont les progrès augmentaient chaque jour; elle avait été apportée de Valachie, après la paix de Sistow; le moindre contact suffisait pour la communiquer d'une personne à l'autre. Trois mille individus en étaient attaqués. Je fis disposer tout dans le lazaret de Fiume, pour faire traiter et guérir, en l'isolant, cette population, qui fut enfin délivrée de l'horrible fléau.
L'emploi de mon temps étant bien réglé, il m'en restait beaucoup que je consacrais à des occupations de mon goût. J'avais fait les frais d'un magnifique cabinet de chimie, où j'avais réuni quelques instruments de physique, nécessaires aux décompositions. Aidé par le pharmacien en chef de l'armée, nommé Paissé, homme d'une grande habileté, je consacrais chaque jour plusieurs heures à diverses expériences, dont l'idée me venait à l'esprit. Frappé du phénomène que produit l'acide sulfurique concentré, quand, mêlé à de l'eau dans une proportion déterminée, il dégage une quantité de calorique très-considérable, et, réfléchissant que la loi de la gravité agissant sur le calorique comme sur tous les autres corps, il doit être pesant, j'eus la pensée qu'on pourrait démontrer cette pesanteur, et la prétention de l'avoir découverte. J'en écrivis à Monge, qui me répondit qu'il n'y croyait pas.
Mon raisonnement était basé sur des faits: son incrédulité ne m'alarma pas, et je persistai dans ma croyance; les expériences réitérées me confirmaient dans ma conviction. Quand, plus tard, je fus à Paris, je courus chez lui; je vis aussi MM. de Laplace et Berthollet; ils convinrent que, si le fait était bien constaté, j'aurais fait une grande découverte. On prit jour pour aller à l'École polytechnique, où tout le monde se rendit. M. Gay-Lussac fit l'opération. Je vis, dans cette circonstance, pour la première fois, M. de Humboldt, le célèbre voyageur, que j'ai beaucoup connu depuis. Le résultat contredit toutes mes expériences, et je fus anéanti. M. Gay-Lussac me proposa de recommencer, mais je ne voulus pas à la présomption ajouter l'obstination, et je me tins pour battu. Je raconte ce petit événement, pour montrer combien il est difficile de bien faire une expérience, et à quel point les apparences sont trompeuses. Il faut une grande habitude, les soins les plus minutieux, et des instruments parfaits, pour observer la nature et découvrir ses secrets. Je me résignai, mais je renonçai, avec une véritable douleur, à un genre de célébrité que j'avais cru mériter et atteindre.
Après avoir passé quelques mois d'hiver à Trieste, les décisions indispensables au bien-être de l'Illyrie n'arrivant pas, et le congé que j'avais demandé m'étant accordé, je partis pour Paris. J'étais bien aise d'aller voir la nouvelle cour, contempler cette fille des Césars, nouvellement associée à nos destinées, et dont la présence vieillissait notre jeune dynastie, en l'unissant aux plus anciennes et aux plus illustres familles de l'Europe.
Je partis de Trieste à la fin de février, laissant le commandement des troupes, en Illyrie, au général Delzons, général très-distingué. J'arrivai à Paris dans les première jours de mars, dans ce mois qui devait être si fertile en événements politiques, et dans lequel devaient successivement se produire les espérances et les convulsions de l'Empire.
Alors, époque de joie et de triomphe, tout avait réussi à Napoléon; le monde paraissait avoir des limites trop étroites pour lui, tout était à ses pieds, et ses moindres désirs avaient presque la puissance irrésistible des lois de la nature. Un fils allait lui naître, et cet enfant, regardé comme le gage de la paix et de la tranquillité de la terre, comme l'arc-en-ciel politique des nations, semblait destiné à porter sur sa tête cette couronne ombragée par de si nombreux lauriers, et à recevoir le sceptre de l'univers pour héritage. On croyait l'édifice majestueux élevé par tant de travaux à l'abri des tempêtes, et, quoique quelques symptômes pussent alarmer déjà les initiés, on n'avait cependant pas encore la pensée que ce flambeau, dont l'éclat, pour ainsi dire, était céleste, dût bientôt pâlir et s'éteindre. Mais tant de prudence, de calcul et de profondeur devait faire place aux conceptions les plus déraisonnables; l'orgueil se changer en aberration grossière; les inspirations du génie disparaître ou se réduire à ce qui flatte les passions; et un homme sorti de la foule, enfant de ses oeuvres, dépasserait bientôt en illusions les princes nés sur le trône, dont les flatteurs ont corrompu le caractère et obstrué l'intelligence. Tout cela cependant était au moment d'arriver, tant est faible notre nature! Trois ans à peine étaient écoulés, et le colosse avait disparu!
La grandeur de Napoléon a été en partie son ouvrage; mais les circonstances ont singulièrement favorisé son élévation. Son arrivée au pouvoir a été l'expression des besoins de la société d'alors, mais sa chute, c'est lui seul qui l'a causée. Il a mis une plus grande et une plus constante énergie à se détruire qu'à s'élever, et jamais on n'a pu faire une application plus juste qu'à lui de cette observation, que les gouvernements établis ne peuvent tomber que par leur faute et meurent toujours par une espèce de suicide.
L'Empereur me reçut à merveille à mon arrivée à Paris: tous les rapports venus sur l'Illyrie l'avaient satisfait; je lui parlai des besoins de ces provinces, de la nécessité de terminer leur organisation: il nomma une commission pour m'entendre: deux séances suffirent pour tout expliquer, tout faire comprendre, et tout terminer. On adopta sans restriction toutes mes idées. J'obtins la grâce de tous les Dalmates condamnés pendant la guerre pour délits politiques; j'obtins aussi pour les Illyriens la participation au cabotage des côtes d'Italie, réservé jusque-là aux seuls Italiens. Dans la discussion de tous ces intérêts, on vanta peut-être avec excès mes connaissances en législation, en administration et en politique.
Je vis alors pour la première fois la nouvelle Impératrice; je trouvai en elle de la dignité et cette expression de bonté qui est l'apanage de toute sa famille.
Le moment des couches de Marie-Louise approchait: l'agitation était dans tous les esprits! Que d'espérances! quel prix on mettait à la naissance d'un fils! Le 19 mars, l'Impératrice ressentit les premières douleurs, et tout ce qui tenait à la cour se rendit aux Tuileries. Nous passâmes la nuit dans le salon bleu, où aujourd'hui reçoit madame la Dauphine. À cinq heures du matin, Dubois ayant annoncé que, selon les apparences, l'accouchement n'aurait pas encore lieu, chacun se retira chez soi. À six heures, le canon annonça la délivrance de l'Impératrice: le nombre des coups de canon devant faire connaître le sexe de l'enfant, tout le monde compta avec soin jusqu'au vingt-deuxième; on courut ensuite aux Tuileries pour féliciter l'Empereur. On a beaucoup argumenté sur les circonstances de cet accouchement si brusque pour faire croire à la supposition d'un enfant. Le renvoi des courtisans fut une maladresse; mais jamais rien n'a été moins fondé ni plus calomnieux que le bruit répandu alors.
On en a dit autant depuis, et avec une aussi grande injustice, lorsque madame la duchesse de Berry accoucha du duc de Bordeaux avec encore plus de promptitude.
C'était mon troisième voyage à Paris depuis l'Empire. Quel que fût mon goût pour les camps, et ma passion pour la guerre, je jouissais vivement de ce séjour; mais il ne devait pas se prolonger beaucoup. Je ne devais plus revoir qu'une seule fois, à l'époque de son déclin, après les désastres de Moscou, cette cour alors si grande, si éclatante et si magnifique.
Masséna avait été envoyé en Espagne l'année précédente pour prendre le commandement d'une armée forte et bien pourvue, destinée à faire la conquête du Portugal. Arrivé jusque devant les lignes de Lisbonne, il n'osa pas les attaquer. Les besoins de toute espèce, la misère, la disette assaillirent bientôt cette armée, la désorganisèrent, et la forcèrent à la retraite.
Le général Foy, envoyé par Masséna, avait informé l'Empereur de la situation des choses. Des divisions fâcheuses existaient dans l'armée. Masséna, vieilli, s'était trouvé au-dessous de lui-même; son rôle, malgré ses grandes qualités comme homme de guerre, aurait été d'ailleurs au-dessus de ses facultés, même dans son plus beau temps: il n'était donc pas étonnant qu'il n'eût pas réussi. Mais je n'anticiperai pas sur le récit de ces événements, dont je vais m'occuper immédiatement. Il formera le préambule de l'histoire de mes campagnes dans la Péninsule, du compte rendu de mes opérations. La retraite résolue s'exécuta, et l'armée se rapprocha de la Castille, ayant à sa suite l'armée anglaise.
L'Empereur, décidé à rappeler Masséna, me proposa de le remplacer et de prendre le commandement de cette armée; tâche difficile dans les circonstances où elle se trouvait! Je crus cependant que cette tâche n'était pas au-dessus de mon zèle. L'Empereur me fit, suivant son usage, les plus belles promesses en secours de toute espèce: on verra comme il les a tenues.
J'allais chercher de la gloire, il voulut stimuler mon ambition: c'était un moyen superflu pour exciter mon ardeur. Il me dit, quand je le quittai, ces propres paroles: «En Espagne sont les grandes récompenses. Après la conquête, la Péninsule est destinée à être divisée en cinq États gouvernés par des vice-rois, qui auront une cour et jouiront de tous les honneurs de la royauté; une de ces vice-royautés vous est destinée, allez la conquérir et la mériter.»
Je partis avec le titre de commandant du sixième corps, qui faisait partie de l'armée du Portugal: à mon arrivée, je devais trouver mes lettres de service comme général en chef, et le rappel de Masséna. Je me mis en route le 26 avril 1811, et je rejoignis l'armée le 6 mai, le lendemain même du combat de Fuente-Oñoro. L'armée étant réunie sous les murs de Rodrigo, Masséna m'en remit le commandement, et partit pour rentrer en France.
RELATIFS AU LIVRE QUATORZIÈME
LE MARÉCHAL MARMONT AU MINISTRE DE LA GUERRE.
«Laybach, le 29 mai 1810.
«Monsieur le duc, je viens de recevoir la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire le 16 mai, par laquelle vous m'annoncez que l'Empereur voit avec peine que j'emploie des troupes françaises dans les démêlés de la frontière. Votre Excellence aura reçu, peu de jours après, mon rapport du 9 et du 11, qui vous aura instruit comment ces événements se sont passés, et que la tranquillité est rétablie d'une manière stable: ces résultats auront sans doute justifié les dispositions que j'ai prises. Je demande à Votre Excellence de prier Sa Majesté d'observer que c'est au déploiement que j'ai fait de forces considérables que j'ai dû de n'avoir presque pas eu à combattre; que, si je n'avais envoyé que peu de troupes, j'aurais eu certainement dix à douze mille hommes sur les bras, qui forment la force totale des Turcs de la frontière, qui ont pris part primitivement à la rébellion, tandis qu'il y en a à peine quatre mille en tête des cantons qui ont été tentés de résister, tant à Bihacz qu'à Czettin; que c'est à ce déploiement de forces que j'ai dû la terreur profonde qui a fait évacuer Czettin, qui pouvait se défendre longtemps, et qui se serait défendue sans cela; que je ne pouvais employer les Croates seuls, puisque alors à peine deux mille avaient reçu des armes; enfin que je ne pouvais plus retarder un seul moment la rentrée en possession de ce territoire, sous peine de renoncer aux avantages qu'il pouvait procurer aux Croates cette année, puisque nous étions arrivés à la dernière époque de la saison où il est possible d'ensemencer les terres.
«Tels sont, monsieur le duc, les motifs qui m'ont déterminé, et j'espère qu'ils paraîtront fondés à Sa Majesté. Au surplus, je n'ai éprouvé aucune espèce de perte.»
LE MARÉCHAL MARMONT À NAPOLÉON.
«Laybach, le 12 juillet 1810.
«Sire, je reçois la lettre que Votre Majesté m'a fait l'honneur de m'écrire le 3 juillet. Les volontés de Votre Majesté vont être exécutées.
«La défense maritime de Pola va être assurée le plus promptement possible par une quarantaine de bouches à feu de gros calibre. J'aurai l'honneur sous peu de jours d'adresser à Votre Majesté le croquis de ces armements, et de lui annoncer d'une manière positive le jour où ils seront terminés. Par aperçu, je crois que ce travail n'ira pas au delà de la fin d'août.
«J'aurai l'honneur également d'adresser à Votre Majesté un mémoire détaillé sur les fortifications dont Pola serait susceptible du côté de terre. Plusieurs officiers sont occupés en ce moment d'un travail sur cet objet.
«Si une escadre se présentait dans l'Adriatique, elle trouverait encore un asile assuré à Raguse. Il y a deux ans, j'y ai fait faire de très-belles batteries, qui peuvent être en vingt-quatre heures armées de soixante bouches à feu. Ainsi, soit au moyen des canons de la place, soit avec ceux de l'escadre, elle serait garantie.
«Une escadre, mais seulement de cinq à six vaisseaux, serait dans ce moment également en sûreté à Zara.
«Enfin la défense de Trieste, complétée par une ligne d'embossage, est très-respectable, et suffit, je crois, pour mettre une escadre à l'abri de tout danger.
«Quant à la défense de terre de Trieste, il me paraît démontré qu'il est impossible de la rendre assez complète pour mettre en sûreté une escadre qui s'y serait retirée. Le port de Trieste, situé au fond d'un vaste entonnoir, ne peut pas être couvert par des ouvrages, et, quelque dépense qu'on fît pour parvenir à ce but, je ne pense pas qu'on pût l'atteindre. Le fort cependant est à l'abri d'un coup de main; il pourrait être amélioré en occupant un mamelon qui se lie avec celui sur lequel il est construit. Mais ces ouvrages exigeraient deux mille hommes; ils seraient susceptibles de quelque résistance; mais ils ne couvriraient pas le port, parce qu'ils n'occuperaient que le quart à peu près de son développement, et que le reste n'est pas susceptible d'être défendu.
«Je viens de demander à la commission de marine, qui se trouve à Trieste en ce moment, un rapport pour l'exécution des volontés de Votre Majesté relativement à l'armement d'un des vaisseaux russes qui sont à Trieste et d'une frégate. J'aurai l'honneur de lui en rendre compte.
«Les travaux que cet armement exige seraient moins difficiles si nos ressources financières avaient été réunies plus tôt; car, si les dépenses qui en résulteront doivent être facilement supportées par les provinces illyriennes, elles sont aujourd'hui au-dessus de leur force.
«Mais, indépendamment de cette considération, et par premier aperçu, il me paraît douteux que le vaisseau puisse être mis en état de naviguer très-promptement: 1° faute de personnel pour diriger les travaux; 2° par le défaut de mâts, qu'il faudra faire couper, façonner et transporter, tous les mâts des vaisseaux russes ayant été détruits par eux, et par le manque de tout ce qui constitue un établissement de marine militaire à Trieste.
«Quant à la frégate, je ne doute pas qu'on ne puisse en très-peu de temps la mettre en état de tenir la mer, et on va s'en occuper sans le moindre retard. Mais un secours qui est pressant, c'est l'envoi d'un bon ingénieur constructeur, de chefs d'ouvriers de différentes classes, et d'un commissaire de marine pour prendre l'administration et mettre de l'ordre dans les dépenses.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU MINISTRE DE LA GUERRE
«Laybach, le 15 juillet 1810.
«Monsieur le duc, les détails que je me suis fait donner sur l'administration des mines d'Idria, dans la visite que j'y ai faite, m'ont convaincu que cette administration difficile et compliquée ne peut être dirigée à une grande distance. La nécessité de nourrir toute la population d'une manière régulière, les soins de tous les instants, qui soumettent cette population plus qu'au même régime que ne le serait un corps de troupes, exigent que l'autorité, qui dispose des ressources et des moyens, soit sur les lieux. Si l'administration de l'ordre des Trois-Toisons veut administrer sans intermédiaire, elle échouera. Si elle donne toute espèce de pouvoirs à un administrateur qui sera sur les lieux, il faut qu'elle fasse choix d'un homme important, qui offre toutes les garanties; et, dès lors, elle doit le payer fort cher.--Mais cet homme, même bien choisi, ne pourra pas obtenir, à beaucoup près, les mêmes résultats que l'administration des provinces illyriennes, parce qu'il faut sans cesse le concours de l'autorité, et qu'elle est indispensable aux progrès et aux améliorations dont cet établissement important est susceptible.
«Je pense donc que le moyen de faire prospérer l'établissement des mines, et d'accroître beaucoup ses produits, serait d'en rendre l'administration au gouverneur des provinces, sauf à verser chaque mois dans la caisse des Trois-Toisons, en argent, ou dans les mains d'un de ses agents, la quantité d'argent ou de mercure déterminée pour former la dotation de l'ordre des Trois-Toisons, qui est à sa charge.
«Si la somme de cinq cent mille francs, déterminée par Sa Majesté, restait la même, les provinces illyriennes y gagneraient beaucoup, car on peut calculer que, par la sollicitude de l'autorité d'une administration bien entendue, le produit des mines doit s'élever à un million, somme très-supérieure a celle que les Autrichiens en ont jamais tirée.
«Dans tous les cas, l'Empereur ferait connaître sa volonté pour la somme à verser dans la caisse des Trois-Toisons, et, le gouvernement des provinces illyriennes dût-il ne rien avoir, il y aurait toujours un avantage considérable pour le pays, en raison de l'accroissement de l'industrie et des produits.
«Telles sont, monsieur le duc, les réflexions que m'ont fait naître la connaissance que j'ai prise de l'administration des mines d'Idria et mon zèle pour le service de Sa Majesté.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU MINISTRE DE LA GUERRE.
«Laybach, le 31 juillet 1810.
«Monsieur le duc, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 21 juillet, qui est relative à l'arriéré de la solde des troupes à Raguse.
«J'ai l'honneur d'adresser à Votre Excellence le tableau de la situation de la solde, qui vient de m'être remis par le trésorier général. Elle y verra que le sort des troupes en Dalmatie et en Albanie a été amélioré.
«Les raisons qui ont placé les troupes dans des conditions aussi défavorables sont telles, que j'ose à peine vous les présenter, tant elles paraissent étranges et incroyables; mais elles n'en sont pas moins vraies et à la connaissance de tout le monde. Les voici:
«M. d'Auchy avait pris en aversion la Dalmatie, et quelque chose que j'aie faite et quelque promesse que j'en aie obtenue, ce qui est constaté par le procès-verbal de nos séances, il n'a jamais voulu s'occuper ni envoyer des secours. Ce n'est que pendant le mois de juin qu'il a commencé à faire quelques dispositions de fonds pour ce pays.
«Le prétexte d'absence de ressource ne peut le justifier; car jamais je ne lui ai demandé des envois de fonds que lorsque j'avais la connaissance des moyens existants; et c'est précisément lorsqu'il manquait à ses engagements, qu'il payait avec profusion des fournisseurs qui étaient ses favoris.
«Lors de la vente des marchandises coloniales, j'avais proposé à M. d'Auchy d'admettre les régiments en payement de leur solde, dans l'achat de ces marchandises. Il en résultait un recouvrement et payement sans numéraire, dont la rareté était un obstacle de plus. M. d'Auchy n'a étendu cette disposition qu'aux fournisseurs, et des sommes très-considérables ont disparu lorsque les troupes étaient dans le plus grand besoin.
«Enfin M. d'Auchy a mis une telle volonté et une telle négligence dans cette partie du service, qu'il avait oublié ou feint d'oublier qu'il existait dans la caisse du receveur, à Zara, cent mille francs; tandis que le préposé du trésorier n'avait pas un sou, que tout le monde était dans le besoin, et qu'en ayant été instruit j'ai dû lui écrire, le 21 juillet, pour le presser de donner l'ordre de faire verser des fonds, de manière à ce qu'on pût en faire l'emploi pour le payement des troupes.
«Pendant ce temps de disette et de besoins, lorsque M. d'Auchy ne voulait s'occuper ni de la Dalmatie, ni des troupes qui y sont en garnison, il donnait, sans ma participation, sans mon consentement, et outre mesure, des sommes à l'administration d'Idria pour des travaux qui nous sont étrangers, travaux dont il fallait sans doute empêcher la suspension, mais qu'il ne fallait pas traiter plus favorablement que les troupes.
«Il est dû, en outre, aux troupes d'assez fortes sommes sur l'an 1809; mais, comme l'administration des provinces illyriennes commence au 1er janvier 1810, nous n'avons pas payé des dettes antérieures. Bien plus, le ministre du trésor public ayant envoyé, au mois de février, huit cent mille francs en numéraire pour payer ce qui était dû aux troupes sédentaires de la Dalmatie pour l'an 1809, nous avons été obligés d'en prendre une partie pour faire la solde des troupes dans les provinces conquises, parce qu'alors on était dans le plus fort de la crise du papier, crise qui n'est pas encore passée, et qui était telle alors, que nous ne pouvions pas nous promettre la rentrée de mille louis.
«Mais les fonds sont compensés par une solde de huit cent quatorze mille francs, qui nous est due par la caisse de la cinquième coalition, et qui servira à solder toutes les dépenses de l'année pour l'an 1809.
«Votre Excellence pourra se convaincre, d'après ce qui précède et qui est de la plus rigoureuse vérité, que, si le sort des troupes de Dalmatie n'est pas le même que celui des provinces cédées, c'est que mes efforts, pour le bien du service de l'Empereur, étaient impuissants lorsque M. d'Auchy était ici.
«Notre situation à cet égard a beaucoup changé, et je ne doute pas qu'avec le concours de M. Belleville et les bonnes dispositions qu'il annonce nous ne fassions tout ce qu'on peut attendre du zèle le plus pur et le plus soutenu.
«Notre situation serait meilleure si M. d'Auchy avait voulu plus tôt, et d'une manière plus complète, s'occuper des moyens d'augmenter les revenus. Mais il a été sourd à ma voix, en cela comme en toute autre chose; et je n'ai pas à me reprocher de l'avoir laissé ignorer, car j'ai la crainte même d'avoir répété trop fréquemment combien son inertie, son insouciance et sa mauvaise volonté étaient funestes. Mais il faut que Sa Majesté sache qu'en ce moment même pas un seul octroi n'est établi, et cependant c'était un des moyens les plus simples et les plus prompts d'augmenter les revenus.
«Une chose aussi qui est indispensable à l'amélioration de nos finances, c'est la mise en activité du Code Napoléon, sans lequel nous ne pouvons établir l'impôt sur l'enregistrement, et que le retard prolongé de M. Cofinhal ajourne indéfiniment. Chaque mois de retard prive le trésor des provinces illyriennes de cent cinquante mille francs, qui est la moitié de la solde de l'armée.
«Je saisis cette circonstance pour prier Votre Excellence de solliciter de Sa Majesté ses ordres à cet égard.
«Enfin, je le répète, les provinces illyriennes, dont les finances seront très-belles en 1811, et qui auront amplement ce qu'il leur faut pour supporter les charges que Sa Majesté leur a imposées, ont besoin d'un secours et d'un prêt cette année, pour donner le temps d'attendre le moment où toute la nouvelle organisation financière pourra être en activité et donner les produits qu'elle promet.
«Toutes mes sollicitudes et celles de M. Belleville tendent à mettre les troupes de Dalmatie au niveau de celles des provinces cédées; et, comme nous sommes pénétrés l'un et l'autre des mêmes principes et des mêmes idées, que nous sommes parfaitement convenus de nos faits, Sa Majesté peut être assurée que chaque jour améliorera la situation de tous les services.»
LE MARÉCHAL MARMONT À NAPOLÉON.
«Trieste, le 7 août 1810.
«Sire, j'ai l'honneur de rendre compte à Votre Majesté que vingt pièces de gros calibre sont aujourd'hui en batterie à Pola, et que trente autres, qui portent à cinquante l'armement de cette rade, y seront placées le 1er septembre. Chaque batterie aura, en outre, un fourneau à rougir les boulets et les établissements indispensables à leur service.
«Il serait désirable que, dans cet armement, il y eût au moins six mortiers; mais, n'en ayant point, j'en demande douze en Italie, afin d'en placer aussi le même nombre à Trieste.
«J'ai l'honneur de rendre compte également à Votre Majesté que j'ai vu sur les lieux, et dans le plus grand détail, les projets qui ont été faits pour la place de Pola. Ils m'ont paru fort satisfaisants. On s'occupe à mettre au net quelques changements que j'ai indiqués, et j'espère, sous quatre ou cinq jours, avoir l'honneur de les adresser à Votre Majesté, ainsi que ceux de Trieste, conformément aux ordres que Votre Majesté m'a fait transmettre par le général Bertrand.
«L'armement de la frégate Lenoi avait été commencé, conformément aux ordres de Votre Majesté, mais il a été suspendu par le mauvais état dans lequel on a trouvé ses fonds. J'ai visité ces fonds avec des gens experts; ils ne m'ont pas paru tels cependant, qu'on dût renoncer à faire naviguer ce bâtiment dans l'Adriatique. En conséquence, on va reprendre son armement, et on le continuera si on ne découvre pas d'autres avaries, et, dans ce cas, cette frégate pourra être en état de servir dans six semaines.
«Quant au vaisseau que Votre Majesté veut qu'on arme, ce n'est que dans quatre ou cinq jours que nous saurons d'une manière précise s'il en est susceptible et s'il est possible de le rétablir sans une dépense plus forte que sa valeur.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU MINISTRE DE LA GUERRE.
«Laybach, le 19 août 1810
«Monsieur le duc, Sa Majesté m'ayant fait donner l'ordre de faire faire le plus promptement possible des projets sur Trieste, j'ai l'honneur de vous adresser ceux qui ont été rédigés sous mes yeux, en vous priant de les soumettre à Sa Majesté.
«L'Empereur m'ayant fait l'honneur de me demander également des projets sur Pola, j'ai l'honneur de les joindre aussi à cette lettre. Je me suis rendu sur les lieux pour pouvoir en juger par moi-même; je vous demande également de les soumettre à Sa Majesté.
«Les mémoires qui accompagnent les projets me paraissent rédigés avec beaucoup de clarté. En conséquence, je crois superflu d'entrer dans de grands détails. Les projets sur Trieste ont été faits sous deux points de vue: le premier, en s'attachant à l'exécution littérale des ordres de Sa Majesté, le second, en s'abandonnant aux idées que font naître les localités et la nature des terrains. Plus je l'ai étudié, et plus je me suis convaincu qu'il est impossible d'obtenir de bons résultats en faisant du château de Trieste le point capital de la défense, et en lui faisant renfermer le matériel qu'il doit contenir; et qu'au contraire on peut faire une très-bonne place en faisant jouer au château le rôle de place secondaire, et en plaçant le centre de la défense à Saint-Vito, et couvrant d'un ouvrage avancé le plateau qui le précède. La place, telle qu'elle a été indiquée dans le projet, serait susceptible d'une bonne défense, n'exigeant probablement pas les quatre mille hommes qu'estime nécessaires le général Maureillan, mais pourrait en contenir beaucoup plus au besoin. Enfin, offrant beaucoup d'espace, ayant un seul point d'attaque, elle présente d'immenses moyens pour renfermer et mettre en sûreté de nombreux établissements.
«Le seul inconvénient paraît être la dépense que les premiers aperçus portent à quatre millions cinq cent mille francs; mais l'opinion générale des ingénieurs est que l'évaluation en a été un peu forcée; et, d'ailleurs, dans ces quatre millions cinq cent mille francs sont comptées les indemnités pour six cent mille francs, dont le payement ne serait pas absolument indispensable.
«Les projets sur Pola sont aussi complets que possible. Ignorant la pensée précise de Sa Majesté pour cette place, j'ai cru qu'il était convenable que celui que j'ai l'honneur de vous adresser remplît toutes les conditions qu'on exige d'une grande place maritime. Sa Majesté pourra en supprimer toute la partie qui lui paraîtra superflue. Le peu d'étendue qu'a la rade de Pola, et qui permettrait à l'ennemi, maître de la terre, d'établir des batteries qui commanderaient le mouillage, nous a forcés d'établir une ligne d'ouvrages qui, en l'éloignant, garantit la flotte de l'action de ses batteries. L'immensité des travaux de la place disparaît en partie lorsqu'on réfléchit que cette place, n'ayant que deux points d'attaque, ce sont ces deux points pour lesquels seuls on doit épuiser les ressources de l'art, et que l'enceinte proprement dite peut être faite avec beaucoup d'économie; partie pouvant être non revêtue, partie non terrassée, enfin tous les ouvrages qui sont situés sur le long promontoire terminé par le cap Figo sont inattaquables avant la prise de la place, puisqu'ils voient tous les points de débarquement, et par conséquent inutile de leur donner une grande force.
«Les localités de Pola sont extrêmement avantageuses pour une bonne fortification, et je pense que le projet, tel qu'il est rédigé, en présentant ce qu'il y a de plus raisonnable, assure tous les moyens d'une longue résistance; la nature du pays qui environne Pola ajoute encore à la force de la place, et l'ennemi, dans un pays inculte, obligé de cheminer sur un sol de roc, sans eau, trouverait de grandes difficultés à réussir et à tenir rassemblés pendant longtemps les moyens qu'exigerait une entreprise aussi importante que celle du siége de cette place.
«J'ai l'honneur de rendre compte à Votre Excellence qu'ayant donné tous les ordres relatifs aux travaux de la marine, et ayant arrêté avec l'intendant général les principales dispositions que les circonstances commandent pour assurer la subsistance et les services, je pars après-demain pour la Croatie, afin de visiter, dans le plus grand détail, les régiments croates, compagnie par compagnie. J'ai toujours pensé que ce voyage était indispensable, et je ne doute pas qu'il ne donne les meilleurs résultats.
«Je ne considérerai l'organisation de ces régiments comme complète qu'après cette tournée, ayant eu depuis six mois l'expérience de leur régime et pouvant apprécier les différents officiers. Mon voyage sera de six semaines environ.»
LE MINISTRE DE LA GUERRE AU MARÉCHAL MARMONT.
«Paris, le 20 août 1810.
«Monsieur le due, j'ai l'honneur de transmettre à Votre Excellence une note que Sa Majesté l'Empereur a dictée sur les provinces illyriennes, et dont elle a prescrit qu'il vous fût donné communication. Votre Excellence verra que l'intention de Sa Majesté est qu'il n'y ait aucun établissement important de défense ou de dépôt dans ces provinces, et qu'il soit seulement projeté, dans la position que vous ferez reconnaître par M. le général commandant du génie, une place sur l'Isonzo, et deux forts qui intercepteraient la route d'Osoppo à Villach, et de Goritzia à Villach par Tarvis. Je vous invite à donner connaissance de la présente note à M. le général baron de Maureillan, afin qu'il la prenne pour base des projets et de tout système de défense qu'il devra concerter avec vous, pour être ensuite soumis à Sa Majesté.»
NOTE SUR LES PROVINCES ILLYRIENNES.
«Le fort de Sachsenbourg doit être détruit, parce qu'il n'est susceptible d'aucune augmentation; qu'il est tellement plongé, que ce serait jeter son argent sans résultat, et que, après quinze jours de défense, la garnison serait inévitablement prise avant qu'on y pût revenir.
«Villach paraît susceptible de peu de chose; du moins tout serait à faire.
«Le cours de la Drave, dont nous sommes en possession, a l'important avantage de nous rendre maîtres du versant des eaux, et de nous permettre de choisir les positions que nous devons occuper sur la chaîne des Alpes.
«Il est à prévoir que, dans les événements d'une guerre, les Autrichiens pourraient nous prévenir; or il est probable que nous n'essayerons pas même de défendre Villach et le versant des montagnes, qu'il faudra se retirer derrière les Alpes. Rester maître des Alpes est la seule chose qu'on doive désirer.
«On peut en dire autant de toutes les provinces illyriennes. Dans une guerre contre l'Autriche, l'armée française repassera l'Isonzo, et il est possible qu'elle ne puisse pas se trouver assez réunie pour se battre dans des pays si près de l'Autriche. On aura obtenu un grand résultat de la circonstance qui nous rend maîtres de tout le pays, si nous restons maîtres de l'Isonzo et du passage des Alpes.
«Un des grands désavantages de la place de Palmanova est qu'elle ne nous rend pas maîtres de l'Isonzo. S'il y a une nouvelle fortification à établir, il faudrait l'établir à Goritzia, Gradiska, ou tout autre point, qu'il faudrait chercher et choisir sur l'Isonzo, qui fasse que l'armée puisse repasser l'Isonzo et être maîtresse de le passer quand elle voudra.
«Ce qui est arrivé dans la dernière guerre avait été prévu, et on avait bien pensé qu'il n'était pas possible de se défendre dans le Frioul.
«Il faudrait donc reconnaître quel est le point qu'il faut occuper pour être maître du chemin d'Osoppo à Villach par la Pontola, celui qui rendrait maître du chemin de Tarvis à Caporetto par Goritzia.
«S'il y avait là deux points qu'on pût occuper, cela mériterait la peine de dépenser un million sur chaque point, de manière que l'ennemi ne pût déboucher par ce chemin sans prendre les forts, ce qui exigerait quinze ou seize jours.
«On ne prétend pas l'empêcher de passer avec de l'infanterie, de la cavalerie, et des divisions légères, mais intercepter la chaussée: c'est de la grande route qu'il est question de se rendre maître.
«Il ne faut donc pas se dissimuler qu'il ne faut établir aucune offensive au delà des Alpes, aucune défensive au delà de l'Isonzo; on sera prévenu par l'ennemi.
«La vraie défense est sur l'Isonzo et les montagnes. Il faut charger le général Poitevin de parcourir cette rivière, et de déterminer un point pour pouvoir l'occuper et faire système avec Palmanova; surtout chercher le point qui intercepte parfaitement la route de Villach à Osoppo, et de Villach à Goritzia par Tarvis.
«Ces deux points sont bien plus importants que celui sur l'Isonzo; car, si le quartier général de l'armée ennemie est à Klagenfurth, il lui faut quatre jours pour se porter aux montagnes; et, s'il y a là des obstacles qui le retiennent, l'ingression par la Carinthie, qui est l'ingression la plus dangereuse, se trouvera considérablement retardée, et l'armée française aura tout le temps de se former dans le Frioul, de débloquer les places et de prendre l'offensive.
«Si, à cause de ces obstacles, l'ennemi ne vient point par Klagenfurth et vient par Laybach, ce serait un détour de quatre ou cinq jours qui retarderait d'autant sa marche.
«Cela l'obligera à diviser ses forces, parce qu'il aura toujours à craindre une attaque par la cavalerie; gagner cinq à six jours dans ces moments-là n'est pas un petit objet.
«Ainsi il faut renoncer à toute espèce de projets sur Laybach; il faut en détruire les fortifications; mais il est bon de conserver le château en l'améliorant, d'abord parce que le château contiendra les habitants, et qu'il peut être utile, dans l'hypothèse où l'ennemi serait prévenu, et où l'armée se porterait en avant, pour assurer les communications, servir de refuge aux partis, et qu'il rend solidement maître du pays.
«Ce château est situé sur une arête si étroite, qu'on ne le croit pas susceptible d'être fortifié pour être gardé.
«Il restera à savoir si les six cents hommes qu'on pourrait laisser dans ce fort pourraient s'y défendre trente ou quarante jours et attendre le retour de l'armée; ce serait une raison de plus pour y dépenser quelque argent, et on pourrait s'exposer à la perte de quelques cinq ou six cents hommes. Il est plus avantageux de le conserver que de le détruire; mais on ne doit le considérer que comme un simple fort qu'il faut améliorer; ce sont les bases d'après lesquelles il faut agir.
«Mêmes raisons au fort de Trieste; il est utile pour mettre la police contre les Anglais, maintenir une ville populeuse et commerçante, et assurer les communications si l'armée est en avant. On a développé, dans une note précédente, les raisons qui déterminaient à mettre en état le fort de Trieste; on attend des renseignements pour savoir si l'armée pourra le garder, dans le cas où elle repasserait l'Isonzo.
«À moins de dépenses considérables, il est douteux qu'on puisse fortifier ce château de manière à le mettre en état de se défendre quinze à vingt jours.
«Ainsi, un principe général pour les fortifications, l'artillerie et le ministre de la guerre, c'est qu'il ne doit y avoir aucun établissement sérieux sur la rive gauche de l'Isonzo, aucun arsenal, magasins de fusils ni d'artillerie; tout doit être à Palmanova, Venise, Mantoue, et, si on veut, à Osoppo et Zara.
«Il ne faut penser à établir aucune offensive sur le pendant des Alpes Juliennes, ni aucune défensive au delà de l'Isonzo.
«On doit être constamment en mesure d'évacuer en quatre jours de temps tout le pays au delà de l'Isonzo, et sur le pendant des Alpes Juliennes, partie sur la Dalmatie, partie sur l'Isonzo.
«On ne doit jamais penser que le commencement de la guerre doit se faire dans les provinces illyriennes.
«Tout ce qui est nécessaire à la garnison de Zara doit se retirer de ce côté: tout le reste sur l'Isonzo.
«Les avantages du pays illyrien sont très-considérables; mais, s'ils étaient mal saisis, ils deviendraient de grands inconvénients.
«Leurs avantages consistent: 1° à ce que l'armée de Dalmatie n'est plus séparée; qu'elle formerait l'avant-garde, et se trouverait sur la Save en avant de Laybach, tandis que les deux mille hommes destinés à la garnison de Zara seraient sur les derrières;
«2° Que, si l'armée française ne pouvait se réunir à temps, l'armée de Dalmatie formerait l'arrière-garde de l'armée et se retirerait sur l'Isonzo, où elle serait jointe par l'armée d'Italie.
«Ainsi, en 1809, seize mille hommes d'élite de l'armée de Dalmatie ne pouvaient rien; et, si l'armée d'Italie était battue, l'armée de Dalmatie l'eût été un peu plus tôt ou un peu plus tard.
«Si les choses eussent été en 1809 comme aujourd'hui, l'armée de Dalmatie eût été à la bataille de Sacile; cet avantage est immense.
«Le second avantage est que, la réunion de l'armée autrichienne étant près du Frioul, elle était en mesure d'y porter la guerre, le second jour de la déclaration de la guerre; aujourd'hui, ce ne peut être que le dixième. C'est un gain de huit jours, qui est très-considérable dans cette circonstance.
«Le troisième avantage, et qui n'est pas le moindre, est que, maîtres de tous les débouchés des Alpes, nous pouvons, pour la défensive, choisir les points qu'il nous importe de fortifier pour retarder de dix ou quinze jours la marche de l'armée ennemie, et que, pour l'offensive, nous sommes sûrs que l'ennemi n'aura pu rien fortifier.
«En résumé, les provinces illyriennes, considérées sous les points de vue de guerre, ne doivent être regardées que comme complétant la possession du Frioul. Si on les considérait autrement, on s'exposerait à de grands malheurs, et on pourrait donner lieu à des pertes de batailles qui pourraient compromettre l'Italie elle-même.
«Ainsi donc, envisageant, les choses sous ce point de vue, il convient de garder les châteaux de Laybach et de Trieste, de s'y fortifier chaque année, moyennant une petite dépense; d'y détruire tous les bâtiments et constructions qui pourraient le mettre dans le cas d'être pris par les obus.
«Si on a dépensé, dans quatre ou cinq ans, quelques centaines de mille francs dans les deux forts, ils peuvent rendre des services qui compensent l'argent qu'on y aura dépensé. Il est vrai aussi qu'ils pourront n'être d'aucune utilité.
«S'il est nécessaire de faire une dépense de quelques millions, ce serait dans une ou deux places qui intercepteraient la communication de la Carinthie dans le Frioul, et une bonne place sur l'Isonzo, en regardant le premier de ces objets comme beaucoup plus important que le second.
«Les provinces illyriennes peuvent aussi être considérées comme pouvant servir dans une guerre contre les Turcs; Carlstadt serait bientôt armée, et Dubicza pourrait servir à l'agression de la Bosnie.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU MINISTRE DES FINANCES.
«Septembre 1810.
«Monsieur le duc, ayant appris qu'il avait été rédigé à Paris un projet d'organisation des tribunaux pour les provinces illyriennes, dans lequel est comprise celle de la justice pour la Croatie militaire, détruisant tout le système qui y a été suivi jusqu'à ce jour, je me suis hâté d'écrire au ministre de la justice pour lui faire connaître la conséquence funeste que ce changement produirait, s'il avait lieu. J'ai l'honneur d'adresser à Votre Excellence copie de la lettre que je lui ai écrite à cet égard. J'y ai développé les motifs puissants qui s'opposent à toute innovation dans ces régiments. Le désir de conserver à Sa Majesté, dans toute son intégrité, et avec tous les avantages qu'elle offre pour son service, une portion aussi utile de la population de ces provinces, m'engage à présenter avec chaleur toutes les considérations qui exigent que l'institution, telle qu'elle est, des régiments croates subsiste sans qu'il y soit porté aucune atteinte. Les résultats heureux qu'on doit attendre de leurs services naissent de cette institution même, qui est, j'en suis convaincu, la seule qui puisse les faire obtenir. Ce que j'ai exprimé sur la justice s'applique mieux encore à l'administration, dont toutes les parties sont parfaitement coordonnées, et qui offre toute espèce de garantie pour la régularité, l'économie et la prospérité de ces régiments. J'ai lieu, tous les jours, de m'en convaincre dans l'inspection que je fais. On s'occupe d'arrêter la comptabilité, qui sera ensuite envoyée à l'intendant général, chargé, m'a-t-on dit, de rédiger un projet de décret sur l'administration de l'Illyrie.
«Je demande, avec les plus vives instances, à Votre Excellence qu'elle veuille bien faire valoir mes observations à ce sujet, et de mettre, autant qu'il dépendra d'elle, obstacle à l'introduction d'un nouveau mode d'administration pour les régiments, pour lesquels, faute de connaître sous tous les rapports leur véritable situation, on peut prendre des mesures préjudiciables aux intérêts de Sa Majesté.
Accoutumé, comme je le suis, à voir Votre Excellence accueillir avec bienveillance mes observations, qui ont pour but le bien public, je lui réitère, avec confiance, l'assurance que c'est ma conviction intime, ma conscience, et mon amour pour le service de l'Empereur, qui me font mettre tant de chaleur à la conservation du système, et que ce serait un malheur public que de voir détruire un aussi bel édifice, source, je crois, de la principale richesse que renferment les provinces illyriennes.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU MINISTRE DE LA GUERRE.
«Laybach, le 2 septembre 1810.
«Monsieur le duc, je reçois en ce moment une lettre qui m'apprend que Sa Majesté ayant daigné recevoir les officiers, députés illyriens, et croates, ils ont fait diverses demandes sur lesquelles je crois de mon devoir de donner, sans perte de temps, à Votre Excellence les renseignements convenables.
«Les officiers ont demandé, à ce que l'on m'assure, que le gouvernement français fournît l'habillement aux soldats en retenant les douze florins qui sont donnés aux familles pour cet objet, sauf à augmenter les impôts. Je puis vous assurer que, à moins que Sa Majesté ne donnât l'habillement aux Croates en leur remettant l'imposition qui le couvre aujourd'hui aux cinq sixièmes, ce qui, assurément, serait tout à leur avantage, rien ne serait plus malheureux qu'une pareille disposition, parce que les Croates ne sont pas en état de donner de l'argent, mais seulement des objets de leur industrie. À plus forte raison, rien ne serait plus malheureux qu'une augmentation d'impôt.
«L'annonce de nouveaux impôts est l'argument qu'emploient sans cesse les Autrichiens pour les inquiéter. Il n'en faudrait pas davantage pour changer l'opinion du peuple et faire émigrer une partie de la population.
«Je crois, d'ailleurs, avoir démontré cette proposition d'une manière complète dans le mémoire que j'ai eu l'honneur de vous adresser. Les officiers sont des ignorants qui sacrifient, sans s'en douter, les intérêts de l'Empereur et de leur pays à la gloriole d'avoir des soldats plus régulièrement habillés.
«Ils ont parlé d'officiers français et dalmates placés dans les régiments qui leur donnent de la jalousie.
«J'ai placé un chef de bataillon par régiment, et certes, eu égard à l'avancement qui a eu lieu, cette disposition a été extrêmement modérée. Il faudrait, pour donner aux Croates toute la valeur dont ils sont susceptibles, mettre un bon nombre d'officiers français pour les commander, et, dans le rapport de l'inspection que j'ai l'honneur d'adresser à Votre Excellence, je demande qu'il en soit placé un par compagnie, au moyen d'échanges convenables. Sous les Autrichiens, au moins la moitié des officiers employés dans ces corps étaient étrangers au pays, et le colonel Slivarich lui-même n'est pas né Croate, mais marié et établi en Croatie depuis qu'il est dans ces régiments. Les chefs de bataillon qui y ont été placés étaient indispensables pour y introduire l'esprit français et contribuer à y faire connaître le service français.
«Quant aux officiers dalmates, je conçois que les députés n'approuvent pas le motif de leur placement; mais il n'en est pas moins fondé. L'objet que je me suis proposé a été de placer près des colonels français, qui ne savent pas l'Illyrique, des jeunes gens sûrs, dévoués, intelligents, et qui, entendant la langue du pays, pourraient rendre compte de tout ce qui s'y passe. J'ai déjà eu lieu de me féliciter de cette mesure, et d'ailleurs, pour ne pas blesser les intérêts des Croates, j'ai ajouté à l'organisation les emplois que je leur ai donnés.
«Les officiers ont dit que l'Empereur avait l'intention d'envoyer un bataillon par régiment à Naples ou en France.
«Si telle est l'intention de l'Empereur, je vous supplie de lui représenter, au nom du bien de son service, que les troupes de cette espèce doivent combattre ou rester chez elles, et que les tenir en garnison fixe est aussi contraire à leur institution qu'à leur esprit et à leur existence, puisque ce sont les enfants de ces soldats qui recrutent le bataillon; que ces individus, mariés en grande partie, pénétrés de l'idée qu'ils doivent combattre et mourir pour l'Empereur, ne verraient, dans l'éloignement de leur pays, que la destruction de leur nation.
«Je ne rappellerai pas ici que ces troupes ne coûtent presque rien lorsqu'elles vivent chez elles, et qu'il faut les payer comme d'autres soldats lorsqu'elles en sortent. Mais je fais remarquer que, si c'est pour les rendre meilleures que ces troupes seraient retirées de chez elles, ce but serait beaucoup mieux rempli par trois mois de campement dans le pays que par un an de garnison éloignée. Rien ne contrarierait plus l'esprit de l'organisation de ces troupes et leur conservation.
«Si l'intention de Sa Majesté est de les envoyer en Espagne, je n'ai rien à répondre, puisque les soldats doivent faire la guerre, quelque part qu'on les envoie. Cependant il est nécessaire d'observer que, pour le début, ce serait une chose fâcheuse que de les employer dans une expédition que les Autrichiens, pendant dix-huit mois, leur ont peinte sous les couleurs les plus désavantageuses, et que le bon parti que Sa Majesté tirera des Croates pour son service à l'avenir dépendra beaucoup de la manière dont ils seront employés la première fois à la guerre.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU GRAND-JUGE.
«Carlstadt, le 3 septembre 1810.
«Je viens de recevoir la nouvelle que M. Paris, président de la cour de cassation, avait été chargé par Votre Excellence de rédiger et de faire connaître aux députés illyriens un projet d'organisation de la justice dans les provinces illyriennes. Ce projet, s'il était adopté, détruirait tout le système de la justice dans la Croatie militaire; et ce changement, comme tous ceux qui pourraient avoir lieu dans l'organisation de cette partie des provinces illyriennes, devant avoir les conséquences les plus graves, je ne perds pas un moment pour adresser à Votre Excellence les observations qui naissent de la nature même des choses.
«Le régime de la Croatie militaire est un chef-d'oeuvre dans toutes ses parties. Je ne saurais trop me répandre en éloges sur la force et la bonté des institutions qui la composent. C'est certainement une des plus belles choses que les modernes aient faites et qu'il serait fâcheux de voir détruire faute de la connaître. Toutes les parties en sont coordonnées. Guerre, administration, justice, etc., forment un tout que le moindre changement doit détruire. Tout a tendu à l'ordre dans ce système, parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles à l'établir dans une population mutine et difficile à conduire, parce que l'ordre était la base de toutes les autres institutions. En conséquence, c'est l'autorité militaire qui a d'abord été nécessaire, et elle a dû continuer à régir ce peuple, parce qu'étant pauvre et ne pouvant donner d'argent le meilleur parti qu'on pouvait en tirer était d'en obtenir le plus grand nombre de soldats possible, et que, pour cela, il fallait inspirer au plus haut degré, à toute la population, l'esprit militaire. Cette population a donc dû être réorganisée pour la faire marcher d'une manière régulière, et, en cela on aura préparé sa prospérité; car des barbares, sans organisation, ne feront que difficilement des progrès dans la civilisation. L'exemple qu'offrent les Morlaques, Dalmates, comparés aux Croates leurs voisins, qui, par suite de leur organisation, sont devenus bien supérieurs à eux, confirment ce précepte. Enfin on a voulu tirer le plus grand parti possible de ce peuple pour le service de l'État, et les effets obtenus sont ici au-dessus de tous les calculs et de toute comparaison.
«Il a fallu et il faut, pour soutenir un pareil système, concentrer les pouvoirs. Élever plusieurs autorités parmi ce peuple serait le principe de l'anarchie, parce que son intelligence ne va pas jusqu'à concevoir leurs rapports: obéir et commander, voilà la sphère de sa conception. Mais, si les pouvoirs ont été concentrés, si tout a été soumis aux formes militaires, que de précautions n'a-t-on pas prises pour empêcher les abus de pouvoir! quelles mesures paternelles l'organisation n'a-t-elle pas consacrées! Aussi, combien sont beaux les résultats, puisque les Croates, qui sont tous voués au service, qui appartiennent sans réserve et se dévouent à l'État, sont heureux, bénissent leur organisation, à un tel point qu'ils abandonneraient leurs foyers s'ils se croyaient menacés d'en changer, certains de retrouver en Autriche l'existence qui leur serait refusée par un nouvel ordre de choses.
«Je vais entrer dans quelques détails pour les tribunaux, et je vais vous faire connaître comment se rend la justice. Votre Excellence verra s'il peut y avoir des motifs pour changer de mode, et s'il n'en est pas mille autres pour conserver celui qui existe.
«Les Croates étant très-pauvres, leurs discussions d'intérêt sont de peu de valeur; en conséquence, on a cherché à leur épargner les frais, et on a placé la justice près d'eux. La population est répandue sur une assez grande surface de pays; il a donc fallu multiplier les tribunaux, ou en établir un par compagnie, c'est-à-dire soixante-douze pour les six régiments. Mais quel caractère a ce tribunal? C'est un tribunal de famille, un tribunal paternel; c'est enfin un tribunal de conciliation plutôt que de justice. Le capitaine de chaque compagnie, un lieutenant de l'économie, deux sous-officiers nommés à tour de rôle, deux soldats également choisis à des époques déterminées, forment ce qu'on appelle une session, qui s'assemble une fois la semaine. Les Croates de la compagnie viennent y discuter leurs intérêts, et rarement retournent-ils chez eux sans être tous contents. Mais, si l'une des parties en appelle, l'affaire est portée devant le tribunal du régiment. Ici le mode change: on doit supposer que, puisque l'affaire n'a pas été résolue d'une manière satisfaisante pour tous, qu'elle est obscure; et alors c'est un homme de loi, homme gradué, qu'on nomme auditeur, qui juge.--Vingt officiers nommés à tour de rôle sont témoins et signent le procès-verbal, qui contient les exposés; mais l'auditeur seul juge. Cet auditeur, quoique homme de loi, porte l'habit et le titre d'un grade militaire; mais on ne l'en a revêtu que parce que ce titre et cet habit sont seuls respectés des Croates. En France, on a donné la robe aux juges parce qu'on a pensé qu'elle imposait aux yeux; ici, elle produirait un effet tout contraire.
«J'ai remarqué que le tribunal de compagnies ou de conciliation terminait beaucoup d'affaires. Il y en a peu à soumettre à l'auditeur, et il les termine presque toutes. Cependant s'il arrive que, par exception, l'affaire soit ou assez obscure ou assez importante pour avoir besoin d'un troisième jugement, c'est ici où je pense qu'on doit rentrer dans l'ordre commun, et qu'il convient de porter l'affaire à un tribunal tout civil; mais, encore une fois, comme les Croates sont pauvres, il faut qu'il soit le plus près d'eux possible. Il faut l'établir à Carlstadt, où leurs affaires journalières, leurs habitudes, les conduisent; le composer seulement de quatre ou cinq juges, si on n'aime mieux, par économie, donner au tribunal de première instance de Carlstadt les attributions de l'appel pour la Croatie militaire.
«Cette justice, rendue sans frais, car les Croates doivent faire eux-mêmes l'exposé de leurs affaires, placée près des familles, garantie par toutes les formes qui assurent la pureté des juges; cette justice, dis-je, qui doit habituellement prononcer sur des affaires de cinq, dix ou quinze florins, n'est-elle pas conforme à la nature et à la situation du pays? n'est-elle pas économique pour l'État, et peut-on raisonnablement lui substituer une justice éloignée de dix à vingt-cinq lieues, et qui, en coûtant de grands frais de déplacement aux Croates pauvres, leur occasionne plus de dépenses encore en les mettant à la disposition des gens de loi.
«Voici maintenant comment se rend la justice criminelle. Les jugements de police correctionnelle se rendent dans les compagnies par la session, ainsi qu'il a été dit plus haut, présidée par le capitaine. La justice criminelle se rend par un conseil de guerre, présidé par le major et composé des officiers supérieurs et d'un nombre déterminé de capitaines, lieutenants, sous-officiers et soldats. L'instruction de la procédure est faite par le premier auditeur du régiment, qui, comme je l'ai dit, est un homme de loi. Dans certains cas, où les délits pour lesquels les lois portent la peine de mort, comme pour ceux portant atteinte à la sûreté publique, la révolte, la désertion en masse, etc., la sentence, approuvée par le colonel, est exécutée immédiatement. Dans tous les autres, elle doit être revisée au tribunal d'appel des régiments. Chez les Autrichiens, ce tribunal est composé d'auditeurs, c'est-à-dire des gens de loi ayant des grades militaires. Je propose de faire reviser, dans les cas ordinaires, le jugement par le tribunal d'appel du régiment, que je suppose composé de juges civils, mais auxquels il faudrait adjoindre un nombre déterminé d'officiers.
«Donner au tribunal civil la police correctionnelle et la justice criminelle; dans tous les cas, ôter l'une et l'autre aux chefs militaires, c'est détruire les régiments croates, car c'est ôter une grande partie de leur puissance aux officiers. Il n'y aurait plus ni discipline ni obéissance; il n'y aurait plus que désordre et confusion.
«Je pourrais facilement m'étendre sur cet article-là; mais Votre Excellence a déjà saisi toutes les conséquences qui seraient la suite d'un changement de système.
«En résultat, toutes les erreurs dans lesquelles on est tombé à ce sujet viennent de ce qu'on ignore ce que c'est que la Croatie militaire. Je ne m'en étonne pas; je n'avais pu le savoir précisément pendant mon séjour en Dalmatie, quoique je le désirasse beaucoup, et je ne connais parfaitement son régime que depuis peu de mois.
«La Croatie ne doit pas être considérée comme une province, mais comme un camp, et sa population comme une armée qui a avec elle son moyen de recrutement, des femmes, des enfants, et des invalides, qui sont les vieillards. C'est une horde de Tartares, qui, au lieu de vivre sous des tentes, vit dans des cabanes, et qui, au lieu d'exister uniquement de ses bestiaux, vit du produit de ses champs et de ses bestiaux; mais c'est une horde organisée, disciplinée, heureuse et marchant rapidement vers la civilisation; (car les lois de la discipline militaire ne sont pas moins employées par les chefs pour établir l'ordre que pour diriger la culture des terres et l'économie des troupeaux); et qui, en même temps, fournit à l'Empereur, moyennant un secours de un million cinq cent mille francs, une armée, belle, brave, instruite, habillée, et toujours prête à marcher, de seize mille hommes, sans en compter huit mille de réserve, c'est-à-dire autant, et avec douze millions de francs d'économie, que donnerait une puissance de deux à trois millions d'âmes. Cette organisation, je le répète, est enfin un chef-d'oeuvre, puisqu'elle résout le problème difficile de donner, en améliorant chaque jour le sort des habitants et en les rendant heureux, dix fois plus que tous les autres peuples pour le service de son souverain.
«Je ne tarirais pas si je voulais entrer dans tous les détails de ce qu'a de bon et d'utile l'organisation des régiments croates; mais je terminerai cette lettre, peut-être déjà trop longue, en déclarant que le peuple croate est déjà, au delà de mes espérances, dévoué à Sa Majesté, et que je prends l'engagement, en conservant son organisation actuelle, de le faire combattre pour son service tant qu'elle le voudra, avec fidélité; d'en faire, en peu de temps, les troupes meilleures que les meilleures troupes allemandes; tandis qu'au contraire il me paraît évident qu'en détruisant une partie de son organisation on compromettra l'autre, et qu'on risque de voir ce peuple changer d'esprit. Alors une portion émigrerait, et il faudrait combattre l'autre à la première apparence de guerre au lieu d'en tirer des secours.
«Telles sont, monsieur le duc, les observations que ma conscience et mon amour pour les intérêts de Sa Majesté m'ont dictées. Je vous demande avec instance de les prendre en considération; je crois pouvoir vous assurer qu'elles en méritent la peine.
«Je vous fais également la prière de me faire connaître les points qui présentent des difficultés. Je crois pouvoir les résoudre toutes. Si les officiers croates n'ont rien dit au changement proposé, l'explication s'en trouve dans leur ignorance de la langue française et leur timidité, car les vérités que je viens d'établir et leurs conséquences n'ont pas dû échapper à ceux d'entre eux qui y ont le moins réfléchi.
«P. S. Les Croates ont tellement horreur d'un changement d'organisation, que le seul moyen que les Autrichiens aient employé avec quelque succès pour les agiter a été de publier qu'on allait changer leur régime. Cette opinion, qui s'était répandue un instant, a fait émigrer plus de cent familles; et le plus léger changement donnerait à ces bruits beaucoup de crédit, tandis que je n'ai négligé aucun moyen pour les détruire.»
LE MARÉCHAL MARMONT À NAPOLÉON.
«Ogucin, le 9 septembre 1810
«Sire, je viens de recevoir une lettre du ministre de la guerre, qui m'annonce les dispositions bienveillantes que Votre Majesté a daigné prendre à mon égard; permettez-moi de mettre à vos pieds, Sire, l'hommage de ma reconnaissance.
«L'augmentation de traitement que Votre Majesté a bien voulu m'accorder n'ajoutera ni à mon zèle pour son service ni à mon amour pour mes devoirs, car mon dévouement et mon zèle sont sans bornes; mais il me facilitera les moyens de les remplir.
«Je suis occupé à faire en détail l'inspection de la Croatie militaire; j'ai lieu d'être satisfait de l'esprit qui règne parmi ce peuple soldat, qui apprécie, comme il le doit, le bonheur de vous appartenir. Je crois pouvoir assurer Votre Majesté que, si elle daigne continuer à ce peuple son organisation complète, où tout a été prévu et calculé de la manière la plus admirable, et qui est un chef-d'oeuvre sous quelque rapport qu'on l'envisage, soit pour votre service, soit pour la tranquillité du pays, soit pour le bien-être de cette population et les progrès de la civilisation, j'en formerai en peu de temps une armée digne de Votre Majesté, et qui combattra avec honneur et gloire dans les rangs de l'armée française.
«L'esprit militaire de ce peuple est tellement établi, et tellement maintenu par son organisation, que les bataillons de campagne, quoique toujours dispersés dans les familles, sont comparables, et par leur instruction, et pour leur caractère belliqueux, et pour tout ce qui distingue les bons soldats, aux plus belles et aux meilleures troupes de ligne.
«Votre Majesté ne doit pas considérer la Croatie militaire comme une province, mais comme un camp, et sa population comme une armée qui la servira fidèlement, et sera toujours prête à donner jusqu'à son dernier homme pour elle.»
LE MARÉCHAL MARMONT À NAPOLÉON.
«Laybach, le 15 octobre 1810.
«Sire, je reçois la lettre que Votre Majesté m'a fait l'honneur de m'écrire le 6 octobre, relative aux bâtiments ottomans. Je supplie Votre Majesté de me permettre de l'assurer de la manière la plus solennelle que ce n'est point par ma propre volonté que ces bâtiments ont été relâchés. M. d'Auchy m'a prévenu verbalement qu'il donnait l'ordre de les relâcher sous caution, motivé sur ce que la valeur de ces bâtiments se trouvait, par la Turquie, entre ses mains, et que le Trésor public y gagnerait la dépense de l'entretien des équipages, et je n'y ai pas mis obstacle.
«J'ai eu sans doute grand tort d'y consentir, puisque Votre Majesté me blâme; mais je n'ai pas eu celui de le vouloir ni de l'ordonner. M. d'Auchy n'a pas un mot de moi qui puisse me faire partager sa responsabilité sur cette affaire, tandis que les ordres donnés au directeur central des douanes sont de lui, et en son nom. Votre Majesté pourra s'en assurer par la copie de sa lettre, qui est ci-jointe.
«Si Votre Majesté daigne réfléchir à la nature des relations qui existaient entre M. d'Auchy et moi, elle sera bien convaincue que, si pareille disposition avait été prise contre son avis, il aurait exigé de moi une lettre que je n'aurais pu lui refuser. Je puis assurer à Votre Majesté que personne au monde n'est plus esclave de ses ordres que moi: de près comme de loin, ils me sont également sacrés.
«Si je n'avais pas cru, dans cette circonstance, que c'était en suivre l'esprit que de se borner à conserver la valeur des bâtiments, je me serais bien gardé de tolérer cette disposition. Les connaissements de ces bâtiments n'ont pas encore été envoyés à Paris; la cause en est dans la lenteur du directeur central des douanes, qui a différé jusqu'à présent à les faire partir. Je les reçois en ce moment, et je les envoie par estafette au ministre des finances.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU MINISTRE DE LA GUERRE
«Laybach, le 20 octobre 1810.
«Monsieur le duc, j'ai l'honneur d'adresser à Votre Excellence le mémoire sur la Croatie militaire que je lui ai annoncé.
«J'ai cherché à faire connaître, le plus succinctement possible, une institution qui n'a d'analogue nulle part, et qui mérite d'être observée avec soin pour être bien jugée et appréciée comme elle le mérite. Le général Andréossy a fait donner l'ordre, par les officiers croates qui sont à Paris, de suspendre tous les remplacements d'habillements, motivé sur ce qu'il s'occupait de leur donner une nouvelle organisation, d'autres uniformes, etc.
«Cette nouvelle, qui est précisément conforme aux moyens qu'emploient sans cesse les Autrichiens pour inquiéter les Croates, a produit le plus mauvais effet.
«J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le détruire. Tout ici se touche, et rien n'est indifférent, parce que tout fait système. Le général Andréossy ne se doute probablement pas qu'une simple question d'uniforme, qui, partout ailleurs, ne signifie rien, est ici fort importante, attendu que c'est une question d'impôt, puisque ce sont les familles qui habillent les soldats, et que, si l'uniforme était déterminé de manière à ce que les familles ne pussent plus les fabriquer elles-mêmes et qu'elles fussent obligées de l'acheter, cette seule disposition ferait une révolution qui causerait l'émigration d'un très-grand nombre d'entre elles qui seraient dans l'impossibilité de faire ce qui leur aurait été demandé.
«Le projet d'organisation générale des provinces illyriennes, que M. l'intendant général, M. le conseiller général de justice, et moi avons unanimement arrêté, sera rédigé dans peu de jours.
«J'ai pensé qu'il était utile, pour pouvoir répondre aux diverses objections qui pourraient être faites à Paris, de vous l'envoyer par quelqu'un qui ait assisté à la discussion, et qui, par son bon esprit et ses lumières, ait pu juger de la valeur des différents motifs qui l'ont déterminé.
«J'ai fait choix de M. Heim, secrétaire général du gouvernement, et avec d'autant plus de plaisir, que ce choix sera agréable à Votre Excellence.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU MINISTRE DE LA GUERRE.
«Laybach, le 28 octobre 1810.
«Monsieur le duc, je reçois la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire le 19 octobre, et qui est relative aux projets de levée de troupes dans les provinces illyriennes pour le service de Sa Majesté.
«Voici quelles étaient les forces que l'empereur d'Autriche en tirait:
«Le régiment de Reiski, de trois bataillons, était formé du territoire de Gouzin, du cercle d'Adelsberg et de l'Istrie autrichienne.
«Le régiment de Schimchan, de trois bataillons, était formé des deux autres cercles de la Carniole.
«Le régiment de Hohenlohe était formé de la Carinthie.
«La Croatie, suivant les différents ordres du gouvernement de Hongrie, fournissait des recrues à divers régiments hongrois qu'on peut évaluer à un bataillon.
«La moitié de la Carinthie étant restée à l'empereur d'Autriche, on peut estimer ce que recrutait le cercle de Villach à un bataillon et demi.
«Ainsi le gouvernement autrichien tirait de ces différents pays huit bataillons et demi.
«Voici comment je pense que la division pourrait être faite pour recruter trois régiments:
«Un régiment dans la haute Carniole et le cercle de Villach;
«Un autre régiment dans la Carniole inférieure, ou cercle d'Adelsberg; Gorizia et Trieste, l'Istrie autrichienne et vénitienne, en remplacement de la partie du cercle de Gorizia, qui est au royaume d'Italie;
«Le troisième régiment dans la Basse-Carniole et la Croatie civile.
«Par ce moyen, les Carinthiens, qui passent pour de mauvais soldats, seraient fondus parmi les soldats des autres provinces, qui en donnent de meilleurs. Il semblerait que la Dalmatie, qui doit fournir une grande quantité de matelots, et qui a à peine deux cent cinquante mille habitants, aurait suffisamment du recrutement du régiment dalmate, qui est en Italie et se trouve toujours au complet. Quant à Raguse et à Cattaro, ces deux pays doivent être consacrés presque en entier à la marine, et il faut compter pour peu les soldats qu'on doit en tirer.
«Mais, si l'Empereur voulait augmenter davantage ses forces, je pense que le meilleur parti serait d'organiser deux régiments frontières dans les montagnes de la Dalmatie; de conserver tout le littoral, Raguse et Cattaro, le littoral hongrois, Fiume et les îles, les marins déduits, au recrutement de la légion dalmate. Par ce moyen, l'Empereur aurait le plus grand nombre de troupes possible, sans surcharger la population, et l'intérieur de la Dalmatie parviendrait à se discipliner et à s'améliorer. L'organisation de Pandours qui y existe a été faite dans cet esprit et comme travail préparatoire, attendu que Sa Majesté m'avait paru être, il y a un an, dans l'intention d'adopter ce système.
«Quant aux officiers, on en trouve beaucoup et de fort bons. Ce pays est rempli d'officiers qui ont quitté le service d'Autriche, qui ne cessent de me demander de l'emploi, et beaucoup d'autres, au service de l'Autriche encore, m'ont écrit ou fait dire qu'ils abandonneraient l'armée autrichienne aussitôt qu'ils pourraient avoir la certitude d'entrer au service de l'Empereur. Pour hâter leur retour, il serait cependant utile d'établir un mode de rappel, soit par un décret de Sa Majesté, soit par une publication.
«Il y avait ici quelques soldats licenciés de l'Autriche sans moyens d'existence; j'en ai formé une compagnie de réserve, par enrôlement volontaire; je l'ai envoyée à Trieste pour former la garnison de la flottille. Cette compagnie est aujourd'hui de quatre-vingts hommes.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU MINISTRE DE LA GUERRE.
«Laybach, le 3 novembre 1810.
«Monsieur le duc, je reçois seulement aujourd'hui 3 novembre la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire le 11 octobre, et qui est relative à différents renseignements que demande Sa Majesté sur les régiments croates.--Je ne perds pas un instant pour y répondre.
«Il n'y a eu aucun changement dans l'organisation des régiments croates. Je me suis contenté d'étudier les règlements autrichiens, de les remettre en vigueur et de suppléer aux lacunes qu'avait laissées la séparation de l'Autriche. Mieux j'ai connu l'organisation de ces troupes, et plus j'ai été convaincu qu'il fallait être extrêmement réservé et ne faire aucun changement. Je vais entrer dans les détails que désire Votre Excellence.
«À l'époque de la prise de possession de la Croatie, les Autrichiens ont fait ce qui était en leur pouvoir pour y jeter la confusion. Les registres ont été détruits ou emportés; les principaux officiers d'économie, qui avaient l'ensemble de l'administration, ont passé la Save, ainsi que les colonels et lieutenants-colonels; de manière que tous les documents qui pouvaient nous éclairer nous ont manqué pendant longtemps. D'un autre côté, les règlements de l'organisation des Croates, qui datent de très-loin, qui ont été modifiés en 1754, sont très-volumineux; nulle part nous ne les avons trouvés rassemblés; et ce n'est qu'avec beaucoup de peine que nous avons pu nous en procurer la plus grande partie. Enfin le siége du commandement et de l'administration centrale de ces régiments était à Agram. Ainsi tous les documents que renfermait ce dépôt se sont trouvés perdus pour nous. Il a donc fallu marcher avec beaucoup de circonspection et étudier tous les détails de ces régiments avant d'oser donner aucun ordre.
«Des colonels français ont été placés à la tête de ces régiments, et parce que les Croates manquaient d'officiers supérieurs, et parce qu'il était convenable de leur donner des chefs sûrs et les accoutumer à nous obéir. Slivarich, qui était major-commandant de bataillon, a cependant été placé comme colonel, afin de faire connaître aux officiers croates qu'ils pouvaient parvenir à ce grade; et, pour récompenser l'ardeur et le zèle qu'il montrait, tous les lieutenants-colonels ont été choisis parmi les Croates, afin d'aider les colonels de leur expérience et de leurs connaissances locales, à l'exception de celui du régiment que commande le colonel Slivarich, qui a été choisi parmi les Français.
«De deux chefs de bataillon qui existent dans chaque régiment, un a été choisi parmi les Français, l'autre parmi les Croates.
«Malgré tous ces soins, j'ai eu bientôt lieu de m'apercevoir que les régiments étaient menés d'une manière arbitraire et sans uniformité. Comme il n'y avait qu'un contrôle et une surveillance éclairée qui pussent y suppléer, je me suis hâté d'y remédier en établissant l'un et l'autre.
«Sous les Autrichiens, tous les régiments croates étaient sous la surveillance d'un commissaire des guerres par brigade; d'un commandant en chef résidant à Agram, remplissant les fonctions d'ordonnateur et d'inspecteur aux revues; du général commandant en Croatie, ayant la haute main sur l'administration, et qui correspondait avec la direction des frontières, à Vienne.
«Il m'a paru indispensable d'établir quelque chose d'analogue: mais, comme nous étions ignorants sur tout; qu'à chaque instant des questions nouvelles se présentaient; que nous n'avions pu encore nous procurer toutes les lois, et que, faute de les connaître, les dispositions les plus sages restaient sans exécution, j'ai pensé qu'un commissaire seul ne suffirait pas pour établir l'ordre et l'ensemble dans toutes les parties du service, et qu'il était nécessaire de former une direction, composée d'un officier supérieur qui eût toujours servi dans les Croates, et qui fût connu pour sa capacité; d'un ancien commissaire des guerres employé dans ces régiments, connaissant bien les règles de l'administration; enfin d'un auditeur connaissant bien les lois et l'administration de la justice dans ces régiments, et ayant servi longtemps comme auditeur, c'est-à-dire comme juge.
«J'ai chargé cette direction de remettre en vigueur toutes les lois et règlements sur l'administration, la justice, la police, etc., etc.; d'entrer en correspondance avec tous les régiments, de leur demander tous les comptes, et de faire son rapport habituel au général commandant la Croatie, auquel j'ai donné pouvoir de résoudre les affaires courantes, et que j'ai chargé de me rendre compte de toutes celles de quelque importance.
«J'ai cru utile de consacrer, par un arrêt, toutes les attributions de la direction en rapport avec les différentes branches de l'administration, qui, quoique ayant connexion avec les régiments, se rattachent à l'organisation générale de l'Illyrie; enfin, le mode de surveillance supérieure et d'inspection de ces régiments s'y rattachant aussi.
«J'ai rencontré des hommes fort capables dans les trois individus qui composent la direction, et qui, en peu de mois, ont rempli le but que je m'étais proposé, et rétabli l'ordre le plus régulier.
«J'ai nommé, indépendamment de cela, comme il y en avait autrefois, trois commissaires, que j'ai choisis parmi les officiers renommés par leurs connaissances en administration; j'en ai attaché un à chaque brigade ou deux régiments. Ils sont chargés, ainsi que l'étaient leurs prédécesseurs, de viser toutes les pièces de comptabilité, suivre dans tous ses détails l'administration des régiments, et d'arrêter cette comptabilité provisoirement à la fin de chaque trimestre.
«J'ai établi dans chaque régiment un conseil d'administration responsable, qui n'existait pas autrefois, afin d'avoir plus de garantie pour l'administration, et de me rapprocher le plus possible de ce qui se fait dans l'armée française.
«Toutes ces mesures sont consacrées dans l'arrêté du 2 juin, que j'ai l'honneur de joindre à cette lettre, et qui a établi, pour toutes les parties du service, une marche régulière. Cet arrêté ordonne aussi une inspection dont j'ai cru utile de me charger cette année.
«J'ai conservé intact le système de l'administration et de l'organisation de ces régiments. Je me suis occupé de réunir, rappeler toutes les lois anciennes, et d'en faire suivre scrupuleusement l'exécution.
«Il serait utile de faire une refonte générale de ces lois, afin d'avoir, dans un cadre rétréci, des règles pour tout. Mais c'est un travail de longue haleine.
«Les seuls et légers changements que j'ai cru utile d'opérer sont ceux-ci: J'ai placé près des colonels un adjudant-major choisi parmi les Dalmates qui appartiennent aux familles les plus dévouées à l'Empereur, afin qu'ils puissent savoir, par ceux qui connaissent la langue, tout ce qui se dit et se fait intéressant le bien du service. Mais, afin de ne pas blesser les officiers croates dans leurs prétentions et leurs intérêts, j'ai ajouté les emplois que j'ai donnés à l'ancienne organisation.
«Des officiers commandant des bataillons avaient le titre de major. Je leur ai donné celui de chef de bataillon. Les lieutenants-colonels étaient précisément ce que sont nos majors français; ils ont pris le titre de colonels-majors. Enfin, tous les officiers ont pris les insignes des officiers français.
«J'ai réduit à six les capitaines de première classe; j'ai supprimé six chirurgiens par régiment; j'ai augmenté la solde des chefs de bataillon et des chirurgiens.
«Enfin, n'ayant point de tribunal de révision, j'ai institué, en attendant l'établissement du tribunal ordinaire, un conseil de révision composé partie d'officiers français, partie d'officiers croates, pour les affaires criminelles.
«Telles sont les seules et uniques modifications que j'ai apportées aux régiments croates. Ainsi Votre Excellence pourra se convaincre, d'après les détails ci-dessus, qu'ils se régissent, s'administrent selon leurs anciennes lois, et que tout ce que j'ai ordonné n'a tendu qu'à remettre ces lois en vigueur, pour remplir les lacunes laissées par la séparation de l'Autriche, et établir une surveillance, un mode de reddition de comptes qui assurait l'ordre public, la conservation des intérêts de Sa Majesté comme aussi celle de ses sujets.
«Mon intention était de retarder l'envoi du rapport d'inspection jusqu'au moment où tous les états qui devaient l'accompagner auraient été terminés; mais, ce travail demandant encore quelques jours, et ce rapport devant compléter les documents que Votre Excellence désire sur ces régiments, je vous l'envoie séparément, et j'aurai l'honneur de vous adresser tous les états qu'il indique.
«Quant à la question du service, il y aurait inconvénient à faire sortir du pays, aujourd'hui, un bataillon par régiment pour se rendre en France.
«Je crois y avoir répondu hier dans la lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire. Je suis convaincu que cette mesure serait aussi funeste au pays que contraire au bon esprit des Croates, et par conséquent au service de Sa Majesté, de les tirer de chez eux pour leur faire tenir garnison. L'esprit de leur institution est de les faire tenir chez eux en temps de paix, et de n'en sortir que pour faire la guerre, parce que le plus grand nombre est marié et que leurs bras sont nécessaires à la culture des terres, et qu'enfin ils forment la partie vigoureuse de la population. Ils partiraient demain sans regret pour aller au fond de la Pologne faire la guerre aux Russes, s'ils en recevaient l'ordre, parce que la guerre est leur métier; mais ils se regarderaient comme perdus s'ils pouvaient avoir un moment l'inquiétude de passer leur vie dans des garnisons fixes, parce qu'ils y verraient la destruction certaine et infaillible de leurs familles; et, dès lors, l'opinion du peuple entier serait changée.
«Pour ce qui est relatif aux sommes qui seraient nécessaires pour les faire entrer en campagne, voici ce que les règlements ont consacré:
«Du jour où ils sont réunis, ils doivent avoir la solde de l'année et recevoir un habillement et un équipement complet des magasins du gouvernement.
«Si le gouvernement préfère le lui acheter au prix de celui qu'il porte, et qui est une propriété de la famille; mais, dans ce cas, il faudrait encore les fournir en nature de sacs à peau, dont ils manquent en général; on ne peut guère estimer le tout à moins de cent francs par homme, y compris trois paires de souliers dont il faudrait leur faire l'avance.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU MINISTRE DE LA GUERRE.
«Laybach, le 10 novembre 1810.
«Monsieur le duc, j'ai reçu la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire le 31 octobre, qui demande de nouveaux renseignements sur les jeunes Croates envoyés en France. Je ne perds pas un instant pour y répondre; vous les trouverez ci-joints aux listes de cent quarante-sept jeunes gens, dont cent quarante-cinq partis.
«Les cinquante-trois autres jeunes gens se composent de tous ceux qui étaient entretenus dans les lycées autrichiens aux frais de l'empereur d'Autriche, et qui ne sont pas encore arrivés. Les parents ont écrit à plusieurs reprises pour les obtenir, mais on n'y a fait aucune réponse.
«J'ai écrit à l'ambassadeur de France pour le prier de réclamer ces jeunes gens; aussitôt que j'aurai sa réponse, les mesures seront prises pour les réunir et les acheminer sur la France.
«Votre Excellence me demande des renseignements sur les grandes professions et fortunes des pères des enfants: une colonne de l'état satisfait à la première question; quant à la fortune, ils sont tous presque également pauvres dans la Croatie militaire. En ce pays, il n'existe pas de classe qui ressemble ni à la noblesse ni à la bourgeoisie des autres pays: il n'y a que des paysans et des soldats, des officiers et des sous-officiers, en retraite ou en activité; les dernière, avec leurs appointements faibles, ont besoin de beaucoup d'économie pour vivre; les autres, sans leurs pensions, ne sauraient comment exister, parce que presque tous les officiers sortent de la classe des soldats. Les sous-officiers subsistent avec leur modique paye, plus la part qu'ils ont dans leur famille.
«J'ai fait le choix de la manière suivante: j'ai pris d'abord la totalité des jeunes gens qui étaient en Autriche entretenus par l'empereur; ensuite la totalité des fils d'officiers de neuf à quinze ans.--J'ai complété le nombre par des enfants du même âge appartenant à des sous-officiers qui jouissaient de la meilleure réputation dans leur régiment.
«Le nombre que l'Empereur a fixé est très-considérable; j'ai pensé qu'il était utile d'y faire concourir les jeunes gens des familles de la Croatie civile et du littoral hongrois, qui, par leur voisinage, ont jusqu'à un certain point de l'influence sur l'opinion des Croates. Les premières, choisies parmi celles qui jouissent de plus de considération et qui remplissent les emplois les plus respectés, qui sont de juges, de comitat et de cercle; en général, ces familles-là ont quelque aisance. Ceux du littoral appartiennent à des familles les plus recommandables qui ne sont pas riches et dont l'opinion passe pour être favorable aux Français.
«Votre Excellence verra, d'après les développements ci-dessus, qu'il est impossible d'espérer que les familles fournissent un trousseau de trois cent cinquante francs, tel que le porte votre lettre du 10 octobre; à l'exception peut-être pour des enfants de la Croatie civile, demander cette somme serait détruire les effets précieux que l'acte de bienfaisance et de générosité de l'Empereur a produits sur les esprits; l'exiger serait superflu, par l'impossibilité où se trouverait le plus grand nombre d'y satisfaire.»
LE MARÉCHAL MARMONT AU MINISTRE DE LA GUERRE.
«Laybach, le 17 décembre 1810.
«Monsieur le duc, le général Lauriston m'a communiqué, conformément aux ordres de Sa Majesté, les projets d'organisation des mines d'Idria, afin que je puisse faire les observations dont je les croirais susceptibles; je ne peux que me réunir à lui pour faire, en général, l'éloge de l'organisation faite par les Autrichiens, et que je crois parfaitement bien entendue. Mais je crois de mon devoir de représenter l'inutilité et les inconvénients qui résulteraient de l'exemption d'impôt qu'il propose.
«Une exemption d'impôt ne pourrait avoir ici d'autre objet que d'accroître les revenus de l'ordre des Trois-Toisons; mais, si telle était l'intention de Sa Majesté, il serait préférable de l'enrichir d'une tout autre manière que d'adopter un système d'exception et de privilége, qui enfanterait toute sorte d'abus.
«Les mines d'Idria jouissaient, il est vrai, de diverses exemptions sous les Autrichiens; mais cette disposition n'était nullement motivée, car les autres mines de la Carniole et de la Carinthie sont imposées sans inconvénients pour leur prospérité. La mine d'Idria appartient à l'ordre des Trois-Toisons, et je ne concevrais pas pourquoi cet ordre, qui doit être considéré comme un particulier, jouirait d'un privilége dont le bon ordre de l'administration a privé les autres mines de ces provinces.
«Mais ce n'est pas seulement la mine d'Idria que l'on voudrait exempter: c'est la seigneurie d'Idria, le domaine d'Idria, les habitants d'Idria, enfin jusqu'au commerce de cette mine. Or j'avoue que je ne puis le concevoir! Si, par la raison que la forêt d'Idria sert aux travaux de la mine, on ne doit pas l'imposer, il faut aussi exempter de l'impôt foncier les terres qui produisent le blé destiné aux habitants, les manufactures qui produisent le drap qui habille les ouvriers, car les mêmes raisonnements y sont applicables: il faudrait exempter les prairies qui fournissent le foin qui nourrit les animaux destinés au transport du mercure; enfin, par de semblables raisonnements, on tombe dans l'absurde. Mais ce n'est pas tout: on a été jusqu'à demander l'exemption des droits de péage sur les routes d'Illyrie, tant pour les objets sortant d'Idria que pour ceux qui y entrent. Ces transports dégradent les routes, et les droits de barrières ne sont établis que pour subvenir aux frais de leurs réparations.
«Le système qui a été adopté à Idria, et qui a déterminé l'administration à fournir aux mineurs tous les objets de première nécessité à bas prix, a pour but d'empêcher le prix de la main-d'oeuvre de s'élever, première cause de la prospérité de toute manufacture.
«Je crois donc qu'il est extrêmement précieux de conserver ce système. Mais, s'il y a des pertes à éprouver, c'est à l'administration des mines à les supporter, et le gouvernement ne doit jamais perdre ses droits. Ainsi, par exemple, l'impôt personnel qui pourrait être dû par des individus employés à la mine doit être supporté par l'administration des mines, afin que les prétentions de ces individus ne s'élèvent pas envers elle dans une proportion supérieure à l'impôt, ce qui ne manquerait pas d'arriver s'ils payaient directement. Mais les individus qui appartiennent à la seigneurie d'Idria, et qui ne sont rien à la mine, ne doivent, par aucune espèce de raison, être soumis à un régime particulier.
«Quant aux droits de vente de vin, qui peuvent être considérés comme un octroi, je ne vois aucune espèce d'inconvénient à l'abandonner à l'administration des mines, puisqu'elle se charge des dépenses communales, des écoles, de l'hôpital, etc., et qu'il convient qu'elle ait toutes ces attributions, afin d'avoir l'autorité qui lui est nécessaire. Il convient aussi qu'elle ait la police municipale de l'arrondissement. Mais, quant à la justice proprement dite, elle doit être rendue à Idria comme dans tous les autres points centraux. Un juge de paix me semble devoir y être établi, et ressortir, comme les autres juges de paix, des tribunaux supérieurs.
«Je me résume donc, et je pense:
«1° Que la mine d'Idria doit être imposée comme les autres mines;
«2° Que le domaine d'Idria doit être imposé comme toutes les autres propriétés semblables de l'Illyrie;
«3° Que les impôts de la nature de ceux que des employés ou ouvriers de la mine seraient dans le cas de supporter devraient être payés par l'administration de la mine impériale;
«4° Que le juge préposé pour membre du conseil d'administration doit être remplacé par un commissaire de police, et qu'il doit y avoir à Idria un juge de paix indépendant de l'administration, soumis aux tribunaux ordinaires, tant pour le civil que pour le criminel;
«5° Enfin qu'il est convenable que l'administration de la mine soit investie de tous les droits et pouvoirs municipaux sur Idria.
«Telles sont, monsieur le duc, les observations que j'ai cru devoir faire à Votre Excellence, et que je la prie de faire valoir auprès de Sa Majesté.
FIN DU TOME TROISIÈME.