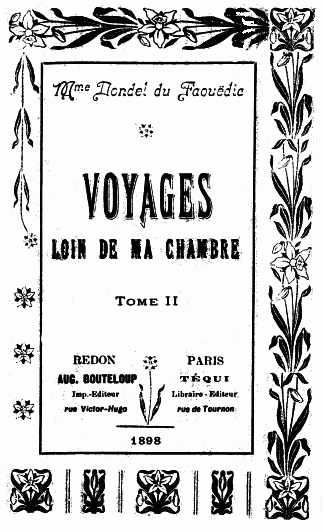
Title: Voyages loin de ma chambre t.2
Author: Noémie Dondel Du Faouëdic
Release date: August 4, 2012 [eBook #40422]
Most recently updated: October 23, 2024
Language: French
Credits: Produced by Laurent Vogel, Carlo Traverso, Chuck Greif and
the Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net (This file was produced from images
generously made available by the Bibliothèque nationale
de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)
| Notes de transcription: Les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées. L'orthographe d'origine a été conservée et n'a pas été harmonisée. |
VOYAGES
LOIN DE MA CHAMBRE
| OUVRAGES DE Mme DONDEL DU FAOUËDIC |
|---|
| VOYAGES LOIN DE MA CHAMBRE |
| 2 vol. in-12, 4 fr. |
| A TRAVERS LA PROVENCE ET L’ITALIE |
| 1 vol. in-8, 3 fr. 50 |
| IMPRESSIONS D’UN TOURISTE SUR SAUMUR |
| ET SES ENVIRONS |
| 1 vol. in-12, 1 fr. 25 |
| LE LIVRE DE GRAND’MÈRE |
| Histoires détachées |
| Ouvrage récompensé d’une Médaille d’honneur |
| par la Société Nationale d’Encouragement au Bien |
| (décrétée d’utilité publique) |
| en sa séance solennelle du 19 mai 1895 |
| 2 volumes in-12, le vol. 2 fr.; les 2 vol. 3 fr. 50 |
| BAGATELLES |
| Ouvrage plusieurs fois couronné |
| Médaille de 1re classe an grand Concours de l’Académie du Maine 1896 |
| 1 vol. in-12, 2 fr. |
| MENUE MONNAIE |
| 1 vol. in-12, 2 fr. |
| BRIMBORIONS |
| 1 vol. in-12, 2 fr. |
| LE GUIDE DE L’EXCURSIONNISTE |
| (REDON et ses environs) |
| 1 vol. avec gravures. |
MADAME N. DONDEL DU FAOUËDIC
——
REDON
AUGUSTE BOUTELOUP, LIBRAIRE-ÉDITEUR
Rue Victor-Hugo
1898
ÉTÉ 1887
TRÉSORS ARCHÉOLOGIQUES
Amboise, Blois, Chaumont,
Chambord,
Azay-le-Rideau, Chenonceaux
—
—
Autres Châteaux historiques,
L’Abbaye de Marmoutiers, Savonnière,
Les Jardins Mame,
Le Parc de Beaujardin, La Colonie de Mettray,
Coup d’œil sur la ville de Tours
A mon fils Henri.
L’été est venu, le soleil visite la terre, et pendant que tes pas nonchalants tracent un sillon doré sur le sable des plages, pendant que ta rêverie plane sur la vague éternelle et que ta pensée s’égare dans l’infini, je parcours le Paradis terrestre de la Touraine, pour me servir de l’expression d’un Tourangeau[1], et je répète avec nos pères: La France est un beau royaume.
Je t’envoie quelques descriptions doublées de mes impressions. Tu les liras à l’ombre d’une roche sauvage, tapissée de varech, fleurie de perce-pierre.
Ces souvenirs, écho d’un passé plein des agitations de la vie et des œuvres humaines viendront te chercher dans la suave solitude des grèves, au milieu des beautés grandioses de la nature en face de ces immenses plaines azurées qui se nomment la mer et le ciel.
Amboise, dont les armes sont: Paillé d’or et de gueules de six pièces, s’élève aux bords de la Loire. La situation de cette petite ville est charmante. Le regard suit avec délice le fleuve puissant qui chemine sous le beau ciel de la Touraine, à travers des coteaux boisés, des plaines verdoyantes, des rives fleuries. Son histoire liée à celle de toute la province, dont elle était autrefois la capitale, offre de l’intérêt. Le château a grand air de loin et de près.
Cent ans avant Jésus-Christ, César avait déjà un fort bâti sur la montagne, dans l’emplacement même où se trouve le château. Les empereurs Dioclétien, Constantin, Gratien, le possédèrent tour à tour. Il passa ensuite en bien des mains, soutint des sièges, fut pris et repris, et tout cela ne favorisait guère le développement de la ville, mais alors on passait la vie... à se battre.
Le fort n’existe plus depuis des siècles, mais un quartier de la ville actuelle porte encore le nom de vieille Rome, et la domination romaine a laissé là un souvenir fort curieux, et qui fixe l’attention des touristes. Il s’agit de vastes souterrains ouverts dans le roc de la montagne, sous le château. On appelle ces souterrains creusés de main d’hommes, et bien cimentés, greniers de César. Ils ont chacun quatre étages. Au milieu se trouve un escalier en pierre, de cent vingt marches, communiquant à chaque étage.
Ce n’est guère que sous Charles VII, Louis XI et Charles VIII, que la ville d’Amboise parvint au point où nous la retrouvons aujourd’hui. Mal percée, mal bâtie, son petit cachet vieillot n’est pas déplaisant; au contraire, il contraste avec le mouvement qui l’anime. La Loire favorise son commerce et son activité.
Le château la domine de sa majestueuse grandeur. Quels larges remparts et quelles grosses tours! Elles sont là deux jumelles, l’une au nord, l’autre au midi, ayant trente mètres de haut et cinq mètres de diamètre. Le plus curieux, c’est qu’elles ont à l’intérieur une route carrossable. On pouvait autrefois arriver en voiture jusqu’au faîte, qui se trouve au niveau de la cour intérieure, d’où la vue est splendide. J’admire le grand balcon en fer forgé. Un cruel souvenir s’y rattache cependant. Au dire de notre cicérone, c’est à ce grand balcon, que furent pendus les pauvres Huguenots, qui avaient conspiré contre Henri II et la terrible Catherine de Médicis.
Involontairement, je me suis baissée, en passant à la petite porte où Charles VIII, se rendant en courant au Jeu de Paume, se frappa si durement le front qu’il en mourut quelques heures après, bien jeune, à vingt-huit ans.
Nous avons admiré la chapelle ogivale, dédiée à Saint Hubert, et regardée comme un véritable bijou d’architecture gothique.
C’est principalement à partir du XVe siècle que la ville d’Amboise s’agrandit et que le château devient le témoin d’évènements qui forment quelques pages intéressantes de l’histoire de France.
En 1469, Louis XI y institua l’Ordre de Saint Michel.
Charles VIII y naquit en 1470.
Saint Vincent de Paul, quittant la Calabre, mandé par Louis XI, séjourna au château d’Amboise.
Louis XII vint rarement à Amboise, c’est cependant lui qui fit forger le grand balcon, dont je viens de parler.
François Ier passa une grande partie de sa jeunesse au château d’Amboise, avec sa mère; mais devenu roi, il trouva cette demeure trop petite. Ce fut dans ce château que, célébrant en 1515, la première année de son règne, les noces de Renée de Montpensier avec le duc de Lorraine, il perça de son épée un sanglier furieux, qui, s’échappant de la cour royale, où on l’avait enfermé, s’était élancé dans un escalier qu’il avait gravi jusqu’aux appartements de la reine.
Trois ans plus tard, en 1519, mourait à Amboise, où ses cendres reposent, Léonard de Vinci, le grand artiste, tout à la fois peintre, poète, écrivain et architecte, que François Ier, par sa munificence et son goût éclairé pour les arts, retenait près de lui.
Au mois de décembre 1539, François Ier arrivant de Loches avec Charles-Quint montait au château par l’escalier de la grosse tour, lorsque le feu prit aux tapisseries qui décoraient les rampes; les deux monarques faillirent être brûlés.
Henri II fit son entrée solennelle à Amboise, le 16 avril 1554; François II et Marie Stuart y arrivèrent le 29 novembre 1559.
A la fin de 1562, Charles IX fit paraître à Amboise un édit de pacification entre les catholiques et les protestants.
Henri III y fonda un collège en 1574.
La Fontaine dit en parlant du château d’Amboise: «Il fut un temps où on le faisait servir de berceau à nos rois, et véritablement, c’était un berceau d’une matière assez solide et qui n’était pas pour se renverser facilement.»
Non, ce berceau n’était pas pour se renverser facilement, car il était aussi l’une des quatre places fortes: Amboise, Tours, Loches et Chinon, que possédait encore le pauvre roi de Bourges, Charles VII, avant que l’Envoyée des Cieux ne fût venue relever la couronne de France et raffermir le trône.
Cependant, dès la fin du XVe siècle, la Cour ne vint plus séjourner à Amboise. Les rois de France préférèrent habiter leur capitale et les châteaux voisins, tels que Fontainebleau, Versailles, Compiègne et autres demeures royales plus rapprochées de Paris.
On ne l’a pas oublié, c’est dans le château d’Amboise qu’Abd-el-Kader, prisonnier de guerre, fut détenu avec toute sa famille pendant cinq ans, depuis 1847, jusqu’en octobre 1852, date de sa mise en liberté.
Ce beau château qui fut le séjour favori des Valois est rempli de souvenirs, au point de vue de l’art et de l’histoire. Comme l’a écrit M. de la Saussaye: si le style c’est l’homme, ne peut-on pas dire aussi que l’art c’est l’époque, car dans les monuments qu’il nous a laissés, on retrouve comme un reflet de l’esprit et du caractère des mœurs et des habitudes du temps.
Le château de Blois, composé d’édifices de différents styles, se partage en quatre parties distinctes.
La première remonte à la plus haute antiquité: ce fut d’abord une forteresse, à laquelle se rattache, pendant plusieurs siècles, l’histoire des comtes de Blois, issus de Hugues Capet.
Cette première partie renferme la Grande Salle des Etats, ou Halle des Comtes de Blois. Cette salle, destinée aux assemblées populaires ou seigneuriales, était alors une partie aussi intégrante d’un édifice du moyen-âge, que la tour du donjon dans un château féodal.
Au temps de la bataille d’Azincourt (XVe siècle) le château de Blois était une place formidable. La chapelle et le corps de bâtiments dans lequel s’ouvre la porte principale ont été construits par Louis XII, dans le style architectural qui précède la Renaissance. La façade du nord est due à François Ier, qui avait la manie de la truelle. La façade ouest, à Gaston d’Orléans, d’après les plans de Mansard. Cette partie serait superbe et digne du célèbre architecte, si elle ne se trouvait pas si voisine des chefs-d’œuvre de Louis XII et de François Ier. Bref, tout ce qui reste de ces immenses constructions est magnifique. Ah! quelle brillante époque que celle de la Renaissance, avec toutes ses richesses d’ornementations, avec cette profusion de détails exquis qui la caractérise. Tout est orné, brodé, enjolivé, jusqu’aux tuyaux de cheminées. C’est un amas de gigantesques gargouilles en pierres, de pilastres cannelés, d’arcades ogivales, de colonnettes élancées, de délicieuses arabesques. L’art s’est montré prodigue. Voici le porc-épic de Louis XII et la salamandre de François Ier. Ce n’est pas non plus sans un petit frémissement de satisfaction, que j’ai retrouvé les armes d’Anne de Bretagne, tantôt encadrées de la Cordelière, tantôt soutenues par des anges. On sait combien ce sujet a été poétiquement traité par les sculpteurs du moyen-âge, que l’on appelait alors avec raison Les maîstres de pierres vives.
Malheureusement, les pierres vives du château de Blois, ont encore plus souffert de l’injure des hommes que de celle du temps.
C’est la façade nord qui m’a le plus séduite. Ce fut celle-là aussi qui convint davantage au bon La Fontaine, lorsqu’il visita Blois, en 1663. «Ce qu’a fait faire François Ier, dit-il, à le regarder au dehors, me contenta plus que tout le reste; il y a force petites galeries, petites fenêtres, petits balcons, petits ornements sans régularité et sans ordre, et c’est justement cela, qui fait quelque chose de grand, qui plaît.»
La Fontaine avait raison, sauf qu’il a un peu trop prodigué l’adjectif petit.
«L’ensemble de cette partie est pleine d’élégance et de majesté. Ici, comme à Chambord, c’est le grand escalier à jour, magnifique de pensée et d’exécution, qui est la pièce capitale.
«Et l’esprit, soudain se représente cet admirable escalier, revêtu de tout le luxe de sa décoration primitive; il revoit ses balcons avec leurs balustres, les salamandres et les F couronnées, dans les caissons des rampes; les sculptures des niches et des entablements, les chiffres gigantesques de François Ier et de Claude de France, les hermines et les fleurs de lys sans nombre, et les arabesques qui étreignaient les contreforts comme les rameaux entrelacés d’un lierre. Puis, il croit voir passer le roi François Ier montant les degrés, entouré de sa cour brillante; les femmes aux chaperons de velours étincelants de pierreries, aux étroits corsages et aux robes traînantes; les hommes à la toque ornée d’une longue plume, au justaucorps noir, à crevés couleur de feu, au manteau court et à la large dague: ou bien encore, le roi Henri III, descendant de ses appartements à la nuit, suivi de ses pages et de ses mignons, entouré de ses quarante-cinq, et allant aux flambeaux, entendre à Saint-Sauveur, la messe de Noël...»
Ce magnifique escalier conduit aux appartements du premier étage, occupés jadis par Catherine de Médicis. Voilà son oratoire, sa chambre à coucher où elle mourut en 1589, son cabinet de toilette, son cabinet de travail, dont les ravissantes boiseries sculptées ne comptent pas moins de deux cent quarante-huit sujets d’ornementation, tous différents les uns des autres, nous dit notre guide. Toutes ces pièces sont complètement vides, il ne reste que quelques peintures murales, des boiseries et de magnifiques cheminées sculptées. De ce cabinet de travail si élégant, on passe dans la tour du moulin ou des oubliettes et l’on entre dans une affreuse prison fermée de portes de fer, un noir cachot qui se trouve ainsi de plain-pied avec les appartements royaux. Ce sont ces mêmes appartements qu’habita Marie de Médicis, lorsqu’elle était sinon prisonnière, du moins exilée au château de Blois. C’est de là, qu’elle s’échappa, en descendant de la fenêtre de l’oratoire, par une échelle de corde et avec l’aide du duc d’Epernon. Au second étage se trouvent les appartements de Henri III, distribués exactement comme ceux de sa mère. Nous avons gravi le petit escalier de pierre, enfoui dans la muraille, par lequel il descendit chez elle après le meurtre du duc de Guise.
Voilà le cabinet de travail du roi, où il se tint pendant la sanglante tragédie. Voilà son cabinet de toilette, où deux moines en prière demandaient à Dieu «le succès d’une expédition entreprise pour le repos du royaume.» Voici le couloir, sorte d’arrière-cabinet, avec sa porte biaise, près de laquelle Guise reçut les premiers coups. Voici enfin la chambre à coucher du roi, dans laquelle Guise vint mourir!
Comme tous les vieux châteaux, le château de Blois, qui aurait si bien pu se contenter de l’Histoire, a ses légendes, des légendes terribles, bien entendu. On parla longtemps avec mystère des oubliettes, au pied desquelles, dans un souterrain, gisaient les ossements des victimes. Des travaux entrepris par le génie militaire ont permis d’examiner ces lieux, jadis inaccessibles. Ce souterrain étroit et profond renfermait effectivement quantité d’ossements, mais ils avaient tous appartenu à des animaux domestiques, et il y a lieu de penser que c’était là qu’on jetait les débris des cuisines situées suivant l’usage dans les dessous du château.
La chapelle, d’un style élégant, fut construite par Louis XII, sur l’emplacement d’une autre chapelle très ancienne, dont il était déjà question au IXe siècle.
Les fins détails d’architecture sont bien conservés, mais il ne reste plus rien de la tribune en bois sculpté, d’un travail précieux, dans laquelle le roi assistait à l’office divin; disparus aussi, les beaux tableaux donnés par Louis XII et ses successeurs, parmi lesquels on remarquait une vierge du Pérugin. Je me suis accoudée au balcon de la chambre à coucher de Louis XII. C’était de ce balcon qu’il se plaisait à causer avec son premier ministre et ami le cardinal d’Amboise, qui se plaçait à la fenêtre d’une petite construction en bois, élevée au-dessus de la porte d’un hôtel que l’on voit tout proche du château.
Beaucoup d’évènements importants se sont déroulés au château de Blois. Bien des questions militaires et politiques s’y sont agitées. Nombre de pages de l’Histoire de France sont là inscrites sur ses pierres. En remontant la chaîne des âges, le touriste ému, pénétré de son sujet, revient par la pensée, vers un passé de plusieurs siècles, et le reconstitue tout entier. En précisant ses souvenirs, il évoque les grands personnages qui habitèrent le château de Blois, il les voit, il les écoute, il revit avec eux les jours évanouis et il retrouve comme en un rêve superbe, les grandes figures de Louis XII, Anne de Bretagne, Charles IX, Catherine de Médicis, Henri III, Marguerite de Valois, la Marguerite des marguerites, Jeanne d’Arc, Dunois, le premier homme de guerre de son époque, les Guises, François Ier, qui n’habita guère le château de Blois qu’au commencement de son règne, pendant qu’il faisait construire la partie qui porte son nom. Chambord ensuite fit tort à Blois.
Il voit encore défiler Charles-Quint qui séjourna quelques jours à Blois en allant à Chambord, Jeanne d’Albret, Isabelle de France, Marie Stuart, Coligny, Mademoiselle de Montpensier, la grande Mademoiselle, Charles II, le prétendant à la couronne d’Angleterre, Louis XIV, qui s’y arrêta quelques jours en se rendant à Saint-Jean-de-Luz, pour épouser l’infante d’Espagne. C’est là qu’il vit pour la première fois Mademoiselle de La Vallière.
Voilà la chambre où Valentine de Milan (dont l’histoire a enregistré la tendresse conjugale) vint avec ses enfants, pleurer son époux, assassiné en 1407. C’est là, dans ce vieux château de Blois, qu’elle prit pour emblème, une chantepleure (arrosoir), entre deux S, initiales de soupir et de soucy, avec la mélancolique devise restée célèbre: «Plus ne m’est rien, rien ne m’est plus» que l’on voyait répétée sur toutes les tentures noires qui garnissaient sa chambre. C’est en vain qu’elle demanda justice. Elle ne put survivre à sa douleur et au triomphe de son ennemi, et mourut à Blois, à l’âge de trente-huit ans, après avoir donné l’exemple de la plus chaste vertu, au milieu de la cour licencieuse d’Isabeau de Bavière. «Le quatrième jour de décembre, dit Juvénal des Ursins, mourut de courroux et de deuil, la duchesse d’Orléans.»
C’est encore dans l’enceinte fortifiée du château de Blois que Jeanne d’Arc (avril 1429), fit son entrée aux acclamations de la multitude. Elle y séjourna plusieurs jours, en attendant les renforts promis par le roi. Pendant ce temps là, Jeanne priait et écoutait ses voix, sainte Catherine et sainte Marguerite qui lui dirent: «Prends l’étendard de par le Roi du Ciel et fait quérir l’épée de Charles-Martel.»
C’est donc à Blois et non à Poitiers comme l’ont prétendu quelques écrivains, que Jeanne fit faire l’étendard qui devait la conduire au triomphe.
Quant à l’épée, voici son histoire.
On croit que l’église primitive de la paroisse Sainte-Catherine, dans l’arrondissement de Chinon, fut fondée par Charles Martel, en 732, après la bataille gagnée sur Abdérame et à l’endroit où l’on avait cessé de poursuivre les Sarrazins. Il y déposa l’épée dont il s’était servi durant le combat, et ce fut cette même épée que Jeanne d’Arc envoya chercher (1429) comme un signe de victoire.
La cœur s’émeut au souvenir de ces preux héroïques, de ces fiers chevaliers qui, conduits par Jeanne, guerroyaient pour le roi et sauvaient la patrie!...
C’est encore au château de Blois, dans l’un de ces appartements majestueux, que Charles d’Orléans, le prince le plus accompli de son temps, charmé des beautés de la nature, en un jour de printemps, écrivit ce charmant rondel, qui le place en tête des poètes du XVe siècle:
En 1462, le 27 juin, Louis XII, fils de Charles d’Orléans et de Marie de Clèves, naquit au château de Blois. Louis XI fut son parrain et lui donna son nom. «Il eut à cette occasion de grandes chères à merveille, dit saint Gelais, trop longues à mettre par escrit.» Ce qui nous prive encore une fois de tous ces détails intimes de la vie au moyen-âge, dont nous sommes si friands aujourd’hui. C’est au château de Blois que le filleul de Louis XI apprit, dans la nuit du 7 avril 1498, l’évènement qui le faisait roi, c’est-à-dire la mort imprévue de Charles VIII au château d’Amboise. C’est aussi dans ce même château que Louis XII, parlant à la Trémoïlle, prononça ces paroles mémorables: «Ce n’est pas au Roi de France, à venger les injures du duc d’Orléans.»
Le célèbre Machiavel fit deux séjours au château de Blois, en 1501 et en 1510, pour prendre part à des conférences diplomatiques, comme ambassadeur de la république florentine, alliée de Louis XII.
C’est au château de Blois, que naquit le 25 octobre 1510, la seconde fille de Louis XII et de Anne de Bretagne. Elle reçut le nom de Renée, qu’elle devait illustrer un jour, dit Dom Lobineau, par son savoir et par la protection qu’elle accorda aux lettres.
C’est encore ici que Jeanne d’Albret entourée d’une brillante escorte, vint préparer le mariage de son fils avec Marguerite de Valois.
Sans les chroniqueurs du temps, il serait impossible de se faire une idée du somptueux intérieur des châteaux royaux et princiers du moyen-âge; des plaisirs variés: tournois, comédies, musique, bals et festins qu’on y donnait, avec «grande ordonnance» et grand souci du cérémonial et du décorum qui régnait déjà parmi les dames et les demoiselles d’honneur, les pages, les chevaliers. On le voit, de tous temps, M. Protocole et Mme Etiquette ont fait des leurs.
Le château de Blois eut donc ses jours de fêtes et ses jours de deuil. Joies et douleurs, sourires et larmes, n’est-ce pas la vie?
Anne de Bretagne mourut au château de Blois le 9 janvier 1514. «Louis XII, dit Seyssel, qui l’avait si tant aimée, qu’il avait déposé en elle tous ses plaisirs et toutes ses délices, la pleura amèrement. Il voulut porter le deuil en noir, contre l’usage, et resta trois jours enfermé dans son cabinet, sans vouloir voir personne. Il serait difficile aussi de peindre le chagrin de ses dames d’honneur et de ses chevaliers bretons; car c’est à tort qu’on a attribué à François Ier l’introduction des dames d’honneur à la cour, c’est à la reine de France, Anne de Bretagne, qu’on doit cette institution.
La reine Anne habita souvent le château de Blois après son second mariage, avec Louis XII, qui avait une prédilection marquée pour ce château.
La cour de la reine Anne, dit Brantôme, était une fort belle école pour les dames et les demoiselles qui, pouvant se façonner sur le modèle de la reine, restaient sages et vertueuses.
Anne est la première reine de France qui ait eu ses gardes particuliers; usant de ses prérogatives de duchesse de Bretagne, elle avait en plus des gentilhommes ordinaires de la cour, cent chevaliers, tous bretons, qui l’accompagnaient aux offices et dans ses promenades. Si ses chevaliers appartenaient aux premières familles de la Bretagne, ses dames et demoiselles d’honneur portaient les plus beaux noms de France: Charlotte d’Aragon, Anne de Bourbon, Catherine et Germaine de Foix, Blanche de Montgazon, Jeanne de Rohan-Guémenée, Catherine de Barres, Louise de Bourdeille, tante de Brantôme, et bien d’autres. Ces dames se réunissaient autour de la reine pour travailler ensemble à des ornements d’église. On garde à Blois le souvenir d’une chape, ruisselante de perles et d’or, destinée au Pape. Les bonnes mœurs, l’esprit et la grâce, qui régnaient alors à la cour de France, étaient en grande réputation dans toute l’Europe.
Mais je m’oublie, il en est toujours ainsi quand je parle de notre bonne duchesse, quand je me rappelle sa vie si courte par les années, si longue par ses œuvres et ses bienfaits.
Ce fut aussi au château de Blois, que la princesse Claude de France, sa fille, trépassa à vingt-cinq ans, le 20 juillet 1524. «Fatale année pour la France, dit un historien, car elle perdit le duché de Milan, deux armées et sa reine.»
C’est dans le château de Blois, que l’on réunit les sommes nécessaires à la rançon de celui qui pouvait écrire après la défaite de Pavie: «Tout est perdu fors l’honneur.»
François Ier préférait à Blois, Chambord; et plus tard à Chambord, Fontainebleau, qui devint sa demeure favorite, ce qui lui faisait dire quand il y allait: Je m’en vais chez moi. C’est François Ier qui fit transporter au château de Fontainebleau la belle bibliothèque du château de Blois, formée par Louis XII. Elle se composait alors d’environ mille neuf cent volumes, dont cent neuf seulement étaient imprimés. Au dire des savants, cette bibliothèque, l’orgueil de la France, faisait l’admiration de l’Europe.
Parmi tant de manuscrits précieux, on remarquait au premier rang les heures d’Anne de Bretagne, qui sont encore aujourd’hui l’un des plus riches trésors de la bibliothèque nationale.
Toutes les marges de ce précieux volume sont ornées d’une fleur, d’une plante peinte d’après nature, avec son nom en latin et en français. On en compte trois cents, exécutées avec une telle perfection, qu’on ne ferait pas mieux à présent, et que cet ouvrage est regardé comme le type le plus parfait de l’art à cette époque.
C’est à Blois, à la fin de l’année 1565, que Charles IX trama avec une patience et une dissimulation extraordinaires, l’odieuse, l’abominable St-Barthelémy.
Blois, qui fut le premier témoin de la popularité et de la domination des Guises, devait devenir plus tard le témoin de leur ruine, et leur tombeau.
Henri III, malgré cette noblesse de parole et cette bienveillance de langage, qui lui étaient habituelles, sentait grandir chaque jour son excitation contre les Guises. Son cœur était plein, il allait déborder.
Le château traverse alors une ère d’horreurs et de crimes. La reine Catherine, très ébranlée par tous ces évènements, ne tarda pas elle-même à mourir. Je viens de voir la chambre où elle rendit le dernier soupir.
A l’avènement de la Maison de Bourbon, l’importance historique du château de Blois commence à décroître. En 1635, Gaston d’Orléans lui rend quelque prestige; retiré à son château de Blois, il le restaure, il entreprend même une reconstruction générale. Ses jardins, où il entretient des collections de plantes les plus rares, sont comparés aux célèbres vergers d’Alcinoüs, et les terrasses, aux jardins suspendus de Babylone.
Le duc d’Orléans ne recherche pas la gloire ardente des conquérants: ses plaisirs sont plus doux, et il cultive toutes les plantes utiles à la santé et les fait distribuer aux pauvres de Blois.
«Que l’on cesse désormais d’admirer les parterres de Pestum, où la rose fleurit deux fois l’année, et les pommes des Hespérides, confiées à la garde du Dragon toujours éveillé! S’il était permis de comparer quelque chose aux champs de l’Eden, ce serait Blois, le merveilleux ouvrage de Gaston. Dans l’étroit espace d’un jardin, il a rassemblé et fait croître toutes les plantes que la terre féconde nourrit dans son sein, les plus humbles comme les plus superbes. Le fils de Bersabée avait appris à connaître tous les végétaux, depuis l’herbe des gazons jusqu’au cèdre du Liban; Gaston les cultiva tous et sut leur assigner le terrain propre à chacun d’eux, plaçant sur un sol aride les plantes des montagnes, et confiant à une terre humide, celles des vallées, afin que toutes se montrassent parées de leurs ornements naturels, et que l’étude en fût rendue plus facile.»
Voilà pour l’extérieur. L’intérieur s’enrichit d’un riche médailler, d’estampes et de pierres gravées, de collections d’oiseaux et d’insectes. «Gaston d’Orléans n’était étranger, selon l’expression du temps, à aucun genre de curiosité.»
Une remarque très particulière, c’est que les trois collections artistiques les plus précieuses, possédées par la France: la Bibliothèque des manuscrits, le Cabinet des médailles et le Muséum d’Histoire naturelle doivent leur origine ou leur accroissement aux richesses accumulées dans le château de Blois.
Pendant les règnes de Louis XV et de Louis XVI, le château de Blois fut confié à des gouverneurs qui ne daignèrent même pas l’habiter.
La Révolution le mutila horriblement pour en faire une caserne.
Plus tard, avec cet esprit qui détruit les choses sous prétexte de les utiliser, on songea à y installer la Préfecture. Il fut question de jeter bas les masures de Louis XII pour y substituer une belle grille de fer.
Une Commission réclama en vain les jardins du Roi pour y établir un jardin botanique, ils furent vendus en détail. L’Administration civile et militaire semblait ne pas comprendre la valeur de ces chefs-d’œuvre, et se complaire à leur destruction.
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Il en est ainsi fort heureusement des générations et des goûts.
En 1841, la Comission des monuments historiques vint enfin classer et sauver le château de Blois des mains, quelque peu vandales, qui le mutilaient depuis trop d’années.
C’est avec soin maintenant que l’on entretient cet admirable château, ce superbe diamant, parmi les joyaux du beau royaume de France.
A chaque instant, je consultais l’excellent ouvrage de M. de la Saussaye, sur le château de Blois.
Rien n’est plus saisissant que de lire les grandes pages de l’histoire, sur le lieu même où elles se déroulèrent. C’est ce que je faisais de temps en temps, à la grande contrariété du guide, qui voulait tout expliquer à sa manière.
Nous avons visité le Musée, au premier étage de l’aile de Louis XII. Les tableaux offrent sans doute de l’intérêt, mais tout l’ensemble m’a paru trop moderne.
Une dernière salle attend les touristes; elle est remplie de photographies plus ou moins réussies, de bibelots plus ou moins artistiques, représentant sur papier, sur bois, sur porcelaine, le château sous tous ses aspects.
Notre guide en jupon, c’est une justice à lui rendre, ne s’est pas montrée plus aimable comme marchande que comme cicérone; et je l’avoue tout bas, cette dernière salle m’a fait complètement descendre des hauteurs de l’histoire, pour rentrer dans les mesquines réalités de la vie.
La vieille ville de Blois a beaucoup de cachet; elle fut entièrement dévalisée par les Prussiens en 1870.
C’est égal, l’ennemi qui sut lui voler tant de choses, n’a pu lui enlever son grand air d’autrefois.
Les vieux hôtels habités jadis par les seigneurs de la Cour intéressent par leur architecture et les souvenirs qu’ils rappellent. Je citerai les hôtels d’Amboise, d’Epernon, de Cheverny ou petit Louvre, de Guise, d’Alluye, de la Chancellerie et... il y en a d’autres.
J’ai encore vu avec intérêt la belle vieille fontaine Louis XII, la Halle au blé, style moyen-âge.
Le plus bel édifice moderne de Blois, est l’évêché. Les jardins s’étendent en terrasses régulières, et de la plus élevée, le panorama est délicieux.
C’est aussi à Blois que se trouve l’église Saint-Nicolas, la plus belle de tout le département, après celle de Vendôme.
Blois a de jolies promenades. Quelle ville, d’ailleurs, n’a pas son Mail! La promenade des Allées est une belle arrivée sous bois, elle a plus d’une demi-lieue et aboutit à une forêt. De la butte des Capucins, chantée par Victor Hugo, la vue n’a d’autres bornes que la limite d’un horizon sans fin. Les trois forêts qui entourent Blois étaient extrêmement considérables au moyen-âge. Depuis trois siècles, elles ont la même étendue, et comprennent environ dix mille hectares, rapportant annuellement un million.
En 1814, l’Impératrice Marie-Louise se retira à Blois; c’est de là que sont datés ses derniers actes.
Autour de Blois sont encore de bien beaux châteaux. J’ai visité Chaumont et Chambord, le roi des châteaux.
Les autres, hélas, je ne les ai vus... que dans mon guide qui signale particulièrement Cheverny, dont l’architecture extérieure et le mobilier intérieur, sont dignes l’un de l’autre; le château de Beauregard, monument historique fort remarquable et les imposantes ruines du château de Bury.
Chaumont, rebâti par l’amiral Charles de Chaumont, neveu du cardinal Georges d’Amboise, présente le type imposant du château féodal dans toute sa sévère grandeur.
Ponts-levis et fossés, chemin de ronde couvert sur les machicoulis, tours et tourelles, hautes cheminées et toits pointus, rien ne manque à cette antique demeure qui garde son aspect formidable. Un pont-levis donne accès au porche, au-dessus duquel se détache un médaillon sculpté aux armes de Louis XII et d’Anne de Bretagne. La lettre L est posée sur un semis de fleurs de lys, et l’A au milieu des hermines de Bretagne; d’autres armoiries sont incrustées à la hauteur de ce médaillon sur les deux grosses tours qui gardent le porche: à droite les armes de Georges d’Amboise, d’illustre mémoire, surmontées du chapeau de cardinal; à gauche, celles de son neveu Charles de Chaumont, amiral et grand maître de France; à l’entrée, sur les créneaux de la tour de droite, se voient aussi les signes cabalistiques de Catherine de Médicis.
De la cour intérieure, formant terrasse, s’ouvre une perspective admirable sur la vallée de la Loire et les forêts qui teintent l’horizon de leurs masses foncées. On pourrait presque dire, comme devant l’Océan, qu’on a la vue de l’infini. C’est une mer de feuillage que la brise fait onduler en leur donnant l’agitation et le bruissement des vagues.
Le fleuve complète le tableau. Quelle belle nappe argentée et miroitante que la Loire à cet endroit! Le pont qui la traverse semble posé là pour l’agrément du décor. Du reste, j’admire tous les ponts jetés sur la Loire, soit par l’Etat, soit par l’administration des chemins de fer; ce sont des œuvres de conception hardie et de grandiose exécution. L’un d’eux, assis sur cinquante-neuf arches de vingt-et-un mètres de hauteur a sept cent cinquante-et-un mètres de longueur.
«Le voyageur qui parcourt la belle levée de Tours aperçoit constamment Chaumont pendant plus de six lieues sous des aspects aussi variés qu’enchanteurs.»
Il faut croire qu’il n’en était pas ainsi autrefois, car on assure que ce vieux donjon, accroché au flanc d’un coteau boisé, était si bien caché dans la verdure, qu’il put échapper ainsi au sac révolutionnaire de 1793. Cela explique sa conservation et celle de tous les objets précieux qu’il renferme.
Les salons, sobrement meublés dans le style Renaissance, sont tendus de magnifiques tapisseries de Beauvais et des Gobelins, fraîches comme si elles dataient d’hier. C’est avec le plus grand intérêt que j’ai visité les appartements historiques: la chambre de Diane de Poitiers, la chambre de Catherine de Médicis, la salle du Conseil, la salle des Gardes, la grande galerie qui rappelle celle de Louis XII au château de Blois; la chapelle avec son rétable et ses sièges en chêne sculpté, et ses beaux vitraux, le chapeau du cardinal d’Amboise y tient une place d’honneur. La chambre authentique de Catherine de Médicis m’a particulièrement frappée. Voilà le lit à colonnes tendu de soie à ramages pâlie par le temps, où cette reine impérieuse cherchait le sommeil et où l’insomnie dut tenir plus d’une fois sa paupière ouverte. Ces sièges à hauts dossiers, tourmentés par l’habile ciseau d’un artiste inconnu, durent aussi bien souvent reposer ses membres fatigués.
Voilà le prie-Dieu brodé aux armes de France, sur lequel elle s’agenouilla. Le missel est encore ouvert sur l’accoudoir, ses feuilles sont jaunes et semblent garder la trace, l’usure des doigts, de celle qui les tournait souvent, et distraitement, sans doute, quand son esprit s’occupait plus de la terre que du ciel. Voilà la table de toilette, l’aiguière, les flacons, les coupes, les boîtes à poudre et à mouches dont l’élégante florentine se servait «pour réparer du temps l’irréparable outrage.» Voici également les chandeliers à deux branches, en cuivre massif, garnis de grosses chandelles du temps en cire jaune. Tout en allant d’un meuble à l’autre, du bureau de travail qui contint plus d’un secret d’Etat, aux coffres sculptés qui servaient à ramasser le linge et les effets personnels, je me demandais si vraiment toutes ces choses avaient appartenu et servi à Catherine de Médicis et je me disais qu’en tout cas: si non è vero...
Cette chambre ouvre directement sur la tribune de la chapelle, dont elle n’est séparée que par un lourd rideau d’étoffe foncée. A droite de cette tenture, une petite porte conduit à la chambre qu’occupait Ruggieri, «l’astrologue aux almanachs, et aux horoscopes,» comme l’appelait le peuple; le confident, le conseil de la reine, qui l’accompagnait dans tous ses voyages. Il était chargé, comme chacun sait, de prédire suivant la marche et les différents reflets des étoiles, les destinées du royaume.
Les personnes qui aiment à lire dans l’avenir consultent encore Cosme Ruggieri, cherchant à appliquer ses prédictions au temps présent, et à tirer des oracles de ses phrases embrouillées sujettes à différentes interprétations ou de ses paraboles savantes, auxquelles chacun peut donner le sens qui lui plaît; langage obscur et mystérieux qui constitue la véritable science des sorciers du passé et des voyants de l’avenir.
Sa chambre aux sombres boiseries, est fort modeste. Elle ne contient plus que son coffre-fort en fer. Son énorme clef, presque effrayante à voir, doit rappeler celles que portaient à cette époque, les guichetiers de la Bastille et autres lieux du même genre. Voilà pour le passé. Quant aux communs récemment construits, ils ont mis à contribution tout ce que l’élégance et le confort modernes ont de plus perfectionné. C’est dans l’emplacement de ces servitudes qu’au XVIIIme siècle, l’italien Nini établit une fabrique de poterie, dont quelques spécimens sont conservés sous vitrine, dans l’une des salles du château.
Le parc est beau, certaines parties sont fort pittoresques, entr’autres, la vallée ombreuse d’un petit ruisseau qui coule au bas de pentes rapides et boisées, sur lequel on a jeté deux ponts rustiques du plus charmant effet. Ces deux ponts solidement charpentés, et pour lesquels on semble ne pas avoir ménagé le bois, sont cependant d’un genre nouveau.
Au bout du premier pont, on aperçoit le faîte d’un gigantesque tronc creux; on pense que cet arbre antique est contemporain du château. C’est un vieux chêne miné par le temps, écorce rugueuse et crevassée, branches sans feuillage, tordues et brisées. Vous pénétrez dans ce tronc, dont l’intérieur est encore plus large que celui du chêne légendaire de la Prévalaye, près Rennes, et vous avez la surprise d’y rencontrer un escalier en spirale, qui dégringole dans toute la hauteur du tronc.
En bas, nouveau pont rustique franchissant la petite vallée. Le curieux de tout ceci, et pourquoi je me suis étendue sur cette description, c’est que les deux ponts, aux massives rondelles de bois, à peine équarri, taillé à coups de hache, ainsi que le gigantesque chêne, tout cela d’une imitation parfaite, est en ciment.
On a conservé et entretenu d’après les premiers plans, le Mail de la Reine, orné l’été, de grands orangers, peut-être contemporains de ceux de Versailles, et la Motte, sa promenade favorite, pleine d’ombre et de fraîcheur. Ah! si ces vieux arbres pouvaient parler, si ces témoins muets d’un autre âge pouvaient raconter l’histoire intéressante de leur époque, que de choses nouvelles, que de révélations piquantes n’entendrait-on pas!
En 1559, Diane de Poitiers, à son grand déplaisir, se vit contrainte par Catherine de Médicis, d’échanger son cher Chenonceaux contre Chaumont. Il passa ensuite entre les mains de la duchesse de Bouillon, qui épousa Henri de la Tour, père de Turenne. Madame de Staël y séjourna pendant son exil. Benjamin Constant l’a également habité. Il est aujourd’hui la propriété de la Princesse de Broglie.
C’est en silence et muette d’admiration que j’ai contemplé Chambord, cette création splendide, le plus beau des châteaux de la vallée de la Loire. La merveille des merveilles du style renaissance enfoui comme un trésor dans le pays le plus triste et le plus malsain de la France, la Sologne.
Voilà donc Chambord, le don national de la France au duc de Bordeaux qui toute sa vie en porta le nom et ne l’habita jamais.
Depuis le jour où il lui fut offert, que de changements, que d’illusions tombées, que de rêves évanouis! Là, dans ces vastes appartements si longtemps éclairés du pur rayon de l’espérance, et qu’aujourd’hui le vide et la solitude envahissent de plus en plus; là, dans cette belle demeure si déserte et que personne ne semble plus devoir faire revivre, l’esprit s’emplit de souvenirs et l’âme de tristesse. Ah! dans ce grand château français, que de châteaux en Espagne furent bâtis jadis par tous les royalistes qui vinrent le visiter; alors on comptait voir le roi reprendre non seulement possession de son château, mais aussi de sa couronne. L’enfant de la Providence en est devenu le vieillard, sans qu’il lui ait été donné de reprendre le chemin de sa patrie et le trône de ses ancêtres. La mort est venue briser les derniers espoirs fondés sur ce prince religieux et chevaleresque, grandi encore par l’exil et qui, de l’aveu même des ennemis les plus acharnés de la royauté, restera dans l’histoire l’une des plus nobles figures du XIXe siècle.
Le château de Chambord forme un carré long de cent cinquante-six mètres sur cent dix-sept, flanqué aux angles de grosses tours rondes. Ce système de construction en enveloppe un second, soutenu également par de massives tours circulaires à pignons pointus. Les deux façades se confondent au nord en une immense ligne partagée en trois sections par les tours qui s’y rencontrent. Ce qui caractérise surtout le château de Chambord à l’extérieur, c’est le nombre et la variété de ses ornements.
«Chambord, monument féerique, forêt de campaniles, de tours, de cheminées, de lucarnes, de dômes et de tourelles», est un éblouissement pour l’archéologue et même pour le simple touriste; principalement dans la partie supérieure que décorent d’innombrables sculptures, salamandres gigantesques, flèches aiguës, clochetons élégants, terrasses à balustres.
Le joyau de l’intérieur de Chambord est l’escalier central en spirale, à double rampe superposée, tout en appartenant au même noyau; la disposition est telle que deux personnes peuvent en même temps monter et descendre sans se rencontrer. Au-dessus des voûtes des quatre salles, divisées en trois étages, et au niveau des terrasses qui les recouvrent, s’arrête la double rampe et commence le couronnement de forme pyramidale ayant trente-deux mètres de hauteur, surmonté d’une fleur de lys en pierre, d’au moins deux mètres; il produit le plus grand effet.
La chapelle, achevée par Henri II, est en parfait état de conservation. On compte à Chambord treize grands escaliers, sans parler des petits, cachés dans l’épaisseur des murs; quatre cent quarante pièces: chambres, salles, salons, galeries. Je n’ai point essayé de parcourir ce dédale d’appartements où il n’y a rien à voir: ce beau château n’est pas meublé; quelques tableaux de maîtres, des portraits, ornent particulièrement le grand salon et la chambre du maréchal de Saxe. On y voit Louis XIV, Mme de Maintenon, Anne d’Autriche, Mme de la Fayette, etc. La statue d’Henri V, d’une grande pureté de lignes et d’une vérité d’expression remarquable, décore le grand salon de réception.
L’enceinte du parc forme la limite d’une commune qui y est contenue tout entière; il compte trente-cinq kilomètres de tour, et comprend de magnifiques futaies et d’immenses taillis peuplés de toute espèce de gibier.
La forêt de Chambord n’approche certainement pas de celle de Fontainebleau qui compte près de dix-neuf mille hectares, mais elle est plus grande que la forêt de Chantilly qui n’a que deux mille quatre cent cinquante hectares; le parc de Chambord compte cinq mille cinq cents hectares, dont quatre mille cinq cents de bois, cinq fermes et quatorze étangs.
Il est traversé par une rivière, le Cosson. On y arrive par six portes et avenues, avec pavillons de garde. Dès l’an 1090, il est question de Chambord, maison de plaisance et de chasse des comtes de Blois.
Plus tard, il fut acquis avec le comté de Blois par Louis d’Orléans, frère de Charles VI, et réuni à la couronne par l’élévation au trône de Louis XII. «Pendant bien longtemps, on attribua cette admirable construction à des artistes italiens.
On nommait le Primatice et le Rosso, mais des recherches plus modernes permettent d’en attribuer la construction à Pierre Nepveu, dit Trinqueau, architecte natif d’Amboise.
Le domaine appartenait depuis longtemps à la couronne, quand François Ier fit commencer les travaux. Pendant douze ans, dix-huit cents ouvriers, dit-on, y travaillèrent sans relâche, et en 1519, Charles-Quint, visitant Chambord, l’appelait déjà un abrégé des merveilles que peut enfanter l’industrie humaine. Pendant la plus grande partie de sa vie, François Ier habita Chambord, devenu son œuvre et sa résidence favorite. Il avait deux bonnes raisons pour cela, son goût pour la chasse, et son amour pour la comtesse de Toury qui habitait un château voisin. D’après les archives du trésor royal, François Ier dépensa à construire Chambord quatre cent quarante-quatre mille cinq cent soixante-dix livres, ce qui représente aujourd’hui plus de cinq millions, et mourut sans que son œuvre fut complètement terminée.
Henri II continua les travaux inachevés par son père. Après lui, la Cour habita Chambord, mais sans l’embellir. Louis XIII s’y plaisait. Louis XIV, qui portait partout son amour du faste et des grandeurs, y donna des fêtes brillantes et pour y loger sa suite fit exécuter divers remaniements. C’est à Chambord qu’eurent lieu les premières représentations de Pourceaugnac 1669, et du Bourgeois gentilhomme 1670. Louis XV donna Chambord à son beau-père, le roi Stanislas de Pologne, qui l’habita huit années, et combla les fossés. Le maréchal de Saxe, auquel il avait été donné en 1748, loin de l’embellir n’y fit rien de bien, au contraire. La famille de Polignac en obtint la jouissance du roi Louis XVI en 1777. Pendant la révolution, le gouvernement y établit un dépôt de remonte.
Napoléon Ier y installa la quinzième cohorte de la Légion d’Honneur, mais c’est au Camp de Boulogne en 1804 que furent distribuées les premières décorations. L’Empereur présida à cette imposante cérémonie, assis dans l’antique fauteuil du roi Dagobert expressément transporté de Paris à Boulogne, avec les casques de Bayard et de Duguesclin.
C’est sur cet antique fauteuil que s’asseyaient les rois francs de la première race pour recevoir, lorsqu’ils prenaient le commandement, les hommages et serments des grands du royaume; il est de bronze, doré par places, fondu et ciselé avec des têtes de panthères pour ornements.
Ce siège, tout ce qu’il y a de plus authentique, fut conservé pendant plusieurs siècles dans le trésor de l’Abbaye de Saint-Denis. Après la suppression des monastères, il passa au Palais-Royal, où il fut conservé avec tout le soin que méritait un meuble aussi précieux, plus tard il fut déposé au cabinet des médailles.
Il fit encore un long séjour au Musée des Souverains, installé dans le beau château de Saint-Germain. Aujourd’hui il habite la bibliothèque nationale où on peut le voir au Cabinet des Antiques.
Après la bataille de Wagram l’empereur érigea Chambord en principauté et en fit don au maréchal Bertier à la condition de terminer le château. Après la mort du prince de Wagram, sa veuve ne pouvant l’achever ni même l’entretenir, obtint l’autorisation, après en avoir coupé tous les bois, de le vendre.
C’est alors qu’une souscription nationale, proposée par le Comte Adrien de Calonne, combattue par Paul-Louis Courier, racheta le domaine de Chambord au prix de un million cinq cent quarante deux mille francs, pour l’offrir au duc de Bordeaux qui venait de naître.
Avant de partir et pendant que mes yeux s’absorbaient une dernière fois, dans la contemplation de cette splendide demeure, mon esprit voyageait grand train et déroulant les événements d’un demi-siècle, je rêvais mélancoliquement au passé qu’était alors l’avenir, lequel n’a rien tenu de ce qu’on attendait de lui. Cette terre essentiellement française, cet ancien domaine de nos rois, ce château qui aurait dû rester l’apanage des princes légitimes du pays, appartient maintenant à un étranger, à un prince italien, peut-être hostile, en tout cas, indifférent, qui se contentera désormais de palper les revenus et d’entretenir tout juste la toiture des bâtiments pour qu’ils ne tombent pas tout à fait en ruine!
Je suis partie navrée.
Vraiment les choses de ce monde n’ont de stable que leur instabilité même!
Encore une demeure attrayante, un vrai régal pour les yeux. C’est avec une satisfaction sans cesse renouvelée que l’archéologue et le touriste visitent tant de purs chefs-d’œuvre du style renaissance. Tous ces châteaux m’émerveillent, je finis par devenir un peu enfant. C’est toujours le dernier visité qui me paraît le plus beau. Donc je retrouve ici même grâce dans les lignes, même profusion dans les sculptures, pilastres et colonnes, balustres et clochetons, niches et bas-reliefs. Là, j’admire la salamandre au milieu des flammes avec la devise du roi chevalier: Nutriseo et exstinguo. Ailleurs, je remarque les armes de Claude sa femme, l’hermine bretonne, et je lis cette autre devise: Ung seul désir, et tout cela supérieurement fouillé, ciselé, si je puis m’exprimer ainsi.
Azay-le-Rideau est bâti sur pilotis, flanqué de tourelles qui forment, avec les deux principaux corps de bâtiment, un ensemble plein de grandeur et de suprême élégance. Le portail d’entrée présente une des plus belles façades de l’édifice, orné de colonnes recouvertes d’arabesques du meilleur goût, il se termine par un fronton armorié, et renferme à l’intérieur un escalier des plus curieux.
Les appartements sont un vrai musée, remplis de meubles rares de toutes les époques et de magnifiques tableaux, portraits historiques des meilleurs maîtres: Charles VIII, Louis XI, Charles IX, Louis XIII, Louis XV enfant, Anne de Bretagne, Anne d’Autriche, Anne de Montmorençy, Rabelais, Michel Cervantès, Catherine de Médicis, Ambroise Paré, Henriette d’Entragues, le maréchal d’Ancre, Mademoiselle de La Vallière, Madame de la Sablière, Marie-Thérèse d’Autriche, Marie Leczinska, la duchesse de Chateauroux, etc., etc.
La principale chambre garde son titre de chambre du Roi, parce que Louis XIV y coucha. Le parc est ravissant. L’Indre, déroulant sans entraves ses capricieux anneaux, dessine des îlots verdoyants, découpe et festonne les pelouses au gré de sa fantaisie. Rien de charmant comme les gracieux méandres de ce ruban d’argent, baignant au nord et au midi les assises du château, puis se faufilant dans les prairies, rayé de temps en temps par de légers ponts qui le traversent; tout au fond la rivière s’échappe de l’enclos par une belle chûte d’eau.
Azay-le-Rideau est un chef-lieu de canton qui passerait certainement inaperçu sans son magnifique château.
Cette bourgade avait autrefois le titre de châtellenie. Son nom lui vient de l’un de ses seigneurs, Hugues de Ridel ou de Rideau, chevalier banneret sous Philippe-Auguste, 1213. Le château actuel bâti au commencement du XVIe siècle par Gilles Berthelot, appartient aujourd’hui au marquis de Biencourt qui n’est point à court de bien, tant s’en faut, puisque le château et ses collections, contenant et contenu, sont estimés sept millions.
Je termine par une jolie page de la vie du marquis de Biencourt.
C’était pendant l’année terrible, le prince Frédéric-Charles et son état-major étaient installés au château d’Azay-le-Rideau. On y faisait bombance. Un jour un officier demande à parler au marquis de Biencourt de la part du prince Frédéric-Charles.
«Il y a ici, monsieur le marquis, cinq voitures qui vous appartiennent.
—Cinq, en effet.
—Son Altesse désirerait s’en servir et je suis chargé de vous en demander l’autorisation.
—Je ne prête pas mes voitures.
—Alors, son Altesse se verra, à son grand regret...
—Faites ce que vous voudrez, ce sera un vol de plus, voilà tout.
—Oh! on vous les rendra.»
Maintenant, pourquoi ces messieurs avaient-ils besoin des voitures du marquis de Biencourt?
Tout simplement pour s’y promener en compagnie d’une douzaine de drôlesses qu’ils avaient fait venir pendant l’armistice. La petite fête terminée, les voitures furent rendues à leur propriétaire.
Le lendemain, Frédéric-Charles passait une revue en face du château.
Tout à coup au milieu de la revue, on vit une grande flamme devant la porte principale. C’étaient les cinq voitures qui brûlaient; monsieur le marquis de Biencourt ne voulant plus s’en servir après ceux qui les avaient souillées, avait ordonné d’y mettre le feu.
Voilà un trait bien français et qui mérite d’être conservé.
C’est toujours ce même esprit chevaleresque qui dictait un jour cette noble parole d’un gentilhomme à Charles-Quint. Celui-ci le sollicitait de recevoir le Connétable de Bourbon, c’était après la bataille de Pavie. Le gentilhomme répondit: «J’obéirai, Sire, mais je vous préviens que le jour même où le traître aura quitté ma demeure, j’y mettrai le feu de mes propres mains, car jamais, ni moi ni les miens ne resterons dans le logis d’un traître.»
Chenonceaux, situé au dire de nos rois de France «en un beau et plaisant pays,» est un château d’un aspect très particulier, et me semble unique en son genre.
Nous y sommes allés par bateau à vapeur. Lorsqu’on a le temps, et qu’on veut bien voir, le bateau est infiniment plus agréable que la locomotive qui passe trop rapidement.
Nous arrivons donc au quai d’embarquement au coup de huit heures, heure annoncée pour le départ. Le bateau n’est pas beau, c’est un petit patouillard qui se repose tout l’hiver, et ne se met en route qu’une ou deux fois par semaine l’été, lorsqu’il trouve un nombre suffisant d’excursionnistes à promener. Un seul homme est à bord, faisant le service et cumulant les emplois. Il est mécanicien, chauffeur, serviteur, etc. Son costume se ressent de son métier. Il porte un vieux pantalon de velours rapé, et une chemise qui semble n’avoir jamais eu de démêlés avec la blanchisseuse.
La vapeur mugit, un long panache de fumée se déroule dans l’air, le bateau semble prêt à démarrer, et cependant nous ne partons pas. Huit heures et demie viennent de sonner à toutes les horloges. Le mécanicien, à plusieurs reprises, a jeté des regards anxieux du côté de la ville. Evidemment il attend quelqu’un. En effet nous apercevons dans le lointain une dame et une petite fille de cinq à six ans, qui accourent de toutes leurs jambes vers le bateau. Enfin! dit le mécanicien, et il s’empresse de donner le signal du départ. J’examine les nouvelles voyageuses.
La dame, en robe de laine noire, me paraît trop simplement mise pour être la mère de l’enfant en ravissante toilette de cachemire blanc, ornée de dentelles crêmes avec capote assortie d’une rare élégance, et mignons souliers de cuir blanc à boufettes de satin, et je me dis en moi-même: la dame, c’est une gouvernante, et la petite fille est sans doute l’heureuse héritière de quelque beau château que nous allons rencontrer sur notre route. Bientôt la dame ouvre un panier, en tire des poires et du pain qu’elle dépose sur une sorte de table pliante et la petite fille se met à manger. Cela m’étonne un peu... Soudain l’homme du bord, noir comme un cyclope, le cou et les bras nus, la barbe et les cheveux en broussailles, sort de la soute au charbon et s’approche de ces dames. Mon sentiment est qu’il ne se gêne pas; mais, comment peindre ma surprise quand je l’entends tutoyer la petite fille: «As-tu fini de manger? Puis il ajoute (je n’en croyais pas mes oreilles): Allons, embrasse papa maintenant! A ces mots l’enfant devient maussade. Elle jette un rapide coup d’œil sur son père d’abord, sur sa belle toilette ensuite, et répond en s’enfuyant: non, non tu es trop sale!... C’était le cri du cœur, et la mère avait l’air d’approuver sa fille! Le père sans se fâcher, trop fier d’ailleurs de sa progéniture, s’en fut chercher le balai pour nettoyer les miettes de pain et les pelures de poires.
Il y a des gens qui sont en avant sur leur siècle, moi je suis en retard; j’étais aussi indignée contre les parents que contre l’enfant. Quelle réponse! mais aussi quelle éducation! Quoi! ce sont les parents eux-mêmes de cette fillette, qui dès sa plus tendre enfance, commencent à en faire une déclassée!
Comment tournera la jeune fille dont on aura développé des goûts trop au-dessus de sa condition. Il faudrait une bien forte dose de raison et de vertu pour résister à la tentation. Il est à craindre qu’à dix-huit ans, elle ne méprise tout à fait son père et ne cherche des gens de bonne volonté pour lui payer des toilettes.
J’ai fait part de mes réflexions. Mes amies m’ont traitée d’arriérée, de réfractaire au progrès... L’une d’elles s’est écrié: «La soie est à qui la paie et les parents ont bien le droit de mettre leurs enfants comme ils veulent.» L’autre a dit: «Si cela les amuse de les habiller comme des gravures de mode, c’est leur affaire; d’ailleurs l’étoffe de laine blanche n’est pas plus chère que l’étoffe de laine noire. L’argument m’a paru triomphant, je n’ai pas cherché à le combattre, j’ai laissé les personnes pour revenir aux choses, pour revenir aux beautés de la nature qui défilaient sous mes yeux.
Les rivières se montrent parfois jalouses des fleuves dont elles sont tributaires. C’est le cas pour le Cher dont les rives, sur un moindre espace sans doute, sont belles à l’égal de celles de la Loire. Quel délicieux paysage, calme, reposé, plein de fraîcheur! Ah! les jolis bosquets feuillus et les jolies prairies d’herbe lisse et moirée! Le Cher tout ensoleillé se déroule comme un collier d’or dans un écrin de velours vert.
Il me semblait humer la brise d’antan, et j’avais plaisir à me repaître de tant de souvenirs historiques enfouis sous les feuillées.
Rien d’original et de grandiose comme l’aspect de Chenonceaux, de ce château en partie assis sur un pont, bâti lui-même sur les piles énormes d’un ancien moulin. Ses arches massives, profondes, barrent entièrement la rivière; vous passez en bateau sous le château avant d’y entrer; une superbe galerie, surmontée d’un second étage, s’étend sur toute la longueur du pont. Les premières arches sont creuses et renferment les caves, les cuisines, les pièces de service et de dégagement.
Chenonceaux remonte très loin dans l’histoire, puisqu’on assure que les Romains, séduits par son site enchanteur, y avaient construit une ravissante villa; on fouille le passé de Chenonceaux sans effroi, sans arrière pensée, la politique n’est pas venue là ourdir ses trames, le sang n’a pas rougi ses pierres, on n’évoque aucun fantôme de victime ou d’assassin; la beauté, l’amour, le plaisir, les arts, l’ont tour à tour habité. J’ai trouvé délicieuse cette journée passée dans cette royale demeure, où j’ai pu laisser ma pensée errer au milieu des plus charmants souvenirs. Diane de Poitiers y apporta l’éclat de sa beauté; Marie Stuart y passa calme et souriante le plus heureux temps de sa vie; Catherine de Médicis qui acheva cette merveille et y entassa les chefs-d’œuvre de sa patrie, vint s’y reposer et oublier les intrigues de la Cour; la reine Marguerite s’y amusa; Louise de Lorraine vint y cacher sa douleur après l’assassinat de son mari par Jacques Clément, et pleurer sous les ombrages mystérieux et profonds qui nous abritent encore. Elle ne sortait de sa retraite que le samedi pour aller entendre la messe à l’église de Francueil, toujours habillée de blanc, suivant l’étiquette du deuil des reines, ce qui l’avait fait surnommer par le peuple qui la voyait passer, la Reine blanche.
Plus tard, Gabrielle d’Estrée fredonna à Chenonceaux les chansons amoureuses que le bon roi Henri composait pour elle. Marie de Luxembourg et Françoise de Lorraine appellent Chenonceaux leur séjour favori. Laure Mancini accompagnée de son oncle le cardinal Mazarin, vint à Chenonceaux dans le but de plaire à Vendôme et de l’épouser. La poétique La Vallière y rêva à son tour.
En 1730, Monsieur Dupin, ancien fermier général, l’achète, le restaure, l’habite et y reçoit l’élite de la société française du XVIIIe siècle. Madame Dupin célèbre par son esprit et ses relations avec J.-J. Rousseau et les autres philosophes du dernier siècle, y mourut en 1779, à l’âge de quatre-vingt-treize ans. C’est grâce aux relations de cette dame avec tous les hommes politiques de la Révolution, que le château de Chenonceaux passa, sans être inquiété, les années désastreuses de la Terreur, et il appartint ensuite au comte René de Villeneuve, son petit-fils. Après lui, le domaine mis en vente aux enchères publiques, devint en 1863 la propriété de Monsieur Pelouze, chimiste.
L’ancienne salle des gardes, un peu sombre aujourd’hui, dont l’extrémité s’ouvrait autrefois sur un balcon, est meublée en chêne et noyer sculptés; des panoplies d’armes et d’armures remontant à François Ier, Henri II et Henri III, décorent les murailles. La plupart des appartements sont tendus en toiles peintes d’un genre particulier, on peut même dire unique, très apprécié des amateurs.[3]
On nous a montré la chambre de la belle Diane, avec sa toilette et son lit tendu de satin blanc; la chambre est vaste, de la fenêtre, un peu petite cependant, on découvre toute la vallée du Cher.
On peut dire que Diane de Poitiers fut l’enchanteresse de son époque; les arts et la littérature doivent la bénir, elle encouragea tous les artistes, les écrivains, les poètes, sauf Marot cependant; mais l’histoire doit se montrer plus sévère, et la morale la condamne absolument.
Diane de Poitiers qui avait des goûts artistiques très développés et très purs s’attacha à Chenonceaux qu’elle embellit à ravir. C’est elle qui fit élever l’admirable façade du levant, ainsi que la magnifique galerie des fêtes bâtie sur le pont, et qui s’ouvre comme je viens de le dire à gauche et à droite sur les deux rives du Cher. Cet édifice grandiose est vraiment la réalisation d’un rêve royal. Cette aile qui s’asseoit tranquillement sur la rivière et prend toute la largeur, est une conception tout à la fois étrange et captivante; la galerie du rez-de-chaussée est une sorte de musée renfermant de nombreux objets de prix. Cette même galerie qui se retrouve au deuxième étage doit devenir un musée de tableaux. On visite aussi le salon vert entièrement tendu et meublé de la couleur de l’espérance. La bibliothèque de Catherine de Médicis, sombre, peu éclairée serait d’un bien haut intérêt si on avait le loisir de l’étudier, elle renferme les archives de Chenonceaux, commençant au XIIIe siècle et comprend cinq mille pièces contenues en cent quarante registres soigneusement reliés.
L’escalier qui est souvent un écueil pour les architectes est ici conçu avec un rare bonheur.
«L’architecte a abandonné la vis de Saint-Gilles et adopté une innovation italienne, c’est-à-dire l’escalier à travées parallèles réunies par des paliers; cet escalier, appliqué au milieu de la façade du couchant, n’en dérange point l’ordonnance. L’escalier de Chenonceaux et celui d’Azay-le-Rideau sont, sinon les plus anciens, au moins les plus somptueux modèles de cette disposition importée d’Italie; car l’escalier de Chambord, malgré la conception magistrale de sa double vis, reste encore fidèle aux antiques traditions de l’art français.»
La chapelle, due à François Ier, intelligemment réparée, a conservé son cachet primitif, c’est un charmant spécimen du style gothique Renaissance; de sveltes colonnettes en faisceaux supportent des tribunes et une voûte à pendentifs sculptés et découpés à jour; l’autel n’est qu’une simple table de pierre soutenue aux angles par des colonnettes très élégantes; à côté de la crédence on remarque une étroite ouverture en œil-de-bœuf oblique, qui communiquait avec l’oratoire de la Reine Louise. Une loge s’ouvre à droite, dans l’épaisseur de la muraille: c’est la place d’honneur réservée aux châtelains. Un caveau sépulcral est établi sous la chapelle.
Les vitraux peints, fort remarquables, sortent certainement de cette admirable Ecole de Tours qui a produit tant de chefs-d’œuvre; ils sont au nombre de six, représentant Notre Seigneur Jésus-Christ, saint Michel, saint Pierre, saint Thomas et saint Gatien; sur trois verrières modernes, on voit sainte Marguerite, sainte Catherine et saint Guillaume.
La consécration de cette chapelle fut faite en 1518, par Antoine Bohier, Cardinal-Archevêque de Bourges, et frère de Thomas Bohier, premier propriétaire, et on peut dire fondateur du château.
Les chroniqueurs du XVIe siècle ont décrit les fêtes somptueuses qui se donnèrent à Chenonceaux.
Ils nous racontent les superbes triomphes que Catherine de Médicis fit organiser à l’intention de François II et de Marie Stuart. L’entrée solennelle des jeunes princes eut lieu le dimanche, dernier jour de mars 1560. Les artistes, les décorateurs, les poètes frottés d’un peu de mythologie, firent des merveilles empreintes d’un cachet exceptionnel de grandeur et de nouveauté.
«Les arcs de triomphe, les obélisques, les colonnes, les statues, les fontaines jaillissantes, les autels antiques, étaient chargés d’emblèmes et d’inscriptions empruntées aux grands poètes de Rome, de la Grèce et de l’Italie moderne. Les feux artificiels y mêlèrent leurs surprises: «dont tout le monde, les yeux ouverts et les bouches béantes, non seulement fut esbahy mais estonné de joie et grande admiration pour n’avoir esté auparavant ce jour jamais veu chose semblable;» enfin, trente canons, rangés en bataille sur la terrasse de la rivière, y ajoutèrent par leurs salves répétées, quelque chose d’imposant.» Peu d’années après la reine-mère reçut son fils Charles IX à Chenonceaux et le fêta pendant quatre jours mais les détails manquent sur cette réception. En 1577 Catherine offre à ses deux fils, Henri III et le duc d’Alençon, la plus fameuse de toutes ses fêtes. Le 2 mai, le duc d’Alençon avait repris sur les protestants la ville de la Charité et ce succès méritait d’être célébré.
Le 15 du même mois, le roi donna un grand festin à son frère au Plessis-lez-Tours, et le sombre château de Louis XI vit une de ces fêtes orientales auxquelles son fondateur ne l’avait guère habitué. Les dames y parurent en habits d’hommes, vêtues de vert (c’était la couleur des fous) et firent le service à la place des officiers de la Cour. Tous les assistants furent aussi habillés de vert, et la dépense de ces vêtements ne s’éleva pas à moins de soixante mille livres.
Le dimanche suivant, Catherine de Médicis fêta à son tour le jeune triomphateur et ses compagnons de guerre. Elle reçut la cour à Chenonceaux et lui offrit un banquet dont le faste licencieux devait éclipser celui du Plessis.
Les traits principaux de ces plaisirs fantastiques nous ont été transmis par Pierre de l’Estoile, dans le Journal de Henri III.
Le festin eut lieu dans le jardin, derrière la grosse tour, près de la fontaine du Rocher. Le roi y figura habillé en femme, comme il le faisait quelquefois dans les fêtes, il portait un collier de perles et trois collets de toile, dont deux à fraise et un rabattu, tels que les portaient les dames de la cour.»
«Au dessous du roy s’assirent ses mignons, tous fardés, peints, pommadés comme leur maître avec de grandes fraises empesées larges d’un demi-pied, de façon dit l’Estoile qu’à voir leurs testes dessus leurs fraises, il sembloit que ce fust le chef de saint Jean en un plat.» Les trois reines assistaient au festin, Catherine, Marguerite sa fille et Louise de Lorraine sa bru, les Reines étaient entourées de leurs Dames d’honneur, et de tout l’escadron volant des jeunes filles; l’Estoile ajoute qu’en cette fête qui coûta cent mille livres, c’est-à-dire un million et demi de notre monnaie actuelle «tout estait parfait et en bel ordre.» Franchement c’eût été malheureux qu’après une pareille dépense, les choses n’eussent pas réussi.
Si j’étais architecte je ferais avec les expressions techniques une description savante de Chenonceaux, cette merveille de la Renaissance, cela m’est impossible, je ne sais qu’admirer cet ensemble incomparable: ici la grande cour d’honneur, le pont levis, le donjon superbe qui sort des douves profondes, remplies des eaux du Cher; là les sveltes tourelles, les hautes cheminées, et les fenêtres sculptées qui se détachent des toits pointus.
La façade orientale, vue du parterre de Diane aux bords de la rivière, est admirable; le décorateur de l’Opéra comique s’en est inspiré dans le décor du second acte des Huguenots.
J’ai éprouvé la même admiration pour le parc. Le jardin français, tel que le tailla Le Nôtre avec ses belles ordonnances, ses terrasses à balustre, ses bassins, ses cascades, ses statues et ses rocailles, ses charmilles, ses labyrinthes, ses vastes boulingrins, ses grandes lignes régulières qui s’allongent dans l’espace, me semble plus grandiose que le jardin anglais proprement dit. Celui-ci primitivement a dû être inventé pour dissimuler son peu d’étendue et son irrégularité. Le regard sans cesse arrêté soit par une allée tournante qui souvent se replie sur elle-même, soit par un massif épais qui barre l’horizon, le regard, dis-je, ne peut réellement se rendre compte de l’importance du terrain, ceci n’est point une critique. Si le jardin français s’aperçoit d’un coup d’œil, le jardin anglais sait ménager les surprises et l’imprévu, et je reconnais tout le parti que le parc anglais permet de tirer d’un emplacement ingrat, où il eut été impossible de dessiner le vrai jardin français avec ses majestueuses ordonnances, jardin en définitive beaucoup plus coûteux que des pelouses ou prairies semées çà et là de grands arbres, de massifs, d’arbustes et de quelques corbeilles de fleurs.
La création de jardins et de parterres dignes des constructions, occupa longuement la reine Catherine et la favorite Diane. Des jardiniers italiens et français, Le Nôtre et même le célèbre potier Bernard Palissy, donnèrent des plans et des dessins.
«Sous l’influence des artistes italiens, l’horticulture prit un grand essor. Les jardins du XVIe siècle représentaient des figures de toutes sortes. Les unes géométriques, les autres de pure fantaisie et dessinaient de capricieuses arabesques et d’élégantes broderies, de fleurs odoriférantes principalement.» On préférait alors l’arôme à la beauté. Les bordures étaient de buis ou de romarin, avec des avenues de grands arbres, des palissades de coudriers et de charmes, et des haies d’aubépines. De longs berceaux de charpente, couverts de treilles et flanqués de cabinets ombreux, entouraient le parterre ou le divisaient en plusieurs jardins particuliers. Les arbres et les arbustes étaient taillés en figures bizarres et peuplaient les parcs d’un monde d’êtres fantastiques. Des bassins et des jets d’eau complétaient la décoration froide et trop symétrique des jardins italiens, où tout semblait subordonné à une loi unique: la fraîcheur, l’ombre et le mystère.
C’est dans ce goût étranger que Diane de Poitiers entreprit les jardins de Chenonceaux; elle employa pour la préparation des terrains seulement, quatorze mille journées d’ouvriers, et la dépense s’éleva à plus de trois mille livres, somme énorme pour le temps. L’argent était rare à cette époque, et nous voyons, d’après les comptes même de l’intendant de Chenonceaux, qu’un maître maçon gagnait quatre sols par jour, un simple ouvrier, deux sols six deniers, une journalière vingt deniers; mais aussi le froment ne valait en 1547, que quinze à dix-sept sols l’hectolitre, et le vin, trois livres le poinçon soit, deux cent cinquante litres.
Diane fit venir un fontainier de Tours pour diriger les sources et en tirer parti. Elle fit ouvrir des allées avec des cabinets de verdure; elle fit un jeu de paume et un jeu de bague et enfin un magnifique dedalus, labyrinthe inextricable où l’on pouvait errer longtemps dans les isoloirs sans trouver d’issue. Bernard Palissy exposa lui-même ses idées dans son Dessein d’un jardin délectable, écrit spécialement pour Chenonceaux et dédié à la reine-mère. «Il emprunte au style italien la division du jardin en compartiments symétriques, les allées à angle droit, les avenues d’ormeaux, les tourelles et les cabinets de verdure. Mais ce qui est entièrement propre à Palissy, ce qui est nouveau, c’est le goût de la nature qu’il introduit dans le jardin, c’est l’idée de marier le jardin avec le paysage environnant, avec le coteau, la prairie et la rivière; ce sont ces grottes rustiques, ces rochers ruisselants d’eau, ces fontaines, ces ruisseaux aux méandres capricieux avec des îles et des ponts, ces mouvements de terrain unissant la colline à la plaine. Palissy eut trouvé le jardin moderne s’il n’eût été trop préoccupé des travaux de son art de terre et de ses figures émaillées.
On nous a montré le chêne de Jean-Jacques, la fontaine de Henri III, mais nous n’avons pas vu le fameux chêne planté jadis par Diane et dont j’avais entendu raconter l’histoire. Ce chêne avait commencé par une promenade de cent mètres qu’on lui fit faire pour s’en aller des bords du Cher qu’il habitait, au beau milieu du parc. Ce changement de demeure n’avait point nui à sa vigoureuse santé il s’acclimata fort bien, l’opération était pourtant difficile. Tous les bœufs du pays n’avaient pas eu les cornes assez fortes pour ébranler le chêne et la masse de terre qui lui servait de piédestal, il fallut établir des machines et d’énormes cabestans pour en venir à bout.
Cela coûta cinquante mille francs. Et, pendant un an, un jardinier n’eut pas d’autre ouvrage que d’arroser le chêne en été et de le réchauffer en hiver par de fortes fumures. Après tout, ce chêne est peut-être celui qu’affectionnait Jean-Jacques qui lui aura donné son nom.
C’est avec un plaisir extrême que nous avons promené notre rèverie dans les lieux enchanteurs où s’égaraient autrefois les beaux pages et les gentes damoiselles de la Cour; et nous avons répété avec le chantre de l’allée de Sylvie:
On dit que Madame Pelouze a déjà dépensé un million et demi à la restauration de Chenonceaux; mais il faudra encore beaucoup d’argent pour rendre à ce fier château et à ces beaux jardins leur éclat primitif. Ainsi le grand parterre entouré de balustres avec sa fontaine monumentale au centre est dans un lamentable état de délabrement.
J’ai eu quelques déceptions, il n’y a point de médailles sans revers. J’avais entendu parler du cocher grand style de Madame Pelouze. N’oubliez pas, m’avait-on dit, de visiter les écuries qui contiennent trente magnifiques chevaux. Le cocher grand style vous énumèrera avec complaisance les qualités des nobles coursiers dont vous verrez les noms inscrits en lettres d’or au-dessus de chaque box. Quand vous serez arrivé aux remarquables purs-sang envoyés par l’empereur du Maroc à M. Grévy, qui s’était empressé de les expédier chez sa sœur, vous verrez avec quel superbe dédain le cocher grand style vous glissera cette petite phrase: en effet ces chevaux sont d’admirables bêtes, c’est un joli cadeau, l’empereur du Maroc a fait de son mieux, mais qu’est-ce qu’un sultan à côté du président de la République Française!... Nous avons donc demandé à voir les chevaux. Je ne sais trop, je vais m’informer, a murmuré le valet pris par d’autres visiteurs et que déjà nous avions dû attendre assez longtemps.
Cette fois il n’a pas tardé à revenir suivi d’un domestique grisonnant, fort modeste celui-là, qui nous a humblement avoué qu’il venait d’expédier tous les chevaux à Paris pour y être vendus. Il ne reste qu’une vieille jument, en ce moment à la prairie, a-t-il ajouté, je puis aller la chercher. «Non, non me suis-je écriée un peu étourdiment, c’est inutile ne la dérangez pas.»
La pluie d’ailleurs commençait à tomber, une de ces petites pluies fines qui n’ont l’air de rien et qui mouillent beaucoup. Nous avions plusieurs fois croisé la dame et la petite fille qui visitaient, comme nous, Chenonceaux.
Revenue sur le bateau j’ai eu ma revanche du matin. La toilette de la petite fille était fort abîmée, sa capote n’avait plus son idéale blancheur, les dentelles mouillées pendaient piteusement sur la robe défraîchie, les souliers semblaient déformés et complètement salis, et je n’ai pu m’empêcher de faire remarquer que, si la petite fille avait porté une simple robe en grisaille de laine ou un costume en toile de Vichy, la toilette n’eut point été perdue. Un coup de savon des mains maternelles lui eût rendu son premier lustre; mes amies ont eu le bon goût de se rendre à l’évidence et de me donner raison.
Si j’insiste sur ces petits détails c’est que je leur crois plus d’importance qu’il ne paraissent en avoir. Ils sont le signe évident des tendances fâcheuses et des aspirations malsaines qui se développent outre mesure depuis quelque temps; ils sont l’indice en cette fin de siècle d’un déclassement qui nous mènera loin, je le crains.
Il a fait mauvais jusqu’au soir, quand le ciel pleure, la terre est moins gaie, mais je rapportais une si belle provision de souvenirs et tant d’enchantements dans les yeux que j’ai pardonné au temps les maussaderies du retour[4].
Comme tu le vois, mon cher Henri, tantôt c’est l’extérieur qui étale d’admirables beautés, tantôt c’est l’intérieur somptueusement décoré, parfois ce sont les deux qui brillent d’un éclat incomparable.
Ici, le parc l’emporte sur le château par le pittoresque de sa situation: vue étendue et variée, sites enchanteurs, eaux vives, cascades tapageuses, pelouses veloutées, drapées de grandes corbeilles de fleurs ou incrustées de mosaï-culture d’une régularité parfaite. Là, le château qui se détache sur l’émeraude des vastes prairies, se mire dans la transparence des eaux ou s’abrite sous l’ombre épaisse des bois et domine par son aspect féodal et princier, par son architecture remarquable.
C’est aussi de la dentelle de pierre, pierre blanche plus facile à travailler, plus agréable à l’œil; mais qui ne vaut pas quand même celle des antiques clochers à jours et des vieux châteaux-forts de Bretagne, façonnés dans le granit. L’intérieur arrive à son tour avec ses meubles rares, ses collections précieuses, ses bibelots artistiques, ses tableaux de maîtres. Cependant je consignerai ici mon intime pensée. Plusieurs de ces beaux châteaux sont un peu le palais de la Belle au bois dormant, j’ai ressenti ce sentiment d’une manière très vive à Chenonceaux, ils ne sont point habités. Pas de maîtres et pas beaucoup plus de domestiques. Un portier qui reste dans sa loge, il faut bien quelqu’un pour répondre, et cependant il me souvient d’avoir un certain dimanche parcouru dans tous les sens un joli parc entourant un joli château auquel nous sonnâmes en vain, sans rencontrer âme qui vive. Le gardien, cette après-midi là, avait sans doute pris la clef des champs.
Lorsque vous êtes entré, un valet de chambre se présente pour vous faire visiter. En général les maîtres sont en voyage, c’est la phrase stéréotypée sur les lèvres des serviteurs; ils voyagent ou vivent ailleurs plus simplement que ne le comporterait leur propriété. Il est certain que pour mener le train considérable qu’exigent de pareils châteaux, il faudrait une fortune énorme, que tous leurs propriétaires n’ont pas.
Leurs châteaux sont des musées qu’ils respectent des trésors dont ils sont fiers à juste titre et qu’ils gardent précieusement, mais dont ils ne peuvent se servir.
Les magnifiques châteaux dont je viens de te parler en détail sont les gros diamants dont la Touraine est en partie l’écrin; mais que de perles précieuses, que de ravissants joyaux, ce bel écrin renferme encore! Dans ce fortuné pays, on peut dire que chaque bourgade, ville ou village, a son château qui le préserve de l’oubli par ses souvenirs historiques, ou l’embellit de sa propre beauté.
Je citerai: Beaumont-la-Ronce, ancien château seigneurial; le château de la Tourballière, tous les deux érigés en marquisat, le premier en 1757, le second en 1656.
Le château de Beugny qui s’enfonce dans la forêt de Chinon. Boussay qui détache son profil gothique au milieu des eaux. Dans ce château sont nées quatre illustrations de la famille de Merou: Jean, chambellan du roi (1363), Pierre, amiral de France (1416); Philippe, chambellan du roi Louis XI (1461); Jacques-François, président de l’Assemblée Nationale (1789), général de division, mort en 1810.
Le château de Brizay, qui appartenait jadis à la famille de Maillé, et fut alors le théâtre d’un évènement douloureux: tous ses habitants furent un jour ensevelis sous les plafonds qui s’écroulèrent à la fois. Simon de Maillé, archevêque de Tours, qui se trouvait dans une partie très élevée du château, survit seul à désastre.
Le très beau château de Commaire, construction moderne, appartenant au marquis de Lussac.
Le château de Grillemont, possédé par le fameux Tristan, et habité par Louis XI.
L’ancien château de Plessis-Rideau, que Gédéon Tallemant des Réaux acheta vers 1650, au prix de cent quinze livres, et auquel il donna le nom de château Réaux.
Le château de la Guerche, construit sous Charles VI, est fort curieux; situé sur les bords de la Creuse, il présente du côté de la rivière qui le baigne, une élévation de plus de cent pieds. On y voit six rangs de voûtes superposées. Les greniers sont au rez-de-chaussée du côté de la cour, et se composent de vastes pièces voûtées bien sèches, bien aérées, quoiqu’au niveau de la Creuse. Les murs à leur base ont cinq mètres d’épaisseur.
Le beau château de Chavigny, bâti dans le goût de la Renaissance. Le château d’Epigny, où naquit en 1717, le chevalier Pierre de Fontenailles, qui a laissé diverses poésies.
Le château de Montbazon situé sur une haute colline, construit au commencement du XIe siècle par Foulques Nerra. En 1459, Charles VII, tenant sa Cour dans le château de Montbazon, y reçut de François II l’hommage du duché de Bretagne.
Le château de la Bourdaisière où naquit Gabrielle d’Estrées en 1565.
Le château de la Vallière, d’où la famille de Baume-Le-Blanc avait pris son nom et qui rappelle tout à la fois la pieuse carmélite et les jours ensoleillés d’amour du grand roi.
Le vieux manoir de la Mothe-Sonzay, qui éveille l’attention des archéologues, fut construit par Henri II pour Diane de Poitiers.
Le château de Rochecotte, ancienne habitation et lieu de naissance du fameux chef vendéen Guillon, marquis de Rochecotte, condamné et fusillé en 1798, à la plaine de Grenelle, à Paris, à l’âge de vingt-neuf ans.
Un peu plus loin on remarque le château moderne de Saint-Patrice, appartenant à Monsieur le comte de Chabrol. Son parc renferme une épine miraculeuse qui commence sa floraison dans le mois de décembre et s’épanouit même sous la neige. La tradition populaire attribue ce phénomène végétal à saint Patrice qui jadis, après avoir traversé la Loire, planta son bâton en ce lieu. Ce bâton prit racine, devint buisson et se couvrit de fleurs. Depuis cette lointaine époque, le buisson qui repousse toujours, rappelle fidèlement chaque année le passage en ces lieux du patron de l’Irlande. Aussi les Irlandais qui visitent la Touraine ne manquent-ils jamais de faire ici un pieux pèlerinage.
Le majestueux château d’Ussé, qui, de son cadre de grands bois, domine le vaste bassin de la Loire. Ce château date de la première moitié du XVIe siècle. Il fut en partie construit par Vauban qui l’habita. Sa chapelle gothique est tout à fait charmante.
J’oublie certainement quelques vieux châteaux semés çà et là par Charles VII. Mais voici la Herpinière, une de ses maisons de plaisance, et Bonaventure, un pavillon élégant qu’il aimait et qu’il avait fait construire pour Agnès Sorel. Il venait souvent avec elle prendre le plaisir de la chasse à l’oiseau, dans les environs.
Le château de la Roche-Racan m’a fort intéressée. C’est là que naquit en 1589 et que mourut en 1670, âgé de quatre-vingt-un ans, le célèbre poète Honorat de Breuil, marquis de Racan, d’une des plus anciennes familles de Touraine. Le château de la Roche bâti à mi-côte et dont les murs ont quatre mètres d’épaisseur à la base, est remarquable aussi par une tour octogone d’où la vue s’étend sur une superbe vallée. Je comprends qu’en présence de cette belle campagne calme et recueillie, l’âme rêveuse du poète ait cherché dans la contemplation des beautés de la nature qui conduisent à Dieu, ses meilleures inspirations. Son esprit bercé, dans un rêve infini, a produit des odes sacrées tirées des psaumes et des poésies pastorales qui, si elles manquent de force, ont cependant donné à la langue poétique une harmonie et une grâce naturelles qu’on ne connaissait pas jusque là.
J’énumèrerai encore, entrevus à vol d’oiseau:
Le vieux château-fort de Montrésor, autrefois flanqué de tours et entouré de douves profondes.
Le château de Candé qui appartient à la famille Drake del Castillo.
Le château d’Armilly. Le château des Hérissaudières. L’ancien château fortifié de Noisay, à la physionomie sévère.
Le château de Brou, bâti au XVe siècle par le maréchal de Boucicaut.
Le château des Etangs qui était autrefois une des principales forteresses du pays. Les Ligueurs y avaient un corps de troupes qui ravageaient les environs.
Le château de Bouffret construit en style gothique.
Le château de Corcoué, style Renaissance.
Les vieux châteaux de Saché et de Marcilly-sur-Maulne.
Le beau château de la Ferrière avec sa grande forêt du même nom.
Gizeux, demeure du XIIe siècle.
Le château de Vantourneux, à Madame la comtesse de Montesquiou.
Le château de Bossay avec son antique donjon du XIIIe siècle.
Le château de la Chenardière qui appartint aux familles de Montmorency, de Laval, de Maillé. Les châteaux de Sennevières, de Sazilly, du Coudray-Montpensier, de Valesne, de Courcelles, de Sonnay, de la Guérinière, de Montgoger, de Rouvray, de Coulaines, de Custière, de la Branchoire, de Valmer, de Poillé, d’Alette, des Recordières, des Ports, des Bordes, de la Brêche, de Saint-Ouen, etc., etc.
J’en passe sans doute beaucoup et peut-être des plus beaux, mais quand on voyage rapidement, on ne peut tout voir, et encore moins tout retenir.
Cette façon prompte de parcourir le pays ne manque pas d’attraits. Ce qu’on voit se présente sous son meilleur aspect, on n’a pas le temps d’envisager l’envers des choses ni d’examiner leur mauvais côté.
J’ai vivement regretté de ne pouvoir visiter le vieux château de Langeais, en mémoire de notre bonne duchesse. En effet, n’est-ce pas dans la grande salle de ce château qu’eut lieu en 1491 le mariage de Charles VIII avec Anne de Bretagne. Oui, l’élégante Touraine est remplie de souvenirs de notre fière Bretagne, qui semble avoir posé sa griffe de granit sur tout ce qu’elle a touché.
Des étrangers ont, paraît-il, acheté ce château qui reste fermé aux visiteurs, mais il n’y a pas bien longtemps encore on pouvait lire sur une pierre posée dans l’escalier, l’inscription suivante: «La pierre phyllozofalle, c’est estre content de ses biens; qui n’a souffisance, n’a rien; 1520.»
Le donjon du château de Langeais est le doyen des édifices de ce genre, il fut construit vers 992 par le duc d’Anjou, Foulques Nerra. Plus tard le château devint la propriété de Pierre de Brosse, barbier de Louis IX. Il passa ensuite aux mains de Jean Bourré, ministre et favori de Philippe le Hardi qui le reconstruisit entièrement. C’est à Langeais que se passait autrefois une coutume étrange, un devoir féodal des plus singuliers. Quand un roi de France arrivait dans cette bourgade pour la première fois, ses habitants étaient obligés d’aller à sa rencontre à une demi-lieue, tenant chacun en main une petite botte de paille. Hein! les habitants ne se mettaient pas en frais pour recevoir leur roi! Cette bienvenue extraordinaire dont on n’a pu me donner l’explication, eut lieu le 14 novembre 1565, lorsque Charles IX vint au château de Langeais, où il passa la nuit.
J’ai entrevu le château de Plessis-lès-Tours. Ce château construit en 1463 par Louis XI, fut sa demeure favorite. C’est là qu’il mourut en 1484, assisté par saint Vincent de Paul et cinq autres religieux que le roi avait près de lui depuis un an. C’est à Plessis-les-Tours que le traître La Balue fut d’abord emprisonné. Son cachot était la tour qui contient l’escalier; voilà à peu près tout ce qui reste de ce château. Ah! ce n’est plus une demeure royale, ce n’est même plus une belle ruine que l’on conserve respectueusement. Décadence des choses humaines: ses pieds baignent dans la fange et ses jardins sont devenus un réceptacle de fumiers et servent de dépotoir à la ville!
Le château de Richelieu n’a pas été plus heureux. Il fut bâti en 1637, par le célèbre cardinal, dans un petit village auquel il donna son nom, et dont il essaya de faire une ville; mais les villes ne s’improvisent pas, elles sont l’œuvre patiente du temps. Et Richelieu n’est aujourd’hui qu’un chef-lieu de canton de deux mille trois cent dix-huit habitants.
C’était un splendide château. Richelieu avait déployé là toute sa magnificence. A l’extérieur, architecture admirablement ornementée; à l’intérieur, marbres, sculptures et peintures des grands maîtres remplissaient les appartements.
Quelques-uns des tableaux sont à Tours, quelques autres à Paris, ainsi que la fameuse table de marbre dont il a été parlé si souvent et qu’on voit aujourd’hui au Louvre.
Quant au château, l’un des plus beaux de France, comme je viens de le dire, et peut-être le plus régulièrement bâti, il n’en reste pas trace. Il a été démoli du faîte à la base, sans qu’on en retrouve une seule pierre.
Le même sort attendait le château de Chanteloup, habitation vraiment royale que le duc de Choiseul, ministre sous Louis XV, avait acheté en 1760. C’est pendant son exil dans ce château, exil qui lui valut tant de sympathies, qu’il fit édifier cette élégante pyramide de quarante mètres de haut, composée de sept étages, qui vont toujours en se rétrécissant, qu’on appelle La Pagode. Elle existe encore et on la voit de loin s’élevant au milieu des bois.
Une table de marbre, placée au rez-de-chaussée, portait le registre de maroquin rouge, où l’on inscrivait le nom des personnages éminents qui venaient visiter le duc pendant sa disgrâce.
Le château de Champigny habité par des princes du sang et jadis par Charles IX, n’est plus lui aussi qu’un souvenir. Richelieu en étant devenu propriétaire le fit complètement démolir.
Il existe cependant la Sainte-Chapelle dont les vitraux, représentant la vie de saint Louis, sont très remarquables.
Le bourg de Champigny est la patrie de Lambert, grand musicien sous Louis XIV. Sa fille épousa Lulli.
Du château de Marmande il ne reste plus qu’une tour de cent dix pieds de haut, qu’on nomme la Flèche de Marmande, et un gros pavillon qu’on appelle la Tour carrée.
Sainte Radegonde dont le nom vient de la pieuse reine de France Radegonde, qui l’habita longtemps, est un joli village tout près de Tours.
On y remarque les ruines de l’ancienne et très célèbre abbaye de Marmoutier.
C’est au IVe siècle que saint Martin, évêque de Tours, fonda cette célèbre abbaye, dont la renommée devait s’accroître de siècle en siècle. Elle était aussi riche des dons du ciel que de ceux de la terre. D’un côté, les vertus austères de ses saints moines qui inspiraient la plus grande vénération; de l’autre, les immenses biens, dus à la piété des peuples et des rois qu’elle possédait. Ce fut avec la sainte ampoule de Marmoutier qu’Henri IV fut sacré.
L’église et les anciens bâtiments rendus en 1797 ont été démolis. Il ne reste que le vieux portique qui servait d’entrée principale au sud. Le superbe escalier qui avait échappé aux fureurs révolutionnaires a été vendu depuis et emporté en Angleterre. On en voit une reproduction très exacte au musée de Tours. Marmoutier appartient aujourd’hui aux Dames du Sacré-Cœur, qui ont fondé dans l’enceinte même de l’abbaye un très beau pensionnat.
Les grottes de Savonnières d’une longueur de cent dix mètres et divisées en plusieurs compartiments qu’on appelle ici caves gouttières, sont curieuses à visiter.
Elles ont beaucoup d’analogie avec les fameuses grottes d’Arcy dans l’Yonne. Elles sont si sombres qu’on ne peut y entrer qu’avec de la lumière. L’eau qui suinte des voûtes forme à la longue de petits ruisseaux qui ont le don de pétrifier tout ce qu’on y dépose. Mais il faut beaucoup de temps pour que l’objet, fruit, légume, nid devienne pierre. Il faut aussi plusieurs mois, pour que ces eaux, qui tombent goutte à goutte se soient solidifiées, dans les moules généralement en métal qui les reçoivent; on fait ainsi de fort jolis camées qui ont toute l’apparence d’une pierre finement sculptée.
Le dépôt de ces eaux, blanches et diaphanes, chargées de sels calcaires, forme encore avec le temps des cristallisations remarquables: des stalactites bizarres qui ont la transparence et le poli de l’albâtre descendent des voûtes.
Les eaux de Savonnières ne sont pas les seules du département à fabriquer des pétrifications, les eaux de l’étang de Saint-Genault dans les environs de Loches agissent ainsi sur le bois auquel elles donnent la pesanteur de la pierre tout en le nuançant de diverses couleurs, sans lui enlever son caractère primitif; d’autres eaux ont la propriété de rougir les pierres blanches qui y séjournent, de former des incrustations brillantes sur les mousses qu’elles baignent.
Non loin des grottes pétrifiantes de Savonnières se trouve le château de Villandry, une belle demeure ombreuse et fleurie, son beau parc se distingue par ses pelouses toutes brodées de mosaïculture, cela devient un art véritable à l’aide de ces feuillages aussi réguliers de formes que variés de tons, on arrive à tracer les plus charmants dessins, élégants festons, capricieuses arabesques, encadrent les initiales enlacées des propriétaires, parfois même, ce sont leurs armoiries qui se détachent sur les tapis d’herbes fines.
L’histoire des jardins célèbres de l’antiquité est parvenue jusqu’à nous.
On écrira aussi celle de quelques-uns de nos jardins modernes à commencer par celui de Monsieur Mame, qui se nomme les Touches et se trouve à Ballan à dix kilomètres de Tours. Les serres de ce beau jardin renferment les plantes les plus curieuses et les plus rares venues de tous les continents, de merveilleuses orchidées, des roses incomparables, des camélias superbes, quel éclatant fouillis de corolles et de calices, quelle abondance de parfums exquis, quelle élégance de formes, quelle richesse de coloris; mais aussi quel entretien méticuleux, que de soins délicats et constants! Chaque mois le plus beau de ces palais de verre se remplit d’une collection choisie des fleurs du moment, c’est la collection des azalées, aux millions de fleurs variées, que nous avons vue dans tout son épanouissement. Je suis sortie absolument éblouie. Ce serait à vous donner envie d’être fleur et d’habiter ces serres là.
Je n’avais que le temps de visiter l’une ou l’autre des propriétés de Monsieur Mame.
En ces jours de chaleur j’ai préféré la campagne à la ville. Les produits de la nature l’ont emporté sur ceux de l’industrie, et cependant la belle imprimerie Mame fondée au commencement du siècle, et qui occupe plus de douze cents ouvriers, mérite bien qu’on la visite.
«La façade de cet établissement est un modèle de grâce, de convenance, d’harmonie, avec lequel rien de moderne ne saurait rivaliser à Tours.»
L’intérieur de ce grand établissement est aussi parfait que possible, tant au point de vue des machines, de la perfection du travail, que du bien-être des travailleurs.
On peut dire que Monsieur Mame est le père de ses douze cents ouvriers avant d’en être le maître, c’est le plus bel éloge qu’on puisse lui adresser.
En fait d’enclos, on visite encore dans un faubourg de Tours le château Beau Jardin, une jolie demeure plantée au milieu d’un parc, sorte de jardin zoologique haut muré. Tous les animaux non féroces de la création auraient le droit si on pouvait les y amener, d’y vivre en liberté.
Les emplumés très nombreux et de races variées picorent où bon leur semble; les quadrupèdes jouissent des mêmes privilèges; de belles vaches blanches vous voient passer sans perdre un coup de dent; les chevreuils bondissent près de vous, les gazelles viennent vous regarder de leurs grands yeux doux; une jolie chèvre de Mongolie suit vos pas; de graves lamas sont assis tranquillement sur les marches du perron et ne se dérangent pour personne.
On comprend qu’ils sont chez eux; tout ce monde vit à sa guise dans cet heureux paradis terrestre, pendant quelque temps du moins, car l’existence de ces nombreux hôtes n’est pas longue, paraît-il, malgré leur liberté relative et les soins dont ils sont l’objet. Une consolation, c’est de penser que ces pauvres victimes de la civilisation sont encore utilisés après décès; leur propriétaire les envoie généreusement enrichir le muséum d’histoire naturelle de Tours[5].
Le temps qui ne replie jamais son aile, m’a entraînée dans son vol incertain et je n’ai pu visiter la magnifique poudrerie du Ripault (d’ailleurs cela eût été fort difficile), qui produit en moyenne cinq cent mille kilos de poudre par an, ni la colonie de Mettray fort intéressante.
Mettray est le type des colonies pénitentiaires agricoles en France et à l’étranger.
Ce passage d’une notice de Monsieur Augustin Cochin sur Mettray, suffit pour faire connaître et apprécier cette belle fondation.
«Pratique de la religion, amour du travail, esprit de famille, émulation de l’exemple, culte de l’honneur, habitude de la discipline, bon usage de la liberté; tout le système pénitentiaire, toute l’influence moralisatrice de Mettray sont dans ces grandes et simples idées.
«Une autre institution non moins importante que la première a été fondée dans la commune de Mettray sous le titre de Maison paternelle. Cet établissement n’est par le fait qu’un collège de répression où l’on reçoit les élèves indisciplinés des maisons d’éducation, et à la faveur duquel on évite le renvoi, parti extrême, qui compromettrait l’avenir de l’enfant, sans remédier au mal.
«Grâce à ces deux institutions, l’enfance pauvre délinquante, et l’enfance riche insubordonnée, se trouvent désormais soumises à une influence vraiment moralisatrice.»
Honneur aux fondateurs de ces excellentes institutions.
Tours, dont la fondation remonte fort loin, dont l’histoire est longue et compliquée, est actuellement une belle ville qui produit un très grand effet avec ses magnifiques ponts, ses nombreuses promenades, ses boulevards, ses avenues, celle de Grand-Mont particulièrement, ses rues larges aux maisons élégantes, aux magasins superbes.
Sa situation est charmante au milieu d’une plaine fertile qui s’étend entre la Loire et le Cher. La plupart des monuments qui l’embellissent sont modernes. Il ne reste de l’admirable basilique de Saint Martin, que deux clochers dont l’un porte le nom de Tour de l’horloge, et l’autre celui de Tour Charlemagne.
Le palais archiépiscopal est très remarquable aussi, la cathédrale l’est également. Saint Martin fut son fondateur. Détruite par un incendie en 561, Grégoire de Tours la reconstruisit en lui donnant de plus vastes proportions. Un second incendie la consuma à la fin du XIIe siècle. Cette fois sa réédification se poursuivit avec lenteur, elle ne fut achevée qu’en 1550. Le portail accompagné de deux tours fort élevées est orné au milieu d’une rosace de toute beauté. En fait d’objets d’art, elle ne contient guère que le tombeau des enfants de Charles VIII, en marbre blanc.
Elle présente cette particularité, que l’on rencontre dans beaucoup d’églises, principalement dans celles qui affectent la forme de la croix latine et qui consiste en une inclinaison très apparente du chevet vers la gauche, représentation symbolique de l’inclinaison de la tête de Notre-Seigneur Jésus-Christ sur la croix.
Ce soir même, je reprends le chemin de Bretagne, mes pérégrinations sont finies et... mes descriptions aussi; mais peut-être encourageront-elles mon cher fils à venir à son tour visiter le Jardin de la France, cette terre riche et souriante, cette belle Touraine, constellée de souvenirs... capitonnée de châteaux.
A mon fils Bertrand.
Je m’intéresse vivement à ton beau voyage à travers l’Algérie, la perle de nos colonies françaises. Tu as visité Alger, la superbe, la reine de ces lieux; Oran, la ville maritime; Constantine, la ville forte par excellence; Bône, l’élégante, la coquette, et qui remplace aujourd’hui l’antique Hippone de saint Augustin; Bougie, la marraine de toutes les chandelles de cire ou de stéarine; Blidah, la patrie poétique des roses parfumées et des oranges exquises. Tu veux maintenant connaître cette campagne algérienne si nouvelle pour toi; t’enfoncer dans la brousse et traverser les plaines d’Alfa; gravir les pentes escarpées de l’Atlas, côtoyer les sinuosités sablonneuses du désert, courir le long des grèves rocheuses qui festonnent la mer bleue. Les beautés grandioses de la nature sauvage t’attirent et te retiennent, et pendant que tu les admires, moi je réponds à l’appel de la civilisation qui convie le monde entier à ses fêtes, à ce spectacle unique: l’Exposition!
Puissent ces pages, faible écho de mes impressions t’intéresser à leur tour, te donner une idée de ces grandes joûtes pacifiques du progrès; un aperçu de toutes les merveilles que renferme aujourd’hui Paris qu’on pourrait appeler en ce moment le salon de l’univers.
Lundi soir, 16 Septembre 1889.
Depuis quelques heures je suis à Paris... Dans ce grand Paris entrevu si souvent dans mes rêves, et que je vais trouver ou plus beau ou peut-être moins beau qu’eux. Le rêve est une féerie sans limites, la réalité a toujours des bornes. Ah! que je suis impatiente de connaître toutes ces belles choses qui caressent ma pensée depuis tantôt cinq mois! Demain, dès que l’horloge aura sonné neuf coups, l’heure réglementaire de l’ouverture de l’Exposition, j’en aurai franchi le seuil.
Nos plans sont dressés. Quatre jours par semaine nous irons à l’Exposition, les autres jours nous visiterons Paris; nous nous reposerons aussi de temps en temps, on ne peut pas tout voir à la fois, et pour bien classer ses souvenirs, il faut que la mémoire puisse s’assimiler les choses et les mettre en place, autrement ce serait le chaos.
Je suis arrivée par la belle gare Saint-Lazare: un monde déjà à elle toute seule. J’ai pris une voiture et fouette cocher! Plus heureuse que cette grande dame du siècle de Louis XIV, qui aurait tant voulu se voir passer en carrosse, moi j’ai eu cet agrément, rien qu’en jetant un coup d’œil rapide sur toutes les grandes glaces qui ornent la devanture des magasins.
Quelle animation, quel mouvement, quel tapage! Ah! que je suis loin du calme des champs! Ce soir je vais m’endormir au bruit de mille rumeurs confuses qui me rappelleront la voix du vent dans les bois. Cette nuit je me croirai bercée par la rafale bourdonnante de nos plages bretonnes... Ce sera le doux songe des paupières closes et du pays natal, en attendant le grand rêve des yeux ouverts: Paris et l’Exposition!...
Mardi, 17 Septembre 1889.
Première impression
Entrées à l’Exposition aujourd’hui, cent soixante-deux mille huit cents personnes.
Je suis émerveillée, enthousiasmée!... Quelle féerie pour les yeux et la pensée que cette Exposition! et quelle haute idée elle donne de l’intelligence humaine. C’est un amoncellement de splendeurs à donner le vertige.
Nous sommes arrivées par le Trocadéro, cette entrée grandiose entre toutes (il y en a vingt-trois) permet d’embrasser d’un coup d’œil l’aspect général de l’Exposition. De l’avenue de Suffren au quai d’Orsay, cette première impression est inoubliable.
L’intérêt et la curiosité s’éveillent au plus haut point. Tous les âges et tous les goûts peuvent se trouver ici dans leur élément.
Cette joute pacifique, cette grande exhibition ne renferme-t-elle pas une incomparable leçon de choses? Tout ce que l’esprit humain a inventé, dans le domaine de l’art et de l’industrie, de la science et de l’imagination, se trouve là. C’est aussi l’histoire palpable, vivante, de tous les produits naturels et si variés du globe. C’est le monde entier parlant au yeux et à l’imagination.
Le terre à terre des choses pratiques et usuelles les plus minimes coudoie l’idéal des choses artistiques et les plus vastes conceptions; la matière marche de front avec les productions les plus éthérées de l’esprit, et tout cela savamment classé, groupé, accumulé, dans le cadre le plus magistral qui se puisse rêver; et l’on reste stupéfait de tant de merveilles; tout ce qu’on voit paraît extraordinaire, c’est une contemplation sans fin.
Voilà un stock formidable de souvenirs qu’il serait bien difficile d’emmagasiner dans le cerveau; mais dont la mémoire retiendra ce qui l’aura frappée davantage.
L’Exposition de 1889 est la septième des Expositions universelles et la quinzième des Expositions nationales.
La première qui se tint au Champ de Mars en 1798, au sortir de la tourmente révolutionnaire comptait cent dix exposants; celle d’aujourd’hui en compte trente-huit mille.
Elle couvre une surface totale de soixante-dix hectares. Le visiteur intrépide qui voudrait tout parcourir en un jour aurait fait à la fin de ses étapes quarante kilomètres.[6]
La tour Eiffel est le clou, elle vous saute aux yeux avant même qu’on soit à Paris: mais, au dire des ingénieurs, le Dôme Central et la Galerie des Machines ne sont pas moins remarquables. C’est une trilogie de merveilles.
Sans compter tous les pavillons, les façades, les innombrables constructions qui représentent les cinq parties du monde, il y a sept palais principaux: Le beau palais du Trocadéro, le palais des Arts libéraux, où l’on voit dans tout son développement l’histoire du travail à travers les âges; le palais des Beaux-arts, encombré de chefs-d’œuvre: sculptures, peintures, gravures, dessins; le palais des Industries diverses, aussi magnifique, aussi resplendissant dans son genre; le palais des Machines, où l’esprit reste pétrifié d’étonnement et d’admiration; le palais du Pétrole, mais oui, cette huile minérale, découverte du XIXe siècle a son palais où sont représentés les appareils servant à son extraction; en un mot tout le matériel nécessaire à cette immense exploitation, ainsi que des échantillons de pétrole et de naphte. Cela intéresse les gens de la partie. Quant aux simples visiteurs, ils s’amusent un instant à regarder les grandes vues panoramiques qui décorent les murs intérieurs et qui représentent les ouvriers au travail sous le ciel d’Asie, d’Amérique et même d’Europe, au Caucase. Ces vues sont bien faites, et l’on comprend tout de suite que ces ouvriers ne sont pas de même race. Enfin le palais de l’Alimentation, le palais tentateur.
Et maintenant que j’ai effleuré toutes ces belles choses, voici mon opinion.
Il est impossible, même à l’imagination la plus féconde, de se faire de loin une idée de l’Exposition. Quant à ceux qui l’ont visitée, ils sont quand même dans l’impossibilité de la bien faire comprendre à ceux qui ne l’ont pas vue. Sans doute ces derniers pourront se rendre un compte exact de bien des choses prises séparément; ils pourront lire tous les livres traitant ce sujet aussi vaste qu’intéressant; ils pourront se représenter un palais, une galerie, un atelier, une usine; on pourra leur donner des détails, beaucoup de détails; mais cet ensemble incomparable, comment l’exprimer!
Mercredi, 18 Septembre 1889.
Le Jardin, le Musée et le Palais du Luxembourg
Buffalo-Bill
Temps délicieux, chaud le jour, tiède le soir; journée bien remplie, comme le seront, j’espère, toutes celles qui doivent suivre.
Nous avons passé la matinée en France, au Luxembourg, et l’après-midi au Mexique, à Buffalo-Bill.
Quel admirable jardin, que ce jardin du Luxembourg! il vous conduit jusqu’à la belle fontaine de l’Observatoire, au milieu de pelouses parfumées, à travers des bois ombreux qui vous donnent l’illusion d’une vraie campagne; ici on peut s’isoler, se croire aux champs et rêver à l’ombre des futaies, que l’automne d’un coup de son pinceau fantaisiste va rougir d’abord et bientôt effeuiller, hélas!
Ces belles statues, ces balustres élégants, ces bassins limpides évoquent les souvenirs d’antan. Il me semble que j’entrevois dans les allées, l’ombre de Marie de Médicis. Je crois entendre sous les charmilles chuchoter les grandes dames de la Cour.
En descendant ainsi les âges, j’arrive à des souvenirs plus cruels et plus récents. C’est dans le Jardin du Luxembourg qu’un grand nombre de fédérés furent enterrés, pendant la Commune; et ce mot si vrai d’un penseur me revenait en mémoire: «Tant que le peuple fera de la politique il ne sera pas heureux! Toute horreur appelle une autre horreur, et c’est comme cela que les représailles engendrent les haines éternelles.»
Pour chasser cette triste évocation, je me suis amusée à suivre la flottille en miniature que les enfants lancent sur le grand bassin, à voir les canards s’ébattre dans les ruisseaux et les hardis moineaux quémander familièrement les miettes de pain qu’un public, amant de la belle nature, ne leur marchande point.
J’ai admiré les orangers séculaires qui ont leurs parchemins comme ceux de Versailles. Ce ne sont plus des arbustes mais des arbres vivant dans des caisses, véritables petites maisons roulantes.
Les nombreuses statues qui ornent ce magnifique jardin et principalement les deux côtés de la grande terrasse sont pour la plupart des œuvres importantes au point de vue de l’art. J’y ai remarqué Sainte Geneviève, la patronne de Paris, Velléda la prophétesse des Gaules, des reines et des princesses.
Très belle la fontaine de Médicis, œuvre de Jacques Debrosse; charmants aussi les quatre groupes représentant plus loin l’Aurore, Le Jour, Le Crépuscule et la Nuit. Je regrette qu’une plaquette aux pieds de chaque statue n’indique pas et son nom et celui de l’auteur, même réflexion pour les Musées où il faut avoir un livret, consulter le catalogue, chercher le numéro; la plaquette simplifierait bien les choses et le nom de l’auteur se fixerait avec l’œuvre même dans le souvenir.
Le Musée du Luxembourg qui a quitté le Palais pour s’installer dans les serres restaurées ad hoc, n’a rien perdu au change. Il est dans de bonnes proportions pour être bien vu, il est tranquille, recueilli et l’on regarde à l’aise, ce qui est un grand agrément, les sculptures et les peintures qu’il renferme. La sculpture est contenue dans une salle unique de quatre cent trente-deux mètres carrés. La peinture qui occupe deux salles présente les œuvres les plus remarquables des artistes vivants. C’est comme l’antichambre du Louvre, où l’on n’est pas pressé d’entrer. On s’attarde d’autant plus volontiers dans l’antichambre, qu’il n’y a que les morts qui puissent entrer au Louvre. C’est là seulement qu’ils reçoivent la consécration suprême de leur talent, le couronnement de leur gloire.
Après le Musée, j’ai pu visiter le Palais.
C’est Marie de Médicis, qui prenant pour modèle le Palais Pitti à Florence posa en 1615 les fondations du Palais du Luxembourg. Il renferme de superbes appartements; la salle où le Sénat tient ses séances est l’ancienne salle de théâtre.
Très belles aussi, la galerie des bustes, la salle du trône, la chambre de Marie de Médicis; à remarquer encore le grand escalier aux monumentales proportions et la chapelle un peu négligée aujourd’hui, puisque depuis 1875, on n’y a pas dit la messe une seule fois.
Nous sommes rentrées, l’appétit bien aiguisé. Le fait est qu’à Paris on se dépense tant, qu’on a besoin de renouveler confortablement ses provisions de forces et de santé, pour garder son équilibre. Deux heures viennent de sonner, en route pour le Mexique!
Nous voici donc en pleine tribu de Peaux-Rouges.
C’est un vrai village, non bâti, mais composé d’un grand nombre de tentes en toile blanche, meublées sommairement de quelques tapis, de quelques peaux, dont s’enveloppent ces exotiques pour dormir. Les tentes des chefs sont un peu plus hautes et plus confortables, on y aperçoit quelques meubles, des sièges, une table, un divan; de plus elles sont bariolées de dessins grossiers aux couleurs vives, qui dénotent que chez ces amateurs de chevelures, l’art n’est pas encore sorti de ses langes. Cependant cette promenade à travers ce campement pittoresque, où l’on entrevoit de grands gaillards cuivrés qui ressemblent à des bandits, ne manque pas d’originalité, et me paraît l’une des principales attractions du spectacle qu’on va chercher à Buffalo-Bill.
Un vaste cirque solidement construit, le plus grand du monde, dit le programme, permet à plusieurs milliers de personnes de prendre place à la fois; le fond du cirque est tendu d’immenses toiles peintes, représentant un coin de la terre mexicaine; ce décor, ce trompe l’œil est d’un bel effet et prête à l’illusion. On rêve un instant pampas, savanes et forêts vierges.
Le personnel est fort nombreux: deux cents chevaux, poneys et buffles sauvages, deux cent cinquante Indiens, pionniers, trappeurs, cow-boys, chasseurs, cavaliers; ces derniers sur leurs chevaux, sans selle, exécutent des fantasias endiablées. Assez curieuses la danse de la Guerre et de la Plume, la chasse au lazo des chevaux fuyant et galopant en liberté.
L’attaque d’un convoi par les Peaux-Rouges manque un peu de prestige; on sent trop que ce n’est pas vrai. Un antique carrosse, dans lequel on fait monter quelques-unes des personnes de marque venues à la représentation, apparaît et parcourt la piste, ce qui simule le voyage; puis soudain retentissent des cris terribles et des coups de feu, le carrosse est entouré de sauvages, il y a lutte, combat, mais enfin tout se termine heureusement, comme dans les contes moraux: la horde sauvage est repoussée avec perte et les honnêtes voyageurs continuent tranquillement leur route.
Ce qu’il y a de très remarquable, c’est l’adresse des tireurs, hommes et femmes, Miss Oakley particulièrement, elle brise avec une rapidité et une précision extraordinaires des boules de verre lancées dans l’espace, sans prendre à peine le temps de les viser.
Nous avons vu travailler les deux bronchos ramenés d’Amérique par le grand peintre Rosa Bonheur, celui-ci n’ayant trouvé personne pour les dresser les a offerts au colonel Cody qui avec ses Mexicains et ses cow-boys est venu à bout de les dompter.
En somme grand bruit à ces représentations, beaucoup de cris et de coups de fusils, beaucoup de chiens, de buffles, de chevaux et de sauvages, n’en déplaise au colonel Cody, un des héros (de théâtre) du moment, et que Paris qui est vraiment la meilleure ville du monde invite à ses fêtes et acclame comme s’il était un vrai héros. Tous ces gens là sont bien d’une autre race que la nôtre et voilà sans doute pourquoi on les accueille si bien. On aime le changement.
Buffalo est amusant à voir une fois: foule énorme comme partout; on nous a montré de loin M. Loyson, ex-Père Hyacinthe, et M. Lincoln, ministre des Etats-Unis.
Pendant les entr’actes on vend une sorte de gâteau mexicain rond comme une ballotte, composé de graines de maïs rouges, pétries dans une espèce de pâte sucrée, le tout enveloppé d’un papier de soie et d’une faveur rose ou bleue. C’est tout à fait joli, tout à fait alléchant, mais ça n’est bon... que pour les yeux, au goût c’est détestable.
Jeudi, 19 Septembre 1889.
Exposition.—Palais et Jardin du Trocadéro
Hier à six heures du matin, le thermomètre marquait quatre degrés au dessus de zéro, au pied de la Tour Eiffel, et sept degrés à son sommet. Il y avait donc une température plus chaude en haut qu’en bas, il paraît que cette différence a déjà été signalée cet hiver et qu’on pourra la constater à peu près chaque matin.
C’est au Palais du Trocadéro[7], qui fut le palais dominant de l’Exposition de 1878 et à ses délicieux jardins que nous avons consacré notre journée. Le Palais est dépassé aujourd’hui, mais c’est égal, il est toujours superbe avec ses galeries extérieures ornées de statues, ses cascades, ses tours quadrangulaires de 70 mètres de haut; sa salle des fêtes qui peut contenir six mille personnes. La galerie intérieure de droite contient des objets anciens qui sont de purs chefs-d’œuvre en bijouterie.
Tous ces trésors échappés aux révolutions, à la guerre, au pillage, à la fonte, racontent magnifiquement l’histoire de l’orfèvrerie française depuis saint Louis jusqu’à nos jours. Nous avons là sous les yeux les trésors les plus célèbres des anciennes abbayes de France, et ceux des grandes cathédrales. Voilà des crédences, des émaux byzantins, des crosses splendides, des patênes, des ostensoirs, des mîtres, des encensoirs, des reliquaires superbes et même des châsses aux précieuses reliques. Voici une croix de l’évêché d’Avignon, trois plaques d’évangéliaires, un calice en or massif du huitième siècle (église de Saint-Gozlin, à Nancy), un reliquaire pour la Sainte-Epine (sœurs Augustines d’Arras), une nef en nacre de perles montée sur argent doré, un Christ sortant du tombeau (don de Henri II à une église).
Admirons aussi les spécimens de l’orfèvrerie profane: le lit d’Antoine, duc de Lorraine et de Renée de Bourbon, sa femme (1515); une collection de coffrets, des bustes en terre cuite de Philippe le Beau et Jeanne la Folle, etc., etc.
Toutes ces pièces rarissimes aujourd’hui, sont l’œuvre de ces fameux orfèvres du Roi qui furent des maîtres.
L’ensemble de ces objets est évalué modestement à quarante millions.
La galerie de gauche est un musée d’architecture. On y voit la reproduction dans leur grandeur naturelle des principales parties de nos monuments historiques, chaires en dentelle de pierre, jubés à jour, statues colossales, tombeaux, portiques, rosaces, portails des plus belles cathédrales tel que celui de Chartres, cloître de Saint-Trophyme; tout cela est représenté avec la fidélité de détail et le fini d’exécution de l’original même. Après un examen attentif de tous ces fragments colossaux, on connaît le passé architectural de son pays, du moyen-âge, de la Renaissance, car aujourd’hui, l’éclectisme le plus absolu règne dans nos monuments modernes. Les architectes actuels empruntent à chacun des cinq ordres ce qui leur convient le mieux, sans s’occuper le moins du monde de rester classique. Ils sont les fondateurs d’un sixième ordre, l’Ordre du Mélange.
Et la suite de cette visite rétrospective et un peu sévère, on éprouve une véritable satisfaction à promener dans les jardins du Trocadéro et à se retrouver au milieu des fleurs qui toujours jeunes et belles sont de tous les temps.
On dirait qu’elles sont les Benjamines de la Nature qui les chérit tout particulièrement et aime à renouveler sans cesse leur fugitive beauté.
C’est d’elles qu’on peut surtout dire: les fleurs sont mortes, vivent les fleurs! Chaque saison, que dis-je! chaque semaine presque apporte une flore différente et c’est ainsi que nous voyons se succéder les camélias, les azalées, les cynéraires, les pensées, les jacinthes, les tulipes, les geraniums, les roses, les œillets, les marguerites, les dalhias, les chrysantèmes la dernière fleur d’automne et peut-être la plus belle parce qu’elle trône seule, toutes ses autres sœurs, les frileuses ont déserté la place. Ah! oui les fleurs sont sans rivales, dans l’art de charmer, de ravir.
Quel enchantement pour les yeux, quel régal pour l’odorat! Si j’osais je dirais que toutes les fleurs de pourpre et de flamme d’azur et d’or étincelantes au soleil semblent tirer un véritable feu d’artifice sous les regards éblouis des promeneurs.
Le Trocadéro est non seulement rempli de fleurs mais aussi de fruits et de légumes, charmant trio qui unit l’agréable à l’utile.
Deux mille cinq cents espèces comprenant quatre mille cinq cents rosiers ouvrent ici leurs cassolettes depuis le commencement de l’été.
Des serres élégantes étalent leurs curieuses collections au nombre desquelles les orchidées brillent par leur variété. Les fruits et les légumes rangés par espèce sont groupés avec un art qui rehausse encore leur éclat.
Ces arbres fruitiers affectent en général la forme des figures géométriques cônes et pyramides mais il y en a de plus bizarres où le fil de fer et la taille jouent un grand rôle.
Question d’amour propre et de parade car les fruits n’en sont pas meilleurs.
On est aussi arrivé à cultiver les arbres fruitiers en pot. Ils sont tout à fait gentils et pimpants dans leur petite taille. Voilà une méthode parfaite qui permettra aux raffinés de servir tout un verger sur leur table et de cueillir au moment du dessert le fruit tout frais à l’arbre même.
Tous les arbres verts de la création ont ici de nobles représentants en tête desquels marchent le Sciadopitys, l’Araucaria Imbricata et le Wellingtonia gigantea qui sont les trois géants végétaux de la Chine, du Chili et de l’Amérique du Nord.
Par exemple une exposition dont je rêve encore et qui n’offre guère de géants, c’est celle du Japon. Ce jardin, orné de vases japonais blancs et bleus, palissé de bambous, garde une saveur locale très prononcée.
Presque tous ses conifères sont nanifiés. Ces plantes là sont bien celles que nous voyons étaler par les artistes japonais sur leurs paravents, leurs potiches, leurs meubles; plantes invraisemblables qui paraissent plutôt l’œuvre d’une imagination fantaisiste que celle de la nature.
Ces arbres qui en liberté atteindraient une hauteur énorme, ici, vivent en pots. Voilà un érable de cinquante ans qui n’a pas plus de cinquante centimètres de haut.
Voilà des sapins, des tuyas lilliputiens, aux troncs tourmentés, bossus, biscornus, qui ont cent et cent cinquante ans d’existence. On les a traités comme on traite le pied des Chinoises en entravant leur crue, mais quels soins il a fallu pour les empêcher de mourir, ces pauvres arbres, ainsi livrés à la torture. C’est plus curieux que beau, il faut que ces Japonais soient de fameux arboriculteurs pour réussir de pareils monstres.
Le Pavillon des forêts m’a séduite par son élégance et son originalité.
Qu’on se figure une construction toute en bois dont la façade, la galerie extérieure, les panneaux sont obtenus par la juxtaposition et l’assemblage de bois de toutes les couleurs, les colonnes sont des arbres séculaires non écorcés.
L’intérieur renferme des échantillons de tous les arbres existant sur la terre. Ce sont des rondelles épaisses, parfois d’une largeur phénoménale, sciées dans le tronc; cette collection est unique dans son genre.
Nous avons passé la soirée à la maison, dans l’intimité de quelques bons amis que ma cousine avait conviés à son dîner hebdomadaire. Un convive retardataire, un jeune homme habitué de la maison, entre au salon en gasconnant comme un riverain de la Garonne. Ciel! quel langage!
Qu’avez-vous, s’écrie-t-on en chœur? «Eh! bienne, mais rienne, seulement ze ne veux pas avoir l’air d’un étranzé dans ma ville natale, puisqu’on ne parle plus français à Paris, mais toutes les langues et tous les idiomes du globe, ze fais comme les autres.»
Il est de fait que la multitude est innombrable partout. Paris ne s’appartient plus; envahissement général des trains, des omnibus, des bateaux, des tramways, des fiacres, des hôtels et des théâtres. Les propriétaires et les directeurs sont dans l’allégresse; ils ont beau augmenter le prix des chambres et des places, il n’y en a jamais assez. Quel succès que cette Exposition! Elle mourra debout, battant son plein, aussi suivie, aussi admirée et même plus que les premiers jours.
Cependant comme il est impossible de contenter tout le monde, bon nombre de Parisiens sont furieux. On a pris leur Paris, ils ne sont plus chez eux, et ils envoient à tous les diables la province et l’étranger.
Le jeune homme s’étant assis a continué: «D’ailleurs Paris n’a jamais été aux Parisiens... En temps ordinaire, le nombre des étrangers est huit pour cent de la population; celui des Français nés dans les départements et habitant Paris est cinquante-huit pour cent; les Parisiens de Paris y sont trente-huit pour cent, juste le tiers. Les savants nous apprennent que sous l’Empereur Julien (qui habitait Paris et l’appelait ses délices) la population était de huit mille habitants. Il n’y avait pas d’exposition alors!
Sous Clovis, il y avait à Paris trente mille habitants. Sous Louis VII en 1220, cent vingt mille habitants. En 1590, le recensement indiqua deux cent mille âmes.
La progression s’augmenta chaque année et nous voyons qu’en 1876, Paris avait près de deux millions d’habitants. Actuellement on donne comme chiffre sûr: deux millions six cent mille.»
Notre jeune homme ne se fût peut-être pas arrêté là sans la phrase traditionnelle: «Madame est servie».
Ce n’était plus le temps de discourir; mais d’offrir son bras, ce qu’il a fait en s’avançant vers moi.
Rassurez-vous, lui ai-je dit en souriant, votre Paris vous sera bientôt rendu.
Vendredi, 20 Septembre 1899.
Le Jardin des Plantes, l’Eldorado
Longue promenade au Jardin des Plantes, magnifique parc d’une contenance d’environ trente hectares et comprenant le jardin botanique et les galeries zoologiques; le labyrinthe et la vallée suisse qui renferme la ménagerie.
Le jardin des Plantes est divisé dans sa longueur en deux parties bien distinctes symétriquement dessinées: l’une se compose des carrés de l’école botanique, des bosquets de printemps, d’été, d’automne, d’hiver, et des deux belles allées de tilleuls plantés par Buffon. La fosse aux ours, les serres et les pépinières la séparent de l’autre partie, qui se subdivise en vallée suisse et jardin anglais, lequel ne forme en définitive qu’un grand et un petit labyrinthe.
C’est sur le grand labyrinthe que s’élève le majestueux cèdre du Liban rapporté tout petit de Keew près Londres par Bernard de Jussieu, non dans son chapeau, comme le dit la légende, mais simplement dans un pot à fleur. Il n’y a pas de Suisse sans chalets, ceux-ci sont tous habités et forment le jardin zoologique à proprement parler.
J’ai fait comme les enfants et acheté les petits pains traditionnels qui doivent régaler les habitants de ce lieu de délices si apprécié du peuple parisien surtout. Nous avons donc fait la connaissance de Mignon, un jeune tigre, de mademoiselle du Cap, une superbe hyène, de la Cochinchinoise, une panthère solennelle et de son époux Gaston; de deux lions Jean-Bart et la belle Fathma, du tigre Néron et de la tigresse Joséphine, de Dora une ourse du Tonkin; ce qu’il y a de plus extraordinaire, c’est que tous ces animaux arrivent à l’appel de leur nom, assurent leurs gardiens. Malgré les soins qu’on leur prodigue, ils semblent malheureux, étiolés, dans leurs cages grillées de quelques pieds, ces pauvres exotiques qui avant la captivité ne connaissaient que l’immensité des forêts ou des déserts. En revanche les ours n’ont point l’air d’engendrer mélancolie dans leurs fosses profondes; ils font les beaux, marchent debout, tendent les bras vers le public; celui-ci leur jette des morceaux de pain, qu’ils reçoivent très adroitement dans leur gueule ouverte.
Nous avons salué Rousset, Henriot, Tonkinois, Mathieu un ours brun, Matelot un ours cocotier, Firmin un ours bien léché, l’Africain, un ours terrible et le Petit-Vieux, doyen vénéré des ours du jardin, une belle assistance comme on voit.
Les zèbres sont également très voraces; leur grande mâchoire constamment dilatée est une cible que les enfants criblent de balles de mie de pain. Très bien éduqués aussi les éléphants: ce sont d’amusants escamoteurs d’une adresse charmante; leur trompe passe au-dessus de plusieurs personnes, pour venir prendre fort délicatement le morceau de gâteau que vous tenez en main.
De coquettes volières logent confortablement la gent emplumée. La belle collection des oiseaux doux et inoffensifs m’a charmée. Oiseaux aquatiques, oiseaux des montagnes, oiseaux des plaines, quelle variété de formes et de plumages! Comme les flamants sont donc jolis dans leur toilette rose! Tous ces cosmopolites ont leur cachet particulier; mais nos oiseaux français ont aussi leur mérite. Fauvettes, pinsons, mésanges, pierrots se donnent des airs d’écoliers en vacances qui font plaisir à voir.
Les serres, parfaitement entretenues, renferment d’innombrables spécimens de plantes exotiques; les deux plus grandes sont, dit-on, les plus belles serres de France, de véritables palais de cristal.
Tous les animaux volant, rampant, marchant, nageant se sont donnés rendez-vous dans les vastes salles d’histoire naturelle. Très intéressante la collection des écureuils, je n’aurais jamais cru qu’il y avait tant de variétés chez ces charmants rongeurs.
Pas si agréables à voir les serpents, on les regarde avec dégoût, et même avec effroi en se rappelant l’histoire de ce savant, mort de la piqure d’un serpent, empaillé depuis vingt ans. C’est l’exacte vérité. L’empailleur avait laissé à cet ophidien d’une espèce très dangereuse ses crochets, des tubes pleins de venin; le savant l’ignorait, on avait oublié ce détail, tout en étudiant son serpent sans y prendre garde, il fait jouer la mâchoire qui se referme sur sa main; les crochets fonctionnent et le venin, presque foudroyant, qui n’avait rien perdu de sa force, au contraire, s’inoculait en quelques minutes dans le sang du malheureux, nouvelle victime à ajouter au long martyrologe de la science.
La salle des fruits me paraît unique dans son genre. C’est une séduction pour l’odorat. Tous les fruits des cinq parties du monde sont là, au naturel, conservés dans l’esprit de vin. Ils répandent un parfum de fruits à l’eau-de-vie tout à fait allèchant.
Bref, le muséum avec ses jardins, ses serres, ses herbiers (hortos sicos, jardins secs), sa ménagerie, ses amphithéâtres et ses laboratoires, ses galeries de zoologie, de botanique, de géographie, de minéralogie, en un mot avec toutes ses collections est un grand établissement national, d’une haute importance, marchant en tête des autres établissements de ce genre en Europe destiné tout à la fois à l’enseignement supérieur et à la vulgarisation des sciences naturelles.
Nous sommes rentrées par une brise frisquette comme disent les marins, le temps est toujours beau mais les nuages s’amoncellent à l’horizon, le soleil par instant reste voilé.
Aussitôt après dîner, nous nous sommes dirigées vers les théâtres de notre voisinage. Quelle audace de songer à y entrer sans places retenues d’avance. L’Odéon était comble, Cluny aussi, au Chatelet même déveine; le Prince Soleil, qu’on y joue, est un souverain auquel il faut avoir demandé audience depuis plusieurs jours pour être reçu. Longue queue à l’Opéra-Comique, nous entrons dans le flot, au bout d’une demi-heure d’attente nous allons enfin franchir le seuil sacré. Soudain un gardien de la paix, de planton à la porte nous glisse à l’oreille: «Mesdames, quelles places avez-vous donc?» «Aucune.» «A la bonne heure, car il n’y en a plus, ce flot vous conduit aux combles dans les places à vingt sous.» Horreur!
De guerre lasse nous allons nous échouer à l’Eldorado, juste à temps pour prendre les deux derniers fauteuils.
On nous sert les traditionnelles trois prunes à l’eau-de-vie, une opérette et beaucoup de chansonnettes dont quelques unes d’un goût douteux. Je constate avec regret que cet esprit, sel attique dont nos pères savaient si bien se servir n’existe plus. Notre génération ne demande point de sel fin, le gros sel de cuisine lui suffit. J’ai acheté la Tour Eiffel, la meilleure chansonnette du répertoire.
Nous sortons à minuit. Brrr... Aïe! Il pleut à verse, surprise désagréable. On court, on s’agite, on hêle les cochers, qui répondent ou ne répondent pas; à cette heure là ils sont les maîtres. Quelques parapluies s’ouvrent. Heureux ceux qui ont eu la précaution d’en apporter! Hélas! pour nous préserver nous ne pourrions ouvrir que nos éventails...... Enfin nous saisissons au passage un automédon libre et de bonne volonté; sauvées, mon Dieu! Nous sommes loin de nos pénates, mais qu’importe... en route, et fouette cocher!
Samedi, 21 Septembre 1889.
Entrées à l’Exposition, quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent seize. Hier, elles avaient été de cent onze mille sept cent cinquante.
Intermittence de pluie et de soleil, un temps d’intérieur.
Nous nous sommes consacrées aux Beaux-Arts, exposition merveilleuse de peintures et de sculptures à laquelle toutes les nations civilisées ont pris part. Tout cela est impossible à décrire; on a calculé que si tous les tableaux français et étrangers qui sont ici, étaient posés à la file les uns des autres, ils se développeraient sur une longueur d’une lieue un quart environ. Cela donne une idée des productions artistiques de notre époque.
Je ne suis point assez connaisseur pour me permettre aucun jugement ni en sculpture ni en peinture. Cependant les paysages finlandais m’ont absolument séduite. Ils sont ravissants; quelle suavité de couleurs! c’est leur ciel sans doute qui donne à la campagne ces teintes rêveuses et poètiques, que je ne retrouve nulle part.
La sculpture est splendidement représentée, le génie français, disent les connaisseurs, s’y affirme d’une façon plus triomphante encore que dans la peinture. J’admire l’Ecole française, mais j’avoue modestement mon faible pour la sculpture italienne. Elle s’attache particulièrement aux enfants, dont elle excelle à rendre les poses, l’attitude, l’expression. Tous ces petit êtres qui rient, qui pleurent, qui s’amusent, qui effeuillent une rose ou réchauffent un oiseau ont été pris sur le vif et, si ce n’était la pâleur du marbre, sembleraient vivants.
Les Italiens habillent avec une entente parfaite leurs modèles. Leurs étoffes sont si souples, leurs broderies si délicates, les gazes si légères, qu’elles laissent deviner les formes sans rien accentuer.
La sculpture française a plus de force et de grandeur. Elle s’inspire de sujets d’un ordre plus élevé; aussi ses statues, en général plus grandes que nature, ne peuvent prendre place que dans des musées ou des palais. La sculpture italienne a plus de grâce et de douceur. Par ses proportions et les sujets qu’elle choisit, elle peut entrer dans tous les salons, c’est la sculpture de la famille et de l’intimité.
Cependant je ne suis jamais passée dans la magnifique galerie Rapp, consacrée à l’Ecole française, sans m’arrêter devant une jeune mère qui coupe du pain pour ses deux marmots lesquels, accrochés à ses jupes, se lèvent sur la pointe de leurs petits pieds pour atteindre plus vite la tartine convoitée. Leur mine éveillée et le charmant sourire de la mère qui les couve du regard, tout cela vous retient. C’est un chef-d’œuvre inspiré par la vie réelle; c’est tout un poème, le poème émouvant de la famille. De temps en temps on rencontre ainsi quelques délicieux sujets.
A mon humble avis, l’ensemble offre encore trop de nudités. Ce sont, j’en suis persuadée, des sujets d’études remarquables, de grandes difficultés vaincues; mais pour les curieux, les profanes qui n’entendent rien aux difficultés de l’art, pour tous ceux qui passent et ne retiennent que l’impression du moment, ces proportions colossales, ces statues dans des postures fatigantes, aux muscles tendus, aux nerfs cordés, aux expressions de visages tourmentés, semblent voulues, cherchées, et ne rendent nullement les réalités de la vie.
Ah! que ces garçonnets et ces fillettes occupés aux choses familières de l’existence, qui pêchent assis sur un rocher, qui lisent ou cueillent des fleurs, que ces enfants nus de la tête aux pieds doivent donc avoir froid!
On les regarde sans illusion. Ce sont des statues superbes, j’en conviens; mais cela reste du marbre. Chez les Italiens, les enfants sont d’une grâce et d’une vérité qui les rendent vivants.
Ciel! j’entends d’ici les vrais artistes m’écraser. Oser émettre une telle opinion. Quel crime! Puisque justement on reproche sans cesse à l’Italie la mièvrerie de ses compositions et la mollesse de son ciseau.
Les découvertes scientifiques du XIXe siècle sont renversantes. La science semble à son apogée; l’art se maintient à un niveau satisfaisant; cependant il est à craindre que s’égrenant, s’éparpillant sur tant d’individus, il ne finisse par s’amoindrir. «Le talent n’est que la menue monnaie du génie.»
Dans le passé, le génie n’eut que de très rares représentants; actuellement, tout le monde s’en croit un petit brin. Jadis, il naissait par siècle un ou deux génies sublimes qui s’appelaient Michel-Ange chez les sculpteurs, Raphaël chez les peintres, Dante chez les poëtes, Mozart chez les musiciens. Chacun de ces élus arrivait dans son genre à la plus haute expression de l’art et devenait un génie national.
Le sentiment artistique est de tous les âges; mais l’explosion géniale, qui à elle seule illumine parfois toute une époque, est toute personnelle. Il y a des moments ou l’art reste stationnaire et même semble décliner, quand il cherche une autre voie.
A l’heure présente, la musique par exemple subit certainement une crise. Elle a banni de ses compositions savantes et mathématiques la douce mélodie; la pauvrette ne peut plus chanter dans les âmes et prendre son vol, on lui a coupé les ailes et pourvu que nos compositeurs modernes possèdent à fond le code de l’harmonie cela suffit. Et pourtant la mélodie c’était le génie, l’harmonie c’est le talent.
Quel dévergondage de notes, quelle orgie de cuivres à présent dans certains opéras. L’orchestre n’a plus pour mission d’accompagner et de soutenir les chants, il a sa partie distincte qu’il tient aussi à faire valoir, et l’audition de cet imbroglio musical devient pour les simples mortels qui l’écoutent attentivement, un véritable travail. Mme de Sévigné, en parlant de la musique de Lulli, disait: «Il n’y en aura pas de plus belle au Paradis.»
Eh! bien, je ne ferai pas entendre ce cri d’admiration pour la musique actuelle. Non, bien sûr, cette musique-ci n’est pas celle du Paradis. Les mélodies célestes sont autre chose que cela. Elles savent parler à l’âme un ineffable langage dont la musique du jour, dans un grimoire savant et compliqué, embrouillé et obscur, ne peut donner aucune idée.
C’est la musique de l’avenir; on dit que nos oreilles s’y feront, tant mieux. La musique est donc arrivée à une époque de transition, mais il ne s’ensuit pas que cette nouvelle musique, pas plus que la nouvelle littérature, soit supérieure à celle du passé. Au contraire.
Pour la science, c’est tout différent: la science est un capital qui va toujours en s’augmentant. Chaque génération nouvelle tire profit de l’héritage légué par sa devancière. Voilà l’explication des progrès incessants et indéfinis de la science, qui ne recule jamais, comme cela peut arriver à l’Art.
Les élections.—L’Exposition.—Les fêtes
Dimanche, 22 Septembre 1889.
Grand jour des élections!
Les afficheurs sont aujourd’hui les maîtres de Paris.
Ils ont mis leur colle et leurs affiches partout, sur les plus beaux monuments, sur les statues même, sans respect pour les illustres qu’elles représentent.
Nous sommes en septembre, et comme autrefois à Rome, à cette époque, ils usent et abusent de ce que l’on appelait septembri libertas.
C’est une véritable débauche, une frénésie, une fureur.
Et les philosophes s’en vont répétant le mot connu: «colle dessous, colle dessus, colle partout!»
On voit des affiches de toutes les couleurs, jaunes, vertes, rouges, bleues, violettes, etc.
On calcule qu’il est dépensé six cent mille kilogrammes de papier à affiches pendant la période électorale à Paris seulement. Un joli chiffre comme on voit.
Il pleut à verse. Puisse cette douche calmante rafraîchir les cerveaux surexcités par la politique.
On dit que chaque peuple n’a que le gouvernement qu’il mérite; eh! bien, il faut croire que nous ne valons pas grand chose à en juger par nos gouvernants.
Le Pilori a publié dernièrement cette jolie chansonnette qui peint la situation:
Dimanche soir, le soleil un peu pâli a daigné paraître. Cette après-midi il nous a envoyé quelques sourires que nous eussions trouvés charmants s’ils avaient été moins mélancoliques; c’est déjà l’automne, et l’automne fait penser à l’hiver. Foule énorme partout, fort gaie, fort réjouie. On ne s’imaginerait jamais que les destinées du pays sont en jeu, sauf cependant qu’à l’Exposition comme ailleurs, le beau sexe domine; ce vingtième dimanche de l’Exposition, pourrait être appelé la journée des dames. C’est à peine si l’on aperçoit quelques timides pantalons, quelques jaquettes isolées dans ce flot de jupes et de chapeaux coquets. Décidément la politique est bien plus absorbante en province qu’à Paris. La province, à défaut de tous les plaisirs qui encombrent la capitale et attirent ses habitants, la province en est réduite à faire de la politique une occupation. Je n’ose pas dire une distraction.
Ici les fêtes succèdent aux fêtes et ne se comptent plus; promenades de tous les exotiques de l’Exposition, illuminations, retraites aux flambeaux, lunchs et punchs, vins d’honneur, et les banquets donc! ils pleuvent depuis celui du 14 juillet, d’homérique mémoire. On parle maintenant d’organiser, au Palais de l’Industrie une fête monstre pour les victimes de la catastrophe d’Anvers. Je crois qu’il n’y a plus rien à inventer, et cependant, pour la solennité des récompenses, ce même Palais de l’Industrie, recevra pour la vingt-cinquième fois, depuis le commencement de l’Exposition, une nouvelle décoration. Ah! il faut être inventif pour trouver ainsi toujours du nouveau, mais il paraît que l’imagination parisienne n’est jamais à bout.
A l’Exposition.—Histoire de l’habitation et du travail
Lundi, 23 Septembre 1889.
Entrées à l’Exposition, cent trente-huit mille six cent cinquante-sept.
Vent sec, beau temps sans pluie ni boue, extrêmement agréable pour marcher.
Toute la nuit il y a eu foule et encombrement dans les principaux quartiers où les journaux affichaient sur des transparents les résultats des élections au fur et à mesure qu’ils arrivaient. Les agents sur pied ont fait quelques arrestations, il y a toujours des turbulents. Dans notre quartier, beaucoup de criailleries dont Boulanger était en principe le prétexte, et quelques chansons que criaient à tue-tête les bandes qui montaient et descendaient le Boul’miche (lisez: Boulevard St-Michel). En somme, Paris est resté sage pendant le dépouillement du scrutin.
Un peu attrapés les bons Anglais qui abondent en ce moment; au spectacle de l’Exposition, ils avaient rêvé d’ajouter celui des élections. Une petite émeute agrémentée de boxe, de savate, avec quelques coups de fusils, ne leur aurait pas déplu. Toujours les mêmes, les Anglais. Ceux-ci font penser à leurs compatriotes, qui impassibles, la lorgnette en main, regardaient brûler Paris en 1871.
La République est victorieuse, c’est le triomphe du nombre... et puis l’immense succès de l’Exposition lui apporte un fameux appoint. Monsieur Carnot, très correct, rélève la République que le grigou de Grévy rapetissait à sa mesure.
Les feuilles gouvernementales exultent, comme le disait l’une d’elles ce matin: «Qui donc voulait l’étrangler cette excellente personne, cette république adorable, cette mère modèle qui protège également tous ses enfants. Tous les peuples pour l’aimer, pour la mieux comprendre, devraient la demander en mariage. Ils reviendraient à l’âge d’or et trouveraient le bonheur parfait.»
Nous avons donc passé notre journée à l’Exposition, où nous nous sommes croisées plusieurs fois avec l’ambassade marocaine.
El Caïd, El Hadj, et leur suite, sont de beaux hommes, ayant grand air, beaucoup de dignité dans la démarche et portant avec élégance le haïk blanc et le fez rouge.
Nous nous sommes consacrées aujourd’hui à l’histoire de l’habitation et à l’histoire du travail au Palais des Arts libéraux.
L’histoire de l’habitation, en quarante-trois spécimens, par l’ingénieur M. Charles Garnier, est fort attachante. Reconstituer les premières demeures de l’homme, rendre les diverses phases par lesquelles il passe pour sortir de la barbarie, les transformations successives qu’il opère petit à petit autour de lui, c’est faire comprendre la longue bataille qu’il dut livrer non seulement aux animaux féroces, mais encore aux éléments déchaînés contre lui; c’est raconter d’une manière saisissante cette marche triomphale, qui, à travers les siècles, doit le mener à la civilisation.
Cette série commence par la caverne d’un Troglodyte, sombre grotte creusée par la nature, et que l’homme n’a pas même essayé d’améliorer. Puis viennent des huttes en terre, des cabanes de roseaux de l’époque lacustre, des paillotes, des tentes, demeures des peuples nomades. Nous nous arrêtons devant les chaumières de nos ancêtres les Gaulois, plantées, comme celles des Germains, à l’ombre des chênes. Ces grands arbres font penser aux Druides dont voici en effet, tout près, les pierres énigmatiques, dolmens et menhirs.
Puis enfin la terre et le bois prennent une forme, la pierre s’y ajoute et la maison est bâtie.
La série se continue avec les spécimens de l’architecture romane, gothique et de la renaissance. Nous arrivons aux plus belles périodes de notre art national «qui, en toute équité, arrive bon premier, dans ce handicap d’un nouveau genre.»
Des habitations Phéniciennes et Assyriennes apparaissent à notre vue. L’Egypte est toute pimpante avec ses colonnettes et ses couleurs vives.
Entrons chez les Hébreux, et admirons-y une riche collection d’antiquités juives. Mêmes curiosités en Etrurie; c’est une hôtellerie du temps qui vous offre les meubles, tables, lits, escabeaux, amphores, ustensiles de ces époques lointaines.
Arrêtons-nous devant ces deux maisons gallo-romaine et grecque, que l’on dit d’une fidélité de reproduction étonnante.
Voilà les maisonnettes de bois naturel de la Norvège, et celles en bois ouvragé de la Russie. Voici l’antre des Lapons et des Esquimaux, ces demeures primitives des neiges et des glaces éternelles côtoient les demeures du Soudan et de l’Arabie, où le soleil est du feu, et c’est vraiment charmant de parcourir chaque hémisphère, sans ressentir ni froid ni chaud. Les constructions chinoises et japonaises sont pleines de fantaisie et de légèreté, avec leurs toits clochetonnés et brillants, leurs cloisons de bambous, leurs fenêtres de papier multicolore.
Nous arrivons aux derniers spécimens de la barbarie existant de nos jours, les cabanes informes des tribus de l’Afrique centrale, et les tentes des Peaux-rouges. Ces tentes pointues sont soutenues à l’aide de longues perches ou branches d’arbres réunies au sommet. Au centre, une excavation dans la terre sert de cheminée; au-dessus, un trou dans la toile permet à la fumée de s’échapper tant bien que mal. Elles sont là, debout ces tentes primitives, auprès des maisons des Astèques et des Incas, suprêmes vestiges d’une étonnante civilisation détruite à jamais.
Et nous voilà devant la tour Eiffel, le contraste est grand, mais qu’importe! Il ne rend que plus saisissante la comparaison entre le passé plein d’essais et de tâtonnements, et le présent qui résume sous nos yeux, les progrès constants et les résultats admirables de la civilisation moderne.
L’histoire du travail, au Palais des Arts libéraux, semble au premier abord un dédale effrayant. Il faut prendre son temps pour examiner la plus vaste encyclopédie d’objets, grands et petits, de choses hétérogènes, de machines simples ou compliquées, longue chaîne qui se rive aux grossiers ustensiles de première nécessité, pour aboutir aux conceptions du luxe le plus raffiné.
C’est une exhibition incomparable, qui attire l’œil autant qu’elle étonne l’esprit. Tous les spécialistes se trouvent donc en présence de ce qui concerne leur partie. «C’est une étude complète de ce qui fut, par la comparaison de ce qui est.»
On a groupé en suivant l’ordre chronologique, tous les produits du travail humain, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Des personnages de grandeur naturelle, complètent l’illusion. Ici, devant cette caverne, voilà un homme primitif, habillé de sa longue chevelure, qui travaille une pierre, un silex, dont il doit faire plus tard une arme tranchante.
Là, devant cette hutte en terre, une femme que la coquetterie n’a point encore conseillée, pétrissant la terre, s’essaie à confectionner des poteries informes.
C’est ainsi que dans toutes les branches d’industrie, on trouve le commencement pour arriver en descendant les âges, à l’outillage perfectionné des Arts et Métiers, aux ateliers gigantesques du Creusot, aux machines formidables des chemins de fer avec leurs trains luxueux. A cette section se trouve le premier wagon-salon construit pour le duc de Wellington.
Un jour, peut-être, nos machines actuelles que nous trouvons si perfectionnées, prendront place à leur tour comme ce wagon-salon, au nombre des souvenirs rétrospectifs. L’électricité est appelée à révolutionner le monde. Que de surprises elle ménage à l’avenir!
Je me suis vivement intéressée à l’histoire de la musique, c’est-à-dire à la reconstitution de tous les instruments depuis la flûte en roseau des premiers pasteurs, la harpe égyptienne conservée au Louvre, le Rébec copié sur une statue du musée de Chartres, jusqu’aux pianos, dont quelques modèles ont des panneaux de verre qui permettent en jouant de se rendre compte du mécanisme, jusqu’à l’orgue colossal, effrayant. Instruments à cordes et instruments à vent; quelle nombreuse famille ils forment, aussi bien chez les anciens que chez les modernes.
L’histoire du théâtre: costumes, affiches, programmes, portraits des virtuoses, architecture des salles, machinerie, cette machinerie si simple autrefois, si compliquée aujourd’hui qu’il faut être de la partie pour y comprendre quelque chose. Cette histoire du théâtre m’a paru très complète aussi.
Les travaux de sculpture et de peinture sont absolument remarquables. On suit là, pas à pas tous les efforts faits par l’homme, depuis le premier coup de pinceau et la première pierre taillée, pour progresser et perfectionner ses œuvres.
Très intéressante la reproduction avec personnages de grandeur naturelle des ateliers de céramique et de cloisonnés chinois à toutes les phases du travail. De loin on croirait ces ouvriers vivants.
L’aérostation a aussi ses représentants personnifiés par la timide Montgolfière et l’audacieux ballon.
Des plans de ponts, de barrages, de phares; des cartes de cosmographie et de géographie se développent sur un espace immense.
Quel est l’irrévérencieux qui s’était permis au siècle dernier de faire cette réponse en parlant des savants? «Un savant c’est un monsieur décoré qui ne sait pas la géographie.» Nous n’en sommes plus là, si tant est que cette épigramme ait jamais été vraie. Et combien de Français, savants ou hardis voyageurs, s’en vont aujourd’hui dans les pays les plus lointains à travers les glaces et les déserts, étudier la géographie sur place.
Saluons dans tous ces charmants spécimens, le daguerréotype, principe de tant d’inventions précieuses.
Je n’ai fait que passer dans la section d’anthropologie, sans doute c’est l’histoire de l’homme, mais c’est aussi celle de ses difformités, de ses maladies, de ses souffrances physiques. Ces corps écorchés, ces chairs qui semblent palpiter encore, tout cela m’a paru trop vrai. Parcourus aussi rapidement les instruments de chirurgie. Ils sont innombrables. Toutes ces scies, ces ciseaux, ces lames, ces pinces aux mille formes, en bel acier poli, brillant, me faisaient frissonner. Je croyais les voir et les entendre fonctionner dans la chair vive et le sang chaud.
Ah! ciel, si le destin m’avait fait naître du côté fort, je n’aurais jamais pu être chirurgien.
Mardi, 24 Septembre 1889.
Montmartre.—Le Musée de Cluny
Journée encore bien remplie: le matin à Montmartre, l’après-midi à Cluny, le soir au théâtre.
Le nombre des curieux et des pèlerins qu’attire l’église du Sacré-Cœur est considérable. Cette construction grandiose, dans le style bysantin, de cent mètres de long, et dont la flèche aura quatre-vingts mètres de haut, s’élève sur une éminence qui a elle-même cent vingt-huit mètres d’altitude. C’est de ce site exceptionnel qu’il faut voir Paris et tous ses monuments. La vue de cette grande capitale, se développant aux pieds de la magnifique basilique qui la domine et semble la protéger, est indescriptible. C’est de là qu’il faut contempler la tour Eiffel, pour comprendre sa prodigieuse hauteur.
En ce moment on ne peut juger la basilique du Sacré-Cœur, enfouie comme elle l’est dans les échafaudages. De loin, on ne peut pas non plus se rendre compte des fondations cachées dans le sol. Ces fondations sont déjà une première église souterraine, qui à elle seule coûte plus de quatre millions. Quoi qu’il en soit, je crains que l’ensemble ne paraisse toujours un peu lourd, un peu écrasé.
Jusqu’à présent, vingt-deux millions ont été dépensés, mais les recettes sont supérieures à ce chiffre, l’argent ne manquera pas. Le devis général s’élève à quarante millions.
Actuellement quatre clochetons dégagés de tout échafaudage, se détachent de la maçonnerie. Au milieu, s’élève la niche monumentale dans laquelle sera placée plus tard la statue du Sacré-Cœur. On n’a point encore commencé la grande coupole tout en pierre (c’est un des caractères distinctif de cet édifice colossal, qu’il n’y entre ni fer, ni bois, ni ardoises), devant être placée à l’intersection de la nef et du transept: elle sera dans le style de Saint-Pierre de Rome. L’échafaudage pour la construction de cette coupole ne sera pas une petite affaire.
La deuxième plate-forme atteindra juste à la hauteur de la colonne Vendôme. Sur cette plate-forme on dressera deux sapines de vingt mètres de hauteur chacune, et qui seront reliées par des croisillons. On se trouvera alors à la hauteur de cinquante-trois mètres, et ce ne sera pas fini. Sur ces sapines mêmes, il faudra élever une énorme charpente de dix-huit mètres, laquelle atteindra la naissance de la flèche, en sorte que le sommet de l’échafaudage se trouvera à soixante-douze mètres au-dessus du sol. Ainsi construit, cet échafaudage aura coûté cent cinquante mille franc.
Après cela on songera au campanile qui ne mesurera pas moins de quatre-vingts mètres de haut. Il y aura encore l’installation de l’éclairage électrique dans toute la basilique, et l’organisation des combles sur lesquels on pourra se promener. Plusieurs centaines de personnes pourront aller et venir, comme en plein boulevard, sur les toitures tout en pierre de l’édifice, d’où on jouira d’un splendide panorama, la vue s’étendant sur un espace de près de soixante kilomètres autour de Paris.
Un escalier intérieur, très bien éclairé par des prises de jour pratiquées dans l’épaisseur des murs, conduira sur ces toitures, d’un travail jusqu’ici inconnu.
C’est dire qu’il faudra encore plusieurs années pour que ce plan gigantesque soit entièrement achevé. La mosaïque sera l’ornementation intérieure des murs. Cette décoration des basiliques primitives s’harmonisera d’ailleurs mieux que toute autre avec le style byzantin.
Toutes les chapelles sont affectées aux grandes corporations modernes, Chapelles de la Marine, de l’Armée, de la Justice sous le vocable de Saint-Louis, des Arts, de l’Industrie, du Commerce. Les chasseurs auront aussi la leur due à l’initiative de Monsieur le Comte de Chabot et c’est la duchesse d’Uzés qui sculpte, m’a-t-on dit, la grande statue de Saint-Hubert qui en sera le principal ornement. Le croirait-on, la corporation qui passe pour la plus athée, la plus irréligieuse, y est aussi représentée, les médecins auront leur chapelle.
On est admis à faire figurer son nom parmi les fondateurs de l’Eglise sur des pierres qui coûtent cent vingt et trois cents francs, suivant qu’elles sont plus ou moins en vue. Treize mille trois cent quatre-vingt-trois pierres à cent vingt francs et deux mille sept cent douze à trois cents francs sont déjà retenues, il faut y ajouter la demande de cent quatre-vingt-dix-huit claveaux et de trente-trois pierres de bandeaux.
C’est à Annecy que se fera le moulage de l’énorme cloche La Savoyarde, qui sera la reine des bourdons de France, offerte par la Savoie, son nom l’indique.
Ce bourdon, du poids de près vingt mille kilogrammes, de quatre mètres de haut, de dix mètres de circonférence, donnera comme son, le contre ut, et s’entendra à quarante kilomètres.
Le battant en fer forgé sera du poids de huit cent trente-cinq kilos; l’anneau qui le fixera au cerveau de la cloche, à lui seul pèsera quatre-vingt-quatorze kilos.
Le mouton de bois qui supportera la Savoyarde doit-être taillé en plein cœur de chêne, dans un arbre superbe, un des rois des forêts du Limousin, offert par le comte de Montbron.
La Savoyarde ne sera pas encore la plus pesante des cloches fondues jusqu’à ce jour.
On sait, en effet, que la fameuse cloche de Moscou, la Géante, était si lourde qu’il fallait vingt-cinq hommes pour la mettre en branle. Son poids était de trois cent mille livres.
En Chine, notamment à Pékin, on en voit plusieurs qui pèsent soixante mille kilos.
A Marseille, le bourdon de Notre-Dame-de-la-Garde est d’un poids d’environ dix-huit mille kilos.
Quant à la célèbre cloche de la «Liberté», à Philadelphie, elle pèse cent cinquante mille livres, et il faut douze hommes pour la mouvoir.
En ce moment les dames catholiques parisiennes et provinciales travaillent avec zèle au tapis splendide qui ornera le chœur.
Le dessin de ce tapis représente Paris et Montmartre, qui se trouvent au centre. Les armes de Paris, soutenues par deux grandes chimères, sont placées dans la partie inférieure et accostées à droite et à gauche par deux blasons rappelant que Henri IV et Jeanne d’Arc ont campé l’un et l’autre à Montmartre avec leurs soldats.
Au-dessus de Paris, sur la première marche de l’autel, l’abbaye de Montmartre représentée par ses trois écus successifs. Celui du milieu est la croix de Lorraine. Deux motifs de style roman, enguirlandés de banderoles, portant le nom des nobles ouvrières, sont placés sur les côtés; enfin, dominant tout l’ensemble, les armoiries des deux archevêques constructeurs de la basilique. Ce tapis reviendra à cent mille francs.
Chacun sait que c’est à Poitiers en 1871, pendant nos désastres que le vœu national prit naissance. Approuvé par les évêques, béni par sa Sainteté Pie IX, adopté par des milliers d’adhérents, reconnu d’utilité publique par l’assemblée législative, on peut dire qu’il est devenu moralement grand et vraiment national.
Durant ma visite de ce matin, c’est du fond du cœur que j’ai demandé à Dieu qu’il répande ses meilleures bénédictions sur ma chère patrie.
Le musée de Cluny ou Palais des Thermes oblige à faire un peu d’histoire. Le palais primitif entouré de magnifiques jardins fut l’œuvre des Romains. A partir du IVe siècle, les rois Francs l’habitèrent jusqu’au Xe; puis il fut abandonné et les Normands achevèrent en partie sa ruine. Au XIVe siècle, il fut acheté par Pierre de Chalus, abbé de Cluny, et resta, jusqu’à la révolution, la propriété des moines qui d’ailleurs possédaient déjà, auprès de la Sorbonne, un collège ayant une grande réputation. En 1790, il devint propriété nationale, fut vendu et passa en plusieurs mains.
M. du Sommerard l’achète en 1833 pour y installer des curiosités archéologiques, des meubles rares, des objets d’art qu’il a passé la plus grande partie de sa vie à réunir. Ce vieux palais n’est-il pas un cadre à souhait pour y collectionner des antiquités? Hautes murailles crénelées, fenêtres à meneaux, balustrades ajourées, portes avec arc surbaissé, clochetons, gargouilles, frises enguirlandées d’animaux et de feuillages finement fouillés dans la pierre. La chapelle est un bijou d’élégance à mettre dans un écrin, comme le Campanile de Florence que Charles-Quint trouvait si beau qu’il aurait voulu le conserver dans un étui.
M. du Sommerard qui avait consenti à céder ses collections à la ville de Paris pour la somme de cinq cent quatre-vingt dix mille francs, et à la condition d’en rester le conservateur, mourut en 1842.
«La ville de Paris ayant alors pris possession effective de l’hôtel et des collections, les rétrocéda à l’Etat l’année suivante, avec les ruines romaines des Thermes de Julien, limitrophes de l’hôtel de Cluny.
Ces ruines, seuls vestiges de l’occupation de Lutèce par les Romains, servaient autrefois de caves à un tonnelier, et les voûtes, couvertes de terre végétale, soutenaient un jardin où le brave homme cultivait des légumes, et même aussi des arbres fruitiers. Louis XVIII fit abattre, en 1820, les maisons qui obstruaient ces ruines curieuses, fit enlever les terres qui les écrasaient, et restituer la forme des bâtiments enfouis, par un travail de restauration intelligente; des fouilles habilement menées amenèrent de nouvelles découvertes intéressantes.
La partie la mieux conservée est la grande salle, dont la voûte s’élève à quarante pieds de hauteur, d’une architecture étonnante par le grandiose des proportions. On croit que ce hall immense constituait la piscine froide des bains romains».
Le musée rétrospectif de Cluny est un amas, une profusion de richesses qu’il faut aller voir et revoir, Voilà des meubles incomparables de tous les pays, des tapisseries merveilleuses, des tombeaux, des bas-reliefs, des autels, des chaires, un lutrin gothique, des cheminées superbes, des médailles, des émaux, des ivoires, d’admirables dentelles, des objets de serrurerie et de ferronnerie, des panoplies encombrées d’armes de toutes les époques, des marbres, des bronzes, des tableaux, des vitraux, des statues, des vases précieux, des bijoux anciens, des instruments de musique extraordinaires, des voitures de galla, des chaises à porteurs d’une élégance hors-ligne, des traîneaux sculptés en forme de cygne; les carrosses sont magnifiques et vraiment «beurrés d’or», suivant l’expression pittoresque d’un gardien.
La collection céramique m’a paru très remarquable par ses nombreux spécimens de tous les temps et de toutes les écoles: faïences hollandaises, italiennes, mauresques, arabes, chinoises, japonaises et françaises comprenant les plus beaux modèles de Bernard Palissy.
La collection de chaussures m’a également intéressée. La chaussure, comme la numismatique, raconte l’histoire des peuples d’une façon plus fragile, sans doute, que le bronze ou l’argent, mais la forme des souliers a varié sous chaque règne, et cela est tout à fait amusant à constater. Anciennement, n’était pas cordonnier qui voulait, ce n’était pas une mince corporation que celle de la chaussure. Au XIVe siècle Paris avait une rue qui s’appelait: la rue Aux Petits Solers de Bazenne, et ce nom lui venait des cavetonniers ou fabricants de petits solers, qui s’y trouvaient en grand nombre. On peut voir à la bibliothèque nationale une ordonnance du roi Jean datée du 30 Janvier 1350, dans laquelle sont indiqués les prix des diverses chaussures depuis huit deniers jusqu’à quatre sols. Au XIIe siècle, les souliers sont pointus; puis viennent les souliers à la poulaine, mode inventée par un comte d’Anjou qui avait une difformité aux pieds. On finit par allonger si démesurément cette pointe recourbée, qu’on nomme poulaine, que l’Eglise s’en mêle et la défend aux clers et aux moines. Charles V à son tour fait paraître un édit qui proscrit la poulaine sous des peines sévères. Il paraît qu’avant nous les Grecs et les Romains avaient donné l’exemple en portant d’extravagantes chaussures. Nous en avons comme preuve ces sages paroles de Cicéron: «Si vous me donniez, dit-il, des souliers sicyoniens, je ne m’en servirais pas: c’est une chaussure trop efféminée, j’en aimerais peut-être la commodité; mais à cause de son indécence, je ne m’en permettrais pas l’usage».
La poulaine cède le pas à la chaussure large, très large, et donne lieu à la phrase proverbiale que nous prenons maintenant au figuré: Etre sur un grand pied. Du reste, dès le VIIIe siècle, nous voyons les souliers accentuer fortement la forme du pied droit et la forme du pied gauche pour mettre à l’aise les cors qui font souffrir les natures sensibles.
Le soulier se présente sous Louis XIV avec un talon rouge modérément haut pour les hommes, ridiculement élevé pour les femmes, voici pourquoi: la Reine Marie-Thérèse d’Autriche est de petite taille, elle ne trouve d’autre moyen de corriger ce défaut naturel qu’en portant des talons pyramidaux. Le peuple, les religieux et les religieuses gardent des souliers plats, et ce soulier plat fut pour Mme de la Vallière, lorsqu’elle entra aux Carmélites, un assujetissement des plus pénibles à cause de sa claudication. La cour enjoliva ses talons de peintures charmantes représentant des amours, des fleurs, des bergères signées Watteau. Sur les talons de Louis XIV étaient peintes des batailles signées Joseph Sarrocel.
Sous Louis XV, les dames portent des mules avec escarboucles, et la Camargo inaugure à l’Opéra un soulier qui fait fortune. La Pompadour revient aux souliers pointus avec une rosette et une boucle, cette mode passe à la chaussure des hommes et Louis XVI élargit si bien la boucle de ses souliers qu’elle effleure le parquet des deux côtés. Après la Terreur, nous voyons paraître timidement la bottine pour dame et la botte hessoise et Souvaroff pour homme.
Je ne sais si l’on collectionnera nos chaussures actuelles; mais en tout temps le soulier ne devrait avoir qu’une devise: commodité.
Le temps passe..., avant de partir je veux donner un coup d’œil aux dentelles. Il y a là des points à l’aiguille et de vieilles guipures sortis bien certainement de la main des fées. Où sont-elles les élégantes, les reines de la mode ou les vraies reines, peut-être, dont elles faisaient jadis ressortir la beauté?
La beauté des choses a été plus durable que celle des personnes.
Je reviendrai certainement passer quelques heures encore dans ce musée qui est une évocation saisissante des richesses et des splendeurs du passé.
Mercredi, 25 Septembre 1889.
"Le Prince Soleil" au Châtelet.
Le Dôme Central.
L’Exposition de nos manufactures nationales.
C’est hier soir que nous étions au Châtelet. Ah! quelle féerie que Le Prince Soleil! C’est un rêve vécu dont il est impossible de rendre compte. Vingt-deux tableaux se succèdent, tous plus extraordinaires, plus fantastiques les uns que les autres. Le ballet est un fouillis de maillots roses et de jupes de gaze. La danseuse étoile et la Mouche d’or font des merveilles; la danse des éventails est pleine d’originalité, où vous voyez cent cinquante personnes accompagnent en s’éventant, les plus jolis airs. Il y a un naufrage épouvantable où personne ne se noie. A la bonne heure, voilà comment je comprends les accidents en mer.
On voit la Suède, le Portugal, Gibraltar, l’Océan Indien, le Japon, le royaume du soleil; on assiste à des fêtes populaires et à des réceptions royales, dont tous les personnages, vêtus de soie, de pierreries et d’or, se meuvent dans des décors étincelants. Bref, de huit heures du soir à minuit, on voyage en plein conte de fées. C’est une fascination, un éblouissement à vous donner le vertige. Ah! sultane Schehérazade, où êtes-vous? Vos récits deviennent ternes comme un coucher de lune comparé aux éclatants rayons du Prince Soleil.
Quand vous arrivez de l’Exposition, on vous demande tout de suite: «Avez-vous vu la Tour, le Dôme central, le Palais des Machines?» Le fait est que cette trinité titanesque est bien faite pour vous troubler. On le serait à moins. Après cela vous percevez deux sentiments très distincts et diamétralement opposés: d’un côté, votre extrême petitesse personnelle; de l’autre, la prodigieuse grandeur de l’humanité!
Le Dôme Central est une œuvre superbe, «pondérée de lignes, harmonieuse de formes» d’une circonférence de trente-deux mètres de diamètre, et dont la coupole atteint une hauteur de cinquante-cinq mètres au-dessus du sol. Son ornementation est fort belle; quatre cartouches symboliques représentent les quatre forces principales de la nature appliquées à l’industrie: la vapeur, l’électricité, l’air et l’eau. Entre ces cartouches sont inscrits les noms des quatre arts que leur nature met en contact avec l’industrie: l’architecture, la sculpture, la peinture et la musique.
Tout en haut une peinture d’un grand effet, imitation de mosaïque, représente la caravane des peuples du globe dans leur costume national et pittoresque, marchant à ce rendez-vous général qu’on nomme l’Exposition.
Ce magnifique dôme renferme de magnifiques choses; contenant et contenu sont dignes l’un de l’autre.
Nos quatre grandes manufactures nationales s’épanouissent ici: Sèvres, Beauvais, les Gobelins et les mosaïques de l’Ecole du Louvre. Celles-ci, déjà remarquables quoique ne datant que d’hier. Quant aux tapisseries des Gobelins, malgré les produits admirables des Orientaux, elles restent sans rivales. Ces panneaux sont de véritables peintures où les nuances sont aussi fondues, aussi adoucies que celles d’un pinceau. Les porcelaines de Sèvres sont bien belles aussi: pâtes irréprochables, dures ou tendres, ainsi que cette porcelaine nouvelle, faite d’une pâte ni dure ni molle et qui rappelle celle de Chine, dont les Célestes gardent toujours le secret; peintures d’une finesse exquise, dessins d’une correction parfaite, mais point de nouveautés de genre ni de forme. Si j’osais hasarder une critique, je dirais que ce genre compassé, un peu raide et régulier, paraît presque démodé, si on le compare à l’imprévu des décorations, au caprice et à l’élégance de formes des autres expositions. La fantaisie qui se niche partout n’a point encore osé franchir le seuil de Sèvres qui reste le temple austère de l’art classique. Après cela, on entre dans un torrent de merveilles qui vous entraîne à l’infini, et l’on rapporte, de cette vision féerique, un fouillis inextricable de souvenirs...
Me voici donc devant une feuille blanche et un encrier noir, essayant de ressaisir, de rattraper tout ce que j’ai vu, mais c’est impossible; je ne puis me rappeler que ce qui m’a frappée davantage et d’ailleurs je suis encore si éblouie, toutes ces merveilles dansent ensemble une si jolie farandole dans mon imagination, que je sens bien que je ne pourrai jamais mettre d’ordre dans ma mémoire. Mais tous les livres ne sont-ils pas là pour vous promener méthodiquement et remettre les choses en place.
Jeudi, 26 Septembre 1889.
L’Hôtel de Ville.
De la fenêtre de ma chambre, je plonge sur plusieurs cours intérieures, sombres, étroites, sales! J’entrevois le réduit noir d’un charbonnier, le pétrin d’un boulanger, le four d’un pâtissier, le laboratoire d’un charcutier. Ah! ce dessous de Paris est bien à l’antipode du dessus, et je n’aurais jamais cru que le beau côté pouvait avoir un si vilain envers. De quels antres sortent cette charcuterie appétissante, ces affriolants gâteaux, ces excellents petits pains frais, croissants d’un sou, croissants de deux sous, qui tiennent une si grande importance dans la boulangerie parisienne. Certaines maisons en vendent jusqu’à dix mille par jour. Le pain de Paris, au dire des étrangers, des provinciaux, et je suis de ce nombre, est du vrai gâteau. Le pain de luxe se divise en deux grandes variétés: le pain français et le pain viennois. Celui-ci est plus agréable au goût; mais ne se conserve pas. Détail plein d’enseignement: le pain viennois, aujourd’hui le pain de consommation courante à Paris, ruina celui qui en inaugura la vente. Le comte Zang, secrétaire de l’ambassade d’Autriche, fonda, en 1840, la première boulangerie qui se servit des procédés de fabrication communément employés à Vienne. Le comte Zang avait installé sa boulangerie rue Richelieu. Dès le matin, on faisait queue pour acheter ses petits pains et ses croissants. Le comte Zang, grisé par le succès, voulut faire grand et se ruina en frais d’installation. Il dut quitter Paris après les évènements de 1848.
Mais le pain viennois est resté à la mode. C’est celui qu’on vous présente, fluet et à gerçures, en tire-bouchon, rond, et cinq fois fendu; celui-ci a nom: «l’Empereur»; il y a aussi le petit mirliton Richelieu et le brahoura ou nonette.
Cependant le pain français est d’une vente plus considérable que le pain viennois.
Le plus apprécié des pains de luxe français est le pain de gruau. Puis viennent le pain de gluten, le pain de seigle, le pain noir, ce qui ne laisse pas que d’étonner fort nos paysans bas-bretons, qui s’écrient d’un ton de suprême dédain: «ça du pain de luxe, jamais! Fi donc!»
De mon lit, j’entends le refrain monotone d’un frileux grillon attiré par la chaleur du four. Il chante toute la nuit. Cette petite voix infatigable, qui domine toutes les rumeurs de la ville, me fait rêver. Il m’apporte comme un écho du pays: le grillon chante aussi à nos foyers bretons.
J’ai dépensé ma matinée à l’Hôtel de Ville et au bazar qui porte son nom. Ah! ce bazar, quelle cohue! quelle bousculade! Ce doit être un lieu de prédilection pour les pickpockets. Du reste nous voyons chaque jour aux fait-divers que ces honorables industriels ne savent pas résister à la tentation.
L’Hôtel de Ville est bâti sur l’emplacement même du magnifique Hôtel de Ville pétrolé, incendié par les communards de 1871, celui-ci avait coûté quinze millions. Celui-là atteindra le chiffre de vingt-cinq millions quand toutes les décorations intérieures seront terminées.
Voilà donc le monument qui remplace aujourd’hui la modeste maison aux Piliers de 1529.
Dans ce temps-là les échevins royalistes étaient logés comme de simples bourgeois, aujourd’hui nos édiles socialistes sont logés comme des rois.
Il y a beaucoup de gens ainsi: autocrates pour tout ce qui est au-dessous d’eux, égalitaires pour tout ce qui est au-dessus. J’ai connu un maître de maison, imbu de ces bons principes qui n’a jamais permis que ses domestiques mangeassent du poulet.
Revenons à l’Hôtel de Ville actuel, l’un des plus beaux et des plus vastes monuments de Paris. Il présente un quadrilatère de cent cinquante mètres sur quatre-vingt-dix, et recouvre une surface de treize mille mètres carrés.
Très belle la cour d’honneur, dite cour Louis XIV, entourée d’une galerie vitrée. Encore plus belle la galerie vestibule du rez-de-chaussée, avec son plafond cintré en pierre et ses douze colonnes de six mètres de hauteur en granit de la Côte-d’Or, aussi beau que du marbre.
La partie centrale est précédée d’un parvis entouré de balustres de marbre et ornée de deux superbes bronzes: l’Art et la Science. Beaucoup de statues, ce qui donne grand air. Sur le fronton deux statues soutenant les Armes de la Ville, au-dessus une troisième statue assise personnifiant la Cité. Même décoration des deux côtés du cadran de l’horloge: un homme et deux enfants représentant le Travail et l’Etude.
Les quatre façades logent dans cent dix niches principales, les célébrités parisiennes: Jean Goujon, François Muiron, de Harley, l’Estoile, etc.... Enfin des statues partout, même sur les toits.
J’ai visité les superbes appartements du préfet, non habités. Le conseil municipal, qui est un petit état dans le grand, a mis son veto. Il n’entend pas que le préfet s’installe chez lui, que dis-je, chez eux, et le préfet cède.
J’ai remarqué dans cette enfilade grandiose la salle des Prévôts où sont gravés, sur des plaques de marbre, les noms des Magistrats municipaux de la Ville de Paris. Cette salle est partagée en trois nefs, séparées par deux rangs de belles colonnes en pierre, la magnifique salle Saint-Jean de quarante-sept mètres de long sur dix-sept mètres de large, formant nef avec travées latérales.
C’est dans cette salle qu’a lieu le tirage au sort; chaque arrondissement occupe une travée, et c’est ainsi qu’elle peut contenir tous les conscrits de Paris à la fois. La Salle des Fêtes est au-dessus, un double escalier orné de statues de marbre y conduit. Cette salle est splendide, tout y est beau, sauf pourtant le plafond bien froid, bien nu et qui attend, faute d’argent probablement, les peintures de maîtres qui doivent l’embellir et l’harmoniser avec un ensemble qui ne laisse rien à désirer.
C’est égal, quand cette salle est remplie de belles toilettes, de fleurs, de musique, de lumière, le coup d’œil doit être féerique.
Cette après-midi nous avons fait quelques visites. J’ai été heureuse de voir enfin la Vicomtesse de Renneville, la fondatrice de la Gazette Rose qui fut longtemps le code very select du hight life, et avec laquelle j’étais en correspondance depuis plusieurs années sans la connaître.
On gratte en ce moment toutes les affiches des élections, ce travail qui ne semble rien ne coûtera pas moins de trente mille francs à la Ville de Paris.
Tous ces murs sont bariolés, c’est une débauche de couleurs et de noms, une véritable orgie de nuances, avec calembour. Quelques candidats, M. Hervé du Soleil, entr’autres, avaient eu recours à un procédé plus nouveau: à l’aide de je ne sais quel moyen, il a fait imprimer son nom sur l’asphalte des trottoirs. Les mauvais plaisants prétendent que c’est trop se mettre sous les pieds des électeurs. Sous leurs yeux, passe encore; mais sous leurs pieds......
Les élections de dimanche ont porté le coup fatal et final à Boulanger et au boulangisme.
Les collectionneurs vont avoir beau jeu. Collectionner est pour certaines gens une fièvre non intermittente. On collectionne tout depuis les boutons de culotte... jusqu’aux affiches électorales. Ces dernières font le bonheur des chiffonniers qui les vendent bien, et comme rien ne se perd, leurs débris servent à fabriquer des poupées, des bourres de fusils, et surtout des boutons de bottines.
Ces affiches, transformées en feuilles de carton de l’épaisseur d’un bouton, sont alors coupées en bandes, puis présentées à une machine qui découpe le bouton et fixe la tige qui formera la queue.
Les boutons sont durcis dans des étuves chauffées à cent cinquante degrés, puis vernis et séchés.
Une seule usine fabrique cinq millions de ces boutons par jour.
Grandeur et décadence des professions de foi!
Ce soir, dîner en ville chez des Parisiens pur-sang fort aimables, fort spirituels, mais qui ne comprennent pas qu’on puisse vivre ailleurs que dans leur Paris.
Vendredi, 27 Septembre 1889.
Le Panthéon.—Les Grands Magasins.
L’Hôtel des Ventes.
La «Famille Benoîton» à l’Odéon.
Temps délicieux, tout m’a paru charmant sous le soleil d’or et le ciel bleu. Le soleil est l’émissaire de la gaîté. C’est incroyable l’influence qu’il exerce sur l’esprit; s’il se montre, tout sourit, s’il se cache tout devient triste.
Le Panthéon, chef-d’œuvre de l’architecte Soufflot, est bâti en forme de croix. L’entrée représente un temple grec; mais la coupole rappelle celle de Saint-Pierre de Rome. Louis XV en posa la première pierre en 1764. Cette église construite pour remplacer la vieille église Sainte-Geneviève qui tombait en ruines n’a pris le nom de Panthéon que sous la première Révolution, le 4 Avril 1791, à l’occasion de la mort de Mirabeau. Un instant, l’ignoble Marat reposa au Panthéon, mais bientôt le peuple justicier jeta ses restes à l’égout de Montmartre. Jusqu’en 1822, le Panthéon resta temple. A cette époque, il fut rendu au culte catholique. En 1832, il redevint temple; vingt ans après, il redevint église catholique. Enfin après la chute du second empire, il cessa d’être église pour devenir définitivement le temple de la gloire. Ces transformations sont absurdes; les athées auront beau faire, ils ne pourront jamais substituer le culte des grands hommes au culte du vrai Dieu. Enfin ils ont décrété que l’église souterraine contiendrait désormais les cendres de nos grands hommes. Victor Hugo y a pris place.
Ce temple, d’une architecture grandiose, est imposant, mais l’intérieur est bien froid. Si ce n’étaient les admirables fresques encore inachevées qui le décorent, il serait fort triste dans sa nudité rigide. Le long de ses hautes murailles se déroulent heureusement de belles peintures nous racontant l’histoire de sainte Geneviève, de saint Louis, la bataille de Tolbiac, le baptême de Clovis, le couronnement, par le pape, de Charlemagne, empereur d’Occident, le martyre de saint Denis. Et ces peintures sont signées: Puvis de Chavannes, Delaunay, Meissonnier. Ce sont là de grands souvenirs qui obligent ce temple à rester chrétien, malgré ses destinées profanes; d’ailleurs la croix domine toujours la coupole du Panthéon. On voudrait bien la faire disparaître, cette croix qui gêne les libres-penseurs du Conseil municipal; mais c’est difficile. Des architectes compétents ont déclaré qu’il serait à peu près impossible de la desceller sans enlever en grande partie la calotte de la lanterne, dans laquelle elle est fixée, et ce petit travail ne coûterait pas moins de trente à quarante mille francs. On songe à la scier, ce serait moins cher; mais comme on le voit, il en coûte de détruire presque autant que d’édifier.
L’après-midi nous sommes allées nous promener, c’est le mot, au Louvre, au Bon-Marché, au Printemps, au Gagne-Petit qui gagne gros sans sacrifier à la réclame, à Pygmalion, à la Samaritaine. Mon Dieu, oui, nous avons été faire un tour de magasins comme on fait un tour de place. Nous avons vu partout des étalages mirobolants, séduisants, provoquants et des choses pour rien.
Si j’avais été seule, je ne me serais pas plus facilement débrouillée au milieu de ces galeries immenses qui se croisent dans tous les sens, montent à tous les étages, que dans un labyrinthe inconnu. Ah! quelle lanterne magique que ces immenses magasins, où passent sans cesse, du matin au soir, des milliers de personnes. C’est très amusant à voir quand on n’a pas besoin d’acheter; car j’aime mille fois mieux faire mes emplettes tranquillement, chez moi, le catalogue en main, examinant et comparant les échantillons dont les magasins sont prodigues. Comme cela, à cent lieues du magasin on fait son choix; dans le magasin c’est impossible. Ces jours derniers, une de mes amies tenant à utiliser son voyage à Paris, s’achète une toilette toute faite. Les essayeuses lui assurent qu’elle lui va divinement. C’est une toilette chère mais qu’importe, mon amie a presque fait le voyage de Paris pour l’acheter. Elle revient enchantée, puis, voilà que dans le calme de sa chambre à coucher, en face de sa psychée, elle s’aperçoit que la fameuse robe ne lui va pas... divinement... mais indignement. Elle en a été quitte pour la retourner. Elle déclare à qui veut l’entendre, qu’on ne l’y reprendra plus.
Bousculé à perpétuité, à peine si l’on peut parler aux commis qui ne savent à qui entendre. Ce n’est peut-être pas toujours de même, il doit y avoir de temps en temps quelques jours de morte saison.
En rentrant pour dîner, nous avons été témoins sur les boulevards, d’un phénomène qui n’a été que plaisant, mais qui aurait pu être fort dangereux. Les câbles pour l’éclairage à l’électricité passent sous les rues. A la hauteur du café Napolitain, un courant par dérivation s’est, paraît-il, produit sous la chaussée, et une déperdition d’électricité se faisait à travers le pavage en bois (le pavage en bois, encore une innovation qui ne me plaît guère; chevaux et voitures sont près de vous avant que vous ne les ayez entendus); si bien que les chevaux, en arrivant à cet endroit, étaient tout à coup pris d’une danse folle; au moment même où leur sabot garni de fer touchait un certain point de la chaussée, les pauvres quadrupèdes subitement électrisés faisaient des bonds désordonnés, peu en rapport avec leur allure fatiguée généralement. Il y a eu bien vite rassemblement, c’était un spectacle inusité qui a duré jusqu’au moment où les gardiens sont venus interrompre la circulation, car on craignait de graves accidents. On est allé chercher des ouvriers électriciens pour couper les fils; mais on pense que tout cela va prendre du temps et que les boulevards courent risque d’être plongés dans une obscurité complète.
L’Hôtel des Ventes de la rue Drouot est un endroit «bien parisien.» Tout le monde y est entré au moins une fois dans sa vie pour voir ce que c’est, et j’ai voulu faire comme tout le monde. C’est l’hôtel du bric à brac, le très beau coudoie le très laid; et parfois de belles antiquités sont éclipsées par le moderne tapageur qui saute aux yeux. Je suis de l’avis de ce monsieur qui ne faisait collection que de porcelaines modernes. «Collectionner du nouveau, c’est insensé», lui disait un amateur qui n’aimait que le vieux. «Pardon, quand j’achète du moderne, je suis sûr de ne pas être trompé, on ne me vendra jamais de vieilles porcelaines pour des modernes, tandis que vous, collectionneur de pièces authentiques, vous risquez tous les jours d’acheter du neuf pour du vieux.»
C’est à l’Hôtel des Ventes qu’on peut philosopher et réfléchir aux vicissitudes humaines. Le mobilier de plus d’un personnage célèbre est venu s’échouer là. Ce dispersement des objets familiers qui lui furent chers est comme l’émiettement de sa vie. Que de souvenirs personnels jetés ainsi aux quatre vents de l’indifférence!...
L’Hôtel des Ventes est aussi un hôtel où la misère vient souvent frapper... Que de chose luxueuses vendues hier, pour acheter le pain de demain!... Douloureuse étape pour la fortune devenue infortune. C’est ici que les cœurs sensibles peuvent venir s’attrister, les naïfs se faire voler, les malins trouver des occasions et les brocanteurs s’enrichir!
La famille Benoîton, avec Mademoiselle Réjane, une grande artiste, nous a fait passer une bien agréable soirée. Quoiqu’elle soit vieille d’un quart de siècle, cette pièce n’a pas vieilli. En effet, si j’ai bonne mémoire, c’est le 4 novembre 1865, qu’elle vit le jour, ou plutôt la lumière, sur la scène de l’ancien Vaudeville. Elle reste jeune, parce qu’elle est vraie et que Sardou a su peindre des caractères. Je pense cependant que ces caractères sont l’exception, et j’espère que les étrangers ne s’imaginent pas que toute la société parisienne ressemble au tableau qu’en a peint M. Sardou.
C’est une satire un peu exagérée de nos mœurs. Si les individus passent, l’humanité reste avec ses mêmes défauts et ses mêmes qualités, et à côté de tant de familles dignes et respectables, il y aura toujours des familles Benoîton. Des mères écervelées et sans cesse sorties, des jeunes femmes imprudentes, des jeunes filles légères et parlant argot, des pères uniquement occupés d’argent; en un mot, il y aura toujours des intérieurs dont la devise sera: luxe et plaisir.
Le théâtre de l’Odéon est le second théâtre français, c’est-à-dire qu’on y joue supérieurement, puisque tous ses artistes vont ensuite à la Maison de Molière chercher la consécration de leur talent. Comme au Théâtre Français la diction est donc parfaite, le style excellent, le naturel complet. On souligne le mot, juste ce qu’il faut pour qu’il ne soit pas trop accentué. On s’imagine qu’à la fin de la représentation tous les artistes doivent être bien fatigués. Ils se sont dépensés sans compter; identifiés à leur personnage, pénétrés de leur rôle, on pense que les émotions qui ont gagné tout l’auditoire, et qu’ils ont si bien rendues, ont dû les épuiser. Il paraît que non. Le talent doit être avant tout le fruit de l’étude, de l’effet cherché et voulu, pour chaque phrase, on pourrait dire pour chaque mot. C’était du reste un principe de Talma, que pour faire beaucoup d’effet, il ne faut plus que le rôle vous en fasse à vous-même, autrement qu’arrive-t-il? on joue suivant les dispositions du moment, on se laisse guider par les situations, entraîner par la passion et comme cela on est un jour bon et le lendemain mauvais. Le jeu ne peut être égal que si l’on est avant tout parfaitement maître de soi.
On raconte que Talma apprenant la mort de sa fille jeta une exclamation douloureuse. C’était le cri du père, mais presque aussitôt l’artiste reprit le dessus et il murmura: «Ah! si je pouvais retrouver ce cri-là sur la scène!» Si cela est vrai, la recherche de l’effet pourrait donc chez certains acteurs dominer tous les sentiments.
Samedi, 28 Septembre 1889.
Le Palais des Machines
Ah! ce Palais, il confond l’esprit, saisit l’imagination, éblouit les yeux, assourdit les oreilles. C’est un ensemble absolument indescriptible, c’est l’apothéose du métal; c’est la plus haute expression des arts mécaniques arrivés à leur apogée, sauf pour l’électricité, qui n’a pas dit son dernier mot et qui, jouant un rôle aussi important quoique plus nouveau que la vapeur, pourrait bien la détrôner un jour.
Les électriciens, ça ne doute de rien; ils assurent que l’électricité arrivera à tout faire, à éclairer la maison, à cuire le rôti, à faire rouler les voitures, etc., etc. La voilà déjà en Amérique qui remplace la corde et le couperet. D’un seul coup de baguette, c’est-à-dire d’une simple décharge, elle envoie de vie à trépas les condamnés, sans qu’ils s’en aperçoivent. Allons, encore quelques perfectionnements et elle sera capable de ressusciter les morts!
Ce colossal palais des machines est dans son genre d’une conception aussi audacieuse, aussi gigantesque que la Tour Eiffel. C’est une merveille d’équilibre et de hardiesse, de force et de légèreté. Le Palais des Machines a cent quinze mètres de largeur, sur quatre cent vingt mètres de longueur, sa hauteur est de quarante-huit mètres. L’Arc de Triomphe de l’Etoile pourrait s’y loger, aussi bien que la colonne Vendôme, qui n’atteindrait pas son sommet. En totalisant les espaces qu’offrent ce Palais et ses galeries, on arrive au chiffre étonnant de quatre-vingt mille quatre cents mètres carrés—huit hectares! Une armée de trente mille hommes pourrait y dormir à l’aise, chaque homme disposant de plus de deux mètres carrés, et les dégagements restant libres, quinze mille chevaux pourraient y être installés, pendant que leurs cavaliers coucheraient dans les galeries du premier étage. Voilà ses proportions!
Dans cet immense hall pas un coin n’est inoccupé. Partout le travail et le mouvement sans arrêt; partout des représentants des œuvres les unes géantes, les autres minuscules.
Il y a là des merveilles de mécanique. La métallurgie, la fonderie, ont fait d’immenses progrès. Nous revenons à l’âge de fer du monde civilisé; ce métal devient le roi des constructions et prend la place du bois et même de la pierre, il se plie à tous les besoins, gardant sous un petit volume une force énorme. Cet amoncellement fantastique de fer, de fonte, de bronze, de cuivre, donne bien cette impression de vacarme pétrifié dont parle Victor Hugo. Il y a des choses qui frappent même les moins compétents. Une scie sans fin, en acier, d’une longueur de trente-cinq mètres cinquante, des blindages extravagants, il y en a qui pèsent vingt-huit mille kilos; effrayant aussi le facsimile d’un lingot d’acier de cent mille kilos.
Il y a des machines charmantes qui font les plus jolies et les meilleures choses du monde. On dirait que les inventeurs de ces machines leur ont communiqué leur intelligence. Elles font tout ce qu’on veut: des dragées, des bonbons, des fleurs, des rubans et des dentelles; elles fabriquent des chaudières et tricotent des bas; elles ravaudent le linge et tissent merveilleusement le coton, la laine, la soie.
Ce sont des ouvrières incomparables!
Après les machines aimables, il y a les machines effrayantes qui hachent, coupent, brisent, broient tout et qui fabriquent de tels engins de destruction qu’elles finiront, j’espère, par rendre la guerre impossible.
A la hauteur de sept mètres, deux grands ponts roulants à l’électricité, marchent constamment d’un bout à l’autre de cette titanesque Galerie des Machines, ce qui permet aux visiteurs qu’ils promènent, d’embrasser d’un coup d’œil cet ensemble colossal, et l’on passe ébloui, fasciné de section en section, de galerie en galerie, de palais en palais, on admire, on admire encore, on admire toujours!... mais l’on ne peut retenir que ce qui frappe davantage.
Dimanche, 29 Septembre 1889.
Grand’messe à Saint-Sulpice.—Exposition
Fontaines lumineuses
Embrasement de la Tour
C’est donc aujourd’hui le grand jour des récompenses: jour de joie pour les uns, jour de déception pour les autres.
La matinée est belle, le soleil luit sur les têtes et l’espérance dans les cœurs. Ce soir il y aura moins d’heureux.
Notre programme est arrêté: grand’messe à Saint-Sulpice; après le déjeuner, un tour aux Champs-Elysées, pour voir défiler le cortège se rendant au Palais de l’Industrie; dîner à l’Exposition, afin d’assister le soir aux jeux des fontaines lumineuses et à l’embrasement de la tour. Il faut nous hâter, les soirées deviennent de plus en plus fraîches.
Après la grand’messe officiée solennellement, j’ai parcouru cette belle église de Saint-Sulpice, dont le portail est de Servandoni. La chaire remarquable fut donnée par le cardinal de Richelieu, les bénitiers formés de deux gigantesques conques marines, par François Ier. J’ai surtout admiré les belles peintures de la chapelle des Anges, la lutte de Jacob; Héliodore, chassé du temple, saint Michel terrassant le démon, qui sont d’Eugène Delacroix. Ces peintures commencées en 1840 furent payées vingt mille francs au grand artiste. Deux autres églises seulement Saint-Denis du Saint-Sacrement et Saint-Paul-Saint-Louis, possèdent deux toiles de ce maître: La déposition de la Croix, peinture murale payée six mille francs, en 1843, et Jésus au Jardin des Oliviers, payée deux mille quatre cents francs, en 1827. Ces peintures sont aujourd’hui d’une valeur inestimable. L’église Saint-Sulpice fut fermée pendant la Révolution. Le gouvernement l’accorda ensuite aux Théophilantropes, qui l’appelèrent le Temple de la Victoire. Le 5 novembre 1799, il y fut donné un grand banquet au général Bonaparte.
L’église Saint-Sulpice, au dire des connaisseurs, n’est point un modèle d’architecture, peu m’importe. Avec ses tours, ses grandes baies, ses colonnes, son vaste perron, je lui trouve fort grand air et elle me plaît ainsi. La belle fontaine qui la précède semble faire partie de son ornementation, c’est ainsi que l’a compris son auteur Visconti, puisqu’elle abrite dans ses niches quatre maîtres de l’éloquence sacrée: Bossuet, Massillon, Fénelon et Fléchier.
Dès une heure, une foule compacte envahit les Champs-Elysées. C’est un enchevêtrement de piétons et de voitures, qui donne le frisson. On n’avance qu’à tour de roues, les moyeux se touchent et nous sentons sur nos épaules les naseaux du cheval traînant la voiture qui nous suit. Nous regardons de très loin le nombreux défilé qui escorte le carosse présidentiel. Après avoir entrevu le visage glacial de Monsieur Carnot, nous nous sauvons à l’Exposition.
Dans de pareilles foules, on peut dire qu’on ne se rend compte de rien, c’est en lisant le programme que l’on voit mieux la fête. Le voici:
La cérémonie des récompenses aura lieu au Palais de l’Industrie.
Vu l’exiguité de la nef, les récompensés ne seront admis que depuis les médailles d’argent jusqu’aux grandes médailles d’honneur. Les récompenses plus modestes seront remises ultérieurement; d’ailleurs on n’aurait pas le temps de tout distribuer en un jour.
Cinq mille hommes de troupes en grande tenue, cavalerie, infanterie et artillerie, occuperont une partie des Champs-Elysées, de la place de la Concorde et du Cours-la-Reine.
Sur le passage du Président de la République, les musiques joueront, les tambours, les clairons, les trompettes battront, sonneront aux champs.
A l’intérieur ce sera la même chose, l’éloquence et la musique complèteront cette fête superbe. On jouera la Marche héroïque de Saint-Saëns comme ouverture; La Marseillaise, à l’arrivée du Chef de l’Etat; pendant le défilé des groupes français et étrangers, le chœur des Soldats, de Faust, l’Apothéose de la Symphonie triomphale de Berlioz et le cortège du premier acte d’Hamlet; entre les deux discours officiels. Lux, paroles de Victor Hugo, musique de B. Godard.
La proclamation des récompenses sera divisée en trois parties, annoncées chacune par des Fanfares écrites spécialement pour la circonstance par M. Léo Delibes. Enfin, la cérémonie sera terminée par la finale du deuxième acte du Roi de Lahore, de M. Massenet, suivi d’une reprise de la Marseillaise. L’orchestre et les chœurs, composés des artistes de la Société des concerts, de l’Opéra, et de l’Opéra-Comique, auxquels seront adjointes les deux musiques de la garde républicaine et de l’école d’artillerie de Vincennes, formeront un total de huit cents exécutants, sous la direction de M. Jules Gracin, chef d’orchestre du Conservatoire.
Le défilé sera composé ainsi:
Les comités étrangers, classés par ordre alphabétique, ayant à leur tête, autour du drapeau, les gardiens de leur section ou de leur pavillon; un peloton de soldats français; les neuf comités français de groupe précédés de bannières; enfin, les commissariats de l’Algérie, de la Tunisie, des colonies et des pays de protectorat.
Il descendra par le grand escalier, traversera la salle dans sa partie centrale et dans toute sa longueur, puis faisant un crochet à droite, passera au pied de la tribune présidentielle en faisant doucement flotter les drapeaux et les étendards.
Ensuite, il pénètrera par une porte latérale sur la scène, où il prendra place.
Au moment de l’entrée du public, le rideau sera baissé. Il ne sera levé que lorsque l’orchestre aura attaqué son premier morceau. A ce moment, la scène sera déjà occupée par les gardiens français de classes portant leurs bannières. Ceux-ci ne prendront pas part au défilé.
Quand le cortège sera arrivé et placé, les groupes seront disposés sur la scène de la façon suivante:
Sur l’avant-scène, deux cent vingt-cinq places auront été réservées aux membres du jury. De chaque côté, quatre porteurs de bannière de groupes français prendront place. La neuvième bannière se tiendra au centre, derrière le jury. Sur les degrés qui conduisaient à l’autel de la Patrie, pour l’Ode triomphale, seront groupés les étrangers, ayant tout autour d’eux les gardiens français de classe. Au fond de la scène, figureront les colonies.
On le voit, rien n’a été négligé pour donner à cette cérémonie le plus d’apparat possible.
Le richissime M. Osiris offre un prix de cent mille francs. Ce prix est destiné à l’auteur de l’œuvre la plus utile figurant à l’Exposition.
Le comité a examiné successivement toutes les candidatures possibles, les inventeurs, les philantropes et même les gastronomes. Tout en rendant hommage aux architectes des autres constructions de l’Exposition, la majorité des membres du syndicat s’est accordée pour décerner le prix Osiris à tous les constructeurs de la Galerie des Machines. Ils ont jugé que leur œuvre, aussi imposante que la tour Eiffel et aussi saisissante par ses vastes dimensions, avait réalisé un immense progrès dans l’art des constructions utiles.
Le commissariat de la section des colonies françaises publiera, en même temps que le palmarès officiel, un palmarès spécial des récompenses accordées à nos exposants d’outre-mer.
Ces récompenses, au nombre de mille deux cent dix-sept, sont ainsi réparties:
Quinze grands prix,
Cent soixante-deux médailles d’or,
Trois cent vingt-et-une médailles d’argent,
Trois cent vingt-six médailles de bronze,
Trois cent quatre-vingt-treize mentions honorables.
En 1878, les exposants des colonies françaises n’avaient obtenu que sept cent soixante-cinq récompenses.
Plus on va à l’Exposition, plus on a envie d’y aller. Je déclare, en conscience, qu’il faudrait largement les six mois qu’elle durera pour tout voir, et encore... Aujourd’hui, cependant, nous n’avons fait que flâner. Nous nous sommes amusées à regarder passer les passants... qui passaient. Le spectacle des visiteurs eux-mêmes constitue la plus vaste section de l’Exposition; que de physionomies particulières, de types exotiques, de toilettes fantaisistes. Nous sommes allées prendre une glace ici, un bock là. Nous nous sommes assises pour écouter les musiques de toutes sortes qui se font entendre un peu partout. La musique étrange et pittoresque des Tziganes dans leurs costumes flamboyants m’a surtout frappée. C’est vraiment merveilleux de voir avec quelle volubilité et en même temps quelle perfection ces virtuoses, qui sont surtout musiciens d’instinct et n’ont fait aucune étude sérieuse, font résonner le violon, la flûte de Pan et leurs instruments nationaux. Leur chef, Miéhesi Nestulescou, un nom qui n’est pas facile à retenir, est un violoniste hors ligne; ses solos, pleins de couleur et d’originalité, admirablement soutenus par l’orchestre, m’ont paru délicieux. En revanche, le Cheval dans les Steppes, solo de musique imitative avec la flûte de Pan, m’a plus étonnée que charmée: c’est un peu trop roumain pour moi; mais c’est égal, un concert comme celui-là de temps en temps ferait plaisir. Nous avons aussi entendu le Xilophone et l’Ocarina: celui-ci est un petit instrument en terre, une petite poterie trouée et l’autre un instrument en bois, un petit clavier sur lequel on frappe avec deux baguettes de fer. Les artistes qui manient ces instruments, de la main ou des lèvres, en tirent des sons d’une douceur infinie et d’une justesse extrême. Orphée avait le don d’animer les pierres; ici c’est la terre et le bois qui parlent. On peut encore entendre la musique caractéristique du tambourin, du galoubet, du biniou, de la cornemuse, de la vielle, de la mandoline, de la guitare, sans oublier les instruments pittoresques propres à chaque peuple et les grandes auditions: concours, festivals et concerts.
Nous sommes allées dîner aux Bouillons Duval. Il y avait foule pour y arriver. Nous avons dû serpenter près d’une heure et nous armer de patience. Nous nous sommes mises à table à sept heures et demie; mais je pense que les derniers n’auront pas dîné avant neuf heures.
Puis, nous sommes allées prendre nos places aux Fontaines lumineuses. C’est un spectacle magique, difficile à décrire. Comment peindre la transparence, la limpidité de ces cascades aériennes, s’irradiant de toutes les couleurs du prisme, de ces gerbes lumineuses s’élançant dans la nue, semblables à des flocons de neige argentée, à des nappes d’or en fusion. Comment dépeindre et l’embrasement de la tour qui fait pâlir les étoiles et paraît tout en feu dans la nuit sombre, et ses projections électriques. De son phare, se détache un fil mince et lumineux qui, traversant l’espace vient envelopper d’une clarté céleste les groupes sculpturaux des jardins, ou couronner d’un nimbe vaporeux le génie triomphant.
Ces projections électriques s’étendent, par les nuits claires, jusqu’à dix kilomètres. Leur puissance lumineuse peut atteindre l’intensité de seize millions de becs Carcel. Les savants expliquent très bien tout cela et le jeu de ces fontaines multicolores et les projections lumineuses; moi, je me contente de les regarder sans chercher les explications, et c’est le conseil que je donne à tous les curieux: Venez et admirez.
Nouvelle de la dernière heure: on annonce la prochaine arrivée à Paris de cinq cents highlanders, qu’un de leurs compatriotes, le colonel écossais David White, conduit en corps visiter l’Exposition.
Voilà qui nous promet une triomphale exhibition de mollets!
Lundi, 30 Septembre 1889.
Les Ruines du Palais de la Cour des Comptes.
Promenade en voiture dans Paris.
Ce matin, nous sommes allées visiter, au quai d’Orsay, les ruines du Palais de la Cour des Comptes et du Conseil d’Etat. J’avais envie de voir de près ces amas de pierres calcinées et de fers tordus qu’on aperçoit continuellement en se promenant dans Paris. Une végétation luxuriante les entoure maintenant. Des gerbes de fleurs tapissent les murs, des fusées de feuillages s’élancent des fenêtres, des lianes flexibles enguirlandent les colonnes: on dirait que la nature réparatrice cherche à cacher le mal fait par la fureur des hommes. Ces ruines ont un portier. Pourquoi faire? Est-ce pour ouvrir la fenêtre aux oiseaux et fermer la porte aux souris! Les fenêtres sont béantes et les portes brisées...
Ces ruines sont peut-être aujourd’hui le seul souvenir attristant, encore debout, légué par la Commune.
«Jadis, il n’était pas beau ce palais, me disait hier un critique d’art, à présent je le trouve superbe dévoré de verdure tel qu’il est; tantôt, il me donne les illusions d’une substruction romaine; tantôt, j’y vois une fantaisie bobélique ou une eau-forte de Séranèse. J’y trouve encore une forêt vierge en miniature où le vent et les oiseaux ont semé, disent les botanistes, cent cinquante-deux espèces de plantes, le feu a été l’artiste capricieux de cette architecture, bien banale, quand elle était crue, et qui est devenue admirable maintenant qu’elle est cuite».
Les gens, amateurs de vues pittoresques, qui trouveraient que Paris manque de ruines—amour du contraste—pourront demander leur conservation, d’autres voudront les garder à un tout autre point de vue, comme l’enseignement perpétuel des générations futures. N’est-ce pas l’histoire racontée aux yeux; l’image vraie des horreurs que peut enfanter la guerre civile. On viendra là, dans ce joli décor de fleurs nouvelles, méditer sur le néant des choses de ce monde, dont les plus merveilleux monuments sont tous appelés à faire un jour des ruines.
C’est dans un linceul de flammes et de sang que la Commune voulait ensevelir Paris. Elle alluma de terribles incendies. Celui-ci fut épouvantable, et les débris de toutes les archives qui brûlaient et s’envolaient, emportées par le vent, vinrent tomber en pluie de petits papiers à plus de trente lieues. Louis Esnault, dans son Paris brûlé par la Commune, raconte qu’on en trouva jusqu’en Normandie, dans un jardin d’Evreux.
«Quand, le mardi 23 mai 1871, les insurgés, serrés de près par les troupes de Versailles, se virent contraints d’abandonner la rue de Lille, l’un de leurs quartiers généraux, ils voulurent élever un rempart de flammes entre eux et leurs adversaires. Ce furent les premiers incendies allumés.
«Précédés d’un spahi du plus beau noir, enchanté de faire payer aux Français de Paris la profanation des mosquées algériennes, les révolutionnaires se rendent d’abord à la Cour des Comptes. Toutes les grilles sont fermées; le concierge appelé ne répond pas.
«Une porte s’ouvre sur la rue de Belle-chasse, donnant accès dans les bâtiments du Conseil d’Etat; un baril de poudre est roulé dans la salle des séances, on y défonce un tonneau de pétrole; l’huile minérale se répand sur le parquet des salons, sur les marches des escaliers.
«En franchissant la galerie extérieure, on gagne vivement la Cour des Comptes.—Taïeb! (bien!) grogne le spahi. Des hommes qui viennent de trouver un stock de médailles de Sainte-Hélène et qui en ont leurs tabliers remplis, lancent les glorieux insignes à la volée dans les cours; des femmes, armées de seaux et de pinceaux d’afficheur, badigeonnent les boiseries de liquide inflammable.
«Il est six heures: la nuit approche; une sonnerie de clairon retentit; un officier des fédérés lâche à bout portant un coup de revolver sur le ruisseau où coule le pétrole, qui flambe instantanément.
»Le Conseil d’État, la Cour des Comptes et des archives, la Caserne du quai d’Orsay, la Caisse des Dépôts et Consignations s’allument en même temps.»
La parure la plus belle de cet édifice moderne qui ne comptait que quatre-vingts ans était la double série d’arcades superposées, entourant la cour intérieure. Une perte bien regrettable aussi est celle des peintures qui ornaient les salles et qui étaient signées: Isabey, Flandrin, Delaroche.
Nous projetons une nouvelle promenade champêtre au Parc Monceau, aux Buttes Chaumont, au Parc Montsouris.
Quand il fait beau, le lundi est le jour qu’on doit choisir pour se promener.
C’est le jour hebdomadaire du nettoyage des établissements publics. Les théâtres font relâche, point de matinées et les musées sont fermés.
Nous avons donc fait l’après-midi une longue promenade en voiture, parcouru les principaux quartiers, salué les monuments au passage, enfin admiré tout cet ensemble grandiose et élégant qui donne tant de physionomie à notre capitale.
Ah! que Paris est grand! et dire cependant que c’est une ville qui ne s’achèvera jamais, grâce à ses réparations, constructions, embellissements et changements.—Le mieux est souvent l’ennemi du bien.—Il paraît qu’on se fatigue même du beau. Le désir du changement appartient à la nature humaine en général et à l’esprit français en particulier. Et voilà pourquoi on a bouleversé de fond en comble et l’on modifie encore sans cesse la vieille cité de Clovis, la capitale des Rois de France.
La place de la Concorde par ses proportions grandioses, sa magnifique ordonnance, ses fontaines monumentales, ses colonnes et ses statues qui personnifient les principales villes de France, est l’une des plus belles places que l’on puisse voir.
L’obélisque de Luxor couvert d’hiéroglyphes contribue aussi à son ornementation.
Ce pauvre enfant du désert, comme l’appellent les uns, cette aiguille de Cléopâtre, comme l’appellent les autres, ce remarquable monolithe de vingt-trois mètres de haut d’un marbre rose qui brave les siècles, apparaît comme l’admirable spécimen d’une civilisation disparue et peut-être supérieure à la nôtre......
Que restera-t-il de nos palais somptueux, de nos monuments si orgueilleux, quand ils auront l’âge des monuments d’Egypte?
Peu de chose sans doute; mais présentement Paris est bien beau avec ses Palais: Louvre, Luxembourg, Palais-Royal, Palais-Bourbon, Palais de Justice; avec ses Hôtels des Invalides, de la Légion d’Honneur, de la Monnaie et son admirable Hôtel de Ville, et Tutti Quanti; avec ses Arcs de Triomphe de l’Etoile et du Carrousel; ses portes Saint-Denis et Saint-Martin; ses belles rues, ses quais, ses magnifiques boulevards, ses vingt-huit ponts sur la Seine, ses fontaines monumentales, ses théâtres, ses colonnes et ses statues colossales, ornant ses places, ses squares et ses jardins.
La colonne Vendôme, à la gloire de Napoléon, fondue avec le bronze de douze cents canons pris à l’ennemi, est une imitation de la colonne Trajane de Rome.
La colonne de Juillet garde le souvenir d’une autre dynastie; le lion qui orne son piédestal, du sculpteur Barye est, dit-on, une œuvre d’art de la plus rare beauté.
Paris est réputé pour l’une des plus belles villes du monde; c’est aussi mon avis et j’en suis fière.
Cette promenade le jour dans notre capitale m’a paru si agréable que j’ai voulu la continuer après dîner. Paris, le soir, avec ses interminables cordons de lumières qui brillent le long des rues, des quais, des boulevards, se présente avec plus de prestige encore; quand la lune s’en mêle, c’est un véritable enchantement.
Les monuments de l’ancienne cité se dressant dans l’ombre vaporeuse et grandissante forment un décor grandiose, magnifique; l’imagination est séduite au plus haut point. Notre-Dame, le Palais de Justice, la Sainte-Chapelle, la Tour Saint-Jacques, toutes ces merveilles de l’art gothique vous ramènent à trois siècles en arrière, et pendant cette minute de rêve et d’oubli du présent, on se demande si les archers sont encore là montant le guêt au sommet des tours.
Les descriptions que Victor Hugo a faites du vieux Paris dans son ouvrage Notre-Dame de Paris, sont d’une rigoureuse exactitude. Je le constate avec plaisir.
Mardi, 1er Octobre 1889.
Ascension à la Tour.
Ah! cette tour, c’est la neuvième merveille du monde, puisque Mme de Sévigné a déjà déclaré que le Mont Saint-Michel est la huitième. Et l’Exposition, c’est aussi une merveille. Le présent surpasse l’antiquité. Enfoncés les Jardins suspendus de Babylone, les Pyramides d’Egypte, le Phare d’Alexandrie, le Colosse de Rhodes! Enfoncés le Temple de Diane, la Statue du Maître des Dieux, le Tombeau de Mausole. Le passé est une belle chose dont nous gardons un souvenir respectueux; mais vivent les temps modernes dont nous admirons les splendeurs infinies!
Je faisais mon ascension seule; ma cousine, un peu fatiguée de la vie étourdissante que nous menons était restée chez elle.
Partie à une heure, j’avais promis d’être de retour à sept heures pour dîner. Et bien! je suis rentrée à huit heures un quart! Ma cousine était dans une inquiétude extrême. Depuis une heure la femme de chambre, debout au balcon, interrogeait du regard toutes les passantes, cherchant à me reconnaître. L’attente rend le temps long et toutes les deux, loin de se calmer, de s’exhorter à la patience, s’exhaltaient de plus en plus.
«Ma cousine aura eu un accident de voiture, disait la maîtresse du logis», et la femme de chambre reprenait en sourdine: «Elle se sera fait écraser par un omnibus».
—A moins que pour changer de locomotion elle n’ait voulu revenir par les bateaux-mouches et qu’elle se soit ensuite trompée de rues pour rentrer à la maison.
—Peut-être s’est-elle en effet égarée? Vous avez raison, cette pensée me tranquillise. Mon Dieu! pourvu qu’elle ne soit pas tombée aux mains d’un bandit qui, lui donnant de fausses indications, l’aura entraînée...
—Taisez-vous, Anne-Marie, vous me faîtes peur...!
—Si Madame n’est pas rentrée à neuf heures, je courrai à la police.
Ma cousine avait la tête à l’envers.
—Il faudra que j’écrive à sa famille, a-t-elle murmuré.
—Et que j’aille à la morgue demain, a continué Anne-Marie, une si bonne dame, quel malheur! que devant Dieu soit son âme! Et Anne-Marie a poussé un gros soupir».
J’ai entendu son hélas et la fin de sa phrase en ouvrant la porte du vestibule. J’arrivais juste à temps pour dire Amen à mon oraison funèbre. Ma cousine s’est jetée dans mes bras: «Que t’est-il donc arrivé?
—Mais rien, du moins une chose bien simple, j’ai été arrêtée par l’enterrement du général Faidherbe et j’ai, non pas perdu, mais dépensé deux heures à voir le défilé, de sorte qu’au lieu d’arriver à la Tour avant deux heures, j’y suis arrivée vers quatre, et j’y suis restée jusqu’à la nuit et même un peu plus, pour la voir à la clarté des lumières après l’avoir vue à la clarté du jour. Je reviens enchantée sans avoir éprouvé le moindre incident, sans parler d’accident».
Nous nous sommes mises à table, ma cousine n’a pas mangé, ses doubles émotions de crainte et de joie lui avaient fermé l’estomac, en revanche, comme le mien battait le rappel depuis longtemps, je me suis montrée fort belle fourchette en faisant honneur aux sauces fines de la cuisinière et même fort belle cuiller en savourant jusqu’à trois reprises une crème aux fruits absolument délicieuse.
Mercredi, 2 Octobre au matin.
L’enterrement du général Faidherbe a été une imposante cérémonie que je suis bien aise d’avoir vue. Dans ce diable de Paris, il y a toujours de l’imprévu dont les étrangers profitent. L’affluence était énorme sur tout le passage du cortège, c’est à grand’peine que les agents chargés d’assurer le service d’ordre parvenaient à faire faire place; chacun se huche comme il peut; on loue une petite table pour monter dessus deux francs, un barreau d’échelle cinquante centimes.
A midi précis, une batterie placée sur le quai d’Orsay a tiré plusieurs salves et le cortège s’est mis en marche.
En tête le 23e de ligne, le 1er régiment du génie et les Sénégalais de l’Esplanade des Invalides portaient une couronne de lauriers, immédiatement après les troupes, venait le char funèbre attelé de quatre chevaux tenus en mains par des piqueurs; aux quatre coins du corbillard, des faisceaux de drapeaux; la bière était recouverte par un drapeau tricolore. Les cordons du poêle étaient tenus par MM. de Freycinet, ministre de la Guerre, l’amiral Duperré, M. Testelin, sénateur du Nord, les généraux Lecointe, Bressonnet et M. Barbier de Meynard, membre de l’Institut.
Autour du char se tiennent des tirailleurs sénégalais. Les sapeurs du génie, en deux files, marchent le long du cortège, l’arme renversée.
La musique est lugubre, la Marche funèbre de Chopin produit un grand effet.
Les délégations qui sont venues apporter des couronnes sont très nombreuses; il y en a des quatre coins de la France; il y en a même de l’Algérie et du Sénégal. Les plus remarquées sont celles-ci:
«A Faidherbe, la colonie du Sénégal.—Au président d’honneur de la Société amicale des anciens élèves de l’Ecole polytechnique.—La ville de Saint-Quentin au général Faidherbe.—Au Grand-Chancelier, les gens de service de la Légion d’honneur.—A son illustre enfant, la ville de Lille.—La marine au général Faidherbe, ancien gouverneur du Sénégal.—Maison de la Légion d’honneur, Saint-Denis.—Maison de la Légion d’honneur, Les Loges.—Au général Faidherbe, les Enfants du Sénégal et du Soudan. Reconnaissance.—Les anciens élèves de l’Ecole polytechnique, etc.»
Derrière les couronnes, vient M. Gaston Faidherbe, fils du général, entouré des officiers d’ordonnance du défunt. Puis les pensionnaires des maisons de la Légion d’honneur, conduites par leurs directrices portant en sautoir le cordon rouge sur la robe noire. M. le général Brugère, représentant M. le président de la République.
L’amiral Krantz, les généraux Saussier et Billot, suivis de nombreux officiers représentant l’armée. Viennent encore: MM. Tirard, Rouvier, Faye, Thévenet, Yves Guyot, suivis de nombreux sénateurs députés, conseillers municipaux et de délégations de tous les corps constitués.
Parmi ces délégations, on remarquait particulièrement le roi nègre Oussman-Gassi, entouré de Sénégalais, ainsi que les spahis et les tirailleurs sénégalais, dont plusieurs portent la croix d’honneur et la médaille militaire.
Comme Mme veuve Malbrough, «je suis montée si haut que j’ai pu monter» au faîte de la célèbre tour et de là j’ai contemplé par un temps à souhait un panorama inoubliable, indescriptiblement beau, car le spectacle change à chaque étage. De la première plate-forme le regard charmé contemple l’ensemble de l’Exposition, qui lui apparaît comme une ville enchantée dont toutes les rues sont des jardins et toutes les maisons des palais. On ne voit que dômes, minarets, tours, villas, chalets, châteaux, pagodes, kiosques, chaumières, pavillons, palais, velums, colonnades, galeries, statues, fontaines; et, couronnant toutes ces constructions bizarres, élégantes, chatoyantes, le Dôme central et le Palais des Machines, c’est éblouissant...
J’ai très bien vu de là l’orme colossal qui se trouve dans la cour de l’Institution des Sourds-Muets. Il a six mètres de circonférence à sa base et mesure plus de quarante-cinq mètres de hauteur de la base au faîte.
Son origine remonte à l’an 1600. Il paraît que c’est un des ormes que Sully, sur l’ordre de Henri IV, fit planter à la porte de chaque église de Paris.
La tradition lui a conféré le nom d’Orme de Sully.
De la deuxième plate-forme, on a la vue splendide de Paris dans sa vaste enceinte. Voilà ses monuments, ses flèches, ses dômes, ses places, ses avenues; le regard domine tout, et Montmartre et le Mont-Valérien, dont la silhouette paraît si haute. Plus loin, on aperçoit Versailles s’abritant dans la verdure; ce filet blanc qui serpente, c’est la Seine; ces fines aiguilles, ce sont des clochers; ces petits sentiers, ce sont des boulevards; ces points noirs, ce sont des hommes.
De la troisième et dernière plate-forme, la vue n’est plus qu’un immense lointain trop confus pour être décrit. Le point le plus éloigné que l’on puisse apercevoir est un sommet de forêt, à quatre-vingt-dix kilomètres. A cette hauteur, il n’y a plus ni mouvement, ni bruit, cette ville morne, ces campagnes silencieuses ne sont-elles qu’un décor, une peinture? la vie n’est-elle plus là? Instinctivement, on lève les yeux au ciel dont l’ampleur est infinie, cette impression, très saisissante, est pleine de grandeur.
La Tour Eiffel, qui n’a rien d’une tour, qu’on se représente généralement ronde, massive, bâtie en pierres, me fait l’effet d’une énorme colonne carrée se retrécissant par le haut, percée à jours et toute bâtie en fer. En effet, elle se compose uniquement de treillis de fer très résistants, très élastiques et très légers assemblés par des goussets en fer rivés.
Cette conception est gigantesque et l’exécution ne l’est pas moins. La Tour Eiffel dont chaque côté a cent vingt-neuf mètres de large occupe une superficie de plus de seize mille mètres carrés, plus d’un hectare et demi. C’est le monument le plus haut, non seulement de Paris, mais du globe. L’arc de Triomphe de l’Etoile a quarante-neuf mètres, le Panthéon, quatre-vingt-trois, le Dôme des Invalides, cent cinq, Saint-Pierre de Rome, cent trente-deux, la cathédrale de Strasbourg, cent quarante-deux, la grande pyramide d’Egypte, cent quarante-six, la cathédrale de Rouen, cent cinquante, la cathédrale de Cologne, cent cinquante-neuf, le monument de Washington, à Philadelphie, cent soixante-neuf; dans le plan, il devait avoir six cents pieds, mais dès le quarante-sixième mètre il s’inclinait d’une façon si inquiétante, qu’on suspendit les travaux; on les reprit, mais en réduisant la hauteur assignée de plus de deux cents pieds.
L’idée de construire une tour colossale n’est pas nouvelle; les descendants de Noé l’avaient déjà eue. En 1832, l’ingénieur anglais Trevithick proposa de bâtir un monument de mille pieds (trois cent quatre mètres quatre-vingts). Les Américains caressèrent plusieurs projets de ce genre mais ils ne furent jamais exécutés.
Que de science, que d’études, que de savantes recherches, que de combinaisons multiples pour mener à bien le chef-d’œuvre que j’ai sous les yeux! Que de calculs, depuis la base assise dans le sol, qu’il a fallu étudier lui-même, jusqu’au faîte, jusqu’à cette lanterne de trois cents mètres de hauteur. C’est après avoir construit dans le Cantal, pour la ligne du chemin de fer, le viaduc de Garraby, que monsieur Eiffel eut l’idée de sa tour. Le viaduc est situé à cent vingt-quatre mètres au-dessus du niveau de la rivière, l’arche centrale qui sert d’appui à la même hauteur et mesure cent soixante-cinq mètres d’ouverture; le tablier métallique a quatre cent quarante-huit mètres de long et la longueur totale est de plus d’un demi-kilomètre. Cet ouvrage audacieux était alors considéré comme l’œuvre la plus colossale du monde. Monsieur Eiffel pensa que ces armatures de fer qu’il avait placées horizontalement pour relier les deux collines de Marjevols, pourraient aussi bien être posées verticalement et s’élever jusqu’à trois cents mètres de haut. Et il l’a fait comme il l’avait dit.
Le poids total de la tour Eiffel est évalué à neuf millions de kilos; le nombre des pièces métalliques qui s’entrecroisent en tous sens est de douze mille; chacune d’elles, en raison de sa forme sans cesse variée, a nécessité un dessin spécial; tous ces dessins ont été préparés au bureau des études de l’usine Eiffel à Levallois-Perret.
C’est d’une double montagne de fer travaillé et de papiers dessinés qu’est sortie cette merveilleuse colonne; et dans tout cela, les rapports l’ont constaté, il n’y a pas eu une seule erreur de calcul, une seule incertitude d’exécution. La dépense totale a été de six millions et demi.
La tour Eiffel présente un grand avantage sur toutes les constructions maçonnées, elle est «amovible». L’Etat auquel elle appartient pourrait la transporter ailleurs si cela lui convenait, l’opération ne serait pas difficile et la dépense relativement minime: un demi-million.
Nous sommes loin de la protestation qui se produisit lorsque le programme officiel annonça l’érection d’une tour de trois cents mètres. Cette protestation fut adressée en février 1887, sous forme de lettre à Monsieur Alphand et signée de noms célèbres: Messonnier, Gounod, Ch. Garinier, Gérôme, Bonal, Bougreau, Sully-Prudhomme, Robert Fleury, Victorien Sardou, Pailleron, Leconte de Lisle, Guy de Maupassant, etc., etc. Ces messieurs affirmaient que cette tour serait le déshonneur de Paris et que «cette cheminée d’usine écraserait de sa masse barbare tous nos monuments humiliés, toutes nos architectures rapetissées. Sur la ville entière frémissante encore du génie de tant de siècles, on verrait s’allonger, comme une tache d’encre, l’ombre odieuse de cette odieuse colonne de tôle».
Presque tous ont fait amende honorable et reconnaissent volontiers que la tour Eiffel est le clou de l’Exposition; ils rendent hommage au génie qui l’a construite. Le succès est une puissance qui s’impose.
Il y a seize guichets délivrant les billets d’entrée, pour aller au premier étage on paye deux francs, pour aller au second un franc, pour atteindre le sommet deux francs. En somme, l’ascension coûte cinq francs, sans compter tous les bibelots qu’on y achète; il est impossible de ne pas rapporter au pays un souvenir de cette ascension qui fait rêver, de cette ascension à neuf cents pieds du sol et qui s’accomplit si aisément; on pourrait presque dire sans qu’on s’en aperçoive, grâce aux ascenseurs dont le plus rapide s’élève de deux mètres par seconde. On peut aussi monter par les escaliers, il y en a deux qui servent à gravir la tour jusqu’à la deuxième plate-forme et les deux autres à la descendre. On monte trois cent cinquante marches pour arriver au premier étage; sa galerie promenoir est vraiment superbe; on en fait le tour, on s’oriente, puis on achète quelques souvenirs aux nombreuses boutiques qui en ont pris possession. Au centre se trouvent quatre restaurants pouvant contenir chacun cinq à six cents personnes: Bar flamand, Restaurant russe, Bar anglo-américain, Restaurant français. On peut dire que le monde entier a passé dans les salons de ces luxueux établissements. C’est à cette première plate-forme que l’on trouve la médaille de bronze à l’effigie de la tour; au second se vend la médaille d’argent, au troisième celle de vermeil. Il faut ensuite monter trois cent quatre-vingts marches pour arriver à la seconde plate-forme. C’est là qu’il faut visiter la curieuse installation du Figaro, avec son imprimerie spéciale, sa rédaction, sa composition.
Le Figaro connaît le monde, il s’est dit que les quatre cinquièmes des visiteurs seraient flattés de voir leur nom dans un journal, il a donc établi un registre où chacun peut écrire son nom et son adresse, lesquels sont imprimés le lendemain dans le journal dit Le Figaro de la Tour Eiffel. Les demandes pleuvent, l’argent aussi; ce journal fait florès et vit, en ce moment, de la vanité humaine. L’incommensurable vanité!
De cette plate-forme au sommet il y a cent soixante mètres, l’escalier qui y conduit a mille soixante-deux marches, c’est un simple escalier de service dont le public ne peut profiter, il faut prendre les ascenseurs. Bref, il y a en tout mille sept cent quatre-vingt-douze marches, avis aux gens malades du cœur ou que l’obésité oppresse.
Cette troisième plate-forme est à deux cent soixante-seize mètres; au-dessus, à trois cents mètres, se trouvent des salles réservées à des expériences scientifiques, météorologiques, biologiques, micrographiques de l’air, etc., et un petit appartement particulier que Monsieur Eiffel habite quelquefois; c’est là que se trouve le livre d’or où les personnages de marque apposent leur griffe. Le phare de la tour a une puissance égale à celle des feux de première classe établis sur nos côtes; il est fixe mais entouré de plaques de verres tournantes, blanches, bleues, rouges qui promènent ainsi chaque nuit nos couleurs nationales sur l’horizon sans bornes.
Un drapeau de trente-six mètres carrés flotte à l’extrême pointe. On assure que des Anglais ayant pu pénétrer jusque là ont coupé dans ce drapeau de petits morceaux d’étoffe qu’ils ont emportés en souvenir de leur ascension. Où il y a de la gêne, il n’y a pas de plaisir; toujours les mêmes! ces braves Anglais...
Moi, j’ai eu quelque peine lorsque j’ai voulu écrire la fameuse carte postale datée de la tour et portant son effigie, qu’il est du devoir de tout bon visiteur d’envoyer à sa famille. On m’avait prévenu que tous les encriers sont assiégés et qu’on ne peut mettre la main sur un porte-plume qu’après une longue attente. J’avais alors fait ce judicieux raisonnement: on peut toujours tremper le bec d’une plume dans un encrier, mais sans la plume on ne peut rien, et j’avais glissé dans ma poche un porte-plume muni d’une belle plume neuve. J’ai pris place au coin d’une table entre un Chinois jaune et une Flamande rousse, haute comme un tambour-major. Tous les porte-plumes fonctionnaient fièvreusement autour de moi. J’ai pris le mien et après l’avoir plongé dans l’encre j’ai écrit:
C’est entre ciel et terre, du haut de cette tour titanesque, devant cette exposition incomparable où sont venues aboutir, sous les formes les plus variées, et dans leur développement le plus parfait, toutes les conceptions du génie humain que ma pensée s’envole vers vous. A mes pieds, les hommes s’agitent comme des fourmis, Paris et ses monuments ont les dimensions de jouets d’enfants; au loin, la campagne encore feuillée ressemble à un immense tapis vert, capitonné de points blancs qui s’appellent villages et châteaux. Voilà le tableau, voilà mes impressions sur le vif.
Mais à travers cette féerie, je revois ma douce Bretagne, ma famille chérie, et ce petit mot d’affection que je lui envoie est une preuve nouvelle que le cœur sait faire valoir ses droits en face des plus grandes merveilles de l’intelligence, des plus hautes conceptions de l’esprit et qu’il garde quand même et toujours l’image de ceux qu’il aime! Oui, au milieu de l’une des plus grandes foules humaines qui se soient jamais rencontrées devant cette Exposition qui tient du miracle, c’est le souvenir qui m’a empoignée, et pendant que ma pensée voguait dans le ciel pur de la science et des beaux-arts, habitant l’idéal le plus élevé qui se puisse atteindre: soudain, la vision de la famille et du pays se présentait à moi et je souriais en même temps à cet autre et si délicieux idéal du cœur.
Quand j’ai quitté la table où j’écrivais, six ou huit personnes m’entouraient, attendant que je leur fisse place, mon premier mouvement a été de remettre mon porte-plume dans ma poche, mais déjà les mains se tendaient pour le saisir. J’ai hésité un instant. Ah! si j’avais tenté de le garder, que serait-il arrivé? les gens qui le reluquaient auraient dit que je prenais un porte-plume ne m’appartenant pas, que j’emportais le mobilier de la tour. On se serait ameuté, on aurait sans doute crié: au voleur, les plus calmes m’eussent traitée de vulgaire pick-pocket, les exaltés auraient fini par jurer que je voulais escamoter la tour. On serait peut-être allé jusqu’à dire que je voulais la fourrer dans ma poche.
J’ai remis mon porte-plume dans la dextre d’un méridional qui gesticulait fort et parlait haut, tout en regrettant un peu les cinquante centimes qu’il m’avait coûté, et beaucoup la jolie tour en miniature qu’il représentait.
Ah! si j’avais le temps! je ne ferais peut-être pas quatre ascensions comme le comte de Flandres, mais je reviendrais certainement jouir de ce spectacle sans pareil, et dont on ne se lasse pas.
Mot de la Fin
M. Eiffel—comme une dame bien connue—monte à sa tour: il est accompagné de son ingénieur. A une certaine hauteur, il veut prendre des points de repère, mais ni lui ni son compagnon n’ont apporté, pour cette opération, la chose essentielle... un mètre.
L’ingénieur descend immédiatement pour se munir de l’instrument indispensable.
On demande à quelle hauteur ils étaient montés l’un et l’autre?
A... deux sans mètre.
Savez-vous où M. Eiffel se trouvait lorsque son ingénieur l’a rejoint?
—???
Mercredi 2 octobre 1889.
Parc Monceau.—Buttes Chaumont
Parc Montsouris.
Nous avons fait aujourd’hui la visite projetée au parc Monceau, aux Buttes Chaumont et au parc Montsouris. Promenades charmantes, oasis délicieuses, dans cet infernal Paris où l’on ne connaît ni le calme ni la sécurité. Les enfants et les vieillards qui ont si grand besoin d’air pur et de soleil les trouvent ici dans l’espace et le repos, le poète et le savant peuvent également lire, rêver, promener dans une quiétude parfaite loin de ces rues tumultueuses où l’on craint sans cesse d’être bousculé, volé, écrasé; où l’on va, vient, s’agite dans un perpétuel qui-vive.
«Pages, laquais, voleurs de nuit, carrosses, chevaux et grand bruit, voilà Paris». C’est Scarron qui disait cela de son temps. Ciel! que dirait-il du nôtre! J’avoue humblement mon incapacité à me tirer d’affaire. Je ne suis point débrouillarde. Je me sens toute ahurie par le bruit et très effarouchée de tant de voitures et de piétons.
Le parc Monceau est l’œuvre de Philippe d’Orléans. Louis-Philippe l’affectionnait aussi beaucoup. Une cascade, des statues de marbre et de bronze l’embellissent encore. Son principal ornement est ce qu’on appelle la Naumachie, colonnade de style corinthien, imitant une belle ruine debout au bord d’une pièce d’eau. Le parc des Buttes Chaumont, trois fois plus grand au moins que le parc Monceau, est très accidenté, très pittoresque: ces mouvements de terrain s’expliquent lorsqu’on sait que ces grands espaces sont de vieilles carrières de plâtre abandonnées, converties en jardin. Les Buttes Chaumont ont aussi elles une grotte, des cascades, un lac d’où s’élance un immense rocher de cent mètres de hauteur, surmonté d’un temple, et un joli pont qui surplombe le lac; c’est dans ce lieu si fleuri et si charmant que se trouvait autrefois le gibet de Montfaucon. Antithêses et contrastes, la vie en est faite, le monde en est plein!
Il faut aller chercher fort loin aussi, derrière l’Observatoire, le parc de Montsouris. Grandes pelouses verdoyantes, ombrages épais, allées unies, sablées et larges comme des grandes routes, vaste pièce d’eau où s’ébattent des familles de canards, de cygnes, d’oies, tel est son ensemble. Ses principaux ornements sont une pyramide élevée à la mémoire de la mission Flatters, massacrée par les Touaregs en 1881, et la reproduction du Bardo, palais du bey de Tunis, qui figura à l’Exposition universelle de 1867, et qui sert d’observatoire météorologique.
Peu de statues, l’une pourtant m’a frappée par son extrême laideur. J’ai demandé quel était ce personnage aussi affreux qu’illustre, après bien des informations, j’ai appris que c’était l’ami du peuple, Marat! Mon Dieu oui, voilà les grands hommes qu’on glorifie aujourd’hui et qu’on offre du même coup à l’admiration et à l’imitation des générations nouvelles. C’est un choix heureux, mes félicitations aux édiles parisiens, comme à l’artiste Baffier qui a su s’inspirer d’un être aussi hideux au physique qu’au moral. J’aimerais à voir à côté de lui Charlotte Corday «l’ange de l’assassinat», suivant l’expression de Lamartine dans les Girondins, mais il est là, tout seul... avec son déshonneur. Il paraît que c’est en 1883 que le conseil municipal commanda cette œuvre d’art, d’un placement difficile, on ne savait où l’ériger. On a trouvé charmant de l’utiliser au parc Montsouris. Cette statue ne passe pas inaperçue, mais le public qui se promène ignore bien certainement son nom.
La statuomanie est à son comble; est-ce donc pour honorer le crime et le vice qu’on élève des statues? C’est l’athéisme qui invente tout cela. Ayant décrété que Dieu là-haut n’existe pas, il déifie l’homme pour le faire Dieu ici-bas; et tous les petits pigmées rêvent d’avoir une grande statue. C’est ainsi qu’agissaient les Athéniens de la décadence; ils s’envoyaient leurs bustes commandés par douzaines, comme nous nous envoyons nos photographies. Et voilà pourquoi le sol de la Grèce est pavé de statues. M. Paul de Cassagnac a raconté des choses charmantes à ce sujet.
«Souvenez-vous, dit-il, de l’histoire édifiante de Démétrius de Phalères, qui, vers ce temps-là, consacrait son talent, sa vertu, son génie à relever sa patrie ruinée, abaissée par la domination Macédonienne.
Les Athéniens, reconnaissants et enthousiasmés, lui élevèrent de son vivant, sous ses yeux, trois cents statues de bronze, pas une de plus, pas une de moins.
Mais peu de jours après, le fils d’Antigone, celui qui fut surnommé Poliorcète, le preneur de villes, s’empara d’Athènes, chassant Démétrius, et séance tenante les Athéniens, oublieux des services fraichement rendus, brisèrent les trois cents statues de bronze, et élevèrent à Poliorcète autant de statues en or.
Puis, à quelque temps de là, Poliorcète était battu près d’Ipsus, et un Athénien avisé, plein d’expérience et d’économie, proposa de ne plus renverser, en entier, les statues élevées aux hommes qu’avait trahis la fortune, et de se contenter de changer les têtes, les corps pouvant continuer de servir pour tout le monde, indistinctement et successivement.
Voilà une ingénieuse idée que les Français pourront mettre un jour en pratique, pour moi, je ne verrais aucun inconvénient à mettre la tête d’un honnête homme sur les épaules de Marat.
Jeudi, 3 Octobre 1889.
Repos complet.—Les Voitures à Paris.
J’ai mis un peu d’ordre dans mon journal pendant que ma cousine recevait des visites, le jeudi est son jour.
Le soir je suis restée au salon; nos soirées, même lorsque nous ne sortons pas, sont toujours bien employées. Coupé par la causerie, la musique et les cartes, le temps passe vite. D’ailleurs, les Parisiens ne trouvent jamais qu’ils veillent trop tard. Le whist est paraît-il un jeu empoignant, mais il me semble que c’est aussi un jeu où l’on s’empoigne. Autrefois il se jouait avec quatre personnes puis on s’est réduit à trois. Aujourd’hui à l’aide de combinaisons savantes on peut le jouer à deux. Quand on aura inventé le moyen de le jouer seul, je me mettrai à l’apprendre, car je le répète, ce jeu ne me paraît pas fait pour adoucir les caractères.
Pendant que les robs se succédaient sans interruption, j’ai causé avec un vieux savant qui ne se prodigue pas et passe généralement ses soirées dans son cabinet de travail en tête-à-tête avec lui-même. Mais non, que dis-je! il n’est jamais seul il l’affirme du moins: la science est sa maîtresse favorite et les livres ses meilleurs amis. Il m’a fort intéressée. A un moment, comme je me plaignais du brouhaha de Paris:
«Que vous avez donc raison, m’a-t-il répondu, et que nous sommes loin du temps—c’était sous François Ier—où il n’y avait à Paris que deux carrosses: celui de la Reine et celui de la belle Diane.
Sous Henri IV, il n’y en avait même plus qu’un, le Roi s’en privait quand la Reine en avait besoin. Les rois voyageaient à cheval, les princesses allaient en litière et les dames en trousse derrière leurs cavaliers. C’était charmant: pas d’écrasés et jamais de réclamations. Une des clauses insérées au bail que passait aux fermiers de sa terre, près Paris, Gilles Lemaître, premier président du Parlement sous Henri II, était qu’aux grandes fêtes de l’année et au temps des vendanges, les fermiers lui amèneraient une charrette couverte et de la paille fraîche dedans pour y asseoir sa femme et sa fille, et encore qu’ils lui amèneraient un ânon ou une ânesse pour servir de monture à leur chambrière. Ce fut fini ces idylles quand un individu s’avisa d’inventer les voitures de place.
Ce serviteur de la civilisation portait un nom de circonstance: il s’appelait Sauvage, il demeurait rue Saint-Martin, à l’hôtel Saint-Fiacre. Le premier carrosse de louage, le carrosse à cinq sous, n’était pas très confortable. Le fameux dominicain Labat l’a vu et décrit. Il pouvait contenir six personnes; il était délabré et traîné par de pauvres bêtes étiques. Au XVIIe siècle, on ne comptait que trois ou quatre cents carrosses dans la capitale, mais la vogue en prit et Paris cessa d’être habitable.
Ecoutez cette appréciation d’un contemporain:
Les carrosses sont confortables, mais que dire des autres voitures, vinaigrettes, diables, cabriolets, que dire sur la route de Versailles des carrosses appelés «pots-de-chambre», ouverts à tous les vents, où l’on brûle en été, où l’on gèle en hiver? que la poussière vous y étouffe ou que la pluie vous y transperce; le majestueux Carabas est encore pis avec ses six chevaux qui font quatre petites lieues en cinq longues heures.
On connut les accidents. Pour les prévenir on inventa les petites lanternes, ce qui ne servit à rien, les piétons étaient écrasés quand même. Un seigneur étranger traversait avec rapidité, à l’entrée de la nuit une rue étroite, sa voiture légère heurta une borne et se brisa en éclats. Pour comble de malheur, un carrosse qui la suivait, dédaigna de s’arrêter et ses roues passèrent sur le corps d’un cheval de grand prix attelé à la voiture fracassée. Le seigneur s’élança sur le cocher, lui demandant avec fureur pourquoi il ne s’était pas arrêté en voyant un cheval par terre: «Pardonnez-moi, Monseigneur, répondit ce cocher modèle, mais il fait nuit et je l’ai pris pour un homme!»
—Ah! monsieur!...
—Madame, c’est l’exacte vérité et d’ailleurs, c’est cette tradition que les cochers suivent toujours. Non, non. j’admire leur adresse et je m’étonne qu’avec tant de chevaux et de voitures en circulation il n’y ait pas plus d’accidents...
—Quel est le nombre de voitures à Paris, le savez-vous?
—Comment, Madame, vous voulez de la statistique? cela n’intéresse que ceux qui la font...
—Si, cela instruit en passant. Tout le monde n’est pas à même de faire de la statistique et je suis sûre qu’ici, dans ce salon, personne que vous ne pourrait me donner ce renseignement.
—Vous le voulez, soit, mais je parlerai bas, car on se moquerait de moi.
En 1818, il n’y avait à Paris que deux mille neuf cent quarante-huit voitures publiques, n’ayant pour la plupart qu’une place à côté du cocher.
En 1828, les omnibus firent leur première apparition. Il y eut bien vite toutes sortes de concurrences. Mais en 1866, le monopole abusif vint mettre son holà et depuis la population parisienne se plaint sans pouvoir rien changer à cet état de choses.
En 1873, on vit les premiers tramways. Leur développement fut assez lent; mais, aujourd’hui, ils ne comptent pas moins de trois cents kilomètres sur lesquels la traction est variée: chevaux, électricité, vapeur, air comprimé.
Actuellement, il y a à Paris mille quatre cent cinquante-six omnibus, quatorze mille deux cent soixante-sept voitures de place et treize mille voitures bourgeoises; seize mille voitures pour le transport des marchandises; total, quarante-quatre mille voitures».
Et j’ai été très contente de ma conversation avec ce vénérable septuagénaire au crâne dénudé, comme il convient à tout savant qui se respecte.
Décidément, je suis comme le jeune Anacharsis, je m’instruis en voyageant.
Vendredi, 4 Octobre 1889.
La France.—Entrées à l’Exposition.
Depuis l’ouverture de l’Exposition jusqu’au 30 septembre, plus de vingt-et-un millions de tikets ont été délivrés aux guichets. Septembre a été le mois des Anglais, cent mille ont traversé la Manche pendant ce mois, mais il en est venu un nombre bien plus considérable. Ces voisins qui ne veulent pas être nos amis sont cependant débarqués en foule chez nous; on en a compté un demi-million. Preuve évidente que si l’Anglais n’aime pas les habitants il apprécie fort le pays.
Nous entreprenons aujourd’hui notre Tour du Monde. Ici ce n’est plus le Tour du Monde en quatre-vingts jours, mais en quatre-vingts heures si l’on veut et même moins. Cela est fort amusant de s’en aller ainsi de pays en pays, de ville en ville, à travers les cinq parties du monde, sans fatigue ni danger, sans guide ni interprète.
A tout seigneur, tout honneur: nous commençons par la France qui, dans toutes les sections, affirme sa supériorité. Elle est chez elle, et il est toujours plus facile de s’installer chez soi que chez les autres. Que de choses à voir et à admirer, cependant je ne saurais parler que de ce qui m’a frappée davantage.
L’exposition somptueuse du mobilier m’a plu excessivement.
Ces ébénistes, ces ornementistes, ces sculpteurs sur bois, ces dessinateurs qui ont su créer tant de formes charmantes et variées, sont de véritables artistes.
«L’industrie française est incomparable dans cette branche de la production nationale.
Depuis la chayère de chêne aux fines dentelures gothiques et la caquetoire dont Henry Estienne disait si plaisamment à propos des Parisiennes de son temps: «Il n’y a pas d’apparence qu’elles aient le bec gelé, pour le moins j’en réponds, puisqu’elles ne se sont pu tenir d’appeler des caquetoires, leurs sièges».
Les meubles modernes ne le cèdent en rien aux meubles anciens; quels ravissants bonheurs du jour, couverts d’incrustations de marqueterie d’une finesse exquise, ce sont des mosaïques des bois les plus rares et les plus précieux.
L’art du tapissier est également poussé aux extrêmes limites. «C’est l’essence même du goût parisien que nous retrouvons ici. Il sait tirer un parti merveilleux des étoffes et tissus de tous genres. Tout ce que la soie, la laine, le fil et le coton peuvent produire, se montre sous les aspects les plus séduisants. Le tapissier parisien drape à ravir, non seulement les lampas, les satins, les damas, mais les plus simples cretonnes, ces tentures si harmonieuses de couleurs, si variées de formes sont tout un poème, le poème séduisant du confort intérieur.
Même succès pour les papiers à tapisser; en entrant on se croit d’abord à une exposition de soieries, velours de Gênes, brocards de Lyon, verdures de Flandres. Ces magnifiques papiers peints jouent si bien l’étofle qu’il faut les toucher pour faire tomber l’illusion, celle-ci disparaît, mais l’admiration reste.
Aujourd’hui, on est arrivé à reproduire jusqu’en vingt-six couleurs les dessins les plus compliqués. L’exposition des cristalleries de Baccarat, de St-Louis, de Choisy-le-Roi m’a vivement intéressée.
Mais celle des glaces de St-Gobain m’a plongée dans la stupéfaction. Je ne me figurais pas qu’on pût arriver à de pareilles dimensions. Il faut voir cela pour y croire.
L’industrie des glaces énormes, comme on les fait maintenant, est toute moderne, mais les miroirs étaient connus des Egyptiens, des Grecs et des Romains, quoiqu’on dise que l’antiquité ne fabriquait que des miroirs en métal poli, le musée de Turin possède des miroirs en verre, trouvés dans des tombeaux égyptiens. Aristote écrit: «Si les métaux et les cailloux doivent être polis pour servir de miroir, le verre et le cristal ont besoin d’être doublés d’une feuille de métal pour reproduire l’image qu’on leur présente».
A son tour, Pline parle des miroirs dans son Histoire naturelle. Après avoir proclamé la renommée immense dont jouit la ville de Sidon en Phénicie, pour les verreries, il ajoute que ce fut dans ce pays que furent inventés les miroirs de verre.
Pendant mille ans, on perd la trace de cette invention. Au Xme siècle, Venise fabrique des miroirs, mais ce n’est qu’au XVIme siècle que cette invention prend de l’importance, et Venise garde si jalousement le monopole de ces glaces limpides, blanches, d’une pureté et d’un éclat incomparable qu’elle décrète qu’elle punira de mort tout ouvrier qui transportera son art dans une ville étrangère.
L’industrie des glaces commença en France l’an 1660, sous Louis XIV, grâce à l’habileté de Colbert qui parvint à déterminer dix ouvriers vénitiens à venir à Paris; ils n’y restèrent pas longtemps et on peut dire que ce fut un Français, Richard de Néhon, très habile verrier de Tour-la-Ville, près Cherbourg, qui établit la première manufacture de glaces en France. En 1691, son neveu, Louis de Néhon, accomplit une véritable révolution dans cette industrie.
Jusque-là, on fabriquait les glaces comme les vitres, c’est-à-dire par le procédé du soufflage, et ce procédé imposait une limite fort restreinte aux dimensions des glaces. Louis de Néhon parvint à obtenir des glaces par la difficile et grandiose opération du coulage, et à partir de ce moment on put fabriquer des plaques de verre de dimensions considérables et d’une épaisseur régulière.
L’exposition de Saint-Gobain n’a pas son égale. Elle tient la première place, non seulement en France, mais dans le monde entier.
La glace principale qu’elle expose et qui bien entendu, ne laisse rien à désirer comme pureté, comme poli, est la plus considérable qui ait été coulée jusqu’à ce jour, elle mesure six mètres de hauteur et quatre mètres onze centimètres de largeur; cela fait une superficie de vingt-six mètres cinquante. Bref, c’est partout l’effort suprême du travail. Chaque spécialiste a envoyé les spécimens les plus perfectionnés de son art, c’est inouï.
Le regard s’arrête stupéfait, croyant toujours que ce qu’il vient de voir est le suprême du genre et quelques pas plus loin il s’aperçoit qu’il s’est trompé et qu’il y a mieux encore.
Les étoffes de soie sont une des supériorités de la France. Lyon et Saint-Etienne s’avancent majestueusement en tête.
Loin de l’amoindrir, les siècles passent en améliorant cette industrie, il y aura bientôt cinq siècles que le premier métier à tisser la soie fut monté à Lyon. Il y a dix ans, Lyon comptait douze mille métiers, aujourd’hui il y en a cent vingt-cinq mille et la valeur des étoffes tissées dépasse quatre cents millions de francs.
Dans le domaine féminin même gloire pour la rubanerie et les fleurs artificielles. La rubanerie de Saint-Etienne depuis six siècles conserve son monopole sur les autres nations. Tous ces jolis rubans, aux nuances si tendres, aux fleurs si fraîches sortent du noir pays du charbon et rapportent peut-être plus que lui: cent millions par an.
Les fleurs artificielles sont extraordinaires de vérité. Les femmes se penchent instinctivement vers elles, comme pour les respirer. Je suis sûre que si on les exposait dehors, les papillons, amants de toutes les fleurs et les scarabées d’or, amoureux de la rose, voltigeraient autour d’elles.
Les petites ouvrières parisiennes ont des mains de fées et je leur trouve beaucoup d’esprit au bout des doigts. Toutes ces fleurs sont d’une fraîcheur, d’une élégance, d’une fidélité de détails et d’une finesse de coloris qui dénotent un véritable talent.
C’est à Paris, qui tiendra toujours le sceptre de l’élégance et du bon goût, que toutes les grandes modistes des pays civilisés viennent faire leurs emplettes.
Après nos désastres, le jour de la signature du traîté de Francfort, le général Grant recevait à la Maison-Blanche. L’indemnité de cinq milliards, imposée par l’Allemagne à la France était le sujet de la conversation. «Les Français ne pourront jamais la payer!» disait-on. Le Président des États-Unis seul se taisait. On lui demanda son opinion. «Les cinq milliards, répondit-il, mais c’est nous qui les paierons. Il suffira à la France de nous envoyer quelques bateaux chargés de rubans et de fleurs».
Et les bijoux. Quel rêve, quelle fascination, c’est un ruissellement de pierreries inoubliable. C’est le pays d’Omphir. Les fleurs qu’on voit ici sont en rubis, saphir, topaze, leurs feuillages, en émeraude, les rochers qui les abritent, en agate et les rivières qui les baignent, en diamant. Dans ma jeunesse, cette éblouissante vision m’eût empêchée de dormir. Il y a là pour cinquante millions de joyaux et de pierreries; jamais exposition n’a présenté une telle profusion de richesses et d’œuvres d’art.
Que de fortunes dorment là dans leurs écrins de velours et de satin. Au centre, une vitrine contient l’un des plus gros diamants qui existent, il pèse cent quatre-vingts carats. Seuls, quatre diamants historiques le dépassent en dimension: le diamant du Rajah de Matan, le Grand Mongol, le Ko-hi-Noor et l’Orloff. Comme pendant à ce diamant, on peut voir une perle invraisemblable de cent soixante-deux grains.
C’est égal, quelle fascination que cet amoncellement de pierres et de perles, il n’y en a pas que là; ce sont des monceaux de diamants qu’on voit dans les tailleries, et aux articles pêche et chasse se trouve une toute petite collection de perles brutes estimée trois millions. On aperçoit se balançant au bout d’un fil une seule perle de soixante-quinze mille francs.
Une autre exposition pleine de charme et d’enchantement encore, c’est celle de la dentelle. La mécanique est arrivée à des prodiges d’imitation. C’est à ne plus savoir discerner comme pour les diamants le vrai du faux, et c’est à vous dégoûter du vrai, puisque le faux est aussi beau et dix fois moins cher. Cependant les vraies, les belles dentelles sont celles faites à la main, soit avec l’aiguille, soit sur le carreau, ou pour mieux dire la pelote où s’enchevêtrent les bâtonnets. Dans cet ordre supérieur, les dentelles du Puy, de Mirecourt, de Bayeux et d’Alençon faites à la main, ces dernières, analogues au vieux Chantilly, sont bien les plus belles. Alençon est resté fidèle au point de France créé sous Colbert; il marche avec le point à l’aiguille en tête de toutes les dentelles et peut rivaliser avec les guipures de Venise, les Malines de Belgique et les points d’Angleterre. Ces dentelles sans doute sont de genre différent, mais immuable chacune dans leur beauté et leur perfection. Deux cent mille ouvrières vivent en France de cette industrie.
Il faut aussi rendre hommage aux brodeuses plus nombreuses encore que les dentellières.
Comme les dentelles, les broderies à la main l’emporteront toujours sur les broderies à la mécanique qui crée cependant des merveilles. Une machine à broder fait plus de cinq cent mille points par jour et remplace ainsi cinquante brodeuses. Elle fait la broderie blanche au plumetis et au crochet, les broderies de couleurs, d’or et d’argent, des ornements d’église, mais elle s’incline devant la tapisserie faite à la main, elle ne peut l’égaler.
La passementerie fait ses preuves depuis longtemps. C’est l’une des industries françaises les plus anciennes; Etienne Boileau a donné une place importante aux Crépiniers ou passementiers dans son livre «des Mestiers du XIIIe Siècle». La pelleterie nous convie aussi à une exposition superbe. La France lutte presque victorieusement avec l’Allemagne et la Russie. Quelles belles fourrures! Quels beaux manteaux elle expose! Cela fait penser à l’hiver, mais non, que dis-je! Le froid ne peut se faire sentir à travers ces poils épais, longs et soyeux; ils sont faits pour vous raccommoder avec les frimas en les éloignant de vous.
L’exposition des jouets est une féerie bien séduisante pour les enfants et même pour les grandes personnes. Certainement, l’esprit s’est mis à la torture pour inventer tant de choses nouvelles et amusantes.
Je pense que les jeux mécaniques sont à leur apogée; je ne vois pas ce qu’on pourrait inventer de plus. Les bateaux marchent tout seuls, les locomotives courent sur les rails, les équilibristes font du trapèze, les jongleurs escamotent leurs muscades, le petit soldat français, toujours guilleret, bat du tambour, Pierrot et Arlequin se battent pour Colombine.
Il y a de beaux théâtres avec décors nombreux et personnages costumés; des ménageries, des arches de Noé contenant tous les animaux de la création.
Ah! que de jolis rôles remplissent tous ces animaux, il y a des ours qui dansent, des chèvres qui jouent du tambourin, des chats qui miaulent, des poules qui gloussent, des vaches qui donnent du lait, des chiens qui tournent après leur queue, des chevaux qui galoppent, il y a des grenouilles qui sautent, des souris qui trottent, des serpents articulés qui font fuir, il y a des singes savants qui jouent du violon en battant la mesure avec la tête, il y a des lions majestueux, des tigres aux crocs féroces, des dromadaires et des éléphants, voire même une girafe.
Le nombre des poupées est infini; quelques-unes grandes comme des enfants et dont la toilette doit coûter plus que celle de beaucoup de bébés. Du reste on peut les mettre dans leurs meubles et leur acheter une maison complète, chambres, salons, cuisines avec fourneaux économiques, c’est insensé! Voici un salon Louis XV du plus pur style, canapé, chaises, fauteuils, garniture de cheminée. Une jeune poupée, en délicieuse robe Pompadour, tient une harpe; à côté d’elle, son professeur, chevelure poudrée, culottes courtes, bas de soie, souliers à boucles d’argent, bat la mesure. Ce jouet, puisqu’il faut l’appeler par son nom, est un modeste bibelot de cinq cents francs et il y en a encore d’un prix plus élevé. En somme, c’est trop beau et c’est trop cher. C’est trop beau, puisque le sort des jeux est d’être brisés, c’est trop cher, puisque ces coûteuses fantaisies ne sont que des amusements enfantins; ces jeux-là se payent avec des billets de banque et n’amusent pas plus que ceux qui se payent avec des sous.
Envisagée au point de vue commercial, cette exposition est une preuve incontestable que la fabrication des jouets est devenue une branche d’industrie artistique et des plus importantes.
Les armes de chasse et les engins de pêche se présentent dans un cadre original tendu d’énormes filets et de peaux de bêtes, entourés d’aigles, de vautours, de chamois, de chevreuils qui se regardent aussi tranquillement que le grand ours blanc polaire toise le lion de l’Atlas qui lui fait vis à vis.
Samedi, 5 Octobre 1889.
La France
Hier, c’était le triomphe du bois et des étoffes, des bijoux et des dentelles, du cristal et du verre, des fleurs et des joujoux, aujourd’hui c’est le triomphe du fer, du bronze et du cuivre maniés par des ouvriers d’une habileté rare. Je ne puis me lasser de regarder l’autel en cuivre doré de onze mètres cinquante de haut sur six mètres de large, du style gothique le plus pur, commandé pour l’église Saint-Ouen de Rouen. Voilà des groupes et des statues admirablement coulés, voici des pendules, des urnes, des lampes gigantesques, celle-ci est une copie très exacte de la tour Eiffel et comme modèle de lampe c’est tout-à-fait réussi, mes compliments à l’auteur de l’idée.
La fonte paraît à son tour et fait une rude concurrence au bronze, en imitant ses plus beaux sujets artistiques en les rendant accessibles à toutes les bourses. Le domaine du cuivre est non moins étourdissant depuis l’humble bougeoir, la pelle, le landier, en remontant toute la gamme des ustensiles de ménage, jusqu’aux foyers des locomotives. Au dire des connaisseurs, les lamineurs et les fondeurs ont fait de véritables tours de force. Du reste, le matériel des chemins de fer est tout simplement prodigieux. Cette locomotive est admirable, aussi perfectionnée que possible il me semble et déjà l’on parle de la remplacer par la locomotive électrique! L’humanité est insatiable!
Les cyclopes tant vantés ne seraient ici que des pygmées et comme ils admireraient l’exploitation actuelle des mines représentées avec toutes les apparences de la vérité! Appareils à monter et descendre, machines d’extraction, de ventilation, wagonnets, cages, biennes, puits dont on voit l’orifice béant. Dans la réalité, certains de ces puits de mine atteignent un demi-kilomètre de profondeur et dire qu’il y a des gens effrayés de monter tout en haut de la tour Eiffel! Dans l’air, la lumière, le ciel bleu! Que serait-ce donc si on les invitait à descendre au milieu des ténèbres, à cinq cent trente mètres dans les entrailles noires de la terre!...
Anzin expose les modèles de ses habitations, à cent ans de distance. Les baraques de 1789, sont devenues en 1889 d’élégants pavillons. Entre ce chaume et ces briques, il y a un siècle d’efforts constants et de progrès soutenus.
Le Creusot, l’une de nos gloires industrielles, est la plus considérable de nos usines françaises.
En 1837, le Creusot n’était qu’un établissement de peu d’importance; aujourd’hui c’est une ville métallurgique de vingt mille âmes, ne laissant rien à désirer au point de vue du bien-être de ses habitants. C’est le modèle par excellence des cités ouvrières, qu’on en juge.
Non seulement le salaire des ouvriers n’est pas inférieur au salaire que l’on donne dans les autres établissements industriels, mais de plus ils ont droit, par exemple, à la «chauffe», c’est-à-dire à la fourniture gratuite du charbon pour leur usage personnel. Les frais médicaux et pharmaceutiques leur sont assurés gratuitement.
Tout ouvrier malade ou blessé perçoit un tiers de son salaire pendant son chômage; de même quand il accomplit une période militaire de vingt-huit ou de treize jours il touche le tiers du prix de sa journée. Une somme de soixante francs par an et par enfant est allouée aux pères de famille qui ont plus de cinq enfants.
L’administration verse, sans aucune retenue sur les salaires, un tant pour cent à une caisse de retraite créée par Monsieur Schneider. D’ailleurs, les fondateurs du Creusot ont multiplié autour de leurs ouvriers les œuvres d’assistance et de bienfaisance.
Au Creusot, il existe plusieurs écoles primaires, une école professionnelle et un hôpital entretenus aux frais de Monsieur Schneider. Les ouvriers bien notés peuvent habiter dans les confortables cités et cela moyennant un modique loyer qui ne dépasse pas huit francs par mois. Chaque logement est composé de trois, quatre ou cinq pièces avec un petit jardin. De plus, Monsieur Schneider a encouragé, facilité le développement des Sociétés coopératives qui fournissent, presque aux prix coûtants, aux ouvriers, les aliments, vêtements et objets de ménage dont ils ont besoin.
On calcule que les œuvres instituées par ce philanthrope et richissime propriétaire, dépassent annuellement la somme de deux millions. Les services de retraites et de secours atteignent la somme d’environ sept cent mille francs, les allocations aux réservistes et aux pères de famille ayant plus de cinq enfants se montent à près de huit cent mille francs.
L’horlogerie nous accueille plus bruyamment. Elle sonne sans cesse, dans tous les tons, mêlant à des voix claires et vibrantes le chant monotone du coucou et le trille enchanteur du rossignol. On peut ici étudier tous les systèmes depuis le modeste réveil-matin jusqu’aux carillons les plus célèbres, depuis la simple cloche que manie le choriste jusqu’au gros bourdon qui ébranle les cathédrales.
Ce n’est pas sans fierté que nous voyons figurer le génie français civil et militaire.
Voilà des spécimens de tous les matériaux de construction. Les pierres, le bois, le fer, le plomb, les chaux, les mortiers, les ciments, les briques, les tuiles, les carreaux, les ardoises, les cartons bitumés pour toiture, etc., etc. A l’aide de ces matériaux nous voyons l’ingénieur qui conçoit et l’ouvrier qui exécute, accomplir de nos jours sans hésitation, sans tâtonnement, les travaux les plus gigantesques dans la mer comme sur la terre.
Le génie militaire se présente avec son contingent de produits effrayants, formidables. Dans ce pavillon ou plutôt ce Palais de la Guerre on marche si serrés les uns contre les autres qu’une épingle ne tomberait pas à terre, comme on dit vulgairement.
Les pièces d’artillerie sont, paraît-il, très remarquables, pour moi, la vue de toutes ces choses effrayantes m’a donné le frisson. On ne pourra plus résister à de tels engins. A force de trouver de pareilles machines à tueries on n’osera plus s’en servir. C’est ma consolation en voyant cet amoncellement de canons, d’obus, de projectiles de toutes sortes qui vomissent avec le fer et le feu, la mort!
Nous quittons le côté de la destruction pour entrer dans celui de la réparation, le service des ambulances si parfaitement organisé. Auprès des choses de première nécessité, que d’objets ingénieux pour soigner délicatement les malades, les blessés, les soulager d’abord et ensuite les guérir. Cependant, le cœur ne se détend pas encore, il évoque la vision des souffrances qui tortureront tant de malheureux, il voit les membres brisés, les opérations douloureuses, les fièvres terribles, il entend les plaintes désespérées, le râle des mourants...
J’aime à croire qu’il y avait plus de patriotisme que de curiosité dans cette foule nombreuse inspectant les provisions de guerre de la France. Elle venait puiser confiance et foi... dans ses armements puissants de terre et de mer. Cette force dans la paix, c’est la sécurité de l’avenir. Du reste, aucun peuple ne songe à la guerre en ce moment, mais dans trois ou quatre ans, ce sera peut-être différent.
Le traité de commerce de Francfort, imposé pour vingt ans, par un ennemi qui nous guette comme le chat guette la souris, ce traité qui nous ruine prendra fin. Nous ne voudrons pas le renouveler, et qu’adviendra-t-il alors?
Le Palais de la Guerre contient aussi d’immenses cartes en relief fort remarquables et qui font parfaitement comprendre la topographie de la France et de ses colonies.
Dimanche, 6 Octobre 1889.
Cent cinquante-quatrième journée et vingt-deuxième dimanche de l’Exposition.—Grand’Messe à Notre-Dame.—Promenade au Bois de Boulogne.
Notre-Dame est la reine des églises de Paris, qui compte soixante-sept églises paroissiales et un nombre infini de chapelles.
Avant la réalisation du projet de Maurice de Sully, deux églises, Saint-Etienne et Sainte-Marie, couvraient à peu près l’emplacement de la cathédrale actuelle. Notre-Dame fut commencée en 1163 et terminée sous Philippe-Auguste en 1223. Mais le monument de Maurice de Sully subit depuis de sensibles modifications. Il reste un chef-d’œuvre de l’architecture gothique du XIIIe siècle, et excite l’enthousiasme de tous les connaisseurs. Notre-Dame a été le théâtre de plusieurs évènements historiques.
Philippe de Valois, après la victoire de Cassel y entra à cheval entouré de ses barons. Raymond VII y vint nu-pieds, en chemise abjurer son hérésie. Henri VI, roi d’Angleterre, y fut couronné roi de France en 1431. Cinq ans plus tard on y célébrait par un Te Deum solennel le départ des Anglais. Pendant la domination des Seize, sous la ligue, Notre-Dame servit de caserne aux troupes fidèles. Au siècle dernier la déesse Raison y fut célébrée. Les Théophilanthropes y prêchèrent. Notre-Dame fut rendue au culte en 1802, Napoléon s’y fit sacrer en 1804. Autour de Notre-Dame restèrent longtemps groupées plusieurs petites églises qui en dépendaient: St-Jean-le-Rond, la chapelle de l’Hôtel-Dieu, Saint-Denis-du-Pas, Sainte-Geneviève-des-Ardents. Plus loin se trouvait le Cloître, réunion de petites maisons avec jardins, habitées par les chanoines du Chapitre.
Le Palais de l’archevêché, démoli en 1838, était contigu à la cathédrale. Jadis on voyait sur la Place du Parvis, devant le portail principal, une échelle patibulaire, marque de la haute justice de l’évêque. En 1767 cette échelle fut remplacée par un carcan, qui lui-même disparut en 1792. C’est de ce poteau que partaient les distances itinéraires de la France.
Notre-Dame, bâtie sur pilotis, a cent trente-trois mètres de long et quarante-huit de large. La nef principale mesure trente-cinq mètres de haut et les tours soixante-six mètres.
Autrefois on y entrait par un perron de treize marches, ce qui lui donnait un aspect plus imposant; il a disparu à la suite de remblais faits pour la préserver d’inondations. La façade, avec son admirable rosace de quinze mètres de diamètre, ses galeries ogivales, ses trois grandes portes merveilleusement fouillées, ses vingt-huit niches contenant les statues de nos rois, depuis Childebert jusqu’à Philippe-Auguste (ces statues sont modernes les anciennes ayant été brisées en 1793), est du plus grand effet. Trois cent soixante-huit marches conduisent à la plate-forme des tours. C’est dans la tour sud que se trouve le gros bourdon. Sa grande voix domine tout Paris. La couverture est en plomb ainsi que la flèche de quarante-cinq mètres de hauteur.
L’intérieur est aussi grandiose; ce vaste temple contient outre les trois nefs, deux cent quatre-vingt-dix-sept colonnes et soixante-dix-huit stalles en chêne sculpté; la lumière qui l’éclaire est tamisée par cent treize vitraux peints. Plusieurs évêques et archevêques dorment à l’ombre de cette magnifique cathédrale, construite par la piété à la gloire du christianisme et où s’identifient en même temps l’art français et la foi chrétienne. Voici les tombeaux des Archevêques Affre, Sibour, Darboy, de Quéleu, des cardinaux Morlot du Belloy, de Noailles, de Beaumont, du marquis de Juigné et du maréchal de Guébriant. On remarque aussi les statues de Louis XIII et de Louis XIV et des plaques de marbre noir où sont inscrits les noms des otages fusillés sous la Commune.
L’orgue est d’une incomparable puissance, il comprend quatre-vingt-six jeux et six mille tuyaux. Quelle belle musique, comme elle élève l’âme!... Si j’habitais Paris, j’irais tous les dimanches entendre la grand’messe à Notre-Dame. Tout était fini et je croyais encore que la cérémonie venait à peine de commencer. Ah! je ne m’attirerais pas la réponse de cet évêque à une élégante qui se plaignait de la longueur de la messe.
—Ce n’est pas la messe, madame, répondit finement le prélat, qui est trop longue, c’est votre dévotion qui est trop courte.
Je n’ai pu visiter le Trésor ouvert toute la semaine excepté le dimanche.
En sortant, j’ai donné un coup d’œil au réseau des petites rues désertes, noires, silencieuses, étroites, qui serpentent autour de Notre-Dame et semblent dormir du sommeil profond des nécropoles. Je suis dans la Lutèce d’autrefois et la rue Massillon me semble aux antipodes des rues enfiévrées du Paris moderne.
Nous avons hésité entre l’Exposition et le Bois de Boulogne, mais il faisait si beau que nous avons choisi ce dernier et bien nous en a pris. La foule a paraît-il été effrayante à l’Exposition. Ce vingt-deuxième dimanche a été une des plus belles journées qu’on ait vue depuis son ouverture.
Dès midi une foule compacte a commencé à affluer dans toutes les parties de l’Exposition. A une heure et demie une queue interminable se pressait à la porte des affaires étrangères; il est vrai que la direction des finances, dont les chefs n’ont sans doute jamais mis les pieds dans cette partie de l’Exposition, avait encore une fois jugé à propos de n’ouvrir que trois guichets sur six.
A trois heures, les deux passerelles qui joignent le pont d’Iéna au Trocadéro se sont trouvées encombrées comme elles ne l’avaient jamais été; du côté du Trocadéro, plus de deux mille personnes attendaient leur tour pour passer.
A partir de ce moment jusqu’à six heures, les visiteurs se sont portés en si grand nombre vers les galeries de l’alimentation, à l’extrémité de l’avenue de La Bourdonnais, qu’il était impossible de voir le moindre vide dans la foule; plusieurs dames se sont trouvées mal. Les entrées ont atteint le chiffre incroyable de trois cent trente-cinq mille neuf cent six personnes, le temps marche, on sait qu’on n’a plus que quelques jours à jouir de ce spectacle unique: et on se hâte... on peut donc dire qu’en ce moment, l’Exposition est le salon de l’univers!
Nous avons pris une voiture pour aller au Bois de Boulogne, mais nous n’avons pu suivre le proverbe qui dit: Si vous voulez aller vite, prenez un cocher jeune. Nous n’avions pas le choix. Trouver en tous temps et particulièrement en temps d’Exposition, un bon cocher, complaisant et poli, c’est trouver l’oiseau rare, le merle blanc, comme on disait jadis. Notre cocher était vieux, fatigué, et son cheval le paraissait encore davantage; nous avons admiré à l’aise les beaux sites du Bois de Boulogne, cela nous a dépensé plus de temps et d’argent, je ne le regrette pas. Nous avons traversé la belle place de la Concorde, remonté les Champs-Elysées, qui justifient leur nom, salué l’Arc de Triomphe de l’Etoile, élevé à la gloire de l’armée française, et fait notre entrée au Bois de Boulogne par le Ranelagh ou la Muette, qui n’est à proprement parler, qu’une immense pelouse entourée d’allées ombreuses et ornée de statues. C’est un fort beau vestibule que le Bois de Boulogne s’est donné là. Cette entrée a grand air et prépare agréablement à toutes les beautés qu’il renferme. Le Bois de Boulogne a été dessiné en pleine forêt de Rouvray (rouvre-chêne). Sa contenance est d’environ huit cent cinquante hectares.
Le nom de Boulogne lui vient d’une église construite en 1319 au Menu Saint-Cloud, à l’imitation d’une église renommée de Boulogne-sur-Mer. Paysages enchanteurs, grands lacs et petites îles, cascades bondissantes et ruisselets langoureux, kiosques et châlets, cafés et restaurants, larges avenues et sentiers solitaires, grands arbres de haute futaie et massifs d’arbustes, en un mot promenade ravissante. Voilà ce qu’on va chercher au Bois de Boulogne et ce que nous avons trouvé.
Le château de Bagatelle, bâti en 1773, est un pur bijou style Louis XVI, enclavé dans le Bois de Boulogne.
On rapporte qu’il fut bâti en trente jours par le Comte d’Artois, (il avait donc une baguette de fées), pour répondre à un désir de Marie-Antoinette, d’avoir un pied à terre entre Paris et Versailles; il aurait coûté six cent mille louis, c’est-à-dire douze millions. En ce temps-là, le jardin de Bagatelle était public. Sous la Révolution on y donna des fêtes champêtres. Napoléon et Joséphine s’y arrêtaient souvent. Le duc de Bordeaux l’habita avant 1830. A cette époque le gouvernement le vendit à un Anglais, lord Wallace, qui refusa plus tard de le céder à l’Impératrice pour le prince Impérial; lord Wallace en fit un musée; il fut question après sa mort de le lotir; de là l’idée de l’acheter et d’y faire l’Auberge des Rois, car Saint-Cloud et les Tuileries sont en cendres et le Palais d’Orsay est nécessaire au ministre des Affaires étrangères.
A noter encore le pré Catelan, les ruines pittoresques du château de Madrid et le Moulin de Longchamp. Le pré Catelan est un éden, le plus délicieux jardin qu’on puisse rêver. Son nom lui vient du troubadour Alfred Catelan, qui fut tué là. Non loin se trouve un obélisque élevé à sa mémoire.
Le château de Madrid fut bâti par François Ier et démoli par Louis XIV. Le Moulin de Longchamps qui évoque tant de souvenirs mérite une mention particulière. Il est le seul vestige qui rappelle maintenant la fameuse abbaye de Longchamps fondée par Isabelle de France, sœur de Louis IX, et dotée par celui-ci de quarante arpents dans la forêt de Rouvray. Le Mont Valérien en formait un calvaire naturel et vénéré. L’abbaye fut d’abord l’objet de pieux pèlerinages. Elle devint surtout célèbre par les concerts spirituels qui s’y donnaient le Mercredi, le Jeudi et le Vendredi-Saints. Tout le Paris élégant s’y retrouvait, et voilà l’origine du rendez-vous annuel des Parisiens et surtout des Parisiennes qui s’en vont encore, les trois jours saints, se promener aux Champs-Elysées et sur la route de Longchamp. Il ne s’agit plus d’un pèlerinage pieux, c’est maintenant un pèlerinage mondain, un concours de mode, où les élégantes du hight-life, et les lanceuses de magasins, vont donner le ton et exhiber les nouvelles toilettes de printemps dont la vogue durera... une saison.
Lundi, 7 Octobre 1889.
Exposition.—Palais des produits alimentaires
Exposition de l’agriculture
Que dire du Palais alimentaire? Qu’il est vraiment «le temple du Dieu Boyau» et que Gargantua lui-même en resterait stupéfait.
Pyramides de Liebig dans leurs pots de grès, de conserves dans leur boîtes métalliques, montagnes de jambons, colonnes remplies de pâtes variées, meules de fromages, gâteaux secs, flots de dragées et de fondants, torrents de fruits confits, avalanches de confitures, bibliothèque de bouteilles de vin, etc., etc. Ah! quel consommateur que l’homme et quelle est sa puissance d’assimilation, de pouvoir ainsi absorber une si grande variété d’aliments.
Voilà les nouveaux appareils qui torréfient le café et les puissantes machines qui broient le chocolat. La boulangerie est fort instructive. C’est là qu’il faut aller pour se rendre compte du travail qu’a coûté la bouchée de pain qu’on mange ou qu’on émiette si inconsciemment. On voit toutes les fillières par lesquelles elle passe avant d’arriver aux lèvres des consommateurs. Ces détails sont pleins d’intérêt. Ici se tiennent rangés en bataille les fûts et les foudres, les barriques et les tonneaux.
Quel colosse que celui d’Epernay, d’une contenance de quinze mille hectolitres, amené à grand peine sur un chariot traîné par vingt-quatre bœufs, avant de le remplir de champagne. C’est un monument, on en ferait une jolie maison, du reste, on a inauguré ce tonneau titanesque par un festin où dix-huit convives se trouvaient fort à l’aise.
L’exposition des vins et spiritueux est joliment affriolante pour les gourmets. Les bouteilles se présentent groupées de cent manières et décrivent les plus jolies figures géométriques. La salle de dégustation, faite pour titiller le palais des amateurs, ne désemplit pas. Elle est sans cesse prise d’assaut, c’est un nouveau siège, le siège des buveurs.
Un monument «obéliscal, catapultueux, hypnotisant» est le monument en tablettes de chocolat, qu’expose la maison Menier. Ce bloc immense qui atteint presque la hauteur du Palais, ne représente que la fabrication d’un jour! soit deux cent cinquante mille tablettes pesant cinquante mille kilos, d’une valeur de deux cent mille francs. Une façade décorative donne l’idée de l’usine célèbre de Noisiel. Derrière cette façade, des machines travaillent et à l’arrière des machines, un diorama reproduit en grandeur naturelle, un des ateliers de broyage. Cette vue fait illusion.
M. Menier possède une plantation considérable de cacao, au Nicaragua, avec une flotte spéciale pour les transports, une sucrerie à Roye et sa chocolaterie de Noisiel. Le personnel de ces trois établissements dépasse trois mille ouvriers.
Chaque année les droits payés à l’Etat s’élèvent à treize millions, les transports de chemin de fer à un million et la provision de papier d’étain pour envelopper le chocolat à six cent mille francs. Six cent mille francs de ces minces feuilles de papier d’argent, cela fait rêver. On comprend facilement par ces chiffres que la chocolaterie de Noisiel est la plus considérable du monde entier.
L’Agriculture est largement représentée. Tout le monde rend hommage à cette vaillante, qui offre aux campagnards des centaines de machines les plus variées et les plus perfectionnées.
Après l’agriculture, la pisciculture. La terre et la mer ne sont-elles pas les deux grandes nourricières du genre humain. On fait donc maintenant l’élevage du poisson comme on fait celui du bétail. Seulement cet élevage récent me paraît plus difficile, et je pense qu’il lui faudra encore bien des perfectionnements, avant qu’il puisse entrer dans le domaine des choses usuelles et pratiques.
L’aquarium du Trocadéro est donc fort intéressant à visiter. Il vous initie aux secrets de la vie cachée au fond des eaux. Vous pouvez suivre son développement complet depuis l’incubation artificielle des œufs, la naissance, l’élevage, jusqu’au jour où le petit poisson devenu grand, viendra s’échouer sur votre table.
On songe à repeupler les rivières d’espèces supérieures, comme la truite et le saumon.
Les chambres de commerce maritimes de France se sont fait construire un joli pavillon, non loin du Palais de l’alimentation. Elles exposent des cartes, des plans, des vues panoramiques des villes et ports, en un mot, beaucoup de choses intéressantes, et particulièrement une réduction des ateliers du grand port marseillais, avec toutes les machines en mouvement.
Le Trocadéro est toujours encombré de fleurs, que le ciel s’est chargé d’arroser aujourd’hui.
On en est au dixième concours d’horticulture, le onzième et dernier avant la clôture de l’Exposition, aura lieu du 18 au 23. Charmantes fleurs. Ce sont elles qui joueront la première mesure de la valse des adieux, qui se continuera jusqu’au point d’orgue final, qui marquera la fin de l’Exposition.
Mardi, 8 Octobre 1889.
La Tour en diamants.—Le chêne antédiluvien "La Fille du Tambour-major" à la Gaîté.
J’espère que nous aurons meilleur temps aujourd’hui. Il ne faisait pas beau hier à l’Exposition, la pluie avait détrempé toutes les allées et les visiteurs portaient de la boue partout. Le soir, c’est devenu un vrai désastre, au moment où les fontaines lumineuses allaient s’embraser, la pluie a redoublé avec une telle intensité que les plus intrépides ont fui.
Nous avons visité ce jour deux curiosités, l’une toute naturelle, l’autre très artistique.
Un chêne antédiluvien, une tour en diamants.
Cette tour exposée dans la Galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, est une reproduction fidèle de la fameuse tour du Champ de Mars, dont M. Eiffel lui-même a bien voulu donner les plans. Elle mesure un mètre de hauteur et comprend quarante mille diamants du poids de trois mille carats. Sa carcasse est en or recouvert d’argent, dans lequel sont serties les pierres.
L’exactitude de cette reproduction est absolue; rien n’y manque, ni les escaliers intérieurs en or, ni les pilastres en pierres fines, ni les restaurants, ni les ascenseurs, ni les colonnades, ni même les becs de gaz. Enfin, au sommet, il y a le fameux phare électrique et tournant comme l’autre.
M. Martin Posno est l’artiste de grand mérite qui a dirigé la construction de cette pièce unique en joaillerie et vraiment française, qu’on estime plus de 200.000 francs et à laquelle 20 ouvriers ont travaillé 13500 heures. Pourquoi n’est-ce pas à l’Exposition qu’on va admirer ce chef-d’œuvre dont la place était marquée parmi les plus belles choses? Je l’ignore et personne n’a pu m’en dire la raison.
Ici il n’est vu que d’un petit nombre et saura-t-on plus tard qui s’est payé ce joyau?
Le chêne antédiluvien que nous avons été voir dans un bateau ad hoc a été découvert près de Lyon dans le Rhône. Ce mastodonte de l’espèce végétale d’un noir d’ébène pèse 5500 kilogr. mesure 31 mètres de haut et 9 mètres de circonférence à sa base. Il était à côté de deux arbres plus colossaux encore, mais qu’il a été impossible d’extraire de leur lit de vase et d’eau[8].
Nous avons rencontré quantité de petites charrettes à bras remplies de meubles. Le 8 octobre est un jour de déménagement pour les modestes loyers. C’est là un de ces tableaux, tableaux qu’on n’oublie pas «le déménagement des petits termes.» Il donne à Paris une physionomie toute particulière ce jour-là. On voit la charrette tirée par le mari, poussée par la femme, suivie par les enfants qui portent, l’un, un oiseau dans sa cage ou un pot de fleurs; l’autre, un objet fragile, le globe d’une pendule antique ou le simple coucou. Les petits portent généralement le balai sur leurs épaules aussi fièrement que s’ils portaient un fusil.
Ajoutons à cela l’arrivée des «Hirondelles d’hiver», c’est ainsi qu’on appelle les petits ramoneurs, et celle des marrons grillés, «marrons de Lyon, châtaignes de Redon», qui s’établissent aux carrefours des rues populeuses, hélas! ce sont déjà les avant-coureurs de la froide saison...
La «Fille du Tambour-Major» est une pièce charmante, pleine d’entrain et de patriotisme. L’entrée des troupes françaises à Milan transporte la salle. C’est un défilé saisissant de soldats à pieds, d’artilleurs aux canons, de cavaliers sur leurs chevaux, tout ce monde passe vainqueur, superbe. Uniformes chatoyants, pompons, plumets, galons, panaches; c’est indescriptible. On se sent empoigné, on applaudit, on crie hurra comme si vraiment on se trouvait en présence de la réalité. Le Français s’emballe facilement pour l’armée; les uns appellent cela du chauvinisme, les autres du patriotisme, en tout cas c’est une des bonnes fibres du cœur qu’il est toujours bon de faire vibrer.
Nous irons demain de bonne heure à l’Exposition car outre notre voyage autour du monde que nous voulons continuer, nous avons des billets pour assister à une séance d’orgue au Palais du Trocadéro.
Mercredi, 9 Octobre 1889.
L’Exposition.—Europe, Angleterre et Russie.
Nous commençons par la Grande-Bretagne, la reine des mers que l’on pourrait aussi appeler, après la France toutefois, la reine de l’Exposition.
On la retrouve partout, elle nous montre ses colonies dans des pavillons et des palais spéciaux et les exposants se présentent au nombre respectable de 1600, chiffre que n’a atteint aucun pays. Comme on le voit, les Anglais «ce peuple amphibie qui gouverne la terre par la mer», ont tenu à prendre une large part à notre Exposition que les uns appellent la plus magnifique foire de l’univers et les autres les marchés aux idées nouvelles.
L’Angleterre expose donc une infinité de choses: Ses faïences, ses porcelaines et son argenterie sont remarquables; également superbes les fourrures qui lui viennent de ses colonies. On voit encore beaucoup de vêtements, des étoffes de laine chaudes et moëlleuses, des meubles, tout ce qui fait partie du confort anglais.
Le côté alimentaire n’a pas été négligé par les fils d’Albion qui pourraient s’intituler les pantagruels des temps modernes. J’ai remarqué une statue noire, c’était une Vénus en chocolat, non loin d’un buste d’une blancheur éblouissante; le buste en stéarine de la reine Victoria. L’Angleterre expose aussi une meunerie modèle qui occupe un bâtiment de deux étages. Toutes les opérations se font automatiquement depuis le broyage du grain, jusqu’à la mise en sac de la plus pure farine. La laiterie qu’elle expose est également bien organisée. De jolies vaches d’Ecosse, d’Islande, du Wilhshire offrent aux visiteurs leur blanche liqueur chaude et mousseuse.
Les Indes anglaises se sont bâti un palais des plus brillants; colonnes, galeries, fenêtres jumelées, coupoles, tout cela doit appartenir au style hindou. Il rappelle, dit-on, le type de la tour Outab de Delhi.
Tous les exposants sont de réels Indiens, à commencer par le Maharajah de Mysore.
Pas brillant le Canada, les Canadiens "au cœur français" auraient-ils donc oublié la mère patrie? C’est le cas de répéter le mot d’où lui vient son nom à canada (ici rien). On raconte qu’au commencement du XVIe siècle les Espagnols n’ayant trouvé aucune trace de mines d’or ou d’argent sur les côtes de ce froid pays se retirèrent en répétant a canada (ici rien). C’est ce mot qui répété plus tard par les indigènes fut pris par les Français pour le nom véritable de cette contrée; qui l’a gardé depuis.
La Nouvelle Zélande a orné son Exposition de grandes peintures murales résumant les trois principales occupations de cette colonie; les vendanges, la chasse aux animaux et la chasse... à l’or, au milieu une immense carte. La chose la plus curieuse de cette exposition est un portique très décoratif en briques dorées dont le volume représente tout son or extrait jusqu’ici!
L’île de Ceylan ne m’a rien dit, on y vend à boire; la colonie de Victoria non plus, on y peut déguster à son aise tous les vins australiens dont on fait l’éloge... Mais cela ne m’intéresse pas. Toute différente pour moi l’exposition du cap de Bonne-Espérance.
On ne s’arrête guère à regarder l’architecture de son pavillon, c’est l’intérieur qui vous éblouit, il est rempli de diamants, c’est inimaginable. Là vous avez l’illusion complète d’une visite aux mines de diamant. Nous sommes arrivées juste à temps pour assister au lavage de la terre diamantifère qui a lieu tous les jours de 3 à 5 heures avec explications, nous avons vu le triage, la taille et le polissage.
Un immense coffre-fort transparent qu’un ingénieux mécanisme permet d’éclairer le soir à la lumière électrique contient pour plusieurs millions de pierres brutes. Au milieu de cette collection brille le plus gros diamant du monde, on l’a trouvé il y a quelques mois à peine dans les mines de Beers, il pèse 482 carats.
J’ai trouvé fort agréable l’audition d’orgue à laquelle nous avons assisté, grande et belle musique, morceaux de savante facture.
Voici le programme:
L’orgue est un instrument magnifique d’une puissance de sons extraordinaire surtout quand il est manié par des maîtres qui s’appellent Charles Widor, Théodore Dubois, Alexandre Guilmant. On n’entend pas seulement de la musique au palais du Trocadéro, on y entend aussi beaucoup de discours et de conférences. Il est phylloxéré de congrès: congrès géodésique, congrès de l’hypnotisme, du magnétisme humain appliqué à la guérison des maladies, congrès de physiologie, congrès des poids et mesures, congrès du repos dominical, congrès des chemins de fer, etc., etc.
Après la reine des Mers, le colosse du Nord; cinq cents exposants le représentent ici. La façade de la section russe est magnifique, l’architecte a eu l’heureuse idée de reproduire les plus beaux monuments du style byzantin de Moscou, le mur du Kremlin, les fenêtres du palais de Tehrem, les tours de la cathédrale de Wassili-Lajenij, le clocher d’Ivan le Terrible, la tour Soukareff. L’intérieur a un aspect gai orné de couleurs vives où le rouge et le bleu dominent. Au fond un énorme écusson représente Saint Georges terrassant le dragon. La Russie est encore une nation neuve, mais son développement commercial et industriel prend depuis quelques années des proportions colossales—les arts suivent la même marche ascendante et la Russie devient un grand peuple, comme elle est déjà un grand pays. A moins d’avoir un calepin en main et de prendre des notes, il est impossible d’énumérer tout ce qu’elle expose.
Les fourrures par leur nombre et leur beauté tiennent une place considérable; elles font rêver aux belles élégantes enfouies l’hiver dans leurs manteaux de zibeline, aux riches boyards qui s’achètent couramment une pelisse en renard bleu dans les prix de vingt à trente mille francs.
L’orfèvrerie est remarquable particulièrement les bijoux de style byzantin les objets nickelés et filigranés; très jolies aussi les broderies au point russe qui est tout simplement notre point de marque, point facile qui va certainement se généraliser et devenir à la mode.
Voilà encore des dentelles, des costumes, des tapis en soie de chèvres, des étoffes en duvet de cygne, des tableaux religieux en véritables pierres précieuses des Monts Ourals, de la vaisselle en bois verni inaltérable à l’usage, etc.
Jeudi 10 Octobre 1889.
Famosa Corrida à la gran plaza (cirque) di Toros, rue Pergolèse.
Eh bien, là, franchement, les combats où plutôt les courses de taureaux ne sauraient m’amuser longtemps une fois suffit comme pour Buffalo et puis pas bon marché ce spectacle vingt francs les bonnes places. Les gens qui se passionnent pour ce genre d’exercice vont sans doute y chercher les émotions fortes que donne la lutte quand il y a aussi danger pour l’homme et que le taureau doit être mis à mort; mais ici rien de cela, c’est un simulacre, cheval et cavalier peuvent quelquefois recevoir un coup de corne, mais c’est rare.
L’arène est entourée d’une palissade tout le long de laquelle règne une saillie en bois, une espèce de marche, qui sert à l’homme poursuivi, de point d’appui pour franchir la palissade et se sauver dans l’étroit corridor qui sépare l’arène des gradins.
Je ne puis m’empêcher de reproduire ici le passage d’un article de journal qui traduit parfaitement ma pensée.
«Tous ces personnages se prennent au sérieux et finissent par se croire le Cid en personne, ainsi que le faisait si bien remarquer un de mes confrères qui n’est pas plus que moi partisan de cette sorte de distraction, tout cela fait pitié et il faut n’y voir qu’une exhibition du cabotinage poussé à ses extrêmes limites.
On objecte que le toréador joue sa vie. Qu’importe! autant il est méritoire et héroïque de la risquer pour porter secours à son semblable dans un incendie ou dans un naufrage, autant il est bête et blâmable de la risquer inutilement en affrontant les cornes d’un taureau qui, en se défendant, essaiera de crever le ventre soit du cheval, soit du toréador.
En Espagne, les assistants sont pris de délire lorsque le sang coule. Comme cela est beau, en effet de voir un taureau tué d’un coup d’épée, ou un cheval éventré laissant tomber ses entrailles dans l’arène. De tels spectacles sont faits pour ces peuplades sauvages de l’Afrique, ou des roitelets s’amusent à jouer avec des têtes, avec le même sang-froid que nous jouons avec des quilles.
Et cependant, il y a des gens parfaitement civilisés, de mœurs douces et doués d’une grande intelligence qui se sont pâmés devant des courses de taureaux. Il faut citer Alexandre Dumas et Théophile Gautier, qui les ont décrites avec un enthousiasme égalant celui qu’ils éprouvaient à la Comédie-Française en écoutant les chefs-d’œuvre du grand répertoire.
Je reviens à la représentation: Tout a parfaitement marché, l’orchestre, les quadrilles, le défilé superbe où l’on voit paraître dans leur costume chatoyant les torreros, les caballeros, les picadores qui combattent à cheval armés de leurs longues lances et les chulos à pied.
Nous avons vu figurer sur le programme les épées les plus célèbres, les prima spadas d’Espagne. Ces jeunes toréadors jouent avec les taureaux comme avec des moutons. On suit aussi les passes du manteau, la pose des bandrilles, mais le plus beau moment c’est lorsqu’armés de la muletta ils amènent la bête où ils veulent et feignent de la mettre à mort puisque cela n’est pas permis en France.
Les chulos harcellent le taureau en agitant leur grand manteau d’étoffe pourpre, banderillos, caballeros, picadores lancent sans pitié sur le pauvre animal des banderolles multicolores qui munies d’une pointe de fer se piquent et s’enfoncent dans la peau, rien de plus original que de voir le taureau courant, mugissant, combattant avec sa douzaine de banderolles sur le dos, du reste le combat est bien inégal, le taureau les cornes emboulées pour atténuer les coups qu’il peut porter reçoit l’attaque de ses adversaires qui eux ne ménagent pas leurs coups.
S’ils se sentent poursuivis de trop près, les picadores ont plusieurs moyens d’échapper au danger, d’abord les chulos qui sont là pour faire diversion, dérouter le taureau, le défiler à leur tour en lui jetant le gant ou plutôt le manteau.
Si le taureau indifférent à leur provocation continue de poursuivre le picadore, celui-ci prend le parti héroïque de s’élancer vers la palissade qu’il franchit d’un bond abandonnant comme Joseph de biblique mémoire son manteau qu’il jette au nez de son ennemi, celui-ci s’arrête surpris et s’acharne sur cette masse de plis flottants, qu’il déchire du sabot et des cornes, pendant que le picadore à l’abri regarde tranquillement passer sa colère. Chaque taureau paraît à son tour et combat seul. On l’agace, on l’excite, on le blesse parfois, enfin il entre en fureur et alors on l’applaudit: «bravo toro»; mais s’il est de trop bonne composition que rien ne l’irrite et qu’il s’accule dans un coin le regard vague, ennuyé, rêvant peut-être à sa liberté dans les plaines herbacées, oh! alors le public s’impatiente et crie: à bas! à bas! à mort! comme si l’animal pouvait comprendre l’injure.
La semaine dernière un taureau s’était montré magnifique d’emportement, joutant rudement contre les hommes et les chevaux, le toréador stimulé à son tour se montrait d’une témérité inouîe. Un jeune Madrilène qui assistait à la représentation, saisit d’enthousiasme, a failli jeter au héros de cette lutte toute sa toilette.
Son chapeau, ses jumelles, son jonc à pomme d’or, son mouchoir parfumé, ses gants, son habit et son gilet auquel pendait un magnifique chronomètre, jonchaient l’arène.
On a craint un instant que ce fanatique se jetât lui-même en signe de satisfaction. On a dit que ses vêtements lui avaient été rendus. J’espère que le chronomètre est resté dans la poche du gilet.
Très originale la manière dont le taureau s’en va; libre et furieux, il serait difficile à prendre, comment s’en débarrasser?
On voit paraître six, huit, dix bœufs qui ont été habitués à faire plusieurs fois de suite le tour de la piste, bientôt le taureau se mêle à cette bande, la suit et disparaît avec elle.
Cette course de bœufs, dressés à chercher leur congénère pour le ramener au toril est fort amusante. On regarde cela tranquille sans appréhension.
C’est un moment d’accalmie pour tout le monde, bêtes et gens.
La course à laquelle nous avons assisté a été des plus émouvante, un peu trop pour mon goût, dix mille personnes y assistaient. Les taureaux très braves ont culbuté plusieurs fois chevaux et picadores. L’émotion du public était à son comble.
On attend encore d’Espagne une cinquantaine de taureaux de combat, curieux train de chemin de fer que celui qui transporte ces animaux voyageant isolé chacun dans son petit appartement, une immense et solide boîte.
Il y a des jours où la recette dépasse ici cent mille francs; voilà un chiffre qui fait rêver et qui me semble un fâcheux pronostic pour l’avenir, car il est à craindre qu’après le simulacre qui obtient tant de succès, on arrive au vrai combat plein d’imprévu et souvent d’accidents. Espérons que les Français ne se passionneront pas pour les exercices tauromachiques et que ce spectacle, voir éventrer des chevaux et daguer des taureaux qui se sont d’abord rués sur les hommes, restera l’amusement favori et national des Espagnols.
Nous sommes sorties du cirque par une pluie diluvienne, ce qui a contribué encore à refroidir mon enthousiasme, toutes les voitures prises, tous les omnibus envahis; attendre! attendre! Patience! c’est le grand mot à Paris et nous avons attendu une heure. Nous étions parties gaîment, mais comme l’a écrit un profond philosophe:
Vendredi, 11 Octobre 1889.
Exposition
l’Autriche-Hongrie, la Belgique, la Hollande.
La section Austro-Hongroise est ornée à l’intérieur, de cartouches portant le nom des principales villes de ce royaume très civilisé et riche en industries de tous genres.
Son exposition de bijoux m’a frappée; l’Autriche possède sans doute des mines de grenat car elle présente des vitrines entières de bijoux qui ne sont absolument composés que de cette pierre taillée et montée de toutes les façons; l’Autriche se fait donc remarquer par ses bijoux de grenat qui ont leur cachet propre comme les coraux, les camées et les mosaïques d’Italie.
On voit aussi quantité de bibelots variés en porcelaine, les plus drôles sont la série des bonshommes branlant la tête au moindre frôlement, mais je crois que ce genre est redevenu jeune à force d’être vieux.
Je me souviens avoir vu dans mon enfance des magots de ce genre là, qui remuaient leur chef à perpétuité et même vous tiraient la langue.
Par exemple ce qui est vraiment beau c’est la cristallerie de Bohême qui ne craint aucune concurrence.
La petite Belgique peut marcher de pair avec les plus grandes nations, elle expose dans toutes les classes.
Les dentelles, la verrerie, les faïences, la draperie, les tapisseries sont les principales spécialités qui font la réputation de l’industrie belge.
La dentelle en est sans contredit la plus ancienne.
Tous les genres de dentelles véritables s’y fabriquent aujourd’hui; telles sont les dentelles connues sous le nom de Valenciennes, Malines, Flandres, application de Bruxelles, Duchesse, torchons, points gaze, Burano, Venise et autres points qui se font à l’aiguille et celles qui s’exécutent à l’aide de fuseaux. Les dentelles aux fuseaux se fabriquent généralement dans les Flandres, sur un petit métier portatif; quant à la dentelle à l’aiguille, elle se fait au moyen d’une simple aiguille et d’un morceau de parchemin retraçant le dessin.
Depuis 1878, les fabricants belges ont fait de grands progrès dans leurs dessins et beaucoup de leurs produits ont un caractère très artistique; on peut, en effet, voir cette fois des panneaux et de petits tableaux exécutés comme en peinture par des dentellières qui n’ont à leur disposition pour produire les ombres et les effets que la différence de grosseur de leur fil ou de leur soie.
La pièce principale de l’Exposition de dentelles est un grand voile de mariée Louis XVI, en point à l’aiguille, de trois mètres de long sur deux mètres de large. Des fleurs en forment le motif; ce voile se compose de trois cent cinquante morceaux et il a fallu plus de deux ans pour l’exécuter. Son prix est de neuf mille francs.
Dans le même genre, il convient de citer des robes, des nappes d’autel, des mouchoirs et des éventails qui font l’admiration des visiteuses.
Charmantes les dentellières flamandes travaillant sous les yeux du public.
L’éloge de la verrerie de Charleroi n’est plus à faire. Dans son exposition remarquable, elle expose des glaces magnifiques qui peuvent rivaliser avec celles de Saint-Gobain. Mêmes compliments aux porcelainiers et faïenciers, tout ce qu’ils exposent est ravissant.
La manufacture royale de tapisseries de Malines nous montre quatre panneaux qui peuvent soutenir la comparaison avec les plus beaux produits des Gobelins. L’une de ces tapisseries appartient au Sénat belge; en voici la légende:
«Le 3 avril 1566 les gentilshommes confédérés remettent à Marguerite de Parme, au palais de Bruxelles, une requête par laquelle ils réclament la liberté de conscience.»
Les ébénistes belges sont également des artistes, tous leurs meubles sont frappés au bon coin de l’originalité.
Une chose fort curieuse encore c’est le plan complet du port d’Anvers; cette miniature permet de comprendre d’un coup d’œil l’importance de ce port gigantesque.
La Hollande tient un bon rang. Ce petit pays qui n’a pas quatre millions d’habitants, mais qui en compte vingt avec ses colonies, est fort intéressant à étudier. Sa façade construite dans le style de la Renaissance néerlandaise, se compose d’une large porte et de quatre baies symétriques en plein cintre, ornées de draperies.
La Hollande est une nation active, industrieuse, intelligente. Ses toiles incomparables, ses velours d’Utrech, ses faïences de Delft justifient leur vieille renommée.
Très belle l’exposition de la manufacture royale d’Eventer dont certains tapis ont jusqu’à dix centimètres d’épaisseur.
Les Hollandais "ces rouliers des mers" comme on les appelait jadis étaient alors renommés dans le monde entier comme constructeurs de navires. A remarquer aussi les cartes, plans, dessins techniques de ports, de digues, de ponts, de canaux, ces canaux qui servent de rues dans les villes et de routes dans les campagnes, et qui prouvent que les Hollandais sont des ingénieurs hors ligne.
Leur pays est une conquête, un empiètement fait sur la mer. Ils ont accompli des travaux prodigieux pour faire une terre riche, fertile de ce pays de polders (marais, aux côtes semées d’îlots). Amsterdam seulement, cette Venise du Nord, compte quatre-vingt-dix îlots reliés par trois cents ponts; elle est entièrement bâtie sur pilotis—en sorte que si l’on pouvait retourner cette cité, elle présenterait l’étonnant spectacle d’une immense forêt dépouillée de feuillages.—Oui, ce pays entièrement plat, quelquefois au-dessous du niveau de la mer, n’est défendu contre les inondations de l’Océan que par un ensemble admirable de digues et un système de canalisation qui donne aux eaux leur libre cours. On peut donc dire que les Hollandais sont en lutte perpétuelle avec l’élément liquide. L’Océan est leur ennemi intime en temps de paix, mais en temps de guerre il devient leur meilleur ami. Les habitants ouvrent les digues et submergent les envahisseurs. Cependant un jour il advint que grâce à la glace la cavalerie française y fit une prouesse dont le souvenir reste dans l’histoire.
La Hollande présente aussi une taillerie de diamants évaluée à deux millions.
Voilà la table où les pierres sont d’abord coupées, puis taillées grossièrement; la taille s’achève à l’aide de meules disposées autour des tables, ces meules sont mues par un moteur à gaz. Une meule ancienne qui marchait à l’aide du pied permet de juger des perfectionnements mis au service du lapidaire.
Récemment encore, Amsterdam était la seule ville du monde où se fit la taille régulière du diamant: elle a maintenant Paris pour rivale en cette industrie très spéciale; mais les ouvriers hollandais, tailleurs de diamants, d’origine portugaise, sont restés les maîtres de cet art délicat où il faut autant de tour de main que de probité.
Les colonies hollandaises font honneur à la mère patrie: étoffes indiennes de tous genres, trophées d’armes et d’instruments de musique, objets richement incrustés, vases en matière précieuse.
Le vaste empire batave est là tout entier.
Autre curiosité très pittoresque et très couleur locale: c’est le village javanais (Kampong). Soixante personnes de la peuplade des Prangers sont là, nous initiant à la vie que mènent vingt millions d’êtres humains. Toutes les cabanes, à commencer par celle du chef, sont en bambou, élevées sur pilotis pour protéger les habitants contre les attaques des fauves. Ici, ce sont des chapeliers tressant d’immenses chapeaux en bambous, là, une vieille Javanaise fait la cuisine au riz. Les femmes très peu vêtues ont les cheveux huilés et les joues fardées; tout cela est d’une couleur locale et d’un pittoresque saisissant.
Le théâtre achève de nous transporter dans un autre monde: l’orchestre, composé d’un violoncelle primitif, de xilophones et de jeux de cloches, de gongs de différents calibres fait danser des bayadères, des almées très authentiques et qu’on a eu mille peines à obtenir du Prince de Pranger qui ne voulait pas les laisser partir de son harem. Elles apparaissent vêtues de bijoux et d’étoffes superbes, un carquois sur l’épaule et une auréole de plumes autour de la tête. Leurs poses sont langoureuses, leurs danses ont beaucoup de charmes. Elles tournent lentement et longtemps. C’est un spectacle étrange pendant lequel on se croit bien loin de Paris.
Nous songeons à aller demain samedi et le mardi suivant à l’Opéra-Comique voir Carmen et Sigurd, deux opéras que je tiens à entendre pendant mon séjour; nos places sont retenues: deux fauteuils d’orchestre au premier rang.
Samedi, 12 Octobre 1889.
L’Exposition.—Europe.—La Grèce.—L’Espagne.—Le Portugal.—La Suisse
Le Palais grec construit dans l’ancien style du pays, ne s’élance point en dôme, campanile, clochetons; il reste droit, sévère, régulier. Sur les deux murs qui s’étendent à droite et à gauche de l’entrée principale, on aperçoit de grandes peintures qui représentent la Grèce ancienne et la Grèce moderne. D’un côté l’Acropole, de l’autre les usines du Laurium.
La même idée se poursuit à l’intérieur. D’un côté, on a inscrit le nom des quatre villes les plus importantes de la Grèce antique: Athènes, Corinthe, Sparte et Thèbes, de l’autre les premières villes de la Grèce moderne: Le Pirée, Syracuse, Corfou et Patras.
Les tissus de soie faits à la main par les femmes d’Athènes et de Corinthe, les broderies soie sur soie et les tapis également tissés à la main, sont d’une perfection hors-ligne.
Les échantillons de marbre sont nombreux et magnifiques, les verts sont de toute beauté, les colonnes de Sainte-Sophie à Constantinople, ont été taillées dans des marbres pareils. On remarque beaucoup un morceau de marbre inconnu jusqu’ici, rouge veiné de bleu et noir, il a été ramassé dans l’île de Chio. Une suite de photographies du plus haut intérêt reproduisent les statues trouvées dans ce pays pétri par les arts et dont plusieurs sont antérieures à Périclès.
On retrouve l’Espagne dans les salons de peinture où ses artistes exposent de superbes tableaux qui font le plus grand honneur à son école moderne, au Palais des Industries diverses où elle prend un salon, et au Palais des Arts libéraux où elle occupe une grande galerie, ce qui ne l’empêche pas d’avoir en outre plusieurs pavillons et kiosques pour l’exposition de ses colonies et la dégustation de ses excellents vins.
Le grand pavillon espagnol des produits alimentaires rappelle les monuments historiques de style muzarabe que l’on voit en Espagne principalement à Tolède. Très beau aussi le Pavillon des colonies espagnoles tout rempli des richesses de ces terres fortunées. On pourrait dire que Cuba est le sucrier du monde et quel est le fumeur qui ne recherche pas les cigares de la Havane?
Le Pavillon du Portugal avec sa tour de trente-six mètres de hauteur fait grand effet. Le style général de ce pavillon est le Louis XV portugais avec des ornements copiés sur les monuments de Bélem notamment du cloître. Les vins portugais sont paraît-il comme les vins espagnols réputés chez les gourmets: j’ai mieux aimé m’arrêter aux faïences émaillées et terres cuites genre Bernard Palissy qui m’ont paru très décoratives.
La Suisse
La Suisse est une vaillante nation, son exposition le démontre. Très remarquables les soieries de Zurich et les broderies d’Appenzell; excellent le chocolat Suchard et le fromage de gruyère. La Suisse est la patrie des fromages comme l’Italie est la patrie des pâtes. Après cela le grand triomphe de la Suisse c’est l’horlogerie. Cette branche si remarquable occupe à elle seule deux cent cinquante mètres avec cent soixante exposants. On y voit tous les modèles connus de montres, pendules, horloges et même des modèles inconnus. Je suis restée en extase devant une montre de vingt-cinq mille francs.
Je viens de consulter une petite personne qui ne me quitte guère, mais cependant se montre à ses heures capricieuse à l’égal d’une jolie femme. Elle est brillante, pimpante, élégante, comme une beauté à la mode. Elle ne marche qu’avec des rubis, des joyaux, s’il vous plaît comme une raffinée du jour. Elle fait entendre incessamment son petit babil et trahit parfois des mouvements d’une regrettable indépendance. Il lui arrive même de bouder.
Quoique très maîtresse d’elle-même comme vous le voyez, elle porte une chaîne comme un prisonnier ou un esclave.
Je dis que c’est une petite personne très libre dans ses mouvements, car sortant presque toujours avec moi il arrive qu’elle marche encore lorsque je m’arrête ou qu’elle s’arrête lorsque je marche. Cette organisation délicate, fantasque, difficile à discipliner qui subit les influences de la gelée et de la chaleur, comme une sensitive lady, vous l’avez déjà deviné, n’est-ce pas? C’est Mademoiselle ma montre.
Voilà comment Leo Lespès parlait jadis si spirituellement de la sienne. Alors les montres coûtaient cher, parce qu’elles étaient bonnes et on les soignait en conséquence, aujourd’hui qu’elles sont pour rien on n’y fait plus attention, et cependant cette gentille personne est ni plus ni moins qu’une merveille.
Je l’ai bien compris après les renseignements curieux qui m’ont été donnés sur le degré de perfection atteint par ces mécanismes minuscules aussi remarquables que ceux de n’importe quelle machine. Quelques chiffres sont nécessaires.
Le ressort moteur entraîne le barillet; son mouvement est transmis par trois roues à l’échappement dont la roue frappe l’ancre ou le cylindre du balancier, à raison d’une moyenne de huit mille coups par heure (avec des différences de trois mille à quatre mille suivant les systèmes); en chemin, un autre engrenage ralentit dans le rapport de douze à un le mouvement qui est transmis à l’aiguille des heures. Tous les mouvements de la montre sont discontinus, et s’exécutent par petits sauts égaux dont le nombre dépasse deux cent millions par an pour certaines montres.
Les personnes soucieuses de conserver leur montre la font nettoyer tous les deux ans, c’est-à-dire après trois cent à quatre cent millions de chocs. Au bout d’une vingtaine d’années, une montre bien faite et qui n’a pas été détruite prématurément, doit subir le changement de quelques pignons; mais c’est après plusieurs milliards de ces petits sauts dont nous parlons, et après que la roue d’échappement a exécuté des dizaines de millions de tours.
Si l’on ajoute à cela des complications telles que chronographe, quantièmes, répétitions à minutes, on reste émerveillé de leur possibilité. Quant au chemin décrit à l’extérieur par le balancier, il est si inattendu qu’on ne peut admettre le résultat qu’après avoir refait le calcul. Le balancier d’une montre dix-neuf lignes mesure, en moyenne, dix-sept millimètres de diamètre sur les vis de réglage; il fait par seconde cinq oscillations d’un tour et demi, soit trois cent quatre-vingt-quinze millimètres de chemin parcouru par seconde, trente-quatre kilomètres par jour, douze mille cinq cents kilomètres par an en nombres ronds; or, les montres à quantième perpétuel, portent une roue qui exécute un tour en quatre ans; pendant ce temps, le balancier aurait fait le tour du monde.
Désormais, je ne toucherai plus à ma montre qu’avec un certain respect et mille précautions.
Dimanche, 13 Octobre 1889
"L’Ode triomphale" d’Augusta Holmès.—"Excelsior"
L’Ode triomphale d’Augusta Holmès, qui déifie la République, a eu lieu à deux heures de l’après-midi, ce qui a permis de faire l’économie de l’éclairage, soit huit mille francs; c’est bien quelque chose.
On a beaucoup parlé de cette fête des fêtes, exécutée aux frais de l’Etat et de la Ville de Paris, qui dépensent trois cent mille francs pour cette représentation, et l’on dira encore que la République n’est pas prodigue! Elle a sans doute pensé que pour consacrer sa gloire elle ne dépenserait jamais trop d’argent. L’ensemble est des plus grandiose!
La scène a soixante mètres de long sur trente de large. Au fond de la scène s’étale une peinture panoramique représentant des villes et des campagnes, montagnes, forêts, rivières, cela représente la France. Au centre de la scène se dresse un autel très élevé et de forme ancienne ombragé d’un voile d’or. Au pied de l’autel brûlent quatre trépieds remplis de parfums; devant l’autel un large escalier orné de trophées d’armes, de drapeaux et de fleurs; au-dessous, une vaste plate-forme sur laquelle défile le cortège en costume symbolique.
Les Arts précédés par le Génie.
Les Sciences précédées par la Raison.
Les corps de Métiers précédés par le Travail et l’Industrie. Les vignerons suivent le Vin que représente un pavois couvert de pampres verts et de grappes vermeilles. Les moissonneurs suivent la Récolte représentée par des gerbes de blé enguirlandées de fleurs des champs. Ils chantent:
Quand ils ont fini, ils vont se ranger en haut de la vaste scène, où iront successivement s’étager les autres chœurs. Les soldats suivent la Guerre que représente un amoncellement de boucliers entourés de palmiers, de lauriers, et de colonnes chargées de trophées.
Les marins suivent la Mer, que représente des monceaux de coraux et de plantes marines. Ils chantent la France. Les soldats disent:
A quoi les marins répondent:
Puis viennent les jeunes gens précédés par l’Amour, et les jeunes filles par la Jeunesse. Les jeunes filles offrent des fleurs et les jeunes gens des palmes de myrte. Leurs chants sont poétiques et harmonieux. Les enfants terminent le défilé. Ils apparaissent sur un char traîné par des bêtes féroces. Ils chantent aussi des vers symboliques et parfois très beaux.
Cette première partie de l’œuvre de Mme Holmès est d’une grande puissance et d’une haute inspiration.
A ce moment la scène s’obscursit, l’orchestre fait entendre des roulements sinistres. Il entame une marche funèbre. Soudain surgit une femme voilée de noir, chargée de chaînes, aux longs cheveux blonds épars. Elle se dirige vers l’autel les bras tendus.. L’Amour et la Jeunesse se sont séparés pour la laisser passer. Cette figure douloureuse, c’est la France blessée qui a perdu ses provinces.
Le peuple va la secourir en appelant la République à son aide.
C’est une sorte de litanie avec le réponse
Alors des plis du drapeau déployé sur l’autel surgit «la terrible, clémente, triomphante et fière République» qui se présente ainsi:
On est empoigné... Quelle belle république ce serait. Malheureusement... celle que nous avons, hélas, ne lui ressemble guère...
Cette représentation comprend douze cents acteurs. M. Colonne, de son bâton de maëstro, dirigeait trois cents instrumentistes et neuf cents choristes; tout a marché à ravir, l’ensemble a été magnifique, mais trop païen, digne des temps mythologiques. C’est ainsi que se faisaient autrefois les fêtes de l’Être suprême, chères à Robespierre et les grotesques cérémonies présidées par la déesse Raison. La Troisième République voudrait-elle, comme sa grand’mère, substituer le culte païen au culte chrétien?
Croyances pour croyances, j’aime mieux les anciennes. Autel pour autel, je préfère celui devant lequel priaient nos aïeux, avant d’aller mourir pour la Patrie, pour Dieu et le Roi.
Après dîner, nous sommes allées à l’Eden-Théâtre, voir Excelsior, une féerie d’un autre genre.
En un jour, c’est beaucoup, mais nous avions des billets. Excelsior est un ballet monstre en six parties et douze tableaux. Six cents personnes en costume ad hoc dansent, défilent, s’agitent sur la scène aux sons d’un orchestre bien nourri, de cent musiciens. Tout cela brille, ruisselle, étincelle, et se retrace bien mieux sous les yeux que sous la plume.
Lundi, 14 Octobre 1889.
Les Bouquinistes
Nous avons flâné aujourd’hui, admiré les beaux étalages et bouquiné du Pont-Royal au Pont St-Michel. C’est là le marché des volumes en plein vent. Les marchands étalent sur les parapets les boîtes où sont jetés pêle-mêle les vieux livres, et cela m’a beaucoup amusée de fureter dans toutes ces boîtes. Ces modestes étalages sont une tentation permanente pour bien des gens.
On jette un coup d’œil en passant sur cette bibliothèque au grand air.
Un titre plaît, on prend le livre, on le feuillette, on en lit des passages, cela n’engage à rien, s’il convient on l’achète, s’il ne convient pas on le remet à sa place et l’on poursuit son chemin. La clientèle est très variée: savants, prêtres, étudiants, petites ouvrières, artistes, stationnent devant ces étalages que le propriétaire laisse complaisamment prendre en main, regarder et lire, dans l’espérance d’une vente à bref délai.
Autrefois, plus d’un collectionneur trouva là des occasions merveilleuses, mais ces heureuses trouvailles sont rares maintenant. Les bouquinistes ne se laissent plus attraper, ils connaissent généralement aujourd’hui la valeur de leur marchandise. Sans doute, ils achètent des lots de livres à l’hôtel des ventes, mais tous les livres de prix ont été préalablement enlevés par les libraires et les collectionneurs, et cette chasse au livre rare si pleine d’imprévus, de surprises agréables autrefois, n’existe plus, cependant le bouquiniste ne vend pas moins, puisque tout le monde achète des livres. On ne trouve plus la qualité, mais on trouve la quantité. Jadis, le roi des bouquinistes était M. Achaintre, un savant, un grand latiniste tombé dans la misère, et qui plus d’une fois donna son avis à des littérateurs sur un passage de Virgile ou un vers d’Horace. Sans doute il y a des collectionneurs raisonnables, respectueux du bien d’autrui, mais il y en a d’envieux, avides de posséder seuls le trésor convoité, et pour lesquels tous les moyens sont bons, même les plus mauvais.
On connaît l’histoire de ce bibliophile, riche de science, mais pauvre d’argent, tous les jours à l’étalage il reluquait un livre rarissime de grand prix; d’abord il l’avait regardé, puis il l’avait feuilleté, enfin il s’était mis à en lire des passages, et chaque fois la tentation plus forte faisait son œuvre, et une idée diabolique hantait son cerveau.
Le marchand, qui ne se doutait de rien, le laissait faire, rêvant au contraire une vente avantageuse et prochaine. Un jour en effet le savant se décide. Vous demandez cent francs de cet ouvrage, dit-il?
C’est le minimum que je puisse le vendre, répond le marchand.
Vous assurez qu’il est complet?
Je l’assure, et je ne diminuerai pas un liard sur ce prix.
Le savant se mit pour la centième fois peut-être à feuilleter le livre.
Soudain il s’arrête, son regard brille d’une joie immense: Marchand, s’écrie-t-il, vous me trompiez, il manque deux pages, voyez-vous-même, de la page 113 on passe à la page 116.
Le marchand reste atterré, son livre a perdu la moitié de sa valeur, et cependant il était sûr, oh! mais bien sûr qu’il était complet. Bref, après une heure de marchandage, le savant triomphe et obtient pour quarante francs l’ouvrage si longtemps désiré. Huit jours après, le savant réunissait ses amis, pour leur montrer le rarissime ouvrage très complet qu’il venait d’acheter, le feuillet manquant avait été habilement recollé à sa place.
C’était l’astucieux bibliophile lui-même qui l’avait subtilisé un jour que le marchand entouré d’acheteurs lui tournait le dos.
Les âmes élastiques se rassurent en se disant: «après tout, les choses d’art n’ont qu’une valeur de convention».
Les âmes honnêtes appellent cet acte indélicat, voler, et elles sont dans le vrai. Je connais une dame qui a fini par se monter une jolie bibliothèque avec les volumes qu’on lui a prêtés; de même qu’il y a différentes catégories d’emprunteurs, il y a aussi différentes catégories de prêteurs. Il y a ceux qui ne tiennent guère aux livres qu’ils ont et les prêtent volontiers; ceux qui oublient à qui ils les ont prêtés, ceux enfin qui n’osent pas les réclamer. Ces gens-là sont tout ce qu’il y a de plus commode à dévaliser. Aux personnes d’ordre qui réclamaient leur bien, la digne dame répondait: «Patientez un peu, je n’ai pas fini la lecture intéressante de vos ouvrages, ou, ils sont si jolis que je les ai prêtés moi-même, mais soyez sans inquiétude, on ne tardera pas à me les rendre. Et le temps passait, et si plus tard le propriétaire hasardait une nouvelle réclamation, la dame prenait un air des plus surpris et s’écriait: «Vous faites erreur, je vous les ai rendus dans le temps, vous les aurez prêtés à d’autres». Mon Dieu, elle était peut-être de bonne foi, et à force d’emprunter des livres et de les mêler aux siens, elle finissait par ne plus s’y reconnaître... Concluons qu’il est plus facile de retenir les livres que ce qu’il y a dedans. C’est ce que disait déjà Helvétius, il y a cent ans. Je compte visiter les catacombes, je suis en instance pour cela.
Mardi, 15 Octobre 1889.
Musée de Minéralogie et Géologie.—Musée du Louvre—Dîner en famille avec une nouvelle arrivée.
Temps froid, avec soleil et ciel bleu; d’ailleurs on peut aller par n’importe quel temps à l’Exposition, ses palais, ses galeries, ses arcades et ses vélums sont là pour vous protéger.
Nous avons visité ce matin un musée où ma cousine et moi nous nous sommes trouvées seules! Cela m’a paru tout à fait drôle, puisque partout il y a foule compacte. Provinciaux des villes et même des campagnes continuent de donner avec un entrain qui stupéfie les Parisiens. Cela prouve qu’il n’y a pas qu’eux à savoir se débrouiller.
Oui, nous avons visité à Paris, en temps d’Exposition, d’immenses salles ouvertes au public... où il n’y avait personne!
Nous étions boulevard Saint-Michel, à l’Ecole des Mines, qui contient le Musée de minéralogie et de géologie.
Des peintures murales représentent les lieux minéralogiques les plus remarquables. Au premier étage sont les collections minéralogiques et géologiques groupées pour la France par départements. Nous ne sommes point montées au second étage qui contient une collection paléontologique de grande valeur et dont tous les spécimens sont étiquetés. Ce sanctuaire d’une science qui n’est pas à la portée de tout le monde ne peut intéresser que des savants.
Nous avons donc vu au premier des pierres de toutes sortes, mais nous ne nous sommes arrêtées que devant les pierres précieuses et nous avons également admiré les œuvres de la nature et celles du travail humain. Les diamants fabriqués ont la pureté et la dureté des diamants naturels, malheureusement, ils sont très petits, on n’est pas encore arrivé à produire de gros diamants, les autres pierres précieuses, saphirs, rubis, émeraudes, sont aussi des poussières comparées à la grosseur des pierres naturelles, les émeraudes surtout qu’on trouve aux Monts Ourals en blocs énormes.
J’ai été éblouie par toutes les merveilleuses peintures et sculptures que renferme le Musée du Louvre. Mais il faudrait y passer des semaines, le catalogue en main pour le voir et l’admirer à son aise. Je n’ai donc fait que passer de galerie en galerie, de travée en travée, de salle en salle: salle ronde, salle carrée, salle des Sept Mètres, etc., etc.
C’est une incomparable réunion de chefs-d’œuvre dans un cadre digne du tableau. En effet, le Louvre, par ses magnifiques proportions, la beauté de son style antique s’unissant à celui de la Renaissance l’extrême élégance de sa décoration, est considéré comme le plus beau Palais de l’Europe, et ses collections artistiques en sont les plus riches et les plus précieuses.
Mais les musées restent, l’Exposition passe, donc il faut consacrer son temps à cette dernière.
Ce soir après dîner, Mathilde, la jeune parente de ma cousine nous a raconté ses déconvenues depuis trois jours. Ses lamentations nous ont fort diverties, ô noirceur du cœur humain. Voici sa navrante odyssée:
Je n’ai pas de chance, nous a-t-elle dit.
En 1867, j’étais toute jeune fille, un de mes oncles, vieux célibataire, m’offre un voyage à Paris, je n’avais garde de refuser. J’étais joyeuse comme un oiseau le matin du départ, nous arrivons dans les meilleures dispositions et nous voilà, du matin au soir, visitant tous les deux Paris et surtout l’Exposition. Malheureusement, nous n’avions nullement les mêmes goûts. Mon oncle s’attardait devant tous les produits gastronomiques, les vins vénérables, les eaux-de-vie de la Comète, les foies-gras de Strasbourg; les armes et les machines l’intéressaient aussi beaucoup. Moi, je n’aurais voulu m’arrêter que devant les beaux meubles, les bijoux, les dentelles et les soieries. Celles de Lyon étaient éblouissantes. Il y avait entr’autre une robe de soie blanche sur la traîne de laquelle s’épanouissait, tissée dans l’étoffe, la queue d’un paon faisant la roue. Cette robe destinée à une souveraine, me fascinait; mais mon oncle n’entendait pas qu’on s’arrêtât à ces babioles.
Nous passions rapidement, ne stationnant que devant les vitrines favorites de mon oncle. Je déplorais, tout bas, ma jeunesse et ma dépendance. Etre libre quand on a quinze ans, quel rêve!
Les années ont passé... je suis mariée et je viens à Paris avec mon mari et mes deux enfants: Yvan, sept ans, Anne, cinq ans, pour voir cette incomparable merveille, dont les oreilles me tintent depuis tantôt six mois. J’espère cette fois la voir à ma guise; mais la femme propose et le mari et les enfants disposent.
Nous arrivons le soir fort tard à l’hôtel, très fatigués d’un long voyage et nous nous couchons vers dix heures ayant vraiment besoin de repos.
Avant minuit nous sommes réveillés par ce cri sinistre: au feu! au feu! Yvan, les yeux hagards, s’est déjà jeté hors de son lit. Des lueurs blafardes passent devant notre fenêtre, les cris d’angoisse redoublent, ils sortent de la chambre contiguë à la nôtre. A peine vêtus, ma fille dans mes bras, mon fils tenant la main de son père, nous descendons l’escalier affolés et nous faisons irruption dans la salle-à-manger de l’hôtel, où plusieurs voyageurs se trouvaient déjà. Les pompiers avaient été prévenus. Voici ce qui était arrivé. Une vieille demoiselle, notre voisine de chambre, avait l’habitude de se faire enfermer et sa domestique qui logeait aux mansardes emportait la clé. Cette demoiselle en frisant ses papillotes, avait mis le feu aux rideaux et l’on juge de son angoisse, ne pouvant sortir. Voilà ce qui avait rendu ses cris si déchirants et effrayé toute la maison. Les pompiers en quelques jets d’eau, eurent bientôt éteint l’incendie et chacun, vers deux heures du matin, put regagner ses appartements; mais comment dormir après de telles émotions?
Nous nous levons tard et sortons aussitôt le déjeuner pour faire quelques commissions; place Saint-Michel nous nous trouvons au milieu d’un encombrement de voitures, Yvan tirait à droite, Anne tirait à gauche, et peu s’en est fallu que nous ne fussions tous les quatre écrasés. J’étais toute frissonnante de peur et mon mari très pâle. Ma chère amie, me dit-il, nous ne sommes pas ici dans nos rues tranquilles de province, il est impossible de se tirer d’affaire avec des enfants de cet âge-là, prenons une voiture. Nous leur avons promis depuis longtemps une visite au Jardin d’Acclimatation, voilà le moment venu. Oui, oui, me suis-je écriée, sauvons-nous à la campagne. Mon mari a souri, comment, à peine arrivée à Paris le but de tous tes désirs, tu songerais à le quitter!
Les enfants ont vite oublié le danger, ravis de rouler en voiture, en attendant la promenade en palanquin sur le dos d’un éléphant.
Le fiacre est à peine arrêté devant l’entrée du Bois de Boulogne que les deux bambins sont à terre, je me précipite pour les suivre et mon mari aussi. Cinq minutes après nous nous apercevons que leurs manteaux et nos deux parapluies sont restés dans le fiacre qui était reparti de suite, et comme en naïfs provinciaux que nous sommes, nous n’avions pas songé à prendre le numéro, nos manteaux et parapluies ne se retrouveront jamais. Nous ne sommes pas les seuls à oublier ces objets, la statistique assure qu’il est perdu environ cinq mille parapluies chaque année à Paris. Nous avons donc bien des compagnons d’infortune, mais ce n’est pas une consolation.
Cette fois, nous rentrons satisfaits de notre promenade, et nous promettant bien de passer le lendemain, qui était hier, une délicieuse journée à l’Exposition. De bonne heure, nous nous y rendons tous les quatre avec les deux sœurs de ma mère qui, vous le savez, habitent Paris depuis longtemps.
Je m’intéresse à beaucoup de choses que mon mari ne regarde même pas.
J’avoue que je suis un peu ébouriffée de tout ce que je vois, on le serait à moins, nous marchons, trottons, circulons et finalement mon mari qui s’arrêtait d’un côté, moi et mes tantes d’un autre, nous finissons par nous perdre, et nous voilà nous cherchant mutuellement et perdant une grande heure à cet agréable exercice. Yvan adore son père, et le voilà tout en larmes. Papa est perdu! Papa est perdu!
—Mais non, mon chéri, calme-toi, nous allons le retrouver.
Anne très fatiguée commençait déjà à faire la grimace; son chagrin éclate à son tour, mais il ne s’agit que d’elle.
—Maman, je suis lassée...
—Ma petite fille, nous cherchons ton papa, tout à l’heure tu vas te reposer.
—C’est maintenant que je veux me délasser; je veux m’asseoir.
Et nous prenons des chaises, qu’entre parenthèse on nous fait payer deux fois. On ne peut pas discuter pour quelques centimes.
Au bout d’un quart d’heure, Anne en avait assez et Yvan pleurait toujours. Anne n’était plus lassée, elle avait faim.
—Je voudrais un gâteau.
—Mais, ma petite, il n’y en a pas ici, nous irons en chercher plus tard.
—Je veux un gâteau, j’ai faim...
Nous nous dirigeons vers une pâtisserie.—Allons, Yvan, ne pleure plus, veux-tu un bonbon?
—C’est pas un gâteau que je veux, c’est papa.
Les enfants mangent des brioches, et j’espère avoir enfin la paix.
Mais généralement quand on a eu faim, on a également soif, et quand on a mangé, il faut boire, et nous voilà à la recherche d’un bock, mais c’est bien une autre affaire, Anne ne veut ni bière ni vin, elle veut de l’eau et c’est justement ce que les limonadiers n’aiment pas à vendre. Yvan refuse énergiquement de boire. Je ne veux pas boire, je veux papa.
Anne a donc bu et mangé consciencieusement, elle éprouve un troisième besoin sur lequel je n’appuie pas, et nous voilà courant jusqu’au diable vert pour trouver le dit pavillon..., et Yvan pleurait toujours. Tout cela avait pris beaucoup de temps, et nous étions véritablement tous très fatigués.
J’ajouterai même que mes bonnes tantes qui n’ont jamais eu d’enfants étaient positivement atterrées. Nous retrouvons mon mari maussade et de mauvaise humeur, me reprochant de l’avoir perdu, et moi à mon tour me révoltant d’être restée seule à subir la corvée des enfants.
Nous prenons le petit decauville qui nous conduit au pied de la célèbre tour. Je n’aurais pas mieux demandé que de me promener, de voir, d’admirer mais j’avais mes deux terribles boulets, non aux pieds, mais aux mains et cela paralysait mon enthousiasme.
Nous dînons à l’Exposition pour prendre les premiers nos places aux fontaines lumineuses. Anne baîllait et Yvan avait fini par dormir sur les genoux de son père. Nous sommes rentrés vers onze heures, harassés. C’était à se demander si nous avions fait vingt-cinq lieues à pied.
Nous nous couchons, mais mon fils très fatigué est pris de fièvre, et nous avons passé la nuit dans l’inquiétude mon mari et moi. De grand matin nous avons fait venir un médecin qui nous a complètement rassurés. Ce n’est que de la fatigue et de l’émotion. C’est pourquoi vous me voyez seule aujourd’hui.
Je viens vous embrasser en courant, dit-elle à ma cousine, et vais relever mon mari qui, assurément, en venant à l’Exposition, ne s’attendait pas à remplir le rôle de garde-malade.
Espérons que notre voyage s’achèvera mieux qu’il n’a commencé.
C’est la grâce que je te souhaite, a murmuré ma cousine en l’embrassant.
Mercredi, 16 Octobre 1889.
Le Jardin d’Acclimatation
Le Jardin d’Acclimatation, établi dans le Bois de Boulogne, est un parc délicieux de vingt hectares.
L’arrivée est charmante sous bois, dans des voitures découvertes courant sur rails à travers les allées. On se croirait assis sur un banc de jardin qui soudain se met en marche entraîné par un cheval endiablé!
Oui, le Jardin d’Acclimatation m’est apparu comme une miniature du Paradis terrestre. Tout le monde doit l’envisager ainsi. Paradis des grands, soit que ceux-ci s’égarent dans les parties ombreuses et solitaires, soit qu’ils aillent rêver des tropiques dans la grande serre centrale ou regarder les caravanes exotiques.
Toutes les races humaines ont campé sous le ciel du Bois de Boulogne: Nubiens, Esquimaux, Fuégiens, Galibis, Cynghalais, Araucaniens, Kalmoucks, Peaux-Rouges, Achantis, Hottentots, Circassiens, Lapons norwégiens et tutti quanti.
Paradis des petits, qui s’en vont chevaucher sur les dromadaires, se faire traîner en voiture par une autruche ou les petits zèbus (bœufs trotteurs) monter dans le palanquin de l’éléphant, assister au repas des phoques. Du reste, il n’y a pas que les enfants à monter en palanquin. Le samedi, jour où on se marie le plus à Paris, on y voit les épousées d’un certain monde dans leurs blanches toilettes. Cette promenade est, paraît-il, la distraction favorite inscrite au programme des noces ouvrières.
Les serres avec ruisselets tranquilles et grottes mystérieuses sont des palais de fleurs, où toutes les plantes frileuses de la création se donnent rendez-vous: il en est de même des animaux remarquables. Ils ont ici leurs représentants: tapirs, sangliers, zèbres domestiques, rennes, chamois, isards, antilopes, daims, cerfs, sans oublier le cerf nain de la Chine, qui pèse environ douze livres. Comme antithèse, je citerai Juliette (Roméo est mort en 1886), l’éléphant offert par le feu roi Victor-Emmanuel. Juliette et Roméo avaient succédé à Castor et Pollux, vendus vingt-sept mille francs à la boucherie parisienne pendant le siège; du reste ils ne furent pas les seuls animaux du Jardin d’Acclimatation que les Parisiens dévorèrent. On mangea alors des côtelettes d’antilopes, des biftecks d’ours, des rôtis d’éléphants, des filets d’hippopotames.
A la suite de tous ces désastres, la ville de Paris dut dépenser cent quatre-vingt mille francs pour remplacer les victimes et repeupler le Jardin d’Acclimatation. Ces beaux animaux doivent être heureux, ils ont tout à souhait, sauf là liberté, et pour ceux qui l’aiment, c’est peut-être manquer de tout.
Les singes ont un palais revêtu à l’extérieur comme à l’intérieur de plaques de faïences pour empêcher les murs de s’imprégner de mauvaises odeurs, les ouistitis sont charmants ainsi que les écureuils gris, ces jolis écureuils qui fournissent la fourrure dite petit-gris ou vair.
Il y a des moutons et des chèvres de tous les pays: de Russie, d’Egypte, de Chine, d’Afrique; la petite chèvre naine de ce dernier pays est un vrai joujou vivant, moins grande que la plupart de celles qu’on achète chez les marchands de jouets.
Je me suis arrêtée longtemps devant le palais des kanguroos: peu gracieux, mais très drôles ces animaux, avec leur grande poche sous le ventre pour élever leurs petits. Ils ont les membres postérieurs très développés, et en s’aidant de leur queue qui leur sert tour à tour de point d’appui dans le repos, de tremplin au départ, de balancier pour la course, ils franchissent d’un seul bond des distances énormes. Les espèces de kanguroos sont très nombreuses, et presque toutes représentées ici.
Très intéressant encore les lamas qui sont les chameaux du Nouveau-Monde et fournissent ces riches toisons dont on fait de si beaux tissus et même de la dentelle maintenant. La vacherie possède les meilleures laitières et pas mal de petites vaches bretonnes. J’en ai été toute fière. La laiterie est auprès, et pour les Parisiens c’est une régalade de pouvoir boire une tasse de lait tout chaud, tout écumeux, il y a des jours où il s’en débite mille tasses.
Les variétés infinies de la race canine se retrouvent en offrant aux regards charmés des amateurs les types les plus purs. Voilà des sujets qui ont toutes les qualités requises pour satisfaire les plus difficiles, le rude chasseur ou la petite maîtresse.
On peut en dire autant des chevaux dont la collection est des plus complètes, depuis le percheron pur-sang, le cheval de trait breton jusqu’au cheval d’Arabie.
Et les poneys! en voilà de tous les pays: de Java, de Siam, de Cochinchine, d’Ecosse, d’Islande, de Russie, de Corse, des Landes, de Navarre, de l’Ile d’Yeu, de Pologne, de Finlande. Ils ont de jolies robes, des formes élégantes, ce sont de mignons petits chevaux, mais en général ils n’ont pas l’air commode.
J’ai admiré en face des écuries le sequoïa gigantea, le sapin géant de la Californie, qui ne croît naturellement que sur un seul point, dans la vallée de Calaveras, donné il y a vingt ans par Monsieur Leroy d’Angers.
Il est autrement beau que celui que je possède à la campagne, mais cela n’est pas étonnant, le mien a été la victime d’une aventure extraordinaire, il commence une seconde vie... Donc cet arbre, déjà fort beau pour ses quinze ans, vivait tranquille et solitaire sur le bord d’une allée qu’il fallait élargir. Je regrettais bien le sacrifice, c’était devenu nécessaire: l’arrêt fatal fut prononcé. Le séquoia est arraché, scié au bas du tronc, et les racines qui formaient un gros bloc, jetées sur un tas de bois à brûler. Ceci se passait au printemps. Tout l’été la pauvre souche resta exposée au grand soleil. Plusieurs fois, je dis à mon cordon bleu: «Mais brûlez donc cette souche, c’est une bûche toute faite pour cheminée de cuisine».
Au fond cela m’agaçait de voir en l’air les racines de mon pauvre séquoia, de mon unique. Et chaque fois la cuisinière me répondait: «Il n’est pas sec.
—Par exemple!
—Il lui pousse sans cesse de petites branches vertes tout autour, que Madame vienne voir».
Je fus voir et la souche du pauvre arbre mutilé se montrait toujours verdoyante. J’en eus pitié. La racine fut remise en terre et les petites branches se mirent à pousser vigoureusement. La première année, nos voisins, des agriculteurs entendus, me disaient: «C’est impossible que cet arbre reprenne vie... C’est un peu de sève restée dans la souche qui fait son dernier jet». Je le craignais, mais non, depuis trois ans mon cher séquoia continue de les démentir. On dirait même qu’il veut rattraper le temps perdu et dépasser ses congénères qui poussent d’un mètre par an et qui atteignent jusqu’à cent dix mètres, deux fois la hauteur des tours Notre-Dame.[9]
Mais revenons au Jardin d’Acclimatation.
Les gallinacées sont un monde où se retrouvent les espèces les plus rares comme les plus communes. Impossible de les énumérer, je dirais cependant que les petites nègres blanches soie, les padoues dorées et les campines proprettes, plus que les grosses espèces qui leur sont comme rendement très supérieures, m’ont séduite. Les faisans sont aussi légion. Ah! les beaux et séduisants plumages, que de reflets, que de bigarrures, d’étincellements, dans ces couleurs plus chatoyantes et plus variées que celles du prisme. Quant aux pigeons, il faut venir ici pour en voir la plus complète collection qui ait été jamais réunie. Le colombier est merveilleusement installé. C’est une élégante construction en briques et fer formant une tour de trente mètres de hauteur sur six mètres de diamètre, divisée en quatre étages; quatre cents couples de pigeons peuvent nicher là. Tout le service se fait à l’aide d’un ascenseur, ce qui simplifie les choses. Les combles de la toiture, en forme de champignon, abrite la nuit les pigeons en liberté. Parfois le vol d’une troupe nombreuse tournoyant autour du colombier produit un sifflement sonore, ce bruit étrange provient de gros sifflets en courge ou bambou attachés sur les plumes de la queue et qui sont d’un usage général en Chine pour effrayer les oiseaux de proie. Nous avons salué au passage les pigeons-voyageurs dont on n’a pas oublié les hauts faits pendant le siège de Paris. Il en est qui franchirent à plusieurs reprises les lignes prussiennes porteurs de ces dépêches microscopiques photographiées sur des feuilles de collodion si légères, que les cent quinze mille dépêches reçues pendant le siège, ne dépassèrent pas à elles toutes le poids d’un gramme, c’est du moins ce qui nous a été dit.
Voilà deux pavillons très bien habités, celui-ci par les grands-ducs qui appartenaient à Gustave Doré, celui-là par un harfang de Norwège ou chouette des neiges, cet oiseau très rare remplace celui qui fut tué méchamment en 1884 par un Anglais, lequel poursuivi devant le tribunal correctionnel fut sévèrement condamné, comme il le méritait d’ailleurs.
Très intéressant le parc des échassiers, hérons, cigognes, flamands, ibis communs et celui des grues qui viennent de tous les points du globe. Très beaux les casoars et les autruches, ravissants les ibis d’espèces rares, roses et rouges, quel magnifique plumage; on dirait des bouquets de roses ou de flammes qui marchent. Cette beauté qui parle aux yeux explique le culte que certains peuples avaient autrefois pour l’ibis, dont ils avaient fait l’oiseau sacré. Les Egyptiens le vénéraient comme une divinité bienfaisante, son apparition coïncidait avec les inondations du Nil. Lorsque les ibis entretenus dans les temples mouraient, on ne les empaillait pas, mais on les embaumait et on les enfermait ensuite dans des nécropoles dont Hermopolis était la principale.
Excessivement curieuse, la pêche qu’on fait faire aux cormorans tous les jours et à heure fixe. Le cou de ces pêcheurs emplumés est entouré d’un anneau qui les empêche d’élargir leur gorge et de pouvoir avaler le poisson qu’ils sont allés capturer au fond de l’eau.
La pêche du cormoran était un sport fort apprécié des anciens rois de France. Pendant longtemps abandonné, on ne le pratiquait plus qu’en Chine. Aujourd’hui il reprend faveur en France et particulièrement chez les Anglais, grands amateurs de tous les genres de sports. Ces animaux peuvent arriver à un dressage parfait. Oui, ces oiseaux pêcheurs de poissons lâchés en liberté s’en vont plonger au loin puis reviennent à tire d’aile vers leur maître déposer entre ses mains le butin conquis et recevoir ensuite la récompense méritée par leurs efforts.
Nous avons pu assister au repas des phoques et des otaries, ou lions de mer des glaces polaires. Ces animaux connaissent très bien l’heure du repas, on les voit alors s’agiter, nager vivement, se dresser hors de l’eau, comme pour dire que l’heure de la réfection est arrivée. Les otaries, par leurs formes étranges font penser aux grands animaux antédiluviens, ils n’ont que des nageoires dont ils se servent comme les quadrupèdes de leurs membres et leur agilité contraste avec la marche lente des phoques qui se traînent sur le ventre.
Les otaries sont d’une docilité extraordinaire; au commandement de leur gardien, ils montent en quelques bonds au sommet du rocher qui surplombe leur grand bassin et se jettent dedans la tête la première. Ils ressemblent alors à des sirènes, bondissent comme des poissons volants et décrivent les courbes les plus gracieuses au milieu de la blanche écume qu’ils font jaillir autour d’eux.
Les oiseaux de volières, parleurs et chanteurs, ramagent dans tous les tons. C’est un concert un peu bruyant, mais on leur pardonne, ils sont si jolis, depuis le perroquet vert, le cacatois huppé, jusqu’aux bengalis, jusqu’aux délicieux oiseaux-mouches. Ah! si les ibis ont l’air de bouquets qui marchent, les colibris ressemblent à des pierres précieuses qui voltigent. Les oiseaux d’eau habitent la rivière qui traverse tout le jardin. Ah le joli lieu pour s’ébattre, se baigner et vivre dans la plus douce quiétude. Nous avons admiré les canards de toutes les espèces, des cygnes majestueux et un grand pélican qui heureusement
L’aquarium est encore un palais, le palais d’Amphitrite, aurait dit ma grand’mère.
Cet aquarium m’a remis en mémoire la petite aventure arrivée à un de mes voisins, le plus honnête homme de la terre, mais campagnard jusqu’aux moelles, c’est-à-dire un peu naïf, souvent étonné et pas débrouillard du tout. Paris a toujours été l’objectif des gens qui ne voyagent guère; aller à Paris, c’est le rêve des jeunes fiancés qui projettent d’y passer le premier quartier de leur lune de miel. C’est ce que fit mon voisin après son mariage, il vint visiter la capitale plaçant au nombre de ses principales curiosités le Jardin d’Acclimatation, de création récente alors, et l’aquarium.
Il le visita dans ses plus grands détails, s’intéressa à tout, s’extasia devant les plantes et les animaux, épuisa tous les termes admiratifs du vocabulaire et quand il fut sorti glissa tout bas à l’oreille de sa jeune épousée: «Eh bien là, franchement, j’ai tout vu, sauf la chose que je tenais le plus à voir.
—Et quoi donc?
—Mais la croix Riome, et mon voisin fulmina ainsi son mécontentement, la croix si admirable du dénommé Riome. Est-ce un savant, un explorateur, un martyr de la science, qu’est-ce qui l’a rendu célèbre, on ne nous l’a seulement pas dit?».
L’aquarium compte dix grands bassins d’eau de mer et quatre d’eau douce. Ces bassins ou bacs, sortes de caisse en ardoise, ont une paroi garnie d’une glace mesurant un mètre quatre-vingts sur quatre-vingts centimètres, ils reçoivent la lumière seulement par en haut, de telle sorte que le visiteur étant dans un demi-jour, voit très bien les objets placés dans l’eau derrière la glace. Ce système très simple, est partout adopté aujourd’hui.
Chacun des bacs est un petit océan où s’agitent les êtres les plus étranges: «les pieuvres promènent en tous sens leurs huit tentacules et fixent le visiteur de leur œil vitreux, les crevettes voltigent comme des papillons sur le devant des bacs et se poursuivent en bondissant sur le sable, formant des ballets fantastiques, auxquels leurs corps transparents donnent une apparence spectrale. Les Bernard l’Ermite sont des Diogènes sybarites vivant dans un tonneau parfaitement approprié à leur taille, c’est-à-dire dans une coquille dont ils ont remplacé le légitime propriétaire. L’anémone parasite se fixe sur la coquille habitée par le Bernard l’Ermite, comme le vieillard de la mer sur les épaules de Simbad, dans les contes des mille et une nuits.»
«Des hippocampes ou chevaux marins peuplent un des bassins et l’on distingue facilement les mâles à la poche abdominale où ils recueillent les œufs pondus par les femelles et abritent leurs petits comme les kanguroos. On peut voir les spinachis ou les épinoches construire leur nid d’algues et de vase, tandis que les macropodes ou les poissons arc-en-ciel de la Chine établissent à la surface d’un bac plein d’eau douce un plafond de bulles d’air au centre duquel ils déposent leurs œufs comme dans un radeau d’écume et dont ils empêchent les jeunes de s’éloigner pendant les premiers jours. Si on examine le sol sablonneux de certains compartiments, on est surpris de le voir constellé d’yeux qui regardent en tous sens; les soles, les plies, les turbots sont là, ensevelis sous une légère couche de sable, juste assez pour cacher le corps en laissant l’œil dépasser.»
Plusieurs poissons s’apprivoisent d’une façon étonnante et connaissent leurs gardiens; telles sont particulièrement les anguilles de mer et les trigles, qui viennent manger dans la main du gardien et le reconnaissent quand il passe.
Derrière l’aquarium existe le pavillon de la pisciculture dans lequel se trouve réunie une collection très complète des poissons d’eau douce et les appareils de pisciculture les plus perfectionnés. Les visiteurs peuvent suivre les opérations de fécondation artificielle et d’élevage qui se font sous leurs yeux.
Si on ajoute à toutes ces choses si curieuses et si intéressantes l’excellent buffet-restaurant, le cabinet de lecture avec bibliothèque et le kiosque de la musique, où se fait entendre un orchestre parfait, on conviendra que le Jardin d’Acclimatation est pour les Parisiens l’oasis délicieuse où ils peuvent venir se reposer et oublier les exigences de leur vie enfièvrée.
Nous sommes revenues perchées sur l’un de ces matadors d’omnibus qui contiennent quarante personnes. Rien de plus amusant entre six et sept heures du soir que cette promenade sur les grands boulevards noirs de monde et de voitures; simples fiacres, coupés de maîtres, colosses d’omnibus, camions, fardiers s’enlacent et serpentent dans tous les sens, s’enchevêtrent et se désenchevêtrent avec une adresse extraordinaire.
L’impériale d’un omnibus, disait Victor Hugo, c’est un balcon ambulant, et en effet, de ce balcon on découvre mille choses nouvelles dans cette immense ville où tout est un sujet d’observation.
Jeudi, 17 Octobre 1889.
La Messe rouge.—La Sainte-Chapelle.
Le Palais de Justice.
2me Visite au Musée de Cluny.—Carmen, Sigurd.
Nous avons pu assister à la messe solennelle de rentrée des Cours. Nous autres, provinciaux, nous disons la Messe rouge, à cause des grandes robes rouges fourrées d’hermine que portent la plupart des magistrats. C’est l’abbé de Beuvron, chanoine de Notre-Dame, qui célébrait la messe. La cérémonie est fort belle, le défilé très imposant. Le garde-meuble prête pour la circonstance de belles vieilles tapisseries pour orner les corridors et l’entrée. La Sainte-Chapelle est un peu petite ce jour là, mais quelle admirable perle de l’art gothique. Je regrette bien que ce délicieux joyaux soit dans un vilain écrin, une cour du Palais de Justice où il est trop caché. Les hommes ont besoin d’air et les monuments aussi, il leur faut l’horizon et l’espace. La Sainte-Chapelle bâtie par saint Louis en 1242, comprend une chapelle basse et une chapelle haute. On remarque dans la chapelle basse ses quarante colonnes, ses clefs de voûte en bois de chêne sculpté et la grande rose du pignon. Dans la chapelle haute on remarque les magnifiques vitraux de seize mètres d’élévation et ses statues des douze apôtres, l’autel et le baldaquin ogival en bois sculpté. La chapelle haute était autrefois réservée au roi et à la reine; on y voit la place où se tenait Saint Louis, à gauche et en face la place de Blanche de Castille. Louis XII y avait une petite logette où sans être vu il pouvait surveiller l’officiant. En 1630, un incendie détruisit la charpente des combles. La flèche en tombant effondra la voûte de l’escalier dû à Louis XII. C’est sur cet escalier en ruine, que Boileau a transporté le théâtre de son lutrin. Pendant la Révolution, la Sainte-Chapelle fut profanée et transformée en club et en magasin. Ce n’est qu’en 1837 qu’on commença à la restaurer. Les travaux ont duré trente ans.
Nous nous sommes promenées dans la salle des pas perdus du Palais de Justice. C’est dans cette salle que les clercs de la Basoche jouaient les mystères de la Passion, des farces, des moralités, des sotties, c’était l’enfance du théâtre.
Nous avons visité quelques pièces seulement, descendu des escaliers magnifiques dans la partie récemment construite qu’occupe la Cour de Cassation. Ce palais est tout un monde et que de souvenirs il renferme!
Le Palais de Justice est le plus ancien monument de la Cité; il a soutenu deux sièges contre les Normands. Robert le Pieux en fit son château. Saint Louis son palais. Philippe le Bel l’agrandit, Louis XII le restaura, Louis le Gros y mourut et Philippe Auguste s’y maria. Quand le Palais de Justice cessa d’être la résidence officielle des rois de France, elle devint celle du Parlement. Quatre tours couronnent ce beau monument. La tour carrée de l’horloge, la tour sinistre des Oubliettes, la tour d’Argent où le roi renfermait ses trésors et la tour crénelée de César, élevée dit-on sur l’emplacement d’un fort construit par cet empereur.
La Cour d’honneur forme un cadre digne du tableau. Ce que j’ai visité avec le plus d’intérêt c’est la Conciergerie, non loin des anciennes cuisines de saint Louis qui servent de prison. Cette conciergerie est devenue tristement célèbre depuis; elle rappelle les massacres de septembre, Marie-Antoinette, sa belle-sœur Elisabeth, Madame Rolland quittèrent la Conciergerie pour monter à l’échafaud. Les girondins Danton, Robespierre, Saint-Just, Camille-Desmoulins et tant d’autres scélérats révolutionnaires passèrent de la Conciergerie à la guillotine, juste retour des choses d’ici-bas.
L’après-midi, pendant que ma cousine recevait ses visites, je suis retournée au Musée de Cluny, comme je le désirais depuis ma première station «au plus exquis des musées français».
Oui, ce joyau d’architecture du XVme siècle est un chef-d’œuvre et peut-être le monument le plus complet de la transition de l’art ogival à l’art de la Renaissance.
Originairement construit vers 1360, il avait été complètement réédifié, vers 1492, par Jacques d’Amboise, frère du ministre de Louis XII. Les abbés de Cluny l’habitèrent rarement, ils y donnèrent le plus souvent l’hospitalité à de hauts personnages. Marie d’Angleterre, veuve de Louis XII, l’occupa et aussi Jacques d’Ecosse, le cardinal de Lorraine, le légat du pape.
Lorsque le musée s’ouvrit au public, il comprenait deux mille objets catalogués, aujourd’hui le nombre s’augmentant d’acquisitions nouvelles et de dons généreux a plus que doublé. Sauf le musée de Naples, unique aussi dans son genre, aucun musée, fut-ce celui de Munich et la maison Plantin d’Anvers, ne peuvent lui être comparés; il y a là des objets sans prix, aussi bien comme valeur intrinsèque que comme valeur artistique ou historique, d’une indéniable authenticité. Telle l’éblouissante collection d’ivoires du IIIe au XVIIe siècle, que j’étais avide de revoir; tels l’admirable jeu d’échecs de saint Louis, en cristal de roche, enrichi de pierreries, le lit de François Ier, dont le dôme est supporté par des guerriers en chêne sculpté, plus grands que nature; le prie-Dieu de la reine Blanche, et le miroir de Venise, que les Médicis apportèrent à la cour de France; l’épée damasquinée de Lahire, le vaillant capitaine. Voici plus loin la colossale armure de François Ier, et les gants énormes qu’il avait, dit-on, à Marignan, le jour même où Bayard eut l’honneur de lui donner l’accolade et de le faire chevalier. Quelle prison pour les mains que ces gants, et comment les doigts pouvaient-ils s’y mouvoir. Mais la main enfermée là devenait une arme terrible, et d’un seul coup, le guerrier ainsi ganté pouvait terrasser ou même occire net son ennemi. Cet objet pointu n’est pas une arme, ceci est une fourchette, la première qui ait paru sur une table royale, et datant de Henri III.
Et sous les vitrines, quelles merveilles de bijouterie et d’orfèvrerie, sans compter les petites vierges de plomb que Louis XI priait si dévotement, par précaution, avant de commettre un crime, ou par repentir, après l’avoir commis.
Mon Dieu! que de choses, que de belles choses!
En sortant j’ai remarqué dans la cour deux énormes pierres datant du XIVe siècle, l’une représente, gravée en creux, l’effigie de Jehan de Sarthenay, provincial de la collégiale de Cluny; l’autre celle de Simon de Gillans, abbé de Cluny en 1394.
Puis j’ai donné un dernier regard au jardin servant de cadre au musée de Cluny et aux Thermes de Julien, oasis fleurie, ombrageant la ruine romaine et le vieil hôtel français.
J’ai donc entendu Carmen samedi et Sigurd hier. Je suis revenue ravie de Carmen, mais ce n’est pas à une première audition qu’on peut juger cette musique très difficile, étrange, brillante, originale, pleine de contraste, de douceur et de feu. Carmen est le chef-d’œuvre de Georges Bizet, la preuve, c’est que cette pièce, donnée pour la première fois au mois de mars 1875, en était arrivée à sa quatre centième représentation le mois dernier.
Sigurd a de fort beaux passages, c’est une musique savante et compliquée qui vous surprend d’abord, aussi me faudrait-il l’entendre plusieurs fois avant de me permettre de l’apprécier.
Je fais une simple réflexion: autrefois quand on venait d’entendre la Favorite, Lucie, la Dame blanche, le Comte Ory, Guillaume Tell et tous les chefs-d’œuvre des maîtres de cette époque, on fredonnait en quittant le théâtre, les jolis airs dont ils sont remplis, aujourd’hui il serait bien difficile en sortant de fredonner quoi que ce soit, on ne peut rien retenir.
Sigurd, pour lequel les Parisiens se pâment à présent, a dormi vingt longues années avant de voir le jour au théâtre de la Monnaie, à Bruxelles. Notre vie est un vrai tourbillon, nous sommes toujours en l’air, toujours en mouvement, sous le sceptre du Plaisir agitant ses grelots. Ah! si cet aimable fou nous rencontrait dans les rues, il nous saluerait certainement comme étant de sa famille.
Vendredi, 18 Octobre 1889.
Je suis très contente de ma visite aux Catacombes. Après avoir vu le dessus de Paris qui est tout ce qu’il y a de plus brillant, j’ai pris intérêt à voir son dessous. Les Catacombes de Paris ne remontent point à une haute antiquité, ce sont tout simplement les carrières de pierres et de plâtre qui ont servi à bâtir en partie la capitale. Plus tard, par mesure sanitaire, l’administration ayant fait disparaître les cimetières qui entouraient les églises, on résolut de déposer tous ces ossements dans les excavations du sous-sol.
On commença par le cimetière des Innocents supprimé en 1786.
La bénédiction de cette nécropole eut lieu la même année. En 1787, les ossements des cimetières Saint-Eustache et Saint-Etienne-des-Grès y furent également transportés. Sous l’ère révolutionnaire, on y déposa les corps des individus tués pendant les troubles; ces carrières contiennent actuellement les restes de plus de six millions de personnes. Au siècle dernier, des affaissements s’étant produits à différentes reprises, on dût en 1776 procéder à un examen minutieux de ces immenses excavations, le péril était redoutable et le travail de consolidation offrait de grandes difficultés. Un groupe d’ingénieurs s’en chargea. On créa des galeries, correspondant aux rues du dessus et portant le numéro de chaque maison. Malgré ces travaux considérables de soutènement, on est tenté de se demander comment Paris tient debout. On estime à cent trente kilomètres le développement des galeries de circulation, soit maçonnées, soit conservées dans les remblais. Les catacombes demandent une grande surveillance; la solidité du dessus dépend beaucoup de l’entretien du dessous.
Il y a une quarantaine d’années on visitait facilement les catacombes, mais plusieurs accidents s’étant produits, l’administration en a interdit l’entrée permanente; il faut une autorisation.
Le principal escalier par lequel on descend est situé dans le pavillon ouest de l’ancienne barrière d’Enfer et avant de franchir le seuil de sa lourde porte on aperçoit les premières marches sombres et étroites. Chaque visiteur reçoit une bougie allumée qu’il devra tenir en main pendant toute l’exploration. Le gardien compte ses visiteurs, si quelque téméraire allait s’égarer... Cette entrée dans les catacombes n’a rien de réjouissant. Il faut descendre, descendre encore jusqu’à vingt mètres dans le sol, là on s’engage dans une galerie voûtée et maçonnée des deux côtés. Cette galerie est très longue, très étroite, on n’y peut marcher deux personnes de front. Elle se dirige vers la plaine de Montsouris et mène à un caveau qui renferme tous les ossements. C’est un long chemin dans lequel on rencontre parfois un ouvrier solitaire et silencieux qui ressemblerait à une ombre qui passe, si ce n’était la lueur vacillante de la petite lanterne qui l’éclaire.
Les ossements sont rangés symétriquement dans plusieurs galeries dont ils tapissent tous les murs. Les tibias et autres gros os alternent avec des cordons de crânes. Cela rappelle avec moins de fantaisie le cimetière des capucins à Rome. Tout cet ensemble est d’un lugubre achevé, l’air humide qu’on respire vous oppresse et la vue de ces choses sinistres vous angoisse. Je n’ai point éprouvé cette impression pénible aux catacombes de Rome.
Là il semblait que l’auréole éclatante de ces saints, de ces martyrs rayonnait jusque sur leurs ossements. On sent que cette terre est bénie et qu’il s’en échappe les plus nobles souvenirs et les plus grands enseignements.
Les principales curiosités rencontrées dans cette excursion macabre sont: la Fontaine de la Samaritaine, le tombeau de Gilbert, les Cloches de Fontis.
La Seine et la Bièvre divisent les carrières de Paris en trois groupes distincts et n’ayant aucune communication entre eux. Les carrières de Chaillot occupent une étendue de quatre cent vingt-deux mille mètres carrés, celles du faubourg Saint-Marceau cinq cent quatre-vingt-dix mille mètres carrés. Sous les faubourgs Saint-Jacques et Saint-Germain elles forment un polygone très irrégulier de trois millions quatre cent sept mille mètres carrés ou un peu plus de trois cent quarante hectares. Les catacombes m’ont suffi; je n’ai pas demandé à visiter les égouts, presque tous de date récente; les plus anciens remontent à 1750. Au commencement du siècle leur développement atteignait vingt-cinq kilomètres. C’est l’ingénieur Belgrand qui conçut en 1854 le réseau d’égouts collecteurs auquel Paris doit en partie ses conditions de salubrité. Sur les sept mille huit cents hectares que renferme l’enceinte de Paris, six mille huit cent soixante-dix sont desservis par ce réseau.
Paris renferme des légions de rats. Je ne parle pas des rats à deux pattes qui grignottent si gentiment les fortunes les plus solides, mais simplement des rats à quatre pattes. Ah! j’en ai appris de belles sur leur compte!
Les égouts sont leurs demeures favorites et les halles leur quartier général d’approvisionnements.
Le rat parisien, descendant du surmulot ou rat d’Asie est souvent gros comme un chat et d’une force peu commune. Des escouades de chiens sont dressées à leur faire la chasse. Ce sont des combats homériques où vainqueurs et vaincus se déchirent à belles dents. Parfois les assaillants succombent sous le nombre toujours croissant de leurs redoutables adversaires.
Pline dans son livre VIII raconte l’histoire de cités entières détruites par les rats! Ce triste sort serait-il réservé à notre capitale. La nature n’a point attaché aux rats leur microbe destructeur. Ils pullulent... et bien des gens assurent sans rire qu’ils dévoreront Paris, c’est effrayant, mais comme ce sont les pessimistes seuls qui le disent, il est toujours permis de croire le contraire.
Samedi, 19 Octobre 1889.
A l’Exposition.—L’Europe: Norwège.—Suède. Danemark.—Finlande.—Italie.
La Norwège.
Le bois sous toutes ses formes est la grande attraction de son exposition. On suit toutes les transformations de l’arbre, depuis le tronc brut qui sort de la forêt jusqu’à la sculpture délicate, la dentelle légère qui orne les meubles les plus charmants, l’art de travailler le bois est poussé si loin qu’on voit ici des maisons complètes, des chalets considérables, entièrement en bois, si bien combinés, si bien agencés, que chaque pièce numérotée se monte et se démonte à volonté. On vous expédie la plus coquette maison du monde par morceaux que vous n’avez plus qu’à déballer et à remettre en place. Le pavillon dans lequel nous sommes est arrivé ainsi.
Voici d’ailleurs deux modèles remarquables de ce genre de construction, l’un en bois verni, luisant et sculpté, d’une grande élégance, l’autre plus rustique en bois naturel avec escalier extérieur.
La Norwège se distingue ensuite par sa pelleterie et sa clouterie qui est un art chez elle. On voit des soleils, des arabesques fleuries, des lettres, des tableaux même, entièrement composés de clous de différentes grandeurs.
Au centre, un beau groupe en bronze représente un maréchal en train de ferrer un cheval.
La section maritime est aussi très importante, elle offre des types particuliers de bateaux marchands et de baleinières avec leurs agrès.
Les Norwégiens ont toujours préféré la mer aux champs. Ce sont des pêcheurs hors ligne. Pendant de longues années la pêche à la baleine fut une de leurs principales sources de richesse, leur marine marchande vient au troisième rang après celle de la France et de l’Allemagne, l’Angleterre exceptée bien entendu.
En définitive, l’ensemble de leur exposition est fort intéressant et je suis bien aise de l’avoir vue en détail.
La Suède
La Suède également a son chalet en sapin verni, construit là-bas et remonté ici pièce à pièce, mais son exposition est minime, son gouvernement n’ayant accordé aucune subvention pour cela; cependant ce chalet contient de belles fourrures entourant une colossale tête d’élan et des échantillons de coutellerie remarquables. Les aciers de Suède sont renommés dans le monde entier.
La vieille orfèvrerie suédoise est ouvragée et ornementée d’une façon très originale. Quatre ouvriers orfèvres dans leur chambre d’artisan fidèlement copiée, vieux sièges en bois, peintures naïves, travaillent devant les visiteurs qui les regardent curieusement.
Le Danemark
Le Danemark a mieux fait les choses que la Suède, il est représenté par cent cinquante exposants.
La décoration de cette section est due au pinceau de Monsieur Lornd, le premier peintre décorateur danois, il y a représenté les châteaux royaux de Danemark.
Les pièces d’orfèvrerie où l’or, le vermeil et l’argent se mélangent d’une façon spéciale, sont d’une parfaite distinction.
Les menuisiers et serruriers danois exposent des choses très artistiques, des objets en fer forgé remarquables et de ravissants meubles incrustés. Il faut aussi admirer les broderies, souvent imitées, des Gobelins, elles sont exquises. On remarque particulièrement un panneau de fleurs d’après nature brodées par une femme du monde Madame Ida Hauten; ce panneau est tout simplement une merveille. On est tenté de cueillir et de respirer ces fleurs là.
La ganterie tient aussi une place importante, car c’est le Danemark qui fabrique les gants de Suède.
La Finlande
Le pavillon de la Finlande est bâti d’après les principes de l’architecture scandinave, en bois verni; fenêtres pointues et étroites, toiture très épaisse et sans ouvertures, laissant à cette construction son cachet de vérité. En effet, cette toiture ne doit-elle pas supporter la chute des neiges pendant six mois. C’est toujours ici, comme en Norwège et en Suède, le règne du bois souverain; l’industrie finlandaise le plie à toutes les formes et l’emploie à tous les usages, tout se fait donc en bois, depuis le papier jusqu’aux maisons.
Les pierres de ce pays sont d’un aspect tout particulier. Voilà des portiques d’un granit à reflets d’opale qui ne se voit nulle part qu’en Finlande. Toute cette contrée présente un cachet bien étrange. Tout s’y empreigne d’un charme mélancolique, d’une douceur idéale. Les peintres la caractérisent merveilleusement dans leurs tableaux, où ils vous montrent des ciels d’une poésie et d’une sérénité incomparables. J’en ai été bien frappée au Palais des Beaux-Arts.
Malgré les neiges qui chaque année semblent les séparer du monde entier, les Finlandais sont instruits. Ils s’occupent des arts avec succès et recherchent avidement toutes les nouvelles découvertes que la science, à pas de géants, fait chaque jour.
Et maintenant quittons Madame la Neige et retournons chez Monsieur le Soleil, l’Italie nous ouvre ses portes.
La façade de la construction qu’elle représente est tout marbre et mosaïque; elle produit un grand effet.
L’intérieur est pittoresquement décoré, le rouge domine et donne beaucoup de relief aux objets exposés. La verrerie et les cristaux occupent une place importante. La fabrique de perles et les mosaïques de Murano marchent en tête avec les verres de Venise et les belles céramiques de Florence. Ah! les jolis miroirs de toutes les grandeurs encadrés de fleurs, d’oiseaux, de papillons ayant leurs formes et leurs couleurs naturelles. Ah! les belles statuettes! Ah! les beaux vases de toutes les dimensions depuis dix centimètres de haut jusqu’à un mètre et plus; girandoles, candélabres, consoles même, tout cela en porcelaines et faïences artistement peintes. Certains de ces objets sont d’une délicatesse et d’une élégance exquises, mais d’une fragilité effrayante et ce qu’il y a de moins pratique à mon avis.
Les verroteries si charmantes à regarder sont de vrais nids à poussière; et quel ennui quand il faut nettoyer ces girandoles que le plumeau peut briser, ces consoles qu’un coup de balai peut fendre et que devant ces débris votre domestique vous réponde comme cette femme de chambre qui venait de casser un vase de prix: «Dame, c’est comme ça que ça s’use!».
Je n’achèterai pas davantage camées et coraux napolitains, ils sont toujours les mêmes et voilà longtemps qu’on en est rabattu. Comme bijou, c’est tout à fait vieux jeu.
J’achèterais plus volontiers une sculpture, les belles statuettes, les jolis groupes, les charmants enfants; comme ils sont gracieux et souriants, les formes sont peut-être un peu efféminées, les contours un peu mous, le ciseau qui les a taillés a sans doute au point de vue de l’art strict, plus de douceur que de force, mais qu’importe, ce qui me plaît me paraît toujours bien fait, et je ne suis pas la seule. Voilà un ravissant marmot qui a séduit bien des gens, je n’en veux pour preuve que le long ruban enroulé autour de son cou et qui porte le nom des cent cinquante-trois personnes qui jusqu’ici en ont demandé une reproduction.
On retrouve encore l’Italie dans les quatre maisons qui figurent à l’Histoire de l’Habitation, maison étrusque et maison pélasge qui servent de bars; la maison pompéienne qui vend des reproductions très fidèles des objets retrouvés à Pompéi, et enfin la maison Renaissance où l’on a établi un four et où l’on fabrique des perles et des verroteries de Venise. Pour cinquante centimes, chacun peut emporter un souvenir, ou l’objet fabriqué devant lui.
Dimanche 20 Octobre 1889.
Grand’messe à Ste-Clotilde.
La grande pantomime de Skobeleff
et le lion cavalier.
Vilaine journée grise et humide à rester chez soi, ou à s’enfermer ailleurs; à l’église le matin, au cirque l’après-midi, c’est ce que nous avons fait.
L’église Sainte-Clotilde est une construction toute moderne, dans le style ogival du XIVe siècle. La façade est très belle avec ses trois portails à frontons aigus et ses deux hautes tours. L’intérieur est des plus élégants: peintures, sculptures, riche maître-autel, stalles ornées de pierreries; tout cela est dû au ciseau, au burin, à la palette d’artistes en renom.
Les pompes du catholicisme sont toujours belles et touchantes, respect des choses saintes, dignité des officiants, chants suaves de la maîtrise, harmonie puissante et religieuse des orgues, tout cela vous arrache aux réalités de l’existence, et pendant cette heure bénie, l’âme toute rayonnante d’amour et d’espérance soulève sans effroi les voiles mystérieux de l’au-delà.
La grande pantomime de Skobeleff intéresse vivement par sa couleur locale, par le caractère altier de ces personnages en grand costume et dont l’ensemble est imposant. Skobeleff, ce guerrier des temps modernes est déjà un héros légendaire.
Tous les peuples ont des penchants romanesques et ne peuvent se représenter leurs favoris qu’à travers la légende qui est le prisme enchanteur de l’histoire.
Bien des envieux disaient que Skobeleff ne devait qu’à la protection sa carrière phénoménale: en dix-sept ans il était devenu, de simple porte-enseigne, général en chef.
Non, il le devait à sa bravoure et à ses qualités guerrières, aux circonstances qui l’ont toujours servi. Sans vouloir raconter son histoire, voici un épisode qui en est une nouvelle preuve.
Skobeleff a servi longtemps sous les ordres du général Kaufmann, le gouverneur général bien connu du Turkestan. Dans l’origine, il ne jouissait ni de son affection, ni de sa protection. A une expédition contre les Boukhares, Skobeleff commandait l’avant-garde. Il avait l’ordre de garder l’expectative jusqu’à l’approche des forces principales commandées par Kaufmann lui-même. Mais en se voyant en face d’un ennemi quinze fois plus fort que lui, et son petit détachement pouvant être facilement cerné par la cavalerie ennemie, Skobeleff ne put se conformer à ses instructions et se vit obligé, après une reconnaissance faite pendant la nuit, d’attaquer les Boukhares, qu’il mit en fuite après leur avoir fait subir des pertes énormes.
Le messager envoyé au général Kaufmann rapporta l’ordre de laisser le champ de bataille intact jusqu’à l’arrivée du commandant en chef. Celui-ci ne tarda pas à paraître. Il se rendit droit au champ de bataille et contrôla le rapport de son subordonné. Il ne lui fut pas difficile de constater la véracité absolue de celui-ci. Alors, en présence des troupes, il tendit la main à Skobeleff et lui dit: «Colonel, je ne vous ai jamais aimé, je ne vous aime pas et je ne vous aimerai jamais, mais vous êtes un brave et je vous utiliserai». Et Kaufmann tint parole.
Le lion cavalier est vraiment fort extraordinaire, et l’on se demande lequel admirer le plus: de ce lion en liberté qui galope sur un cheval ou du cheval qui se laisse monter par un lion.—Pour moi, la palme est à celui qu’on ne voit pas, c’est-à-dire au dompteur. Quelle dose de patience et d’habileté il a fallu pour arriver à un pareil résultat.
Un grand chien l’air tranquille et rassuré court à côté du cheval et gambade autour de la piste; tous trois, le chien, le cheval et le lion semblent les meilleurs amis du monde.
Les clowns sont très amusants, les équilibristes d’une force rare; l’un marche au plafond la tête en bas, un autre, en vélocipède, dévale à toute vitesse un escalier. On applaudit, mais le grand succès est celui du lion, le roi des animaux l’emporte aujourd’hui sur celui de la création.
Une séance de tableaux vivants termine dans un calme agréable ce spectacle parfois un peu trop émotionnant.
Lundi 21 Octobre 1889.
L’EXPOSITION
San-Marino.—Monaco.—La Serbie.—La Roumanie.—Grand-duché de
Luxembourg.
San-Marino
San-Marino, avec ses soixante-deux kilomètres de superficie et ses huit mille habitants, doit son origine à un tailleur de pierre dalmate nommé Marin; au VIe siècle, celui-ci se retira dans cet endroit désert et bâtit un petit ermitage pour prier et servir Dieu loin du monde. Sa réputation de sainteté appela bientôt, autour de lui, un grand nombre de fidèles et l’ermitage devint une ville. De tous temps l’indépendance des habitants a été respectée, sauf par César Borgia qui leur imposa un gouverneur et Alberoni qui envahit leur territoire en 1739. Il fallut céder à la force, mais leur soumission ne fut que passagère.
En 1797, Bonaparte leur offrit d’agrandir leur minuscule état; ils refusèrent, ne demandant qu’une chose, c’est qu’on les laissât tranquilles possesseurs de ce qu’ils avaient depuis quinze cents ans. Enclavés dans l’Italie, ils ont trouvé, jusqu’ici, le moyen d’éviter toute annexion. La république aristocratique (elle tient beaucoup à cet adjectif) de San-Marino a donc voulu, elle aussi, prendre part dans le bon combat de la paix et de l’industrie. Elle s’annonce par une façade monumentale ornée de son blason: d’azur aux trois monts de sinople supportant trois tours d’argent couronnées de panaches de même; des armes superbes, on en conviendra. Une ville qui se trouve bâtie à 738 mètres d’altitude peut bien mettre quelques monts dans ses armoiries. Son passé est représenté par des armes anciennes, des mosaïques du IIIe siècle et de vieilles tapisseries; le présent par une reproduction en relief de San-Marino et des environs—ce travail est très remarquable—et par une très belle cheminée sculptée. La sculpture est l’industrie nationale de San-Marino; il y a des familles entières où l’on manie le ciseau de père en fils depuis 1500 ans.
Parmi les produits du sol, les racines d’iris tiennent une grande place; c’est au mont Titan qu’on cueille en abondance ces racines odorantes qui parfument le linge d’une si douce senteur.
La principauté de Monaco peut marcher de pair avec la minuscule république de San-Marino quant à la grandeur de son territoire et au nombre de ses habitants.
Monaco, cette terre bénie qui garde un reflet du paradis terrestre, Monaco, cette perle de la Côte d’azur, au dire de ses admirateurs, Monaco s’est bâti un très élégant pavillon dans le style italien avec peintures extérieures blanches et rouges qui rayonnent au soleil, cet ensemble est des plus riants; des palmiers, des grenadiers, des orangers, des aloès, toute la flore du midi complètent l’illusion. L’intérieur offre des spécimens fort remarquables de poteries monégastes.
C’est aussi le palais des parfums, les fleurs les plus embaumées sont ici chez elles sous la forme d’essences délicates et de senteurs exquises; les poteries monégastes sont aussi très remarquables, mais le clou, c’est l’exposition particulière du prince héréditaire de Monaco. Le Prince Albert est un savant, c’est lui qui a su fixer la route parcourue par le gulf-stream, et un explorateur des plus distingués. Sa collection comprend des plantes sous-marines qu’il est allé lui-même cueillir dans l’abîme; des poissons extraordinaires, des crevettes d’un mètre de long par exemple, et enfin tous les engins qui ont servi à faire ses recherches au fond des mers. Les naturalistes doivent être ici dans leur élément.
La Serbie.
La construction serbe est de style serbo-byzantin, le plus parfait, le marbre et les mosaïques lui donnent un aspect excessivement riche, mais ce qu’il y a de plus curieux et de tout à fait particulier, c’est que cette architecture, celle de l’ancienne Serbie ne se retrouve plus et que nous voyons ici ce qu’on ne pourrait voir dans le pays même, l’occupation turque ayant détruit jadis tous les beaux monuments de ce genre. La Serbie expose beaucoup d’étoffes, des tapis superbes et bon marché, des broderies genre turc et des objets en filigrane d’un cachet spécial.
La Serbie expose encore beaucoup de prunes sèches (elle en fait un grand commerce et les expédie jusqu’en Amérique), puis, à côté de ses prunes sèches et pour qu’elles ne s’arrêtent pas dans le gosier, des bières excellentes très appréciées dans toute la région du bas Danube.
La Roumanie, comme les autres pays en général, présente une construction gardant très fidèlement, dit-on, le type national.
On a tenu à reproduire le même caractère à l’intérieur. La façade, les portes, les pavillons latéraux, les vitrines même, sont copiés sur des motifs empruntés aux églises de la Roumanie. La plus grande de ces vitrines, celle du centre, est une reproduction du dôme de la fameuse cathédrale d’Ardgesch.
Comme dans tous les pays semi-orientaux, les broderies prennent une grande place. Ces broderies de toute beauté sont faites à la main par des ouvrières souvent mal outillées, sans modèle, n’ayant à leur disposition que des métiers fort défectueux.
Parmi ces broderies, il faut citer celles de Madame de Lucesco, qui lui ont pris sept années de travail; il est bon d’ajouter qu’elle a tout fait, même tissé l’étoffe sur laquelle elle a brodé.
Du reste, les tapis et les étoffes sont aussi des œuvres féminines qui défient le temps, ces étoffes-là sont d’une solidité à user plusieurs générations. Ceux qui les achètent n’en voient pas la fin, ce sont elles qui voient passer les familles.
Les costumes roumains qui sont semblables à ceux que portaient leurs ancêtres font très bon effet, c’est autrement joli pour les hommes et les femmes que la mode actuelle qui, chez nous, a étendu son monotone et égalitaire niveau sur presque toutes nos provinces. Le costume national a vécu en France et s’en est allé comme tant de bonnes choses... du bon vieux temps. Là-bas, il n’en est pas ainsi et la reine elle-même tient beaucoup à voir conserver dans ses états le costume national et si pittoresque de la Roumanie. La Roumanie expose encore des armes perfectionnées et des objets de céramique à côté d’un obélisque de sel, l’une des richesses du sol roumain. Il produit encore des bois magnifiques, et j’ai admiré une rondelle de noyer de deux mètres de diamètre.
Je termine par l’exposition de confiserie bien alléchante, j’en réponds, de Monsieur Capsa qui s’intitule élève de Boissier, c’est de la modestie, il aurait pu mettre émule. Voilà qui est très bien, cela prouve que les Roumains aiment la France.
Le chalet-restaurant roumain dans le prolongement de la rue du Caire est plein de couleur locale, c’est la vraie maison de campagne de ce pays-là, avec son pignon, sa tour et son toit saillant. On y entend des tziganes roumains, des vrais, beaucoup plus purs que les tziganes hongrois, un peu mélangés par les voyages. On est servi par des roumaines authentiques dans leurs costumes pittoresques et comme elles ne savent pas un mot de français, on voit bien qu’elles ne sont pas nées à Nanterre ou dans le faubourg de Montmartre. La cuisine est à l’avenant. On dit que la fleica, beefteak et les frigarui, filets de bœuf sont excellents ainsi que la tzuica, eau-de-vie de prunes et de tamaïosa, sorte de vin muscat. Il y a encore bien d’autres mets indigènes; c’est ici l’exotisme culinaire en pleine floraison. Nous terminons notre promenade à travers l’Europe par le Grand-Duché de Luxembourg qui est fort petit, ce qui ne l’empêche pas de tenir ferme son drapeau dans la voie du progrès: chartres anciennes, parchemins authentiques, médailles précieuses racontent l’histoire de son passé.
Des plans, des cartes, beaucoup de dessins modernes nous parlent de son présent et les nombreux échantillons de ses productions industrielles nous montrent les progrès accomplis depuis cent ans par ce vaillant petit pays qui pourrait prendre pour devise: En avant!
Mardi 22 Octobre 1889.
Entrées payantes ce jour à l’Exposition: 123.284
La Chine et le Japon.—La Perse.
Le Siam.—Le Maroc.
L’Egypte et la Rue du Caire.
Nous avons parcouru l’Europe, visitons aujourd’hui quelques pays de l’Asie et de l’Afrique. Demain nous nous occuperons des possessions françaises. Après cela l’Amérique et l’Océanie auront leur tour.
Chine et Japon.
Sauf le thé qui étale ses nombreuses espèces dans des sacs de différentes tailles, le pavillon du Céleste-Empire n’est encombré que d’objets artistiques: broderies étincelantes, vrais chefs-d’œuvre de souplesse et de moëlleux. Pour obtenir cette souplesse étonnante, le procédé est bien simple, ces belles soies sont battues longtemps avec de lourds marteaux avant d’être envoyées à la teinture. Puis viennent les sculptures sur ivoire d’une finesse exquise, les incrustations superbes de nacre et d’ivoire sur bois dur, sandal, ébène, etc., les peintures capricieuses et fantaisistes au suprême degré. Tous ces trésors sont accompagnés d’une armée de bibelots hors ligne comme originalité et exécution. Il n’y a que les Chinois pour réussir de semblables merveilles de patience et d’art. Quant à leur exposition de porcelaines, c’est un éblouissement.
Le Japon a fait les choses plus magnifiquement que la Chine. Il a dépensé six cent cinquante mille francs à s’organiser et il a envoyé en chiffre exact cinq cent quatre-vingt-seize exposants.
Tous les matériaux de ses constructions sont venus directement du Japon, ici ce n’est donc pas une imitation même parfaite, c’est la réalité: toitures, bois, pierres, portes, panneaux, cadres, laques, tout cela a été préparé dans le pays et mis en place par des ouvriers japonais. La porte d’entrée qui date du XVIme siècle, en bois sculpté, de Klyaki, est un chef-d’œuvre. Son exposition de porcelaines, de meubles incrustés, de cloisonnés, de bronzes incomparables est un rêve. C’est pour les yeux le régal suprême que viennent savourer les friands de japonisme quintessencié. Oui, tous ces vendeurs japonais et chinois sont bien authentiques, avec leurs robes à grands ramages, leur teint jaune, leurs yeux obliques et leur longue natte de cheveux qui pend comme un cordon de sonnette. On a une envie folle de tirer dessus quand ils ne répondent pas de suite à votre appel.
La Perse.
La Perse a sa mosquée des plus élégantes où s’étalent, à côté des produits naturels du pays, des sabres effrayants, des tapis d’un moëlleux et d’un coloris remarquables, des châles d’une telle finesse que pliés ils passeraient dans le cercle d’un bracelet. Puis, à côté de ces produits modernes, des objets anciens, vieilles étoffes, vieilles faïences, vieux cuivres, aussi beaux que curieux.
Je regrette seulement que le Shah n’ait pas laissé quelques unes de ses tiares qui ont tant ébloui les Parisiens pendant son séjour. L’exposition eut été complète.
Le Siam.
Le Pavillon du Siam encombré de mille choses est construit dans le style le plus pur du pays. Le roi seul a fait tous les frais de cette exposition. Il a envoyé des palanquins, des instruments de musique profane et sacrée, des vêtements de soie couverts de broderies d’or et d’argent, des défenses d’éléphants, des fleurs conservées, des bois merveilleusement sculptés. Tout cela nous initie à des mœurs bien différentes des nôtres et à des travaux que nos artistes ignorent.
A propos de Siam, voici les noms et prénoms du souverain de ce royaume:
Pra-Bat-Samdath-Pra-Paramadis-Maha-Tschulas-Loucorn-Pra-Tschula-Tchau-Reao-Tchau-Yu-Hua!
Il paraît que, là-bas, cela se prononce sans respirer[10].
Le Maroc
Le Maroc nous présente avec son pavillon impérial une tente marocaine, un grand bazar et un café-restaurant. L’architecture marocaine ou plutôt celle des Maures d’Espagne se retrouve là moins pure cependant que dans l’Alcazar et la Merquitta de Cordoue qui restent le type de la perfection, mais c’est toujours une profusion de colonnes d’ouvertures ogivales, de nefs surbaissées et de cintres rétrécis à la base en forme de croissant.
Le pavillon impérial est rempli de belles choses qui ne sont point à vendre; heureusement que le grand bazar est là pour satisfaire l’envie des visiteurs qui retrouvent à peu près les mêmes objets: armes damasquinées, plats de cuivre ciselés, étoffes de laine et de soie, sparterie en écorce, en paille, en jonc, en feuilles; broderies d’or et d’argent, et enfin des maroquins bien authentiques du pays même où le maroquin a pris naissance, d’où son nom. On voit ici en exemplaires de premier choix tout ce que comporte l’industrie des pays orientaux.
Le restaurant vous sert sa cuisine et sa musique marocaines, ce n’est ni très bon à manger ni très agréable à entendre, mais on retrouve là une saveur toute particulière, celle de la couleur locale au plus haut degré.
L’Egypte et la rue du Caire
Cette pittoresque rue, comme il s’en trouvait tant autrefois dans la vieille ville égyptienne, cette rue qui apporte à Paris en plein XIXe siècle un spécimen de l’art arabe des khalifes est tout ce qu’on peut voir de plus curieux et de plus intéressant. A elle seule, elle personnifie pour moi toute l’Egypte. Ses nombreux bazars sont remplis de tous les produits orientaux les plus connus, tapis, étoffes voyantes, bibelots de toutes sortes et bijoux assez remarquables en filigrane.
On voit donc dans cette rue unique, beaucoup de boutiques, beaucoup de marchands, beaucoup de promeneurs et les plus drôles sont ceux qui circulent sur de petits ânes conduits par des guides indigènes.
Tout cet ensemble forme un spectacle qui vaut bien la peine d’être regardé.
C’est à Monsieur Delort de Gléon, premier député de la nation française au Caire que revient l’honneur de cette création saisissante au plus haut point. Son but était de donner à Paris un spécimen de l’art arabe des khalifes, si élégant et si différent de l’art brutal de l’Algérie et de la Tunisie et aussi de l’art surchargé d’ornements et de dentelles que les Maures ont importé en Espagne; il fallait surtout être sincère et faire vrai.
C’est le problème qui a été résolu, les murs ont l’aspect brut des crépissages du Caire, toutes les boiseries sont authentiques et proviennent des anciennes maisons des siècles passés. Les Moucharabiés, ces ingénieux grillages en bois qui s’avancent en balcon sur la rue, permettant aux femmes de voir sans être vues, ont été collectionnés dans les quartiers démolis; les portes ont de 200 à 300 ans.
«La rue du Caire du Champ de Mars n’est donc point tout à fait une restitution exacte des rues actuelles; il n’y a plus au Caire, ni dans aucune autre ville égyptienne, de rues qui soient aussi vierges de toute construction moderne; la pluie, les tremblements de terre, le temps surtout ont eu raison des anciennes maisons. Quand on parcourt un vieux quartier du Caire, on trouve la plupart des façades éboulées et raccommodées tant bien que mal. Si le quartier est commerçant, elles sont rebâties à la franque, c’est-à-dire dans le plus mauvais goût.
Ici, nous avons une rue ancienne absolument complète, ayant conservé tout son caractère. La monotonie des maisons est rompue par des motifs d’architecture: deux mosquées, une école qui sert de commissariat, un minaret, trois portes. Comme je l’ai dit plus haut, ces portes sont authentiques et datent des XVe, XVIe et XVIIe siècles. Quant au Minaret, c’est une reproduction d’une parfaite exactitude, car il eut été impossible de transporter un Minaret authentique du Caire à Paris, celui-ci est le frère cadet du célèbre Minaret de Kaïd-Bey.
La maison située à côté et qui sert de café est du XVIIIe siècle. Le Louis XV arabe, c’est bien moins élégant que le Henri II du minaret. L’influence turque s’est fait sentir, mais l’exactitude commandait le mélange des styles tel qu’il existe réellement.
Tous les ornements plaqués sur les murailles: les crocodiles, les sphinx, les enseignes, ont été apportés d’Egypte, de même que les faïences anciennes. Ces faïences, arrachées du cylindre d’une coupole et que l’indolence orientale n’a pas eu le courage de replacer, ont été recueillies et utilisées. C’est presque un musée de céramique égyptienne.
Comme population, on a fait venir cent soixante Arabes, pas des Arabes des Batignoles, des vrais Arabes, arrivés avec les matériaux égyptiens. Ils parlent fort peu français, mais c’est leur affaire, leur baragouin ne fait que corser la couleur locale. Il faut qu’en entrant dans la rue du Caire, on soit bien au Caire et non pas dans une Egypte d’opéra-comique.
Ces habitants sont divisés en trois catégories: les ouvriers, les marchands et les âniers. Ouvriers orfèvres, tisserands, potiers, tourneurs, incrusteurs, ciseleurs, confiseurs, etc., marchands de bibelots, de soieries, de vieilles broderies... il y a même un fripier,—on a songé aux peintres, qui probablement, seront très heureux de se procurer des costumes véritables—un café avec musique arabe, des débitants de pâtisserie, de nougats et de confitures, de roatloukoum, retenez bien le mot pour avoir l’air de comprendre déjà la langue du pays.
Le seul moyen de transport qu’on connaisse au Caire, ce sont les ânes, de petits ânes blancs qui trottent comme des pur-sang. M. Delort en a fait venir cent, avec leurs âniers et tout le personnel d’ouvriers qui en découle, tondeurs, maréchaux-ferrants, selliers, bourreliers, etc... Ces ânes font le bonheur des enfants, car la promenade n’occasionne aucun danger, l’ânier ne quitte jamais la bête qu’il conduit, il court à côté d’elle, réglant son pas sur le sien et guettant sans cesse le cavalier novice: si celui-ci perd l’équilibre, le conducteur est là pour le recevoir dans ses bras.
Donc, pour le visiteur, l’illusion est complète; sur les portes, les marchands indigènes étalent leurs produits, les ouvriers travaillent, le forgeron bat le fer sur son enclume, le potier tourne avec le pied la roue qui fait mouvoir l’argile qu’il modèle sans autre outil que ses mains, le tisserand est attelé à son métier antique, qu’à aucun prix il n’a voulu changer depuis des siècles. Au fond du café, les guzlas, les tambourins et les tarboucks retentissent, du haut du minaret le muezzin appelle à la prière. Avec un peu de bonne volonté, on peut se figurer que derrière les moucharabiés, les femmes du sérail vous observent.»
Mercredi 23 Octobre 1889.
Possessions françaises
Nos colonies font honneur à la mère patrie. En première ligne l’Algérie et la Tunisie, la Cochinchine, l’Annam, le Tonkin, présentent chacune leur palais. Celui de l’Algérie avec son dôme, son minaret, ses décors de faïence franche et brillante, sa grande galerie ornée de vitraux est des plus séduisants; à l’intérieur, trois grandes salles représentent les trois départements d’Alger, d’Oran et de Constantine. Le jardin qui entoure le palais contient les plus belles plantes d’Algérie et quantité de bazars tenus par des indigènes. Tous les ouvriers sont là à l’ouvrage, travaillant chacun selon son métier; en voilà qui tournent, d’autres qui brodent, d’autres qui travaillent les métaux; voilà des bibelots de toute espèce et des bijoux sans fin; les colliers de sequins sont fort élégants.
Il y a foule dans la rue d’Alger, c’est un mouvement, un va-et-vient tout à fait réjouissant, distrayant. Les uns vont au café Maure pour prendre cet excellent café où l’on trouve tout à la fois à boire et à manger et pour voir les belles danseuses mauresques. Les autres vont à la maison Kabyle admirer les méharis pur sang, chameaux coureurs; ces vaisseaux (ship) du désert, suivant l’expression pittoresque des Anglais. Le désert lui-même n’a pas été oublié, une grande toile peinte nous donne l’illusion de ces espaces infinis, arides et désolés: au centre, jaillit un puits bouillonnant avec une oasis qui se détache agréablement sur le sable éternellement jaune et le ciel éternellement bleu.
Le palais tunisien a copié ses façades, dôme, véranda, mosquée sur les meilleurs modèles des Palais de Tunisie et de la cité sainte de Kérouan; tout cet ensemble est plein de caractère et de couleur. Sous notre ciel un peu terne rayonne l’orient lumineux. Voici un intérieur arabe qui semble très animé; ce ne sont cependant que des mannequins, hommes et femmes revêtus des riches costumes du pays.
Le souk ou bazar dans ses vingt-six boutiques offre un spécimen de toutes les industries de Tunis; ici le fabricant de chéchias, plus loin les brodeurs en or et argent, le bijoutier, le parfumeur, le barbier, le peintre sur poterie, le damasquineur, le menuisier, le cafetier, le confiseur, le tourneur, le tisserand, le sculpteur d’arabesques, l’écrivain; ils sont là, travaillant sous de belles voûtes blanches, soutenues par des colonnes bariolées de rouge, couleur favorite de tout bon musulman. Ah! le beau tapis de Kérouan et les belles soies de Tunis, les beaux burnous de Djeriet et les belles couvertures de Djerba.
La Tunisie a, comme l’Algérie, des forêts de chênes-liège, des chênes, des eucalyptus et des dattiers dont on compte deux cent cinquante variétés.
Nous voyons encore figurer ici le Sénégal, le Gabon, le Congo, l’île de la Réunion, Madagascar, Mayotte, les Comores, l’Inde française, Pondichéry, Chandernagor, Mahé, la Nouvelle-Calédonie, les îles du Pacifique, la Guyane française, le Cambodge; chaque peuple, chaque contrée a envoyé ses meilleurs produits, et l’on dit que les Français ne sont pas colonisateurs! Allons donc! toutes ces possessions prouvent le contraire. Nous avons un vaste empire colonial et c’est dans le palais central qu’on peut s’en rendre compte du haut des galeries surtout.—Voyage facile qu’on fait en s’accoudant aux balustrades.
Que d’admirables choses, dont l’énumération est impossible, dues à la nature d’abord, au travail patient, au génie inventif de l’homme. Je citerai cependant la pyramide des dieux soudiens, une pyramide de ces dieux Bouddha comme les gravures nous les représentent depuis des siècles et que l’Asie adore toujours, ils s’abritent sous un bouquet d’énormes bambous et cet ensemble frappe vivement par son étrangeté. Devant le palais central se trouve une jolie pièce d’eau avec son pont cintré tonkinois et ses sampans ou barques anamites, et maintenant parcourons les villages indigènes; voici les grandes cases Onolof de St-Louis, habitations des gens qui n’ont pas le moyen d’avoir des maisons. Les cases de bois coûtent de cinq à six cents francs et finissent généralement par un incendie; il y a des cases encore plus modestes, celles des pêcheurs de St-Louis, elles ne coûtent que deux cents francs, celles-là flambent un peu plus vite, voilà tout.
Mais en voilà bien d’autres, celles des Toucouleurs aux murailles et au mobilier en terre sèche.
Case bambara copiée aux environs de Batrel, case du Cayor, maison de chef Gourbi de Souls (pasteurs), habitation rudimentaire de nomades, tente de Maure Trarza, tente d’homme de qualité, enfin tente des captifs en vieille cotonnade bleue où vivent les esclaves des Maures.
Examinons le Bambal Soulouron, haut fourneau primitif des forgerons du Fouta-Djallon, pays riche en minerais. Le Sak ou grenier à miel et le poste du gardien du Lougan, espèce de mirador d’où le garde agite un épouvantail pour chasser les oiseaux qui viennent picoter les semailles.
Toutes ces choses qui nous révèlent des pays lointains, inconnus sont bien curieuses et très attachantes. Pendant quelques instants, on oublie les civilisations outrées de la vieille Europe pour ne voir que les primitifs auxiliaires des peuples à demi sauvages.
La tour de Saldé est un modèle remarquable des postes construits par le général Faidherbe au Sénégal.
Ce genre de forteresse est imprenable par un ennemi non muni de canon; c’est ainsi que la tour de Médine avec son commandant et 25 hommes a soutenu quatre mois le siège de vingt mille noirs. En vis-à-vis se trouve le Tata de Kedougou (Soudan français), la fortification des noirs, de là aussi ils défendent et tuent les blancs; toujours la guerre on la retrouve partout en permanence.
Donnons un coup d’œil au pavillon de Madagascar, à l’habitation malgache, et sans transition passons au restaurant anamite où Dieu merci on ne mange pas du poisson pourri, d’œufs couvés et des côtelettes de chien domestique.
Les théâtres anamites à coups de tam-tam appellent les spectateurs; j’aime autant me reposer dans les serres coloniales. Ah! les beaux palmiers, les énormes fougères, les incomparables orchidées! Décidément, c’est bien le pays du soleil que nous visitons. Quelle magie, quel rayonnement dans les couleurs. Je crois l’avoir déjà dit, n’est-ce pas charmant de voir sans cesse le Nord et le Midi se tenir par la main? Les quatre points cardinaux voisinent ensemble et fraternisent dans la plus touchante intimité.
Voilà le pavillon de la Guadeloupe avec son joli modèle d’usine à sucre et à rhum.
Ceci c’est une factorerie française du Gabon absolument exacte; cette case est celle d’un colon concessionnaire de la Guyane française, ces colons-là en général sont les forçats.
Nous nous arrêtons volontiers dans le village cochinchinois; mais nous traversons hâtivement le village canaque, ces indigènes-là, c’est comme le bloc enfariné de la Fontaine, ils ne nous disent rien qui vaille, les avons-nous vraiment corrigés de leur anthropophagie et ont-ils bien perdu l’habitude de festoyer d’un blanc? chassez le naturel...
Le palais de la Cochinchine est du plus pur style annamite c’est-à-dire d’architecture chinoise, le bois y joue un grand rôle. La Cochinchine possède d’immenses forêts de bois durs très résistant à l’humidité comme aux insectes; les charpenteries et menuiseries de ce palais authentique ont été exécutées à Saïgon par 300 ouvriers annamites et chinois.
La porte d’entrée supportée par 4 colonnes finement sculptées donne accès dans une cour intérieure, ornée de vases en porcelaine et de dragons en faïence. Cette cour est le complément obligé de toute demeure anamite; cela m’a rappelé l’atrium des maisons de Pompéï avec leur bassin comme ici.
Le palais de l’Annam et du Tonkin est construit sur une place carrée avec une cour centrale en partie occupée par un riche baldaquin abritant un magnifique Bouddha, celui d’Hanoï, une œuvre capitale de fondeurs indo-chinois.
Ce palais est très remarquable, beau bois sculpté, faïences, peintures l’embellissent à l’envie, ainsi que deux grandes terrasses décorées d’écran à jour de balustres de vases contenant des arbustes rares. Ces terrasses font partie des riches maisons tonkinoises et font grand effet.
Ici, comme dans le palais de la Cochinchine on voit des bateaux, des armes, des instruments, des laques, des incrustations de nacre, des bronzes, des soieries, des nattes, des porcelaines, des statues, le bambou dans toutes ses applications industrielles, des meubles admirables, des coffrets, des cercueils; ce meuble essentiel dont personne ne peut se passer et que les fils en signe d’affection s’empressent d’offrir à leurs parents. Les Annamites sont d’industrieux ouvriers, mais mon Dieu qu’ils sont donc laids avec leur petite taille, leur face glabre, leurs dents noircies et rongées par le bétel et leur posture accroupie, c’est leur manière de s’asseoir—pas élégante il faut en convenir.
L’exposition cambodgienne a rassemblé ses envois dans la fameuse pagode d’Angkor-Wât, le nom de pagode d’Angkor-Wât n’est pas juste en ce sens que l’étrange construction que nous avons-là sous les yeux n’est qu’une des portes d’angle de ce temple fameux extraordinaire, un des monuments les mieux conservés de ceux laissés par les Khmers ce grand peuple disparu d’où les Cambodgiens prétendent descendre.
La région d’Angkor renferme des constructions absolument merveilleuses, des ruines respectées des âges et découvertes au XVIe siècle par des missionnaires français.
Qu’étaient les Khmers? ce peuple d’une haute culture intellectuelle, ces incomparables architectes dont quelques monuments remontent au IIIe ou IIe siècle avant J.-C.?
Bien des civilisations et vingt races ont disparu depuis et l’esprit se suspend en point d’interrogation devant cette architecture d’une beauté inouîe et d’un luxe extravagant.
Le véritable sanctuaire d’Angkor-Wât occupait une surface de près de 6000 mètres. Le fossé qui l’entourait avait 200 mètres de largeur et le rectangle qu’il englobait ne mesurait pas moins de 827 mètres de largeur, la tour centrale avait 80 mètres. Voilà quel était ce monument unique—ce que nous voyons ici n’en est donc qu’un diminutif bien amoindri; le principal motif de sa façade est la tour partagée en nombreux étages simulant une accumulation de parasols, abritant la partie occupée par l’image de la divinité. Sur chaque face, des frontons formés d’un encadrement représentant un serpent à cent têtes, décorent les étages. Les 40 mètres de cette tour extraordinaire sont ornés de la sorte et n’ont rien de lourd ni d’inexact tout en rappelant un monument, qui, reconstitué tel qu’il était dans les temps anciens, couvrirait à lui seul le champ de Mars tout entier sans souffrir de l’écrasant voisinage de la colonne Eiffel.
Le visiteur n’a pas le temps de philosopher et de méditer sur ce passé plein de grandeur.
D’autres merveilles l’appellent encore et il marche, marche toujours comme Isaac Laquedem.
Jeudi 24 Octobre 1889.
Repos et Repas
Quand je dis repos, c’est une manière de parler. Oui, repos l’après-midi dans le salon de ma cousine, mais le matin j’ai joliment trotté à faire des commissions.
Ce n’est déjà pas amusant pour soi, mais pour les autres c’est tout ce qu’il y a de plus ennuyeux!
On craint de se tromper, de ne pas bien faire la chose, on se donne une peine infinie et l’on ne contente pas toujours cette clientèle improvisée.
«Vous allez à Paris, achetez-moi donc ceci, rapportez-moi cela». Comme vous seriez aimable si vous pouviez me rassortir cette étoffe, il m’en faut 3 mètres, je l’avais prise au Bon-Marché.
—Mais, chère amie, c’était l’hiver dernier, la pièce doit être épuisée depuis longtemps.
—Peut-être que non, informez-vous; vous me rendrez service.
«En passant au Louvre, prenez un béret pour mon petit garçon. Ils sont pour rien ces bérets et charmants, je les ai vus dans le catalogue.»
«Madame si j’osais... je vous chargerais aussi d’une commission, d’une seule.
—Laquelle?
—Permettez-moi de vous demander d’aller place Louvois chez M. Feuardent, le grand numismate, et de lui remettre la note suivante, il vous confiera quelques médailles que vous aurez la complaisance de me rapporter».
Ah! provinciaux mes amis, faites donc vous mêmes vos commissions. Plume en main, demandez ce qu’il vous faut, la poste et les catalogues ne sont pas faits pour les chiens, comme disait Voltaire en parlant des hôpitaux.—Servez-vous en et cessez de recourir à des personnes que vous embarrassez beaucoup et auxquelles vous prenez le plus bénévolement du monde leur temps et... leur argent. Sans doute vous les rembourserez au retour, mais c’est à Paris qu’on a besoin pour soi de son porte-monnaie et qu’il n’est pas agréable de le vider pour les autres.
Après ce préambule mettons-nous en route.
Je vais au Bon-Marché chercher la fameuse étoffe, j’avais un échantillon. Le commis me regarde avec des yeux tout ronds comme si j’étais un phénomène. «Ce lainage de fantaisie est de l’an dernier, c’est passé de mode.» Ce mot, il l’avait prononcé d’un ton de suprême dédain, on aurait dit que je lui demandais une étoffe du règne de Louis-Philippe, et je reprends timidement: Si vous vouliez avoir la complaisance de chercher quelque chose s’assortissant... Bien entendu on ne trouve rien, j’avais perdu une bonne demi-heure. En sortant, je me trouve face à face avec une ancienne amie devenue parisienne, nous causons.
«Ah! me dit-elle, vous faites des commissions pour les autres? grand bien vous fasse. Il y a belle lurette que je n’en fais plus pour personne.
—Et pourquoi, vous que j’ai connue si empressée?
—Pourquoi? je vais vous conter cela, vous pouvez bien me donner quelques instants, allons-nous asseoir dans le square du Bon-Marché.
«Au commencement de mon mariage, une mienne cousine bretonne bretonnante me pria d’aller au Printemps le jour de l’Exposition lui acheter un châle en dentelle espagnole article d’exposition offert à 50% de rabais, ce jour-là seulement. J’avais une visite à faire rue du Havre; je m’habille en conséquence enchantée de pouvoir faire en même temps visite et commission. J’entre au Printemps, c’était une cohue épouvantable, une bousculade indescriptible. C’est un flot humain qui vous porte et qu’il faut suivre. J’y entre bravement, j’achète la dentelle, après un quart d’heure de remous je parviens à m’esquiver. Je vais faire ma visite, la dame est chez elle; elle me complimente sur ma toilette, sur ma jolie broche. Je conviens qu’elle est aussi fort de mon goût et j’ajoute: J’ai le bracelet pareil, c’est ma parure de noce, et je tends mon bras droit pour le montrer—rien—je crois m’être trompée, je regarde mon bras gauche—rien! plus de bracelet!!! une cruelle inquiétude me traverse l’esprit. Je me lève nous inspectons le salon, le vestibule, l’escalier. Ou j’avais perdu mon bracelet, ou on me l’avait volé. Je retourne au Printemps, je cours au bureau des réclamations. On me répond: Madame vous venez de formuler la 43e réclamation de la journée, mouchoirs de poche, en-cas, porte-monnaie. Il y a même une dame qui a perdu son soulier et une autre son enfant...
—Et vous n’avez jamais retrouvé votre bracelet?
—Jamais! ce petit service où j’économisais six francs pour ma cousine m’a coûté cher; mon bracelet, perte sèche de 800 francs, 2 courses de voiture, plus une scène de mon mari furieux, suivie d’une bouderie de plusieurs jours.
—Voilà qui n’est pas encourageant, ai-je murmuré.
—Non, aussi personne, entendez-vous bien, fut-ce le grand Turc lui-même ou le Czar de toutes les Russies, personne ne me rattrapera à faire des commissions.»
Du Bon-Marché je me suis précipitée au Louvre pour chercher le béret, là ça marchera tout seul, pensai-je.
J’ai été reçue par de jeunes factrices, dédaigneuses, mises comme des gravures de mode, ces petites plébéiennes jouant à la grande Dame et se prenant au sérieux m’ont paru cocasses.
«Nous n’avons pas ce béret, et l’on m’a renvoyée à 2 ou 3 comptoirs.
—Je suis certaine que vous avez ce béret bleu marine dans vos catalogues.
«Il fallait le dire tout de suite, nous ne nous occupons pas ici des articles de province, écrivez pour le demander.
Hein! «écrivez pour le demander.» ce n’était donc pas la peine de me déranger pour venir le prendre.
Et puis allez donc raconter cela à la maman qui attend le béret, elle ne vous croira pas et se plaindra bien-haut que vous n’avez même pas voulu entrer au Louvre pour lui faire cette petite commission. Je vais à la Belle-Jardinière, au Pont-Neuf, à la Samaritaine, impossible de trouver un béret conforme à celui dont j’ai la description. J’ai déjà une heure et demie de voiture, il est bientôt 10 heures, je me fais conduire place Louvois et je congédie mon cocher, je prendrai l’omnibus pour revenir.
Place Louvois je monte au premier étage et je me trouve devant une porte hermétiquement close.
Je sonne, un grand flandrin de domestique vient m’ouvrir—«M. Feuardent?
—M. Feuardent n’est pas encore arrivé.
«Ah! il est cependant 10 heures.
—Oui, mais Monsieur ne vient généralement qu’après son déjeuner, vers 11 heures ½.
«Alors j’attendrai, et je fais un pas pour franchir la porte.
—Pardon, Madame, on n’entre pas.
—Comment, on ne peut pas attendre là dans ce vestibule?
—Personne ne peut entrer ici avant l’arrivée de mon maître, cette mesure a été prise à la suite d’une tentative de vol commise justement par un individu qui, pendant une demi-heure qu’il avait attendu M. Feuardent avait eu le temps de prendre l’empreinte de plusieurs serrures.»
Fallait-il attendre ou m’en retourner? j’hésitai un instant; revenir me prendrait encore plus de temps.
Je n’avais plus qu’à m’asseoir sur une marche de l’escalier ou à faire les cent pas dans la rue.
Je descends, en face de moi, rue Richelieu, je vois écrit en gros caractère: Bibliothèque Nationale.
Voilà mon affaire pensai-je aussitôt, je vais pouvoir lire pendant une heure et calmer mon impatience; plusieurs personnes entraient en ce moment je les suis et je m’engage avec elles dans un long corridor. Soudain j’entends une grosse voix qui crie: «Hé! là-bas, avez-vous votre carte? Je ne devine pas tout d’abord que cette demande s’adresse à moi et la grosse voix devenue plus rogue reprend: «Avez-vous votre carte, répondez-donc, Madame, c’est à vous que je parle.
—Je croyais qu’une bibliothèque nationale c’était comme un musée national et qu’on pouvait y entrer sans formalités.
—C’est ce qui vous trompe. Il faut une carte personnelle. Que diable, on doit se conformer aux règlements.
Je cours encore.—De guerre lasse, je suis allée m’asseoir dans le joli square Louvois où j’ai contemplé tout à mon aise la belle fontaine d’un goût si pur de Visconti. Les quatre figures en bronze qui l’ornent sont de Klagmann. Elles représentent la Seine, la Loire, la Saône et la Garonne. Tout en regardant mélancoliquement l’eau tomber je pensais que ce joli square si plein de calme, de verdure et de fraîcheur occupe l’emplacement de la salle d’opéra, où fut assassiné le duc de Berry, le 13 février 1820. Tout change et se transforme, seul le souvenir et l’espérance subsistent. Le Souvenir qui est le passé et l’Espérance qui est l’avenir.—C’est donc avec le Souvenir que se pétrit l’histoire.
A onze heures et demie je sonnais de nouveau chez M. Feuardent auquel je remettais la lettre de mon digne ami. Les médailles demandées obligeaient M. Feuardent à quelques recherches, les désirait-on en or ou en argent...? encore une question à laquelle je ne pouvais répondre qu’après avoir écrit au pays. Je vis avec effroi que les choses ici ne marcheraient ni plus vite, ni plus facilement[11].
Il était midi passé quand je suis sortie. Après l’angelus le mouvement des omnibus se ralentit. Entre midi et une heure les cochers dînent, c’est un moment de repos. Bref, je n’ai pu revenir que par l’omnibus d’une heure pour le déjeuner de midi.
Voilà qui est décidé je n’accepterai plus de commissions pour personne à moins de les faire comme le curé de mon village les faisait il y a 40 ans. A cette époque il fut obligé d’aller à Paris; il ne fit pas son testament avant de partir, comme cela se pratiquait au commencement du siècle alors qu’on mettait 8 jours pour aller de Nantes à Paris, mais enfin il songea à son voyage plus d’un mois à l’avance, en parla, et ses paroissiens, mis au courant de ses projets, arrivèrent en foule pour le charger de leurs petites commissions—des commissions ridicules.—Que répondre, comment refuser à ses chères ouailles de rapporter aux unes des aiguilles perfectionnées, des flanelles irrétrécissables; aux autres une lampe carcel dernier genre, un pot de la fameuse pommade du Lion qui ferait pousser des cheveux sur un caillou, une marmite otoclave qui cuit la soupe toute seule, etc., etc., et chacun d’ajouter: Je ne sais pas trop ce que cela coûte, je vous rembourserai au retour.—Le curé partit le porte-feuille plus bourré d’adresses que de billets de banque.
Deux personnes seulement avaient eu la délicatesse d’envelopper dans leur liste de commissions l’argent nécessaire pour les faire.
Le curé revient au bout de quelques jours; tous les intéressés se précipitent à la cure. Le pasteur a pris un air solennel. «Mes chers paroissiens, dit-il, je n’ai pu faire vos commissions sauf deux pourtant (les figures s’allongent), et j’en suis bien marri. Il faisait très chaud; en arrivant à l’hôtel, j’ai ouvert la fenêtre de ma chambre, devant cette fenêtre se trouvait une table, j’y ai posé, pour les classer, tous les petits papiers ou vous aviez inscrit vos commissions, un coup de vent a passé soudain et toutes vos feuilles légères se sont envolées par la fenêtre, sauf, comme je vous l’ai dit, celles qui contenaient de l’argent.»
La seconde partie de la journée a été plus agréable, le jeudi est donc le jour hebdomadaire où ma cousine reçoit des visites l’après-midi et le soir ses amis à dîner.
Causeries très animées—mais vraiment ces Parisiens m’amusent: Ils sont extrêmement fiers de leur Paris, extrêmement fiers de l’habiter et les ¾ le connaissent moins bien que les provinciaux.
L’ayant sans cesse sous la main ils pensent qu’ils auront le temps de le visiter quand ils voudront. Ils attendent les occasions qui ne viennent pas toujours, paraît-il. Les Parisiens ne sont donc pas curieux, moi qui les croyaient même badauds. J’ai connu jadis une dame qui refusa d’aller passer la Semaine Sainte à Rome, alors que les fêtes de Pâques avaient tant de solennité dans la capitale chrétienne, parce que c’était l’époque de sa grande lessive bi-annuelle, et qu’on dise après cela que les femmes sont frivoles et qu’elles ne savent pas s’occuper de leur maison. Cette dame est le modèle parfait de la femme de ménage et je la cite en exemple aux générations futures. Je connais à l’heure actuelle une autre dame qui a vécu 16 ans à Paris, deux expositions ont eu lieu pendant ce laps de temps. Et elle n’a même pas pris la peine d’y aller.—Et qu’on dise après cela que les femmes sont curieuses! On me demande mes impressions, on me questionne aimablement: Vous avez été à Montmartre? Oui: Vous avez visité l’hôtel de Ville? Oui: Vous vous êtes promenée dans les catacombes? Certainement et permettez que je vous le dise, il y a vraiment des gens qui ne sont pas dignes d’habiter Paris, puisqu’ils ne cherchent même pas à le connaître.
Ah! mais je compte bien quelque jour visiter l’Hôtel de Ville et l’église du Sacré-Cœur, quand elle sera plus avancée, quant à visiter les catacombes, j’en serais bien fâchée.
—C’est une des curiosités de votre capitale.
—Je le sais, mais si l’on pensait souvent à ce qu’il y a sous Paris on ne vivrait plus tranquille dessus.
—C’est un sol machiné.
—Oui à croire qu’il va s’effondrer—on ne marche que sur des abîmes, écoutez cela: Il y a donc d’abord les catacombes, excavations, immenses de plus de mille hectares, puis les égouts dont les principaux sont larges comme des rivières—les conduits d’eau propre qui alimentent les fontaines—les tuyaux du gaz, les fils du télégraphe et ceux du téléphone, les tubes pour les lettres. Maintenant on songe à creuser la voie des câbles électriques qui doivent fournir la lumière. Le gaz devient rococo et l’électricité s’apprête à user envers lui des procédés qu’il eut jadis pour l’huile.
—Vous discertez éloquemment..., et mon interlocutrice a continué d’un air sérieux et d’un ton grave:
—Je me demande ce que Paris deviendrait entre tous ces fluides, si ceux du ciel attirés par leurs semblables de la terre, essayaient de les rejoindre! Voyez-vous des nuages pleins de foudre crevant sur la grande ville, et atteignant ses foyers d’électricités! quelle commotion, quel cataclysme! et j’ajouterai que les électriciens, si sûrs cependant de leurs succès, n’aiment pas qu’on les questionne là-dessus. Est-ce que cela ne vous effraie pas, moi j’ai froid jusqu’au fond des moëlles.
—Je prends les choses moins au tragique, ai-je répondu, et je dois même vous prévenir que votre beau discours n’aurait rien changé à mes projets.»
Vendredi 25 Octobre 1889.
Le Mexique, la République Argentine, le Brésil, le Nicaragua, le Guatemala.—Républiques de l’Equateur, Dominicaine, du Salvador, la Bolivie, le royaume d’Hawaï.
Le petit chemin de fer Decauville qui parcourt environ une lieue de l’Esplanade des Invalides au palais des Machines est peut-être actuellement la ligne la plus fréquentée du monde entier puisqu’il transporte toute la journée dix mille voyageurs par heure.
Je commence à me reconnaître à l’Exposition et à en comprendre l’organisation. Le ticket donne certainement le droit d’entrer, mais il faut quand même avoir souvent la main à la poche pour pouvoir circuler partout. On paie pour voir l’Exposition des aquarellistes, celle des pastellistes, celle du globe terrestre. On paie pour voir le Pavillon de la mer, le panorama du Tout-Paris, l’exposition de la Compagnie Transatlantique, etc., etc.; enfin l’ascension complète de la fameuse tour coûte au minimum 5 francs chaque fois.
Ajoutons que lorsqu’on est fatigué les pousse-pousse tentateurs vous prennent encore quelques francs, les théâtres et les restaurants aussi... et les souvenirs donc! On augmente chaque jour sa liste d’acquisitions.
Il ne faut pas oublier la famille, les amis, les serviteurs, tous ceux qui n’ont pu visiter cette grande exhibition universelle.
Je rapporte un stock de tours Eiffel sous toutes les formes.
On croirait que l’on doit trouver sous la main tous les moyens de réfection et qu’on ne doit manquer de rien, pas du tout les restaurants exotiques, les bouillons Duval, les comptoirs de dégustation, de pâtisserie, les bars, les brasseries, les cafés etc., sont assiégés il faut attendre et pour cela s’armer d’une robuste patience.
L’Exposition est vraiment une ville unique ayant des bureaux pour la poste, le télégraphe, le téléphone. Un service médical avec salle de secours pour les blessés et les indisposés; des cabinets de toilette et autres. Des salons de lecture et correspondance, des bureaux de change pour l’argent, des bureaux de police pour les réclamations, des bureaux de tabac, et le bureau des interprètes parlant toutes les langues.
Le Mexique
Le Mexique aussi a fait grandement les choses. Il s’est construit un magnifique palais dans le style ancien du pays, avant sa découverte par les Européens; le palais est l’un des plus beaux. Au centre de cette construction, reluit le Temple du Soleil, symbole des croyances primitives. Produits naturels et industriels se groupent autour de l’astre Roi on pourrait même dire de l’astre dieu. Si l’on me demandait ce qui m’a frappée dans l’exposition mexicaine, je répondrais sans hésiter, les chapeaux masculins—Ah! quels monuments et comme ils doivent être lourds à porter—rien que de les voir me donne mal à la tête. Ces chapeaux très ornés, très artistement faits, coûtent fort cher. Si j’avais eu 150 francs à perdre, j’aurais acheté un de ces chapeaux là pour l’offrir au musée de ma ville natale. Dans le pays, c’est bien une autre affaire cela devient un luxe insensé. Certains Mexicains ont leurs chapeaux garnis de pierres précieuses, de diamants. C’est toute une fortune que ce couvre-chef, l’adroit filou qui parviendrait à le dérober sans être pris pourrait ensuite vivre de ses rentes. Voilà des chapeaux bien tentants mais il paraît qu’au Mexique les indigènes sont tentés par tout ce qu’ils voient. L’Evangile dit tout homme est né menteur et voleur, ce dernier qualificatif convient surtout aux Mexicains. On est obligé dans les églises d’enchaîner aux marches de l’autel la sonnette dont se sert le choriste qui répond la messe, sans cela il l’emporterait... par mégarde.
Au repas, que donnait jadis l’infortuné empereur Maximilien, l’argenterie subissait un rude assaut. Au moment où les convives se levaient de table les serviteurs rejetaient promptement les pans de la nappe sur le couvert qui se trouvait ainsi caché autrement les invités eussent glissé l’argenterie dans leurs poches... par distraction.
Honneur aux deux palais de La République Argentine et du Brésil, celui-ci avec sa tour de dix mètres, ses galeries, sa terrasse, son jardin et sa serre vous retient longtemps. La serre est ornée de merveilleuses fleurs toujours épanouies, et le jardin renferme un échantillon des arbustes et des plantes remarquables du Brésil. On y rencontre les orchidées les plus rares et les plus extraordinaires; il y a là pour quatre cent mille francs de fleurs et de plantes valeur marchande.
Le bassin dont l’eau est chauffée à trente degrés de chaleur contient la Victoria regia de l’Amazone. Cette magnifique plante atteint des proportions incroyables. Elle peut facilement porter un petit enfant sur une seule de ses larges feuilles blanches auxquelles les indigènes donnent le nom de «Bancs des Uanapés», et à propos de l’Amazone une mention à son palais remarquable, aussi avec ses urnes et ses vases anciens dignes représentants de l’art primitif, des potiers de l’Amazone, c’est-à-dire de l’Ile de Marajo, une île grande comme le Portugal et qui se trouve à l’embouchure de ce fleuve gigantesque.
Le palais de la République Argentine, avec ses cinq coupoles, sa large galerie promenoir du premier étage coûte modestement un million deux cent mille francs! C’est dire le luxe qu’on y a déployé. Il est tout en fer et fonte, et construit de manière à pouvoir être remonté à Buenos-Ayres. Un grand soleil couronne cet édifice majestueux. On l’aperçoit de très loin.
Est-ce comme république, comme civilisation, ou comme richesse que ce pays se compare au soleil? That is the question. «En tout cas c’est une république qui fait les choses princièrement.»
L’intérieur du palais est orné d’un millier de cabochons de verre qui s’illuminent à la lumière électrique et lui donnent un aspect positivement féerique. Son exposition se compose principalement de produits naturels comme nous en avons déjà vu beaucoup et auxquels nous n’avons jeté qu’un coup d’œil en passant.
Nicaragua
Le Nicaragua se distingue par ses productions naturelles. Il nous présente particulièrement des collections de plantes rares et d’oiseaux superbes. Ah! ces oiseaux des tropiques, de quel merveilleux plumage ils sont vêtus; que de grâce dans leur délicate structure, quel éclat dans leur étincelant coloris, c’est à se demander si ce sont des oiseaux ou des papillons. Leur plumage a le châtoiement des pierres précieuses et quelle variété depuis le colibri, un saphir volant jusqu’au quetzal dont le plumage dépasse en beauté celui de l’oiseau de paradis.
Charmant, le pavillon du Guatémala; le rez-de-chaussée renferme une collection très complète d’oiseaux et d’insectes du pays. Cette collection appartient à un Français. Au 1er étage, une grande peinture panoramique représente des animaux qu’on ne serait pas rassuré de rencontrer,—serpents, tigres, chacals, tapirs sont plus agréables à voir en image qu’en réalité.
Le pavillon de la république de l’Equateur ne se rencontrerait pas partout aujourd’hui. C’est la reproduction aussi fidèle que possible de l’un des temples que les Incas consacraient au Soleil. Le mobilier d’une grande richesse, cristal et or, se détache sur des tentures pourpre d’un grand effet. Dans son exposition figurent principalement «les industries extractives» telles que celle du café, du sucre, du coton, des plantes médicinales: quinquina, cochenille, ivoire végétal ou noix de Corozo, cristal de roche; puis enfin des tissus de laine, de fil et de coton, des broderies et des dentelles.
La petite république Dominicaine brille aussi par ses produits naturels, ses bois des îles et ses minerais, son café, son cacao, son sucre, son tabac et sa cire, puis elle présente quelques produits fabriqués, tels que savons, rhums, alcools. Même genre d’exposition dans le pavillon du Salvador, une heureuse république dont les finances sont si prospères qu’elle n’a pas de dettes. Ce pavillon est original. Son style où se mélange agréablement l’architecture arabe et espagnole doit donner une idée assez exacte des belles constructions du pays.
La Bolivie
Le pavillon de la Bolivie est fort joli avec ses quatre tours et son architecture bizarre. C’est un bon spécimen des constructions modernes de Bolivie. Il est rempli des principales productions du pays, parmi lesquelles figurent au 1er rang les minerais d’argent et de cuivre qui s’extraient paraît-il de mines inépuisables.
L’Exposition du royaume d’Hawaï ou des îles Sandwich occupe aussi un coquet pavillon, rempli des produits naturels du pays, café, sucre, tabac, riz. Les Hawaïens font d’assez jolis meubles mosaïques; des nattes et ce qui leur est tout à fait propre, des manteaux de plumes d’oiseaux, plumes de coq principalement; avec ces plumes multicolores et brillantes on forme des dessins superbes. Mais mon Dieu, a-t-il fallu en tuer de ces pauvres gallinacés pour faire de leurs plumes des vêtements entiers.
Le Chili, le Paraguay, l’Uruguay, le Vénézuela ont aussi leurs palais. Ah! si l’on voulait tout voir, tout approfondir, les six mois que dure l’exposition ne suffiraient pas et la voilà qui touche à sa fin; bientôt je vais lui dire adieu.
Samedi, 26 Octobre 1889.
Je me suis délassée toute la journée en savourant mes souvenirs, en rangeant mes bibelots et en commençant l’emballage de toutes ces jolies choses. Ma caisse ne suffit plus, j’aurai de l’excédent. Depuis six semaines que je marche comme le juif-errant, voilà franchement un repos bien gagné. Je ne suis plus la diligente mère Jeanne, debout la première pour veiller à la maison. Il y a longtemps que mon réveil-matin habituel, que le roi de ma basse-cour a lancé aux échos sa fanfare guerrière, lorsque je me lève à présent. Mon Dieu oui, je fais la grasse matinée comme une petite maîtresse; d’ailleurs, on se couche si tard ici, que minuit est encore plus animé à Paris que midi chez nous.
Après dîner, nous sommes allées au Musée Grévin; un musée d’un nouveau genre rempli de personnages... en cire; c’est la ressemblance étonnante, la reproduction parfaite du modèle, dit-on. Nous avons vu la reine d’Angleterre fort laide, l’empereur d’Allemagne et son jeune fils, Bismark, nos gouvernants actuels, très ressemblants, Carnot que chacun reconnaît, tous ces personnages fort bien groupés, les uns debout semblant marcher, les autres assis semblant causer. Quelques personnes, bien vivantes celles-là, s’amusent à garder une immobilité complète, si bien qu’à la fin on ne sait plus quels sont les gens vrais ou faux. Tout en allant demander un renseignement à quelque joli mannequin, on écrase le pied d’une élégante personne que l’on prenait pour une statue.
Puis on descend un sombre escalier qui conduit à des sous-sols faiblement éclairés; là on a la vision de scènes lugubres entrevues dans une demi obscurité. Tout cela prend alors un air de vérité qui saisit vivement. Nous assistons aux touchants adieux de Louis XVI à sa famille, à l’arrestation douloureuse de Marie-Antoinette, la voilà dans sa chambre à la Conciergerie. Donnons aussi un coup d’œil à Lafayette, à Bailly, à Rouget de l’Isle, avant ou après la Marseillaise, peu importe.
Si ce n’était les employés de l’établissement qui crient de temps à autre: «Méfiez-vous des voleurs, il y a des pick-pockets ici,» et qui vous rappellent que ce spectacle n’est qu’une fiction on serait joliment impressionné.
Voici la série des célèbres criminels, expressions mauvaises, visages ignobles pour la plupart. Cette triste exhibition se termine par l’exécution d’un condamné à mort. Voilà les bois de justice, le bourreau, le condamné couché sur la fatale machine. Dame! j’ai fermé les yeux; ce n’était qu’une image, mais j’en avais assez.
On est bien aise de remonter à la lumière et d’entendre la musique des dames hongroises. Le soir entre onze heures et minuit nous sommes revenues sur l’un de ces grands omnibus qui atteignent la hauteur des entre-sols.
Tout en roulant à la lueur du gaz et des étoiles mon esprit philosophait un peu en pensant au philosophe Pascal qui le premier eut l’idée d’installer des voitures au service du public avec itinéraire tracé d’avance. Son ami le marquis de Roanne s’empara de son idée et obtint en 1672 le droit de faire circuler les dits véhicules qui furent d’abord de vieux carrosses défraîchis vendus par leurs propriétaires. On payait 5 sols la place. Mais ce ne fut qu’en 1819 que parut le premier omnibus.
J’ai trouvé ce petit voyage assez pittoresque, mais je n’aimerais pas à le recommencer souvent il y a toujours un peu de cohue pour monter et descendre et les accidents sont si vite arrivés.
Si, du fond de la Bretagne, ma famille, plongée dans le sommeil, m’avait vue perchée, ainsi passer en rêve, je crois qu’elle se serait mise à se frotter les yeux et que ce rêve l’aurait tout-à-fait réveillée.
Dimanche, 27 Octobre 1889.
Grand’messe à la Madeleine.—L’après-midi promenade aux jardins des Tuileries, et du palais Royal.
L’Eglise de la Madeleine fut commencée sous Louis XIV. C’est Mademoiselle de Montpensier qui en posa la première pierre.
Sous Napoléon Ier, elle n’était point encore achevée et ce grand conquérant rêva d’en faire un temple à sa gloire et à celle des armées françaises. Des tables d’or devaient former les pages des annales de l’Empire... Mais les conquérants passent vite parfois et la Restauration fit mieux en rendant ce bel édifice à sa première destination: Au culte de Dieu.
Le perron a 28 marches et le péristyle 52 colonnes avec 34 statues dans des niches carrées.
Les portes de bronze ont de superbes bas-reliefs. Le fronton, œuvre de Lemaire, représente le Jugement dernier.
La Madeleine a le style d’un temple grec, c’est fort beau, mais quand il s’agit des églises, je préfère bien le style gothique avec ses fenêtres ogivales, dont les vitraux de couleurs répandent de si douces et mystérieuses clartés.
L’intérieur est somptueux, on y officie comme dans toutes les grandes églises de Paris avec beaucoup de solennité.
Le jardin des Tuileries évoque bien des souvenirs plus tristes que gais. Où est-il ce beau palais commencé sous Catherine de Médicis et qui depuis Louis XV fut la résidence habituelle de nos rois. Ils se plurent à l’embellir, Napoléon III particulièrement. Le peuple devait en avoir raison et le détruire un jour, du reste, dans tous les temps d’émeutes et de révolutions, c’est toujours le palais des Tuileries que le peuple attaque d’abord: en 1792, il s’en empare et massacre les Suisses fidèles, même scène en 1830, et en 1848, il en est le maître; en 1871 le peuple a progressé il ne se contente plus du pillage et du vol, la torche incendiaire de la Commune passe partout et le réduit en cendres.
Quelle honte! quelle tache incrustée au front de Paris, que ces ruines... aussi s’est-on empressé de les faire disparaître et de remplacer les beautés de l’art par celles de la nature.
On a donc créé un nouveau jardin qui cache sous ses arbustes et ses fleurs l’emplacement même du palais des Tuileries.
Sous Louis XIV, le jardin primitif renfermait une vaste volière, un étang, une ménagerie, une orangerie.
En 1665, Le Nôtre dessina un nouveau plan avec les deux belles terrasses que l’on admire encore aujourd’hui: la terrasse du Bord de l’eau donnant sur la Seine et la terrasse des Feuillants dont le monastère avoisinait les Tuileries.
Sur l’emplacement même du manège des Tuileries on éleva en 1790 une salle où l’Assemblée constituante termina sa session, où l’Assemblée législative tint la sienne et où la Convention délibéra jusqu’en 1793. Le Conseil des Cinq Cents y siégea aussi jusqu’en 1798.—Rien ne manque aujourd’hui à la décoration de ce vaste jardin de 30 hectares, grands arbres ombreux, massifs d’arbustes, parterres de fleurs, bassins d’eau vive, terrasses de l’Orangerie et du Jeu de Paume, pelouses verdoyantes. Ajoutons que toutes ces délicieuses choses de la nature sont encore embellies par de nombreuses statues et des groupes de marbre et de bronze dûs à nos meilleurs maîtres français.
Nous avons promené au jardin des Tuileries avec une dame, amie de ma cousine qui nous a raconté un fait bien touchant arrivé dernièrement devant elle à la gare de l’Est.
Deux femmes et une petite fille guettaient anxieusement l’arrivée du train de Strasbourg. La grand’mère attendait son mari qui venait aussi lui voir l’Exposition.
«Grand-mère, disait l’enfant, va-t-il bientôt arriver.
—Oui, chérie, prends patience, répondait l’aïeule.
Soudain le sifflement aigu de la locomotive se fait entendre, une porte s’ouvre, le flot des voyageurs s’écoule par cette grande baie un instant trop étroite.
—Le voilà, le voilà! crie la petite fille.
Un petit vieux, sec, cassé, simplement mais proprement vêtu apparaît. D’une main, il s’appuie sur un parapluie et de l’autre, il brandit un bouquet de fleurs et avant d’avoir embrassé sa femme, sa fille et sa petite-fille, il leur a tendu le bouquet.
Cela vient de là-bas...., dit-il simplement. La petite fille sourit, mais en contemplant ces fleurs qui avaient poussé sur la terre arrachée à la France, l’aïeule et la mère fondirent en larmes: Ce souvenir si vibrant encore après dix-neuf années prouve au plus haut degré la force et la durée des sentiments inspirés par l’amour de la patrie. Le jardin du Palais Royal est fort attrayant avec ses grands arbres, son bassin, ses parterres, ses statues. Ce beau jardin ne fut pas toujours ce lieu tranquille où les promeneurs viennent entendre de la musique. Sa longue existence a connu des périodes agitées. Beaucoup plus vaste d’abord qu’il ne l’est aujourd’hui, il s’y tenait une foire permanente.
Sous la révolution il devint le club en plein vent où péroraient les exaltés. Au centre se trouvait alors un cirque, amusement de ceux qui ne faisaient pas de politique. Le feu détruisit ce cirque en 1798.
Ma cousine m’a fait remarquer dans l’un des parterres le canon que le soleil fait partir à midi précis.
Ces superbes jardins, au centre même de Paris sont fort appréciés de ses habitants, aussi y a-t-il toujours beaucoup de promeneurs. C’est le lieu favori des bonnes d’enfants.... et des militaires.
Après cette charmante flânerie, au milieu de la verdure et des fleurs, il m’est arrivé une petite aventure qui aurait pu mal finir; elle s’est terminée d’une manière aussi heureuse qu’inattendue.
Vers 5 heures, je devais me rendre seule, ma cousine préférant rentrer, à une matinée musicale donnée par un grand professeur de piano.
En sortant ma cousine m’avait dit: Aujourd’hui dimanche tu ne feras aucune acquisition, ne prends pas ta bourse, c’est toujours plus sûr, j’ai la mienne pour payer l’omnibus. A 5 heures moins un quart nous entrions au bureau de l’omnibus que nous venions d’apercevoir dans le lointain. Hélas, il était bondé, un monsieur d’un certain âge et un jeune Saint-Cyrien venaient d’y monter; il ne restait plus qu’une place à prendre. Vite, dépêche-toi, me crie ma cousine, ça m’est égal d’attendre, mais toi, tu arriverais trop tard. Je me précipite et je me trouve assise au fond de la voiture, le monsieur à ma droite et le jeune homme en face de moi. Au moment où l’omnibus s’ébranlait, je me souviens, pensée terrible, que je n’ai pas d’argent. Un ah! involontaire s’échappe presque de mes lèvres, je me sens rougir jusqu’à la racine des cheveux. Quel ennui, quelle humiliation! L’employé a ouvert sa saccoche et reçoit les places, il s’avance... c’est le quart d’heure ou plutôt la minute de Rabelais. Que dire! Que faire! on va me laisser là, c’est certain. Depuis quelques semaines les compagnies sont devenues intraitables sous ce rapport, ayant depuis le commencement de l’exposition perdu plus de 20.000 fr. de places non payées. Aujourd’hui pas d’argent... pas de place et il faut obéir à cet impérieux commandement: descendez. Que vais-je devenir dans ces quartiers qui me sont complètement inconnus? j’en frissonne. L’employé est arrivé devant le vieux monsieur: «Vos places!
—Nous vous les avons payées en montant, rappelez-vous. C’est mon fils qui vous a donné l’argent.
—Oui, oui, c’est vrai!» et l’employé tourne sur ses talons et va sur l’impériale faire sa collecte.
Pendant ce colloque j’avais pris un air de belle indifférence. J’écoutais impassible..., j’étais sauvée. L’employé m’avait sans doute prise pour la femme et la mère de ces messieurs.
Le lendemain je suis allée au bureau des omnibus de l’Odéon pour payer ma place. L’employé m’a répondu franchement:
Cette restitution nous causerait plus d’ennuis que cela ne vaut, ne vous en préoccupez pas; c’est le roulement; et j’ai déposé dans le tronc d’une église le montant de ma place. J’ajouterai même que je l’ai triplé pour remercier la Providence de m’avoir tirée si gentiment de ce mauvais pas.
A sept heures et demie je suis rentrée charmée de la bonne musique que je venais d’entendre et des jolies compositions de Chaminade, parfaitement interprétées. J’ai changé de robe à la hâte, car ma cousine réunissait ses amis en mon honneur.
C’était mon dîner d’adieu. Parmi ses invités figurait une très élégante jeune femme qui habite aux Champs-Elysées, dame! avoir une villa délirante ou un hôtel somptueux aux Champs-Elysées c’est un rêve. Beaucoup de personnes se contentent des rues adjacentes, mais cela s’appelle quand même habiter les Champs-Elysées; et ça vous pose tout de suite.
Les Parisiens sont ébouriffés de la vie que mènent à Paris les Provinciaux, avides de tout voir et de tout connaître.
Deux choses sont absolument nécessaires pour visiter notre belle capitale, de la patience et de l’argent et même en bien des circonstances, la première l’emporte sur l’autre, l’argent ne peut remplacer la patience.
Je regrette beaucoup de n’avoir pu aller au Théâtre Français. Sans doute le grand Opéra est une belle chose, mais j’aime à comprendre ce que j’entends, et ceux qui n’y vont pas souvent en reviennent plus qu’étonnés, ils en reviennent ahuris, abasourdis. C’est une série de roulades, de vocalises, de trilles, et de ha! à perte de vue et d’haleine, on chante indéfiniment sur deux mots par exemple: Partons, hâtons-nous, remplissent presque un chœur. Ce départ se chante pendant plus d’un quart d’heure et le public ne peut s’empêcher de se dire que pour des gens pressés, ils y mettent le temps. Bref le public est bon enfant, il écoute sans s’impatienter il y aurait de quoi cependant. Je ne pousse pas le dédain de l’Opéra au point de ce vieux provincial y allant pour la première fois. «C’était beau, n’est-ce pas, lui dit-on?—«Beau! ils m’ont assourdi les oreilles; la moitié des personnages jouaient et chantaient en même temps, sans doute pour gagner plus vite leur salaire, quant à ceux qui chantaient seuls, que vous dirais-je! j’en fais autant tous les matins quand je me gargarise.»
Parlez-moi du Théâtre Français, on y comprend tout ce qui s’y dit. Le génie si clair, si harmonieux de notre belle langue s’y développe dans toute sa magnificence. Pour ma part je trouve que la Comédie Française et l’Opéra Comique sont les deux genres qui conviennent le mieux au tempérament français. Pour s’émouvoir, s’enthousiasmer, il me semble que les seuls plaisirs des yeux et des oreilles ne suffisent pas, il faut encore y joindre ceux de l’esprit. Je regrette donc bien de n’avoir pu voir le plus ancien théâtre de France réellement fondé en 1680. Il est considéré comme le premier théâtre du monde entier. Tous les véritables chefs-d’œuvre de l’esprit français y ont été mis à la scène. On l’appelait souvent la «Maison de Molière». Mais il était aussi la maison de Corneille et de Racine.
C’est en 1689 que, par ordre de Louis XIV, «l’Hôtel des Comédiens du roi», entretenus par Sa Majesté, prit le nom de «Comédie Française».
N’est-ce pas après la mort de Corneille que l’on adressa ce joli distique aux Comédiens.
«Corneille était mort en 1684, et Molière en 1673, ils ont donc précédé la constitution de ce théâtre, et c’est à l’Hôtel de Bourgogne, situé alors rue Turbigo, que leurs œuvres sauf quelques-unes, (jouées à Versailles, devant la Cour seule) ont été offertes au public. Ces deux grands hommes sont pourtant considérés comme les véritables créateurs de ce théâtre, dont Napoléon Ier a dit un jour: «Le Théâtre Français est l’orgueil de la France, l’Opéra n’en est que la vanité.»
En 1770, les artistes de la Comédie-Française furent, avec la permission du roi, s’installer aux Tuileries et y restèrent jusqu’en 1782, à cette date, ils allèrent dans une nouvelle salle élevée sur l’emplacement de l’Hôtel de Condé, salle reconstruite plus tard et devenue l’Odéon.—C’est là qu’en 1784 fut joué pour la première fois le Mariage de Figaro, véritable prologue de la Révolution. Là aussi en 1787 débuta Talma, qui, plus tard, devait jouer à Erfurt devant le «parterre de rois» que lui avait promis l’empereur.
«Sous l’Empire, les artistes suivent l’empereur à Saint-Cloud, à Fontainebleau, à Trianon, à Compiègne, à la Malmaison. Ils le suivent en Allemagne, à Dresde, à Erfurt. Ils étaient désignés sous le nom de «Comédiens ordinaires de S. M. l’empereur et roi».
«On a gardé souvenir de la fameuse soirée du 22 octobre 1852 à laquelle assistait le prince Louis-Napoléon, président de la République. On y joua Cinna. On y entendit une ode d’Arsène Houssaye: L’empire c’est la paix et un proverbe d’Alfred de Musset: Il ne faut jurer de rien. Le prince président y fut fêté avec un indescriptible enthousiasme, et quand il remonta en voiture pour retourner à Saint-Cloud, les cris de: «Vive l’empereur!», partirent tout seuls».
Cette nouvelle dynastie impériale qui allait se fonder si florissante, si durable semblait-il n’existe plus. En 40 ans, le père et le fils sont morts. Vraiment le monde n’a de stable que son instabilité!
Lundi 28 Octobre 1889.
A l’Exposition.—Les Etats-Unis.
Les Etats-Unis ont voté un million deux cent cinquante mille francs pour leur installation, c’est dire qu’elle est très complète et renferme quantité d’objets fort intéressants mais impossible à énumérer. Quinze cents exposants sont venus. J’ai beaucoup admiré les boutiques en bois de rose massif d’un bijoutier qui expose quantité de diamants entre autre un collier de deux millions.
J’ai encore remarqué ce qu’à New-York on appelle le vase centenaire. Ce vase en argent massif fort artistement travaillé est d’une hauteur de 1m28, il pèse 60 kilos et vaut 125000 francs.
Très curieux les bois pétrifiés du territoire de l’Avizola; il paraît qu’une forêt entière a été ainsi transformée. Ces bois aux reflets de jade sont uniques au monde.
A la section d’agriculture, j’ai remarqué le palais du maïs qui est bâti tout en maïs et dans lequel on vous offre du maïs préparé de toutes les façons.
Mais la suprême, mais l’éblouissante exposition des Américains dont ils sont fiers à juste titre est celle d’Edison.
Pendant une grande heure je me suis extasiée devant ces inventions extraordinaires illuminées le soir par vingt mille lampes électriques incandescentes; cela suffirait pour éclairer une grande ville. Les premiers jours de mon arrivée ici, j’avais entendu, dans je ne sais quel coin, deux phonographes qui ne m’avaient point enthousiasmée loin de là, j’avais posé comme tant d’autres mes oreilles contre les tubes pour écouter les paroles emmagasinées par la roue tournante couverte de lamelles de cuivre qui ont retenu les vibrations de la voix. La 1re fois j’avais entendu des sons très maigres, très lointains, quelque chose comme les airs que serinent les orgues de barbarie, la seconde fois, je n’avais entendu... que le silence, j’en suis bien fâchée pour moi et pour les phonographes qui ont parlé à toute la presse et dont toute la presse a parlé. C’était à me demander si je devenais sourde puisque tout le monde avant et après moi se félicitait sur ce qu’il venait d’entendre. Cette fois-ci cela a été bien différent; chez l’inventeur qui ne se sert que de ses instruments très perfectionnés, c’est merveilleux.
Le bâtiment Edison présente un aspect fort singulier, son exposition occupe à elle seule 675 mètres carrés. Dame! pour un inventeur qui se fait admirer dans le monde entier, ce n’est pas trop. Le buste du grand électricien apparaît à la fenêtre la plus éclairée de sa construction que domine le formidable feu à incandescence de son invention. Il faudrait avoir des connaissances très approfondies, très spéciales et qui ne sont point de la compétence féminine pour parler de cette exposition dont l’installation coûte 400.000 francs. Les Américains sont aussi forts pour la mécanique qu’ils sont faibles pour les arts.
On dit que M. Edison conserve les premiers bégaiements de sa fille Marguerite qu’il compte lui faire entendre à sa majorité. Cet emmagasinage des sons et des vibrations de la voix, cela ne tient-il pas du prodige! Edison est le magicien des temps modernes.
Voici sur Edison et sa famille des renseignements intéressants:
Les Edison sont originaires de Hollande, où ils étaient meuniers de père en fils, lorsque le dernier émigra en Amérique vers 1730.
La longévité est exceptionnelle dans la famille. L’arrière-grand-père du célèbre inventeur est mort à cent deux ans et son grand-père à cent trois.
Son père, qui vit encore et porte allègrement ses quatre-vingt-cinq ans, est d’une vigueur peu commune. Il a six pieds deux pouces.
Quant au fils qui étonne le monde par ses découvertes et ses inventions, qui, né dans une chaumière, habite aujourd’hui un palais, disons-le bien vite, c’est à son travail seul qu’il le doit; sa vie est un conte de fée.
Excellent époux, excellent père, excellent maître, il rend tout le monde heureux. Il mène une existence fort régulière, cependant il lui est arrivé de rester quelquefois, hanté par le génie de l’invention, 40, 50, 60 heures même de suite au travail sans boire, ni manger, ni parler à personne. En temps ordinaire, il se borne à surveiller ses ouvriers au nombre de 3000. Constamment entouré d’un état-major d’ingénieurs, Edison, avec leur aide, est arrivé à 600 découvertes et inventions. Il est du reste bien récompensé de ses travaux car il a su doubler sa gloire de 50 millions de fortune.
Tout captive, tout retient dans cette exposition unique et merveilleuse, soit qu’on monte ou qu’on descende l’échelle des âges et des êtres. Que de rayonnements partout, il est impossible de ne pas rapporter quelques étincelles de tant de lumières.
Quel triomphe que ces conquêtes pacifiques qui apportent le bien-être et la richesse aux peuples, n’est-ce pas la vraie gloire, celle qui crée et comme elle laisse loin derrière elle celle qui détruit: la gloire sanglante des champs de bataille, ce qui n’empêche que l’exposition de la guerre ne soit formidable. C’est au frontispice de cette galerie qu’on peut mettre: «Qui veut la paix, prépare la guerre.»
Espérons donc qu’avec cette préparation permanente de la guerre nous garderons toujours la paix et que dans 10 ans nous assisterons à une autre joute pacifique de l’univers. De nouveaux perfectionnements, de nouvelles découvertes viendront nous émerveiller encore. La science est insatiable. En Avant! c’est la devise du progrès. Oui cette nouvelle exposition deviendra alors le magnifique berceau du XXe siècle.
Mardi, 29 Octobre.
Journée pieusement employée à visiter les églises, je ne dirai pas toutes, car quoique Paris compte moitié moins d’églises et de chapelles que Rome qui en possède environ trois cents, ce serait une rude tâche s’il fallait toutes les voir le même jour. J’ai visité avec grand intérêt Saint-Sévérin, une des plus vieilles et des plus curieuses églises de Paris.
Comme date primitive de sa fondation, elle remonte à la fin du XIe siècle, mais elle fut réédifiée au XVIe et agrandie au XVIIe. Elle possède de beaux vitraux, de belles peintures et beaucoup d’inscriptions funéraires. C’est dans cette église que furent placées les premières orgues qu’on ait entendues à Paris.
L’église Saint-Germain-des-Prés a gardé le nom de l’ancien monastère dont elle dépendait et qui se trouvait situé au milieu de vastes prairies d’où son nom. Voilà donc tout ce qui reste de cette puissante abbaye, qui, plusieurs fois saccagée par les Normands et plusieurs fois reconstruite, avait été fondée sous Childebert. Le pinceau de Flandrin a concouru à l’embellissement de l’intérieur, les fresques et les vitraux du chœur sont de lui. Non loin de l’abbaye, se trouvait le fameux Pré-aux-Clercs, où tous les escholiers et basochiens de la vieille Lutèce allaient promener, s’ébaudir et deviser.
Saint-Germain-des-Prés et Saint-Germain l’Auxerrois sont certainement deux des plus anciennes églises de Paris, et la monographie qu’un journaliste de loisir—mais y en a-t-il?—en pourrait faire ne serait pas sans intérêt.
Saint-Germain l’Auxerrois, fondée par Chilpéric I, rappelle bien des souvenirs brillants, n’était-ce pas la paroisse royale où les grandes dames et les seigneurs de la cour se pressaient quand le roi de France habitait le Louvre et les Tuileries.
Saint-Gervais est une vieille église du XVe siècle, elle est de style ogivale, sauf le portail remarquable dans son genre mais qui détonne avec le reste. Elle a encore quelques beaux vitraux échappés au vandalisme de la Terreur qui en brisa la majeure partie. Les stalles du chœur, en bois sculpté, proviennent de Port-Royal-des-Champs, comme les chandeliers et la croix de bronze doré du maître-autel proviennent de l’ancien abbaye de Sainte-Geneviève. En 1795 Saint-Gervais fut concédé aux Théophilanthropes (amis de l’homme). Cette secte née des folies révolutionnaires et qui voulait fonder une nouvelle religion en fit le temple de la Jeunesse comme elle avait fait de Saint-Laurent le temple de la Vieillesse, de Saint-Eustache le temple de l’Agriculture, et de Saint-Roch le temple du Génie.
Devant sa façade existait encore au commencement du siècle, un vieil orme sous lequel on avait rendu la Justice, d’ailleurs c’était la coutume autrefois d’avoir à côté de l’entrée principale de l’Eglise un arbre de haute futaie autour duquel les fidèles se réunissaient en attendant l’office.
Madame de Sévigné s’est mariée en cette église; dans la chapelle de Scarron se trouvent aussi des souvenirs de Madame de Maintenon.
Saint-Eustache est une belle église demeurée plus d’un siècle en chantier. Ses souvenirs historiques ne sont pas gais. Plusieurs prêtres y furent massacrés lors de l’invasion des Pastoureaux. C’est là que se forma la confrérie des Bouchers qui sous Charles VI causa tant de frayeur dans Paris.
Saint-Roch est très riche en œuvres d’art. Cette église garda longtemps sur la façade les traces de la mitraille et des balles que Bonaparte le 13 vendémiaire, à la tête d’un bataillon de volontaires lança sur les sections insurgées qui se dirigeaient contre la Convention.
La Trinité est une superbe église toute neuve, toute jeune, elle a à peine trente ans. On pourrait l’appeler la paroisse du beau monde. Les élégantes en remplissent la nef, pieusement accoudées sur leur prie-Dieu de velours.
Le square qui la précède avec sa fontaine monumentale, ses perrons à balustre, sa façade surchargée d’ornements, style renaissance lui donnent grand air, c’est un beau monument moderne.
Notre-Dame-des-Victoires est une des églises les plus fréquentées de Paris, ce qui prouve combien la dévotion à la Mère de Dieu est répandue dans toutes les classes. Louis XIII en posa la première pierre, en 1629 et l’appela Notre-Dame-des-Victoires, en souvenir des succès remportés par les catholiques sur les hérétiques.
Cette église servit de Bourse pendant la Révolution et fut rendue au culte en 1809. Les boiseries du chœur sont remarquables et le nombre des ex-voto de tous genres est infini. La province y a une large part. Ces témoignages de reconnaissance et d’amour symbolisent bien des grâces reçues et prouvent que la Vierge Mère comme son divin Fils aime les Francs.
Notre-Dame-des-Victoires est une des églises qui possèdent encore le plus de reliques; avant 1871, elle en avait un nombre considérable.
Malheureusement, la Commune visita l’église et enleva pour ainsi dire tous les reliquaires qui étaient en or et chargés de pierres précieuses.
On vit disparaître aussi la couronne donnée en 1853 par Pie IX à la Sainte-Vierge et qui ne valait pas moins de soixante-dix mille francs.
On a pu réunir cependant un grand nombre d’ossements qui sont renfermés dans quatre grands reliquaires et placés au chœur et à l’autel de la Vierge.
Quelques reliques sauvées avec leurs reliquaires sont placées sur l’autel de saint Augustin.
Saint Merri est l’aînée des églises de Paris; elle remonte au VIIIe siècle. Il y existe une crypte à l’endroit où se trouvait le tombeau de saint Médéric son patron. Les magnifiques vitraux qui l’ornaient jadis ont été enlevés, mais elle est encore très ornée de superbes peintures.
Saint-Thomas d’Aquin renferme de très belles peintures, Notre-Dame de Lorette rappelle le style d’une basilique romaine. L’extérieur est donc sévère et froid, mais l’intérieur rend bien la physionomie de ce quartier mondain.
L’église Saint-Etienne du Mont est très ancienne, elle doit son nom à sa situation sur la montagne Sainte-Geneviève. Son style se ressent un peu de la lenteur de sa construction et des remaniements apportés par ses différents architectes. On en rapporte quand même un bon souvenir: l’extérieur est assez beau et l’intérieur tout à fait superbe, tableaux et vitraux sont remarquables, mais ce qui l’est peut-être davantage parce que cela se voit plus rarement, c’est le jubé ainsi que deux escaliers qui s’enroulent autour des piliers et conduisent à la plate-forme. Ses clefs de voûtes le sont également ainsi que la magnifique galerie qui unit les piliers et fait le tour de la nef et du chœur.
Saint-Etienne du Mont est contiguë à l’ancienne abbaye de Sainte-Geneviève, dont il ne nous reste qu’une tour, la tour de Clovis, attenant au lycée Henri IV. La chaire est un chef-d’œuvre de sculpture sur bois. Ici reposent le Raphaël français Le Sueur, le profond philosophe Pascal, le célèbre poète Racine, le savant écrivain Le Maistre de Sacy. L’archevêque Mgr Sibour y fut assassiné le 3 janvier 1857.
Voilà donc les églises que j’ai le plus remarquées et que j’énumère sans ordre comme elles se présentent à ma mémoire, j’en ai visité d’autres mais qui m’ont moins frappée.
En sortant de Saint-Eustache, je suis entrée aux Halles centrales, où j’ai trouvé là un nouveau spectacle; foule compacte comme partout, mais un tout autre monde. Quel amoncellement de victuailles! Guirlandes de bœufs entiers, étalages de poulets dodus, montagnes de beurre et d’œufs, pyramides de légumes, colonnes de fruits, réservoirs remplis de poissons vivants et frétillants, etc., etc., et dire que toutes ces provisions se renouvellent chaque jour; quel gouffre que Paris, quels ogres que ses habitants.
Mercredi 30 Octobre 1889.
Dernière journée à l’Exposition
Avant de m’y rendre j’ai voulu revoir les deux magasins du Louvre et du Bon Marché. J’y ai entendu le cri de guerre deux sur dix, c’est-à-dire les deux yeux des inspecteurs fixés sur les dix doigts des acheteurs qui sont parfois des voleurs. Ce mot 2 sur 10 est le: «Sentinelle prenez garde à vous.» Je ne l’avais point entendu et ça m’a beaucoup étonnée. Ensuite je me suis rendue à l’Exposition.
J’ai voulu revoir une dernière fois ce spectacle unique, cet ensemble grandiose et saisissant, encore plein de vie et de mouvement aujourd’hui et qui bientôt ne sera plus qu’un souvenir.
Je tenais à passer une dernière journée à l’exposition. Les nuages remplissaient le ciel de mélancolie, c’était vraiment un ciel couleur d’adieux, et cependant elle est toujours splendide cette Exposition, elle mourra debout!
Je suis allée revoir encore une fois tout ce que je trouvais de plus beau, donner un dernier coup d’œil, un dernier sourire à ces monuments d’un jour, à ces demeures éphémères, à ces palais, à ces pavillons cosmopolites qui ont coûté tant de millions et dont la durée aura été si courte.
J’ai parcouru les boutiques, je me suis arrêtée devant les parades, les affiches de théâtre et les clowns appelant à grands coups de tam-tam et de quelques autres instruments aussi harmonieux, les spectateurs à la danse du ventre, aux pantomimes d’almées plus ou moins authentiques.
J’ai revu les Odalisques et les Bayadères aux robes éclatantes, le cou enguirlandé de sequins ayant des castagnettes d’argent aux doigts et des grelots sonores aux chevilles, des bracelets depuis le poignet jusqu’au coude prenant les yeux mi-clos, les bras étendus, les poses les plus langoureuses.
J’ai revu avec plaisir les danses typiques des gitanos et des gitanas, les pirouettes cadensées et interminables des vertigineux derviches tourneurs, le charmeur de serpent, la danse guerrière des nègres du Kordofan.
J’ai encore croisé des gens de toutes couleurs, sans parler des Européens blancs et roses, j’ai revu des visages jaunes, marrons, bruns clair, bruns foncé et noirs.
En passant devant le panorama de la Compagnie Transatlantique je ne me suis pas laissée tenter plus que les autres fois, quoi qu’on dise que l’illusion est complète. On se croirait dit-on au milieu des flots de la haute mer. J’ai visité sur nos côtes bretonnes à Brest, à Lorient et à Saint-Nazaire de trop beaux navires pour chercher à revoir leur pâle reproduction. La réalité vaut toujours mieux que son image. Par exemple j’ai traversé avec intérêt la salle consacrée à la manufacture nationale des tabacs et j’invite tous les chiqueurs, priseurs et fumeurs à se donner rendez-vous ici.
Avant 1870, dix-huit départements avaient le droit de cultiver le tabac; depuis la guerre, cette autorisation a été étendue à 22 départements qui emploient 17000 hectares à cette culture. La production du tabac est un travail qui ne se fait pas tout seul et qui oblige ceux qui s’en chargent à beaucoup de soins et de formalités, mais le bénéfice est rénumérateur, environ mille francs par hectare.
J’ai regardé un instant la fabrication des cigarettes, j’ai suivi les opérations multiples qu’elles subissent avant de passer aux lèvres des consommateurs.
Il en est des cigarettes comme de bien des choses, des épingles, des aiguilles que l’on considère comme des riens, sans penser au temps qu’elles ont pris au travail qu’elles ont exigé.
J’ai salué sans un sentiment de tristesse le palais du Trocadéro, celui-là ne sera pas détruit, il restera toujours au milieu de ses parterres ravissants où les fleurs se montrent dans un délicieux chatoiement de couleurs, il est acquis aux grandes auditions musicales. Et depuis six mois, il a vu aussi une floraison complète de congrès permanents, congrès géodésique, congrès de l’hypnotisme, du magnétisme humain appliqué à la guérison des maladies, congrès des chemins de fer, de physiologie, etc., etc.
L’exposition a merveilleusement réussi, pas d’orage politique, et bon état sanitaire malgré cette immense agglomération d’individus accourus de tous les pays. Il est venu 5 millions de provinciaux dans les hôtels, sans compter les personnes descendues chez les amis et les parents. En estimant à 100 francs en moyenne l’argent dépensé par chaque individu on arrive au chiffre énorme de 500 millions, jetés par les départements à la capitale. Il est venu également plus d’un million et demi d’étrangers à 500 francs seulement par personne, cela fait 770 millions de francs, ce qui représente comme dépenses faites à Paris pendant l’Exposition le chiffre formidable de 1 milliard 250 millions chiffres ronds.
Les Anglais et les Américains qui apprécient fort le bien-être matériel, le talent culinaire et qui ont comme nous l’avons dit le culte du dieu Boyau, ont fait grandement les choses, on estime que les Américains du Nord et du Sud ont dépensé plus de 300 millions pendant leur séjour à Paris.
Il n’y a pas à dire le grand soleil de la civilisation a rayonné tout particulièrement sur Paris cette année, ce succès, cette exposition sans rivale nous vaudra sans doute encore quelques jalousies, quelques rancunes, mais c’est égal l’orgueil national est satisfait et je suis ravie de mon voyage.
J’ai vu Paris, j’ai été éblouie de ses pompes, j’ai admiré ses œuvres, mais cela ne m’a pas déprovincialisée.
N’est-ce pas d’ailleurs au milieu des plus grandes foules que le sentiment de l’isolement se fait le plus sentir et qu’on éprouve le besoin de revenir à son chez soi. Je regagne mon home champêtre, vraiment fière d’être Française!
Jeudi 31 au matin. Jour du départ.
J’ai donc dit hier un dernier adieu à cette ville unique. l’Exposition où toutes les nations en grandes dames qu’elles sont, accourues avec empressement, se sont présentées dans tout l’éclat de leur beauté et de leur splendeur, entourées de tout ce qu’elles ont de meilleur et de plus admirable. J’ai dit avec regret un dernier adieu à toutes ces merveilles qui bientôt vont disparaître.
La pioche du démolisseur a déjà commencé son œuvre; le sol va se couvrir de débris informes et cet ensemble inoubliable ne présentera plus que l’image du chaos. Tout passe, tout croule, tout fuit.
C’est la loi ici-bas, même pour les meilleures et les plus belles choses: L’histoire est là pour nous raconter le lamentable sort des plus grandes cités et des plus beaux monuments de l’antiquité. Le temps en a fait des ruines.
Ma cousine voulait me garder encore: «Reste, m’a-t-elle dit, reste pour la Toussaint et pour la fête des Trépassés, tu verras quel culte, quel respect les Parisiens professent pour les morts. Nous irons voir le cimetière du Père Lachaise, cette nécropole incomparable où pendant deux jours, le 1er et le 2 novembre une foule considérable dans le silence et le recueillement apporte aux chers disparus, à ceux qui sont déjà rendus au port, un tribut de fleurs et de larmes, de regrets et de prières.»
—Je te remercie, mais je refuse.
—Tu as tort, tu verrais une ville d’une superficie de plus de 40 hectares toute bâtie de stèles, de colonnes, de monuments splendides, toute remplie de souvenirs historiques, puisque là reposent tant de célébrités.
—C’est ça! une ville des morts à faire envie aux vivants.
—Tu l’as dit, c’est presque un cimetière gai.... aucun aspect sombre, le trépas se voile sous les feuillages les plus charmants, les fleurs les plus parfumées.
—Grand merci quand même, non, non, ai-je répondu, je ne veux pas entendre tinter un lugubre glas sur les dernières heures d’un séjour enchanté; j’emporte un souvenir sans nuage de cette joyeuse étape, elle restera comme un oasis délicieux rencontré sur les grandes routes poudreuses de la vie où nous marchons tous si péniblement, j’emporte un souvenir sans nuage de ce rêve vécu, de ce rêve idéal qui a déployé ses ailes dans une lumineuse et sereine beauté; la malice des choses qui vous agace parfois avec ténacité a fait trêve, je n’ai éprouvé aucun ennui, aucune inquiétude: santé parfaite, temps superbe, réalisation momentanée de tous mes désirs, mais l’existence ne peut pas s’écouler sous le sceptre du plaisir, les vacances ne peuvent pas durer toujours, je dois partir, la famille et le devoir me rappellent au pays.
Au revoir et merci, merci de ton affectueuse et cordiale hospitalité et au revoir; l’an prochain, tu viendras me rendre ma visite et passer avec nous l’été à la campagne.
FIN
| Amboise | 9 |
| Blois | 14 |
| Chaumont | 33 |
| Chambord | 39 |
| Azay-le-Rideau | 47 |
| Chenonceaux | 51 |
| Autres Châteaux historiques, L’Abbaye de Marmoutiers, Savonnière, les Jardins Mame, le Parc de Beaujardin, la colonie de Mettray, coup d’œil sur la ville de Tours | 69 |
| Journal d’une Campagnarde à Paris pendant l’Exposition | 91 |
| Arrivée à Paris | 95 |
| Première impression | 97 |
| Le Jardin, le Musée et le Palais du Luxembourg—Buffalo-Bill | 101 |
| Exposition. Palais et Jardin du Trocadéro | 107 |
| Le Jardin des Plantes.—L’Eldorado | 115 |
| Exposition. Beaux-Arts | 112 |
| Les Elections.—L’Exposition.—Les Fêtes | 126 |
| A l’Exposition. Histoire de l’Habitation et du Travail | 131 |
| Montmartre.—Le Musée de Cluny | 139 |
| Le Prince Soleil au Châtelet.—Le Dôme Central.—L’Exposition de nos Manufactures Nationales | 150 |
| L’Hôtel de Ville | 154 |
| Le Panthéon.—Les grands Magasins.—L’Hôtel des Ventes.—La «famille Benoiton» à l’Odéon | 160 |
| Le Palais des Machines | 167 |
| Grand’messe à St-Sulpice.—Exposition.—Fontaines lumineuses.—Embrasement de la Tour | 170 |
| Les Ruines du Palais de la Cour des Comptes.—Promenade en voiture dans Paris | 179 |
| Ascension à la Tour | 185 |
| Défilé aux obsèques du Général Faidherbe.—La Tour Eiffel | 188 |
| Parc Monceau.—Buttes Chaumont.—Parc Montsouris | 201 |
| Repos complet.—Les Voitures à Paris | 205 |
| La France.—Entrées à l’Exposition | 210 |
| La France | 221 |
| Cent cinquante-quatrième journée et vingt deuxième dimanche de l’Exposition.—Grand’messe à Notre-Dame.—Promenade au bois de Boulogne | 227 |
| Exposition.—Palais des produits alimentaires.—Exposition de l’Agriculture | 235 |
| La Tour en diamants.—Le chêne antédiluvien.—«La Fille du Tambour-Major» à la Gaîté | 239 |
| L’Exposition: Europe, Angleterre et Russie | 243 |
| Famosa Corrida à la gran plaza (cirque) di toros, rue Pergolèse | 248 |
| Exposition: L’Autriche-Hongrie, la Belgique, la Hollande | 254 |
| L’Exposition: Europe, la Grèce, l’Espagne, le Portugal, la Suisse | 261 |
| «L’ode triomphale» d’Augusta Holmès.—«Excelsior» | 266 |
| Les Bouquinistes | 271 |
| Musée de Minéralogie et Géologie.—Musée du Louvre.—Dîner en famille avec une nouvelle arrivée | 275 |
| Le Jardin d’Acclimatation | 284 |
| La Messe rouge.—La Sainte-Chapelle.—Le Palais de Justice.—Deuxième visite au Musée de Cluny.—Carmen, Sigurd | 297 |
| Les Catacombes | 303 |
| A l’Exposition: L’Europe, Norwège, Suède, Danemark, Finlande, Italie | 308 |
| Grand’messe à Sainte-Clotilde.—La grande Pantomime de Skobeleff et le Lion cavalier | 314 |
| L’Exposition: San-Marino, Monaco, la Serbie, la Roumanie, Grand-duché de Luxembourg | 317 |
| La Chine et le Japon, la Perse, le Siam, le Maroc, l’Egypte et la rue du Caire | 323 |
| Possessions françaises | 331 |
| Repos et Repas | 339 |
| Le Mexique, la République Argentine, le Brésil, le Nicaragua, le Guatémala. Républiques de l’Equateur, Dominicaine, du Salvador, la Bolivie, le royaume d’Hawaï | 350 |
| Musée Grévin | 358 |
| Grand’messe à la Madeleine.—L’après-midi, promenade aux Jardins des Tuileries et du Palais-Royal | 361 |
| A l’Exposition: les Etats-Unis | 371 |
| Visites de quelques Eglises | 376 |
| Dernière journée à l’Exposition | 382 |
| Jour du Départ | 387 |
Page 273, dernier alinéa, 2me ligne.—Et ils sont dans le vrai, lisez: Et elles sont dans le vrai.
Page 276, ligne 13.—On est pas encore, lisez: On n’est pas encore.
Page 336.—Cette cour et le complément, lisez: Cette cour est le complément.
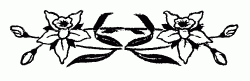
| Erreurs corrigées: |
|---|
| sequoia=>séquoia {3} |
| pour y subsistuer une=> pour y substituer une {pg 28} |
| Le plus bel édifice moderne de Blois, est l’évèché=> Le plus bel édifice moderne de Blois, est l’évêché {pg 30} |
| If faut croire qu’il=> Il faut croire qu’il {pg 34} |
| de cette spendide demeure=> de cette splendide demeure {pg 45} |
| le bateau semble prêt à démarer=> le bateau semble prêt à démarrer {pg 52} |
| n’ai pas cherché à le combatre=> n’ai pas cherché à le combattre {pg 54} |
| au au milieu des plus charmants souvenirs=> au milieu des plus charmants souvenirs {pg 55} |
| apprécié des des amateurs=> apprécié des amateurs {pg 56} |
| Qu’à m’égarer dans dans ces bocages=> Qu’à m’égarer dans ces bocages {pg 66} |
| sultan à à côté du président=> sultan à côté du président {pg 67} |
| Il parait qu’on ne peut=> Il paraît qu’on ne peut {pg 68} |
| ruine qne l’on conserve respectueusement=> ruine que l’on conserve respectueusement {pg 78} |
| mort de la pigure d’un serpent=> mort de la piqure d’un serpent {pg 117} |
| des scienses naturelles=> des sciences naturelles {pg 118} |
| Aussitôt après diner=> Aussitôt après dîner {pg 119} |
| les cerveaux surrexcités par la politique=> les cerveaux surexcités par la politique {pg 126} |
| carosses=> carrosses {x4} |
| L’obélisque de Luxor couvert d’hiéroghyphes=> L’obélisque de Luxor couvert d’hiéroglyphes {pg 183} |
| un porte-plume muni d’nne=> un porte-plume muni d’une {pg 197} |
| colonade de style=> colonnade de style {pg 202} |
| quoiqu’on dis eque l’antiquité=> quoiqu’on dise que l’antiquité {pg 212} |
| Nous ne voudrons pas le renouveller=> Nous ne voudrons pas le renouveler {pg 226} |
| Les Théophilantrhopes y prêchèrent=> Les Théophilanthropes y prêchèrent {pg 228} |
| L’un deux=> L’un d’eux {pg 240} |
| qui sépare l’arêne des=> qui sépare l’arène des {pg 248} |
| comment s’en débarasser=> comment s’en débarrasser {pg 252} |
| ilôts reliés par trois cents=> îlots reliés par trois cents {pg 258} |
| la Grèce aucienne=> la Grèce ancienne {pg 261} |
| Elle fait entendre incessament=> Elle fait entendre incessamment {pg 263} |
| de de ces petits=> de ces petits {pg 265} |
| C’est une sorte de litanie avec le répons=> C’est une sorte de litanie avec le réponse {pg 268} |
| Des peintures murales réprésentent=> Des peintures murales représentent {pg 275} |
| Cette fois, nous rentrons satîsfaits de notre=> Cette fois, nous rentrons satisfaits de notre {pg 280} |
| le Jardin d’Acclimation=> le Jardin d’Acclimatation {pg 285} |
| les cen q uinze mille dépêches=> les cent quinze mille dépêches {pg 290} |
| Après avoir vu le desssus de Paris=> Après avoir vu le dessus de Paris {pg 303} |
| un paneau de fleurs=> un panneau de fleurs {pg 310} |
| Danemarck.—Finlande.—Italie=> Danemark.—Finlande.—Italie {pg 308} |
| la chûte des neiges=> la chute des neiges {pg 311} |
| dont l’ensemble est imponast=> dont l’ensemble est imposant {pg 314} |
| T’Egypte et la Rue du Caire=> L’Egypte et la Rue du Caire {pg 323} |
| les mûrs ont=> les murs ont {pg 327} |
| potiers, tourneurs, inscrusteurs=> potiers, tourneurs, incrusteurs {pg 329} |
| magnifique Bouddah=> magnifique Bouddha {pg 336} |
| sont d’industrieux uvriers=> sont d’industrieux ouvriers {pg 337} |
| des omnibus se ralenti=> des omnibus se ralentit {pg 346} |
| l’Uruguay, le Vénézuella=> l’Uruguay, le Vénézuela {pg 357} |
| travail qu’elle ont exigé=> travail qu’elles ont exigé {pg 384} |
| et cet ensemble innoubliable=> et cet ensemble inoubliable {pg 387} |
| Tu l’as dis=> Tu l’as dit {pg 388} |
| A l’Exposition: L’Europe, Norvège, Suède, Danemarck=> A l’Exposition: L’Europe, Norwège, Suède, Danemark {table} |
| Dernières journée à l’Exposition=> Dernière journée à l’Exposition {table} |
[1] Ouvrage publié en 1661, Le Paradis de la Touraine, par le père Martin Martineau, carme déchaussé.
[2] Rayonnant.
[3] Elles se composent de lés de toile de 3 ou 4 mètres de hauteur sur 80 de largeur. Les unes sont à fond d’or ou d’argent, les autres à fond de couleur, enjolivées d’arabesques, de fruits, de fleurs, d’oiseaux, quelques-unes ont des personnages, et représentent une chasse. Le curieux, c’est que ces ornements ne sont pas le fait d’un pinceau habile, tous les dessins sont des applications de tontures de laine, ce qui leur donne le riche aspect du velours. Elles ont dû être fabriquées sur place. Elles ont servi de modèle à la restauration de plusieurs châteaux de la Renaissance. C’est à Blois qu’on les a imitées pour la première fois.
[4] Il paraît qu’on ne peut plus visiter Chenonceaux, le Crédit Foncier qui avait acquis ce domaine l’a revendu à un Américain du Sud, Monsieur Terry, qui l’aime passionnément, jalousement même et l’habite avec sa famille. Les Touristes ne pouvant plus visiter Chenonceaux en sont réduits à saluer de loin la noble demeure tout en promenant dans le parc dont l’accès n’est pas interdit.
[5] Depuis ma visite à Beaujardin, le propriétaire est mort; tous les animaux ont été vendus, et ce domaine a changé de maître et de destination.
[6] L’exposition de 1855 qui occupa cent soixante huit mille mètres carrés, dura du 15 mai au 15 novembre. Le nombre des exposants fut de vingt-trois mille neuf cent cinquante quatre; celui des visiteurs de cinq millions cent soixante mille. Les entrées payantes produisirent trois millions deux cent mille francs.
L’exposition de 1867 occupa six cent quatre-vingt-sept mille mètres carrés; il y eut trente-deux mille exposants, le nombre total des entrées payantes s’éleva à près de onze millions, la recette à dix millions sept cent soixante-cinq mille francs. Les dépenses faites par la Commission impériale montèrent à vingt-trois millions quatre cent quarante mille francs; les subventions et les recettes fournirent une somme totale de vingt-six millions deux cent cinquante-sept mille francs; donc boni de deux millions huit cent seize mille francs.
En 1878, le nombre des exposants fut plus considérable qu’en 1867. Cette fois l’Exposition comprenait sept cent quarante-cinq mille cinq cent trente-cinq mètres carrés; la recette fut de vingt-trois millions sept cent mille francs, avec la subvention de la ville de Paris.
En 1889, la surface totale a été de neuf cent cinquante mille quatre-vingts mètres carrés; le nombre des entrées s’est élevé à trente-deux millions cinq cent mille. Les recettes ont atteint cinquante millions: boni de dix millions.
Les chiffres ont aussi leur éloquence: nous sommes loin des cent dix exposants de 1798.
[7] Trocadéro: nom donné à une colline près Paris, pour perpétuer le souvenir d’un fait d’armes des troupes françaises qui, en 1823, sous les ordres du duc d’Angoulême, s’emparèrent du fort du Trocadéro, dans l’île de Léon, près Cadix, ce qui entraîna la reddition de cette ville. Depuis Paris s’est beaucoup agrandi, il a englobé la colline, et le palais bâti dessus a pris son nom.
[8] J’ai lu depuis dans un journal cet entrefilet:
Le métier de commissaire priseur est farci d’imprévu. L’un d’eux mettait samedi aux enchères un chêne antédiluvien. Cet arbre géant, témoin des temps préhistoriques que l’on trouva il y a quelques années, dans le lit du Rhône, a été vendu, avec le bateau spécial qui l’avait apporté lors de l’Exposition 4300 francs.
[9] Voilà neuf ans que j’écrivais ces lignes, mon séquoia est redevenu arbre. Je livre aux savantes méditations des arboriculteurs ce cas de puissante végétation absolument exceptionnelle.
[10] Les plaisants qui n’ont pu en retenir un traître mot offrent 500 fr. à la personne capable de les retenir après dix minutes d’étude.
[11] En effet j’ai dû écrire à mon estimable ami; retourner une seconde fois chez M. Feuardent, et enfin une troisième et dernière pour prendre la livraison des dites médailles, en un mot cela m’a coûté 5 heures de temps et 3 courses de voiture.