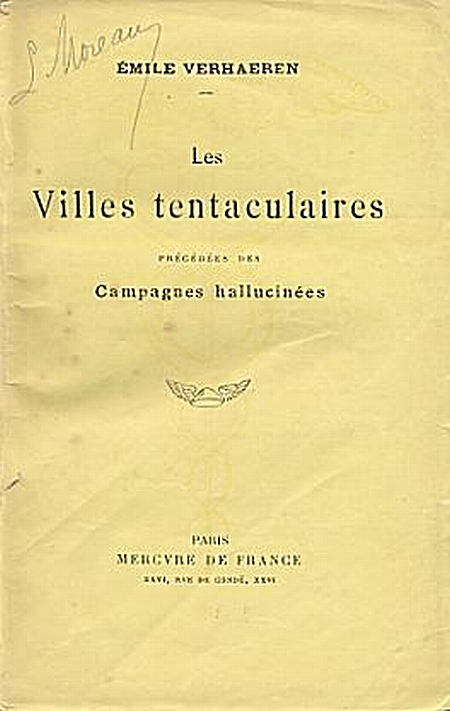
Title: Les Villes tentaculaires, précédées des Campagnes hallucinées
Author: Emile Verhaeren
Release date: May 5, 2014 [eBook #45590]
Most recently updated: October 24, 2024
Language: French
Credits: E-text prepared by Marc D'Hooghe (http://www.freeliterature.org) from page images generously made available by Internet Archive/Canadian Libraries (https://archive.org/details/toronto)
The Project Gutenberg eBook, Les Villes tentaculaires, précédées des Campagnes hallucinées, by Emile Verhaeren
| Note: | Images of the original pages are available through Internet Archive. See https://archive.org/details/lesvillestentacu00verhuoft |
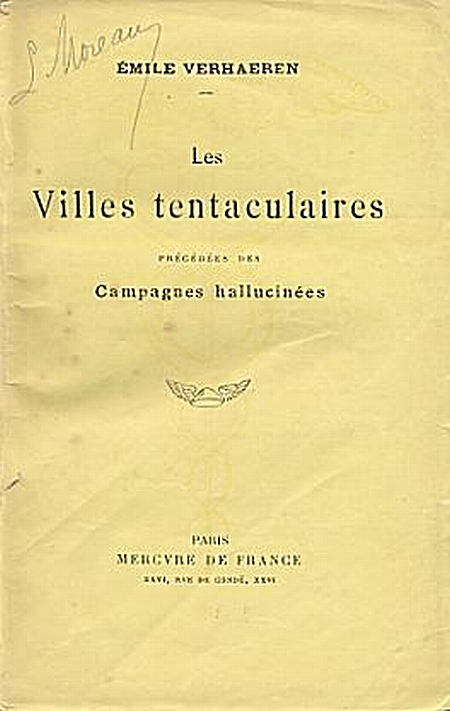
LA VILLE
Tous les chemins vont vers la ville.
Du fond des brumes,
Là-bas, avec fous ses étages
Et ses grands escaliers et leurs voyages
Jusques au ciel, vers de plus hauts étages,
Comme d'un rêve, elle s'exhume.
Là-bas,
Ce sont des ponts tressés en fer
Jetés, par bonds, à travers l'air;
Ce sont des blocs et des colonnes
Que dominent des faces de gorgonnes;
Ce sont des tours sur des faubourgs,
Ce sont des toits et des pignons,
En vols plies, sur les maisons;
C'est la ville tentaculaire,
Debout,
Au bout des plaines et des domaines.
Des clartés rouges
Qui bougent
Sur des poteaux et des grands mâts,
Même à midi, brûlent encor
Comme des œufs monstrueux d'or
Le soleil clair ne se voit pas:
Bouche qu'il est de lumière, fermée
Par le charbon et la fumée,
Un fleuve de naphte et de poix
Bal les môles de pierre et les pontons de bois
Les sifflets crus des navires qui passent
Hurlent la peur dans le brouillard:
Un fanal vert est leur regard
Vers l'océan et les espaces.
Des quais sonnent aux entrechocs de leurs fourgons
Des tombereaux grincent comme des gonds,
Des balances de fer font choir des cubes d'ombre
Et les glissent soudain en des sous-sols de feu;
Des ponts s'ouvrant par le milieu,
Entre les mâts touffus dressent un gibet sombre
Et des lettres de cuivre inscrivent l'univers,
Immensément, par à travers
Les toits, les corniches et les murailles,
Face à face, comme en bataille.
Par au-dessus, passent les cabs, filent les roues,
Roulent les trains, vole l'effort,
Jusqu'aux gares, dressant, telles des proues
Immobiles, de mille en mille, un fronton d'or.
Les rails ramifiés rampent sous terre
En des tunnels et des cratères
Pour reparaître en réseaux clairs d'éclairs
Dans le vacarme et la poussière.
C'est la ville tentaculaire.
La rue—et ses remous comme des câbles
Noués autour des monuments—
Fuit et revient en longs enlacements;
Et ses foules inextricables
Les mains folles, les pas fiévreux,
La haine aux yeux,
Happent des dents le temps qui les devance.
A l'aube, au soir, la nuit,
Dans le tumulte et la querelle, ou dans l'ennui,
Elles jettent vers le hasard l'âpre semence
De leur labeur que l'heure emporte.
Et les comptoirs mornes et noirs
Et les bureaux louches et faux
Et les banques battent des portes
Aux coups de vent de leur démence.
Dehors, une lumière ouatée,
Trouble et rouge, comme, un haillon qui brûle,
De réverbère en réverbère se recule.
La vie, avec des flots d'alcool est fermentée.
Les bars ouvrent sur les trottoirs
Leurs tabernacles de miroirs
Où se mirent l'ivresse et la bataille;
Une aveugle s'appuie à la muraille
Et vend de la lumière, en des boîtes d'un sou;
La débauche et la faim s'accouplent en leur trou
Et le choc noir des détresses charnelles
Danse et bondit à mort dans les ruelles.
Et coup sur coup, le rut grandit encore
Et la rage devient tempête:
On s'écrase sans plus se voir, en quête
Du plaisir d'or et de phosphore;
Des femmes s'avancent, pâles idoles,
Avec, en leurs cheveux, les sexuels symboles.
L'atmosphère fuligineuse et rousse
Parfois loin du soleil recule et se retrousse
Et c'est alors comme un grand cri jeté
Du tumulte total vers la clarté;
Places, hôtels, maisons, marchés,
Ronflent et s'enflamment si fort de violence
Que les mourants cherchent en vain le moment de silence,
Qu'il faut aux yeux pour se fermer.
Telle, le jour—pourtant, lorsque les soirs
Sculptent le firmament, de leurs marteaux d'ébène,
La ville au loin s'étale et domine la plaine
Comme un nocturne et colossal espoir;
Elle surgit: désir; splendeur, hantise;
Sa clarté se projette en lueurs jusqu'aux cieux,
Son gaz myriadaire en buissons d'or s'attise,
Ses rails sont des chemins audacieux
Vers le bonheur fallacieux
Que la fortune et la force accompagnent;
Ses murs se dessinent pareils à une armée
Et ce qui vient d'elle encore de brume et de fumée
Arrive en appels clairs vers les campagnes.
C'est la ville tentaculaire,
La pieuvre ardente et l'ossuaire
Et la carcasse solennelle.
Et les chemins d'ici s'en vont à l'infini
Vers elle.
LES PLAINES
Sous la tristesse et l'angoisse des cieux
Les lieues
S'en vont autour des plaines;
Sous les cieux bas
Dont les nuages traînent,
Immensément, les lieues
Marchent, là-bas.
Droites sur des chaumes, les tours;
Et des gens las, par tas,
Qui vont de bourg en bourg.
Les gens vaguants
Comme la route, ils ont cent ans;
Ils vont de plaine en plaine,
Depuis toujours, à travers temps;
Les précèdent ou bien les suivent
Les charrettes dont les convois dérivent
Vers les hameaux et les venelles,
Les charrettes perpétuelles,
Criant le lamentable cri,
Le jour, la nuit,
De leurs essieux vers l'infini.
C'est la plaine, la plaine
Immensément, à perdre haleine.
De pauvres clos ourlés de haies
Ecartèlent leur sol couvert de plaies;
De pauvres clos, de pauvres fermes,
Les portes lâches
Et les chaumes, comme des bâches,
Que le vent troue à coups de hache.
Aux alentours, ni trèfle vert, ni luzerne rougie,
Ni lin, ni blé, ni frondaisons, ni germes,
Depuis longtemps, l'arbre, par la foudre cassé,
Moule, devant le seuil usé,
Comme un malheur en effigie.
C'est la plaine, la plaine blême,
Interminablement, toujours la même.
Par au dessus, souvent,
Rage si fort le vent
Que l'on dirait le ciel fendu
Aux coups de boxe
De l'équinoxe.
Novembre hurle, ainsi qu'un loup,
Lamentable, par le soir fou.
Les ramilles et les feuilles gelées
Passent gifflées
Sur les mares, dans les allées;
Et les grands bras des Christs funèbres,
Aux carrefours, par les ténèbres,
Semblent grandir et tout à coup partir.
En cris de peur, vers le soleil perdu.
C'est la plaine, la plaine
Où ne vague que crainte et peine.
Les rivières stagnent ou sont taries,
Les flots n'arrivent plus jusqu'aux prairies,
Les énormes digues de tourbe,
Inutiles, arquent leur courbe.
Comme le sol, les eaux sont mortes;
Parmi les îles, en escortes
Vers la mer, où les anses encor se mirent.
Les haches et les marteaux voraces
Dépècent les carcasses,
Pourrissantes, de vieux navires.
C'est la plaine, la plaine
Immensément, à perdre haleine,
Où circulent, dans les ornières,
Parmi l'identité
Des champs du deuil et de la pauvreté,
Les désespoirs et les misères;
C'est la plaine, la plaine
Que sillonnent des vols immenses
D'oiseaux criant la mort
En des houles de cieux au Nord;
C'est la plaine, la plaine
Mate et longue comme la haine,
La plaine et le pays sans fin
D'un blanc soleil comme la faim,
Où, sur le fleuve solitaire,
Tourne aux remous toute la douleur de la terre.
CHANSON DE FOU
Le crapaud noir sur le sol blanc
Me fixe indubitablement
Avec des yeux plus grands que n'est grande sa tête;
Ce sont les yeux qu'on m'a volés
Quand mes regards s'en sont allés,
Un soir, que je tournai la tête.
Mon frère?—il est quelqu'un qui ment,
Avec de la farine entre ses dents;
C'est lui, jambes et bras en croix,
Qui tourne au loin, là-bas,
Qui tourne au vent,
Sur ce moulin de bois.
Et celui-ci, c'est mon cousin
Qui fut curé et but si fort du vin
Que le soleil en devint rouge;
J'ai su qu'il habitait un bouge,
Avec des morts, dans ses armoires.
Car nous avons pour génitoires
Deux cailloux
Et pour monnaie un sac de poux
Nous, les trois fous,
Qui épousons, au clair de lune.
Trois folles dames sur la dune.
LE DONNEUR DE MAUVAIS CONSEILS
Par les chemins bordés de pueils
Rôde en maraude
Le donneur de mauvais conseils.
La vieille carriole en bois vert-pomme
Qui l'emmena, on ne sait d'où,
Une folle la garde avec son homme,
Aux carrefours des chemins mous.
Le cheval paît l'herbe d'automne,
Près d'une mare monotone,
Dont l'eau malade réverbère
Le soir de pluie et de misère
Qui tombe en loques sur la terre.
Le donneur de mauvais conseils
Est attendu dans le village,
A l'heure où tombe le soleil.
Il est le visiteur oblique et louche
Qui, de ferme en ferme, s'abouche,
Quand la détresse et la ruine
Ronflent en tempêtes sur les chaumines.
Il est celui qui frappe à l'huis,
Tenacement, et vient s'asseoir
Lorsque le hâve désespoir,
Fixe ses regards droits
Sur le feu mort des âtres froids.
En habits vieux comme ses yeux,
Avec sa blouse lâche
Et ses poches où vivement il cache
Les fioles et les poisons,
Mi-paysan, mi-charlatan,
Retors, petit, ratatiné,
Mains finaudes, ongles fanés,
Il égrène ainsi qu'un texte
Les faux moyens et les prétextes
Et les foisons des mauvaises raisons.
On l'écoute, qui lentement marmonne,
Toujours ardent et monotone,
Prenant à part chacun de ceux
Dont les arpents sont cancéreux,
Dont les moissons sont vaines
Et qui regardent devant eux
Las, trébuchants et malchanceux,
La mort venir du bout des plaines de leurs haines.
A qui, devant sa lampe éteinte,
Seul avec soi, quand minuit tinte,
S'en va tâtant aux murs de sa chaumière
Les trous qu'y font les vers de la misère,
Sans qu'un secours ne lui vienne jamais,
Il conseille d'aller, au fond de l'eau,
Mordre des dents les exsangues reflets
De sa face dans un marais.
A tel qui branle et traîne un corps
Comme un haillon à un bâton.
Usé d'espoir, tari d'efforts;
A qui grimace sa vieillesse
Devant l'orgueil du vieux soleil,
Il reproche les avanies,
Que font ses fils qui le renient,
A l'infini de sa faiblesse.
Il pousse au mal la fille ardente.
Avec du crime au bout des doigts,
Avec des veux comme la poix
Et des regards qui violentent.
Il attise en son cœur le vice
A mots cuisants et rouges,
Pour qu'en elle la femelle et la gouge
Biffent la mère et la nourrice
Et que sa chair soit aux amants,
Morte, comme ossements et pierres
Du cimetière.
Aux vieux couples qui font l'usure
Depuis que les malheurs ravagent
Les villages, à coups de rage,
Il vend les moyens sûrs
Et la ténacité qui réussit toujours
A ruiner hameaux et bourgs,
Quand, avec l'or tapi au creux
De l'armoire crasseuse ou de l'alcôve immonde,
On s'imagine, en un logis lépreux,
Être le roi qui tient le monde.
Enfin, il est le conseiller de ceux
Qui profanent la nuit des saints dimanches
En boutant l'incendie à leurs granges de planches.
Il indique l'heure précise
Où le tocsin sommeille aux tours d'église,
Où seul, avec ses yeux insoucieux,
Le silence regarde faire.
Ses gestes secs et entêtés
Numérotent ses volontés,
Et l'ombre de ses doigts semble ligner d'entailles
Le crépi blanc de la muraille.
Et pour conclure il verse à tous
Un peu du fiel de son vieux cœur
Moisi de haine et de rancœur;
Et désigne le rendez-vous,
—Quand ils voudront—au coin des bordes,
Où, près de l'arbre, ils trouveront
Pour se brancher un bout de corde.
Ainsi va-t-il de ferme en ferme;
Plus volontiers, lorsque le terme
Au tiroir vide inscrit sa date,
Le corps craquant comme des lattes,
Le cou maigre, le pas traînant,
Mais inusable et permanent,
Avec sa pauvre carriole
Avec son fou, avec sa folle,
Qui l'attendent, jusqu'au matin,
Au carrefour des vieux chemins.
CHANSON DE FOU
Je les ai vus, je les ai vus,
Ils passaient par les sentes,
Avec leurs yeux, comme des fentes,
Et leurs barbes, comme du chanvre.
Deux bras de paille,
Un dos de foin.
Blesses, troués, disjoints,
Ils s'en venaient des loins,
Comme d'une bataille.
Un chapeau mou sur leur oreille,
Un habit vert comme l'oseille;
Ils étaient deux, ils étaient trois,
J'en ai vu dix, qui revenaient du bois.
L'un d'eux a pris mon âme
Et mon âme comme une cloche
Vibre en sa poche.
L'autre a pris ma peau
—Ne le dites à personne—
Ma peau de vieux tambour
Qui sonne.
Quant à mes pieds, ils sont liés,
Par des cordes au terrain ferme;
Regardez-moi, regardez-moi,
Je suis un terme.
Un paysan est survenu
Qui nous piqua dans le sol nu,
Eux tous et moi, vieilles défroques,
Dont les enfants se moquent.
Et nous servons d'épouvantails qui veillent
Aux corbeaux lourds et aux corneilles.
PÈLERINAGE
Où vont les vieux paysans noirs
Par les couchants en or des soirs
Dans les campagnes rouges?
A grands coups d'ailes affolées,
En leurs toujours folles volées,
Les moulins fous fauchent le vent.
Les cormorans du vieil automne
Clament au loin—et le ciel tonne
Comme un tocsin parmi la nuit.
C'est l'heure ample de la terreur,
Où passe en son charroi d'horreur,
Le vieux Satan des labours rouges.
Par la campagne en grand deuil d'or,
Où vont les vieux silencieux?
Quelqu'un a dû frapper l'été
De mauvaise fécondité:
Le blé, très dru, ne fut que paille.
Les bonnes eaux n'ont point coulé
Par les veines du champ brûlé;
Quelqu'un a dû frapper les sources;
Quelqu'un a dû sécher la vie,
Comme une gorge inassouvie,
D'un seul grand coup vide un plein verre,
Par la campagne en grand deuil d'or.
Où vont les vieux et leur misère?
L'âpre semeur des mauvais germes,
Aux jours d'Avril baignant les fermes,
Les vieux l'ont tous senti passer.
Ils l'ont surpris morne et railleur,
Penché sur les moissons en fleur;
Plein de foudre, comme l'orage.
Les vieux n'ont rien osé se dire.
Mais tous, craignant son rire
Et que peut-être il ne revînt;
Sachant de plus par quel moyen
On peut fléchir Satan païen,
Qui règne encor sur la moisson,
Par la campagne en grand deuil d'or,
Où vont les vieux et leur frisson?
Le semeur d'or du mauvais blé
Entend venir ce défilé
D'hommes qui se taisent et marchent.
Il sait que seuls ils ont encore,
Au fond du cœur, qu'elle dévore,
Toute la peur de l'inconnu.
Qu'obstinément ils dérobent en eux
Son culte, sombre et lumineux,
Comme un minuit blanc de mercure,
Et qu'ils redoutent ses révoltes,
Et qu'ils supplient pour leurs récoltes
Plus devant lui que devant Dieu.
Par la campagne en grand deuil d'or.
Où vont les vieux porter leur vœux?
Le Satan d'or des champs brûlés.
Et des fermiers ensorcelés
Qui font des croix de la main gauche,
Ce soir, dans le bois d'ombre et de feu rouge
Sur un bloc noir qui soudain bouge,
Depuis une heure est accoudé.
Les vieux ont pu l'apercevoir,
Avec des yeux dardés vers eux,
D'entre ses cils de chardons morts.
Ils ont senti qu'il écoutait
Les silences de leur souhait
Et leur prière uniquement pensée.
Alors, subitement,
Avec des gestes joints
Tendus vers lui de loin,
Pour seule offrande et seuls indices
En un grand feu de branches lisses.
Ils ont jeté un chat vivant.
La bête, les pattes pliées,
Est morte, en des rages liées.
Après—vers son chaume tanné
De vents d'automne et de grand froid,
Chacun, par un chemin à soi,
Sans rien savoir est retourné.
CHANSON DE FOU
Brisez-leur pattes et vertèbres,
Chassez les rats, les rats.
Et puis versez du froment noir,
Le soir,
Dans les ténèbres.
Jadis, lorsque mon cœur cassa.
Une femme le ramassa
Pour le donner aux rats.
—Brisez-leur pattes et vertèbres
Souvent je les ai vus dans l'âtre,
Taches d'encre parmi le plâtre,
Qui grignottaient ma mort.
—Brisez-leur pattes et vertèbres.
L'un deux, je l'ai senti
Grimper sur moi la nuit,
Et mordre encor le fond du trou
Que fit, dans ma poitrine,
L'arrachement de mon cœur fou.
—Brisez-leur pattes et vertèbres.
Ma tête à moi les vents y passent,
Les vents qui passent sous la porte,
Et les rats noirs de haut en bas
Peuplent ma tête morte.
—Brisez-leur pattes et vertèbres.
Car personne ne sait plus rien.
Et qu'importent le mal, le bien,
Les rats, les rats sont là, par tas,
Dites, verserez-vous, ce soir,
Le froment noir,
A pleines mains, dans les ténèbres?
LES FIÈVRES
La plaine, au loin, est uniforme et morne
Et l'étendue est veule et grise
Et Novembre qui se précise
Bat l'infini, d'une aile grise.
De village en village, un vent moisi
Appose aux champs sa flétrissure;
L'air est moite; le sol, ainsi
Que pourriture et bouffissure.
Sous leurs torchis qui se lézardent,
Les chaumières, là-bas, regardent
Comme des bêtes qui ont peur,
Et seuls les grands oiseaux d'espace
Jettent sur les chaumes et leur frayeur,
Le cri des angoisses qui passent.
L'heure est venue où les soirs mous
Pèsent sur les terres envenimées
Où les marais visqueux et blancs,
Dans leurs remous,
A longs bras lents,
Brassent les fièvres empoisonnées.
Sur les étangs en plates-bandes
Les fleurs, comme des glandes,
Et les mousses, comme des viandes,
S'étendent.
Bosses et creux et stigmates d'ulcères,
Quelques saules bordent les anses,
Où des flottilles de viscères,
A la surface, se balancent,
Parfois, comme un hoquet,
Un flot pâteux mine la rive
Et la glaise, comme un paquet,
Tombe dans l'eau de bile et de salive.
L'étang s'apaise, qui remuait ses rides,
Les crapauds noirs, à fleur de boue,
Gonflent leur peau et leur gadoue.
Et la lune monstrueuse préside:
Telle l'hostie
De l'inertie.
De la vase profonde et jaune
D'où s'érigent, longues d'une aune,
Les herbes d'eaux et les roseaux,
Des brouillards lents comme des traînes,
Déplient leur flottement, parmi les draines;
On les peut suivre, à travers champs,
Vers les chaumes et les murs blancs;
Leurs fils subtils de pestilence
Tissent la robe de silence,
Gaze verte, tulle blême.
Avec laquelle, au loin, la fièvre se promène.
La fièvre,
Elle est celle qui marche,
Sournoisement, courbée en arche,
Et personne n'entend son pas.
Si la poterne des fermes ne s'ouvre pas,
Si la fenêtre est close,
Elle pénètre quand même et se repose,
Sur la chaise des vieux que les ans ploient,
Dans les berceaux où les petits larmoient
Et quelquefois elle se couche
Aux lits profonds où l'on fait souche.
Avec ses vieilles mains dans l'âtre encor rougeâtre,
Elle attise les maladies
Non éteintes, quoique engourdies;
Elle se mêle au pain qu'on mange
A l'eau morne changée en fange;
Elle monte jusqu'aux greniers,
Dort dans les sacs et les paniers
Et, comme une impalpable cendre,
Sans rien voir, on sent d'elle la mort descendre.
Inutiles, vœux et pèlerinages
Et seins où l'on abrite les petits
Et bras en croix vers les images
Des bons anges et des vieux Christs.
Le mal have s'est installé dans la demeure.
Il vient, chaque vesprée, à tel moment
Déchiqueter la plainte et le tourment,
Au régulier tic-tac de l'heure;—
Les mendiants n'arrivent plus souvent
A la porte ni à l'auvent
Prier qu'on les gare du froid,
Les moineaux francs quittent le toit,
Et l'horloge surgit déjà
Celle, debout, qui sonnera,
Après la voix éteinte et la raison finie,
L'agonie.
En attendant, les mois se passent à languir.
Les malades rapetisses
Leurs habits lourds, leurs bras cassés,
Avec, en main, leurs chapelets,
Quittant leur lit, s'y recouchant,
Fuyant la mort et la cherchant,
Bégaient et vacillent leurs plaintes,
Pauvres lumières, presque éteintes.
Ils se traînent de chaumière en chaumière
Et d'âtre en âtre,
Se voir et doucement s'apitoyer
Sur la dîme d'hommes qu'il faut payer,
Atrocement à leur terre marâtre;
Des silences profonds coupent les litanies
De leurs misères infinies;
Et, longuement, parfois, ils se regardent
Au jour douteux de la fenêtre,
Et longuement, avec des pleurs,
Comme s'ils voulaient se reconnaître
Lorsque leurs yeux seront ailleurs.
Ils se sentent de trop autour des tables
Où l'on mange rapidement
Un repas pauvre et lamentable;
Leur cœur se serre atrocement,
On les isole et les bêtes les flairent
Et les jurons et les colères
Volent autour de leur tourment.
Aussi, lorsque la nuit, ne dormant pas
Ils s'agitent entre leurs draps
Songeant qu'aux alentours, de village en village,
Les brouillards blancs sont en voyage,
Voudraient-ils ouvrir la porte
Pour que d'un coup la fièvre les emporte,
Vers les étangs en plates-bandes
Où les plantes comme des glandes
Et les mousses comme des viandes
S'étendent,
Où s'écoute, comme un hoquet,
Un flot pâteux minant la rive
Ou leur corps mort, comme un paquet,
Choirait dans l'eau de bile et de salive.
Mais la lune, là-bas, préside,
Telle l'hostie
De l'inertie.
CHANSON DE FOU
Celui qui n'a rien dit
Est mort, le cœur muet,
Lorsque la naît
Sonnait
Ses douze coups
Au cœur des minuits fous.
—Serrez-le vite en un linceul de paille,
Les poings noués, et qu'il s'en aille.
Celui qui n'a rien dit
M'a pris mon âme et mon esprit.
Il a sculpté mon crâne
En navet creux, dont les chandelles
Sont mes prunelles.
—Nouez-le donc, nouez le mon,
Rageusement, en son linceul de paille.
Celui qui n'a rien dit
Dormait, sous le rameau bénit,
Avec sa femme, en un grand lit,
Quand j'ai tapé comme une bête
Avec une pierre, contre sa tête.
Derrière le mur de son front
Battait mon cerveau noir,
Matin et soir, je l'entendais
Et le voyais qui m'invoquait
D'un rythme lourd comme un hoquet;
Il se plaignait de tant souffrir
Et d'être là, hors de moi-même, et d'y pourrir
Comme les loques d'une viande
Pendue au clou, au fond d'un trou.
Celui qui n'a rien dit, même des yeux,
Qu'on lui coupe le cœur en deux,
Et qu'il s'en aille
En son linceul de paille.
Que sa femme qui le réclame
Et hurle après son âme,
Ainsi qu'une chienne, la nuit,
Se taise ou bien s'en aille aussi
Comme servante ou bien vassale.
Moi je veux être
Le maître
D'une cervelle colossale.
—Nouez le mort en de la paille
Comme un paquet de ronces;
Et qu'on piétine et qu'on travaille
La terre où il s'enfonce.
Je suis le fou des longues plaines
Infiniment, que bat le vent
A grands coups d'ailes,
Comme les peines éternelles;
Le fou qui veut rester debout,
Avec sa tête jusqu'au bout
Des temps futurs, où Jésus-Christ
Viendra juger l'âme et l'esprit,
Comme il est dit.
Ainsi soit-il.
LE PÉCHÉ
Sur sa butte que le vent gifle,
Il tourne et fauche et ronfle et siffle
Le vieux moulin des péchés vieux
Et des forfaits astucieux.
Il geint des pieds jusqu'à la tète,
Sur fond d'orage et de tempête,
Lorsque l'automne et les nuages
Frôlent son toit de leurs voyages.
L'hiver, quand la campagne est éborgnée,
Il apparaît une araignée
Colossale, tissant ses toiles
Jusqu'aux étoiles.
C'est le moulin des vieux péchés.
Qui l'écoute, parmi les routes,
Entend battre le cœur du diable,
Dans sa carcasse insatiable.
Un travail d'ombre et de ténèbres
S'y fait, pendant les nuits funèbres,
Quand la lune fendue
Gît-là, sur le carreau de l'eau,
Comme une hostie atrocement mordue.
C'est le moulin de la ruine
Qui moud le mal et le répand aux champs,
Infini, comme une bruine.
Ceux qui sournoisement écornent
Le champ voisin en déplaçant les bornes;
Ceux qui, valets d'autrui, sèment l'ivraie
Au lieu de l'orge vraie;
Ceux qui jettent les poisons clairs dans l'eau
Où l'on amène le troupeau:
Ceux qui, par les nuits seules,
En brasiers d'or font éclater les meules,
Tous passèrent par le moulin.
Encore:
Les conjureurs de sorts et les sorcières
Que vont trouver les filles-mères;
Ceux qui cachent dans les fourrés
Leurs ruts et leurs spasmes vociférés;
Ceux qui n'aiment la chair que si le sang
Gicle aux jeux, frais et luisant;
Ceux qui s'entr'égorgent, à couteaux rouges,
Volets fermés, au fond des bouges;
Ceux qui flairent l'espace
Avec, entre leurs poings, là mort pour tel qui passe,
Tous passèrent par le moulin.
Aussi
Les vagabonds qui habitent des fosses
Avec leurs filles qu'ils engrossent;
Les fous qui choisissent des bêtes
Pour assouvir leur rut et ses tempêtes;
Les mendiants qui déterrent les mortes
Rageusement et les emportent;
Les couples noirs, pervers et vieux,
Qui instruisent l'enfanta coucher entre eux deux
Tous passèrent par le moulin.
Enfin:
Ceux qui font de leur cœur l'usine,
Où fermente l'envie et cuve la lésine;
Ceux qui dorment, sans autre vœux,
Avec leurs sous, comme avec Dieu;
Ceux qui projettent leurs prières,
Croix à rebours et paroles contraires;
Ceux qui cherchent un tel blasphème
Que descendrait vers eux Satan lui-même;
Tous passèrent par le moulin.
Ils sont venus sournoisement,
Choisissant l'heure et le moment,
Les uns lents et chenus
Et les autres mâles et fermes,
Avec le sac au dos.
Ils sont venus des bourgs perdus
Gagnant les bois, tournant les fermes,
Les vieux, carcasses d'os,
Mais les jeunes, drapeaux de force.
Par des chemins rugueux comme une écorce,
Ils sont montés—et quand ils sont redescendus,
Avec leurs chiens et leurs brouettes
Et leurs ânes et leurs charrettes,
Chargés de farine ou de grain,
Par groupes noirs de pèlerins,
Les grand'routes charriaient toutes.
Infiniment, comme des veines,
Le sang du mal parmi les plaines.
Et le moulin tournait au fond des soirs,
La croix grande de ses bras noirs,
Avec des feux, comme des yeux,
Dans l'orbite de ses lucarnes
Dont les rayons gagnaient les loins.
Parfois, s'illuminaient des coins,
Là-bas; dans la campagne morne
Et l'on voyait les porteurs gourds,
Ployant au faix des péchés lourds,
Hagards et las, buter de borne en borne.
Et le moulin ardent,
Sur sa butte, comme une dent,
Alors, mêlait et accordait
Son giroiement de voiles
Au rythme même des étoiles
Qui tournoyaient, par les nuits seules,
Fatalement, comme ses meules.
CHANSON DE FOU
Vous aurez beau crier contre la terre,
La bouche dans le fossé,
Jamais aucun des trépassés
Ne répondra à vos clameurs amères.
Ils sont bien morts, les morts,
Ceux qui firent jadis la campagne féconde;
Ils font l'immense entassement de morts
Qui pourrissent, aux quatre coins du monde,
Les morts.
Alors
Les champs étaient maîtres des villes
Le même esprit servile
Ployait partout les fronts et les échines,
Et nul encor ne pouvait voir
Dressés, au fond du soir,
Les bras hagards et formidables des machines.
Vous aurez beau crier contre la terre,
La bouche dans le fossé:
Ceux qui jadis étaient les trépassés
Sont aujourd'hui, jusqu'au fond de la terre,
Les morts.
LES MENDIANTS
Les jours d'hiver quand le froid serre
Les bourgs, le clos, le bois, la fagne,
Poteaux de haine et de misère,
Par l'infini de la campagne,
Les mendiants ont l'air de fous.
Dans le matin, lourds de leur nuit,
Ils s'enfoncent au creux des routes,
Avec leur pain trempé de pluie
Et leur chapeau comme la suie
Et leurs grands dos comme des voûtes
Et leurs pas lents rythmant l'ennui;
Midi les arrête dans les fossés
Matelassés de feuilles, pour leur sieste;
Ils sont les éternellement lassés
De leur prière et de leur geste,
Si bien qu'au seuil des fermes solitaires
Ils apparaissent, tels des filous,
Le soir, dans la brusque lumière
D'une porte ouverte tout à coup.
Les mendiants ont l'air de fous.
Ils s'avancent, par l'âprete
Et la stérilité du paysage,
Qu'ils reflètent, au fond des yeux
Tristes de leur visage;
Avec leurs bardes et leurs loques
Et leur marche qui les disloque,
L'été, parmi les champs nouveaux,
Ils épouvantent les oiseaux;
Et maintenant que décembre sur les bruyères
S'acharne et mord
Et gèle, au fond des bières
Du cimetière,
Les morts,
Un à un, ils s'immobilisent
Sur des chemins d'église,
Mornes, têtus et droits,
Les mendiants, comme des croix.
Les mendiants ont l'air de fous.
Avec leur dos comme un fardeau
Et leur chapeau comme la suie,
Ils habitent les carrefours
Du vent et de la pluie.
Ils sont le monotone pas
—Celui qui vient et qui s'en va
Toujours le même et jamais las—
De l'horizon vers l'horizon.
Ils sont les béquillants,
Les chavirés et les bancroches;
Et leurs bâtons sont les battants
Des cloches de misère
Qui sonnent à mort sur la terre.
Ils sont les éternels stigmatisés
Par la pitié et les miséricordes
Les épuisés et les usés
D'âme et de corps
Jusqu'à la corde.
Aussi, lorsqu'ils tombent enfin,
Séchés de soif, troués de faim,
Et se terrent comme des loups,
Le soir,
Au fond d'un trou,
Le désespoir
Plus vieux que n'est la mer
Se fixe en leurs grands yeux ouverts.
Et ceux qui viennent
Après les besognes quotidiennes,
Ensevelir à la hâte leur corps
Ont peur de regarder en face
L'éternelle menace
Qui luit sous leur paupière, encor.
LA KERMESSE
Avec colère, avec détresse,
Avec ses refrains de quadrilles,
Qui sautèlent sur leurs béquilles,
L'orgue canaille et lourd,
Au fond du bourg,
Moud la kermesse.
Quelques étals, au coin des bornes.
Et quelques vieilles gens,
Au seuil d'un portail morne.
Et quelques couples seuls qui se hasardent,
Les gars braillards et les filles hagardes,
Alors qu'au cimetière deux corbeaux,
Sur les tombeaux,
Regardent.
Avec colère, avec détresse, avec blasphème.
Mais, vers la fête
Quand même,
L'orgue s'entête.
Sa musique de tintamarres
Se casse, en des bagarres
De cuivre vert et de fer blanc,
Et crie et grince dans le vide,
Obstinément,
Sa note acide.
Sur la place, l'église,
Sous le cercueil de ses grands toits
Et les linceuls de ses murs droits,
Tait les reproches
Solennels de ses cloches;
Un charlatan, sur un tréteau,
Pantalon rouge et vert manteau,
Vend à grands cris la vie;
Puis échange, contre des sous,
Son remède pour loups garous
Et l'histoire de point en point suivie,
Sur sa pancarte,
D'un bossu noir qu'il délivra de fièvre quarte.
Et l'orgue rage
Son quadrille sauvage.
Et personne, des hameaux proches,
N'est accouru;
Vides les étables—vides les poches,
Et rien que la mort et la faim
Dont se peuple l'armoire à pain;
Dans la misère qui les soude
On sent que les hameaux se boudent,
Qu'entre filles et gars d'amour
La pauvreté découd les alliances
Et que les jours suivant les jours
Chacun des bourgs
Fait son silence avec ses défiances.
L'orgue grinçant et faux,
Dans son armoire
D'architecture ostentatoire,
Criaille un bruit de faux
Et de cisailles.
Dans la salle de plâtre cru,
Où ses cris tors et discors, dru,
Contre des murs de lattes
Eclatent,
Des colonnes de verre et de jouants bâtons
—Clinquant et or—tournent sur son fronton;
Et les concassants bruits des cors et des trompettes
Et les fifres, tels des forêts,
Cinglent et trouent le cabaret
De leurs tempêtes
Et vont là-bas
Contre un pignon, avec fracas,
Broyer l'écho de la grand'rue.
Et l'orgue avec sa rage
S'ameute une dernière fois et rue
Des quatre fers de son tapage
Jusqu'aux lointains des champs,
Jusqu'aux routes, jusqu'aux étangs,
Jusqu'aux jachères de méteil,
Jusqu'au soleil;
Et seuls dansent aux carrefours,
Jupons gonflés et sabots lourds,
Deux pauvres fous avec deux folles.
CHANSON DE FOU
Je suis celui qui vaticine
Comme les tours tocsinnent.
J'ai vu passer à travers champs
Trois linceuls blancs
Qui s'avançaient, comme des gens.
Ils portaient des torches ignées,
Des faux blanches et des cognées.
Peu importe l'homme qu'on soit,
Moi seul je vois
Les maux qui dans les cieux flamboient,
Le sol et les germes sont condamnés,
—Vœux et larmes sont superflus—
Bientôt,
Les corbeaux noirs n'en voudront plus
Ni la taupe ni le mulot.
Je suis celui qui vaticine
Comme les tours tocsinnent.
Les fruits des espaliers se tuméfient;
Dans les feuillages noirs,
Les pousses jeunes s'atrophient;
L'herbe se brûle et les germoirs,
Subitement, fermentent;
Le soleil ment, les saisons mentent,
Le soir, sur les plaines envenimées,
C'est un vol d'ailes allumées
De souffre roux et de fumées.
J'ai vu des linceuls blancs
Entrer, comme des gens,
Qu'un même vouloir coalise,
L'un après l'autre, dans l'église,
Ceux qui priaient au chœur,
Manquant de force et de ferveur
Les mains lâches s'en sont allés.
Et depuis lors moi seul j'entends
Baller
La nuit, le jour, toujours,
La fête
Des tocsins fous contre ma tête.
Je suis celui qui vaticine
Ce que les tours tocsinnent.
Au long des soirs et des années,
Les fronts et les bras obstinés
Se buteront en vain aux destinées,
Irrémissiblement,
Le sol et les germes sont damnés.
Dire le temps que durera leur mort?
Et si l'heure resurgira
Où le vrai pain vaudra,
Sous les cieux purs de la vieille nature,
L'antique effort?
Mais il ne faut jamais conclure.
En attendant voici que passent
A travers champs,
D'autres linceuls vides et blancs
Qui se parlent comme des gens.
LE FLÉAU
La Mort a bu du sang
Au cabaret des Trois Cercueils.
La Mort a mis sur le comptoir
Un écu noir,
«C'est pour les cierges et pour les deuils.»
Des gens s'en sont allés
Tout lentement
Chercher le sacrement.
On a vu cheminer le prêtre
Et les enfants de chœur,
Vers les maisons de l'affre et du malheur
Dont on fermait les tragiques fenêtres.
La Mort a bu du sang.
Elle en est soûle.
«Notre Mère la Mort, pitié! pitié!
Ne bois ton verre qu'à moitié,
Notre Mère la Mort, c'est nous les mères.
C'est nous les vieilles à manteaux,
Avec leurs cœurs en ex-votos,
Qui marmonnons du désespoir
En chapelets interminables;
Notre Mère de la Mort et du soir,
C'est nous les béquillantes et minables
Vieilles, tannées
Par la douleur et les années:
Nos corps sont prêts pour tes tombeaux,
Nos seins sont prêts pour tes couteaux.»
—La Mort, dites, les bonnes gens,
La Mort est soûle:
Sa tête oscille et roule
Comme une boule.
La Mort a bu du sang
Comme un vin frais et bienfaisant;
Il coule doux aux joints de la cuirasse
De sa carcasse.
La Mort a mis sur le comptoir
Un écu noir.
Elle en voudra pour ses argents
Au cabaret des pauvres gens.
«Notre-Dame la Mort, c'est nous les vieux guerres
Tumultuaires,
Tronçons mornes et terribles entailles
De la forêt des victoires et des batailles,
Notre-Dame des drapeaux noirs
Et des débâcles dans les soirs,
Notre-Dame des glaives et des balles
Et des crosses contre les dalles,
Toi, notre vierge et noire orgueil,
Toujours si fière et si droite, au seuil
De l'horizon tonnant de nos grands rêves;
Notre-Dame la Mort, toi, qui te lèves,
Au battant de nos tambours,
Obéissante—et qui, toujours,
Nous fus belle d'audace et de courage,
Notre-Dame la Mort, cesse ta rage,
Et daigne enfin nous voir et nous entendre
Puisqu'ils n'ont point appris, nos fils, à se défendre.»
—La Mort, dites, les vieux verbeux,
La Mort est soûle,
Comme un flacon qui roule
Sur la pente des chemins creux.
La Mort n'a pas besoin
De votre mort au bout du monde,
C'est au pays qu'elle enfonce la bonde
Du tonneau rouge.
La Mort est bien assise, au seuil
Du Cabaret des Trois Cercueils,
Elle exècre s'en aller loin,
Sous les hasards des étendards.
«Dame la Mort, c'est moi la Sainte Vierge
Qui viens en robe d'or chez vous,
Vous supplier à deux genoux
D'avoir pitié des gens de mon village.
Dame la Mort, c'est moi, la Sainte Vierge,
De l'ex-voto, près de la berge,
C'est moi qui fus de mes pleurs inondée
Au Golgotha, dans la Judée,
Sous Hérode, voici mille ans.
Dame la Mort, c'est moi, la Sainte Vierge
Qui fis promesse aux gens d'ici
D'aller toujours crier merci
Dans leurs détresses et leurs peines;
Dame la Mort, c'est moi la Sainte Vierge.»
—La Mort, dites, la bonne Dame,
Se sent au cœur comme une flamme
Qui, de là, monte à son cerveau.
La Mort a soif de sang nouveau,
La Mort est soûle,
Un seul désir comme une houle,
Remplit sa brumeuse pensée.
La Mort n'est point celle qu'on éconduit
Avec un peu de prière et de bruit,
La Mort s'est lentement lassée
Des bras tendus en désespoirs,
Bonne Vierge des reposoirs,
La Mort est soûle
Et sa fureur, hors des ornières,
Par les chemins des cimetières,
Bondit et roule
Comme une boule.
—«La Mort, c'est moi, Jésus, le Roi,
Qui te fis grande ainsi que moi
Pour que s'accomplisse la loi
Des choses en ce monde.
La Mort, je suis la manne d'or
Qui s'éparpille du Thabor
Divinement, jusqu'aux confins du monda.
Je suis celui qui fus pasteur,
Chez les humbles, pour le Seigneur;
Mes mains de gloire et de splendeur
Ont rayonné sur la douleur,
La Mort, je suis la paix du monde.»
—La Mort, dites, le Seigneur Dieu,
Est assise, près d'un bon feu,
Dans une auberge où le vin coule
Et n'entend rien, tant elle est soûle.
Elle a sa faux et Dieu a son tonnerre.
En attendant, elle aime à boire et le fait voir
A quiconque voudrait s'asseoir,
Côte à côte, devant un verre.
Jésus, les temps sont vieux,
Et chacun boit comme il le peut
Et qu'importent les vêtements sordides
Lorsque le sang nous fait les dents splendides.
Et la Mort s'est mise à boire, les pieds au feu;
Elle a même laissé s'en aller Dieu
Sans se lever sur son passage;
Si bien que ceux qui la voyaient assise
Ont cru leur âme compromise.
Durant des jours et puis des jours encor, la Mort
A fait des dettes et des deuils,
Au cabaret des Trois Cercueils;
Puis, un matin, elle a ferré son cheval d'os,
Mis son bissac au creux du dos
Pour s'en aller à travers la campagne.
De chaque bourg et de chaque village,
Les gens étaient venus vers elle avec du vin,
Pour qu'elle n'eût ni soif ni faim,
Et ne fît halte au coin des routes;
Les vieux portaient de la viande et du pain,
Les femmes des paniers et des corbeilles
Et les fruits clairs de leur verger,
Et les enfants portaient des miels d'abeilles.
La Mort a cheminé longtemps,
Par le pays des pauvres gens,
Sans trop vouloir, sans trop songer,
La tête soûle
Comme une boule.
Elle portait une loque de manteau roux,
Avec de grands boutons de veste militaire,
Un bicorne piqué d'un plumet réfractaire
Et des bottes jusqu'aux genoux.
Sa carcasse de cheval blanc
Cassait un vieux petit trot lent
De bête ayant la goutte
Sur les pierres de la grand' route;
Et les foules suivaient vers n'importe où,
Le grand squelette aimable et soûl
Qui trimballait sur son cheval bonhomme
L'épouvante de sa personne
Jusqu'aux lointains de peur et de panique,
Sans éprouver l'horreur de son odeur
Ni voir danser, sous un repli de sa tunique,
Le trousseau de vers blancs qui lui tétaient le cœur.
CHANSON DE FOU
Les rats du cimetière proche,
Midi sonnant,
Bourdonnent dans la cloche.
Ils ont mordu le cœur des morts
Et s'engraissent de ses remords.
Ils dévorent le ver qui mange tout
Et leur faim dure jusqu'au bout.
Ce sont des rats
Mangeant le monde
De haut en bas.
L'église?—elle était large et solennelle
Avec la foi des pauvres gens en elle,
Et la voici anéantie
Depuis qu'ils ont, les rats,
Mangé l'hostie.
Les blocs de granit se déchaussent
Les niches d'or comme des fosses
S'entr'ouvrent vides;
Toute la gloire évocatoire
Tombe des hauts piliers et des absides
A bas.
Les rats,
Ils ont rongé les auréoles bénévoles,
Les jointes mains
De la croyance aux lendemains,
Les tendresses mystiques
Au fond des yeux des extatiques
Et les lèvres de la prière
En baisers d'or sur les bouches de la misère;
Les rats,
Ils ont rongé des bourgs entiers
De haut en bas,
Comme un grenier.
Aussi
Que maintenant s'en aillent
Les tocsins fous ou les sonnailles
Criant pitié, criant merci,
Hurlant, par au delà des toits,
Jusqu'aux échos qui meuglent,
Nul plus n'entend et personne ne voit:
Puisqu'elle est l'âme des champs,
Pour bien longtemps,
Aveugle.
Et les seuls rats du cimetière proche,
A l'Angelus hoquetant et tintant,
Causent avec la cloche.
LE DÉPART
Avec leur chat, avec leur chien,
Avec, pour vivre, quel moyen?
S'en vont, le soir, par la grand'route,
Les gens d'ici, buveurs de pluie,
Lécheurs de vent, fumeurs de brume
Les gens d'ici n'ont rien de rien,
Rien devers eux
Que l'infini, ce soir, de la grand'route.
Chacun porte au bout d'une gaule,
En un mouchoir à carreaux bleus,
Chacun porte dans un mouchoir,
Changeant de main, changeant d'épaule,
Chacun porte
Le linge usé de son espoir.
Les gens s'en vont, les gens d'ici,
Par la grand'route à l'infini.
L'auberge est là, près du bois nu,
L'auberge est là de l'inconnu;
Sur ses dalles, les rats trimballent
Et les souris.
L'auberge, au coin des bois moisis,
Grelotte, avec ses murs mangés,
Avec son toit comme une teigne,
Avec le bras de son enseigne
Qui tend au vent un os rongé.
Les gens d'ici sont gens de peur:
Ils font des croix sur leur malheur
Et tremblent;
Les gens d'ici ont dans leur âme
Deux tisons noirs, mais point de flamme,
Deux tisons noirs en croix.
Par l'infini du soir, sur la grand'route,
Voici venir les ricochets des cloches
Là-bas, au carrefour des bois.
C'est les madones des chapelles
Qui, pareilles à des oiseaux au loin perdus,
Rappellent.
Les gens d'ici sont gens de peur,
Car leurs vierges n'ont plus de cierges
Et leur encens n'a plus d'odeur:
Seules, en des niches désertes,
Quelques roses tombent inertes
Sur une image en plâtre peint.
Les gens d'ici ont peur de l'ombre sur leurs champs,
De la lune sur leurs étangs,
D'un oiseau mort contre une porte;
Les gens d'ici ont peur des gens.
Les gens d'ici sont malhabiles,
La tète lente et les vouloirs débiles
Quoique tannés d'entêtement,
Ils sont ladres, ils sont minimes
Et s'ils comptent c'est par centimes,
Péniblement, leur dénûment.
Leur récolte, depuis des chapelets d'années,
S'égrena morne en leurs granges minées;
Leurs socs taillèrent les cailloux,
Férocement, des terrains roux;
Leurs dents s'acharnèrent contre la terre
A la mordre, jusqu'au cœur même.
Avec leur chat, avec leur chien,
Avec l'oiseau dans une cage,
Avec, pour vivre, un seul moyen
Boire son mal, taire sa rage;
Les pieds usés, le cœur moisi,
Les gens d'ici,
Quittant leur gîte et leur pays,
S'en vont, ce soir, par les routes, à l'infini.
Les mères traînent à leurs jupes
Leur trousseau long d'enfants bêlants,
Brinqueballés, brinqueballants;
Les yeux clignant des vieux s'occupent
A refixer, une dernière fois,
Leur coin de terre morte et grise,
Où mord la lèpre comme la bise
Où mord la rogne comme les froids.
Suivent les gars des bordes,
Les bras usés comme des cordes,
Sans plus d'orgueil, sans même plus
Un seul élan vers les temps révolus
Et le bonheur des autrefois,
Sans plus la force en leurs dix doigts
De se serrer en poings contre le sort
Et la colère de la mort.
Les gens des champs, les gens d'ici
Ont du malheur à l'infini.
Leurs brouettes et leurs charrettes
Brinqueballent aussi,
Cassant, depuis le jour levé,
Les os pointus du vieux pavé:
Quelques-unes, plus grêles que squelettes,
Entrechoquent des amulettes
A leurs brancards,
D'autres grincent, les ais criards,
Comme les seaux d'ans les citernes
D'autres portent de vieillottes lanternes,
D'autres apparaissent, comme les proues
De vieux bateaux cassés—et leurs deux roues,
Où l'on sculpta jadis le zodiaque,
Semblent rouler le monde entier dans leur baraque.
Les chevaux las ballent au pas
Le vieux lattis de leur carcasse;
Le conducteur s'agite et se tracasse,
Comme un moulin qui serait fou,
Lançant parfois vers n'importe où,
Dans les espaces,
Une pierre lasse
Aux corbeaux noirs du sort qui passe.
Les gens d'ici
Ont du malheur—et sont soumis.
Et les troupeaux rêches et maigres,
Par les chemins rapés et par les sablons aigres,
Également sont les chassés,
Aux coups de fouet inépuisés
Des famines qui exterminent:
Moulons dont la fatigue à tout caillau ricoche,
Bœufs qui meuglent vers la mort proche,
Vaches hydropiques et lourdes
Aux pis vides comme des gourdes
Et les ânes, avec la mort crucifiée
Sur leurs côtes scarifiées.
Ainsi s'en vont bêtes et gens d'ici,
Par le chemin de ronde,
Qui fait dans la détresse et dans la nuit,
Immensément, le tour du monde.
Venant, dites, de quels lointains,
Par à travers les vieux destins,
Passant les bourgs et les bruyères,
Avec, pour seul repos, l'herbe des cimetières,
Allant, roulant, faisant des nœuds
De chemins noirs et tortueux,
Hiver, automne, été, printemps,
Toujours lassés, toujours partant
De l'infini pour l'infini.
Tandis qu'au loin, là bas,
Sous les cieux lourds fuligineux et gras,
Avec son front comme un Thabor,
Avec ses suçoirs noirs et ses rouges haleines
Hallucinant et attirant les gens des plaines,
C'est la ville que le jour plombe et que la nuit éclaire
La ville en plâtre, en stuc, en bois, en marbre, en fer, en or,
—Tentaculaire.
LA BÊCHE
A l'orient du pré, dans le sol rêche
Est là, pour à toujours, qui grelotte, la bêche
Lamentable et nue;
Sous le ciel sec, la terre sèche;
Et rien, sinon la maigre bêche,
Latte de bois mort, latte de bois nu.
—Fais une croix sur le sol jaune
Avec ta longue main,
Toi qui t'en vas, par le chemin—
La chaumière d'humidité verdâtre
Et ses deux tilleuls foudroyés
Et des cendres dans l'âtre
Et sur le mur encor le piédestal de plâtre,
Mais la Vierge tombée à terre.
—Fais une croix vers les chaumières
Avec la longue main de paix et de lumière—
Des crapauds morts dans les ornières infinies
Et des poissons dans les roseaux
Et puis un cri toujours plus pauvre et lent d'oiseau,
Infiniment, là-bas, un cri à l'agonie.
—Fais une croix avec ta main
Pitoyable, sur le chemin—
Aux verrous rouilles des étables,
L'orde araignée, elle a tissé l'étoile de poussière;
Et la ferme sur la rivière,
Par à travers ses chaumes lamentables,
Comme des bras aux mains coupées,
Croise ses poutres d'outre en outre.
—Fais une croix sur le demain,
Définitive, avec ta main—
Un double rang d'arbres et de troncs nus sont abattus,
Au long des routes en déroules,
Les villages—plus même de cloches pour en sonner
Le hoquetant dies iræ
Désespéré, vers l'écho vide et ses bouches cassées.
—Fais une croix aux quatre fronts des horizons.
Car c'est la fin des champs et c'est la fin des soirs;
Le deuil au fond des cieux tourne, comme des meules,
Ses soleils noirs;
Et des larves éclosent seules
Aux flancs pourris des femmes qui sont mortes.
A l'orient du pré, dans le sol rêche,
Sur le cadavre épars des vieux labours,
Domine là, et pour toujours,
Plaque de fer clair, latte de bois froid,
La bêche.
LA PLAINE
La plaine est morne et ses chaumes et granges
Et ses fermes dont les pignons sont vermoulus,
La plaine est morne et lasse et ne se défend plus,
La plaine est morne et morte—et la ville la mange.
Formidables et criminels,
Les bras des machines hyperboliques,
Fauchant les blés évangéliques,
Ont effrayé le vieux semeur mélancolique
Dont le geste semblait d'accord avec le ciel.
L'orde fumée et ses haillons de suie
Ont traversé le vent et l'ont sali:
Un soleil pauvre et avili
S'est comme usé en de la pluie.
Et maintenant, où s'étageaient les maisons claires
Et les vergers et les arbres allumés d'or,
On aperçoit, à l'infini, du sud au nord,
La noire immensité des usines rectangulaires.
Telle une bête énorme et taciturne
Qui bourdonne derrière un mur,
Le ronflement s'entend, rythmique et dur,
Des chaudières et des meules nocturnes;
Le sol vibre, comme s'il fermentait
Le travail bout comme un forfait,
L'égout charrie une fange velue
Vers la rivière qu'il pollue;
Un supplice d'arbres écorchés vifs
Se tord, bras convulsifs,
En façade, sur le bois proche;
L'ortie épuise aux cœurs sablons et oche
Et les fumiers, toujours plus hauts, de résidus:
Ciments huileux, plâtras pourris, moellons fendus,
Au long de vieux fossés et de berges obscures
Lèvent, le soir, leurs monuments de pourritures.
Sous des hangars tonnants et lourds,
Les nuits, les jours,
Sans air et sans sommeil,
Des gens peinent loin du soleil:
Morceaux de vie en l'énorme engrenage,
Morceaux de chair fixée, ingénieusement,
Pièce par pièce, étage par étage,
De l'un à l'autre bout du vaste tournoiement.
Leurs yeux, ils sont les yeux de la machine,
Leurs dos se ploient sous elle et leurs échines,
Leurs doigts volontaires, qui se compliquent
De mille doigts précis et métalliques,
S'usent si fort en leur effort,
Sur la matière carnassière,
Qu'ils y laissent, à tout moment,
Des empreintes de rage et des gouttes de sang.
Dites! l'ancien labeur pacifique, dans l'Août
Des seigles mûrs et des avoines rousses.
Avec les bras au clair, le front debout
Dans l'or des blés qui se retrousse
Vers l'horizon torride où le silence bout.
Dites! le repos tiède et les midis élus,
Tressant de l'ombre pour les siestes.
Sous les branches, dont les vents prestes
Rythment, avec lenteur, les grands gestes feuillus,
Dites, la plaine entière ainsi qu'un jardin gras,
Toute folle d'oiseaux éparpillés dans la lumière,
Qui la chantent, avec leurs voix plénières,
Si près du ciel qu'on ne les entend pas.
Mais aujourd'hui, la plaine, elle, est finie;
La plaine est morne et ne se défend plus:
Le flux des ruines et leurs reflux
L'ont submergée, avec monotonie.
On ne rencontre, au loin, qu'enclos rapiécés
Et chemins noirs de houille et de scories
Et squelettes de métairies
Et trains coupant soudain des villages en deux.
Les Madones ont tu leurs voix d'oracle
Au coin du bois, parmi les arbres;
Et les vieux saints et leur socle de marbre
Ont chu dans les fontaines à miracles.
Et tout est là, comme des cercueils vides
Et détraqués et dispersés par l'étendue,
Et tout se plaint ainsi que les défunts perdus
Qui sanglotent le soir dans la bruyère humide.
Hélas! la plaine, hélas! elle est finie!
Et ses clochers sont morts et ses moulins perclus.
La plaine, hélas! elle a toussé son agonie
Dans les derniers hoquets d'un angélus.
L'AME DE LA VILLE
Les toits semblent perdus
Et les clochers et les pignons fondus,
Par ces matins fuligineux et rouges,
Où, feux à feux, des signaux bougent.
Une courbe de viaduc énorme
Longe les quais mornes et uniformes;
Un train s'ébranle immense et las.
Au loin, derrière un mur, là-bas,
Un steamer rauque avec un bruit de corne.
Et par les quais uniformes et mornes,
Et par les ponts et par les rues,
Se bousculent, en leurs cohues,
Sur des écrans de brumes crues,
Des ombres et des ombres.
Un air de soufre et de naphte s'exhale,
Un soleil trouble et monstrueux s'étale;
L'esprit soudainement s'effare
Vers l'impossible et le bizarre;
Crime ou vertu, voit-il encor
Ce qui se meut en ces décors,
Où, devant lui, sur les places, s'élève
Le dressement tout en brouillards
D'un pilier d'or ou d'un fronton blafard
Pour il ne sait quel géant rêve?
O les siècles et les siècles sur cette ville,
Grande de son passé
Sans cesse ardent—et traversé,
Comme à cette heure, de fantômes!
O les siècles et les siècles sur elle,
Avec leur vie immense et criminelle
Battant—depuis quels temps?—
Chaque demeure et chaque pierre
De désirs fous et de colères carnassières!
Quelques huttes d'abord et quelques prêtres:
L'asile à tous, l'église et ses fenêtres
Laissant filtrer la lumière du dogme sûr
Et sa naïveté vers les cerveaux obscurs.
Donjons dentés, palais massifs, cloîtres barbares;
Croix des papes dont le monde s'empare;
Moines, abbés, barons, serfs et vilains;
Mitres d'orfroi, casques d'argent, vestes de lin;
Luttes d'instincts, loin des luttes de l'âme
Entre voisins, pour l'orgueil vain d'une oriflamme;
Haines de sceptre à sceptre et monarques faillis
Sur leur fausse monnaie ouvrant leurs fleurs de lys,
Taillant le bloc de leur justice à coups de glaive
Et la dressant et l'imposant: grossière et brève.
Puis, l'ébauche, lente à naître, de la cité:
Forces qu'on veut dans le droit seul planter;
Ongles du peuple et mâchoires de rois;
Mufles crispés dans l'ombre et souterrains abois
Vers on ne sait quel idéal au fond des nues;
Tocsins brassant, le soir, des rages inconnues;
Textes de délivrance et de salut, debout
Dans l'atmosphère énorme où la révolte bout;
Livres dont les pages, soudain intelligibles,
Brûlent de vérité, comme jadis les Bibles;
Hommes divins et clairs, tels des monuments d'or
D'où les événements sortent armés et forts;
Vouloirs nets et nouveaux, consciences nouvelles
Et l'espoir fou, dans toutes les cervelles,
Malgré les échafauds, malgré les incendies
Et les têtes en sang au bout des poings brandies
Elle a mille ans la ville,
La ville âpre et profonde;
Et sans cesse, malgré l'assaut des jours,
Et les peuples minant son orgueil lourd,
Elle résiste à l'usure du monde.
Quel océan, ses cœurs! quel orage, ses nerfs!
Quels nœuds de volontés serrés en son mystère!
Victorieuse, elle absorbe la terre;
Vaincue, elle est l'affre de l'univers:
Toujours, en son triomphe ou ses défaites,
Elle apparaît géante, et son cri sonne et son nom luit
Et la clarté que font ses feux dans la nuit
Rayonne au loin, jusqu'aux planètes!
O les siècles et les siècles sur elle!
Son âme, en ces matins hagards,
Circule en chaque atome
De vapeur lourde et de voiles épars;
Son âme énorme et vague, ainsi que ses grands dômes
Qui s'estompent dans le brouillard;
Son âme, errante, en chacune des ombres
Qui traversent ses quartiers sombres,
Avec une ardeur neuve au bout de leur pensée;
Son âme formidable et convulsée:
Son âme, où le passé ébauche
Avec le présent net l'avenir encor gauche.
O ce monde de fièvre et d'inlassable essor
Rué, à poumons lourds et haletants,
Vers on ne sait quels buts inquiétants?
Monde promis pourtant à des lois d'or,
A des lois douces, qu'il ignore encore
Mais qu'il faut, un jour, qu'on exhume,
Une à une, du fond des brumes.
Monde aujourd'hui têtu, tragique et blême
Qui met sa vie et son âme dans l'effort même
Qu'il projette, le jour, la nuit,
A chaque heure, vers l'infini.
O les siècles et les siècles sur cette ville!
Le rêve ancien est mort et le nouveau se forge.
Il est fumant dans la pensée et la sueur
Des bras fiers de travail, des fronts fiers de lueurs,
Et la ville l'entend monter du fond des gorges
De ceux qui le portent en eux
Et le veulent crier et sangloter aux cieux.
Et de partout on vient vers elle,
Les uns des bourgs et les autres des champs,
Depuis toujours, du fond des loins;
Et les routes éternelles sont les témoins
De ces marches, à travers temps,
Qui se rythment comme le sang
Et s'avivent, continuelles.
Le rêve! il est plus haut que les fumées
Qu'elle renvoie envenimées
Autour d'elle, vers l'horizon;
Même dans la peur ou dans l'ennui,
Il est là-bas, qui domine, les nuits,
Pareil à ces buissons
D'étoiles d'or et de couronnes noires,
Qui s'allument, le soir, évocatoires.
Et qu'importent les maux et les heures démentes,
Et les cuves de vice où la cité fermente,
Si quelque jour, du fond des brouillards et des voiles,
Surgit un nouveau Christ, en lumière sculpté,
Qui soulève vers lui l'humanité
Et la baptise au feu de nouvelles étoiles.
UNE STATUE
On le croyait fondateur de la ville,
Venu des pays clairs et lointains
Vers ceux d'Europe—avec sa pauvre crosse en main,
Et grand, sous sa bure servile.
Pour se faire écouter il parlait par miracles,
En des clairières d'or, le soir, dans les forêts,
Où des granits carraient leurs symboles épais,
Et tonnaient leurs oracles.
Il était la tristesse et la douceur
Descendue autrefois, à genoux, du calvaire,
Vers les hommes et leur misère
Et vers leur cœur.
Il accueillait l'humanité fragile,
Il lui chantait le paradis sans fin
Et l'endormait dans le rêve divin,
Le front posé sur l'évangile.
Plus tard, le roi, le juge et le bourreau
Prirent son verbe et le faussèrent;
Et les textes autoritaires
Apparurent, tels des glaives hors du fourreau.
Contre la paix qu'il avait inclinée
Vers tous, de son geste clément,
La vie, avec des cris et des sursauts déments,
Brusque et rouge, fut dégaînée.
Mais lui resta le clair apôtre et le soleil
Tiédi, aux yeux de tous, de patience et d'indulgence
Et la pieuse et populaire intelligence
Venait puiser en lui la force et le conseil.
On l'invoquait pour les fièvres et pour les peines,
On le fêtait en mai, au soir tombant,
Et des mères apportaient leurs enfants
Baigner leurs maux dans l'eau de sa fontaine.
Son nom large et sonore d'amour
Marquait la fin des longues litanies
Et des complaintes infinies
Que l'on chantait, depuis toujours.
Il se définissait, près d'un portail roman,
En une image usée et tremblotante,
Qui écoutait, dans la poitrine
Haletante des tours,
Les bourdons lourds clamer au firmament.
LES CATHÉDRALES
Au fond du cœur sacerdotal,
D'où leur splendeur s'érige
—Or, argent, diamant, cristal—
Lourds de siècles et de prestiges,
Pendant les vêpres, quand les soirs
Aux longues prières invitent,
Ils s'imposent les ostensoirs
Dont les fixes joyaux méditent.
Ils conservent, ornés de feu,
Pour l'universelle amnistie,
Le baiser blanc du dernier Dieu,
Tombé sur terre en une hostie.
Et l'église, comme un palais de flambeaux noirs,
Dont les châsses d'argent et d'ombre
Taisent leurs cris de métaux sombres,
Par l'élan clair de ses colonnes exulte
Et dresse, en faisceaux d'arcs et en voussoirs,
Jusqu'au faîte, l'éternité du culte.
Dans un encadrement de grands cierges qui pleurent,
A travers temps et jours et heures
Les ostensoirs
Sont le seul cœur de la croyance
Qui luise encor, cristal et or,
Dans les villes de la démence.
Dehors, le bourdon sonne et sonne,
A grand battant tannant
Les longs regrets, pareils aux râles
Vers le passé, des cathédrales.
Et les foules qui tiennent droits,
Pour refléter le ciel, les miroirs de leur foi,
Réunissent, à ces appels, leurs âmes,
Autour des ostensoirs en flammes.
—O ces foules, ces foules,
Et la misère et la détresse qui les foulent!
Voici les pauvres gens des blafardes ruelles,
Barrant de croix, avec leurs bras tendus,
L'ombre noire qui dort dans les chapelles.
—O ces foules, ces foules
Et la misère et la détresse qui les foulent.
Voici les corps usés, voici les cœurs fendus,
Voici les cœurs lamentables des veuves
En qui les larmes pleuvent,
Continûment, depuis des ans.
—O ces foules, ces foules
Et la misère et la détresse qui les foulent!
Voici les mousses et les marins du port
Dont les vagues monstrueuses brassent le sort.
—O ces foules, ces foules
Et la misère et la détresse qui les foulent!
Voici les travailleurs cassés de peine,
Aux six coups de marteaux des jours de la semaine.
—O ces foules, ces foules
Et la misère et la détresse qui les foulent!
Voici les enfants las de leur sang morne
Et qui mendient et qui s'offrent au coin des bornes.
—O ces foules, ces foules
Et la misère et la détresse qui les foulent!
Voici les boutiquiers des quartiers vieux
Limant sur l'établi leur sort méticuleux.
—O ces foules, ces foules
Et la misère et la détresse qui les foulent!
Voici les marguilliers massifs et mous
Qui font craquer leur stalle en pliant les genoux.
—O ces foules, ces foules
Et la misère et la détresse qui les foulent!
Voici les armateurs dont les bateaux de fer,
Fortune au vent tanguent parmi la mer.
—O ces foules, ces foules
Et la misère et la détresse qui les foulent!
Voici les grands bourgeois de droit divin
Qui bâtissent sur Dieu la maison de leur gain.
—O ces foules, ces foules
Et la misère et la détresse qui les foulent!
Les ostensoirs, ornés de soir,
Vers les villes échafaudées,
En toits de verre et de cristal,
Du haut du chœur sacerdotal,
Tendent la croix des gothiques idées.
Ils s'imposent dans l'or des clairs dimanches
—Toussaint, Noël, Pâques et Pentecôtes blanches—
Ils s'imposent dans l'or et dans l'encens et dans la fête
Du grand orgue battant du vol de ses tempêtes
Les chapiteaux rouges et les voûtes vermeilles;
Ils sont une âme, en du soleil,
Qui vit de vieux décor et d'antique mystère
Autoritaire.
Pourtant, dès que s'éteignent le cantique,
Et l'antienne naïve et prismatique,
Un deuil d'encens évaporé s'empreint,
Sur les trépieds d'argent et les autels d'airain;
Et les vitraux, grands de siècles agenouillés
Devant le Christ, avec leurs papes immobiles
Et leurs martyrs et leurs héros, semblent trembler
Au bruit d'un train lointain qui roule sur la ville.
UNE STATUE
Au carrefour des abattoirs et des casernes,
Il apparaît, foudroyant et vermeil,
Le sabre en bel éclair sous le soleil.
Masque d'airain, casque et panache d'or;
Et l'horizon, là-bas, où le combat se tord,
Devant ses yeux hallucinés de gloire!
Un élan fou, un bond brutal
Jette en avant son geste et son cheval
Vers la victoire.
Il est volant comme une flamme,
Ici, plus loin, au bout du monde,
Qui le redoute et qui l'acclame.
Il entraîne, pour qu'en son rêve ils se confondent,
Dieu, son peuple, ses soldats ivres;
Les astres mêmes semblent suivre,
Si bien que ceux
Qui se liguent pour le maudire
Restent béants: et son vertige emplit leurs yeux.
Il est de calcul froid, mais de force soudaine:
Des fers de volonté barricadent le seuil
Infrangible de son orgueil.
Il croit en lui—et qu'importe le reste!
Pleurs, cris, affres et noire et formidable fête,
Avec lesquels l'histoire est faite.
Il est la mort fastueuse et lyrique,
Montrée, ainsi qu'une conquête,
Au bout d'une existence en or et en tempête.
Il ne regrette rien de ce qu'il accomplit,
Sinon que les ans brefs aillent trop vite
Et que la terre immense soit petite.
Il est l'idole et le fléau:
Le vent qui souffle autour de son front clair
Toucha celui des Dieux armés d'éclairs.
Il sent qu'il passe en rouge orage et que sa destinée
Est de tomber en brusque écroulement,
Le jour où son étoile étrange et effrénée,
Cristal rouge, se cassera au firmament.
Au carrefour des abattoirs et des casernes,
Il apparaît, foudroyant et vermeil,
Le sabre en bel éclair dans le soleil.
LE PORT
Toute la mer va vers la ville!
Son port est innombrable et sinistre de croix,
Vergues transversales barrant les grands mâts droits.
Son port est pluvieux de suie à travers brumes,
Où le soleil comme un œil rouge et colossal larmoie.
Son port est ameuté de steamers noirs qui fument
Et mugissent, au fond du soir, sans qu'on les voie.
Son port est fourmillant et musculeux de bras
Perdus en un fouillis dédalien d'amarres.
Son port est concassé de chocs et de fracas
Et de marteaux tonnant dans l'air leurs tintamarres.
Toute la mer va vers la ville!
Les flots qui voyagent comme les vents,
Les flots légers, les flots vivants,
Pour que la ville en feu l'absorbe et le respire
Lui rapportent le monde en des navires.
Les orients et les midis tanguent vers elle
Et les Nords blancs et la folie universelle
Et tous nombres dont le désir prévoit la somme.
Et tout ce qui s'invente et tout ce que les hommes
Tirent de leurs cerveaux puissants et volcaniques
Tend vers elle, cingle vers elle et vers ses luttes:
Elle est la ville en rut des humaines disputes,
Elle est la ville au clair des richesses uniques
Et les marins naïfs peignent son caducée
Sur leur peau rousse et crevassée,
A l'heure où l'ombre emplit les soirs océaniques.
Toute la mer va vert la ville!
O les Babels enfin réalisées!
Et les peuples fondus et la cité commune;
Et les langues se dissolvant en une;
Et la ville comme une main, les doigs ouverts,
Se refermant sur l'univers.
Dites, les docks bondés jusques au faîte!
Et la montagne, et le désert, et les forêts,
Et leurs siècles captés comme en des rets;
Dites, leurs blocs d'éternité: marbres et bois,
Que l'on achète,
Et que l'on vend au poids,
Et puis, dites! les morts, les morts, les morts
Qu'il a fallu pour ces conquêtes.
Toute la mer va vers la ville!
La mer soudaine, ardente et libre,
Qui tient la terre en équilibre;
La mer que domine la loi des multitudes,
La mer où les courants tracent les certitudes;
La mer et ses vagues coalisées,
Comme un désir multiple et fou,
Qui renversent des rocs depuis mille ans debout
Et retombent et s'effacent, égalisées;
La mer dont chaque lame ébauche une tendresse
Ou voile une fureur, la mer plane ou sauvage,
La mer qui inquiète et angoisse et oppresse
De l'ivresse de son image.
Toute la mer va vers la ville!
Son port est flamboyant et tourmenté de feux
Qui éclairent de hauts leviers silencieux.
Son port est hérissé de tours dont les murs sonnent
D'un bruit souterrain d'eau qui s'enfle et ronfle en elles.
Son port est lourd de blocs taillés, où des gorgones
Dardent les réseaux noirs des vipères mortelles.
Son port est fabuleux de déesses sculptées
A l'avant des vaisseaux dont les mâts d'or s'exaltent.
Son port est solennel de tempêtes domptées
En des havres d'airain de marbre et de basalte.
LES SPECTACLES
Au fond d'un hall sonore et radiant,
Sous les ailes énormes
Et les duvets des brumes uniformes,
Parfois, le soir, on déballe les Orients.
Les tréteaux clairs luisent comme des armes;
De gros soleils en strass s'allument en des coins;
Des cymbaliers hagards entrechoquent leurs poings
Casseurs de cris et de vacarmes.
Le rideau s'ouvre: et bruit, clarté, fracas,
Splendeur, quand les danseurs et les danseuses roses
Apparaissent, mêlant et démêlant leurs poses,
En un taillis bougeant de gestes et de pas;
Et que la salle, avec son lustre au centre,
Et ses velours lourds et replets
Et ses balcons en bourrelets
S'étale ainsi qu'un ventre.
Des bataillons de chair et de cuisses en marche
Grouillent, sur des rampes ou sous des arches;
Jambes, hanches, gorges, maillots, jupes, dentelles,
—Attelages de rut, où par couples blafards
Des seins bridés mais bondissants s'attèlent,—
Passent, crus de sueur ou bleus de fard;
Des mains vaines s'ouvrent et se referment vite,
Sans but, sinon saisir l'invisible désir
En fuite;
Une sauteuse, la jambe au clair,
Raidit l'obscénité dans l'air;
Une autre encor, les yeux noyés et les flancs fous,
Se crispe, ainsi qu'une bête qu'on foule,
Et la rampe l'éclairé et bout par en-dessous
Et toute la luxure de la foule
Se soulève vers elle et l'acclame, debout.
O le blasphème en or criard, qui, là, se vocifère!
O la brûlure à cru sur la beauté de la matière!
O les atroces simulacres
De l'art blessé à mort que l'on massacre!
O le plaisir qui chante et qui trépigne
Dans la laideur tordue en tons et lignes;
O le plaisir humain au rebours de la joie,
Alcool pour les regards, alcool pour les pensées,
O le pauvre plaisir qui exige des proies
Et mord des fleurs qui ont le goût de ses nausées!
Jadis, il marchait nu, héroïque et placide,
Les mains fraîches, le front lucide,
Le vent et le soleil dansaient dans ses cheveux;
Toute la vie harmonique et divine
Se réchauffait dans sa poitrine;
Il la respirait fruste et l'expirait plus belle;
Il ignorait la loi qui l'eût dressé: rebelle;
Et l'aube et les couchants et les sources naïves
Et le frôlement vert des branches attentives,
Par à travers sa chair donnaient à son âme profonde,
L'universel baiser qui fait s'aimer les mondes.
Mais aujourd'hui, sénile et débauché,
Il lèche et mord et mange son péché;
Il cultive, dans un jardin d'anomalies,
Bibles, codes, textes, règles, qu'il multiplie
Pour les nier et les briser par des viols.
Et ses amours sont l'or. Et ses haines? les vols
Vers la beauté toujours plus claire et plus certaine
Qui s'ouvre en fleurs d'astres au pré des nuits lointaines.
Et le voici au fond de palais monstrueux
Dont les vitraux dardent aux cieux
L'inquiétude,
Et le voici, soudain, qui se transforme en multitude.
Avec mille regards contagieux,
Avec mille regards cherchant des milliers d'yeux,
Avec son âme éparse en mille âmes de braise,
Pour qu'elle arde plus fort de la flamme mauvaise,
Il s'enfle et se propage en des vices nouveaux.
Sa conscience change et son cerveau.
Un nouvel être naît: homme, enfant, vieillard, femme,
Tordus en total noir, en somme infâme,
En vigne rouge, immense, inassouvie,
Qui l'absorbent, comme s'il leur versait la vie.
O les hontes et les crimes des foules
Passant sur la ville comme des houles,
Et s'engouffrant en des loges de plâtre,
De haut en bas, autour des halls et des théâtres!
La scène brille, ainsi qu'un éventail,
Au fond, luisent des minarets d'email
Et des maisons et des terrasses claires.
Sous les feux bleus des lampadaires,
En rythmes lents d'abord, mais violents soudain,
Se cueillant des baisers et se frôlant les seins,
Se rencontrent les bayadères;
Des négrillons, coiffés de plumes,
—Les dents blanches, couleur d'écume,
En leurs bouches, vulves ouvertes—
Bougent, tous les mêmes, d'après un branle inerte.
Un tambour bat, un son de cor s'entête,
Un fifre cru chatouille un refrain bête,
Et c'est enfin, pour la suprême apothéose,
Un assaut fou débordant sur les planches,
Un étagement d'or, de gorges et de hanches,
D'enlacements crispés et de terribles poses
Et des torses offerts et des robes fendues
Et des grappes de vice entre des fleurs pendues.
Et l'orchestre se meurt ou brusquement halète
Et monte et s'enfle et roule en aquilons;
Des spasmes sourds sortent des violons;
Des chiens lascifs semblent japper dans la tempête
Des bassons forts et des gros cuivres;
Mille désirs naissent, gonflés, pesants, goulus.
On les dirait si lourds que tous, n'en pouvant plus
Se prostituent en hâte et crient et se délivrent.
Et minuit sonne et la foule s'écoule
—Le hall fermé—parmi les trottoirs noirs;
Et sous les lanternes qui pendent
Rouges, dans la brume, ainsi que des viandes,
Ce sont les filles qui attendent.
LES PROMENEUSES
Au long de promenoirs qui s'ouvrent sur la nuit
—Balcons de fleurs, rampes de flammes—
Des femmes en deuil de leur âme
Entrecroisent leurs pas sans bruit.
Au dehors,
Une atmosphère éclatante et chimique
Etend ses effluves sur l'or
Myriadaire d'un décor panoramique.
Des clous de gaz pointent des diamants
Autour de coupoles illuminées;
Des colonnes passionnées
Tordent de la douleur au firmament.
Sur les places, des buissons de flambeaux
Versent du soufre ou du mercure;
Tel coin de monument qui se mire dans l'eau
Semble un torse qui bouge en une armure.
La ville est colossale et luit comme une mer,
Lointainement, de vagues électriques,
Et ses mille chemins de bars et de boutiques
Aboutissent, soudain, aux promenoirs d'éclair,
Où ces femmes—opale et nacre,
Satin nocturne et cheveux roux—
Avec en main des fleurs de macre,
A longs pas clairs, foulent des tapis mous.
Ce sont de très lentes marcheuses solennelles
Qui se croisent, sous les minuits inquiétants,
Et se savent—depuis quels temps?—
Douloureuses et mutuelles.
Un soudain reflet d'incendie
Eclaire, au même instant, deux mains
Qui se serrent, deux mains mates, deux mains
Où le crime sur des bagnes radie,
Sous les crêpes d'un très grand deuil,
Des yeux obstinés et hagards,
Dans un même destin ont rivé leurs regards,
Comme des clous dans un cercueil.
Telle bouche vers telle autre s'en est allée,
Comme deux fleurs se rencontrent sur l'eau,
Tel front semble un bandeau
Sur une pensée aveuglée.
Telle attitude est pareille toujours;
Dans tels yeux nus rien ne tressaille,
Quoique le cœur, où le vice travaille,
Batte âprement ses tocsins sourds.
J'en sais dont les robes funèbres
Voilent de pâles souliers d'or
Et dont un serpent d'argent mord
Les longues tresses de ténèbres.
Des houx rouges de leur tourment
Elles ont fait des diadèmes;
J'en vois: des veuves d'elles-mêmes
Qui se pleurent, comme un amant.
Quand leurs rêves, la nuit, s'esseulent
Et qu'elles tiennent dans la main
Une âme et un bonheur humain,
Elles savent se qu'elles veulent.
Si leur peine devait finir un jour,
Elles en seraient plus tristes peut-être,
Qu'elles ne sont inconsolables d'être
Celles du souterrain amour.
Au long de promenoirs qui dominent la nuit,
De lentes femmes,
En deuil immense de leur âme,
Entrecroisent leurs pas sans bruit.
UNE STATUE
Un bloc de bronze où son nom luit sur une plaque.
Ventre riche, mâchoire ardente et menton gourd;
Haine et terreur murant son gros front lourd
Et poing taillé à fendre en deux toutes attaques.
Le carrefour, solennisé de palais froids,
D'où ses regards têtus et violents encore
Scrutent quels feux d'éveil bougent dans telle aurore,
Comme sa volonté, se carre en angles droits.
Il fut celui de l'heure et des hasards bizarres.
Mais textuel, sitôt qu'il tint la force en main
Et qu'il put étouffer dans hier le lendemain
Déjà sonore et plein de cassantes fanfares.
Sa colère fit loi durant ces jours bâtés,
Où toutes voix montaient vers ses panégyriques,
Où son rêve d'état strict et géométrique
Tranquillisait l'aboi plaintif des lâchetés.
Il se sentait la force étroite et qui déprime,
Tantôt sournois, tantôt cruel et contempteur,
Et quand il se dressait de toute sa hauteur
Il n'arrivait jamais qu'à la hauteur d'un crime.
Massif devant la vie, il l'obstrua, depuis
Qu'il s'imposa sauveur des rois et de lui-même
Et qu'il utilisa la peur et l'affre blême
En des complots fictifs qu'il étranglait, la nuit.
Si bien qu'il apparaît sur la place publique
Féroce et rancunier, autoritaire et fort,
Et défendant encor, d'un geste hyperbolique,
Son piédestal bâti comme son coffre-fort.
LES USINES
Se regardant avec les yeux cassés de leurs fenêtres
Et se mirant dans l'eau de poix et de salpêtre
D'un canal droit, tirant sa barre à l'infini,
Face à face, le long des quais d'ombre et de nuit
Par à travers les faubourgs lourds
Et la misère en guenilles de ces faubourgs,
Ronflent terriblement les fours et les fabriques.
Rectangles de granit, cubes de briques,
Et leurs murs noirs durant des lieues,
Immensément, par les banlieues;
Et sur leurs toits, dans le brouillard, aiguillonnées
De fers et de paratonnerres,
Les cheminées.
Et les hangars uniformes qui fument;
Et les préaux, où des hommes, le torse au clair
Et les bras nus, brassent et ameutent d'éclairs
Et de tridents ardents, les poix et les bitumes;
Et de la suie et du charbon et de la mort;
Et des âmes et des corps que l'on tord
En des sous-sols plus sourds que des Avernes;
Et des files, toujours les mêmes, de lanternes
Menant l'égout des abattoirs vers les casernes.
Se regardant de leurs jeux noirs et symétriques,
Par la banlieue, à l'infini,
Ronflent le jour, la nuit,
Les usines et les fabriques.
Oh les quartiers rouilles de pluie et leurs grand'rues!
Et les femmes et leurs guenilles apparues
Et les squares, où s'ouvre, en des caries
De plâtras blanc et de scories.
Une flore pâle et pourrie.
Aux carrefours, porte ouverte, les bars:
Etains, cuivres, miroirs hagards,
Dressoirs d'ébène et flacons fols
D'où luit l'alcool
Et son éclair vers les trottoirs.
Et des pintes qui tout à coup rayonnent,
Sur le comptoir, en pyramides de couronnes;
Et des gens soûls, debout,
Dont les larges langues lappent, sans phrases,
Les ales d'or et le whisky, couleur topaze.
Par à travers les faubourgs lourds
Et la misère en pleurs de ces faubourgs,
Et les troubles et mornes voisinages,
Et les haines s'entre-croisant de gens à gens
Et de ménages à ménages,
Et le vol même entre indigents,
Grondent, au fond des cours, toujours,
Les haletants ronflements sourds
Des usines et des fabriques symétriques.
Ici: entre des murs de fer et pierre,
Soudainement se lève, allière,
La force en rut de la matière:
Des mâchoires d'acier mordent et fument;
De grands marteaux monumentaux
Broient des blocs d'or, sur des enclumes,
Et, dans un coin, s'illuminent les fontes
En brasiers tors et effrénés qu'on dompte.
Là-bas: les doigts méticuleux des métiers prestes,
A bruits menus, à petits gestes,
Tissent des draps, avec des fils qui vibrent
Légers et fins comme des fibres.
Au long d'un bail de verre et fer,
Des bandes de cuir transversales
Courent de l'un à l'autre bout des salles
Et les volants larges et violents
Tournent, pareils aux ailes dans le vent
Des moulins fous, sous les rafales.
Un jour de cour avare et ras
Frôle, par à travers les carreaux gras
Et humides d'un soupirail,
Chaque travail.
Automatiques et minutieux,
Des ouvriers silencieux
Règlent le mouvement
D'universel tictacquement
Qui fermente de fièvre et de folie
Et déchiquette, avec ses dents d'entêtement,
La parole humaine abolie.
Plus loin: un vacarme tonnant de chocs
Monte de l'ombre et s'érige par blocs;
Et, tout à coup, cassant l'élan des violences,
Des murs de bruit semblent tomber
Et se taire, dans une mare de silence,
Tandis que les appels exacerbés
Des sifflets crus et des signaux
Hurlent toujours vers les fanaux,
Dressant leurs feux sauvages,
En buissons d'or, vers les nuages.
Et tout autour, ainsi qu'une ceinture,
Là-bas, de nocturnes architectures,
Voici les docks, les ports, les ponts, les phares
Et les gares folles de tintamarres;
Et plus lointains encor des toits d'autres usines
Et des cuves et des forges et des cuisines
Formidables de naphte et de résines.
Dont les meutes de feu et de lueurs grandies
Mordent parfois le ciel, à coups d'abois et d'incendies.
Au long du vieux canal à l'infini,
Par à travers l'immensité de la misère
Des chemins noirs et des routes de pierre,
Les nuits, les jours, toujours,
Ronflent les continus battements sourds,
Dans les faubourgs,
Des fabriques et des usines symétriques.
L'aube s'essuie
A leurs carrés de suie;
Midi et son soleil hagard
Comme un aveugle, errent par leurs brouillards;
Seul, quand les semaines, au soir,
Laissent leur nuit dans les ténèbres choir,
Le han du colossal effort cesse, en arrêt,
Comme un marteau sur une enclume,
Et l'ombre, au loin, sur la ville, paraît
De la brume d'or qui s'allume.
LA BOURSE
La rue énorme et ses maisons quadrangulaires
Bordent la foule et l'endiguent de leur granit
Œillé de fenêtres et de porches, où luit
L'adieu, dans les carreaux, des soirs auréolaires.
Comme un torse de pierre et de métal debout,
Avec, en son mystère immonde,
Le cœur battant et haletant du monde,
Le monument de l'or, dans les ténèbres, bout.
Autour de lui, les banques noires
Dressent des lourds frontons que soutiennent, des bras
Les Hercules d'airain dont les gros muscles las
Semblent lever des coffres-forts vers la victoire.
Le carrefour, d'où il érige sa bataille,
Suce la fièvre et le tumulte
De chaque ardeur vers son aimant occulte;
Le carrefour et ses squares et ses murailles
Et ses grappes de gaz sans nombre,
Qui font bouger des paquets d'ombre
Et de lueurs, sur les trottoirs.
Tant de rêves, tels des feux roux,
Entremêlent leur flamme et leurs remous,
De haut en bas, du palais fou!
Le gain coupable et monstrueux
S'y resserre, comme des nœuds,
Et son désir se dissémine et se propage
Parlant chauffer de seuil à seuil,
Dans la ville, les contigus orgueils.
Les comptoirs lourds grondent comme un orage,
Les luxes gros se jalousent et ragent
Et les faillites en tempêtes,
Soudainement, à coups brutaux,
Battent et chavirent les têtes
Des grands bourgeois monumentaux.
L'après-midi, à tel moment,
La fièvre encore augmente
Et pénètre le monument
Et dans les murs fermente.
On croit la voir se raviver aux lampes
Immobiles, comme des hampes,
Et se couler, de rampe en rampe,
Et s'ameuter et éclater
Et crépiter, sur les paliers
Et les marbres des escaliers.
Une fureur réenflammée
Au mirage d'un pâle espoir.
Monte parfois de l'entonnoir
De bruit et de fumée,
Où l'on se bat, à coups de vols, en bas.
Langues sèches, regards aigus, gestes inverses,
Et cervelles, qu'en tourbillons les millions traversent,
Echangent là, leur peur et leur terreur.
La hâte y simule l'audace
Et les audaces se dépassent;
Des doigts grattent, sur des ardoises,
L'affolement de leurs angoisses;
Cyniquement, tel escompte l'éclair
Qui casse un peuple au bout du monde;
Les chimères sont volantes au clair;
Les chances fuient ou surabondent;
Marchés conclus, marchés rompus
Luttent et s'entrebutent en disputes;
L'air brûle—et les chiffres paradoxaux,
En paquets pleins, en lourds trousseaux,
Sont rejetés et cahotés et ballottés
Et s'effarent en ces bagarres,
Jusqu'à ce que leurs sommes lasses,
Masses contre masses,
fie cassent.
Tels jours, quand les débâcles se décident,
La mort les paraphe de suicides
Et les chutes s'effritent en ruines
Qui s'illuminent
En obsèques exaltatives.
Mais, le soir même, aux heures blêmes,
Les volontés, dans la fièvre, revivent;
L'acharnement sournois
Reprend, comme autrefois.
On se trahit, on se sourit et l'on se mord
Et l'on travaille à d'autres morts.
La haine ronfle, ainsi qu'une machine.
Autour de ceux qu'elle assassine.
On vole, avec autorité, les gens
Dont les avoirs sont indigents.
On mêle avec l'honneur l'escroquerie,
Pour amorcer jusqu'aux patries
Et ameuter vers l'or torride et infamant,
L'universel affolement.
Oh l'or! là-bas, comme des tours dans les nuages,
Comme des tours, sur l'étagère des mirages,
L'or énorme! comme des tours, là-bas,
Avec des millions de bras vers lui,
Et des gestes et des appels la nuit
Et la prière unanime qui gronde,
De l'un à l'autre bout des horizons du monde!
Là-bas! des cubes d'or sur des triangles d'or,
Et tout autour les fortunes célèbres
S'échafaudant sur des algèbres.
De l'or!—boire et manger de l'or!
Et, plus féroce encor que la rage de l'or,
La foi au jeu mystérieux
Et ses hasards hagards et ténébreux
Et ses arbitraires vouloirs certains
Qui restaurent le vieux destin;
Le jeu, axe terrible, où tournera autour de l'aventure,
Par seul plaisir d'anomalie,
Par seul besoin de rut et de folie,
Là-bas, où se croisent les lois d'effroi
Et les suprêmes désarrois,
Eperdûment, la passion future.
Comme un torse de pierre et de métal debout,
Avec, en son mystère immonde,
Le cœur battant et haletant du monde,
Le monument de l'or dans les ténèbres bout.
LE BAZAR
C'est un bazar, au bout des faubourgs rouge:
Etalages bondés, éventaires ventrus.
Tumulte et cris brandis, gestes bourrus et crus,
Et lettres d'or, qui soudain bougent,
En torsades, sur la façade.
Chaque matin, on vend, en ce bazar,
Parmi les épices, les fards
Et les drogues omnipotentes,
A bon marché, pour quelques sous,
Les diamants dissous
De la rosée immense et éclatante.
Le soir, à prix numéroté,
Avec le désir noir de trafiquer de la pureté,
On y brocante le soleil
Que toutes les vagues de la mer claire
Lavent, entre leurs doigts vermeils,
Aux horizons auréolaires.
C'est un bazar, avec des murs géants
Et des balcons et des sous-sols béants
Et des tympans montés sur des corniches
Et des drapeaux et des affiches,
Où deux clowns noirs plument un ange.
A travers boue, à travers fange,
Roulent, la nuit vers le bazar,
Les chars, les camions et les fardiers,
Qui s'en reviennent des usines
Voisines,
Des cimetières et des charniers,
Avec un tel poids noir de cargaisons,
Que le sol bouge et les maisons.
On met au clair à certains jours,
En de vaines et frivoles boutiques,
Ce que l'humanité des temps antiques
Croyait divinement être l'amour;
Aussi les Dieux et leur beauté
Et l'effrayant aspect de leur éternité
Et leurs yeux d'or et leurs mythes et leurs emblèmes
Et des livres qui les blasphèment.
Toutes ardeurs, tous souvenirs, toutes prières
Sont là, sur des étals, et s'empoussièrent.
Des mots qui renfermaient l'âme du monde
Et que les prêtres seuls disaient au nom de tous,
Sont charriés et ballottés, dans la faconde
Des camelots et des voyous.
L'immensité se serre en des armoires
Dérisoires et rayonne de plaies
Et le sens même de la gloire
Se définit par des monnaies.
Lettres jusques au ciel, lettres en or qui bouge,
C'est un bazar au bout des faubourgs rouges!
La foule et ses flots noirs
S'y bouscule près des comptoirs;
La foule et ses désirs multipliés,
Par centaines et par milliers,
Y tourne, y monte, au long des escaliers,
Et s'érige folle et sauvage,
En spirale, vers les étages.
Là haut, c'est la pensée
Immortelle, mais convulsée,
Avec ses triomphes et ses surprises,
Qu'à la hâte on expertise.
Tous ceux dont le cerveau
S'enflamme aux feux des problèmes nouveaux,
Tous les chercheurs qui se fixent pour cible
Le front d'airain de l'impossible
Et le cassent, pour que les découvertes
S'en échappent, ailes ouvertes,
Sont là gauches, fiévreux, distraits,
Dupes des gens qui les renient
Mais utilisent leur génie,
Et font argent de leurs secrets.
Oh! les Edens, là-bas, au bout du monde,
Avec des arbres purs à leurs sommets,
Que ces voyants des lois profondes
Ont exploré pour à jamais,
Sans se douter qu'ils sont les Dieux.
Oh! leur ardeur à recréer la vie,
Selon la foi qu'ils ont en eux
Et la douceur et la bonté de leurs grands yeux,
Quand, revenus de l'inconnu
Vers les hommes, d'où ils s'érigent,
On leur vole ce qui leur reste aux mains
De vérité conquise et de destin.
C'est un bazar tout en vertiges
Que bat, continûment, la foule, avec ses houles
Et ses vagues d'argent et d'or;
C'est un bazar tout en décors,
Avec des tours de feux et des lumières,
Si large et haut que, dans la nuit,
Il apparaît la bête éclatante de bruit
Qui monte épouvanter le silence stellaire.
L'ÉTAL
Non loin du port, la nuit, lorsque l'essor
Des tours et des palais vertigineux s'affaisse
Dans l'ombre—et que brûlent des yeux de braise,
Le quartier fauve et noir allume encor
Son vieux décor de vice et d'or.
Des commères, blocs de viande tassée et lasse,
Interpellent, du seuil de portes basses,
Les gens qui passent;
Derrière elles, au fond des couloirs rouges
Des feux luisent, un rideau bouge
Et se soulève et permet d'entrevoir
De la chair nue en des miroirs.
Le port est proche. A gauche, au bout des rues,
L'emmêlement des mâts et des vergues obstrue
Un pan de ciel énorme;
A droite, un tas grouillant de ruelles difformes
Choit de la ville—et les foules obscures
S'y dépêchent vers leurs destins de pourriture.
C'est l'étal flasque et monstrueux de la luxure
Dressé, depuis toujours, sur les frontières
De la cité et de la mer.
Là-bas, parmi les flots et les hasards,
Ceux qui veillent mélancoliques, aux bancs de quart
Et les mousses, dans les agrès et les cordes pendues,
Et les marins hallucinés par les yeux bleus des étendues,
Tous en rêvent et l'évoquent, tels soirs;
Le cru désir les tord en effrénés vouloirs;
Les baisers mous du vent sur leur torse circulent;
La vague éveille en eux des images qui brûlent;
Et leurs deux bras supplient et longuement se désespèrent
Et s'exaltent, tendus du côté de la terre.
Et ceux d'ici, ceux des bureaux et des bazars,
Chiffreurs lotus, marchands précis, scribes hagards,
Fronts assouplis, cerveaux loués et mains vendues,
Quand les clefs de la caisse au mur sont appendues,
Sentent le même rut mordre leur corps, tels soirs;
On les entend descendre en troupeaux noirs,
Comme des chiens chassés, du fond du crépuscule,
Et la débauche en eux si fortement bouscule
Leur avarice et leur prudence routinière
Qu'elle les use et les détraque et les ruine, avec colère.
C'est l'étal flasque et monstrueux de la luxure
Dressé, depuis toujours, sur les frontières
De la cité et de la mer.
Venus de quels lointains bénins ou fatidiques?
Venus de quels comptoirs fiévreux ou méthodiques?
Avec, en leurs yeux durs, la haine âpre et sournoise,
Avec, en leur instinct, la bataille et l'angoisse,
Autour de femelles rouges qui les affolent,
Ils s'assemblent et s'ameutent en rageuses paroles.
De gros lambris fougueux et des ornements crus
Luisent, au long des murs et, par bouquets se dardent;
Des satyres sautants et des Bacchus ventrus
Rient d'un rire immobile en des glaces blafardes;
Des fleurs meurent. Sur des tables de jeu,
Les bolschauffent, tordant leur flamme en cheveux bleus;
Un pot de fard s'encrasse, au coin d'une étagère;
Une chatte bondit vers des mouches, légère;
Un ivrogne sommeille étendu sur un banc,
Et des femmes viennent à lui et se penchant
Frôlent ses yeux fermés, avec leurs seins énormes,
Leurs compagnes, reins fatigués, croupes qui dorment,
Sur des fauteuils et des divans sont empilées,
La chair morne et vague d'avoir été foulée
Par les premiers passants de la vigne banale.
L'une d'elles coule en son bas un morceau d'or,
Une autre bâille et s'étire, d'autres encor
—Flambeaux défunts, tyrses usés des bacchanales—
Sentant l'âge et la fin les flairer du museau,
Les jeux fixes, se caressent la peau,
D'une main lente et machinale.
C'est l'étal flasque et monstrueux de la luxure
Dressé, depuis toujours, sur les frontières
De la cité et de la mer.
D'après l'argent qui tinte dans les poches,
La promesse s'échange ou les reproches,
Un cynisme tranquille, une ardeur lasse
Préside à la tendresse ou la menace.
L'étreinte et les baisers ennuient. Souvent,
Lorsque les poings s'entrecognent, au vent
Des insultes et des jurons, toujours les mêmes,
Quelque gaieté s'essore et jaillit des blasphèmes,
Mais aussitôt retombe—et l'on entend,
Dans le silence inquiétant,
Un clocher proche et haletant
Sonner l'heure lourde et funèbre,
Sur la ville, dans les ténèbres.
Pourtant, à certains mois, quand les fêtes émargent
L'hiver, à la Noël, l'été, à la Saint-Pierre,
Le vieux quartier de crasse et de lumière
Monte vers le péché, avec un élan large.
Il fermente de chants hurlés et de tapages:
Fenêtre par fenêtre, étage par étage,
Ses façades dardent, de haut en bas,
Le vice—et, jusqu'au fond des galetas,
Brâme l'ardeur et s'accouplent les rages.
Dans la grand'salle, où les marins affluent,
Poussant au devant d'eux quelque bouffon des rues
Qui se convulsé en mimiques obscènes,
Les vins d'écume et d'or bondissent de leur gaîne;
Les hommes saouls braillent comme des fous,
Les femmes se livrent—et, tout à coup,
Les ruts flambent, les bras se nouent, les corps se tordent,
On ne voit plus que des instincts qui s'entremordent,
Des seins offerts, des vent respris—et l'incendie
Des yeux hagards en des buissons de chair brandie.
Et cela monte et s'affaisse pour remonter encore:
Et cela roule, ainsi que des marées
Exaspérées,
Jusqu'au moment, où l'aube emplit le port
Et que la mort ardente aux renouveaux
Balaie et repousse vers les havres
Ce qui reste, sur le carreau,
De débauche tuée et de cadavres.
C'est l'étal flasque et monstrueux de la luxure,
Où le crime plante ses couteaux clairs,
Où la folie, à coups d'éclairs,
Fêle les fronts de meurtrissures,
C'est l'étal flasque et monstrueux,
Dressé, depuis toujours, sur les frontières
Tributaires de la cité et de la mer.
LA RÉVOLTE
La rue, en un remous de pas,
De corps et d'épaules d'où sont tendus des bras
Sauvagement ramifiés vers la folie,
Semble passer volante,
Et ses fureurs, au même instant, s'allient
A des haines, à des appels, à des espoirs;
La rue en or,
La rue en rouge, au fond des soirs.
Toute la mort
En des beffrois tonnants se lève;
Toute la mort, surgie en rêves,
Avec des feux et des épées
Et des têtes, à la tige des glaives,
Comme des fleurs atrocement coupées.
La toux des canons lourds,
Les lourds hoquets des canons sourds
Mesurent seuls les pleurs et les abois de l'heure.
Les cadrans blancs des carrefours obliques,
Comme des yeux en des paupières,
Sont défoncés à coups de pierre:
Le temps normal n'existant plus
Pour les cœurs fous et résolus
De ces foules hyperboliques.
La rage, elle a bondi de terre
Sur un monceau de pavés gris,
La rage immense, avec des cris,
Avec du sang féroce en ses artères,
Et pâle et haletante
Et si terriblement
Que son moment d'élan vaut à lui seul le temps
Que met un siècle en gravitant
Autour de ses cent ans d'attente.
Tout ce qui fut rêvé jadis;
Ce que les fronts les plus hardis
Vers l'avenir ont instauré;
Ce que les âmes ont brandi,
Ce que les yeux ont imploré,
Ce que toute la sève humaine
Silencieuse a renfermé,
S'épanouit, aux mille bras armés
De ces foules, brassant leur houle avec leurs haines.
C'est la fête du sang qui se déploie,
A travers la terreur, en étendards de joie:
Des gens passent rouges et ivres;
Des gens passent sur des gens morts;
Les soldats clairs, casqués de cuivre,
Ne sachant plus où sont les droits, où sont les torts.
Las d'obéir, chargent, mollassement,
Le peuple énorme et véhément
Qui veut enfin que sur sa tête
Luisent les ors sanglants et violents de la conquête.
—Tuer, pour rajeunir et pour créer!
Ainsi que la nature inassouvie
Mordre le but, éperdument,
A travers la folie énorme d'un moment:
Tuer ou s'immoler pour tordre de la vie!—
Voici des ponts et des maisons qui brûlent,
En façades de sang, sur le fond noir du crépuscule;
L'eau des canaux en réfléchit les fumantes splendeurs,
De haut en bas, jusqu'en, ses profondeurs;
D'énormes tours obliquement dorées
Barrent la ville au loin d'ombres démesurées;
Les bras des feux, ouvrant leurs mains funèbres,
Eparpillent des tisons d'or par les ténèbres;
Et les brasiers des toits sautent en bonds sauvages,
Hors d'eux-mêmes, jusqu'aux nuages.
On fusille par tas, là-bas.
La mort, avec des doigts précis et mécaniques,
Au tir rapide et sec des fusils lourds,
Abat, le long des murs du carrefour,
Des corps raidis en gestes tétaniques;
Leurs rangs entiers tombent comme des barres.
Des silences de plomb pèsent sur les bagarres.
Les cadavres, dont les balles ont fait des loques,
Le torse à nu, montrent leurs chairs baroques;
Et le reflet dansant des lanternes fantasques
Crispe en rire le cri dernier sur tous ces masques.
Tapant et haletant, le tocsin bat,
Comme un cœur dans un combat,
Quand, tout à coup, pareille aux voix asphyxiées,
Telle cloche qui âprement tintait.
Dans sa tourelle incendiée,
Se tait.
Aux vieux palais publics, d'où les échevins d'or
Jadis domptaient la ville et refoulaient l'effort
Et la marée en rut des multitudes fortes,
On pénètre, cognant et martelant les portes;
Les clefs sautent et les verrous;
Des armoires de fer ouvrent leur trou,
Où s'alignent les lois et les harangues;
Une torche les lèche, avec sa langue,
Et tout leur passé noir s'envole et s'éparpille,
Tandis que dans la cave et les greniers on pille
Et que l'on jette au loin, par les balcons hagards,
Des corps humains fauchant le vide avec leurs bras épars.
Dans les églises,
Les verrières, où les martyres sont assises,
Jonchent le sol et s'émiettent comme du chaume;
Un Christ, exsangue et long comme un fantôme,
Est lacéré et pend, tel un haillon de bois,
Au dernier clou qui perce encor sa croix;
Le tabernacle, où sont les chrêmes,
Est enfoncé, à coups de poings et de blasphèmes;
On soufflette les Saints près des autels debout
Et dans la grande nef, de l'un à l'autre bout,
—Telle une neige—on dissémine les hosties
Pour qu'elles soient, sous des talons rageurs, anéanties.
Tous les joyaux du meurtre et des désastres,
Etincellent ainsi, sous l'oeil des astres;
La ville entière éclate
En pays d'or coiffé de flammes écarlates;
La ville, au fond des soirs, vers les lointains houleux,
Tend sa propre couronne énormément en feu;
Toute la rage et toute la folie
Brassent la vie avec leur lie,
Si fort que, par instants, le sol semble trembler,
Et l'espace brûler
Et la fumée et ses fureurs s'écheveler et s'envoler
Et balayer les grands cieux froids.
—Tuer, pour rajeunir et pour créer;
Ou pour tomber et pour mourir, qu'importe!
Ouvrir, ou se casser les poings contre la porte!
Et puis—que son printemps soit vert ou qu'il soit rouge—
N'est-elle point, dans le monde, toujours,
Haletante, par à travers les jours,
La puissance profonde et fatale qui bouge!
AU MUSÉE
La couronne formidable des rois
En s'appuyant de tout son poids
Sur un masque de cire
Semblait broyer, dans ce hall froid,
Tout un empire.
Le pâle émail des yeux usés
S'était fendu en agonies
Minuscules, mais infinies,
Sous les sourcils martyrisés.
Le front avait été l'éclair,
Avant que les pâles années
N'eussent rivé les destinées,
Sur ce bloc mort de morne chair.
Les crins encore étaient ardents,
Mais la colossale mâchoire,
Mi-ouverte; laissait la gloire
Tomber morte d'entre les dents.
Depuis des temps qu'on ne sait pas,
La couronne, violemment cruelle,
De sa poussée indiscontinuelle
Ployait le chef toujours plus las.
Les astuces, les perfidies
Louchaient en ses joyaux taillés,
Et les meurtres, les sangs, les incendies
Semblaient reluire entre ses ors caillés.
Elle écrasait et abattait
Ce qui jadis était sa gloire:
Le front géant qui la portait
Et la dardait vers les victoires
Et telle, accomplissait, sans bruit,
L'œuvre d'une force qui se détruit,
Obstinément, soi-même,
Et finit par se définir
Pour l'avenir
Dans un emblème.
Couronne et tête étaient placées,
Couronne ardente et tête autoritaire,
En un logis de verre,
Au fond d'un hall, dans un musée
L'image apparaissait définitive.
Un vieux gardien, vêtu de noir,
Veillait, obstinément, sans voir
Que cette mort se consommait impérative
Et présidait à la force toujours accrue
De la foule brassant sa vie et ses rumeurs
Et ses clameurs et ses fureurs au fond des rues.
UNE STATUE
Avec, devant les yeux, l'astre qu'était son âme
Par des chemins de rocs incandescents de flamme,
Il s'en était allé si loin vers l'inconnu
Que son siècle vieux et chenu,
Toussant la mort, au vent trop fort de sa pensée,
L'avait férocement enseveli sous la risée.
Il était oublié, depuis des tas d'années
Vers l'avenir échelonnées,
Lorsqu'un matin la ville éclata d'or
Et de fête pour son apothéose
Et le grandit en une pose
De volonté debout sur un piédestal d'or.
On inscrivit sur le granit de gloire,
L'exil subi, la faim, l'affre et la prison,
Et l'on tressa, comme une floraison,
Son crime ancien, autour de sa mémoire.
On lui prit sa pensée et l'on en fit des lois;
On lui prit sa folie et l'on en fit de l'ordre:
Et ses railleurs d'antan ne savaient plus où mordre
Le battant de toscin qui sautait dans sa voix.
Son image d'airain sacra le carrefour,
D'où l'on voyait briller, agrandi de mystère,
Son front suprême et clair et large et comme austère
Dans le tumulte et la rage des jours.
LA MORT
Avec ses larges corbillards
Ornés de plumes majuscules,
Par les matins et les brouillards,
La mort circule.
Parée et noire et opulente,
Tambours voilés, musiques lentes,
Avec ses larges corbillards,
Ornés de pâles lampadaires,
La Mort s'étale et s'exagère.
Sous les porches illuminés,
Pareils aux nocturnes trésors,
Les gros cercueils écussonnés
—Larmes d'argent et blasons d'or—
Écoutent l'heure éclatante des glas
Que les cloches cassent, là-bas;
L'heure qui tombe, avec des bonds
Et des sanglots, sur les maisons,
L'heure qui meurt sur les demeures,
Avec des bonds et des sanglots de plomb.
Parée et noire et opulente,
Au cri des orgues violentes
Qui la célèbrent,
La mort toute en ténèbres
Règne, comme une idole assise,
Sous la coupole des églises.
Des feux tordus comme des hydres,
Buissonnent clairs, autour du catafalque immense,
Où des anges, tenant des faulx et des clepsydres,
Dressent leur véhémence,
Clairons dardés, vers le néant.
Le vide en est grandi sous le transept béant;
De pâles voix d'enfants
A l'infini crient l'agonie,
Par à travers ces ironies.
Tandis que les hautes murailles
Montent, comme des linceuls blancs,
Autour du bloc formidable et branlant
De ces coupables funérailles.
Drapée en noir et familière,
La Mort s'en va le long des rues
Longues et linéaires.
Drapée en noir, comme le soir,
La vieille Mort agressive et bourrue
S'en va par les quartiers
Des boutiques et des métiers,
En carrosse qui se rehausse
De gros lambris exorbitants,
Couleur d'usure et d'ancien temps.
Drapée en noir, la Mort
Cassant, entre ses mains, le sort
Des gens méticuleux et réfléchis
Qui s'exténuent, en leurs logis,
Vainement, à faire fortune;
La Mort soudaine et importune
Les met en ordre dans leurs bières
Comme des fardes régulières.
Et les cloches sonnent péniblement
Un malheureux enterrement,
Sur le défunt, que l'on trimballe,
Par les églises colossales,
Vers un coin d'ombre, où quelques cierges,
Pauvres flammes, brûlent, devant la Vierge.
Vêtue en noir et besogneuse,
La Mort gagne jusqu'aux faubourgs,
En charriot branlant et lourd,
Avec de vieilles haridelles
Qu'elle flagelle
Chaque matin, vers quels destins?
Vêtue en noir,
La Mort enjambe le trottoir
Et l'égoût pâle, où se mirent les bornes,
Une à une, qui vont là-bas, vers les champs mornes;
Et leste et droite et dédaigneuse
Gagne les escaliers et s'arrête sur les paliers
Où l'on entend pleurer et sangloter,
Derrière la porte entr'ouverte,
Des gens laissant l'espoir tomber, inerte.
Et dans la pluie indéfinie,
Une petite église de banlieue,
Très maigrement, tinte un adieu,
Sur la bière de sapin blanc
Qui se rapproche, avec des gens dolents,
Par les routes, silencieusement.
Telle la Mort journalière et logique
Qui fait son œuvre et la marque de croix
Et d'adieux mornes et de voix
Criant vers l'inconnu leurs espoirs liturgiques.
Mais d'autres fois, c'est la Mort grande et sa légende,
Avec son aile au loin ramante,
Vers les villes de l'épouvante.
Un ciel en fusion plombe la terre moite;
Des tours noires s'étirent droites
Telles des bras, dans la terreur des crépuscules;
Les nuits tombent comme épaissies,
Les nuits lourdes, les nuits moisies,
Où, dans l'air gras et la chaleur rancie,
Tombereaux pleins, la Mort circule,
Ample et géante comme l'ombre,
Du haut en bas des maisons sombres,
On l'écoute glisser muette et haletante.
La peur du jour qui vient, la peur de toute attente,
La peur de tout instant qui se décoche
Persécute les cœurs, partout,
Et redresse, soudain, en leur sueur, debout,
Ceux qui, vers les minuits, songent au matin proche.
Les hôpitaux gonflés de maladies,
Avec les yeux fiévreux de leurs fenêtres rouges,
Fixent le ciel nocturne, où rien ne bouge
Ni ne répond aux détresses brandies.
Les égouts roulent le poison
Et les acides et les chlores,
Couleur de nacre et de phosphore,
Vainement tuent sa floraison.
De gros bourdons résonnent
Pour tout le monde, pour personne;
Les églises ont barricadé leur seuil,
Devant la masse des cercueils.
Comme des bateaux noirs que repousse le havre,
La pourriture, elle est, là-bas,
Numérotée en tas;
Et la prière même a peur de ces cadavres.
Et l'on entend, en galops éperdus,
La mort passer et les bières que l'on transporte
Aux nécropoles, dont les portes,
Ni nuit ni jour, ne ferment plus.
Tragique et noire et légendaire,
Les pieds gluants, les gestes fous,
La Mort balaie en un grand trou
La ville entière au cimetière.
LA RECHERCHE
Chambres claires, tours et laboratoires,
Avec, sur leurs frises, les sphinx évocatoires
Et vers le ciel, braqués, les télescopes d'or.
Blocs de lumière éclatés en trésors,
Cristaux monumentaux et minéraux jaspés,
Glaives de soleil vierge, en des prismes trempés,
Creusets ardents, godets rouges, flammes fertiles,
Où se transmuent les poussières subtiles;
Instruments nets et délicats,
Ainsi que des insectes,
Ressorts tendus et balances correctes,
Cônes, segments, angles, carrés, compas,
Sont là, vivant et respirant dans l'atmosphère
Do lutte et de conquête autour de la matière.
C'est la maison de la science au loin dardée,
Obstinément par à travers les faits jusqu'aux idées.
Dites! quels temps versés au gouffre des années,
Et quelle angoisse ou quel espoir des destinées,
Et quels cerveaux chargés de noble lassitude
A-t-il fallu pour faire un peu de certitude?
Dites! l'erreur plombant les fronts; les bagnes
De la croyance où le savoir marchait au pas;
Dites! les premiers cris, là-haut, sur la montagne,
Tués parles bruits sourds de la foule d'en bas.
Dites! les feux et les bûchers; dites! les claies;
Les regards fous, en des visages d'effroi blanc;
Dites! les corps martyrisés, dites! les plaies
Criant la vérité, avec leur bouche en sang.
C'est la maison de la science au loin dardée,
Obstinément, par à travers les faits jusqu'aux idées.
Avec des yeux
Méticuleux ou monstrueux,
On y surprend les croissances ou les désastres
S'échelonner, depuis l'atome jusqu'à l'astre.
La vie y est fouillée, immense et solidaire,
En sa surface ou ses replis miraculeux,
Comme la mer et ses gouffres houleux,
Par le soleil et ses mains d'or myriadaires.
Chacun travaille, avec avidité,
Méthodiquement lent, dans un effort d'ensemble;
Chacun dénoue un nœud, en la complexité
Des problèmes qu'on y rassemble;
Et tous scrutent et regardent et prouvent,
Tous ont raison—mais c'est un seul qui trouve!
Ah celui-là, dites I de quels lointains de fête;
Il vient, plein de clarté et plein de jour,
Dites! avec quelle flamme au cœur et quel amour
Et quel espoir illuminant sa tête;
Dites! comme à l'avance et que de fois
Il a senti vibrer et fermenter son être
Du même rythme que la loi
Qu'il définit et fait connaître.
Comme il est simple et clair devant les choses
Et humble et attentif, lorsque la nuit
Glisse le mot énigmatique en lui
Et descelle ses lèvres closes;
Et comme en s'écoutant, brusquement, il atteint,
Dans la forêt toujours plus fourmillante et verte,
La blanche et nue et vierge découverte
Et la promulgue au monde ainsi que le destin.
Et quand d'autres, autant et plus que lui,
Auront à leur lumière incendié la terre
Et fait crier l'airain des portes du mystère,
—Après combien de jours, combien de nuits,
Combien de cris poussés vers le néant de tout.
Combien de vœux défunts, de volontés à bout
Et d'océans mauvais qui rejettent les sondes—
Viendra l'instant, où tant d'efforts savants et ingénus,
Tant de génie et de cerveaux tendus vers l'inconnu,
Quand même, auront bâti sur des bases profondes
Et jaillissant au ciel, la synthèse des mondes!
C'est la maison de la science au loin dardée,
Vers l'unité de toutes les idées.
LES IDÉES
Sur la Ville, dont les affres flamboient,
Régnent, sans qu'on les voie,
Mais évidentes, les idées.
On les rêve parmi les brumes, accoudées
En des lointains, là-haut, près des soleils.
Aubes rouges, midis fumeux, couchants vermeils,
Dans le tumulte violent des heures,
Elles demeurent;
Et leur âme, par au-delà du temps et de l'espace,
S'éternise, devant les flux et les reflux qui passent.
Et la première et la plus vaste, c'est la force
Epanouie ou souterraine,
Multipliée en poings, en bras, en torses,
Ou tout à coup sereine,
Dans un cerveau suprême et foudroyant.
Par à travers l'or effrayant,
Les cris, la chair, le sang, la lie,
Elle apparaît: celle qui tend ou qui délie
L'énorme effort humain bandé vers la folie.
Depuis que se mangent ou se fécondent
A chaque instant qui naît, qui meurt, les mondes,
L'atome est vibrant d'elle.
Elle est l'ardeur de la conquête universelle.
Indifférente au bien, au mal, mais haletante
En chaque assaut dont les cités sont fermentantes,
Elle érige la gloire en beau geste dans l'air,
Ou bien allume, à coups d'éclairs,
Parla nuit sourde où rien ne bouge,
Le crime immense avec la mort à son poing rouge.
Et voici la justice et la pitié, jumelles;
Mères au double cœur dont les claires mamelles
Versent le jour clément et se penchent vers tous.
Ceux d'aujourd'hui les affichent deux ennemies
Luttant avec des cris et des antinomies,
Au nom de Christ, le maître abominable ou doux,
Selon celui qui interprète ses paroles.
La loi qui est déesse, on la proclame idole;
Et les codes sont des meutes qu'on dresse à mordre;
Et la peur règne—mais l'ordre,
Qui doit s'ouvrir comme une grande fleur
Libre et vive, malgré ses milliers de pétales,
Dont nul n'a comprimé l'ardeur,
Puisera l'équité dans la bonté totale.
Oh! l'avenir montré tel qu'un pays de flamme,
Comme il est beau devant les âmes,
Qui, malgré l'heure, ont confiance en leur vouloir.
Tant de siècles ne détiennent l'espoir,
Depuis mille et mille ans, indestructible,
Sans que tous les désirs ligués, frappant la cible,
Ne tuent un jour la haine et n'instaurent l'amour.
La conscience humaine est sculptée en contours
Puissants et délicats que, sans cesse, elle affine,
Pour transmuer sa vie en facultés divines
Et créer son bonheur et s'affirmer: un Dieu;
Le futur éclatant est un oiseau de feu,
Dont les plumes, une par une,
Se détachant de l'aile et retombant vers nous,
Frôlent de flamme et de splendeur nos regards fous.
Et plus haute que n'est la force et la justice,
Par au delà du vrai, du faux, de l'équité,
Plus loin que l'innocence ou que le vice,
Luit la beauté.
Touffue et claire,
Méduse ténébreuse et Minerve solaire,
Fondant le double mythe en unique splendeur,
Elle épouvante de grandeur.
Sublime, elle a pour prêtres les génies
Qui communient
De la lumière de ses yeux;
Les temps sont datés d'elle et marchent glorieux,
Selon que son vouloir les prend pour ostiaires;
Son poing crispé saisit les mille éclairs contraires
Et les assemble et les resserre et les unit,
Pour tordre et pour forger d'un coup, tout l'infini.
La rose Egypte et la Grèce dorée
Jadis, aux temps des Dieux, l'ont instaurée
En des temples d'où s'envolait l'oracle;
Et Paris et Florence ont rêvé le miracle
D'être, à leur tour, l'autel où ses pieds clairs,
Vibrants d'ailes, se poseraient sur l'univers.
Aujourd'hui même, elle apparaît dans les fumées
Les yeux offerts, les mains encor fermées,
Le corps exalté d'or et de soleil;
Un feu nouveau d'entre ses doigts vermeils
Glisse et provoque aux conquêtes certaines,
Mais les marteaux brutaux des tapages modernes
Cassent un bruit si fort, sous les cieux ternes,
Que son appel vers ses fervents s'entend à peine.
Et néanmoins elle est la totale harmonie
Qui se transforme et se restaure à l'infini,
Par à travers les mille efforts que l'on croit vains.
Elle est la clef du cycle humain,
Elle suggère à tous l'existence parfaite,
La simple joie et l'effort éperdu,
Vers les temps clairs, baignés de fêle
Et sonores, là-bas, d'un large accord inentendu.
Quiconque espère en elle est au delà de l'heure
Qui frappe aux cadrans noirs de sa demeure;
Et tandis que la foule abat, dans la douleur,
Ses pauvres bras tendus vers la splendeur,
Parfois, déjà, dans le mirage, ou quelque âme s'isole,
La beauté passe—et dit les futures paroles.
Sur la Ville, d'où les affres flamboient,
Régnent, sans qu'on les voie,
Mais évidentes, les idées.
VERS LE FUTUR
O race humaine aux astres d'or nouée,
As-tu senti de quel travail formidable et battant,
Soudainement, depuis cent ans,
Ta force immense est secouée?
Du fond des mers, à travers terre et cieux,
Jusques à for errant des étoiles perdues,
De nuit en nuit et d'étendue en étendue,
Se prolonge là-haut le voyage des yeux.
Tandis qu'en bas les ans et les siècles funèbres,
Couchés dans les tombeaux stratifiés des temps,
Sont explorés, de continent en continent,
Et surgissent poudreux et clairs de leurs ténèbres.
L'archarnement à tout peser, à tout savoir,
Fouille la forêt drue et mouvante des êtres
Et malgré la broussaille où tel pas s'enchevêtre
L'homme conquiert sa loi des droits et des devoirs.
Dans le ferment, dans l'atome, dans la poussière,
La vie énorme est recherchée et apparaît.
Tout est capté dans une infinité de rets
Que serre ou que distend l'immortelle matière.
Héros, savant, artiste, apôtre, aventurier,
Chacun troue à son tour le mur noir des mystères
Et grâce à ces labeurs groupés ou solitaires,
L'être nouveau se sent l'univers tout entier.
Et c'est vous, vous les villes,
Debout
De loin en loin, là-bas, de l'un à l'autre bout
Des plaines et des domaines
Qui concentrez en vous assez d'humanité,
Assez de force rouge et de neuve clarté,
Pour enflammer de fièvre et de rage fécondes
Les cervelles patientes ou violentes
De ceux
Qui découvrent la règle et résument en eux,
Le monde.
L'esprit des campagnes était l'esprit de Dieu;
Il eut la peur de la recherche et des révoltes,
Il chut; et le voici qui meurt, sous les essieux
Et sous les chars en feu des nouvelles récoltes.
La ruine s'installe et souffle aux quatre coins
D'où s'acharnent les vents, sur la plaine fuie,
Tandis que la cité lui soutire de loin
Ce qui lui reste encor d'ardeur dans l'agonie.
L'usine rouge éclate où seuls brillaient les champs;
La fumée à flots noirs rase les toits d'église;
L'esprit de l'homme avance et le soleil couchant
N'est plus l'hostie en or divin qui fertilise.
Renaîtront-ils, les champs, un jour, exorcisés
De leurs erreurs, de leurs affres, de leur folie;
Jardins pour les efforts et les labeurs lassés,
Coupes de clarté vierge et de santé remplies?
Referont-ils, avec l'ancien et bon soleil,
Avec le vent, la pluie et les bêtes serviles,
En des heures de sursaut libre et de réveil,
Un monde enfin sauvé de l'emprise des villes?
Ou bien deviendront-ils les derniers paradis
Purgés des dieux et affranchis de leurs présages,
Où s'en viendront rêver, à l'aube et aux midis,
Avant de s'endormir dans les soirs clairs, les sages?
En attendant, la vie ample se satisfait
D'être une joie humaine, effrénée et féconde;
Les droits et les devoirs? Rêves divers que fait
Devant chaque espoir neuf, la jeunesse du monde!
TABLE
LES CAMPAGNES HALLUCINÉES
La ville
LES PLAINES
CHANSON DE FOU
LE DONNEUR DE MAUVAIS CONSEILS
CHANSON DE FOU
PÈLERINAGE
CHANSON DE FOU
LES FIÈVRES
CHANSON DE FOU
LE PÉCHÉ
CHANSON DE FOU
LES MENDIANTS
LA KERMESSE
CHANSON DE FOU
LE FLÉAU
CHANSON DE FOU
LE DÉPART
L'AME DE LA VILLE
UNE STATUE (MOINE)
LES CATHÉDRALES
UNE STATUE (SOLDAT)
LE PORT
LES SPECTACLES
LES PROMENEUSES
UNE STATUE (BOURGEOIS)
LES USINES
LA BOURSE
LE BAZAR
L'ÉTAL
LA RÉVOLTE
AU MUSÉE
UNE STATUE (APÔTRE)
LA MORT
LA RECHERCHE
LES IDÉES