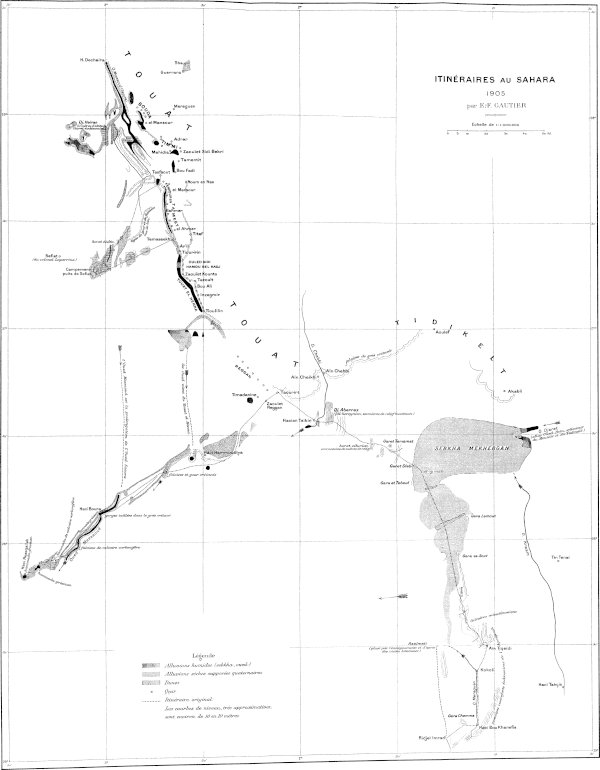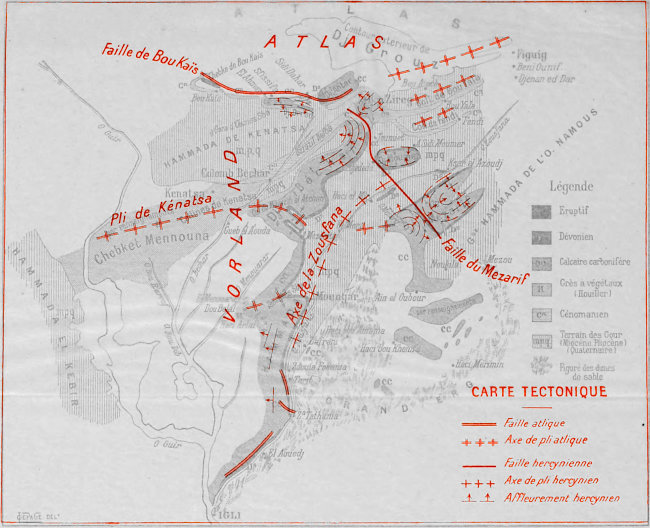On peut cliquer sur les cartes et les figures pour les agrandir.
Table des figures et planches — Table des matières
MISSIONS AU SAHARA
SAHARA ALGÉRIEN
LIBRAIRIE ARMAND COLIN
Voyages au Maroc (1899-1901), par le Marquis de Segonzac. Un volume in-8o de 400 pages, avec 178 photographies, dont 10 grandes planches hors texte (20 panoramas en dépliants), 1 carte en couleur hors texte et de nombreux appendices, broché20 fr.
Relié demi-chagrin, tête dorée27 fr.
Le Rif et les Djébala : Tanger, Fès, Melilia ; Melilia, Ouezzan, Tanger. — Les Braber : de Qçar-el-Qebir à la vallée de Fès, de la vallée de Fès à la vallée de la Mlouïa ; vallée de la Mlouïa ; de la Mlouïa au Sbou. — Le Sous : Marrakech, Taroudant, Tiznit, Agadir, Mogador. — Renseignements politiques, statistiques et religieux. — Appendices : politique ; — astronomique ; — météorologique ; — géologique ; — botanique ; — entomologique ; — numismatique ; — géographique.
(Ouvrage couronné par l’Académie française. Prix Furtado.)
1702-07. — Coulommiers. Imp. Paul BRODARD. — 4-08.
MISSIONS AU
SAHARA
par
E.-F. GAUTIER et R.
CHUDEAU
TOME I
SAHARA ALGÉRIEN
PAR
E.-F.
GAUTIER
Chargé de Cours à l’École supérieure des
Lettres d’Alger
65 figures et cartes dans le
texte et hors texte, dont 2 cartes en couleur,
et 96 phototypies hors texte
![[Décoration]](images/logo.png)
PARIS
LIBRAIRIE ARMAND COLIN
5, RUE DE MÉZIÈRES, 5
1908
Droits de reproduction et de traduction
réservés pour tous pays.
A PAUL BOURDE
Souvenir reconnaissant.
[vii]PRÉFACE
En 1902, 1903, 1904 et 1905, j’ai fait une série de voyages au Sahara, d’abord seul, puis en compagnie de M. Chudeau, qui à son tour a voyagé seul jusqu’à la fin de 1906.
Voici le détail de ces voyages : juillet, août et septembre 1902, voyage au Gourara par l’oued Saoura ;
Février-septembre 1903, voyage à In Ziza par In Salah, en compagnie de M. le baron Pichon, et à la suite de M. le commandant Laperrine ;
Décembre 1904 à septembre 1905, voyage transsaharien par In Ziza, Gao, Tombouctou.
M. Chudeau m’a rejoint à Taourirt en mai 1905, il a traversé le Sahara par le Hoggar, l’Aïr, Zinder, et, après avoir poussé jusqu’au Tchad, il est rentré en Europe à la fin de 1906.
Chacun de nous a donc passé au Sahara de dix-huit à vingt mois. Il se trouve que M. Chudeau a surtout voyagé dans le Sahara soudanais, et moi dans le Sahara algérien. Chacun s’est chargé de rédiger les résultats communs pour la région qu’il connaissait le mieux. Je publie aujourd’hui un premier volume consacré au Sahara septentrional, et qui sera suivi d’un second, sous la signature de M. Chudeau, consacré au Sahara méridional.
Il est bien entendu que cette division du Sahara en deux parties nous est imposée par les hasards de notre itinéraire.[viii] Nous n’avons nullement la prétention qu’elle soit géographiquement justifiée. Elle serait même absurde en géographie humaine. Aussi le chapitre III du présent volume sera-t-il consacré à l’ethnographie préhistorique du Sahara tout entier, partie soudanaise incluse. A tout autre point de vue cette division est commode, elle permet de traiter à part des questions distinctes.
Par exemple, au point de vue géologique, la limite est bien nette entre le Sahara gréseux et calcaire du nord, et le Sahara central (Hoggar et Tanezrouft) avec ses roches métamorphiques, archéennes et éruptives.
Entre le nord et le sud la nature différente des vestiges de l’âge quaternaire met une vive opposition. Dans le nord, ce sont des lits d’oueds profondément gravés ; le chapitre II du présent volume est une monographie d’un fleuve quaternaire. Dans le sud, au contraire, les traces les plus apparentes qu’a laissées le quaternaire sont des dunes fossiles. Ceci revient à dire que dans le nord le désert a succédé à la steppe et dans le sud la steppe au désert : un gros fait qui n’a jamais été mis en lumière.
Nous avons donc pu nous partager le Sahara sans nuire à l’unité des sujets respectivement traités.
En ce qui me concerne, le présent volume, qui paraît sous ma responsabilité, n’est pas le moins du monde un compte rendu de voyage ; c’est une exposition synthétique des résultats obtenus, et on a donc emprunté à la bibliographie du sujet tous les renseignements susceptibles d’éclairer cette synthèse.
On a donné une place faible ou nulle, d’une part aux résultats astronomiques et topographiques, d’autre part aux résultats paléontologiques.
Les premiers sont relégués dans un appendice ; il est vrai qu’ils ont été utilisés pour l’établissement des deux cartes, qui accompagnent les chapitres II et VII ; il est vrai aussi que ces deux cartes font ressortir quelques faits nouveaux et intéressants (cours de l’O. Messaoud, dessin de l’Açedjerad, position[ix] d’Ouallen). Ces itinéraires originaux n’en sont pas moins une faible fraction de l’itinéraire total parcouru, et leur originalité d’ailleurs n’est pas toujours entière. C’est que les officiers des oasis ont fait une besogne topographique énorme et excellente, et qui a été en grande partie publiée. On la trouvera éparse dans les suppléments au Bulletin du comité de l’Afrique française. Elle a été synthétisée dans deux cartes récentes : Carte provisoire de l’extrême-sud au 1/800000, dressée à l’aide des documents topographiques existant dans les archives du gouvernement général par M. le capitaine Prudhomme. Carte des oasis sahariennes, 1/250000, par MM. le lieutenant Nieger et le maréchal des logis Renaud (Paris, 1904). D’une façon générale je renvoie le lecteur à ces deux cartes.
Dans un ouvrage où j’ai donné une place considérable à l’étude géologique et plus spécialement stratigraphique on pourra s’étonner que la paléontologie soit à peu près complètement absente. Pourtant un grand nombre de fossiles ont été recueillis. Ceux qui se rapportent à l’âge carboniférien, encore qu’intéressants par la nouveauté des gisements, ne nous apprennent rien de nouveau sur la faune dinantienne au Sahara. Les fossiles dévoniens en revanche sont apparemment intéressants, surtout ceux des étages supérieurs, puisque M. Haug, dans le laboratoire de qui ils ont été déposés, va leur consacrer une monographie.
Couvert par sa haute autorité, je me suis borné ici à considérer comme acquises les données paléontologiques sur lesquelles j’ai appuyé mes études stratigraphiques ; et j’ai consacré tous mes efforts à dégager autant que possible l’architecture du pays.
Les photographies reproduites dans ce volume ne sont pas toutes de moi, tant s’en faut. Beaucoup ont été prises par M. le baron Pichon, mon compagnon de voyage en 1903. Un certain nombre m’ont été obligeamment prêtées par M. le lieutenant-colonel Laperrine[1].
[x]J’ai repris et refondu dans mon texte plusieurs articles de moi, antérieurement publiés dans des revues diverses. J’ai été amené à les modifier profondément non seulement dans la forme mais aussi dans le fond.
Il me reste à dire que notre voyage eût été impossible sans l’appui que nous avons trouvé d’une part à Paris et d’autre part aux oasis.
Un groupe de personnalités parisiennes, MM. Paul Bourde, Le Châtelier, Étienne, Dr Hamy, Levasseur, Michel Lévy, ont bien voulu s’occuper de recueillir sur mon nom les subventions nécessaires. Je dois une reconnaissance tout particulièrement profonde à MM. Paul Bourde et Le Châtelier.
Je remercie les institutions qui, à la requête de ces messieurs, ont bien voulu me subventionner, les ministères de l’Instruction publique et des Colonies, l’Académie des Inscriptions, la Société de Géographie de Paris, la Société d’encouragement à l’Industrie nationale, la Société de Géographie commerciale.
Aux oasis, je suis particulièrement l’obligé de M. le lieutenant-colonel Laperrine et de M. le commandant Dinaux, mais je suis par surcroît l’obligé de tout le monde.
[1]Quelques photographies anonymes ont été achetées aux soldats chargés de la poste à Colomb-Béchar et à Tar’it.
[1]SAHARA ALGÉRIEN
CHAPITRE I
ONOMASTIQUE
Les ouvrages descriptifs concernant l’Afrique du Nord sont hérissés de mots arabes ; tout particulièrement les comptes rendus d’itinéraires écrits sur place par nos officiers, sous la suggestion immédiate du pays ; et par exemple les articles de ce genre, très intéressants et très importants, qui paraissent depuis quelques années dans les suppléments au Bulletin du Comité de l’Afrique française. D’ailleurs même les ouvrages écrits à tête reposée, en France, et pour un public métropolitain, ne sont pas exempts du même défaut, puisque, invariablement, en tête ou en queue du livre, on trouve un petit dictionnaire des termes géographiques arabes[2].
Ces textes, lardés de mots empruntés à une langue étrangère, sont à coup sûr exaspérants pour le public français.
Que le défaut, si c’en est un, soit commun à tous les géographes nord-africains, cela suffirait déjà à les justifier. Ils obéissent à une nécessité. En France nos topographes recueillent précieusement les termes géographiques locaux (douix de Bourgogne, combes du Jura, puys d’Auvergne, etc.) pour en enrichir le vocabulaire général. Nous trouvons à ces termes, indispensables d’ailleurs, puisqu’ils correspondent à des nuances nouvelles, une valeur éducative ; ils nous permettent de classer des notions et nous forcent à les approfondir. Il est clair que les termes géographiques arabes ont la même valeur, et le même caractère indispensable.
[2]Dans un pays comme le Sahara où les formes du terrain, les aspects du sol, les modes de l’hydrographie, sont parfaitement originaux, sans analogues chez nous, il serait absurde de vouloir se tirer d’affaire avec notre vocabulaire français ; pour être compris de tout le monde on renoncerait à l’être réellement de personne, puisqu’on s’interdirait toute précision. D’autre part vouloir créer des expressions françaises nouvelles, serait d’abord se résigner à l’emploi de périphrases, étant donnée la rigidité de notre vieille langue. Mais par surcroît ce serait d’une outrecuidance ridicule : des mots nouveaux, immédiatement acceptés de tout le monde, il en naît tous les jours, mais on ne les crée pas consciemment.
Les paysages polaires ne sont guère plus éloignés des nôtres que les paysages désertiques. Pour en rendre les différents aspects il est né dans le domaine des langues germaniques, et plus spécialement de la langue anglaise un vocabulaire spécial, qui a sans difficulté passé dans le nôtre. Nos géographes polaires emploient sans hésitation un grand nombre de mots, comme floe, pack-ice, inlandsis, dont on peut bien dire qu’ils n’ont pas encore, pour beaucoup de lecteurs une signification bien précise. D’autres termes ont, d’ores et déjà, passé franchement dans l’usage courant, fjord, iceberg. Il en est un au moins qui s’est francisé jusque dans son orthographe ; car c’est, j’imagine, quelque chose comme « bank-ice » qui s’est déguisé en « banquise ».
Ce petit effort d’acclimatation, que nous avons fait sans y songer pour le pôle, il est inadmissible que nous refusions de nous l’imposer pour notre Sahara, un pays dont nous avons en quelque sorte la responsabilité scientifique.
On n’a pas naturellement la prétention d’apporter ici une idée, ou de montrer une voie nouvelles. Le processus de naturalisation des termes arabes a déjà commencé automatiquement. Les mots dont on s’occupera dans les lignes qui suivent ne sont pas tous pour le public français des étrangers au même degré. Tout le monde sait, j’imagine, ce que c’est qu’un oued par exemple. Mais il y a peut-être intérêt à substituer au lexique usuel, qui voisine avec la table des matières et celle des errata, une tentative d’explication coordonnée.
Expliquer un mot d’ailleurs, c’est chercher à comprendre la chose, à en dégager la genèse. Un chapitre d’onomastique saharienne c’est en quelque sorte une étude du climat désertique dans son retentissement sur les sols, les formes topographiques, l’hydrographie.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. I. |

Cliché Gautier
1. — TYPE DE HAMMADA
Dalles et esquilles de grès éo-dévonien.
entre In-Semmen et Meghdoua dans l’Açedjerad.
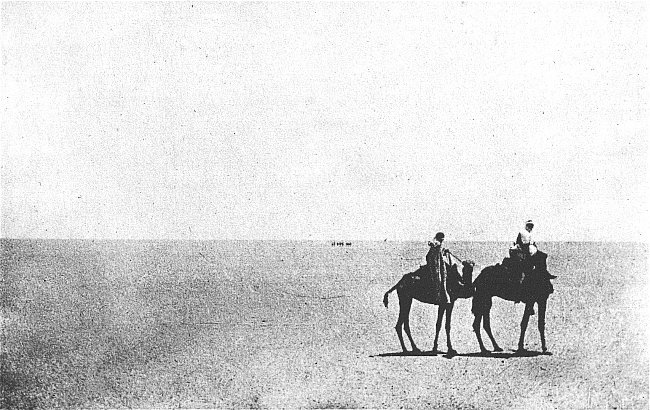
| Phototypie Bauer, Marchet et Cie, Dijon | Cliché Laperrine |
2. — TYPE DE REG
Plaine d’alluvions décapée.
[3]Les sols.
Hammada. — Le mot a déjà pénétré dans le vocabulaire géographique, jusqu’à un certain point. Il le doit peut-être au livre de Schirmer, à quelques belles photographies de Foureau, aux détails donnés par Flamand sur les hammadas pliocènes subatliques. Bref on a déjà répandu dans le public des données scientifiques précises sur la hammada et le mot commence à acquérir droit de cité chez nous.
Rappelons que ce sont des plateaux rocheux à peu près horizontaux ; l’âge et la nature de la roche importent peu ; tantôt calcaires pliocènes (hammada de Kenatsa, de l’O. Namous) — d’autres fois calcaires carbonifériens (hammada de Tar’it) — calcaires crétacés dans le Tadmaït — grès éodévoniens dans le Mouidir, l’Ahnet, l’Açedjerad. — Ce qui distingue la hammada du plateau c’est le facies très particulier que lui a donné le climat désertique. La roche est nue, décharnée de toute terre végétale, récurée et polie par le vent, vernissée uniformément par des actions chimiques, qui ont été étudiées minutieusement par Walther ; de grandes étendues luisantes et monochromes. Sous l’influence des températures extrêmes la roche a éclaté en grandes dalles et en menues esquilles, formant sous les pieds un chaos qui rend souvent la marche pénible.
La hammada est en somme la forme désertique du plateau comme le reg est la forme désertique de la plaine.
Notons que le mot hammada a au moins un synonyme ; c’est « gada » qui est employé dans le djebel Amour, et dans l’Atlas saharien, mais qu’on retrouve aussi plus au sud, à Beni Abbès notamment.
La traduction berbère de hammada est tassili (le tassili des Azguers, etc.).
Il est possible que, en approfondissant, on trouverait entre ces mots des nuances différentes de sens. Mais je ne suis pas en état de le faire, et tout cela, en gros, rentre bien dans la catégorie hammada (voir pl. I, phot. 1).
Reg. — Un des mots les plus répandus et les plus intraduisibles.
Quand on essaie d’en serrer de près le sens on s’aperçoit que le reg est avant tout une plaine rigoureusement horizontale. Tandis que le mot n’a pas pénétré dans le langage courant géographique, la chose est bien connue du grand public ; elle l’est même trop. Dans le grand public l’idée de désert évoque, à l’exclusion de toute autre[4] image, sauf peut-être celle des dunes, une grande plaine infinie parfaitement nue et plate comme la mer. Qu’on ajoute la silhouette d’un Bédouin et de son chameau, ou bien encore une fumée de bivouac, qui monte mince et rectiligne dans l’air immobile, et on a un tableau qui a été fait cent fois, et qui est dans toutes les mémoires. C’est une bonne représentation du reg. (Voir pl. I, phot. 2.)
Une plaine aussi parfaite est nécessairement d’alluvions ; et le reg en effet est d’origine alluvionnaire. Cette origine pourtant ne se décèle pas au premier coup d’œil. De façon à peu près constante le sol est couvert de gravier, gros ou menu, disparate, en couche plus ou moins épaisse ; on a l’impression d’une allée de jardin, élargie démesurément jusqu’au bout de l’horizon. Mélangées au gravier, et posées sur le sol en vrac, on trouve des choses hétéroclites, pointes de flèches et haches néolithiques par exemple.
Voici une coupe de reg, relevée, par M. Chudeau dans l’oued Takouiat entre In Ziza et Timissao. On observe de haut en bas :
1o Un lit de cailloux roulés quartzeux, de 5 millimètres à 1 centimètre de diamètre, couvrant toute la surface.
2o 10 centimètres de sable pur, contenant quelques cailloux et vers sa partie inférieure du sable fin.
3o Sable argileux.
Le gravier qui couvre le sol est évidemment le résidu de couches supérieures enlevées par l’érosion éolienne. Le sol désagrégé par la sécheresse a livré au vent, pour être emportés au loin, tous ses éléments terreux, dissous par pulvérulence en particules légères ; le cailloutis est resté en place.
Il s’ensuit que ces alluvions sont nécessairement anciennes, leur dépôt remonte à une époque géologique antérieure, puisque, actuelles, elles resteraient assez humides pour se défendre contre le vent. Aussi bien par leur distribution, et par leur énorme extension, elles ne trahissent aucune connexité avec le régime hydrographique actuel.
Nous avons donc les éléments d’une définition satisfaisante du reg. Une plaine d’alluvions anciennes, à laquelle le décapage éolien a donné un facies original. C’est une individualité géographique tranchée, qui mérite un nom à part.
Erg. — Ici toute explication est superflue. Les énormes amas des dunes sont dans le paysage saharien le trait qui a le plus frappé l’imagination de prime abord ; et le mot d’Erg qui les désigne s’est à peu près acclimaté chez nous. Les cartes l’ont adopté (Grand Erg, Erg oriental, etc.). Il nous est indispensable malgré la coexistence en français[5] du mot dunes, puisqu’il désigne un énorme amas de dunes continentales, et somme toute une individualité géographique tout à fait originale.
Le vocabulaire arabe est riche en termes précis qui désignent les différents aspects de l’erg. On est conduit nécessairement à en retenir quelques-uns vraiment indispensables. (Voir pl. III, phot. 6.)
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. II. |

Cliché Gautier
3. — TYPE DE FALAISE (baten ou kreb)
dans les calcaires dinantiens.
Oued Zousfana entre les Beni Goumi et Igli.

Cliché Laperrine
4. — UN COIN DU TASSILI AUPRÈS DE TIMISSAO
Érosions confuses dans les grès éo-dévoniens ruiniformes.
Peut être considéré comme un type de Chebka.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. III. |

Cliché Pichon
5. — TYPE DE GARA
Haci Gouiret au sud d’In Salah.
L’entablement est en grès albien ; au sommet, petites ruines d’âge indéterminé.

Cliché Laperrine
6. — ERG ET NEBKA
Au premier plan Erg ; on distingue bien les sifs (versants abrupts), tous orientés dans le même sens ; — au second plan la dune s’abaisse, on voit apparaître des taches noires de végétation, c’est la nebka.
Sif. — Le mot sif par exemple désigne la pente raide des dunes, celle qui est sous le vent ; le mot sif, qui signifie sabre, évoque heureusement l’idée de ces longues balafres, courbes, qui semblent sur la face de l’erg l’empreinte d’une lame gigantesque. Dans une région déterminée le regard des sifs[3] est constant, occidental par exemple, là où le vent dominant souffle de l’est.
Feidj ou gassi. — L’erg est articulé au moins dans ses parties les plus accessibles par de longs couloirs libres de sable, que les indigènes appellent gassi dans l’est et feidj dans l’ouest.
Un des résultats les plus intéressants, et peut-être les moins remarqués des explorations de M. Foureau dans l’erg oriental, est de nous avoir fait connaître la distribution de ces gassis. Sur une carte d’ensemble on les voit courir dans une direction uniforme, parallèles les uns aux autres, extrêmement allongés et vermiformes. Et sans doute faut-il tenir compte d’une schématisation forcée, mais qui souligne des faits incontestables. Ce qui frappe ce n’est pas seulement que les feidjs soient parallèles entre eux, mais encore qu’il y ait une relation évidente entre leur direction et celle des vallées quaternaires.
Et l’explication est, je crois, assez aisée à imaginer : le vent dominant accumule le sable sur les lignes du modelé qui courent normalement à sa direction.
Les mots feidj et gassi signifient respectivement « col »[4] et « rue ». Ce sont en effet les routes naturelles que suivent les caravanes. On évite soigneusement les dunes, même lorsqu’on traverse l’erg. Parmi tant de légendes européennes concernant le chameau, celle qui en fait un animal adapté à la dune est une des plus absurdes.
On a justement attiré l’attention sur son pied large et spongieux, qui lui fait une marche si particulière, silencieuse et nonchalante, comme en pantoufles ou en espadrilles ; ce pied est évidemment[6] accommodé à un terrain mou et sec, où il enfonce moins par exemple que le sabot pointu d’un cheval[5]. Chez l’antilope adax, animal exclusivement saharien, on observe aussi un élargissement disproportionné du pied. (Voir pl. XXXIV, phot. 64.) Le pied du chameau est d’ailleurs tout aussi bien adapté à la marche sur la hammada, où par sa plasticité il donne à l’animal une prise bien plus solide sur le roc nu que ne ferait un sabot dur et glissant.
Par-dessus tout l’animal ainsi chaussé est incapable d’avancer sur un sol boueux, il s’y enlise et il y patine en grandes glissades dangereuses. Bref le pied du chameau est un pied désertique, ainsi qu’on pouvait aisément le prévoir.
Mais ses longues jambes grêles et fragiles, son corps rigide et pataud où toute la souplesse s’est réfugiée dans le cou, en font une bête de plaine, destinée à la progression rapide en ligne droite, à travers d’immenses espaces, sur terrain facile. La traversée des regs est le triomphe du chameau, les pentes raides le déconcertent.
Or l’erg est très accidenté ; l’ascension ou même la descente d’un sif un peu accusé devient une rude épreuve pour une caravane, il n’est pas rare qu’un chameau roule et se casse une patte. Un cheval vif, souple, à la fois bien plus leste de corps et plus apte de tempérament à un effort bref, à un coup de collier, rend de bien meilleurs services dans les ergs que le méhari. D’ailleurs le méhariste traverse la dune, quand il ne peut pas faire autrement, à pied, en tirant sa monture par la bride.
En général il s’efforce de la contourner ; on suit les feidjs, la traversée d’un erg considérable à « contre-sif » est une entreprise terrible ou parfois impossible. Et on conçoit dès lors que dans les préoccupations des voyageurs et par suite dans les comptes rendus d’itinéraires les mots de feidj ou de gassi et de sif prennent une grande importance.
Nebka. — Les indigènes distinguent nettement et non sans raison sous le nom de nebka[6] une catégorie tout à fait particulière de dunes.
Ce sont des dunes en miniature, des mamelonnements légers ; elles sont par surcroît parsemées de verdure, les touffes se trouvent non pas dans les interstices des mamelons, où l’expérience des paysages d’érosion porterait à les chercher, mais tout au contraire au[7] sommet des petites dunes exiguës ; c’est que la touffe ou l’arbuste a été précisément l’obstacle autour duquel le sable s’est accumulé. Une autre caractéristique de la nebka est la blancheur du sable, qui atteste comme la médiocrité du relief la jeunesse de la formation. Les hautes et vieilles dunes sont d’une belle couleur dorée, parce que, à travers les siècles, le brassage éolien a oxydé les grains de quartz. (Voir pl. III, phot. 6 et pl. VIII, phot. 15.)
Tout cela est très concordant, la nebka est de la dune en formation ; il est tout à fait intéressant que le concept en soit étroitement uni à celui de végétation ; une nebka est toujours un pâturage, et c’est précisément pour cela, pour son importance pratique et humaine, qu’elle a été désignée par un nom spécial qui revient fréquemment dans les itinéraires. C’est un champ de bataille où la végétation, étouffée par l’amoncellement éolien du sable, fait une résistance acharnée, et apparemment inutile à la longue. En certains cas c’est très nettement une section d’oued en voie d’obstruction ; dans l’oued Saoura par exemple au sortir de Foum el Kheneg (Voir pl. IX, phot. 19 et encore pl. XLV, phot. 84) ou bien encore à Tagdalt. Ainsi, rien qu’en serrant le sens du mot nebka, on est amené à concevoir que les dunes se forment aux dépens des alluvions fluviales.
Hammada, reg, erg et nebka, ce sont là en somme essentiellement des sols. Sol de pierre nue, de gravier, de sable ; ici sol de décapage (hammada et reg), là inversement sol d’alluvionnement éolien (erg et nebka). Dans les grandes lignes c’est une énumération satisfaisante des principaux sols sahariens, où toute la superficie, l’épiderme, porte la marque exclusive du vent ; tout cela est l’œuvre du simoun qui tantôt a raclé le sol jusqu’au squelette, tantôt l’a enfoui sous les balayures.
Notons qu’un élément fait défaut dans ces balayures, ce sont les particules d’argile, les poussières de limons ; il y a là des masses considérables de dépôts qui ont disparu et qui ne se retrouvent nulle part : sur le sol du moins ; — car je crois que l’atmosphère du Sahara contient une grande quantité de poussières. J’ai pris en effet aux époques les plus différentes un très grand nombre d’angles horaires du soleil (une centaine de séries au moins) ; je crois pouvoir affirmer que dans les journées les plus radieuses on ne peut pas observer à travers les verres foncés, parce qu’ils éteignent à peu près complètement le soleil ; l’air est constamment opaque, chargé de choses pulvérulentes ; cela tient apparemment à ce qu’il n’est jamais lavé par la pluie. Ces particules argileuses après avoir flotté longtemps entre ciel et terre, après avoir été charriées çà et là par le vent[8] finissent nécessairement par sortir du Sahara, et se déposent quelque part, dans l’Océan par exemple, très loin de leur pays d’origine. En tout cas le désert est le seul pays du monde où elles ne peuvent pas se déposer, des molécules à peu près impondérables ne peuvent pas tomber dans un air agité, et elles restent impondérables aussi longtemps qu’elles restent sèches. Par ce curieux processus naturel le désert exporte en pays humide la plus grande partie de ses argiles, d’où prédominance des sables.
Sol de timchent. — On n’a pas fait des formes du sol une énumération exhaustive dans le détail. Il faudrait faire une petite place par exemple au timchent. Sur des étendues parfois assez grandes on marche sur une croûte épaisse et continue de plâtre, à peu près pur, que les indigènes appellent timchent. Ce sont généralement des dépôts quaternaires, et assez souvent aquifères, beaucoup de puits sont creusés dans le timchent. Les dépôts gypseux, il est vrai, n’ont rien de particulièrement saharien, mais des plaines de gypse, le plâtre à l’état du sol, ont pourtant un cachet spécial, et il y a lieu peut-être de laisser à cette formation un nom particulier, qui évite une périphrase. (Voir des berges en timchent, pl. X, phot. 20.)
Formes du terrain.
Gara. — Le mot de gara est un de ceux qui sont en bonne voie de naturalisation française[7]. On sait qu’il désigne un « témoin » d’érosion, presque toujours composé de couches molles à la base protégées au sommet par un chapiteau de roche dure, calcaire, grès, basalte, etc. La gara est isolée de tous côtés, circonscrite de pentes raides, c’est une table. Cette forme du terrain n’est tout à fait inconnue nulle part, et pourtant je ne crois pas qu’elle soit désignée dans une autre langue que l’Arabe par un nom populaire. Il est vrai que nos climats humides se prêtent moins bien que le désertique à la sculpture des garas, surtout des petites, les plus frappantes parce qu’on les embrasse d’un coup d’œil ; il y faut un régime d’orages rares, brefs, et terribles, qui ruissellent sur la roche dure sans l’entamer et qui font des dégradations énormes et instantanées dans la pulvérulence des couches molles. Dans un pays humide où les couches dures sont attaquées chimiquement par l’infiltration des eaux, tandis que les couches molles imbibées forment une pâte plus compacte, leur écart[9] de résistance à l’érosion s’atténue, et les lignes du paysage tendent à s’arrondir en mamelonnements flous. Au Sahara la gara est une forme tout à fait habituelle et pullulante du relief. (Voir pl. III, phot. 5 ; pl. XXIX, phot. 55 ; pl. XLV, phot. 84.)
Baten et kreb. — Une autre forme tout à fait familière et d’ailleurs apparentée est la falaise, le gradin brusque en longue ligne, sculpté par l’érosion dans une complexe de couches tendres et dures. Les indigènes distinguent les grandes falaises, hautes d’une soixantaine de mètres qui courent sans discontinuité sur des centaines de kilomètres, et qu’ils appellent des batens ; et les petites, les ressauts plus ou moins insignifiants qu’ils appellent des krebs.
Dans une tentative d’exposition géographique il est inutile d’avoir recours à ces termes indigènes, puisque nous avons un mot français qui est parfaitement suffisant, celui de falaise. Mais ces dénominations de baten et kreb reviennent fréquemment sur les cartes ; le baten Ahnet est la falaise terminale de l’Ahnet, le baten du Gourara, la falaise terminale du Tadmaït. Au nord-ouest d’In Salah un petit accident porte le nom de Kreb er Rih. (Voir pl. II, phot. 3 ; pl. XXIII, phot. 44 ; surtout pl. XLIV, phot. 82.)
Moungar, tar’it. — L’onomastique de ces sortes d’accidents est très riche.
Un feston de falaise, ou si l’on veut un promontoire se nomme moungar, dans la vallée de la Zousfana un Moungar a été illustré récemment par une rencontre sanglante entre légionnaires et Marocains.
Il y a, non pas en arabe, mais en berbère, un synonyme exact à notre mot canyon. C’est Tar’it : le nom revient fréquemment au Sahara, il est porté par un ksar de la Zousfana, par un oued de l’Ahnet. L’arabe a d’ailleurs des synonymes qu’on retrouve fréquemment sur les cartes (Foum, Kheneg).
Chebka. — Tout à fait essentiel est le mot de chebka, auquel rien ne correspond dans notre langue. Ce sont des régions où le relief d’érosion devient confus ; le mot signifie littéralement filet, et il fait assez bien image, évoquant un entre-croisement, un dédale de garas et de batens. L’origine des chebkas a été excellemment expliquée par M. Flamand ; ce sont des zones de captage où des érosions d’âge et de sens différents se sont contrariées[8]. (Voir pl. II, phot. 4.)
[10]Le Sahara est peut-être le pays du monde où l’on a à sa disposition le vocabulaire le plus riche, pour suivre et pour serrer de près les aspects variés du travail érosif dans un pays d’architecture tabulaire. Le processus de l’érosion désertique et l’absence de végétation donnent à ces accidents une multiplicité, une raideur de pentes et une netteté de lignes tout à fait particulières. Aussi font-ils dans le paysage une impression d’œil disproportionnée à leur importance ; il y a là pour le topographe une difficulté peut-être insurmontable. Comment représenter sur une carte générale, à une échelle convenable, un kreb d’une dizaine de mètres à peine, qui est pourtant sur le terrain, malgré l’insignifiance de la dénivellation un trait du modelé extrêmement remarquable ?
Tout le Sahara crétacé et dévonien, c’est-à-dire la moitié septentrionale, est un pays de gara, de baten et de chebka. Pour nos yeux européens, habitués à des reliefs variés et flous, ces grands horizons sahariens monotones, aux lignes horizontales et heurtées, sont aussi étranges que le sol ou le climat. Dans ces paysages le dessin est aussi déconcertant que la couleur. Si on veut s’en rendre compte qu’on regarde la carte du Mouidir-Ahnet, par le commandant Laperrine et le lieutenant Voinot, publiée par le Bulletin de l’Afrique française[9], on y trouvera dans l’Adrar Ahnet cette mention, un peu naïve peut-être, mais qui rend fidèlement une impression juste : genre montagnes de France.
L’Adrar Ahnet est un tronçon de pénéplaine calédonienne, surélevé, et disséqué. On y voit des pitons, des crêtes, des aiguilles, des vallées, c’est-à-dire des formes pour lesquelles nous avons déjà des noms tout faits. Au fond ce modelé de l’Adrar Ahnet reste très original, très désertique. Ce massif, qui a 300 mètres à peine de ressaut, est aussi nu, aussi tourmenté, aussi sauvage que les plus hautes cimes des Alpes. Les pics sont presque aussi inaccessibles, les moindres ascensions présentent quelque danger et exigent des cordes. A une région, qui serait chez nous un gracieux paysage de collines, le climat et l’érosion désertiques ont donné un modelé de très haute montagne. Mais du moins cette originalité n’a pas de répercussion sur le vocabulaire. (Voir pl. XLVIII, phot. 89, pl. L et LI).
Hydrographie.
L’oued. — Le mot oued est naturalisé français. On sait qu’il désigne une rivière de pays sec à circulation superficielle intermittente.[11] La nécessité d’avoir un mot spécial, pour une catégorie de cours d’eau si particulière, a été si vivement sentie, et ce mot est devenu d’un usage si courant que toute explication est superflue.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. IV. |

Cliché Laperrine
7. — OUED SAHARIEN
Marqué simplement par une traînée de touffes vertes.
A l’horizon profil de dunes.

Cliché Pichon
8. — OUED TLILIA
Au second plan à droite berge de l’oued taillée par l’érosion quaternaire dans les calcaires crétacés.
L’oued actuel est représenté par les touffes de végétation, qui constituent un bon pâturage type.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. V. |
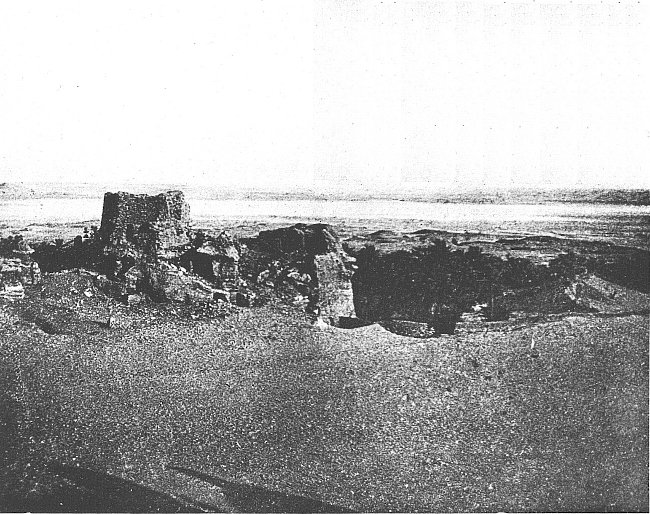
Cliché Gautier
9. — SEBKHA DE TIMIMOUN
La sebkha est au second plan ; une bande uniforme d’un blanc éclatant, à cause du sel.
Une sebkha est une cuvette fermée, où s’accumulent, faute d’exutoire, les substances chimiques.

Cliché Pichon
10. — TYPE DE MAADER (ou daya)
Pendant contrasté de la sebkha
C’est une cuvette alluvionnaire traversée par un courant souterrain, qui entraîne plus loin les produits chimiques ; en conséquence la nappe d’eau reste douce, et alimente la végétation.
Sebkha et chott. — On peut en dire autant des sebkhas et des chotts. Je ne crois pas qu’il y ait lieu de chercher une différence de signification entre les deux expressions. Ce sont simplement deux synonymes, le premier plus usité en Algérie et le second au Sahara.
Leurs aires respectives de distribution ne sont pourtant pas nettement délimitées. En Algérie, et dans une même province on dit la sebkha d’Oran et le chott R’arbi. Au Sahara on dit le chott Melr’ir, et la sebkha de Timimoun. J’imagine que la solution de cette petite difficulté serait dans une étude des frontières dialectales. En tout cas s’il existe entre les deux une nuance de sens je suis incapable de l’indiquer.
La sebkha, puisque c’est en somme l’expression saharienne (et c’est aussi, je crois, en conséquence, la moins familière au public français), n’a pas d’équivalent dans notre langue ; sur nos sols bien drainés nous n’avons pas de bassin fermé. C’est à la fois un lac et une zone d’épandage, le point terminus d’un réseau fluvial. Les caractères généraux sont trop connus pour qu’il y ait lieu d’insister — bords nettement délimités et souvent par des falaises, surface unie, nette de végétation et de sable ; fondrières et sables mouvants ; efflorescences salines qui augmentent lorsque des orages et des inondations déterminent un afflux de la circulation souterraine (Voir pl. V, phot. 9.)
Les termes hydrographiques, en somme, sont précisément ceux qui se passent le mieux de toute introduction auprès du public français. Cela est tout naturel si l’on songe que toute notre éducation géographique, et le simple usage de nos cartes, attirent particulièrement notre attention sur le réseau fluvial.
Les cours d’eau jouent dans la vie humaine un rôle capital aussi bien et plus encore au Sahara qu’ailleurs, mais ils le jouent autrement. Ce n’est plus le cours d’eau dans ses usages immédiats qui est ici essentiel, c’est la végétation. L’oued est par excellence un lieu de pâturages et devient ainsi le point d’attraction unique pour le nomade ; là est concentrée toute la vie parce que là seulement on trouve du vert.
Au point de vue alimentaire le régime hydrographique a une onomastique spéciale dont certains termes valent une tentative d’acclimatation.
[12]Maader. — Celui de maader par exemple paraît indispensable.
Il est inconnu, il me semble, dans le nord, dans la région de l’Atlas, où on emploie à sa place le mot daya, peut-être plus connu du public français (daya de Tilr’emt, plateau des dayas) ; je crois ce mot synonyme de maader à quelques nuances près.
En hydrographie désertique le maader est l’équivalent de notre lac, aussi exactement en somme que l’oued correspond à notre rivière. Dans le processus de disparition d’un lac, en passant par le marécage, on aboutirait au maader : une cuvette d’alluvions, nettement circonscrite, avec oueds affluents et effluents. C’est par son effluent que le maader se diversifie de la sebkha ; au lieu qu’un oued vienne y mourir, et l’incruster de dépôts chimiques, le maader est traversé et vivifié par un courant souterrain. Il est couvert de végétation ; les maaders sont parmi les plus beaux pâturages sahariens ; ce sont des points importants, centres de vie qu’il est impossible de laisser anonymes. (Voir pl. V, phot. 10.)
Le maader (au rebours de la sebkha qui reste unie parce qu’aride), a toujours une tendance à se mamelonner de sable accumulé autour des touffes, souvent il passe à la nebka, dont nous avons rattaché la mention à l’alinéa de l’erg, mais qui ne peut pas être passé sous silence à propos d’hydrographie. Et d’ailleurs il y a une corrélation évidente entre les maaders et les ergs. Les grands maaders du Mouidir, dont l’oued Bota est l’effluent, sont partiellement recouverts d’assez grands ergs, avec lesquels ils partagent les noms de Tegant et d’Iris. Les dunes envahissent de même les maaders de l’oued Adrem, le maader Arak, etc.
Nous arrivons ainsi, à propos de nomenclature, à suivre les principales étapes de la décomposition après décès du régime hydrographique ; ce qui fut évidemment un lac ou un marais devient un maader, puis une nebka, puis un erg ; et il est évidemment assez méconnaissable au premier coup d’œil sous ce dernier avatar.
Haci. — L’eau vive, libre, directement utilisable, se présente au Sahara sous des aspects dont la diversité a été minutieusement notée par l’onomastique indigène.
Certains mots ont leur équivalent français. Haci par exemple est très suffisamment traduit par notre puits, et c’est presque dommage ; le puits saharien en effet, est bien différent du nôtre par son rôle économique. Il jalonne les routes désertiques, marquant le gîte d’étape, tenant lieu d’hôtellerie et de caravansérail.
On le fait très étroit, à peine suffisant pour livrer passage à un[13] homme, qui y rappelle un ramoneur dans une cheminée. C’est que malgré toutes les précautions il s’ensable, il faut le désobstruer et presque le creuser à nouveau ; ce gros travail, toujours à recommencer, est d’autant moindre que le diamètre est plus petit. Dans ce pays où les habitations les plus somptueuses sont en pisé, les margelles des puits ont le privilège d’être grossièrement mais solidement maçonnées en pierres sèches ; et de telle façon que les voyageurs soigneux puissent fermer l’orifice avec des dalles, en lutant les interstices avec de la fiente de chameau. Et si imprévoyants que soient les indigènes ils n’y manquent pas, surtout les voyageurs isolés, ou en petites troupes, disposant pour désobstruer le puits d’un petit nombre de bras. Au voisinage du puits, autant que possible sur des éminences, en des points choisis pour être visibles de loin, se dressent des pyramides de pierre, des amers qui guident le voyageur. Il existe des formules déprécatives aux divinités des puits, qui semblent d’antiques oraisons païennes, mal islamisées : — celle-ci par exemple, avec laquelle on prend congé : « bqaou ala kheir, ehl el haci, ehl el ma — demeurez en paix, elfes du puits, elfes de l’eau ». Tout cela fait au puits saharien une physionomie à part, à laquelle n’est pas adéquat notre mot de puits, évocateur d’une cour de ferme ou d’un coin de grange.
Notons encore que le puits soudanais est tout différent du puits saharien ; dès qu’on arrive à l’Adr’ar des Ifor’ass la différence s’accuse brusquement ; le puits soudanais a un diamètre énorme à l’orifice même, cinq ou six mètres ; son seul aspect prouve que le climat est changé, on ne craint plus l’ensablement. (Voir pl. VII, phot. 13 et 14.)
Notons que le mot bir synonyme algérien de haci n’est guère usité au Sahara.
Aïn. — Le mot d’aïn a ceci de particulier qu’il correspond à deux concepts français bien distincts, celui de source naturelle et celui de puits artésien. Tout ce qui sourd, naturellement ou artificiellement, toute eau animée d’un mouvement ascendant porte le nom d’aïn. Ici donc le vocabulaire français est plus riche que l’arabe, et il n’y a pas lieu par conséquent d’avoir recours à ce dernier ; il est impossible pourtant de ne pas insister sur ce mot d’aïn qui revient à chaque instant sur les cartes, comme celui de haci d’ailleurs, et qui contribue à en rendre la lecture difficile[10].
Une source saharienne est, elle aussi, très différente de son homonyme[14] européen. Le mot évoque chez nous l’idée de ruissellement, on dit le bruissement d’une source, la source d’une rivière. La notion est étroitement unie à celle d’eau courante, et même, par extension à celle de commencement : on dit métaphoriquement « remonter à la source ». Dans ces acceptions, qui sont précisément les usuelles, le mot de source est intraduisible par celui d’aïn. Ici nous touchons du doigt l’indépendance essentielle des deux vocabulaires vis-à-vis l’un de l’autre. Lors même que deux termes se correspondent assez pour être pratiquement interchangeables, cette équivalence est apparente plutôt que réelle.
Dans un pays où le rapport entre les pluies et l’évaporation est tel qu’il ne peut pas exister un seul cours d’eau pérenne, une source ne coule jamais ; la source se présente sous l’aspect d’un simple trou d’eau, une vasque, à bords assez nets, quoiqu’on distingue d’anciens niveaux et des bavures, traces des variations du niveau suivant les saisons et les années. Souvent les bords et le fond même sont complantes de végétaux aquatiques (berdi par exemple, autrement dit typha). Le diamètre de la flaque est évidemment fonction du débit et de l’évaporation, l’homme n’en a pas le contrôle ; pourtant l’aspect du trou suggère l’idée d’un certain travail humain d’accommodation ; on a creusé, récuré, grossièrement entretenu les talus, transformé un suintement boueux en un bassin d’eau claire ; il y a là un rudiment de captage. Il n’existe peut-être pas au Sahara de source entièrement naturelle, comme chez nous ; l’homme a toujours collaboré, si modestement que ce soit, à l’œuvre de la nature ; il n’y a guère de sources sahariennes que captées.
Et dès lors on comprend mieux que le même mot d’aïn puisse désigner aussi un puits artésien. En dernière analyse, un puits artésien est une source particulièrement difficile à capter. Ceux des oasis d’ailleurs, ceux du moins qui sont anciens et purement indigènes, ne présentent pas extérieurement l’appareil mécanique des nôtres ; ils ne sont ni forés à la machine ni tubés. On sait qu’ils sont creusés et entretenus, avec des instruments primitifs, par une corporation de plongeurs, les r’tass. Ils ont donc extérieurement l’aspect banal d’un trou vaguement circulaire, dont la seule particularité, mais essentielle est d’être plein d’eau jusqu’au bord ou même à déborder. C’est exactement l’aspect d’une source, entre les deux catégories d’aïn il y a bien une différence de structure intérieure mais non pas de physionomie à la surface du sol. Tel puits artésien que j’ai vu aux environs d’Ouargla, ou bien encore celui d’Ouled Mahmoud dans le Gourara, ressemblent exactement à des sources Touaregs, comme Aïn[15] Tadjemout ou Aïn Tikedembati. Des photographies seraient interchangeables.
En somme sous le nom d’aïn les indigènes se représentent un orifice où l’eau affleure jusqu’à déborder, par opposition au puits, où l’eau ne se trouve qu’à une profondeur plus ou moins grande et parfois considérable.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. VI. |

Cliché Gautier
11. — AGUELMAN TAGUERGUERA (en aval)
dans le canyon de l’oued, dont on voit une des parois (grès éo-dévoniens).

Cliché Gautier
12. — AGUELMAN TAGUERGUERA (en amont) occupant tout le fond du canyon (grès éo-dévoniens).
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. VII. |

Cliché Laperrine
13. — PUITS DE TIMISSAO
Type de puits saharien à orifice étroit.

Cliché Laperrine
14. — TYPE DE PUITS SOUDANAIS à large orifice ; (Adr’ar des Ifor’ass.)
R’dir ou aguelman. — On pourrait être tenté de traduire le mot arabe r’dir, alias guelta (ou son équivalent berbère aguelman) par le français « mare », « flaque d’eau ». Il est remarquable pourtant qu’on ne le fait jamais ; à ce point que le mot de r’dir est déjà presque acclimaté chez nous. Les r’dirs sont en effet les mares qui subsistent dans le lit d’un oued, en des points privilégiés, et pendant un temps plus ou moins long, après l’écoulement de la crue. Et c’est dire qu’ils n’ont pas d’équivalent exact en dehors du pays des oueds.
Par définition le r’dir n’est pas pérenne, et, en règle générale, il est bien loin d’offrir au voyageur les mêmes garanties qu’un puits ou une source ; à moins de renseignements précis et récents on ne peut pas compter sur lui avec certitude. Dans l’espèce pourtant il y a des aguelmans pérennes (In Ziza, Taguerguera), et parmi ceux qui ne le sont pas il en est beaucoup qui conservent de l’eau pendant plusieurs mois. Cela signifie que ces r’dirs sont alimentés par des réserves souterraines ; le soleil du Sahara aurait vite fait d’assécher une flaque où l’eau ne se renouvellerait pas. D’ailleurs les plus beaux r’dirs sont en terrain perméable, ceux de l’oued Saoura, par exemple, dans les sables du lit ; l’aguelman Taguerguera dans les grès dévoniens ; celui d’In Ziza dans les laves. Voilà qui suffirait à les diversifier de nos mares, creusées au contraire dans un sol imperméable.
Il n’y a donc pas d’opposition essentielle entre les r’dirs et les sources ou les puits. Ce ne sont pas des citernes, il ne saurait y avoir au désert de réserves d’eau un peu importantes indépendamment des souterraines. Mais les r’dirs s’alimentent à des nappes superficielles, susceptibles de s’assécher tout à fait ou de s’appauvrir considérablement dans les périodes de longues sécheresses. M. le capitaine Mussel en 1905 a vu l’aguelman Taguerguera[11] presque à sec ; dans l’intervalle de deux visites (1903-1905) l’aguelman d’In Ziza avait baissé de moitié.
Un autre caractère du r’dir, particulièrement frappant pour l’indigène,[16] c’est que par son aspect extérieur il ne rappelle en rien les puits ou les sources. L’eau s’étale largement, l’aguelman Taguerguera a une centaine de mètres de long, et M. le capitaine Besset en décrit au Mouidir de beaucoup plus considérables ; ce sont de petits lacs, pittoresques et mystérieux, sans affluent ni effluent apparents. (Voir pl. VI, phot. 11 et 12.)
Tilmas. Abankor. — Tilmas (en berbère abankor), n’a pas d’équivalent français. C’est le sable humide où il suffit de creuser à la main une petite cuvette pour qu’elle se remplisse d’eau ; un r’dir ensablé si on veut ; et l’on conçoit que le sable protège la nappe humide à la fois contre l’évaporation et contre la contamination, ou du moins (car il semble que les microbes supportent mal le climat saharien), contre les impuretés.
Pour être complet il faudrait consacrer un alinéa aux foggaras, mais il est évident que leur étude sera mieux à sa place dans le chapitre des oasis, dont elles sont l’orgueil et la particularité la plus caractéristique.
En somme l’eau du Sahara se présente sous forme d’affleurements, et l’on dirait presque de filons ; plus précieuse d’ailleurs qu’aucun minerai imaginable. L’eau superficielle, immédiatement accessible sans travail humain, celle des tilmas, des r’dirs, des sources, est relativement rare : un coup d’œil sur une carte générale du désert montre l’énorme prédominance des points d’eau qui portent le nom de haci. Pour boire et pour irriguer les indigènes ont développé des qualités d’ingénieurs hydrauliciens tout à fait disproportionnées à leur culture générale. Les animaux eux-mêmes ont dû suivre cet exemple dans une certaine mesure. Il en est, les domestiques, le chameau par exemple, qui mourraient de soif si on ne les abreuvait pas, et dont l’initiative se réduit à se rassembler autour du puits avec des mugissements plaintifs. D’autres se passent de boire, autre chose du moins que le suc des plantes ou la rosée (la gazelle). Les grandes antilopes ne se trouvent que dans les régions où l’eau est à fleur du sol (tilmas de l’erg er Raoui, aguelmans et sources du pays touareg) ; et elles ont dû apprendre du moins à gratter le sable des tilmas. Le chacal, grand buveur, se montre particulièrement ingénieux. Au voisinage des puits il creuse des galeries jusqu’à l’eau, des « travers-bancs ». J’en ai vu de semblables au puits d’Ouallen, et les officiers de la colonne Flye Sainte-Marie en ont admiré dans la Ménakeb.
Dans un pareil pays il est clair que l’onomastique des points d’eau doit être particulière.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. VIII. |

Cliché Gautier
15. — OUED ZOUSFANA
Arbuste (jujubier) juché sur un monticule.

Cliché Gautier
16. — TYPE DE MEDJBED (sentier saharien) sur le reg du Touat
A l’horizon la palmeraie du Timmi, en avant de laquelle on distingue plusieurs lignes de foggaras.
[17]Medjbed. — On se trouve couramment entraîné dans l’exposition à donner aux routes sahariennes leur nom indigène de medjbed. Les mots français de route ou de sentier seraient en somme inadéquats. Au point de vue voirie un medjbed est un sentier créé et entretenu par les pieds des chameaux ; il est en général admirablement marqué au moins sur les sols de reg et de hammada ; partout ailleurs que dans l’erg le sol saharien conserve les empreintes avec indiscrétion, racontant à qui sait le déchiffrer, au sujet de la dernière caravane, eût-elle passé depuis des mois, les moindres incidents du voyage. Mais c’est un sentier transcontinental, se prolongeant rectiligne sur des centaines et des milliers de kilomètres ; jalonné de tas de pierres aux croisements, suivant de point d’eau en point d’eau un itinéraire étudié par la sagesse inconsciente des générations. Pour traduire une expression de ce genre, « le medjbed d’In Salah à Tombouctou », le mot de sentier paraîtrait un peu grêle. (Voir pl. VIII, phot. 16.)
Ce medjbed d’ailleurs, qui conduit de l’eau à l’eau, et qu’il s’agit de ne pas perdre ou de retrouver sous peine de mort, devient dans l’imagination du voyageur un personnage considérable ; ces incertaines traces d’usure à la surface du sol, seuls guides et seuls vestiges d’humanité sur d’immenses étendues, prennent une sorte de caractère sacré ; et on ne conçoit pas la possibilité de laisser anonyme une individualité si marquante.
Tanezrouft. — Le mot de Tanezrouft, semble bien être, dans son acception vraie, autant qu’il est possible de la dégager, un nom propre plutôt que commun, le nom d’un pays, immense, il est vrai, et mal délimité. Les indigènes le donnent à tout ce qui s’étend entre les pays Touaregs (Hoggar, Mouidir, Ahnet, Açedjerad) d’une part et le Soudan de l’autre. Cette immense région est peut-être une unité géologique ; il semble bien en effet qu’elle soit tout entière une pénéplaine silurienne et archéenne. Mais c’est avant tout une unité climatique, le pays absolument dépourvu d’eau et inhabitable sur d’immenses étendues, le pays de la peur, de la soif, des marches ininterrompues haletantes, de vingt heures sur vingt-quatre pendant plusieurs jours, le désert maximum qu’on traverse en tremblant.
Dans d’autres parties du Sahara des régions analogues semblent porter des noms différents. Dans l’ouest par exemple le Djouf semble un pendant et d’ailleurs une prolongation du Tanezrouft, de même que le Tiniri dans l’est.
Il est donc probablement incorrect mais il est commode et il devient usuel d’employer ce terme de Tanezrouft dans un sens général, et de[18] l’appliquer aux grandes étendues vides, aux déserts maxima, qui séparent les uns des autres au Sahara les districts habités.
Et sans doute nous saisissons ici sur le fait la déformation que nous infligeons, plus ou moins consciemment, au vocabulaire indigène quand nous essayons de le franciser. Mais nous ne faisons pas ici une étude philologique du vocabulaire géographique indigène. Le but poursuivi est d’enrichir le nôtre en mettant à notre disposition des termes nouveaux pour exprimer sans périphrase des individualités géographiques nouvelles.
Il est remarquable cependant que nous soyons amenés à emprunter ces termes nouveaux au vocabulaire indigène. En d’autres contrées désertiques les géographes n’ont pas cette ressource, ou, faut-il dire, cet embarras. A feuilleter Le Kalahari du Dr Passarge on s’étonne d’y rencontrer une nomenclature exclusivement européenne et même improvisée par périphrases (Salzpfanne, Sandpfanne, Pfannencrater, etc.) ; à la périphrase sandpfanne pourtant, le Dr Passarge substitue souvent le nom hollandais de Vley. L’Afrique du Sud tout entière semble un pays où le vocabulaire géographique ne s’est pas enrichi de termes populaires indigènes et où l’Européen a baptisé les formes caractéristiques avec les ressources de ses propres langues (Kopje).
C’est évidemment que les langages multiples et enfantins de populations nègres ne sont pas assez riches pour justifier un emprunt. Au Sahara nous avons affaire à de vieilles races cultivées et à une langue savante. L’explication pourtant n’est peut-être pas suffisante. A trouver cet affreux pays, ce désert, pourvu d’une si riche onomastique bilingue, on éprouve quelque surprise. Cet étiquetage minutieux des formes et des individualités géographiques atteste l’effort accumulé d’un peuple observateur, qui est aujourd’hui bien maigrement représenté, et c’est peut-être le legs d’un passé plus prospère. On se serait abstenu pourtant de formuler une conclusion aussi incertaine, si elle n’était étayée par bien d’autres observations beaucoup plus probantes, que nous aurons à présenter dans les chapitres suivants.
D’une façon générale, par exemple, la seule existence des puits qui jalonnent les medjbeds semble attester que le Sahara n’a pas toujours été ce que nous le voyons. Car si ces puits n’existaient pas, il serait impossible, dans ces effroyables solitudes, d’en trouver l’emplacement et de les forer. Nous les devons apparemment à des générations humaines, qui ont assisté au desséchement progressif et l’ont combattu pied à pied, suivant dans le sol la nappe d’eau qu’ils avaient connue en surface. Si l’on songe aux difficultés de l’exploration,[19] dans les déserts vides et bruts de l’Australie, on se rend compte que l’aménagement du Sahara pour la vie humaine est une merveille inappréciable. Elle devient inintelligible, si nous ne la concevons pas comme le produit d’une accommodation graduelle à une transformation péjorative du pays. Les indigènes n’auraient pas pu inventer : il faut donc qu’ils se soient souvenus.
[2]Foureau, Documents scientifiques de la mission Saharienne, p. 1175 (Glossaire de quelques termes employés).
[3]Le but poursuivi étant de franciser, et d’introduire dans notre vocabulaire géographique un certain nombre de termes arabes, il me paraît légitime et indispensable de renoncer aux pluriels arabes, souvent si différents des singuliers qu’ils semblent un autre mot. Il est tout à fait indifférent, par exemple, au point de vue géographique à tout le moins, que sif fasse au pluriel siouf.
[4]On sait que le diminutif de Feidj est Figuig, le petit col.
[5]Bernard et Lacroix, L’évolution du nomadisme en Algérie, p. 117.
[6]Certainement utilisé à Laghouat et à Djelfa ce mot paraît inconnu dans le Tell. Voici à son sujet une note de M. Marçais : « le mot nébka, pluriel nebkät, collectif enbék, se trouve déjà dans le poète arabe antéislamique Tarafa. Il est dans le dictionnaire de Beaussier ».
[7]Même sous sa forme pluriel — gour ; — on dit le terrain des gour.
[8]Flamand, Une mission d’exploration scientifique au Tidikelt, Annales de Géographie, t. IX, 1900, p. 238.
[9]Bulletin du Comité de l’A. F., supplément de septembre 1904, p. 209.
[10]On trouvera dans le texte le mot Haci représenté par l’abréviation H. et Aïn par A.
[11]Suivant le dialecte, les Touaregs prononcent et par conséquent on peut écrire indifféremment Tadjerdjera ou Taguerguera ; de même qu’on écrit Azguer ou Azdjer.
[20]CHAPITRE II
LES OUEDS ET LES DUNES
I. — L’oued Messaoud.
Dans la partie orientale de notre Sahara Algérien, le réseau des oueds quaternaires est bien et assez anciennement connu. De Duveyrier au commandant Roudaire et à Foureau une série de voyageurs ont dessiné sur nos cartes un ensemble cohérent et détaillé, le bassin de l’Igargar. Encore, bien que çà et là le vent et le sable aient effacé ou enfoui des tronçons d’oued, l’ensemble apparaît nettement. Deux artères maîtresses l’O. Mya et l’O. Igargar se réunissent pour aboutir dans une cuvette en partie plus basse que le niveau de la mer, et semée de grands chotts (Melr’ir, etc.).
Cette cuvette a été l’objet d’études topographiques très sérieuses et nous sommes certains qu’elle n’a jamais communiqué avec la Méditerranée pourtant si proche. Le seuil de Gabès ne porte la trace d’aucune brèche. Au plus beau moment de l’Igargar, lorsque « les crocodiles jouaient dans ses ondes », son bassin aurait donc été un bassin fermé, et l’on peut se croire autorisé à conclure que le Sahara quaternaire fut plutôt une steppe qu’un pays franchement humide. La conclusion est à retenir.
Dans la partie occidentale du désert, on pouvait admettre a priori que le réseau quaternaire serait aussi profondément gravé et aussi bien conservé. Aussi l’est-il ; et il me semble possible d’en esquisser le dessin général.
On connaît depuis Rohlfs le tracé d’un grand oued quaternaire occidental, l’O. Saoura ; depuis Igli, où la Saoura est constituée par la réunion des oueds Zousfana et Guir, le lit est très net à berges hautes et vives jusqu’à Foum el Kheneg où le fleuve s’est creusé une gorge étroite dans les grès éodévoniens. (Voir pl. IX, phot. 17.)
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. IX. |

Cliché Gautier
17. — LE LIT DE LA SAOURA A TIMR’AR’IN (Timgharghit)
Taillé dans le mio-pliocène ; à l’horizon, très-floue, la chaîne d’Ougarta.

Cliché Galibert
18. — UNE CRUE DE LA SAOURA à Ksabi, en octobre 1904.
Huitième jour de la crue.
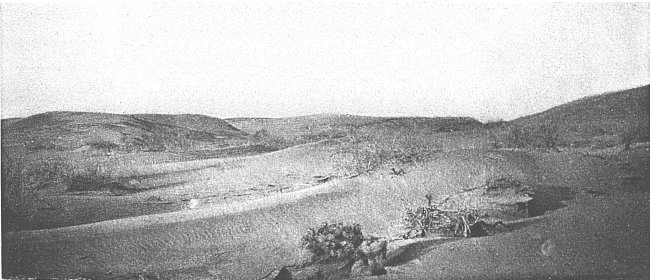
| Phototypie Bauer, Marchet et Cie, Dijon | Cliché Gautier |
19. — LE LIT DE LA SAOURA A FOUM EL KHENEG
Nebka constituant le tampon de sable qui a arrêté et fait dévier la crue photographiée en 18.
[21]Mais au delà les incertitudes commençaient. On savait que l’O. Saoura se continuait sous le nom d’O. Messaoud, ce qui est juste ; et ce changement de nom indique chez les indigènes un sens géographique exact de l’importance de Foum el Kheneg comme démarcation entre deux sections différentes de l’oued. Sur le cours de l’O. Messaoud on ne savait rien : le lieutenant Niéger, auteur d’une excellente carte du Touat, résume ainsi la question : « La carte au 1/2000000 du dépôt de la guerre, ainsi que celle de M. Vuillot, accusent au sud du Touat une forte sebkha dans laquelle viendraient se déverser l’oued Saoura et l’oued Djaghit. Cette sebkha est prolongée par un thalweg qui irait se perdre dans l’erg au sud de Taoudéni. Les renseignements que nous avons pu recueillir à ce sujet étant absolument contradictoires, il est impossible de conclure. Un fait reste certain, c’est que la Saoura longe le Touat s’épanouissant en zone d’épandage[12]. » Voilà donc un fait curieux. Les anciennes cartes sont naturellement très mauvaises, dressées par renseignements ; on y voit pourtant l’oued Messaoud nettement affirmé, le dessin de son cours est très schématique, mais ne s’écarte pas trop de la réalité. Le lieutenant Niéger, sur son excellente carte récente ne se croit pas le droit de porter l’O. Messaoud, et il met en doute son existence. Notons d’ailleurs que M. Niéger, par sa connaissance de l’arabe et ses rapports quotidiens avec les indigènes, est aussi apte qu’aucun de ses devanciers à recueillir des renseignements indigènes, et concluons qu’il est beaucoup plus difficile aujourd’hui qu’il y a vingt ans de se renseigner sur l’O. Messaoud. Voilà encore une conclusion à retenir.
A la seule inspection d’une carte topographique exacte du Touat (Niéger, Prudhomme) il semble en effet légitime de conclure que l’O. Messaoud longe le Touat. On constate en bordure des oasis un long chapelet de sebkhas extrêmement allongées, souvent bordées à droite et à gauche, ou à tout le moins sur une rive par des falaises d’érosion. Mais l’examen d’une carte géologique modifie déjà cette conclusion. — Les palmiers du Touat longent rigoureusement une grande faille, le long de laquelle les terrains crétacés du Tadmaït viennent butter contre un horst ou un chapelet de horsts primaires. C’est manifestement cet accident qui force les eaux souterraines à réapparaître à la surface du sol. Il est superflu de faire intervenir à titre explicatif l’action de l’O. Messaoud. Et quelques-unes des falaises elles-mêmes pourraient bien être tectoniques et non pas d’érosion.
En fait, nous sommes aujourd’hui fixés sur le cours de l’O. Messaoud ;[22] les deux itinéraires, que je publie[13] de H. Sefiat et de H. Rezegallah, nous font connaître avec précision des sections importantes de l’O. Messaoud, dont la continuité au large du Touat n’est plus douteuse, quoiqu’en bien des points il subsiste des incertitudes sur le tracé exact.
De ces deux itinéraires le plus intéressant est à coup sûr celui de H. Rezegallah. Le long du sentier qui va de Zaouiet Reggan à H. Rezegallah, entre les kilomètres 88 et 137 on chemine dans le lit d’un très grand oued orienté N.-N.-E.-S.-S.-O. Le lit est entaillé d’une dizaine de mètres dans des couches horizontales composées tantôt d’argiles et de grès crétacés, tantôt d’argiles et de calcaires carbonifériens. L’oued n’est pas complètement asséché, on y trouve, parfois en abondance, la végétation habituelle des pâturages sahariens (damran, hâd, etc.), et un puits dont l’eau, encore qu’un peu saumâtre, reste buvable à la rigueur, Haci Boura. Le guide Abiddin spontanément, comme aussi les notables de Zaouiet Reggan, consultés au retour, affirment que c’est là l’O. Messaoud, continuation de l’O. Saoura. Il est clair d’ailleurs que ces indigènes ne se placent pas au point de vue géologique, et ce n’est pas l’O. Messaoud quaternaire qui les intéresse, mais simplement l’actuel ; ce qu’ils affirment c’est que, de mémoire d’homme, certaines crues de la Saoura ont roulé dans l’O. Messaoud jusqu’à Haci Boura. Il s’agit de mémoire de très vieil homme ; seuls les « Kebar », les anciens, auraient vu couler l’O. Messaoud. Dès le début de notre occupation, nos officiers en ont entendu parler, et le capitaine Letord fit une pointe infructueuse dans l’ouest à la recherche de l’O. Messaoud[14]. Pour un peu nébuleux que soient ces vieux souvenirs indigènes, et quoiqu’ils laissent subsister bien des imprécisions de détail, ils se trouvent confirmés par les faits. Dans la région de H. Boura, à une centaine de kilomètres sud-ouest du Bas-Touat, il existe bien un grand oued, dans le lit duquel s’est conservée quelque humidité, et qui de son vivant coulait indubitablement au sud-ouest. Sur le sens de l’écoulement, l’examen des gorges que l’oued s’est taillées en aval d’Haci Boura ne laisse subsister aucun doute : entre les murailles de grès et d’argiles, sur environ 500 mètres, la dénivellation est très forte, il y a eu là de véritables rapides.
C’est un fait d’autant plus intéressant que, dans ces grandes plaines monotones à l’ouest du Touat, le baromètre ne donne pas d’indications[23] utilisables pour déterminer le sens général de la pente. L’équilibre barométrique est très instable, le Sahara est le pays du vent, des orages secs, brusques et violents ; le passage d’une dépression entraîne des oscillations qui vont facilement à une dizaine de millimètres, et qui masquent tout à fait les oscillations faibles et graduelles déterminées par le changement de niveau. L’existence et l’allure de l’O. Messaoud à H. Boura est donc une indication très précieuse que la grande plaine se draine au sud-ouest. Le chapelet des oasis du Touat ne jalonne pas le moins du monde, comme l’on l’a cru d’abord le fond d’une cuvette ; c’est un accident très important sans doute au point de vue humain, comme aussi au point de vue géologique, mais insignifiant comme dénivellation dans une grande plaine doucement inclinée au sud-ouest.
Et que dans cette direction il ait existé très anciennement une tendance à la dépression dans les compartiments de l’écorce terrestre c’est ce que semblerait indiquer la composition géologique du sol. La continuité des dépôts infra-crétacés est simplement interrompue par des horsts primaires médiocrement étendus, et, dans l’état actuel de nos connaissances, rien n’empêche de croire que les grès albiens du Touat ne rejoignent, à titre de formation à peu près synchronique, les grès analogues du Djouf et du Soudan. L’idée que nous nous faisions de cette partie du Sahara se trouve donc modifiée.
Si l’on peut être affirmatif sur l’existence même de l’O. Messaoud, on ne peut pas indiquer avec précision son tracé au sud et au nord d’Haci Boura.
Haci Rezegallah. — Tout d’abord, Haci Rezegallah, le point le plus occidental de l’itinéraire est lui aussi un puits creusé dans le lit d’un oued quaternaire. Le lit est bien marqué entre ses falaises, et tapissé d’une maigre végétation partout où il n’est pas ensablé. Malgré cet ensablement, qui va fréquemment jusqu’à l’enfouissement sous des dunes puissantes, il n’est pas douteux que ce lit, après des méandres répétés, n’aille rejoindre celui de l’O. Messaoud, avec lequel il fait un angle prononcé ; — mais est-ce à titre de continuation, ou d’affluent ? En un point situé à peu près au coude formé par la réunion des deux oueds, on se trouve au sommet d’une falaise de calcaire carboniférien violet, pétri de fossiles clairs, à l’assaut de laquelle des dunes montent à droite ou à gauche, ce qui restreint malheureusement la vue d’ensemble. Cette falaise est la continuation indubitable de celle qui borde au nord le lit de l’O. Rezegallah, comme aussi de celle qui borde à l’ouest le lit de l’O. Messaoud. Mais droit devant soi, au sud, on n’aperçoit[24] plus la contre-partie attendue, l’autre rive. En contre-bas, très loin à perte de vue, on a sous ses pieds un paysage un peu indistinct, brouillé par l’entre-croisement et le poudroiement de petites dunes, mais qui semble bien être une immense plaine et peut-être une sebkha. Tout se passe donc comme si l’O. Messaoud et l’O. Rezegallah se rejoignaient dans une sebkha. Mais de cette sebkha, d’ailleurs hypothétique, l’O. Rezegallah est-il un affluent ou un effluent ? Autant de questions qui naturellement ne peuvent pas se trancher a priori.
Ce qui est certain, c’est que, dans la région de H. Boura et de H. Rezegallah, l’oued Messaoud, sinon l’actuel du moins son prédécesseur quaternaire, n’est pas le moins du monde au bout de sa course ; l’intensité de ses érosions l’atteste ; il serait absurde de supposer qu’il finisse là ; il continue, au contraire, dans une direction qui semble le conduire au Djouf et à Taoudéni. Aussi bien nous sommes ici, à Rezegallah, sur la route indigène de Taoudéni.
Haci Sefiat. — Au nord de Haci Boura, le lit de l’oued Messaoud est barré par un sif d’erg que je n’ai pas franchi. D’autre part, au nord du Touat, le cours de ce même oued a été relevé soigneusement par les officiers des oasis, depuis Foum el Kheneg jusqu’à la hauteur de Tesfaout. Son lit très net, mais quelquefois bi et trifide, est jalonné de puits. La route directe de Bouda à Ksabi ne s’en écarte guère. (Voir cartes Niéger et Prudhomme.) La zone d’incertitudes sur le tracé exact du fleuve va donc de Tesfaout à Haci Boura.
Entre ces deux points, l’itinéraire de Haci Sefiat nous fournit pourtant un jalon. Il recoupe deux grands lits quaternaires, tous deux orientés N.-S. Le plus oriental est un grand cirque d’érosion, très profondément gravé (une dizaine de mètres au moins), semé de garas, largement ouvert au sud ; il est clair qu’une rivière puissante a été à l’œuvre ici, mais on ne reconnaît plus son passage qu’à son travail d’érosion ; tout est desséché et parfaitement nu. L’oued, dans le lit duquel se trouve le puits de Sefiat, a conservé au contraire un reste de vie ; il est vrai que l’eau du puits est saumâtre au point d’être imbuvable ; les touffes vertes de hâd qui tapissent le lit sont si amères, si chargées de sel, que les chameaux n’en veulent pas, quoique le hâd passe pour leur friandise favorite. Ce n’en est pas moins la seule trace de verdure et le seul puits qu’on rencontre depuis le Touat. Apparemment c’est l’oued Messaoud, et on serait tenté de croire que le grand cirque d’érosion desséché représente un bras mort. Autour de Haci Sefiat le lit est très large et très puissamment érodé, il ressort avec[25] netteté malgré l’envahissement des dunes. Il semble d’ailleurs qu’on ait affaire à un confluent.
Le réseau des affluents. — Autour de l’artère principale le réseau des affluents commence à se dessiner sur la carte.
O. Djar’et[15]. — Les vieilles cartes par renseignements font de l’O. Djar’et un affluent de l’O. Messaoud, et placent le confluent dans le Bas-Touat au voisinage de Taourirt. C’est aujourd’hui un des oueds les mieux connus du Sahara ; les officiers des oasis ont reporté sur la carte le réseau compliqué des oueds du Mouidir, dont la réunion constitue l’O. Bota, qui prend plus bas le nom d’O. Djar’et. Qu’il aille rejoindre l’O. Messaoud, ce n’est pas douteux, mais la jonction n’a certainement pas lieu au Touat ; cela ressort avec évidence de l’itinéraire Taourirt-Ouallen (en compagnie du lieutenant Mussel)[16].
Il y a bien au sud, et à proximité de Taourirt, un point d’eau, Hacian Taibin, sur le bord d’une petite sebkha, mais la seule rivière qui y aboutisse est l’O. Chebbi, descendue du Tadmaït. Le bassin de l’O. Chebbi reste séparé de celui du Djar’et par une apophyse hercynienne (dj. Aberraz) et par un horst calédonien (Bled el Mass). En arrière de cet obstacle puissant, l’O. Djar’et s’est étalé en une immense sebkha, qui porte le nom de Mekhergan, et qui ne se trouve encore portée sur aucune carte, mais sur laquelle un certain nombre de détails précis ont été réunis.
La sebkha commence déjà sous le méridien d’Akabli (itinéraire Laperrine-Villatte) ; l’itinéraire Taourirt-Ouallen la rencontre à 80 kilomètres sud-est de Taourirt à vol d’oiseau, précisément au pied d’une butte de calcaire récifal dévonien, qui s’appelle Garet-ed-diab. Avec des étranglements et une allure en chapelet, on la voit se continuer vers le sud pendant une soixantaine de kilomètres au moins et peut-être une centaine jusque sous le parallèle du puits de Tikeidi[17], au voisinage duquel l’O. Meraguen venu de l’Açedjerad se perd dans une sebkha qui semblerait un prolongement de la sebkha Mekhergan. Elle a donc des dimensions énormes, 150 kilomètres de long peut-être, et la plupart du temps elle s’élargit à perte de vue. C’est un trait tout à fait essentiel de la géographie quaternaire, le réceptacle commun de l’oued Djar’et et de toutes les rivières de l’Ahnet.
Au voisinage d’Akabli, c’est-à-dire à l’embouchure de l’O. Djar’et, on signale des fondrières dangereuses, et l’on peut supposer par[26] analogie que la sebkha conserve sur quelques points privilégiés au débouché de grands oueds quelques traces analogues d’humidité. Mais partout ailleurs, elle est complètement morte et desséchée, si complètement aride que l’apparition d’une larve d’insecte y provoquait une exclamation de surprise. Elle cesse donc d’intéresser les indigènes nécessairement utilitaires, ils la classent simplement tanezrouft, et comprennent mal les questions qu’on leur pose au sujet de son émissaire probable.
Le problème de l’émissaire trouverait peut-être sa solution à Azelmati. C’est un misérable point d’eau, important toutefois, parce que, entre Taourirt et Ouallen, il jalonne la route la plus directe, mais la plus désolée, encore inexplorée. D’après les renseignements indigènes qui cadrent avec ce que nous avons aperçu de loin, ce point d’eau se trouverait dans une gorge, ouverte vers l’ouest, et creusée dans les argiles du Dévonien moyen, entre les garas d’Azelmati et de Chaab ; les inondations de l’O. Meraguen parviennent jusque-là (?).
Le nom d’Azelmati s’applique aussi à une vaste étendue uniforme, qui est peut-être une immense sebkha desséchée. Dans le numéro de La Géographie du 15 décembre 1907, M. Nieger donne les renseignements les plus intéressants sur cette sebkha, qui serait en somme l’épanouissement occidental de la sebkha Mekhergan. Quoi qu’il en soit[18], le baromètre indique une différence de niveau très sensible, entre les sebkhas d’Hacian Taibin et Mekhergan, cette dernière serait plus basse de 5 millimètres[19]. Plus significatives peut-être que les indications du baromètre sont celles du terrain, l’existence d’un puissant obstacle montagneux et celle de la grande sebkha elle-même. En somme, le bas Djar’et, comme l’O. Messaoud, au lieu de se rapprocher du Touat, tend à s’en éloigner vers le sud-ouest.
D’autre part, lorsque dans la traversée du Tanezrouft d’In Ziza, on voit tous les grands oueds quaternaires, descendus du Hoggar, O. Tiredjert, O. Takouiat, O. Tamanr’asset, prendre la direction de l’ouest, on reste frappé de cette convergence de toutes les rivières quaternaires vers cette cuvette médiocrement éloignée du Djouf, aux approches de laquelle tous les voyageurs ont noté un niveau très bas (120 à 150 m.). Il est difficile de se soustraire à la conclusion que[27] nous avons affaire aux différentes parties d’un même réseau fluvial quaternaire qu’on pourrait appeler le réseau de l’O. Messaoud.
O. Tlilia. — Au nord, on peut reconstituer ce réseau avec bien plus de précision et en faisant la part bien moindre à l’hypothèse.
Tout d’abord, nous connaissons aujourd’hui des tronçons considérables de ce qui fut évidemment un grand affluent de gauche descendu du Tadmaït. La carte Niéger, comme la carte Prudhomme, portent un O. Tlilia qui draine la plus grande partie du Tadmaït, depuis le méridien d’In Salah. (Voir pl. IV, phot. 8.) Il prend sa source au voisinage de la grande falaise terminale du plateau, en un point bien déterminé, où l’érosion régressive d’un petit torrent, l’O. Aglagal, qui coule en sens inverse, a profondément entaillé la falaise, et s’est annexé la tête de vallée de l’O. Tlilia. (Voir pl. XLIII, phot. 81.) On le suit sans lacunes depuis sa source jusqu’à sa sortie des plateaux calcaires, sur une étendue de 120 kilomètres. Les cartes publiées ne donnent pas de renseignements sur ses destinées ultérieures, mais les officiers des oasis savent qu’il aboutit au Touat à Zaouiet Kounta.
Or, l’itinéraire de Haci Rezegallah croise et longe, à partir de Haci Hammoudiya un grand oued affluent de l’oued Messaoud, qui vient précisément du Bas-Touat, région d’Inzegmir. C’est évidemment la prolongation de l’O. Tlilia, ou en tout cas d’une artère fluviale dont l’O. Tlilia serait un élément constituant.
Voilà donc un grand affluent de l’O. Messaoud que nous suivons depuis sa source jusqu’à son embouchure.
Sebkha de Timimoun. — Il ne faut pas hésiter à rattacher la sebkha de Timimoun au système de l’O. Messaoud. La forme même de la sebkha, son allongement très marqué, ses étranglements, son allure en chapelet, suggèrent l’idée qu’elle a dû être en relation avec un fleuve coulant vers le sud-ouest, et dont les hautes falaises qui encadrent la sebkha, et les garas qui la jalonnent attestent la puissance érosive.
Comment le chapelet de sebkhas du Gourara se reliait au chapelet de sebkhas du Touat, c’est ce qui apparaît beaucoup plus nettement sur la carte Niéger que sur la carte Prudhomme ; aussi bien la carte Niéger, qui est essentiellement une marqueterie d’itinéraires, une œuvre de plein air, composée sur place, est en général beaucoup plus expressive du terrain réel. On y voit très bien qu’une ligne de falaises rejoint les sebkhas de Timimoun et de Brinken. Entre Brinken et le[28] Bouda, on distingue deux lignes divergentes de jonction, l’une au sud par Sba, Meraguen, jalonnée de petites falaises ; l’autre au nord, directe de Sba au Bouda, marquée par de la verdure, un long pâturage de nebka. Aussi bien entre le Touat et le Gourara, il n’y a pas de démarcation naturelle, la ligne des oasis est continue, et cela seul serait un indice. Il faut donc admettre que l’oued quaternaire du Gourara aboutissait au Bouda, et de là il semble bien que ce soit lui et non pas l’oued Messaoud qui ait longé le Touat, sculptant ses falaises et ses garas, contenu par l’obstacle des horsts hercyniens, jusqu’à sa réunion avec l’O. Tlilia dans le voisinage de Zaouiet Kounta. Puis les deux fleuves réunis par Inzegmir, le Sali et le grand lit relevé au voisinage de Haci Hammoudiya allaient rejoindre l’O. Messaoud.
Les oueds du grand Erg. — Au nord du Gourara, le grand Erg met un obstacle sérieux mais non pas insurmontable à la reconstitution du réseau quaternaire. On voit assez nettement les artères quaternaires dont la sebkha de Timimoun est le réceptacle commun, et qui constituent l’oued du Gourara.
Le Tadmaït fournit une contribution importante, l’O. Aflissès, profondément gravé dans les plateaux calcaires, mais dont le cours n’a été reconnu qu’incomplètement et par tronçons. Il semble bien que ce soit lui qui ait creusé l’immense cirque d’érosion entre la gara bou Dhemane et la gara el Aggaia, et qui alimente encore les palmeraies tout particulièrement denses au voisinage de Timimoun.
Comme il est naturel, c’est au nord et de l’Atlas que descendent les oueds les plus nombreux. On en compte trois : l’O. Seggueur, l’O. R’arbi, l’O. Namous ; leur cours supérieur est très net, profondément encaissé dans la hammada, suivi d’ailleurs par de vieilles routes de caravanes. Mais le cours inférieur est enfoui sous les effroyables amas de sable du grand Erg, par surcroît encore très mal connu. On entrevoit cependant avec une probabilité suffisante les points de sortie au sud de l’Erg, sur la sebkha, et quelquefois même la direction générale du cours.
Un grand oued débouche à l’extrémité orientale de la sebkha du Gourara auprès d’el Hadj Guelman ; c’est à lui que la sebkha de Timimoun doit ce qu’elle conserve d’humidité et de placage quaternaire. En hiver, lorsque sont tombées les pluies lointaines sur l’Atlas et le Tadmaït, on voit, à partir d’el Hadj Guelman, et progressivement vers l’ouest, la surface de la sebkha changer de couleur, se poudrer de points blancs scintillants ; c’est le sel qui remonte,[29] témoin d’une évaporation plus énergique et par conséquent d’une augmentation dans la réserve profonde d’humidité.
Cet oued qui débouche à el Hadj Guelman est apparemment le même auquel les ksouriens du Tinerkouk doivent l’eau de leurs puits et le Meguidden ses pâturages. C’est vraisemblablement la prolongation de l’oued Seggueur qui, simplement tangent à l’erg sur la plus grande partie de son cours, se suit facilement jusqu’au delà d’el Goléa.
Le cours de l’oued Namous n’apparaît pas du tout sur les cartes publiées, mais M. Mussel[20], sur sa carte encore inédite, en trace de grands tronçons ; l’oued traverse le groupe des oasis de Telmin dans sa partie orientale, entre Takhouzi et Adjir ; on le suit au sud jusqu’à proximité de Charouin et de Haci el Hamira.
C’est l’oued R’arbi sur lequel nous sommes le moins renseignés. Pourtant à la lisière méridionale de l’erg l’attention est attirée par une ligne d’oasis, el Ahmar, Guentour, Tesfaout, Charouin, et le long de cette ligne la carte Niéger marque ce qui semble être un grand lit d’oued. Charouin à coup sûr est sur le bord d’une gigantesque cuvette d’érosion qui m’a semblé aller rejoindre en biais celle de la sebkha du Gourara. Sur la route de Charouin à Ouled Rached ces deux cuvettes ne sont plus séparées que par une ligne de garas, autant du moins que l’envahissement du sable permet d’en juger. Il semble bien que dans cette région deux grandes rivières, reconnaissables à leurs érosions, aient fait leur jonction : apparemment l’O. R’arbi et l’oued du Gourara. (Voir fig. 44, p. 226.)
Ajoutons que dans sa partie occidentale, le grand Erg a sûrement enfoui toute une série d’affluents de l’O. Saoura, et il garde beaucoup mieux le secret de leur réseau. La carte inédite Mussel permet de suivre jusqu’à Haci Ouskir un gros affluent venu du Mezarif et qui passe par Haci Mezzou. Elle révèle çà et là sous l’erg de grands tronçons, un oued Si Ali par exemple au nord du puits de ce nom.
Le long de la Saoura on croit deviner des embouchures ; en certains points, de dessous l’erg on voit sourdre brusquement l’eau nécessaire à l’alimentation des palmeraies. A Mazzer, c’est une grosse source naturelle débouchant d’une grotte de travertin. A Beni Abbès, l’homme est intervenu, mais avec peu de travail, et à fleur de terre, on a fait couler de grosses séguias. L’eau afflue avec une abondance particulière dans la R’aba (littéralement la forêt de palmiers) ; sur une[30] dizaine de kilomètres les ksars se touchent, el Ouata, Ammès, Ksir el Ma, el Maja, etc. ; l’eau est partout à fleur de sol dans toute cette section de l’oued. De là part d’ailleurs, à travers l’erg, une route de caravanes semée de puits ; il est clair qu’un gros affluent a dû déboucher ici. Mais d’où vient-il ? Qu’est-ce, d’autre part, que ce groupe d’oasis de Telmin perdu au milieu de l’erg, et au nord duquel on voit sur la carte une constellation de puits ? On ne fait qu’entrevoir une puissante circulation souterraine qui doit être une image plus ou moins fidèle de l’ancienne circulation superficielle quaternaire sur la rive gauche de la Saoura.
L’O. Tabelbalet. — L’O. Saoura est hémiplégique, toute sa rive droite est à peu près morte ; de ce côté en effet l’oued longe le pied d’un accident montagneux et la ligne de partage est toute proche entre la Saoura et une autre grande artère quaternaire, qu’on pourrait appeler l’O. Tabelbalet.
A vrai dire cet oued n’a pas de nom, et les indigènes ne soupçonnent pas son existence. Il est enfoui sous l’erg er Raoui, mais pas assez profondément pour qu’on ne le retrouve pas. Depuis la palmeraie de Tabelbalet jusqu’à Oguilet Mohammed, la lisière méridionale de l’erg er Raoui est jalonnée de puits, Haci el Hamri, Tinoraj, H. er Rouzi, Haci el Maghzen, Noukhila ; d’ailleurs le nombre de puits existants le long de cette ligne pourrait être augmenté presque indéfiniment ; entre Tinoraj et Tabelbalet, il suffit de creuser n’importe où, dit-on, pour avoir de l’eau, Haci el Maghzen est, comme son nom l’indique, un puits improvisé par les maghzen (policiers indigènes) de Beni Abbès. Tous ces puits sont des trous d’eau à fleur de sol : d’ailleurs on rencontre de grands troupeaux d’antilopes adax, ce qui suppose de l’eau superficielle, d’accès facile. (Voir pl. XXXIV, phot. 64.) Le nom de l’erg est significatif ; er Raoui signifie humide ; le nom contraste avec celui de l’erg Atchan, tout voisin, « l’Erg assoiffé ». Enfin au voisinage des trois puits que j’ai vus et probablement de tous les autres, on distingue très bien l’oued enfoui sous la dune. C’est bien net, en particulier à Tinoraj et à H. el Hamri ; on y voit, avec ses falaises d’érosion, ce qu’il faut appeler sans doute le lit mineur de l’oued, puisqu’il est taillé dans des dépôts plâtreux et dans des formations d’aspect tourbeux, qui doivent ici évidemment, comme partout ailleurs au Sahara, représenter le lit majeur. (Voir pl. X, 20.) A Oguilet Mohammed je n’ai pas vu le lit mineur, mais la dune repose sur les dépôts gypseux habituels. Il n’est pas téméraire de conclure que tous les puits jusqu’à Tabelbalet sont creusés dans[31] le lit de l’oued, dont nous pouvons donc reconstituer le tracé de Tabelbalet à Oguilet Mohammed, on peut même dire avec une probabilité suffisante jusqu’à Ouled Saï. En somme il longe au nord-est le pied de l’arête gréseuse éodévonienne que les indigènes appellent le kahal de Tabelbalet, et qui sépare l’erg er Raoui de l’erg d’Iguidi.
D’où vient cet oued ? Evidemment de l’Atlas marocain, qui est tout proche, mais qui est encore trop mal connu pour qu’on puisse essayer de préciser.
En aval, le djebel Heirane se dresse en promontoire au confluent de deux grands oueds quaternaires ; la hammada crétacée qui lui sert de socle, est profondément entaillée à l’est par l’oued Messaoud, et au sud-ouest par un oued inconnu, étalé en sebkha, dont le lit fait avec celui de l’oued Messaoud un angle aigu. Cet oued dont nous connaissons avec précision l’embouchure, n’est-il pas l’oued de Tabelbalet ? La carte, qui accompagne le rapport de tournée du capitaine Flye Sainte-Marie dans l’Iguidi[21], est nettement favorable à cette hypothèse.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. X. |

Cliché Gautier
20. — TIN ORAJ
L’Oued Tabelbalet enfoui sous l’erg er-Raoui.
On distingue les berges en timchent (dépôt plâtreux, d’un blanc éclatant).
L’Iguidi. — Cette même carte et ce même rapport permettent de supposer que l’Iguidi, au moins dans sa partie orientale, et l’erg ech Chech tout entier qui lui fait suite, rentrent dans le bassin quaternaire de l’O. Messaoud. Un certain nombre de faits ressortent avec évidence.
Nous savons depuis longtemps que les grands oueds du Tafilalet réunis en un réceptacle commun qui est l’O. Daoura, vont se perdre dans une grand sebkha[22]. Le lieutenant Niéger nous apprend[23] le véritable nom de cette sebkha, qui est Mahzez.
D’autre part, le capitaine Flye Sainte-Marie nous donne sur l’Iguidi des renseignements précis. Les puits de l’Iguidi sont très inégalement répartis. La bordure nord est très pauvre : deux points d’eau seulement, très éloignés l’un de l’autre, Mana et Inifeg. La bordure sud au contraire est le plus beau coin de tout l’erg ; c’est le Menakeb, « 15 puits sur 150 kilomètres », les puits sont nettement alignés nord-ouest-sud-est ; on voit partout des traces d’une puissante érosion, falaises, cirques et garas. Il faut affirmer que le Menakeb est un grand oued, l’analogie est évidente avec l’oued de Tabelbalet, à la lisière sud de l’erg er Raoui.
[32]J’étais tenté de considérer l’oued Menakeb comme un émissaire de la sebkha Mahzez. M. Niéger, qui a vu le terrain, est d’un avis contraire. D’autre part, d’après une communication orale de M. le capitaine Martin, Mahzez serait beaucoup plus près de Tabelbalet que les cartes ne le montrent, et ce serait donc peut-être l’O. Tabelbalet qui prolongerait l’O. Daoura (?).
Quoi qu’il en soit il y a vraisemblablement, sous l’Iguidi et à sa bordure nord, un réseau d’artères quaternaires qui apporte ou apportait jadis à l’O. Messaoud, non seulement les eaux de Tafilalet, mais aussi les eaux des Eglab ; le plateau archéen (?) granitique (?) et peut-être par endroits volcanique (?) des Eglab, déjà traversé par Lenz, revu plus en détail par Flye Sainte-Marie et ses officiers, apparaît d’ores et déjà avec une certaine netteté (c’est sur la carte Flye Sainte-Marie qu’il faut le chercher naturellement). Il a un relief assez accusé, six ou sept cents mètres d’après M. Niéger[24] ; encerclé de dunes sur toutes ses faces ce fut évidemment, et, dans une certaine mesure, c’est encore un centre de dispersion hydrographique ; il domine de deux ou trois cents mètres la plaine où serpente l’oued Messaoud, et c’est l’épaulement occidental du bassin.
L’O. Messaoud actuel. — On arrive donc à reconstituer avec précision, à quelques incertitudes près, le réseau d’un oued Messaoud quaternaire, collecteur de toutes les eaux depuis les Eglab et l’Atlas du Tafilalet jusqu’au Hoggar. Ce squelette de vieux fleuve mort est d’un intérêt plus actuel qu’on n’imaginerait au premier abord.
Dans tout le Sahara algérien, ce qui reste de vie a souvent des relations évidentes avec le vieux réseau ; et les parties mêmes de ce réseau qui sont aujourd’hui tout à fait mortes ne le sont pas depuis l’époque quaternaire ; nous sommes aux oasis depuis quelques années à peine, et dans ce court laps de temps on a déjà recueilli des faits incontestables qui attestent la continuation sous nos yeux de la déchéance.
Ces faits se rapportent au cours actuel de l’O. Saoura et de l’O. Messaoud. Les crues de la Saoura, cela revient à dire les pluies de l’Atlas arrivent à Foum el Kheneg, encore aujourd’hui :
On publie ci-contre une photographie du lit inondé de l’oued à Ksabi ; je la dois à l’obligeance de M. le maréchal de logis Galibert, elle a été prise au huitième jour de la crue en octobre 1904. (Voir pl. IV, phot. 18.) L’hiver de 1906 a été particulièrement pluvieux,[33] et d’après le témoignage oral de M. le capitaine Martin l’oued à Beni Abbès a coulé, au point d’être très difficile à franchir pendant cinq mois consécutifs. Les crues arrivent d’ailleurs très au delà de Foum el Kheneg, mais à partir de ce point le régime change brusquement. Jusqu’à Foum el Kheneg l’oued a un lit profond, net de sable, au fond duquel la crue, contenue et guidée, chasse sans incertitude, sûre de sa route. Il est probable que c’est une question de pente.
Au delà de Foum el Kheneg, la crue s’étale, hésite et tâtonne ; d’une année à l’autre, elle ne retrouve plus son chemin. C’est la zone d’épandage qui commence, l’oued fait patte d’oie, delta. Qu’on jette un coup d’œil sur la carte (Niéger ou Prudhomme) on distinguera deux paliers d’épandage. Le premier est immédiatement à la sortie de Foum el Kheneg, l’oued se divise en trois bras. Le plus occidental diverge définitivement et va se perdre au loin sous le nom d’O. Seiba. Les deux plus orientaux, après s’être séparés à Haci Zemla, finissent par se rejoindre en amont d’Haci Zouari ; au delà la pente s’accentue, et le lit de l’oued retrouve pour un temps son encaissement net, et son unité. Il les perd entre le Bouda et le djebel Heirane, où il s’étale en un dédale de grandes îles et de faux bras en éventail.
Vaille que vaille, malgré les vagabondages et les déperditions, la crue, il y a une douzaine d’années, est encore arrivée au Touat. Niéger note que, à Tesfaout, l’eau a déraciné quelques palmiers et abattu quelques maisons. Or, voici que la crue de 1904, celle qui a été photographiée à Ksabi n’a pas pu dépasser le palier d’épandage de Foum el Kheneg, au delà de la gorge un tampon de sable lui a barré le chemin et l’a rejetée au nord-ouest, dans la direction de la sebkha el Melah, c’est-à-dire dans une voie toute nouvelle que la Saoura n’avait jamais prise. Rien de plus naturel ; j’ai vu, en 1903, le lit de l’oued à la sortie de Foum el Kheneg ; ce n’était déjà plus un lit, les berges étaient indiscernables, c’était une plaine mamelonnée de sable où le tracé de la rivière ne se reconnaissait qu’à la verdure espacée du pâturage. (Voir pl. IX, phot. 19.) Quelques grains de sable de plus ont suffi pour déterminer un changement qui, s’il eût été durable, aurait été de grande conséquence. L’O. Messaoud serait mort sur une étendue de 150 kilomètres ; les pâturages et les puits se seraient asséchés, et une route jusqu’ici fréquentée serait devenue impraticable.
Si je suis bien informé, la crue de 1906, puissamment aidée par les efforts des indigènes et de l’administration, a triomphé de l’obstacle, le danger est écarté, provisoirement du moins.
[34]Mais nous saisissons sur le fait le processus de l’asséchement le long des oueds sahariens ; il est purement mécanique, et tout à fait indépendant d’un changement quelconque dans le climat général.
Depuis l’établissement du climat désertique, le sable soutient une lutte acharnée et heureuse contre l’oued, où roulent les grandes crues intermittentes, venues des montagnes lointaines. Il y a des points stratégiques, des points faibles, où se livrent les batailles décisives ; ce sont les paliers de rupture de pente, où la chasse d’eau n’est plus assez forte pour lutter victorieusement ; l’amoncellement du sable y crée des zones d’épandage où la crue s’étale, s’éparpille et s’arrête. Toute la portion aval du fleuve est ainsi condamnée à mort.
Nous sommes désormais en état de mieux comprendre l’état dans lequel se trouve aujourd’hui le bas O. Messaoud, et de mettre au point les souvenirs à demi légendaires que les Touatiens se sont transmis sur son passé immédiat.
L’O. Messaoud historique. — La région de Haci Boura et de Haci Rezegallah, c’est-à-dire l’oued Messaoud au large du Bas-Touat, est tout à fait étrange. La vie semble s’y être arrêtée hier, un palais de la Belle au Bois dormant. Tout le pays est couvert de traces humaines, de celles naturellement qu’on peut attendre au désert ; les puits sont très soignés, avec de superbes margelles en grandes dalles, bien supérieures à la moyenne comme aspect extérieur ; ces puits de luxe contiennent de l’eau saumâtre, et on n’échappe pas au soupçon que la qualité de l’eau a dû jadis justifier mieux qu’aujourd’hui tous ces frais d’architecture. Les redjems, ces gros tas de pierre, indicateurs du chemin, sont très nombreux, il n’y a guère de sentier saharien mieux jalonné ; mais le sentier lui-même a disparu ; les medjbeds pourtant, ces sentiers sahariens gravés par le pied des chameaux, sont incroyablement tenaces ; on les retrouve très nets, au moins par places, dans des régions où les guides expérimentés, grands connaisseurs de traces, affirment qu’il n’a passé personne depuis un an (voir là-dessus en particulier le rapport de tournée du capitaine Flye, passim) ; sur le sol du Sahara, partout ailleurs que sur les dunes naturellement, les traces qui jouent un si grand rôle dans la vie des indigènes, sont beaucoup plus tenaces qu’en nos pays ; ici la moindre égratignure du sol est durable ; la marque d’un pied de chameau trahit encore après des mois le passage de la dernière caravane ; c’est que le vent, seul agent d’érosion, est impuissant à l’effacer, et même s’il saupoudre de sable le léger dessin en creux, il ne le fait que mieux ressortir. Aussi est-on frappé de ne plus voir,[35] entre Haci Boura et Haci Rezegallah la moindre trace de medjbed.
En revanche, beaucoup de tombeaux musulmans groupés en petits cimetières ; mais c’est la seule trace de leur séjour qu’aient laissée les campements de nomades. Et il a dû y avoir ici, en effet, de superbes pâturages, représentés aujourd’hui par des étendues de tiges sèches ; là où il subsiste des plantes vertes, elles sont salées et les chameaux y touchent à peine. On est frappé de l’absence de tout gibier ; le seul mammifère dont nous ayons vu les traces est un fennec, petit animal qui se nourrit d’insectes et de lézards[25].
En somme la région fut, à une époque médiocrement éloignée, un centre important de vie nomade. C’est ici, disent les indigènes que paissaient les troupeaux du Sali ; car ce pays, qui, hier encore, était utilisable, a des propriétaires, il est rattaché à une portion spéciale du Touat, le groupe du Sali. Rien de plus naturel puisque l’O. Tlilia prolongé joint le Sali à l’O. Messaoud. Pourtant à quel point le Sali dans ces dernières années s’est désintéressé de ses vieux droits, c’est ce que semble prouver la difficulté avec laquelle on recueille aujourd’hui des renseignements indigènes sur l’O. Messaoud ; on ne trouve même pas de guides au Touat, le nôtre était un Jakanti de Tindouf (Jakanti est beaucoup plus connu sous sa forme au pluriel, Tadjakant).
Ces difficultés ont été exagérées encore par le mutisme voulu de nos indigènes fraîchement soumis, qui craignent en nous renseignant d’attirer sur eux des représailles. Mais à quel point la pénurie de guides est réelle, c’est ce que montre en détail le rapport de « tournée à Taoudeni » du lieutenant-colonel Laperrine[26], et il en explique les causes. Naturellement les ksouriens du Sali, agriculteurs sédentaires, n’ont jamais gardé leurs troupeaux eux-mêmes ; le mot de sédentaire au Sahara a un sens terriblement absolu : avant notre arrivée, qui a bouleversé tant de choses, et en particulier les conditions des voyages, le ksourien ne pouvait guère s’éloigner de sa seule protection, les murailles du ksar ; et le court rayon de ses pérégrinations ne le conduisait guère au delà des derniers palmiers. Les troupeaux de Sali dans l’O. Messaoud étaient donc gardés par des nomades.
De ces nomades nous connaissons assez exactement le nom, l’origine et la fin. Les nomades propres du Touat étaient les Ouled Moulad et les Arib. Le nom des premiers se trouve sur les anciennes cartes, celles de Vuillot, par exemple. Ils avaient leurs affinités avec[36] le Tafilalet, les Beraber et plus spécialement peut-être, la tribu des Beni Mohammed. Ils parlaient arabe, leurs pâturages étaient dans l’Iguidi et l’erg ech Chech ; leur zone d’influence s’est parfois étendue jusqu’à Ouallen, où ils ont quelque temps coupé la route de Tombouctou. C’était en somme l’avant-garde marocaine contre les Touaregs, avec lesquels une dernière rencontre a mal tourné pour les Ouled Moulad. Il y a une vingtaine d’années la tribu tout entière fut surprise au Menakeb et massacrée par un rezzou de Taitoq.
Les Arib d’autre part ont quitté le pays et ont émigré en masse vers l’oued Draa.
Des incidents comme l’anéantissement des Ouled Moulad ne sont pas rares au Sahara, et ce qui est curieux c’est que la tribu ne se soit pas reconstituée. Les pertes subies étaient insignifiantes pour cette puissante réserve de bandits entraînés qu’est le Maroc méridional ; après comme avant l’incident, les Beraber sont restés les maîtres au Touat ; c’est nous qui les en avons péniblement arrachés. Il semble donc que les Ouled Moulad et les Arib aient été chassés de leurs pâturages beaucoup moins par les Touaregs que par les progrès de la sécheresse.
Il n’est donc pas douteux que l’O. Messaoud, entre Haci Boura et Haci Rezegallah n’ait été récemment soustrait à l’exploitation humaine, et d’ailleurs les indigènes nous affirment qu’il a coulé pour la dernière fois il y a une cinquantaine d’années.
A les en croire, les progrès de la sécheresse se laisseraient suivre bien plus loin dans le passé, ils auraient été effrayants dans une période historique relativement brève. Au Touat et chez les Tadjakant, on conserve le souvenir d’une époque où des ânes de Sali, chargés de dattes, ravitaillaient Taoudéni. Ceci se passait, nous dit-on, « au temps des Barmata » ; et cette indication chronologique manque sans doute de précision.
On verra pourtant, au chapitre du Touat, que les Barmata ne sont nullement des personnages de légende, et leur temps correspond à peu près aux XIIe, XIIIe, XIVe siècles.
Il faudrait donc admettre que, il y a quelques siècles, l’O. Messaoud aurait conservé jusqu’à Taoudéni assez de verdure et d’humidité pour que des ânes aient pu suivre son lit. Les renseignements indigènes sont en tout cas positifs, circonstanciés et même vaguement datés.
D’autre part la tournée récente de M. le lieutenant-colonel Laperrine nous apporte des renseignements précieux sur la route de Taoudéni. Il y en a deux, ou du moins la route de Taoudéni aboutit au[37] Touat par deux embranchements distincts, l’un, par Haci Rezegallah, au Bas-Touat, l’autre par Haci Sefiat à Tesfaout ; c’est cette dernière route qui a été suivie par M. le lieutenant-colonel Laperrine. Le détachement a souffert horriblement.
Voici par exemple la description d’une étape[27] : « Les assoiffés et les malades, qui avaient bu de l’eau salpêtrée s’étaient mis complètement nus sur leurs méhara ; pris de délire certains refusaient d’avancer et se laissaient tomber de leurs montures, disant qu’ils préféraient mourir sur place, etc. » Souffrances et dangers pourtant ne doivent pas être mis exclusivement au compte de la route : elle a été abordée dans de très mauvaises conditions ; chameaux épuisés d’avance, tonnelets et outres percés, puits comblés et longs à désobstruer, une foule d’obstacles supplémentaires ont failli rendre fatal un voyage qui, en d’autres circonstances, n’eût certainement pas excédé les forces de méharistes entraînés. Le détachement Laperrine entre Taoudéni et Tesfaout a rencontré six puits entre lesquels la distance maximum sans eau est d’environ 150 kilomètres. Il est vrai que l’un d’eux, Tni Haïa, n’a que de l’eau imbuvable et même vénéneuse, de sorte que, entre el Biar et Bir Deheb il faut franchir 250 kilomètres sans point d’eau utilisable ; mais c’est encore très faisable avec des animaux en bon état. M. le lieutenant-colonel Laperrine croit d’ailleurs possible de retrouver et de remettre en état d’autres vieux puits oubliés, il signale un certain nombre de bons pâturages. La route se maintient tout entière à l’intérieur de l’erg ; et elle longe l’énorme massif archéen (?) des Eglab, qui doit à son altitude relativement considérable, et surtout à sa proximité de l’Océan une certaine quantité de pluies, ainsi que l’a constaté la reconnaissance Flye Sainte-Marie. Ce sont ces pluies évidemment qui alimentent les puits et les pâturages de l’erg ; elles sont canalisées et entraînées par le vieux réseau quaternaire. Ould Brini el Bir Deheb en particulier sont en relation avec des oueds orientés ouest-est[28]. Nous sommes ici apparemment dans le réseau des affluents de rive droite de l’oued Messaoud.
Cette vieille route complètement abandonnée pourra donc se rouvrir ; même revivifiée pourtant, et entretenue administrativement, elle restera assez dure ; assurément fermée aux ânes chargés de dattes qui seraient pourtant, aujourd’hui comme autrefois, les bienvenus à Taoudéni. En faisant la part aussi large qu’on voudra aux mirages du passé dans la mémoire indigène il reste qu’une grande route de[38] commerce a été complètement désertée, apparemment parce que son aridité croissante la rendait plus difficilement praticable.
Au Touat même, un asséchement très marqué du pays est à la fois affirmé par les indigènes, et rendu vraisemblable par l’étude du terrain.
On verra au chapitre du Touat que les Barmata (?) y ont laissé de nombreuses ruines en pierres sèches très différentes des villages modernes en pisé.
Les ksars Barmata sont alignés comme leurs successeurs le long de la grande faille du Touat, jalonnée de sebkhas. Mais ils sont invariablement, par rapport aux ksars actuels, en retrait vers l’est de plusieurs kilomètres et en amont de plusieurs dizaines de mètres. Ils sont construits sur la falaise crétacée, tandis que les autres sont en contre-bas, tantôt sur la petite falaise pliocène (Zaouiet Kounta, Touat el Henné) ; tantôt tout à fait dans la plaine au milieu des sables (Sali, Reggan). Il n’a pas encore été fait d’étude détaillée des vieux ksars, précisément parce qu’ils sont trop à part, si éloignés de la route que beaucoup d’entre eux ne s’aperçoivent même pas. L’un d’eux, el Euzzi, à la hauteur de Zaouiet Kounta, est aujourd’hui à 4 bons kilomètres de la ligne des palmiers.
Cela suggère que le niveau des sources a baissé.
J’ai vu auprès d’el Euzzi, au pied même de la butte, une séguia desséchée, c’est-à-dire un canal à ciel ouvert, alors que, à Zaouiet Kounta, les foggaras vont capter l’eau à des profondeurs de 20 mètres.
On a peine à croire que des agriculteurs sahariens aient placé leurs villages à plusieurs kilomètres de l’eau et des cultures.
Il est vrai que les Barmata à en juger par leur histoire un peu vague, et par l’architecture même de leur ksars étaient moins préoccupés d’agriculture, que de domination militaire et de commerce ; c’étaient peut-être des nomades et leurs villages des magasins-forteresses. Il faudrait examiner de près leurs vieux puits et leurs vieux canaux : pourtant, sous réserve d’études ultérieures, on a une première impression très forte que le pays s’est desséché.
On a d’ailleurs sur ce sujet les affirmations des indigènes.
M. Vattin en a recueilli d’étranges, mais qui pourtant ne sont pas absurdes. « Les gens de Tiouririn et d’Adrar (district de Zaouiet Kounta) expliquent que si les ksars d’Ikis, Temassekh et Mekid sont bâtis sur une colline, c’est parce qu’à l’époque des Juifs le pays était couvert par les eaux. » Ce sont là, nota bene, des ksars modernes en pisé, encore habités et vivants, et l’aspect du pays est loin de contredire les affirmations des indigènes ; il y a là, aux[39] environs de Temassekh, comme le montre un coup d’œil sur la carte, un lit d’oued extrêmement large, profondément taillé dans des terrains tout récents, pliocènes ou post-pliocènes, et l’oued par conséquent est encore plus récent qu’eux. Nous avons considéré cet oued comme la prolongation de celui du Gourara ; mais il est clair que son lit a pu être utilisé par un bras de l’O. Messaoud, les communications sont largement ouvertes par Tesfaout. Le lit est aujourd’hui couvert de dépôts alluvionnaires et sableux, où se maintient un pâturage assez vert, et où l’on trouve en abondance des Cardium edule. Il est vrai que ces coquilles peuvent provenir de la désagrégation des couches pliocènes qui sont fossilifères. « Il paraît, dit encore Wattin, que, au sud-ouest de Tamentit, le pays était autrefois couvert par les eaux. » Au sud-ouest de Tamentit se trouve précisément la grande zone d’épandage de l’oued Messaoud, et en particulier l’oasis de Tesfaout où la dernière crue, il y a une quinzaine d’années, a fait notoirement des ravages. Rien de tout cela n’est invraisemblable. Voici, il est vrai, qui est plus fort. « Une légende très curieuse, conservée dans le Touat, rapporte que presque tous les ksars communiquaient entre eux par eau. Un indigène de Tamentit, le nommé M’hamed Salah ould Didi, raconte que le nommé Elhadj M’barek ould Didi Moussa, des Oulad Ahmed, district du Timmi, lui avait affirmé avoir lu une lettre qu’un commerçant rentrant de voyage écrivait à ses parents à Inzegmir, pour les prévenir que les « barques de Tamentit étaient parties pour Timadanin et n’étaient pas encore revenues ». Il faudrait une terrible crue pour rendre navigables les sebkhas du Touat du Timmi au Reggan ; et on hésite à admettre sans supplément de preuves l’existence d’une flottille à Tamentit. M. Martin, interprète militaire, a eu communication d’un texte arabe d’après lequel des émigrants, arrivant au Touat en l’an 4624 de la création du monde se seraient établis sur les bords d’un grand oued qui coulait régulièrement. Ceci nous mettrait d’après la chronologie juive usuelle à l’an 863 de notre ère. Et d’ailleurs, il n’est pas surprenant qu’une date en chronologie hébraïque se soit maintenue dans un pays comme le Touat, qui a un passé juif incontestable. Mentionnons enfin la bizarrerie de ces noms triomphants, oued Messaoud « la rivière heureuse » ; haci Rezegallah, le « cadeau de Dieu », si peu justifiés aujourd’hui et qui semblent l’écho d’un passé brillant. Reste à savoir quel degré de confiance il faut attribuer à ces vieux souvenirs.
Les indigènes arabisants ont une imagination redoutable, une facilité fâcheuse à se créer des souvenirs faux et précis. Dans leurs[40] pays d’ailleurs dépouillé de toute végétation, nu, écorché et disséqué comme une préparation de laboratoire, l’histoire de la terre se déchiffre plus aisément qu’ailleurs. On voit partout de grands oueds morts et des lacs desséchés ; de là à se les représenter hier encore remplis d’eau vive il n’y a qu’un pas, et l’indigène peut l’avoir franchi de lui-même aussi aisément que l’explorateur européen. Pourtant la réunion des affirmations indigènes et des faits observés forme un faisceau d’arguments, auquel il serait facile encore d’ajouter quelques faits nouveaux.
Les foggaras[29] du Bouda, du Timmi et de Tamentit grouillent de barbeaux. On n’en trouve pas plus au sud, au Reggan en particulier. Il faut bien admettre que ces barbeaux du Timmi témoignent de l’ancienne existence d’eau libre et courante dans le Haut-Touat. Il est vrai que ce sont des bêtes étonnamment migratrices et résistantes. A notre arrivée à Beni Abbès, les r’dirs de l’oued étaient très poissonneux ; en bons civilisés et conformément à toutes nos traditions d’exploitation destructive, nous les avons péchés jusqu’à disparition totale. Le mal pourtant n’a pas été sans remède ; on a reconnu expérimentalement que chaque nouvelle crue renouvelle le stock de barbeaux. On voit d’ailleurs très bien d’où ils viennent ; les r’dirs profonds de Colomb-Béchar par exemple sont un vivier naturel, où on fait des pêches miraculeuses avec une épingle recourbée. Il en existe bien d’autres, à coup sûr, dans le haut du Guir. Entraînées par la crue, ces petites bêtes franchissent étourdiment d’énormes distances et échouent où elles peuvent. Pour peupler les foggaras du Haut-Touat, il a donc pu suffire de quelques alevins apportés par le hasard d’une crue ; une fois qu’ils eurent pullulé dans le dédale des galeries souterraines de captage, on conçoit très bien qu’ils s’y soient maintenus. Pourtant, s’ils venaient à disparaître aujourd’hui, on a peine à croire qu’ils trouveraient des successeurs.
La seule existence des foggaras me paraît un argument en faveur de l’asséchement graduel du pays. Au Touat seul ces galeries souterraines, parfois très profondes, auraient, d’après Niéger, au moins 2000 kilomètres de développement ; un métropolitain de grande capitale européenne est à peine plus compliqué. Notre industrie européenne conçoit et exécute de pareils travaux en quelques années, mais non pas la pauvre industrie des ksouriens, outillés d’une pioche et d’un couffin. Les foggaras ne peuvent pas être nées d’un plan préconçu, elles sont l’aboutissement de tâtonnements progressifs à travers[41] les siècles. Les premières devaient être beaucoup plus courtes, et pourtant suffisantes, mais de génération en génération, il a fallu chercher l’eau raréfiée à une distance et à une profondeur croissante sous le sol. Cette hypothèse, en tout cas, me paraît la seule qui rende compte de la disproportion entre l’énormité de l’œuvre et les ressources de ceux qui l’ont exécutée.
Il faut surtout relever que l’existence de véritables rivières au Touat, à une époque rapprochée de nous, est très loin d’être inexplicable, elle est même scientifiquement vraisemblable, d’après le peu que nous savons sur l’énorme masse de sable qui, d’el Goléa à Tindouf, a progressivement barré aux eaux de l’Atlas les chemins du sud.
II. — Les Dunes.
Lorsque, dans nos climats, nous trouvons les dunes localisées au voisinage de la mer, nous admettons sans difficulté qu’elles ont été édifiées en collaboration par la mer et le vent, l’une fournissant les matériaux et l’autre la mise en œuvre. On ne s’est jamais demandé, je crois, si les dunes désertiques ne présupposeraient pas, elles aussi, une collaboration analogue de deux érosions, fluviale et éolienne. D’ailleurs, pour expliquer ces énormes amas croulants, qui donnent à première rencontre une impression d’instabilité et de fluidité, la tendance, si naturelle, à s’exagérer le rôle du vent a déjà conduit des géographes éminents à des conclusions qui ont dû être abandonnées. On s’est représenté l’armée des dunes progressant lentement, mais sûrement, d’est en ouest, à travers tout le continent du Nil à l’Atlantique, sous la poussée d’un alizé hypothétique[30]. Il a fallu reconnaître, depuis les études de M. Rolland, que les dunes sont stables, au moins dans leurs contours généraux, et dans les courtes limites de temps d’une mémoire humaine. Les vieux guides indigènes retrouvent l’erg tel qu’ils l’ont toujours connu depuis leur enfance, avec ses mêmes sommets, ses mêmes cols, ses mêmes détails caractéristiques, auxquels traditionnellement on reconnaît le chemin. L’alluvion éolienne, à coup sûr, a une action puissante à la longue sur le modelé, mais pas plus rapide, semble-t-il, que l’alluvion fluviale dont les effets sont parfois instantanés dans le détail, mais ne sont pas immédiatement sensibles dans l’ensemble. Pour les dunes, comme pour les vallées d’érosion, il y a un profil d’équilibre, un point au delà duquel les modifications deviennent insensibles.
[42]On peut aller plus loin. Je ne sache pas qu’il existe d’études détaillées nombreuses sur la composition des sables désertiques ; et je ne suis malheureusement pas en état de combler cette lacune ; mais un petit nombre de gros faits, qui sautent aux yeux, empêchent de souscrire à cette phrase de M. de Lapparent : « la vraie dune [saharienne] est caractérisée par l’uniformité de sa composition[31] ». L’affirmation est de G. Rolland, et s’applique par conséquent aux grands ergs algériens, plus particulièrement à l’erg oriental. Dans ces limites elle est très intéressante, mais on ne peut pas l’étendre à l’ensemble du Sahara. Dès qu’on dépasse In Ziza vers le sud et qu’on entre par conséquent dans la zone nigérienne, on constate un changement dans la nature du sable, il devient poisseux et salissant, il colle à la peau ; c’est une surprise physiquement désagréable pour qui vient du nord où il n’est pas nécessaire d’être musulman pour trouver efficaces les ablutions au sable. La moindre analyse chimique serait plus convaincante qu’une impression de peau : du moins celle-ci n’est-elle pas personnelle, tous les Européens l’éprouvent ; le sable du Tanezrouft semble mélangé d’argile, il participe de la nature du sol, où, à côté des quartzites, les micaschistes, chloritoschites et autres argiles métamorphisées tiennent une grande place en superficie. Notons cependant, que dans ce Tanezrouft méridional nous avons vu des brumes sèches prodigieusement opaques, qui laissent un dépôt argileux très net, et qui viennent de l’Adr’ar des Ifor’ass, où elles sont en relation avec les tornades. La présence dans le sable d’éléments argileux pourrait donc avoir une cause climatique et non géologique. Il est facile d’ailleurs d’invoquer d’autres faits plus probants. A propos de l’Iguidi, le lieutenant Mussel écrit : « le sable des dunes contient une quantité infinie de petits grains noirs dus à la décomposition des schistes[32] ». Et tout près de l’Iguidi, à la lisière occidentale de l’erg er Raoui, à Tinoraj par exemple, j’ai vu en effet le sable des dunes mélangé sur toute son épaisseur de petites paillettes noires, en telle abondance que la coloration générale s’en trouve nettement assombrie. Si nous sommes ici déjà en dehors de la zone schisteuse, du moins en sommes-nous tout près. D’après M. Chudeau, à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest d’Agadès, il existe une roche siliceuse rouge violacée ; toutes les dunes qu’elle supporte ont la même teinte. Le sable pur, aux grains « exclusivement quartzeux, individuellement hyalins ou légèrement colorés en jaune rougeâtre par des traces d’oxyde de fer, et qui prennent en[43] masse une teinte-d’or mat », ce sable classique étudié par G. Rolland ne se trouve qu’à l’est de la Saoura, dans la zone où les grès dévoniens et crétacés jouent un rôle prépondérant.
Nous sommes donc amenés à conclure qu’il y a un lien entre la géologie du sol et la composition des dunes qui le couvrent. Les dunes sont beaucoup plus locales, beaucoup plus en place qu’on ne l’imaginait. Le sirocco a beau être un puissant agent de transport, de triage et de classage, il n’a cependant pas déplacé beaucoup les matériaux qu’il a remaniés et entassés.
Allons plus loin. On a dégagé quelques-unes des lois qui président à la formation des dunes. On sait qu’une dune se forme toujours autour d’un obstacle naturel, dont la résistance matérielle au vent force le sable à se déposer. Toutes les dunes ont en profondeur un squelette rocheux ou terreux, apparent ou non. En bien des points du Sahara, à In Salah par exemple, il suffit d’élever un mur pour le retrouver enfoui sous le sable l’année suivante. La lutte acharnée que tant de ksars livrent au sable envahisseur, et qui a fourni des arguments à la théorie des dunes en marche, n’a pas d’autre cause. En bâtissant le ksar, ses maisons et les murettes de ses jardins, l’homme a créé la dune contre laquelle il lui faut défendre ses cultures, et qui est d’autant plus redoutable qu’elle est nouvelle et que le profil d’équilibre est plus loin d’être atteint.
On sait aussi que ces longs couloirs nets de sable, qui s’étirent à travers les ergs et qu’on appelle, suivant les lieux, gassi ou feidj, trahissent un certain parallélisme qui ne peut pas être fortuit. Cela ressort nettement sur les cartes de l’erg oriental, dressées d’après F. Foureau, et sur les cartes des ergs occidentaux, Iguidi compris, dressées par les officiers des oasis (cartes Niéger, Prudhomme, itinéraire Flye Sainte-Marie). Le parallélisme n’existe pas seulement entre gassis voisins : d’un bout à l’autre de la zone des grandes dunes, sur les bords de l’Igargar comme dans l’Iguidi, la direction des feidjs est à peu près la même, oscillant entre nord-sud et nord-ouest-sud-est. D’un fait aussi général il faut une explication générale, et le vent seul peut la fournir, on l’a dit depuis longtemps[33]. Il n’est pas douteux que nous ayons là un enregistrement mécanique de la direction du vent dominant qui est le vent d’est. Mais cette explication, pour exacte qu’elle soit, n’est pas suffisante, car elle ne rend pas compte de tous les faits observés.
Il est incontestable qu’il y a un rapport étroit entre la direction[44] des feidjs comme aussi des contours extérieurs de l’erg d’une part, et celle des oueds quaternaires d’autre part. Qu’on prenne la carte de l’Algérie à 1 : 800000, feuille 6. Il saute aux yeux que les gassis du Grand Erg sont la prolongation rectiligne des oueds descendus du Hoggar. Le plus important de tous les gassis, le gassi Touil, correspond, comme il sied, à l’O. Igargar.
L’erg de Timimoun tout entier est encadré sur trois faces par trois grands oueds, Seggueur à l’est, Meguiden et sebkha du Gourara au sud, O. Saoura à l’ouest. Sur beaucoup de points, presque partout à ma connaissance, le long de la Saoura tout entière, sur les bords de la sebkha du Gourara, l’encadrement est rigoureusement exact. La dune vient mourir sur la rive. L’erg er Raoui est limité à l’ouest sur toute son étendue par l’O. Tabelbalet. De l’Iguidi à peine entrevu nous savons du moins avec certitude qu’il est limité à l’ouest sur 150 km. par l’O. Menakeb. Tout le long de l’O. Messaoud, de Foum el Kheneg à Rezegallah, le lit de l’oued principal, ses faux bras, les lits de ses affluents sont régulièrement longés de minces cordons de dunes, avant-coureurs de l’erg ech Chech, qui s’étirent pendant des dizaines de kilomètres, collés aux rives occidentales.
En somme, presque toutes les lignes topographiques de l’erg, contours extérieurs, tracé des gassis, coïncident avec des tronçons du réseau quaternaire sous-jacent. Rien de plus naturel, la dune, on le sait, se modèle nécessairement sur le relief, qui est lui-même l’œuvre de l’érosion ; il faut donc bien que la topographie de l’erg laisse transparaître l’érosion quaternaire ; de par les lois mécaniques de leur formation, les dunes devaient s’enraciner sur les lignes de falaises, d’autant que la plupart des oueds coulent nord-sud, normalement à la direction du vent dominant.
Voici un autre fait connexe. On sait depuis longtemps que les ergs ne sont pas au désert les régions les plus désolées, ils ont de beaux points d’eau et de beaux pâturages, mais c’est un fait dont on donne généralement une explication incomplète. On se borne à invoquer la perméabilité des dunes qui en fait de précieux réservoirs d’humidité ; la plus belle dune du monde ne peut rendre plus qu’elle n’a reçu, et les pluies locales au Sahara sont trop rares pour alimenter un point d’eau sérieux ; sur un point déterminé, il peut s’écouler dix ans d’un orage à l’autre ; les nappes pérennes sont nécessairement alimentées par le drainage souterrain d’énormes superficies. Il est a priori vraisemblable que les puits et les sources, dans l’erg comme partout ailleurs, sont en relation avec la circulation souterraine, à laquelle il va sans dire que les dunes apportent une contribution très précieuse.
[45]A posteriori presque toujours, dans l’erg, la nappe est dans le sol et non pas dans le sable ; presque toujours aussi les points d’eau jalonnent le lit d’un oued quaternaire (Saoura, O. de Tabelbalet, Menakeb, O. Messaoud, etc.). Il y a d’extrêmes différences au point de vue de l’humidité entre des fractions d’erg toutes voisines. L’erg intermédiaire entre celui du Gourara et l’Iguidi se subdivise en deux parties, l’erg Atchan et l’erg er Raoui ; tous les deux méritent leurs noms (« assoiffé » et « humide »). C’est que l’erg « humide » recouvre un grand oued venu de l’Atlas. L’autre, emprisonné au nord dans une cuvette sans affluent, est réduit à ses ressources locales d’humidité. L’Iguidi et l’erg du Gourara sont manifestement alimentés en eau par les grands oueds descendus de l’Atlas ou des Eglab. Le vieux réseau quaternaire, tout enseveli qu’il soit, conserve un reste de vie souterraine ; c’est lui qui fait l’habitabilité de l’erg.
Dès lors on peut se demander si la présence de l’eau, sur certains points privilégiés, n’a pas une influence sur la répartition des dunes[34]. Dans certains cas ce n’est pas douteux. Il me paraît évident, par exemple, que les grandes crues de la Saoura, en balayant son lit jusqu’à Foum el Kheneg, contribuent à arrêter la progression de l’erg. Il est évident aussi que les sebkhas opposent à la dune une résistance vigoureuse ; celle de Timimoun par exemple, assiégée au nord par d’énormes dunes, reste franche de sable dans toute son étendue. Il est clair que le vent n’a pas de prise sur le sable humide, et d’autre part, sur cette immense étendue, rigoureusement plane et désolée, le sable qu’il pousse n’est arrêté par aucun obstacle. Quel est le rôle des bas-fonds humides où l’eau reste assez douce pour alimenter de la végétation, parfois même arborescente (tamaris, retem, etc.), et qu’on appelle des nebkas ? Il est difficile de conclure. La végétation évidemment contribue à fixer le sable local, mais elle fait obstacle et arrête au passage beaucoup de sable en suspension. Une nebka est mamelonnée d’innombrables petites dunes, dont chacune est couronnée par une touffe ou un arbuste ; la plante pousse en hauteur désespérément pour échapper au sable qui monte. C’est un des épisodes les plus curieux de la grande lutte entre la dune et l’eau.
Au total, quelque incomplète que soit notre connaissance des causes, le fait est hors de doute. Le tracé des ergs est bien un calque grossier du réseau quaternaire enfoui. Mais ce n’est pas la seule relation qu’on puisse signaler entre les deux.
[46]Nous connaissons assez bien aujourd’hui la partie du Sahara comprise entre l’Algérie et le Niger pour en esquisser une représentation d’ensemble, dans laquelle la localisation des grandes masses de dunes apparaît tout à fait curieuse. Elles sont dans les régions déprimées. C’est dans la région de Tar’it, je crois, que les altitudes maximum sont atteintes, environ 600 mètres à la base des dunes. Mais l’erg de Tar’it n’est qu’un promontoire avancé du grand Erg, qui dans son ensemble repose sur un socle moins élevé, de 300 à 500 mètres. Les ergs soudanais sont encore plus bas, dans le Djouf et sur les bords du Niger. Les parties élevées du Sahara, hammadas « subatliques », plateau du Tadmaït, pays des Touaregs, Tanezrouft, tout cela est rocheux, caillouteux, décharné et comme épousseté, l’inverse de l’erg. Lorsqu’on y rencontre des dunes, ce qui est rare, elles sont petites et d’ailleurs localisées dans des dépressions relatives. C’est un étrange contraste : les hauts sont impitoyablement balayés, raclés, polis et luisants : les bas sont enfouis sous d’énormes amas de sable. En schématisant, un peu, on pourrait poser la règle suivante : au-dessous de 500 mètres, région de l’erg ; au-dessus, zone des hammadas. Cela revient à dire que la loi de la pesanteur a présidé à la répartition des ergs. Voilà qui est singulier. Si mal connu que soit encore le processus d’alluvionnement éolien, si on voulait le définir et l’opposer à l’alluvionnement fluvial, on dirait, il me semble, que le premier échappe aux lois de la pesanteur, tandis que le second leur est étroitement soumis. Nous pouvons déjà entrevoir que l’alluvionnement fluvial est moins étranger à la répartition des dunes qu’on ne pourrait croire.
Regardons-y de plus près. L’Erg algérien se divise en deux grandes masses : l’Erg oriental, au sud d’Ouargla, et l’occidental, celui de Timimoun. Ils sont séparés par une grande étendue de plateaux calcaires où passe la grande route de Laghouat, Ghardaïa, el Goléa ; au sud de l’Algérie, c’est la seule large brèche dans la muraille des sables. Or l’Erg oriental est dans la cuvette de l’Igargar, l’Erg occidental dans la cuvette de l’O. Messaoud. Ce dernier se subdivise en trois tronçons séparés par de longs couloirs, au travers desquels ils tendent d’ailleurs à se rejoindre. Chacun de ces trois tronçons correspond à ceux des grands rameaux dont la réunion constitue l’O. Messaoud : l’erg de Timimoun recouvre les oueds constitutifs de l’O. Gourara, l’erg er-Raoui l’O. Tabelbalet, l’Iguidi l’O. Menakeb. On constate une tendance à l’accumulation des dunes précisément au point où les grosses ramifications quaternaires sont le plus serrées, au point de convergence.
[47]Passons aux amas de dunes plus petits et excentriques au Grand Erg. Le couloir du Tidikelt entre le Tadmaït et le Mouidir-Ahnet est, en sa qualité de dépression, assez sablonneux, In Salah est assiégé par les dunes ; mais les agglomérations un peu notables, les petits ergs, forment deux groupes bien localisés. L’un, erg Iris-erg Tegan, est dans le grand maader au pied des pentes concentriques du Mouidir où tous les oueds du Mouidir convergent pour former l’O. Bota ; l’autre, erg Enfous, est dans une situation curieusement symétrique, dans le grand maader de l’O. Adrem, au point où convergent tous les oueds de l’Ahnet.
Plus au sud, entre l’Ahnet et In Ziza, le seul erg un peu considérable qu’on rencontre sur la route du Soudan est collé à l’un des plus grands oueds descendus du Hoggar, l’O. Tiredjert. On commence à soupçonner que les ergs se répartissent non pas directement d’après les altitudes barométriques, mais d’après la distribution des grands dépôts d’alluvions aux dépens desquels ils sont formés.
A priori, c’est tout naturel, quoique ce point de vue semble avoir trop échappé aux géographes. Reclus lui-même a écrit cette phrase étrange : « Si les Vosges, montagnes de grès et de sables concrétionnés, se trouvaient sous un climat saharien, elles se changeraient bientôt en amas de dunes comme celles du désert africain[35]. » Si les Vosges se trouvaient sous un climat saharien, le Mouidir nous donne un excellent exemple de ce qu’elles deviendraient. Qu’importe au vent, le grand architecte des dunes, que le grès soit pour les géologues du sable concrétionné ; pour lui c’est de la roche, et ce qu’il lui faut c’est du sable libre.
La phrase de Reclus est un curieux témoin de la difficulté que nous éprouvons, par manie catégorisante, à concevoir la complexité d’un processus naturel. Parce que les dunes sont un produit éolien, il faut que le vent suffise à tout expliquer, non seulement la forme extérieure des dunes, mais encore la production même du sable qui les compose.
Le climat désertique qui écaille les roches, les vents violents chargés de milliards de petits projectiles quartzeux, ce sont là assurément, comme on l’a remarqué, de puissants agents d’érosion. On a tout dit sur l’érosion éolienne, et pas assez peut-être sur ses limites. Les roches désertiques ont une surface lisse et luisante, on le sait, et qui atteste à coup sûr une usure éolienne, mais aussi la formation d’une croûte d’origine chimique, « une écorce brune, dite vernis du[48] désert »[36]. Tous les grès du Sahara algérien sont recouverts de cette écorce, dont la couleur va du brun foncé (grès néocomiens) au noir de jais (éodévonien). Elle est particulièrement curieuse sur les grès éodévoniens, parce que la croûte superficielle noire contraste vivement avec le cœur de la roche, d’un blanc éclatant ; c’est une peinture étalée uniformément sur l’immensité des collines et des hammadas. La croûte est très dure et résistante, on le remarque particulièrement à propos des grès crétacés, qui sont plutôt tendres, et auxquels la croûte fait une carapace et une protection. Nul doute qu’il n’y ait là un obstacle à la puissance érosive du vent.
C’est peut-être à cette patine résistante que beaucoup de gravures rupestres doivent leur conservation. Les régions désertiques sont par excellence leur domaine ; elles sont rares dans le Tell, sans être tout à fait absentes. Cette distribution peut s’expliquer, au moins partiellement, par des causes historiques. Mais, sous bénéfice d’inventaire, on n’échappe pas à l’hypothèse que des causes climatiques aient pu jouer un rôle ; les gravures auraient été conservées en plus grande abondance là où les agents de destruction étaient le moins efficaces.
Les gravures préhistoriques dans l’Afrique du Nord sont plus difficiles à dater qu’en Europe, parce qu’une représentation d’éléphant ou de Bubalus antiquus, par exemple, n’offre pas en soi la même garantie d’âge reculé que la représentation d’un mammouth ou d’un renne. Il suffit en effet de remonter à Carthage pour retrouver l’éléphant dans la faune nord-africaine. L’attribution de gravures sahariennes à l’âge quaternaire reste donc hypothétique. Il en est pourtant de très vieilles et qui restent très nettes sous leur patine. Plusieurs milliers d’années d’érosion éolienne n’ont pas suffi à les effacer. Croit-on que ces égratignures auraient survécu pendant le même nombre de siècles à l’action de la pluie ? Leurs analogues européennes n’ont résisté qu’au fond des cavernes, sous le manteau protecteur des alluvions et des stalactites.
Au Sahara même, la presque totalité des gravures est sur des roches siliceuses, grès ou granite. Est-il vraisemblable que les indigènes se soient abstenus de parti pris de graver sur des calcaires, et peut-on leur supposer un pareil degré de discernement géologique ? Je connais une seule station de gravures sur calcaire (rive droite de la Saoura, à la hauteur du Ksar d’el Ouata, au point dit Hadjra Mektouba ; litt. « Pierres écrites ») ; au premier[49] abord, on n’y voit qu’une multitude de grafitti libyco-berbères plus ou moins récents ; un examen plus attentif fait découvrir au contraire de très vieilles figures, mais floues et indistinctes, il faut chercher l’angle favorable d’éclairage pour en apercevoir les vestiges effacés. D’autre part on voit partout à la surface de la pierre, marquée en cuvettes et en rivulets, l’action des eaux pluviales ; il est clair que c’est la pluie qui a détruit les plus vieilles images par son action chimique sur le carbonate de chaux. Ainsi donc, même dans les pays où il pleut tous les dix ans, et sur les roches calcaires à tout le moins, l’action des eaux météoriques reste plus efficace que celle du vent. Aussi bien l’on s’est déjà demandé, je crois, ce que seraient devenus, sous nos climats, les hiéroglyphes d’Égypte, et sans doute n’a-t-on jamais mis en parallèle, au point de vue de l’intensité, les érosions éoliennes et pluviales. Mais comment n’a-t-on pas été frappé davantage de la disproportion extraordinaire entre les formidables amas de sable qui constituent les dunes et l’action érosive du vent, qui est supposée les avoir détachés de la roche grain à grain ?
Inversement, on sait que le climat désertique est au Sahara une apparition récente, puisque l’âge quaternaire a connu de grands fleuves ; et on ne doute pas que les roches sahariennes n’aient été soumises à l’érosion subaérienne, et par conséquent pluviale, depuis leur émersion, cela revient à dire à tout le moins depuis la fin de l’âge crétacé, et en beaucoup de points du Dévonien. Où veut-on que s’en soient allés les déchets d’une érosion qui s’est exercée pendant des âges géologiques ? N’est-il pas évident qu’ils doivent se retrouver quelque part, précisément dans les dépressions où les eaux les ont nécessairement entraînés, et où nous trouvons aujourd’hui les ergs ? Il semble naturel d’admettre a priori que le vent est le simple metteur en œuvre de matériaux qu’il a trouvés tout préparés. Là où les fleuves disparus avaient étalé des plaines sablonneuses, le vent a accumulé des dunes ; il a transposé des alluvions fluviales en « alluvions éoliennes ».
A posteriori, les faits précis abondent à l’appui de cette thèse. Dans les limites mêmes du Tell, il y a tendance à la formation de dunes au moins sur un point, le plateau de Mostaganem. Mais là les géologues sont sur un terrain qu’ils connaissent bien, ils n’hésitent pas à reconnaître que les dunes se forment sur place aux dépens des sables pliocènes. C’est plus au sud, dans le désert inconnu, pays des mirages, qu’on n’ose pas dériver les mêmes effets de causes analogues.
Sur les hauts plateaux, en bordure et au nord de l’Atlas saharien, court un cordon de dunes, d’Aïn Sefra à Bou Saada. J’ai longuement[50] examiné la dune d’Aïn Sefra ; elle repose incontestablement sur des alluvions quaternaires à peu près exclusivement sableuses. Il est clair que l’une s’est formée aux dépens des autres ; à la base de la dune, les alluvions restées en place sont celles où l’oued actuel maintient quelque humidité attestée par de grosses touffes d’alfa ou de plantes désertiques (Voir fig. 26). Et d’autre part, que les alluvions quaternaires soient ici bien plus sablonneuses qu’argileuses, on se l’explique aisément si l’on songe à l’énorme place que tiennent les grès dans la chaîne des Ksour.
A l’ouest du Touat, sur l’itinéraire d’Adrar au djebel Heiran, on traverse un double cordon de dunes, qui recouvre exactement un double ruban de Quaternaire. La dune repose sur le sable nettement interstratifié de pellicules argileuses ; on a manifestement affaire à un ancien bras de l’O. Messaoud, devenu en quelque sorte intumescent par l’entassement éolien des alluvions jadis étalées.
La route qui va de Charouin aux Ouled Rached reste presque tout le temps au fond d’une immense cuvette d’érosion, bordée de falaises et semée de garas ; c’est le confluent de deux grands oueds quaternaires, représentés aujourd’hui par l’O. R’arbi (?) et la sebkha de Timimoun. On ne conçoit pas que dans cette grande cuvette, comme dans toutes les formations du même genre, le colmatage n’ait pas marché de pair avec l’érosion. On s’attendrait à trouver tout le fond tapissé d’alluvions ; en réalité, elles ne se sont conservées que dans la partie sud, où elles sont fixées par un restant d’humidité ; la sebkha de Timimoun se prolonge jusque-là par une languette de largeur insignifiante. Mais dans le nord, dans la partie de la cuvette de beaucoup la plus étendue, l’erg Sidi Mohammed remplit la dépression jusqu’au pied des falaises qui le bordent. Il est difficile de se soustraire à la conclusion que l’erg représente les masses alluvionnaires livrées par le desséchement et la pulvérulence au remaniement et au vannage éolien (fig. 44, p. 226).
Nous saisissons donc sur le fait, semble-t-il, en un certain nombre de points, la substitution directe, sur place, de la dune à l’alluvion quaternaire. Mais il va sans dire que l’âge du sable n’a aucune importance : le sable tertiaire vaut le quaternaire, pourvu qu’il soit libre.
Voici un gros fait, qui n’a jamais été mis en évidence et qui commence pourtant à apparaître bien net, sans contestation possible. Toutes les grandes masses d’erg au sud de l’Algérie, aussi bien à l’est qu’à l’ouest, dans le bassin de l’Igargar et dans celui de l’O. Messaoud, toutes celles du moins qu’on connaît un peu, reposent sur[51] le même substratum géologique, le Mio-pliocène, le « terrain des gour » de M. Flamand, en d’autres termes sur les dépôts continentaux qui se sont accumulés pendant une grande partie du Tertiaire, à tout le moins pendant toute la durée de l’âge néogène, sur l’avant-pays de l’Atlas, alors en voie de surrection.
Sur l’Erg oriental, M. Foureau nous a appris que son ossature est faite de gour.
Le grand Erg occidental (Gourara) ne repose pas seulement sur le « terrain des gour », mais encore, à l’ouest et au sud, il le recouvre exactement ; depuis Tar’it jusqu’à Charouin les limites des dunes coïncident assez exactement avec celles du Mio-pliocène. En règle générale, les dunes semblent s’arrêter où commencent les roches anciennes, primaires ou crétacées.
Même observation à propos du groupe moins important des ergs Atchan et er-Raoui, qui sert de trait d’union entre l’erg du Gourara et l’Iguidi. Partout où j’ai pu les observer, j’ai vu le contour extérieur de ces ergs suivre à peu près le dessin irrégulier et fantaisiste des compartiments effondrés où les dépôts mio-pliocènes ont été conservés, tandis que les horsts de grès éodévonien restent nets de sable.
Enfin l’Iguidi lui-même, entre Inifeg et le Menakeb, semble avoir un substratum de garas, taillées dans une formation horizontale médiocrement épaisse puisque le sous-sol ancien transparaît fréquemment. Il est permis de croire que cette formation est encore mio-pliocène.
C’est là un ensemble de faits assez curieux, et ne serait-il pas hasardeux de vouloir expliquer par une coïncidence fortuite cette identité constante du substratum ?
Regardons-y de plus près d’ailleurs. Le « terrain des gour », comme l’a reconnu M. Flamand depuis longtemps, est composé de deux étages : A la base, et sur la partie de la tranche de beaucoup la plus considérable, des formations alluvionnaires, que l’on peut appeler miocènes pour la commodité de l’exposition ; elles varient d’épaisseur et sans doute aussi de composition ; mais le sable libre est prédominant. Au sommet, des calcaires à silex, des poudingues à ciment travertineux, une croûte calcaire de formation subaérienne, et d’âge supposé pliocène, épaisse à peine de quelques mètres et très dure.
Au pied de l’Atlas, dans les hauts des O. Namous et R’arbi, cette croûte est restée intacte, scellant dans le sous-sol les sables miocènes, elle constitue la surface d’immenses hammadas nettes de dunes. A mesure qu’on s’avance vers le sud et qu’on se rapproche du niveau[52] de base, l’érosion plus active a déchiqueté la carapace, mettant en liberté les formations sableuses sous-jacentes, et l’erg commence.
En résumé, c’était une idée admise que l’allongement d’est en ouest et la disposition générale des grands ergs étaient en relation avec les vents dominants[37]. Les faits observés s’accordent mal avec cette hypothèse. Tout semble se passer comme si les grands ergs étaient à peu près en place, au point précis où le jeu de l’érosion, depuis le Miocène, avait accumulé les plus grandes masses de sable libre.
Il y a peut-être quelque impertinence à laisser aussi complètement à l’arrière-plan, dans une étude sur les dunes, le rôle propre du vent. Ce n’est pas assurément qu’on songe à méconnaître son importance, c’est qu’on a peu à ajouter à ce qui a été dit partout. Un point pourtant mériterait peut-être plus d’attention qu’on ne lui en a prêté d’ordinaire.
On sait comment la dune se comporte vis-à-vis de la chaleur solaire : elle l’emmagasine et la perd par rayonnement avec une quasi-instantanéité. Dans le jour, en été, la dune brûle, elle est inabordable pieds nus ; dès la tombée du jour, elle devient d’une fraîcheur délicieuse, tandis que les grandes masses rocheuses, les falaises de l’Ahnet par exemple, moins ardentes à midi, dégagent pendant la plus grande partie de la nuit une haleine de four, très pénible dans leur voisinage immédiat. Au campement d’Ouan Tohra, au pied d’une grande falaise gréseuse, le 7 juin à cinq heures du matin, le thermomètre marquait 33°, alors que, à un kilomètre de la falaise, il s’abaissait à 30°,8. Inversement dans l’erg er Raoui, au puits de Tinoraj, le 25 février à six heures du matin, l’eau contenue dans une cuvette à demi enfoncée dans le sable était gelée en bloc, un gobelet d’étain pris dans la glace y était si solidement fixé qu’on pouvait, avec l’anse du gobelet soulever la cuvette. Le thermomètre marquait cependant + 10° ; ce sont des effets comparables à ceux d’une machine à glace.
Cette instantanéité d’échauffement et de refroidissement est parfaitement expliquée par la porosité de la dune, qui multiplie sa surface d’absorption et de rayonnement. Quoique ces faits soient bien connus, je ne sais pas si l’on a suffisamment insisté sur leurs conséquences météorologiques probables.
Il s’ensuit en effet que, au Sahara, d’immenses espaces juxtaposés, ici région des grands ergs, là région des hammadas, doivent constituer,[53] au point de vue météorologique, des entités aussi distinctes et aussi opposées que, à la surface du globe, les mers et les continents. La distribution des grands amas de sable doit avoir une influence considérable sur la distribution des pressions barométriques, et on la retrouverait apparemment dans le dessin des isobares. On peut imaginer par exemple que, en été, une zone cyclonique de basses pressions s’établit sur l’erg, et inversement en hiver une zone anticyclonique de hautes pressions. C’est là assurément une hypothèse extrêmement hasardeuse dans l’état actuel de nos connaissances, mais elle cadre assez bien avec le petit nombre des faits connus. On sait que les équinoxes au Sahara sont violemment orageux, comme si d’été à hiver les conditions météorologiques générales s’inversaient brusquement. D’autre part, dans le Sahara algérien, ce sont assurément les vents d’est qui dominent ; dans le Sahara marocain, au contraire, d’après Lenz, ce sont les vents d’ouest. Il est donc possible que, de par l’existence même des ergs et la distribution des pressions barométriques qui en est le corollaire, les vents aient une tendance à tourbillonner autour de la région des dunes ; ce qui nous aiderait à comprendre qu’un certain état d’équilibre ait été atteint.
En tout cas, une étude détaillée de l’action du vent sur les ergs devrait être nécessairement appuyée sur des connaissances météorologiques précises et étendues, qui nous font encore tout à fait défaut. Il faut donc renoncer à insister davantage sur la part et le rôle du vent dans l’amoncellement des grandes dunes[38]. Il va sans dire que cette part et ce rôle sont énormes, et on n’a pas naturellement la prétention de contester que l’erg ne soit une formation éolienne.
Pourtant les effets de l’action éolienne ont été exagérés ; on lui entrevoit d’incontestables limites. En règle générale, les grandes masses de dunes sont en place, là où l’érosion fluviale en avait accumulé les matériaux. Vis-à-vis d’elles le vent ne semble avoir qu’une puissance insignifiante de déplacement. Il en a trié les éléments, et surtout il les a vannés, emportant au loin en poussière impalpable les éléments argileux qui ne peuvent faire tout à fait défaut dans un dépôt sédimentaire, et ne laissant subsister que les grains de quartz pur ; surtout il a créé le modelé, entassant ce qui était étalé. On n’a[54] pas la prétention d’établir là une loi qui s’applique à toutes les dunes et à tous les déserts du globe ; mais il semble bien que les choses se passent ainsi dans la partie du Sahara qui nous occupe. Nous sommes ici dans un désert tout jeune, au début d’une évolution péjorative, qui a commencé à la fin du Quaternaire, et dont l’homme a été le témoin.
Les dunes sont, en somme, le résultat d’un antagonisme direct, on dirait presque d’une lutte tragique entre le vent et les oueds, sur le champ clos restreint des dépôts alluvionnaires ; les dunes sont la maladie, et, pour ainsi dire, l’éléphantiasis dont meurent les oueds. La circulation superficielle est enrayée la première par l’obstacle mécanique des bourrelets de sable[39]. Puis toute la partie aval, ne recevant plus son contingent annuel de crues, tend à se dessécher, les alluvions se trouvent livrées sans défense par la sécheresse et la pulvérulence à l’action du vent, qui les éparpille, entassant ici une dune nouvelle, raclant ailleurs le sol jusqu’au roc, détruisant enfin la continuité du tapis alluvionnaire, c’est-à-dire le réservoir de la circulation souterraine. On saisit ainsi bien nettement le mécanisme de desséchement progressif à travers les siècles, sans qu’il soit nécessaire de faire entrer en ligne de compte la moindre aggravation du climat désertique.
Pour survivre en tant qu’habitat humain à la première apparition de ce climat de mort, la partie du Sahara qui nous occupe était bien outillée. Les puissantes ramifications de l’O. Messaoud étaient un monumental système d’irrigation naturelle susceptible de conduire les pluies de l’Atlas jusqu’au cœur du désert, jusqu’à Taoudéni. Et apparemment elles n’y ont failli qu’à la longue et progressivement, à mesure qu’elles s’engorgeaient. Si l’on en doute, qu’on songe à ce fait incontestable : des crues alimentées par les pluies de l’Atlas entre Figuig et Aïn Chaïr, en suivant le chenal de l’O. Saoura, parvenaient il y a cinquante ans à Haci Boura, il y a dix ans à Tesfaout. Mais l’O. Saoura est le seul, entre tant de fleuves puissants, qui soit resté à peu près libre de sable. Qu’on imagine le centre d’attraction et de vie qu’a dû être l’O. Messaoud, lorsqu’il colligeait toutes les pluies de l’Atlas entre Laghouat et l’O. Draa ! Un souvenir de cette époque meilleure s’est conservé dans la mémoire des indigènes, et, semble-t-il, dans le nom même de l’O. Messaoud, le « bienheureux ». Que le lit de l’O. Messaoud ait constitué jadis une route accessible jusqu’à Taoudéni aux bourriquots chargés de dattes, voilà qui n’est plus[55] si invraisemblable, et cette légende pourrait bien être un souvenir.
Lors de la conquête de l’Algérie, cette puissante barrière de grands ergs, entrevue au sud de l’Atlas, passait pour infranchissable ; elle ne l’est pas à coup sûr à la circulation des caravanes, mais c’est pourtant bien une barrière, qui coupe au cœur du Sahara sa part d’humidité et de vie. Or, elle s’est édifiée lentement et grain à grain, elle n’a pas atteint du premier coup son étanchéité actuelle. Encore aujourd’hui elle a son point faible, la brèche de la Saoura. Qui sait à quelle époque peut-être récente d’autres brèches bienfaisantes se sont obstruées définitivement ?
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XI. |
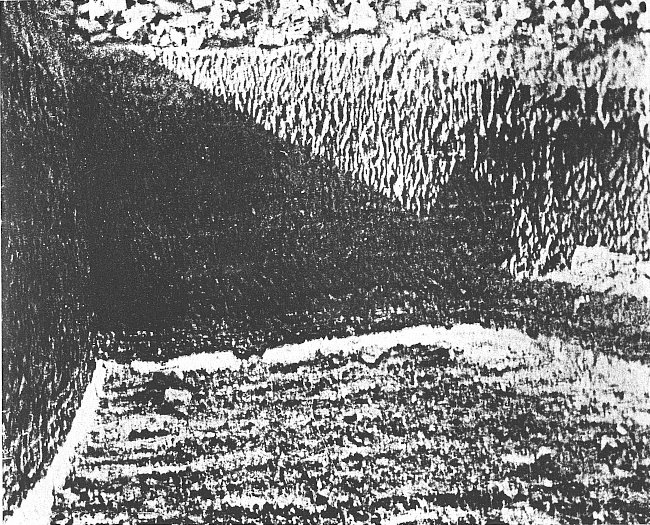
Cliché Cauvin
21. — UN TROU D’EXPLOITATION A TAOUDÉNI
Au sommet les déblais ; au-dessous couches d’alluvions ; au fond le banc de sel.
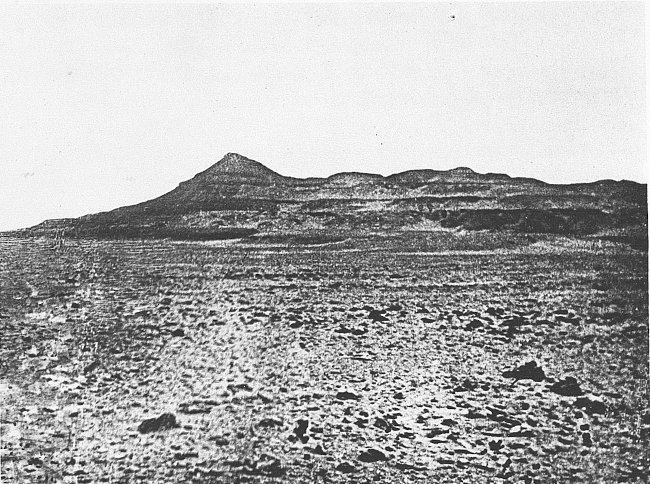
Cliché Cauvin
22. — LA FALAISE D’ÉROSION QUI LIMITE LA CUVETTE DE TAOUDÉNI.
III. — Taoudéni.
Sur l’O. Messaoud et ses dunes, dans les pages qui précèdent, on a coordonné des observations recueillies sur le terrain. Dans les lignes qui suivent, on essaiera de systématiser un tout petit nombre de faits, de renseignements indigènes et de probabilités, qu’il serait plus sage d’appeler des conjectures, sur un immense pays inexploré. C’est une entreprise qui a son côté dangereux, on ne se le dissimule pas. Mais, d’autre part, il paraît impossible de ne pas formuler sommairement quelques hypothèses très simples, qui se présentent naturellement à l’esprit, et qui cadrent avec tous les faits connus.
Au nord-ouest de Tombouctou s’étend le Djouf, qu’on nous représente comme une immense cuvette, couverte de dunes.
En relation avec ce Djouf paraissent être de nombreuses mines de sel, Taoudéni, Trarza, les salines beaucoup plus occidentales de Tichitt qui alimentent le commerce d’Oualata et de Nioro. Elles sont encore peu connues : Caillié a vu Trarza, le lieutenant-colonel Laperrine et le capitaine Cauvin ont vu Taoudéni. Les produits de l’extraction sont, en revanche, très répandus au Soudan, de longues dalles minces d’un facies uniforme, quelle qu’en soit la provenance.
Quel est l’âge de ce sel ? Par analogie avec l’Algérie, qui est il est vrai, bien lointaine, on pourrait par exemple le supposer, a priori, triasique. Mais il faut avouer qu’il est beaucoup plus naturel d’y voir un dépôt récent[40].
Le lieutenant Cortier, compagnon du capitaine Cauvin, a décrit avec une netteté minutieuse la succession des couches dans les[56] trous d’exploration à Taoudéni[41]. Elles sont parfaitement horizontales.
Au sommet, une couche d’argile, pétrie de gypse en fer de lance, mélangée de cristaux de sel, rouge et passant au vert en profondeur. Cette couche argileuse, de 5 à 6 mètres de puissance, repose sur une première couche de sel compact, épaisse de 0 m. 25 à 0 m. 30. Ces deux premières couches sont bien visibles, au-dessous des déblais, sur la photographie ci-jointe, due à l’obligeance du capitaine Cauvin. (Voir pl. XI.)
Au-dessous, on rencontre deux autres couches de sel interstratifiées de faibles épaisseurs d’argile, quelques centimètres. Et plus bas encore on pourrait exploiter d’autres couches de sel, mais « dès que la troisième est enlevée, l’eau jaillit de toutes parts ».
Les gros commerçants maures, qui ont ce qu’on pourrait appeler l’entreprise de l’exploitation, Mohammed Béchir, par exemple, que j’ai pu interroger à Tombouctou, insistent beaucoup sur ces infiltrations d’eau, qui mettent au travail un gros obstacle, inattendu au Sahara. Ils ajoutent que dans les excavations inondées et abandonnées la couche de sel exploitée se régénère elle-même dans la saumure et redevient à la longue exploitable. Enfin les indigènes ont affirmé au lieutenant Cortier avoir trouvé « dans l’argile mêlée de sel des ossements et des empreintes d’hippopotames et de caïmans ». La description du lieutenant Cortier, illustrée par la seconde photographie ci-jointe du capitaine Cauvin, permet d’imaginer aisément la morphologie du pays. Les salines tapissent le fond d’une cuvette entourée de tous côtés par des falaises et des garas ; une photographie représente la gara qui surplombe Taoudéni. (Voir pl. XI.) Dans cette cuvette un grand oued, au lit humide, l’O. Telet, débouche dans « des gorges sauvages ».
La petite cuvette de Taoudéni est inscrite dans une autre beaucoup plus grande, qui est la partie orientale du Djouf. Le long de l’itinéraire Cauvin, la limite méridionale du Djouf, à cent kilomètres au sud de Taoudéni, est marquée par la falaise de Lernachich, haute de 80 mètres et longue de 140 kilomètres. Tout ce qui a été vu du Djouf est sculpté de falaises et de garas.
Comme Lenz l’avait déjà signalé, le Djouf oriental est moins élevé que Tombouctou d’une centaine de mètres, mais la cuvette de Taoudéni est le point le plus déprimé, en contre-bas d’une soixantaine de mètres.
[57]En somme, ce que le Djouf oriental, tel qu’on nous le décrit, a de plus caractéristique, c’est son modelé. Toutes ces falaises sont de composition identique, une alternance de grès et d’argiles en couches horizontales. Il serait dangereux de rechercher l’âge de la formation ; peut-être doit-on dire pourtant qu’un échantillon de grès envoyé au Muséum contient des sphéroïdes, au vu desquels on n’hésiterait pas à le proclamer albien s’il avait été trouvé au Touat (grès à sphéroïdes du Touat et du Gourara).
Quel que soit l’âge de cette formation, ce qui est évident en tout cas, c’est qu’elle a été sculptée par une érosion énergique et jeune.
D’autre part, les salines sont exactement là ou on pouvait attendre un chott, au point le plus déprimé, dans une cuvette où débouche un oued ; elles sont encore humides ; les bancs de sel alternent avec des couches d’argiles gypseuses et salées ; tout cela cadre bien avec l’hypothèse d’une cuvette qui aurait joué, pour un grand oued venu de l’est ou du nord-est, le même rôle que le Melr’ir et le Djerid tunisien pour l’Igargar.
Sur cette cuvette nous avons par ailleurs des renseignements, et nous serons conduits à formuler des hypothèses qu’on doit se borner ici à indiquer sommairement[42]. On sait qu’une mer crétacée et tertiaire a couvert le Soudan jusqu’au Tchad et jusqu’à Bilma. Un dernier reste de cette Méditerranée africaine a subsisté dans l’ouest jusque dans la première période de l’âge quaternaire (?) ; elle a laissé des fossiles pléistocènes marins (marginelles et colombelles) sur le pourtour méridional du Djouf, de Tombouctou à la Maurétanie. Il semble donc que l’oued Messaoud a dû s’y jeter, comme d’ailleurs à coup sûr le Niger.
D’autre part, le coude du Niger, d’un dessin si particulier, et qui ramène les embouchures du grand fleuve sous le parallèle de ses sources, semble résulter d’une capture récente. Autrefois, et peut-être jusqu’à une époque récente, historique, le Niger coulait au nord et se déversait dans le Djouf, par le lac Faguibine, la vallée bien marquée de Ouallata, et les salines de Tichitt (?). Sur cet ancien Niger on retrouve au Soudan des souvenirs un peu légendaires, comme au Touat sur l’ancien oued Messaoud. Le vieux lit d’ailleurs n’est pas encore complètement mort, il achève de s’assécher sous nos yeux avec le lac Faguibine.
Ainsi donc cette cuvette basse du Djouf, ancienne mer pléistocène, aurait été le réceptacle commun de toutes les eaux descendues de[58] l’Atlas au nord et du Fouta-Djallon au sud. Le Niger et l’oued Messaoud y auraient voisiné, établissant ainsi une ligne de verdure et de vie à travers tout le Sahara, et précisément dans la région aujourd’hui la plus désolée. A cette hypothèse la zoologie apporte une confirmation. M. Germain (appendice X) signale au Touat et au Hoggar une coquille Planorbis salinorum, qui n’avait été trouvée jusqu’ici que dans les ruisseaux de l’Angola. Au sud comme au nord le désert semble repousser les fleuves et les force à rétrograder vers leurs sources ; il a conquis ainsi récemment de grandes régions qui devaient leur vie aux pluies lointaines, acheminées par les fleuves, comme l’Égypte aux pluies d’Abyssinie canalisées par le Nil. Depuis que l’humanité a des annales, c’est-à-dire depuis 2000 ou 3000 ans, on n’a jamais constaté avec certitude un changement de climat, en particulier sur les bords de la Méditerrannée, si proches et si dépendants du Sahara.
Quand nous nous trouvons en présence de témoignages qui semblent indiquer un progrès récent et considérable du désert, il est donc difficile d’invoquer une péjoration du climat ; mais il est certainement permis de supposer un processus mécanique, et non pas climatique de desséchement.
Que le Sahara ait pu voir s’accomplir, à une date peu reculée, de pareils bouleversements du régime hydrographique, il est naturel qu’on éprouve quelque répugnance à l’admettre, et il est facile de concevoir en effet que, sommairement exposés, ils semblent fâcheusement romanesques. C’est, je crois, qu’on n’a jamais mis en lumière la véritable origine et le rôle des dunes. Qu’en Chine, l’embouchure du Hoang-ho se soit déplacée de 500 kilomètres, on n’en est pas surpris parce que l’instabilité des alluvions deltaïques est un phénomène classique pour les morphologistes. Ils ne se rendent pas compte que les sables désertiques, dont la mobilité dangereuse n’a pas besoin d’être démontrée, ont avec le régime hydrographique des rapports exactement aussi étroits que les alluvions, puisque ce sont précisément des alluvions desséchées. Dans un pays en voie de desséchement désertique, les fleuves ont dans les sables de leurs lits et de leurs cuvettes les germes d’une maladie progressivement et rapidement mortelle. Du moins a-t-on essayé de le démontrer.
Ajoutons enfin que cette maladie est particulièrement grave dans un pays comme le Sahara, où les oueds, même quaternaires, semblent bien avoir abouti pour la plupart à des cuvettes fermées. Ainsi que le fait observer avec raison M. Chudeau, « lorsqu’un[59] fleuve arrive à la mer, les sédiments qu’il y dépose ont un volume relatif trop faible pour agir rapidement sur le niveau de base. Il n’en est plus de même dans un bassin fermé ; le niveau de base se surélève constamment ; la pente des fleuves devenue de plus en plus faible ne leur permet plus de lutter contre l’ensablement d’une manière efficace ; en même temps les marécages qui, en pays plat, sont si fréquents dans les parties basses des vallées, remontent constamment vers l’amont, donnant naissance aux maaders », aux sebkhas, et aux regs.
[12]Lieutenant Niéger, Levé d’itinéraire (Bulletin du Comité de l’Afr. fr., Supplément de février 1905, p. 53).
[13]Voir la carte (hors texte) et l’appendice I, p. 339.
[14]Le sergent Fremigacci avait vu H. Boura et H. Rezegallah, et fait dit-on à ses supérieurs sur l’O. Messaoud des rapports oraux qui n’ont pas réussi à forcer l’attention. (Cf. Mussel dans Bulletin du Comité de l’Afr. fr., août 1907, p. 311.)
[15]S’écrit aussi Djaghit, ou Djagteh.
[16]Voir les cartes (hors texte) et l’appendice I, p. 339.
[17]S’écrit aussi Tikkiden (Niéger) ? Voir l’orthographe tifinar’ dans l’appendice IV, p. 350.
[18]On trouvera en appendice l’orthographe exacte en tifinar de Azelmati. C’est sans doute une racine berbère. Les Arabes en donnent une étymologie qui est imaginaire mais caractéristique az-zell-mat : qui s’égare périt ; dans cette immense étendue sans points de repère le voyageur qui perd la direction est condamné à mort.
[19]Nos carnets météorologiques, contenant les cotes barométriques, sont à l’étude au bureau météorologique central. Les conclusions seront publiées dans le second volume.
[20]M. le capitaine Mussel a dressé une carte de l’erg, dont je dois la communication à l’obligeance de l’auteur et à celle de M. de Flotte-Roquevaire. Je suis heureux de voir que M. Mussel à la suite d’une longue campagne dans les dunes, se range au point de vue qu’on a essayé de défendre dans ce chapitre. C’est une confirmation précieuse de sa justesse (voir Bulletin du Comité de l’Afr. fr., août 1907).
[21]Capitaine Flye Sainte-Marie. Dans l’ouest de la Saoura. Une reconnaissance vers Tindouf (Renseignements col. et documents Comité Afr. fr..., XV, 1905), p. 534.
[22]Voir la carte du Maroc par de Flotte de Roquevaire, 1 : 1000000 (Paris, 1904).
[23]Niéger, art. cité, p. 482.
[24]Communication orale de M. Niéger.
[25]Canis Zerda L.
[26]Supplément au Bulletin du Comité de l’Afrique française d’avril 1907, p. 77 et 90.
[27]Supplément au Bulletin du Comité de l’Afrique française de juin 1907.
[28]Id., p. 143.
[29]Le pluriel de foggara est fgagir, mais on évitera de l’employer.
[30]E. Reclus dans H. Schirmer, Le Sahara (Paris, 1893), p. 159.
[31]A. de Lapparent, Traité de Géologie (5e édition, Paris, 1906), p. 149.
[32]Bull. Comité Afr. fr., supplément de décembre, 1905, p. 534.
[33]A. de Lapparent, ouvr. cité, p. 150.
[34]Inutile de mentionner, autrement que pour mémoire, l’hypothèse manifestement erronée du capitaine Courbis (voir H. Schirmer, Le Sahara, p. 158, note 5).
[35]Elisée Reclus, Nouvelle Géographie universelle, XI (Paris, 1886), p. 792.
[36]A. de Lapparent, ouvr. cité, p. 151 (d’après J. Walther).
[37]A. de Lapparent, ouvr. cité, p. 150.
[38]Dans cet ordre d’idées, je renonce à tout développement au sujet des dunes parlantes, ou plutôt ronflantes, souvent étudiées (Girard, Évolution comparée des sables, 1903). Je mentionne seulement que la dune ronfle au poste de Tar’it, avec le bruit d’une batteuse à blé et aussi, je crois, au poste de Beni Abbès. Il serait intéressant de savoir si l’état de l’atmosphère et la direction du vent ont une influence sur le phénomène. Nous avons entendu la dune crier sous nos pas, avec une voix toute différente, dans un entonnoir de sable à pentes raides, au nord d’In Ziza.
[39]Voir déjà là-dessus : G. Rolland, Hydrologie du Sahara algérien (Documents relatifs à la mission dirigée au sud de l’Algérie par M. A. Choisy, tome III, 1895), p. 31.
[40]M. G.-B.-M. Flamand, d’après les notes et les échantillons de M. Niéger, conclut à un âge quaternaire probable.
[41]Lieutenant Cortier, De Tombouctou à Taoudéni (La Géographie, XIV, 15 décembre 1906, p. 329).
[42]On en donnera le détail dans le second volume consacré au Soudan ; voir d’ailleurs : Annales de Géographie, 15 mars 1907, p. 129.
[60]CHAPITRE III
ETHNOGRAPHIE SAHARIENNE
Dans les pages qui suivent on a essayé d’exposer les résultats ethnographiques du voyage.
Les documents étudiés se classent en trois catégories — monuments rupestres (surtout des tombeaux) — gravures rupestres — armes et outils néolithiques.
I. — Les Tombeaux (Redjems).
Dans toute la zone parcourue — Sud-Oranais et Sahara — il n’y a pas de monuments mégalithiques de la catégorie dolmens. A tout le moins il n’en a jamais été signalé. Notons pourtant que Duveyrier a dessiné auprès de R’adamès un « cist » analogue à ceux qui ont été décrits à Djelfa en compagnie de dolmens[43]. Mais R’adamès appartient encore au Sahara littoral.
On a signalé d’autre part quelques pierres debout. Foureau en a photographié une[44], qui surmonte une tombe, et à propos de laquelle il note : « Je n’ai jamais rencontré au Sahara de sépulture comportant un tel monolithe. » Pour rare qu’il soit le fait n’est pas isolé ; Chudeau signale à Tit deux monolithes de ce genre, l’un associé à une tombe (fig. 3C), et l’autre isolé mais dans une sorte de champ funéraire (fig. 2B) ; M. Benhazera en a vu une dizaine groupés près de la gara de Tilketine, aux sources de l’oued In Dalladj, dans la koudia du Hoggar[45]. M. Benhazera a noté sur deux d’entres elles des inscriptions tifinar’. Il mentionne leurs dimensions moyennes,[61] « une hauteur de 2 m. 60 et une largeur de 25 centimètres environ sur chacune de ses quatre faces unies et lisses » ; ce dernier trait laisserait croire qu’on est en présence d’un fragment de colonnade basaltique ; Motylinski signale au Hoggar l’usage ornementatif de semblables fragments[46]. Chudeau a observé de même la médiocre épaisseur des monolithes à Tit, une quinzaine de centimètres de diamètre ; et la pierre debout figurée par Foureau est évidemment de même type. Ces colonnettes minces, qui portent parfois des inscriptions, et qui sont fréquemment associées à des tombeaux, font songer à des stèles funéraires barbares. Dans l’état de nos connaissances le rapprochement ne saurait être une explication. Du moins peut-on affirmer, je crois, que ces pierres debout, d’ailleurs très rares, ne sont pas des menhirs, au sens usuel du mot. Elles n’ont pas de rapport avec les énigmatiques Esnamen de R’adamès dessinés par Duveyrier.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XII. |

Cliché Gautier
23. — GRAND REDJEM DU TYPE LE PLUS FRUSTE
Nord d’Aïn Sefra (A de Teniet R’zla).
Une tranchée l’entaille jusqu’au sol.

| Phototypie Bauer, Marchet et Cie, Dijon | Cliché Gautier |
24. — REDJEM B D’AÏN SEFRA (dj-Mekter)
Après les fouilles, qui ont donné un mobilier en cuivre et en fer.
On voit éparses autour de l’orifice les dalles qui constituaient la chambre funéraire.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XIII. |

Cliché Gautier
25. — REDJEM D DE BENI-OUNIF pendant les fouilles.
Autour de l’orifice, dans lequel un ouvrier est accroupi, on distingue les écailles de grès fixées dans le sol.

Cliché Gautier
26. — CIMETIÈRE ACTUEL (Charouïn)
On distingue, aux extrémités de chaque tombe, les deux pierres debout (chehed), comme aussi les cruches cassées et les écuelles funéraires.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XIV. |

Cliché Laperrine
27. — CERCLE DE SACRIFICES (?)
Menhirs, comme dolmens, sont donc inconnus au Sahara, où pourtant les matériaux pour les édifier abondent, gneiss, quartzites, grès, qui se débitent facilement en grandes dalles. C’est une lacune significative. Car les dolmens abondent au contraire dans toute la zone méditerranéenne, de Tanger à l’Enfida tunisienne[47].
En revanche, sur tout l’immense parcours, d’Aïn Sefra jusqu’au Niger, on rencontre, pour ainsi dire à chaque pas, des sépultures qui rentrent toutes dans la même catégorie, celle des redjems.
La dénomination de redjem (pluriel ardjem) a été adoptée par M. le Dr Hamy ; elle est donc déjà connue et il y a tout intérêt à la conserver ; d’ailleurs il n’en existe pas d’autre. Les sépultures de ce genre ont été l’objet déjà de bien des travaux, on les a désignées presque toujours sous la double dénomination de bazina et de chouchet, dont chacune désignait une variété particulière[48] ; mais il y a certainement intérêt à réunir ces variétés diverses dans une catégorie unique à laquelle il faut donner un nom.
Une observation préliminaire s’impose pourtant. Le mot redjem, en arabe vulgaire, s’applique à tout tas de pierres, quel qu’il soit, à ceux qui ont un caractère de signal, jalonnant le chemin ou marquant l’emplacement d’un puits, ou encore un caractère religieux[49], à ceux mêmes qui ont été dressés par les géodèses du service topographique,[62] tout aussi bien qu’à ceux qui sont en réalité des tombeaux, mais qui d’ailleurs, très fréquemment, n’en ont pas l’air. A vrai dire, la plupart des indigènes ne soupçonnent pas que ces tas de pierres puissent éventuellement recouvrir un cadavre, et, lorsqu’on fouille, l’apparition des ossements provoque toujours une stupeur chez les ouvriers.
Il est donc bien entendu que nous employons le mot redjem dans un sens détourné de celui qu’il a en arabe, les redjems dont il s’agit sont exclusivement les funéraires.
Distribution. — L’énumération des points où j’ai constaté la présence de redjems est assez longue.
Il s’en trouve tout autour d’Aïn Sefra, non seulement un groupe important à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest du village, au pied du djebel Morghad[50], et un autre à cinq kilomètres au sud-est sur les premières pentes du djebel Mekter, mais encore en bien d’autres points de la vallée.
Le Dr Hamy, d’après M. de Kergorlay, en signale à proximité de l’oasis de Mograr Tahtani.
J’en ai relevé auprès de Beni Ounif, de Ben Zireg, de Bou Yala, de Fendi, auprès du puits de Haci el Aouari, auprès de Colomb-Béchar, à Ménouarar, le long de la Zousfana à Ksar el Azoudj, et en particulier auprès de Zaouia Fokania ; j’en ai relevé auprès de Guerzim et de Ouarourourt dans l’oued Saoura, dans la chaîne d’Ougarta au voisinage de l’erg er Raoui, entre Ksabi et Charouin, au pied de la gare Zaledj non loin du puits de Mallem.
Je n’en ai pas vu, encore que j’en aie cherché, auprès des ksars « actuels » du Touat, qu’il y a de bonnes raisons, il est vrai, de croire très récents, mais on en trouverait au dire des indigènes, auprès des « anciens » ksars, situés à quelques kilomètres à l’est de la palmeraie.
Il en existe auprès de Haci Rezegallah.
Les redjems sont fréquents dans l’Ahnet ; je cite en particulier les groupes de Taloak et de Ouan Tohra que j’ai étudiés.
Il en existe à In Ziza, et on les retrouve nombreux dans l’Adr’ar des Ifor’ass, en particulier dans les oueds In Ouzel, Taoudrart, Tougçemin où j’ai fait séjour ; j’en ai d’ailleurs noté au passage tout le long de mon itinéraire, au pied de l’Açeref, dans l’oued Koma, dans l’oued Ebedakad, dans l’oued Kidal, au puits de Tabankor ; je[63] crois en avoir vu sous bénéfice d’inventaire, c’est-à-dire de fouilles qui n’ont pas été faites, jusque sur les bords du Niger, au Tondivi. D’ailleurs le lieutenant Desplagnes mentionne des redjems au Soudan nigérien[51].
Chudeau en a relevé un grand nombre au Hoggar et Motylinski dans la Koudia ; comme Duveyrier et Foureau dans le Tassili des Azguers. M. Chudeau en signale dans le Tassili de l’oued Tagrira, à In Azaoua, dans l’oued Tidek et aux environs d’Iferouane, à Takarédei (20 kilomètres nord-ouest d’Agadès), et au puits d’Assaouas (50 kilomètres au sud-ouest d’Agadès). Il en signale encore dans l’Adr’ar de Tahoua, surtout entre Tahoua et Matankari. Le capitaine Pasquier en a vu entre Gao et Menaka[52].
En revanche M. Chudeau croit que les redjems font tout à fait défaut dans la région de Zinder et du Tchad (Tegama, Damergou, Alakhos, Koutous).
En somme, dans les grandes lignes, leur distribution coïncide avec celle des Berbères ; les redjems disparaissent dès qu’on arrive dans les pays Haoussa et Bornouan.
Dans ces limites, leur répartition suggère un certain nombre d’idées générales.
Et d’abord, l’énumération des points déterminés où j’ai trouvé des redjems est en même temps celle des points où les hasards de la route m’ont imposé un séjour un peu prolongé. Le Touat mis à part, partout où je me suis arrêté quelques jours, une courte promenade autour du campement ou du village m’a permis de relever des redjems en assez grand nombre. Souvent aussi j’en ai rencontré sous mes pas, en cours de route, alors que je ne les cherchais pas, nouvelle preuve de leur extrême fréquence. Je dirais presque qu’ils sont partout.
D’autre part ils ne sont jamais groupés en très grand nombre, quelques dizaines tout au plus et souvent quelques unités. Rien de comparable aux grandes nécropoles du Tell avec leurs milliers de tombes.
Cette distribution suggère l’idée que ce sont des sépultures de nomades.
Très certainement aussi il y a un rapport entre les redjems et les points d’eau actuels. Je n’en ai jamais noté dans les étendues franchement désertiques et inhabitables. On verra qu’il en est tout autrement pour bien des gisements néolithiques, et nous sommes[64] donc amenés à conclure d’ores et déjà que les redjems ne peuvent pas remonter à une antiquité très reculée.
Il est remarquable pourtant qu’ils sont très rares non seulement au Touat, mais encore dans l’oued Saoura ; je n’y ai vu qu’un tout petit nombre de redjems, encore bien que j’aie fait séjour à Beni Abbès et à Ksabi. J’en ai rencontré davantage dans la chaîne d’Ougarta où je n’ai fait que passer. On sait pourtant que, actuellement, toute la population est concentrée dans l’oued Saoura et au Touat. Il semble donc que la répartition des redjems nous reporte à une époque où la population était distribuée à la surface du Sahara tout autrement qu’aujourd’hui.
Terminus ad quem. — Aussi bien n’est-il pas possible de considérer les redjems comme des sépultures contemporaines, par la simple raison que, à coup sûr, elles ne sont pas musulmanes.
Les tombeaux musulmans sont aisément reconnaissables ; on sait que le cadavre est étendu, la figure tournée vers la Mecque ; à la tête et aux pieds se dressent des stèles grossières, qui ne peuvent guère faire défaut parce qu’elles ont une signification religieuse ; ce sont les « témoins » de la foi (Chehed) ; il est vrai que les Touaregs sont des musulmans tièdes. (Voir pl. XIII, phot. 26.)
Dans les redjems au contraire, toutes les fois que les ossements n’ont pas été réduits en poussière par le temps, on constate que le squelette est replié sur lui-même, à l’ancienne mode libyque signalée par les auteurs anciens.
Les redjems sont donc nécessairement préislamiques, ce qui ne signifie pas nécessairement antérieurs à l’hégire, l’islamisme ayant pénétré et surtout s’étant enraciné définitivement au Sahara à une époque qu’on ne peut pas, j’imagine, fixer partout avec précision. M. Benhazera, pourtant, s’appuyant sur Ibn Khaldoun et sur les traditions indigènes, essaie d’établir que les Touaregs ont été islamisés au XIe siècle[53].
Terminus a quo. — D’autre part je crois bien que les pauvres mobiliers funéraires trouvés dans les ardjem nous permettent de fixer un terminus a quo. En voici l’énumération. (Voir pl. XV, phot. 28 et 29.)
Aïn Sefra. — Un redjem A situé à Teniet R’zla (Feidjet el Betoum de M. le Dr Hamy) ne contenait qu’un ornement en os travaillé,[65] « un disque plat et poli, de forme ovale raccourcie, qui mesure 35 mm. sur 30 ». (Voir phot. 29, au centre de la figure.) Pas d’objets en métal, un certain nombre de silex peut-être taillés, mais trop rudimentaires et trop communs pour qu’on les considère avec certitude comme partie du mobilier funéraires.
Un redjem B situé au sud-est d’Aïn Sefra (djebel Mekter) a livré le mobilier le plus riche que j’aie rencontré au cours de mes fouilles, et sans doute ce n’est pas beaucoup dire. Aux pieds du squelette « un robuste outil de fer, bien conservé, long de près de 0 m. 18, dilaté aux deux bouts en prismes à quatre plans et terminés en pointes, de façon à rappeler la forme des carrelets actuels ». A cette description qui est du Dr Hamy, j’ajouterai que le milieu de l’« outil » semble avoir été recouvert d’une gaine en cuir (?) ou en bois (?) semblant constituer une poignée. Au voisinage des deux pointes, qui sont de longueur inégale, on distingue des intumescences de coloration plus claire, bien visibles sur la photographie qui semblent être une trace laissée par les extrémités de la gaine. J’ajoute aussi que les archéologues n’ont pas pu identifier cet outil. (Voir phot. 28 sur le bord droit de la figure.)
A côté se trouvaient des débris, assez cohérents au moment de l’exhumation, de ce que j’estime avoir été un fourreau cylindrique, apparemment celui de l’outil ; notons cependant que M. Hamy a cru y reconnaître une douille de lance ou de javeline. (Voir phot. 28, sur le bord gauche et en bas.)
Dans la même partie de la tombe un tout petit annelet de cuivre, gros comme une perle, ayant apparemment servi d’ornement à l’outil ou à son fourreau.
Dans un autre coin mal déterminé, une tige de fer terminée par une sorte de spatule triangulaire, mais qui faisait avec la tige un angle de 45°. Serait-ce un grattoir ? Et l’outil en forme de carrelet serait-il un perçoir ? outil à l’usage des nomades qui employaient beaucoup le cuir ? M. Hamy semble considérer la tige de fer à bout en spatule comme un débris de javeline (?)
Ce qui importe après tout, c’est que ces objets, si difficiles à identifier, déformés par la rouille, sont incontestablement en fer.
Dans un autre coin du tombeau, auprès des os de l’épaule et de la main, qui se touchent :
Deux bagues de cuivre, une « plaque de ceinture en cuivre de forme carrée, longue, ornée sur son pourtour d’un fin pointillé repoussé, et fixée par deux clous en fer, dont l’un est encore adhérent à son rivet de cuivre circulaire et aplati » : la plaque a 2 cm.[66] sur 5 ; son attribution à une ceinture est naturellement hypothétique. (Voir phot. 28 sur le bord gauche et en haut.)
Dans la même région d’Aïn Sefra (dj. Mekter) M. le capitaine Dessigny a fouillé d’autres tombeaux, une quarantaine. Dans le plus remarquable il a trouvé, à la hauteur du cou, « 81 petites rondelles aplaties et percées au centre, mesurant 5 mm. de diamètre ». Au milieu de ces rondelles, qui ont été découpées dans la coque d’œufs d’autruche, « se détache une perle de cornaline de forme sphérique, aplatie, large de 8 mm., haute de 5, deux autres grains lenticulaires en verre irisé » ; « un autre collier, porté par le même personnage, était fait d’une lamelle de cuivre très étroite (1 mm.), tordue en spirale allongée ; la partie conservée mesure environ 8 mm. 13 de longueur ». (Voir phot. 29 au centre de la figure.)
Dans d’autres tombeaux voisins, M. le capitaine Dessigny a trouvé deux « bracelets d’argent, ouverts, formés d’une simple tige de 3 à 4 millimètres d’épaisseur, courbés de façon à laisser 40 à 42 millimètres d’ouverture ; un bracelet de cuivre de même forme et de mêmes dimensions, mais plat à l’intérieur et orné sur les bords de fines striations ; cinq bagues ouvertes, de cuivre et d’argent, cylindriques et un peu renflées vers le milieu, ou en forme de lame plate ou un peu convexe (une de ces bagues se ferme à l’aide de deux petits crochets recourbés). (Voir phot. 28.)
Enfin des colliers encore, surtout de rondelles d’œuf d’autruche. L’un se compose de 522 rondelles (dont le diamètre varie de 6 à 11 mm.) ; il mesure plus de 0 m. 90 ; un autre « en a 475 et dépasse 0 m. 72 » ; « un troisième n’atteint plus que 0 m. 15 avec 85 disques ». Un dernier collier est composé « de cornalines, une perle lenticulée de pâte de verre, une autre perle en pierre verte, et deux petits disques de coquilles ; c’est un grossier collier d’enfant ». (Voir phot. 29.)
Beni Ounif. — C’est à Aïn Sefra qu’ont été faites les fouilles de beaucoup les plus nombreuses, grâce au zèle de M. le capitaine Dessigny, comme aussi les plus fructueuses.
A Beni Ounif un redjem C ne contenait qu’un silex nettement taillé, de la forme d’une pierre à fusil ; un autre D contenait un grand collier de 360 rondelles d’œuf d’autruche, et des débris en très mauvais état d’une tige en fer, courbée (?) ; un autre E un collier d’environ 120 rondelles d’un diamètre beaucoup plus petit que les précédentes. Est-il utile de mentionner que les indigènes chez qui l’usage du collier est tout à fait tombé en désuétude,[67] prennent ces colliers pour des chapelets ? Il est tout à fait impossible, répétons-le, vu la disposition intérieure et extérieure des tombeaux, de leur supposer un caractère musulman.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XV. |
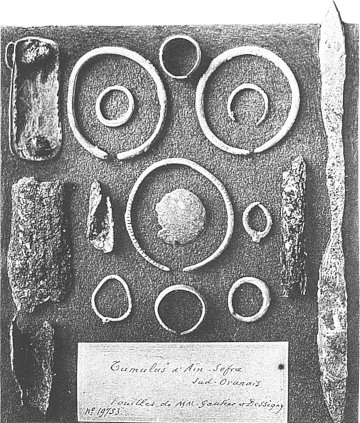
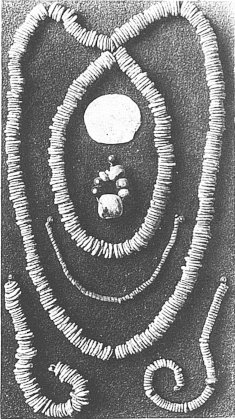
Clichés du Muséum
28 et 29. — MOBILIERS FUNÉRAIRES trouvés dans des régions d’Aïn Sefra et de Beni-Ounif.
(Fer, cuivre, argent, coquille d’œuf d’autruche, verroterie).

Cliché Gautier
30. — GRAVURE RUPESTRE DE BARREBI (oasis des Beni-Goumi)
sur des grès supposés dévoniens ou infra-dinantiens.
La figure principale représenterait un bovidé (?) ou un gnou (??).
Dans la région de Tar’it, en amont de Zaouia Fokania, auprès de la petite palmerie d’Haouinet, j’ai fouillé deux redjems. Dans l’un F, j’ai trouvé des débris de fer. Dans l’autre G un grain de collier (?) en pierre percée, une très jolie pointe de flèche en silex sans pédoncule, une quinzaine de silex de formes très incertaines, qui pouvaient à la rigueur passer pour taillés. Ces deux redjems sont voisins, font partie du même groupe, ont la même structure et semblent contemporains.
A Taloak j’ai trouvé dans un redjem H qui contenait d’ailleurs desossements remarquablement conservés, pour tout mobilier, des débris d’une poterie semblant faite au tour et qu’on aurait pu croire moderne.
A Ouan Tohra enfin la fouille du redjem I a donné un mobilier funéraire intéressant ; des débris de cuir, deux perles de cornaline, des débris de fer, trois plaques de cuivre, tout à fait identiques de forme, et analogues de dimensions à celle du redjem B d’Aïn Sefra[54].
Ouan Tohra est dans l’Ahnet tout près de sa limite sud, au cœur du Sahara, à 600 kilomètres d’Aïn Sefra. Il est curieux qu’on trouve à de pareilles distances l’un de l’autre deux tombeaux fournissant le même mobilier.
Je n’ai mentionné que les tombeaux qui ont donné quelque chose ; une fois sur deux au moins je n’ai trouvé que des débris d’ossements et quelquefois rien.
En résumé, ce qui frappe, c’est la rareté relative des silex taillés. Il est vrai que d’autres chercheurs semblent avoir été plus heureux que moi ; M. le capitaine Normand à Ksar el Azoudj et à Fendi, M. le capitaine Ihler à Moungar n’ont trouvé dans les redjems, outre les pièces de collier du type habituel, que des silex taillés, pointes de flèche sans pédoncule. Je ne crois pas qu’on puisse considérer ces quelques pièces comme preuve d’une haute antiquité. Presque tous les silex que j’ai trouvés moi-même pouvaient être classés débris d’atelier, les pointes nettes et finies sont extrêmement rares (une seule en somme dans le redjem G d’Haouinet). Je ne[68] sache pas qu’on ait jamais trouvé dans les redjems une seule hache en pierre polie.
Les débris de silex sont parfois si abondants, en vrac sur le sol, qu’on n’échappe jamais complètement au soupçon que leur présence dans le redjem est tout à fait fortuite ; ils ont pu y être jetés avec les matériaux de remplissage au moment des funérailles. Si même ils ont fait partie du mobilier, il ne faut pas se dissimuler que, au Sahara, l’usage des outils ou des armes en silex s’est conservé certainement jusqu’à une époque toute récente, extrêmement postérieure à l’introduction des métaux.
Ce qui me paraît concluant c’est la fréquence du fer et du cuivre, voire même de l’argent. Nous avons certainement affaire à des sépultures de l’âge du fer, et qu’on peut qualifier de libyco-berbères.
La forme. — De ces redjems la forme extérieure et la disposition intérieure varient, dans de certaines limites. Ce sont toujours des tas de pierres, mais plus ou moins ordonnés, se rapprochant plus ou moins d’une construction en pierres sèches et suivant des plans qui varient.
Il y en a de tout à fait frustes, qui sont à la lettre des tas, le redjem A par exemple d’Aïn Sefra. — On l’a éventré jusqu’au sol sans y trouver trace d’une structure ordonnée, et sans voir autre chose que des pierres en vrac. Le redjem recouvre un espace vaguement circulaire, et la forme générale est celle d’un cône très surbaissé à pointe camarde, la forme d’un tas. Le redjem A d’Aïn Sefra a 12 mètres de diamètre et 3 mètres de haut. (Voir pl. XII, phot. 23.)
Ce redjem A reposait sur du sol non remanié, on n’a pas trouvé trace d’excavation. Les ossements et le très maigre mobilier funéraire ont été trouvés au-dessus du sol, mélangés aux pierres.
Strabon mentionne en effet chez les Libyens un rite funéraire qui consistait à lapider le cadavre jusqu’à enfouissement complet.
Voilà donc quelle est la forme la plus fruste du redjem, si fruste que pour en établir le caractère funéraire il n’y a guère qu’une preuve évidente, c’est d’y trouver un squelette. Il y en a une autre pourtant qui est un corollaire de celle-ci. Les redjems funéraires ont souvent un petit cratère au sommet, le vide causé par la tombée en pourriture et en poussière du cadavre amène au centre de la région un effrondrement qui a nécessairement sa répercussion en surface et au sommet[55].
[69]D’autres redjems sont d’un type un peu plus évolué.
Un redjem C′ de Beni Ounif, à côté de C (qui est du type le plus fruste), comporte une tombe ovale creusée dans le sol de grès tendre, 1 mètre et 1 m. 20 de diamètre, 0 m. 50 de profondeur ; cette tombe où le cadavre n’était plus représenté que par une dent canine et quelques débris, était remplie de terre ; au-dessus s’étalait le redjem, de 4 mètres de diamètre, simple tas de pierres. Ici donc c’est sur une tombe et non pas sur le cadavre posé à même le sol, que le redjem est élevé.
Un pas plus loin et par une évolution facile à suivre nous arrivons au type beaucoup plus soigné du redjem B d’Aïn Sefra (djebel Mekter). (Voir pl. XII.)
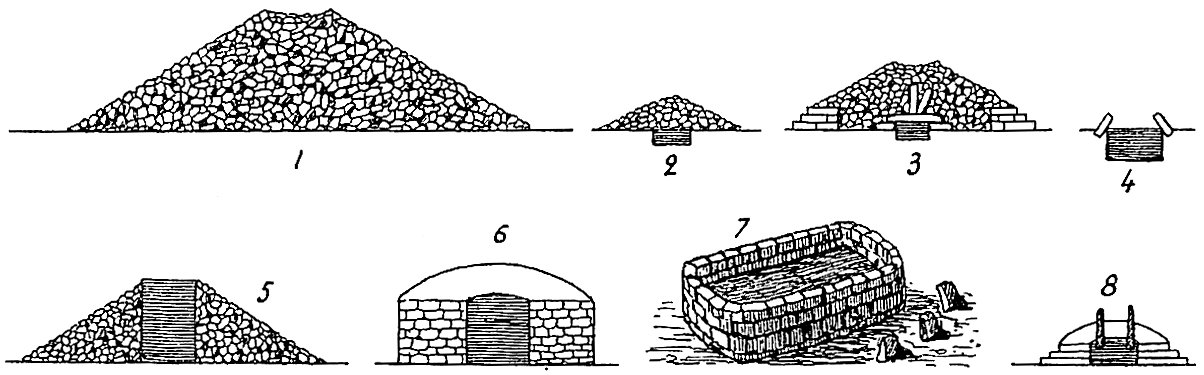
Fig. 1. — Principaux types de redjems.
1. Redjem A d’Aïn Sefra. — 2. Redjem C′ de Beni Ounif. — 3. Redjem B d’Aïn Sefra. — 4. Redjem E de Beni Ounif. — 5. Redjem F d’Haouinet. — 6. Redjem de l’Adr’ar’ des Ifor’ass. — 7. Redjem de l’O. Tougçemin. — 8. Redjem islamisé de l’O. Taoundrart.
(Figure extraite de L’Anthropologie, Masson et Cie, édit.)
Au centre du redjem qui a 8 mètres de diamètre sur 2 m. 20 de hauteur, une chambre funéraire très nette, circulaire, d’un mètre de diamètre, est mi-creusée dans le sol, mi-bâtie et couverte à l’aide de grandes dalles de grès. L’intérieur est plein de sable pur, partiellement transformé en grès par les actions chimiques qui ont accompagné la décomposition du cadavre.
Sur le toit de la chambre funéraire quelques grandes dalles en désordre laisseraient supposer l’existence d’un second étage funéraire mal construit et effondré (?)
La construction en pierres sèches n’affecte pas seulement la chambre funéraire, mais on en trouve des traces dans le redjem lui-même. A la base et sur le pourtour extérieur du cône, court un anneau de dalles formant un escalier circulaire très grossier. Tout le reste est un simple entassement de pierres quelconques.
[70]Ce type de redjem est très fréquent au djebel Mekter, la plupart de ceux qu’a fouillés le capitaine Dessigny étaient de ce type. Les redjems de la daia de Tilr’emt étudiés par le colonel Pothier (Revue d’Ethnographie, 1886) sont aussi de ce type, qui paraît septentrional. Il est extrêmement intéressant, parce qu’il rentre dans une catégorie classée. Plus perfectionné, ce type donne évidemment le grand tombeau d’Henchir el Assel, dont une restitution est au Musée du Trocadéro[56]. Monumentalisé encore il donnera le Medracen et le Tombeau de la Chrétienne. On suit donc d’étape en étape, de perfectionnement en perfectionnement tous les degrés entre le simple tas de pierres et les monuments funéraires les plus célèbres de l’art berbère.
Le redjem E de Beni Ounif est d’un type aberrant. C’est une fosse remplie de sable, de la forme habituelle, c’est-à-dire circulaire, et entourée d’un petit mur de pierres fichées dans le sol et émergeant à peine. (Voir pl. XIII, phot. 25.) Ce type est très rare, je ne l’ai vu que là ; pourtant quelque chose de cette disposition se retrouve dans un tombeau copié par M. Chudeau au Hoggar (fig. 6, B) ; je considère ce type comme une ébauche du suivant qui est extrêmement fréquent.
Un tas de pierres, qui rappelle tout à fait par sa forme les redjems habituels, mais au centre duquel se trouve en guise de chambre funéraire un évidement cylindrique allant du sommet du redjem au sol, une sorte de tour aux parois grossièrement maçonnées en pierres sèches. Elle est remplie de sable, et elle contient souvent plusieurs cadavres superposés. Peut-être restait-elle précisément ouverte au sommet pour qu’on pût procéder à des funérailles successives.
Les redjems d’Haouinet sont de ce type et d’ailleurs la presque totalité des redjems de la Zousfana. C’est encore lui qui prédomine dans l’Ahnet à Taloak, à Ouan Tohra.
Dans l’Adr’ar des Ifor’ass il a évolué vers une plus grande perfection. C’est une véritable tour intérieurement aussi bien qu’extérieurement, assez soigneusement construite en pierres sèches ; une tour aux murailles épaisses, haute de 1 mètre à 1 m. 20.
A l’oued Tougçemin, un tombeau de ce type a une forme aberrante et compliquée. La tour est subquadrangulaire et on voit des restes d’une enceinte extérieure en pierres fichées debout dans le sol.
Evidemment ces tours régulières en pierres sèches ne méritent plus guère le nom de redjem, ce ne sont plus des tas. Il n’est pas[71] douteux pourtant qu’elles n’en soient issues par des perfectionnements successifs.
Ce type turriforme renferme les mêmes mobiliers funéraires que l’autre, auprès de squelettes disposés de même.
On a dit combien le premier type est classiquement berbère, puisqu’il aboutit au Tombeau de la Chrétienne. Le second ne l’est pas moins. Les tours funéraires sont bien connues en Algérie. On en trouvera une reproduction dans Recherches des Antiquités dans le nord de l’Afrique (Instructions adressées aux correspondants du ministère de l’Instruction publique). C’est la sépulture turriforme que les archéologues appellent chouchet, et c’est l’autre qu’ils appellent bazina. Aussi bien semble-t-il évident, à jeter un coup d’œil sur la planche, que ces deux types, si divergents qu’ils soient lorsqu’on les examine à leur dernier degré d’évolution (B d’Aïn Sefra et Tougçemin), sont issus l’un et l’autre du redjem grossier primitif (A). Il est clair en effet que B d’Aïn Sefra est très proche de F d’Haouinet.
Redjems du Hoggar. — Les redjems du Hoggar méritent une petite monographie, ils sont particulièrement évolués et monumentaux. M. Chudeau en a figuré quelques exemplaires choisis, qui se trouvent entre Tamanr’asset et Abalessa.
Il a consacré particulièrement son attention à un groupe voisin de Tit, l’ar’rem bien connu sur l’oued du même nom.
La vallée de l’O. Tit est limitée au nord par un plateau basaltique qui domine la vallée d’une vingtaine de mètres ; au sud du village se dresse une aiguille granitique, le Tinisi. Les tombes les plus remarquables se trouvent sur le plateau basaltique. Celle qui est figurée en D (fig. 3) est presque exactement au nord du Tinisi ; B est un peu à l’est de la précédente, et C à un demi-kilomètre plus loin sur un promontoire du plateau.
Groupe C. — La tombe la plus à l’est (C, fig. 2 et 3) est entourée d’une série importante de constructions auxiliaires : vers l’ouest (fig. 2) un petit cercle formé de grosses pierres posées sur le sol (c) ; au nord-ouest (d) une série de fers à cheval dessinés par des pierres posées sur le sol (mais non enfoncées) et dont le relief atteint un décimètre.
Vers l’est un groupe de redjems (e) du type figuré en A (fig. 3) et qui ne diffèrent les uns des autres que par leurs dimensions ; les plus hautes ne dépassent guère un mètre. Les deux rangées internes de ce groupe sont peut-être disposées sur des cercles concentriques à la tombe. Au nord se trouve un redjem isolé (e).
[72]La tombe C (fig. 3) est constituée par un mur haut de 1 m. qui dessine un cercle de 7 m. de diamètre environ. Ce mur est soigneusement construit en pierres sèches, l’espace intérieur est rempli de cailloux de petite taille formant au niveau du sommet du mur une surface assez bien dressée. Au milieu est creusée une cavité circulaire de 0 m. 80 de diamètre intérieur, limitée par un mur soigneusement établi, mur qui s’élève notablement au-dessus du reste du monument. Ce mur est renforcé vers l’extérieur par un amoncellement de grosses pierres. A l’intérieur de cette cavité, à l’extrémité occidentale du diamètre est-ouest, est fichée dans le sol une longue pierre haute de 1 m. 10. Les tombes musulmanes présentent souvent deux pierres analogues « les cheheds », mais toujours situées aux extrémités du diamètre nord-sud. Enfin, adossée à l’ouest du mur extérieur, se trouve une sorte de niche demi-circulaire recouverte de quelques grandes dalles ; cette niche est vide.
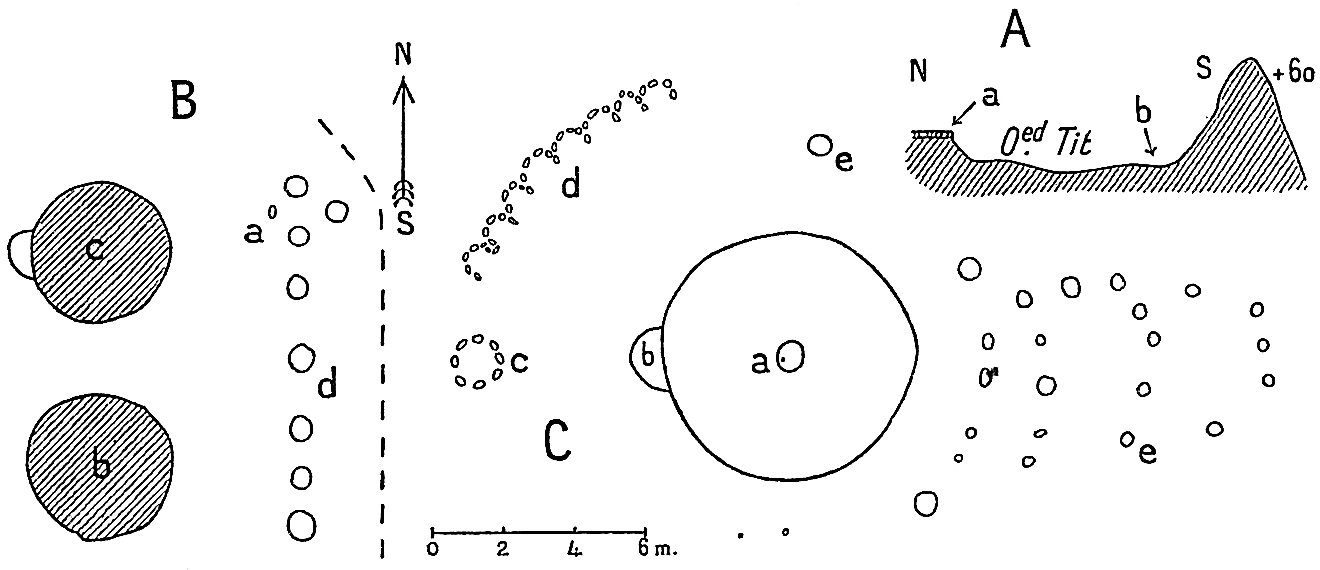
Fig. 2.
A, profil de la vallée de l’O. Tit ; a, place occupée par les tombeaux B et C de la figure 2 et B C D de la figure 3 ; b, place occupée par les tombeaux A et B, fig. 6, au pied de la gara Tinisi. — B, groupe de deux tumulus c et b (ce dernier figuré en B, fig. 3) accompagnés d’une pierre debout (a) et de redjems (d) du type figuré en A, fig. 3. — C, Tombeau C de la figure 3 accompagné de nombreux redjems (e) vers l’est, et d’un redjem isolé (e) au nord ; c, cercle de pierres ; d, groupe de fers à cheval formés de pierres posées sur le sol.
Groupe B. — Un autre groupe est constitué par deux tombes (B, fig. 2), voisines l’une de l’autre, et accompagnées à l’est d’une rangée de redjem (d). A côté est dressée une pierre debout (a) ; comme celle de la tombe C, cette pierre n’a qu’une quinzaine de centimètres de diamètre. L’une des tombes (c) est ornée d’une niche adossée à sa face ouest, et identique à celle qui vient d’être décrite.
La seconde tombe (b) est figurée seule en B (fig. 3) ; elle est constituée par un mur circulaire, haut de 0 m. 80, entourant un espace de 4 mètres de diamètre environ, espace rempli de cailloutis jusqu’en[73] haut du mur. Ce mur bâti en pierres sèches (basalte) soigneusement appareillées, est entouré d’une rangée d’écailles granitiques verticales accolées au mur.
Tombe D. — Le chouchet D, D′ (fig. 3) est remarquable surtout par l’épaisseur de sa muraille et son caractère asymétrique ; le puits bien circulaire a 1 m. 50 de diamètre ; à l’ouest la muraille a 1 m. 20 d’épaisseur, à l’est 1 m. 80. La hauteur est partout 1 m. 80. A 2 mètres vers l’est, et orientées N.-S., sont dressées 4 écailles granitiques, dont la hauteur varie de 0 m. 50 à 0 m. 80. Ces écailles sont reliées par deux rangées de pierres au chouchet. A part les écailles, qui sont granitiques, tout le reste est de basalte ; il y a lieu de remarquer que les pierres qui constituent la base du chouchet sont de beaucoup les plus épaisses. La muraille n’est pas aussi intacte qu’on l’a figurée, il y a quelques pierres éboulées.
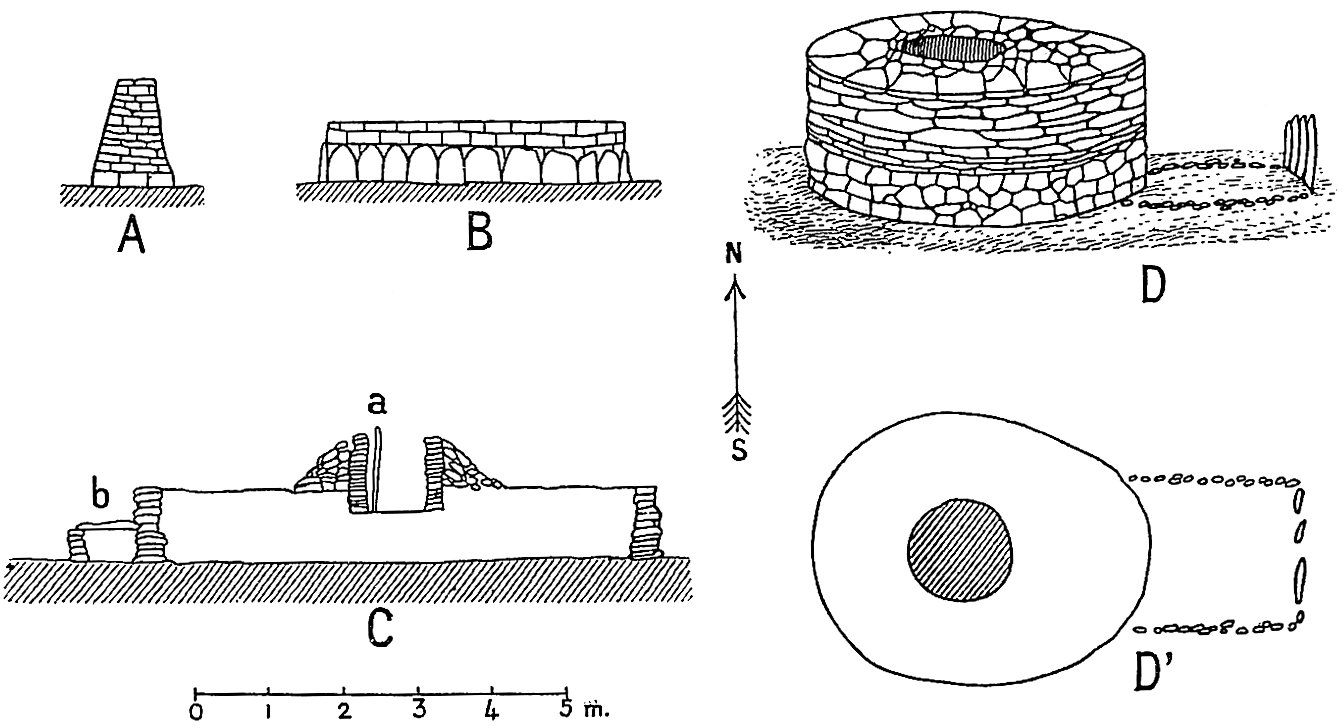
Fig. 3.
A, redjem ou pyramide de pierres accompagnant certains tombeaux. — B, tombeau (B, fig. 2). C, tombeau (C, fig. 2) : a, pierre debout 1 m. 10 ; b, niche adossée à l’ouest du tombeau. — DD′ tombeau.
Ces tombeaux B C D sont situés près du village de Tit, sur le bord du plateau basaltique qui limite au nord la vallée de l’Oued (A, fig. 2).
O. Outoul. — Au confluent de l’oued Outoul et de l’oued Adjennar, sur la route de Tamanr’asset à Tit M. Chudeau a dessiné un très beau tombeau analogue à C (fig. 3) et qui est reproduit en A (fig. 4).
Tin Hinan. — Ce sont là incontestablement de beaux monuments d’une ordonnance plus compliquée, et d’un travail plus soigné que les autres redjems sahariens, mais le chef-d’œuvre de cette architecture funéraire est le tombeau de Tin Hinan à Abalessa. C’est une énorme tombe turriforme de 20 mètres de diamètre, juchée au[74] sommet d’une éminence, et entourée de plusieurs chouchets du type ordinaire (B et B′ de fig. 4). Le mur d’enceinte a 2 mètres de haut ; à l’intérieur des murettes délimitent des chambres. Motylinski a photographié et longuement décrit ce monument par lequel il se déclare « profondément impressionné[57] ». A juste titre en effet : c’est le plus beau redjem du Sahara, et ce somptueux tombeau berbère est un document archéologique de valeur comparable au Tombeau de la Chrétienne ou au Medracen. Il est au type chouchet ce que ceux-ci sont au type bazina, le dernier terme de l’évolution. Notons qu’il a sur les autres redjems encore une supériorité importante, celle de n’être pas anonyme ; Tin Hinan est un personnage presque historique, c’est l’ancêtre de tous les nobles Touaregs, ancêtre maternel naturellement, puisque le Hoggar en est resté au matriarcat. C’est la souche de tout l’arbre généalogique Hoggar. Autour du grand tombeau les petits rangés en cercle passent pour ceux des Imr’ads de Tin Hinan. Et un chouchet situé en contre-bas, à quelques centaines de mètres dans la vallée, serait celui de Tamakat, ancêtre maternelle des tribus Imr’ads.
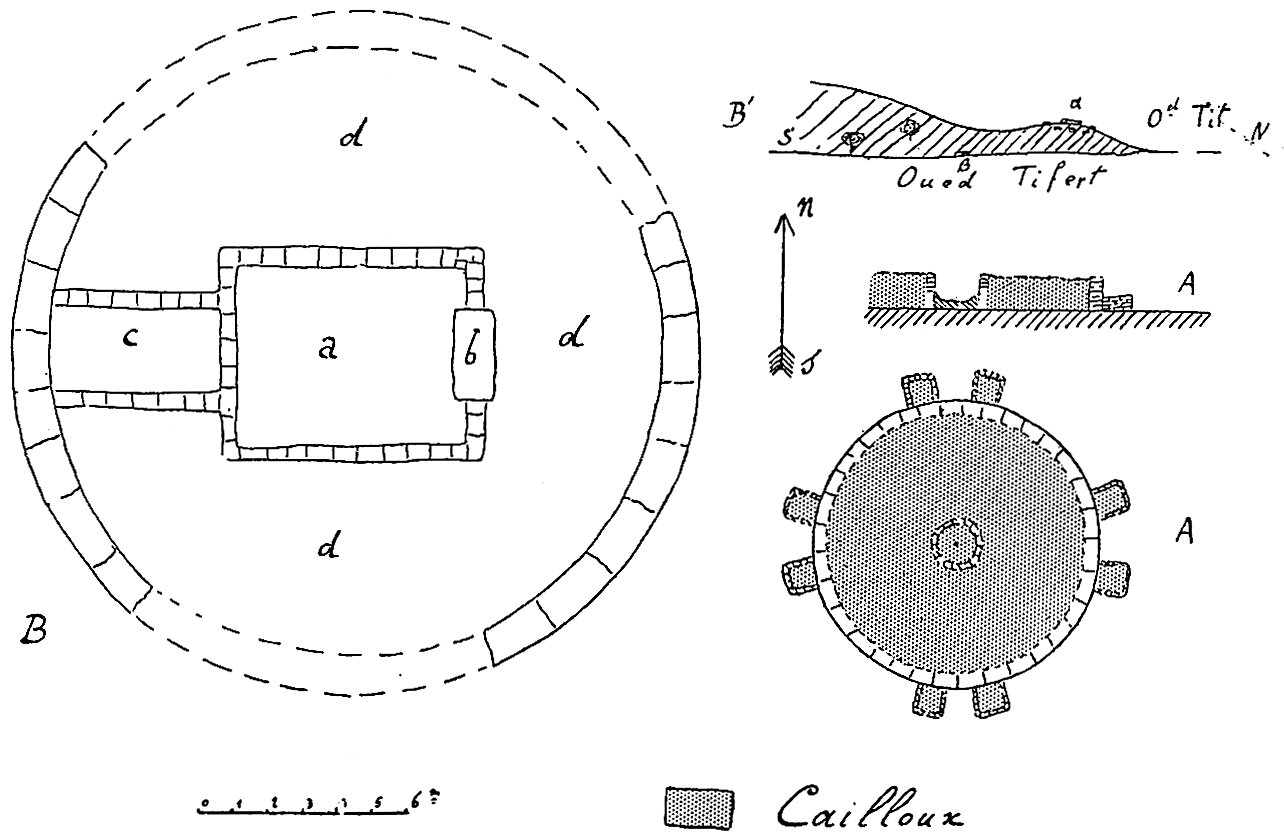
Fig. 4.
A, tombeau au confluent de l’oued Outoul et l’oued Adjennar (entre Tit et Tamanr’asset). — B, tombeau de Tin Hinan ; a, chambre centrale ; b, grande pierre sous laquelle est une niche s’ouvrant en a ; c, couloir à entrée masquée ; d, chambres périphériques encombrées de pierres éboulées. Le mur d’enceinte a 2 mètres de haut. — B′, tombe de Tin Hinan entourée des chouchets de ses imr’ads. — β, de Takamat ; une mosquée moderne lui est adossée.
(Figure extraite du Bulletin de la Société d’anthropologie.)
[75]Le Hoggar nous offre donc les plus beaux spécimens de redjems au Sahara et en même temps les plus récents, les seuls qui soient datés, ou, en tout cas, attribués à des personnages historiques. Ils appartiennent tous au type turriforme, chouchet.
L’autre type — bazina — est d’ailleurs représenté par de très nombreux exemplaires mais tout à fait frustes. Chudeau admet que les bazinas, au Hoggar, sont d’habitude sur les bords de l’oued ; tandis que les chouchets, du moins les plus typiques, sont juchés sur les plateaux et les collines dominant la vallée. Le fait est trop constant pour qu’on puisse l’attribuer au hasard. Faut-il voir dans cette répartition différente l’indice d’une différence d’âge, ou au contraire de caste ? Que les chouchets soient à la fois de construction beaucoup plus soignée, et se dressent sur des éminences, ce sont deux caractères qui s’accordent bien et on pourrait conclure à un caractère aristocratique (?)
Chudeau note que les chouchets, abondants dans tout le Hoggar, ne semblent pas s’étendre vers le sud-est ; il a vu les derniers à deux jours au sud-est de Tamanr’asset, près du point d’eau de l’oued Zazir, sept beaux chouchets bien typiques en forme de tour, les deux plus grands ayant 6 mètres de diamètre et 2 mètres de haut. Au delà, sur la route de l’Aïr, ce type disparaît brusquement.
Son extension vers l’ouest est d’ailleurs bien délimitée. On ne le trouve pas, je crois, dans l’Açedjerad, dans l’Ahnet, dans le Mouidir occidental. Il apparaît bien net dans l’Adr’ar des Ifor’ass, plus particulièrement dans sa partie septentrionale (In Ouzel, oued Tougçemin), celle qui regarde le Hoggar, et qui est sous sa dépendance politique. M. Chudeau le signale à Tin Zaouaten.
En somme, la province des beaux chouchets semble limitée au Hoggar et à quelques-unes de ses dépendances immédiates. Les plus beaux échantillons semblent être à Abalessa et se rapporter aux ancêtres des nobles Touaregs actuels.
Provinces orientales. — Sur les tombeaux anciens de l’Aïr, Chudeau a rapporté des renseignements qui en montrent surtout le caractère humble et banal. Il note des groupements importants dans l’oued er Ghessour (Tassili méridional), à In Azaoua, à Iferouane, mais ce sont des tas de pierres du type si répandu. Pourtant Chudeau a levé dans l’oued Tidek (Aïr) le plan d’un grand tombeau assez soigné et assez particulier. C’est un redjem mixte, bazina à cavité turriforme centrale, qui se dresse au centre de trois cercles concentriques réguliers, dessinés par des pierres à la surface du sol (fig. 5).
[76]Certainement cette province de l’Aïr se distingue nettement de la province nord-orientale (Mouidir et surtout Tassili des Azguers), telle qu’on l’entrevoit à travers les descriptions de Duveyrier, Foureau, Besset et Voinot[58].
Duveyrier, on l’a dit, a dessiné près de R’adamès un cist, autrement dit un dolmen sans toit. A cette exception unique près, les types du Tassili ont une parenté évidente avec ceux du Hoggar, encore qu’ils aient une originalité incontestable.
Les tombes figurées par Foureau (l. c., fig. 378 et 379) se reconnaissent au premier coup d’œil, ce sont des chouchets classiques, des redjems turriformes, tout à fait semblables à ceux du Hoggar et de l’Adr’ar des Ifor’ass.
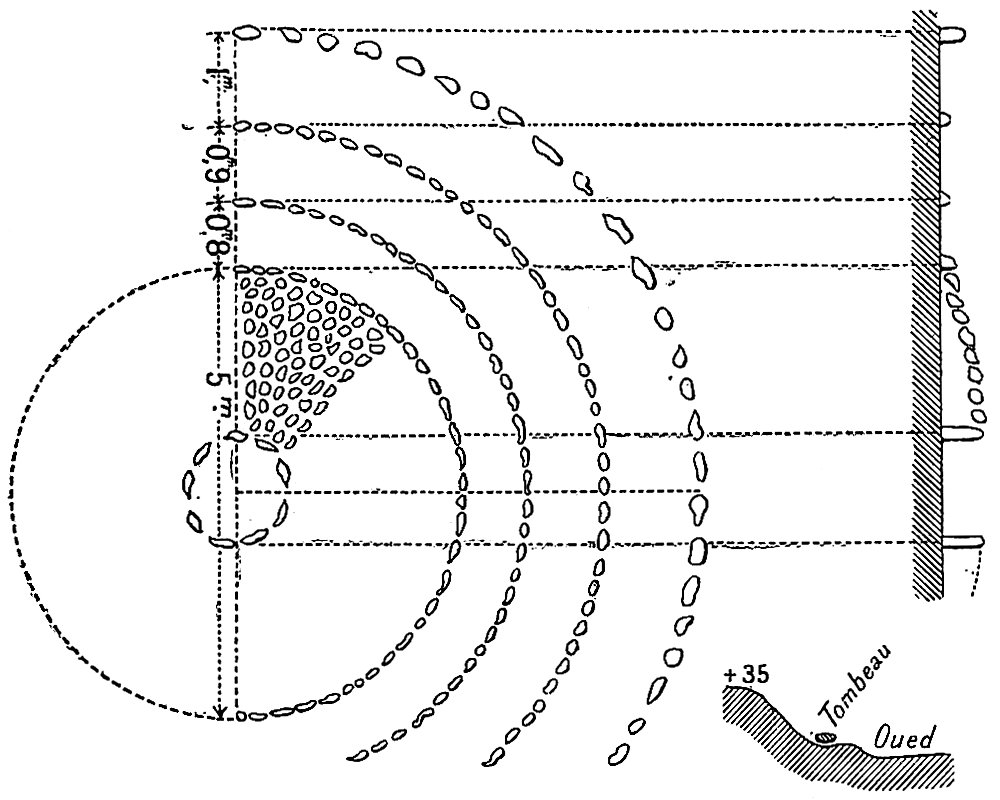
Fig. 5. — Tombeau sur les bords de l’oued Tidek (Aïr).
(Figure extraite de L’Anthropologie. Masson et Cie, édit.)
Il semble que Besset, au Mouidir occidental a vu de nombreux chouchets, qu’il décrit ainsi : « un mur circulaire en pierre sèche à l’intérieur duquel repose le corps recouvert de dalles et de sables ».
La tombe représentée par Foureau (l. c., fig. 377), et qui est surmontée d’un monolithe, a, nous l’avons vu, quelques analogues au Hoggar.
Les autres tombes, au contraire (fig. 381, 382, 383, 385, 386, 387[59]), c’est-à-dire la plupart de celles que décrit M. Foureau, semblent[77] au premier coup d’œil sur la photographie, très aberrantes des types occidentaux. Ce qui frappe d’abord en effet, c’est un lacis compliqué de murettes basses ou, si l’on veut, de pavage en cordon, dessinant le plus souvent des ellipses, ou bien encore un triangle (fig. 305) ; ces dessins, compliqués comme des soutaches, couvrent de grands espaces dont le grand diamètre atteint 80 mètres.
A y regarder de près pourtant et surtout à consulter le texte on se rend compte bien vite que ces lignes compliquées aboutissent à un tombeau central, ou à un groupe de tombeaux, qui sont purement et simplement des redjems, ou comme dit M. Foureau, « des tumuli de débris de roches amoncelés en forme de cônes bas, tronqués ».
M. Voinot décrit et figure deux redjems de ce genre « à soutaches » sur la limite méridionale du Mouidir, à Tin Lalen (O. Arak) et à Amguid. Je crois pourtant que, au Mouidir, ce type est sporadique ; Besset ne le mentionne pas.
A l’ouest du Hoggar nous ne l’avons rencontré qu’une seule fois. Au nord-est d’In Ziza, dans l’oued Akifou j’ai vu à la surface du sol un grand dessin en cordon de pierres qui rappelait par ses allures de soutache les photographies de Foureau : une ellipse, dont le grand axe est prolongé par des cornes rectilignes. En relation avec ce monument je n’ai pas vu de redjem, mais je n’ai fait que passer et je n’ai même pas eu le temps de mettre pied à terre. Notons que l’oued Akifou est à peu près le point le plus oriental de mon itinéraire, il n’est donc pas surprenant d’y voir représenté, sporadiquement, le type monumental de l’est. (Voir fig. 9, no 6.)
Le Tassili des Azguers serait donc une province particulière où le redjem est entouré d’un dessin compliqué de cordons en pierres sèches, figurant toujours une voie d’accès au tombeau ; on ajoute au tombeau un vestibule ornemental, pour ainsi dire.
Notons pourtant que certains tombeaux figurés par Chudeau ont un rudiment de ceinture extérieure, de même d’ailleurs que le redjem de l’oued Tougçemin (fig. 1, no 7). Les festons figurés par Chudeau en d, fig. 2, au voisinage du grand tombeau C sont même tout à fait analogues aux soutaches.
En somme pourtant les redjems préhistoriques du Hoggar, autant que nous les connaissons, ne sont pas enclos d’un cordon de pierres avec voie d’accès. Je dis les préhistoriques, nous verrons en effet qu’il en est tout autrement des tombeaux actuels.
Malgré la variété de ces types, qui se laissent répartir en provinces un peu vagues, mais qui sont évolués les uns des autres, et qui se[78] relient par des types mixtes intermédiaires, l’unité fondamentale n’est pas douteuse. Je ne sais jusqu’à quel point elle ressort des descriptions précédentes, qu’on s’est efforcé de faire minutieuses, et qui éparpillent l’attention. Pour qui a parcouru le pays, et vu à de brefs intervalles, quoique à de longues distances une grande quantité de redjems, l’impression d’unité est très forte.
En définitive, tout concorde parfaitement ; la disposition extérieure et intérieure des redjems, la nature du mobilier funéraire, la position accroupie du squelette. Tout cela est nettement berbère préislamique. Notons encore que les seuls crânes trouvés, au nombre de trois, dont deux d’enfants, étaient délichocéphales, comme on pouvait s’y attendre de crânes berbères[60]. Tout cela suffirait déjà à autoriser des conclusions très positives. Mais il y a plus.
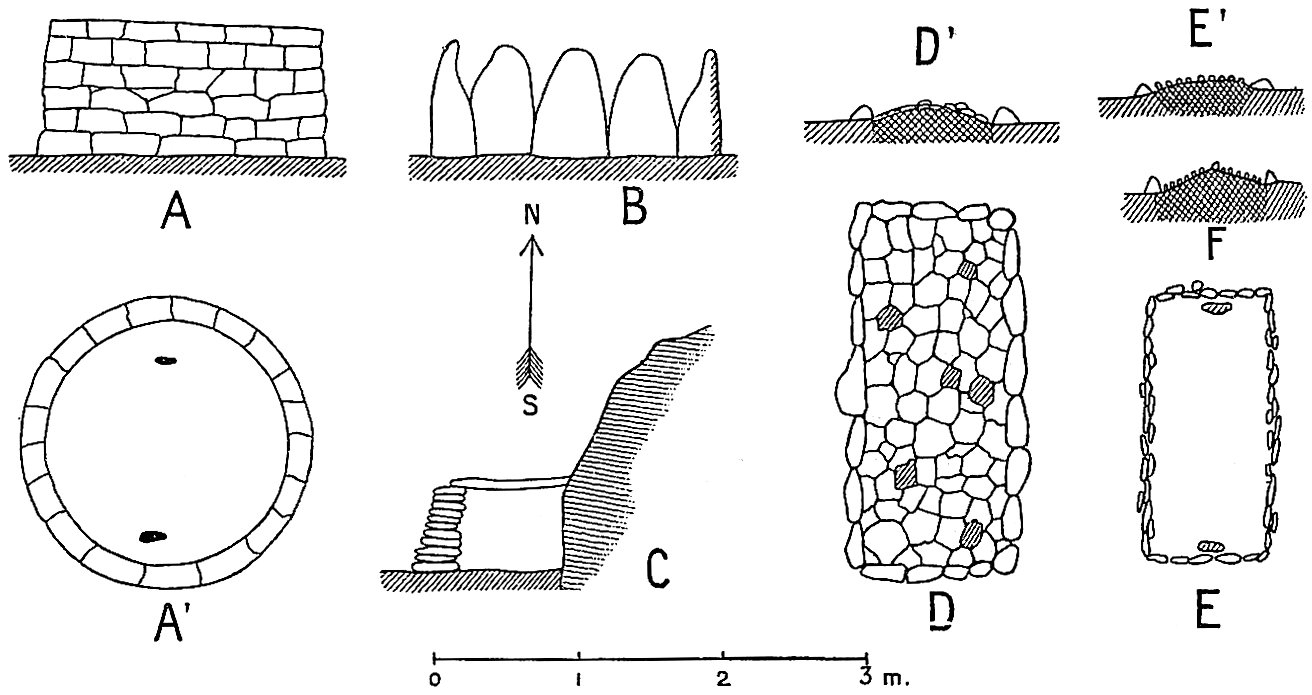
Fig. 6.
A A′, chouchet typique avec les deux cheheds. — B, chouchet construit en écailles granitiques. — A et B sont situées près de Tit au pied de la gara Tinisi (b A, fig. 2). — C, tombeau de forgeron près de Tamanr’asset. — D D′, tombeau au point d’eau de l’oued Kadamellet (15 kilomètres N.-N.-O. d’Iferouane). — E E′ F, tombes actuelles de Tamanr’asset.
On suit très bien les transitions graduées entre les redjems préislamiques et les tombeaux actuels. Chudeau a noté, autour de Tamanr’asset, dans la vallée de l’oued Sirsouf, un grand nombre de tombes remarquables par leurs petites dimensions ; elles sont en forme de chouchet, hautes de 0 m. 60, larges de 1 m. et recouvertes[79] par de grandes dalles ; entre ces dalles et le sol il y a un espace vide ; souvent deux de ces tombes sont accolées ; parfois elles sont appuyées contre un rocher, qui remplace une partie de la muraille circulaire (C, fig. 6). Ce dernier type rappelle singulièrement les niches qui accompagnent certaines tombes (cf. fig. 3, C en b). La tradition fait de ces chouchets les tombes d’une tribu de forgerons, morts autrefois à la suite d’une famine. On sait que chez les Berbères, comme au Soudan d’ailleurs, et chez la plupart des primitifs, les forgerons sont une caste peu estimée ; la petitesse des tombes dans l’oued Sirsouf est peut-être cause que la légende y loge des parias.
En tout cas, Chudeau a vu les tombes des Touaregs morts au combat de Tit (7 mai 1902) ; quelques-unes tout au moins ressemblent singulièrement à celles qui sont attribuées aux forgerons.
En pays Touareg, en particulier dans l’Adr’ar des Ifor’ass, on voit des redjems islamisés. Dans l’oued Taoundrart j’ai noté un tombeau du type redjem, d’une belle construction régulière en pierres sèches, turriforme à l’intérieur, à gradins extérieurs, mais dans lequel étaient fichés les deux cheheds musulmans, l’équivalent de nos croix sur nos tombes. (Voir fig. 1, no 8.)
Chudeau en a vu et dessiné de semblables (A et A′, fig. 6).
Tout particulièrement intéressants sont les cimetières d’es Souk et de Kidal. On sait que es Souk et Kidal sont aujourd’hui des ruines de villes historiques parfaitement connues. Vieilles capitales de l’empire Berbère Sanhadja elles ont été détruites au XVe siècle par l’empire Sonr’aï. Les cimetières d’es Souk et de Kidal sont donc datés avec précision. Et sans doute ils sont franchement musulmans et d’un caractère bien différent des redjems ci-dessus étudiés. C’est d’abord un cimetière aux tombes juxtaposées, resserrées sur le plus étroit espace possible ; on a dit que les redjems préhistoriques sont au contraire éparpillés ; là même où ils se trouvent groupés, toujours en petit nombre, chaque redjem est à plusieurs mètres, souvent plusieurs dizaines de mètres de son voisin le plus proche. Dans ces nécropoles à population dense d’es Souk et de Kidal, chaque tombe porte les deux pierres debout musulmanes, les témoins (chehed), et comme l’une marque l’emplacement de la tête et l’autre des pieds, on peut juger d’un coup d’œil que les funérailles ont été conformes au rite islamique. Le cadavre est certainement étendu et non replié. Seulement chaque paire de « chehed » est inscrite dans un cercle de pierres sèches, un mur, bas, rudimentaire, faisant à peine saillie au-dessus du sol, mais bien net et incontestable. Le cimetière est tout entier composé de tours tangentes entre elles. On peut donc affirmer[80] qu’au XVe siècle encore, les sépultures des Berbères Sanhadja étaient des redjems du type turriforme islamisés.
Chudeau signale dans l’Aïr des tombes analogues, dont la forme suppose un cadavre étendu, mais qui ont l’architecture en pierres sèches du redjem.
La tombe figurée en D, figure 6, se trouve dans la vallée de l’O. Kadamellet (Aïr) ; c’est un rectangle de 2 m. 50 sur 1 m. 10. Le pourtour en est dessiné par une rangée de grosses pierres ; l’intérieur est une butte de terre soigneusement recouverte de pierres plates. Lorsque la jonction se faisait mal, la terre restant à découvert, une pierre plate recouvrait le trou (ombrées sur le croquis). Le grand côté du rectangle est orienté N.-S. il n’y a pas de chehed. Cette absence de chehed ne prouve pas que la tombe soit préislamique ; on sait combien les Touaregs du nord sont peu croyants ; à Tamanr’asset, un parallélipipède rectangle bien construit est la tombe d’un Touareg que, paraît-il, Aïtarel l’aménokal, mort en 1900, avait connu ; cette tombe n’a pas de chehed.
Voici d’ailleurs de quelle façon Chudeau décrit les rites actuels de sépulture, et les tombes authentiquement contemporaines. Les tombes modernes de Touaregs se rapprochent de toutes les tombes arabes ; la fosse, profonde d’une soixantaine de centimètres, et large d’autant (une coudée et quatre doigts), a sa longueur orientée N.-S. ; le corps enseveli d’un linceul est couché sur le côté droit, la tête au sud et tournée vers l’est (vers la Mecque). On recouvre le corps de grosses pierres plates, cimentées parfois avec de l’argile et l’on achève de remplir la fosse avec des cailloux ; le pourtour de la tombe est marqué par une rangée de grosses pierres. Pour les hommes on place deux cheheds l’un à la tête et l’autre aux pieds ; pour les femmes un chehed à la tête et deux aux pieds. On choisit pour ces cheheds des pierres longues à section rectangulaire ; pour les tombes d’hommes,[81] et pour le côté de la tête dans les tombes de femmes, le grand côté de cette section est orienté E.-O. : dans les tombes de femmes les deux autres cheheds, presque contigus, ont leur grand côté orienté N.-S. (cf. fig. 7). Les croquis E, E′, F (fig. 6) représentent des tombes de Tamanr’asset. Les cailloux de remplissage forment une légère saillie dont la ligne médiane est souvent marquée par une série de cailloux blancs (quartz) plus gros (F). Les autres cailloux sont de couleur quelconque. Dans le cimetière de Tamanr’asset la plupart des tombes ont, du côté de la tête, un pot de terre ou une écuelle de bois remplie de cailloux ; elles ressemblent ainsi beaucoup à celles des oasis et du M’zab. (Voir pl. XIII, phot. 26.) Quatre seulement sur les quinze qui constituent le cimetière présentent un bâton fiché dans le sol, près du chehed sud. Dans le cimetière d’Iferouane (Aïr) les tombes sont encore du même type, mais les pots pleins de cailloux font défaut, et les bâtons existent à toutes les tombes : le bois, rare dans le Hoggar, est commun dans l’Aïr. Dans le cimetière d’Agulac (Aïr), village actuellement abandonné, les cheheds du côté de la tête portent en arabe une courte inscription (2 ou 3 mots).
Les tombes dont il vient d’être question sont celles des Imr’ads et des Haratins. Celles des Touaregs nobles en diffèrent par la présence d’une enceinte elliptique, percée vers l’ouest d’une ou de deux entrées qui donnent accès dans une allée d’ordinaire bien sablée qui entoure la tombe ; vers l’est l’enceinte présente vers l’extérieur une saillie avec une pierre debout, c’est le lieu de prières orienté vers la Mecque. Cette enceinte varie dans sa hauteur ; elle est parfois seulement indiquée par une rangée de grosses pierres comme dans les deux tombes sur les figures 7 et 8 ; plus rarement elle est constituée par un véritable mur qui rappelle un chouchet. Ces tombes de Touaregs nobles sont communes dans le Hoggar, mais ne sont pas spéciales à cette région. Le cimetière abandonné de Takaredei (25 k. N.-O. d’Agadès) en contient quelques-unes.
[82]Manifestement, à travers les rites islamiques, la vieille architecture funéraire transparaît ; il est tout à fait remarquable, en particulier, que les tombes de nobles aient une enceinte en pierre et un couloir d’accès, dans lesquels il semble impossible de ne pas reconnaître les « soutaches » des redjems au Tassili.
De cette continuité dans le type des tombes, au fil de l’évolution graduelle, les Touaregs eux-mêmes ont quelque conscience, encore qu’un peu vague.
On a déjà dit que, dans le nord, en Algérie, le caractère funéraire des redjems est profondément oublié de la population. Il n’en est plus de même au sud dès qu’on arrive dans l’Ahnet. Les Touaregs savent très bien que leurs redjems sont des tombeaux, et ils les entourent d’une certaine vénération. Duveyrier a vu à Radamès « des tombeaux en forme de butte sur lesquels les femmes des Touareg allaient se coucher lorsque les Touareg étaient en expédition et où elles obtenaient des nouvelles, etc. ».
Des anecdotes de ce genre courent le Sahara. On m’a parlé, par exemple, d’un Touareg égaré, séparé de sa caravane ; il passe la nuit sur un redjem et il voit en rêve le lieu précis où campe la caravane, si bien qu’il la rejoint le lendemain.
En pays Touareg les redjems sont assurément l’occasion de phénomènes psychiques, de l’ordre de ceux qu’on classe chez nous, dans les revues spéciales, sous le nom de vue à distance,, télépathie, etc.
Les Touaregs ne consentiraient pas à violer un redjem : ils le laissent pourtant fouiller sous leurs yeux par un Européen avec une parfaite indifférence ; le sacrilège ne les choque plus du moment qu’ils n’en ont pas la responsabilité directe. C’est qu’ils sont assez islamisés pour avoir perdu tout intérêt à leur propre passé préislamique ; ils en ont même perdu la conscience, ils ne le voient plus comme leur propre passé à eux. A Ouan Tohra les fouilles ayant amené l’exhumation de quelques squelettes, les Touaregs se sont étonnés de les trouver pareils à des ossements quelconques ; ils les auraient attendus gigantesques ; d’après leurs légendes c’est une race surhumaine et disparue qui dort sous les « izabbaren » (c’est le nom touareg des redjems). Grandiaque effossis mirabitur ossa sepulchris, l’homme est partout le même, au Hoggar ou dans la vallée du Pô.
Il ne faut pourtant pas être trop absolu, puisqu’il existe au Hoggar des izzabaren tout à fait semblables aux redjems du type habituel, mais qui sont les tombeaux de personnalités déterminées[83] ancêtres des Touaregs. Le tombeau de Tin Hinan est un aveu indirect.
Autres monuments lithiques. — Les redjems n’ont donc plus rien de mystérieux, leur histoire peut être considérée comme déchiffrée dans les grandes lignes.
Ils ne sont pas les seuls monuments lithiques notés au passage. Au bas des pentes du dj. Mekter, à huit kilomètres environ à l’est d’Aïn Sefra, le capitaine Dessigny a trouvé un cercle régulier circonscrit par des pierres debout fichées en terre ; il y a fait des fouilles qui n’ont donné aucun résultat. J’ai vu ce monument rudimentaire, le seul de ce genre si je ne me trompe qui ait été signalé en Algérie (mais cela ne veut pas dire le seul qui existe). Je lui trouve une grande ressemblance avec des monuments du même genre, que j’ai relevés au Sahara.
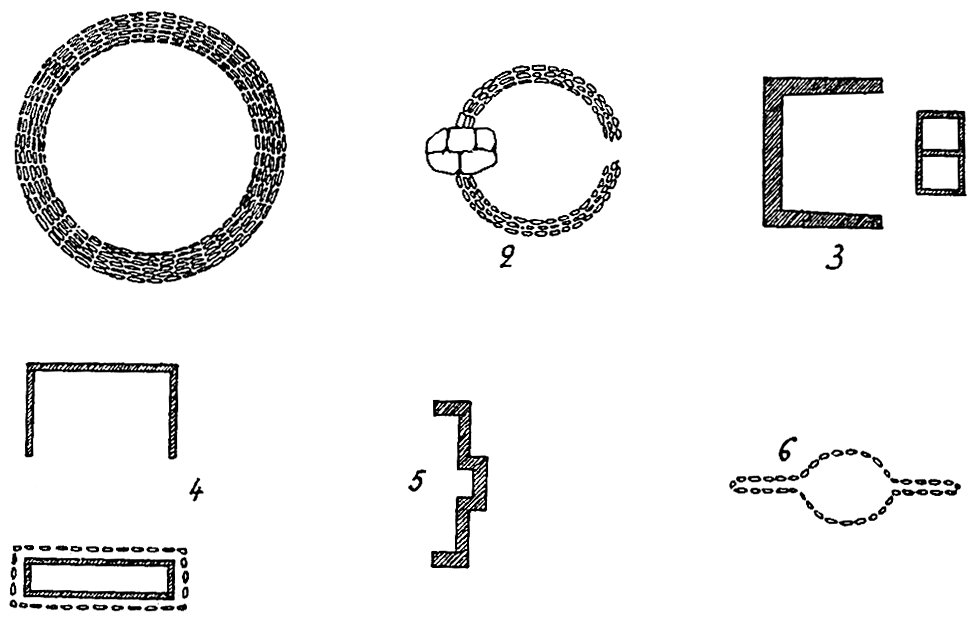
Fig. 9. — Monuments en pierres sèches (pavages à fleur de sol).
1. Cercle de Toloak. — 2. Cercle d’Ouan Tohra. — 3 et 4. Rectangles à Ouan Tohra. — 5. Mosquée touareg. — 6. Dessin en pierres sèches dans l’O. Akifou. — Les figures sont orientées comme une carte de géographie.
(Figure extraite de L’Anthropologie, Masson et Cie, édit.)
Un de ceux que j’ai vus de plus près, et le seul que j’aie soigneusement fouillé, se trouve à Taloak. Le cercle est parfaitement régulier, on peut croire qu’il a été tracé au cordeau. Le mur qui le circonscrit, au ras du sol, est fait de six rangées de pierres debout, chaque rangée inscrite dans la précédente, et tout cela d’un appareil assez soigné. Ce mur a 1 mètre d’épaisseur. La partie centrale du cercle, libre de pierres a 7 mètres de diamètre. Notons que les pierres ne sont pas posées sur le sol mais profondément enracinées.
J’ai vu, en passant, des cercles tout à fait semblables à diverses[84] reprises, à six kilomètres au nord d’Ouan Tohra, dans l’oued Ebedakad (Adr’ar des Ifor’ass) ; le colonel Laperrine en a photographié. (Voir pl. XIV, phot. 27.)
Chudeau en signale un certain nombre au Hoggar, près d’Abalessa, à 12 kilomètres au sud de Tamanr’asset, dans l’oued Tinfedet (sud du Hoggar) au sud des tilmas : sur ce dernier point le type est assez aberrant, de petites dimensions, 2 mètres seulement de diamètre :
Dans l’Aïr, Chudeau a vu de grands cercles à 10 kilomètres au nord-ouest d’Iferouane, à 7 kilomètres au nord de Salem-Salem, dans un cimetière musulman. (Voir fig. 10.)
Détail intéressant, il note l’emploi de cailloux blancs (quartz) pour paver soit l’intérieur du cercle, soit des bandes intercalées entre circonférences concentriques. (On a vu que l’usage décoratif du quartz s’est conservé dans la technique des tombeaux modernes.)
Foureau lui aussi a vu ces grands cercles (fig. 384, p. 1081). Barth est le premier qui les ait signalés à 200 kilomètres dans l’est de Mourzouk[61].
En somme ils sont anciennement connus, ils ont été notés par tous les voyageurs, ils sont fréquents et épars sur tout le Sahara central. Il y a quelques types aberrants.
Auprès du puits d’Ouan Tohra (à 200 mètres au sud) un autre cercle de 5 mètres de diamètre présente quelques particularités. Le mur de pierres qui le circonscrit est interrompu par une porte qui s’ouvre à l’est. Et juste en face, à l’autre extrémité du diamètre, le mur s’épaissit en une plate-forme ovale, dont le grand arc est dans la prolongation du diamètre. (Voir fig. 9, no 2.)
Enfin à quelques mètres de là, auprès du même puits d’Ouan Tohra, un autre monument est tout à fait différent de forme, mais doit être rangé, je crois, dans la même catégorie. Il s’agit toujours de murs au ras de terre, il serait peut-être plus exact de dire des dessins en pavage. Mais ici ce n’est plus un cercle qui est dessiné. C’est un rectangle long de 5 mètres et large de 4. L’un des grands côtés fait défaut complètement, celui de l’est, et de ce côté, où le rectangle est ouvert, à quelques mètres, inscrit dans la prolongation des petits côtés, se trouve un autre rectangle beaucoup plus petit (2 m. 50 de grand diamètre), séparé en deux compartiments par un cordon de pavage. Chudeau signale un monument de ce genre à Tin Amensar (oued Tit). (Voir fig. 9, nos 3 et 4 et fig. 10, F.)
L’idée qu’on ait affaire ici à des monuments funéraires doit être,[85] je crois, tout à fait écartée. En effet, j’ai fouillé sérieusement le grand cercle de Taloak : partout à l’intérieur du pavage annulaire j’ai trouvé tout de suite le sol naturel, non remanié, je n’ai pas vu trace d’un tombeau. En revanche, à la surface du sol ou à une profondeur insignifiante, on rencontre des débris de poteries, du bois carbonisé, des cristaux fragiles mélangés à la terre, et qui n’ont pas supporté le voyage, mais qui ont paru être du salpêtre ou des nitrates quelconques. Faut-il croire que, à l’intérieur de ce cercle, on a fait des sacrifices, qui ont imprégné le sol de produits organiques ? Il semble difficile en tout cas de lui prêter un caractère autre que religieux.
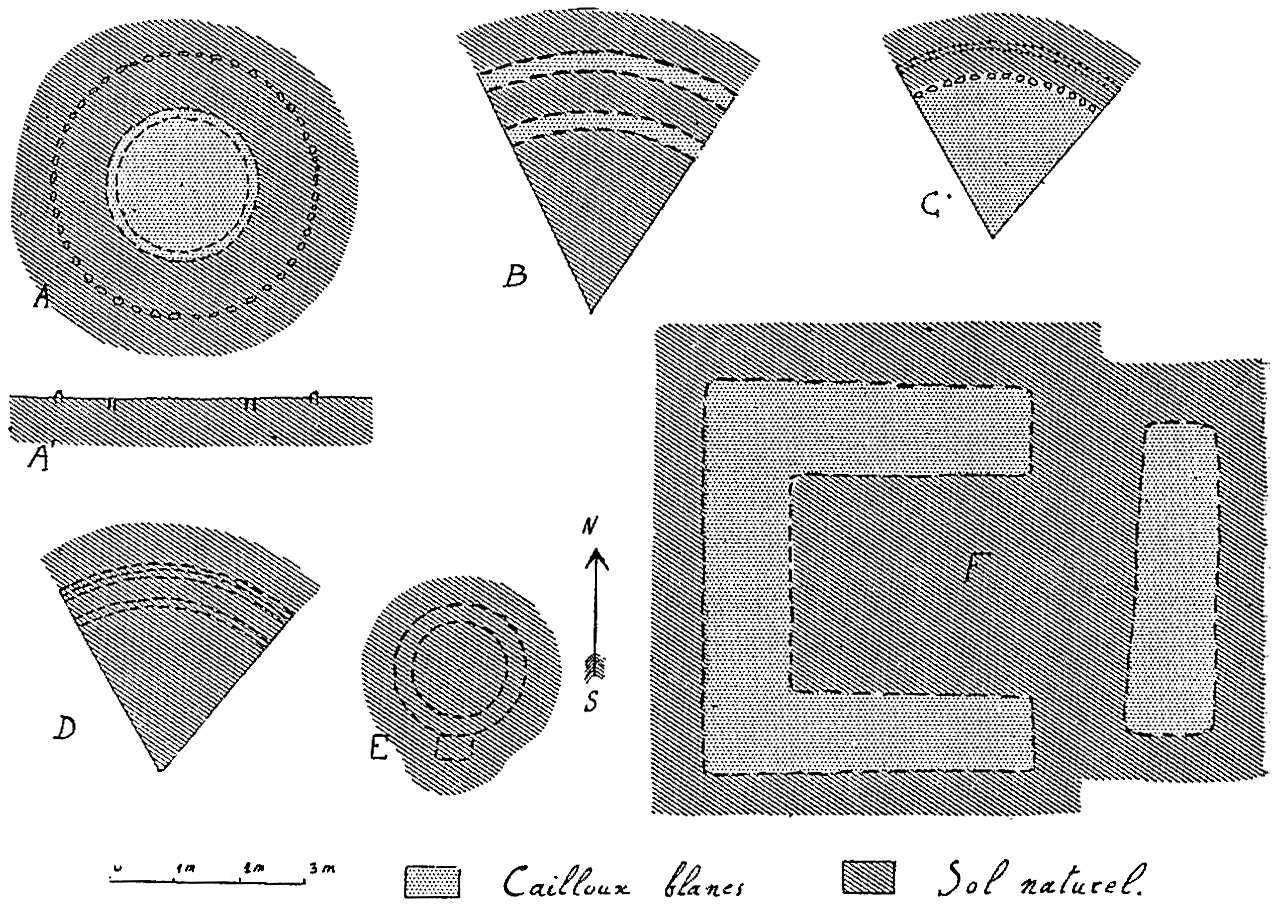
Fig. 10.
A, 10 kilomètres au nord-ouest d’Iferouane. — B, 12 kilomètres au sud de Tamanr’asset. — C, 7 kilomètres au nord de Salem-Salem, dans un cimetière musulman. — D, près d’Abalessa. — E, oued Tinfedet (sud du Hoggar) au sud des Tilmas. — F, oued Tit, près de Tin Amensar.
(Figure extraite du Bulletin de la Société d’anthropologie.)
J’ai fouillé aussi le plus petit des rectangles de Taloak, lui non plus ne peut pas être un tombeau ; on y rencontre partout le sol naturel, et si ce n’est pas un tombeau il faut avouer qu’il a une allure d’autel.
Voici enfin qui me paraît donner à ces hypothèses une valeur de quasi-certitude. Ces monuments mégalithiques relativement anciens et énigmatiques voisinent avec d’autres, qui ne sont ni l’un ni l’autre ; ce sont les mosquées des Touaregs. Ces mosquées[86] (m’salla) ont la plus grande analogie architecturale avec les cercles de sacrifice ; la forme seule diffère ; ce sont des cordons de pavage qui dessinent une mosquée réduite à sa plus simple expression, c’est-à-dire à la niche qui indique la direction de la Mecque (le mihrab). Une mosquée de ce genre à In Ziza a une grande réputation de sainteté. (Voir fig. 9, no 5.)
Il est remarquable de trouver en général réunis sur le même point redjems, cercles de sacrifices et m’salla. Les redjems d’ailleurs sont toujours juchés sur une éminence, dominant le pays et aperçus de loin[62]. L’emplacement où ils s’élèvent n’a pas été choisi apparemment sans préoccupations religieuses. Ce sont d’anciens lieux consacrés, semble-t-il, et qui le sont restés après le triomphe de l’Islam ; si bien qu’on y suit l’évolution des cultes ; à côté de la mosquée il subsiste d’anciens sanctuaires préislamiques.
Conclusion. — En résumé, la question des monuments rupestres au Sahara, funéraires et religieux, semblé élucidée, au moins dans ses grandes lignes. Le problème d’ailleurs, tel qu’il se pose actuellement et sous réserve de découvertes ultérieures, est remarquablement simple. En d’autres pays, en particulier dans les provinces voisines d’Algérie et du Soudan, le passé préhistorique se présente sous des aspects multiples. En Algérie les redjems abondent, mais on trouve à côté d’eux des dolmens, quelques sépultures sous roche (grotte des Troglodytes, etc.), pour ne rien dire des puniques et des romaines. Au Soudan, comme on peut s’y attendre, en un pays où tant de races sont juxtaposées, le livre de M. Desplagnes énumère des tombeaux de types divers et multiples, poterie, grottes sépulcrales, cases funéraires, tumulus[63].
Rien de pareil au Sahara. On distingue bien des types différents de redjems, les caveaux sous tumulus du nord, qui sont peut-être influencés par les dolmens et les sépultures romaines, les redjems à soutaches du Tassili des Azguers, les chouchets du Hoggar, qui semblent nous raconter l’itinéraire et l’expansion des nobles Touaregs actuels. Mais tout cela se ramène à un type unique, évidemment berbère, le type redjem.
Berbères sont aussi les cercles de sacrifices et monuments similaires. Parmi tant de pierres sahariennes entassées ou agencées par l’homme on n’en connaît pas une seule qu’on puisse soupçonner de l’avoir été par une main autre que Berbère.
[87]Et ceci nous conduirait à conclure que les Berbères ont habité le Sahara dans toute l’étendue du passé, historique et préhistorique, si d’autre part tous ces redjems ne paraissaient récents. Quelques-uns, qui ne se distinguent pas des autres, sont encore nommément attribués à des personnalités connues, si courte que soit la mémoire historique des Touaregs (Tin Hinan et les siens). Les mobiliers funéraires contiennent du fer, et on n’en connaît pas un seul qui soit purement et authentiquement néolithique.
Cette énorme lacune est naturellement de nature à nous inspirer la plus grande prudence dans nos conclusions. D’autant plus que, après tout, les monuments similaires algériens, dans l’état actuel de nos connaissances, ne paraissent pas plus anciens. A en juger d’après le témoignage des redjems seuls, les Berbères seraient dans l’Afrique du nord et a fortiori dans le Sahara, un épiphénomène.
II. — Gravures rupestres.
Rappelons que, en matière de gravures rupestres algériennes et depuis les travaux de Pomel et Flamand, il est d’usage de distinguer les gravures rupestres proprement dites, anciennes, à trait profond, net, lisse, à patine très sombre, de grande taille — et les gravures libyco-berbères qui sont des grafitti informes, à traits pointillés, sans patine, et beaucoup plus récents[64].
On emploiera donc sans plus d’explications les expressions gravures anciennes et libyco-berbères.
J’ai rencontré le long de mon itinéraire un assez grand nombre de stations de gravures rupestres, je les décrirai successivement en allant du nord au sud.
Station du col de Zenaga (Figuig). — L’emplacement de cette station a été indiqué avec précision par M. Normand[65], elle se trouve sur un petit monticule à l’entrée du col et à gauche quand on vient de Beni Ounif. Les dessins sont gravés sur des blocs de grès albiens, dits grès à dragées ou à sphéroïdes, les mêmes qui tiennent une[88] place si considérable dans tout le Sud-Algérien, et qui furent une matière de prédilection pour le graveur rupestre. Les gravures sont éparses sur tout le monticule, les unes sur des pans de roche verticaux et d’autres au contraire sur des surfaces horizontales.
Les figures ci-jointes ont été exécutées par M. Ferrand, dessinateur de l’École des sciences d’après des calques et des estampages ; elles présentent donc des garanties suffisantes d’exactitude. Ces gravures rentrent tout à fait dans la catégorie des gravures anciennes. Elles en ont tous les caractères distinctifs.
1o Les figures ont de grandes dimensions, parfois même elles sont grandeur nature ;
2o Le dessin est amusant et trahit un souci de la nature qui fait songer à nos dessins quaternaires sur bois de renne ou ivoire de mammouth ;
3o Le trait est profond, régulier ;
4o La patine est aussi foncée dans le trait lui-même que sur la roche avoisinante ;
5o L’extrême antiquité de la gravure, déjà prouvée par la patine, est accusée par le choix des sujets, animaux disparus, comme l’éléphant ; ou fossiles, comme le buffle antique.
Les gravures du col de Zenaga sont naturellement d’intérêt inégal. Il en est qui sont des énigmes indéchiffrables : par exemple l’animal à taille mince de lévrier, à cou démesuré de girafe et ceint d’un collier, à tête indistincte, hérissée et balafrée de longs poils (?) (fig. 11, γ). Ou bien encore la figure β de la même planche, qu’on ne sait comment décrire, à moins qu’on ne se décide à y voir un être humain schématique, assis et les bras écartés (?)
Quelques animaux ne sont reconnaissables que tout à fait en gros, et non sans quelque hésitation, α de la même figure 11, semble bien être un mouton avec une corde au cou. α, β, γ de la figure 12 comme aussi α de la figure 13 sont évidemment des bovidés et d’espèces différentes, γ de la figure 12 a les cornes courtes et le muffle carré. Tous les autres ont le muffle pointu et les cornes démesurément longues ; mais sont-ce bien des Bubalus antiquus ? on serait tenté de répondre oui pour α de la figure 13 ; pourtant l’hésitation reste permise. Elle ne l’est plus pour γ de la même figure ; c’est un joli dessin de bubale antique, simplement esquissé mais bien campé ; toutes les caractéristiques de l’animal y sont ; les cornes immenses, circulaires, le chanfrein courbé, le garrot élevé.
β de la figure 3 est également un éléphant réussi, quoique réduit[89] à ses lignes principales, et faisant songer aux animaux dessinés d’un trait de plume de nos journaux illustrés.
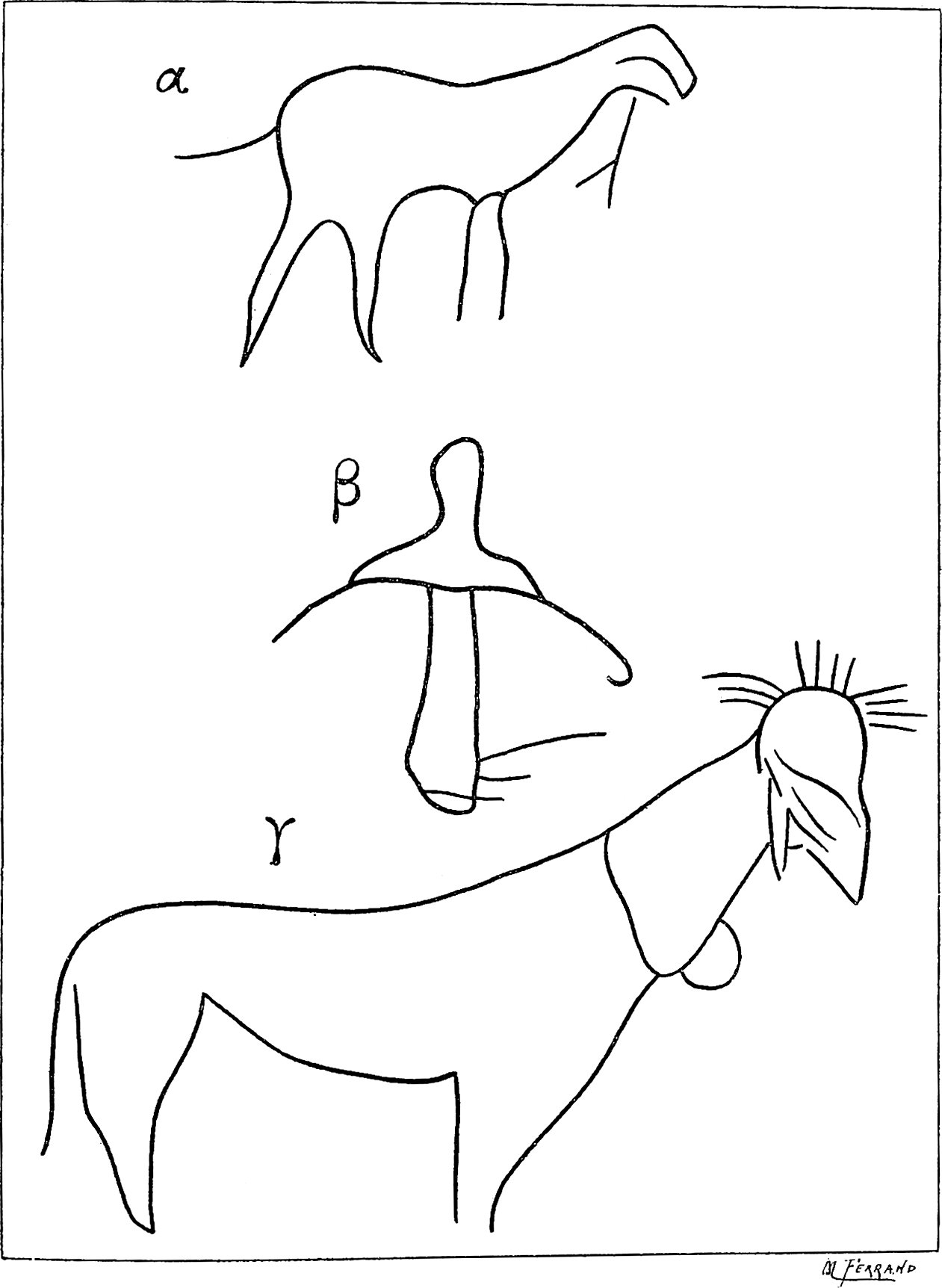
Fig. 11. — Gravures rupestres du col de Zenaga. α a 0m,40 de la tête à la croupe ; β a 0m,28 de la tête à la base ; γ a 0m,82 de la tête à la queue.
(Figure extraite de L’Anthropologie. Masson et Cie, édit.)
Mais la plus intéressante de ces gravures est sans contredit, comme le capitaine Normand l’a bien reconnu, celle du bélier ou du bouc, coiffé d’un sphéroïde muni d’appendices (uræi) ; au sujet d’un animal[90] tout à fait analogue une longue discussion a eu lieu au Congrès international d’Anthropologie de 1900[66]. La question agitée était celle de ses affinités égyptiennes ; on a cru reconnaître dans le sphéroïde un disque solaire flanqué de chaque côté d’un serpent uræus ; ce serait[91] une représentation du grand dieu de Thèbes en Égypte, Ammon ; et dès lors on peut se demander, suivant l’antiquité plus ou moins grande qu’on attribue aux gravures rupestres, si c’est la gravure sud-oranaise dont l’inspiration est venue d’Égypte, ou si au contraire c’est le dieu Ammon qui est d’origine libyenne.
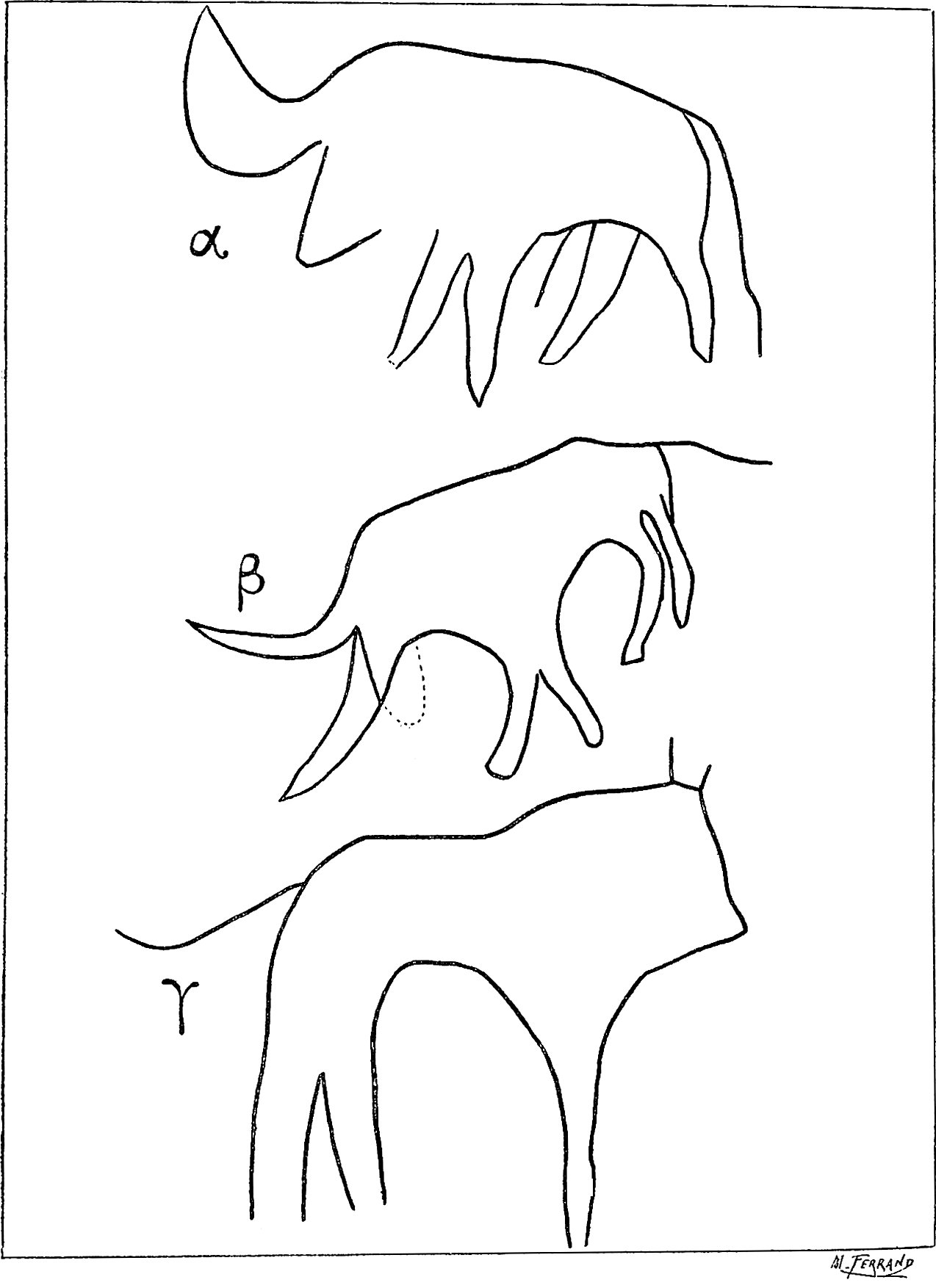
Fig. 12. — Gravures rupestres du col de Zenaga. α a 0m,48 des cornes à la croupe ; β a 0m,46 des cornes à la croupe ; γ a 0m,45 du museau à la croupe.
(Figure extraite de L’Anthropologie. Masson et Cie, édit.)
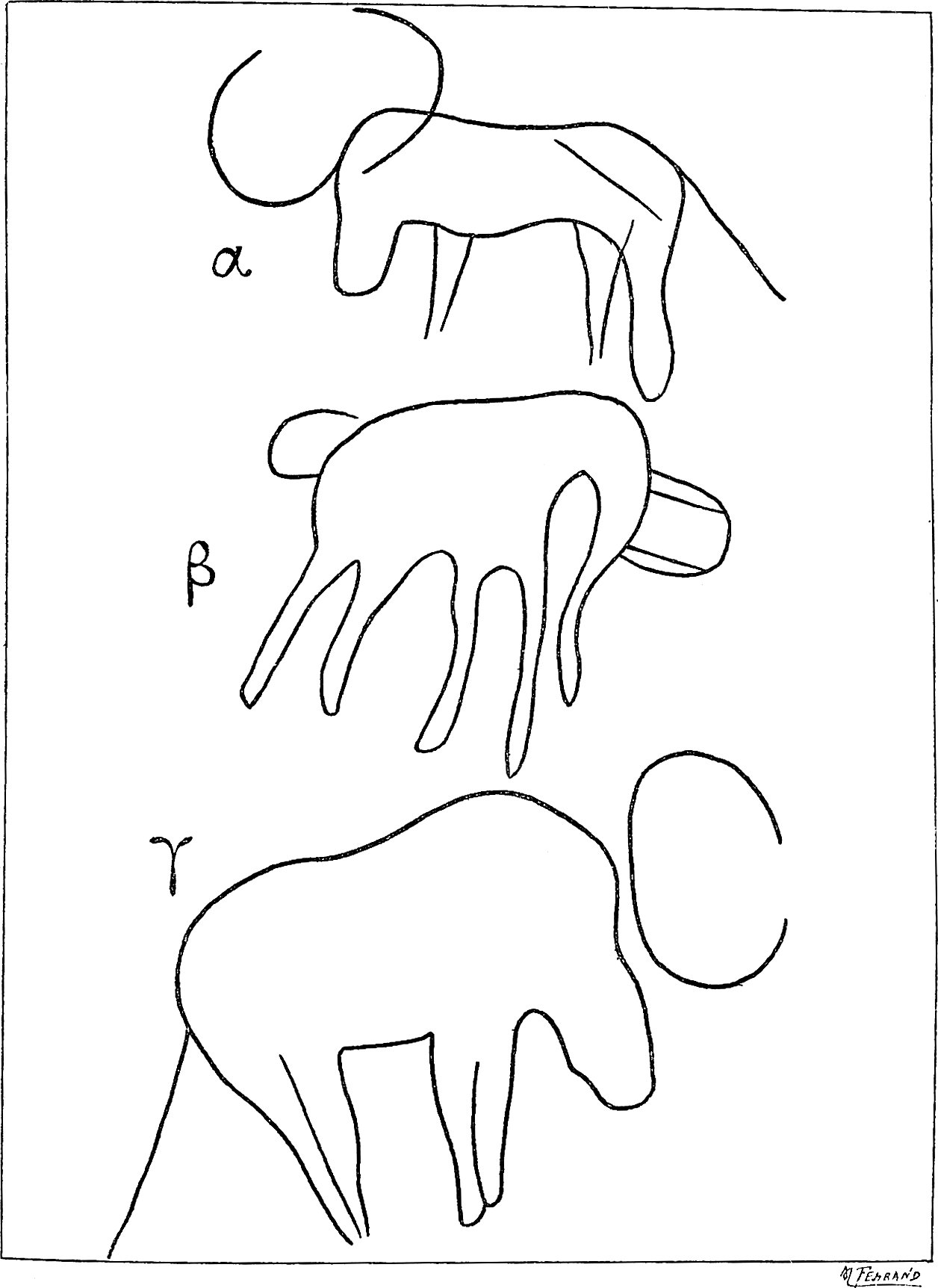
Fig. 13. — Gravures rupestres du col de Zenaga. α a 0m,43 de la corne droite à la croupe ; β a 0m,39 de la pointe des défenses à la croupe ; γ a 0m,53 de la pointe des cornes à la croupe.
(Figure extraite de L’Anthropologie. Masson et Cie, édit.)
[92]On a publié jusqu’ici deux exemplaires seulement du bouc casqué[67], tous deux communiqués par M. Flamand et provenant l’un et l’autre de la station de Bou Alem. Je sais que M. Flamand en possède d’autres dans ses cartons[68] de provenances diverses, mais toujours sud-oranaise. Voilà donc le bouc casqué classé parmi les sujets familiers aux graveurs rupestres.
Le bouc du col de Zenaga (fig. 14) se distingue de ceux de Bou Alem par certains détails, le dessin de la tête est un peu différent, le chanfrein moins accusé ; la barbiche très nette ; mais ce trait si particulier de la corne rabattue en bas et en avant ne laissent guère de doute sur l’identité de l’animal avec celui où Gaillard a cru reconnaître Ovis longipes.
Les accessoires sont à peu près les mêmes qu’à Bou Alem ; l’animal porte un collier, auquel on pourrait croire qu’est suspendu un objet de forme ovoïde ; mais peut-être est-il préférable d’admettre une faute de dessin ayant amené un entre-croisement des lignes. Le graveur semble avoir fait le collier d’abord et n’avoir pas pu ensuite y faire entrer le cou. Le sphéroïde n’est pas rattaché par une bride au-dessous du menton ; mais les uræi (?) sont dessinés comme à Bou Alem et rattachés à peu près au même point. A noter la présence autour du sphéroïde de lignes divergentes et rayonnantes vers l’extérieur ; un détail qui rendrait vraisemblable l’identification du sphéroïde au disque solaire.
La gravure est à peu près de grandeur nature, un mètre exactement de la tête à la queue. Ces grandes dimensions sont cause que les pieds de l’animal sont restés en dehors de mon calque ; ils ne figurent donc pas sur le dessin ci-joint ; ils ne sont d’ailleurs ni aussi soignés ni aussi bien conservés que le reste de la figure ; la corne n’est certainement pas dessinée ; mes souvenirs sur ce point sont corroborés par l’examen d’une photographie, obligeamment communiquée par M. Flamand. A cela près la gravure est très belle ; tout l’espace circonscrit par les lignes extérieures de la figure est évidé et soigneusement poli, l’évidement étant régulièrement décroissant des lignes extérieures au centre. C’est ce que le dessin cherche à rendre en entourant la figure d’un grisé qui veut schématiser les aspérités de la roche.
Il est impossible de concevoir une figure pareille, représentant un aussi gros effort, comme un graffitti de pâtre qui s’amuse. La[93] gravure est sur un pan de roche vertical, difficilement accessible, du moins aujourd’hui, et dominant la palmeraie. Elle se verrait de loin si sa patine ne la rendait indiscernable. On échappe difficilement à la conclusion qu’elle avait une signification religieuse.
Cette énumération des gravures du col de Zenaga est loin d’être complète. Je regrette en particulier de n’avoir pas calqué une autruche très nette, quoique médiocrement dessinée.
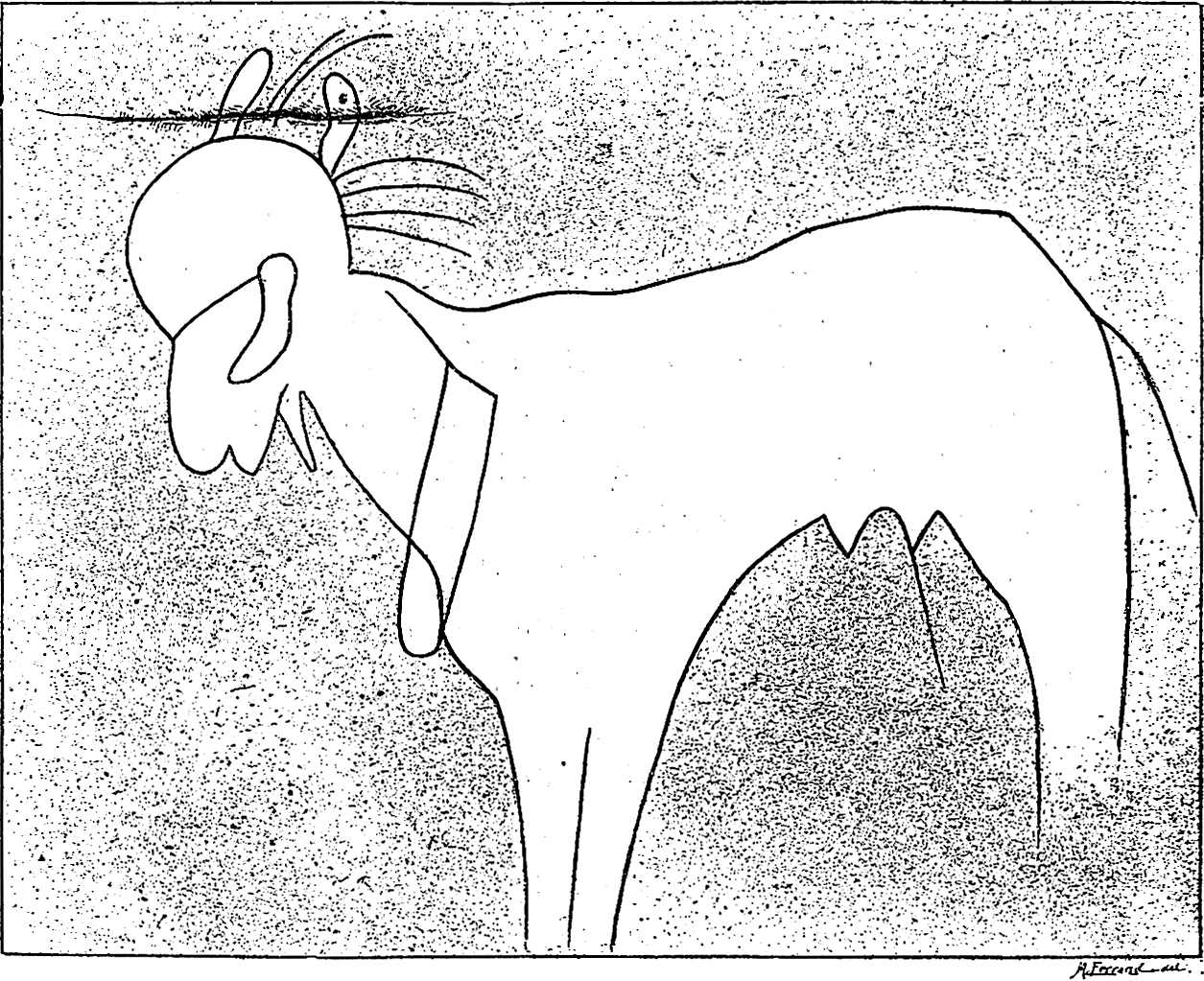
Fig. 14. Gravure du col de Zenaga. Dimension : 1 mètre de la tête à la queue. Toute la partie du dessin restée en blanc est soigneusement évidée et polie dans l’original.
(Figure extraite de L’Anthropologie. Masson et Cie, édit.)
J’ai négligé systématiquement les gravures modernes rentrant dans la catégorie de celles que M. Flamand a baptisées libyco-berbères, reconnaissables au premier coup d’œil à leur grossièreté, à l’absence de patine, au trait sans profondeur et « pointillé », comme aussi aux inscriptions qui les accompagnent. Au col de Zenaga la seule inscription de quelque longueur est en langue arabe (versets du Coran) ; les inscriptions en caractères libyco-berbères sont rares et de quelques lettres. Les gravures mêmes de cette époque sont en proportion extrêmement faible, comparée aux autres ; j’ai noté des sceaux de Salomon, des sandales (pourtour extérieur d’un pied[94] humain ou plutôt d’une sandale). Ces dernières plus intéressantes puisqu’elles abondent en pays Touareg.
Station de Barrebi. — A 150 kilomètres au sud de Figuig, le long de la Zousfana, j’ai longuement étudié la station de Barrebi[69].
Barrebi est un ksar dans l’oasis des Beni Goumi, plus connu sous le nom de Tar’it.
Les gravures s’alignent, pendant un kilomètre peut-être, sur la tranche d’une couche de grès, surmontée en stratification concordante par une couche fossilifère de calcaire dinantien.
Ce grès, probablement carboniférien, se trouve être beaucoup moins résistant aux intempéries que les grès crétacés de la chaîne des ksour où ont été relevées jusqu’ici la plupart des gravures rupestres connues en Algérie. La paroi de grès est très ébouleuse, très effritée, il est donc possible que les gravures les plus anciennes et par conséquent les plus belles aient disparu.
En tout cas les gravures subsistantes à Barrebi sont bien moins soignées et moins intéressantes que celles, toutes voisines pourtant, du col de Zenaga à Beni Ounif.
Il en est cependant plusieurs d’incontestablement anciennes, à en juger non seulement par les dimensions, la profondeur du trait et la patine, mais aussi par les animaux représentés. Dans la figure 15, 1 est un éléphant incontestable, si mal dessiné qu’il soit ou du moins je n’imagine pas qu’il puisse être autre chose.
3, 5 et peut-être 2, 6 et 7 sont des représentations de Bubalus antiquus, bien mauvaises il est vrai. L’immense développement des cornes dans 3 et 5 ne laisse pas de place au doute. Mais nous sommes loin de tant de belles gravures publiées représentant cet animal. Il faut noter qu’un Bubalus antiquus (no 5) porte sur le dos ce qui semble bien être la représentation conventionnelle d’un bât.
4 est intéressant parce qu’il présente une analogie évidente avec des gravures publiées par Pomel (Pl. XI, fig. 1, 2, 3)[70] et où il a cru reconnaître le gnou, dont il signale en Algérie des ossements fossiles. (Voir pl. XV, phot. 30.) On pourrait d’ailleurs reconnaître à la rigueur un gnou dans les nos 2 et 6 à la direction « apparente » des cornes. Pourtant je crois bien que 6 représente un bœuf quelconque et 2 un Bubalus antiquus bâté. Pour cette dernière figure en particulier, il suffit de supposer que la tête de la bête est[95] représentée à profil perdu et que par conséquent il manque une corne.
Même le no 4 est trop informe, je crois, pour qu’on y reconnaisse avec certitude un gnou, d’autant plus que les figures publiées par Pomel ne sont pas meilleures. Il me semble que l’existence du Gnou dans les gravures rupestres nord-africaines reste encore à démontrer.
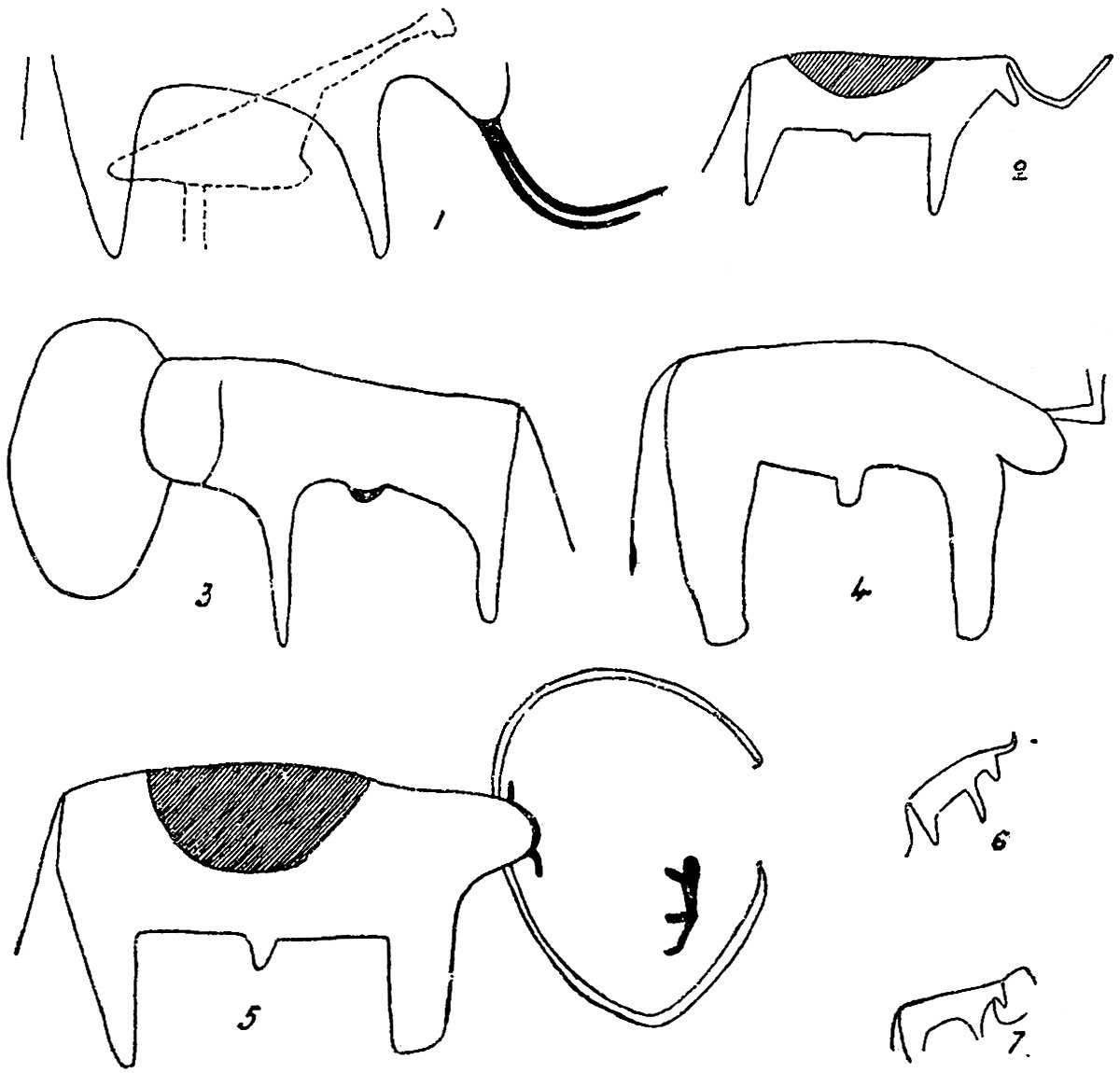
Fig. 15. — Gravures rupestres de la station de Barrebi. — Réduction au vingtième d’après un calque ; 1, par exemple, a 1m,20 des défenses à la queue.
1. Éléphant. — 3 et 5. Bubalus antiquus. — 2, 4, 6 et 7. Incertains.
(Figure extraite de L’Anthropologie. Masson et Cie, édit.)
Il faut noter d’ailleurs que le no 4 s’il est de grande taille et dessiné d’un trait ferme est peu patiné.
Les nos 1, 2, 5 et 6 de la figure 16 représentent la même antilope à cou allongé, à cornes recourbées en avant quoique 6 soit de facture différente et manifestement plus récente. (Voir pl. XV, 30.) Ce sont d’assez jolies figures en somme, et quoiqu’il manque les pattes à 1 et le museau à 5, la silhouette de l’animal est rendue dans les quatre figures d’une façon concordante et nette. On imagine assez[96] bien la bête. Il est difficile d’y reconnaître une quelconque des antilopes algériennes actuelles. La gazelle, le mouflon et l’adax sont exclus sans contestation possible par la forme des cornes. Il ne serait peut-être pas impossible de songer au bubale (Bos elaphus), chez qui pourtant les cornes sont épaisses et courtes, et affectées d’une courbure en avant bien peu sensible. On comprend que Pomel, reproduisant une figure de ce genre[71], ait cherché à la rapprocher d’une espèce fossile « Antilope (Nagor) maupasii analogue au Mbil (Antilope Laurillardi) ». Aujourd’hui pourtant nous savons qu’il existe, sinon en Algérie du moins à proximité, dans le Sahara des Touaregs, une antilope qu’il serait raisonnable de reconnaître dans nos figures, c’est le Mohor, antilope de Sœmmering[72].
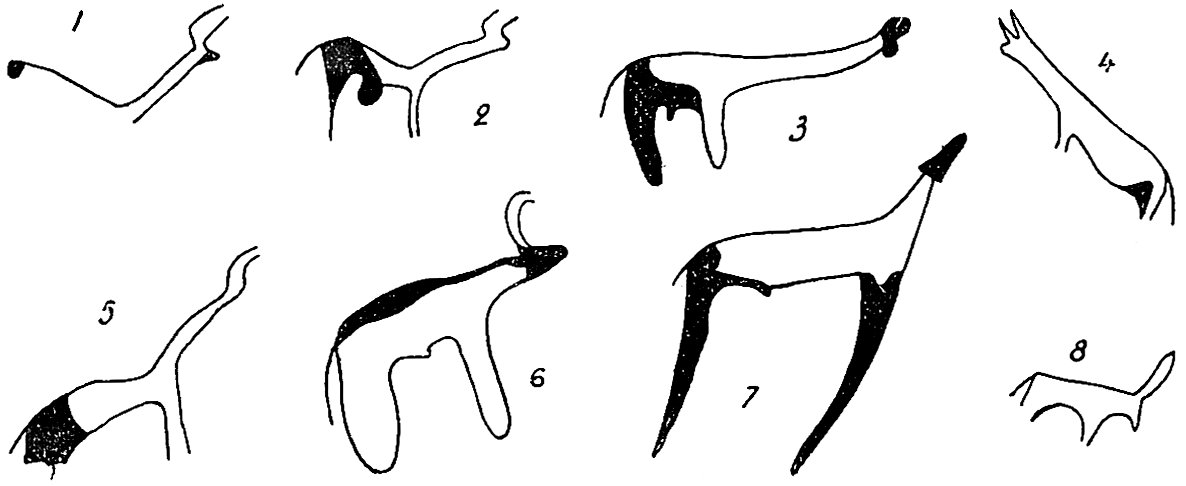
Fig. 16. — Gravures rupestres de la station de Barrebi. Réduction au vingtième d’après des calques du lieutenant Pinta.
1, 2, 5 et 6. Antilope Mohor (?) — 3, 4, 7 et 8. Incertains.
(Figure extraite de L’Anthropologie. Masson et Cie, édit.)
Dans les nos 3, 4 et 7 de la figure 16 je ne sais pas s’il serait bien sage de prétendre reconnaître quelque chose, non plus peut-être que dans le no 8 encore bien que la longueur des cornes semble indiquer une antilope adax. Y a-t-il lieu de formuler derechef à propos de 3 et 7 l’hypothèse de l’okapi[73] ?
Le no 2 de la figure 17 est tout à fait remarquable par sa facture très soignée, tout l’intérieur est excavé, lisse et patiné ; c’est de beaucoup la plus belle gravure de la station. 2 et 3 me paraissent représenter le même animal, un taureau vulgaire, quoique Pomel, dans une figure de ce genre, veuille reconnaître une espèce fossile « Ægoceras lunatus, proche parent de Kobus et autres cavicornes quaternaires[74] ».
[97]1 est bien grossier, de facture récente, sans patine (comme 3 d’ailleurs) ; à la direction de la corne, recourbée devant les yeux, il semble bien qu’il faille reconnaître le bœuf algérien actuel, si fréquemment figuré, Bos ibericus.
Dans une gravure tout à fait semblable à 5, Pomel veut reconnaître « un grand Échassier de la famille des Cigognes et des Grues »[75]. Ici il est manifestement impossible de le suivre, l’éminent géologue est victime du point de vue paléontologique auquel il se place. C’est la figuration conventionnelle classique de l’autruche dans toutes les gravures rupestres nord-africaines.
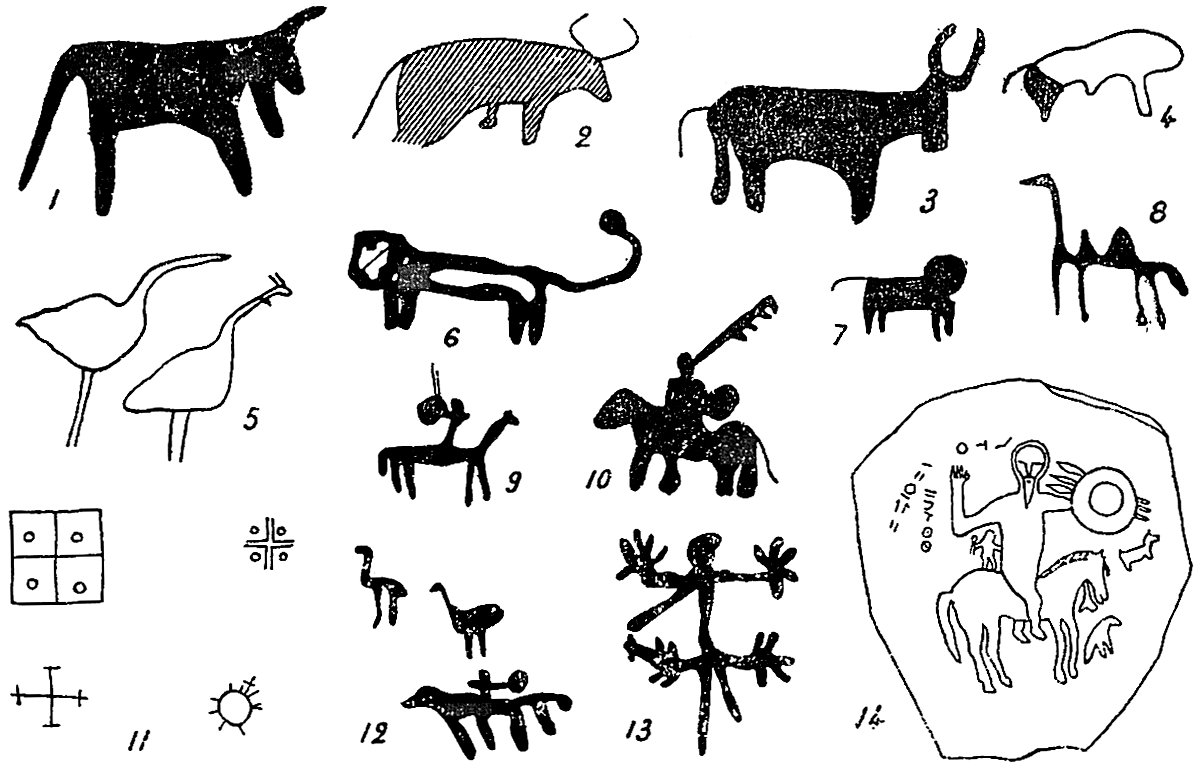
Fig. 17. — Gravures rupestres de la station de Barrebi. — Réduction au vingtième d’après des calques du lieutenant Pinta.
1. Bos ibericus. — 2 et 3. Bœufs (2 très soigné). — 5. Autruche. — 4, 6, 7. Lion. — 8. Chameau. — 9, 10, 12. Cavalier numide. — 14. Stèle funéraire du musée d’Alger.
(Figure extraite de L’Anthropologie. Masson et Cie, édit.)
Les figures commentées jusqu’ici sont d’antiquité inégale ; s’il fallait, au point de vue chronologique, attribuer une valeur absolue à la facture, au fini de l’exécution, 2 de la figure 17 tout seul, en y joignant peut-être 1, 2 et 5 de la figure 16, mériterait d’être rangé dans la catégorie de gravures rupestres anciennes ; mais toutes ces gravures du moins, même les moins patinées, sont de grandes dimensions, et circonscrites d’un trait net.
Celles dont il nous reste à parler sont franchement libyco-berbères et évoluent vers le schéma, le graphisme conventionnel. A noter des images de carnassiers, de lion peut-être (4, 6 et 7 de la fig. 17),[98] une figuration de chameau (8), une gravure tout à fait indéchiffrable (13), et enfin des cavaliers porteurs du bouclier rond et des trois sagaies. C’est l’ornement classique des Libyens sur les stèles d’Alger[76].
J’ai reproduit ci-contre une de ces stèles provenant de la Grande-Kabylie. L’analogie saute aux yeux. Il est clair que nous avons dans ces trois gravures 9, 10 et 12 une représentation grossière du « cavalier numide » ou « gétule ».
Ce sont les seules figures humaines que j’aie notées dans la station avec une toute petite figure à phallus dressé entre les cornes du Bubalus antiquus.
Station d’Aïn Memnouna. — Je n’ai pas vu la station d’Aïn Memnouna. Mais M. le lieutenant Voinot a bien voulu m’adresser à son sujet des dessins et des notes détaillées.
Elle est relativement voisine de Barrebi, dans une région qu’on peut encore considérer comme une dépendance de l’Atlas, entre la Zousfana et le Guir, mais plus près du Guir. « La station, dit le lieutenant Voinot, est à environ 1500 mètres au sud de la source, en dehors de la gorge et à l’est du medjbed allant du Guir à l’Aïn Memnouna. Les dessins sont gravés sur les pierres de la hammada.
« Les dessins de la station de l’Aïn Memnouna présentent les mêmes caractères que ceux attribués à l’époque préhistorique par M. Flamand. La gravure est faite en creux au simple trait de 1 à 2 mm. de largeur et de faible profondeur, surtout dans quelques parties fort usées. Le trait est patiné dans le même ton que le grès. Les lignes des gravures ont été tracées avec une grande sûreté de main. Les allures générales des animaux représentés dénotent un réel essai d’observation de la nature, et la plupart des dessins ne manquent pas de grâce malgré la simplicité de leur exécution. »
En somme, la station est à plat, à même la hammada, sous les pieds des passants, sur des plaques de grès horizontales. Le cas n’est pas isolé quoique, en général, le graveur utilise une paroi verticale.
Les gravures sont incontestablement anciennes.
M. Voinot ne dit pas qu’il ait estampé ou calqué ; ses reproductions sont, je crois, de simples dessins, ne visant pas à une exactitude rigoureuse. La station d’ailleurs est très éloignée de nos postes actuels, elle n’a été vue qu’en passant au cours d’une randonnée rapide.
[99]Ces dessins de M. Voinot sont au nombre de sept (fig. 18). Dans le 1 il reconnaît une antilope adax ; dans le no 3 une gazelle (le dessin géométrique à côté de la gazelle restant indéterminable)[77] ; dans le no 5 M. Voinot croit reconnaître un demman, mouton à poil ; mais, sous cette réserve qu’il a vu la gravure elle-même, il me semble que le dessin, à tout le moins, suggérerait plutôt l’idée d’un Bos ibericus, bœuf à cornes recourbées devant les yeux (?) Pour M. Voinot, 2 est un âne, 6 un taureau, 4 une figure cabalistique, et 7 derechef un taureau. « C’est la plus belle gravure de la station sans contredit ; les longs poils du mufle et de l’organe sexuel sont nettement représentés. Ce bœuf a l’air de porter une selle. »
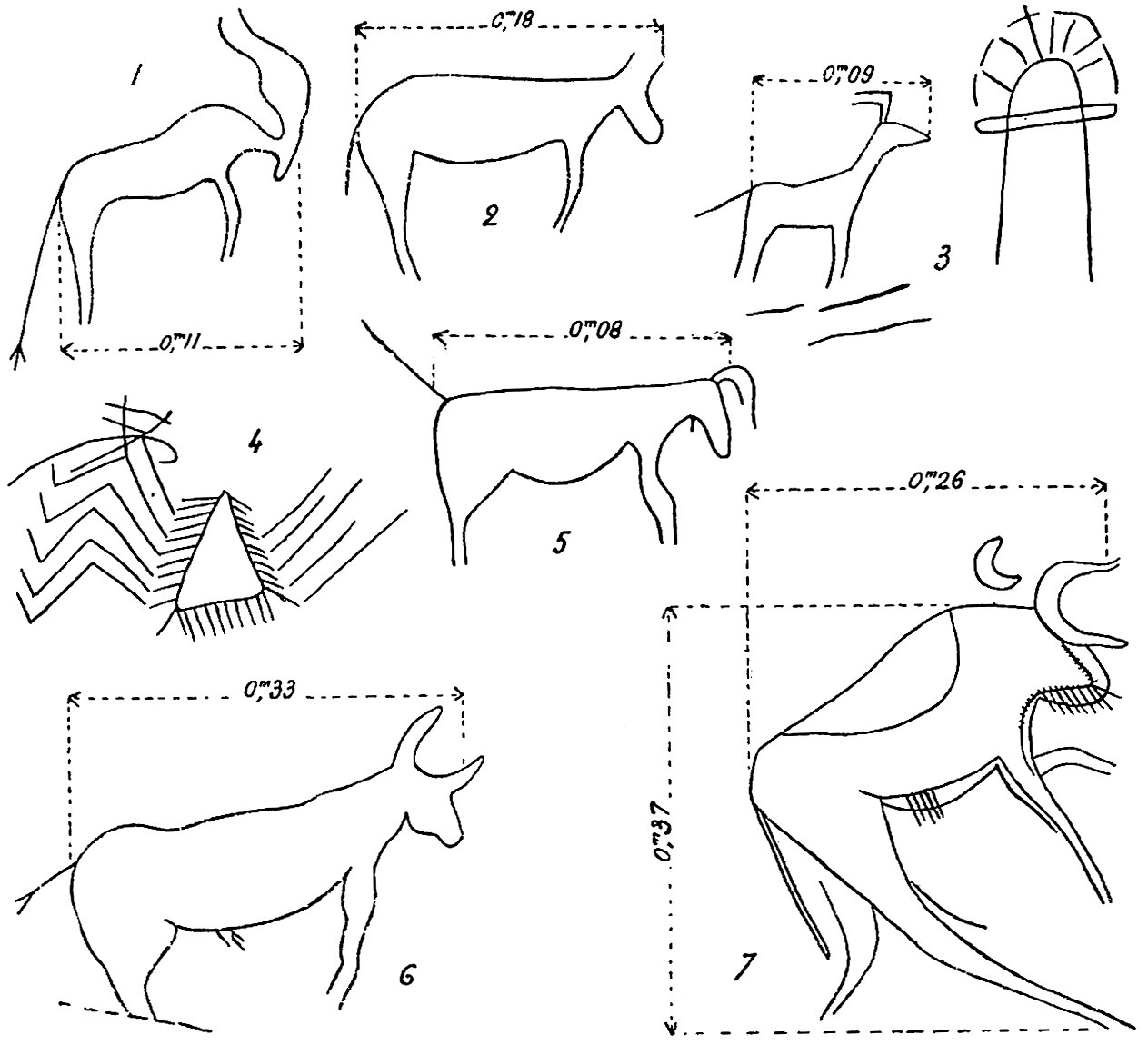
Fig. 18. — Gravures rupestres de la station d’Aïn Memnouna. — Dessins de M. le lieutenant Voinot.
1. Antilope adax. — 2. Ane ? — 3. Gazelle. — 5. Mouton ou bœuf ? — 6 et 7. Taureau.
(Figure extraite de L’Anthropologie. Masson et Cie, édit.)
[100]Station de Hadjra Mektouba. — A mi-chemin entre Beni Abbès et Kerzaz, sur la rive droite de la Saoura, à 4 ou 5 kilomètres de l’oued une couche de calcaire mésodévonien affleure au milieu des dépôts continentaux mio-pliocènes et forme une sorte de trottoir large à peine d’une dizaine de mètres et long de plusieurs kilomètres. (Voir pl. XXXII, phot. 61.) Cet affleurement est couvert de dessins rupestres et porte en conséquence le nom de Hadjra Mektouba (les pierres écrites)[78].
Il n’est pas tout à fait sans exemple que des dessins rupestres soient gravés sur le calcaire. M. Flamand signale une station de ce genre dans le Tadmaït[79]. Elles sont très rares.
A la station de Hadjra Mektouba, ce qui frappe d’abord ce sont des inscriptions arabes récentes ; on reconnaît facilement des actes de foi (il n’y a de Dieu que Dieu, etc.). La station se trouve, en effet, sur le chemin des pèlerins qui vont à la zaouia très vénérée de Kerzaz.
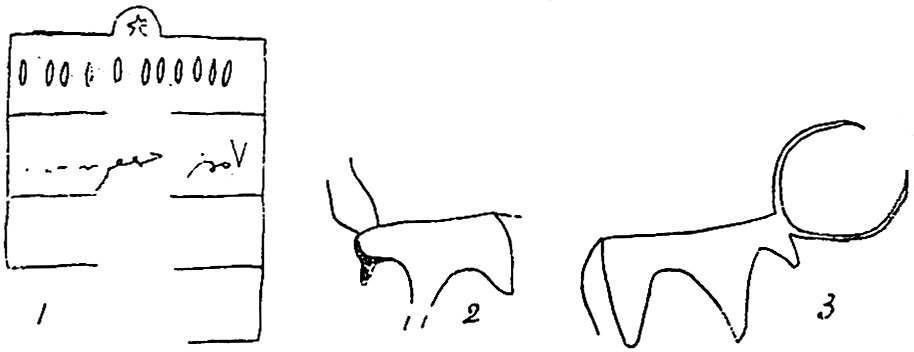
Fig. 19. — Gravures rupestres de la station de Hadjra Mektouba.
Réduction au vingtième d’après calques.
(Figure extraite de L’Anthropologie. Masson et Cie, édit.)
J’ai relevé (fig. 19, no 1) une inscription arabe, d’ailleurs indéchiffrable, encadrée dans une figure géométrique, dont M. Basset, l’arabisant éminent, directeur de l’École des Lettres, ignore la signification. A titre d’hypothèse il suggère l’idée que ce pourrait être un mekkam (souvenir d’un marabout quelconque qui aurait séjourné, prié, etc., sur ce point précis). A coup sûr la station de Hadjra Mektouba est au point de vue islamique une sorte de lieu saint.
On distingue aussi quelques lettres tifinar’, mais en petit nombre, et de mauvaises gravures libyco-berbères ; j’ai noté un méhariste à bouclier rond.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XVI. |

Cliché Gautier
31. — GRAVURE RUPESTRE DANS L’OUED TAR’IT (Ahnet)
Sur grès éo-dévonien.
L’animal représenté est une girafe.

Cliché Gautier
32. — GRAVURE RUPESTRE, A TAOULAOUN (Mouidir)
sur grès éo-dévonien.
Le sujet représenté est une chasse au mouflon ; pour pouvoir photographier, on a passé les figures à la craie.
[101]C’est là tout ce qu’on aperçoit au premier abord, et l’on serait tenté de croire que les gravures anciennes ne sont pas représentées. A y regarder de près pourtant, on les trouve en grand nombre, mais si effacées qu’elles sont à peine discernables. Il faut chercher pour chaque coin de pierre l’éclairage favorable ; et sous un certain jour on voit se révéler de vieux dessins flous mais incontestables, des arrière-trains, des pattes, souvent même l’animal entier (antilopes, animaux cornus [?]) (Voir nos 2 et 3.)
L’aspect de la roche explique facilement la disparition presque totale des vieilles gravures. La face du calcaire porte distinctement l’empreinte des pluies pourtant si rares. Le calcaire évidemment, par sa sensibilité à l’action chimique des pluies, conserve beaucoup plus mal la gravure que le grès, par exemple.
Il me semble curieux que je n’en aie pas vu dans toute la chaîne d’Ougarta, où pourtant les grès éodévoniens, extrêmement développés auraient dû attirer le graveur. Il se peut il est vrai qu’elles m’aient échappé. Cette hypothèse est même très vraisemblable.
Stations des oasis et du Tadmaït. — En revanche dans la région des oasis et le Tadmaït, qui sont relativement connus, les gravures sont assurément rares et peu intéressantes. Ce sont surtout des inscriptions (tifinar’ ou libyco-berbères !). J’en ai vu à Tesfaout (Timmi), à Ouled Mahmoud (Gourara), dans l’oued Aglagal (Tidikelt — et nota bene sur une dalle calcaire), à Haci Gouiret (au sud d’In Salah). M. le commandant Deleuze en a relevé une près de Tesmana (Gourara)[80]. M. Flamand à Haci Moungar, à Aïn Guettara[81]. Il en existe assurément d’autres et cette énumération n’a pas la prétention d’être exhaustive. Mais on sait que, dans l’état actuel de nos connaissances, ces inscriptions sont indéchiffrables ; on ne peut donc que les mentionner.
On ne connaît sur cette grande étendue que trois stations de gravures rupestres assez médiocres, à Tilmas Djelguem (sur calcaire), à la gara Bou Douma, et à Aoulef (gara des Chorfa)[82]. Ajoutons, quoiqu’un peu en dehors de la zone quelques grafitti insignifiants que j’ai vus sans les copier à Haci Ar’eira (au sud du Tidikelt). Sous réserve de découvertes ultérieures il semble donc qu’une zone intermédiaire[102] assez pauvre sépare les deux régions riches en gravures du nord et du sud — l’Atlas et les plateaux Touaregs.
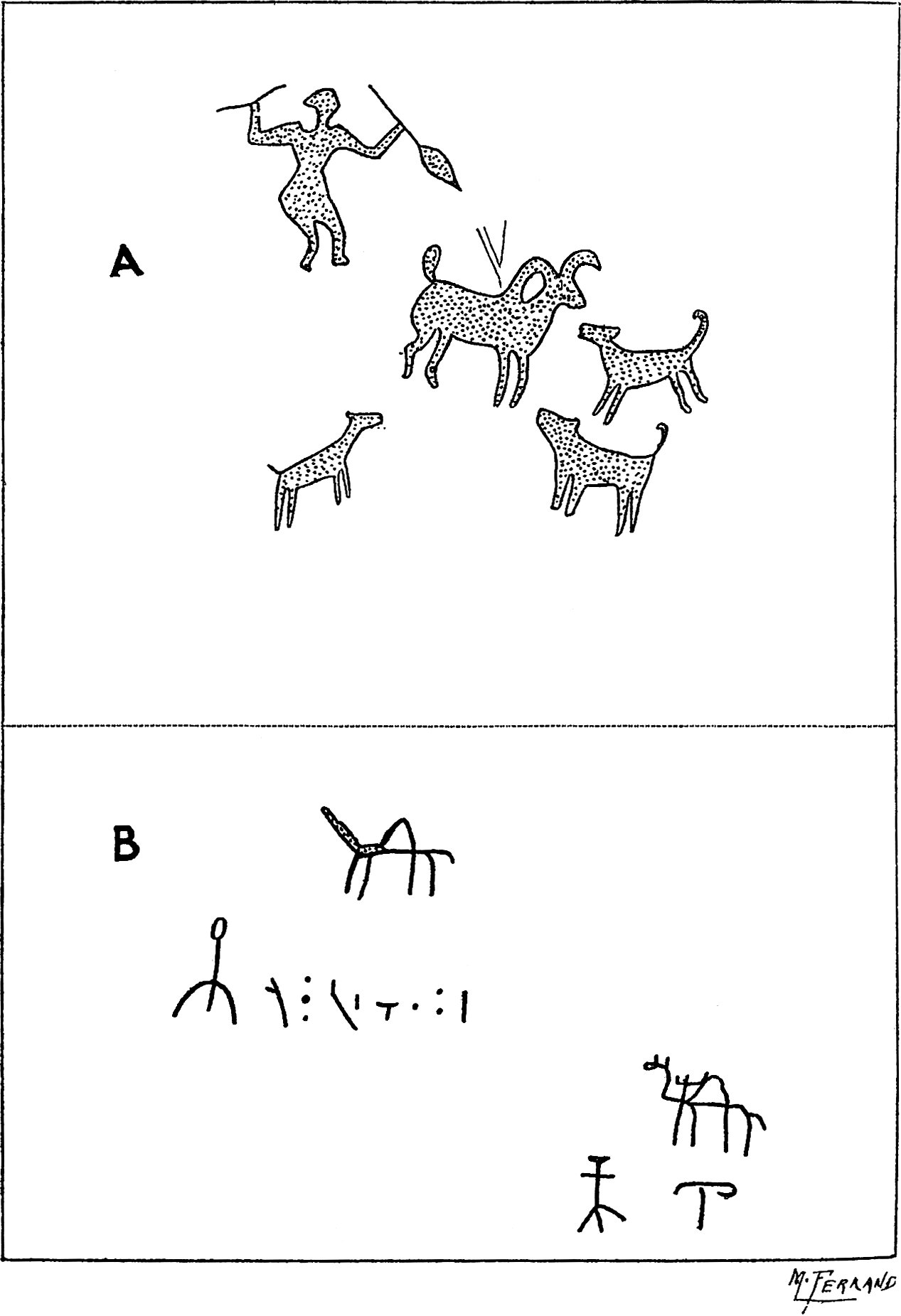
Fig. 20. — Taoulaoun.
A, d’après une photographie. Hauteur du mouflon au garrot, 0 m. 30 à 0 m. 40. B, hauteur du chameau (?), 0 m. 05. Ici, comme dans les figures suivantes, les grisés marquent la surface grattée, c’est-à-dire où la patine de la surface environnante a été enlevée par grattage.
(Figure extraite de L’Anthropologie. Masson et Cie, édit.)
Stations des plateaux Touaregs. — La zone privilégiée me paraît[103] être celle des plateaux gréseux éodévoniens. En tout cas au Mouidir occidental et dans l’Ahnet j’ai vu huit stations dont cinq ou six intéressantes. Ce sont, au Mouidir : Taoulaoun, à côté du point d’eau, — jolie chasse au mouflon reproduite figure 20. (Voir aussi pl. XVI, phot. 32.)
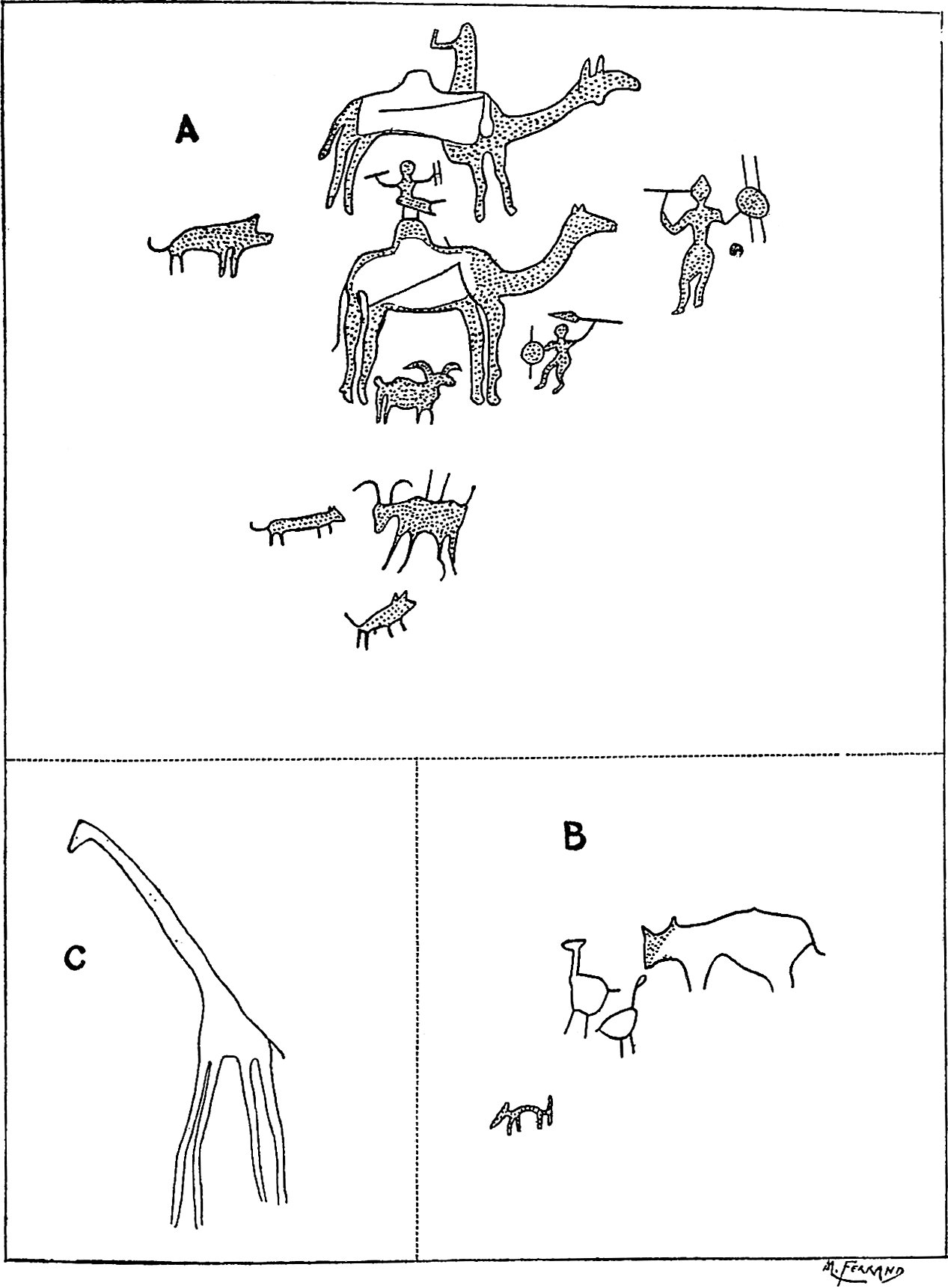
Fig. 21. — Oued Tar’it.
A, d’après une photographie assez indistincte et un dessin ; hauteur totale de l’espace occupé par les personnages, 2 mètres environ. B, hauteur des autruches, 0 m. 15 environ. C, d’après une photographie, 0 m. 60 environ de hauteur.
(Figure extraite de L’Anthropologie. Masson et Cie, édit.)
[104]Tahount Arak, au point d’eau — gravures insignifiantes, et qui n’ont pas été reproduites. Elles sont à 3 ou 4 mètres au-dessus du sol, sur la corniche en surplomb d’un énorme bloc rocheux détaché, et actuellement inaccessibles sans échelle ce qui est un cas très rare.
Dans l’Ahnet : Taloak, 100 mètres à l’est du point d’eau, au sommet d’une petite falaise, tifinar’ et grafitti insignifiants, qui n’ont pas été reproduits.
Foum Zeggag, dans les gorges de ce nom, à deux heures de marche au sud de Taloak, rive droite de l’oued ; je n’ai vu, en passant, que deux médiocres éléphants. (Voir fig. 25, no 1.)
Oued Tar’it, rive gauche, à une quinzaine de kilomètres environ au nord d’Aguelman Tamana. Très belle station, grands méharis montés figurant dans une scène de guerre ou plutôt de chasse ; — girafe soignée ; — reproduits figure 21. (Voir aussi pl. XVI, phot. 31.)
Aguelman Tamana ; au point d’eau, rive gauche de l’oued, — station intéressante, grands bovidés, dont quelques-uns bâtés, reproduits figure 22.
Ouan Tohra, au pied de la haute falaise qui avoisine le puits, sur de gros blocs éboulés ; station riche et intéressante, et qui, par surcroît, a pu être étudiée longuement ; bovidés et animaux divers, reproduits figures 24, 25. (Pl. XVII, phot. 33.)
Tin Senasset, au point d’eau ; sur blocs éboulés au pied de la falaise ; bovidés, un cheval ; reproduits figure 23.
Ces huit stations ont été découvertes par hasard, parce qu’elles sautaient aux yeux, au cours d’un raid à méhari. Il y a donc lieu de supposer qu’une investigation minutieuse en fera découvrir beaucoup d’autres.
On en a d’ailleurs signalé d’autres. M. Voinot a publié des tifinar’, des inscriptions arabes, des empreintes de pieds, et quelques vagues grafitti, copiés dans les gorges de Tir’atimin ; — il nous a donné aussi une reproduction intéressante d’une petite scène de chasse à l’Aïn Tér’aldji. Ces deux stations sont dans le Mouidir occidental[83].
Motylinski suivant un itinéraire connu a pourtant relevé quelques petites stations nouvelles au Mouidir occidental — des tifinar’ à Haci el Kheneg — quelques autruches dans les gorges de Takoumbaret[105] — des tifinar’ et des grafitti à Hacian Meniet (déjà signalés par Guillo-Lohan)[84].
Notons que dans l’Açedjerad nous n’avons pas vu de gravures rupestres et M. Besset n’en signale pas dans le Mouidir oriental. Au Tassili des Azguers M. Foureau en a copié une seule[85]. Il se pourrait donc que l’Ahnet fût particulièrement riche pour des raisons qui échappent, historiques apparemment. Mais c’est une conjecture hasardeuse. L’exploration des plateaux éodévoniens Touaregs reste à faire au point de vue archéologique il est certain en tout cas que les grès de cet âge se prêtent admirablement à la gravure, et d’une façon générale en Algérie comme au Sahara le grès est par excellence matière épigraphique. Ces gravures du Mouidir-Ahnet, reproduites dans les figures 20 à 25 se prêtent à une étude d’ensemble. Non seulement elles sont toutes sur grès, et sur le même grès, mais à tous les points de vue ces stations diverses sont étroitement apparentées.
Elles sont toujours au voisinage immédiat d’un point d’eau, ou à tout le moins d’un pâturage actuellement fréquenté ; elles sont toutes aisément accessibles, à portée de la main, à une seule exception près, la station de Tahount Arak ; mais le roc isolé de Tahount Arak est au milieu de l’oued, son pied baigne dans l’eau, et il a suffi d’un bien petit nombre de crues pour produire l’affouillement qui met la gravure hors de portée. Il ne semble donc pas que les gravures remontent à une époque où le climat fut autre qu’aujourd’hui.
Cette impression de jeunesse est corroborée par l’étude même des figures. Je n’en vois qu’une ou deux susceptibles d’être classées anciennes, la girafe de la figure 21, C. D’après mes souvenirs, corroborés par une assez bonne photographie, cette gravure est tout à fait du type de celles de Zenaga ; la patine est aussi foncée que celle de la roche environnante, le trait est profond et régulier, on retrouve tous les caractères d’une grande antiquité. Du moins il me semble ainsi rétrospectivement ; à l’époque où j’ai vu cette girafe je n’étais malheureusement pas encore familier avec l’aspect des gravures rupestres de l’époque ancienne (en 1903) ; je trouve aussi mentionné dans mes notes que E de la figure 22 (bovidé) est très patiné.
Mais ces figures sont seules de leur espèce. Nous avons fait M. Chudeau et moi, en 1905, un séjour prolongé à Ouan Tohra, et, malgré des recherches attentives, nous n’avons pas trouvé une seule gravure d’aspect ancien. Elles semblent très rares sinon tout à fait absentes.
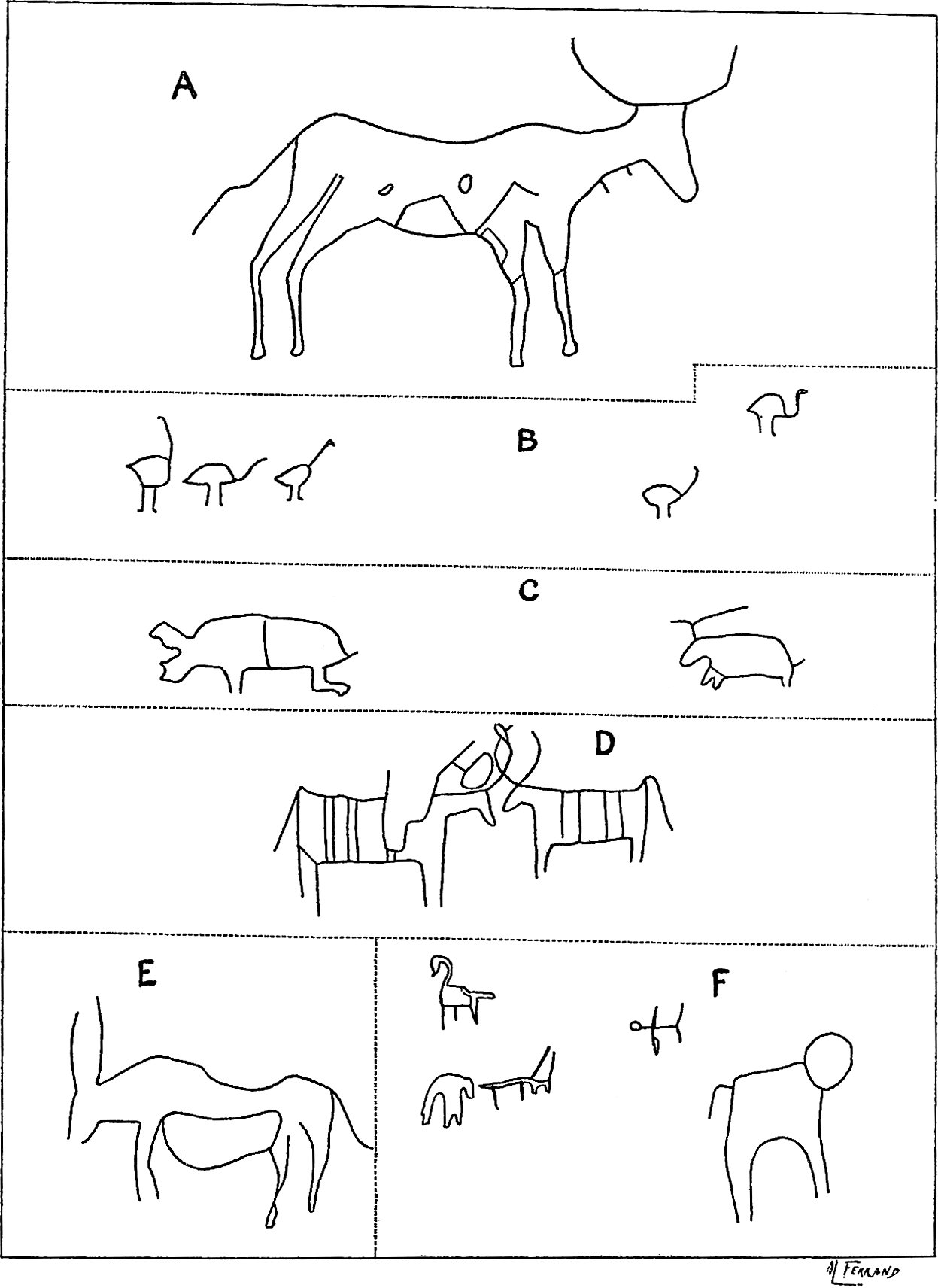
Fig. 22. — Aguelman Tamana.
A, 0 m. 50 de la tête à la queue. B, hauteur moyenne 0 m. 10 à 0 m. 15. C, 0 m. 20 à 0 m. 30 de la tête à la queue. D, 1 mètre de droite à gauche. E, 0 m. 50 de la tête à la queue. F, dessins de gauche 0 m. 10 en moyenne, celui de droite 0 m. 30.
(Figure extraite de L’Anthropologie. Masson et Cie, édit.)
[106]En somme, toutes les figures reproduites, moins une ou deux douteuses, sont indubitablement récentes. Et d’abord la faune reproduite n’est plus du tout celle du col de Zenaga. La présence du chameau est à elle seule significative. On est généralement d’accord pour[107] admettre que le chameau n’a été introduit ou réintroduit dans l’Afrique nord-occidentale que dans les premiers siècles de l’ère chrétienne, il ne semble y être abondant que vers l’époque de Justinien[86].[108] Sans entrer dans la question, c’est un fait positif qu’on ne connaît aucune figuration de cet animal dans les nombreuses stations déjà connues de vieilles gravures ; elles abondent au contraire dans les graffitti libyco-berbères.
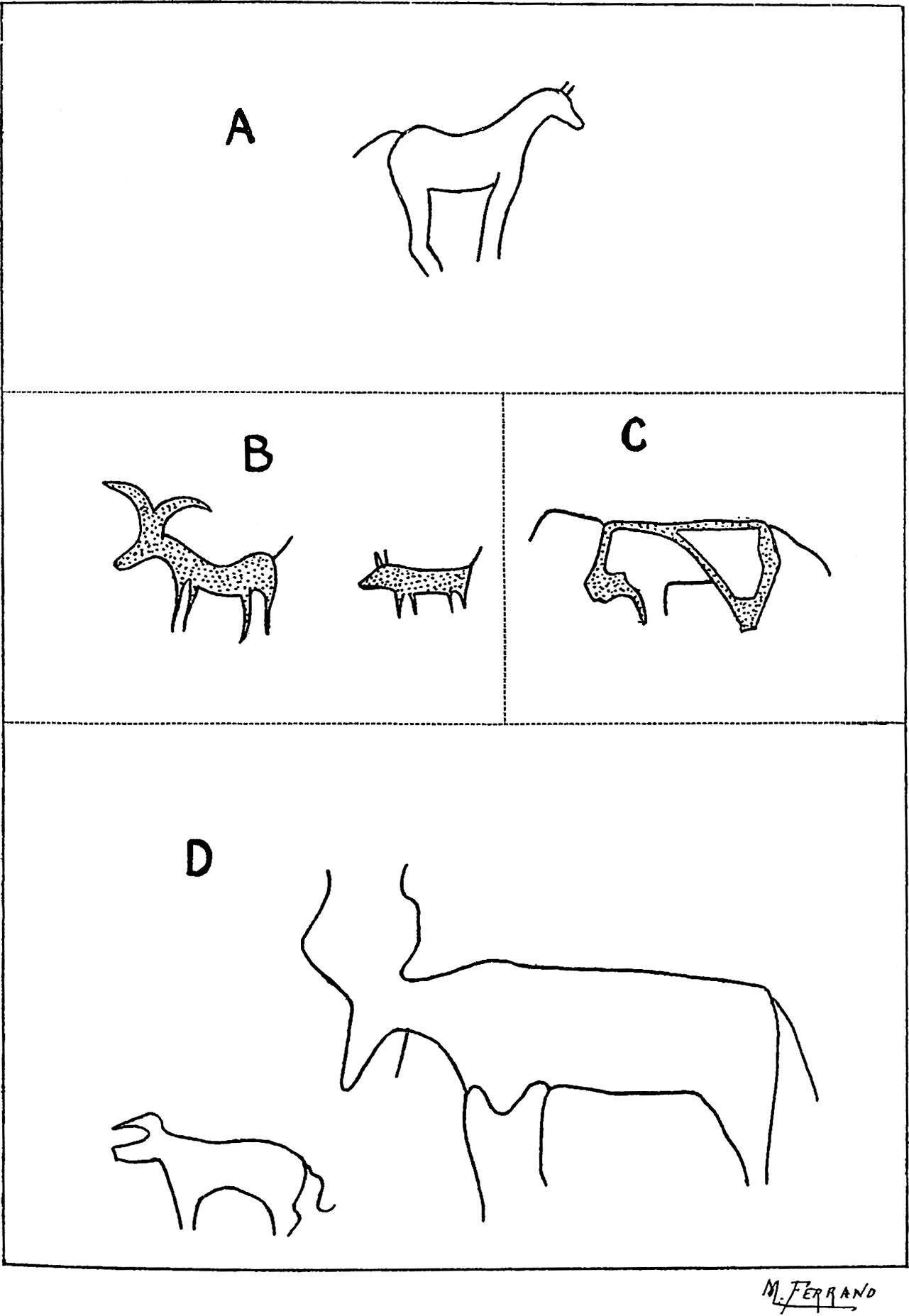
Fig. 23. — Tin Senasset.
A a 0 m. 15. B, 0 m. 08 à 0 m. 10. C, 0 m. 30. D, 1 mètre de la tête à la queue.
(Figure extraite de L’Anthropologie. Masson et Cie, édit.)
Tous les autres animaux qui accompagnent le dromadaire[87], dans les figures ci-jointes sont contemporains : le cheval (fig. 23, A) et l’âne (fig. 24, B) ; le mouflon (fig. 20, A), la gazelle (fig. 21, A) ; le chien (fig. 20 et 21) ; l’autruche (fig. 22, B ; fig. 24, B, et fig. 21, B) sont encore des animaux familiers aux habitants du Mouidir-Ahnet.
Il en est de même de l’animal figuré en A figure 24 et en 2 figure 25 qu’on y voie une chèvre ou une antilope adax.
Les bœufs sont très fréquents (fig. 22, A ; fig. 24, A et D ; fig. 23, D ; et sans doute aussi fig. 22, E). On les représente bâtés (fig. 22, D et fig. 25, no 5).
On sait que les bœufs zébus, originaires du Soudan, font partie du cheptel habituel au Hoggar[88]. Au Soudan à tout le moins on les utilise comme bêtes de somme.
Le sanglier (fig. 21, A) existe peut-être au Hoggar ? et en tout cas dans l’Adrar’ des Ifor’ass (phacochère), et dans l’Aïr.
La station de Foum Zeggag, qui par ailleurs est insignifiante, a ceci de particulier qu’on y voit deux éléphants incontestables, l’un a environ 1 m. 50 dans sa plus grande dimension, l’autre 0 m. 50. C’est ce dernier qui est reproduit ci-contre d’après un simple dessin (et non pas d’après un calque) figure 25. Ces gravures d’éléphants ne sont pas patinées, et à leurs dimensions près elles n’ont aucun des caractères qui caractérisent les vieilles gravures. Si l’éléphant est tout à fait étranger à la faune de l’Ahnet, il ne faut pas oublier que les Touaregs de l’Ahnet passent les années de sécheresse dans l’Adr’ar des Ifor’ass, où ils sont chez eux, à proximité du Niger. L’éléphant leur est familier, comme d’ailleurs la girafe.
Je n’essaie pas davantage d’identifier des dessins mal venus et cocasses (fig. 22, C et F).
En résumé, comme conclusion d’ensemble, toute cette faune est contemporaine. Elle n’est pourtant pas rigoureusement actuelle. Il y[109] a là une nuance qu’il est facile de préciser ; il est évident que le nombre des bovidés représentés (dont quelques-uns bâtés), est tout à fait disproportionné au nombre des méharis. Ceci nous reporte à une époque ou ceux-ci, d’introduction récente, n’avaient pas encore complètement supplanté ceux-là, les bœufs nigériens, bêtes de somme garamantiques.
D’ailleurs la représentation de la figure humaine achève de lever tous les doutes sur l’âge approximatif de nos gravures.
Qu’on examine figure 20, A, le javelot que brandit le chasseur (voir aussi fig. 21, A), il semble bien que ce javelot se termine par un fer de lance.
Que l’on compare cet armement avec celui qui est figuré sur les vieilles gravures algériennes publiées par Pomel[89] ; et dont le caractère néolithique est incontestable. Evidemment notre chasseur est très postérieur ; le sauvage a été promu barbare.
Pourtant il n’est pas actuel. La plupart des êtres humains figurés sont nus, tout au plus peut-on imaginer qu’ils ont un pagne autour des hanches. Voilà qui est tout à fait contraire aux habitudes actuelles ; le Touareg comme tout musulman, est un paquet d’étoffes flottantes. D’ailleurs l’attirail de guerre du Touareg est bien connu, il a été popularisé par la gravure, un immense bouclier carré, une très longue lance en fer, un sabre très long sans pointe, arme de taille. Ce sont des armes tout à fait appropriées pour un méhariste. Or les chasseurs ou les guerriers de nos reproductions (fig. 21, A ; fig. 20, A ; fig. 24, E) sont invariablement armés d’un bouclier rond tout petit et de trois javelines.
Ce guerrier à bouclier rond, nous l’avons déjà rencontré dans les stations du nord, à Barrebi en particulier ; mais ici, dans les stations de l’Ahnet il est dessiné avec plus de soin, plus détaillé. La ressemblance en devient plus frappante avec le cavalier, figuré à côté des caractères libyques sur la stèle funéraire du musée d’Alger. (Voir fig. 17.) Celui-ci porte à son bras gauche exactement le même petit bouclier rond et les mêmes trois javelines, ces dernières fixées de la même façon à la partie postérieure du bouclier, donnant une impression de panoplie. Il me semble que ce détail est de nature à entraîner la conviction.
Ce méhariste armé en cavalier numide date approximativement nos gravures.
Notons encore qu’elles sont accompagnées d’inscriptions tifinar’[110] en grand nombre et qui paraissent contemporaines. Au col de Zenaga les gravures se présentent seules sans accompagnement épigraphique.
Enfin l’aspect seul de nos gravures interdit de les reporter très loin dans le passé puisque la patine fait défaut ; les parties gravées de la roche contrastent vivement par leurs couleurs avec les parties intactes ; elles ont un aspect frais.
Pourtant au point de vue de l’exécution technique elles seraient déconcertantes ; elles ne rentrent pas exactement dans les catégories établies dans le nord par M. Flamand. Là, dans la chaîne des ksour par exemple, tout ce qui n’est pas belle gravure ancienne, à trait profond et lisse, à patine noire, est immonde grafitti libyco-berbère. Ce sont deux catégories bien tranchées et la plupart des gravures au Mouidir-Ahnet ne rentrent ni dans l’une ni dans l’autre.
Les chameaux de la figure 20, B, par exemple, sont des graffitti libyco-berbères types. Est-il possible de les classer avec les beaux méharis de la figure 21, A. Ces derniers ont 0 m. 50 de haut ; les autres 0 m. 05 ; ceux-ci sont parfaitement schématiques, et rappellent plutôt au premier coup d’œil un caractère chinois qu’un animal quelconque. Ces gravures procèdent d’intentions différentes ; l’auteur de la figure 21, A, tâche de reproduire un animal tel qu’il le voit, c’est un artiste, dans une mesure aussi faible qu’on voudra ; l’auteur de la figure 20, B écrit l’hiéroglyphe du chameau, il fait de l’idéographie.
A ne considérer que l’habileté des dessinateurs, et ce qu’on pourrait appeler leurs traditions artistiques, les belles gravures du Mouidir-Ahnet sont tout à fait comparables à celles de Zenaga. Que l’on considère les petits tableautins des figures 20 et 21, scènes de chasse, j’imagine, à moins qu’on ne veuille voir dans la figure 21 une scène de guerre, une rencontre entre méharistes et piétons, mais la présence de gibier et de chiens est peu favorable à cette hypothèse. En quoi ces amusantes compositions sont-elles inférieures par exemple à la gravure rupestre algérienne de Kef Messiouar publiée par Gsell (Monuments antiques, t. I, p. 48) et qui représente une famille de lions s’apprêtant à dévorer un sanglier ? De part et d’autre c’est la même ignorance de la perspective, mais c’est aussi parfois le même bonheur à silhouetter tel ou tel animal. Qu’on regarde la gazelle entourée par les chiens (fig. 21, A), le cheval (fig. 23, A), la chèvre et l’autruche de la figure 24, B pour ne rien dire de la vache placide et de l’âne qui brait de la même planche. On ne trouvera rien de mieux dans la série des gravures rupestres sud-oranaises. Et c’est une chose à noter aussi que les dimensions sont les mêmes. Ici comme là[111] les figures sont grandes, la plupart ont de 0 m. 50 à 0 m. 75, c’est-à-dire que la somme de travail est considérable. Nous ne sommes plus en présence de graffitti œuvre de quelques minutes de désœuvrement, il faut supposer chez l’auteur un travail soutenu et une certaine habitude de la main.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XVII. |

Cliché Gautier
33. — GRAVURES RUPESTRES A OUAN TOHRA
sur grès éo-dévonien.
Les figures ont été passées à la craie.

Cliché Laperrine
34. — TYPE DE GRAVURES RUPESTRES SUR GRANIT (Hoggar).
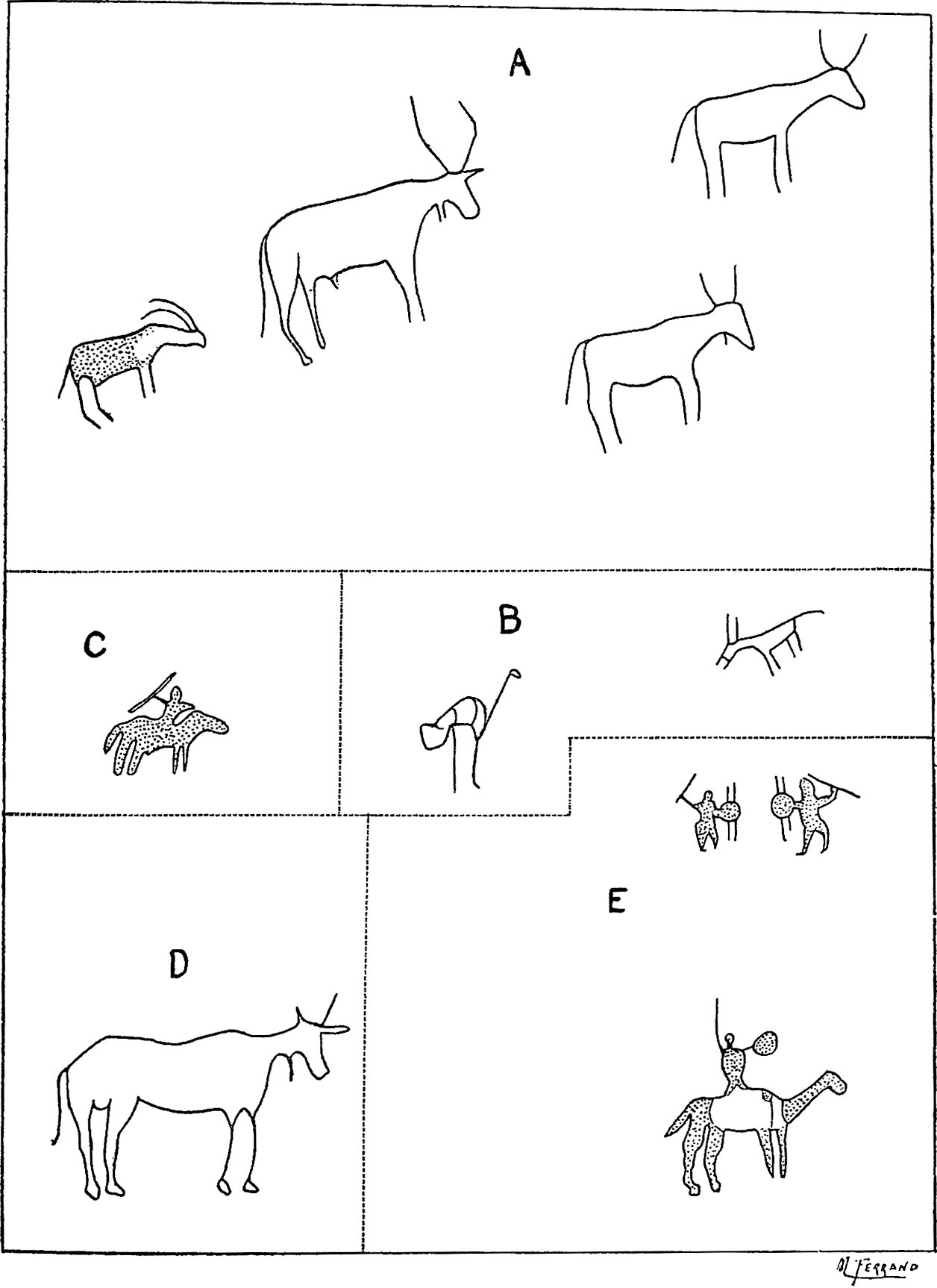
Fig. 24. — Ouan Tohra.
A, d’après une bonne photographie ; le bovidé du milieu a 0 m. 50 de la tête à la queue. B, 0 m. 15 et 0 m. 20. C, 0 m. 20. D, 0 m. 75 de la tête à la queue. E, personnages d’en haut, 0 m. 10, celui d’en bas. 0 m. 20.
(Figure extraite de L’Anthropologie. Masson et Cie. édit.)
[112]Pourtant les gravures de l’Ahnet se distinguent de celles de Zenaga, non seulement par l’absence de patine, mais encore par la différence de facture. M. Flamand, en matière de gravures sud-oranaises, distingue le trait profond, régulier, qui caractérise les gravures antiques et le « pointillé produit par une série linéaire de percussions », qui caractérise les gravures libyco-berbères. Celles qui nous occupent ne sont ni gravées profondément ni pointillées par percussion ; la patine superficielle de la roche a été enlevée par grattage, tantôt suivant des lignes, tantôt sur de larges espaces (fig. 21, A ; fig. 23, C ; fig. 24, A), tantôt sur la totalité de la figure (voir surtout fig. 20, A). Erwin de Bary note, dans l’Aïr, au rocher de Dakou, « des figures d’hommes, de chameaux et de chevaux qui y sont gravées. Les dessins ne sont pas taillés dans la pierre à l’aide d’un ciseau et résultent seulement d’un grattage[90] ».
Notez d’ailleurs que nous sommes au désert où les roches sont couvertes d’une patine très foncée. Les grès éodévoniens en particulier sont des masses de quartz peintes en noir ; la moindre égratignure, le moindre grattage fait apparaître un dessin très blanc sur fond très noir. Avec une pareille matière le graveur obtient avec un minimum d’effort un maximum d’effet utile.
Déjà, à Barrebi, nous avions vu apparaître entre les graffitti libyco-berbères et les gravures anciennes un type de transition. Ce type s’affirme au Mouidir-Ahnet.
La décadence ici a été bien plus lente et progressive, les traditions de gravure se sont maintenues plus longtemps.
En résumé la race berbère, qui dans le Tell a perdu d’assez bonne heure ses anciennes aptitudes artistiques, les a conservées au contraire dans le Sahara jusqu’à une époque voisine de nous.
Station de Timissao. — On a longuement insisté sur les stations du Mouidir-Ahnet, qui présentent un intérêt particulier. Celle de Timissao a beaucoup d’analogies avec elles malgré la distance.
La station de Timissao a été signalée par le colonel Laperrine. Elle se trouve à côté du puits dans une caverne de la falaise en grès éodévonien. Le mot caverne est ambitieux, il faudrait dire plutôt abri sous roche. De cette grotte, si l’on veut, le plancher, les murs et le plafond sont couverts de gravures et d’inscriptions que j’ai examinées d’une façon un peu sommaire (fig. 25).
Ici, au contraire d’Ouan Tohra, il existe quelques dessins qui[113] paraissent anciens. Par la patine ils ne se distinguent pas de la roche, il est vrai que ce signe a moins de valeur ici qu’ailleurs. Tous ces dessins, en effet, sans exception sont sur le plancher de la grotte, c’est dire qu’ils ont été foulés par les pieds de générations, ils ont dû se patiner plus vite. Mais le trait est profond et assez net. Noter dans la figure 4 la longueur disproportionnée des cornes. Évidemment l’artiste a campé le corps de son animal de trois quarts et la tête de profil, pour mettre les cornes en valeur ; cette recherche de l’effet et cette pose compliquée sont dans le nord caractéristiques des plus vieilles gravures.
Les animaux représentés sont actuels cependant. 7 semble bien représenter un bœuf de l’espèce Bos ibericus. Et je crois que 4 et 6 représentent des antilopes adax. Notons pourtant que Pomel[91], à propos d’animaux analogues, propose d’une façon tout à fait affirmative l’identification avec l’antilope oryx (cf. Leucoryx Licht), encore qu’il n’en ait pas authentiquement constaté la présence dans la faune quaternaire algérienne. Mais l’oryx ne se trouve plus aujourd’hui qu’en Égypte, l’adax au contraire est un familier du Sahara algérien, et ses cornes ressemblent à celles de l’oryx, assez du moins pour qu’il soit imprudent de vouloir les distinguer sur une gravure rupestre.
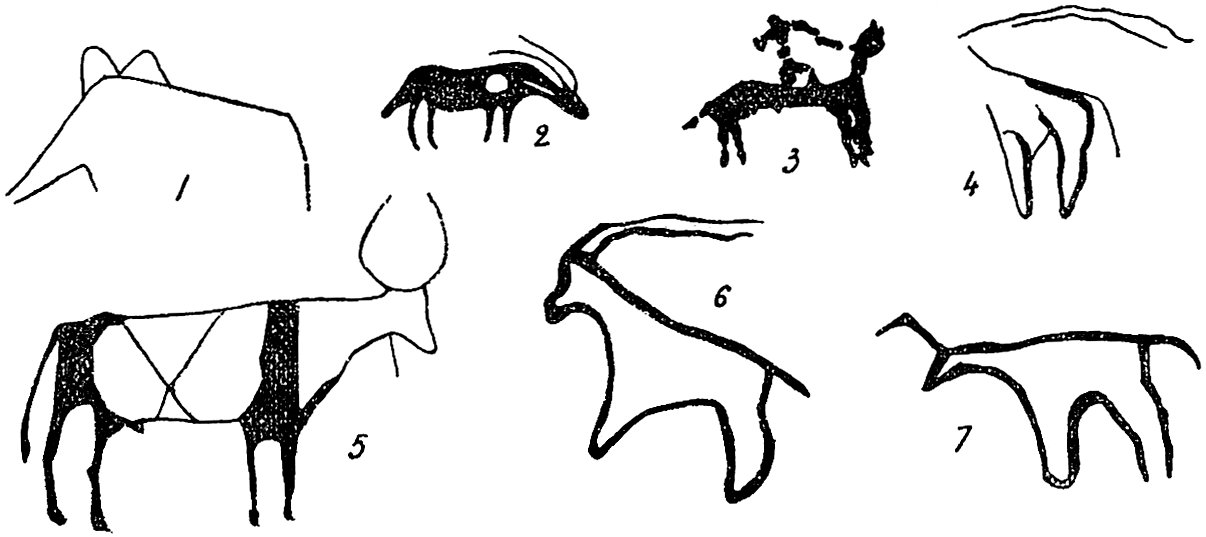
Fig. 25. — Gravures rupestres des stations de Foum Zeggag (1) ; de Ouan Tohra (2, 3, 5) ; de Timissao (4, 6, 7).
Réduction au vingtième d’après calques et estampages (sauf 1 qui a été simplement dessiné).
(Figure extrait de L’Anthropologie. Masson et Cie, édit.)
Stations Ifor’ass. — Dans l’Adr’ar des Ifor’ass je suis en mesure de signaler quatre stations d’importance inégale, malheureusement je n’ai pas pu en étudier sérieusement une seule.
[114]Avant d’arriver à notre campement de l’oued Taoundrart, à trois kilomètres environ, j’ai vu quelques lettres tifinar’ et un dessin informe d’animal ; le tout était gravé sur une roche éruptive.
Une très belle station se trouve à Ras Taoundrart dans les gorges de l’O. Assanirès. Les dessins sont gravés sur une muraille presque verticale de granit. Les inscriptions tifinar’ y abondent ; les dessins sont du type libyco-berbère saharien, un certain nombre de chameaux, et beaucoup de chevaux, des lions.
M. Chudeau a vu une station de gravures rupestres sur granit à In Fenian ; trois ou quatres figures, dont un cheval.
Enfin dans l’oued Tougçemin, à trois kilomètres est du campement, j’ai vu sur granit quelques autruches et un animal informe où on aurait pu reconnaître une girafe.
En somme, dans l’Adr’ar des Ifor’ass la présence des gravures rupestres est incontestable, elles ressemblent à celles du nord, autant qu’on peut en juger après un examen sommaire, elles sont toutes du type récent ; ici où le grès fait défaut la matière préférée est le granit.
Stations du Hoggar. — M. Chudeau a signalé de très beaux dessins rupestres au Hoggar, au confluent des oueds Outoul et Adjennar, entre Tamanr’asset et Tit ; une girafe paissant, en particulier, est fort bien réussie.
Sur cette même station peut-être, ou en tout cas sur une autre toute voisine, dans l’oued Adjennar, Motylinski nous donne des détails plus circonstanciés[92]. Il signale en effet une girafe — puis beaucoup de bœufs ou de vaches qui semblent analogues à ceux de l’Ahnet (il en est de bâtés ; Motylinski mentionne à leur cou des appendices, cordes ou fanons (?) qu’on retrouvera sur nos figures) — beaucoup d’autruches aussi — une chasse au mouflon avec chiens qui fait songer au tableautin de Taoulaoun, — des chevaux, des ânes, des méharis assez soignés pour qu’on distingue la forme de leur selle, ils portent la rahla actuelle, au pommeau en forme de croix — deux vaches à bosse et une autruche sont non pas gravés mais dessinés à l’ocre, ce qui semble exclure une antiquité reculée.
Motylinski nous signale une autre belle station dans une partie éloignée du Hoggar, tout à fait au nord, aux limites du Mouidir, à la gara Tesnou. Il y a dessiné sur son carnet, un peu trop sommairement, un éléphant qui pourrait bien être ancien.
D’autre part il a silhouetté à Tit une vache à très grandes cornes,[115] dont on aimerait à savoir si ce n’est pas un Bubalus antiquus. Ce serait fort intéressant, malheureusement il est tout à fait impossible d’être affirmatif.
Motylinski signale brièvement un certain nombre d’autres stations au sommet de la Koudia.
Oued Medjoura — une vache bâtée avec appendices au cou.
Oued Tér’oummout (sources de l’oued Tamanr’asset) — animaux et inscriptions.
Iberrahen (sources de l’oued In Dalladj) — un incontestable « cavalier gétule ».
En somme le Hoggar serait un beau champ d’études pour amateur de gravures rupestres. Les mauvais graffitti abondent, mais il y a un grand nombre de belles gravures, comparables à celles de l’Ahnet ; à la matière près pourtant ; car ici le grès fait défaut, comme dans l’Adr’ar des Ifor’ass on a employé ici le granit ou les roches éruptives. (Voir pl. XVII, phot. 34.)
Stations de l’Aïr. — L’Aïr aussi mériterait une étude détaillée, qui est actuellement impossible ; Chudeau signale, entre le Hoggar et l’Aïr, à quelques centaines de mètres au nord de l’aguelman du Tassili Tan Tagriera, dans les grès dévoniens, une grotte avec quelques beaux dessins rupestres. Il en a revu dans l’Aïr ; — dans le massif d’Agouata, au voisinage d’Aguellal ; — et enfin, près de Takaredei, à deux kilomètres à l’ouest du cimetière des Iberkor’an ; ces derniers, les plus méridionaux connus dans la région représentant deux girafes.
Foureau[93] nous renseigne sur deux autres stations de l’Aïr, Tilmas Talghazi et oued Tidek (fig. 388, 389, 390, 391, 392, p. 1087 à 1093). On y voit figurés une girafe, des autruches, de mauvais chameaux, des chevaux, des bovidés, des singes peut-être, des hommes sans armes, en tunique courte et flottante et à coiffure compliquée. Ces gravures seraient plus anciennes que les caractères tifinar’ et arabes qui les accompagnent ; pourtant la facture est pointillée, ce qui serait considéré dans le nord comme un indice de médiocre antiquité.
Les grafitti libyco-berbères sont eux aussi fréquents dans l’Aïr, au moins dans le nord. Chudeau a noté les derniers dessins de ce type à Aguellal ; à une centaine de mètres au nord de l’inscription qui signale le passage de la mission Foureau-Lamy. Les quelques chameaux[116] figurés en ce point sont accompagnés d’une inscription en caractères arabes, qui par la patine semble du même âge que les dessins.
Foureau et Chudeau s’accordent à noter la disparition des gravures, en même temps que celle des Redjems au sud de l’Aïr dans les régions Haoussas et Bornouannes.
Stations du Niger et du Sénégal. — Enfin les explorateurs soudanais nous signalent la limite sud des gravures sur les bords du Sénégal et du Niger.
« Pendant la mission Tagant-Adrar M. Robert Arnaud découvrait en Maurétanie sénégalaise, dans les abris sous roche de la gorge de Garaouat des dessins et des inscriptions rupestres » peints en noir et en rouge[94].
M. Desplagnes a publié dans son livre des gravures et inscriptions nigériennes. Les figures 81 et 82 de la planche XLII représentent des caractères tifinar’. Sur la figure 89 de la planche XLVI on voit des « cavaliers numides » du type habituel.
En revanche les figures 84 (pl. XLIII) — 85 et 86 (pl. XLIV) — 90 (pl. XLVI) n’ont plus qu’un rapport bien lointain avec les graffitti libyco-berbères. Il y a peut-être quelque parenté, car on croit reconnaître un motif commun, la sandale ou empreinte de pied. Mais l’ensemble est très aberrant, nous entrons là dans un nouveau monde, une province à part de dessins soudanais.
En somme, partout où on a été à même de constater des limites, nos gravures rupestres, comme les redjems, ont la même extension que la race berbère elle-même.
Inscriptions tifinar’. — On a dû être très bref sur les inscriptions tifinar’ (libyco-berbères ? libyques ?) ; on s’est borné à les mentionner incidemment. C’est qu’elles se défendent contre toute tentative d’énumération par leur nombre immense, et contre toute tentative d’explication par le mystère qui les entoure et qui n’est pas dissipé.
L’alphabet tifinar’ est phonétiquement connu, les Touaregs ont conservé l’usage actuel de cette écriture. En 1903, au puits de Ouan Tohra, nous avons trouvé un caillou couvert de caractères fraîchement tracés à l’ocre ; c’était une circulaire rupestre faisant connaître aux caravanes notre présence dans le pays.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XVIII. |
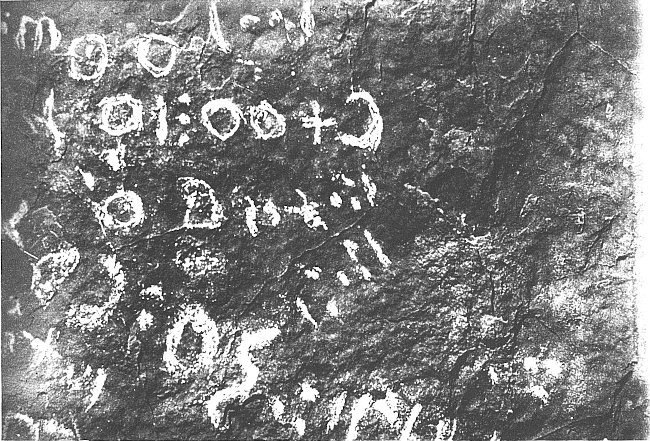
Cliché Augé
35. — INSCRIPTION SUR GRÈS ALBIEN
au Ksar d’Abani, près Tesfaout.
Les lettres, indistinctes, ont été probablement passées à la craie.

Cliché Augé
36. — INSCRIPTION SUR GRÈS ALBIEN
au Ksar d’Abani (suite de la précédente)
Cette inscription donnée par les indigènes comme hébraïque est évidemment berbère.
[117]Il était donc légitime d’espérer que des indigènes érudits pourraient nous aider à déchiffrer les vieilles inscriptions. Il semble qu’il faille renoncer à cet espoir. M. Motylinski, dans son récent voyage, qui s’est terminé si malheureusement par sa mort, s’était attaché spécialement à résoudre ce problème et il résulte de ses notes manuscrites qu’il a échoué.
Les vieux tifinar’ sont indéchiffrables pour les Touaregs eux-mêmes. Toute leur archéologie se résume en quelques légendes de folklore. Caractères et dessins sont attribués à des personnages mythiques, le peuple des Amamellé, un personnage qu’ils appellent Élias. On trouve déjà ces noms dans un texte donné en appendice dans la vieille grammaire d’Hanoteaux. Sous bénéfice d’inventaire il me semble que Amamellé et Élias sont assez analogues aux Djouhala d’Algérie, constructeurs des dolmens, une personnification de la race berbère préislamique, avec laquelle le Berbère converti renie toute parenté.
Si le voile doit jamais être levé ce sera sans doute par la philologie moderne, à la suite des méticuleuses monographies de dialectes Berbères, qui ont été amorcées par M. R. Basset, mais qui sont encore loin de leur conclusion. Ce jour-là les épigraphistes trouveront au Sahara une ample matière, mais peut-être de qualité médiocre.
Conclusions générales. — Cette longue étude analytique comporte, je crois, des conclusions générales.
A propos des gravures anciennes, à plusieurs reprises, j’ai refusé d’adopter les identifications auxquelles s’est arrêté Pomel. Ce n’est pas lui manquer de respect que de critiquer le point de vue trop paléontologique auquel il s’est placé, dans une série de monographies paléontologiques, où l’étude des gravures rupestres est accessoire. S’il veut reconnaître, par exemple, dans une autruche évidente, un grand échassier indéterminé, c’est que a priori il imagine un cadre quaternaire, climat humide et grands marais. Il s’est trouvé entraîné par son point de départ à supposer aux gravures rupestres une précision de planche anatomique dont elles sont malheureusement bien éloignées. Des déterminations qu’il a proposées il n’en subsiste que deux tout à fait incontestables ; celles de l’éléphant et du Bubalus antiquus : mais l’éléphant a subsisté en Berbérie jusqu’en pleine époque historique, et il est possible que nous ayons sur le Bubalus antiquus un texte de Strabon[95]. Sous bénéfice d’inventaire et jusqu’à[118] plus ample informé, l’âge quaternaire des gravures rupestres anciennes n’est rien moins que prouvé.
L’étude des gravures rupestres sahariennes justifie et précise la distinction entre les deux catégories de gravures, anciennes et libyco-berbères. D’autant que dans chacune de ces catégories nous avons le portrait de l’artiste : d’une part un homme coiffé de ce qui semble bien être des plumes, armé d’un bouclier à double échancrure, d’une hache manifestement néolithique, d’arc et de flèches[96]. D’autre part le « cavalier numide » avec son bouclier rond et ses trois javelots.
Mais aussi longtemps qu’on a connu seulement les gravures algériennes, il y a une telle différence entre les deux catégories, leurs domaines apparaissent si tranchés, les factures si différentes, qu’on a pu imaginer un abîme entre les deux. Pour Pomel c’est l’œuvre de deux races tout à fait différentes, l’une quaternaire et peut-être nègre ; l’autre berbère et toute récente.
L’étude des gravures sahariennes rétablit la continuité ; on suit désormais les étapes, les dégradations successives qui conduisent des plus belles gravures anciennes aux plus immondes graffitti modernes ; la graduation de la décadence est établie : les gravures de Mouidir-Ahnet sont le missing link. Il en est d’incontestablement libyco-berbères qui sont dans le dessin étroitement apparentées avec d’autres incontestablement anciennes. Comparez par exemple les scènes de chasse de part et d’autre, la chasse à l’autruche dans Pomel[97], et au mouflon sur les roches de Mouidir[98]. Tout cela prend l’apparence d’une école unique progressivement atrophiée : et dès lors il devient difficile d’imaginer que les gravures soient l’œuvre de deux races différentes, il semble que tout soit berbère et on peut d’autant moins reculer les gravures anciennes dans une antiquité extrêmement lointaine.
J’imagine que les causes de la décadence sont assez faciles à dégager. Et sans doute faut-il faire sa part au triomphe de l’islamisme iconoclaste. Mais il y a autre chose. Tous les dessins, même les plus récents ont été gravés avec un instrument en pierre, il suffit pour s’en rendre compte de s’essayer à reproduire une gravure sur la roche même d’une station. On n’y parvient pas avec la pointe d’un couteau ou d’une arme en fer, le trait obtenu est infiniment trop délié, filiforme et presque invisible ; qu’on essaie avec une pierre et[119] on réussit sans peine en très peu de temps. Aussi bien cette constatation n’est pas nouvelle, elle n’a pas échappé à Pomel et à Flamand. Je crois même qu’on peut expliquer comme suit l’énorme différence de facture entre les deux types libyco-berbères, le saharien et l’algérien (voir par exemple la planche 25, nos 2 et 3). Les gravures du type algérien, en pointillé à grands éclats (no 3) ont été exécutées avec une pierre quelconque, sans pointe, un caillou contondant, à une époque ou les pointes néolithiques n’étaient plus d’usage courant, ou par un individu qui s’en trouvait démuni. Les gravures du type saharien (no 2) ont été exécutées avec une pointe de silex. Et dès lors on comprend bien que les gravures de ce type inconnues dans le nord, abondent au Sahara, puisque, aussi bien, l’usage des armes et des outils en pierre s’est de toute nécessité conservé bien plus longtemps au cœur du continent qu’au voisinage de la Méditerranée.
Au surplus les Touaregs actuels ne gravent plus ; je n’ignore pas que Rohlfs a trouvé au désert de Libye un dessin rupestre de bateau à vapeur, mais je parle du Sahara occidental, et d’ailleurs on ne peut pas tirer de conclusions générales d’une fantaisie individuelle. Ce qui est certain, en règle générale, c’est que le Touareg a continué à considérer les pierres comme la seule matière qui se prête à l’écriture, encore aujourd’hui il les couvre de tifinar’ et de dessins généralement géométriques (voir la fig. 17, no 11). Ils sont particulièrement abondants dans la grotte de Timissao. Mais ce n’est plus de l’écriture gravée, elle est peinte, généralement à l’ocre ; d’ailleurs le Touareg, grand ornemaniste en cuir est assez familier avec les couleurs minérales. Il se peut au surplus qu’il y ait eu une ancienne alliance entre la gravure et la peinture rupestre ; dans certaines figures comme le bélier coiffé d’un disque (fig. 14), tout l’espace circonscrit par le trait extérieur est creux et parfaitement lisse ; on imagine volontiers que cet évidement devait être recouvert d’un enduit coloré. En tout cas la substitution d’une mode à l’autre, de la peinture à la gravure, doit se rattacher à la disparition des derniers outils en pierre. On sait d’ailleurs que cette disparition dans l’Afrique du nord est assez récente et on dira tout à l’heure que chez le Touaregs en particulier il ne faut pas gratter beaucoup pour retrouver le néolithique.
En somme la gravure rupestre semble avoir suivi pas à pas la décadence du lithisme. Sous cette réserve qu’une synthèse est peut-être tout de même prématurée, on se représenterait hypothétiquement comme suit les phases de la gravure rupestre.
A. — L’époque des belles gravures sud-oranaises, néolithisme[120] exclusif. La gravure est un art qui a ses ouvriers habiles, et même c’est un art religieux, le bélier casqué a été certainement l’objet d’un culte (Ammon, alias Bou-Kornéin le cornu).
B. — Libyco-berbère saharien. La gravure n’a plus de sens religieux, elle n’excite plus le même intérêt, l’influence du christianisme puis de l’Islam se fait sentir, mais au Sahara du moins le néolithisme persiste et avec lui les outils et les procédés de la gravure.
C. — Libyco-berbère méditerranéen le lithisme est en voie d’extinction, la gravure devient tout à fait grossière, de très bonne heure dans la zone méditerranéenne, où la phase B n’existe pas, beaucoup plus tard au Sahara.
La limite chronologique entre A et B apparaît nettement, la disparition de l’éléphant et l’apparition du chameau, phénomènes historiquement datés, nous reportent approximativement au début de l’ère chrétienne.
Il est difficile de dire jusqu’à quelle époque le libyco-berbère saharien a pu se maintenir ; jusqu’à une époque peut-être beaucoup plus rapprochée de nous qu’on n’imagine, et l’expression « cavalier numide ou gétule » serait mal choisie s’il fallait la prendre à la lettre. Le Berbère est étonnamment conservateur, les Touaregs cavaliers du Niger conservent encore aujourd’hui dans ses traits essentiels l’armement des stèles du musée d’Alger, les trois javelots qu’ils lancent en galopant avec une adresse stupéfiante, dit-on, fidèlement transmise de génération en génération depuis Massinissa.
Sur le terminus a quo des plus anciennes gravures, il est impossible de se prononcer, il est pourtant, je crois, de prudence élémentaire, et jusqu’à plus ample informé de ne pas les mettre en parallèle avec nos gravures européennes sur os et sur pierre, contemporaines du mammouth et du renne.
Il reste à ajouter ceci. Dans l’état actuel de nos connaissances, l’extrême rareté au Sahara des gravures rupestres de type ancien reste un fait frappant. Sans doute il y en a d’incontestables à Timissao et je crois bien qu’il faut rattacher à cette catégorie une girafe de l’O. Tar’it dans l’Ahnet. Mais nous ne savons pas du tout quel temps il faut pour patiner une gravure ; à coup sûr j’ai cherché vainement des gravures anciennes à la station si riche d’Ouan Tohra, et dans une station quelconque du Sud-Oranais pareille recherche, je crois, ne fût pas resté vaine. C’est l’Algérie qui reste le pays classique des vieilles gravures, les plus beaux échantillons, et les plus nombreux sont là. On a l’impression qu’au Sahara ces Berbères graveurs sont venus tardivement.
[121]III. — Armes et instruments néolithiques.
J’ai trouvé en cours de route un certain nombre d’armes et d’instruments néolithiques.
Station d’Aïn Sefra. — La station d’Aïn Sefra est très anciennement connue, si anciennement qu’elle a presque cessé d’être une station, les pièces les plus intéressantes ayant été enlevées depuis longtemps. J’y ai recueilli cependant un lot considérable de débris parmi lesquels M. Verneau a bien voulu sélectionner un petit nombre de pièces « des lames retouchées sur les bords et des lames à encoche », de petits outils que M. Verneau estime avoir servi à la taille et à la perforation des rondelles d’œuf d’autruche.
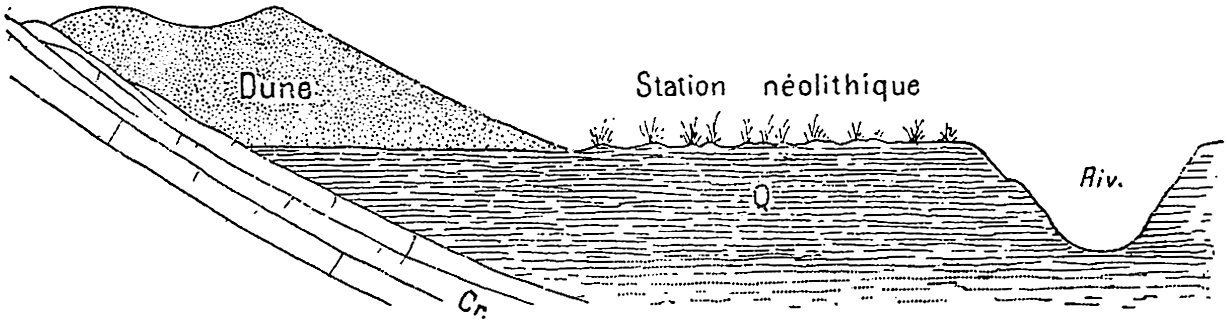
Fig. 26. — Coupe schématique de la station néolithique d’Aïn Sefra.
(Figure extraite de L’Anthropologie. Masson et Cie, édit.)
Un séjour prolongé m’a permis d’étudier le gisement, dont les conditions me paraissent intéressantes.
Le substratum immédiat est formé par des alluvions quaternaires presque exclusivement sablonneuses sous lesquelles s’enfoncent au sud, en plongée très accusée, les grès crétacés du dj. Mekter, et dans lesquelles au nord l’oued actuel a creusé son lit. Au contact du Crétacé et du Quaternaire, mi-partie sur l’un et sur l’autre une dune est accumulée. La surface du quaternaire est parsemée de touffes de végétation, autour de chacune desquelles l’érosion éolienne a profondément affouillé, de sorte que chaque touffe couronne un monticule. Il est clair que ceci est un champ de bataille entre le vent et la végétation, l’un tendant à décaper et l’autre à protéger le sol : rien de plus fréquent au Sahara. Il est clair aussi que la dune représente les conquêtes du vent, la dune s’est formée aux dépens du sable quaternaire sur lequel elle repose.
Les silex gisent en vrac entre les touffes sur la plate-forme quaternaire, et aux endroits où ils sont le plus denses les fouilles ne donnent absolument rien ; tout est à la surface du sol.
[122]Tout se passe donc comme si les silex étaient un résidu des couches disparues, décapées par le vent, et accumulées par lui sous forme de dune à quelques mètres de là.
C’est un fait général au Sahara que les silex néolithiques se trouvent comme à Aïn Sefra en vrac à la surface du sol et à proximité d’une dune. Dans la plupart des cas je suis convaincu qu’une analyse détaillée des conditions de gisement donnerait un résultat identique. Au Sahara, pays de décapage éolien, il n’y a plus de gisements, mais simplement des résidus de gisement. Le vent s’est chargé des fouilles, et voilà pourquoi il y a, d’une part, une si grande abondance de matériaux recueillis, et d’autre part une extrême pénurie de renseignements précis sur la stratigraphie des stations.
Station de Zafrani. — Une station néolithique importante se trouve sur la rive gauche de la Zousfana entre Moungar et le puits de Zafrani, en bordure de la dune et sur le Quaternaire. Les silex comme toujours sont épars sur le sol. Ils ont été extrêmement abondants, car tous les convois militaires qui depuis 1902 viennent camper une fois par mois à Zafrani ont méthodiquement pillé la station, qui n’est pas encore tout à fait épuisée. Le musée d’Alger a une assez jolie collection de ces silex, représentée ci-contre (pl. XIX, phot. 38).
Les pointes de Zafrani sont en deux silex différents, l’un noir et l’autre blanc. Cela correspond peut-être à la présence dans le pays de deux catégories très différentes de rognons siliceux, les uns carbonifères et les autres pliocènes.
Ces silex sont intéressants parce que très particuliers, très différents de ceux qu’on recueille couramment en si grand nombre dans la région d’Ouargla et dans l’erg oriental. La planche XIX (phot. 37) donne à titre de spécimen et pour la comparaison, quelques échantillons de ces pointes orientales. Tandis qu’elles sont menues, longues de 2 ou 3 centimètres, et admirablement travaillées sur les deux faces, on dirait presque ciselées[99], les pointes de la Zousfana sont deux fois plus longues et plus épaisses, et d’un travail très grossier, unilatéral. Les premières sont de vraies pointes de flèche, tandis que les autres seraient plutôt des pointes de lance ou de javelot.
Nous entrons donc ici dans une autre région néolithique, car,[123] d’une façon générale, et à de très rares exceptions près, les pointes du type Zousfana n’ont jamais été trouvées dans l’est (cf. la collection Foureau) ; et la réciproque est vraie, on va voir que les rares pointes connues dans la Saoura et au Touat sont presque toutes du type Zousfana.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XIX. |
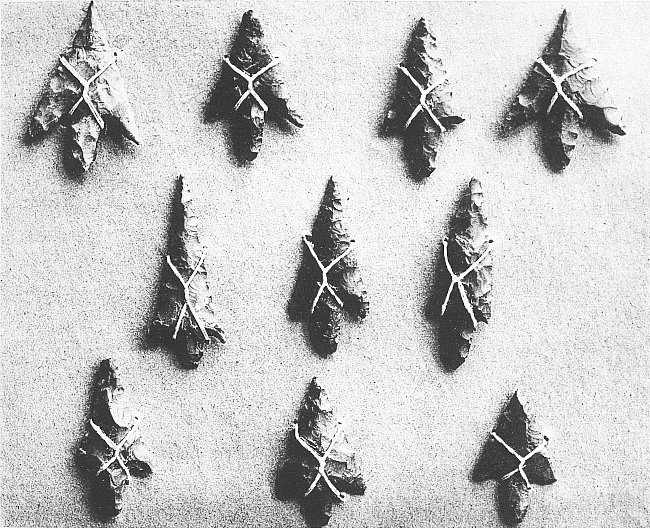
Cliché Virzewski
37. — TYPE DES POINTES D’OUARGLA (Musée d’Alger) ;
(Grandeur nature.)
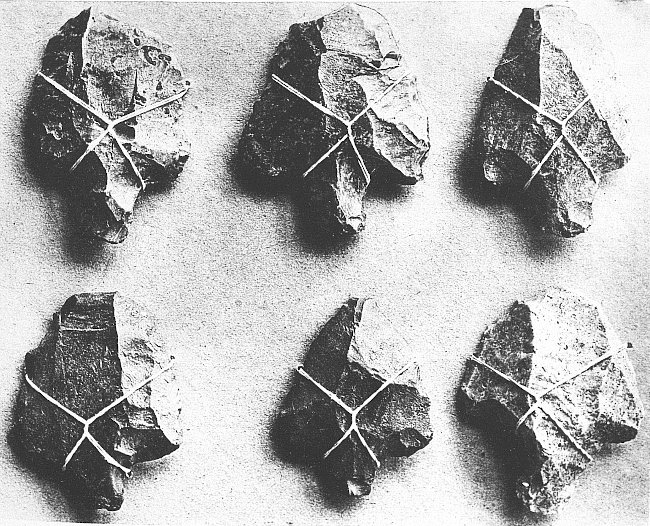
Cliché Virzewski
38. — TYPE DES POINTES DE LA ZOUSFANA (Musée d’Alger).
(Grandeur nature.)
Ces deux types sont connus et classés en Algérie. Voici comment M. Pallary caractérise ce dernier : « Pointes de trait pédonculées, grosses, massives, irrégulières, très rarement symétriques... toujours cet outillage est façonné sur une seule face. » Il provient toujours de stations en plein air d’après M. Pallary, qui déclare n’avoir jamais trouvé d’industrie similaire dans les grottes ; et qui conclut ainsi : « Aux temps néolithiques succède en Algérie la période numide et berbère, et c’est sans doute le contact des étrangers qui, introduisant dans notre pays les métaux, a dû amener cette décadence de la pierre que nous avons constatée dans les ateliers en plein air[100]. »
Ainsi les grosses pointes seraient un type de décadence, et représenteraient la dernière phase du néolithisme africain, contemporaine des métaux et presque moderne.
Les petites pointes soignées d’Ouargla se retrouvent bien elles aussi en Algérie, d’après Pallary ; elles sont « l’épanouissement du néolithique oranais » ; mais elles s’y trouvent toujours dans les dépôts supérieurs des cavernes (grottes des Troglodytes, du Polygone, de Noiseux et de la Tranchée), en compagnie d’une faune qui n’est pas tout à fait actuelle[101]. Voilà qui est intéressant, sous la plume d’un homme comme M. Pallary, connaisseur excellent de la préhistoire algérienne. Nous constatons ici, comme à propos des gravures, que les belles traditions de taille se sont conservées bien plus tard au Sahara qu’en Algérie. Et nous acquérons la notion que ces innombrables gisements de l’erg oriental, particulièrement signalés et exploités par M. Foureau, constituent probablement une province à part, cantonnée dans le bas Igargar.
Station de Tar’it. — Dans la palmeraie de Tar’it on trouve deux gisements néolithiques. Ils sont très médiocres ; des débris, de vagues grattoirs, mélangés à des morceaux d’œuf d’autruche percés et travaillés. Pas une seule pointe décente de flèche ou de javelot.
Les silex de Tar’it se trouvent en deux points :
[124]a. Au voisinage de la palmeraie dite « des Adieux », à quelques kilomètres au nord du poste de Tar’it sur la route de Beni Ounif. Cette petite palmeraie est aujourd’hui inhabitée, et inculte, à l’exploitation des palmiers près ; mais elle ne l’est pas nécessairement, l’eau y sourd, et les conditions d’habitabilité sont encore aujourd’hui réalisées. L’eau est même fort abondante puisqu’elle est captée et amenée par deux foggaras (canaux souterrains) à la palmeraie actuellement cultivée. La palmeraie « des Adieux » est aux trois quarts enfouie dans la dune et l’ensablement est apparemment la cause de son abandon.
b. Au ksar en ruines de Mzaourou. Ces ruines, comme une demi-douzaine d’autres que je n’ai pas visitées, représentent la vie urbaine dans l’oasis de Tar’it, à une époque immédiatement antérieure à l’actuelle. Elles sont juchées au sommet de la falaise carboniférienne, dans une situation qui a évidemment la prétention d’être inexpugnable, et qui a donc été choisie par des habitants guerriers et autonomes. Les ksouriens actuels, qui ne sont plus ni l’un ni l’autre, ayant abandonné aux nomades le soin de les protéger, habitent dans la vallée au milieu des palmiers et au contact immédiat des jardins. Tandis que les ksars actuels sont bâtis en pisé, les vieilles ruines sont en pierres sèches ; à Mzaourou d’ailleurs le troglodytisme a joué un rôle important ; la falaise est creusée de cavernes cloisonnées de murs. Bref les ksars actuels et ceux du type Mzaourou représentent évidemment deux civilisations distinctes et successives.
Ces ruines en pierre sèche, qui toutes ont un nom, sont d’ailleurs historiquement connues, dans la mesure où les traditions indigènes méritent le nom d’histoire. Elles auraient été abandonnées à la suite des prédications d’un saint personnage venu de Syrie, et cet abandon serait en relation avec la conversion des indigènes à l’islamisme (?) ; ou plutôt avec cette recrudescence de prédication et d’ardeur maraboutique qui s’est produite au XVe siècle à la suite des victoires espagnoles.
A Mzaourou les débris de silex mélangés à des morceaux d’œuf d’autruche se trouvent dans les ruines mêmes du ksar, dans le sol, ou du moins dans ce qui en subsiste accroché aux anfractuosités de la roche. Et faut-il donc croire que l’usage des silex, sinon comme armes, du moins comme menus outils s’est conservé jusqu’au XVe siècle. Cela n’a rien d’invraisemblable dans l’Afrique du nord et tout particulièrement au Sahara[102].
[125]En somme les gisements néolithiques de Tar’it sont très différents de celui de Zafrani, mais ils ont comme lui un caractère algérien, il rappellent Aïn Sefra.
Gisements de la Saoura et du Touat. — Le long de la Saoura, au Touat et dans son voisinage, je ne connais pas de gisements néolithiques sérieux ; j’ai seulement trouvé quelques pièces sporadiques.
Une pointe en silex à Bou Khrechba, sur la rive gauche de l’O. Saoura, sur des dépôts mio-pliocènes continentaux au pied de la dune.
Une pointe en silex entre Ksabi et Haci Mallem sur la route de Charouin, à une dizaine de kilomètres de Haci Mallem, au pied d’un cordon de dunes.
Trois pointes en quartzite sur la route de Taourirt à Haci Rezegallah, sur la rive droite de l’oued anonyme venu d’In Zegmir, et comme d’habitude en relation avec un cordon de dunes[103].
Pour être complet ajoutons un fragment de bracelet de verre, analogue à ceux que Foureau signale à différentes reprises, et trouvé sur la route de Haci Sefiat à Temassekh, à une dizaine de kilomètres de Sefiat.
Je sais que le capitaine Flye et ses compagnons ont trouvé dans l’Iguidi un petit nombre de pièces, une très jolie pointe en feuille de laurier, très finement travaillée, une hache au contraire très grossière (du type de Saint-Acheul) ; et sans doute aussi des mortiers et pilons en pierre sur lesquels on reviendra.
Enfin on m’a dit qu’à l’est du Touat sur les premiers gradins du Tadmaït on rencontrait des débris d’ateliers aux affleurements des troncs d’arbres silicifiés (qui abondent dans le crétacé inférieur).
Ce sont les seules traces de néolithisme qui aient été signalées encore dans cet immense espace. Sans doute il a été bien peu parcouru encore ; et de plus il l’a été à peu près constamment suivant des routes déterminées qui s’attachent naturellement aux points actuellement habités. Or la distribution de la vie humaine à l’époque néolithique, si rapprochée de la nôtre qu’on la suppose au Sahara, était certainement très différente de l’actuelle. Dans l’est du Sahara algérien les gisements sont dans le Tadmaït et surtout dans le Grand Erg, très loin des palmeraies d’Ouargla. Il n’en reste pas moins surprenant qu’un aussi petit nombre de trouvailles aient été faites dans un pays qui, après tout, a été sillonné par pas mal d’itinéraires :[126] surtout si l’on songe que, dans la région d’Ouargla, il n’y a pas eu, je crois, un seul voyage, qui n’ait amené la découverte de nombreux et très beaux gisements. On est amené à conclure provisoirement que la partie occidentale du Sahara français est beaucoup moins riche que l’orientale, de plus le néolithisme y prend une forme nouvelle et bien plus fruste. Les quelques échantillons recueillis dans l’O. Saoura et à l’ouest du Touat seraient plutôt du type de Zafrani, des pointes fortes et grossières. La pointe finement travaillée, du type oriental est prodigieusement rare dans toute la région de l’ouest.
Il n’en est pas moins vrai que, entre les types néolithiques oriental et occidental il y a un point de ressemblance. De part et d’autre les pointes en silex (flèches ou javelots, armes de jet) ont une prédominance très marquée. Les haches sont très rares.
Et c’est d’autant plus notable que la proportion s’inverse dès qu’on dépasse le Touat au sud.
Gisements de l’Ahnet. — Stricto sensu j’ai trouvé deux haches dans l’Ahnet, l’une sur la route de Foum Zeggag à Ouan Tohra (à quelques kilomètres de ce dernier puits) ; l’autre à peu de distance au sud de Tin Senasset. Mais ces deux puits sont à l’extrême limite sud de l’Ahnet, à la limite du Tanezrouft, et il est remarquable que dans l’Ahnet proprement dit, comme d’ailleurs au Mouidir, on n’ait pas encore signalé à ma connaissance un seul gisement néolithique.
D’après les Touaregs il se trouve, il est vrai, de grands mortiers en pierre dans l’erg Tegant ; mais cet erg se trouve au nord du Mouidir, à la limite du Tidikelt, et d’ailleurs c’est un erg, ce qui suffit pour en faire quelque chose d’étranger aux grands plateaux gréseux du pays Touareg.
Foureau a été frappé de la rareté des gisements néolithiques chez les Azguers, et Motylinski n’en a pas trouvé au Hoggar, non plus que Chudeau.
Les montagnes touaregs, en somme, dernier refuge de la vie actuelle au Sahara, sont très pauvres en néolithisme.
Gisements du Tanezrouft. — J’ai trouvé au contraire un assez grand nombre d’armes et d’outils néolithiques en traversant le Tanezrouft.
J’ai déjà mentionné deux haches trouvées en deux points différents à la limite sud de l’Ahnet.
Dans l’O. Akifou une hache en ryolite et une sphère-écraseuse de même matière.
[127]Entre ce point et In Ziza deux autres haches.
Il faut noter la présence à la limite méridionale de l’Ahnet et au nord d’In Ziza, d’une tendance à l’ensablement et d’un puissant cordon de dunes allongé parallèlement à l’O. Tiredjert. Les objets en pierre polie ont tous été trouvés à petite distance d’une dune.
Une hache à l’oued Tamanr’asset près de Timissao.
Une jolie pointe de silex en feuille de laurier du type d’Ouargla, au sud de la gara Tirek.
Dans la même région (N. d’In Ouzel) un pilon très allongé et très mince et un rouleau cylindrique en quartz rubanné ; ce dernier, qui n’est pas arrivé en Europe, était long de 0 m. 13 mais il a pu l’être davantage, il semblait brisé à une extrémité au moins, la section n’était pas tout à fait sphérique (grand diamètre 0 m. 056, petit diamètre 0 m. 052).
Dans le Tanezrouft oriental, entre In Ouzel et le Hoggar, Chudeau a trouvé encore huit haches ou pilons.
Au total la traversée du Tanezrouft a donné une vingtaine d’armes ou d’outils néolithiques. On sait que les indigènes appliquent le mot de Tanezrouft aux parties les plus arides et les plus inabordables du Sahara. Entre l’Ahnet et In Ouzel la partie traversée du Tanezrouft a 500 kilomètres, et sur cette grande étendue on ne rencontre que deux points d’eau. Ces solitudes mortes, où personne aujourd’hui ne séjourne jamais, se traversent à marches forcées de jour et de nuit, le moindre retard pouvant avoir de graves conséquences. Les objets rapportés ont été ramassés précipitamment parce qu’ils se sont trouvés sous les pieds du chameau, de jour, suffisamment en évidence pour être aperçus à quelques mètres de distance, à un moment où l’œil du cavalier n’était pas attiré par autre chose. Dans de pareilles conditions il me paraît remarquable qu’un aussi grand nombre d’objets ait été trouvé ; cela suppose évidemment une diffusion assez abondante des produits de l’industrie néolithique à la surface du Tanezrouft.
Il devient curieux par contraste qu’on n’ait rien trouvé dans les vallées de l’Ahnet, où l’on marchait à petites journées, faisant de longs séjours, et entouré de Touaregs familiers avec le pays, qui savaient devoir bénéficier d’une prime s’ils indiquaient un gisement néolithique.
Les Touaregs connaissent les haches néolithiques, ils s’en servent pour aiguiser leurs rasoirs, et ils ont d’ailleurs au sujet du néolithisme des légendes explicatives. Si je les ai correctement interrogés (ce qui est à vrai dire malaisé) ils indiquent en effet le Tanezrouft[128] comme la région par excellence où le néolithisme a laissé de traces.
Ce curieux renseignement cadre avec les observations de MM. Foureau et Chudeau à l’est du Hoggar. L’Aïr semble lui aussi très pauvre en néolithisme.
M. Chudeau a bien rapporté une flèche provenant de Teguidda n’Taguei (50 kilomètres N.-O. d’Agadès), mais elle était isolée, et le point d’ailleurs est franchement en dehors de l’Aïr montagneux.
M. Foureau a trouvé une fort belle hache à Aoudéras sur la limite méridionale de l’Aïr, mais il croit « qu’elle a été apportée en ce lieu ; car on ne trouve pas un seul instrument de pierre taillée à des centaines de kilomètres à la ronde ». C’est une affirmation qui a du poids sous la plume d’un collectionneur néolithique aussi attentif, aussi expérimenté et aussi heureux.
En revanche M. Foureau signale une très belle station néolithique au puits d’Assiou. M. Chudeau a trouvé une hache dans le nord du Tiniri et une flèche au sud d’In Azaoua. Le Tiniri serait donc relativement riche en stations néolithiques, de même que le Tanezrouft dont il est le pendant oriental.
Gisements de l’Adr’ar des Ifor’ass et de l’O. Tilemsi. — Sur tout le trajet entre In Ouzel et le Niger le nombre des outils néolithiques directement trouvés en place est restreint.
O. Tassemak débris d’atelier auprès d’une colline en quartzite (insignifiants).
O. Ichaouen une moitié de mortier en granit brisé (trop lourde pour être emportée).
A Tissédiyé une très petite et assez joliment travaillée pointe de flèche en quartz, et un débris de poterie. A noter que les rochers de Tissédiyé portent quelques gravures rupestres et qu’ils sont ensablés, chose rare dans l’Adr’ar.
Mentionnons encore, pour mémoire, une grande pointe de lance en roche cristalline, grossièrement mais incontestablement taillée, trouvée entre l’oued Tougçemin et Bour’oussa, mais malheureusement perdue.
Voilà pour l’Adr’ar des Ifor’ass.
Au Tilemsi, débris d’atelier, ou en tout cas esquilles de silex auprès du puits de Tabankor (insignifiants).
Au puits de Tabrichat, ou plus exactement à la mare temporaire qui voisine avec le puits, une très jolie petite hache.
[129]Je sais par ouï-dire qu’on a trouvé des flèches en silex et des poteries au poste même de Gao.
En somme, une pointe de flèche de Tissédiyé et une petite hache de Tabrichat, voilà tout ce que j’ai recueilli « en place » d’In Ouzel au Niger. Il est vrai que l’Adr’ar n’est plus, comme le Sahara, un pays à sol nu, décapé par les influences continues de la sécheresse et du vent. C’est au contraire un pays à sol alluvionnaire en formation, couvert de végétation. Les conditions sont donc bien plus défavorables pour la rencontre fortuite d’outils néolithiques en vrac à la surface du sol.
Pourtant entre les puits de Tarikent et d’Adiyamor, j’ai rencontré un cimetière musulman, actuel peut-être, et en tout cas moderne, qui est un véritable musée d’industrie néolithique. A peu près toutes les pierres tombales (pierres debout, stèles) sont des haches, des mortiers, des pilons, etc. ; bref d’innombrables outils néolithiques en admirable état de conservation ; il y en avait des centaines, et les échantillons prélevés ne représentent naturellement qu’une faible partie de l’ensemble. (Voir appendice VI, p. 352.)
Il est clair que l’existence de pareils cimetières-musées suppose une abondance, dans la région, d’outils néolithiques.
Au témoignage unanime des officiers, des cimetières de ce genre se rencontrent fréquemment dans la zone nigérienne, et les outils néolithiques rapportés du Soudan nigérien par le lieutenant Desplagnes, sont tout à fait les mêmes que ceux du Tanezrouft, de l’Adr’ar des Ifor’ass, et du Tilemsi. La province néolithique dans laquelle on entre au sud de l’Ahnet se continue donc au Soudan dans la boucle du Niger, jusqu’au Hombori, au Mossi.
Cette province néolithique se caractérise par l’énorme prédominance des haches. La collection Foureau qui provient surtout du Grand Erg au sud d’Ouargla ne contient qu’une trentaine de haches contre environ 6000 silex. Ma petite collection, recueillie au sud des oasis, contient une trentaine de haches contre deux pointes en silex et en quartz. Les collections soudanaises du lieutenant Desplagnes donneraient, je crois, une proportion analogue.
Et sans doute faut-il faire observer que le sol, au nord et au sud des oasis, n’offrait pas du tout les mêmes ressources à l’industrie néolithique : au nord les rognons de silex abondent dans les couches pliocènes ; au sud les terrains archéens, métamorphiques et éruptifs fournissent de superbes matériaux pour le travail des haches (Voir appendice VI), tandis que le silex fait défaut. Ce n’est pas absolu pourtant, du moins si on envisage la totalité de la province. Les[130] dépôts crétacés et tertiaires du Soudan (ceux du Tilemsi par exemple) contiennent des rognons de silex, et pourtant dans l’O. Tilemsi comme ailleurs ce qu’on rencontre surtout ce sont des haches.
On serait donc tenté de croire qu’aux différentes provinces néolithiques ont correspondu historiquement des civilisations diverses.
Rouleaux, meules dormantes. — Il faut mentionner à part une catégorie intéressante d’instruments en pierre polie, des rouleaux écraseurs et meules dormantes. Ils ne sont pas cantonnés dans la zone des haches en roches cristallines. Foureau en a trouvé beaucoup dans la zone d’Ouargla, où il a noté qu’ils accompagnent les gisements néolithiques. C’est là une affinité intéressante entre ces deux provinces, par ailleurs si différentes.
J’ai rapporte un instrument en pierre polie, long d’une cinquantaine de centimètres, et plus massif à un des bouts, en forme de massue, un bâton de pierre. Cet échantillon est isolé, c’est un outil contondant à la manière d’un pilon. Mais je n’ai pas vu le mortier qui lui correspondrait et l’interprétation reste hasardeuse.
Ce qui est beaucoup plus fréquent, ce sont des rouleaux écraseurs, de formes variables, cylindriques, en olive, sphériques, auxquels correspondent des augets, dont l’intérieur seul est soigneusement poli.
Tout ce matériel a servi indubitablement à moudre du grain. C’est l’équivalent, en civilisation primitive, de la meule tournant autour d’un axe.
Il est bien connu d’ailleurs, il se retrouve en Espagne, par exemple, à l’époque néolithique. Mais là, comme dans l’Afrique mineure, il appartient à un passé très lointain, qu’on exhume péniblement. Au Sahara et au Soudan il est actuel.
[131]On est frappé d’abord du grand nombre des échantillons signalés. Tous les voyageurs sahariens en ont rencontré. Lenz en a reproduit quelques-uns provenant de Taoudéni[104]. J’ai déjà dit que le capitaine Flye en a rapporté de l’Iguidi. Foureau en mentionne un grand nombre[105].
Il est tout naturel que les outils de ce genre soient extrêmement nombreux, puisqu’ils sont encore en usage au moins sur certains points et dans une certaine mesure.
Dans les oasis sahariennes (Touat, Tidikelt) on se sert pour moudre le grain de la meule méditerranéenne, algérienne, deux disques en pierre accolés, et réunis par un axe en fer autour duquel on fait tourner le disque supérieur au moyen d’une poignée également en fer. Il y a probablement très longtemps que la meule s’est substituée au rouleau écraseur, sur lequel elle a une supériorité évidente.
Il faut noter pourtant qu’on emploie encore pour écraser les noyaux de dattes (car on ne laisse rien perdre), un petit disque en pierre, de la grosseur du poing, creusé au centre de chacune de ses faces planes d’une petite cavité. Encore est-il que cet instrument semble devenir de jour en jour plus désuet, car en ayant trouvé un dans les ruines de Mzaourou j’ai eu toutes les peines du monde à m’en faire indiquer l’usage. Il me paraît évident que ce disque à écraser les noyaux de dattes est le dernier représentant des rouleaux écraseurs.
Au sud des oasis la meule algérienne disparaît, au moins dans le Sahara central, car, par l’intermédiaire de la Maurétanie elle a atteint Tombouctou.
Les Touaregs de l’Aïr font usage du rouleau écraseur, les affirmations de MM. Foureau et Chudeau, confirmées par une photographie très nette de M. Foureau ne laissent pas de doute à ce sujet.
Il est certain aussi, que le rouleau écraseur est actuellement en usage, sinon dans tout le Soudan du moins au Mossi[106].
Il faut noter pourtant que, dans l’Aïr à coup sûr, et peut-être aussi dans le Mossi, le grain est d’abord concassé, le plus gros de la besogne est fait dans un mortier en bois, avec un pilon en bois (du type si commun dans toute l’Afrique nègre). C’est ensuite seulement que le résidu de cette première trituration est versé dans des augets où les femmes achèvent de le réduire en farine avec les rouleaux écraseurs.
Or on a vu que, au nombre des échantillons recueillis au Tanezrouft[132] se trouve un véritable pilon en pierre, un outil de percussion qui n’a pas pu être employé comme rouleau. Il nous reporte à une période aujourd’hui close, où tout le matériel à moudre était lithique, depuis le pilon jusqu’au rouleau.
Il est évident aussi que dans ce domaine très étendu, où se rencontre épars sur le sol le matériel à moudre néolithique, les régions où il est resté en usage sont d’étendue insignifiante. Sur les bords du Niger par exemple, il me semble bien que son usage a presque tout à fait disparu. A Tombouctou on m’a bien montré deux pierres plates, qu’on frotte l’une contre l’autre et qui servent à parachever la fabrication de la farine, mais elles sont frustes, à peu près telles que la nature les a faites, un accessoire domestique sans importance, bien éloignées du fini et de l’élégance des rouleaux et des augets qu’on trouve dans la brousse.
On a dit que les rouleaux et les augets se retrouvaient aujourd’hui dans les cimetières ; j’ai rapporté une meule dormante brisée, qui porte une inscription arabe funéraire. M. Desplagnes en a publié une fort belle[107].
Si les rouleaux à moudre et les augets n’étaient tombés en désuétude on s’expliquerait difficilement leur accumulation sur les tombes en grandes quantités ; non seulement ces beaux outils intacts, finement travaillés, auraient trop de valeur pour être ainsi abandonnés si on en avait l’emploi, mais encore leur association sur les tombeaux avec des haches néolithiques suggère l’idée d’une sorte de vénération religieuse, s’attachant à des restes un peu mystérieux du passé. Au reste j’ai recueilli une petite légende touareg qui confirme cette manière de voir. Au puits de Meniet (sud du Mouidir) mourut la chamelle d’Élias (personnage du folklore touareg) ; de ce point précis Elias lança sa sagaie qui tomba à dix kilomètres de là ; au point où elle est tombée, à côté d’un redjem on voit des pilons en pierre. Ainsi les pilons en pierre sont associés à la sagaie d’Elias, ce serait faire beaucoup d’honneur à un ustensile actuel de ménage parfaitement identifié.
En résumé l’usage du matériel à moudre néolithique a partiellement disparu, mais il s’est maintenu partiellement, et nous saisissons ici sur le fait combien toute cette zone est encore incomplètement dégagée du néolithisme.
Aussi bien il n’est pas difficile d’en donner d’autres preuves.
La hache touareg est en fer, mais à emmanchure néolithique.
[133]On sait que les Touaregs et les Nigériens portent au-dessus du coude un bracelet de pierre (l’abedj). C’est un produit de l’industrie locale, j’ai trouvé dans les hauts de l’O. Taoundrart (Adr’ar des Ifor’ass) sur un affleurement de chloritoschistes un atelier d’abedj. Ainsi les Touaregs ont conservé la tradition du travail de la pierre.
Conclusion. — Il paraît évident que dans toute la Berbérie l’usage des outils et des armes en pierre s’est maintenu jusqu’à une époque récente. Dans les tombeaux on trouve le cuivre et le bronze toujours mélangés avec le fer ; pas trace d’époques indépendantes du cuivre et du bronze ; des silex taillés en petit nombre ont été trouvés dans des tombeaux qui contenaient aussi des objets en fer. Tout indique que le néolithisme rejoint ici l’âge du fer.
D’autre part, il n’y a aucune raison d’admettre que l’introduction du fer ait eu lieu ici de meilleure heure qu’en Europe. Au contraire, on trouve des stations de silex taillés dans des ruines historiquement datées comme celles de Mzaourou. Des dessins rupestres libyco-berbères, datés eux aussi par les animaux d’introduction récente qu’ils représentent (chameaux), n’ont pu être gravés qu’avec un outil néolithique. Tous ces vestiges du passé, outils néolithiques (les pilons à tout le moins), gravures, redjems sont rattachés par les Touaregs à des personnages mythiques, Elias et Amamellé, au sujet desquels le folklore fourmille d’anecdotes. Chez les Berbères d’Algérie, a fortiori chez ceux du Sahara, encore plus illettrés, l’histoire a vite fait de dégénérer en mythe. Pour que les souvenirs rattachés à Elias et Amamellé soient restés aussi vivants il faut qu’ils ne remontent pas à une époque reculée.
Au reste ce sont là les conclusions auxquelles on s’arrête généralement, ce sont celles de Foureau.
On peut affirmer encore que le néolithisme descend à une époque d’autant plus rapprochée de nous qu’on s’enfonce davantage dans l’intérieur du continent ; comme en témoigne non seulement l’emmanchure néolithique des haches touaregs et soudanaises, et l’usage de l’abedj, mais encore le fini des dessins rupestres sahariens représentant le chameau, ou encore la beauté des pointes d’Ouargla.
Nous sommes en état, semble-t-il, de distinguer des provinces. Celle du nord-ouest (Zousfana) est la moins intéressante, en ce sens du moins qu’elle est un simple prolongement de l’algérien néolithique. Mais les deux autres sont bien individualisées, aussi bien vis-à-vis de l’Algérie qu’entre elles.
Elles sont on ne peut plus distinctes ; d’une part, dans l’erg oriental[134] entre Ouargla et Radamès, énorme prédominance des flèches en silex ; — de l’autre, dans tout le Sahara central, prédominance non moins énorme des haches en roches cristallines.
Cette province Saharienne centrale semble un simple prolongement de la Soudanaise, telle que je l’ai entrevue et que M. Desplagnes l’a étudiée. Je ne saurais pas assurément où fixer une limite entre les deux et sur quels arguments baser une distinction. Notons même que les flèches nigériennes assez rares trouvées par M. Desplagnes sont exactement du type d’Ouargla[108]
Au contraire, du côté de l’Algérie l’hiatus est évident. Non seulement les rouleaux écraseurs d’âge récent font défaut en Algérie, mais les pointes d’Ouargla ne s’y trouvent que dans les vieux dépôts de cavernes.
Il reste bien entendu, naturellement, que toutes ces formes néolithiques, algériennes, sahariennes et soudanaises, ont des affinités communes avec le néolithique égyptien. Que l’Égypte soit pour toutes les civilisations nord-africaines le centre le plus ancien de diffusion, c’est un point acquis et d’ailleurs trop évident. Mais à cette restriction près le néolithique saharien tout entier a ses affinités bien plutôt avec le Soudan qu’avec l’Algérie. C’est un fait qui n’a jamais été signalé, et qui paraît incontestable.
Il semble bien aussi qu’il y ait entre les deux provinces, d’Ouargla et Saharienne centrale, un autre point très important de ressemblance. Qu’on jette un coup d’œil sur la carte des gisements de silex à la fin du deuxième volume des Documents de la Mission saharienne[109], on sera frappé de voir combien ces stations se pressent dans la cuvette de l’Igargar. Elles sont beaucoup plus rares non seulement au Tassili, mais aussi au Tadmaït, dans le haut pays, dans la section amont des fleuves.
C’est absolument ce que nous avons observé dans le Sahara central, les montagnes, Hoggar, Aïr, Mouidir, Ahnet sont très pauvres en industrie néolithique. Nous la trouvons concentrée dans le Tanezrouft et dans le Tiniri, c’est-à-dire dans les plaines d’alluvions des bas fleuves. Évidemment c’est là que vivaient les néolithiques, dans des régions qui sont aujourd’hui parfaitement inhabitables et inhabitées. Car la cuvette de l’Igargar, elle aussi, est dans son ensemble un désert redoutable, quoiqu’un peu de vie se soit conservée en son point le plus bas, au voisinage de l’Atlas (Ouargla, l’oued R’ir).
Tout au rebours la vie actuelle au Sahara s’est réfugiée aux[135] extrêmes radicelles des réseaux fluviaux dans les massifs montagneux qui arrêtent au passage quelque humidité. Les redjems et les gravures rupestres lui font cortège ; nous n’en avons pas vu dans les plaines désertes, Foureau n’en signale pas dans la cuvette de l’Igargar et pour les redjems en particulier cette lacune ne peut pas être fortuite. Quand nous disons gravures rupestres, nous entendons les plus récentes, les libyco-berbères frustes ou soignées, dépourvues de patine, puisque les anciennes font à peu près défaut. En un mot tout ce qui est actuel ou moderne en fait d’humanité ou de vestiges humains, tout ce qui se rattache à l’âge du fer est concentré dans les montagnes : tout le néolithique dans les plaines en contre-bas. Et notons que les seules gravures rupestres dont je puisse garantir l’ancienneté sont à Timissao, au cœur du Tanezrouft (?)
Cette répartition inverse des deux populations successives, néolithique et moderne, atteste évidemment qu’il s’est produit entre les deux un changement profond dans les conditions d’habitabilité, j’évite à dessein de dire un changement de climat.
Les néolithiques avaient d’ailleurs un matériel très compliqué à moudre le grain. Est-il incorrect d’en inférer qu’ils étaient grands consommateurs, et par conséquent producteurs de céréales, c’est-à-dire sédentaires ? Sans doute les Touaregs actuels, qui ne sont rien moins que cultivateurs, ont conservé dans une certaine mesure ce matériel néolithique ; et sans doute aussi ils consomment des grains, le peu de blé, orge, sorgho, qui pousse dans les ar’rem du Hoggar, et les graines de graminées sauvages (comme le drinn). Pourtant il n’est pas douteux que les céréales ne constituent pas pour eux, comme pour les peuples sédentaires, la base de l’alimentation : ils vivent surtout de lait, de viande et de dattes. Et c’est peut-être précisément parce que les grains sont pour eux une alimentation accessoire, qu’ils se contentent du matériel néolithique, d’ailleurs appauvri et dégénéré. En tout cas, ils laissent inutilisés à la surface du Sahara des milliers de rouleaux et de meules dormantes, en parfait état de conservation, et dont ils semblent même, pour peu que la forme en soit aberrante du type familier, ne pas soupçonner l’usage, avec cette incuriosité du Touareg pour tout ce qui n’est pas l’auxiliaire pratique et immédiat de sa rude existence.
Notons encore que la grande prédominance des haches dans tout le Sahara central suggère bien en effet l’idée d’une population agricole et sédentaire. On imagine qu’une population de nomades, pasteurs, chasseurs et guerriers, aurait eu un outillage militaire plus compliqué, où les armes de jet, les pointes auraient tenu une grande place.
[136]Tout cela concorde, et je ne crois pas interpréter abusivement le témoignage des faits en affirmant que, pendant toute la durée de l’époque néolithique, les cuvettes alluvionnaires du Sahara les plus désolées aujourd’hui ont été peuplées et susceptibles de culture à quelque degré. Il serait désirable assurément d’appuyer cette théorie sur des documents, je ne dis pas plus probants, mais plus nombreux. Il est clair que les plaines sahariennes défendues contre l’exploration par leur aridité, et par l’accumulation des dunes, sont tout particulièrement inconnues. Elles recèlent probablement, de l’homme néolithique, d’autres vestiges que des haches éparses et des meules dormantes. D’ores et déjà pourtant, l’idée paraît s’imposer, étayée sur un nombre respectable de faits négatifs et positifs, tous concordants. Mais ici nous nous heurtons à une difficulté intéressante. Le néolithique est d’hier dans le monde entier, et tout particulièrement dans l’Afrique du nord ; il est par définition post-quaternaire, et dans le Sahara il paraîtrait déraisonnable de reculer l’introduction du fer à beaucoup plus de deux mille ans. S’il s’était produit un changement de climat à une époque aussi récente, déjà historique, et dans un pays aussi proche de la Méditerranée, à coup sûr nous en serions informés.
Il faut donc que la modification constatée dans les conditions d’habitabilité soit indépendante du climat ; disons donc que les grands fleuves sahariens ont conservé, jusqu’à la fin du néolithique, assez de vie et d’humidité pour alimenter, par exemple, des oasis, aussi longtemps que les progrès du décapage éolien, et la formation des dunes qui en est la conséquence, n’avaient pas interrompu la continuité du tapis alluvionnaire.
Notre étude ethnographique nous conduit donc à des conclusions déjà formulées à la fin du chapitre précédent ; par des voies différentes nous sommes conduits à la même hypothèse, qui en devient plus vraisemblable.
On pourrait aller plus loin et aborder incidemment une question un peu dangereuse. Qu’étaient ces néolithiques sahariens, agriculteurs et riverains des grands oueds ? des Berbères ? ou des Soudanais ? c’est la vieille question garamantique, soulevée par Duveyrier.
On a dit que l’outillage néolithique saharien est soudanais bien plus qu’algérien.
On sait d’autre part que le climat, au Sahara, aux oasis par exemple, interdit aux hommes de race blanche l’agriculture, qui, jusqu’aux portes de Biskra, reste réservée aux Noirs.
La question des bœufs porteurs est de nature à jeter quelque jour sur la question. Des bœufs bâtés sont fréquemment représentés dans[137] les dessins rupestres, et cela jusqu’à Barrebi, au pied de l’Atlas. Nous savons d’ailleurs par les auteurs anciens que les Garamantes avaient des bœufs porteurs, et que ces animaux jouaient à peu près au Sahara le rôle actuellement dévolu aux chameaux. D’ailleurs, quoiqu’on l’ait trop souvent oublié, en traitant la question si controversée des Garamantes, on n’ignore pas que le bœuf porteur est actuellement encore d’un usage courant au Soudan, sur les bords du Niger. Les Touaregs de la boucle connaissent et emploient le bœuf porteur. Le bœuf soudanais est d’ailleurs beaucoup moins exclu du Sahara qu’on ne l’imagine : Duveyrier le signale à R’at[110].
Dans l’Adr’ar des Ifor’ass il est abondant, et il se retrouve au Hoggar même ; les Touaregs du Hoggar ont un cheptel de zébus qu’ils renouvellent facilement chez les Ifor’ass, leurs clients. Cela revient à dire qu’il ne serait pas impossible aujourd’hui encore de faire traverser le Sahara à une charge portée par un bœuf. Les zébus du Hoggar, pour peu qu’on choisisse la saison et la route, atteindraient sans difficulté insurmontable le Tidikelt (où les moutons et les chèvres arrivent tous les hivers), et le long des oasis, qui forment un chapelet continu, le voyage se continuerait jusqu’en Algérie. Ce voyage serait une absurdité économique, le bœuf ne pouvant évidemment soutenir la concurrence du chameau, il ne serait pas une impossibilité pratique.
Lors donc que nous constatons l’existence de bœufs porteurs garamantiques dans les postes romains de la Tripolitaine, il est difficile de se soustraire à la conclusion que les caravanes transsahariennes disposaient il y a deux mille ans d’un outillage, et peut-être d’un personnel soudanais.
Rappelons que dans le nom des Garamantes on a voulu retrouver celui des Haratins, cette tribu ou plutôt cette caste de Noirs qui peuplent les oasis de l’O. R’ir, d’Ouargla, du Touat, de l’O. Draa ; il est vrai que le sang des Haratins est incessamment renouvelé par les Nègres soudanais affranchis, mais si la traite a contribué à maintenir cette caste, il ne s’ensuit pas qu’elle l’ait créée. Il pourrait bien y avoir là un résidu d’une ancienne tribu soudanaise aborigène. La thèse a été soutenue et elle l’est encore.
Les Touaregs eux-mêmes sont sans doute des Berbères et par suite des Blancs. La couleur de la peau est assez claire en général, les[138] traits du visage sont caucasiques, l’allure générale est méditerranéenne. Beaucoup d’entre eux pourtant sont de taille gigantesque, et ils sont en moyenne bien plus grands que les Berbères du nord ; dans leur voisinage on ne voit guère que certaines races soudanaises, les Yoloffs, par exemple, qui soient d’aussi haute stature. Les femmes touaregs ont une tendance marquée à la stéatopygie, qui n’est certes pas un trait caucasique. Une grande partie de leur outillage, et de ce qui paraît chez eux, à qui vient du nord, le plus national est incontestablement soudanais ; le bracelet en pierre, par exemple (l’abedj), est porté par tout le monde au Niger, on en fabrique de superbes au Hombori. Nous avons déjà dit qu’ils ont le matériel à moudre soudanais (mortier et pilon de bois, écraseur en pierre) ; la hache de fer à emmanchure néolithique est commune aux Touaregs et aux Nègres.
Ils partagent également avec les Nègres du Soudan leurs institutions les plus vénérées ; par exemple un reste de matriarcat ; la transmission de l’héritage de l’oncle maternel au neveu, et non pas de père en fils, forme la base du droit successoral aussi bien chez les Sonr’aï que chez les Hoggar. Et des restes très visibles de totémisme unissent encore les Touaregs aux Nègres ; par exemple, un Touareg ne mange pas de lézard de sable « parce qu’il est, dit-il, son oncle maternel ». Il s’abstient aussi de poisson et d’oiseaux[111].
Il semble que, en grattant un peu le Berbère touareg, on retrouve le nègre auquel il s’est récemment substitué.
Qu’il y ait eu à une époque récente, celle peut-être de la conquête romaine, un Sahara encore néolithique et peuplé tout autrement que le nôtre, de Nègres agriculteurs qui s’étendaient jusqu’aux confins de l’Algérie, c’est donc une hypothèse commode, groupant en un faisceau tous les faits observés.
[43]Duveyrier, Les Touaregs du nord, p. 279, pl. XV, et Capitaine Bernard, Observations archéologiques..., dans Revue d’Ethnographie, 1886.
[44]Foureau, Documents scientifiques de la Mission saharienne. Figure 377.
[45]Benhazera, Six mois chez les Touaregs du Ahaggar. Société de Géographie d’Alger, 1906, p. 327-328.
[46]Bulletin du Comité de l’Afrique française, supplément d’octobre 1907, p. 257, etc.
[47]Cités et nécropoles berbères de l’Enfida, par M. E.-T. Hamy. Extrait du Bulletin de Géographie historique et descriptive, no 1, 1904.
[48]Voir dans Recherche des Antiquités dans le nord de l’Afrique (Instructions adressées aux correspondants du ministère de l’Instruction publique). Paris, Leroux, 1890, p. 42, 43.
[49]Edmond Doutté, Merrakech, p. 58.
[50]Signalé au Dr Hamy par M. le comte Jean de Kergorlay (Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions, 1903).
[51]Desplagnes, Le Plateau central nigérien, p. 46 bis, Pl. XXVI.
[52]Rapport inédit.
[53]L. c., p. 331, etc.
[54]Deux font partie de la même charnière (?) qu’elles constituent par leur association (27 mm. de long sur 14 et 19 mm. de large). La troisième a 40 mm. sur 25 ; elle est repliée sur elle-même de façon à former à elle seule une charnière complète. Les clous sont en cuivre. On n’en donne pas de reproduction photographique parce que l’identité est complète avec l’échantillon d’Aïn Sefra. Tous ces objets sont en cuivre et non en bronze. Voir appendice VII, p. 354.
[55]Bourguignat, qui a observé la présence de ces cratères ou cupules d’effondrement dans les redjems du Nahr Ouassel, croit à tort que les redjems cratériformes ont été « violés ».
[56]Voir coupe et plan dans Cités et Nécropoles berbères de l’Enfida, par M. E.-T. Hamy, extrait du Bulletin de Géographie historique et descriptive, no 1, 1904, p. 29.
[57]Motylinski, Voyages à Abalessa et à la Koudia, dans le supplément du Bulletin du Comité de l’Afr. fr., octobre 1907 ; voir les phot. p. 262 et 266.
[58]Supplément au Bulletin du Comité de l’Afrique française de janvier 1904 et octobre 1904.
[59]Cette dernière (387) est la seule de ce genre qui ne se trouve pas rigoureusement au Tassili des Azguers, mais elle en est peu éloignée.
[60]Crâne d’enfant trouvé à Aïn Sefra par le capitaine Dessigny (E.-T. Hamy, Les Ardjem d’Aïn Sefra, l. c.). — Crâne d’enfant trouvé à Taloak et rapporté au Muséum. — Crâne d’Ouan Tohra retiré à peu près intact du redjem mais si fragile qu’il n’a pas supporté le voyage.
[61]Foureau, l. c., p. 1091.
[62]A ce point de vue le Tombeau de la Chrétienne est remarquable ; on le voit de partout dans l’arrondissement d’Alger.
[63]L. c., p. 43 et s.
[64]Pomel, Carte géologique de l’Algérie, Notices explicatives. — Paléontologie ; passim.
Flamand, Note sur des stations nouvelles ou peu connues de pierres écrites, L’Anthropologie, mars-avril 1892.
Id., Note sur deux pierres écrites... d’El Hadj Mimoun, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 16 mars 1897.
Id., Congrès international d’Anthropologie de 1900 (Comptes rendus, p. 267).
Id., Les pierres écrites, Société d’Anthropologie de Lyon, 29 juin 1901.
[65]Communication de M. le Dr Hamy à l’Académie des Inscriptions, séance du 5 septembre 1902, d’après des dessins du capitaine Normand.
[66]L. c.
[67]Gsell, Monuments antiques de l’Algérie, t. I, p. 46 et Gaillard, Le Bélier de Mendès, Société d’anthropologie de Lyon, 4 mai 1901.
[68]Ils paraîtront dans le Corpus des gravures rupestres que M. Flamand prépare.
[69]Signalée pour la première fois d’après le lieutenant Barthélemy par Capitan, Revu. de l’École d’anthropologie de Paris, XII, 1902, p. 300-311.
[70]Pomel, Carte géologique de l’Algérie. Paléontologie, monographies. Les Bosélaphes Raye
[71]L. c. Antilopes Pallas, p. 38 et pl. XV, fig. 12.
[72]Foureau, Documents scientifiques, t. II, p. 1013, fig. 359.
[73]Anthropologie, XVI, 1905, p. 119-120.
[74]L. c., Antilopes Pallas, pl. XV, fig. 8, 9.
[75]Pomel, l. c. Bubalus antiquus, Pl. X, p. 83.
[76]Instructions adressées par le Comité des travaux historiques. — Recherche des antiquités dans le nord de l’Afrique, p. 60, fig. 21.
[77]On le retrouve dans une inscription du Gourara copiée par le commandant Deleuze (Flamand, Note sur quelques stations nouvelles, etc., pl. V).
[78]Cette station est la même que celle qui a été étudiée par ouï-dire par M. Flamand sous le titre Gravures et inscriptions rupestres relevées entre Beni Abbès et le ksar d’el Ougarta (Note sur quelques stations nouvelles, etc., Bulletin de géographie historique et descriptive, no 2, 1905). El Ougarta est une lecture fautive pour el Ouata.
[79]La Géographie, 1900, p. 362.
[80]G.-B.-M. Flamand, Note sur quelques stations nouvelles, etc., Bulletin de Géographie historique et descriptive, no 2, 1905, p. 283.
[81]Ibid., et Congrès international d’Anthropologie, Paris, 1900. Bull. Soc. anthr. de Lyon, juin 1901 et juin 1902.
[82]Flamand, l. c., et Rimbaud, Supplément du Bulletin du Comité de l’Afrique française, no 5, septembre 1901.
[83]Supplément au Bulletin du Comité de l’Afrique française d’octobre 1904, p. 250, 251. M. Flamand (l. c., Notes sur quelques stations nouvelles, etc.) a publié d’après des dessins de M. le maréchal des logis Paté des inscriptions et grafitti provenant de deux localités ainsi orthographiées : oued Tiratanin et roche Takount dans l’oued Tougoulgoult. Tiratanin est sûrement une faute de lecture pour Tir’atimin ; la seconde station me paraît identique à Tahount Arak.
[84]Notes manuscrites encore inédites de M. Motylinski.
[85]P. 1071, fig. 380.
[86]Voir la bibliographie de la question dans Flamand : Pierres écrites. Société d’anthropologie de Lyon, 29 juin 1901, p. 34. Voir aussi : Flamand, De l’Introduction du chameau dans l’Afrique du Nord, XIVe Congrès des orientalistes. — Lefébure, Le chameau en Égypte, ibid., et particulièrement R. Basset : Le nom du chameau chez les Berbères (ce nom est dérivé de l’arabe).
[87]Je sais naturellement que cette appellation de dromadaire est la seule exacte ; mais la distinction entre chameau et dromadaire n’est maintenue que dans les dictionnaires ; elle n’est pas de langue courante.
[88]Cela ressort surtout des notes manuscrites de Motylinski.
[89]Pomel, Monographies. Le Singe et l’Homme. Planches passim.
[90]Journal de voyage de... Traduit et annoté par Schirmer. Paris, Fischbacher, 1898, p. 115.
[91]L. c., Les Antilopes Pallas, p. 34, et fig. 1, 2, 3, 4 de la pl. XV.
[92]Notes manuscrites, qui seront publiées intégralement.
[93]Foureau, Documents scientifiques de la mission saharienne.
[94]D’après Desplagnes, l. c.
[95]Livre XVII, chap. III, p. 5, il est question d’un animal de taille gigantesque qui ressemble à un taureau (?)
[96]Pomel, Monographies. Le Singe et l’Homme. Planches passim.
[97]L. c.
[98]Fig. 20.
[99]Elles ont fait l’objet d’une monographie détaillée par Pallary : Classification industrielle des flèches néolithiques du Sahara, dans L’Homme préhistorique. 1er juin 1906.
[100]Paul Pallary, Caractères généraux des industries de la pierre, L’Homme préhistorique, février 1905, p. 40.
[101]Id., ibid., p. 38, et AFAS, 1891, II, p. 637-644.
[102]On a signalé en Algérie sur beaucoup de points des outils néolithiques dans des ruines berbères et romaines. P. Pallary, l. c., Caractères généraux etc., p. 41.
[103]M. le commandant Laquières a trouvé, je crois, quelques pointes à Beni Abbès.
[104]Lenz, Tombouctou, trad. Lehautcourt, t. II, p. 76.
[105]Foureau, Documents scientifiques de la mission, passim.
[106]Voir Desplagnes, l. c., pl. XXI.
[107]L. c., pl. XLI. Voir appendice V, p. 351.
[108]Pl. XV, fig. 29, dans l’ouvrage de M. Desplagnes.
[109]Fig. 394.
[110]P. 221. On a l’impression que Duveyrier est aujourd’hui beaucoup plus cité que lu. Son enthousiasme un peu juvénile pour les vertus touaregs l’a discrédité. Pourtant ses résultats sont presque toujours confirmés par les travaux récents. Sa carte en particulier apparaît aujourd’hui tout à fait remarquable pour l’époque. C’était un excellent observateur.
[111]Voir dans Desplagnes une foule de détails curieux et d’hypothèses peut-être hasardeuses sur les grands totems soudanais du poisson, de l’oiseau et du serpent.
[139]CHAPITRE IV
LA ZOUSFANA
Dans les trois premiers chapitres on a cherché à exposer, en les systématisant peut-être outre mesure, un certain nombre de faits concernant le Sahara en général. Les chapitres qui suivent seront au contraire des monographies. On essaiera d’étudier successivement, dans le Sahara algérien, les régions traversées par l’itinéraire.
Celle qui se présente d’abord est la région de la Zousfana.
Le pays dont il s’agit est celui que traverse la ligne de chemin de fer récemment construite de Beni Ounif à Colomb-Béchar, et la route d’étapes entre Beni Ounif et Igli. Dans les dernières années on y a fondé trois postes militaires importants, Colomb-Béchar, Ben Zireg et Tar’it (écrit souvent Taghit). C’est une région accidentée par de puissantes masses montagneuses, le Mezarif, le Béchar, le Moumen, l’Antar, le djebel Orred, le Grouz. Les géants entre tous les autres sont le Grouz et l’Antar, qui dépassent 1900 mètres. Mais le Mezarif, le Moumen, le Béchar, encore que plus modestes, se dressent à 1400 mètres sur un socle, la vallée de la Zousfana, qui en a 700 ou 800.[112]
Roches primaires (carbonifériennes). — Cette région montagneuse est en grande partie constituée par des roches primaires, et surtout carbonifériennes.
Au point de vue paléontologique, la couche intéressante est une puissante assise calcaire qui contient un peu partout des fossiles ; j’en ai trouvé en particulier au Mezarif et dans l’Antar, où on n’en[140] avait pas encore signalé. Mais il y a surtout deux beaux gisements classiques, celui de Taouerda à quelques kilomètres au nord d’Igli, et celui de Mouizib el Atchan (littéralement la gouttière de la soif) ; c’est le nom d’un torrent à sec conduisant au col où passe la route directe de Colomb-Béchar à el Morra. Encore que séparés par une centaine de kilomètres, ces deux gisements de Taouerda et du Mouizib n’en font qu’un en réalité ; ce sont deux sections d’une même couche qu’on voit se continuer sans interruption, ils contiennent d’ailleurs des fossiles identiques.
Ces fossiles ont été étudiés par plusieurs géologues : MM. Joleaud, Ficheur, Douvillé, Collot, Thévenin[113]. Leurs conclusions sont parfaitement nettes.
M. Ficheur écrit : « L’ensemble de cette faune... présente des caractères assez nets pour l’attribution du niveau fossilifère d’Igli à l’étage Dinantien et à la partie supérieure du sous-étage Tournaisien des géologues belges. »
Et M. Armand Thévenin : « L’étude de ces fossiles confirme en la complétant la note publiée en 1900 par M. Ficheur sur le carbonifère d’Igli... C’est bien là une faune du Dinantien inférieur et moyen (calcaire carbonifère d’Irlande, Visé et Tournay). »
La formation m’a paru avoir environ 500 mètres de puissance, mais c’est là un chiffre simplement approximatif ; dans une région plissée, de semblables évaluations sont sujettes à caution. Le calcaire est très dur, souvent rognonneux et de coloration assez variable, du bleu foncé, qui domine incontestablement, au gris et au jaune. Les assises calcaires (j’en ai compté huit au Mouizib) sont intercalées de marnes ou d’argiles, dont la puissance augmente progressivement vers la base de la formation. (Voir fig. 28 et aussi pl. XXI, XXII et XXIII.)
C’est au Mouizib surtout que j’ai eu le loisir d’étudier cette formation, mais elle m’a paru très uniforme dans toute la région, — à une exception près.
A Ben Zireg des pressions plus énergiques ont transformé les marnes ou argiles en ardoises ; il en résulte un facies si nouveau qu’on peut avoir des doutes sur le synchronisme ; les calcaires de Ben Zireg pourtant contiennent des fossiles, rares et mauvais, il est vrai, mais que M. Haug qui les a examinés, déclare carbonifériens. (Voir appendice XI.)
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XX. |
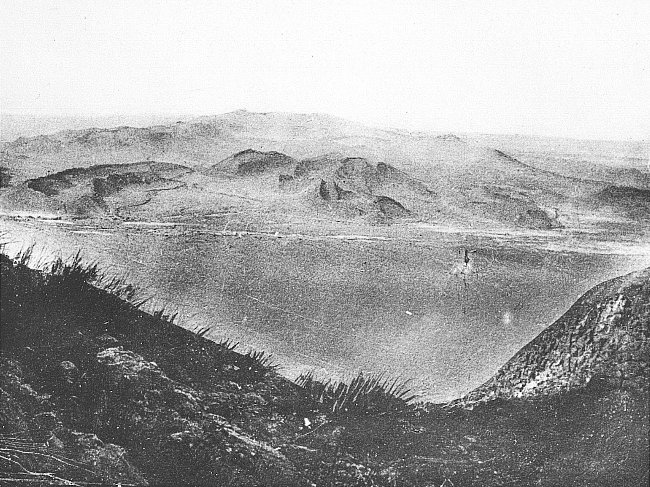
| Phototypie Bauer, Marchet et Cie, Dijon | Cliché Gautier |
39. — DJ. ORRED
Vu en contrebas du sommet de l’Antar.
Affleurements ennoyés de couches calcaires dinantiennes vivement redressées.
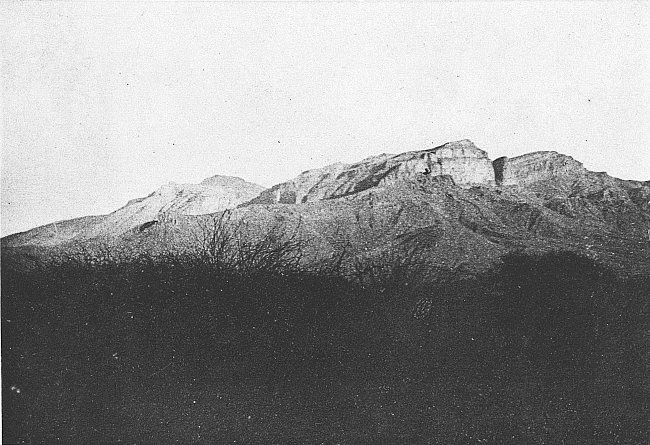
Cliché Gautier
40. — SOMMET DE L’ANTAR
Vu du djebel Orred (exactement Sidi-Dahar), montrant l’horizontalité des couches calcaires dinantiennes au sommet.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XXI. |

Cliché Gautier
41. — DANS LE BÉCHAR : COL DU MOUIZIB EL ACHAN
Sommet de la descente qui mène à la Zousfana. — Calcaires dinantiens.

Cliché Gautier
42. — DANS LE BÉCHAR : COL DE TENIET NAKHLA
Sommet du col. — Calcaires dinantiens.
[141]Les calcaires dinantiens, par leur dureté, ont résisté à l’érosion et sont accusés en relief ; ils composent la masse de tous les massifs montagneux sans exception (le Grouz mis à part). Au rebours, les formations inférieures et supérieures au dinantien, beaucoup plus molles, sont accusées en creux ; et par conséquent ennoyées la plupart du temps. Elles sont donc beaucoup plus difficiles à étudier, et elles ont trop échappé à l’attention. En réalité il est très possible de s’en faire une idée.
Les couches inférieures s’observent dans la vallée de la Zousfana entre Ksar el Azoudj et Zaouia Tahtania. Sur tout le pourtour, au Mouizib comme à Tar’it, au Mezarif, au Moumen, on voit les calcaires dinantiens reposer en concordance sur des couches argileuses ou marneuses, d’un gris verdâtre, interstratifiées de grès rouge foncé ou noir, en bancs minces ; dans la vallée même, sur différents points, mais surtout dans la partie nord, à Ksar el Azoudj en particulier et à Haci el Begri, on voit cette même formation percer à travers l’ennoyage. Elle paraît homogène et puissante. (Voir appendice XI.)
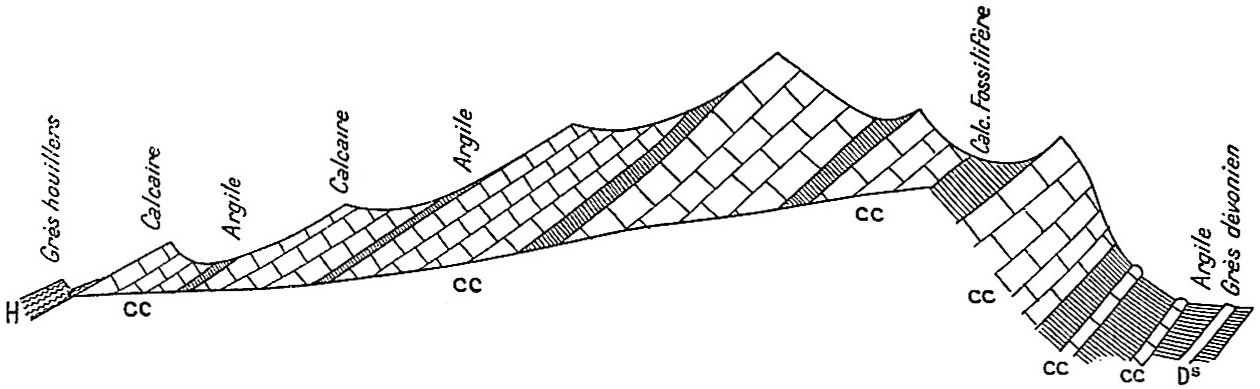
Fig. 28. — Coupe du Mouizib el Atchan.
CC, calcaire carbonifère ; Ds, dévonien supérieur ; H, houille.
Je n’y ai pas trouvé de fossiles, et s’il est commode provisoirement de la considérer comme dévonienne, encore faut-il observer que les couches à clyménies de Beni Abbès, qui appartiennent authentiquement au Dévonien supérieur, ont un facies tout à fait différent.
Les couches supérieures au dinantien ont été observées en deux points, fort éloignés l’un de l’autre, au nord du Béchar d’une part, et à Menouar’ar de l’autre (versant occidental de la hammada de Tar’it).
Au Mouizib on voit les calcaires dinantiens s’enfoncer en stratification concordante sous des grès, qui constituent le sous-sol de toute la plaine entre le poste de Colomb et la montagne de Béchar, et qu’on suit jusqu’à Kenatsa. (Voir pl. XXVI, phot. 49.) On ne fait qu’apercevoir ces grès à travers les déchirures du sol formé de cailloutis[142] et d’alluvions récentes. Il semble bien toutefois que l’ensemble de la formation soit essentiellement gréseux.
Sur la route de Tar’it à Menouar’ar, on retrouve les mêmes formations, se succédant dans le même ordre, et on voit les calcaires carbonifériens fossilifères disparaître sous les mêmes grès, ou du moins sous des grès d’aspect identique. Mais ici les alluvions récentes superficielles sont moins développées ; les grès sont à nu sur une certaine étendue ; et on constate qu’ils sont interstratifiés avec des bancs très minces de calcaire à crinoïdes, tout à fait semblables à celui de l’étage immédiatement inférieur. Le puits de Menouar’ar est creusé dans les alluvions d’un petit oued juste au pied d’une falaise haute à peine d’une dizaine de mètres et sur la tranche de laquelle apparaissent les couches suivantes de bas en haut.
| A la base. | 1. Poudingue fossilifère | 1m,50 |
| 2. Grès passant au poudingue | 1m,50 | |
| 3. Schistes gréseux | 3m. | |
| 4. Poudingue fossilifère | 1m,50 | |
| Au sommet. | 5. Calcaire à crinoïdes | 1m,50 |
Dans les poudingues, les fossiles abondaient, mais si mal conservés et si fragiles qu’il a été impossible de les recueillir. A coup sûr les crinoïdes prédominaient. Le calcaire bleu du sommet avait tout à fait l’aspect des calcaires de Béchar.
La réapparition de ces calcaires au milieu des grès tendrait évidemment à faire croire qu’il s’agit de formations très voisines, dont la plus récente est la simple continuation, sans lacune, de la plus ancienne.
M. Gentil signale au Maroc, dans le Haut-Atlas, des grès Permiens en relation avec des calcaires Dinantiens[114]. Ici il semble bien qu’il faille conclure à un âge carboniférien.
M. le lieutenant Poirmeur a rapporté des fossiles de deux points qui sont ainsi désignés[115] : « 1o vallée de l’O. bou Gharraf, affluent de l’O. bou Dib ; ... à fleur de terre, dans un îlot formé par un affleurement rocheux, dans le lit de l’oued. — 2o Gueb el Aouda, piton rocheux, qui domine l’O. Béchar à 25 kilomètres au sud du ksar. » Les deux échantillons sont des moulages en grès rougeâtre, ferrugineux, de plantes houillères. M. Bureau a reconnu dans le premier Stigmaria ficoides, et il écrit à son sujet : « Il est clair que ce rhizome bien que n’étant plus in loco natali, n’a pas subi un transport violent[143] ni à une longue distance. » L’autre est Lepidodendrum Veltheimianum. Ces types appartiennent à la phase la plus ancienne de la végétation carbonifère.
D’autre part M. G.-B.-M. Flamand a trouvé dans la même région de petits lits de houilles à empreintes végétales[116]. Ces grès houillers du Béchar, ennoyés sur de grandes étendues, pourraient présenter après tout un intérêt pratique. Sur le chapitre de la houille saharienne on est en général très sceptique. La question a été traitée avec une haute compétence par M. Haug, qui aboutit à des conclusions négatives, à propos des échantillons et des fossiles rapportés par M. Foureau de l’erg d’Issaouan. Mais Issaouan et Béchar sont à mille kilomètres l’un de l’autre, et les conditions du gisement sont bien différentes et même inverses. M. Haug écrit :
« Tant que l’on envisageait les calcaires carbonifères de l’erg d’Issaouan comme du carbonifère inférieur on pouvait conserver l’espoir de rencontrer au-dessus d’eux des terrains houillers, mais à présent que l’âge moscovien et ouralien de ces calcaires est établi, il n’est plus permis de garder des illusions à cet égard[117]. »
Au Béchar c’est justement l’étage inférieur, Dinantien, qui est calcaire, franchement marin. Les étages supérieures au contraire sont gréseux et ont un facies de formation littorale.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XXII. |

Cliché Gautier
43. — DANS LE BÉCHAR, AU PIED DU VERSANT NORD
Petite palmeraie d’el Djenien. — Calcaires carbonifériens.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XXIII. |

Cliché Gautier
44. — DJEBEL BÉCHAR
Vu du Sud, c’est-à-dire de la Zousfana, sur laquelle il se termine par une falaise.

Cliché Gautier
45. — DJEBEL BÉCHAR
Vu du Nord, c’est-à-dire de la cuvette synclinale de Colomb-Béchar.
On distingue nettement l’inclinaison des couches dans la montagne.
Au premier plan Modjbed.
Roches secondaires — Dans le nord de la région étudiée ce sont les roches secondaires qui dominent ; elles constituent à peu près toute la masse du Grouz, où elles sont représentées par une grande variété d’étages depuis le Lias jusqu’au Cénomanien. Je n’ai fait qu’entrevoir le Grouz dont la géologie est certainement très délicate à débrouiller. Je ne puis que renvoyer à la carte géologique récente de M. Poirmeur[118].
En dehors du Grouz dans la région de Colomb-Béchar, et même, semble-t-il, dans celle du bas Guir le Cénomanien couvre de grands espaces. Il est riche en superbes fossiles de détermination facile[119]. Il est représenté par le facies qui lui est habituel dans tout le Sud-Algérien, à la base des marnes gypseuses, au sommet des calcaires clairs, très durs. Les marnes font parfois défaut, à Ben Zireg par exemple. La formation n’est pas puissante, une cinquantaine de[144] mètres d’épaisseur peut-être, à Ben Zireg une dizaine ; on constate partout, sans conteste, qu’elle repose directement sur le substratum carboniférien. Les grès albiens (à dragées et à bois silicifiés) sont encore représentés dans le Grouz, ils disparaissent complètement à partir de Ben Zireg. La transgression cénomanienne est évidente, au sud du Grouz elle a déposé sur le substratum primaire une simple pellicule, un placage secondaire. (Voir appendice XI.)
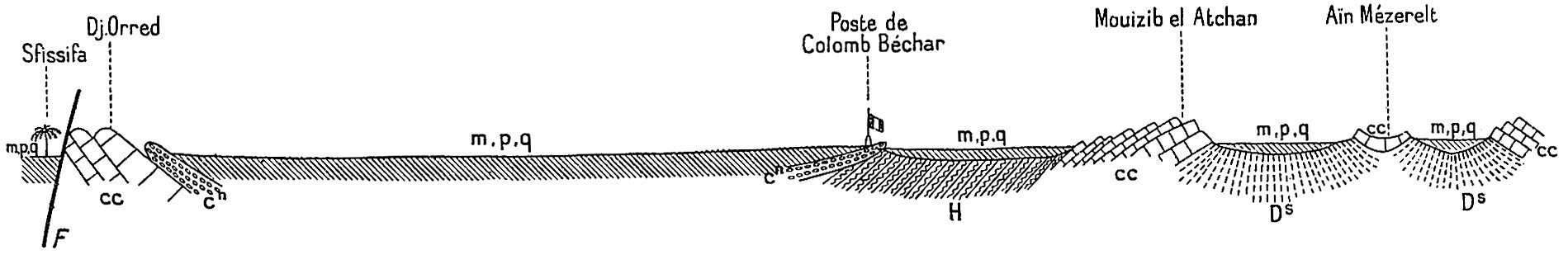
Fig. 29. — Coupe de Sfissifa à Mézerelt par Colomb et le Mouizib.
Cn, cénomanien ; m, p, q, mio-pliocène et quaternaire.
Plis hercyniens. — Je crois pouvoir essayer une exposition tectonique ; quelques traits généraux en tout cas apparaissent bien nets.
Les couches primaires sont affectées de vieux plissements, qu’on peut appeler hercyniens ; à Ben Zireg les strates carbonifériennes sont redressées verticalement, et dessinent un anticlinal fermé à l’ouest ; sur ce pli arasé, le Cénomanien repose parfaitement horizontal[120]. La relation est la même au poste de Colomb-Béchar et à Kenatsa. Il y avait donc des plis primaires arasés avant le dépôt du Cénomanien. (Voir fig. 29, 30, 31 et 32.)
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XXIV. |

Cliché Gautier
46. — COLLINES DE BEZAZIL KELBA (littéralement : tétines de chienne) ; versant nord du Béchar.
C’est une feuille de calcaire cénomanien qui plonge vers le spectateur ; la crête est érodée en dents de scie.
[145]La vallée de la Zousfana de Ksar el Azoudj à Tar’it est une grande boutonnière anticlinale, autour de laquelle les affleurements primaires dessinent des auréoles concentriques de plus en plus jeunes. Ce pli est orienté nord-est-sud-ouest, ce qui est une direction notablement aberrante de celle des plis atliques.
Dans la partie nord-est du Mezarif, où le pli est un synclinal fermé au sud-ouest, les strates calcaires profondément déchaussées par l’érosion, se dressent en murailles demi-circulaires concentriques, toutes rasées régulièrement à la même hauteur. Évidemment un tronçon de pénéplaine exhaussée, et disséquée par l’érosion.
L’extrémité fermée du synclinal touche à une faille au delà de laquelle apparaît l’extrémité également fermée d’un anticlinal, également arasé.
La faille se constate directement, puisqu’elle ramène en surface une bande de grès dévoniens, mais elle ne se traduit dans l’orographie actuelle par aucune dénivellation, elle est donc fort ancienne, constitutive de la pénéplaine.
Si on prolonge par la pensée cette ligne de faille, elle passe entre l’extrémité fermée à l’ouest de l’anticlinal de Ben Zireg, et l’extrémité fermée à l’est du synclinal du Béchar. Il court donc là, dans une direction à peu près nord-sud, un accident, un décrochement, j’imagine, à la rencontre duquel les plis se ferment et se relaient[121]. L’accident et les plis sont évidemment contemporains, cela forme un ensemble, et comme l’âge hercynien est prouvé pour certaines parties il l’est pour le tout.
Je ne sais quelle part faire aux plis hercyniens dans l’allure très particulière du djebel Moumen. Il a un sommet rectiligne et que de loin on jugerait tabulaire ; en réalité il est couronné par une feuille de calcaire pliée en synclinal très aigu dans le sens de la longueur. (Cf. fig. 31.)
Plis atliques. — C’est naturellement la surrection de l’Atlas qui a rajeuni le relief hercynien.
L’énergie des plissements atliques varie de part et d’autre d’une ligne de faille très apparente. A Bou-Kaïs elle est jalonnée de pointements éruptifs (ophite ?), elle passe au nord du dj. Orred, entre le dj. Orred et l’Antar (Pl. XX), enfin au sud de l’Antar. Elle sectionne en falaises brusques et fraîches les calcaires dinantiens de l’Orred ; au pied de l’Antar elle a affecté les calcaires cénomaniens, qui sont[146] vivement redressés au nord, et parfaitement horizontaux au sud. Il faut donc qu’elle soit post-cénomanienne.
Au nord de cette ligne sont les montagnes géantes, le Grouz et l’Antar (près de 2000 m.).
Tout ce qu’on peut affirmer ici du Grouz, au point de vue géologique, c’est qu’il se termine au sud par un pli couché ; je puis l’affirmer en m’appuyant sur l’autorité de M. Ficheur, professeur de géologie à l’École des sciences d’Alger ; il a constaté auprès de Beni Ounif, aux djebels Melias et Zenaga que les calcaires jurassiques reposent sur les grès albiens[122]. Le pli couché est bien net aussi auprès de Bou Aïech ; on y voit une feuille calcaire repliée sur elle-même et coinçant dans le synclinal des schistes indéterminés.
Le dj. Antar est de structure plus simple, mais analogue.
Cette montagne est constituée tout entière par un pli déversé au sud. (Cf. fig. 31 et 32.) Sur sa face occidentale, non loin de Sidi Dahar, dans une large déchirure, on a sous les yeux une magnifique coupe géologique ; on y voit les argiles dévoniennes coincées au cœur du pli ; le calcaire carbonifère les recouvre en plaques horizontales puissantes qui constituent le sommet de la montagne (voir pl. XX, phot. 40), puis sur la face sud, dominant Ben[147] Zireg ces mêmes calcaires se replient et passent sous le Dévonien.
L’âge atlique de ce pli est de toute évidence, puisque les calcaires cénomaniens y participent énergiquement.
Au sud de la faille les conditions sont tout autres. L’altitude s’abaisse brusquement, le Béchar est plus bas que l’Antar de 500 à 600 mètres. Du haut de l’Antar on aperçoit le Béchar et l’Orred étalés à ses pieds comme en projection planimétrique. (Voir pl. XX, phot. 39.)
Le Béchar et l’Orred sont les épaulements nord et sud d’un synclinal largement étalé, au centre duquel est le poste de Colomb-Béchar, et dont le fond est recouvert par le placage cénomanien et l’ennoyage récent (fig. 29).
Le Cénomanien est resté horizontal au centre, mais il est redressé au nord et au sud, tant sur les flancs de l’Orred que sur ceux du Béchar, où il constitue les curieuses collines de Bezazil Kelba. (Voir pl. XXIV, phot. 46.) Le synclinal hercynien a donc rejoué récemment, quoique assez faiblement.
Les collines de Bon Yala et de Fendi sont elles aussi le résultat de plis légers affectant le Cénomanien (?)
La partie occidentale du Béchar a été affectée d’un plissement atlique. Immédiatement à partir du Mouizib on le voit apparaître dans les schistes argileux dévoniens, passer dans les calcaires dinantiens (fig. 30), puis dans les grès houillers ; il détermine l’éperon que le Béchar projette vers l’ouest, jusqu’au Guir, au sud de Kenatsa.
Ce pli est double ; les deux indentations profondes qui déterminent les cols voisins du Mouizib et du Teniet Nakhla sont des anticlinaux très nets, accusés en creux aussi longtemps qu’ils affectent les argiles dévoniennes et séparés par l’éperon calcaire en relief de l’Aïn Mézerelt qui est affecté d’une légère ondulation synclinale (fig. 29 et 30).
Ce double pli (pli de Kenatsa, si l’on veut), est franchement orienté est-ouest, il fait un angle très accusé avec la direction générale des strates primaires redressées, dont l’indépendance vis-à-vis de lui est manifeste.
Sur son passage la feuille de calcaire dinantien par exemple a été tordue et indentée, mais elle conserve sa direction générale hercynienne, plus voisine de nord-sud que d’est-ouest. On constate directement le conflit entre les deux systèmes de plis, hercyniens et atliques.
M. Poirmeur, dont la belle carte nous a renseignés sur la forme véritable du Béchar, remarque justement que cette forme est celle[148] d’un T. Ce T doit la moitié occidentale de sa barre au plissement atlique, le reste relève de la virgation hercynienne. Je n’ai pas vu le Mezarif méridional, mais la carte Poirmeur nous y montre un éperon projeté vers l’ouest, qui paraît symétrique à celui de Béchar. Il est probable que le même effet procède de la même cause.
La grande hammada calcaire à l’ouest de Tar’it est une pénéplaine où les strates ont la direction hercynienne (nord-est-sud-ouest). (Voir fig. 33.)
Sur la route de Tar’it à Menouar’ar, un peu avant d’arriver à ce dernier point, exactement au puits de Daou Blel, on rencontre soudain des couches redressées plus énergiquement, et dont l’allure stratigraphique n’a aucun rapport avec celles des couches voisines. Elles plongent alternativement vers le nord et vers le sud. Il y a là un pli brusque qui vient évidemment du grand col appelé Teniet Sba, à l’extrémité orientale duquel (sur la Zousfana), on aperçoit en effet une disposition analogue.
Ainsi donc la coupure de Teniet Sba, le col le plus important du Béchar doit son origine au croisement d’un pli atlique avec le pli hercynien, de même que, plus au nord, les cols du Mouizib et du Teniet Nakhla.
Plus au sud on constate des diaclases toutes fraîches, aux Beni Goumi par exemple (Tar’it et Mzaourou) ; — je crois aussi que la Zousfana, en aval des Beni Goumi, a été guidée à travers la hammada par une diaclase fraîche.
Tout cela est bien concordant. La faille de Bou-Kaïs sépare l’Atlas de son Vorland. Tout ce qui est au sud est essentiellement une pénéplaine hercynienne, encore reconnaissable, mais affectée de quelques plissements atliques, bousculée, faillée et disséquée profondément par l’érosion.
L’ennoyage. — L’érosion, qui a déchaussé et isolé les puissants massifs calcaires, a naturellement accumulé dans les vallées des dépôts plus ou moins épais, d’âges divers, et qu’on arrive assez[149] facilement à dater, par comparaison avec les dépôts continentaux analogues d’Algérie et du Sahara algérien. Les dépôts les plus anciens (miocènes ? en tout cas prépliocènes), tiennent une grande place et atteignent une certaine épaisseur dans la vallée de la Zousfana, en amont des Beni Goumi, et en aval de Ksar et Azoudj, où on les voit disparaître sous les poudingues pliocènes. (Voir pl. XXV, phot. 47 et 48. Voir aussi appendice XI.)
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XXV. |

Cliché Gautier
47. — PORTION DE LA FALAISE DE KSAR EL AZOUDJ
Le chapiteau est en poudingue pliocène.
Au dessous, à travers les éboulis et les alluvions, on observe sur le terrain des schistes supra-dévoniens (?) très redressés.

Cliché Gautier
48. — FALAISE DE KSAR EL AZOUDJ (vue d’ensemble).
A gauche, on aperçoit, marqué par une tache noire de végétation, un coude de l’oued Zousfana, qui a sculpté la falaise ; — à l’horizon, à droite, collines cénomaniennes (?) de Fendi.
Le pliocène a ici les mêmes caractères que dans tout le Sud-Algérien, accumulations de gros galets, cailloutis souvent transformé en banc de poudingue, dépôts d’une époque où, comme aujourd’hui, entre les intervalles d’orages brefs et terribles, un climat très sec favorisait la formation de croûtes travertineuses.
Aux environs de Beni Ounif, c’est-à-dire au débouché des principales vallées du Grouz, c’est le cailloutis qui est prodigieusement développé, mélangé à du cailloutis actuel.
Au débouché de toutes les gorges, les cônes de déjection de galets s’étalent et se rejoignent. Le chemin de fer en construction trouve dans le Pliocène une carrière inépuisable de ballast, et le voyageur qui a suivi la ligne d’étapes, pour peu qu’il se soit écarté de la piste frayée, garde le souvenir désagréable de ces éternels cailloux roulés croulant sous les sabots du cheval.
Partout ailleurs, c’est-à-dire dans la majorité des cas, le Pliocène se présente sous la forme d’un poudingue très dur : dans la vallée de la Zousfana en amont de Ksar el Azoudj, au moins sur la rive droite (Fendi, Djenan ed dar) ; à l’ouest de Beni Ounif (poudingue de Bou Aiech) ; la grande hammada de Kenatsa est essentiellement une table de poudingue pliocène. La grande hammada qui commence au Guir sur la rive droite, et qui s’étend jusqu’au Tafilalelt est aussi pliocène probablement. (Voir appendice XI.)
Les dépôts quaternaires contrastent vivement avec les pliocènes ; sur l’emplacement même de Beni Ounif, au pied du ksar, on voit des dépôts marneux puissants de quelques mètres, et qui attestent évidemment une sédimentation paisible de vase à éléments très fins.
Ils ont un aspect de dépôt lacustre ; un lambeau de sédiments analogues à Ben Zireg contient même un petit lit d’aspect tourbeux ; tout cela suppose un climat plus humide que l’actuel.
L’érosion quaternaire a vivement attaqué les dépôts plus anciens, elle a sculpté en particulier de nombreuses falaises couronnées par des tablettes de poudingues. (Ksar el Azoudj, phot. 47 et 48 — bord sud de la hammada de Kenatsa, phot. 49.)
[150]Le monument le plus curieux de l’érosion quaternaire est certainement l’Oum es Seba, curieusement planté au milieu de la hammada de Kenatsa.
De Colomb-Béchar, on aperçoit dans l’ouest, sur la hammada, une montagne aux contours fantastiques. Les indigènes l’appellent Oum es Seba, littéralement la « mère-aux-doigts ». C’est un nom qu’ils donnent volontiers aux sommets dentelés, ruineux, hérissés de colonnes naturelles, qui évoquent vaguement l’idée de doigts dressés. L’Oum es Seba, vue de loin dans un pays de mirages, semble quelque chose d’énorme, presque une concurrence à l’Antar. De près, elle a dix mètres de haut ; c’est une « gara » du type classique, et attestant l’importance des érosions auxquelles elle a été soumise. La base est de sable, passant au grès tendre ; toute la masse est marneuse, et le sommet franchement calcaire. Ce sont ces calcaires tendres du sommet qui ont été curieusement découpés par l’érosion. (Voir fig. 30).
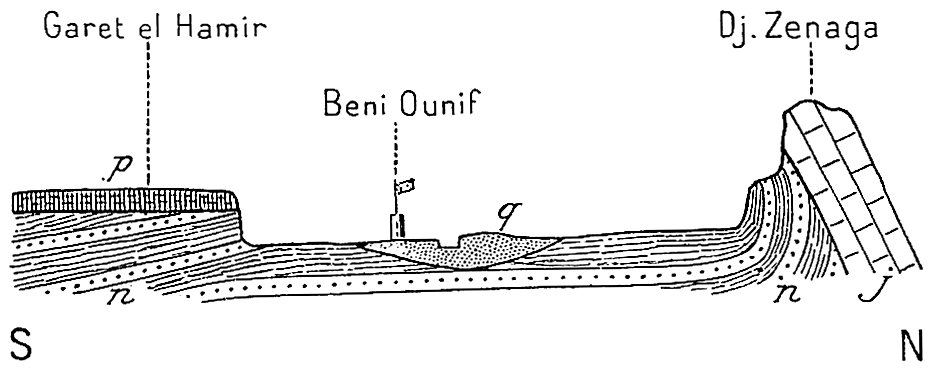
Fig. 34. — Coupe prise aux environs de Beni Ounif, montrant la terrasse pliocène, et les dépôts quaternaires. Cette coupe est due à l’obligeance de M. Ficheur.
j, Calcaires jurassiques ; n, Grès albiens ; p, Pliocène ; q, Quaternaire.
Importance géographique du Vorland primaire. — Ces dépôts continentaux ont un caractère commun, leur faible puissance et leur discontinuité ; le socle de vieilles roches est largement dénudé ; nous avons été à même d’étudier ici le contre-coup de la surrection de l’Atlas sur son Vorland, et c’est être privilégié ; car, dans l’Atlas oriental tout entier le contact est enfoui sous un manteau continu et très épais de dépôts continentaux.
En Algérie, dans les trois provinces, au sud de l’Atlas saharien dans toute sa longueur, on sait que les dépôts d’atterrissement sont prodigieusement développés ; les plus anciens ont été attribués par les géologues à l’Oligocène. Ainsi donc, dans la cuvette d’Ouargla, dans la région des daya, dans celle de l’oued R’arbi et de l’oued Namous, les débris de l’Atlas se sont accumulés presque depuis le début de l’âge tertiaire ; ils atteignent des centaines de mètres[151] d’épaisseur ; ce sont ces dépôts continentaux oligocènes et miocènes que M. Flamand appelle le « terrain des gour ». Cette formation, si particulière au Sud-Algérien, cesse ici pour la première fois de former un placage ininterrompu.
Dans l’est d’ailleurs, ce ne sont pas seulement les dépôts mio-pliocènes qui soustraient à l’observation le substratum primaire, mais aussi les formations crétacées, très puissantes et continues. Ici le crétacé n’est plus représenté que par des lambeaux cénomaniens.
Cette venue au jour de roches plus anciennes semble en relation avec un changement radical dans la nature de l’Atlas.
On a laissé le Grouz en dehors de l’étude géologique détaillée ; il n’est cependant pas si inconnu qu’on ne puisse dégager à son sujet un certain nombre de grands faits généraux, qui l’individualisent nettement par rapport à ses voisins orientaux, les massifs des Ksour et de l’Amour.
Grosso modo on est fixé sur sa constitution ; il est formé presque tout entier de calcaires liasiques et jurassiques. Les roches crétacées sont absentes, semble-t-il, sauf à la périphérie, où on retrouve avec les calcaires cénomaniens des lambeaux de grès albiens (à Beni Ounif par exemple [fig. 34]).
Ce sont précisément ces mêmes grès qui tiennent une place prépondérante dans la chaîne voisine des Ksour et dans le djebel Amour, constituant pour la plus grande partie la masse des montagnes, et donnant la note dominante du paysage. Cela revient à dire qu’en allant d’Aïn Sefra à Beni Ounif on quitte, à la hauteur de Duveyrier environ, l’Atlas gréseux pour entrer dans un Atlas calcaire.
On a déjà dit que le Grouz se termine au sud par un pli couché où l’on voit les calcaires jurassiques reposer sur les grès albiens.
Or des plissements aussi énergiques, allant jusqu’au renversement, sont une nouveauté pour qui vient de l’est. La chaîne des Ksour, le djebel Amour sont au contraire des régions de « plissements ébauchés » suivant l’expression du dernier géologue qui s’en est occupé, M. Ritter[123].
Voici donc une autre originalité du Grouz comparé à ses voisins de l’est. Il n’est pas seulement calcaire, tandis qu’ils sont gréseux ; il est en outre énergiquement plissé, tandis qu’ils le sont faiblement. Il est vrai que le premier caractère est apparemment un corollaire du second, l’énergie du plissement a amené en surface les couches plus profondes qui se sont trouvées calcaires.
[152]Un raisonnement analogue conduit à conclure que l’apparition du Vorland avec ses vieilles roches primaires a quelque rapport de cause à effet avec l’énergie subitement accrue des plissements atliques.
Quoi qu’il en soit il y a là un fait d’importance géographique tout à fait considérable. Nous verrons dans les chapitres suivants que cette limite géologique entre les roches primaires et les terrains plus récents (crétacés marins et tertiaires continentaux), est une ligne de verdure et de vie qui se prolonge sans interruption notable pendant huit cents kilomètres, jusqu’au cœur du Sahara, jusqu’à In Salah. L’affleurement du Vorland primaire ne présente donc pas seulement un intérêt théorique et scientifique ; c’est lui, incontestablement, qui fait de la Zousfana la grande porte d’entrée du Sahara, une voie commerciale et ethnique de premier ordre ; notre étude géologique nous conduit à des conclusions de géographie humaine.
Gîtes minéraux du Grouz. — A tout autre point de vue c’est le Grouz qui a une grande importance humaine.
Et d’abord le Grouz et ses dépendances atliques, semblent avoir le monopole des gîtes minéraux.
Et, à ce point de vue encore, le contraste est grand entre lui et la chaîne des Ksour, ou le djebel Amour, ses voisins orientaux. Dans tout l’Atlas saharien jusqu’au Hodna, il n’existe guère d’exploitation minière, ancienne ou récente. Aussi bien les grès médiocrement plissés de l’Atlas saharien ne peuvent pas être préjugés a priori aussi métallifères que les calcaires bouleversés de la région du Grouz ; d’autant que, dans l’Atlas que nous connaissons (Algérie-Tunisie), les régions calcaires sont le domaine de prédilection des gîtes minéraux exploitables.
D’autre part, la question de la houille mise à part, le Vorland hercynien ne semblerait pas avoir d’avenir minier, au moins d’après les informateurs indigènes qui signalent beaucoup de gîtes et tous dans l’Atlas.
Il est certain qu’entre les sources de la Zousfana et celles du Guir, il existe au moins deux exploitations minières indigènes, régulières et, autant que le milieu le permet, organisées. L’une est au djebel Maïz, au nord du Grouz ; c’est une mine de cuivre, elle a été vue par des Européens, le colonel Quiquandon en particulier, qui ont constaté l’existence de galeries souterraines assez profondes. L’autre exploitation minière est beaucoup plus loin à l’ouest, sur les bords du Guir, à Beni Yati. C’est une mine de plomb et probablement aussi[153] de cuivre. Elle n’est connue que par des renseignements recueillis par le lieutenant Pariel, de Colomb-Béchar. Mais ces renseignements spécifient l’existence d’installations plus ou moins permanentes pour la calcination du minerai : on le brûle en gros tas par forts vents d’ouest. Il semblerait que ces deux gisements (djebel Maïz et Beni Yati) sont les plus considérables et les mieux exploités, aux yeux des indigènes. Mais on en connaît plusieurs autres, de moindre importance.
Au djebel Melias, qui est un simple contrefort du Grouz, à six kilomètres de Beni Ounif, un filon de plomb et de cuivre court sur le flanc nord de la montagne. Dans ce filon les indigènes de Figuig ont creusé un trou, car ce serait trop dire une galerie, de 1 m. 50 de profondeur.
On pourrait étendre la liste des petits gisements de ce genre.
L’exploitation indigène porte sur deux métaux, le plomb et le cuivre, et voici à quels besoins économiques elle répond. Le plomb sert à fondre des balles, et le minerai de plomb, tel quel, la galène, est un fard très usité, le koheul, bien que ce mot arabe désigne littéralement le sulfure d’antimoine. Tous les indigènes connaissent la galène et ses usages. Mais le minerai de cuivre est beaucoup plus mystérieux. Un fait frappe d’abord, c’est que toutes les mines de cuivre sont considérées par les indigènes comme mines d’or et d’argent ; ils n’y soupçonnent pas la présence du cuivre, et ne semblent pas établir de corrélation entre le minerai qu’ils extraient et, par exemple, les douilles de leurs cartouches. En poussant un peu plus loin l’investigation, on s’aperçoit que tout le minerai est extrait pour le compte des orfèvres juifs établis à Figuig et à Kenadsa. Ces orfèvres, ouvriers habiles, font de curieux bijoux d’argent et d’or ; la matière de ces derniers est qualifiée par le vendeur « or du Soudan », mais, comme cet or se recouvre très vite d’une pellicule de vert-de-gris, il y entre assurément une forte proportion de cuivre marocain. Le peu de minerai de cuivre annuellement extrait du djebel Maïz ou des gisements voisins sert donc, à peu près exclusivement, à des alliages de bijouterie, inavoués et fructueux.
Des balles, du fard et des bijoux, voilà tout ce que les indigènes font de leurs minerais ; une exploitation aussi rudimentaire et aussi spéciale ne permet assurément pas de rien augurer pour l’avenir d’une exploitation industrielle. D’ailleurs, à côté du cuivre et du plomb, dont les minerais sont aisés à reconnaître, il peut y en avoir d’autres que des professionnels européens soient seuls à même de rechercher, à supposer résolu le double problème — de la sécurité[154] sur une frontière encore très peu sûre — et du transport à si grande distance de la mer.
Pluies et végétation. — C’est au point de vue du climat, c’est-à-dire des pluies, qu’il est particulièrement important pour la région de la Zousfana qu’elle soit dominée au nord par la masse du Grouz.
Le Grouz est une longue arête de 80 kilomètres, large de 5 ou 6 peut-être. Il serait plus exact de dire : un faisceau d’arêtes parallèles (généralement deux et quelquefois trois), entre lesquelles un système de profondes vallées longitudinales articule le Grouz tout entier. Chegguet el Abid, Haouci Chafa, etc. ; elles sont dues, d’après M. Ficheur, à l’intercalation entre les calcaires liasiques et jurassiques de couches argileuses et marneuses, qui n’ont pas offert de résistance à l’érosion.
Ces grandes vallées sont colmatées de cailloutis pliocène jusqu’à leur tête, elles sont donc des réservoirs d’humidité et des aqueducs souterrains.
Ce formidable écran montagneux n’est pas seulement par excellence le condensateur des pluies, qui tombent parfois et séjournent sous forme de neige ; il est organisé pour les emmagasiner, les acheminer et les distribuer. Les massifs primaires lui sont généralement inférieurs en altitude et en étendue, et par surcroît ils conservent une massivité de pénéplaine, ils n’ont pas un modelé compliqué, une structure ajourée.
Sur la moyenne annuelle des pluies les chiffres précis font encore défaut. On a du moins le témoignage de la végétation et des cultures.
Dans le Grouz la végétation des vallées témoigne de précipitations assez abondantes.
Dans toute cette Afrique du nord, qui est le pays des fleurs, je ne crois pas qu’il y ait eu au printemps de 1904 un coin plus follement fleuri que les hautes vallées du Grouz ; on y marchait environné de senteurs violentes et parfois agressives, car il y a une fleur qui pue le cadavre. Cette magnifique floraison peut être accidentelle, heureuse conséquence d’un hiver qui fut incontestablement pluvieux. Mais la végétation arborescente n’est pas moins curieuse. Elle est d’abord relativement abondante, ou du moins elle n’est pas aussi rare qu’on le supposerait ; la plaine au pied du Grouz a ses tout petits bosquets, en particulier autour de Bou Aiech. Ils sont souvent composés de pistachiers (betoum), mais on rencontre assez fréquemment aussi des caroubiers et surtout des oliviers sauvages, parfaitement vigoureux,[155] poussant librement sans le secours de l’irrigation. Et voilà qui est étrange, car l’olivier est un arbre méditerranéen, qu’on n’attend pas au désert.
Le sommet de l’Antar est aussi un îlot de végétation du Tell (bosquets de genévriers par exemple).
Mais tout le reste du pays a une végétation saharienne, c’est-à-dire dans la majorité des cas tout à fait absente. Le Béchar, le Mezarif, le Moumen, la hammada de Moungar Tarit, sont des étendues désolées de roc nu.
Quand un peu de végétation apparaît dans des coins de vallées privilégiés, c’est ce qu’on appelle au Sahara un pâturage, ces buissons rabougris et mal virescents dont le chameau se nourrit. (Voir pl. XXVI, phot. 50.) La végétation arborescente est surtout représentée par de rares tamaris, et quelques talhas très sporadiques (faux gommiers) ; il y en a un par exemple à el Morra.
Il faut noter pourtant la fréquence d’Anabasis aretioides, que les Arabes appellent ed-dega et le corps d’occupation « chou-fleur du bled », elle ressemble en effet à une pomme de chou-fleur posée au ras du sol sans tige. C’est une plante des hauts plateaux oranais qui disparaît à mesure qu’on s’éloigne plus avant dans le Sahara.
Notons aussi que le porc-épic, qui est nettement une bête du Tell, se trouve encore le long de la Zousfana entre Tar’it et Igli.
En somme la région de la Zousfana doit peut-être au voisinage de l’Atlas des pluies un peu moins rares que dans le reste du Sahara. Mais elle en reçoit directement très peu. C’est au réservoir de l’Atlas et en particulier du Grouz qu’elle doit d’être habitable à un assez haut degré. Figuig, Fendi, Ouakda, Béchar, Kenadsa, Tar’it, forment un groupe assez important de palmeraies, toutes alimentées par le Grouz. Notons que, pour trouver l’équivalent à la lisière du Sahara il faut aller dans l’ouest au moins jusqu’à Laghouat et peut-être même jusqu’à Biskra.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XXVI. |

Cliché Gautier
49. — FALAISE DE KENATSA
Les roches noirâtres à la base de la falaise sont des grès houillers redressés ; l’entablement clair est du calcaire horizontal (cénomanien et pliocène).
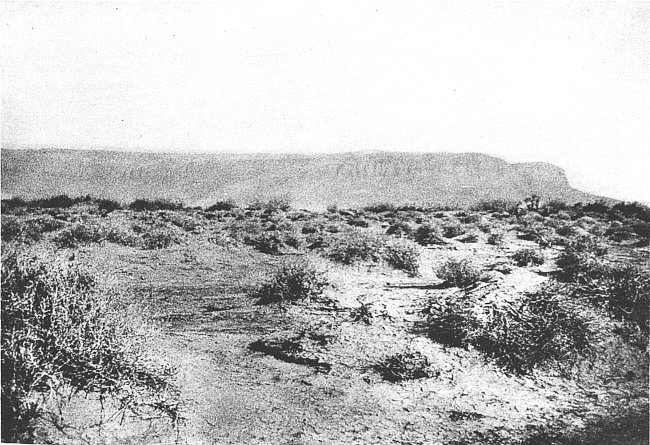
Cliché Gautier
50. — LA ZOUSFANA en aval de Ksar el Azoudj.
Le lit de l’Oued est très large et très touffu ; — à l’arrière plan le djebel Moumen.
Régime des eaux. — Il y a d’assez nombreuses petites sources dans les massifs montagneux dinantiens.
Le Mezarif, par exemple, a trois points d’eau pérennes (O. Chegga, Aïn Nakhlat, Aïn Mezarif).
Le Moumen lui-même, malgré ses dimensions assez exiguës a deux points d’eau ; le Béchar a une demi-douzaine de points d’eau, je citerai ceux que j’ai vus : el Djenien et Aïn Mézerelt (pl. XXII).
J’ai vu aussi H. Ar’lal, Daou Belal et Menouar’ar en relation avec la hammada de Moungar.
[156]Ces points d’eau sont invariablement au débouché de torrents, descendus de leurs montagnes respectives, et généralement en rapport avec la limite soit inférieure (c’est le cas le plus général), soit supérieure (Djenien, Menouarar) des calcaires carbonifériens.
Les trois sources du Mezarif, par exemple, sont, malgré leur éloignement topographique, au même niveau stratigraphique, à l’affleurement du premier banc de grès dévonien (?) immédiatement au-dessous des calcaires dinantiens. Aïn Mézerelt et les sources du Moumen, je crois, sont exactement dans la même situation.
Il est clair que les petites sources de cet ordre restituent goutte à goutte à la circulation atmosphérique, la provision propre d’humidité du Mezarif, du Moumen, du Béchar ; elles portent donc témoignage que chacun de ces massifs, sous une forme quelconque, rosée, givre, neige ou pluie, condense et emmagasine, pour son compte personnel, une certaine quantité de vapeur d’eau.
Mais cette quantité est faible. Aucune de ces petites sources n’a fixé de la vie humaine, quoiqu’un petit nombre d’entre elles (Aïn Nakhlat, el Djenien) alimentent comme leur nom l’indique, à titre de curiosités, quelques palmiers sporadiques. Ce n’est pas cependant qu’elles soient dépourvues d’importance économique. Dans ce pays coupé de puissantes barrières rocheuses, les petits points d’eau jalonnent les routes de montagnes, les plus difficiles et les plus mal fréquentées : les routes des « djich[124] » ; ils rendent habitables des repaires provisoires où une bande guette le coup à faire. Le Mezarif septentrional est un repaire admirablement aménagé par la nature, avec trois issues indépendantes, correspondant aux trois points d’eau, et situés aux points les plus opposés de l’horizon. Le 25 décembre 1904 un rezzou de Chaamba revenant d’une razzia fructueuse, et cerné dans le Mezarif par des forces supérieures leur a glissé entre les doigts avec une extrême facilité.
Les grosses agglomérations, les grosses taches de culture et de verdure, sont en relation avec les eaux descendues de l’Atlas, des sommets avoisinant deux mille mètres.
Nappe artésienne. — Le groupe d’oasis le plus important, celui de Figuig, est dans une cuvette encerclée par les contreforts du Grouz et du Beni Smir.
Son hydrographie a été étudiée par M. Ficheur. Toute l’eau de[157] Figuig est artésienne, non pas qu’il y existe un seul puits, mais les sources viennent de la profondeur, amenées en surface par des failles. Quelques-unes de ces sources attestent leur origine par leur température élevée ; deux des ksars de Figuig portent le nom caractéristique de « hammam ». D’autres, de température normale, ont une force ascensionnelle qui se traduit par un bouillonnement très visible. M. Ficheur estime que la nappe artésienne doit se trouver entre les calcaires liasiques et les couches argileuses infrajurassiques (?) du Chegguet el Abid.
Je serais tenté, sous bénéfice d’inventaire, de mettre dans une catégorie voisine les sources qui alimentent les petites palmeraies de Bou-Kaïs, el Ahmar, Sfissifa. Elles jalonnent au pied de l’Atlas la grande faille couturée de roches éruptives. Une source de Bou-Kaïs a une trentaine de degrés, tandis que l’eau du puits de Colomb-Béchar ne dépasse pas 22°.
Les oueds. — Les autres oasis jalonnent les oueds descendus de l’Atlas. L’oued le plus considérable, la Zousfana, alimente la plus belle oasis, celle de Tar’it, qui rivalise avec Figuig.
Grâce au capitaine Normand qui a passé deux ans à creuser des puits sur la ligne d’étapes nous pouvons nous faire une idée précise du régime hydrographique dans la Zousfana.
Elle prend sa source dans la cuvette du Figuig et elle est donc alimentée par les torrents du Grouz et du Beni Smir.
Sur tout son parcours elle coule à l’air libre une fois ou deux par an, lors des très grandes crues. En général elle est à sec comme il sied à un oued saharien. Pas partout cependant. Elle coule à l’air libre assez régulièrement en deux points très éloignés l’un de l’autre, au col de Tar’la sur cinq ou six kilomètres, et dans la palmeraie de Tar’it sur une quinzaine de kilomètres. En ces deux points c’est apparemment un seuil rocheux qui ramène en surface la nappe aquifère. A Tar’la l’oued sort de la cuvette de Figuig en forçant une muraille de calcaires basiques et jurassiques. A Tar’it l’oued a creusé son lit dans des terrains d’atterrissement, mais au travers desquelles on voit percer les calcaires dinantiens[125] ; sous les murailles mêmes du ksar de Tar’it le lit est franchement entaillé dans les vieux calcaires et c’est en ce point précis que ce lit, sec en amont, se remplit d’eau vive.
[158]Entre Tar’la et Tar’it le capitaine Normand[126] nous indique à quelles profondeurs les puisatiers ont rencontré l’eau, à Ksar el Azoudj 3 mètres, Haci el Mir 5 mètres, el Morra 10 mètres, el Moungar 20 mètres. Rappelons que, à Ksar el Azoudj et Haci el Mir le sous-sol dévonien affleure.
En somme cet oued Zousfana a un lit souterrain continu et pérenne ; les terrains d’atterrissement où il coule sont gorgés d’eau à une profondeur plus ou moins faible ; on a pu y trouver un point d’eau, ou y creuser un puits tous les 25 kilomètres le long de la ligne d’étapes, qui est suivie régulièrèment par de l’infanterie européenne, des chevaux et des mulets. Sans doute les étapes sont dures ; au cœur de l’été l’eau devient rare, il faut parfois rationner bêtes et gens, toute l’année d’ailleurs elle est mauvaise, magnésienne et salée. Pour qui vient du nord c’est déjà le Sahara et ses horreurs. En réalité c’est un Sahara très atténué.
A Ksar el Azoudj, et de là jusqu’au pied du Moumen, jusqu’à Haci el Begri et Haci el Mir, la végétation est très belle, pour le Sahara s’entend, les tamaris forment par places de vrais boqueteaux. D’ailleurs Ksar el Azoudj fut certainement un point habité, à une époque indéterminée, comme son nom l’indique (Pl. XXVI, phot. 50).
A el Morra les Ouled Djerir plantent et récoltent de l’orge après les crues[127].
En aval de la palmeraie de Tar’it (exactement de Zaouia Tahtania) l’oued coule en pleine hammada de calcaire carboniférien, à même la roche, ou du moins sur une couche d’alluvions insuffisante, il offre donc de moindres ressources ; entre Tar’it et Igli le puits d’el Aouedj coupe l’étape.
Le Grouz envoie à la Zousfana sur sa rive droite toute une série d’affluents qui ont une vie souterraine et parfois superficielle.
L’oued de Fendi, qui passe à Bou Yala, a coulé plusieurs fois à pleins bords pendant l’hiver 1904, au point de compromettre la sécurité du poste provisoire de Bou Yala. A Beni Ounif, à Bou Aiech, à Colomb-Béchar, il suffit de creuser n’importe où un puits de quelques mètres pour avoir de l’eau.
Les oasis de Beni Ounif, de Tebouda, de Fendi sont chacune en relation avec un torrent descendu du Grouz. Fendi a de petits lacs, qui sont charmants, perdus dans un fouillis de palmiers abandonnés[159] à eux-mêmes, incultes et non taillés ; car l’oasis de Fendi, dangereusement située, a été désertée par ses propriétaires. Tout autour, les murailles de calcaire cénomanien (?) encadrent la palmeraie et la dominent en vasque gigantesque ; ce trou de verdure et d’eau est à bon droit le coin de paysage le plus célèbre de la région, Fendi, bien plus complètement qu’aucune des autres palmeraies, répond à l’ensemble d’idées traditionnelles qu’évoque le mot d’oasis.
Les palmeraies d’Ouakda et de Béchar (poste de Colomb-Béchar) sont dans le lit de l’O. Khéroua qui draine l’Antar. Là aussi, à l’oasis de Béchar, l’oued coule à l’air libre, les eaux souterraines sont ramenées en surface par l’affleurement des marnes cénomaniennes ou des argiles primaires, et elles s’étalent en étangs.
Les étangs de Colomb-Béchar ne sont pas aussi joliment encadrés que ceux de Fendi ; en revanche, ils sont très poissonneux. Les barbeaux abondent et quelques-uns sont énormes ; naturellement aucune autre espèce n’est représentée ; le barbeau est le seul poisson, je crois, acclimaté au Sahara. Ceux de Béchar voisinent seulement avec un grand nombre de tortues aquatiques.
Il est donc de toute évidence que le réseau hydrographique, qui est assez serré, comme le montre un coup d’œil sur la carte, n’est pas complètement mort. Les oueds ont une vie souterraine. Tout le long de leur cours, ils ont une réserve d’humidité qui se dépense parfois spontanément en sources et en mares d’eau libre. Il y a dans le sous-sol une nappe superficielle importante qui alimente les tapis de fleurs du Grouz, les bosquets d’oliviers sauvages, et un certain nombre d’oasis.
En général les sources les plus importantes semblent conditionnées par le voisinage de l’énorme masse des roches primaires peu perméables, qui forcent la nappe superficielle à s’étaler à l’air libre. Il est remarquable que les petits étangs de Fendi et de Béchar, ces sortes d’anévrismes à ciel ouvert de la circulation souterraine, se trouvent au point précis où les oueds Fendi et el Khéroua vont quitter les roches secondaires pour pénétrer dans le domaine des roches primaires.
Groupe d’oasis de Béchar. — Si l’on met à part Figuig, pour lequel on ne possède pas les éléments d’une monographie[128], les principaux groupements humains sont les palmeraies de Béchar, et celles de Tar’it.
[160]Le poste de Colomb-Béchar voisine avec les deux petits ksars de Béchar et d’Ouakda dont les palmeraies se confondent en une seule oasis.
Le lieutenant Cavard nous donne sur ces deux ksars des renseignements démographiques et historiques.
Béchar a une soixantaine de maisons et peut armer 80 fantassins et 7 à 8 cavaliers. Ouakda serait moitié moins important à en juger par le nombre de ses fantassins, une quarantaine. Ouakda a 8000 palmiers.
Ces toutes petites bourgades ont pourtant un passé fort ancien. On garde à Béchar le souvenir d’un siège que le ksar a soutenu au Ve siècle de l’hégire, soit au XIIe siècle après J.-C. contre le sultan Moulay Ahmed Dehbi, surnommé le Sultan noir.
Je crois, il est vrai, que ces souvenirs de gloire ne s’appliquent pas au ksar actuel de Béchar, qui est une forteresse de pisé sur la rive droite de l’oued. Sur la rive gauche en tout cas s’étendent les ruines confuses d’un vieux ksar en pierres sèches.
Je ne crois pas qu’on ait recueilli à son sujet les souvenirs indigènes. Mais sa seule existence est intéressante. A travers tout le Sahara nous retrouverons ce même contraste entre des ksars actuels en pisé, et de vieilles ruines en pierres sèches.
Les habitants de Béchar et d’Ouakda sont presque tous des khammès (métayers, il serait plus juste peut-être de dire des serfs).
Comme partout au Sahara la prééminence sociale appartient aux nomades, qui sont ici les Ouled Djerir[129].
Ils sont 5000 d’après le lieutenant Cavard, avec 600 tentes, et ils pourraient mettre en ligne 1100 fantassins et 80 cavaliers.
Ils ont des terrains de culture dans l’O. Namous (Oglat Djedida) et dans l’O. Zousfana (el Morra). Ils ont des droits de propriété à Bou Yala, Tebouda, Fendi. Ils ensilotent à Béchar et à Ouakda, où ils sont propriétaires d’une grande partie des palmiers, et dont ils sont en somme les suzerains.
Maigre suzeraineté d’ailleurs, car il est notoire que les Ouled Djerir sont pauvres ; ils n’ont pas assez d’orge ni de dattes pour leur consommation ; conformément à tous les usages sahariens ils comblent le déficit par les bénéfices du banditisme ; et de la sorte la pauvreté entretient chez eux des vertus militaires qui rehaussent leur prestige.
D’après Cavard, leur arbre généalogique remonte au VIIe siècle après[161] J.-C. ; à cette époque vivait Djerir, l’ancêtre éponyme ; et c’est alors que la tribu s’est individualisée en se séparant des Hamyan.
Ces hobereaux besogneux partagent l’autorité avec une autre grande puissance, religieuse celle-là, la zaouia (monastère) de Kenatsa. Kenatsa est à 24 kilomètres de Béchar, exactement au pied de l’escarpement terminal de la hammada qui porte son nom. Les sources qui alimentent les jardins sont dans les grès houillers à la base de l’escarpement. La zaouia a un aspect d’ancienne prospérité ; elle s’annonce de loin par un gracieux minaret bâti en briques, sans faïences apparentes, il est vrai ; autant qu’on peut en juger à quelque distance, car la visite en est prohibée, c’est l’architecture de Tlemcen, de Fez et de Marrakech qu’elle rappelle, et non pas du tout ces grossières mosquées en pisé blanchi, de profil déjà soudanais, qu’on voit aux oasis sahariennes. (Voir pl. XXVIII, phot. 54.) La zaouia possède certainement une bibliothèque, avec des manuscrits curieusement enluminés sur papier de luxe ; il est non moins certain par malheur que ces manuscrits sont mangés aux rats. Enfin Kenatsa a ses Juifs, ce qui revient à dire, en pays marocain, un peu d’industrie et de commerce.
L’ordre religieux de Kenatsa (les Ziania) a été fondé au XVIIe siècle par un chérif marocain originaire de l’O. Draa.
Tar’it. — La création d’un poste militaire au ksar de Tar’it (alias Taghit), a donné à ce nom une sorte de notoriété. L’usage s’est à peu près établi d’étendre ce nom à toute l’agglomération humaine qui se décompose en cinq ksars : Zaouia Fokania, Tar’it, Barrebi, Bakhti et Zaouia Tahtania. Les indigènes de ces cinq ksars ont pourtant un nom d’ensemble, celui de Beni Goumi, qui est fort ancien et se trouve déjà dans Ibn Khaldoun.
La palmeraie de Tar’it ou des Beni Goumi s’allonge sur 16 kilomètres le long de l’oued Zousfana entre le monastère d’amont (Zaouia Fokania), et le monastère d’aval (Z. Tahtania).
Cette ligne de verdure et d’eau est profondément encaissée entre la falaise carboniférienne à droite et la dune à gauche ; dans ce couloir étroit et sinueux la paroi de sable et la paroi de roc, hautes chacune d’une centaine de mètres, se rapprochent à se toucher ; si bien que, fréquemment, le sentier qui longe l’oued est forcé d’escalader les premières pentes de la dune. (Voir pl. XXVII, phot. 51 et 52.)
Les sables reposent — comme toujours — sur des terrains d’atterrissement quaternaires et mio-pliocènes, dans lesquels l’oued en général a entaillé son lit.
[162]Pas partout cependant. — La falaise carboniférienne est la lèvre d’une faille ; en deux points au moins à Tar’it et à Z. Tahtania on en voit des esquilles. Celle du Tar’it se distingue sur la photographie. (Cf. pl. XXVII, phot. 51.) A travers l’esquille de Tar’it l’oued s’est creusé en pleine roche un canyon profond et court entre le piton de Baroun sur la rive droite et le piton qui porte le ksar sur la rive gauche. De là vient précisément le nom du ksar : Tar’it est un nom berbère qu’on pourrait traduire par canyon.
On a déjà dit que ce barrage rocheux ramène en surface la nappe aquifère et ressuscite la Zousfana. Dans les puits des jardins, aux saisons les plus sèches, l’eau se trouve à deux mètres de profondeur. Cette eau pourtant, comme celle de l’oued lui-même, est à peine potable, on recueille du sel dans les boues de l’oued ; ces alluvions quaternaires dans lesquelles est taillé le lit actuel sont toujours chargées de gros cristaux de gypse (les roses de sable), de chlorures et de magnésie. Les Beni Goumi vont chercher leur meilleure eau sous la dune, dans les alluvions mio-pliocènes ; ils la captent et la conduisent au moyen de petites foggaras.
Ces dunes de Tar’it, une avancée de grand erg, sont scandaleusement inexplorées, l’inconnu commence à un kilomètre du poste. On peut affirmer pourtant que, en un point au moins elles recouvrent un oued enfoui, affluent de la Zousfana.
A quelques kilomètres au nord du ksar de Tar’it en bordure de l’erg les officiers du poste reconduisent généralement leurs amis jusqu’à une petite palmeraie, qu’ils ont surnommée « des Adieux ». Elle est au bord de l’erg, sous lequel on distingue des falaises et des témoins d’érosion, un lit, où l’eau est à fleur de terre. De là partent des foggaras qui alimentent Zaouia Fokania. Les éclats de silex abondent à la surface du sol. On trouve réunis là, comme si souvent dans l’erg, la dune, l’oued enfoui et le gisement néolithique. On sait d’ailleurs que cet erg jouxtant les Beni Goumi est loin d’être dépourvu de puits — celui de Zafrani par exemple.
Un autre oued, affluent de la Zousfana (rive droite), joue un rôle subordonné dans la vie économique de Tar’it. C’est l’oued Abd en Nass dont la vallée court parallèlement à la Zousfana, sur la hammada carboniférienne ; elle suit l’affleurement d’une couche argileuse intercalée dans les calcaires de la pénéplaine. Vallée sèche, un simple cordon de reg où les moutons trouvent une maigre pitance, mais une voie d’accès commode, une route naturelle bien plus aisée que la rocaille de la hammada ou les sables de l’oued. Le nom a été quelquefois orthographié Had en Nass ; mais l’autre[163] leçon paraît préférable : parmi les nombreux tombeaux de saints qui se partagent la vénération des Beni Goumi, il s’en trouve un de Sidi Abd-en-Nass (le serviteur des hommes) — un nom d’une jolie humilité maraboutique, surenchérissant sur l’humilité de cet autre nom plus répandu, Abd-Allah (le serviteur de Dieu).
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XXVII. |

51. — VUE PRISE DU KSAR DE TAR’IT, en regardant la falaise.
Contre l’apparence les couches calcaires dinantiennes, qu’on distingue au-dessus des palmiers, ne sont pas stratigraphiquement inférieures à celles qu’on voit à l’horizon à gauche, au sommet de la falaise. C’est la même assise dont la continuité a été rompue par une faille.
(Le tracé de la faille est jalonné par la Koubba blanche à gauche de la figure et par l’échancrure de la ligne d’horizon, au sommet et au milieu de la falaise.)

52. — VUE PRISE DU KSAR DE TAR’IT, en regardant la dune.
(Du même point que 51, après une conversion de 180° :)
On se rend compte de l’encaissement du Ksar entre la dune et la montagne.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XXVIII. |

Cliché Gautier
53. — TENTES DOUI-MENIA, de type marocain, dans l’oued Zousfana.
A gauche une grande tente noire du type algérien, tout différent.
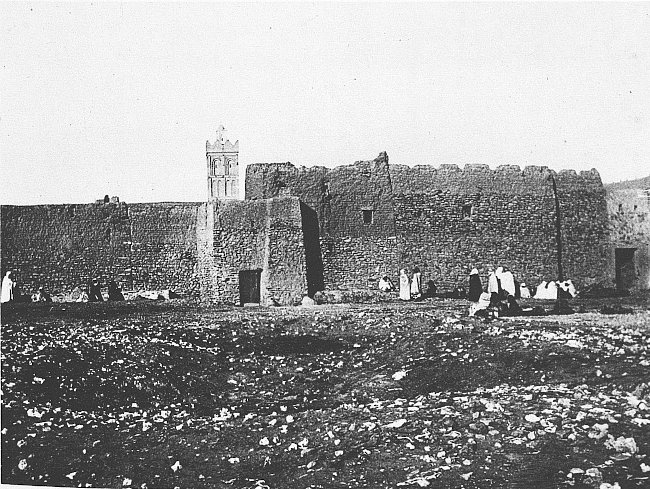
54. — LA ZAOUIA DE KENATSA
Le Minaret est intéressant, d’un travail soigné.
Sur les Beni Goumi nous avons la bonne fortune de posséder une bonne monographie démographique et historique[130].
Les cinq ksars comptent au total 1754 habitants, la palmeraie renferme 77951 pieds de palmiers ; très peu d’animaux, sauf des ânes, des moutons et des chèvres, qui se contentent de peu. Un groupement humain médiocre et misérable à coup sûr, bien plus important pourtant que celui tout voisin d’Igli, auquel le hasard des explorations a donné une bien plus grande notoriété géographique.
Le pays des Beni Goumi est très anciennement habité ; avec des gisements néolithiques, dont un très beau (H. Zafrani), on y trouve une très belle station de gravures rupestres, en face du ksar de Barrebi, au pied de la falaise (éléphants, Bubalus antiquus).
D’ailleurs les deux tiers des Beni Goumi sont des « haratin » ; c’est-à-dire qu’ils appartiennent à cette race négroïde mystérieuse, qui peuple le Sahara septentrional et le sud du Maroc, dans le nom de laquelle on a voulu retrouver celui des Garamantes, et dans laquelle il semble bien que survive un lambeau de préhistoire, et d’une préhistoire soudanaise, nègre.
Au voisinage des cinq ksars actuellement habités les vieilles ruines abondent, éparses dans la palmeraie et sur la falaise. Les plus intéressantes sont celles qui sont perchées au sommet de la falaise. Elles sont en pierres sèches, tandis que les constructions actuelles sont en pisé ; et elles se rattachent donc à une catégorie déjà signalée de ruines, qu’on retrouve souvent dans le Sahara.
Il est intéressant aussi que ces vieilles ruines soient invariablement des nids d’aigle, dans une forte situation militaire de bourgs rhénans ; tandis que leurs successeurs actuels sont dans la vallée, au milieu des jardins, à proximité de la dure besogne quotidienne. Ces ruines orgueilleusement perchées semblent nous ramener à une époque où les Beni Goumi, aujourd’hui serfs de la glèbe, étaient les suzerains de leur pays.
Toutes ces ruines ont leur nom, et il en est de significatifs ; ainsi celui de Ar’rem Bou Zoukket, le nom de ar’rem n’a survécu aujourd’hui dans l’usage courant que chez les Touaregs. — A noter[164] aussi le nom de Médinet el Yhoud, « la ville des Juifs » ; on verra quel rôle les Juifs jouaient dans le Sahara du Moyen âge.
J’ai vu de près les ruines les plus méridionales, celles de Mzaourou, au-dessus de Zaouia Tahtania. Ce qui reste du sol dans les interstices du rocher est pétri de silex taillés et de débris d’œufs d’autruche. La falaise est creusée de cavernes, où se voient des restes de cloisons, et les Beni Goumi furent donc des Troglodytes.
Ces ruines font à peu près défaut dans la partie nord de la falaise ; à une seule exception près, Baroun au-dessus de Tar’it ; elles se pressent au contraire dans la partie sud, au-dessus de Zaouia Tahtania et de Bakhti. Cette partie de la falaise a son nom spécial Dir Chemaoun (la montagne de Samuel ? d’après Calderaro).
Sur Dir Chemaoun et ses ruines Calderaro a recueilli d’intéressantes traditions indigènes. Elles nous disent comment au IVe siècle de l’hégire, Si Beyazid, de la ville de Bezdama, dans la province de Bagdad, vint apporter l’islam au Dir Chemaoun ; comment à son appel les Beni Goumi quittèrent leurs forteresses pour aller s’établir dans la vallée ; et comment cette grosse transformation religieuse et sociale fut accompagnée de batailles dans l’une desquelles périt Si Beyazid. Son tombeau, très vénéré, est au nord de Bakhti, mais les traditions indigènes avouent que l’érection de ce tombeau, entourée de circonstances miraculeuses, est très postérieure à la mort du saint et manifestement ce tombeau est un cénotaphe.
Je n’ai pas de renseignements sur Si Beyazid : j’ai constaté qu’il est vénéré, lui ou un homonyme, dans la région de Djelfa. M. Basset me fait observer que son nom est turc, ce qui rend peu vraisemblable la date indiquée par la tradition. En tout cas il est impossible de la prendre à la lettre ; parmi les ruines de Dir Chemaoun il en est une Beni Ouarou, qui porte le nom d’une tribu les Beni Ouarin, dont la venue au Beni Goumi est, d’après les traditions indigènes, postérieure à Si Beyazid. D’ailleurs les ksars de Mzaourou et de Teiazib étaient encore habités il y a un siècle.
A coup sûr on peut retenir ceci. Les indigènes se souviennent que l’abandon des hauteurs fortifiées par la masse de la population est en relation avec les progrès de l’islamisme, et l’extension de la culture arabe. Et cela est tout naturel, car ces nids de troglodytes ont bien un caractère berbère.
Calderaro a fidèlement et minutieusement recueilli tout ce qui a surnagé du passé dans la mémoire des Beni Goumi. Les ksars actuels sont récents sauf Barrebi le plus peuplé et le plus vieux. Les principaux parmi les anciens centres de la vallée sont au nord Bou Cheddad et[165] Tikoumit, voisins et rivaux ; auprès de Tar’it Ksar el Kebir, surnommé Médinat el Bizane, la ville des vautours ; au sud de Bakhti Toukouidin. Dans toutes les oasis on retrouve cette même instabilité dans l’emplacement des ksars, les villages sahariens au rebours des nôtres se déplacent facilement ; c’est qu’ils sont en pisé, dont les ruines font un tas informe de boue séchée ; le pisé ne se prête pas aux réparations et aux réédifications, les morceaux n’en valent rien ; il est plus simple de reconstruire ailleurs une ville neuve.
Pourtant Calderaro mentionne fréquemment des exodes causés par la sécheresse et la famine. Encore que la conclusion ne soit pas nettement formulée, il semble que les ressources du pays aient été en déclinant, ce que la proximité de l’erg rend assez vraisemblable.
Dans cette histoire de sédentaires, comme il est naturel, les méfaits[166] des nomades tiennent une grande place. Après 150 ans on garde encore à Tar’it le souvenir d’Ahmed el Khatsir des Angad près d’Oudjda, qui n’épargna dans le ksar qu’une seule femme enceinte.
L’histoire politique des Beni Goumi est essentiellement celle des tribus nomades qui ont exercé la suzeraineté. Elle semble tenue à peu près à jour depuis le VIIIe siècle de l’hégire. Vers cette époque « la puissante tribu des Beni Ahssen occupa les pays environnants et les Beni Goumi devinrent leur propriété ». Ceci est intéressant parce que nous retrouverons très vivant dans le Saoura le souvenir des Beni Ahssen ou Beni Hassen.
« La nombreuse tribu des Hamyan, rattachée actuellement au cercle de Méchéria, succéda aux Béni Ahssen » ; ces mêmes Hamyan dont les Ouled Djerir sont un rameau détaché.
Puis vinrent les R’nanema et avec eux nous entrons déjà dans l’histoire contemporaine ; ce sont actuellement les suzerains de la Saoura. Ils ont été expulsés de la Saoura par les Doui Menia, il y a un siècle à peine, à la suite de guerres dont le dernier épisode fut le siège et la prise de Mzaourou, dernière forteresse des R’nanema.
La palmeraie des Beni Goumi appartient aujourd’hui aux Doui Menia. Ce sont, on le sait, des nomades de l’oued Guir. Leur centre est dans le Bahariat (la petite mer), une grande cuvette alluvionnaire qui se prête à la culture de l’orge. Les Doui Menia y ont des magasins fortifiés d’où ils tirent leur nom — Menia est un synonyme Berbère de Kalaa, on disait indifféremment jadis el Goléa ou el Menia pour désigner le ksar sud-oranais que nous désignons exclusivement sous le premier nom ; Menia, Kalaa, ou Goléa désignent une hauteur fortifiée.
Les petites saouias des Beni Goumi, celle d’amont et celle d’aval, n’ont aucune importance, elles sont bien loin d’avoir la richesse, l’influence et le rayonnement lointain de Kenatsa. Mais il est intéressant peut-être de retenir la date de leur fondation.
Z. Fokania a été fondée au commencement du XVIe siècle par un Maure de Seguiet el Hamra.
Z. Tahtania il y a 250 ans environ, en même temps qu’Igli, par un saint du Gourara.
On verra que les XVe et XVIe siècles ont été un âge critique, un tournant de l’histoire dans l’arabisation du Sahara ; et que les moyens employés ont été précisément le prosélytisme religieux, la fondation de Zaouias.
La vie sociale et économique. — Je n’ai pas parlé de l’O. Guir parce que je ne l’ai pas vu. — Mais le triangle montagneux inscrit entre[167] les deux oueds, Guir et Zousfana, constitue une région naturelle, un pays, qui a son unité économique, sociale et même politique.
Les procédés d’irrigation ne sont pas essentiellement originaux, cela va sans dire, il est intéressant pourtant de constater la coexistence des procédés telliens et sahariens.
Il y a des barrages maçonnés au travers de l’oued tout comme dans l’Atlas de la Mitidja encore que beaucoup plus modestes. Les étangs de Fendi et de Béchar sont œuvre humaine, l’eau s’y étale en arrière d’un barrage en maçonnerie.
Les puits sont la grande ressource, et chaque jardin a le sien : mais les foggaras (aqueducs souterrains) apparaissent déjà dans toutes les oasis ; ils sont brefs et à fleur de sol, bien éloignés encore de pouvoir se comparer aux extraordinaires galeries du Touat, dont c’est précisément l’énorme développement qui fait le caractère ; ils portent le même nom pourtant et sont identiques en effet au moins dans leur essence.
Ceux du pied de l’Atlas, à Beni Ounif par exemple, évidés en plein cailloutis pliocène, rappellent curieusement ce qu’on dit des travaux analogues dans l’oasis de Merrakech.
J’ai recueilli à Beni Ounif quelques renseignements sur la façon dont l’eau se partage entre les usagers. L’instrument de mesure porte le nom de karrouba ; c’est un vase de cuivre percé d’un trou, par lequel entre goutte à goutte, en un temps déterminé, une heure par exemple, l’eau sur laquelle on fait flotter le vase[131]. En somme, c’est un sablier d’eau. C’est donc le temps d’irrigation qu’on mesure et non pas directement la quantité d’eau employée. L’objet des transactions, ce qui se vend et se loue, ce qui se fait objet de propriété, c’est la karrouba, l’heure d’irrigation. Ce système n’a rien de particulier, il est usité au contraire dans beaucoup de régions algériennes. Il est tout différent pourtant de celui qu’on emploie aux oasis sahariennes, au Touat par exemple ; là-bas c’est l’eau même qu’on se partage et dont on est arrivé à jauger le débit par des procédés primitifs et ingénieux.
Les cultures elles aussi présentent un caractère mixte. La plus importante à coup sûr est la culture d’oasis, de jardin, à l’ombre des dattiers ; il faut noter seulement que les dattes les plus prisées de beaucoup sont importées du Tafilalet ; mais le dattier n’en demeure pas moins par excellence, comme au Sahara, l’objet de la propriété et l’unité d’évaluation de la richesse. Pourtant la culture des céréales[168] coexiste, de l’orge en particulier, non pas seulement dans l’oasis, en jardins, mais indépendamment de toute palmeraie, en plein champ, dans des plaines d’alluvions fécondées par les crues. C’est ainsi que les Ouled Djerir cultivent de l’orge à el Morra sur la Zousfana et surtout les Doui Menia dans le Bahariat sur le Guir.
En 1902 à Tar’it, à Igli, et jusqu’à Beni Abbès, tandis que l’orge de l’administration se vendait 32 francs celle du Guir en valait 17. Il serait exagéré de conclure que le Bahariat produit assez pour alimenter une exportation sérieuse. On a expérimenté que la moindre demande fait tout de suite hausser les prix, parce que les stocks sont très faibles, mais du moins le pays suffit-il à sa consommation, et non seulement à celles des êtres humains, mais encore des chevaux.
En effet les Doui Menia élèvent une race de chevaux renommés. Nous sommes ici encore dans le domaine des nomades cavaliers et non dans celui des méharistes. Assurément les chameaux abondent, mais ce sont chameaux de bât. Les Doui Menia et les Ouled Djerir pratiquent naturellement le banditisme à travers le Sahara. Le Sahel marocain en particulier a beaucoup à se plaindre de leurs rapines. Le Bulletin de la Société d’Alger[132] a donné un récit tout à fait curieux de rezzou Doui Menia au Sahel. En 1904, une harka partie du Guir a poussé jusque dans l’Adr’ar des Ifor’ass et s’est heurtée à la garnison française de Tombouctou. Mais les Ifor’ass bons méharistes ont constaté avec surprise l’absence totale de méharis dans le camp ennemi, et leur terreur qui fut très vive s’en est mêlée de quelque mépris. Ces énormes randonnées, lorsque le cheval devient inutilisable se font à pied, avec la faculté naturellement de se reposer sur le dos des chameaux de bât. Dans toute la Zousfana il est impossible d’acheter une selle de méhari, et si on a la bonne fortune d’en rencontrer une elle provient d’une razzia au Sahel.
Il est de conséquence que les Doui Menia et les Ouled Djerir soient des cavaliers incapables de dresser un méhari. C’est un trait qui les rattache à la région des steppes, des hauts plateaux, et qui les montre étrangers au vrai désert.
La société a bien un caractère saharien ; la distinction fondamentale est entre sédentaires et nomades. Les moines de Zaouia mis à part, on trouve, en règle générale, fixée dans les ksars, une humanité inférieure et subordonnée ; il y a bien dans chacun d’eux une minorité d’hommes libres, ou ce qui revient au même de propriétaires, qui maintiennent, à l’abri de leurs murailles, une indépendance précaire et[169] humiliée. Les ksars sont par définition des bourgs fortifiés, et il n’y a pas une seule agglomération qui ne soit une forteresse, on dort chaque nuit sous verrous, gardé par des sentinelles, ce qui implique à la fois une grande insécurité et quelque prétention à l’autonomie. Les ksouriens sont strictement réduits à la défensive, et ici comme ailleurs l’offensive seule assure la prééminence. La bourgeoisie libre des ksars est à peu près invariablement rattachée à une tribu nomade par un lien de vasselage, qui implique de la part du nomade la protection militaire, de la part du ksourien le paiement d’un tribut, la reconnaissance de certains avantages précis, et la tolérance de beaucoup d’abus vagues. Dans les palmeraies d’ailleurs, c’est un petit nombre de jardins qui restent la propriété de la bourgeoisie locale ; la plus grande partie des palmiers appartiennent aux nomades suzerains, qui viennent une fois l’an camper sous les murs du ksar et faire la récolte.
Aussi la plus grande partie des ksouriens ne sont ni libres ni propriétaires, c’est le misérable prolétariat des khammès (métayers, serfs de la glèbe). Le contrat de métayage varie médiocrement suivant les oasis, il reste identique dans ses grandes lignes.
Le métayer khammès, comme son nom l’indique, a théoriquement droit au cinquième de la récolte ; mais dans les palmeraies ce cinquième est calculé d’une façon particulière. Les produits se répartissent en deux catégories très différentes ; les légumes du jardin, qui sont l’accessoire, et les dattes qui sont l’essentiel. Tous les produits potagers, tout ce qui pousse à l’ombre des palmiers, appartient sans restriction au khammès. Le propriétaire se réserve toutes les dattes, moins une faible fraction, qui est en général d’un septième, ou bien encore d’un régime par palmier, abandonné au khammès.
Cette société sédentaire se retrouve dans tout le Sahara algérien, et déjà d’ailleurs dans le sud de l’Algérie (dans la chaîne dite des Ksour). Mais ici, on l’a déjà dit, nous voyons apparaître un élément nouveau, inconnu à l’Algérie ; presque tous les khammès sont des haratins, c’est-à-dire qu’ils appartiennent à une race distincte, soudanaise. Nous arrivons déjà dans une région trop chaude et trop paludéenne pour que la race blanche puisse survivre au travail de la terre.
La bourgeoisie ksourienne d’ailleurs se distingue des nomades sinon par la race du moins par la langue. Tous les ksouriens, au rebours des nomades, parlent un dialecte berbère, et ils donnent à ce dialecte le nom de Zenatiya ; c’est précisément ainsi que les Berbères des oasis appellent leur langue. De l’identité du nom avons-nous le droit de conclure à l’identité des dialectes ? Assurément[170] non, il faut attendre des études plus approfondies. Pourtant les ksouriens de Beni Ounif déclarent comprendre sans difficulté les gens du Touat, tandis qu’ils se débrouillent mal, disent-ils, dans le dialecte du Tafilalet[133].
Les suzerains de tout le pays sont en somme les Doui Menia, ce qui lui donne une sorte d’unité politique.
Les Ouled Djerir, encore que très individualisés par leur origine distincte et par bien des traits de caractère, ne sont qu’une petite tribu besogneuse, encore affaiblie et appauvrie par des guerres récentes et malheureuses contre les Beni Guil[134] ; ils ont dû accepter le patronage et même rentrer dans les cadres de la grande tribu Doui Menia.
Sur les Doui Menia on n’a pas encore de renseignements démographiques précis. Mais ils ont au Sahara une réputation de bourgeois à leur aise, de gros commerçants entrepreneurs de caravanes, présentant une certaine surface, plus estimables, par exemple, que les Beni Guil, qui sont des « chacals ». Il n’est pas douteux que tout cela ne soit très relatif. Mais à coup sûr la tribu est prospère, et même amollie par la prospérité ; leur réputation militaire est médiocre.
La route transsaharienne et Figuig. — La caractéristique principale de la région entre Guir et Zousfana est d’être la porte du Sahara et du Soudan. Là exactement aboutit la route qui, par l’oued Saoura, le Touat, le Tidikelt, le Hoggar, l’Adr’ar des Ifor’ass constitue la voie la plus commode probablement de tout le désert, les routes les plus voisines de l’Atlantique mises à part. Cette fameuse « rue de palmiers » longue de 800 kilomètres, et qui mène au cœur du Sahara, au pied des premiers escarpements du Hoggar, ne paraît pas avoir d’analogue au désert. Interrompue par des brèches insignifiantes, cette fantastique ligne de verdure va exactement d’In Salah à Figuig ; et c’est à elle que Figuig est redevable de son importance. Le Grouz est un obstacle très sérieux aux communications du N. au S., avec sa longueur de 80 kilomètres, ses sommets qui atteignent 1800 mètres, et la continuité impressionnante de ses murailles calcaires. Cette continuité, il est vrai, n’est pas toujours réelle : immédiatement a l’O. du Chafet el Koheul, point culminant du Grouz, l’oued el Ouazzani ouvre à travers toute l’arête une brèche très curieuse : c’est un long couloir, aboutissant à un énorme cirque, au N. duquel la paroi[171] septentrionale du Grouz, très abaissée et amincie, est réduite pour ainsi dire à une pellicule. On a déjà dit combien le Grouz, vu de près, apparaît articulé ; ici il est évidé intérieurement. Il n’en est pas moins vrai que ce défilé et ses pareils, s’il en existe, sont d’accès assez pénible ; ce sont des portes dérobées par où se faufilent éventuellement les bandes de pillards ; ce ne sont pas des chemins pour d’honnêtes chameaux de caravane, pesamment chargés. La voie de communication normale évite le Grouz et passe par Figuig, dont le nom signifie en arabe le « petit col ». C’est une porte entre le Maroc et le Sahara, et elle s’ouvre précisément au point où vient se raccorder à l’Atlas la « grande rue des Palmiers ».
Ainsi Figuig n’est pas seulement, grâce à ses eaux artésiennes, un centre agricole considérable pour le pays ; c’est encore, grâce à sa situation géographique, ce qu’on pourrait appeler un centre urbain et commercial, avec une population de Juifs qui a su, par exemple, comprendre immédiatement les avantages du chemin de fer et en tirer parti.
La question marocaine. — Et dès lors s’éclaire (il est grand temps après un demi-siècle écoulé) un petit article du traité de 1845 entre la France et le Maroc.
On sait que le traité ne précisait pas la frontière dans la zone des hauts plateaux et du Sahara. Il se bornait à déclarer marocains Figuig et le petit ksar voisin d’Ich. Nul doute que le maréchal Bugeaud n’ait pas compris la portée de cette clause. Et on peut se demander quelle fut l’intention des négociateurs marocains. Ont-ils proposé cette rédaction vague par imprécision naturelle de barbares ? ou par finesse de diplomates orientaux, qui mettent à profit l’ignorance de l’adversaire, et qui craignent de l’éclairer sur l’importance de ses concessions. En tout cas Figuig marocain c’était le verrou tiré sur la seule route qui relie l’Algérie au Niger, et il est resté tiré jusqu’au début du XXe siècle.
Toute cette région de la Zousfana d’ailleurs, comme la Saoura et le Touat est fortement marquée à l’empreinte marocaine.
Elle l’est déjà par la nature : en Algérie et en Tunisie, tout le long de l’Atlas saharien, on chercherait vainement, on l’a déjà dit, un contact direct, une pénétration réciproque entre les domaines hercynien et atlique ; l’Atlas saharien y est séparé du horst primaire par d’immenses étendues de plateaux crétacés. Au contraire, si mal connu que soit encore l’Atlas marocain, nous savons pourtant avec certitude que les plissements primaires hercyniens finissent, au sud de[172] Merrakech, par constituer la masse même de l’Atlas et modifier profondément sa structure. Au point de vue géologique, la région de Figuig serait donc déjà plus marocaine qu’algérienne.
Marocaine, ou plus exactement sud-marocaine, la région qui nous occupe l’est encore par ses promesses de richesses minières. Aux mines de Beni Saf, dans le département d’Oran, tous les ouvriers sont des Marocains, originaires de la province du Sous. Tandis que les proches voisins de Beni Saf, les Riffains par exemple, qui fournissent à la province d’Oran une abondante main-d’œuvre agricole, ont dû être écartés du travail minier, parce qu’ils s’y montraient inaptes ; à travers tout le Maroc, malgré l’éloignement, les Soussi se trouvent attirés à Beni Saf et ils y déploient une dextérité atavique de professionnels. On sait d’ailleurs que le Sous, au Maroc, passe pour un pays minier.
Le Grouz est encore bien éloigné du Sous ; pourtant il contient des gîtes minéraux, bien connus des indigènes et vaguement exploités par eux. Si l’on en croit leurs dires, la minéralisation irait en augmentant vers l’ouest, c’est-à-dire que le Sous minier se prolongerait à travers le Tafilalet jusqu’au Grouz. Il est trop clair que ce sont là des affirmations sujettes à caution.
Ces similitudes géologiques et physiques ont eu, comme il arrive si souvent, leur répercussion sur la répartition de l’humanité.
La région est de langue berbère, et elle a donc ses affinités avec le Maroc.
Dans la province d’Oran, les îlots de langue berbère font à peu près complètement défaut, la langue arabe y a tout envahi et a complètement supplanté l’idiome aborigène. Il y a une coupure absolue entre les provinces berbères de Kabylie et de l’Aurès d’une part, et d’autre part l’énorme bloc des Berbères marocains, qui commencerait à Figuig.
Petit détail, mais qui est significatif, dans les campements Doui Menia on voit apparaître la petite tente ronde marocaine en cotonnade (voir pl. XXVIII, phot. 53), si différente de la grande tente algérienne carrée en poil de chameau, popularisée par la gravure, les tableaux et les expositions.
Sur la Zousfana et sur le Guir nous rencontrons déjà les Beraber du Tafilalet à titre de proches voisins avec lesquels des intérêts économiques communs amènent des connexions multiples.
Les Beraber possèdent des palmiers sur le Guir, à Bou Denib par exemple et vice versa les Doui Menia au Tafilalet. Les ksouriens[173] de Tar’it avaient d’anciens traités avec les Beraber[135]. C’est le Tafilalet qui a fourni au chemin de fer la plupart de ses ouvriers. Or on sait que le Tafilalet est le berceau de la dynastie marocaine actuelle.
En somme il ne faut pas se dissimuler que nous sommes ici dans un coin du Maroc.
Cette enclave marocaine sur la route du Soudan nous a prodigieusement gênés. Son existence nous a entraînés à des efforts absurdes pour ouvrir ailleurs par Laghouat et el Goléa une route artificielle qui suppléât la naturelle. A côté du misérable ksar d’el Goléa nous avons été conduits à construire une ville militaire à casernes monumentales, qui se sont vidées le jour où le Touat est tombé entre nos mains, et qui ont pris en quelques années un aspect comique de ruines de Palmyre.
Tant d’efforts glorieux et à peu près vains pour résoudre la question transsaharienne, depuis Duveyrier jusqu’à Foureau en passant par Flatters, un demi-siècle de tâtonnements, tout cela a son origine dans l’article concernant Figuig dans le traité de 1845. La solution cherchée s’est offerte d’elle-même et toutes les difficultés se sont dénouées comme par enchantement, le jour où nous avons disposé de cette « rue des palmiers » dont Figuig est la porte.
Une puissance installée d’une part au Soudan et d’autre part en Algérie ne pouvait pas se désintéresser de la seule route existante entre le Niger et l’Atlas.
Mais ce qui est très particulier c’est que, en plaçant cette route sous notre contrôle nous nous soyons imaginé ne pas léser le Maroc. En réalité nous avons tourné le traité de 1845 en mettant à profit son imprécision, et en termes crus cela pourrait s’appeler le violer. Assurément le Maroc n’est pas en géographie politique une entité précise, le traité même le prouve surabondamment puisqu’il nous donne le droit de poursuite. Il n’en est pas moins vrai que les Marocains se sentaient chez eux sur cette route transsaharienne qui aboutit a Figuig, elle jouait un rôle dans leurs transactions et dans leurs habitudes économiques. L’occupation française les a profondément choqués et lésés, au moment même où nos agents à Tanger cherchaient à nouer avec le maghzen des relations d’intimité.
Aussi bien est-il clair qu’il serait inadéquat de reprocher à la politique française sa perfidie ; le cas est beaucoup moins inavouable ; il s’agit simplement de notre anarchie coloniale chronique. Et sans doute eût-il été possible, avec une politique générale nettement[174] consciente d’elle-même, de concilier nos intérêts sahariens et marocains.
La pacification. — Que le triangle de pays entre Guir et Zousfana ait été une parcelle du territoire marocain cela rend d’autant plus intéressant le processus d’occupation et de pacification dans une région qui, hier encore, était la plus troublée et la plus fermée de nos frontières.
Aujourd’hui on y rencontre à chaque instant les traces et les souvenirs de l’état de guerre. Les grottes du Grouz, et elles sont nombreuses, ont été manifestement habitées à une époque récente, et situées, comme elles le sont, dans les escarpements les plus sauvages, il n’y a guère de chance qu’elles aient servi d’asile à d’honnêtes bergers. Dans les cols du Grouz et du Béchar et sur les routes qui y conduisent, on voit de place en place des parapets semi-circulaires, en pierres non cimentées, mais soigneusement choisies et solidement maçonnées ; ce sont des abris de tireurs. L’Oum es Seba, cette petite gara quaternaire, qu’on aperçoit de Colomb-Béchar, et qui se dresse au milieu d’une hammada désolée, a ses abris de tireur ou plutôt de chouaf (sentinelle), abris taillés dans la roche tendre ; on y trouve des vestiges d’installation semi-permanente, un four à cuire la galette, par exemple ; l’Oum es Seba a été manifestement un poste de vigie, surveillant la route du sud-ouest. Tout le pays apparaît aménagé pour la guerre, d’une façon primitive mais intelligente. Et il est inutile de rappeler les combats qui l’ont ensanglanté récemment et dont quelques-uns ont eu en France un retentissement considérable.
Cette période troublée est close, et il est remarquable qu’elle ne l’ait pas été par un fait de guerre éclatant, par une colonne et une répression militaire. Il serait inexact, en effet, les dates le montrent, d’attribuer au bombardement de Figuig le rétablissement de la paix ; des combats acharnés, Moungar, Tar’it, sont postérieurs à ce bombardement. L’état de guerre a pris fin, parce qu’une série de mesures, l’occupation pacifique d’un certain nombre de points, en ont rendu la continuation impossible.
On se rend bien compte que la possession tranquille des massifs montagneux, le Béchar, le Grouz était indispensable aux bandes qui y ont laissé les traces de leur installation. Les nouveaux postes, Colomb-Béchar, el Ardja au N. de Figuig, prennent à revers ces forteresses naturelles et les rendent intenables.
Mais ce n’est pas seulement la situation militaire qui s’est trouvée modifiée, c’est encore et surtout la situation générale. Pour comprendre l’évolution accomplie dans les dispositions des indigènes, il[175] suffit d’examiner les effets de la nouvelle politique sur un point déterminé, à Colomb-Béchar. Il fut un temps, en 1902 et 1903, où la crête du Béchar était considérée par nous comme frontière franco-marocaine, bien qu’on n’ait jamais su pourquoi cette frontière passait là plutôt qu’ailleurs, et simplement, semble-t-il, par une répugnance pour l’indétermination, naturelle à l’esprit français.
En 1902 et pendant la plus grande partie de 1903, les petites oasis de Béchar et d’Ouakda, situées du bon côté de cette frontière hypothétique et respectée, furent des refuges inviolables, centres d’approvisionnement et de rassemblement pour les bandes. Il s’y créa une forte organisation de piraterie, et il s’y fit des bénéfices considérables. Ce fut un beau moment pour la petite tribu des Ouled Djerir, propriétaire d’Ouakda et de Béchar ; elle joua alors, malgré sa faible importance numérique, un rôle prépondérant.
On fut enfin contraint d’envoyer contre ce nid de pirates la colonne commandée par le colonel d’Eu ; elle y entra sans coup férir et n’y trouva naturellement que la population inoffensive et épouvantée des pauvres ksouriens. La colonne partie, les nomades revinrent et le brigandage recommença.
D’après les officiers du Bureau arabe de Colomb-Béchar, les ksouriens demandèrent au colonel d’Eu de créer un poste chez eux. Et quelle que soit en pareil cas l’humilité hyperbolique des indigènes, il semble bien que leur demande n’ait pas été une simple formule de politesse ; ils avaient en tout cas les meilleures raisons du monde d’être sincères. Simples métayers, serfs des Ouled Djerir, exclus de la participation aux bénéfices éventuels du brigandage, ils étaient entre l’enclume et le marteau : maltraités par nous pour les méfaits d’autrui, maltraités par les nomades pour avoir accueilli la colonne avec une soumission dont ils auraient été fort embarrassés de se départir. On a regretté quelquefois dans la presse l’établissement de postes français en territoire marocain. Existe-t-il une fiction diplomatique assez respectable pour qu’on laisse en son nom de pauvres paysans dans une situation aussi cruelle ?
On a donc fini par où il eût été sage de commencer, on a créé un poste à Colomb-Béchar, non sans que des appréhensions fussent exprimées çà et là sur l’avenir de ce poste, qu’on s’imaginait d’avance assailli par des hordes furieuses. Rien de pareil ne s’est produit, le poste depuis sa création n’a pas tiré un coup de fusil. Ceux des ksouriens que le malheur des temps avait chassés au Tafilalet sont rentrés un à un. La zaouia de Kenatsa, assez proche pour se sentir protégée, a donné libre carrière à son amour de l’ordre public, tout naturel chez[176] des moines propriétaires et commerçants, dont la foi n’est nullement menacée. Ce qui peut paraître surprenant c’est que les Ouled Djerir, irréconciliables la veille, se sont ralliés à nous le lendemain de l’occupation ; c’est qu’en effet tous les palmiers sont à eux, et la récolte annuelle est une rentrée sûre, qu’ils ne sont pas disposés à sacrifier pour les bénéfices aléatoires et transitoires du brigandage. Aussi ce geste très simple, établissement d’un poste de police à Colomb-Béchar, sans bataille et sans violence, a groupé autour de nous toute la population, pauvres et riches, ksouriens et nomades, les uns pour la protection que nous assurons à leurs personnes, et les autres pour le mal que nous pourrions faire à leur propriétés.
Par un processus psychologique analogue, la fondation déjà ancienne du poste de Tar’it a fait passer progressivement de notre côté les Doui Menia, propriétaires de la palmeraie. Partout les instincts du propriétaire l’ont emporté sur ceux du pillard.
En dernier lieu, la mainmise discrète sur Figuig, surveillé par nos deux postes de Beni Ounif et d’el Ardja, a amené à composition les Beni Guil qui, sans y être propriétaires, y ont du moins tant d’intérêts.
Parmi les instruments de pacification, il ne faut pas oublier le chemin de fer. Après avoir marqué un long temps d’arrêt à Beni Ounif, il a été continué jusqu’à Béchar. On sait que son action sur les indigènes est puissamment aidée par la politique commerciale du Gouvernement Général, qui a déclaré franc de droits le pays au sud d’Aïn Sefra. On connaît le rapide développement de l’entrepôt franc de Beni Ounif. La transformation est prodigieuse depuis l’époque pourtant si proche (1903), où Beni Ounif était, non pas même un poste, mais un simple camp militaire, entouré d’une levée de terre. Le village européen a poussé tout seul, en quelques mois, et son seul aspect montre qu’il y a eu là un mouvement de capitaux, des opérations commerciales heureuses[136]. La création d’un pareil centre, si modeste qu’il soit, serait considérée dans le Tell comme un gros succès pour la colonisation officielle. Ici l’État n’est pas intervenu et l’initiative privée a tout fait. C’est peut-être, il est vrai, ce qui explique la réussite.
Beni Ounif a succédé à Duveyrier, mais succédé, sans métaphore, après décès. Les habitants de ce qui fut Duveyrier se sont transportés à Beni Ounif, tous sans exception, emportant avec eux jusqu’à leurs charpentes et jusqu’à leurs portes. Duveyrier a perdu tout droit à figurer sur une carte, à autre titre du moins que celui de station de[177] chemin de fer. Ce déménagement fantastique a eu lieu le jour où Beni Ounif devint point terminus du chemin de fer, et où par conséquent Duveyrier cessa de l’être. On a exprimé la crainte que Beni Ounif n’échappe pas à un pareil retour de fortune. Il est incontestable que sa prospérité était due en partie aux travaux de prolongation de la ligne ; le jour où le nombreux personnel employé à ces travaux s’est porté plus loin, Beni Ounif a perdu beaucoup de sa vie et traverse une crise dangereuse. Il a pourtant une grosse chance d’y survivre : Beni Ounif, c’est Figuig, dont la palmeraie ne se laissera pas déménager, et dont les habitants auront toujours besoin de fournisseurs européens. Les gens de Figuig ont pris une grosse part du mouvement commercial créé par le chemin de fer, une part d’autant plus considérable qu’il sont les intermédiaires naturels entre le négociant européen et l’arrière-pays marocain. Il se noue là entre le Maroc et nous des liens commerciaux qui entraînent dans les habitudes du trafic des modifications considérables. La route commerciale entre le Tafilalet et Fez tend à être abandonnée pour celle de la Zousfana. A la fin de 1906, les Beraber lésés dans leurs intérêts de caravaniers et de commerçants, et sans doute aussi surexcités par la tension générale des rapports entre France et Maroc ont coupé les routes de Béchar et menacé nos postes d’une attaque à main armée.
En somme, il s’est fait là, à petit bruit, sous la direction du général Lyautey, une expérience intéressante. Elle établit que dans le coin le plus farouche du Bled Siba (Maroc insoumis), une force de police, qui apporte avec elle l’ordre et la paix, groupe autour d’elle, sans combat, l’immense majorité de la population. Ces populations anarchiques et pillardes apprécient, comme le reste de l’humanité, l’organisation et la sécurité, quoiqu’elles soient incapables de se les assurer elles-mêmes.
[112]La carte topographique a été établie par M. le lieutenant Poirmeur. Cf. Bulletin de la Société géologique de France. T. VI, fascicule 2, 1907.
[113]E. Ficheur, Note sur le terrain carboniférien de la région d’Igli (B. S. géol. de Fr., IIIe série, XXVIII, 1900, p. 915-926). — A. Thévenin (C. r. sommaire séances Soc. géol. de Fr., 5 décembre 1904, p. 178).
[114]C. r. sommaire Soc. géol. de Fr., 6 juin 1905, p. 95. La note est très brève.
[115]Ed. Bureau, Le terrain houiller dans le nord de l’Afrique, C. R. Ac. S., t. CXXX, VIII, p. 1629-1631. 20 juin 1904.
[116]Flamand, C. R. Ac. Sc., 17 juin 1907. C. r. sommaire Soc. géol. de Fr., p. 131 et 137.
[117]Foureau, Documents, etc., p. 813.
[118]Poirmeur. Bulletin de la Société géol. de Fr., l. c.
[119]A l’étude au laboratoire de géologie d’Alger. L’attribution faite par M. Ficheur ne comporte aucune espèce de doute. Très belles huîtres de Lisbonne en très grand nombre.
[120]Voir un croquis des environs de Ben Zireg dans les cahiers du Service géographique de l’Armée, no 21, 1904.
[121]Cf. le transparent de la carte hors texte (Esquisse géologique.... du Béchar).
[122]Rapport inédit de M. Ficheur au gouverneur général.
[123]Étienne Ritter, Le djebel Amour, Bulletin du service de la carte géologique d’Algérie.
[124]Les mots djich, rezzou, harka, qu’on emploiera fréquemment, désignent des bandes de pillards d’importance croissante : une bande d’une dizaine d’hommes est un djich, de plusieurs centaines, une harka.
[125]C’est une esquille détachée de la falaise, par une diaclase très visible. La carte géologique est à trop petite échelle pour qu’on ait pu y porter ce détail. (Voir pl. XXVII, phot. 51). La faille a peut-être un rapport avec la réapparition de l’eau vive.
[126]Capitaine Normand, Ses travaux dans la vallée de la Zousfana, Bulletin du Comité de l’Afrique française, supplément de juillet 1904, p. 165.
[127]Lieutenant Cavard, Les Ouled Djerir, Bulletin du Comité de l’Afrique française, supplément de novembre 1904, p. 279.
[128]On ne peut que renvoyer à l’excellente étude de Doutté dans La Géographie, 1903, I, p. 177.
[129]Lieutenant Cavard, Les Ouled Djerir, l. c.
[130]Calderaro, Les Beni Goumi, Bulletin de la Société de Géographie d’Alger, 1904, 2e trimestre, p. 307, etc.
[131]Voir pour plus de détails : Doutté, l. c. dans La Géographie.
[132]Albert, Une razzia au Sahel, Bull. Société de Géog. d’Alger, 1906, p. 129.
[133]Voir Doutté, l. c. (La Géographie).
[134]Calderaro, l. c. p. 321.
[135]Calderaro, l. c.
[136]Lieutenant de Clermont-Gallerand, Communication sur le mouvement commercial entre Beni Ounif et le Tafilelt, Bulletin de la Société de Géographie d’Alger, 1905, p. 539.
[178]CHAPITRE V
RÉGION DE LA SAOURA[137]
La région dont il s’agit est inscrite entre l’erg d’Iguidi et la Saoura, ou plutôt le grand erg qui borde l’oued Saoura à l’est. Elle est donc limitée au nord-est et au sud-ouest par d’énormes masses de sables.
Elle est bien loin elle-même d’être libre de sable puisqu’on y trouve deux ergs notables (Atchan et er Raoui). Mais du moins distingue-t-on avec netteté l’ossature rocheuse, qui est constituée par la chaîne à laquelle on peut laisser le nom d’Ougarta.
Sous-région d’Igli. — La région considérée se rattache au nord à celle du Béchar. Elle s’y rattache par une sous-région qu’il faut étudier à part, celle d’Igli.
L’infrastructure primaire de cette sous-région en serait particulièrement intéressante puisqu’on y verrait le passage des plissements hercyniens d’Ougarta affectant le Dévonien et orientés S.-E.-N.-O. aux plissements du Béchar, également hercyniens, mais affectant le Carboniférien, et orientés S.-O.-N.-E.
Malheureusement, sur la route suivie, qui longe la Saoura, cette infrastructure est voilée en grande partie par des dépôts horizontaux. La Saoura s’est creusé son lit dans ces dépôts et l’on ne peut juger de l’infrastructure que par ce qui en apparaît au fond du lit.
Les dépôts horizontaux sont épais de quelques dizaines de mètres seulement. Leur horizontalité est parfaite, ou du moins semble telle à l’œil. Ils sont composés pour la plus grande part de sables plus ou moins agglomérés en grès tendre ; au sommet ces sables supportent[179] généralement un banc calcaire puissant de 5 à 6 mètres, contenant des rognons de silex. Cette description s’applique surtout aux dépôts de Beni Abbès que j’ai pu examiner de plus près. Mais ceux d’Igli ne m’ont pas semblé différents. Il s’agit d’une formation déjà mentionnée et que j’ai suivie jusqu’à Charouin. Ce sont les dépôts continentaux mio-pliocènes. Les formations sableuses représenteraient le Miocène continental, sur lequel le Pliocène, au climat désertique, aurait étendu une couche travertineuse et calcaire[138].
Dans le lit de la Saoura l’infrastructure primaire affleure surtout depuis la plaine d’Igli (confluent de la Zousfana et du Guir), jusqu’au ksar de Mazzer. Au delà l’ennoyage ne présente presque plus de fenêtres.
Les fossiles ne font pas défaut, et ce sont les mêmes qu’à Taouerda, ils se rapportent au Dinantien. Ils proviennent de calcaires bleuâtres d’aspect identique à ceux de Taouerda, de Tar’it ou du Béchar. Mais ici, au rebours de ce qui se passe au nord, le calcaire dans l’ensemble de la formation ne joue plus qu’un rôle subordonné. Le poste d’Igli est construit au sommet d’une gara, couronnée par une table de calcaire (Voir pl. XXIX, phot. 55) : cette gara est stratifiée comme suit : à la base et sur la plus grande partie de la hauteur totale qui est d’une cinquantaine de mètres, schistes argileux ou marneux assez friables — au-dessus une couche mince de grès, un mètre peut-être — au sommet un banc de calcaire bleu fossilifère, épais de 4 à 5 mètres. La gara d’Igli est un témoin détaché d’un barrage transversal à la vallée que l’oued a troué : d’Igli à Mazzer, l’oued a troué successivement six ou sept barrages de ce genre, qui semblent tous identiques, schistes mous couronnés et protégés par une table calcaire. Toutes ces couches ont le même pendage, elles plongent au nord-ouest, comme celles de Taouerda et de Tar’it. Pourtant il serait peut-être plus juste de dire que les couches d’Igli plongent nord-nord-ouest ; ce qui supposerait un léger rebroussement dans la direction du pli hercynien. Il est malaisé d’observer avec certitude le sens de la plongée parce qu’elle est peu accusée ; elle l’est de moins en moins à mesure qu’on avance vers le sud et aux environs de Mazzer elle est presque nulle.
Le pointement dévonien le plus rapproché de Mazzer le long de l’oued est celui d’Ouarourourt à 20 kilomètres environ. L’ennoyage de toute la région intermédiaire ne permet pas de préciser les relations[180] stratigraphiques entre le Carboniférien d’Igli et le Dévonien d’Ouarourourt.
La chaîne d’Ougarta. — Pour essayer de déchiffrer la structure de la grande zone dévonienne entre l’Iguidi et le Grand Erg algérien, il faut envisager d’abord la chaîne d’Ougarta. C’est là que se trouvent les couches les plus anciennes ; et les plis qui les ont affectées apparaissent nettement sur un immense espace.
Je donne à cette chaîne le nom d’Ougarta faute de mieux. Ougarta et Zeramra sont deux petites palmeraies sur sa lisière nord-orientale. Le mot chaîne gagnerait à être mis au pluriel ; il s’agit d’un faisceau puissant de petits chaînons. Ce faisceau couvre une superficie considérable, la presque totalité à vrai dire de la région considérée. A partir de Guerzim en effet la Saoura en longe la lisière orientale et l’occidentale touche à l’Iguidi. La chaîne d’Ougarta s’étend en largeur jusqu’aux puits d’Inifel et de Mana. Les oasis de Tabelbalet sont à l’intérieur de la chaîne.
En longueur, on la voit nettement commencer au sud au Markeb Bouda et à Ouled Saï ; mais la limite nord n’est pas connue. On sait seulement que la chaîne se prolonge vers le nord-ouest au delà de Zeramra et au delà de Tabelbalet.
La topographie de ce pays immense est très sommaire ; on l’a dressée avec quelques itinéraires levés par les officiers de Beni Abbès ; il n’y a malheureusement aucune comparaison possible avec la belle carte du Béchar dressée à loisir par le lieutenant Poirmeur. Les conclusions d’une étude géologique seront de ce fait affectées d’erreurs indéterminables. L’itinéraire que j’ai suivi moi-même part de Beni Ikhlef (à côté de Guerzim), et par Haci Touil, Oguilet Mohammed, Tinoraj, va rejoindre Ougarta. Il équivaut donc à une double traversée de la chaîne à peu près entière. D’autre part, j’ai suivi la Saoura sur tout son cours.
Âge des couches. — A la hauteur et à l’ouest de Kerzaz, au sud d’Aïn Dhob, dans une région faillée, s’étend la sebkha el Mellah. Elle est très particulière par l’épaisseur de ses dalles de sel. A en juger par la comparaison avec les autres sebkhas, celle de Timmimoun par exemple, qui est pour ainsi dire à peine saupoudrée de sel, on est tenté de croire que les seules conditions climatiques n’expliquent pas une pareille accumulation. Sur la rive ouest de la sebkha d’ailleurs on aperçoit de loin un monticule auquel les indigènes donnent le nom de Golb el Melah, « montagne de sel ». En Algérie il faudrait conclure à la présence du Trias ; on n’a jamais signalé au[181] Sahara d’étage dévonien salifère. Il est évidemment impossible de conclure d’une façon positive, mais la question méritait peut-être d’être posée : notons qu’une montagne de sel est signalée sur le bas Guir[139].
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XXIX. |

| Phototypie Bauer, Marchet et Cie, Dijon | Cliché Gautier |
55. — LE POSTE D’IGLI sur une gara carboniférienne.
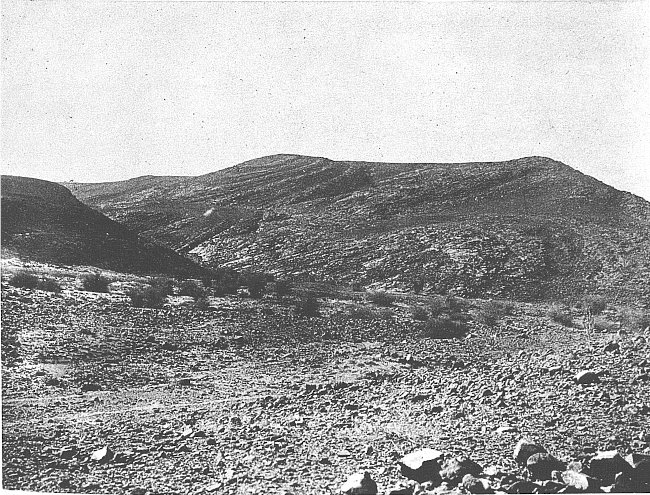
Cliché Gautier
56. — SUR LA RIVE DROITE DE LA SAOURA, à Beni-Ikhlef.
Sur tout le fond on distingue bien l’allure des couches gréseuses dévoniennes ; l’érosion y a fait ressortir des lignes qui rappellent les reflets de la moire.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XXX. |

Cliché Gautier
57. — L’OUED SAOURA A BENI-IKHLEF.
La photographie est prise sur la falaise mio-pliocène de la rive gauche ; le rond de l’Oued est une nebka (monticules de sable et touffes de végétation) ; — à l’arrière plan la chaîne d’Ougarta ; sur la rive droite de l’Oued, au pied de la chaîne, on distingue des lambeaux de terrasse mio-pliocène.
A ce Trias très hypothétique près, et si l’on fait abstraction des dépôts continentaux mio-pliocènes et des dunes, je n’ai vu dans la chaîne d’Ougarta qu’une seule formation, très homogène et qui paraît constituer toutes les chaînes[140]. C’est le grès du Mouidir, blanc patiné noir, qui, dans le reste du Sahara, est attribué au Dévonien inférieur. Il y a un ou plusieurs niveaux argileux (argiles vertes et rouges) comme au Mouidir. En revanche, l’étage supérieur des grès du Mouidir et de l’Ahnet est très fossilifère, tandis que les fossiles ici font à peu près complètement défaut. Il se pourrait cependant que cette lacune fût imputable aux hasards de l’itinéraire, car j’ai rapporté un fossile, un seul, un pygidium de Trilobite, non trouvé en place il est vrai, mais qui provient des environs de Beni Ikhlef. Autre différence avec le Mouidir-Ahnet : dans la chaîne d’Ougarta le soubassement silurien ou archéen n’apparaît nulle part, du moins à ma connaissance. Il est donc impossible d’évaluer avec certitude l’épaisseur totale de la formation. Dans l’Ahnet M. Chudeau l’a trouvée médiocrement puissante, 250 mètres environ. Du moins peut-on dire que, à juger par ce qu’on voit, la formation d’Ougarta n’aurait pas une puissance supérieure.
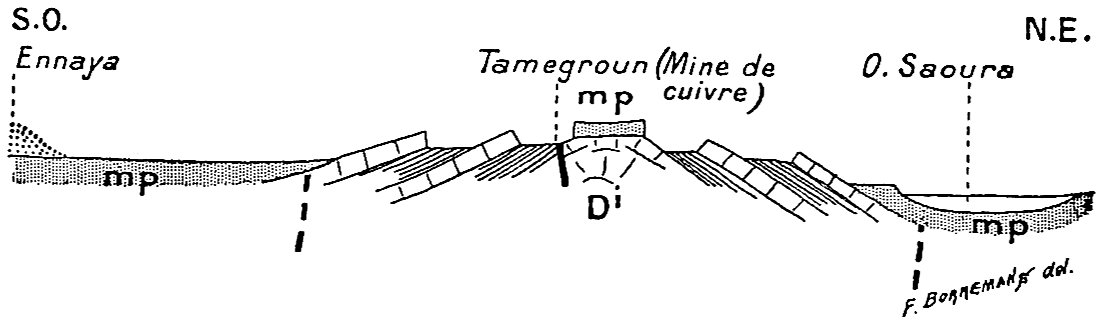
Fig. 36. — Coupe de l’O. Saoura (Beni Ikhlef) à Ennaya.
Échelle : 1/200000. — mp, Mio-Pliocène ; Di, Dévonien inférieur.
(Bull. Soc. géol. Fr., 4e série, t. VI, p. 732, fig. 1.)
[182]En résumé les grès d’Ougarta sont identiques à ceux de l’Ahnet dont l’âge dévonien inférieur est bien établi.
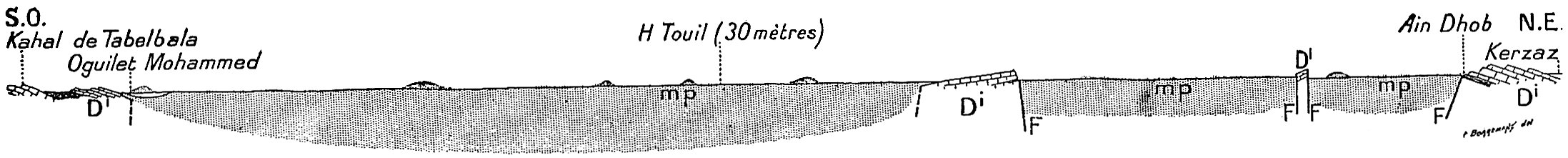
Fig. 37. — Coupe de Kerzaz à Oguilet Mohammed.
Échelle : 1/600000. — F, faille.
(Bull. Soc. géol. Fr., 4e série, t. VI, p. 734, fig. 3.)
Les plis hercyniens. — Les grès d’Ougarta sont minéralisés. Au lieu dit Tamegroun à mi-chemin entre Guerzim et Ennaya, sur le flanc ouest d’un dôme anticlinal, court un filon de quartz cuivreux, orienté dans le sens du plissement. Le filon a été exploité, aussi bien est-il célèbre dans la région. (Voir appendice III et pl. XXXI, phot. 58.) Un autre filon de cuivre existe au sud-ouest d’Ennaya, le point porte un nom caractéristique, Golb en Nehas, la montagne du cuivre. Il a été visité par le lieutenant Rousseau, qui m’a envoyé quelques échantillons de minerai.
Les grès de l’Ahnet, au rebours de ceux-ci, ne sont jamais minéralisés ; la raison en est simple : ils rentrent dans la zone calédonienne du Sahara et n’ont pas été plissés. Les grès d’Ougarta, au contraire, ont été soumis à des plissements hercyniens.
Le caractère plissé de la région est incontestable, on s’en rendra compte, je pense, d’un coup d’œil sur les coupes ci-jointes. (Voir aussi pl. XXXI, phot. 58, 59 et pl. XXXII, phot. 60.) Les plis sont très nets, médiocrement accusés, en général symétriques, souvent ils sont courts, réduits à des dômes anticlinaux ou à des cuvettes synclinales qui se relaient. Ce sont là des indices concordants d’un plissement peu énergique ; on s’explique ainsi que les couches inférieures à l’éo-dévonien n’aient été nulle part amenées au jour, au moins le long de l’itinéraire suivi, malgré la faible épaisseur de cette formation.
Malgré d’énormes lacunes on suit facilement et sans conteste la direction générale des plis ; ils courent nord-ouest-sud-est, comme la chaîne elle-même et comme la Saoura, qui en suit le pied. Cette direction fait un angle droit avec celle des plis hercyniens dans la Zousfana.
[183]Les plis sont sectionnés à la même hauteur, le sommet arasé de l’anticlinal à Tamegroun porte un lambeau étendu de Mio-Pliocène horizontal (fig. 36), le pays a tous les caractères d’une ancienne pénéplaine ravinée par l’érosion.
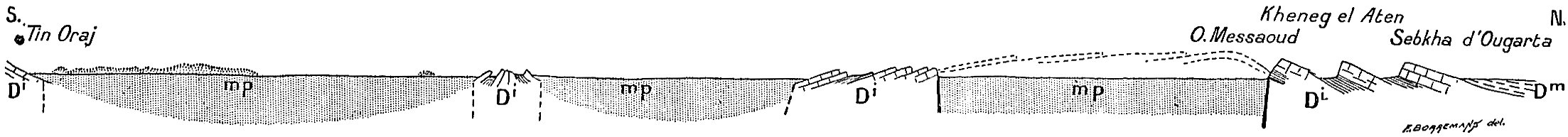
Fig. 38. — Coupe d’Ougarta, à Tin Oraj.
Échelle : 1/400000. — Dm, Dévonien moyen.
(Bull. Soc. géol. Fr., 4e série, t. VI, p. 736, fig. 5.)
Cette pénéplaine a été affectée de failles dont le dessin se reconnaît facilement sur la carte, parce que le placage mio-pliocène s’est conservé dans les compartiments effondrés, où il s’est, comme d’habitude, partiellement transformé en dunes.
Un grand effondrement dans le sens longitudinal a divisé la chaîne d’Ougarta lato sensu en deux grandes arêtes néo-dévoniennes, la branche d’Ougarta proprement dite et l’arête de Tabelbalet (les indigènes disent le Kahal ?)[141].
Entre les deux un gigantesque compartiment effondré à contours irréguliers en zigzags, supporte, sur un socle mio-pliocène, les ergs Atchan et er Raoui.
Souvent les failles ont été guidées par la direction des plis, c’est le cas le plus fréquent, mais il arrive qu’elles ont taillé à contre-fil, coupant les plis à angle droit par une cassure brutale. C’est ce qu’on observe par exemple dans le grand cirque d’effondrement où se trouve avec la sebkha el Melah la pointe nord de l’erg Atchan.
Les failles sont récentes en relation avec la surrection de l’Atlas ; les lèvres en rejet sont fraîches, ont gardé un profil de falaise : le grand lambeau horizontal mio-pliocène sur la crête de Tamegroun, (cailloutis et poudingues inconsistants), a le facies des dépôts miocènes ou si l’on veut oligocènes, il est dénivelé de 100 mètres par rapport à ceux des compartiments effondrés ; les failles ne peuvent donc pas être plus anciennes que le tertiaire.
Dans les compartiments surhaussés, l’érosion a été très active. Elle a été d’autant plus efficace que les couches d’argiles molles interstratifiées[184] dans les grès durs lui donnaient une prise. Le relief s’est ainsi rajeuni et recréé par le creusement de profondes vallées longitudinales qui ont accusé en saillie marquée les plis hercyniens. La sécheresse du climat actuel aidant, qui exagère les pentes, d’après une loi bien connue, la chaîne d’Ougarta fait encore figure assez montagneuse.
Longues falaises infranchissables, gorges étroites en canyons, lits caillouteux à pente torrentielle ; — le relief est jeune, comme les effondrements qui ont été le point de départ du processus érosif.
La zone Beni Abbès-Ougarta. — Il nous reste à parler de la région comprise entre la chaîne d’Ougarta et la Saoura. Au point de vue géologique c’est la plus intéressante, malgré sa faible étendue relative, par l’abondance de ses fossiles et la variété de ses roches.
C’est un compartiment effondré par rapport à la chaîne d’Ougarta. Au contact les failles ne sont pas apparentes.
Partout sur la lisière orientale de la chaîne d’Ougarta, à Zeramra, à Ougarta, à Guerzim et au delà, on voit, ou on croit voir les couches du Dévonien inférieur plonger sous les couches plus récentes ou sous la hammada mio-pliocène d’une inclinaison régulière. Les bastions avancés de la chaîne, dj. Zeramra, dj. Kahla, Nif Kroufi, qu’on pourrait prendre sur la carte topographique du capitaine Prudhomme pour des horsts limités par des à-pics, sont au contraire, sur le terrain, autant que j’ai pu en juger, des bombements anticlinaux parfaitement réguliers.
L’hypothèse des failles n’en reste pas moins la seule qui puisse rendre compte d’une dénivellation aussi marquée et d’aspect aussi frais que celle qui existe entre la chaîne d’Ougarta et la hammada de Beni Abbès, ces deux parties disjointes d’une même pénéplaine. Les failles longitudinales par rapport au sens des plis échappent à l’observation plus aisément que les transversales.
Le compartiment effondré, comme d’habitude est plaqué de mio-pliocène et couvert çà et là de dunes. L’étude stratigraphique du substratum primaire est donc très malaisée. Pourtant le long de la Saoura d’une part, et d’autre part au pied des montagnes et au débouché des torrents, l’érosion a ménagé quelques fenêtres, où il est possible de faire sur le sous-sol des observations lacunaires.
Horst de Merhouma. — Le long de la Saoura entre Beni Abbès et Idikh, l’oued traverse une formation assez puissante, qu’on peut appeler, pour la commodité de l’exposition, couches de Merhouma, du nom du point d’eau au voisinage duquel on les aperçoit d’abord en venant du nord.
[185]A la partie supérieure de la formation ce sont des grès, plongeant à l’est, qui ont tout à fait le facies éodévonien ; ils reposent, en discordance, je crois, sur une assise schisteuse, qui est restée malheureusement en dehors de la route suivie ; cette assise paraît puissante et ses éléments complexes ; on y trouve des schistes noirs très durs, à bilobites, qui ont le facies de certaines phyllades siluriennes du Sahara. Elle mériterait un examen approfondi[142].
Dans la cuvette de Beni Abbès j’ai pu observer le contact entre ces phyllades et les couches calcaires supradévoniennes. Ce contact est anormal, les couches calcaires sont coupées brusquement et rebroussées. Il y a là une faille, très ancienne, puisqu’elle était arasée quand s’est déposé le placage mio-pliocène.
Fenêtre d’Ougarta. — Le petit village d’Ougarta est à la limite exacte des grès éodévoniens, sur des argiles et des schistes argileux mous. Au sud du village s’étend une très grande sebkha, dont le sol est une pénéplaine de schistes argileux interstratifiés de couches calcaires minces.
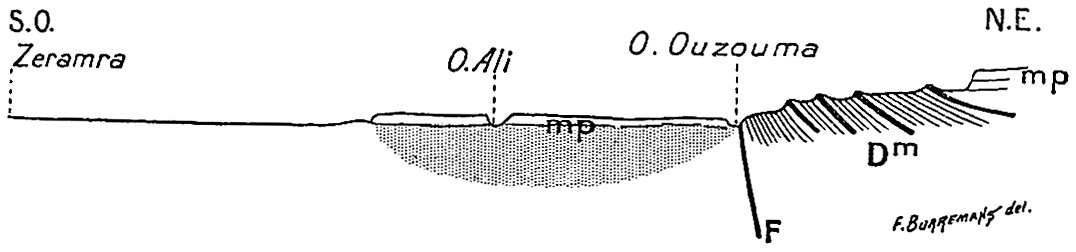
Fig. 39. — Coupe à l’est de Zeramra. — Échelle : 1/300000.
(Bull. Soc. géol. Fr., 4e série, t. VI, p. 741, fig. 8.)
A trois ou quatre kilomètres d’Ougarta, sur la route de Beni Abbès on voit une couche de calcaire gréseux, pétri d’Orthocères et interstratifié dans un grès très tendre jaune clair.
A une dizaine de kilomètres au nord d’Ougarta, ce gisement à Orthocères se retrouve sous la garet Yhoudia, qui est un témoin détaché de la hammada mio-pliocène. La couche calcaire à Orthocères a un mètre d’épaisseur ; elle est interstratifiée dans des argiles rougeâtres beaucoup plus puissantes.
Aux environs d’Ougarta, si la couverture mio-pliocène fait à peu près complètement défaut, le sol est souvent couvert de dépôts quaternaires et de cailloutis actuel, apportés par les oueds de la montagne. Il n’a pas été possible de préciser les relations stratigraphiques[186] entre ces affleurements de facies assez différent. Il est vrai que la stratification s’écarte peu de l’horizontale, et, à si faible distance, on peut supposer avoir affaire au même niveau ou a des niveaux très voisins, à moins pourtant qu’il n’existe des failles inaperçues.
Fenêtre de Zeramra. — Le petit village de Zeramra est, lui aussi, a la limite des grès éodévoniens ; il est bâti sur ces grès ; mais, dans son périmètre immédiat, on ne voit pas d’autres roches primaires. Le contact est voilé par le terrain quaternaire ou par des lambeaux de Mio-Pliocène.
En revanche, à quelques kilomètres du village, aussi bien sur la route d’Ougarta que sur celle de Beni Abbès, on traverse des couches puissantes bien différentes de celles d’Ougarta, au moins comme faciès (fig. 39). Ce sont des grès, généralement en plaquettes, intercalés de calcaires violets, bleus, amarantes, à crinoïdes, à spirifer, à orthocères. Ces couches sont très dures, elles sont énergiquement redressées et sont à découvert sur 2 kilomètres environ, elles ont donc une certaine puissance, au moins une centaine de mètres.
Les fossiles ne sont pas très caractéristiques. Pourtant M. Haug admet qu’ils appartiennent au dévonien moyen[143].
La formation est certainement affectée de plis arasés, ils sont de même orientation que ceux de l’Éodévonien, ils semblent même grosso modo concorder avec eux et les prolonger ; mais il y a certainement des failles.
La coupe de la figure 39 semble bien révéler une diaclase à la hauteur de l’O. Ouzouma. De part et d’autre de cet oued en effet le niveau de la hammada mio-pliocène n’est plus le même.
Fenêtre de Beni Abbès. — Dans le lit de la Saoura, au voisinage de Beni Abbès affleurent les plus remarquables des couches néodévoniennes et les mieux connues, celles qui ont livré une faune abondante du Dévonien supérieur, l’étage à clyménies[144].
Les fossiles se trouvent dans des bancs de calcaires rouges sombres, très ferrugineux, interstratifiés avec des schistes argileux très fissiles et mous, de même couleur, et qui contiennent aussi quelques fossiles mais beaucoup plus rares.
[187]Ces couches, avec le même facies et les mêmes fossiles se rencontrent en deux points médiocrement éloignés l’un de l’autre au nord et au sud de Beni Abbès, et qui sont en allant du nord au sud :
A) Ouarourourt, une petite palmeraie ; le Dévonien supérieur affleure sur la rive droite de l’oued, immédiatement à l’ouest de la palmeraie, sous la falaise mio-pliocène.
L’affleurement se suit sur une assez grande distance au pied de la falaise, en amont et en aval d’Ouarourourt. Ici le Dévonien supérieur est affecté d’un plissement anticlinal très net (fig. 40) ; c’est cette arête anticlinale qui a forcé l’oued à faire un coude prononcé en amont d’Ouarourourt. Elle est dirigée nord-ouest-sud-est, exactement est 30° sud en visant l’aval de l’oued. Au sud de l’anticlinal d’Ouarourourt les couches dévoniennes sont sensiblement horizontales.
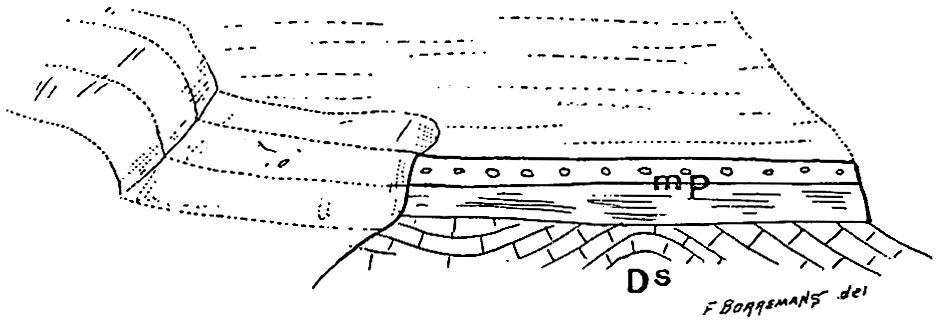
Fig. 40. — Ouarourourt.
Ds, Dévonien supérieur.
(Bull. Soc. géol. Fr., 4e série, t. VI, p. 744, fig. 9.)
B) 8 kilomètres au sud vrai de Beni Abbès. C’est là que les couches calcaires fossilifères sont coupées brusquement et rebroussées au contact du horst de Merhouma.
Ces affleurements sont au nord de Merhouma ; au sud du horst on retrouve ou du moins on entrevoit à peu près les mêmes couches se succédant dans le même ordre.
Fenêtre des « pierres écrites » (pl. XXXII, phot. 61). — Au sud-ouest de Tametert en pleine hammada, affleure, au ras du sol, une bande de calcaire, tantôt simple et tantôt double, large de quelques mètres et longue de plusieurs kilomètres ; on y voit tout du long une foule de gravures rupestres et d’inscriptions, ce qui explique le nom de cet affleurement Hadjra Mektouba « pierres écrites ». La roche est bleue claire et quelquefois violette, elle renferme des crinoïdes et des débris de coquilles ; le facies rappelle les affleurements de Zeramra. L’affleurement est parallèle à l’oued, et semble avoir une allure anticlinale.
[188]Les couches à Bivalves. — Quand on va des « Pierres écrites » au ksar d’el Ouata, au point où l’on descend la falaise de l’oued, juste en face du ksar de Bou Hadid, on passe sur un autre affleurement dévonien empâté dans la falaise mio-pliocène et de facies particulier. Ce sont des calcaires (?) gris, assez tendres, renfermant des moules de coquilles (dont la forme rappelle le genre Panenka). Ces couches plongent vers l’oued, je les crois intermédiaires comme âge entre l’affleurement précédent et le suivant.
Fenêtre d’Idikh. — En face du ksar d’Idikh, sur la rive droite de l’oued, on retrouve une dernière fois les calcaires violets à clyménies, c’est un petit lambeau qui m’a paru affecté d’une ondulation anticlinale. A quelques centaines de mètres dans le prolongement de ce lambeau, sur l’autre rive de l’oued, on en voit un autre couronné de ruines, d’un calcaire assez analogue d’aspect et de couleur, mais pétri de crinoïdes au lieu de clyménies. Il plonge franchement nord ou nord-est.
En résumé, on peut essayer de classer comme suit les terrains méso et néodévoniens voilés par la hammada de Beni Abbès.
A la base, les couches d’Ougarta, avec abondance d’orthocères.
Au-dessus, les calcaires et les grès en plaquette de Zeramra, identiques, semble-t-il, aux calcaires des Pierres écrites.
Puis les couches à bivalves.
Enfin, les calcaires à clyménies.
Il est certain d’ailleurs que cette série est lacunaire, et en outre l’ordre qui paraît le plus plausible pourrait être erroné.
On peut affirmer, en revanche, que ces couches sont affectées de plissements arasés orientés S.-E.-N.-O.
On peut affirmer aussi que le plissement est léger ; les argiles et les marnes, qui jouent un grand rôle, sont toujours feuilletées, mais la pression subie n’a pas été assez énergique pour les transformer en véritables schistes.
Plus au sud les étages supérieurs du Dévonien n’apparaissent nulle part ; au delà d’el Beiada et de Tagdalt, où affleurent des grès massifs ou en plaquettes d’âge indéterminé on ne voit plus jusqu’à Foum el Kheneg que des grès éodévoniens incontestables et du Mio-Pliocène.
Cette dernière formation prend un facies assez particulier dans la falaise de Timmoudi, que j’ai pu examiner à loisir. Au-dessous du ksar elle est composée sur presque toute son épaisseur d’une succession de lits caillouteux, qui attestent un courant assez rapide. Tout à côté, au sud, la falaise est tout entière en argile très fine, que le ruissellement a curieusement sculptée, et qui atteste une sédimentation[189] tranquille en eau stagnante. (Voir pl. XXXIII.) Évidemment nous avons ici la section d’un vieux lit de rivière. Le tout est couronné uniformément par la croûte travertineuse habituelle (pliocène ?).
Il est clair qu’une formation continentale aussi étendue n’est pas homogène, et le nom vague de mio-pliocène, que nous lui donnons, est une appellation d’ensemble commode qui supplée à notre ignorance des détails.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XXXI. |

Cliché Gautier
58. — MINE DE CUIVRE DE TAMEGROUN dans la chaîne d’Ougarta.
Au premier plan on voit les trous d’exploitation, dans l’un desquels un indigène est debout.
Au fond grande vallée longitudinale entre deux assises gréseuses.

Cliché Gautier
59. — DANS LE KAHAL DE TABELBALA, auprès d’Oguilet Mohammed.
Dans le fond à gauche les dunes en masse indistincte ; — au delà de l’oued on distingue l’allure stratigraphique des grès éo-dévoniens.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XXXII. |

Cliché Gautier
60. — DANS LA CHAÎNE D’OUGARTA. — Kheneg el Aten.
Grès éo-dévoniens.
Un des coins les plus sauvages de la chaîne.

Cliché Gautier
61. — HADJRA MEKTOUBA
Affleurement de calcaire méso-dévonien au milieu du reg.
Sur ces calcaires, inscriptions et gravures rupestres.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XXXIII. |

62. — BERGE DROITE DE LA SAOURA AU KSAR DE TIMMOUDI.
On aperçoit le Ksar au sommet de la falaise mio-pliocène, constituée par des couches de sable et surtout de galets agglomérés en grès tendres et en poudingues.
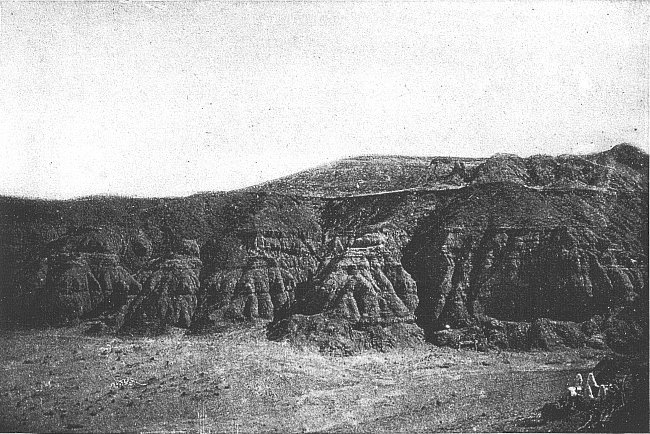
Cliché Gautier
63. — FALAISE DE TIMMOUDI.
Continuation de la précédente, mais de composition bien différente, argileuse.
On voit d’un coup d’œil que l’érosion a sculpté la paroi de tout autre façon.
Structure générale. — En somme la région étudiée est essentiellement une pénéplaine hercynienne, dont les plis modérés courent sud-est-nord-ouest. Elle est affectée dans son ensemble d’une pente régulière nord-sud ; j’estime à deux cents mètres environ la différence de niveau entre Igli et Foum el Kheneg (sur une distance d’environ 200 kilomètres).
L’horizontalité de la pénéplaine a été dérangée par des diaclases dont les unes ont suivi le sens des plis et les autres une direction perpendiculaire à la première.
Les compartiments surélevés ont été disséqués par l’érosion et présentent une série de longues arêtes gréseuses parallèles ; la raideur des pentes, exagérée par le climat désertique, rend les communications difficiles, et donne au paysage un aspect sauvage malgré la faiblesse des altitudes relatives (100 à 150 m.).
La jeunesse de l’érosion atteste qu’il s’agit de diaclases récentes, évidemment en relation avec la surrection de l’Atlas.
Les alluvions anciennes, mio-pliocènes, occupent une superficie considérable comme partout sur le versant méridional de l’Atlas, qui est enfoui sous les débris de la grande chaîne. Elles sont bien moins puissantes pourtant que dans l’est où elles recouvrent le sous-sol d’un manteau continu, épais en certains points de plusieurs centaines de mètres (O. Namous).
Ici, encore qu’on en trouve quelques lambeaux sur les sommets, le Mio-Pliocène n’a été conservé en plaques étendues que sur les compartiments effondrés. Le long de la Saoura, à Beni Abbès par exemple, le Mio-Pliocène a une quarantaine de mètres de puissance. Le puits de Haci Touil (erg er Raoui) creusé dans le Mio-Pliocène, et le plus profond de la région comme son nom l’indique[145], a une trentaine de mètres, ce qui semble indiquer que, là aussi, la croûte d’ennoyage n’excède pas quelques dizaines de mètres.
Comme partout au Sahara algérien ces dépôts en grande partie[190] sableux ont été remaniés superficiellement par le vent et transformés en dunes.
Une longue bande de Mio-Pliocène et de dunes (erg er Raoui, erg Atchan), coupe en deux dans le sens longitudinal la chaîne d’Ougarta ; séparant la chaîne proprement dite d’Ougarta de celle de Tabelbalet (que les indigènes appellent le Kahal de Tabelbalet).
D’autre part la chaîne d’Ougarta (stricto sensu) est assiégée à l’est par les dernières dunes du Grand Erg. La chaîne de Tabelbalet confine vers l’ouest à l’Iguidi.
Si donc on essayait de résumer brièvement l’originalité géographique de la région étudiée, on arriverait à peu près à la conclusion suivante.
Au sud de l’Atlas s’étire d’est en ouest une énorme accumulation de dunes dont les matériaux ont été fournis par les déjections de la grande chaîne attaquée par l’érosion depuis l’Oligocène, et qu’on pourrait appeler les grands ergs subatliques. Cette gigantesque barrière de dunes est rompue à l’ouest de l’O. Saoura par les chaînes jumelles d’Ougarta et de Tabelbalet ; elles articulent l’énorme accumulation de sable en trois masses inégales, nettement distinctes, encore qu’elles tendent à se rejoindre, et qu’elles fassent manifestement partie d’un même ensemble ; l’erg du Gourara, — le groupe jumeau Atchan et er Raoui, — l’Iguidi.
Cet affleurement du vieux sous-sol rocheux en double crête montagneuse au milieu des hammadas, des regs et des dunes subatliques donne à la région son unité géographique. Il la fait priviligiée au milieu d’étendues inhabitables et presque inabordables. L’affleurement de vieilles roches où les argiles jouent un rôle considérable ramène en surface et met à la disposition de l’homme la nappe souterraine d’humidité. Ainsi prend naissance une double ligne de verdure et de vie — oued Saoura — oued de Tabelbalet, toutes les deux longeant à l’est l’une la chaîne d’Ougarta, l’autre celle de Tabelbalet.
O. Saoura. — Le nom de Saoura s’applique à l’oued formé par la réunion de la Zousfana et du Guir, et qui garde ce nom jusqu’à Foum el Kheneg.
Dans son ensemble la Saoura coule nord-ouest-sud-est : c’est la même direction que celle des plissements hercyniens et il y a entre les deux un lien de cause à effet.
Entre Igli et Ksabi (tout proche de Foum el Kheneg) une trentaine de ksars s’alignent le long de la Saoura, ce qui fait en moyenne un village tous les six ou sept kilomètres ; sur certains points ils sont[191] notablement plus serrés, jamais à plus de 25 kilomètres l’un de l’autre.
Une pareille densité de population est tout à fait anormale le long d’un oued saharien et s’explique nécessairement par des conditions physiques très particulières.
Très en gros on peut dire que l’O. Saoura est resserré sur tout son cours entre la dune et la montagne ; sa rive gauche est de sable et sa rive droite de roc, traduit en langage géologique, cela signifie qu’il suit assez exactement la limite des deux terrains le Mio-Pliocène et le Dévonien. C’est une circonstance heureuse, parce que cette limite est aquifère.
Le lit est partout marqué avec une extrême netteté, encadré de hautes falaises, qui atteignent parfois une cinquantaine de mètres ; et il est net de sable. Les dunes, très puissantes pourtant, et qui atteignent facilement une centaine de mètres d’altitude, s’arrêtent méticuleusement à l’oued, leur contour en suit fidèlement les méandres, et ces masses instables ne se permettent nulle part d’envahir le lit béant à leurs pieds. Que cet océan de sable soit arrêté si nettement par un aussi petit obstacle, c’est un fait étrange et qu’on serait tenté de dire miraculeux, en ce sens du moins que nos connaissances actuelles ne nous en fournissent pas d’explication tout à fait satisfaisante ; à tout le moins peut-on dire qu’il atteste une connexion entre le contour des ergs et le tracé des oueds. Quelles que soient les causes il est tout à fait important que la Saoura ait un lit profond, net, libre d’obstacle où la pente est en moyenne d’un millimètre par mètre. C’est un canal naturel d’irrigation qui guide et chasse au loin les crues. (Voir pl. XXX.)
La Saoura en effet n’est pas un fleuve tout à fait mort, et à certaines époques, très espacées il est vrai, elle coule sans métaphore. Elle est constituée par deux rivières, la Zousfana et le Guir, qui ne sont pas dépourvues d’eau courante. On sait déjà ce qui peut s’en trouver dans la Zousfana, et c’est à vrai dire assez peu. D’après le capitaine Normand l’oued coulerait une fois ou deux par an, et il semble que ces crues exceptionnelles parviennent jusqu’à Igli.
Mais c’est le Guir surtout qui est une rivière tout près d’être normale. On le connaît très mal. On sait pourtant qu’il prend sa source dans des montagnes bien plus hautes et bien plus humides que le Grouz et le Beni Smir, dans le grand Atlas marocain ; les « montagnes de neige » disent les indigènes, djebel el theldj. Les hautes vallées Atliques constitutives du Guir sont habitées par une population sédentaire et agricole de Beraber. Même sur le bas Guir le « Bahariat »[192] des Doui Menia est une grande plaine de culture liée à l’existence des crues régulières.
On nous dit d’ailleurs que l’oued sur tout ou presque tout son parcours garde habituellement un filet d’eau légèrement salée ; la salure de ces eaux s’expliquant vraisemblablement par des causes géologiques : la carte Prudhomme signale sur le bas Guir un « Golb el Melah — rocher de sel » ; il est possible que le Guir rencontre des bancs de sel triasique, si fréquents dans l’Atlas, et il est sûr que sur tout son cours, moyen et inférieur, les argiles cénomaniennes, chargées de gypse et de sel jouent un rôle considérable. A Igli même, au confluent avec la Zousfana, et à différentes époques, j’ai vu couler le Guir et de la boucle de l’oued auprès du poste on entend s’élever un coassement continu de grenouilles. Par le canal de la Zousfana et surtout du Guir les crues descendues de l’Atlas envahissent la Saoura ; elles approvisionnent de barbeaux les r’dirs de Beni Abbès ; très certainement il arrive qu’elles parcourent d’un élan la Saoura tout entière jusqu’à Foum el Kheneg ; au poste de Ksabi en octobre 1904 le maréchal des logis Galibert a photographié une crue qui couvrait toute la vallée et qui n’était pas encore écoulée au bout de huit jours (voir pl. IX, phot. 18). Octobre 1904 a été particulièrement pluvieux dans le Sud-Oranais, à cette date une inondation a ravagé le village d’Aïn Sefra qui n’avait pas connu pareille catastrophe depuis sa fondation.
On n’a pas de documents sur la fréquence et la périodicité des crues. Il est certain pourtant que dans l’hiver 1906-1907, qui fut particulièrement pluvieux, l’oued a coulé pendant cinq mois consécutifs au pied du poste de Beni Abbès, et au printemps 1907 la crue dépassait assurément Foum el Kheneg.
Il est probable que la Saoura coule à de très longs intervalles, supérieurs à une année, mais enfin elle coule, et elle roule alors d’énormes masses d’eau.
Il est clair qu’elle emmagasine alors de puissantes réserves dans les cuvettes de son lit, qui est, en tout temps, semé de r’dirs ; — (Beni Abbès — la R’aba — Kerzaz — Beïada — Ksabi, où les moustiques sont intolérables). Il serait imprudent pourtant d’attribuer les r’dirs à l’influence exclusive des crues.
Un fait tout à fait caractéristique c’est que la Saoura est en quelque sorte hémiplégique ; toutes les palmeraies sans exception sont sur la rive gauche, et lorsque par exception et pour des raisons de commodité architecturale on a construit le ksar sur la rive droite (Timmoudi), le village est séparé de la palmeraie par[193] toute la largeur de l’oued. Toutes les canalisations s’enracinent à l’est.
Rien de plus naturel. L’oued Saoura sur sa rive droite longe le pied de la montagne à quelques kilomètres de la ligne de partage des eaux ; sur la rive gauche, au contraire, le bassin encore qu’on ne puisse pas préciser ses limites s’étend certainement très loin.
D’ailleurs sur la rive gauche la nappe d’eau souterraine trouve des conditions particulièrement favorables de mise en réserve et d’adduction progressive. L’erg du Gourara est très mal connu ; il est impossible de tracer, même hypothétiquement, le réseau des affluents qui s’y trouvent assurément enfouis. En tout cas il est certain que l’erg est formidablement massif et il semble bien reposer à peu près partout sur le même substratum, le Mio-Pliocène, particulièrement intéressant par ses épaisseurs de sable miocène non concrétionné. Sable d’alluvions ou de dunes, l’épaisseur doit atteindre et dépasser presque partout une centaine de mètres ; une monstrueuse éponge que la pente du terrain égoutte dans la Saoura tout le long de sa rive gauche.
C’est d’abord un admirable condensateur. Les rares pluies qui tombent sur ce sol meuble par excellence sont bues avec une instantanéité qui ne laisse aucune chance à l’évaporation. On sait en outre qu’un sol de sable, par sa porosité qui multiplie sa surface de radiation nocturne, est particulièrement apte à provoquer des rosées ou des phénomènes de cet ordre ; on signale en hiver sur les dunes la fréquence relative des gelées blanches et notons que à Ksabi la température en hiver s’abaisse occasionnellement jusqu’au-dessous de zéro. L’erg est donc bien organisé pour soutirer à l’air ambiant le maximum d’humidité.
Mais par surcroît, et ceci est je crois l’essentiel, il recouvre un réseau de rivières quaternaires, c’est-à-dire un terrain dont les âges antérieurs ont organisé le drainage. Ainsi advient-il que toutes les eaux qui tombent ou qui se condensent dans un immense espace, englobant un morceau de l’Atlas sont absorbées, protégées, et acheminées vers la rive gauche de la Saoura.
Quand on essaie de serrer d’un peu plus près la question on distingue dans le lit de la Saoura un certain nombre de sections qui s’individualisent.
Entre Igli et Beni Abbès la limite géologique entre Mio-Pliocène et Dévonien n’est pas marquée exactement par le lit de l’oued ; elle est même assez loin dans l’ouest, où elle est jalonnée par deux petites palmeraies, celles d’Ougarta et de Zeramra. Le lit de la Saoura, il[194] est vrai, a entamé le Mio-Pliocène jusqu’à la pénéplaine primaire sous-jacente.
Dans cette section du cours les palmeraies sont rares et distantes, mais en revanche assez considérables. Ce sont Igli, Mazzer, et Beni Abbès, respectivement séparées par des étapes de 25 kilomètres. Pour être tout à fait complet, il est vrai, il faut ajouter la palmeraie, très petite et inhabitée, d’Ouarourourt à quelques kilomètres en amont de Beni Abbès.
Qu’Igli soit précisément au confluent de la Zousfana et du Guir cela suppose que ces deux oueds ont un rôle à jouer dans l’irrigation des jardins. En arrière d’une barrière rocheuse carboniférienne, la nappe d’eau souterraine stagne dans une grande plaine d’alluvions, où on va la chercher dans des puisards larges et peu profonds (de 4 à 8 mètres) et d’après Calderaro ces puisards sont la principale ressource de la palmeraie. Pourtant je retrouve dans mes notes mention d’une foggara, une seule, une canalisation quelconque allant capter de l’eau, plus douce que celle du Guir, dans la direction de l’est, sous les dunes.
Le cas de Mazzer est parfaitement clair : à la base de la falaise mio-pliocène, sur la rive gauche, jaillit une très grosse source ou mieux un petit ruisseau d’eau claire ; il débouche sous une voûte travertineuse qu’il s’est construite lui-même, il donnerait 100 litres à la minute. On l’appelle Aïn el Hammam. Il existe d’ailleurs à Mazzer cinq autres petites sources beaucoup moins importantes.
Ouarourourt est alimenté de même par un tout petit filet d’eau qui sourd à la base de la dune.
Beni Abbès a ses r’dirs pérennes et poissonneux, mais cette pérennité même d’une mare superficielle, dans un pays où les crues ne sont pas même annuelles, je crois, atteste que les r’dirs doivent être alimentés par une circulation souterraine. Ce ne sont pas les r’dirs d’ailleurs qui jouent un rôle essentiel dans la vie de la palmeraie. C’est la seguia ; elle jaillit de la falaise mio-pliocène, au sud immédiat du village, tout à fait comparable à la source de Mazzer et plus importante encore. Il existe d’ailleurs outre la grosse source huit petits suintements distincts tous voisins. Il est donc incontestable que, dans la section amont de la Saoura, — Igli mis à part — les palmeraies sont alimentées par de grosses sources naturelles, des douix dirait-on en Bourgogne, qui jalonnent la rive gauche.
En aval de Beni Abbès l’oued entre dans une section de son cours tout à fait à part. Il a dû s’ouvrir un chemin à travers un horst éodévonien, et pour partie peut-être silurien ; il s’est creusé dans les[195] grès un beau canyon (en aval de Merhouma), et dans les argiles des gorges sauvages (ksar en Nsara). L’érosion paraît ici plus jeune qu’en amont et la pente du lit paraît, à l’œil, plus accentuée. Une carte topographique précise accuserait, je crois, une rupture de pente, à la traversée de cette barrière puissante, où l’oued n’a pas encore atteint un profil d’équilibre. L’existence de cette barrière n’est probablement pas étrangère à la richesse en eau de la falaise et de la cuvette à Beni Abbès.
Ce horst hercynien offre de médiocres conditions aux agglomérations humaines. Elles n’y font pas tout à fait défaut pourtant, il y a des cultures à Merhouma, mais pas de village, il est vrai ; des palmeraies minuscules avec quelques habitants à Noukhila et à Bechir. Çà n’en est pas moins un intervalle à peu près vide entre les groupements importants d’amont et d’aval.
Celui d’aval surtout est considérable, c’est le plus dense de toute la Saoura. A partir de Tametert, mais surtout d’el Ouata où la cuvette s’élargit, jusqu’à Beiada, sur une cinquantaine de kilomètres, les palmiers se touchent, et souvent aussi les ksars ; c’est la R’aba, la forêt de palmiers. Ce coin privilégié est devenu le centre politique et militaire de la région ; je dis au point de vue indigène, puisque notre administration française s’est fixée à Beni Abbès : mais la R’aba est l’habitat de la tribu nomade suzeraine, les R’nanema.
Cette section du cours est encadrée entre ce qui semble bien être deux ruptures de pentes ; en amont le horst de Tametert ; en aval, au delà de Beïada, le point critique est Tagdalt. L’oued prend là un aspect très particulier, le lit perd tout à fait sa netteté habituelle ; il est envahi sinon directement par la dune du moins par la nebka, qui en est l’avant-coureur. A travers les mamelonnements de sable on ne le retrouve plus qu’à la traînée de végétation arbustive (tamaris, etc.). Il y a certainement là un palier.
La R’aba est le seul coin de la Saoura où j’ai observé un double lit majeur et mineur, et une double ligne de terrasses étagées ; l’une, la supérieure taillée dans le Mio-Pliocène, l’autre, l’inférieure, dans ces dépôts d’un blanc éclatant, plâtreux, qui sont abondants au voisinage d’Ouargla et qu’on classe quaternaires anciens.
Au cœur de la R’aba (Bou Hadid, el Ammès) la ligne orientale des terrasses disparaît ou s’écarte hors de vue, le lit s’élargit en vaste cuvette, où se pressent les palmiers et les ksars et où l’eau se trouve partout dans le sol à un très petit nombre de mètres. C’est de là justement que part à travers l’erg une route de caravanes jalonnée de[196] puits, encore inexplorée, mais qui a bien des chances de suivre le thalweg d’un oued enfoui.
Je suis mal renseigné sur le régime de l’irrigation dans la R’aba, il y a apparence qu’il existe là aussi des foggaras ou du moins une canalisation ; il m’a semblé pourtant que les puisards et les r’dirs jouaient le rôle le plus important, comme à Igli, et au rebours de Beni Abbès.
Au delà de Tagdalt et surtout à partir de Guerzim l’oued suit rigoureusement le pied de la chaîne d’Ougarta jusqu’auprès de Timmoudi. Nulle part la dissymétrie des deux rives n’est aussi directement sensible à l’œil, la rive gauche est taillée comme d’habitude dans le Mio-Pliocène, immédiatement dominé par les hautes dunes. A droite le Mio-Pliocène est représenté localement par des lambeaux de terrasses très discontinues et qu’il faut un examen attentif pour déceler dans le paysage (voir pl. XXX, phot. 57 et pl. XXIX, phot. 56). Ce qui frappe c’est l’énorme talus rocheux, inclinée à 45°, ce qui est l’inclinaison même des strates, noir de poix, et où l’érosion en découpant les strates a dessiné d’immenses rondelles qui prennent sous le soleil des reflets de moires (voir pl. XXIX, phot. 56) ; l’ensemble a une centaine de mètres d’un seul jet, et la nudité absolue de ces collines gréseuses leur donne un aspect sauvage de grandes montagnes. L’aspect est un peu celui d’un coupe-gorge, et l’on se rend compte en effet que la proximité de ce massif montagneux, qui peut si facilement devenir un repaire, est une menace pour la vallée. C’est peut-être pour cela que cette partie de l’oued est habitée par des marabouts ; là se trouvent les deux grosses zaouias de Guerzim et de Kerzaz, protégées par leur caractère sacré.
Guerzim a de superbes foggaras, longues de 2 kilomètres à ce qu’il m’a semblé, et rappelant déjà celles du Touat. Bien entendu leur point de départ est à l’est à la base des dunes.
Kerzaz au contraire a des r’dirs, beaucoup d’eau stagnante et peut-être même en certains endroits courante. L’oued Saoura, dont le lit est ici très étroitement resserré entre la falaise et la montagne, tend à se revivifier localement et une canalisation compliquée n’est pas nécessaire.
Pourquoi cette différence dans les conditions hydrographiques entre points voisins. La solution de ce petit problème est sans doute ensevelie sous l’erg.
Dans la dernière section de son cours — de Timmoudi à Foum el Kheneg — la Saoura s’écarte à quelques kilomètres de la chaîne d’Ougarta, qu’on aperçoit cependant à faible proximité (pl. IX, 17) ; mais cette chaîne perd rapidement de son altitude et de sa puissance.[197] A Ksabi elle est réduite à une arête rocheuse de quelques dizaines de mètres, ennoyée presque jusqu’au sommet, à l’assaut de laquelle les dunes montent de part et d’autre. Ici par-dessus l’O. Saoura et les derniers débris de la chaîne d’Ougarta le Grand Erg et l’erg Atchan se rejoignent déjà par quelques filaments. Ce faible obstacle est percé par la Saoura aux gorges de Foum el Kheneg.
Jusque-là jusqu’à Foum el Kheneg qui est en somme l’exutoire de la cuvette de Ksabi l’O. Saoura reste vivant, semé de palmeraies et de ksars (Ksabi, Tim’rarin, etc.). On ne peut que signaler à distance assez grande au cœur de l’erg oriental un groupe important de palmeraies et de puits, celui de Telmin. Il est possible qu’entre la nappe de Telmin et celle de la basse Saoura il existe une relation.
En tout cas il est remarquable que la Saoura qui a été un ruban de sources, de palmeraies et d’agglomérations humaines cesse brusquement de l’être au delà de Foum el Kheneg ; les indigènes ont vivement senti ce changement et l’ont accusé dans leur nomenclature ; l’O. Saoura prolongé cesse de porter ce nom il devient l’O. Messaoud, un oued saharien banal, qui traverse le désert sans en modifier le caractère, souvent méconnaissable, de continuité incertaine, bi- et trifide, conservant à peine assez d’eau pour alimenter en des points très éloignés un pâturage et un puits saumâtre. Cette déchéance s’accuse sans transition dès que l’oued a derrière lui la chaîne d’Ougarta, il est séparé désormais par une barrière infranchissable de son réservoir d’humidité, cette masse énorme de sédiments friables et de dunes qui s’étend de l’Atlas à Ksabi.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XXXIV. |

Cliché Gautier
64. — Dans l’erg er-Raoui, UNE ANTILOPE ADASE, qui faisait partie d’un troupeau d’une trentaine de têtes.
Remarquer l’élargissement brusque du sabot ; forme de pied adaptée aux sols désertiques.
L’oued Tabelbalet. — Dans la région étudiée l’O. Saoura a un pendant, qu’on peut appeler l’oued Tabelbalet. Il n’a pas de nom pour les indigènes qui en dénomment les tronçons visibles ; et ne s’intéressent pas à sa continuité, évidente, mais sans portée pratique.
Voici ce qu’on sait.
Je n’ai pas vu l’oasis et les ksars de Tabelbalet, et quoiqu’ils aient été vus par nos officiers à plusieurs reprises, il n’en a jamais été publié de description ; l’oasis est au pied de la chaîne Tabelbalet, à la lisière de l’erg er Raoui ; l’eau est partout à très faible profondeur dans le sol.
Au sud de Tabelbalet la ligne de contact entre l’erg et la chaîne reste aquifère sur cent kilomètres au moins.
Jusqu’à Haci Bel Rouz le nombre des puits échelonnés est assez considérable (Noukhila, Haci el Maghzen, etc.) ; et ce nombre pourrait être augmenté facilement, on trouve de l’eau n’importe où, dit-on ;[198] en tout cas H. el Maghzen a certainement été improvisé à l’étape par les maghzen de Beni Abbès.
Au delà l’eau devient plus rare, pourtant le bord de l’erg reste jalonné de trois puits au moins, Tin Oraj, Haci el Hamri, Oguilet Mohammed. Ces trois puits, les seuls que j’ai vus, sont tous creusés dans le lit d’un oued enfoui. La photographie de Tin Oraj, montre nettement les 2 berges du lit mineur découpées dans le quaternaire ancien (terrain plâtreux d’un blanc éclatant). (Voir pl. X, phot. 20.)
A Haci el Hamri et Oguilet Mohammed j’ai fait des constatations analogues. Partout on retrouve les érosions et les dépôts d’un grand oued quaternaire. Il y a là évidemment un grand oued enfoui et encore vivant. Il vient à coup sûr de l’Atlas, d’un point indéterminé dans la région inexplorée à l’ouest du Guir. Sa nappe d’eau, en tout cas, est nécessairement alimentée, au moins pour une grande partie, par les pluies de l’Atlas.
Cet oued anonyme et que j’appellerai Tabelbalet, est curieusement symétrique à la Saoura ; comme elle, il coulait entre les dunes et la chaîne rocheuse ; mais ici les dunes ont été bien plus envahissantes, la plus grande partie de l’oued gît sous un amoncellement de sable, et l’O. Tabelbalet, bien plus gravement atteint, bien plus décomposé que la Saoura par le climat désertique, est un centre de vie humaine incomparablement moins intéressant.
L’erg qui a effacé l’O. Tabelbalet s’appelle l’erg er Raoui, c’est-à-dire l’« humide ». Dans sa partie méridionale à tout le moins, la mieux connue et assez fidèlement reproduite sur la carte dans ses grands traits, l’erg est très peu compact, très évidé intérieurement par des gassis immenses et larges. Le sable est surtout entassé sur le lit même de l’O. Tabelbalet. C’est à l’oued enfoui que l’erg doit son nom bien mérité. Il alimente du gros gibier, de grands troupeaux d’antilopes adax (voir pl. XXXIV, phot. 64), cela suppose une végétation relativement abondante et des points d’eau facilement accessibles, à fleur du sol.
Erg Atchan et sebkha el Melah. — Tout contre, relié à l’« erg humide » par de longs filaments de dunes, l’erg Atchan « l’assoiffé » fait contraste avec lui. Ce n’est pas qu’il ne recouvre lui aussi une ramification d’oueds quaternaires, mais qui sont apparemment tout à fait morts, impropres à alimenter une vie quelconque. Les seules eaux potables de la région, assez voisines de l’erg mais tout à fait en dehors sont à Aïn Dhob et à Nechea. Ce sont des sources jalonnant une ligne de faille.
[199]Le trait le plus remarquable du régime hydrographique est la sebkha el Melah. C’est la grande mine de sel pour les riverains de la Saoura ; le sol est couvert d’une croûte de sel pur, brisée en dalles cahotiques sous l’influence des variations de température, et dont l’épaisseur atteint plusieurs centimètres. Encore qu’il ne soit pas surprenant de trouver du sel dans une sebkha, je n’en connais pas d’autre où les dépôts actuels de sel aient une pareille puissance. On a déjà traité le petit problème géologique que pose son existence.
Il s’en pose un autre, topographique et hydrographique. En 1903 la sebkha m’avait paru de niveau plus bas que le lit voisin de la Saoura ; mon baromètre avait marqué le même jour à quelques heures d’intervalles, 735 millimètres à Aïn Dhob contre 730 à Kerzaz. Les indications d’un anéroïde sont naturellement sujettes à caution. Mais celles-ci semblent avoir été confirmées depuis. La crue de 1904 arrêtée à Foum el Kheneg par un tampon de sable (voir pl. IX, phot. 19) a reflué en masse vers la sebkha el Melah ? Il serait intéressant de savoir comment l’existence d’une pareille dépression se concilie avec le travail de l’érosion quaternaire. Mais avant de chercher l’explication du fait il conviendrait d’attendre qu’il fût hors de doute.
Privé de points d’eau, contourné par tous les itinéraires, l’erg Atchan, flanqué de la sebkha el Melah, reste inconnu. On peut affirmer cependant qu’il occupe un compartiment effondré au cœur de la chaîne d’Ougarta ; le bassin de réception est limité très vite au nord, où de puissantes masses montagneuses interceptent tout accès souterrain ou subaérien aux eaux de l’Atlas. Et c’est apparemment ce qui explique l’« erg assoiffé » voisin mal partagé de l’« erg humide ».
La chaîne d’Ougarta. — Sur la chaîne de Tabelbalet on ne sait rien de détaillé. On voit mieux déjà la chaîne d’Ougarta, malgré d’énormes lacunes. On peut affirmer que, au point de vue humain, économique, elle présente un intérêt, tout inhabitée qu’elle est : ce n’est pas du tout un coin désespéré du Sahara.
A priori on pouvait le prévoir ; la chaîne est constituée de ces mêmes grès éodévoniens, excellent réservoir d’humidité, qui font habitable la plus grande partie du pays Touareg.
Elle a en effet ses points d’eau, le puits d’Ennaya, par exemple, le r’dir de Kheneg el Aten (voir pl. XXXII, phot. 60.) Elle a aussi ses pâturages, celui d’Ennaya entre autres ; Ennaya est une cuvette synclinale tapissée de Mio-Pliocène et de petites dunes. La montagne elle-même, la roche nue, au printemps de 1905, était couverte de[200] ce que les Sahariens appellent un pâturage d’« acheb ». Je ne crois pas que cette végétation ait été décrite ni étudiée au point de vue botanique.
La plupart des plantes sahariennes sont des arbustes rabougris dont les chameaux mangent les feuilles, les pousses vertes, les extrémités tendres ; ils sont pérennes, et, dans les périodes les plus sèches, quand les jeunes pousses font défaut, la ramification ligneuse subsiste au-dessus du sol. Les plantes sahariennes les plus célèbres, le hâd par exemple, le dhomran rentrent dans cette catégorie.
L’acheb n’est pas une plante, c’est une catégorie, tout à fait distincte de la précédente, celle des plantes éphémères, printanières, que les bonnes années font sortir du sol pour un petit nombre de semaines, dans les coins privilégiés. Les indigènes leur donnent aussi ce joli nom, r’ebia, le printemps ; végétation classique de steppe en somme, la plante n’est représentée en temps ordinaire que par ses racines invisibles, ou peut-être même par une graine enfouie ; vienne le moment favorable, et l’attente dût-elle être de plusieurs années, la végétation subaérienne évolue précipitamment.
Au printemps de 1905, qui avait été précédé, on l’a dit, de pluies abondantes et de grandes crues en octobre 1904, l’acheb sur les montagnes d’Ougarta était assez varié ; un caractère commun évident était l’énorme prédominance des organes floraux, pas de feuilles, des fleurs en grappes volumineuses, sur des stipes grêles et nus ; pas trace de verdure dans l’impression d’ensemble. Au-dessus de Beni Ikhlef l’acheb était représenté par une espèce à fleurs violettes ; la montagne apparaissait de loin couverte d’une moisissure violette d’un effet étrange et délicat sur la roche noire de poix.
Les chameaux « mangent le printemps » avec avidité ; l’engloutissement de gerbes de fleurs dans ces gueules particulièrement répugnantes heurte notre concept européen du bouquet, et fait une impression blasphématoire.
J’ai noté aussi la présence d’Anabasis aretioides.
La chaîne d’Ougarta serait donc un pays de pâturages, et si elle n’est pas un pays d’élevage la faute en est aux hommes et aux circonstances, non pas à la nature.
Elle a aussi des richesses minérales, on l’a dit.
A l’ouest de Beni Ikhlef sur la route d’Ennaya, au lieu dit Tamegroun un filon de quartz cuprifère court dans les grès dévoniens, qui sont imprégnés au contact. Autant que j’ai pu en juger après un examen sommaire, et toutes réserves faites sur mon inexpérience, en matière d’évaluations minières, l’affleurement mériterait d’attirer[201] l’attention s’il se trouvait dans un pays moins inaccessible et moins désolé. D’autant plus qu’il n’est certainement pas isolé (Golb en Nehas). On peut se demander s’il n’y a pas là pour la Saoura une ressource future éventuelle[146].
C’en a été une à coup sûr dans un passé indéterminé. L’affleurement de Tamegroun a été exploité par les indigènes, très sommairement, il est vrai ; les trous et les tranchées d’exploitation qui s’échelonnent le long du filon, ont à peine un mètre ou deux de profondeur. (Voir pl. XXXI, phot. 58.) Le minerai était calciné ou traité sur place, comme l’atteste la présence de scories.
Le souvenir de cette exploitation s’est conservé dans la mémoire des indigènes.
Je dois à l’obligeance de M. le capitaine Martin, commandant l’annexe de Beni Abbès, et à celle de M. l’interprète militaire Stackler, la copie et la traduction d’un texte arabe, conservé au monastère de Guerzim, et qui concerne la mine de Tamegroun[147]. Il y est question de sorcellerie bien plus que de métallurgie. La mine est devenue un trésor gardé par des génies : les procédés d’extraction n’ont rien de scientifique : « il faut égorger un hibou, le battre avec une tige de fenouil, etc. ». On sait d’ailleurs que chez les primitifs un lien étroit unit la sorcellerie et le travail ou l’extraction des métaux : au Maroc, le Sous est à la fois la patrie des mineurs et des sorciers. Tamegroun d’ailleurs a sans doute été exploité par les Marocains, à une époque indéterminée ; je ne crois pas qu’il le soit actuellement.
L’homme. — Si obscur que soit le passé humain de l’O. Saoura on peut essayer, peut-être, de dégager des souvenirs et des légendes indigènes quelques grandes lignes un peu floues.
On trouve dans la région des tombeaux préislamiques (redjems) ; ils sont tout à fait semblables aux redjems habituels à mobilier de cuivre et de fer ; et leur distribution semble accuser une répartition de la vie toute différente de l’actuelle. Le lit même de la Saoura, où sont concentrées les oasis actuelles est plus pauvre en redjems que la chaîne d’Ougarta ; ils paraissent nous reporter à une époque de vie nomade où la culture intensive des oasis n’existait pas encore. A Beni Abbès, d’autre part, on se souvient ou on croit se souvenir de la date où aurait été captée la grosse source. Ce souvenir a pris naturellement forme de légende religieuse. « Un marabout égyptien, Si Othman el Gherib planta un bâton en terre : à ma mort, dit-il,[202] une source jaillira en ce point pour que vous puissiez laver mon cadavre. Le bâton resta fiché en place, et, quand on le retira, à la mort du santon, la source jaillit. » Ceci se serait passé soixante ans avant que le Touat fût occupé[148]. Il va sans dire que ces bribes d’hagiographie sont dépourvues d’intérêt historique. Peut-être pourtant doit-on retenir que la palmeraie de Beni Abbès n’a pas la réputation de remonter à une époque immémoriale.
Voici maintenant qui est plus récent et plus précis.
Dans l’oued Saoura, à une trentaine de kilomètres au sud de Beni Abbès, auprès du ksar de Tametert, on montre les ruines d’un ksar au sommet d’une butte ; c’est Ksar en Nsara, le bourg des chrétiens. D’après la tradition, ce bourg, peuplé de chrétiens, aurait subsisté jusqu’à une date indéterminée, où les musulmans l’assiégèrent, le prirent et le détruisirent.
D’autres ruines portant le même nom, et auxquelles se rattache la même légende, se voient entre Beni Ikhlef et Bou Khrechba.
D’après le P. de Foucault ces vieux « villages nazaréens » sont nombreux dans l’O. Draa[149].
A une pareille distance des côtes marocaines, ces chrétiens ne peuvent pas avoir été des Portugais ; s’agirait-il donc d’une communauté chrétienne indigène, qui aurait été détruite tardivement ? M. Basset, consulté, croit cette hypothèse inadmissible. Il ne faut pas d’après lui, prendre trop à la lettre le nom de Nsara (chrétiens) : « Je le regarde comme synonyme de Djohala (païens) ; ces noms s’échangent souvent dans les traditions populaires : comme dans les chansons de gestes, les Saxons de Guiteclin (alias Witikind), jurent par Mahom, Appollin et Tervagant. » Les habitants de Ksar en Nsara n’étaient donc pas des chrétiens, c’étaient des païens ou semi-païens, peut-être des kharedjites ; à coup sûr des ennemis de la foi orthodoxe, puisque leurs voisins musulmans les ont anéantis. Rien ne nous autorise d’ailleurs à fixer la date de cet anéantissement. Pourtant, la précision des souvenirs indigènes me semble rendre peu vraisemblable une date très reculée.
C’est aux « Nazaréens[150] » que la tradition attribue le captage des sources et l’aménagement des oasis (tradition très nette à Ougarta en particulier). Elle leur donne pour successeurs les Beni Hassen, et ici nous sommes sur un terrain historique assez sûr. Les Beni Hassen,[203] qui se retrouvent aujourd’hui au Maroc dans la plaine de l’O. Sebou ont été au Sahara les propagateurs de la langue arabe et d’un degré plus élevé de culture islamique jusqu’au Sénégal. L’arabe que parlent les Maures sénégalais s’appelle aujourd’hui encore le Hassaniya[151]. Les Beni Hassen ont laissé en effet dans la Saoura le souvenir d’une très grande et très puissante tribu ; et ce souvenir est resté très vivant, leur nom revient souvent dans la tradition. Les ruines d’un ksar Beni Hassen (mais que je n’ai pas vues) se trouvent à Beni Abbès sur la gara qui surplombe la palmeraie de l’autre côté de l’oued (rive droite). (Voir fig. 41.)
La Saoura actuelle est dominée politiquement, où du moins elle l’a été jusqu’à notre venue, par les R’nanema.
Au poste de Beni Abbès, M. le capitaine Martin a bien voulu me communiquer une étude sur les R’nanema, œuvre d’un officier dont je regrette d’ignorer le nom.
Voici de quelle façon la tribu se divise elle-même.
| Ataouna. | ||||||
| Debahba | Oulad Hammou. | |||||
| Oulad Saad. | ||||||
| Oulad Rezoug. | ||||||
| Chemamcha | Oulad Hossein. | |||||
| Maadid. | ||||||
| R’nanema | Gourdana. | |||||
| Oulad Zian. | ||||||
| Ataouna | Oulad Ali. | |||||
| Oulad Alla. | ||||||
| Gharaba. | ||||||
| Oulad ben Kina. | ||||||
| Gourdana[152] | Oulad Moktar. | |||||
| Oulad Dehan. | ||||||
| Oulad Abbou. |
Je ne suis pas très sûr que cette sèche énumération soit susceptible de présenter un intérêt général. Peut-être pourtant permet-elle d’entrevoir l’armature politique et sociale de la tribu. M. Doutté, étudiant les tribus du Maroc occidental, a publié quelques tableaux de subdivisions ethniques dont l’analogie avec celui-ci paraît évidente, quoiqu’ils soient d’une analyse beaucoup plus poussée.
Le dernier élément constitutif semble bien être la famille lato-sensu.
M. Doutté décrit ainsi la tribu marocaine. « Bien que l’analyse[204] montre qu’elle est en général formée d’éléments de provenances diverses au point de vue ethnique, elle est cependant conçue par ses membres comme une immense famille, et cette conception se traduit souvent par la croyance en un ancêtre éponyme[153]. »
Les Oulad Alla par exemple affirment descendre tous d’un certain Alla ben Hammou, originaire de Bou Denib (dans les hauts de l’O. Guir).
Les Oulad Hammou se rattachent à un certain Hammou Ould Keroum, des Krerma, fraction des Ahlaf, habitant la plaine de Tafrata au sud-ouest d’Oudjda.
Ces familles sont groupées en clans (?) groupés eux-mêmes en une confédération, qui est la tribu (?) des R’nanema.
Les familles, qui ont conservé le souvenir de leur origine, se réclament des coins les plus divers de l’Afrique du nord. Il en est qui sont venues de Kairouan et même de Tripolitaine, d’autres du dj. Amour, beaucoup du Maroc (Moulouya, O. Draa, Merrakech, Sahel). En somme, ici comme dans tout le reste de l’Afrique du nord le brassage des races a été très énergique[154], avec une prédominance peut-être des éléments marocains.
Ce qui fait l’originalité et l’unité de ces R’nanema, d’origines si diverses, c’est qu’ils sont nomades et non pas ksouriens.
Le territoire qui leur appartient est considérable, le long de l’oued il va de Merhouma jusqu’au delà de Tagdalt. C’est la section la plus riche de la Saoura, la r’aba, recouverte d’une « forêt » continue de palmiers, l’oasis d’un seul tenant de beaucoup la plus étendue de toute la région. Les ksars s’y pressent plus nombreux qu’ailleurs ; et d’ailleurs les R’nanema sont propriétaires de ksars isolés en dehors des limites de leur territoire propre ; un des ksars de Beni Abbès par exemple est R’nanema. Ces ksars, au rebours des autres, ne sont pas des individualités politiques autonomes ; beaucoup d’entre eux ne sont même pas des individualités municipales.
Anefid par exemple est une simple ferme habitée par des métayers haratin.
D’autres sont de simples lieux de refuge et d’ensilotement, des abris momentanés, inhabités la plupart du temps, des murailles vides à proximité des terrains de culture ; ce sont, par exemple, Béchir (qui est une station d’été), Tametert, Idikh, Ammès, Ksir el Ma, Beiada, Timr’arin, Meslila, Ksabi.
C’est le même type de ksars qu’on retrouve dans l’oued Guir (Bahariat) entre les mains d’autres nomades les Doui Menia : simples[205] magasins fortifiés et non pas lieux d’habitation ; la vie s’écoule ailleurs dans les pâturages.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XXXV. |
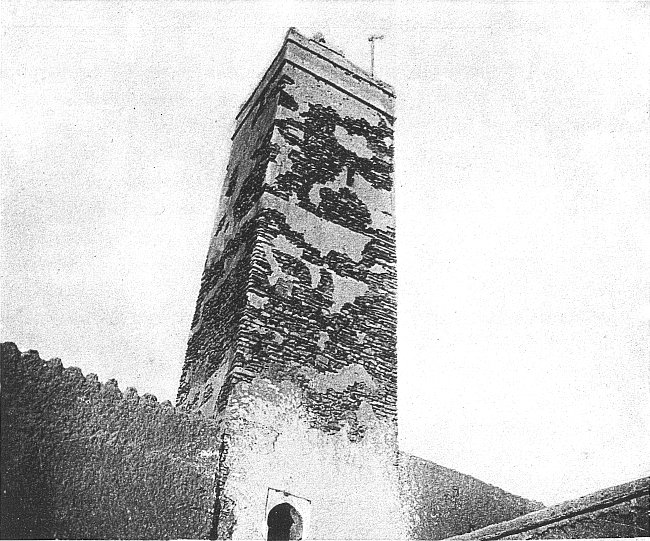
Cliché Gautier
65. — LE MINARET DE KERZAZ, construit en pierres, qui contrastent avec le pisé des murs.

Cliché Gautier
66. — UN QUARTIER DE KERZAZ vu du haut du minaret de la photographie 65.
Remarquer les toits en terrasses de pisé. A gauche et en haut de la figure, on voit l’Oued Saoura et la dune voisiner comme d’habitude.
Les pâturages des R’nanema sont à l’est dans l’erg, et sans doute ne se font-ils pas faute d’utiliser ceux de l’ouest, dans la chaîne d’Ougarta, lorsqu’ils peuvent le faire sans danger. Ce sont d’ailleurs des nomades à parcours assez restreint, ces Sahariens ne sont pas des méharistes, tous cavaliers, ou piétons, et cela suffit à leur interdire les grandes randonnées à travers le désert. Ils ne s’éloignent pas de la Saoura.
En revanche ils ont fait peser un joug très lourd sur les indigènes de la Saoura. Rohlfs, le premier Européen qui les a vus, insiste sur leurs exactions. C’était pourtant, lors de notre venue, une tribu en décadence. Si vagues que soient les données historiques à leur sujet, on suit le recul progressif de leur influence à travers le XIXe siècle.
On a vu qu’ils furent les maîtres de la Zousfana et qu’ils en furent expulsés par les Doui Menia après des luttes acharnées.
En 1894 une harka de Doui Menia et de Beraber, provoquée par les agents du sultan, ravagea la Saoura, et fit tomber après un long siège le ksar principal des R’nanema (el Ouata, je crois), où s’était réfugiée caïd Alla, le chef ou en tout cas l’homme le plus influent de la confédération.
Les R’nanema étaient donc progressivement refoulés par une poussée venue de l’ouest, lorsque nous nous sommes établis dans l’O. Saoura. Aussi ont-ils vu en nous des protecteurs ; et caïd Alla en particulier nous a été dévoué aussi longtemps qu’il a vécu.
L’autorité brutale des nomades est contre-balancée par l’influence religieuse des zaouias.
Il y en a une petite à el Maja, une autre à Beni Ikhlef, une autre à Igli, mais les plus notables de beaucoup sont Guerzim et surtout Kerzaz. Guerzim est dit-on plus ancienne, et se juge elle-même plus vénérable. Kerzaz est actuellement bien plus importante, on s’en rend compte au seul aspect de son minaret, très simple, mais construit de la base au sommet en dalles de grès, luxe unique dans un pays de construction en pisé. (Voir pl. XXXV, phot. 65 et 66.)
D’après Depont et Coppolani, la zaouia de Kerzaz, maison mère de l’ordre des Kerzazia, a été fondée par le chérif, Ahmed ben Moussa el Hassani Mouley Kerzaz, né vers 1502 de J.-C. La date est à retenir ; les XVe et XVIe siècles sont un moment décisif dans l’histoire des oasis sahariennes. La confrérie, d’après Depont et Coppolani[155],[206] compte environ 2000 adeptes dans la province d’Oran, et davantage vraisemblablement au Maroc. Dans la Saoura sa prépondérance est financière autant que politique ; Kerzaz est propriétaire de palmiers dans des oasis éloignées, comme Beni Abbès. A Kerzaz la baraka se transmet héréditairement dans la famille du fondateur, mais non pas de père en fils ; elle appartient aux plus âgés des membres de la famille. Il en résulte une gérontocratie, qui donne au gouvernement et à l’administration municipale un caractère original — très distinct de ce qu’on observe soit dans les ksars, soit chez les R’nanema.
Les ksars autonomes. — Vis-à-vis des nomades et des marabouts les ksars autonomes de la Saoura jouissent d’une indépendance dont le degré varie avec leur force et leur situation. Nous sommes assez bien renseignés sur les ksars septentrionaux Igli, Beni Abbès.
Igli. — M. Calderaro, nous a donné un historique d’Igli[156]. Il donne l’étymologie du mot dont l’ethnique est Glaoua. Les Glaoua sont une tribu marocaine bien connue qui habite le Grand Atlas au sud de Merrakech. Quelques membres de cette tribu « sont venus s’installer à une époque reculée sur un monticule à environ 1500 mètres au sud-ouest d’Igli, et auraient fondé un ksar appelé Aghrem Amekran (le grand Ksar) dont les ruines sont encore visibles de nos jours ». Le ksar actuel est une zaouia fondée vers le milieu du XVIIe siècle par un chérif venu du Gourara, Sidi Mohammed ben Othman. La date est à retenir ; c’est à la même époque à peu près que fut fondée la zaouia de Kenatsa. Mais Igli est bien loin d’avoir eu la fortune de Kenatsa ; son rayonnement est resté tout local ; sa seule filiale est le petit couvent voisin de la zaouia Tahtania. Aussi les Glaoua sont bien loin de jouer, soit dans l’oued Zousfana, soit dans la Saoura le rôle d’aristocratie religieuse et financière qui est réservé aux grandes zaouias, comme Kerzaz ou Kenatsa ; leur histoire telle que M. Calderaro nous la raconte sommairement est celle de tant d’autres ksars ; à travers les âges ils ont été pillés alternativement par les nomades voisins, Beraber, mais surtout Doui Menia et R’nanema. A notre arrivée ils payaient la protection des Ouled Sliman, fraction Doui Menia. Pourtant « les Doui Menia, d’après M. Calderaro, ne possèdent pas de palmiers dans l’oasis d’Igli ; la palmeraie entière appartient aux Ksouriens ». C’est là un grand avantage qu’ils ont sur d’autres, les Beni Goumi en particulier. Ils le doivent apparemment à leur caractère religieux.
[207]Mazzer. — Mazzer, d’après les notes manuscrites du poste de Beni Abbès, a été partiellement peuplé par des réfugiés venus de Si Akkachi, un vieux ksar dont on voit les ruines à mi-chemin entre Igli et Mazzer et qui aurait été détruit par les Glaoua il y a cent cinquante ans. Un certain Moussa ben Brahim, échappé au désastre avec sa famille, aurait fait souche à Mazzer des Oulad Moussa ben Brahim.
Mais Mazzer est beaucoup plus ancien, et d’ailleurs on ne concevrait pas que sa très belle source ait pu jamais rester inutilisée.
La tradition mentionne une ancienne émigration des indigènes de Mazzer (Oulad Raho, Oulad Khalfallah), qui seraient allés s’établir au nord du Tafilalet, dans le district de Tissini (?) Petit détail, insignifiant en soi et qui ne vaudrait sans doute pas la peine d’être rapporté, s’il ne s’ajoutait à d’autres pour montrer les liens étroits, après tout, qui unissaient la Saoura au Maroc.
Les autres familles de Mazzer sont les Oulad Moussa ben Daoud, (venus de l’O. Draa) ; les Oulad Hamza et les Oulad Alla (venus des hauts du Guir).
Mazzer est un petit ksar d’autonomie précaire. Il a acheté la protection des Ouled Sliman (fraction Doui Menia) et il est entièrement dans leurs mains.
Voici un petit détail qui permet d’apprécier le degré de subordination des ksouriens de Mazzer vis-à-vis des nomades et des marabouts, voire même vis-à-vis de leurs voisins plus puissants les ksouriens d’Igli.
Les marabouts de Kerzaz ont dans l’oasis de Mazzer les droits d’irrigation suivants (proportionnels naturellement au nombre des palmiers irrigués),
| ⎰ ⎱ |
6 | bassins | en été. | |
| 14 | — | en hiver. | ||
| Les Glaoua ont droit à | ⎰ ⎱ |
2 | — | en été. |
| 3 | — | en hiver. | ||
| Les Oulad Moussa ben Daoud | ⎰ ⎱ |
1/2 | — | en été. |
| 1 | — | en hiver. | ||
| Les Oulad Hamza | ⎰ ⎱ |
1/2 | — | en été. |
| 1 | — | en hiver. |
Les marabouts de Kerzaz ont donc à Mazzer des droits de propriété qui sont à ceux d’une des quatre familles indigènes comme 20 est à 1 et demi.
On saisit là sur le fait et on peut exprimer en chiffres l’abjection[208] de prolétaire ksourien dans sa propre palmeraie. Et notez qu’il s’agit de ksouriens libres et non pas de haratin.
Beni Abbès. — Il y a trois ksars dans l’oasis de Beni Abbès, l’un est celui des R’nanema, l’autre est habité par les haratin qui cultivent pour le compte des marabouts de Kerzaz les palmiers appartenant à la zaouia (la petite palmeraie d’Ouarourourt). Le troisième est celui des Abbabsa (indigènes libres de Beni Abbès). Cette simple énumération atteste que les Abbabsa ne sont pas les maîtres chez eux. Ils constituent pourtant un gros ksar qui a son histoire distincte et son autonomie.
Les Abbabsa, d’après les notes manuscrites aux archives de Beni Abbès se décomposent comme suit :
| Oulad Hamed | On ne nous donne de renseignements que sur leur antiquité relative. Ils ont précédé à Beni Abbès l’arrivée de la famille suivante. | |
| Oulad Ali ben Moussa | ||
| Oulad Raho | Viennent du ksar d’el Maïz à Figuig. Deux frères ont quitté en même temps le ksar, Ali ben Yahia, qui s’est fixé à Beni Abbès où il a fait souche des Oulad Raho — et X... qui s’est fixé à Charouin où il a fait souche d’une famille qui se donne le nom de Cheurfa. | |
| Oulad men la Ikhaf | Sont originaires du Sfalat (Tafilalet). Le premier d’entre eux qui se soit fixé à Beni Abbès est Si Mohammed ben Abdesselam, qui a fondé le ksar actuel il y a 150 ans ; car auparavant la population était répartie en 2 ksars. | |
| Ces quatre familles sont groupées en un rameau unique, sous le nom d’Oulad el Mehdi : elles ont vécu à part dans un ksar spécial jusqu’à la fondation du ksar actuel. Les Oulad el Mahdi sont originaires de la fraction des Oulad Noguir, tribu des Idersa, confédération Doui Menia. | ||
| Oulad el Kebir | ||
| Oulad Obéid | ||
| Oulad Saïd | ||
| Oulad Cherki |
L’aspect du terrain confirme ces renseignements généalogiques. Au-dessous du ksar des Haratin, on voit les ruines de celui qui fut habité autrefois par les Oulad et Mehdi ; au nord du ksar des R’nanema les ruines de celui qu’habitaient les Ouled Hamed, Ouled Ali ben Moussa et Ouled Raho. Ce sont les anciens habitants de ces ruines qui fusionnèrent il y a cent cinquante ans pour fonder le ksar actuel.
Tous les ksars, en ruines ou actuels, sont voisins et ont un air de parenté, ils sont groupés dans la palmeraie ou sur sa lisière, au pied de la gada de Si Mohammed ben Abbou. On appelle ainsi ce tronçon de hammada pliocène, libre de sable, qui s’allonge en feidj au milieu de l’erg, à l’est de Beni Abbès, et sur la tranche duquel sourdent les[209] eaux qui alimentent la palmeraie. Le ksar plus ancien des Beni Hassen se dresse au contraire sur l’autre rive, la droite, au sommet d’une gara difficilement accessible loin de l’eau et des cultures, dans une situation défensive et dominatrice, qui évoque à elle seule une autre époque, d’autres conditions politiques et apparemment économiques. (Voir fig. 41.)
Les notes manuscrites anonymes aux archives de Beni Abbès nous renseignent sur ce qu’on pourrait appeler les relations diplomatiques des Abbabsa. La plupart des ksars de la Saoura avaient conclu avant l’occupation française des conventions avec les tribus voisines. Ces conventions étaient de deux sortes.
La tata était un pacte par lequel les parties contractantes s’engageaient mutuellement à réparer les dommages éventuellement causés par des individus appartenant à l’une ou l’autre partie. La tata ne comportait le paiement d’aucune redevance.
La khaoua était une convention par laquelle une fraction ou un homme influent accordait sa protection à une autre fraction plus faible, et ce moyennant le paiement d’une redevance qui portait le nom de mezrag.
Les Abbabsa avaient une tata avec les Aït bou Grara, des Aït Rebbach (Beraber). En 1894 ils en conclurent une avec un certain Taleb Brahim ou Addou, des Aït ou Menaçef (Beraber), qui habitait au Draa. Ils en avaient une autre avec les Ouled Ahmar des Idersa (Doui Menia) ; mais ceux-ci ne tinrent pas leurs engagements. Il est évident que ces tata conclues avec des Beraber avaient pour but d’assurer aux Abbabsa l’accès des marchés du Tafilalet.
Les notes manuscrites anonymes ne mentionnent pas de convention avec les R’nanema. Il faut bien qu’il y en ait eu cependant, et de portée politique bien plutôt que commerciale, puisque il y a dans l’oasis de Beni Abbès, un ksar de R’nanema. On nous dit que ce ksar a été construit il y a une vingtaine d’années par les Abbabsa eux-mêmes qui y appelèrent et y installèrent les R’nanema, à titre de protecteurs, parce que les Doui Menia menaçaient de détruire la séguia.
Les notes manuscrites nous font connaître d’une façon plus ou moins fragmentaire l’histoire moderne des Abbabsa ; c’est une histoire de petites guerres confuses avec tous les voisins.
Les grands ennemis sont les R’nanema, puisque les maîtres. Il y a quatre-vingts ans, les R’nanema construisirent sur la falaise un ksar qu’ils durent abandonner plus tard parce que l’approvisionnement en eau y était trop difficile. Pendant la durée de cette occupation, les[210] Abbabsa enfermés chez eux tuaient tout R’nanema isolé et vice versa. Ils dépêchèrent en ambassade au sultan un certain Sliman ben Raho, grand-père du caïd actuel. Le sultan envoya 25 cavaliers makhzen sous les ordres du caïd Mohammed ben Sridi du Tafilalet. Cette démonstration suffit. Les makhzen laissèrent à Beni Abbès trois fusils de rempart qu’on a conservés et qu’on décore du nom de canons. Si Abdallah ben Abd er Rahman, chef de la zaouia de Kerzaz intervint entre Abbabsa et R’nanema et fit conclure la paix. Ceci devait se passer au voisinage de 1820. On sait que beaucoup plus tard les R’nanema en vinrent à leurs fins, puisque les Abbabsa durent provoquer l’établissement chez eux d’une sorte de garnison R’nanema.
Il y a une soixantaine d’années, d’après les notes manuscrites, c’est-à-dire, j’imagine, vers 1848 une caravane Doui Menia (fraction des Arib) fut pillée par les R’nanema à côté de Beni Abbès. En représailles une harka Arib et Doui Menia mit le siège devant Beni Abbès, elle ne put s’en emparer mais coupa 2400 palmiers au sud de la palmeraie actuelle dans la plaine d’Amama.
Les notes manuscrites mentionnent encore une guerre avec les Glaoua (gens d’Igli), beaucoup plus récente, et qui doit se placer vers 1890. Cette petite guerre est d’une curieuse mesquinerie municipale. A l’origine, expulsion d’un habitant par la djemaa de Beni Abbès, à propos d’une querelle de propriété. Le banni alla trouver les Glaoua, et sut les intéresser à sa cause, par un stratagème religieux qui doit être une survivance d’usages préislamiques (sacrifice rituel d’un mouton en un certain point du village)[157]. Les Glaoua traduisirent[211] la djemaa des Beni Abbès devant le cadi, qui donna raison au demandeur. Le banni sollicita, pour obtenir l’exécution de la sentence, l’appui du caïd Alla, l’homme le plus puissant de la confédération R’nanema, et lui donna mille francs d’honoraires. Caïd Alla s’entremit, et échoua.
Alors les Glaoua vinrent assiéger Beni Abbès, avec un effectif d’auxiliaires que nous connaissons exactement : 50 habitants de Mazzer, 12 Doui Menia, 30 Beni Goumi, et quelques Ataouna (fraction R’nanema). Les Abbabsa achetèrent la retraite des nomades et battirent les ksouriens.
Les Glaoua repoussés font alliance avec les Ataouna et vont camper au sud de Beni Abbès pour attendre leur contingent. Caïd Alla intervient derechef, apparemment pour des raisons sonnantes et trébuchantes ; il ménage un compromis entre Abbabsa et Glaoua ; les premiers faisant aux seconds des promesses pécuniaires fallacieuses. Les Glaoua se retirent avant l’arrivée des Ataouna.
La fin de l’histoire fait défaut dans le manuscrit. On nous dit cependant que la guerre a duré deux ans ; et on nous donne la liste des morts et blessés de part et d’autre. — Morts deux Abbabsa et un Glaoua — blessés un Abbabsa et huit Glaoua. On ne nous dit pas la valeur de la propriété litigieuse, cause de tout le mal ; mais on ne se trompe assurément pas en l’affirmant minime. Le manuscrit nous donne en effet en chiffres précis le montant de la plus grosse fortune privée à Beni Abbès, celle du caïd Mouley Ahmed ben Sliman : il possède exactement une vache, sept moutons demman, un âne, et 610 palmiers.
On a les meilleures raisons du monde évidemment de dénier tout intérêt au récit minutieux de cette guerre municipale. Il m’a semblé qu’il jetait un jour sur la vie des ksouriens, et qu’il délimitait le cercle étroit de leurs haines et de leurs préoccupations : c’est un admirable exemple d’anarchie, et d’impuissance à résoudre la moindre difficulté sociale : la façon même de conduire la guerre, cet enchevêtrement de négociations, de pots-de-vin, et de batailles prudentes, tout cela est curieux, et rappelle tout à fait ce qu’on nous raconte des guerres civiles marocaines.
Les guerres auxquelles Beni Abbès a été directement intéressé ne sont pas les seules dont elle ait subi les ravages dans le courant du XIXe siècle. Le territoire de Beni Abbès a été le théâtre de batailles entre Doui Menia et R’nanema en 1882 et 1885. La harka de 1894, dirigée par les Marocains contre les R’nanema, a copieusement dévalisé au passage les Abbabsa. De l’insécurité chronique la plaine[212] d’Amama, au sud de l’oasis, porte témoignage. Les 2400 palmiers que les Doui Menia ont coupé n’ont jamais repoussé. C’est aujourd’hui une nebka improductive.
L’histoire de Beni Abbès est particulièrement bien connue, parce que le poste français s’y est installé ; mais c’est un assez bon type moyen de grande oasis autonome. Elle a ses limites territoriales nettement fixées, du côté de Mazzer c’est Guetibat Slama, du côté de Tametert c’est Merhouma. Il est vrai qu’en deçà de ces frontières les Abbabsa ne sont que relativement leurs propres maîtres.
Beni Ikhlef. — Les notes manuscrites nous donnent une bonne monographie de Beni Ikhlef.
L’oasis située entre Guerzim et Kerzaz, contient trois ksars et une zaouia. Ce sont Ksar el Kebir, Ksar Menaceria, Ksar Haouch ou Kodia ; Zaouia de Si Abdallah ben Cheikh, branche de l’ordre de Guerzim. Ces quatre villages, d’ailleurs tout voisins, et renfermés dans l’enceinte de la même palmeraie, forment l’agglomération de Beni Ikhlef, dont l’ethnique est Khalfaoua. Les Khalfaoua se subdivisent eux-mêmes comme suit :
| Ouled Ahmar, originaires du sahel marocain, tribu des Oulad Délim. | |||
| Ksar el Kébir | Ouled Mellouk, descendants des Beni Hassen les premiers occupants de la Saoura. | ||
| Ouled Abdallah, sortis des Beni Mohammed, qui habitent actuellement les ksour du district d’es Sifa dans le Tafilalet. | |||
| Ouled el Abbès, sortis eux aussi des Beni Mohammed. | |||
| Ksar Menaceria | Ouled ben Ahmed, — — | ||
| Ouled Abd el Malek, — — | |||
| Ksar Haouch ou Kodia | El Kodia, originaires de Zaouia el Cadi, district d’Oued Ifli (Tafilalet). | ||
| Ouled Abdallah, déjà mentionnés comme sortis des Beni Mohammed. | |||
Sur l’ordre chronologique dans lequel se sont fixées au pays ces différentes fractions, on nous donne quelques renseignements sommaires. Ici comme partout dans la Saoura les Beni Hassen (Oulad Mellouk) ont précédé tous les autres. Les Beni Mohammed, qui sont venus ensuite, passent pour avoir acheté aux Beni Hassen les terres qu’ils occupèrent à Beni Ikhlef.
A cette époque les Khalfaoua habitaient des ksars situés à l’ouest des actuels, et dont on voit les ruines.
L’histoire moderne des Khalfaoua sommairement racontée est beaucoup plus brillante que celle des Abbabsa.
Il y a soixante ans, il est vrai, c’est-à-dire vers 1840, à la suite[213] d’une querelle pendant la diffa, une harka de Beraber Aït Atta, en route pour le Touat prit d’assaut les ksars de Beni Ikhlef.
Mais il y a quarante ans (1860 ?) les Khalfaoua ont enregistré des victoires sur les Doui Menia, à la suite d’une longue guerre. Ils ont battu les maghzen du sultan en 1891, les Ouled Djérir en 1893 ; la grande harka de 1894 n’est pas venue jusqu’à eux. Ils passent pour fiers, indépendants et braves ; leur réputation militaire est bien supérieure à celle des autres ksouriens et leur autonomie est bien plus effective.
A cette supériorité leur origine ethnique n’est peut-être pas tout à fait étrangère. On a vu qu’ils sont tous issus de tribus marocaines ; ce n’est pas une circonstance indifférente, dans un pays où l’on verra, au cours de cette étude, avec une évidence croissante que toutes les invasions pacifiques ou guerrières, depuis quatre ou cinq siècles, attestent une « poussée vers l’Est ». Je ne sais pas si on signale sur un autre point de la Saoura, des fractions qui se rattachent, ou prétendent se rattacher aux vieux Beni Hassen vénérés.
Mais surtout il faut insister sur la situation géographique de Khalfaoua. Ils sont encastrés entre Guerzim au nord (limite précise au jardin de Debibina) — et Kerzaz au sud, ou plus exactement Zaouia Kebira (limite précise au lieu dit Tagherdaia). C’est-à-dire qu’ils s’appuient de part et d’autre sur deux zaouias très respectées et très puissantes ; et ils ont apparemment avec elles des relations d’étroite amitié, puisqu’un de leurs quatre villages est une zaouia. Ils font donc partie de ce bloc monastique de la Saoura, qui partage avec les R’nanema la suprématie politique.
De quelque façon qu’on l’explique, le fait incontestable est que ce sont des Ksouriens exceptionnels, leur part d’autonomie, de dignité nationale, et de prospérité matérielle, est très supérieure à la moyenne ; ce sont pourtant des Ksouriens purs, tout à fait étrangers au nomadisme.
Agdal. — Ceux d’Agdal sont à l’autre bout de l’échelle. C’est un tout petit ksar entre celui d’Anefid au nord, et celui d’el Beïada au sud. Les habitants se décomposent comme suit :
| Ouled ben Hamida | Descendent de Bel Kacem ben Abd er Rahman, de la fraction des Gouassim, tribu des Angad (près d’Oudjda). |
| Ouled Aïssa | Un frère a fondé une famille apparentée à Tar’it, un autre au Timmi. |
| Ouled el Mir | ? |
| Ghouaba | Origine inconnue ; s’étaient d’abord fixés à Guerzim. |
[214]Le petit ksar d’Agdal est trop faible pour avoir jamais eu autre chose qu’un semblant d’autonomie ; il a toujours été pillé par tout le monde ; il est d’ailleurs situé sur le territoire des R’nanema, et entièrement à leur discrétion.
Tous ces détails monographiques, encore que fragmentaires et incohérents, me paraissent intéressants en ce qu’ils précisent la physionomie du Ksourien, j’entends du Ksourien libre, Berbère ou Arabe, la question des Haratin restant complètement réservée.
Les généalogies établissent qu’il y a parité d’origine avouée chez les Ksouriens et chez les R’nanema nomades. Tous ces tableaux se ressemblent, non seulement les nomades ne constituent pas une caste à part, mais ils n’ont même pas la prétention d’en constituer une.
Quoiqu’il y ait entre Ksouriens de grandes différences de degré dans la sujétion et dans la misère (par exemple entre Beni Ikhlef et Agdal), il est clair que dans l’ensemble la classe tout entière est humble et méprisée.
Si on cherche la caractéristique essentielle du Ksourien, il semble bien, ici comme ailleurs, que ce soit sa pauvreté. Il est propriétaire sans doute, il possède sa maison et quelques palmiers ; mais il lui manque les bêtes, les troupeaux de chameaux et les chevaux, c’est-à-dire les moyens de transport. On n’accepte d’être Ksourien que parce qu’on n’a pas de quoi être nomade. Dans le centre de Géryville, depuis que l’occupation française, en apportant la sécurité, a déterminé l’enrichissement progressif et général de la population, on a vu les ksars se vider et tomber en ruines[158]. Ici comme ailleurs les différences de condition sont en définitive pécuniaires. Les Ksouriens sont des prolétaires, ou, si l’on veut, des bourgeois au sens ancien, étymologique du mot ; et d’ailleurs un ksar est très exactement un village fortifié, c’est-à-dire un bourg.
Il est probable que, ici plus qu’ailleurs, la misère a des conséquences physiologiques, et que les Ksouriens tendent en conséquence à devenir une race différenciée. Au Sahara, on l’a mis en lumière depuis longtemps, la race blanche ne vit pas impunément à l’ombre des palmiers ; sous l’influence du paludisme les enfants métis ont chance de survie dans la mesure où ils ont du sang noir, et la race se négrifie. Il me semble qu’il est souvent difficile de distinguer d’un Haratin un soi-disant Ksourien blanc.
Pas de renseignements détaillés, en tout cas pas de monographie[215] sur les Ksars de la basse Saoura, en aval de Kerzaz. Et nous connaissons encore plus mal les ksars à l’ouest de la Saoura, Ougarta, Zeramra, Tabelbalet.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XXXVI. |

Cliché Gautier
67. — KSAR DE ZERAMRA ; tout petit, on le voit tout entier.
A droite, la Koubba de la photographie 68 (fagots contre le mur).
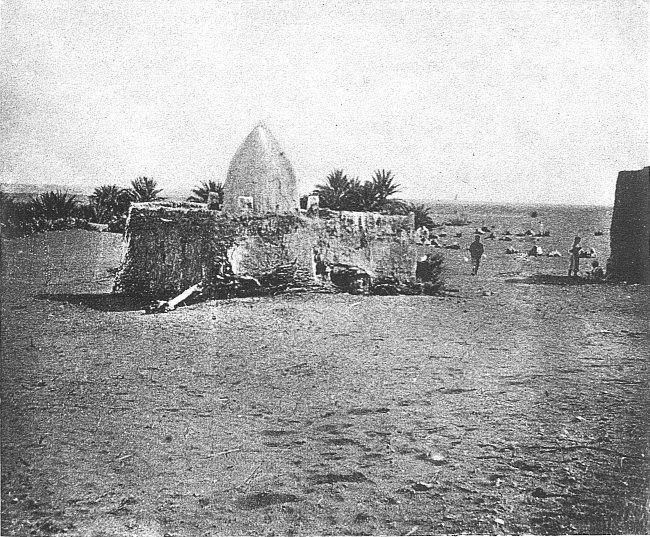
Cliché Gautier
68. — A ZERAMRA, KOUBBA DU SAINT QUI GARDE LE BOIS A BRÛLER.
On voit des fagots et des souches appuyés au mur.
Ougarta et Zeramra sont au pied de la chaîne d’Ougarta, au contact des grès éodévoniens et des couches mésodévoniennes. Ce contact est aquifère ; les deux palmeraies sont alimentées par de petites sources. Elles le sont maigrement, et les deux ksars sont de bien petites agglomérations humaines. La photographie de Zeramra en rend déjà sensible l’exiguïté, dont les chiffres du recensement permettent de se rendre un compte précis. Zeramra a 50 habitants dont 9 hommes adultes. (Voir pl. XXXVI, phot. 67.)
Ces noms de Zeramra et d’Ougarta qui sont d’usage courant et que les cartes ont fixés, ne sont pourtant que des déformations arabes des véritables noms Berbères, encore en usage et qui sont respectivement Mezremour et Ouggart. Ce dernier d’ailleurs est le même que le nom beaucoup plus connu de Touggourt.
Je ne sais pas si cette coexistence du nom berbère et du nom arabe implique la persistance d’un dialecte berbère dans ces deux petits ksars. En tout cas elle semble indiquer une arabisation plus tardive et plus imparfaite.
Ougarta et Zeramra sont en effet à une assez faible distance de la Saoura, une quarantaine de kilomètres, mais ce sont des kilomètres de reg nu, et qui suffisent à les isoler beaucoup. Ils sont en dehors des routes habituelles, nos patrouilles y sont venues tard et rarement. On s’étonne que des agglomérations aussi faibles aient pu subsister dans une situation aussi dangereuse, aussi en l’air, sur une frontière aussi peu sûre que la marocaine.
Ça n’a été possible naturellement qu’à force d’humilité et de ménagements vis-à-vis des deux partis. Zeramra et Ougarta ne savent pas qui ils doivent redouter le plus des Beraber ou de nous et se comportent en conséquence.
A fortiori peut-on en dire autant de Tabelbalet qui est beaucoup plus éloigné, et sur lequel nos renseignements sont très lacunaires.
On sait que l’oasis contient trois ksars, et qu’elle est importante ; qu’il y existe une petite zaouia.
On se rend assez bien compte des conditions de la culture. La nappe d’eau est à fleur de sol, dans les hauts de cet oued Tabelbalet, qu’on suit tout le long de l’erg er Raoui.
A Ougarta, où la prononciation a chance d’être plus correcte qu’à Beni Abbès, on prononce Belbala, par suppression des T initial et final — de même qu’on dit indifféremment au lieu de Tafilalet,[216] Tafilala, d’où on tire l’adjectif filali. Et que les noms d’origine berbère soient restés ainsi un mot vivant, séparable en ses éléments grammaticaux, on serait tenté de croire que cela suppose chez les indigènes une familiarité avec la grammaire berbère.
Pourtant on vient d’apprendre, d’une façon incontestable, que l’idiome propre de Tabelbalet est entièrement original, il n’est ni arabe ni berbère ! L’assertion est tellement extraordinaire qu’on se hâte de la placer sous la haute autorité de M. R. Basset. L’éminent arabisant et berbérisant a entre les mains un vocabulaire de Tabelbalet, recueilli par un officier. Il n’a pas encore eu le temps d’en faire une étude détaillée ; mais il croit avoir affaire à un sabir où les mots sonr’aï sont particulièrement nombreux. Cet îlot de langue soudanaise à proximité du Maroc est inattendu, quoiqu’on ait déjà signalé au Touat un sabir analogue. Il semble, il est vrai, que Tabelbalet, aujourd’hui en pleine décadence, ait été un grand marché d’esclaves ou un relais important de négrier. Il jalonne aujourd’hui, comme point stratégique important, la route du Tafilalet au Touat celle des rezzous et des harkas. L’oasis est d’ailleurs sous le patronage des Aït R’ebbach. Les bandes de Beraber qui à différentes reprises sont venues nous inquiéter aux oasis y ont toutes fait étape ; depuis la première qui a donné l’assaut à Timmimoun jusqu’à la dernière, qui a enlevé les chameaux au pâturage d’Haci R’zel et qui a été surprise au retour par le maghzen de Beni Abbès à Noukhila, dans l’oued Tabelbalet. Nous hésitons à fermer aux razzias cette porte d’entrée en occupant l’oasis, parce que si près du Tafilalet on craint apparemment d’être entraîné plus loin qu’on ne le voudrait ; et ici donc, sur un petit point, nous saisissons sur le fait ce que les frontières entre pays organisés et pays barbares ont de nécessairement phagédéniques.
Les précieuses notes manuscrites, au poste de Beni Abbès, ne contiennent pas d’étude sur l’organisation politique et municipale.
On se rend compte seulement que les ksars ont une organisation démocratique, la djemaa y concentre l’autorité. Chez les nomades au contraire, et dans les zaouias, la plus grande part d’autorité revient en pratique à des familles ou à des personnages influents.
Les notes manuscrites nous apprennent qu’il y a dans chaque ksar un impôt et un seul ; celui qui doit permettre de subvenir aux besoins des hôtes et des pauvres. Dans ce but tout individu valide doit fournir une guessaa d’orge et quelques poignées de blé ; les propriétaires de palmiers doivent une mesure déterminée de dattes par groupes de cent palmiers (cette unité d’imposition — les cent[217] palmiers — porte le nom de mezrag). Il y a dans chaque ksar une chambre commune où on emmagasine le produit de cet impôt en nature pour y puiser le jour du besoin.
Auprès du ksar de Zeramra se dresse un tombeau de saint, aux murailles duquel sont accotés des fagots. C’est la provision de bois individuelle des habitants ; chacun y dépose la sienne parce qu’elle y est en parfaite sécurité ; nul n’oserait en dérober un brin ; elle est protégée efficacement par la crainte de ce saint particulier ; car ce ne sont pas tous les saints en général qui ont le privilège de veiller sur le bois à brûler. (Voir pl. XXXVI, phot. 67 et 68.)
Voilà donc un pays où la police est exercée par un tombeau, et où le seul service public organisé est celui de l’assistance publique. Ce sont deux détails charmants et touchants, et qui évoquent une Salente. Si d’une vieille société défunte, dans quelques lignes de fastes dépareillés, ces deux seules institutions avaient survécu, et qu’on voulût à l’aide de ces fossiles uniques reconstituer tout le corps social, on serait conduit à imaginer un peuple idéalement doux et heureux, incarnation d’un rêve philanthropique. Elles font partie intégrante de la société la plus violente et la plus misérable qui soit.
A Ougarta, les ksouriens invités à augmenter le débit de leurs sources par un récurage facile, et dont ils reconnaissaient l’urgence, suppliaient qu’on leur en donnât l’ordre, dût-on même n’en pas surveiller l’exécution ; n’y ayant pas chez eux d’autorité d’où pût émaner cette chose qui nous paraît si simple, un ordre administratif. Curieux exemple d’imbécillité, d’aboulie sociale.
Les notes manuscrites donnent de curieux détails sur l’irrigation à Beni Abbès, c’est-à-dire sur l’organisation de ce qui est la base unique de la vie économique.
La grande source a un débit de 15 à 18 litres à la seconde ; il faut y ajouter le débit, insignifiant il est vrai, de neuf petites foggaras.
Cette masse d’eau est divisée en 41 parts, chacune d’un jour ou d’une nuit. Ce nombre étant impair, ceux qui à la première tournée ont eu l’eau de jour se trouvent à la seconde l’avoir de nuit et vice versa.
Chaque part d’arrosage (journée ou nuit) est divisée en cinq redjala (pluriel de radjel). — Et chaque radjel est divisé lui-même en soixante habbas.
Prix courant du radjel : 200 francs ; de la habba : 3 fr. 33.
Il existe un répartiteur, qui s’appelle habbar, et qui est établi près de la mosquée. Il mesure le temps au moyen du vase de cuivre percé d’un trou qui est d’un usage courant à Figuig et ailleurs sous le[218] nom de karrouba, et qui porte ici le nom de tsirira, un sablier d’eau, à cela près que l’eau entre goutte à goutte dans le récipient tandis que le sable fuit grain à grain de notre sablier. La tsirira est un bateau troué qu’on fait flotter sur un baquet et qui coule en un temps donné. En été on compte 18 tsirira de jour et 13 de nuit. En hiver c’est l’inverse. La tsirira s’emplit donc 31 fois en vingt-quatre heures, ce qui fait l’unité de temps équivalente à 46 minutes 27 secondes.
Le répartiteur chargé de la tsirira réunit par la partie supérieure autant de feuilles de palmier qu’il y a de propriétaires ayant droit à l’eau dans la journée ou dans la nuit, et à chaque tsirira il fait un nœud à une feuille. Dès qu’il y a à la feuille autant de nœuds qu’il revient de tsiriras au propriétaire, le successeur de celui-ci, qui assiste à l’opération, sort en courant du ksar et crie à son métayer ou à son esclave, posté dans le jardin, d’y mettre l’eau.
La plus grande latitude est laissée aux propriétaires pour se céder la totalité ou une partie de leur eau, ou pour changer de tour de répartition.
La source étant située à quinze cents mètres environ de Beni Abbès l’eau est amenée au moyen d’une séguia (canal à ciel ouvert). La séguia vient-elle à se rompre hommes et femmes se précipitent pour le réparer sur l’ordre de la djemaa. S’il y a dépense on la répartit au prorata des droits de chacun.
Dans l’organisation vermoulue des oasis, la réglementation traditionnelle de l’irrigation est apparemment ce qu’il y a de plus solide et de plus respecté.
D’après Demontès[159] on a recensé dans l’annexe de Beni Abbès 6469 habitants. Toute cette population parle arabe, exclusivement, à partir de Beni Abbès, encore bien que les noms des ksars attestent un vieux fonds berbère (Tametert, Timr’arin, etc.). Le long de l’oued quand on vient du nord Mazzer est le dernier ksar où le berbère se soit conservé.
[138]Flamand, Aperçu général sur la géologie, etc., du bassin de l’oued Saoura. Extrait des Documents pour servir à l’étude du Nord-Ouest Africain, par Lamartinière et Lacroix, p. 37, etc.
[139]Voir carte Prudhomme. La montagne de sel a été vue, je crois, par M. le capitaine Dinaux.
[140]Notons cependant l’existence, dans le laboratoire de géologie de la Sorbonne, de clyménies envoyées par M. le lieutenant Bavière ; elles proviennent, sauf erreur peu vraisemblable d’étiquette, de deux points appelés Bou Maoud et Dkhissa, qu’on trouvera sur la carte à l’intérieur de la chaîne. La présence en ces deux points du dévonien supérieur est donc à peu près certaine. Ces clyménies, d’après M. Haug, n’appartiennent pas au même étage que celles de Beni Abbès. Il est évident que la chaîne d’Ougarta apparaîtra beaucoup moins simple à mesure qu’on la connaîtra mieux.
[141]Est-ce un mot berbère ? faut-il le rapprocher du mot arabe qui signifie noir ? la chaîne noire de Tabelbalet ? la première hypothèse est de beaucoup la plus vraisemblable.
[142]A proximité de Beni Abbès, il y a là une question assez simple qui pourrait tenter un officier du poste.
[143]M. le lieutenant Bavière a envoyé à la Sorbonne des clyménies qui proviennent, sauf erreur, d’Ougarta et de Zeramra. La présence en ces points du dévonien supérieur n’a certainement rien de surprenant. Mais ces gisements de clyménies, que je n’ai pas vus, sont nécessairement distincts des gisements à orthocères. Les schistes marneux et les calcaires dans la sebkha d’Ougarta me paraissent au contraire très susceptibles, d’après le facies, de contenir des clyménies, quoique je n’en ai pas trouvé une seule.
[144]Voir Ém. Haug, Sur deux horizons à Céphalopodes du Dévonien supérieur dans le Sahara Oranais (C. R. Ac. Sc., 6 juillet 1903).
[145]Haci Touil signifie « le puits profond ».
[146]Voir appendice VII (analyse du minerai).
[147]Voir appendice III.
[148]Notes manuscrites qui m’ont été communiquées au poste de Beni Abbès par M. le capitaine Martin.
[149]Communication orale du Père de Foucault, le célèbre voyageur au Maroc.
[150]On sait que Nazaréen est la traduction littérale de Nsara.
[151]Faidherbe, Langues sénégalaises, wolof, arabe, hassania, etc. Paris, 1887.
[152]Les Touaregs du Niger portent ce nom de Gourdana ; ce sont, je crois, les nègres qui le leur donnent en langue Sonr’aï. Y a-t-il là autre chose qu’une simple coïncidence ?
[153]Bulletin du Comité de l’Afrique française, supplément du 15 janvier 1905.
[154]Voir là-dessus : Doutté, La Géographie, 1903, I, p. 185 et suiv.
[155]Depont et Coppollani, Les Confréries religieuses musulmanes, p. 501.
[156]Bulletin de la Société de Géographie d’Alger, 1904, p. 331.
[157]De Foucault mentionne un usage analogue. « La debiha est l’acte par lequel on se place sous la protection perpétuelle d’un homme ou d’une tribu. Cette expression a pour origine l’ancien usage, qui n’est suivi aujourd’hui qu’en circonstances graves, d’immoler un mouton sur le seuil de l’homme à qui on demande son patronage. » (De Foucault, p. 130 ; voir aussi Bulletin du Comité de l’Afr. fr., suppl. de janvier 1905, p. 20.)
[158]Communication orale du capitaine Martin, commandant l’annexe de Beni Abbès, jadis officier de bureau arabe chez les Trafi. On trouvera d’ailleurs l’idée développée dans : Bernard et Lacroix, Évolution du Nomadisme.
[159]Bulletin du Comité de l’Afrique française, janvier 1903, p. 12.
[219]CHAPITRE VI
GOURARA ET TOUAT[160]
Le Touat, le Gourara et le Tidikelt forment un complexe d’oasis, dont l’unité géographique est incontestable, et qui pourtant n’a pas d’appellation commune. Il en a bien une dans l’usage courant, il est vrai, celle de Touat ; mais on ne peut pas s’en contenter, puisque le nom de Touat, dans son sens restreint et précis, le seul adéquat, s’applique seulement à une des trois provinces.
M. Flamand a cherché a combler cette lacune d’onomastique avec le néologisme improvisé d’archipel Touatien du Sahara.
Le Touat (lato sensu), et l’on pourrait dire aussi « le groupe occidental » s’oppose au groupe oriental d’Ouargla. L’un se rapporte à l’oued Igargar, et l’autre à l’oued Messaoud : l’un a des puits artésiens et l’autre des foggaras. Les oasis du groupe Touatien, d’ailleurs, se continuent toutes les unes les autres en « rue de palmiers », vivant dans une certaine mesure d’une vie commune. A quelques restrictions près, elles s’abreuvent à la même nappe d’eau, celle qui sourd à la base du Tadmaït dans les grès Albiens ; toutes les oasis en effet depuis el Goléa jusqu’à In Salah, en passant par Timmimoun et Adr’ar, jalonnent fidèlement en un immense demi-cercle le pied de la falaise terminale du Tadmaït.
Cela n’empêche pas que les trois provinces ont un nom et une individualité distincts. Le Tidikelt en particulier doit être étudié à part pour des raisons à la fois géologiques et ethnographiques. Le Touat et le Gourara, en revanche, se pénètrent assez mutuellement pour qu’il y ait intérêt à les rapprocher dans une étude commune.
[220]Géologie du Gourara.
Le Gourara, comme la Saoura, et d’ailleurs comme le Touat, est essentiellement une pénéplaine primaire, entrevue à travers les déchirures d’un placage horizontal de terrains plus récents. Ces derniers sont crétacés et mio-pliocènes.
Terrains crétacés. — Les terrains crétacés du Gourara sont bien et anciennement connus. Leur âge est déterminé par les fossiles abondants d’el Goléa ; on retrouve ces fossiles d’ailleurs tout le long de la grande falaise calcaire, qui borde le Gourara au sud et que les indigènes appellent le Baten ; cette falaise est le dernier ou, si l’on préfère, le premier étage des plateaux calcaires du Tadmaït ; elle est turonienne.
Ces calcaires turoniens reposent directement et en concordance sur des marnes ou des argiles gypseuses (cénomaniennes ?), qui reposent elles-mêmes sur des grès à sphéroïdes. Cette formation ne contient d’autres fossiles que des arbres silicifiés en abondance ; il n’a jamais été fait une étude quelconque de ces fossiles végétaux ; mais les grès à sphéroïdes, autrement dits à dragées, contenant des arbres silicifiés, sont bien connus dans le sud de l’Algérie.
On les a signalés à Beni Ounif, ils sont très développés dans la chaîne des Ksour, au djebel Amour, à Djelfa, où ils ont été bien étudiés par Ritter, et où ils sont incontestablement d’âge albien[161]. La parité de facies n’implique pas nécessairement celle de l’âge : notons pourtant que partout, au Grouz, à Djelfa, au Gourara, la succession et la puissance des trois étages est la même : grès albiens, argiles gypseuses cénomaniennes (?), calcaires turoniens, avec une puissance totale de 100 à 150 mètres. Sur la route suivie par la mission Foureau, au Djoua, une formation gréseuse et argileuse à lits de gypse a livré des ossements fossiles de poissons ; M. Haug lui attribue un âge albien et un caractère lagunaire[162].
L’attribution de nos grès à l’albien reste pourtant incertaine ; cette formation dépourvue de fossiles marins, et qui renferme en revanche de gros troncs d’arbres, est probablement continentale ; l’uniformité[221] du facies est assez remarquable, elle n’est pas absolue pourtant, il y a des intercalations argileuses, des poudingues d’un type très aberrant (falaises de Taourirt par exemple) ; cette formation peut représenter des dépôts continentaux d’âges très divers.
Dans l’Atlas les grès albiens ne sont pas le moins du monde le terme inférieur de la série crétacée. Ils reposent sur des assises infra-crétacées à fossiles marins, calcaires urgo-aptiens, grès et calcaires néocomiens. Ces étages font certainement défaut au Gourara et dans tout le Sahara ; partout où le contact est visible, c’est-à-dire en un grand nombre de points, on constate que les grès albiens reposent directement sur le substratum primaire. Ici donc comme à Colomb-Béchar nous constatons la transgression cénomanienne.
Tertiaire. — Nous retrouvons ici le Mio-Pliocène (?) avec ses caractéristiques habituelles (base plus ou moins sableuse et chapeau calcaire). Il joue vraisemblablement un rôle important dans le Gourara septentrional, que je n’ai pas vu (les oasis éparses dans l’erg au nord de la sebkha). Depuis Ksabi on le suit jusqu’à Charouin, en ce dernier point il est couronné par une croûte calcaire épaisse d’un mètre, au-dessous de laquelle on distingue dans la falaise (très masquée d’éboulis) une formation gréso-argileuse en feuillets minces, très chargée de gypse.
Là se place la limite méridionale du Mio-Pliocène, au sud de la sebkha on ne le revoit plus, sauf en lambeaux insignifiants ; on ne le retrouvera plus, en tant que grande formation continue et puissante, ni au Touat, ni au Tidikelt, ni au Sahara central. Ces couches, bien caractérisées en somme, que nous avons appelées mio-pliocènes (terrain saharien de Pomel, terrain des gour de Flamand), restent collées à l’Atlas, elles représentent manifestement l’amas de ses déjections, depuis qu’il a commencé à surgir, à l’époque oligocène.
Et il va sans dire qu’on retrouve ailleurs, dans tout le Sahara, des dépôts continentaux susceptibles d’être fort anciens, tertiaires, mais ils sont extrêmement loin d’avoir cette masse énorme, et cette uniformité de facies, qui donnent au Mio-Pliocène subatlique une sorte d’individualité.
Le Gourara est une région déprimée, le point le plus bas entre l’Atlas au nord et le Tadmaït au sud. — C’est la cuvette allongée, ouverte à l’ouest, vers laquelle convergaient tous les oueds quaternaires de l’Atlas (oued Namous, oued R’arbi) et du Tadmaït (oued Aflissès). Il y a apparence que ces oueds, venus de tous les points de l’horizon, se réunissaient ici en une grande artère, affluent de la[222] Saoura. Il est certain, en tout cas, qu’on les voit se réunir dans la sebkha de Timimoun, étirée vers le S.-O. sur 80 kilomètres de long.
L’érosion de ce grand réseau a largement mis à nu le sol de la pénéplaine primaire.
Il court une large bande primaire, somme toute, entre les palmeraies du nord qui doivent leurs eaux aux couches tertiaires, et les palmeraies du sud qui doivent la leur aux couches crétacées.
Malheureusement, cette bande primaire est souvent voilée par des dunes, des dépôts quaternaires, des témoins tertiaires ou crétacés ; et par surcroît, là même où elle affleure elle est bien loin d’avoir été étudiée d’une façon suffisante.
La série des étages primaires semble très complète depuis le Dévonien.
Dévonien inférieur. — Du Dévonien inférieur on n’a pas rapporté de fossiles. Mais on a de bonnes raisons stratigraphiques pour rapporter à cet étage les grès blancs à patine noire dont le facies rappelle ceux d’Ougarta et du Mouidir.
Dans la région qui nous occupe, ces grès ne tiennent plus qu’une place subordonnée. Au delà de Foum el Kheneg, la chaîne d’Ougarta se continue par des débris ennoyés. A Ksabi, les grès éodévoniens ne constituent plus qu’une arête de 500 mètres d’épaisseur et de 50 mètres de relief.
Entre Ksabi et Timimoum on revoit les grès éodévoniens une première fois à la Gara Zaleg (et au sud de cette Gara), une seconde fois à mi-chemin entre Tesfaout et Timimoun.
Ces deux fois l’Éodévonien affleure au cœur d’un anticlinal hercynien.
En somme, l’Éodévonien ne s’étale plus largement, il est masqué presque partout par des couches moins anciennes.
Dévonien moyen. — La présence du Dévonien moyen est constatée authentiquement dans la région étudiée. Il est représenté par des calcaires amarantes qui contiennent de nombreux fossiles, entre autres Calceola sandalina.
Les premiers échantillons rapportés par M. le commandant Laquières ont été recueillis « à trois heures de marche avant d’arriver à Charouïn par le sud (route des Ouled Rached), dans un fond pierreux de 3 kilomètres de largeur[163] ». Mes propres échantillons[223] proviennent d’un point voisin, mais que je ne crois pas rigoureusement identique ; j’y reviendrai.
Sur la route entre Fgagira et Charouïn (à 10 kilomètres du premier point) on rencontre d’autres calcaires amarantes, d’aspect analogue à ceux dont il vient d’être question. Ils ne contiennent pas à ma connaissance Calceola sandalina ; je n’y ai trouvé que des Orthocères indéterminables et des Zaphrentis. Leur position stratigraphique permet de croire qu’ils représentent un autre affleurement de Dévonien moyen.
Dévonien supérieur. — On connaît dans la région considérée au moins deux gisements du Dévonien supérieur. — A Fgagira, les fossiles se trouvent dans des calcaires en bancs minces intercalés dans des bancs d’argiles beaucoup plus puissants.
Au sud de Charouïn, route d’Ouled Rached, la formation est constituée à la base par du calcaire violacé très compact, et au-dessus par des schistes mous en minces feuillets rougeâtres.
Les deux gisements ne sont pas contemporains ; tous deux sont du Dévonien supérieur, mais celui de Charouïn représente « un niveau incontestablement plus élevé ». « Le niveau est probablement le même qu’à Beni Abbès » et l’aspect pétrographique du gisement présente en effet de l’analogie (malgré l’énorme distance entre les deux).
Charouïn représente l’étage à Clyménies et Fgagira la « zone à Gephyroceras intumescens ». Ce sont « deux niveaux fossilifères du Dévonien supérieur, nettement dessinés par des faunes riches et caractéristiques. Leurs affinités paléontologiques avec les couches du même âge de l’Allemagne centrale sont tout à fait remarquables et accentuent encore le caractère « hercynien » ou mieux « armorico-varisque » des chaînes paléozoïques du Sahara septentrional[164] ».
Les Ktoub. — Ces formations du Dévonien moyen et supérieur tiennent en superficie un espace bien restreint. La roche la plus répandue de beaucoup est malheureusement d’un âge difficile à préciser.
Ce sont des schistes feuilletés passant à des grès en plaquettes, de couleur sombre, dans les tons violet noir. Les indigènes les appellent ktoub (feuillets de livre) et les redoutent pour les pieds de leurs chameaux, que les ktoub sont susceptibles de couper comme au couteau.
[224]Ces schistes ne sont pas tout à fait dépourvus de fossiles. Sur la route de Tesfaout à Timimoun, à quinze kilomètres environ de ce dernier point (rive occidentale de la Sebkha), j’ai trouvé dans les schistes, à proximité d’une lentille calcaire, un Céphalopode que M. Henri Douvillé et M. Haug ont vu et qui est une goniatite indéterminée.
Sur la rive orientale de la sebkha (route de Timimoun à Deldoul), le commandant Deleuze a recueilli des échantillons de grès en plaquettes, couverts de Leptæna (M. Haug ne croit pas pouvoir préciser l’étage).
Enfin, M. Chudeau a recueilli quelques fossiles, qui ne sont pas encore parvenus en Europe.
Tout cela n’est pas concluant, je crois.
D’autre part, à Fgagira, on voit les ktoub reposer directement, et, à ce qu’il semble en concordance sur les couches à Gephyroceras. Dans la sebkha de Timimoun (comme aussi au Touat), on voit aussi le calcaire carboniférien reposer directement sur les ktoub. Et ceci permettrait de conclure assez légitimement à l’âge dévonien supérieur des Ktoub.
Pourtant, dans le gisement dévonien moyen (ou présumé tel), à 10 kilomètres est de Fgagira, des ktoub bien nets sont intercalés entre les bancs calcaires. D’autre part le Silurien supérieur au Sahara, on le verra, est probablement représenté par des ktoub à graptolites. Il semble donc que cette formation, quoique d’aspect assez homogène, ne soit pas nécessairement synchronique.
Comme il faut conclure, on a attribué les ktoub, sur la carte, au Dévonien supérieur, partout où il y avait doute sur leur âge. Mais naturellement la question reste entière.
Ajoutons, pour être complets, qu’un forage pratiqué dans la palmeraie de l’Aouguerout a ramené au jour, d’une faible profondeur (une dizaine de mètres)[165] un fossile, que M. Chudeau croit dévonien, sans pouvoir préciser l’étage.
Carbonifère. — Des calcaires carbonifères riches en fossiles se montrent dans le nord du Gourara, à la lisière des dunes.
Sur la route de Ksabi à Charouïn par H. Mallem, à 20 kilomètres de Ksabi, le sentier traverse des calcaires bleu sombre et amarante, fossilifères, plongeant légèrement à l’est. M. Haug les croit carbonifériens.
[225]C’est dans l’angle nord-est de la sebkha de Timimoun que le Carboniférien est le plus largement étalé.
Dans la sebkha même, exactement à la hauteur de Timimoun, on voit reposer sur les ktoub, d’abord des calcaires bleus fossilifères, puis des marnes contenant beaucoup de fossiles libres.
Dans l’erg au nord de la sebkha, à Tala, Kali, Ouled Saïd, el Hadj Guelman on retrouve le calcaire bleu fossilifère à Productus.
A noter que le Carboniférien peut être aussi développé au sud de la sebkha qu’au nord.
En effet à Timimoun même, au-dessous du ksar, et par conséquent au sud de la Sebkha, on voit le Carboniférien s’enfoncer sous le Crétacé.
L’allure des plissements hercyniens. — Ces formations primaires sont affectées de plis hercyniens sur la direction desquels on a le droit d’être assez affirmatif.
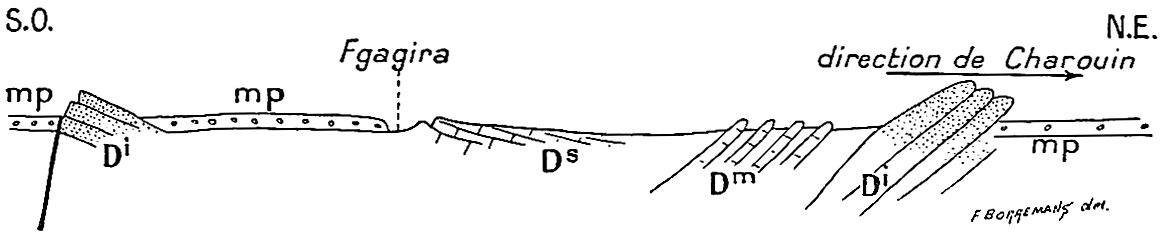
Fig. 42. — Coupe du synclinal de Fgagira. — Échelle : 1/300000.
(Bull. Soc. géol. Fr., 4e série, t. VI, p. 751, fig. 12.)
Synclinal de Fgagira. — Les dépôts de Fgagira (fig. 42) forment manifestement un synclinal dont l’épaulement sud-occidental est formé par les derniers débris de la chaîne d’Ougarta, au delà de Foum el Kheneg — les trois étages dévoniens sont représentés — l’orientation du pli est N.-O.-S.-E.
Synclinal au sud de Charouïn. — Les dépôts au sud de Charouïn forment un autre synclinal (fig. 43). J’y ai observé des couches du Dévonien moyen et d’autres du Dévonien supérieur. Les calcaires amarantes à Calceola sandalina que j’ai vus constituent l’épaulement du synclinal du côté de Charouïn, ils plongent énergiquement au sud-ouest. Si j’ai bien compris les explications qui m’ont été données, les fossiles Laquière provenaient de l’épaulement opposé (côté d’Ouled Rached) que je n’ai pas vu, mais où le Dévonien moyen serait largement découvert et étalé à l’air libre. Les dépôts dévoniens supérieurs au cœur de l’anticlinal plongent légèrement au N.-E.
Il n’est donc pas douteux que ce synclinal ait à peu près la même orientation que le précédent N.-O.-S.-E.
Les deux coupes ont d’ailleurs un air de parenté. Ce pli ne semble pas symétrique. Les plongées les plus rapides regardent l’ouest.
[226]En somme entre Ksabi et Charouïn les plis hercyniens sont manifestement orientés N.-O.-S.-E.
Bords de la Sebkha. — Ce qui est curieux c’est que plus à l’est la direction est toute différente.
Sur la route la plus orientale et la plus directe de Charouïn à Ouled Rached (fig. 44), celle qui coupe la dune au lieu de la contourner, il est malaisé sans doute de deviner l’allure du Dévonien sous-jacent (précisément à cause des dunes) ; pourtant, j’ai noté au départ de Charouïn, à l’entrée de l’erg, des affleurements orientés S.-O.-O.-N.-E.-E. Nous sommes tout près du synclinal à couches fossilifères, une dizaine de kilomètres peut-être et pourtant dans l’intervalle la direction des plis a obliqué de près de 90°. Dans la sebkha même et sur ses bords l’allure des plis est assez compliquée.
Un pli anticlinal bien marqué, orienté grossièrement est-ouest est transversal au grand axe de la sebkha à peu près en son milieu à la hauteur de Beni Melouk. Aussi bien la sebkha est-elle nettement étranglée en ce point.
Au sud et au nord de ce point les bandes de ktoub sont franchement allongées dans le même sens que le grand axe de la sebkha S.-O.-N.-E. C’est bien net en particulier au pied du ksar de Timimoun où les couches carbonifériennes plongent est 64° sud (154° à partir du nord en comptant par l’est) (fig. 45).
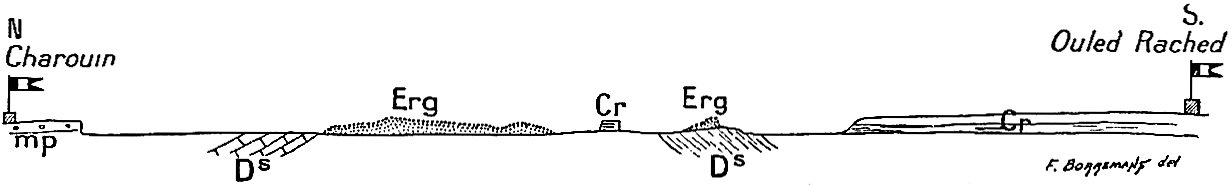
Fig. 44. — Route directe entre Charouïn et O. Rached. — Échelle : 1/400000.
(Bull. Soc. géol. Fr., 4e série, t. VI, p. 752, fig. 14.)
Enfin au nord de la sebkha dans la région de Tala, Kali, el Hadj Guelman, les plis hercyniens ont subi une nouvelle torsion, ils sont orientés franchement N.-S. A Tala les couches plongent à 274° soit sensiblement O. vrai.
Il semble bien qu’on ait le droit de conclure comme suit :
La Gourara est pour les plis hercyniens une zone de rebroussement — à l’ouest de Charouïn ils ont une direction qu’on pourrait[227] appeler armoricaine — sur les bords de la sebkha une direction qu’on pourrait appeler varisque.
Antérieurement, nous avons abouti à des conclusions analogues. Les plis de la Zousfana seraient varisques — ceux d’Ougarta armoricains.
Failles récentes. — Il n’est pas douteux que la topographie actuelle ne doive beaucoup à des failles récentes.
Un examen attentif révélera je crois des diaclases en relation avec la sebkha de Timimoun.
En tout cas les ksars de l’Aouguerout sont bâtis sur une muraille de couches crétacées verticales (argiles et grès), qui se dresse brusquement au milieu des couches voisines horizontales. Il y a là certainement un accident post-crétacé, qui a ramené, on l’a vu, le sous-sol primaire à proximité de la surface, et en amont duquel les foggaras vont capter la nappe d’eau (fig. 52).
La palmeraie d’Ouled Mahmoud est, elle aussi, en relation avec des diaclases qui ont amené dans le crétacé la formation d’une cuvette synclinale[166]. Aussi bien on sait depuis longtemps que les couches crétacées du Sahara sont faillées.
Géologie du Touat.
Le Touat est une grande plaine de composition géologique très complexe. L’horizontalité en est due à des dépôts pour la plupart, je crois, crétacés. A travers les fenêtres de ces dépôts, on peut observer çà et là la pénéplaine hercynienne sous-jacente. Le Dévonien et le Carboniférien sont certainement représentés.
Éodévonien. — A la limite du Touat et du Tidikelt, à Aïn Cheikh, un gisement fossilifère éodévonien est connu depuis quelque temps déjà[167]. Ce sont exactement les mêmes roches et les mêmes fossiles qui existent dans tout l’Ahnet et dans tout le Mouidir.
[228]Au Touat proprement dit, en revanche, je ne connais pas de gisement de fossiles éodévoniens. Mais plusieurs affleurements me semblent devoir être rapportés à cet étage.
Le djebel Heirane est composé presque tout entier de grès fin et dur, à cœur blanc et à patine noire, c’est-à-dire d’une roche que nous sommes habitués à considérer comme caractéristique de l’Éodévonien.
Ces mêmes grès, ou du moins, des grès d’aspect tout à fait analogue, se retrouvent à 20 kilomètres nord-est de Haci Sefiat sur la route de Tesfaout.
Dévonien moyen. — Dans toute l’étendue du Touat, y compris le gisement d’Aïn Cheikh, je ne connais pas de fossiles mésodévoniens.
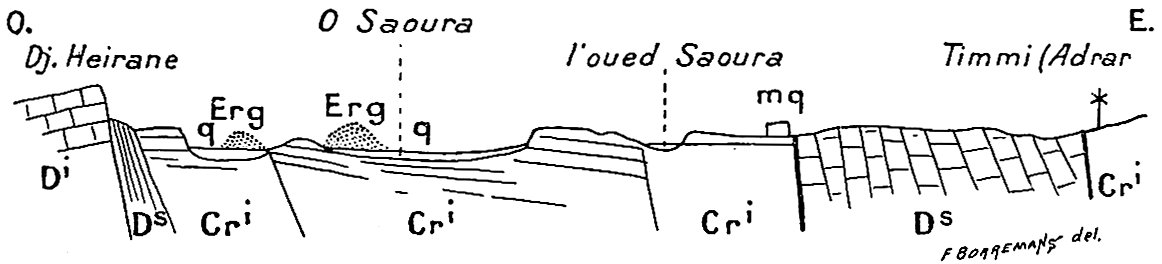
Fig. 46. — Coupe du Timmi au dj. Heirane. — Échelle : 1/600000.
Cri, Crétacé inférieur.
(Bull. Soc. géol. Fr., 4e série, t. VI, p. 754, fig. 16.)
Les Ktoub. — Au Touat comme au Gourara un rôle relativement considérable est joué en surface par des schistes durs, fissiles, pour lesquels nous avons adopté la dénomination indigène de ktoub. Immédiatement à l’ouest du Timmi, en particulier, s’étend un lambeau important de ces roches. Elles ont tout à fait l’aspect des ktoub du Gourara. Je n’y ai cependant pas trouvé un seul fossile, malgré des recherches que le voisinage d’Adrar rendait faciles. En revanche, j’ai constaté à l’ouest de Temassekh la superposition en concordance à ce qu’il semble de Carboniférien fossilifère incontestable sur les ktoub comme à Timimoun. Au même point une lentille calcaire dans les ktoub. Il paraît donc possible, sous bénéfice d’inventaire, de les considérer provisoirement comme supradévoniens (fig. 47).
Notons pourtant que M. Mussel attribue aux ktoub du Timmi un âge silurien, parce qu’il les trouve identiques à ceux de l’Iguidi[168], ce qui est une constatation intéressante. En l’absence de fossiles toutes les attributions sont possibles et indifférentes ; tous les schistes noirs se ressemblent ; ceux du Gourara, qui contiennent des fossiles dévoniens,[229] ne m’ont pas paru différents des schistes alunifères siluriens (?) d’Aïn Chebbi. Ceux du Timmi restent certainement indéterminés.
Carboniférien. — On trouve au Touat un grand nombre de gisements fossilifères carbonifériens. Aïn Cheikh mis à part, l’étage carboniférien paraît ici le seul fossilifère ; en revanche il l’est abondamment.
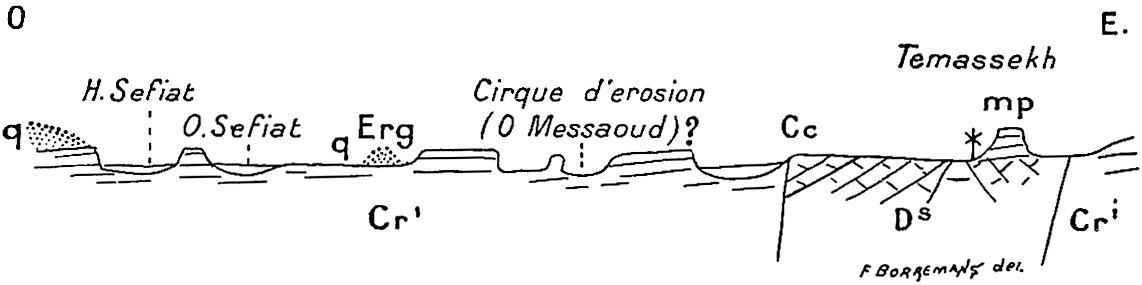
Fig. 47. — Coupe de Temassekh à Haci Sefiat. — Échelle : 1/600000.
(Bull. Soc. géol. Fr., 4e série, t. VI, p. 755, fig. 17.)
Voici l’ordre des gisements en allant du nord au sud.
a) A une douzaine de kilomètres dans l’ouest de Temassekh (fig. 47) ; c’est le point où on voit le Carboniférien reposer sur les ktoub. En venant de l’ouest on rencontre d’abord un banc de calcaire blanc puis un autre de calcaire jaunâtre fossilifère peu cohérent, puis un autre de calcaire amarante très fossilifère. Ces bancs sont séparés par des couches de marne ou d’argile.
b) Tazoult. — A côté du ksar de Tazoult, un tout petit pointement — à la base calcaire bleu massif, au-dessus grès en plaquettes. Au sommet alternance en bancs minces de calcaires noir et blanc, puis calcaire massif (fig. 48). — (Notons un affleurement d’ophite). Le facies rappelle les calcaires carbonifères du nord, ceux d’Igli.
c) Aïn Cheikh. — A l’ouest de la source, des couches calcaires peu épaisses dans des marnes ou des argiles puissantes. Fossiles superbes libres dans les marnes.
d) A l’est d’Hacian Taïbin couches fossilifères que M. Chudeau analyse comme suit :
1o A la base : grès en bancs minces, avec quelques intercalations d’argile et de calcaire.
2o Grès brunâtre, en bancs épais de 1 à 2 mètres ; plongée 45°.
3o Calcaire à fossiles siliceux.
[230]4o Calcaire bleu foncé en bancs de 30 centimètres à 1 mètre ; plongée 45° ; débris de Productus.
e) Très loin dans l’ouest, au coude de l’oued Messaoud, avant Haci Rezegallah, des calcaires compacts pétris de fossiles ; les mêmes calcaires apparaissent le long de l’oued Messaoud, plus au nord ; ces calcaires reposent en corniche sur des argiles ou des marnes, et grâce à cette circonstance l’oued s’y est encaissé profondément.
Tous ces gisements donnent les mêmes fossiles, dinantiens d’après M. Haug.
Plissements hercyniens. — Au point de vue stratigraphique le gisement de Rezegallah est tout à fait à part ; je n’y ai vu que des couches horizontales ; et, sous réserve, puisque l’étendue des couches observées est assez restreinte, je suis tenté de croire que nous sommes ici en dehors du domaine des plissements hercyniens. Leur limite occidentale passerait donc quelque part entre Hacian Taïbin et Haci Boura.
Le petit affleurement éodévonien auprès de Haci Sefiat est lui aussi sensiblement horizontal, de même que les couches gréseuses de même facies qui constituent le djebel Heirane. Au pied du djebel Heirane à l’est on voit des ktoub, supposés néo-dévoniens (?), verticalement redressés, en contact évidemment anormal avec les grès éodévoniens (miroirs de faille).
Sous bénéfice d’inventaire je croirais que cette faille court du djebel Heirane à Haci Boura (autrement dit Rezegallah), et qu’elle délimite les domaines hercyniens et calédoniens.
Le Vorland occidental du Touat, erg d’Iguidi, région de Taoudéni, reste encore très peu connu ; pourtant outre les documents de Lenz, nous disposons maintenant de ceux qui ont été recueillis par le capitaine Flye Sainte-Marie, par le lieutenant-colonel Laperrine et par leur compagnon le lieutenant Mussel.
Il semble incontestable que toute la grande région des Eglab, au cœur du fer à cheval des dunes de l’Iguidi, est un massif archéen ou éruptif complètement en dehors de la zone des plissements hercyniens.
M. Mussel[169], au voisinage de Taoudéni, Lenz auprès de Tindouf, ont vu le Carboniférien horizontal sur d’immenses étendues. Tout se passe donc, en tout cas, comme si la limite occidentale des plissements hercyniens passait tout près du Touat à l’ouest et tout près de[231] la chaîne d’Ougarta au sud-ouest[170] à l’est de la ligne Dj. Heirane-H. Boura tous les affleurements primaires du Touat sont nettement plissés.
A la limite du Touat et du Tidikelt, entre djebel Aberraz et Aïn Cheikh, court un pli hercynien, dont l’axe est éodévonien ; c’est un pli énergique, uniformément déversé vers l’est, sa direction est nord-sud. On en fera au chapitre suivant une étude plus détaillée.
On ne peut pas être aussi précis au sujet des autres plis hercyniens du Touat ; on les devine plutôt qu’on ne les voit, encore que leur existence soit incontestable. Le Carboniférien de Tazoult forme un dôme anticlinal bien net, fermé au sud et brusquement interrompu au nord par une cassure.
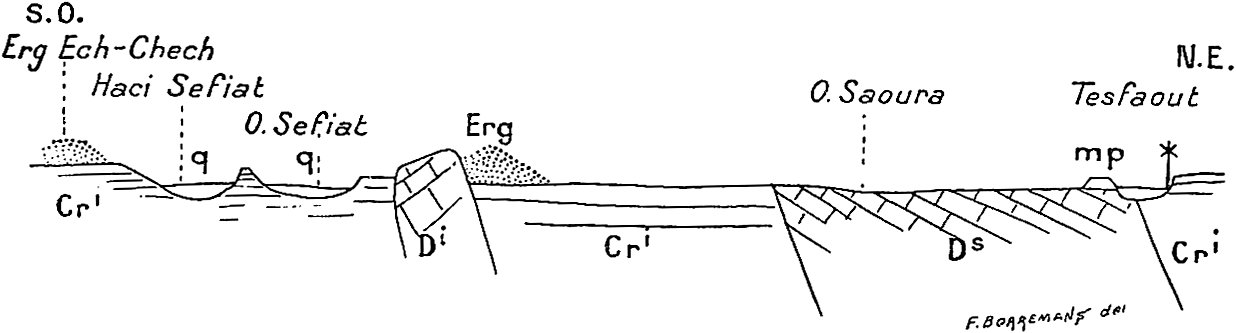
Fig. 49. — Coupe de Tesfaout à Haci Sefiat. — Échelle : 1/600000.
q, Quaternaire.
(Bull. Soc. géol. Fr., 4e série, t. VI, p. 758, fig. 20.)
A l’ouest de Temassekh, les couches primaires (carbonifériennes et supradévoniennes) plongent à l’ouest, mais avec un pendage de plus en plus accusé à mesure qu’on s’approche de Temassekh ; elles finissent par être tout à fait verticales. La direction du pli est N.-N.-O.-S.-S.-E., faisant un angle d’une vingtaine de degrés avec la ligne nord-sud. Il semblerait naturel d’admettre que ce tronçon de pli, à en juger par sa direction et sa proximité topographique, est la continuation de celui qu’on a vu s’amorcer à Tazoult.
A Tesfaout l’affleurement primaire (ktoub supradévoniens ?) est composé de couches qui plongent vers l’est. La direction du pli est N.-N.-O.-S.-S.-E. (angle de 28° avec nord-sud).
Au Timmi, à l’ouest de la Sebkha, autre affleurement très étendu de ktoub supradévoniens. Les couches sont redressées au voisinage de la verticale, elles m’ont paru pourtant avoir une tendance à plonger vers l’est. La direction du plissement est N.-N.-O.-S.-S.-E. (angle de 22° avec nord-sud).
[232]Tout cela en somme est bien fragmentaire. Il semble pourtant qu’on puisse risquer la conclusion suivante.
Au large du Touat les couches primaires sont affectées de plissements hercyniens dirigés N.-N.-O.-S.-S.-E. Et c’est d’ailleurs une direction qu’on retrouve bien nette, avec une inflexion plus marquée vers l’ouest, dans la chaîne d’Ougarta.
En somme, sur toute la distance entre le Tidikelt et l’Atlas, la virgation de la chaîne hercynienne apparaît nettement. Franchement nord-sud au Tidikelt la direction des plis s’infléchit progressivement jusqu’à N.-O.-S.-E., d’un côté, tandis que de l’autre on voit apparaître par rebroussement la direction N.-E.-S.-O. (Timimoun, Zousfana) ; à partir du Gourara la structure est en éventail (fig. 50).
Crétacé. — Ce sont les terrains horizontaux d’âge post-primaire qui tiennent au Touat de beaucoup la plus grande place en superficie. On a déjà dit que tout le pays est une immense plaine. Mais l’attribution de ces terrains horizontaux à tel ou tel étage est assez délicate.
A l’est du Touat le problème est simple ; la route d’Adrar à In Salah par Ilatou et Matriouen ne sort pas du Crétacé. Elle traverse le grand plateau calcaire du Tadmaït. Une petite falaise calcaire que l’on franchit une quinzaine de kilomètres avant d’arriver au puits d’Ilatou en marque le début à l’ouest. Sur l’âge de ces calcaires nous sommes renseignés par des gisements fossilifères. Le plus rapproché du Touat, à ma connaissance est celui que j’ai trouvé à Matriouen (rive gauche de l’oued, au pied de la falaise) ; les fossiles identifiés par M. Ficheur sont : Pseudodiadema sp., Natica sp. Ostrea olisiponensis.
Nous sommes donc au même niveau qu’à el Goléa, cénomanien et turonien.
Au Touat comme au Gourara les calcaires massifs reposent sur des argiles gypseuses (cénomaniennes ?) qui reposent elles-mêmes sur les grès albiens. Les bois silicifiés abondent dans ces grès, comme d’habitude : le plus beau gisement est incontestablement celui de Taourirt. On y voit, dans la falaise qui domine le ksar actuel, de gros troncs silicifiés en place, encastrés dans la pierre[171] ; ici d’ailleurs ce n’est plus à proprement parler du grès, c’est un poudingue à gros éléments et ses éléments semblent uniformément primaires ou archéens, les quartz en particulier abondent. Ils ont été évidemment arrachés à une ride primaire quelconque, aujourd’hui arasée et enfouie sous les dépôts crétacés. C’est le seul point à ma connaissance[233] où le grès à dragées prenne un facies aussi net de poudingue et c’est le seul point aussi où les bois silicifiés se présentent sous forme de troncs presque intacts. En général, on ne voit que des fragments à peine plus grands que la main.
La falaise de Taourirt paraît nous présenter une section d’un vieux lit d’oued précénomanien.
Au Touat (au rebours du Gourara), les grès albiens ont été incomplètement débarrassés par l’érosion de leur couverture d’argiles cénomaniennes. Sur la route du Gourara au Touat les argiles apparaissent du côté de Sba et de Guerrara. Les ksars du Timmi et du Boudda sont construits sur des argiles gypseuses, assez gypseuses même pour qu’on puisse au Boudda exploiter le plâtre.
Le grès albien affleure d’ailleurs çà et là (à Meraguen, au Boudda). Aussi n’a-t-on pas osé porter sur la carte géologique ces argiles cénomaniennes, aux contours indécis dans l’état de nos connaissances ; on a fait coïncider la limite du Crétacé moyen avec la base des calcaires turoniens.
A l’ouest du Touat l’attribution des couches horizontales à tel ou tel étage devient plus délicate. On peut affirmer en tout cas qu’elles tiennent une grande place, réduisant les affleurements primaires au rôle de fenêtres. Elles sont de composition assez uniforme, argiles de couleurs vives, rouges et vertes, alternant avec des bancs de grès du type habituel, à dragées et à bois silicifiés.
A la partie supérieure de cette formation on voit quelquefois des argiles gypseuses ; au puits de Sefiat, en particulier, elles constituent les falaises qui entourent le puits. Pourtant le grès a souvent un facies particulier, qui n’est pas celui des grès à dragées, il est spongieux, creusé de cavités, entre lesquelles subsistent des colonnettes filiformes, j’imagine qu’il est calcarifère. A la surface des hammadas il se découpe en buttes ruiniformes qui sont une nouveauté dans le paysage.
Ce grès particulier constitue par exemple toute la hammada d’où émerge le chicotéodévonien du dj. Heirane. On le voit à Haci Boura, à Haci Rezegallah.
Il est vrai que sur la route entre le dj. Heirane et le Bouda j’ai cru observer le passage latéral d’un facies à l’autre.
Nulle part, à ma connaissance, on ne voit réapparaître les calcaires et les marnes fossilifères du Tadmaït, qui permettent dans la région orientale une détermination précise.
Pourtant ces formations horizontales manifestement post-primaires, se distinguent bien nettement des dépôts tertiaires par leur compacité[234] et leur aspect ancien ; localement elles ont été vigoureusement affectées par des failles (fig. 46) ; il est difficile de ne pas les croire prétertiaires. Et après tout leur analogie de facies est évidente avec l’albien du Touat dont il est naturel de croire qu’elles sont ce qu’elles paraissent, un simple prolongement.
Notons que M. Chudeau a vu, au Tegama, une formation qu’il juge analogue aux grès albiens du Touat et contemporaine. MM. Mussel et Cortier signalent au voisinage de Taoudéni des couches de facies analogue. Il est très possible que tous ces affleurements très distants les uns des autres se rejoignent. Tout se passe comme si le Crétacé inférieur, représenté par une formation argileuse et gréseuse à fossiles végétaux, et d’origine continentale ou lagunaire, couvrait d’immenses espaces dans tous les bas-fonds du Sahara, entourant d’une immense auréole les massifs du Hoggar.
Et en tout cas, à l’ouest du Touat, on ne connaît pas encore de limites occidentales à l’extension en surface de cette formation.
Mio-Pliocène. — Il reste à parler des dépôts tertiaires continentaux qui jouent un si grand rôle au nord. Ici leur rôle est très réduit. Çà et là auprès des puits de Sefiat, par exemple, ou du puits d’Hammoudiya, on voit sur le Crétacé un lambeau de croûte calcaire qu’on peut rapporter au Pliocène. Mais on ne rencontre de dépôts assez étendus pour être notés sur une carte schématique qu’au voisinage des oasis.
Il court là, entre Tesfaout et le Sali, une bande mio-pliocène à peu près rectiligne, longue de près de 100 kilomètres, et large uniformément de 3 ou 4 kilomètres à peine ; l’épaisseur est d’une vingtaine de mètres.
A Temassekh la formation, facile à étudier sur la falaise de la gara, est constituée à la base de couches sableuses plus ou moins durcies ; au sommet un chapeau de calcaire et de plâtre (sol de timchent) ; le plâtre est pétri de Cardium edule.
J’ai examiné une grande gara allongée qui s’étend entre Tiouririn et Temassekh, sur toute son étendue elle porte un chapeau de calcaire blanc, à rognons de silex, passant quelquefois au poudingue et dont l’aspect rappelle tout à fait les calcaires pliocènes du nord. Sur toute la ligne des oasis dans les groupes Ouled Si Hamou bel Hadj et Touat el Henna la formation est essentiellement représentée par des couches sableuses, très mêlées de stalactites gréseuses, qui contribuent sans doute à les fixer, et qui attestent la présence d’éléments calcaires. Auprès de Zaouiet Kounta j’ai eu l’occasion d’examiner[235] de plus près la formation. A la base des grès calcarifères coquilliers, au-dessus des travertins très vacuolaires, très spongieux, une dentelle de calcaire dur, pétri d’empreintes de plantes et de coquilles. Les coquilles sont des Melanopsis. C’est dans les travertins que sont creusés plusieurs étages superposés de foggaras.
L’âge récent de la formation est donc attesté non seulement par son facies mais aussi par ses fossiles ; (voir appendice X). Et d’autre part elle est bien loin d’être contemporaine puisque ce dépôt de dépression, fluvial ou lacustre, est aujourd’hui accusé en relief. Dans le nord la bande mio-pliocène a été réduite par l’érosion quaternaire à un chapelet de garas, dans le sud elle a gardé sa continuité, mais elle se présente sous la forme d’une terrasse, adossée à l’est à la falaise secondaire, et se terminant à l’ouest par un à-pic.
Ces dépôts mio-pliocènes, d’un dessin si particulier sur la carte, semblent nous renseigner sur l’hydrographie de la région à l’époque néogène. Manifestement il y a eu là soit un fleuve, soit un chapelet de lacs ou de sebkhas.
Les failles. — La plaine du Touat a été affectée de failles, les coupes ci-jointes en font ressortir un grand nombre, mais sur lesquelles il n’est pas possible, dans l’état de nos connaissances, de donner des détails circonstanciés.
Au contraire on est en mesure d’insister sur la grande faille du Touat, en relation avec la ligne des sebkhas et des palmeraies, le long de laquelle vient affleurer la nappe d’eau souterraine. Cette ligne est régulièrement droite sur 150 kilomètres, et cela seul suffirait à faire soupçonner la faille, dont l’existence d’ailleurs est facile à prouver. Sur une grande partie de son trajet elle amène en surface des tronçons de la pénéplaine hercynienne, et elle est accusée, par un pointement éruptif au moins (Tazoult). A Taourirt le ksar est dominé de plusieurs dizaines de mètres par la falaise des grès albiens, or il est construit sur les argiles gypseuses cénomaniennes (?) ou en tout cas plus jeunes que les grès. Nous sommes donc certains que la faille du Touat a affecté les terrains crétacés.
La bande étroite des dépôts mio-pliocènes est rigoureusement collée à la faille, ce qui ne peut pas être fortuit ; nous avons donc la certitude que dès l’époque néogène la faille du Touat avait, comme aujourd’hui, une importance hydrographique. Mais d’autre part les couches mio-pliocènes sont aujourd’hui accusées en relief sur toute leur étendue, ce qui semble indiquer que la faille a rejoué depuis leur dépôt.
[236]M. Chudeau affirme, en effet, qu’elle a dû rejouer à une époque toute récente, et pour ainsi dire contemporaine. Il a constaté que les oueds actuels qui débouchent de la falaise forment des vallées suspendues, c’est bien visible en effet à Taourirt.
A l’est de la falaise, le réseau hydrographique, arrivé à maturité, témoigne d’un long travail de l’érosion, une rupture de pentes et des rapides caractérisant la traversée de la falaise, à l’ouest de laquelle les rivières ou tout au moins leurs lits reprennent jusqu’à l’oued Messaoud une allure tranquille. Que si on rapproche ces faits du peu de dureté des grès à sphéroïdes, qui constituent la falaise, il devient évident que cette falaise est postérieure à l’établissement du réseau hydrographique, postérieure même à l’établissement d’un climat sec au Sahara. Si les rivières avaient coulé pendant que se soulevait la lèvre orientale de la faille l’érosion aurait été puissante ; le profil d’équilibre serait sinon reconquis jusqu’à la source, du moins en bonne voie de reconstitution. En fait les rapides et l’allure torrentielle n’existent que sur quelques centaines de mètres.
Une observation récente que M. Chudeau doit au colonel Laperrine confirme ces indications et ajoute un trait nouveau. Le printemps 1907 a été particulièrement pluvieux au Sahara, et la plupart des oueds du Touat ont coulé ; deux d’entre eux n’ont pu parvenir jusqu’à la falaise et ont formé deux lacs sur le premier gradin du Tadmaït : le jeu de la faille avait amené, un renversement de la pente à l’est du Touat. La pluie continuant cependant, l’un des lacs a atteint le bord de la falaise, et s’est déversé brusquement dans la dépression du Touat, creusant dans la falaise un nouveau ravin et dévastant le petit ksar de Noum en Nas. Il a donc suffi d’une saison pluvieuse pour qu’une de ces rivières ait pu relier, malgré la falaise du Touat, sa source à son embouchure.
L’état d’équilibre instable qu’a créé la faille du Touat ne peut donc être que très jeune : de même qu’à Noum en Nas, il a suffi de quelques orages pour entailler partout la falaise, et malgré la rareté des pluies au Sahara, il est impossible d’admettre qu’un réseau hydrographique aussi anormal puisse subsister un grand nombre de siècles.
Les géologues allemands ont fait des constatations analogues dans la région des grands lacs[172]. Cette Afrique, que l’on supposait a priori un vieux Tafelland rigide commence au contraire à nous apparaître comme un des pays du monde où les mouvements tectoniques sont les plus récents. Et, si l’on songe à quelle altitude ont été portés dans[237] l’Atlas les dépôts marins pliocènes, on ne sera pas surpris que le Vorland ait subi jusqu’au Touat le contre-coup de mouvements orogéniques aussi jeunes.
Hydrographie.
Le Gourara et le Touat rentrent dans le bassin de l’oued Messaoud, au sujet duquel on a donné, dans le chapitre II, des indications précises. De ce côté le bassin est limité par l’Atlas et le Tadmaït.
La topographie du Tadmaït est presque inconnue ; hier encore elle l’était complètement. On sait pourtant que la plus grande partie du Tadmaït déverse vers les oasis ses eaux d’orages ; on connaît aujourd’hui l’existence de très grands oueds, tout à fait comparables, comme dimension, à l’oued Mya, qui a simplement sur eux l’avantage de les avoir précédés sur nos cartes ; ils coulent tous à l’opposé de l’oued Mya, vers l’ouest, et ils sont tributaires des oasis ; ce sont les oueds Tlilia, Ilatou, R’zelan, Sba, Aflissès, etc.[173].
D’autre part les oueds Saoura, Namous, R’arbi, Seggueur descendent de l’Atlas. Un immense réseau-squelette d’oueds quaternaires converge vers les oasis du Gourara et du Touat.
A l’époque actuelle, le trait frappant de l’hydrographie ce sont les sebkhas. Les oasis s’alignent en cordon sur les bords de sebkhas multiples. Il n’y a pas en effet, comme les anciennes cartes l’indiquent à tort, une grande sebkha du Touat, mais un lacis ou un chapelet de petites : l’oasis de Bouda a la sienne, celle de Tamentit en a une autre nettement séparée, etc. La sebkha la plus étendue est probablement celle de Timimoun ; en tout cas, c’est la plus pittoresque, avec sa bordure de falaises et de dunes ; elle a 40 kilomètres de long sur 6 ou 7 maximum de large. (Voir pl. V, phot. 9.)
Il est malaisé de préciser ce qu’on pourrait appeler le régime hydrographique de la sebkha. Les habitants du Touat affirment que les leurs ont été des lacs, de mémoire d’homme, et qu’on y a circulé en bateau de ksar à ksar.
On a dit quelles traditions précises ont été recueillies là-dessus par M. Wattin, interprète militaire.
Quoi qu’il en soit du passé, les oasis sahariennes, dans le présent, ignorent à peu près complètement l’eau naturellement vive et courante.
Les oueds quaternaires coulent peut-être une fois en dix ans.
[238]Quant aux sebkhas, elles ont sur un petit nombre de points, d’étendue très restreinte, de l’eau libre en permanence ; au Timmi, par exemple, dans le voisinage d’Adrar, capitale administrative du Touat, on montre, à la limite de la palmeraie, une flaque d’eau qui ne tarit jamais ; le niveau de ces mares est sujet à des fluctuations notables suivant les saisons. D’autres petits coins de sebkha ont en hiver un pied d’eau libre qui disparaît l’été. Mais dans l’immense majorité des cas, la sebkha reste toute l’année une étendue de vase plus ou moins séchée, plus ou moins semée de fondrières, et plus ou moins saupoudrée de sel. La couche salée superficielle est tout particulièrement hygrométrique ; la surface des sebkhas, terne dans les périodes de plus grande sécheresse, devient étincelante de sel, dès qu’on signale de gros orages, fussent-ils tombés très loin de là. C’est d’ailleurs une loi bien connue en pays désertique que cet accroissement concomitant, paradoxal en apparence, de l’humidité et de la salure superficielle. A mesure que s’accumule l’eau salée contenue dans la masse, la capillarité en entraîne en surface une plus grande quantité, qui s’évapore en déposant un résidu de cristaux. Cette difficulté, on le sait, a entravé, dans l’Égypte anglaise contemporaine, l’extension des cultures[174].
Ainsi, les sebkhas, qui ne reçoivent pourtant, en règle générale, aucun affluent superficiel, restent très sensibles à l’influence des orages lointains, elles sont, en quelque sorte, un pluviomètre de leur immense bassin fluvial, parce qu’elles sont le point où aboutit toute la circulation souterraine. Si donc les oasis se collent aux sebkhas, s’alignent sur leurs bords, ce n’est pas pour leur valeur propre ; les sebkhas, avec leurs terres et leurs eaux, chargées de principes chimiques, sont parfaitement inutilisables, mais elles sont l’indice infaillible d’une abondante nappe d’eau souterraine.
Notons encore que, au Gourara et au Touat, les sebkhas sont toujours, comme l’oued Saoura entier, asymétriques, et si l’on veut hémiplégiques ; sur une rive pénéplaine primaire, sur l’autre couches crétacées ou tertiaires ; la rive primaire est morte, la végétation et la vie sont concentrées sur l’autre.
Nous avons encore peu de renseignements précis sur le climat des oasis ; pourtant le lieutenant Niéger nous donne, sur les pluies, quelques chiffres intéressants. « En 1901, il y avait douze ans que la région n’avait pas eu de pluies... Pendant l’année 1901, quelques pluies. En 1902 on a obtenu, à Adrar, 60 millimètres. » L’hiver[239] 1906-1907 a été très pluvieux. Ces pluies sont des orages brusques et violents, défonçant les toits en terre battue, délayant les murettes de sel, des catastrophes gaies ; leur extrême rareté est soulignée par ce fait, que rien n’est prévu pour s’en défendre. Il est clair que, dans un pareil pays, on ne peut pas compter sur les pluies locales pour alimenter la palmeraie. Et pourtant l’eau est réellement abondante : « Quelques oasis ont plus d’eau qu’il ne leur en faut. Aux offres d’argent qui ont été faites dans certains districts, pour augmenter le débit des foggaras, il fut répondu par une fin de non-recevoir. D’autres... ont accepté, mais sans grand empressement[175] » Ainsi, ce n’est pas l’eau qui manque, les oasis ruissellent d’eau vive, de cascatelles, de petites séguias où vivent des barbeaux. Tout cela est arraché au sol par le travail humain, et y rentre, pour ainsi dire, instantanément, pour y être absorbé par la végétation de la palmeraie. Il faut assurément que cette prodigalité éphémère, sur un tout petit point privilégié, soit alimentée par les réserves lentes d’immenses espaces désertiques. C’est le Tadmaït qui est le grand collecteur, et c’est à son aridité que les oasis doivent leur verdure.
Car un petit nombre d’oasis seulement, celles du Gourara septentrional, sont alimentées par l’Atlas.
Que partout ailleurs l’eau vienne du Tadmaït, c’est incontestable. On la voit sourdre à la tête des longues et innombrables foggaras, toutes parallèles entre elles. Çà ne laisse pourtant pas de surprendre, au moins au premier abord. C’est que ces immenses plateaux calcaires sont un terrible pays. Pour en avoir une représentation adéquate, il faut aller directement d’el Goléa à Ouargla. Il y a là, au cœur de nos possessions, dans un pays que nous occupons depuis trente ans, un intervalle de 200 kilomètres où toute notre machinerie n’a pas encore pu faire jaillir une goutte d’eau. L’été 1903, une caravane de six Arabes y est morte de soif.
Si le Tadmaït est aussi inconnu encore, c’est surtout parce que l’extrême rareté des points d’eau en rend l’exploration détaillée bien difficile en dehors de quelques grands medjbeds. En somme, c’est un Tanezrouft. Après tout ce sont des causses, et même sous nos climats le causse est d’une aridité bien connue. Ces causses sahariens, effroyables dans l’ensemble ont pourtant quelques coins verts, des oasis par exemple. Il est vrai que le seul groupe d’oasis un peu important, le M’zab, est un miracle de volonté humaine, avec ses puits de 60 mètres creusés dans le roc dur. Le M’zabite est à proprement[240] parler un commerçant fixé dans les villes du Tell et qui entretient au Sahara une maison de campagne ruineuse.
En plein Tadmaït dans l’O. Tlilia, on trouve deux petites palmeraies, Matriouen et In Belbel, insignifiantes, à vrai dire. Enfin le Tadmaït a ses pâturages ; celui d’Ilatou, par exemple, fréquenté par les méharistes du Touat. Les nomades du Tidikelt paissent leurs chameaux au Tadmaït aussi bien qu’au Mouidir.
Tout cela suppose nécessairement que le Tadmaït a ses pluies, sur l’abondance desquelles nous n’avons, il est vrai, aucune donnée précise. Mais il est naturel d’admettre qu’un aussi gros massif, et aussi élevé (jusqu’à 700 mètres d’altitude) est notablement plus pluvieux que les oasis elles-mêmes situées à un niveau beaucoup plus bas. Il faut tenir compte aussi de l’énorme étendue du bassin de réception. Il y a là dans le bassin du Touat et du Gourara une masse continue de causses qui peut avoir 350 kilomètres de long sur 150 de large. Toute l’eau qui y tombe s’engouffre dans les avens et dans les fissures et s’achemine vers les oasis.
Le Dr Siegfried Passarge propose une autre explication. Il écrit textuellement : « Les nappes d’eau des puits artésiens dans le Sahara algérien et lybique datent peut-être du quaternaire (Pluvialzeit). Il me paraîtrait plausible d’admettre cette explication, plutôt que de faire venir du Soudan l’eau des oasis libyques, de l’Atlas ou du Hoggar celle du Sahara algérien[176]. »
Le Tadmaït serait donc encore gorgé d’humidité quaternaire, et les restes de son ancienne opulence lui permettraient d’alimenter les oasis, malgré l’indigence des pluies actuelles ; en caricaturant un peu et en précisant outre mesure cette très jolie idée, l’eau qui gonfle les dattes de 1907 serait contemporaine de notre mammouth européen, ou si l’on veut du gnou, du rhinocéros, de la faune quaternaire nord-africaine, aujourd’hui émigrée au Zambèze.
L’hypothèse est charmante, un peu hardie peut-être. Pour qu’elle s’imposât, il faudrait qu’on ait constaté une disproportion entre la quantité moyenne des pluies et le débit des foggaras ; nous sommes extrêmement loin de semblables précisions. Ce qu’on peut affirmer c’est que, au Sahara comme dans toute l’Afrique du nord, les années pluvieuses ou sèches ont un retentissement immédiat sur les sources.
Que l’hypothèse de M. Passarge soit une généralisation de faits observés dans l’Afrique du sud, c’est par surcroît une considération[242] qui n’est pas de nature à la recommander sans restriction aux géologues nord-africains.
Quoi qu’il en soit d’ailleurs, la conclusion générale est la même.
Les oasis et les sebkhas jalonnent la ligne-limite des terrains crétacés et primaires, au Gourara et au Touat ; ce jalonnement est méticuleux à cent mètres près ; ce ne peut pas être une coïncidence fortuite, il faut admettre une relation de cause à effet ; cette limite géologique est un lieu d’habitation humaine parce que, comme beaucoup de ses pareilles, elle est une ligne de sources, suivant laquelle affleure la nappe souterraine. A propos de la Saoura et même de la Zousfana nous avons fait une constatation analogue et la même loi s’applique au Tidikelt. On peut donc généraliser.
De Figuig au Tidikelt en passant par le Gourara et le Touat, s’étend une ligne d’oasis à peu près continue, longue de plusieurs centaines de kilomètres et large à peine de quelques centaines de mètres. M. Basset cite le dicton arabe d’après lequel une jument en marche pourrait être saillie à la première oasis et mettrait bas à la dernière.
Cette « rue de palmiers », un trait tout à fait extraordinaire de la géographie saharienne, on peut en rendre un compte précis dans un petit membre de phrase : les palmiers jalonnent à l’ouest, jusqu’à son extrême limite sud, la limite de la transgression cénomanienne (fig. 50).
Les Foggaras. — Le Touat, le Gourara et le Tidikelt se distinguent de tous les autres groupes d’oasis sahariennes, par l’extrême développement de leurs foggaras ; le contraste est particulièrement vif avec le groupe oriental d’Ouargla, dont toute l’eau est artésienne.
A l’est et à l’ouest des grands causses crétacés, les conditions hydrographiques s’inversent. Le schéma ci-joint fait comprendre d’un coup d’œil pourquoi. De part et d’autre du faîte, ligne de partage des eaux, la cuvette synclinale d’Ouargla et le versant d’anticlinal du Tadmaït occidental se font pendant et contraste. Ainsi s’explique la différence extrême du mode d’existence dans les deux groupes d’oasis. Celles d’Ouargla sont massées au fond de la cuvette synclinale et vivent de leurs puits artésiens ; celles du Touat-Gourara s’alignent à la périphérie du bombement anticlinal, et vivent de leurs foggaras, c’est-à-dire de sources et de suintements captés à fleur du sol (fig. 51).
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XXXVII. |
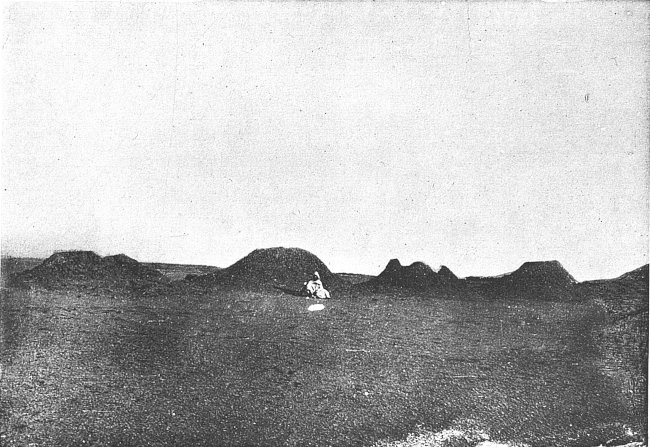
Cliché Perrin
69. — FOGGARA VU LATÉRALEMENT.
Chaque taupinière est formée par les déblais autour de l’orifice d’un puits d’aération ; cette foggara alimente l’oasis du Timmi.

| Phototypie Bauer, Marchet et Cie, Dijon | Cliché Gautier |
70. — UNE FOGGARA DU TIMMI photographiée suivant son axe.
Au premier plan on distingue nettement l’orifice d’un puits d’aération ; une série d’orifices tout pareils jalonnent jusqu’aux palmiers du fond l’aqueduc souterrain.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XXXVIII. |
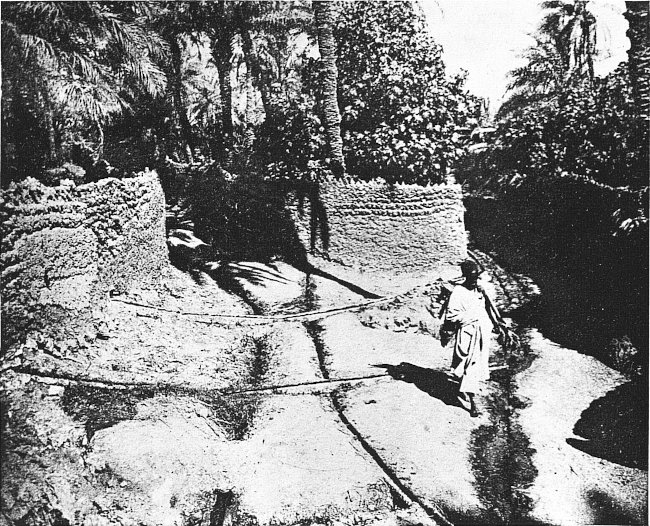
Cliché Gautier
71. — CROISEMENT DE PETITES SEGUIAS (canaux d’irrigation à ciel ouvert) superposées en deux étages (Oasis de Timimoun).

Cliché Laperrine
72. — Dans l’oasis du Timmi, Kesra ou « peigne », dont la forme est bien reconnaissable.
Entre les dents du peigne, l’eau se répartit et s’écoule dans un grand nombre de petits canaux qui ont chacun leur propriétaire.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XXXIX. |

Cliché Laperrine
73. — PUITS A BASCULE DANS UN JARDIN DU TIMMI.

Cliché Gautier
74. — GRANDE SÉGUIA (canal à ciel ouvert) DANS L’OASIS DU TIMMI.
On sait qu’une foggara (pluriel fgagir) est tout simplement un canal souterrain de captage et d’adduction. Rien de plus connu en[243] tout pays. Ce que les foggaras des oasis ont de particulier c’est leur immense développement. Chacune a plusieurs kilomètres de longueur. Niéger, qui n’a pas la prétention d’être complet en a compté trois cent soixante-douze au Touat seulement ; ce serait au moins deux mille kilomètres de cheminement souterrain : or, ces canaux sont des galeries où un homme peut à la rigueur circuler, ils sont munis de puits d’aération de dix en dix mètres ; la tête de la foggara est toujours à une profondeur de plusieurs dizaines de mètres. Au voisinage de chaque oasis, on voit se poursuivre jusqu’au bout de l’horizon les lignes parallèles des puits d’aération, chacun avec son bourrelet de terre d’extraction ; c’est un paysage de taupinières géométriquement disposées. (Voir pl. XXXVII, phot. 69 et 70 et aussi pl. VIII, phot. 16.) Cet évidement du sol rend les voyages de nuit dangereux ; c’est un accident banal que la chute au fond d’un puits d’une bête au pâturage, d’un cavalier, d’un piéton même. Il faut songer aux instruments primitifs avec lesquels ce gigantesque travail a été mené à bien, des pioches et des couffins remplis de déblais, qu’on se passe de main en main. D’après les indigènes, le travail de creusement a progressé d’aval en amont, c’est-à-dire qu’on a attaqué la nappe souterraine à son point d’affleurement, et qu’on a poussé la galerie horizontale jusqu’à ce que le débit soit devenu suffisant. C’est en effet ce qui semble vraisemblable. Les ksouriens actuels suffisent à peine à l’entretien de leurs foggaras, ils en ont laissé tarir beaucoup qu’il serait possible de revivifier. On n’imagine pas qu’ils pourraient concevoir et créer de toutes pièces le lacis compliqué de leurs canaux souterrains, s’ils ne l’avaient trouvé tout fait. Et même on n’imagine pas, si abâtardis qu’on suppose les ksouriens actuels, qu’une génération déterminée de leurs ancêtres en aient jamais été beaucoup plus capables qu’eux. Les foggaras n’ont pas dû naître d’un plan préconçu, elles sont l’aboutissement de tâtonnements progressifs à travers les siècles. Elles semblent porter témoignage de l’asséchement graduel du pays, les premières devaient[244] être beaucoup plus courtes et pourtant suffisantes, mais de génération en génération il a fallu chercher, à une profondeur croissante dans le sol, l’eau nécessaire à l’irrigation. Cette hypothèse en tout cas me paraît la seule qui rende compte de la disproportion entre l’énormité de l’œuvre et l’insuffisance de ceux qui l’ont exécutée.
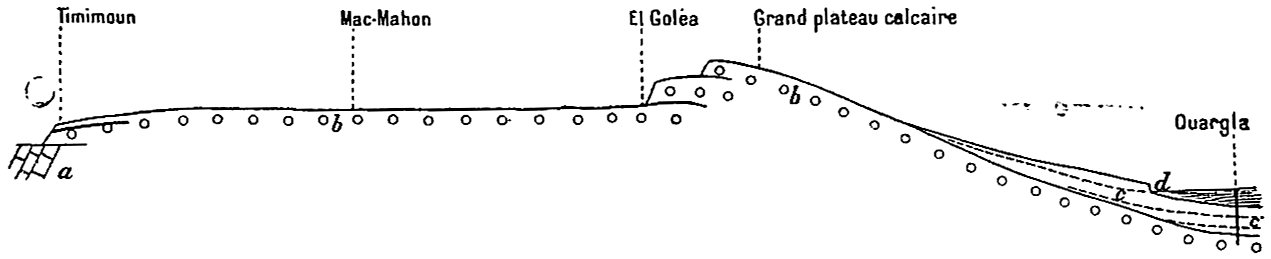
Fig. 51. — Coupe schématique entre Ouargla et Timimoun (hauteurs très exagérées).
a, Dévonien. — b, Crétacé (au voisinage de Timimoun, on n’a pas cherché à distinguer du Crétacé les terrains plus récents). — c, Oligocène. — d, Quaternaire — et | foggaras et puits artésiens.
Pourtant d’après un travail manuscrit de M. le lieutenant Voinot, il existe au Tidikelt (à Foggaret el Arab en particulier) des foggaras qui semblent récentes, et qui, au dire des indigènes, si on l’interprète correctement, auraient été construites de toutes pièces. Il faut se garder de conclusions absolues.
Notons que des canaux souterrains du même genre ont été signalés en Asie Mineure. Ils ont été soigneusement étudiés par l’expédition Beck-Lehmann au lac de Van et aux sources du Tigre, où ils remontent à la domination chaldéenne[177]. Il ne faut pas oublier que les foggaras, comme les puits artésiens, et comme toute la culture intensive des oasis, ont évidemment une origine orientale.
Gourara. — Du côté du Touat, la limite officielle du Gourara est, je crois, entre Sba et Meraguen ; du côté de la Saoura je pense que Telmin est englobé dans le Gourara ; ces limites sont en tout cas plus ou moins artificielles ; de part et d’autre du Gourara, au nord et au sud, la « rue de palmiers » continue. Mais le Gourara n’en a pas moins une individualité bien marquée.
La partie septentrionale est très mal connue ; elle se trouve n’avoir jamais fait l’objet d’une monographie ; et d’autre part je l’ai à peine entrevue. Pour comble de malheur le Grand Erg n’a fait encore l’objet d’aucune publication cartographique sérieuse[178] ; et sa connaissance détaillée serait naturellement le prologue indispensable d’une étude hydrographique sur le Gourara septentrional.
Au témoignage des indigènes, recueilli par M. Martin[179], interprète militaire, le bas oued Namous serait jalonné par les oasis d’Ouled Aïssa, Haïha, Touat en Nebou, Charouïn ; pourtant la carte Mussel (inédite) suggérerait plutôt qu’il s’agit du bas oued R’arbi (?).
D’après la même autorité (M. Martin), les oasis du Tinerkouk, très éparses sur 50 kilomètres jalonnent le lit bien marqué de l’O. Salah, qui semble en rapport avec l’O. Meguidden (faux bras ? cours inférieur ?).
En somme, il semble y avoir essentiellement deux lignes de verdure[245] et d’humidité. Mais par rapport à ces deux lignes il subsiste bien des oasis aberrantes et inexpliquées. Dans un pays où le tracé des oueds quaternaires a été bouleversé par la formation des dunes, les nappes souterraines sont apparemment très diffuses. Au Tinerkouh l’irrigation se fait certainement au moyen de puisards. A Charouïn il ne m’a pas semblé que les foggaras fussent très développées. Toute cette région qui reçoit ses eaux de l’Atlas, filtrées à travers l’immense complexe des cônes de déjection, a naturellement ses affinités hydrographiques avec les oasis de la Saoura.
Le Gourara méridional, au contraire, de beaucoup le mieux connu, ressemble au Touat. A Timimoun et dans les oasis voisines sur la rive sud de la sebkha le développement des foggaras est magnifique.
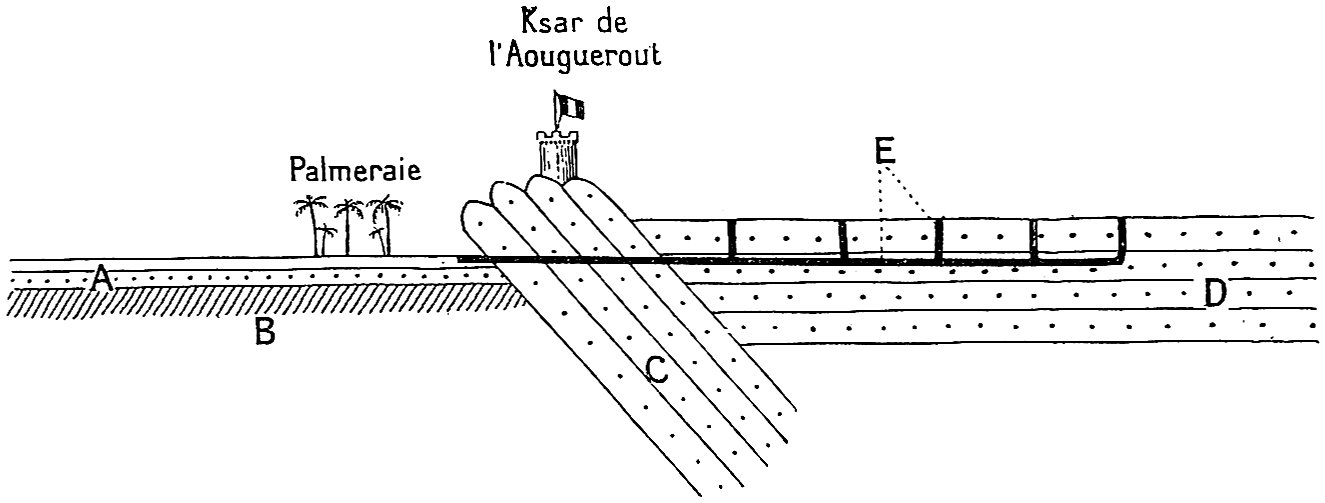
Fig. 52. — Coupe schématique de l’Aouguerout.
A, Quaternaire et Crétacé ; B, Primaire ; C, Crétacé redressé ; D, Crétacé horizontal ; E, foggara avec ses puits d’aération.
Pourtant à titre de curiosité il faut signaler deux puits artésiens, celui d’Ouled Mahmoud et celui de Kaberten. Pas de renseignements sur ce dernier, mais pour le premier il semble que le puits soit en relation avec l’existence d’une cuvette synclinale dans les couches crétacées, dont l’horizontalité habituelle est ici dérangée.
On a déjà dit que la palmeraie de l’Aouguerout, très isolée, à l’écart et en amont des autres, est elle aussi en rapport avec une faille qui a dérangé l’horizontalité des couches crétacées ; les têtes des foggaras sont en amont de la faille, les palmiers en aval (fig. 52).
Un forage dans la palmeraie a amené la découverte à une faible profondeur (une dizaine de mètres) de roches primaires fossilifères (un fossile a été vu par M. Chudeau).
Il y a donc au Gourara des accidents brusques et très localisés, failles ou plis posthumes, qui ont intéressé les couches crétacées, y faisant naître des cuvettes synclinales, des poches d’eau, où il devient possible à titre exceptionnel de forer des puits artésiens dans[246] ce pays de foggaras. C’est un trait de ressemblance avec le Tidikelt, bien plutôt qu’avec le Touat.
Une autre particularité du Gourara, qui rappelle encore le Tidikelt, c’est qu’il est relativement riche en pâturages (Deldoul, Bel Razi, Lalla R’aba). Rien de semblable ne s’observe au Touat.
Il faut se souvenir que, au Touat et au Gourara, le sol n’est pas tout à fait le même. Ici les grès albiens sont à nu. Au Touat, à tout le moins dans le haut Touat, ils sont généralement recouverts d’un placage d’argiles cénomaniennes. Il se peut qu’un sol de grès soit plus favorable aux pâturages.
Mais il faut peut-être faire intervenir surtout des causes humaines. Lalla R’aba, par exemple, fut un lieu de cultures ; on voit encore le tracé des foggaras mortes, et les ruines d’un ksar. — Mais ce ksar, dit-on, a longtemps servi de rendez-vous et de base d’opérations aux bandes beraber, qui ont fait le vide ; et le pâturage, naturellement, a bénéficié de l’abandon des cultures.
Des trois groupes touatiens, le Gourara est probablement le plus riche en eau, comme il est le plus peuplé, mais il y a des raisons de croire que la culture y est moins intensive qu’au Touat. Il a en effet une population particulière, plus primitive et moins évoluée.
Les ksars et les ksouriens du Gourara n’ont pas été l’objet de monographies au rebours de ceux du Touat. D’ailleurs, même au Touat, on ne s’est jamais préoccupé dans les statistiques d’établir la proportion respective des Berbères et des Arabes. Nous manquons donc de chiffres précis.
En gros du moins il est certain que le Gourara est presque tout entier berbère. Les Berbères s’y présentent en masses compactes, constituant des ksars entiers, la plupart des ksars, si bien qu’on a plus vite fait d’énumérer ceux qui ne le sont pas.
Le Tinerkouk tout entier est habité par des Arabes (Chaamba, Ouled Sidi Cheikh, etc.). A l’ouest du Tinerkouk et à l’extrémité orientale de la sebkha du Gourara, un certain nombre de ksars, groupés auprès de la zaouia d’el Hadj Guelman appartiennent aux Khenafsa qui sont en partie nomades, et qui sont arabes. A l’autre extrémité du Gourara, au voisinage du Touat, Sba, Guerrara, Ouled Mahmoud sont arabes, ainsi que quelques ksars de l’Aouguerout.
Tout le reste est berbère, en particulier les groupes les plus importants du Gourara, Timimoun, Charouïn, Brinken. Ces Berbères se donnent à eux-mêmes le nom de Zenati, et à langue qu’ils parlent celui de Zenatia. Inutile de faire observer que les Zénètes sont une grande famille berbère bien connue ; et on a déjà dit que[247] les indigènes de Figuig se réclament eux aussi de cette famille. Les Beni Goumi sont classés par Ibn Khaldoun parmi les Zenata, de même que les Rached qui ont donné leur nom au ksar Gourarien d’Ouled Rached.
La Zenatia d’ailleurs est parlée dans tout le Sahara algérien, au M’zab, à Ouargla, dans l’O. R’ir[180].
Les Zenati du Gourara, lorsqu’ils savent l’arabe, ont une prononciation très particulière et très défectueuse ; par exemple ils prononcent le t (ت) ts comme les Tlemcéniens. Sur cette particularité de la prononciation tlemcénienne voilà ce qu’écrit M. W. Marçais. « Le ث et ت se sont confondus en Tlemcénien en un son unique ț ; le ț n’est plus une dentale pure ; c’est en quelque sorte une lettre double équivalente à ts, prononcé en une seule émission de voix. Cette prononciation est courante aussi en algérois et dans les dialectes citadins du Maroc septentrional. Peut-être faut-il l’attribuer à une influence berbère[181]. »
Je ne puis malheureusement pas pousser plus loin l’étude des déformations que les Zenati font subir à l’arabe ; elles sont à coup sûr assez nombreuses et assez considérables pour frapper immédiatement une oreille peu exercée. Dans la bouche d’un Zenati l’arabe sonne décidément comme une langue étrangère.
Les seules inscriptions berbères que je connaisse au Gourara sont à Ouled Mahmoud. Il y en a deux groupes l’un auprès du vieux ksar abandonné, et l’autre au sommet du ksar actuel ; ces dernières sont sûrement antérieures à la construction du ksar qui est tout récent ; aussi on a bâti sur l’inscription, dont une moitié se trouve à l’extérieur et l’autre à l’intérieur d’une maison[182]. Le sens de ces inscriptions est inconnu et les indigènes sont fort éloignés d’avoir à leur sujet des souvenirs précis, puisqu’ils les croient hébraïques. A coup sûr les caractères sont berbères, et probablement assez récents, libyco-berbères plutôt que libyques. L’inscription du vieux ksar est accompagnée de grafitti libyco-berbères (chameaux). Elle est accompagnée aussi d’une inscription arabe, facile à déchiffrer ; elle a le caractère d’un épithalame, à moins qu’on ne préfère lui en prêter un érotique ; ce sont deux noms accolés d’homme et de femme. — « Un tel fils[248] de Zenati — une telle fille de Zenati. » Ce ksar d’Ouled Mahmoud d’ailleurs, où l’empreinte berbère est restée marquée jusque dans une inscription arabe, est précisément un des rares points du Gourara d’où le dialecte berbère a officiellement disparu. Aujourd’hui Ouled Mahmoud est habité par des gens de langue arabe, qui ont un affreux accent zenati, mais qui se disent issus d’un ancêtre commun venu de Tunis. Une inscription dans la mosquée donnerait la date exacte de l’arrivée de l’ancêtre. — Ancêtre qui a bien des chances d’être simplement spirituel et éponyme pour beaucoup de ses prétendus descendants. Cela signifie apparemment que Ouled Mahmoud a été converti à la stricte observance de l’islamisme et à l’usage de la langue arabe par un santon tunisien, bâtisseur de mosquée, du nom de Mahmoud.
D’après les officiers il y a une différence marquée de mentalité entre les ksouriens arabes et berbères ; au Gourara les premiers sont de relations plus courtoises, d’idées plus larges et de compréhension plus rapide ; les Berbères donnent une impression d’infériorité et de sauvagerie. Au Touat et au Tidikelt en effet ce bloc zenati du Gourara a mauvaise réputation, le mot Gourari en est employé couramment dans un sens péjoratif ; presque synonyme de haratin, de serf ; — par exemple, au cours d’une étape saharienne très dure, un guide, blaguant la misère commune, affirme brusquement qu’on serait beaucoup mieux à In Salah entre deux petites Gourariet. Dans le même ordre d’idées le Gourara passe, jusqu’en Algérie, pour la patrie de sorciers et surtout de sorcières très redoutées ; ce qui laisse supposer un pays plus teinté que ses voisins de vieux paganisme préislamique.
Tout cela est bien concordant. La grande originalité du Gourara c’est d’être un bloc berbère arriéré, où l’islam et la langue arabe, l’un portant l’autre, n’ont pas jeté des racines aussi profondes qu’au Touat et dans la Saoura. On a dit que le berbère a tout à fait disparu de la Saoura. On verra que, au Touat, il s’est conservé dans un nombre insignifiant de tout petits ksars.
Il est tout naturel que les oasis les plus occidentales soient les plus arabisées ; dans le complexe O. Guir-O. Zousfana on observe de même que les Doui Menia parlent arabe, tandis que les Beni Goumi, plus orientaux, parlent berbère. Au Sahara, et d’ailleurs en Algérie même, la dernière vague l’islamisation est venue de l’ouest, du Maroc et de la Séguiet el Hamra.
Or tandis que l’O. Saoura et le Touat ont été effectivement et son encore virtuellement la grande voie d’accès marocaine au Sahara, le[249] Gourara au contraire est la voie d’accès algérienne. Par l’oued Namous et à travers l’erg depuis des âges immémoriaux les caravanes sud-oranaises des Trafi, des Hamyan, viennent commercer au Gourara.
La faune du Gourara, par ailleurs dépourvue d’originalité, je crois, a des termites. Ils infestent le poste de Mac-Mahon. A Ouled Mahmoud les indigènes ont dû prendre la fuite devant eux, ils ont quitté l’ancien ksar, et bâti le nouveau, il y a vingt-cinq ans environ, chassés par une invasion de termites. Chose curieuse, entre l’ancien et le nouveau ksar il y a deux ou trois kilomètres d’oasis, et cette petite distance a suffi pour arrêter la migration. Au vieux ksar les dangereux insectes avaient été apportés brusquement par une crue de l’oued, qui vient de l’Aouguerout. J’ignore s’il faut en conclure qu’il y a des termites à l’Aouguerout. A coup sûr ils restent très localisés, les rares points contaminés ne sont pas phagédéniques, sauf un cas très particulier et fortuit comme la crue d’Ouled Mahmoud. Je ne sache pas qu’ils aient été signalés sur d’autres points du Gourara. Ils sont enkystés, il semble qu’on ait affaire à une espèce d’un âge géologique extérieur, en voie de disparition, et qui s’est maintenue péniblement sur quelques points privilégiés par suite de circonstances favorables.
Ce n’est pas l’espèce bâtisseuse de grandes termitières turriformes, comme on en voit sur les bords du Niger ; c’est l’espèce souterraine, qui est partout, comme une menace invisible, dans le sol intact et dans les murs lisses, d’une ubiquité mystérieuse ; sur la terre battue d’une chambre il suffit de laisser ses bagages pour qu’il s’ouvre aussitôt comme par magie des orifices par où débouchent les colonnes d’attaque.
Ce sont des termites de ce genre qui se trouvent dans l’Adr’ar des Ifor’ass, et aussi, semble-t-il, au Kalahari[183] : insectes de steppe apparemment.
A ma connaissance le Gourara serait le seul point du Sahara où ces termites ont survécu. Mais il paraît probable qu’il y en a d’autres. Une carte de la répartition des termites au désert serait peut-être une contribution intéressante à des études sahariennes. Elle nous permettrait peut-être de tirer des conclusions sur le passé.
Touat. — Le Touat est beaucoup plus simple de structure que le Gourara ; la « rue des palmiers » y devient rectiligne rigoureusement sur près de 200 kilomètres entre Bouda et Taourirt.
[250]Sur le terrain et sur la carte, la vue de ce chapelet de sebkhas, souvent longées sur une rive ou sur l’autre, et parfois sur les deux, par des falaises d’érosion, suggère d’abord l’idée que les oasis jalonnent le lit d’un oued, qu’on imaginerait la prolongation de l’oued Saoura. On a dit dans un autre chapitre que l’O. Messaoud coulait au large du Touat, après l’avoir simplement effleuré à Tesfaout. Ce sont ses affluents, l’O. Gourara, l’O. Tlilia, qui ont sculpté les falaises du Touat. Mais ce qui a conditionné la longue ligne des palmiers c’est une grande faille authentiquement constatée.
Le Touat, malgré son unité de structure, se divise en deux parties bien distinctes, le haut et le bas Touat.
Haut Touat. — Le haut Touat va du Bouda à Temassekh. Il a le monopole des barbeaux tout à fait inconnus dans le bas Touat. Cela signifie que les crues de la Saoura atteignent parfois Tesfaout, mettant le haut Touat en communication très intermittente avec le haut Guir, assez poissonneux.
Les éléments du sol sont empruntés à des schistes primaires, à des grès albiens, à des argiles gypseuses cénomaniennes ; les alluvions et les dépôts tertiaires tiennent une place insignifiante ou nulle. Les dunes aussi sont complètement absentes, comme au Gourara méridional (à Timimoun du moins, car Deldoul est ensablé). Et ceci est très particulier, car au bas Touat et au Tidikelt, les dunes sont une calamité municipale, l’ennemi public contre lequel tout village soutient une lutte séculaire.
Dans le haut Touat rien de pareil, les ksars, les murailles, les palmiers restent parfaitement nets de sable accumulé. Nous sommes ici dans une zone de décapage et non d’alluvionnement éolien.
Tout cela a sans doute sa répercussion soit sur la composition chimique du sol, soit, d’une façon ou de l’autre que je ne puis préciser, sur son adaptation à la culture. Il y a en effet, entre le haut et le bas Touat, des différences agricoles notables, malgré l’identité du climat. Dans le haut Touat le henné ne vient pas, et la datte est de qualité inférieure.
Le haut Touat a donc une individualité même au point de vue géographie physique ; mais surtout historique et humain.
Et d’abord il a une histoire qui remonte au XIVe siècle. Ibn Batouta et Ibn Khaldoun parlent assez longuement du Bouda et de Tamentit, qui semblent bien avoir été alors les plus gros centres commerciaux, les capitales du groupe touatien.
[251]C’est à la fin du XVe siècle surtout que l’histoire du haut Touat se précise et devient intéressante.
On sait depuis longtemps, depuis Léon l’Africain, que, en l’année 1492, le Touat a été le théâtre d’un épisode tragique ; à cette époque, sur l’instigation de Mohammed ben Abd el-Kerim ben Mer’ili plus connu sous le nom d’El Mer’ili, les Juifs furent massacrés et leur synagogue détruite[184]. Mais ce qui pouvait paraître un simple fait divers tragique, a été en réalité, pour les oasis, un événement considérable, un tournant de l’histoire. Le « temps des Juifs », l’histoire de leur établissement, leur prospérité, leur massacre, tout cela revient à chaque instant dans les traditions indigènes, et non pas seulement dans leurs traditions orales, M. Wattin, interprète militaire, a retrouvé au Touat, a traduit et publié un manuscrit arabe d’histoire locale ; le titre est El-Bassit par Sid Mohammed et-Taïeb ben el-Hadj Abd er-Rahim[185]. El-Bassit parle longuement des Juifs.
Ils se seraient établis au Touat « l’année de l’éléphant », c’est-à-dire l’année où Abraha, roi de l’Éthiopie, monté sur un éléphant blanc, entreprit une expédition contre la Mecque, pour renverser le temple de la Kaaba ; ce qui nous reporterait au VIe siècle de J.-C. Les arabisants diront ce qu’ils pensent de cette indication chronologique. Il est curieux en tout cas que les traditions indigènes conservent le souvenir d’une migration de Juifs, d’un établissement en masse. Et il ne l’est pas moins qu’on attribue à cet établissement une date aussi reculée, antérieure à l’hégire ; c’est d’ailleurs l’événement le plus ancien dont les oasis ont gardé souvenance.
Les traditions nous montrent des juifs ksouriens, propriétaires, agriculteurs, tout différents du mercanti usurier qu’est actuellement le juif de l’Afrique Mineure. Les puits artésiens d’Ouled Mahmoud et de Kaberten (au Gourara) sont attribués aux Juifs ; d’après Niéger « la foggara Hennou de Tamentit, et toutes les foggaras mortes comprises entre Zaouiet Sidi Bekri et Beni Tameur » seraient l’ouvrage des Juifs. D’après la même autorité ils auraient eu trois cent soixante-six ksars. C’est à eux qu’on attribue la fondation des ksars de Tamentit, qui serait restée jusqu’en 1492 une oasis juive. C’est là un fait considérable si l’on songe que Tamentit est encore aujourd’hui la capitale morale du Touat, son centre industriel, commercial, et si l’on peut dire intellectuel.
Il n’est pas interdit d’espérer que des découvertes archéologiques viendront jeter quelque jour sur cette civilisation disparue. J’ai[252] estampé dans le ksar de R’ormali (oasis de Bouda), une inscription hébraïque, qui a été publiée par M. Philippe Berger[186] ; c’est une pierre tombale de 1329. Cette inscription est d’un travail soigné ; elle semble attester l’existence de ce qu’on pourrait presque appeler une école de graveurs ; et on pouvait prévoir qu’elle ne resterait pas isolée. En effet M. le lieutenant-colonel Laperrine a expédié à Alger trois nouvelles inscriptions hébraïques[187].
Les traditions indigènes ont conservé de la persécution un souvenir détaillé. Ils connaissent parfois le lieu de sépulture des victimes. D’après Niéger « un massacre aurait eu lieu entre Sbaa et Meraguen. Les indigènes montrent à trois kilomètres sud-ouest de Guerara, une espèce de tumulus, qui serait le tombeau des infidèles ». El-Mer’ili, l’ennemi des Juifs, eut à surmonter de grosses résistances locales ; son principal adversaire fut le cadi de Tamentit, El-Asmouni qui chercha à intéresser à sa cause, ou plutôt à celle des Juifs, les ouléma du Maghreb. Les massacres ne furent décidés qu’après consultation de saints personnages lointains, parmi lesquels on cite Es-Snousi et Et-Tounsi. L’assassinat du fils d’El-Mer’ili au Touat[188] longtemps après la persécution laisse deviner qu’elle avait semé des haines vivaces, et qu’elle n’avait pas obtenu un résultat complet et immédiat.
La mémoire d’El-Mer’ili, dont le tombeau est à Bou Ali, est aujourd’hui en grande vénération aux oasis ; mais on pourrait presque en dire autant de ses victimes ; à coup sûr il ne s’attache pas à leur souvenir la haine et le mépris dont le musulman poursuit ordinairement l’infidèle. C’est déjà un fait remarquable que ces Juifs exterminés depuis quatre cents ans ne soient pas tombés dans l’oubli. On parle du « temps des Juifs » avec une sorte de piété ; c’était le temps où les sebkhas étaient des lacs, où le Touat avait ses felouques, le bon vieux temps ; les Juifs apparaissent comme des bienfaiteurs, auteurs des puits artésiens et des foggaras, créateurs d’oasis et fondateurs de ksars. L’inscription de R’ormali n’est pas le moins du monde abandonnée, elle est un peu traitée en fétiche, encastrée dans un pilier de pisé, le côté gravé en dehors. Dans les ruines du ksar juif d’Ar’lad (oasis de Tamentit) les femmes vont pleurer, avec l’espoir, il est vrai, d’être récompensées de leurs larmes par la découverte d’un trésor. Le commandant Laquière écrit : « La tradition courante au Touat est que les gens de Tamentit tiennent cette[253] aptitude à l’industrie et au commerce de leurs ancêtres juifs, à qui serait due la fondation de la ville. Les indigènes se défendent d’ailleurs de cette origine et disent que, lors de l’arrivée des musulmans dans le pays, les Juifs ont disparu en majeure partie. D’après eux, seuls les habitants du quartier d’Akbour descendraient des Juifs fondateurs de Tamentit. Les descendants d’ailleurs sont de parfaits musulmans aujourd’hui, se disent même marabouts et enseignent le Qoran. »
Il en est de même à peu près partout aux oasis ; on ne trouvera jamais un ksourien qui ne renie ses propres ancêtres juifs, mais il avoue ceux de son voisin. Au fond, malgré les siècles écoulés, tous savent à quoi s’en tenir, et dans les victimes d’El-Mer’ili ils reconnaissent des aïeux. La persécution de 1492 n’a pas été simplement le massacre de quelques Juifs, elle a été surtout la conversion en masse d’un peuple.
Ce temps des Juifs dont le souvenir s’est conservé non seulement dans le haut Touat mais encore au Gourara, fut assurément le temps de l’indépendance berbère, les Juifs dominaient soit par leur nombre, soit par leur industrie et leur richesse une société berbère.
En même temps que les trois inscriptions hébraïques trouvées à Tamentit, M. le lieutenant-colonel Laperrine a envoyé à Alger une pierre sculptée, de même provenance[189] et qui, d’après M. Basset représente une tête de bélier. M. Basset a relevé deux textes, l’un de Corippus et l’autre d’El-Bekri attestent l’existence chez les Berbères d’un culte du bélier, qui s’est maintenu jusqu’au XIe siècle[190]. Après tout il subsiste encore à Tamentit ce qu’on pourrait appeler une autre idole berbère, objet d’un culte actuel. C’est un très bel aérolithe, posé au milieu d’une place, où il est protégé par son poids et par la vénération du peuple. M. le commandant Laquière en a publié une photographie[191]. Les indigènes affirment qu’il est tombé du ciel, et sur ce point on peut les en croire, auprès du petit ksar de Noum en Nas. En ce temps-là il était tout en or, aussi excitait-il de si dangereuses convoitises que Dieu, dans sa sagesse, le muta au fer. En réalité, au prix où se débitent les aérolithes dans les musées et les laboratoires, celui de Tamentit, quoiqu’il ne soit pas en or, a une grosse valeur, mais les gens de Tamentit l’ignorent, et ils esquivent ainsi un conflit pénible entre leur piété et leurs instincts ataviques de commerçants.
[254]Je ne sais pas jusqu’à quel point le culte d’un aérolithe est compatible avec l’Islam. On songe de suite à la pierre noire dans la Kaaba de la Mecque, mais justement cette pierre noire est, je crois, antérieure à l’Islam.
Les inscriptions berbères abondent au Tadmaït, et on s’est trop pressé peut-être de les attribuer exclusivement aux Touaregs actuels. En tout cas, il existe à Tamentit, auprès du ksar de Bassi, un rocher couvert de Tifinar’ (voir pl. XVIII, phot. 35 et 36). Il est peu vraisemblable que ce soit une inscription Touareg, que ferait-elle en pleine oasis de Tamentit où les Touaregs n’ont jamais eu aucune influence ; et si c’en était une, les indigènes la connaîtraient pour telle ; or, ils la considèrent comme une inscription juive, si bien qu’un mercanti juif d’Adrar, peu lettré apparemment, a pu s’y laisser prendre et verser de vraies larmes d’émotion sur cette soi-disant relique des siens. Il est vraisemblable qu’elle est, sinon juive, du moins « du temps des Juifs », d’une époque où les Zenati de Tamentit avaient encore l’usage du Tifinar’. Sa présence dans l’oasis, et l’oubli dans lequel elle est tombée semblent témoigner d’un recul de la culture nationale berbère.
On sait que, dans toute la Berbérie, des débris d’institutions et de mœurs romaines ont survécu longtemps à l’Islam, les derniers se retrouvent aujourd’hui encore dans les tribus restées les plus berbères de l’Afrique du nord, dans la Kabylie du Djurdjura, dans l’Aurès ; il faut assurément ranger non seulement le haut Touat mais encore le complexe des oasis sahariennes parmi les coins de Berbérie où l’on rencontre en plus grande quantité ces sortes de fossiles romains. Les ksouriens agriculteurs ont conservé, non seulement le souvenir, mais encore l’usage très vivant du calendrier Julien, avec les noms latins des mois, encore très reconnaissables, Naier (Januar), Fobraier, Maris, Ibril, etc. Chaque année ils fêtent le 12 janvier de notre calendrier grégorien, qui est le premier du calendrier Julien.
En somme il s’est conservé dans le bas Touat et au Gourara, pendant tout le Moyen âge, une société berbère, au milieu de laquelle survivait, dans certaines communautés, une religion de l’empire romain, le judaïsme ; et d’une façon générale, un état d’esprit archaïque, antérieur à la conquête islamique. C’est du moins la seule hypothèse qui rende compte des faits observés. Contre cette société berbère, partiellement infidèle, il se produisit à partir de 1492, une réaction violente de l’Islam et de la culture arabe.
Dans le haut Touat cette réaction a fait disparaître l’ancienne société zenati bien plus complètement qu’au Gourara, où elle est, on[255] l’a vu, à peine entamée. Ici, la prédominance politique et sociale appartient presque partout aujourd’hui à des familles de langue et, s’il fallait les en croire, de race arabe. Les nombreux Zenati parlant berbère, et qui ne peuvent renier ni le nom de leur tribu, ni leur idiome, en rougissent et cherchent du moins à rattacher leur origine à l’Arabie au moyen de fausses généalogies[192].
Ils ne forment plus d’ailleurs que des groupements familiaux, on les trouve dans presque tous les ksars mélangés aux Arabes. Le brassage a été assez énergique pour influer, à ce qu’il m’a semblé, sur la prononciation ; les Zenati du haut Touat lorsqu’ils parlent arabe, n’ont pas, je crois, l’affreux accent gourarien.
Il y a cependant un groupe de très petits ksars qui sont restés intégralement Zenati : Temassekh, Ikkiz, Ar’il, Titaf, el Ahmer et Ouled Antar. Il est curieux que ce groupe soit précisément intercalé entre le haut et le bas Touat, comme pour attester qu’il y a bien là en effet une frontière entre des pays différents, historiquement et ethnologiquement distincts.
Bas Touat. — Le bas Touat diffère d’abord du haut par la nature de son sol. Au voisinage de Zaouiet Kounta toute une série d’oasis Ouled sidi Hamou bel Hadj, Touat el Henna, Inzegmir, sont installées sur le Mio-Pliocène, qui donne un sol sableux et calcaire, tout différent, j’imagine, des terres fortes et argileuses du haut Touat. En tout cas, c’est le pays où pousse le henné, comme l’indique son nom de Touat el Henna, et c’est aussi le pays du tabac.
Plus au sud à partir de Sali, la dune envahit les oasis. A Enzeglouf un village à peu près enfoui a dû être abandonné. Partout l’aspect de la dune hérissée de haies en djerid atteste la lutte acharnée des indigènes contre l’envahissement. (Voir planche XLII, phot. 79.) A Zaouiet Reggan la crête des dunes est aujourd’hui à l’ouest de la palmeraie, les indigènes se souviennent d’un temps où elle était à l’est ; la ligne en marche des dunes a progressivement traversé toute la palmeraie, comme une énorme vague. Et ceci nous donne l’assurance que le vent d’est domine ; aussi bien tout le montre, la topographie même de la dune et le regard des sifs, l’affirmation unanime des indigènes. Et d’ailleurs le vent d’est domine partout aux oasis, au Tidikelt comme dans le haut Touat et au Gourara.
Cet ensablement agressif est un spectacle surprenant pour qui vient du nord, si libre de dunes. Mais il est de règle au Tidikelt, In[256] Salah aussi est menacé d’enfouissement. Les indigènes disent que le sable du bas Touat vient de R’adamès et du Grand Erg oriental ; il ne faut pas prendre cette assertion à la lettre, elle signifie évidemment que tout le long de la route qui va à R’adamès, et qui est assez suivie, on observe la même tendance à l’ensablement. On sait que cette route suit le fond d’un grand fossé d’effondrement, creusé entre les masses montagneuses du Tadmaït et celles du Mouidir-Ahnet. C’est le long de ce fossé que le sable chemine poussé par un vent d’est dont les parois de l’immense couloir rectifient sans doute et assurent la direction, et dont elles augmentent la force. Le Reggan et le Sali sont précisément dans la direction de ce grand courant d’air chargé de sable.
Que par cette longue voie des grains de sable venus de l’erg oriental aient pu arriver jusqu’au Touat, c’est une hypothèse dont il serait oiseux de contester la vraisemblance. Mais ici, comme ailleurs, si on admet que le sable est dans la dépendance exclusive du vent, il devient inexplicable qu’on le trouve seulement dans les bas-fonds : On ne comprend pas que l’action du vent puisse avoir des effets identiques à ceux de la pesanteur. Il ne faut pas oublier que deux systèmes d’oueds quaternaires puissants, l’O. Igargar et l’O. Bota ont accumulé dans cette longue dépression tout ce qu’ils ont arraché de sable aux plateaux gréseux Touareg, Tassili, Mouidir, Ahnet, Açedjerad. Il y a là sur place ample matière à l’édification des dunes.
Il est donc naturel que le Reggan et le Sali, sous le vent d’un pareil réservoir de sable soient envahis aux dunes ; le reste du Touat et le Gourara méridional sont au contraire sous le vent du Tadmaït, dont les calcaires sculptés par des rivières divergentes, ne se prêtent pas à l’accumulation de grandes masses sableuses.
Quoi qu’il en soit, au Sali et au Reggan, les dunes ont tué d’importantes fractions de palmeraies ; mais cet inconvénient n’est pas sans quelque compensation. Un certain degré d’ensablement est-il favorable à la qualité de la datte ? Ce qui est certain c’est que celles du Sali et du Reggan passent pour les meilleures de tout le Touat.
Au bas Touat on ne retrouve plus le souvenir des Juifs. On y retrouve d’autres légendes, moins précises évidemment, car je ne sache pas qu’elles s’appuient sur des textes sérieux : je crois pourtant incontestable qu’elles ont un fonds de vérité historique. Au bas Touat, avant la période actuelle, on a connu le temps des Barmata, et cette indication chronologique manque sans doute de précision. Pourtant le nom même des Barmata donne un terminus a quo : arabe littéral « el Baramik » en français les Barmécides. Et il[257] importe peu que ce nom illustre dans l’histoire de l’Islam ait été manifestement usurpé, comme tant d’autres, par des Berbères en quête de fausses généalogies. Le dernier vizir Barmécide est tombé en 803, et ses homonymes du Touat sont donc postérieurs au IXe siècle, probablement postérieurs de beaucoup.
Ces Barmata, d’autre part, ne sont nullement des personnages de légende ; ils ont laissé au Touat les preuves les plus positives de leur existence, des ruines de ksars nombreux.
Au bas Touat, depuis Titaf, la ligne des ksars actuels, jusqu’à Taourirt, est longée régulièrement, à l’est et en contre-haut, d’une ligne de ksars en ruines ; j’ai vu à coté de Zaouiet Kounta les ruines d’el Euzzi et de Salobouiye ; à côté de Taourirt, les ruines d’Agebeur. Villages actuels et ruinés sont tout à fait différents. Les actuels sont en pisé, ils se ressemblent tous, géométriquement carrés, flanqués aux angles de tours carrées, tout cela est très régulièrement crénelé. Vus de loin avec leurs murs lisses et comme vernis de boue durcie, avec leurs lignes droites et leur structure géométrique, ils ont l’air de forteresses de marchands de jouets, gardées par des soldats de plomb. (Voir pl. XL, phot. 76.)
Ce type de ksar paraît être marocain ; on le retrouve, assez exactement, semble-t-il, sur des photographies publiées par M. de Segonzac[193], et qui se rapportent à la haute Moulouya. Nos ksars algériens sont d’un type bien différent, ce sont des tas informes, des agglomérations de petites maisons si serrées, si enchevêtrées, qu’on serait tenté de dire des conglomérats, des lumachelles ; les contours généraux n’accusent aucune espèce de plan d’ensemble ; ils ont l’absurdité, la fantaisie et le pittoresque de vieilles choses lentement progressives, qui ont poussé à travers les siècles, au hasard de la vie et de l’évolution. La différence entre les deux types est la même qui a été si souvent signalée entre les villes et les hameaux de nos vieux pays, et les centres urbains des pays neufs, « villes champignons » des États-Unis, villages de colonisation algériens ; avec leur disposition en damier, œuvre d’arpenteurs géomètres. Si l’on songe que tous les ksars du Touat, comme d’ailleurs du Gourara et de la Saoura, sont de ce même type colonial et administratif, si étrange dans un pays qui n’a jamais connu l’administration, on n’échappe pas à la conclusion qu’ils sont tous le produit d’une même pensée et approximativement d’une même époque, ils attestent une conquête, une révolution brusque.
[258]Les ksars en ruines, d’autre part, n’ont aucun rapport architectural avec les modernes. Et d’abord ils sont construits en pierre, et non en pisé ; c’est probablement à cette différence des matériaux de construction que nous devons la conservation excellente des ruines ; après trois ou quatre siècles, il n’y resterait pas une pierre debout, si on en avait eu l’emploi, puisque les ruines auraient été une carrière. En fait les vieux ksars sont en remarquable état ; beaucoup de murs sont encore debout et le squelette général est intact. Je n’oserais pas affirmer que le mortier fasse défaut partout, mais une partie des murs à tout le moins est bâtie en pierres sèches. L’aire d’extension de ces ruines en pierres sèches à travers le Sahara est considérable ; il en existe de tout à fait semblables à celle du Touat auprès de Colomb-Béchar, auprès de Charouïn, et jusque dans l’Adr’ar des Iforass (es Souk, Kidal)[194]. Partout, l’Adr’ar mis à part, le pisé a complètement supplanté la pierre sèche ; c’est une substitution étrange par sa généralité. (Voir pl. XL, phot. 75.) Les vieux ksars du Touat, au rebours des nouveaux, ne trahissent pas le moindre souci de symétrie dans le plan général. Ils sont généralement perchés, non seulement au haut de la falaise, mais encore toutes les fois que ç’a été possible au sommet d’une gara détachée de la falaise, dans une position inexpugnable ; ils prennent là-haut une silhouette de château moyenâgeux. Le choix de semblables emplacements est très fréquent dans toute la Berbérie ; pour désigner ces nids d’aigle il existe un vieux mot berbère « kalaa » qui a survécu sur une foule de points dans l’onomastique locale (el Goléa, Koléa, Kalaa des Beni Abbès, etc.). Ces kalaa de pierres sèches représentent le village berbère ; les ksars modernes le village arabe, un plus haut degré de culture islamique. Sur une transformation tout à fait analogue nous avons des données historiques chez les Beni Goumi (région de Tar’it). On connaît et on vénère le marabout qui l’a dirigée.
La kalaa de Taourirt est la seule que j’aie eu le loisir d’examiner. Elle s’appelle Agebeur ; il est à noter qu’aucune de ces ruines n’est anonyme ; le cimetière d’Agebeur est incontestablement musulman ; un coin est resté vivant, c’est une koubba blanchie à la chaux, soigneusement entretenue, où serait enterré un santon marocain Abd-er-Rahman el Oudiayi ; cette ville d’Oudia d’où le santon serait originaire est-elle Oujda, à côté de notre frontière ? Je n’en sais pas plus long, mais il est évident que l’antiquité de ces ruines n’est pas très reculée.
[259]Les ksars en ruines du bas Touat sont précisément ceux auxquels est resté accroché le nom des Barmata. Il n’est pas impossible de recueillir au sujet des Barmata quelques traditions indigènes, mais bien vagues et contradictoires. D’après M. Wattin ils sont venus au Reggan vers l’an 901 de notre ère à l’époque où Ibrahim ben Ahmed était gouverneur de l’Ifrikiya. On les dit frères des Zenati et des Beraber, c’est-à-dire Berbères ; mais on ajoute frères des Bambaras soudanais, ce qu’il ne faut pas apparemment prendre à la lettre.
Pourtant j’ai vérifié que le souvenir des Barmata se retrouve très net à Tombouctou. Ils furent certainement à un moment donné les courtiers du commerce transsaharien et ils eurent des attaches au Soudan.
Par surcroît, l’association à leur nom de celui des Bambara pourrait bien n’être pas complètement absurde. D’après M. Chudeau, quelques faits notés au Soudan, d’accord avec leurs légendes qui les font venir du nord, semblent bien montrer que les Bambaras, question de race mise à part bien entendu, ont leurs affinités avec les Sahariens ; presque rien ne les rapproche des autres nègres du Soudan. Voici les principaux arguments dont quelques-uns assez forts, que fait valoir à l’appui de cette opinion, le directeur de la station agronomique de Koulikoro, M. Vuillet, qu’un long séjour et de nombreux voyages au Soudan ont mis à même de voir et de bien voir.
1o Des prénoms comme Moussa, Ahmadou, d’origine arabe, sont fréquents chez les Bambaras même non musulmans. Plus au sud ces prénoms disparaissent.
2o Les villages bambaras, avec leurs cases carrées et leurs toits plats rappellent les ksars du Sud-Algérien et non les huttes rondes de la plupart des noirs. Leur vêtement, le harnachement des chevaux les rapprochent aussi des Arabes.
Leur arme est la lance et non pas l’arc.
L’élevage, la fabrication du beurre, la castration du bétail les éloignent aussi des régions plus méridionales.
3o Les arguments les plus intéressants sont tirés de la culture. Le blé (malikama) se rencontre en quelques points du pays bambara ; le dattier (tamar), à peine productif cependant, existe dans presque tous leurs villages. Le citron (lemerou), le henné, le sésame sont cultivés partout, au moins en petit.
Les cultures du sud (fabirama, papaye, banane, goyave, igname) sont à peine connues en pays bambara, où elles ont été le plus souvent importées par les Européens. Le manioc amer qui est l’espèce de[260] grande culture parce que son amertume à l’état cru le met à l’abri des singes, des porcs-épics et des passants, est ignoré des Bambaras qui ne plantent que le manioc doux.
D’après les traditions du bas Touat, recueillies par M. Wattin[195], les Barmata n’étaient pas musulmans, mais c’est d’une absurdité évidente, il faut entendre sans doute que leur orthodoxie était douteuse. Ils auraient été anéantis par une tribu Touareg, les Settaf, et leurs ksars étaient déjà ruinés et le pays vide quand les nouveaux furent fondés par des Marocains venus du Sahel et du Chaouia. Ceci non plus ne semble pas pouvoir être entendu à la lettre. Les gens du bas Touat, presque tous Cheurfa (descendus de Mahomet), cela va sans dire, ne veulent rien avoir de commun avec ces Barmata plus ou moins hérétiques, de même que les gens du haut Touat renient toute parenté avec les juifs massacrés par el Mer’ili. Mais s’il n’existait pas un lien on ne s’expliquerait pas que le nom de chaque kalaa ait surnagé, et qu’il se trouve à Agebeur, encastré dans les ruines, un marabout encore vénéré. On reconnaît d’ailleurs que dans certains ksars, à Sali, à Bou Ali, à el Mansour, il survit des descendants de Barmata. Voici une tradition recueillie par Watin au sujet de Sidi Ahmed er Reggadi, fondateur de Zaouiet Kounta au XIVe siècle. A son arrivée à Bou Ali, les descendants de Barmek, qui étaient considérés comme des païens, eurent peur, mais Ahmed fit apporter du petit lait, il distribua cette boisson entre les enfants de Barmek et les siens en leur disant : « buvez, et riez en frères ». Le « Temps des Barmata » au Reggan, correspond à l’expression « Temps des Juifs » dans le haut Touat.
Ici comme là la disparition de l’ancienne société coïncide avec une puissante poussée d’islamisation, une recrudescence de pitié, qui a semé le pays de Zaouias, Zaouiet Kounta et Zaouiet Reggan, fondées toutes les deux par des Chorfa du Tafilalet qui ont fait souche à Tombouctou de la tribu maraboutique bien connue, les Kounta. Les gens de Sali aussi sont des Chorfa marocains, mais qui s’entendent assez mal avec leurs cousins et voisins.
Tout cela en somme n’est pas trop discordant ; si le nom même des Barmata nous a fourni un terminus a quo, le IXe siècle, l’examen de leurs ksars, et des légendes qui s’y rattachent, nous donne un terminus ad quem, un peu vague, le XIVe ou le XVe siècle.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XL. |

Cliché Gautier
75. — AU TIMMI, FABRICATION DES BRIQUES CREUSES, ÉLÉMENTS DU PISÉ.

Cliché Gautier
76. — ADRAR (Timmi), CAPITALE DU TOUAT.
Type de ksar actuel, en pisé, quadrangulaire, flanqué de tours carrées
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XLI. |

Cliché Gautier
77. — TIMIMOUN — UNE RUE DANS LA PALMERAIE.
D’un mur à l’autre, une poutre en tronc de palmier, qui a fléchi sous son propre poids comme d’habitude.

Cliché Gautier
78. — TIMIMOUN. — UN COIN DU KSAR.
La place principale, traversée par une séguia ; — toits en terrasse de pisé.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XLII. |

Cliché Laperrine
79. — UNE PALMERAIE ENSABLÉE.
A gauche, sur la crête de la dune, et pour essayer de la fixer, des haies en palmes.

Cliché Gautier
80. — TIMIMOUN. — BOUCHERS HARATIN DÉPEÇANT UN CHAMEAU.
[261]Le XVe siècle au Sahara et dans l’Afrique Mineure.
Nous pouvons maintenant jeter un coup d’œil d’ensemble sur cette époque, si curieuse au Sahara, qui va approximativement du XIVe au XVIe siècle et qui a vu s’accomplir partout la même transformation.
Dans l’O. Zousfana un certain Sidi Beyazid convertit les Beni Goumi païens. La date est indéterminée mais il faut noter que le nom de Beyazid est turc.
Dans l’O. Zousfana, des « Nazaréens (?) » bâtisseurs de ksars ont été massacrés ou convertis par les Beni Hassen.
Au Gourara et dans le haut Touat une société juive a été détruite par el Mer’ili en 1492.
Au bas Touat des Barmata païens (?) ont pour successeurs au XIVe et XVe siècle des Chorfa du Tafilalet.
Avec des variations locales c’est partout la même révolution, et à peu près à la même époque.
Elle s’accompagne partout d’un changement dans l’architecture des villages. Aux kalaa de pierre bâties dans de fortes situations défensives et offensives succèdent les ksars en pisé, fortifiés, il est vrai, mais modestement cachés dans la palmeraie, au milieu des cultures. Ce sont des refuges de paysans traqués, ou des jardins à cascatelles pour moines inoffensifs ; au lieu de bourgs féodaux, qui sentent l’indépendance, le banditisme, et sans doute aussi le nomadisme, car les kalaa sont toujours à quelque distance des bas-fonds cultivables. Ces siècles de transition sont ceux où se fondent les grands monastères sahariens, Kenatsa, Kerzaz, Zaouiet Kounta, etc. Et, sous bénéfice d’inventaire, car les études hagiographiques restent encore à entreprendre, c’est alors apparemment que surgirent ces innombrables tombeaux de saints, avec leurs coupoles blanches qui constellent toutes les palmeraies et qui extériorisent pour l’œil la prédominance des préoccupations pieuses.
Il y a eu là apparemment, en même temps qu’une révolution religieuse et linguistique, une profonde transformation économique, et sociale, un progrès de l’agriculture intensive, de la paix publique, et de la culture générale.
Or cette révolution religieuse on la signale dans toute l’Afrique du nord.
Au XVe et au XVIe siècle, l’Islam, chassé d’Espagne, poursuivi jusqu’en Afrique par les chrétiens, se ressaisit et se rénove ; le sentiment religieux s’exaspère, les saints, les marabouts, les missionnaires[262] pullulent ; c’est le moment où les vieux noms berbères des tribus disparaissent, pour céder la place aux dénominations actuelles, tirées de marabouts éponymes ; pour la première fois, l’Afrique Mineure s’islamise intégralement.
Et c’est un fait bien curieux que dans cette Berbérie ultra-conservatrice l’Islam introduit au VIIIe siècle n’ait triomphé définitivement qu’au XVIe. C’est même un fait considérable, étrange et généralement si ignoré, qu’on sent le besoin d’en établir l’exactitude en s’appuyant sur des autorités incontestables. Beaucoup moins palpable qu’une bataille ou un changement de dynastie cette grande transformation diffuse et lente a presque complètement échappé aux rares historiens de l’Afrique du nord. Mercier lui consacre à peine une dizaine de lignes imprécises : « Nous devons signaler l’arrivée de marabouts, venus en général de l’ouest, du pays de Seguiet el Hamra... ils ont, en maints endroits, réuni des tronçons épars, d’origine diverse, et en ont formé des tribus qui ont pris leurs noms. Les Koubba de ces marabouts se trouvent répandues dans tout le nord de l’Afrique et perpétuent le souvenir de leur action qui a dû s’exercer surtout du XIVe au XVIIIe siècle[196]. » Aucun historien n’a fait de cette question pourtant intéressante l’objet d’une étude détaillée ; les éléments, incomplets, en sont épars dans des travaux hagiographiques et philologiques, en particulier de M. Basset.
Dans « Nédromah et les Traras »[197], par exemple, M. Basset signale « les traces d’une influence juive, antérieure à l’établissement des Israélites actuels de Nédromah (où ils vinrent de Miknâsah au milieu du XVIIIe siècle), car nous les trouvons dans des monuments du Moyen âge ». M. Basset cite une tribu qui a un nom hébraïque, les Ouled Ichou ; il mentionne un tombeau très vénéré de Josué, et le cap Noun, dont le nom, qui lui est appliqué dès le Moyen âge, est celui du père de Josué. « On sait que les Juifs se répandirent de bonne heure en Afrique, non pas seulement en Cyrénaïque, et dans la région Carthaginoise, où ils prospérèrent, mais aussi dans l’ouest. Les Vandales tolérèrent le libre exercice de la religion juive, et on voit, par un passage de la lex Wisigothorum cité par Grœtz, que les juifs d’Espagne s’adonnaient au commerce et à la navigation sur les côtes d’Afrique... Ils étaient nombreux dans ce dernier pays puisqu’ils s’entendirent avec leurs frères restés en Espagne pour organiser contre Egica, vers 693, une insurrection qui échoua[198]. »
[263]Voilà qui est évidemment de nature à jeter une lumière sur les traditions touatiennes au sujet des Juifs.
Parmi les saints de Nedromah, M. Basset fait une grande place aux « marabouts venus de la Seguiet el Hamra ; ceux-ci se rattachent aux missions qui au XVe et au XVIe siècle ranimèrent l’Islam dans tout le nord de l’Afrique[199] ».
Au sujet de la confédération des Traras, qui se forma au XVIe siècle, M. Basset observe : « Contrairement à ce qui se passa ailleurs, elle ne prit pas le nom soit d’un ancêtre éponyme, soit d’un marabout reconnu comme l’ancêtre spirituel[200]. »
Dans les montagnes de Cherchell les Beni Menacer actuels furent jusqu’au XVIe siècle des Zenètes Maghraoua, dont le nom se trouve déjà dans Ptolémée sous le nom de Μακχούρηβοι. Ils ont adopté leur nom actuel aux environs du XVIe siècle et « ils le dérivèrent de celui d’un saint nommé Mansour, qui se serait fixé parmi eux pour les ramener à la religion, et serait ainsi devenu leur ancêtre spirituel éponyme[201] ».
C’est ainsi que « les Mekhâlif, entre Djelfa et Laghouat, se rattachent à un Sidi Makhlouf ;... les Douaouïda (province de Constantine) à Sidi Douad, etc. ».
M. René Basset donne tout une liste de marabouts algériens venus du Maroc et de la Seguiet el Hamra, et qui ont évangélisé Blidah, Mascara, la Kabylie, etc.[202]. Le santon fameux de Milianah, Sidi Ahmed ben Yousof se rattache spirituellement, au titre de disciple, « à ce grand mouvement de renaissance religieuse[203] ».
Voilà qui éclaire évidemment le rôle joué au Touat par el Mer’ili, à Tar’it par Si Beyazid, etc.
La révolution du XVe siècle au Sahara et en particulier au Touat ne lui est donc pas particulière ; des événements analogues, répercussions des victoires espagnoles, se sont produits à la même époque dans toute l’Afrique du nord. Le Maroc battu en Europe et envahi en Afrique, fut apparemment sensible à l’humiliation nationale et au recul de l’Islam ; par surcroît il fut le refuge des musulmans andalous chassés d’Espagne : ces proscrits nombreux, intelligents, cultivés et aigris se dispersèrent sur la surface du Maroc par petites colonies,[264] qui devinrent des centres de fermentation religieuse et patriotique. Et c’est ainsi que l’extrême Ouest-Africain est devenu, par un curieux choc en retour, un centre d’expansion énergique non seulement de l’Islam mais de la langue arabe. Les Arabes du Touat sont venus de l’ouest, de la Seguiet el Hamra, où la colonie andalouse était considérable, et qui fut un centre de rayonnement important entre tous. Il l’est resté d’ailleurs, comme en témoigne le rôle d’agitateur xénophobe joué actuellement par Ma el Aïnin. Qu’une population expulsée, et en quête d’une nouvelle patrie, se soit portée de préférence au Sahara, dans les parties périphériques et, pour ainsi dire, coloniales de l’empire marocain, ou que, en tout cas, elle y ait exercé une influence plus profonde, c’est assez naturel. Serait-il absurde de rappeler à ce propos le rôle joué en Algérie, après 1870, par d’autres annexés, les Alsaciens-Lorrains ? En tout cas il y a là tout un ensemble de faits que notre éducation historique européenne ne nous habitue pas à associer avec les dernières larmes de Boabdil, et qui n’en sont pas moins réels. Les défaites marocaines en Andalousie ont eu leur répercussion et leur revanche un peu partout dans l’Afrique du nord, mais plus particulièrement à l’autre bout de l’empire, au Sahara.
C’est là dans le passé le dernier tournant d’histoire qu’on aperçoive nettement aux oasis. Au delà tout devient confus. L’article de M. Wattin sur les origines du Touat énumère il est vrai un certain nombre d’événements fort antérieurs au XVe siècle. Mais les souvenirs indigènes sont flous et incertains. En 289 de l’hégire (901 de l’ère chrétienne) une migration serait venue de l’est, provoquée par les exactions d’Ibrahim ben Ahmed, gouverneur de l’Ifriqiya ; les immigrés se fixèrent au Reggan, et donnèrent au pays le nom de Touat, parce qu’ils étaient fatigués (ouatin !!)
Ce sont précisément les Barmata. Mais d’autre part, d’après M. Basset, la même légende et la même étymologie sont appliquées à des nègres de la suite du roi de Melli, Mensa Mousa[204].
D’après Wattin, ce qui signifie naturellement d’après les indigènes dont il reproduit les dires, les ancêtres des Touatiens seraient tous arrivés au Touat entre les années de notre ère 901 et 1067. Mais d’autre part, d’après le même Wattin, les Juifs sont arrivés au Touat dans l’année de l’éléphant, c’est-à-dire au VIe siècle. Il paraît impossible de tirer de tout cela un renseignement positif d’intérêt général[205].
[265]Les Haratin. — Il n’est pas difficile de poser le problème à résoudre. Les Berbères furent-ils les premiers habitants du Touat ? ou ont-ils été précédés par des Nègres ? C’est la question des haratin.
Toute la basse classe, et par conséquent la partie la plus considérable de la population, est composée de Nègres. Seuls d’ailleurs ils sont en état de supporter physiquement le travail de la terre, parce qu’ils résistent à la malaria.
Mais ces Nègres se divisent en deux catégories bien tranchées, les esclaves et les haratin.
Pour les esclaves point de difficulté, leur origine est claire, la plupart sont nés au Soudan et ont été amenés aux oasis par la traite. D’après Wattin ils ont un idiome spécial, le kouria, qui serait un pot-pourri de toutes les langues soudanaises. M. Wattin ne donne aucun détail sur cet idiome qu’il n’a évidemment pas eu le temps d’étudier ; mais il est très affirmatif sur son existence. D’après le peu qu’il en dit on imagine un sabir, un pigin-englisch ; il est assez vraisemblable en effet que dans un milieu d’esclaves soudanais, d’origines et d’idiomes différents, réunis par leur misère commune, il soit né une sorte de lingua franca nigritienne. Cette petite question reste pourtant à approfondir.
Il est autrement délicat de se prononcer sur l’origine des haratin. C’est une classe, ou une caste de la société, un prolétariat agricole, et peut-être faut-il aller jusqu’à dire des serfs de la glèbe ; ils travaillent les jardins d’autrui d’après un contrat de métayage, équivalent à celui qui lie le khammès algérien ; je crois qu’ils n’avaient pas le droit de rompre ce contrat de métayage, et à coup sûr ils n’en avaient pas la possibilité.
Ce prolétariat nègre se retrouve dans tout le Sahara algérien et marocain, à Ouargla, au Tafilalet, dans l’O. Draa, et partout il porte le même nom.
On pourrait être tenté de dériver ce nom de حرث (harat : labourer) ; d’après les archives marocaines il y a une classe de haratin (laboureurs blancs) auprès de Tanger[206]. Il semble donc bien que aux yeux des indigènes la caractéristique essentielle des haratin c’est moins la couleur de la peau que la positon sociale.
Les haratin sont-ils des esclaves libérés, une caste d’affranchis ? sont-ils au contraire le résidu d’une ancienne population aborigène, asservie par les Berbères, des Garamantes ? C’est une question qui a fait couler beaucoup d’encre. Les haratin du Touat et des groupes[266] voisins d’oasis n’ont certainement pas d’idiome qui leur soit propre. Ils parlent la langue de leurs maîtres, arabe ou berbère suivant les oasis. Un certain nombre savent le kouria, mais non pas tous ; ceux qui le parlent sont d’anciens esclaves, et le kouria serait incontestablement le jargon propre des esclaves. Notons pourtant que M. Basset, étudiant à Tiaret l’idiome berbère parlé par une colonie de haratin a retrouvé des influences yolof[207].
On n’a jamais étudié les haratin au point de vue ethnologique ; il est certain pourtant qu’ils ont les instruments de musique des Nègres, le tambour et la double timbale (karkabou) ; ils ont leurs danses et leurs habitudes bruyantes dans les nuits de pleine lune ! A première vue à tout le moins ils ne semblent pas s’en distinguer.
D’ailleurs, au dire de nos officiers (capitaine Flye Sainte-Marie en particulier), tout hartani qu’on interroge déclare que son grand-père était esclave ; chez aucun on ne trouverait la prétention d’appartenir à une caste différente par ses origines de la caste servile ; les intéressés eux-mêmes se déclareraient affranchis.
A coup sûr les coutumes facilitent et multiplient les passages d’une caste à l’autre. Les affranchissements sont fréquents, et tout affranchi est de droit hartani. L’enfant de hartani et d’esclave est de droit hartani, comme d’ailleurs l’enfant de hartani et de parent libre est libre de droit. Des deux ascendants c’est toujours celui dont la condition est la plus relevée qui la transmet à l’enfant. On voit ici par quel processus légal la race entière se négrifie.
On peut donc affirmer que rien de ce qu’on observe au Touat n’autorise à considérer les haratin comme une race aborigène. Mais je ne crois pas qu’il serait sage d’aller plus loin et de poser une conclusion absolue. Il est clair que, dans la période actuelle, les Soudanais sont venus aux oasis comme esclaves et qu’ils y ont fait souche de haratin : d’autre part c’est un fait historiquement certain que, au Moyen âge, ils y sont venus en conquérants, à la suite des rois de Mellé et des sultans Sonr’aï ; une légende de Tombouctou, qu’on a rapportée plus haut, attribue au Touat, au pays et à son nom, une origine soudanaise. Dans un chapitre antérieur on a dit que, au centre du Sahara, la race Berbère paraît superposée récemment à une population nègre néolithique.
En définitive, dans un pays où, pour des raisons climatiques, les nègres sont les seuls cultivateurs possibles, et qui d’ailleurs est en libre communication avec la Nigritie, il serait imprudent, et l’on[267] pourrait presque dire absurde, d’affirmer a priori qu’ils ont été un épiphénomène, des immigrants tardifs, ouvriers malgré eux de la onzième heure.
Conditions politiques et économiques. — Nous avons la bonne fortune de posséder, sur le Touat, ce qui nous manque sur les groupes voisins d’oasis, un certain nombre de monographies très sérieuses écrites sur place par des officiers de bureau arabe[208]. Il est donc possible d’entreprendre, à propos du Touat, une petite étude politique et économique, qui pourra s’appliquer en beaucoup de ses parties à tout l’ensemble des oasis occidentales.
Tout d’abord les trois provinces, Touat, Gourara et Tidikelt ont été recensées ; et ce recensement réduit d’une bonne moitié les évaluations antérieures sur le chiffre de la population. On espérait 100 ou même 150000 âmes, le groupe entier a environ 50000 habitants.
Au Touat le lieutenant Niéger nous donne un tableau méticuleux des ksars et des groupes de ksars, et on voit comment cette population se répartit. Le Touat, par exemple, a douze oasis, douze palmeraies distinctes, formant chacune un tout plus ou moins centralisé ; dans chacune un nombre variable de villages ; celle de Timmi, par exemple, en a 26 ; celle de Sbaa en a 2, et Noum en Nas un seul. L’importance de chaque village varie de 25 à 500 habitants.
On a déjà dit que les ksars sont en pisé. Le Crétacé, au-dessus et parfois au-dessous des grès à dragées, a des bancs épais d’argile, que les indigènes appellent « tin » ; ces argiles ont été et sont encore très exploitées, les galeries d’exploitation sont parfois habitées, et dans une faible mesure, il y aurait donc lieu de signaler aux oasis des vestiges de troglodytisme (Tesfaout au Gourara, el Ahmer au Touat). En général le tin est employé à la confection du pisé et des briques crues, matériaux habituels de construction (voir pl. XL, phot. 75) ; les ksars des oasis sahariennes doivent au tin une coloration générale rouge qui leur est propre, au moins si on les compare aux ksars d’Ouargla, d’es Souf. Là-bas les matériaux de construction sont tout autres, la chaux et le plâtre abondent, les villages sont d’un blanc éclatant ; et ce n’est pas une simple question de coloration ; l’architecture, dans la cuvette d’Ouargla, est bien moins primitive. On ne connaît rien, aux oasis occidentales, de comparable aux superbes moulures de plâtre, qu’on exhume dans les ruines de Sedrata. Ouargla et el Souf connaissent et pratiquent la voûte ; aux[268] oasis toutes les maisons sont couvertes d’une mauvaise terrasse en terre avec une ossature de troncs de palmier ; on sait que le tronc de palmier n’a pas de résistance, quelque faible portée qu’on lui donne il fléchit progressivement en arc de cercle (voir pl. XLI, phot. 78) ; il ne donne donc que de petites terrasses éphémères, à travers lesquelles le pied passe, et à la merci d’un orage. Ces monceaux de terre battue ajourée, que sont les ksars des oasis, avec leurs longs passages couverts, font une impression de termitières. (Voir pl. XLI, phot. 77 et aussi pl. XXXV, phot. 66.)
Sur la constitution de la société l’essentiel a été dit ; on sait qu’il existe à la base une caste d’esclaves, et une caste de prolétaires serfs, les haratin.
Ajoutons que la classe des hommes libres comporte elle-même des subdivisions : tout à fait en haut de la hiérarchie sociale sont les chorfa (descendants du Prophète), et les merabtin (descendants de saints, d’ascètes illustres) ; au-dessous les aouam, la tourbe des simples musulmans dont les ancêtres ne furent jamais béatifiés. Nous pourrions dire les nobles et les roturiers à condition de se souvenir qu’en général dans la Berbérie théocratique toute noblesse est religieuse et la sainteté héréditaire.
L’organisation politique est très lâche. Le rouage essentiel est la djemaa, composée de tous les notables de chaque ksar ; mais nous sommes assez mal fixés sur ses attributions et ses moyens d’action ; nous ne savons pas si elle délègue son autorité et à qui, ni de quelle-façon elle fait exécuter ses décisions ; probablement assez mal. Son autorité, en tout cas, ne dépasse pas les limites du ksar, et dans ce groupement de ksars, qui est une oasis, il n’y a pas de rouage politique central, aucune cohésion.
La grande oasis de Timmi par exemple avec ses 26 ksour, est bien une individualité géographique et agricole, mais non pas du tout politique, elle est gouvernée par 26 djemaa, entre lesquelles, en cas de dissentiment, il n’y a de secours possible qu’à la force.
En pratique, pourtant, il y a souvent une famille prépondérante, dont le chef dirige, tant bien que mal, tout le district ; c’est le cas de Mohammed ben Abd er-Rahman, au Timmi ; de Abd el-Qader ben el-Hadj Bel Kacem, au Bouda. A ces petits seigneurs féodaux le gouvernement français confère aujourd’hui, et le sultan du Maroc conférait autrefois, le titre de caïd ; mais c’est un titre étranger, auquel rien d’officiel ne correspond dans l’administration indigène.
Il faut encore signaler ici comme partout dans l’Afrique du nord le rôle politique des zaouias ; au Touat, Zaouiet Kounta et[269] surtout Zaouiet Reggan, au Gourara el-Hadj Guelman. Enfin, deux grands çoffs divisent la population de toutes les oasis Sahariennes, le çoff Yahmed et le çoff Sofian.
Cette institution du çoff, encore qu’elle nous paraisse, avant tout, à nos yeux d’Européens, un principe de division et de guerre civile, est au contraire ici le seul lien entre les différents districts, puisqu’elle est la seule qui s’étende à la totalité du pays. En dehors des influences personnelles et religieuses, la djemaa dans le ksar, le çoff dans l’ensemble des oasis sont les seules institutions politiques existantes.
Les lois et coutumes en matière d’irrigation sont d’une importance particulière, la monographie du Touat, par le lieutenant Niéger, contient, à ce sujet, un alinéa très intéressant. Au Touat, l’eau est objet de propriété en soi, indépendamment du sol ; il est courant qu’un propriétaire de palmiers soit simplement locataire de l’eau, sans laquelle sa propriété ne saurait subsister. « Cette anomalie, dit Niéger, s’explique facilement par le désir que les gens riches de la contrée, possesseurs de foggara, avaient de conserver les moins favorisés dans leur dépendance. » On comprend aisément, en effet, que la possession de l’eau soit un instrument de domination, et que les simples propriétaires de palmiers constituent une classe inférieure et dépendante. Chaque foggara a donc son propriétaire, ou plus généralement ses propriétaires, et qui ne sont pas le moins du monde indivis ; la proportionnalité de leurs droits se mesure très exactement au nombre de puits d’aération qui appartiennent à chacun. Chaque section de foggara a donc son propriétaire : Niéger ne nous dit pas s’il est responsable de son entretien ; cela paraît probable, et, dans ce cas, la propriété des foggara ne serait pas seulement un instrument de domination, elle présupposerait une certaine situation de fortune et une certaine prééminence sociale ; il est clair que, pour entretenir une foggara, pour faire face aux aléas d’un éboulement par exemple, il faut disposer, soit de capitaux, soit d’une clientèle étendue d’ouvriers. On ne nous dit pas non plus si la communauté se désintéresse entièrement de cette question vitale de l’irrigation. C’est peu vraisemblable : qu’arrive-t-il, par exemple, si le propriétaire d’une section de foggara laisse dépérir sa propriété et compromet, par là, la prospérité d’une portion de l’oasis ? Nous ne savons pas davantage comment se fait la location de l’eau ; y a-t-il des baux, des enchères ? On devine l’existence de tout un code minutieux de l’irrigation, qu’il serait intéressant de connaître.
Le lieutenant Niéger nous donne d’intéressants détails sur la[270] répartition matérielle de l’eau. Ailleurs, dans l’oasis de Figuig, par exemple, ce qui se répartit, ce qui fait objet de propriété et de contrats, c’est le tour d’irrigation, l’heure, la fraction de temps pendant laquelle on aura l’usage de l’eau. C’est donc le temps qui se mesure au moyen de la karrouba, un vase en cuivre, percé d’un trou, qui joue le rôle d’horloge hydraulique, ou, plus simplement, de sablier d’eau. Ce mode de répartition n’est pas inconnu au Touat, mais il y est rare. Niéger mentionne « une seule foggara à Tamentit, où chaque propriétaire prend l’eau pendant un temps déterminé et arrose immédiatement son jardin ». En général, c’est l’eau elle-même qu’on mesure ; on jauge son débit, et il est curieux de voir comment les ksouriens ont résolu ce problème délicat. L’instrument dont ils se servent porte le nom de chekfa ; c’est une plaque de cuivre percée de trous. Chacun de ces trous a une dimension déterminée ; les uns sont l’unité de mesure (habba), et les autres en sont des fractions ou des multiples. Il suffit de barrer entièrement le courant avec cette plaque de cuivre ; « l’équilibre est établi lorsque l’eau coule par une gouttière ménagée à la partie supérieure de l’instrument ; on bouche à cet effet le nombre de trous nécessaires dans la chekfa. Il suffit alors de compter un à un les trous restés libres, et qui correspondent à des mesures connues (habba, 1/2 habba, etc.), pour avoir le débit ».
M. le lieutenant-colonel Laperrine a bien voulu attirer mon attention sur un passage curieux de Ronna : les Irrigations[209]. On y voit que, en France, les anciens fontainiers faisaient usage du pouce d’eau, qui est simplement l’équivalent français de la habba.
Il est curieux de constater ainsi, une fois de plus, que les hydrauliciens du Sahara ont emprunté leurs connaissances précises au fonds commun du vieux monde. Du moment que les ksouriens ont un instrument de jauge, suffisamment précis et pratique, il est aisé de concevoir comment s’opère la répartition. Au débouché de chaque foggara, dont le débit est jaugé, se trouve un kasri, que les Français appellent un « peigne » à cause de sa forme. C’est, si l’on veut, un delta de pierre entre les branches duquel l’eau de la foggara se divise. (Voir pl. XXXVIII, phot. 71.) Chaque dent du peigne, ou chaque branche du delta a son propriétaire auquel une chekfa, disons un compteur, fixé à demeure, assure automatiquement la quantité d’eau exacte qui lui revient. Il est curieux de voir comment, à travers les trous de la chekfa, l’eau des oasis se vend et se loue, pour ainsi dire goutte à goutte.
[271]Ce système surprend par son ingénieuse complexité, mais il a un gros inconvénient ; à jauger l’eau, et à l’éparpiller ainsi entre les différents propriétaires, on en perd beaucoup. Avec l’autre système celui de la karrouba on gaspille beaucoup moins. Il semble que l’organisation politique des Touatiens les ait amenés à choisir ce mode défectueux de répartition. Il n’est pas rare en effet qu’une même foggara appartienne à plusieurs ksars, qui, étant parfaitement autonomes, ne pouvaient pas rester dans l’indivision. L’anarchie du pays livre ainsi à l’évaporation une quantité d’eau assez notable.
Chaque ksar a son jaugeur d’eau, Kiel el-ma qui est en même temps, dans les questions d’irrigation, quelque chose comme un arbitre ou un juge.
Et c’est en même temps quelque chose d’assez voisin de notre notaire ; ce qui fait sa force, et ce qui le rend irremplaçable, c’est sa connaissance méticuleuse des intérêts et des fortunes.
En somme, tout ce que cette assez pauvre race humaine a conservé d’intelligence et d’énergie est concentré autour de ces questions d’irrigation et de culture. Elle a réalisé là des miracles, à propos desquels on regrette de constater une disproportion entre la somme des efforts et de l’ingéniosité déployés, et le résultat économique final, qui est médiocre. (Voir pour l’irrigation aux oasis, pl. XXXVIII, phot. 72. et pl. XXXIX, phot. 73, 74.)
La datte est, comme partout dans les oasis, la richesse principale, mais celles du Touat ne supportent pas la comparaison avec les fruits magnifiques d’Ouargla et de l’oued R’ir. Au dire des indigènes on a souvent essayé de transplanter au Gourara et au Touat les meilleures espèces d’Ouargla ; elles y dégénèrent très vite.
C’est probablement une question de sol. La cuvette d’Ouargla et de l’oued R’ir est alluvionnaire, les déjections de l’Igargar s’y sont accumulées sur de grandes profondeurs ; ce sol chargé de produits chimiques donne d’ailleurs des eaux purgatives, à peine potables. Le Touat doit à ses grès des eaux très pures et un sol pauvre.
Les indigènes en ont conscience et recherchent avidement le fumier mais leur cheptel misérable ne leur en fournit guère ; de très rares chameaux, quelques ânes et quelques moutons étiques ; les poules elles-mêmes sont remarquables par leurs dimensions exiguës ; elles pondent des œufs à peine plus gros que ceux du pigeon. Toute la vie animale domestique est malingre ou absente. Le chien n’existe pas, trop mal outillé pour survivre aux étés sahariens, avec sa peau dépourvue de pores sudorifiques.
Sous les palmiers mûrissent d’excellents raisins, qu’on retrouve[272] d’ailleurs sur bien des points au Sahara (Hoggar par exemple) ; ils ne ressemblent pas du tout à ceux d’Algérie, ils ont la peau aussi fine et le grain aussi petit que les raisins les plus septentrionaux de France, évidemment la vigne s’étiole au sud comme au nord de la zone méditerranéenne. En compagnie du raisin les jardins du Touat ont des fruits et des légumes, figues, oignons, fèves, pastèques, etc., qui constituent pour l’indigène une ressource alimentaire appréciable, mais qui ne sont pas des richesses économiques réalisables.
Dans cette catégorie des produits agricoles susceptibles d’alimenter un commerce viennent très loin après les dattes, le henné et le tabac, d’importance pécuniaire insignifiante, mais surtout les céréales, mil, orge et blé. D’après M. le capitaine Flye Sainte-Marie le blé vient très beau, et le Touat proprement dit, à lui seul, en a produit en 1904 17600 quintaux, de quoi suffire non seulement aux besoins locaux, mais encore à ceux de la garnison et peut-être à une faible exportation.
Il est vrai que la consommation locale de denrées alimentaires doit être très faible. Incontestablement, les prolétaires des oasis, autrement dit les haratin, sont une population à peine nourrie. On leur voit d’effrayants sternums de momies. Le climat, en été du moins, diminue d’ailleurs l’appétit et fait tomber l’embonpoint. L’Européen lui-même, si j’en juge par mon exemple, perd rapidement, avec ses habitudes de suralimentation, une partie notable de ses provisions adipeuses. Sous la double influence du climat et de la famine, les haratin ont dû développer d’étonnantes facultés d’assimilation digestive intégrale, et d’évacuation minima. Il y aurait là un beau champ d’études pour ces cas de jeûne extraordinairement prolongé, sur lesquels a été attirée l’attention des médecins, des psychistes et même du grand public. Les oasis doivent être pleines de Succi, auxquels il a manqué un manager.
Les autorités françaises craignent ou feignent plaisamment de craindre que le Touat ne se vide d’habitants, le bruit s’étant répandu dans la population qu’il y avait au nord des pays où l’on mangeait. Le Tell à ce point de vue malgré la distance, a toujours exercé une attraction puissante sur les Touatiens. Si M. Basset a pu étudier à Tiaret le dialecte berbère du Touat et du Gourara, c’est qu’il y a trouvé une colonie de haratin.
Sur la misère et la famine au Touat M. l’interprète militaire Martin[210] m’a fourni quelques chiffres dont je lui laisse la responsabilité,[273] mais qui sont effrayants. Un palmier vaut à Ouargla de 30 à 50 francs ; dans l’oued R’-ir de 60 à 70 ; et les meilleures espèces (deglat nour) vont à 300 francs ; au Touat les palmiers ont une valeur maximum de 6 à 7 francs le pied, soit environ dix fois moindre.
La journée de travail au Touat se paie un sou et une poignée de dattes.
A la suite de l’occupation française, la situation économique a été modifiée profondément, et dans un sens péjoratif, au moins par certains côtés.
Le Touat a toujours vécu de la traite des Nègres ; elle lui était doublement nécessaire, d’abord pour renouveler sa main-d’œuvre, puis comme aliment principal du commerce transsaharien. La suppression de la traite est un coup terrible, qui frappe le Touat à la fois dans son agriculture et dans son commerce ; la main-d’œuvre noire, la seule viable sous cette latitude, tend à émigrer, maintenant que nos lois lui en donnent le droit, et la sécurité des grands chemins la possibilité ; comment comblera-t-on les vides ? Et d’autre part, à travers le Sahara, sur cette route commerciale dont le Touat fut un entrepôt, le Soudan, à quelques plumes d’autruches près, n’a jamais expédié que de la marchandise humaine, en échange des produits manufacturés qu’il recevait de la Méditerranée, et qui d’ailleurs, aujourd’hui, lui parviennent plus commodément par la voie océanique. Nous avons rencontré à Ouallen une caravane du Touat en partance pour Tombouctou ; elle se composait de deux chameaux chargés de tabac. Les fameuses caravanes d’autrefois, si surfaites qu’on les imagine, étaient apparemment plus fortes et transportaient des marchandises plus variées.
Par surcroît notre venue a troublé profondément le commerce intérieur du Sahara entre nomades et sédentaires. Le Touat était le marché où les produits agricoles (surtout les dattes) s’échangaient contre ceux de l’élevage (mouton, beurre). Pour des raisons diverses, et à titre plus ou moins provisoire ou définitif, les nomades ont désappris le chemin du marché.
Ceux du sud, les Touaregs, ont quitté les oasis après l’occupation d’In Salah pour n’y plus reparaître pendant de longues années.
Ceux de l’ouest sont les Beraber, depuis la disparition des Ouled Moulad ; c’étaient les nomades particuliers du Touat proprement dit ; ils ne l’ont quitté qu’après de sanglants combats, et ils semblent encore loin d’accepter le nouvel ordre des choses.
Ces désertions du moins ne sont pas durables ; la question Touareg[274] est déjà résolue et la question Beraber recevra quelque jour une solution. Au nord, du côté des nomades algériens, clients propres du Gourara, le mal est moindre, mais il est irréparable. Les Hamyan et les Trafi du Sud-Oranais, poussés par l’administration française, ont vite repris, après une courte interruption leur habitude séculaire d’envoyer une fois l’an au Gourara de grandes caravanes[211]. Pourtant M. le capitaine Flye Sainte-Marie, dans son étude très documentée, constate la décadence du trafic sud-oranais, malgré les encouragements administratifs ; au Touat proprement dit le nombre des chameaux oranais est tombé de 4300 à 1700[212]. L’insécurité de la frontière n’est pas étrangère à cette déchéance. Mais la grosse raison est ailleurs, elle a été indiquée par MM. Lacroix et Bernard[213]. Les conditions économiques ont été si profondément modifiées dans l’Oranie par l’occupation française que la répercussion s’est fait sentir sur l’alimentation. « Les indigènes arrivent à ne plus tenir aux dattes. » Ou s’ils en consomment encore, ce sont les dattes supérieures de l’oued R’ir. La datte en Algérie est tombée du rang d’aliment à celui de friandise ; et les médiocres produits des palmeraies touatiennes s’accumulent en stocks invendus.
En compensation de tant de ruines l’occupation française a eu ses avantages. Le premier est une garnison qui laisse dans le pays à peu près l’intégralité de sa solde. Dans une sous-préfecture française c’est un bienfait apprécié. Au Touat ç’a été le point de départ d’une révolution économique. L’argent monnayé a tué le troc ; les Juifs, les Mzabites, voire les Chaamba ont fondé des maisons de commerce ; au lieu des anciennes caravanes libres qui venaient échanger en nature des moutons contre des dattes, on a vu apparaître des caravanes organisées par entreprise, exécutant des commandes, et qui viennent chercher au Touat non plus des dattes mais de l’argent ; elles ont emprunté des routes nouvelles celles de l’est qui viennent du M’zab, d’Ouargla, ou même de Gabès. A la place de l’ancienne vie commerciale paralysée on en voit naître une nouvelle.
Autre bienfait corrélatif du premier, la garnison a apporté la sécurité, grâce à laquelle on cherche à développer les procédés d’irrigation et l’étendue des cultures. Les sondages artésiens, entrepris, il est vrai, avec un outillage insuffisant, n’ont encore rien donné ; et il est bien possible que ce mécompte ne soit pas fortuit. Les indigènes,[275] au Touat-Gourara, ont creusé deux puits artésiens seulement, en regard de foggaras qui se comptent par milliers ; ce sont après tout d’admirables hydrauliciens, et ils compensent l’infériorité de leur outillage par une expérience de dix ou vingt siècles ; nous pouvons espérer faire mieux, mais non pas autrement. La simple réparation des foggaras a donné d’excellents résultats. D’après le capitaine Flye Sainte-Marie le débit « a augmenté dans une proportion incroyable (1/4, 1/3, 3/7)[214] ». On songe à bétonner les canaux à l’air libre (séguia) et les bassins de réception (madjen) pour éviter l’infiltration. (Voir pl. XXXIX, phot. 74 et XXXVIII, 71 et 72.) Bref on est en mesure d’augmenter notablement les ressources en eau.
On a pu amorcer ainsi aux oasis quelques parcelles nouvelles de terre cultivable, malgré les difficultés qu’oppose ici comme en Égypte la salure du sol[215]. La production des céréales s’est accrue dans une assez forte proportion, et la vente du blé a pu compenser en quelque mesure le mévente des dattes.
Ce vieil organisme économique très affaibli lutte de son mieux pour traverser une crise redoutable.
Les nitrates de potasse. — On a pu croire que le Gourara-Touat avait des chances de développement minier. On y a signalé depuis longtemps des gisements de nitrates, sur la frontière du Touat et du Gourara (à Ouled Mahmoud, Kaberten, Sba, Tililan[216]). J’en ai vu trois qui se ressemblent, et je crois savoir que l’autre est du même type.
M. Pouget, professeur à l’École des sciences d’Alger, a bien voulu analyser un échantillon de terre à nitrates, que j’ai rapporté d’Ouled Mahmoud. Il y a trouvé une forte proportion de sel de cuisine (41 p. 100). Quant aux nitrates, ce sont plutôt des nitrates de soude que de potasse. Mais « le traitement que les indigènes font subir au minerai transforme partiellement le nitrate de soude en nitrate de potasse, grâce à la présence de chlorure de potassium[217] ». En somme, on pourrait extraire du minerai 6,45 p. 100 de salpêtre. C’est une quantité faible, les caliches du Chili en contiennent de 3 à 10 fois plus.
[276]La teneur du minerai en salpêtre est variable. Elle n’est suffisante qu’après une forte pluie, suivie d’un grand vent, c’est-à-dire d’une forte évaporation. Les indigènes l’affirment du moins, et ils attendent ce moment favorable pour l’exploitation intermittente de leurs nitrates. D’ailleurs l’ascension des sels par capillarité est, paraît-il, un phénomène constant ; les déchets des caliches se rechargent automatiquement, et peuvent être exploités de nouveau. Au Gourara, cette particularité inspire à M. Flamand l’espoir qu’il existe en profondeur des gisements très riches, alimentant les gisements pauvres superficiels.
Il faut espérer qu’un coup de sonde sera donné par l’administration qui dispose d’un petit appareil à forages. Le terrain encaissant est partout le même, argiles cénomaniennes ou albiennes.
Il faut avouer que l’aspect des gisements n’est pas engageant. Celui d’Ouled Mahmoud est tout petit ; c’est une sebkha minuscule de cent à deux cents mètres de diamètre. Elle est enclose dans la palmeraie, en contre-bas du village, dans une dépression marquée. Toutes les déjections et toutes les matières animales ont dû y être entraînées et s’y accumuler depuis des siècles, d’autant plus que le sol environnant est d’argile imperméable. On est donc tenté de croire que la petite nitrière d’Ouled Mahmoud est simplement l’égout naturel d’un village très ancien.
Celles de Sba et de Tililan sont aussi de petites sebkhas à proximité de villages. L’outillage et les procédés d’extraction sont assez ingénieux quoiqu’ils donnent des résultats déplorables. D’après M. Pouget, plus de la moitié du salpêtre contenu dans le minerai se retrouve dans les déchets, soit 3,8 sur 6,45 p. 100. D’autre part, le nitrate de potasse obtenu est très impur, il contient 33 p. 100 de nitrate de soude.
L’outillage et les procédés des Gourariens ne leur sont d’ailleurs pas particuliers. Ils étaient en usage dans les oasis des Zibans et de l’oued R’ir au milieu du XIXe siècle[218]. Je ne sais pas si les nitrières d’Ouled Mahmoud auront une autre fortune que celles des Zibans, aujourd’hui tombées dans l’oubli.
[161]Étienne Ritter, Le Djebel Amour, Bulletin du service de la carte géologique de l’Algérie, Alger, 1902.
M. Flamand attribue au Néocomien les grès du Gourara, mais dans un travail ancien, qui a précédé celui de Ritter (Flamand.... dans Documents pour servir à l’étude du Nord-Ouest Africain, par Lamartinière et Lacroix, Alger 1897).
[162]Foureau, Documents, etc., p. 824.
[163]Flamand, Sur la présence du Dévonien à Calceola sandalina dans le Sahara occidental, C. R. Ac. Sc., 1er juillet 1901.
[164]Ém. Haug, Sur deux horizons à Céphalopodes du Dévonien supérieur dans le Sahara oranais, C. R. Ac. Sc., 6 juillet 1903.
[165]Note de M. Chudeau : « Le sondage de Tiberkamin atteignait 66 mètres : il y aurait : alluvions, 3 mètres ; Crétacé, 7 mètres ; Primaire. Le fossile m’a paru être Atrypa reticularis ? »
[166]Observation de M. Chudeau.
[167]Flamand, Sur la présence du Dévonien inférieur dans le Sahara occidental, C. R. Ac. Sc., 2 juin 1902.
[168]Supplément au Bulletin, etc., juillet 1907.
[169]Supplément au Bulletin, etc., juillet 1907 ; voir en particulier les coupes, p. 151 et 152.
[170]Les grès dévoniens de Maurétanie sont eux aussi horizontaux, d’après le témoignage oral et les carnets de M. Dereims, le seul géologue professionnel qui les ait vus.
[171]Un tronc de 30 centimètres de diamètre (Note de M. Chudeau).
[172]Bornhardt, Deutsch Ost. Afrika, Berlin, 1900, t. VII.
[173]On ne les trouvera pas sur les anciennes cartes. Il faut les chercher sur les cartes Prudhomme et Niéger.
[174]Brunhes, L’Irrigation.
[175]Lieutenant Niéger : Le Touat, Bulletin du comité de l’Afrique française. Suppléments no 7 et 8, juillet et août, 1904.
[176]Dr Siegfried Passarge, Die Kalahari. Berlin, 1904, p. 667.
[177]Hartmann, dans Zeitschrift für assyriologie, Bd XIX, p. 352.
[178]La carte Mussel, encore inédite, est le document le plus sérieux.
[179]Martin, Oasis sahariennes, Bulletin de la Société de géog. d’Alger, 1906, p. 395.
[180]René Basset, Étude sur la zénatia du Mzab, de Ouargla et de l’Oued-R’ir. Publication de l’École des Lettres d’Alger, 1893.
Du même auteur une étude sur le dialecte du Gourara dans : Journal Asiatique, 1885, Notes de Lexicographie berbère.
[181]W. Marçais, Le Dialecte arabe parlé à Tlemcen, publication de l’École des Lettres, 1902, p. 13 et 14.
[182]Publiée par le Dr Hamy, on la donne en appendice.
[183]Siegfried Passarge, Die Kalahari.
[184]René Basset, dans Journal Asiatique, VIII, série X, 1887, p. 365 et s.
[185]Bull. Soc. de Géogr. d’Alger.
[186]Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions, mai 1903, voir aux appendices.
[187]A l’étude au laboratoire géologique de M. Flamand.
[188]Barth, Reisen und Entdeckungen, II, p. 83.
[189]Également à l’étude au laboratoire de M. Flamand.
[190]Corippus, Johannide, II, 109 ; IV, 667. El Bekri, Texte arabe de de glane, p. 161.
[191]Laquière, La colonne Servières : publication du Bulletin du comité de l’Afrique française, p. 21.
[192]Wattin, l. c.
[193]Segonzac, Voyages au Maroc, 1899-1901, p. 160, fig. 92 ; voir aussi les fig. 95, 104, 105, 109.
[194]Duveyrier en signale d’analogues, qu’il qualifie de garamantiques, à R’adamès et au Fezzan (Voir Exploration du Sahara, p. 251).
[195]Louis Watin, Origine des populations du Touat, Bull. Soc. Géogr. Alger, 1905, 2e trimestre, 209, etc.
[196]Ernest Mercier, Histoire de l’Afrique septentrionale, t. II, p. 382.
[197]Nedromah et les Traras. Publication de l’École des Lettres d’Alger. 1901, p. VII.
[198]L. c., p. XV et XVI.
[199]L. c., p. V.
[200]L. c., p. 66.
[201]René Basset, Notes de lexicographie berbère. Le dialecte des Beni Menacer, Journal asiatique, 1885, p. 5.
[202]Id., p. 20 en note.
[203]René Basset, Les dictons satiriques attribués à Sidi Ahmed ben Yousof, Journal asiatique, 1890, p. 6.
[204]R. Basset, Histoire de Tombouctou, p. 21.
[205]Notons qu’il y a eu un empire Saharien Zenati, dont le centre était à Sidjilmessa (Tafilalet), mais sur lequel on a actuellement des données bien vagues.
[206]Archives marocaines, no II, p. 216.
[207]Journal asiatique, VIIIe série, X, 1887, p. 365 et suiv.
[208]Flye Sainte-Marie, Bulletin de la Société de Géographie d’Oran, 1904, p. 345 et suiv. Niéger, l. c. Laquière, l. c.
[209]Bibliothèque de l’enseignement agricole, publiée sous la direction de Münz, t. II, p. 292.
[210]Communication orale.
[211]Voir Bulletin du Comité de l’Afrique française. Renseignements coloniaux. Septembre 1905, p. 350.
[212]Bull. Société d’Oran, 1904, p. 370.
[213]L’Évolution du Nomadisme en Algérie, p. 238 et 239.
[214]L. c., p. 380.
[215]L. c., p. 387.
[216]G.-B.-M. Flamand, Aperçu sur la géologie du bassin de l’oued Saoura (Extrait des Documents pour servir à l’histoire du Nord-Ouest Africain par Lamartinière et Lacroix, Alger, 1897, p. 108). — Id., De l’Oranie au Gourara, 1897. — Id., Observations sur les nitrates du Sahara... (Bull. Soc. géol. de Fr., IVe série, 1902, p. 366-368).
[217]Extrait d’une note de M. Pouget, qu’on donne intégralement dans l’appendice IX.
[218]G.-B.-M. Flamand (Aperçu..., p. 113) donne là-dessus d’intéressants détails d’après le capitaine Carette (1844) et l’ingénieur Dubocq (1852).
[277]CHAPITRE VII
TIDIKELT ET MOUIDIR-AHNET[219]
Il y a de bonnes raisons, géologiques, hydrographiques et de géographie humaine, pour réunir dans une étude commune le Tidikelt et les premiers plateaux touaregs.
La région étudiée et qui fait l’objet d’une carte d’ensemble se divise commodément en trois régions naturelles qu’on étudiera à part : 1o le Tidikelt, 2o la pénéplaine inhabitée entre le Tidikelt et le Mouidir-Ahnet, 3o le Mouidir-Ahnet.
Géologie du Tidikelt.
Le Tidikelt s’allonge à la bordure méridionale du grand plateau de Tadmaït. Il fait donc pendant au Touat et au Gourara qui sont les bordures occidentale et septentrionale du même plateau.
Crétacé. — Les roches crétacées sont ici les mêmes qu’à l’ouest et au nord. Un magnifique gisement de fossiles se trouve à la tête de l’oued Aglagal ; les Ostrea olisiponensis sont très nombreuses et très belles ; c’est toujours comme à Matriouen et à el Goléa le même étage qui est fossilifère, Cénomanien-Turonien.
La falaise de l’oued Aglagal, haute environ de 200 mètres, est une magnifique coupe naturelle qui s’applique à la presque totalité des couches crétacées au Tadmaït. Les étages supérieurs et moyens du Crétacé sont ainsi représentés de haut en bas (fig. 53) :
| 10. | Calcaire à silex. | une soixantaine de mètres. supposé, d’après la stratigraphie, représenter le Sénonien, mais sans preuves paléontologiques. |
|
| 9. | Argile. | ||
| 8. | Grès. | ||
| 7. | Argiles à silex. | ||
| [278]5. | Calcaire compact. | une centaine de mètres. | |
| 4. | Argiles ou marnes à Ostrea olisiponensis. | ||
| 3. | Calcaires à Ostrea olisiponensis. | ||
| 2. | Argiles très puissantes. |
Au pied de la falaise s’étend très loin une plaine d’ennoyage, alluvions quaternaires et dunes, et c’est à une quinzaine de kilomètres plus loin seulement et en contre-bas de cent mètres, au Kreb er Rih, qu’on voit réapparaître le Crétacé, représenté par l’Albien gréseux du type habituel.
Cette falaise, que mon itinéraire s’est trouvé croiser à l’oued Aglagal (pl. XLIII, 81), est un accident très important. C’est elle qui limite au sud le Tadmaït, elle dépasse 300 kilomètres de long, et son altitude, d’un seul jet, dépasse parfois 300 mètres et n’est jamais inférieure à 150. Elle est jalonnée par des sources A. Tabbagueur, A. Souf, A. el Hadjadj, A. Guettara. C’est la lèvre en rejet d’une superbe faille est-ouest qui se constate directement. Au sud de la falaise, au pied de laquelle affleure le grès albien, on voit réapparaître, en contre-bas de plusieurs centaines de mètres, toute la série des calcaires crétacés ; qui constituent des causses étendus entre In Salah et la falaise[220] (Voir la carte en couleurs.)
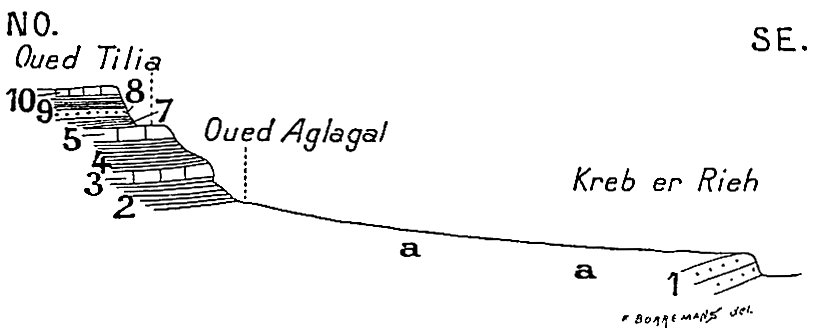
Fig. 53. — Falaise terminale du Tadmaït. — 1/600000.
1, grès albiens ; a, sol masqué par des formations récentes ; pour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, se rapporter au texte.
(Bull. Soc. géol. Fr., 4e série, t. VII, p. 196, fig. 1.)
Il est donc certain que le Tidikelt représente par rapport au Tadmaït un compartiment effondré.
Les grès albiens jouent au Tidikelt le même rôle prépondérant qu’au Touat et au Gourara, mais ils sont développés surtout aux deux extrémités, orientale et occidentale ; les bois silicifiés caractéristiques sont épars sur le sol dans toutes les directions autour d’In Salah comme autour d’Aoulef.
Au centre, entre In R’ar et Tit, la continuité du placage albien[279] est tout à fait interrompue. Un grand affleurement primaire s’avance en golfe jusqu’auprès d’In R’ar. L’érosion de l’oued Souf y est certainement pour quelque chose ; mais l’explication est insuffisante ; il faut admettre l’existence de failles nord-sud ; de part et d’autre de l’affleurement primaire en effet on retrouve des lambeaux importants de calcaires crétacés (étage moyen ou supérieur ?) qui se présentent à la place et au niveau des grès albiens.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XLIII. |

Cliché Pichon
81. — OUED AGLAGAL, entaillant la falaise terminale du Tadmaït au sud.
Argiles et calcaires crétacés.
Je les ai vus à Baba-Ahmed et à Aïn Tarlift.
La falaise de Baba Ahmed a 60 à 70 mètres de haut (5 mm. de différence au baromètre anéroïde).
Les couches se succèdent ainsi de la base au sommet.
| Calcaires massifs | 40 | mètres. |
| Argiles schisteuses rouge brique | 10 | — |
| Calcaire | 5 | — |
| Argiles ? où se trouve la source | 5 | — |
A l’Aïn Tarlift la falaise terminale est beaucoup moins haute, une vingtaine de mètres et présente approximativement la composition suivante de la base au sommet :
| Grès | 6 | mètres. |
| Argiles | 7 | — |
| Calcaires | 7 | — |
Contre cette formation sensiblement horizontale viennent buter, au pied de la falaise, les couches carbonifériennes énergiquement plissées ; à Baba Ahmed la couche calcaire supérieure contient des fossiles, malheureusement très friables et indéterminables.
Malgré l’absence de fossiles, l’âge crétacé de ces formations n’est pas douteux, mais elles n’ont plus du tout le facies de l’Albien, au niveau duquel elles se présentent pourtant, et dont il parait difficile d’admettre qu’elles représentent, par transformation latérale ; un facies particulier. Un système de failles est donc vraisemblable.
Notons d’ailleurs que le golfe primaire d’In R’ar, sur tout son pourtour, c’est-à-dire sur le trajet probable des failles, est jalonné de sources très nombreuses qui jaillissent au sommet des falaises ; Aïn Baba Ahmed, Imellal, Aïn Othman, el Mouizzir, etc. ; la carte Prudhomme n’en donne pas moins de dix-huit.
Des accidents tectoniques beaucoup moins importants, mais de même orientation nord-sud jouent au Tidikelt au point de vue humain un rôle considérable, toutes les palmeraies du Tidikelt sont des lignes de végétation allongées nord-sud ; c’est particulièrement marqué à Foggaret ez Zoua, In Salah, Aoulef. En général la ligne[280] des palmiers est doublée d’une sebkha étirée dans le même sens. Cela revient à dire que les eaux du Tidikelt sont concentrées dans des poches ou plus précisément, dans des cuvettes synclinales, très allongées dans le sens de la méridienne. M. Flamand, à propos de Foggaret ez Zoua et d’In Salah, était arrivé à cette conclusion, et elle paraît incontestable ; les couches crétacées de Baba Ahmed ont une allure synclinale, en cuiller, sensible à l’œil. En somme, les terrains du Tidikelt, en général crétacés, sont affectés des plis posthumes, dont la direction est imposée par celle des plis primaires sous-jacents ; car tous, les calédoniens, comme les hercyniens, ont ici une direction uniformément subméridienne[221]. Ces plis ont rejoué, et les failles profondes se sont traduites en surface par des fléchissements en cuvettes synclinales de la couverture crétacée.
Sous-sol primaire. — La couverture crétacée est sans épaisseur au Tidikelt et, à sa limite sud, il est facile d’étudier le sous-sol primaire. Cette limite est très nette, elle est marquée presque partout par des falaises abruptes mais peu élevées (quelques dizaines de mètres).
Les formations primaires qu’on observe au pied des falaises et dans le golfe d’In R’ar sont généralement carbonifériennes, ou du moins presque tous les gisements de fossiles signalés sont carbonifériens.
Les fossiles abondent dans la dépression d’In R’ar (Aïn In Mellal, Aïn Mouizzir Sr’ir, Aïn Othman). Des fossiles de cette provenance ont été étudiés par M. Flamand[222] qui conclut ainsi : « On voit que toute cette faune, dans son ensemble, est bien caractéristique du terrain carboniférien et que — la présence d’espèces telles que Plectambonites analoga, Productus semireticulatus, Michelinia favosa, Fenestella membranæ, Pleurotomaria Yvani, etc., indique vraisemblablement l’existence de deux étages viséen et tournaisien. »
Des fossiles d’Aïn Tar’lift appartiennent au même étage.
Au chapitre précédent on a déjà mentionné les gisements de fossiles carbonifériens limitrophes du Touat et du Tidikelt, à Aïn Cheikh et Hacian Taïbin ; ainsi que le gisement authentiquement éo-dévonien d’Aïn Cheikh.
M. Flamand qui en a étudié le premier les fossiles, conclut ainsi[223] :[281] « L’ensemble de cette faunule caractérise nettement le Dévonien inférieur ; de plus, la présence et l’association de quelques formes : Chonetes sarcinulata Schloth., Spirifer cf. Rousseaui Rouault, Pleurodictyum du groupe du constantinopolitanum, etc., permettent de considérer les assises gréseuses d’Haci Cheikh comme appartenant vraisemblablement à l’étage coblentzien. »
Ce sont les seuls fossiles dévoniens qui aient encore été signalés au Tidikelt. Les formations carbonifériennes sont malheureusement bien loin d’avoir ici la même uniformité de facies que dans le nord : dans la zone du Béchar, par exemple, ou même encore au Gourara, le Carboniférien (Dinantien) se distingue aisément à ses assises massives de calcaire bleuâtre.
Au Tidikelt, le calcaire n’a pas tout à fait disparu (Hacian Taibin, par exemple). Mais les marnes prédominent ; ce sont elles qui fournissent les plus beaux fossiles (Aïn Cheikh, Tar’lift). Elles sont interstratifiées de schistes très fissiles (ktoub), de grès très fissiles ou même de grès en bancs assez épais, qui paraissent appartenir à l’étage.
Ce caractère protéiforme du Carboniférien est d’autant plus regrettable qu’on peut être amené à confondre ces formations avec d’autres d’un âge tout différent. S’il y a lieu de croire, en effet, que le Carboniférien soit au Tidikelt l’étage primaire le plus largement représenté en surface, il est incontestable que les plis et les accidents primaires ont chance d’avoir amené à l’affleurement tous les étages du Dévonien et du Silurien.
En effet l’architecture de la pénéplaine primaire apparaît au Tidikelt avec plus de netteté relative qu’au Touat ; dans le Tidikelt occidental, en particulier, l’étude du plissement hercynien à Aïn Cheïkh et au dj. Aberraz est très instructive. Les deux coupes s’appliquent au même plissement, à 20 kilomètres environ de distance l’une de l’autre, et elles sont bien symétriques.
[282]Aïn Cheikh. — La coupe (fig. 54) est loin de me satisfaire ; je l’ai relevée trop vite en 1903 et je n’ai pas revu Aïn Cheikh depuis. La coupe a environ 4 kilomètres de long, transversalement à la direction du pli. C’est une fenêtre ouverte à travers les grès du Crétacé inférieur par l’érosion de l’oued Chebbi. Voici d’ouest en est la succession des affleurements primaires.
1. Marnes et calcaires intercalés, fossiles carbonifériens abondants.
2. Formations peu résistantes, accusées en creux et couverts de débris, supposées représenter le Méso et le Néo-dévonien ?
3. Les grès éodévoniens, avec intercalations d’argile, fossilifères. La source d’Aïn Cheikh jaillit entre deux feuillets de grès. Des dépôts travertineux tout voisins attestent l’importance de la source à l’époque quaternaire.
4. Argiles ou marnes, formation peu résistante, accusée en creux et couverte de débris, difficile à observer. (Méso-dévonien ?)
5. Couches de calcaire amarante compact, contenant des fossiles, en particulier des orthocères, indéterminables. (Méso-dévonien ?)
6. Schistes noirs, fissiles, puissants, l’oued Chebbi y a creusé son lit. Il doit son nom à un gisement d’alun (chebbi) qui se trouve en grands cristaux dans un lambeau d’alluvions quaternaires à proximité de la source. Il semble donc bien que ces schistes soient alunifères.
Or les schistes à graptolithes, rapportés par Foureau du Tindesset, sont des schistes alunifères, et jamais encore on n’a signalé d’alun au Sahara dans une formation autre que silurienne. D’autre part, la source d’Aïn Chebbi, qui est abondante et pérenne, est probablement en relation avec un accident, une faille.
Les couches 1, 2, 3, 4, 5 plongent toutes à l’ouest, sous un angle de 45° peut-être. Le grès éodévonien recouvre les calcaires à orthocères, plus jeunes que lui. De part et d’autre de l’affleurement éodévonien qui marque nécessairement l’axe du pli, les affleurements de couches plus jeunes ne sont nullement symétriques.
Nous avons donc un pli orienté nord-sud (simple ou double ?), vigoureusement déversé sur l’est, et qui vient s’écraser le long d’une faille contre un horst silurien.
Notons que ceci est une interprétation tardive, après des années écoulées, de la coupe notée sur le carnet.
Djebel Aberraz. — Celle du dj. Aberraz en revanche (fig. 55), encore que lacunaire, ne fait aucune part à l’hypothèse interprétative ; elle est due à M. Chudeau.
Le djebel Aberraz est formé par deux anticlinaux déversés vers l’est ; le pli occidental surtout est important ; ils contrastent nettement avec la région située plus à l’est (jusqu’à Bled el Mass) où les plis à peine[283] marqués forment une série de dômes et de cuvettes nettement fermés.
Les couches carbonifériennes fossilifères s’observent au voisinage de Hacian Taïbin sur le versant ouest du pli occidental.
Au sommet de ce pli, au dj. Aberraz proprement dit, affleurent en puissantes assises des grès qui ont le facies et la masse des grès éodévoniens. Cette partie du pli ayant été malheureusement traversée de nuit la succession des couches n’a pas pu y être notée.
Ce plissement hercynien est arrêté à l’est par le horst calédonien de Bled el Mass. Il est composé de grès et de schistes verts et violets, parfois de couleur claire, très plissés et injectés de quartz. (Voir pl. XLIX, 90.)
Ce horst silurien était déjà arasé à l’époque dévonienne, puisque le grès dévonien de Garet Tamamat repose dessus en couches horizontales.
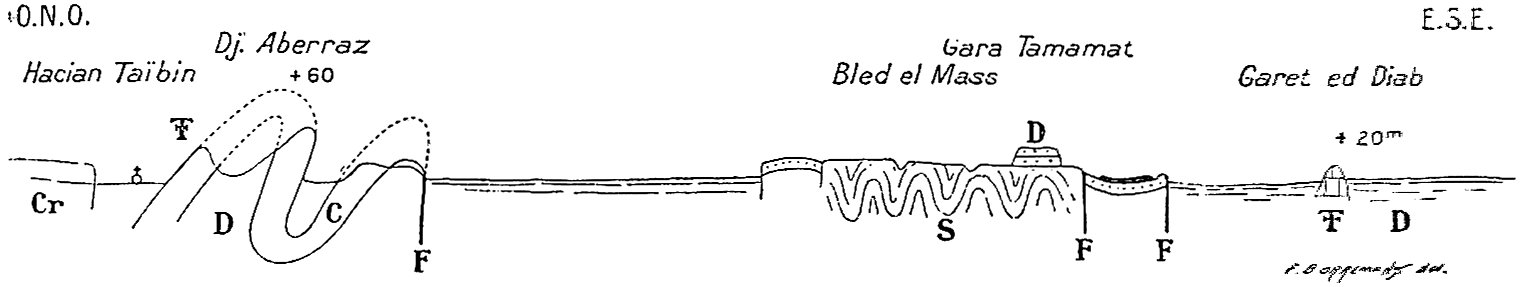
Fig. 55. — Coupe d’H. Taïbin à Garet el Diab. — 1/600000,
Cr, Crétacé inf. ; C, Carbonifère ; D, Dévonien ; S, Silurien ; Ŧ, pointe fossilifère ; F, faille et diaclase.
(Bull. Soc. géol. Fr., 4e série, t. VII, p. 202, fig. 2.)
Il semble donc bien établi qu’un horst silurien, bordé à l’ouest par une faille nord-sud, s’étend d’Aïn Chebbi à Bled el Mass ; c’est le butoir contre lequel est venu se déverser sur toute sa longueur visible le pli hercynien d’Aïn Cheikh-Dj. Aberraz ; et nous constatons ici, avec une grande précision, la limite entre les domaines respectifs des plis hercyniens et calédoniens.
Si mes souvenirs, un peu lointains, sont exacts, les schistes alunifères d’Aïn Chebbi sont bien moins dérangés que les couches de Bled el Mass. — Ceux du Tindesset, photographiés par Foureau[224], paraissent assez voisins de l’horizontale. Il n’y a là aucune contradiction puisque les schistes à graptolithes sont rattachés par M. Haug au Silurien supérieur[225]. Les couches de Bled el Mass sont probablement du Silurien inférieur[226].
[284]Pli d’In R’ar. — Le pli hercynien d’In R’ar est encore plus mal connu que celui d’Aïn Cheikh, pourtant son étude nous conduit à des conclusions identiques.
D’après un rapport manuscrit de M. Voinot, les couches primaires plongent en sens inverse de part et d’autre du golfe primaire.
D’autre part, sur l’itinéraire de Tirechoumin à Baba-Ahmed et dans le prolongement du golfe, on rencontre successivement des couches qui plongent à l’est, au voisinage de Tirechoumin, et à l’ouest au voisinage de Baba Ahmed. Il ne semble donc pas douteux qu’il n’y ait là un grand pli anticlinal étiré nord-sud.
Le pli d’In R’ar s’arrête brusquement à 15 kilomètres environ au sud de Tirechoumin, à une ligne de faille au delà de laquelle le Carboniférien fossilifère se présente brusquement en couches horizontales sur de grandes étendues. Plus au sud, on ne retrouve plus de couches carbonifériennes ou dévoniennes plissées, et quand on arrive à des couches plissées, elles appartiennent au substratum calédonien. Ici donc encore nous pouvons délimiter avec précision les domaines respectifs des plissements hercyniens et calédoniens (fig. 50).
En somme, dans le Tidikelt occidental, d’In R’ar à Aïn Cheikh, le sous-sol primaire est une pénéplaine où l’on distingue deux faisceaux de plis hercyniens, entre lesquels le horst calédonien projette un promontoire jusqu’à la falaise crétacée. Et si les détails manquent, ce sont là du moins des traits généraux absolument exacts.
Sud d’In Salah. — Dans le Tidikelt oriental (In Salah), la structure de la plate-forme primaire est plus mal connue et plus incertaine ; je n’ai de documents que sur la route d’In Salah au Mouidir par Haci el Kheneg (route faite en partie de nuit).
Le puits d’el Kheneg est dans des grès bien lités, interstratifiés de quelques lamelles argileuses ; à travers les couches minces d’argile les couches gréseuses sont réunies par des colonnettes de grès, très régulières, qui se débitent en rondelles tout à fait semblables, comme forme et comme dimension, à des bourres de fusil de chasse ; dans les argiles, j’ai recueilli une Rhynchonnelle.
Malheureusement, ce fossile n’est pas caractéristique. D’après le facies, on pourrait croire les couches d’el Kheneg éodévoniennes ? (surtout à cause des « bourres de fusil », mais c’est naturellement un indice très faible). En tous les cas elles appartiennent plutôt à la série dévonienne.
On sait que dans un échantillon de schistes provenant de Haci el Kheneg et rapporté par le lieutenant Cottenest, M. Flamand a découvert[285] des Graptolithes[227] ; ces schistes ont été recueillis au campement à quelques centaines de mètres du puits. Leurs relations stratigraphiques avec les terrains voisins sont inconnues.
Il semble impossible d’attribuer au Silurien les grès à colonnettes de H. Kheneg — qui par définition ne sont pas des schistes à graptolithes. Mais ces grès supposés éodévoniens sont à peine dérangés, ils plongent vers l’ouest d’une inclinaison très légère. Ils ont donc échappé au plissement hercynien, et, comme à Garet Tamamat ils reposent vraisemblablement sur le horst silurien.
Seulement je ne puis pas indiquer, dans le Tidikelt oriental les limites exactes de ce horst.
Le substratum primaire apparaît, le long de l’oued Inesmit, au pied de la falaise crétacée, à une quarantaine de kilomètres au S.-S.-E. d’In Salah. Il est représenté par des schistes fissiles noirs, des calcaires bleus à Crinoïdes et à Cyathophyllum en bancs réguliers, des marnes, des grès en plaquettes.
C’est un facies qui rappelle celui des couches carbonifériennes. Les strates plongent au N.-N.-O., d’une inclinaison légère, mais plus accusée qu’à H. el Kheneg. Je n’ose pas risquer d’hypothèse explicative.
Malgré l’incertitude des limites exactes, il n’est pas douteux que l’extrémité du horst calédonien ne voisine avec In Salah puisque Haci el Kheneg est à une centaine de kilomètres seulement de l’oasis.
Nous sommes donc certains que le placage crétacé du Tidikelt, sur toute sa longueur, recouvre à peu près la vieille suture en zigzag des domaines hercynien et calédonien.
M. Flamand a signalé un plissement hercynien à l’est du Tidikelt (Aïn Kahla)[228], et rien naturellement n’empêche de croire que la zone des plis hercyniens ne réapparaisse plus loin à l’est.
Pourtant le pli d’Aïn Kahla a un axe cristallophyllien ou cristallin, et cela le rapprocherait plutôt des plis calédoniens que des hercyniens. La question n’existait pas au moment où M. Flamand a vu ce pli ; puisque alors, l’existence au Sahara de plis calédoniens n’était pas soupçonnée. Elle mériterait un supplément d’information ; si le pli d’Aïn Kahla est hercynien, il faudrait conclure que les plis hercyniens gagnent en intensité, d’ouest en est. Car les plis occidentaux ne[286] sont pas assez énergiques pour amener à l’affleurement des couches aussi anciennes.
Géologie de la pénéplaine entre le Tidikelt et le Mouidir-Ahnet.
Entre le Tidikelt et les premiers contreforts du Mouidir, de l’Ahnet et de l’Açedjerad s’étend une région naturelle, caractérisée par son extrême aridité. Elle est donc particulièrement difficile à connaître puisqu’on la traverse à marches forcées. Nous en avons amorcé l’étude en étudiant le substratum primaire du Tidikelt.
Cette région a été traversée par moi, seul ou en compagnie de M. Chudeau, suivant trois itinéraires différents — d’In Salah au Mouidir — de Taloak à Baba Ahmed — de Taourirt à Taloak.
D’In Salah au Mouidir. — On a déjà parlé des premières couches rencontrées, celles de l’O. Inesmit et de Haci el Kheneg.
Au pied des premières pentes du Mouidir, aux puits de Afoud dag Rali, Bel Rezaïm et In Belrem, on rencontre des couches particulièrement intéressantes parce qu’elles sont très fossilifères. Les fossiles, étudiés par M. Haug, appartiennent au Dévonien supérieur[229].
La succession des couches est la suivante de bas en haut :
| 1. Schistes bariolés | 10 | mètres. |
| 2. Grès | 5 | — |
| 3. Calcaires | 3 | — |
| 4. Grès à grain fin clairs | 10 | — |
| 5. Grès rouge | 3 | — |
Toutes ces couches sont peu ou prou fossilifères, mais surtout les calcaires. Dans les schistes et dans les grès rouges, on trouve des dépôts plâtreux, parfois cristallisés. Cette formation constitue une arête de faible altitude, — une vingtaine de mètres, très continue sur une trentaine de kilomètres et jalonnée par les trois puits.
Ces couches, au moins dans la partie nord de l’arête, plongent à l’ouest de 45° au moins, et d’autre part sur la rive droite de l’O. In Belrem dont elles longent la rive gauche, les grès éodévoniens plongent dans le même sens et semblent s’enfoncer en stratification concordante sous le Néo-Dévonien, le contact étant ennoyé. De sorte[287] qu’on croirait avoir affaire à un plissement qui aurait affecté les deux terrains. Une étude attentive montre qu’il n’en est rien.
En effet, les coupes aux deux puits septentrionaux Afoud dag Rali et Bel Rezaïm montrent bien les couches néo-dévoniennes plongeant à l’ouest de 45°.
Mais, au puits d’In Belrem, la stratigraphie est bien différente. Au puits même on retrouve, parfaitement horizontaux, ces mêmes calcaires fossilifères qui, aux deux autres puits, sont redressés énergiquement. Au sud du puits d’In Belrem, l’accident néo-dévonien n’est plus une arête, c’est une falaise où les couches néo-dévoniennes sont horizontales. Au pied de la falaise on voit affleurer un paquet de ces mêmes couches (ou du moins elles m’ont paru telles), extrêmement redressées et voisines de la perpendiculaire. La faille se constate donc directement.
En somme, le long de l’O. In Belrem, le contact est anormal entre l’Éo- et le Néo-Dévonien.
De Taloak à Baba Ahmed. — On a déjà parlé de la section septentrionale de cet itinéraire, depuis Baba Ahmed jusqu’à une quinzaine de kilomètres au sud de Tirechoumin. On a dit qu’il court là un pli hercynien, où le Carboniférien joue un rôle important, et qui s’arrête court à une ligne de faille, au delà de laquelle les couches carbonifériennes sont horizontales.
Ces couches horizontales s’étalent en plateau jusqu’à Haci Ar’eira sur un trajet d’une quinzaine de kilomètres. A la base sont des schistes très fissiles (ktoub), passant au grès en plaquettes. Au sommet, des calcaires violets fossilifères.
D’autre part, M. Villatte a rapporté des fossiles carbonifères de deux points situés à une petite distance dans l’ouest (Tin Tenaï et l’O. Kraam). La bande carboniférienne s’étend donc jusque-là. Au delà, entre Haci Ar’eira et l’oued In Gharen, à travers l’ennoyage, on voit percer, à deux ou trois reprises, des couches dont je ne puis pas indiquer la succession exacte, mais qui sont des bancs de grès bien lités, des grès en plaquettes, des schistes fissiles, des argiles schisteuses et des bancs de calcaires bleus à Crinoïdes. Le facies est à peu près le même que celui du Carboniférien (?) de l’oued Inesmit. Ces couches, quand elles ne sont pas horizontales, sont affectées d’une plongée légère vers le nord ; je crois que leur horizontalité a été dérangée par de petites failles.
Au sud de l’O. In Gharen, le long de l’oued Adrem, jusqu’à Taguerguera, sous les ergs Tessegafi et Ennfouss, le placage des[288] alluvions et des dunes soustrait le sous-sol primaire à l’observation sur de grands espaces. La région est une vaste cuvette où viennent converger tous les oueds de l’Ahnet et de l’Açedjerad ; l’oued Adrem est souvent encaissé entre des terrasses d’alluvions anciennes (terrasses de cailloutis auprès de H. Tadounasset).
Toutes les fois que le sous-sol primaire apparaît, il est d’aspect assez uniforme, des argiles et des marnes schisteuses de couleurs vives, avec d’assez rares intercalations de bancs calcaires très minces. Malgré l’uniformité du facies, cette formation essentiellement argileuse ou marneuse se rapporte à deux étages, Méso- et Néo-Dévonien. En effet, sur tout le pourtour méridional de l’erg Tessegafi les gisements fossilifères abondent.
Au-dessus des berges de l’O. Tadounasset sur les flancs d’une gara haute de 50 mètres environ, M. Villatte a recueilli dans des marnes une faune étudiée par M. Haug, qui conclut ainsi[230] : « L’ensemble de la faune possède incontestablement un cachet néo-dévonien. »
D’autre part, « un peu à l’est du campement de l’O. Tadounasset, à Tin Taggaret, M. Villatte a recueilli encore dans des marnes » plusieurs fossiles méso-dévoniens étudiés par M. Haug[231].
Enfin, nous pouvons signaler deux nouveaux gisements méso-dévoniens à Meghdoua et près de Taloak (à 3 ou 4 kilomètres N.-E. en bordure de l’erg).
A Meghdoua la formation a une vingtaine de mètres, se décomposant ainsi de la base au sommet.
| 1. Argiles bleues | 10 | mètres. |
| 2. Calcaires et grès | 5 | — |
| 3. Calcaires à Orthocères | 5 | — |
A Taloak cette couche calcaire, qui semble caractéristique du Méso-Dévonien, ne fait pas défaut non plus, mais elle est réduite à quelques centimètres d’épaisseur. Le Méso-Dévonien, d’une façon générale, repose en concordance sur l’Éodévonien.
Pas toujours cependant. A Tikedembati on constate (comme à In Belrem) un contact anormal le long d’une faille. La faille se voit directement, et on la suit depuis sa naissance, sous forme de flexure dans les hauts de Foum Zeggag.
En somme, entre Taloak et Baba Ahmed l’itinéraire traverse une série d’auréoles qui représentent en succession régulière tous les étages depuis l’Éodévonien jusqu’au Dinantien.
[289]Taourirt à l’Açedjerad. — Le long d’un dernier itinéraire qui va de Taourirt à l’Açedjerad[232], on rencontre d’abord le pli hercynien du dj. Aberraz et le horst silurien du Bled el Mass, qui ont été étudiés plus haut. Les grès dévoniens, jaunes clairs à patine noire, qui reposent horizontalement sur les plis calédoniens arasés, ont le facies éodévonien. Pourtant ils ne sont pas fossilifères, et ils sont peut-être un facies littoral du Dévonien moyen ; ils sont en effet en bancs minces, à stratifications obliques, indiquant le voisinage d’un rivage ; d’autre part, entre la garet Tamamat et l’erg Fisnet, sur 250 kilomètres, on ne sort pas du Méso-Dévonien étalé en couches horizontales et souvent fossilifères. Il s’annonce par Garet ed Diab, un récif de calcaire fossilifère intercalé au milieu des argiles, et qui témoigne lui aussi d’une mer peu profonde.
Les argiles méso-dévoniennes constituent apparemment le fond de l’immense sebkha Mekhergan ; mais elles sont recouvertes par des dépôts quaternaires et on ne peut pas les observer directement.
Au delà de la sebkha du moins, on retrouve le Méso-Dévonien fossilifère au nord de Haci Tikeidi.
De grandes falaises d’érosion permettent d’observer la succession des couches qui est à peu près, de la base au sommet.
- 1. Schistes à Brachiopodes.
- 2. Grès.
- 3. Argiles.
- 4. Grès.
- 5. Calcaire à Orthocères.
Les argiles se retrouvent à Kokodi, et les calcaires à Orthocères à Ridjel Imrad.
Notons enfin au nord de Tikeidi la présence de dépôts d’eau douce (quaternaire ancien à Cardium edule) ; ces dépôts très érodés sont à 5 mètres au-dessus du niveau de la vallée.
En résumé, et malgré d’énormes lacunes, trois itinéraires transversaux permettent de se rendre un compte général de la grande pénéplaine qui sépare le Tidikelt du Mouidir-Ahnet.
A de rares affleurements siluriens près, les couches appartiennent aux étages moyen et supérieur du Dévonien et au Carboniférien. Ces couches affleurent en auréoles grossièrement concentriques, se succédant régulièrement par ordre d’ancienneté décroissante du sud au nord. Dans le nord, au voisinage du Tidikelt, on observe quelques lambeaux de pénéplaine hercynienne.
[290]Mais la plus grande partie de la région étudiée appartient au domaine des plissements calédoniens. Sur un socle silurien qui apparaît exceptionnellement, les couches méso- et néo-dévoniennes et dinantiennes reposent à peu près horizontales. Cette horizontalité est pourtant interrompue par des failles et surtout des diaclases, mais qui n’ont amené nulle part de dénivellation apparente supérieure à 70 ou 80 mètres.
C’est précisément ce qui fait l’unité géographique de cette région. D’une part, c’est une pénéplaine sans relief et l’on sait que, au Sahara, les plaines et les pénéplaines sont précisément les parties les plus arides. D’autre part, les couches géologiques qui forment la surface sont, en général, marneuses et argileuses ; il se trouve que les marnes et les argiles dominent dans les trois étages représentés. Le sol est donc imperméable, ce qui constitue une nouvelle cause d’aridité.
Entre le Tidikelt, pays d’oasis, et le Mouidir-Ahnet, pays de pâturages, la pénéplaine qui nous occupe est un pays absolument désolé et inhabitable.
Géologie du Mouidir-Ahnet.
Le Mouidir, l’Ahnet et l’Açedjerad forment une grande région naturelle, très uniforme, favorisée au point de vue de la végétation et de l’habitabilité, où l’on retrouve partout les mêmes grès éodévoniens et le même substratum silurien.
J’ai parcouru la partie occidentale du Mouidir et orientale de l’Ahnet, en 1903 ; et l’Açedjerad, en 1905, en compagnie de M. Chudeau.
Silurien de Tadjemout. — Dans la partie occidentale du Mouidir, le substratum prédévonien affleure très largement dans un cirque immense où les oueds Arak, Tadjemout, etc., se réunissent pour former l’oued Tibratine.
Ce cirque est encombré d’alluvions anciennes et récentes et de dunes, mais ce tapis superficiel est crevé fréquemment par des arêtes et des chapelets d’arêtes prédévoniennes, qu’on peut observer aussi sur les bords de la cuvette, qu’elles limitent en muraille.
Les roches sont certainement très variées. La première arête qui se dresse au débouché des gorges de l’Arak est gneissique. Dans les gorges mêmes on observe, à l’entrée, des schistes noirs très fissiles, qui m’ont paru des micaschistes, et un peu plus loin, derechef, du gneiss. (Pl. XLV, 83.)
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XLIV. |
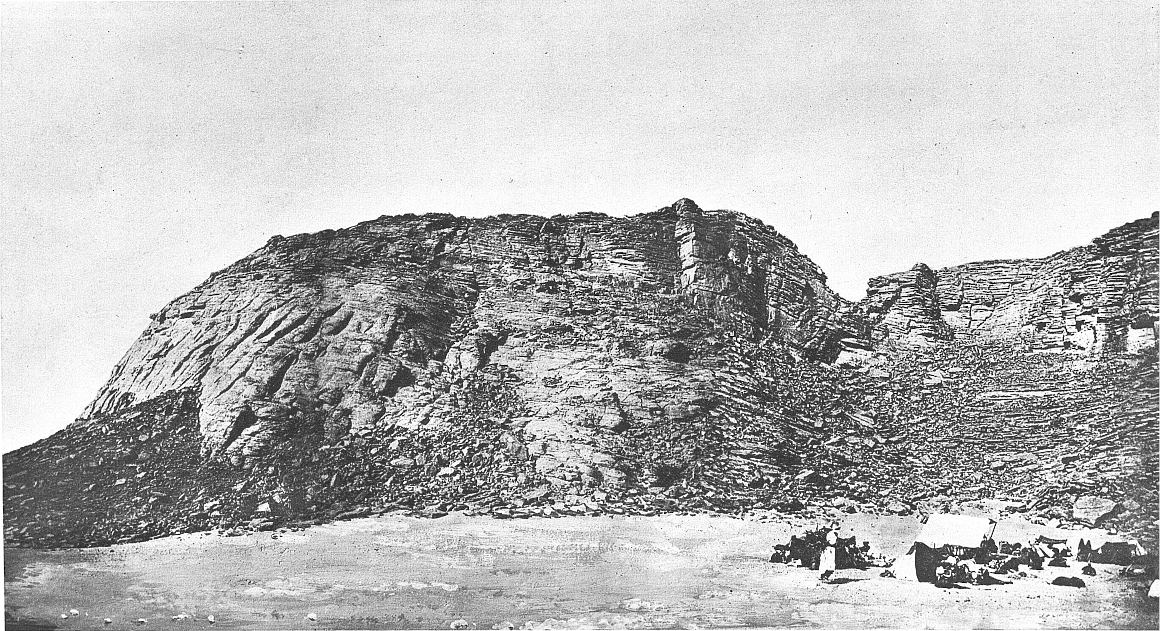
Cliché Pichon
82. — A OUAN TOHRA. — LE BATEN AHNET, grès éo-dévoniens
(falaise terminale de l’Ahnet « falaise de glint »).
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XLV. |
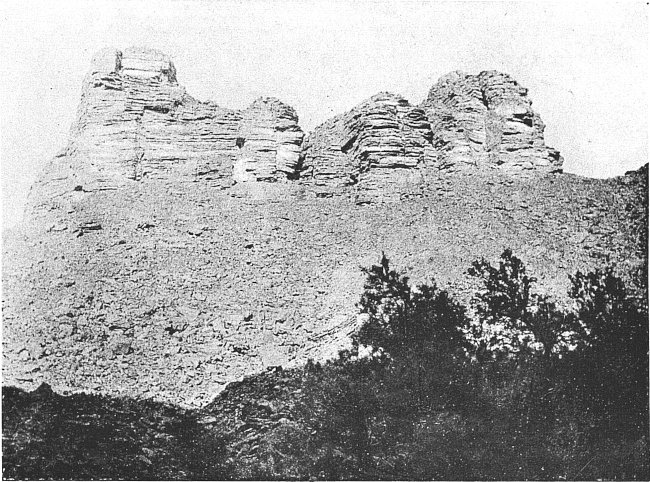
Cliché Pichon
83. — OUED ARAK (Mouidir) ; UNE PAROI DU CANYON.
Au sommet, grès éo-dévonien : sous les éboulis, on retrouve aisément sur le terrain des roches cristallines (gneiss ?) en place.

| Phototypie Bauer, Marchet et Cie, Dijon | Cliché Pichon |
84. — OUED TIBRATIN (près de Taoulaoun, Mouidir) ; — LARGE VALLÉE DANS LES ARGILES ÉO-DEVONIENNES.
Bon type de nebka, et de maader ; les arbustes sont des tamaris.
La falaise à gauche est en grès éo-dévonien ; au fond, silhouette de gara.
[291]A quelques kilomètres à l’ouest de Tadjemout, il y a des cipolins. A Tadjemout même des grès à grain très fin, très durs, tout à fait semblables à ceux de l’Adr’ar Ahnet.
Adoukrouz et Adr’ar Ahnet. — On retrouve les roches prédévoniennes dans la cuvette d’Adoukrouz (extrémité orientale de l’Ahnet). Au puits d’Adoukrouz, il y a des schistes cristallins et ce qui m’a paru être un puissant filon de quartz. Mais à 500 mètres de là, on rencontre, dans l’est, des phyllades très puissantes et des grès, analogues aux formations de Bled el Mass. Ces couches sont violemment plissées : au Mouidir les plis sont orientés nord-sud, à Adoukrouz N.-O.-S.-E.
A H. Macin, nous avons noté en 1903 une roche cristalline d’allure schisteuse. A Foum Lacbet, on a trouvé en 1905 des calcaires bleus et blancs avec schistes, phyllades et quartz ; on observe des ripple-marks. L’affleurement des couches dessine un dôme anticlinal orienté N.-O.-S.-E., fermé vers le sud.
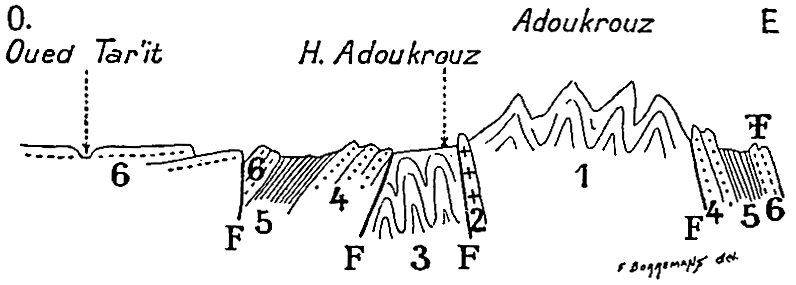
Fig. 56. — Au nord de l’Adr’ar Ahnet. — 1/600000.
Éodévonien : 6, grès ; 5, argiles ; 4, grès. — Silurien : 3, schistes cristallins ; 2, quartz ; 1, phyllades.
(Bull. Soc. géol. Fr., 4e série, t. VII, p. 211, fig. 3.)
L’énorme masse de l’Adr’ar Ahnet dans sa partie nord-orientale, qui a été directement observée, est constituée par des assises très puissantes de grès et de quartzites. Ces grès roses clairs sont très énergiquement plissés, injectés de filons de quartz, comme d’ailleurs toutes les formations siluriennes, tandis que les filons de quartz font tout à fait défaut dans le Dévonien de la région. Dans les grès de l’Adr’ar Ahnet les ripple-marks abondent. Le long de l’O. Tedjoudjoult on chemine plusieurs kilomètres dans cette formation sans en sortir, dans une direction pourtant à peu près perpendiculaire à l’axe de l’affleurement. Dans le lit de l’oued il est vrai, on rencontre quelques cailloux roulés cristallins. Toute la formation est affectée de plissements N.-O.-S.-E.
Les affleurements d’Adoukrouz, H. Macin, Foum Lacbet, Adr’ar Ahnet, simplement séparés les uns des autres par un placage d’alluvions anciennes ou récentes constituent un seul et même affleurement[292] continu, où le Silurien est représenté, à l’est par des grès et des schistes, à l’ouest par des cipolins et des schistes cristallins.
Que ces grès et ces phyllades soient siluriens, cela est démontré, en l’absence de fossiles, par les relations stratigraphiques des couches avec l’Éodévonien, qu’on voit, en particulier dans des garas avoisinant Foum Lacbet, reposer horizontal sur la tranche des plis arasés.
D’autre part, que les schistes cristallins (cipolins, etc.) soient du Silurien métamorphisé, cela ressort de leurs relations avec les grès et les phyllades, dont ils sont la continuation et avec lesquels ils s’enchevêtrent.
Pourtant le Silurien sédimentaire et le métamorphisé sont, partout où l’observation a été possible, séparés par des failles avec dénivellation consécutive ; c’est le résultat, j’imagine, d’une différence de compacité et de massivité.
Le Silurien métamorphique constitue une pénéplaine recouverte d’un manteau troué d’alluvions, au-dessus de laquelle le Silurien sédimentaire se dresse en horsts abrupts, fraîchement disséqués par l’érosion.
Que s’il y a là une généralisation hâtive, du moins est-il certain que les phyllades à l’est d’Adoukrouz et les grès de l’Adr’ar Ahnet constituent des massifs montagneux déchiquetés de 100 à 300 mètres d’altitude relative au-dessus du socle de la pénéplaine.
L’Adjerazraz, qui a été vu de loin seulement, est un petit massif, très isolé et individualisé, qui a toutes les apparences d’un horst silurien plus petit que ses voisins, mais analogue[233].
Sud et Nord d’Aït el Kha. — Les affleurements siluriens de Tadjemout et de l’Adr’ar Ahnet sont des promontoires avancés, jusqu’au cœur du Mouidir-Ahnet, de cette grande pénéplaine, en grande partie silurienne, qu’est le Tanezrouft. Un troisième promontoire, du même genre, ou, si l’on préfère, un golfe, pénètre sous le méridien d’Aït el Kha au moins jusqu’à la hauteur de Foum Zeggag.
Au sud d’Aït el Kha, le manteau alluvionnaire est crevé de longues rides de schistes cristallins, étirées N.-O.-S.-E., et qui représentent apparemment le Silurien métamorphique.
Au nord d’Aït el Kha, à la hauteur de Foum Zeggag, on rencontre un filon éruptif d’une roche granulitique.
L’Éodévonien. — Ce substratum silurien, et sans doute aussi, pour quelques parcelles, archéen et éruptif, qu’on peut étudier sur[293] de grandes étendues dans le sud du Mouidir-Ahnet est recouvert par des grès éodévoniens, de facies très uniforme, et dont l’extension dépasse d’ailleurs de beaucoup les limites de la région étudiée.
L’âge de cette formation est déterminée par des fossiles provenant de nombreux gisements (Tikeidi, Taloak, Taguerguera, etc.). Tous ces gisements sont à la partie tout à fait supérieure de la formation. Les fossiles ont été étudiés par M. Haug[234].
| Spirifer cf. Hercyniæ Gieb. | Wilsonia Henrici Barr. |
| Spirifer nov. sp. | Pterinæa fasciculata Goldf. |
| Tropidoleptus rhenanus Frech. v. Sahariana. | Edmondia. |
| Tentaculites aff. spiculus Hall. | |
| Pentamerus cf. vogelicus de Ver. | Homalonotus cf. Herscheli Murch. |
Ces fossiles sont caractéristiques « de l’étage coblentzien ».
M. Chudeau a établi comme suit la succession des couches éodévoniennes dans l’Açedjerad et l’Ahnet, numérotées de la base au sommet.
| 1. Grès grossier et poudingue rougeâtre | 30 | mètres. | ||||||
| 2. Poudingues, arkoses et psammites en bancs bien lités (galets de 4 à 5 centimètres dans le poudingue) | 40 | — | ||||||
| ÉODÉVONIEN INFÉRIEUR | 3. Grès formant muraille verticale d’un seul bloc. On y distingue cependant sur la cassure fraîche des arkoses, psammites, etc., le tout intimement lié | 80 | — | |||||
| 4. Grès en bancs irréguliers hétérogènes ruiniformes | 20 | — | ||||||
| 5. Argiles blanches et violettes | 30 | — | ||||||
| 6. Grès bien lités | bancs minces | 80 | — | |||||
| ÉODÉVONIEN SUPÉRIEUR | bancs plus épais 2-3 mètres | |||||||
| grandes dalles minces de 0,20 (4 mètres) | ||||||||
| 7. Argiles bariolées | 10 | — | ||||||
| 8. Grès en bancs irréguliers fossilifères (Ripple-marks, Bilobites) | 10 | — | ||||||
| Épaisseur totale de la formation éodévonienne | 300 | mètres. | ||||||
1, 2, 3, n’affleurent pas dans l’Açedjerad. On ne les a vus que plus à l’est près de l’Adr’ar Ahnet. 4 affleure à Ouallen et à l’ouest de Meghdoua (croupe d’Insemmen). Les argiles 5 jouent un rôle important ; elles correspondent à des vallées très larges (Ouallen), ou à des dépressions comme entre Iglitten et Taksist (fig. 59). Par leur plasticité, elles expliquent l’indépendance des compartiments supérieur et inférieur entre eux.
Sauf à la partie supérieure, peu ou pas de fossiles, mais toujours des ripple, des stratifications obliques. Aucune roche éruptive, pas même un filon de quartz.
[294]Les éléments de cette analyse serrée ont été recueillis dans l’Açedjerad et dans l’Ahnet ; mais dans ses grandes lignes cette analyse est valable pour le Mouidir occidental.
A coup sûr, les termes principaux de la série sont représentés ; en particulier les argiles médianes sont très développées dans la cuvette de Taoulaoun, qu’elles conditionnent ; les fossiles se trouvent dans les couches supérieures et ne se trouvent que là ; on y trouve aussi, dans la pâte de la roche, des colonnettes gréseuses bien individualisées, ayant parfois la grosseur du poing, et que le lieutenant Besset a signalées le premier. Ces lusus naturæ qu’on a pris pour des fossiles végétaux font défaut, semble-t-il, dans l’Ahnet.
En somme une formation, presque entièrement gréseuse, très uniforme, et qui, vue superficiellement, le paraît davantage encore parce que tous les grès sont revêtus d’une patine désertique noire de poix sous laquelle la moindre égratignure fait apparaître le cœur plus ou moins clair de la roche.
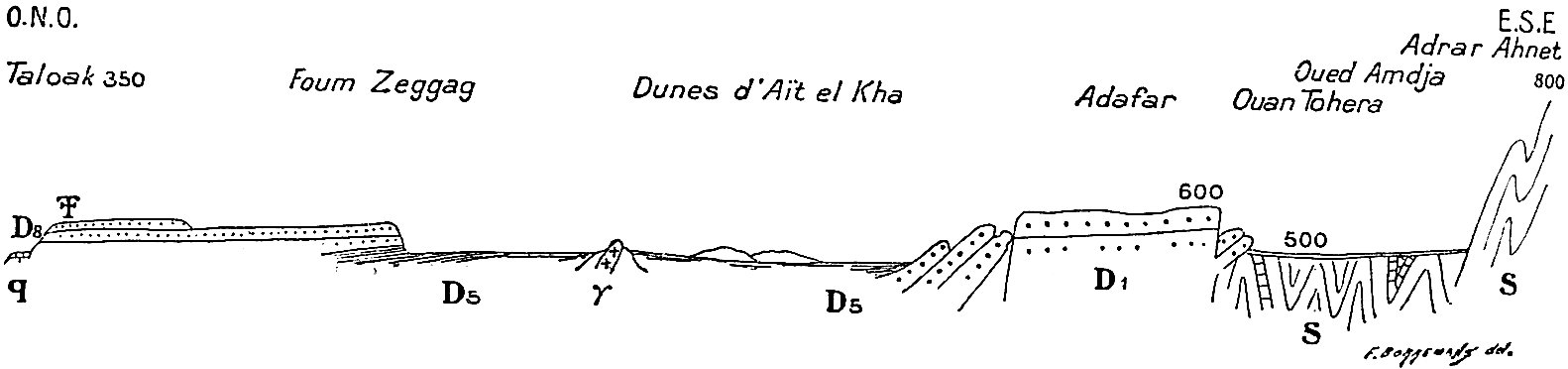
Fig. 57. — Taloak à l’Adr’ar Ahnet. — 1/750000.
S, Silurien ; γ, Granulite, D1-8, Dévonien, inf. ; q, Tuf quaternaire.
(Bull. Soc. géol. Fr., 4e série, t. VII, p. 213, fig. 4.)
Dans tout le Mouidir-Ahnet, l’Éodévonien affleure, à l’exclusion de toute formation postérieure, à une seule exception près : un lambeau méso-dévonien s’est conservé dans la cuvette d’Igliten.
Stratigraphie. — Les relations stratigraphiques de l’Éodévonien et du Silurien s’observent avec une admirable netteté sur tout le pourtour de la cuvette de Tadjemout. Le Dévonien horizontal repose sur la tranche des couches siluriennes ou archéennes.
C’est bien net, en particulier à Tahount Arak (voir pl. XLV, phot. 83), ou encore aux environs de Tin Teraldji, voire même à Tadjemout, quoique le sommet de l’arête silurienne qui domine le puits ait été découronné du Dévonien.
L’Éodévonien en plateaux tabulaires délimités par des falaises reposant sur la pénéplaine silurienne, telle est la règle générale le[295] long de la ligne de contact entre les deux formations dévonienne et silurienne.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XLVI. |

Clichés Pichon
85. — OUED ADJAM : Porte qui donne accès dans le horst silurien d’Adoukrouz.
Dans l’échancrure, au fond, très floues, les collines siluriennes ; au premier plan, de part et d’autre de l’échancrure, mais bien visibles surtout à droite, les grès éo-dévoniens, basculés le long de la faille.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XLVII. |

Cliché Pichon
86. — PRÈS DE L’OUED ADJAM, au nord d’Adoukrouz ;
grès éo-dévoniens basculés le long de la faille ; vue de détail.

Cliché Pichon
87. — Même sujet que 86, vue d’ensemble.
A la limite extrême du premier plan, un redjem.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XLVIII. |

Cliché Pichon
88. — Près de l’Oued Adjam ; la muraille de grès éo-dévonien basculée au nord d’Adoukrouz.
La muraille est double par intercalation d’un horizon argileux.

Cliché Pichon
89. — L’ADRAR AHNET.
Profil déchiqueté de sierra, caractéristique des collines siluriennes ;
à gauche un Talha (faux gommier).
L’Éodévonien se termine sur la pénéplaine silurienne par ce qu’on appelle ailleurs des falaises de glint ; c’est ce que les Arabes appellent le baten Ahnet. (Voir pl. XLIV, phot. 82.) Les lacs de glint ne font même pas défaut, représentés par des maader (maader Arak, par exemple).
La continuité du baten est pourtant interrompue assez souvent lorsque la ligne de contact coïncide avec une ligne de faille. C’est le cas par exemple au voisinage d’Adoukrouz.
Autour d’Adoukrouz, on l’a déjà dit, l’ancienne pénéplaine constitue un horst en relief très marqué de 100 à 300 mètres, énergiquement disséqué et formant une masse montagneuse confuse.
Sur la face nord et nord-ouest du horst, l’Éodévonien a basculé le long de la faille, formant un placage continu de couches redressées à 45°, suivant une ligne en arc de cercle. (Voir pl. XLVI, phot. 85 et pl. XLVII, phot. 86 et 87.)
L’Éodévonien tout entier est représenté, de sorte que l’arête est double, les argiles s’étànt accusées en creux, comme on le voit sur la coupe d’Adoukrouz (fig. 56). (Voir pl. XLVIII, phot. 88.)
La coupe de Taloak à Ouan Tohra montre à Foum Lacbet un cas analogue ; un paquet de grès éodévonien redressé le long de la faille limite de la pénéplaine (fig. 57).
Entre Haci Macin et le bord de la hammada dévonienne on observe le contact des deux terrains sous une forme nouvelle : la hammada se continue par la pénéplaine sans accident topographique, horizontalement. La faille a amené les couches éodévoniennes au niveau exact de la pénéplaine. Ces failles, ou, plus exactement, vu leur faible amplitude, ces diaclases expliquent le relief du Mouidir-Ahnet.
En général le Dévonien est dans l’ensemble horizontal ou affecté d’une inclinaison générale très régulière et très faible. Voir par exemple les coupes Ouallen Meghdoua et Taloak-Ouan Tohra (fig. 59 et 57).
Parfois les couches dévoniennes apparaissent brusquement avec une inclinaison très forte, égale ou supérieure à 45°. Ainsi dans les deux coupes précitées on est frappé de la juxtaposition des couches horizontales avec des couches complètement basculées. C’est que les argiles rendent les deux masses gréseuses indépendantes et facilitent ces mouvements locaux de bascule le long des diaclases.
On se rend un compte bien net de la structure du Mouidir occidental en jetant un coup d’œil sur la coupe (fig. 58) de Tadjemout à[296] l’erg Timeskis par Foum Tebalelt ; de part et d’autre de la pénéplaine à Tadjemout et à Foum Tebalelt l’Éodévonien est représenté par les mêmes couches horizontales ; mais il s’en faut qu’elles soient au même niveau, il y a une différence d’au moins 100 mètres. Au-dessus du niveau à peu près uniforme de la pénéplaine la falaise de Tadjemout est deux fois plus élevée que celle de Tebalelt. La muraille de Tadjemout avec ses à-pics de plus de 200 mètres ne forme pas seulement la bordure de la pénéplaine à l’est, elle se prolonge très loin au nord sur la rive droite de l’O. Tiratimine, au moins jusqu’à la cuvette de Taoulaoun. C’est un gigantesque gradin qui sépare le petit Mouidir occidental que nous étudions d’un autre Mouidir, oriental, beaucoup plus étendu et beaucoup plus élevé. On ne conçoit pas qu’il puisse y avoir là autre chose qu’une longue diaclase.
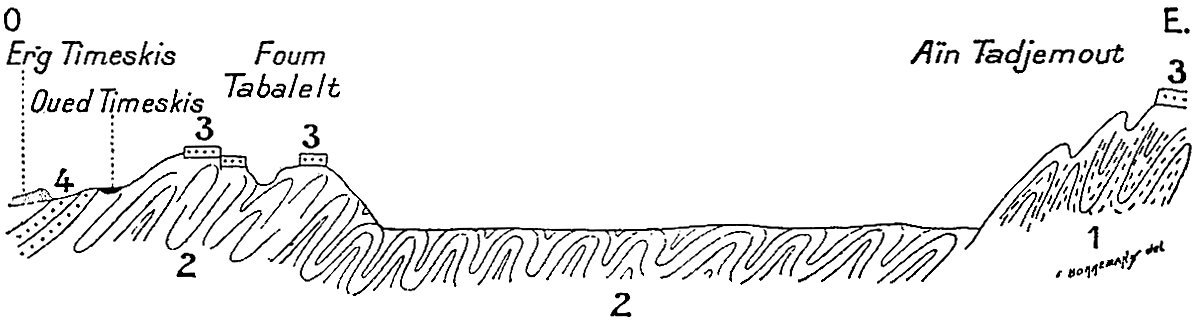
Fig. 58. — Coupe de l’erg Timeskis à Tadjemout. — Long. : 1/600000 ; haut. : 1/20000.
4, Grès éodév. sup. ; 3, Grès éodév. inf. ; 2, Silurien ; Schistes cristallins ; 1, Quartzites.
(Bull. Soc. géol. Fr., 4e série, t. VII, p. 216, fig. 5.)
Dans le Foum Tebalelt j’ai noté des couches éodévoniennes horizontales, mais gondolées et qui semblent attester que le soubassement a été affecté de très petites failles.
Enfin à l’extrémité de la coupe, entre l’ennoyage de l’oued Timeskis et l’erg on voit pointer des couches éodévoniennes violemment redressées à quelques centaines de mètres à peine de distance et, à une centaine de mètres en contre-bas, des grès dévoniens horizontaux. La diaclase est donc évidente.
Ces couches redressées de l’O. Timeskis sont à la limite ouest du Mouidir comme celles de l’O. In Belrem dont elles sont l’évidente continuation.
En somme, cette partie du Mouidir est un premier gradin occidental, encadré entre deux grandes failles nord-sud, à regard ouest, ayant amené chacune une dénivellation d’une centaine de mètres.
La route suivie entre Timeskis et l’O. Souf Mellen ne sort pas de l’Éodévonien. Il est vrai que la limite des roches anciennes ne doit[297] pas être éloignée, car on trouve, en assez grand nombre, dans le lit de l’O. Souf Mellen, des cailloux roulés cristallins.
Ce sont des couches généralement horizontales, mais affectées au voisinage de l’O. Timeskis, de petites failles qui ont dérangé l’horizontalité.
La structure de l’Ahnet-Açedjerad est aussi conditionnée par des diaclases, quoiqu’il puisse n’y pas paraître au premier abord. En effet, les accidents éodévoniens isolés de Tikeidi et de Timeguerden sont des dômes anticlinaux fermés.
Entre l’O. Takçis et l’O. Meraguen, l’Açedjerad projette une longue arête anticlinale. La cuvette d’Iglitten est nettement synclinale.
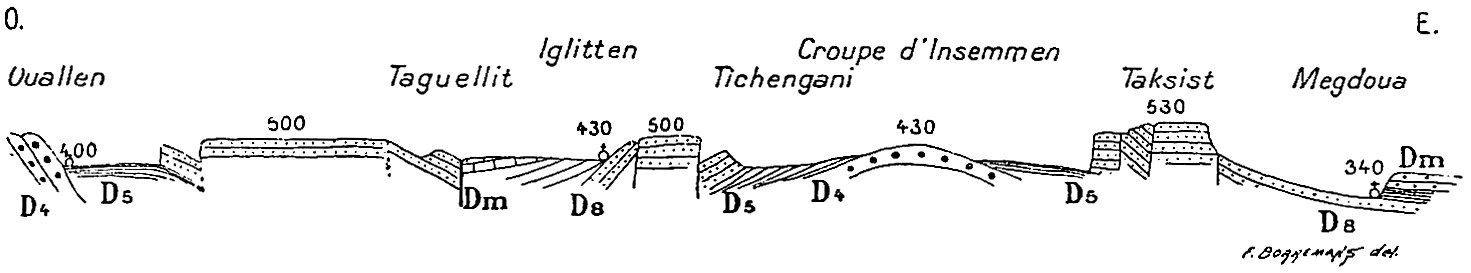
Fig. 59. — Coupe transversale de l’Açedjerad. — 1/250000.
D4-8, Éodévonien ; D8, Grès fossilifères, 10 ; D7 Argiles, 10 ; D6, Grès, 80 ; D5, Argiles, 30 ; D4, Grès ruiniformes, 20 ; — Dm, Dévonien moyen, Argiles et Calc. à Orthocères.
(Bull. Soc. géol. Fr., 4e série, t. VII, p. 217, fig. 6.)
Sous les ergs Tessegaffi et Ennfouss, l’extrémité méridionale de la pénéplaine méso-dévonienne, se raccordant aux dernières pentes de l’Ahnet et de l’Açedjerad, a tout à fait les allures d’une cuvette synclinale fermée au sud.
Il y a donc toutes les apparences d’un système de plis. Et ce n’est pas particulier à la région considérée ; le Mouidir oriental, tel que la carte du lieutenant Besset nous l’a révélé[235], présente ces mêmes apparences à un plus haut degré encore ; il se termine au nord par un chapelet de dômes anticlinaux, et sa forme générale est curieusement symétrique à l’Ahnet-Açedjerad.
C’est que l’Éodévonien a une faible épaisseur, 300 mètres environ ; à travers cette mince couverture, se trahissent en surface les plis calédoniens sous-jacents, qui ont dirigé les diaclases. Un coup d’œil sur les coupes Ouallen-Megdoua (fig. 59) et Taloak-Ouan Tohra (fig. 57) montre qu’on n’a pas affaire à des couches proprement plissées, mais à des formations dont l’horizontalité a été dérangée seulement par des diaclases.
[298]Jeunesse des diaclases. — Ces failles et ces diaclases sont très jeunes ; on ne s’expliquerait pas autrement la jeunesse du relief. Les hammadas dévoniennes sont entaillées de canyons étroits et profonds dans lesquels les oueds s’ils coulaient, auraient des allures torrentielles (voir pl. VI, phot. 11 et 12, pl. XLV, phot. 83) ; tout à fait torrentielles sont également les vallées qui entaillent les horsts siluriens, disséqués et déchiquetés comme des sommets alpestres. (Voir pl. XLIX, phot. 91, pl. L, phot. 92.)
Avec ces tronçons de lits aux pentes rapides contrastent les allures des oueds au débouché des canyons et des torrents sur les pénéplaines. Là ils s’étalent en larges maaders, qui seraient des lacs ou des marais sous un climat humide. Le réseau hydrographique est évidemment loin de la maturité. Il est vrai que sous le climat actuel il ne peut mûrir que lentement, mais on sait que le climat quaternaire était bien plus humide que l’actuel.
Les oueds du Tadmaït ont exactement les mêmes allures (O. Aglagal, par exemple). (Voir pl. XLIII, phot. 81.)
Conclusions générales.
En résumé on voit assez nettement dans son ensemble la structure de toute cette région (Tidikelt, pénéplaine carbonifère, Mouidir-Ahnet).
Les oasis du Tidikelt jalonnent un long fossé d’effondrement entre les causses crétacés du Tadmaït et les plateaux gréseux Touaregs. L’existence de ce fossé est conditionnée par de grandes failles orientées est-ouest, et dont l’âge récent n’est pas douteux, puisqu’elles ont affecté toutes les couches crétacées ; il est encore attesté par la jeunesse de l’érosion.
Tout cela est donc tertiaire et en relation évidente avec la surrection de l’Atlas.
Par ailleurs la structure du pays est en rapport étroit avec de très anciens accidents hercyniens et calédoniens.
Ou est frappé d’abord de voir au fond du fossé courir la vieille suture entre les deux zones hercynienne et calédonienne. Tout se passe comme si la vieille cicatrice avait imposé sa direction aux jeunes failles ; il y a là apparemment une ligne de moindre résistance dans l’écorce terrestre. Non seulement au Tidikelt, mais encore au Touat, il y a une concordance entre les limites des plissements hercyniens et celles de la transgression cénomanienne.
Les plis hercyniens et calédoniens ont tous une direction oscillant[299] autour de nord-sud. Cette direction s’est ainsi imposée à beaucoup de failles récentes ou de plis posthumes, et elle joue un grand rôle dans la configuration actuelle du pays.
Tout d’abord le nord de l’Afrique tout entier, dans la région qui nous intéresse est parcouru par un grand axe orographique orienté nord-sud ; un chapelet de sommets.
C’est, au sud, le Hoggar, puis en allant vers le nord, l’Ifetessen, point culminant du Mouidir, au Tidikelt même c’est le dj. Idjeran, et le dj. Azzaz, qui prolongent le Mouidir jusqu’au contact du Tadmaït.
Si mal connus que soient les causses crétacés on ne peut pas mettre en doute l’existence d’un bombement anticlinal très accusé qui sépare les ergs orientaux et occidentaux, les oasis d’Ouargla et du Touat. Enfin, en Algérie même, on retrouve peut-être un dernier écho de ce grand axe nord-sud. Dans sa prolongation, en effet, se trouvent les hauts plateaux miocènes de Médéa, qui contrastent curieusement avec le niveau très bas des dépôts contemporains dans la vallée du Chéliff à l’ouest et dans celle de l’O. Souman à l’est.
En somme, une grande arête, très accusée et très bien marquée, un trait tout à fait essentiel de l’orographie nord-africaine, sépare les bassins de l’Igargar et de l’O. Messaoud.
Il faut noter au Tidikelt que les oasis apparaissent à l’ouest du dj. Azzaz. — A l’est le fossé d’effondrement semble se prolonger très loin mais il est désert.
La direction nord-sud joue donc un rôle considérable dans la structure générale ; elle se retrouve à chaque instant dans les détails du modelé.
Chaque oasis du Tidikelt aligne ses palmiers au fond d’une cuvette synclinale dont le grand axe court nord-sud. La coupure d’In R’ar a cette même direction ; de même que presque toutes les diaclases de l’Açedjerad, de l’Ahnet, du Mouidir.
En somme, un pays d’architecture tabulaire où le contre-coup de la surrection de l’Atlas s’est fait sentir énergiquement ; les failles, les diaclases, les plis posthumes tertiaires, ont suivi les directions qui leur étaient imposées par celles des plis et des failles primaires.
Toute la région est drainée par l’O. Djar’ét, dont le réseau compliqué est aujourd’hui bien connu dans ses grandes lignes. — La contribution de Tadmaït est très faible, le seul affluent considérable qu’il envoie au Djar’ét est l’O. Souf qui a creusé la coupure d’In R’ar. Du Mouidir, de l’Ahnet, de l’Açedjerad, de grandes artères (le Bota, le Nazarif, le Souf Mellen, l’Adrem, le Meraguen) convergent[300] et viennent se perdre dans la grande sebkha Mekhergan. Il est probable que cette grande sebkha avait à l’âge quaternaire un émissaire encore inconnu qui rattachait tout le système à celui de l’O. Messaoud. On s’est expliqué là-dessus dans un chapitre antérieur.
Inutile de dire que ce grand réseau quaternaire n’a plus un intérêt actuel, on ne sait même pas dans quelle mesure il est susceptible d’être animé accidentellement par de grandes crues.
Ce qui est certain c’est que les grandes artères, toute la partie basse du réseau, tout ce qui, dans un pays humide, serait particulièrement vivant, tout cela aujourd’hui est un désert, un Tanezrouft. La vie s’est réfugiée à la périphérie, de part et d’autre de l’artère centrale, d’un côté au Tidikelt et de l’autre sur les plateaux touaregs.
Le Tidikelt.
Le Tidikelt a certainement de grandes affinités déjà signalées avec le Touat et le Gourara. Il les continue linéairement, c’est l’extrémité de la « rue de palmiers ». Notons pourtant que la continuité au Tidikelt est interrompue par des brèches fréquentes et notables.
Ici comme au Touat et au Gourara les oasis sont en général sur la plus inférieure des couches crétacées, les grès albiens ; ces grès sont recouverts par place par des terrains d’atterrissement récents, en un point (pourtour de la coupure d’In R’ar) ils font défaut et sont remplacés par des calcaires crétacés d’étage indéterminé. Mais la nappe d’eau est bien dans le Crétacé. Il a été souvent question de la « r’aba » du Tidikelt, qui est naturellement non pas une forêt, comme le sens usuel du mot arabe r’aba semblerait l’indiquer, mais un pâturage de chameaux, maigre et piteux d’ailleurs. C’est un long ruban de verdure rare et grise qui s’étire exactement à la limite du Crétacé et du Primaire, mais toujours exclusivement sur le Crétacé.
La r’aba est un lieu de sources ou de points d’eau ; elles sont particulièrement abondantes autour de la grande trouée d’In R’ar mais, plus ou moins serrées, elles se retrouvent partout dans la r’aba. Ainsi donc, au sommet de la falaise secondaire, des sources, une brousse de zita et d’autres arbustes sahariens ; en bas, sans transition, sur la pénéplaine carboniférienne, l’aridité absolue, le désert maximum. Ce contraste saisissant est le même partout.
C’est ainsi d’ailleurs que les assez beaux pâturages du Gourara méridional (Bel R’azi, Deldoul, Lella R’aba) sont sur le Crétacé et s’arrêtent brusquement à la limite des terrains primaires.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. XLIX. |

Cliché Laperrine
90. — BLED EL MASS.
Couches siluriennes (phyllades) très énergiquement plissées et arasées, sur le terrain on les voit supporter le dévonien horizontal.
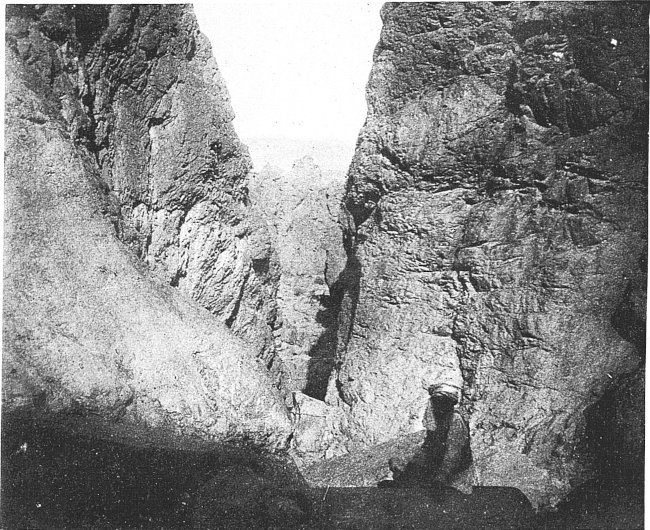
Cliché Gautier
91. — Dans l’Adrar Ahnet (guelta d’Ouan Tohra), une gorge sauvage au fond de laquelle la progression n’est pas possible sans corde. — Grès quarziteux.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. L. |

Cliché Pichon
92. — ADRAR AHNET ; UN RAVIN DANS LES GRÈS SILURIENS.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. LI. |

Cliché Pichon
93. — ADRAR AHNET ; OUED TEDJOULJOULT. — Grès Siluriens.
[301]Il n’est pas possible de se soustraire à la conclusion que la nappe d’eau se trouve dans le Crétacé.
Mais d’où vient-elle ?
M. Flamand attribue à l’eau d’In Salah une origine méridionale ; il la croit venue du Mouidir et l’hypothèse n’est pas invraisemblable ; les grès du Mouidir sont, assurément, un gros réservoir d’humidité, avec lequel il est facile d’imaginer que le Tidikelt puisse être en communication.
Il est certain que le dj. Azzaz et le dj. Idjeran, affleurement de grès dévonien qui borne à l’est le Tidikelt, sont des lieux de sources (Aïn Kahla, etc.) et ces sources sont alimentées par le Mouidir. A l’autre bout du Tidikelt Aïn Cheikh jaillit de même dans un affleurement de grès éodévonien. Il semble donc bien que la nappe souterraine des grès méridionaux doive trouver son chemin jusqu’au Tidikelt où l’existence de failles facilite son ascension. D’autre part pourtant, on ne peut guère supposer que l’oasis d’In R’ar soit, par une coïncidence purement fortuite, précisément au débouché d’un grand oued descendu du Tadmaït. Il faut apparemment se garder de conclusions absolues et supposer que le Mouidir et le Tadmaït collaborent à la prospérité du Tidikelt.
Il en a grand besoin, car il se trouve dans des conditions défavorables pour utiliser la nappe d’eau du Tadmaït, qui manifestement d’après la pente générale du terrain est surtout drainé au profit des autres groupes d’oasis (Ouargla, Gourara, Touat).
N’oublions pas il est vrai que le Tidikelt, comme importance numérique en palmiers et en âmes, est inférieur de moitié au Touat ou au Gourara. Un coup d’œil sur la carte montre que, au Tidikelt, la distribution des oasis est assez particulière.
Tandis que les palmeraies du Gourara et du Touat s’étendent bout à bout, en formation linéaire, les palmeraies d’In Salah, d’In R’ar, d’Aoulef, etc., sont parallèles l’une à l’autre, en colonne de compagnie.
Cela revient à dire que chacune a son originalité propre, et sa nappe d’eau particulière. Il serait désirable d’en avoir des monographies.
Quoique ces études de détail fassent défaut on peut affirmer cependant, en règle générale, que chaque palmeraie est en relation avec une petite cuvette syndicale, allongée nord-sud, petit pli posthume déterminé par un effondrement local du substratum hercynien ou calédonien. Cette petite cuvette synclinale est une poche où l’eau s’est accumulée comme le montre non seulement l’existence de l’oasis mais encore en général celle d’une ou plusieurs sebkhas.
La carte ci-jointe, dressée par M. le lieutenant Voinot, et qui m’a[302] été communiquée par M. le commandant Lacroix, rend sensible cette disposition à l’oasis d’Aoulef-Timokten. La cuvette synclinale n’est pas marquée seulement par les courbes de niveau, mais encore par des foggaras, naturellement normales à la pente, et qui viennent de l’ouest à Timokten et de l’est au contraire à l’Aoulef. Cette disposition des foggaras en auréole ou en rose des vents autour d’une sebkha centrale ne se retrouve nulle part ni au Touat, ni même je crois au Gourara, où le parallélisme des foggaras entre elles est la règle générale.
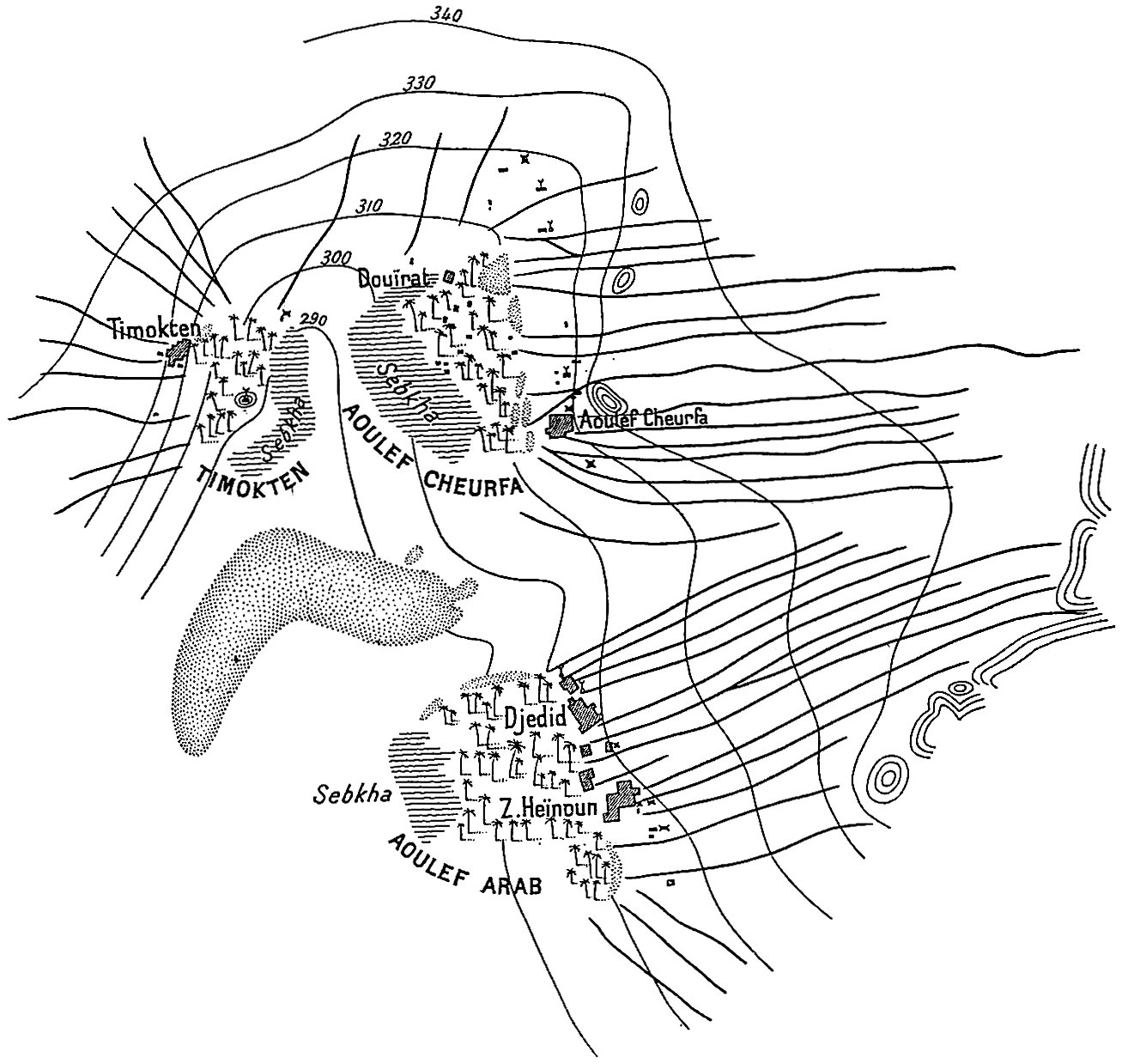
Fig. 60. — Carte d’Aoulef, dressée par M. le lieutenant Voinot.
(Les traits noirs convergents sont les foggaras.)
Notons pourtant que certaines oasis du Gourara, en petit nombre (par exemple Ouled Mahmoud), sont elles aussi en relation avec de petits plis posthumes.
Cette similitude apparaîtra accentuée si on se rappelle que le Gourara a quelques puits artésiens (Ouled Mahmoud en particulier). Depuis notre installation aux oasis nous avons fait des efforts infructueux[303] pour en forer au Touat — couronnés de succès au contraire au Tidikelt, au moins sur certains points.
D’après M. le lieutenant Voinot le Tidikelt a 8 puits artésiens : 1 à Foggaret ez Zoua, 4 à In Salah, 1 à Akabli, 1 à Tit, 1 à In R’ar. Evidemment l’accumulation des eaux dans des cuvettes synclinales explique le succès de ces forages.
Le Tidikelt a donc une hydrographie assez originale. D’autre part on sait déjà qu’il partage avec le bas Touat le privilège regrettable d’être ensablé. In Salah est très menacé par les dunes. Aoulef l’est aussi comme en témoigne la carte. D’après les traditions, dans un certain nombre de ksars l’homme a été chassé par le sable.
Notons cependant que dans le fossé d’effondrement, qui a le monopole des dunes, le Tidikelt est bien loin d’être le point le plus ensablé. Les grosses agglomérations de dunes se trouvent dans les maaders du Bota (erg Tegant, erg Iris), et de l’O. Adrem (erg Ennfous, erg Tessegafi), c’est-à-dire au point précis où il est naturel qu’ils soient, si on admet un rapport entre les alluvions et les dunes.
Histoire. — C’est au point de vue humain que le Tidikelt se distingue franchement du Touat et du Gourara.
A ce point de vue la meilleure monographie a été rédigée il y a plusieurs années déjà par M. le lieutenant Voinot. Elle n’a pas été publiée encore, et il est à craindre qu’elle ne le soit jamais ; c’est une raison de plus pour lui faire de larges emprunts[236].
Dans le travail de M. Voinot, la partie historique est très neuve et très intéressante.
Dans le haut Touat, au Gourara, dans l’O. Saoura il ne subsiste pas de traditions indigènes concernant le premier aménagement hydraulique du pays ; aussi loin que va la mémoire humaine on retrouve les oasis déjà existantes. Elles sont probablement préislamiques ; en tout cas il est impossible d’affirmer qu’elles ne le sont pas.
Au bas Touat, d’après Watin[237], des traditions un peu confuses assignent une date à l’établissement des premières foggaras. Elles auraient été creusées par les Barmata, au IIIe siècle de l’hégire, c’est-à-dire au Xe siècle de J.-C. Auparavant il n’y aurait eu au Reggan que des puits de caravane, creusés par les Arabes Moakel, nomades du Sahel, qui « avaient établi un courant commercial entre le Soudan[304] et le Maroc ». Ces traditions sont, il est vrai, fâcheusement associées à l’étymologie Ouatin Touat, ce qui n’est pas pour leur donner un caractère d’authenticité ; elles méritent pourtant attention.
Au Tidikelt le doute n’est plus permis, les traditions recueillies par Voinot sont nombreuses, précises et concordantes. Partout le souvenir s’est conservé d’une époque où le pays entier était un pâturage, parcouru par les troupeaux touaregs, et dont la r’aba est aujourd’hui le dernier vestige. Dans chaque oasis on indique exactement la date de la fondation.
In Salah serait la plus ancienne ; ce fut un pâturage des Touaregs Kel Amellen jusqu’au XIIIe siècle environ, époque où les premières foggaras auraient été creusées par un nègre nommé Salah, et un certain Mohammed el Hedda, venu de Deldoul (Gourara). De là évidemment l’étymologie Aïn Salah, inventée après coup par les Arabes, puisque le nom véritable est In Salah, et que la particule Berbère In est fréquente dans l’onomastique (In R’ar, In Belrem, etc.).
Viennent ensuite par ordre d’ancienneté :
Akabli, — autrefois pâturage de Hacci Debder — l’oasis a été fondée en 1230 — agrandie en 1235, 1255, 1273, 1303.
Aoulef, puis Tit, puis In R’ar.
L’oasis de Timokten n’a été mise en culture qu’aux environs de 1700.
Les oasis de l’extrême est, Haci el Hadjar, Milianah, Foggaret el Arab, Igosten, datent du XVIIIe siècle. A Foggaret el Arab, la foggara la plus ancienne, foggara el Guedima, est de 1720 ; la plus récente, celle de Hadj Ali, est de 1800.
Ce sont là des souvenirs précis, souvent datés, quelques-uns tout récents, et qui ne peuvent pas être mis en doute.
Aussi bien les défricheurs du Tidikelt sont venus très souvent du Touat et du Gourara.
A Aoulef la migration de 1303 est celle des Ouled Meriem du Reggan. Les Ahl Azzi qui fondèrent Tit venaient de Fenourin (Touat). Parmi les fondateurs de Timokten, les uns (Ouled Yahia) venaient de Deldoul, les autres (Ouled Dehane) du Timmi.
Il est clair que parmi les trois groupes touatiens, le Tidikelt est le plus récent de beaucoup, c’est une idée toute nouvelle et que nous devons entièrement à M. Voinot.
On sait anciennement que les inscriptions tifinar’ ne sont pas rares au Tadmaït[238], et les Touaregs affirment que le Tadmaït fut[305] jadis leur domaine. Tout confirme donc le recul des Touaregs au Tidikelt dans les derniers siècles.
La grande poussée d’arabisation, venue de l’ouest, du Maroc et de la Seguiet el Hamra, ce qu’on pourrait appeler la poussée andalouse, a donc eu sa répercussion jusqu’ici. Elle a refoulé les Berbères hors du Tidikelt, et du même coup elle y a apporté l’agriculture. Nous saisissons ici sur le fait, beaucoup plus nettement qu’ailleurs, le lien qui existe entre la poussée andalouse et le progrès économique au Sahara, et sans doute il n’est pas surprenant que les fugitifs des huertas espagnoles aient été en Afrique de bons professeurs d’hydraulique agricole.
Démographie et organisation politique. — Le Tidikelt est sur la frontière des deux langues et des deux cultures, arabe et berbère ; c’est une marche où l’influence arabe est encore mal assise. On s’en rend compte en étudiant avec M. Voinot sa démographie et son organisation politique.
J’emprunte d’abord à M. Voinot un tableau intéressant et inédit.
| BLANCS | HARATIN | TOTAL des habitants | |
|---|---|---|---|
| Foggaret ez Zoua | 333 | 137 | 470 |
| Foggaret el Arab | 39 | 36 | 75 |
| Igosten | 204 | 107 | 311 |
| Haci el Hadjar | 116 | 47 | 163 |
| Sahela Fokania | 190 | 83 | 273 |
| — Tahtania | 63 | 38 | 101 |
| Miliana | 32 | 19 | 51 |
| In Salah | 1090 | 610 | 1700 |
| In R’ar | 437 | 45 | 482 |
| Tit | 412 | 110 | 522 |
| Aoulef | 1813 | 1978 | 3791 |
| Akabli | 471 | 421 | 892 |
| Total général | 5200 | 3631 | 8831 |
Ce tableau fait ressortir d’un coup d’œil un certain nombre de faits intéressants.
Il nous donne la proportion exacte à la population générale des haratin, c’est-à-dire des paysans. Je ne crois pas qu’on la connaisse au Touat et au Gourara. Ici elle est assez faible. Sur 8831 habitants 3631 seulement cultivent, et nourrissent les autres. Il est vrai que le nombre des esclaves n’est pas indiqué, on ne nous dit pas s’il est[306] inclus dans celui des haratin. On verra en outre que l’agriculture n’est pas la seule ressource alimentaire du Tidikelt.
Sur douze ksars il en est deux beaucoup plus importants que les autres qui renferment à eux seuls plus de la moitié de la population totale, ce sont In Salah et Aoulef ; autour de l’un se groupe le Tidikelt oriental, autour de l’autre l’occidental : ce sont les deux capitales, comparé au Touat et au Gourara le Tidikelt est centralisé.
De ces deux centres le plus important n’est pas le plus connu, In Salah (1700 habitants) ; mais c’est de beaucoup Aoulef (3791 habitants). Je n’imagine pas pourquoi la plus petite agglomération est précisément celle dont le nom s’est imposé au public européen ; c’est apparemment une notoriété de hasard, mais qui a eu ses conséquences puisque In Salah, après avoir été notre objectif stratégique, est aujourd’hui notre capitale administrative. Ce n’est pas sans conséquences fâcheuses pour Aoulef, et même au Sahara une réclame insuffisante eut un désavantage économique.
L’hydrographie de détail au Tidikelt n’ayant pas été étudiée, il est impossible de savoir si Aoulef dispose d’une nappe d’eau plus puissante ; faut-il invoquer, pour expliquer l’infériorité d’In Salah, le fait incontestable que les dunes y sont bien plus agressives ? ou faut-il trouver naturel que le centre le plus occidental soit aussi le plus évolué, puisque la colonisation est venue de l’ouest ?
Le tableau ne distingue pas les Arabes des Berbères, mais le texte du rapport Voinot est explicite sur la question.
La prédominance politique appartient incontestablement aux Arabes.
Dans l’est, à In Salah, les maîtres sont les Ouled Ba Hammou, Ouled Baba Aïssa et Ouled Mokhtar, qui se rattachent à un ancêtre commun venu du dj. el Akhdar en Tripolitaine.
Dans l’ouest, à Aoulef, ce sont les Ouled Zenana venus de Tlemcen en 1690. Ces deux groupes de familles arabes, chacune dans son domaine, exercent leur autorité d’une façon assez particulière.
Et d’abord ils l’assoient sur la force et la crainte, et non pas sur le respect religieux. Il existe au Tidikelt des zaouias, qui ont été fondées au XVIIe et au XVIIIe siècle comme dans les autres groupes d’oasis. Des chorfa du Touat (Sali) ce sont établis à Aoulef au commencement du XVIIe siècle. Des Kounta se sont fixés à Akabli en 1749, mais ces personnages religieux sont bien loin de jouer dans le Tidikelt occidental le rôle prépondérant qui est dévolu aux gens de poudre, les Ouled Zenana.
La prééminence des familles arabes guerrières a eu pour conséquence[307] certaines tendances monarchiques. A In Salah la famille Badjouda, des Ouled Ba Hammou, exerçait une sorte de royauté.
En somme, sans que les djemaa aient disparu, il existe au Tidikelt, dans chacun des deux centres, une concentration de l’autorité entre les mains de familles arabes militaires. Nous sommes loin de l’anarchie touatienne et cela sent la marche frontière.
Les Berbères d’ailleurs, quoique subordonnés, ne sont pas ici dans une situation humiliée comme les Zenati du Touat et du Gourara, ils ne font pas figure de vaincus et d’annexés.
Le groupe berbère le plus important est celui des Ahl Azzi, ils se disent issus du Tafilalet en faisant étape au Touat. Ils sont m’rabtin (marabouts), c’est-à-dire qu’ils constituent une noblesse religieuse très respectée, dont l’arbre généalogique remonte aux premiers temps de l’Islam. En réalité, j’imagine que leur rôle social est le suivant. Comme Berbères ils sont bilingues, et comme marabouts, dans un pays où toute l’instruction est religieuse, ils ne peuvent pas être tout à fait analphabets. Auprès des Touaregs de marque on trouve généralement un secrétaire Ahl Azzi. Ils constituent une tribu d’interprètes, et ils jouent donc un rôle considérable dans un pays Arabe qui a des voisins et l’on pourrait presque dire des maîtres Berbères.
Car les Touaregs sont chez eux au Tidikelt, ils en sont restés en quelque sorte les suzerains. A 30 kilomètres au sud d’In Salah, Haci Gouiret est dominé par une petite gara couverte d’inscriptions tifinar’ ; ç’a été la guérite des guetteurs touaregs, beaucoup d’inscriptions y sont récentes, grafitti de sentinelles dans un corps de garde, et sa seule existence atteste des prétentions de surveillance et de domination.
L’influence touareg au Tidikelt s’atteste dans le costume, par la prédominance des cotonnades bleues, tout à fait inconnues au Touat et au Gourara où les blanches sont seules en usage.
Quelques tribus ou fragments de tribus Touaregs sont fixés au Tidikelt, à Akabli. — Les Settaf y sont devenus ksouriens, ce sont des nobles Azguers.
Autour d’Akabli gravitent d’autres Touaregs, agrégés aux tribus de l’Ahnet, les Sekakna, les Mouazil et les Kenakat ; ce qui explique pourquoi Sidi Ag Gueradji, chef des Taïtoq et de l’Ahnet, a eu longtemps à Akabli une sorte de maison de plaisance.
Les Sekakna, les Mouazil et les Kenakat sont des nomades, et ce ne sont pas les seuls au Tidikelt — nomades aussi, parmi les Arabes, les Oulad Zenana d’Aoulef, les Oulad Bahamou et les Oulad Mokhtar d’In Salah, les Ouled Yahia et les Ouled Dahane de Timokten, les Zoua[308] de Foggaret ez Zoua. En somme, une fraction assez considérable du Tidikelt continue à nomadiser. Cela s’accuse d’ailleurs dans le tableau, dressé par Voinot, du cheptel au Tidikelt.
600 chameaux, 16 chevaux, 20 mulets, 700 ânes, 2500 moutons et chèvres.
La proportion des chameaux est tout à fait anormale pour un pays d’oasis et atteste la persistance des habitudes nomades. On se rappelle que le Touat n’a pas un seul nomade et que le Gourara en a pour mémoire (les Kenafsa). Voici donc une autre originalité du Tidikelt, et si on peut y voir une survivance de l’époque où tout le pays était en pâturages, il est surtout légitime de noter la relation entre le nomadisme et les vertus guerrières tout particulièrement nécessaires au Tidikelt.
La pénéplaine déserte.
La pénéplaine, hercynienne et calédonienne, qui sépare le Tidikelt des plateaux touaregs est une région naturelle nettement individualisée, un petit Tanezrouft, un désert d’une intensité maximum ; les caravanes la traversent à marches forcées, d’une sorte de bond stratégique ; quitte à souffler et à flâner, quand elles l’ont laissée derrière. Elle fait valoir par le contraste les pays qu’elle sépare, les palmeraies du Tidikelt et les pâturages touaregs.
Et c’est à peu près tout ce qu’on peut en dire. Il est clair qu’une région à travers laquelle on fuit nuitamment se prête mal à une étude de détail et d’ailleurs un pays parfaitement inhabité présentera toujours un intérêt presque exclusivement géologique.
L’homme ne laisse pas cependant d’y avoir marqué sa trace.
A H. Ar’eira, à 500 mètres au sud des superbes gommiers qui voisinent avec le puits, et qui frappent davantage dans un pays aussi nu, les rochers portent de mauvaises gravures rupestres et des inscriptions en tifinar’.
Auprès de Haci Tirechoumin on voit une msalla (mosquée en plein vent) et le tombeau très vénéré de Sidi Abd et Hassani.
Dans toute la partie orientale de la pénéplaine d’ailleurs, les puits ne sont pas très rares, — sur la route d’In Salah, Haci Gouiret et H. el Kheneg sont séparés par 70 kilomètres — Haci el Kheneg et Afoud Dag Rali par une quarantaine.
Sur la route d’Akabli par Baba Ahmed les étapes de puits à puits (Tirechoumin, Ar’eira, O. Adrem) ne dépassent guère une cinquantaine de kilomètres. — Ce sont des distances insignifiantes au désert[309] et pour des méharis. Il est vrai que l’eau ne suffit pas, il faut des pâturages, et c’est leur absence ou leur insuffisance qui impose aux caravanes une allure accélérée.
Les puits se trouvent invariablement dans le lit des grands oueds Bota, Nazarif, Souf Mellen, dans des poches d’alluvions en arrière de barrières rocheuses ; il est difficile de ne pas conclure que ces grands oueds coulent quelquefois, encore qu’on n’ait pas là-dessus un seul renseignement positif. Il est donc possible que des crues exceptionnelles fassent pousser au voisinage des puits des pâturages temporaires, susceptibles de fixer pendant quelques semaines à de longs intervalles un peu de vie humaine.
A mesure qu’on s’avance à l’ouest, c’est-à-dire en aval, l’aridité augmente. La route de Taourirt est extrêmement dure, 140 kilomètres sans eau de Hacian Taibin à Tikeidi. — 165 par la route directe de Hacian Taibin à Ridjel Imrad ; car le point d’eau intermédiaire de Azelmati est intermittent et insuffisant. Ce sont là de vraies étapes de Tanezrouft, dangereuses en été.
Ce grand couloir de l’O. Djar’et est libre de sable au milieu, presque partout on marche sur un sol de roche nette, ou de reg, en un mot sol décapé. Les dunes sont rejetées de part et d’autre, au pied du Tadmaït d’une part, et de l’Ahnet de l’autre (dunes du Tidikelt, erg Timeskis, erg Enfouss, Tessegafi, Fisnet).
Pourtant la sebkha Mekhergan, qui est dans une position tout à fait centrale, est partiellement recouverte et bordée de dunes.
En somme, là comme ailleurs, il semble bien que les dunes se trouvent précisément là où le ruissellement des oueds quaternaires a accumulé les plus grandes masses d’alluvions — à la surface et auprès de ce grand lac desséché qu’est la sebkha Mekhergan, et le long des grandes lignes de rupture de pente.
Plateaux Touaregs.
La partie étudiée des plateaux touaregs est l’extrémité occidentale d’une région beaucoup plus étendue et très uniforme, qui embrasse le Mouidir tout entier, et le Tassili des Azguers. C’est une auréole de grès éodévonien, qui s’étire d’est en ouest sur douze degrés de longitude, et qui joue au Sahara un rôle tout à fait considérable au point de vue humain.
La section étudiée embrasse le Mouidir occidental, l’Ahnet et l’Açedjerad, de Aïn Tadjemout à Ouallen soit une bande de 300 kilomètres de long.
[310]On s’est efforcé déjà d’en décrire par le menu la composition géologique et la structure, qui expliquent sa richesse en eau et en pâturages ; et par conséquent son importance en géographie humaine.
C’est un pays montagneux, les sommets de l’Adr’ar Ahnet doivent approcher de 1000 mètres. Il y pleut à coup sûr un peu plus que dans les plaines basses, quoique là-dessus nous n’ayons ni une observation, ni a fortiori une série d’observations précises. A coup sûr le climat reste saharien, il n’y a pas de pluies régulières, saisonnières et annuelles. En 1903, 1904, 1905, au dire des indigènes, corroboré par la baisse des sources, il n’est pas tombé une goutte d’eau.
Ces montagnes sont en grande partie gréseuses. Les grès reposent sur un soubassement silurien à peu près imperméable ; ils sont très perméables, malgré leur âge, parce qu’ils n’ont jamais été plissés et métamorphisés ; ils sont médiocrement épais ; et interstratifiés de couches argileuses qui les divisent en compartiments étanches ; enfin ils sont faillés et dénivelés. C’est un ensemble de conditions merveilleusement favorables à la création de nappes souterraines et à leur utilisation par l’homme.
Aussi les plateaux touaregs ont une vieille réputation d’humidité et de verdure ; et ils ont incontestablement un caractère désertique moins accusé que les effroyables plateaux crétacés du Mzab et du Tadmaït.
En tous pays les montagnes gréseuses sont plus verdoyantes que les causses.
Le Mouidir-Ahnet n’a pas d’eau courante ; ses oueds, au lit si profondément encaissé, ne coulent que par métaphore, sauf au moment des orages qui donnent naissance à des torrents brusques et éphémères. Pourtant, sur certains points favorisés, et sur des étendues plus ou moins médiocres, un filet d’eau vive survit longtemps à l’orage.
Ainsi, à Tahount Arak, le commandant Laperrine, lors de sa première tournée (en 1902), a vu un ruisselet d’eau courante. En 1903 il avait disparu.
En revanche, il y a ce qu’on pourrait appeler de l’eau libre, de l’eau superficielle, accessible sans outillage de terrassier et sans corde à puits. C’est une grande nouveauté pour qui vient du Tadmaït. Dans ces affreux plateaux crétacés du Sahara algérien les puits sont la seule ressource et ils atteignent souvent de grandes profondeurs (20 à 30 mètres en moyenne sur la route d’el Goléa à Ouargla ; 60 mètres au M’zab). Ils sont souvent creusés en pleine[311] roche, dans le calcaire dur, et ils représentent un grand effort humain collectif. L’eau se soustrait à l’utilisation humaine dans les entrailles du sol.
Le Mouidir-Ahnet a ses puits ; mais quelle différence avec ceux de la hammada crétacée ! Ceux du Mouidir-Ahnet ont quelques mètres à peine de profondeur, ils sont creusés, non pas dans la roche, mais dans les dépôts meubles. Ils représentent une somme de travail si médiocre que, au cas fréquent où la caravane trouve le puits bouché par les éboulis, elle a souvent avantage, au lieu de déblayer le vieux puits, à en creuser un nouveau à côté.
Des puits semblables sont déjà un acheminement aux abankor.
Le mot touareg abankor, dont le représentant arabe est tilmas, n’a pas de traduction française ; on l’applique à une couche de sable humide, où il suffit de creuser à la main un trou de 20 ou 30 centimètres pour qu’il se remplisse d’eau. Il y a par exemple un abankor à Taloak.
Ainsi aux points d’eau du Mouidir, même lorsque l’eau est souterraine, elle est accessible sans grand effort. La plupart ou la moitié du temps on la trouve à l’air libre sous la forme d’une mare. Il y en a deux catégories, les unes sont des sources et les autres des aguelman (en arabe r’dir). Les sources sont parfois reconnaissables sur la carte au nom qu’elles portent, Aïn Tadjemout, Aïn Tikedembati : Tin Senasset, Tin Taggar, Tikeidi et Iglitten sont aussi des sources ; elles sont donc très nombreuses. En général, les sources n’arrivent pas à ruisseler, ce sont de petites vasques, où l’ascension lente de l’eau souterraine contre-balance l’évaporation.
Les aguelman (en arabe r’dir, guelta) sont des mares, voire même des lacs.
L’un des aguelman, Taguerguera (celui d’amont), a près de 100 mètres de long sur 5 ou 6 de large. Il est très pittoresque, une gigantesque vasque de roc nu. Il avait, en 1903, 4 ou 5 mètres de profondeur. (Voir pl. VI, phot. 11.)
C’est incontestablement le géant de tous les aguelman dans la région étudiée, le seul auquel on puisse appliquer le nom de lac.
Les petits aguelman ne sont pas rares : celui de Tamama, en amont de Taguerguera dans l’oued Tar’it (Ahnet) ; celui de Taoulaoun au confluent des oueds Tibratin et Tiratimin ; deux autres sont échelonnés dans les gorges de l’oued Tibratin ; un autre est à Tahount Arak (tout cela au Mouidir). Un autre, que les Touaregs nous ont simplement désigné sous le nom générique de guelta, et qui est apparemment anonyme, mérite une mention spéciale ; il est juché à[312] une altitude d’une centaine de mètres dans les grès siluriens de l’Adr’ar Ahnet presque au sommet d’une vallée torrentielle, étroite et sauvage, et de pente si raide, accidentée de ressauts si brusques, que l’ascension exige des cordes. (Voir pl. XLIX, phot. 91.) La guelta a 4 ou 5 mètres de diamètre et 2 mètres de profondeur, elle est logée dans une anfractuosité de roc nu.
Le trait commun de tous ces aguelman, grands ou petits, c’est de jalonner des lits d’oued ; il est impossible pourtant de les considérer tous comme des flaques, résidus de la dernière crue, des citernes naturelles. M. le lieutenant Besset signale au Mouidir un aguelman alimenté par des sources visibles[239]. Sur l’itinéraire suivi je n’ai rien vu de semblable ; mais il est impossible d’imaginer que Taguerguera par exemple, ou la guelta de l’Adr’ar Ahnet ne soient pas en relation avec une nappe d’eau souterraine. Dans une vasque de roc nu, sous le ciel du Sahara, l’eau ne se conserverait pas indéfiniment si elle n’était renouvelée par l’afflux de sources invisibles.
Je crois que, au Mouidir-Ahnet, la majorité sinon la totalité des aguelman sont des sources, dont on méconnaît la nature parce qu’on les rencontre dans le lit d’un oued. Et d’ailleurs l’érosion, entamant le sol jusqu’au niveau de la nappe, explique la fréquence des sources dans les lits desséchés.
Un raisonnement analogue peut s’appliquer d’ailleurs aux tilmas et aux puits. Au fond du puits d’el Kheneg, par exemple, j’ai noté que l’eau sourd dans la roche même. Il est clair que les expressions, puits, tilmas, aguelman, nous renseignent sur l’aspect extérieur du point d’eau, mais non pas sur l’origine de la nappe. Un puits peut être un mode de captage d’une source, un tilmas peut être une source trop faible pour s’affirmer franchement en surface.
Un coup d’œil sur la carte montre que la distribution générale des points d’eau est indépendante des oueds. Ils jalonnent non pas les cours d’eau, mais bien les lignes de contact géologiques.
Sur la limite supérieure de l’Éodévonien s’alignent Afoud Dag Rali, H. Bel Rezaim, H. In Belrem, Taguerguera, Tikedembati, Taloak, Tin Taggar, Tezzaï, Meghdoua, Tikeidi, Iglitten, Taguellit.
Taoulaoun et Ouallen sont au contact des deux étages éodévoniens.
Le contact inférieur de l’Éodévonien (avec le Silurien) est, lui aussi, assez riche en points d’eau, Aït el Kha, Tin Senasset, Ouan Tohra, Haci Macin, Tahount Arak, H. el Kheneg.
[313]Aïn Tadjemout et Haci Adoukrouz sont au contact du Silurien sédimentaire et métamorphique, sur des failles évidentes.
En somme le Mouidir-Ahnet est par excellence une région de sources ; alimentées par de grandes nappes profondes, les points d’eau sont presque tous pérennes. La longue période sans pluie 1902, 1903 et 1904 en avait asséché plus ou moins complètement un petit nombre dans le haut pays (Tin Senasset, Aït el Kha, surtout aguelman Tamama, qui n’avait plus une goutte d’eau dès 1902). Le grand aguelman Taguerguera avait beaucoup baissé, mais il était loin d’être à sec. Et d’une façon générale la grande majorité des sources ne tarissent jamais.
En géographie humaine, le pâturage est au moins aussi important que le point d’eau, et sans doute les deux vont ensemble, au moins dans une certaine mesure. On constate en tout cas que les pâturages, au Mouidir-Ahnet, tendent à se distribuer eux aussi, suivant les lignes de contact géologique, plutôt que le long des oueds.
A la traversée des plateaux Touaregs, les oueds sont extrêmement pittoresques, ils se sont taillé des canyons étroits, aux murailles perpendiculaires de grès nu, parfois très élevées. Ces gorges sauvages ne sont pas seulement superbe matière à photographies, elles ont pour les Touaregs quelque intérêt alimentaire ; la preuve en est que, en certains points privilégiés, on y observe des groupements de gravures rupestres, trace la plus durable d’ancienne fréquentation — dans le Foum Zeggag par exemple, dans l’O. Tar’it surtout, ou encore dans les gorges de Tiratimin (Mouidir, d’après le colonel Laperrine).
La verdure des canyons pourtant se réduit à une bande étroite au fond du lit, on mène paître de préférence dans les bas-fonds largement étalés, où les bêtes s’égaillent sur de grands espaces, et où le pâturage s’épuise lentement.
A l’intérieur de la zone gréseuse les points les plus fréquentés sont les vallées très ouvertes, — au contact argileux des deux étages gréseux éodévoniens, Ouallen par exemple, Taoulaoun (voir pl. XLV, phot. 84) ; — ou bien encore la cuvette synclinale d’Iglitten où s’est conservé un lambeau méso-dévonien.
Mais c’est de préférence la lisière de la zone gréseuse qui est vivante, au nord et au sud, en aval et en amont de l’auréole éodévonienne.
En aval de l’Ahnet, par exemple, s’étend la grande plaine d’el Ouatia, colmatée d’alluvions plus ou moins transformées en dunes. Cette masse alluvionnaire, qui voile la pénéplaine méso- et néodévonienne est très humide, semée de puits ; sur une grande étendue c’est un pâturage utilisable, on y rencontre toujours des tentes sur un[314] point ou l’autre, et cette plaine pourrait bien être le cœur économique de l’Ahnet, encore qu’elle lui soit excentrique et simplement tangente, à parler littéralement.
A l’autre frontière, celle d’amont, la méridionale, au pied et en arrière des falaises dévoniennes terminales (baten Ahnet), s’étendent sur la pénéplaine silurienne des plaques considérables d’alluvions humides, maader et erg : — ce sont les résidus ou les représentants de ce qu’on appelle en Russie les lacs de glint ; — pâturages d’Aït el Kha, de Ouan Tohra, de Haci Masin, d’Adoukrouz, dans l’Ahnet ; de maader Arak et de Tadjemout au Mouidir.
En somme, aux plateaux Touaregs, la vie végétale, et par conséquent humaine, est surtout périphérique ; les plateaux gréseux eux-mêmes se présentent sous la forme de hammadas grandioses et abominables, indéfiniment nues, noires et luisantes.
La flore. — La flore du Mouidir-Ahnet n’a rien d’original. Au moins n’avons-nous pas vu, je crois, une seule espèce qui ne figure dans le catalogue de Foureau[240].
Les pâturages ne contiennent rien qui soit de nature à surprendre l’estomac des méharis du nord ; on y voit les plantes classiques : le had, le dhamrane, le belbel (toutes trois des salsolacées). Tout au plus pourrait-on signaler parmi les graminées la prédominance inusitée du bou-rékouba (Panicum turgidum et colonum) sur le drinn (Arthratherum pungens). La première est plutôt soudanaise, et la seconde algérienne.
Les espèces arbustives ou arborescentes sont naturellement peu nombreuses ; il semble qu’on puisse essayer d’en dresser une liste, qui sera à la fois très courte et à peu près complète.
Le plus bel arbre, on pourrait presque dire le seul qui mérite ce nom est le talha (acacia gommier) ; quelques échantillons supportent la comparaison avec un grand arbre de notre flore européenne ; la grande majorité, il est vrai, sont bien plus modestes, le tronc atteint à peine la grosseur de la cuisse. (Voir pl. XLVIII, phot. 89.) Après le gommier il faut citer le teboraq (Balanites ægyptiaca) qui a lui aussi le port et les dimensions d’un arbre médiocre.
L’ethel et le tarfa (deux espèces de Tamarix) sont de beaux végétaux, de grosses masses de verdures, mais d’allures buissonnantes,[315] aux troncs multiples et rampants, la ramure est seule vivante, le tronc est un cadavre pourri, où le doigt enfonce. (Voir pl. XLV, phot. 84.) C’est le gommier seul, vu la rareté des Balanites, qui fournit aux Touaregs ce qu’on pourrait appeler leur bois d’ébénisterie, c’est-à-dire de quoi fabriquer le seul meuble du nomade, la selle de son[316] méhari. Sur les gommiers et les Balanites les tamarix ont, du moins, la supériorité de n’être pas épineux, infiniment appréciée de qui s’assoit à leur ombre. Après ces géants il ne reste que le menu fretin des broussailles et des arbustes : — le r’tem qui a des allures de genêt, — le koronka (Callotropis procera), qui ne mérite guère cette épithète latine ; il n’a de grand que son fruit, une énorme gousse ovoïde, d’un beau vert frais, aussi gros qu’un œuf d’autruche, ridiculement disproportionné à sa taille d’un mètre cinquante : il joue un rôle important dans l’économie domestique des Touaregs ; son suc laiteux tient lieu du goudron végétal des Algériens, c’est un remède efficace contre la gale des chameaux, et son bois donne le charbon nécessaire à la confection de la poudre.
Toute cette flore arbustive, au point de vue de la géographie botanique, est plutôt méditerranéenne, la plupart des espèces comme le r’tem et le tamarix rappellent le sud de l’Algérie ; quelques-unes seulement, font déjà songer au Soudan, comme le Balanites ægyptiaca dont le nom revient si souvent dans Barth. En somme, c’est la flore saharienne classique, avec un caractère nettement septentrional. Il y a peu de rapports avec la flore nettement soudanaise de l’Adr’ar des Iforass, pourtant voisin.
D’autre part on ne voit pas encore apparaître, à ces altitudes médiocres, quelques espèces qu’on nous signale plus haut, dans le Hoggar ou même à l’Ifetessen ; le jujubier par exemple (zizyphus lotus) fait défaut, de même que l’olivier sauvage et le thym.
Ce n’est donc pas par l’originalité de sa flore que le Mouidir-Ahnet se distingue, c’est par son abondance relative. Le lit des oueds et les bas-fonds étendus, zones d’épandage des crues, qui sous un autre climat seraient marécageux, et qu’on appelle ici des maader, dessinent à la surface du pays un lacis de verdure, et comme un réseau de circulation et de vie. Il est vrai qu’ils sont mis en valeur par l’effroyable nudité des grands plateaux gréseux qui les séparent. Le contraste et la surprise, la satisfaction de déjeuner à l’ombre, en rehaussent singulièrement l’effet sur l’œil du voyageur et rendent délicate la mise au point des impressions.
C’est incontestablement une verdure éparse et rabougrie, et qui paraîtrait misérable ailleurs qu’au désert. Telle qu’elle est pourtant, elle suffit à la subsistance d’une faune assez abondante d’animaux sauvages et domestiques.
Faune. — Pas de grands carnassiers, rien qui dépasse la taille du renard, du chacal et du fennec (un tout petit canidé à grandes[317] oreilles)[241]. Ils trouveraient pourtant à se nourrir, car le gibier est assez abondant. La girafe et l’autruche ne sont représentées aujourd’hui que par leurs effigies ; l’autruche, en particulier, a été reproduite avec prédilection par les artistes inconnus, auteurs des gravures rupestres. Pas de sanglier, — nous n’avons pas rencontré d’antilope mohor, dont l’existence pourtant ne fait pas de doute, puisque les Touaregs emploient sa peau à confectionner leurs grands boucliers. Les sommets rocheux servent de refuge à des mouflons. Mais c’est la gazelle surtout qui est de rencontre quotidienne, dans le voyage de 1903 les méharistes de l’escorte en ont tué cinquante-quatre ; il est vrai que cette hécatombe s’explique, non seulement par l’abondance du gibier, mais aussi par son inexpérience des fusils à longue portée. Les gangas (un gallinacé voisin de la perdrix) sont aussi d’une candeur qui surprend ; les allures du gibier témoignent de la rareté de l’homme et de la médiocrité de ses armes.
Tout cela, en y ajoutant le lièvre, ne constitue pas une faune sauvage beaucoup plus riche que celle des grands ergs par exemple. Il semble seulement que le nombre des individus soit plus grand au Mouidir Ahnet.
La faune domestique est plus intéressante ; c’est Duveyrier, je crois, qui a signalé en pays touareg la présence de l’âne sauvage ou onagre[242]. Nous avons en effet rencontré (à Tadjemout, en particulier) des troupeaux d’ânes en liberté, loin de toute habitation humaine actuelle. Mais on sait qu’au cours de la première randonnée du commandant Laperrine au Mouidir (1902) un de ces animaux fut chassé, abattu, et qu’on le trouva châtré. Il s’agit, en réalité, d’un mode particulier d’élevage ; les animaux sont complètement laissés à eux-mêmes, on se fie à leur sauvagerie pour les protéger contre le vol. Il semble, il est vrai que cette sauvagerie doive rendre illusoires les droits du propriétaire : il se contenterait, dit-on, de capturer et de dresser les ânons.
Pour que l’élevage soit possible dans de pareilles conditions, il faut un pays de sources et d’aguelman, où l’eau est directement accessible aux bêtes. Dans le Grand Erg ou sur les plateaux crétacés, là où il n’y a d’eau qu’au fond des puits, une bête ne peut boire que si on l’abreuve. La gazelle se tire d’affaire par un miracle qu’on n’a jamais expliqué, peut être une faculté d’abstinence qui dépasserait celle du chameau, ou l’utilisation ingénieuse des plantes succulentes. L’âne abandonné à lui-même serait condamné à mort. D’une façon[318] générale, pour un peuple pasteur, l’existence de l’eau à l’air libre est une condition sine quâ non d’existence ; on ne voit pas les Touaregs abreuvant toutes leurs bêtes seau par seau péniblement tiré du puits.
Ceux du Hoggar élèvent certainement des bœufs à bosse du Soudan ; Guillo Lohan en a vu par troupeaux d’une quarantaine[243]. Motylinski les signale fréquemment. Les Touaregs du Mouidir-Ahnet ne semblent pas en avoir ; pourtant les prisonniers de 1887 ont affirmé le contraire à Bissuel[244] ; et il ne paraît pas incroyable que le Mouidir-Ahnet puisse nourrir quelques bœufs, cela n’est pas en tout cas impossible a priori.
Il y a d’assez beaux troupeaux de chèvres et de moutons sans laine (deman). Les chameaux[245] sont naturellement la partie la plus précieuse du cheptel. Il y aurait une comparaison intéressante à faire entre les méharis touaregs et ceux d’Ouargla (élevés par les Chaamba). Que ceux-ci, habitués au sable, se coupent les pieds sur les cailloux des hammadas, c’est sans doute une simple question d’entraînement. On a signalé depuis longtemps des différences de poil : le méhari targui est parfois tout blanc ; et des différences de structure générale : le méhari targui est moins massif, plus léger. Ce qui frappe surtout, c’est ce qu’on pourrait appeler ses qualités morales ; il est familier, souple, et même silencieux ; cette dernière qualité est particulièrement rare chez ses congénères ; de son maître à lui on croit deviner des liens de confiance et de compréhension mutuelle. En somme, c’est un méhari plus évolué, plus éloigné, par la sélection et le dressage, du chameau de bât dont j’imagine qu’il est issu. Aussi il fait prime, les Chaamba eux-mêmes reconnaissent sa supériorité, malgré leur amour-propre d’éleveurs.
Le Mouidir. — La partie étudiée des plateaux Touaregs se divise en deux parties, en deux individualités bien distinctes, au point de vue géographique et humain, le Mouidir et l’Ahnet.
Le nom de Mouidir est une déformation, dans laquelle il est difficile de dire la part qui revient à la phonétique arabe et à l’européenne, du nom berbère Immidir. La forme incorrecte, consacrée par l’usage, me paraît avoir éliminé tout à fait l’autre.
Il s’agit ici d’une petite partie du Mouidir, la lisière occidentale. Encore que le Mouidir lato sensu soit en dehors de notre sujet,[319] puisque nous ne l’avons pas vu, il est impossible de ne pas signaler entre lui et l’Ahnet une très curieuse similitude de conformation ; non seulement la composition géologique est la même, on l’a déjà dit ; mais la structure et la forme générale sont identiques.
Les cartes le montrent d’un coup d’œil. Que l’on compare par exemple notre carte de l’Ahnet avec celle du Mouidir, dressée par M. Besset[246]. J’ai d’ailleurs publié moi-même une carte géologique générale du Mouidir-Ahnet[247], qui a rapidement vieilli, mais qui fait ressortir la symétrie entre ce qu’on pourrait appeler les deux organismes jumeaux ; le Mouidir et l’Ahnet représentent chacun une cuvette d’effondrement distincte, semi-circulaire ; ou si l’on veut une cuvette synclinale fermée au sud. Dans les deux pays toutes les pentes des hammadas convergent, en section d’entonnoir, vers un centre qui est marqué par la présence des dépôts quaternaires et des dunes.
Les ergs Ennfous et Tessegafi correspondent exactement aux ergs Tegant et Iris. L’oued Adrem tient exactement la place de l’oued Arouri (Bota) ; les pâturages d’el Ouatia ont leur pendant au Mouidir dans les maader Tegant et Iris.
D’autre part, les deux pays, Ahnet et Mouidir, à leur extrémité occidentale, projettent vers le nord, vers le Tidikelt, en long promontoire, une chaîne gréseuse, caractérisée par des bombements anticlinaux fermés. Les curieux accidents isolés de Tikeidi et de Timegerden sont, dans l’Ahnet, la reproduction des dj. Azaz et Idjeran au Mouidir.
La ressemblance fraternelle se laisse établir trait pour trait. Ici et là les mêmes causes orogéniques ont produit les mêmes effets.
Entre les deux régions la seule différence est de niveau, mais elle est considérable. Le Mouidir est traversé par le grand axe montagneux nord-africain, la ligne Hoggar-Ifetessen-Tadmaït. Il est bien plus élevé que l’Ahnet. L’Ifetessen atteint 1600 mètres, l’Adr’ar Ahnet 1000, et l’Açedjerad cinq ou six cents.
Tout est plus grand au Mouidir. M. Besset y décrit des canyons profonds de plusieurs centaines de mètres, ceux que j’ai vus sont certainement plus modestes — 60 ou 80 mètres au maximum. Il a mesuré des aguelman cinq fois plus grands que Taguerguera, le géant de l’Ahnet, et peuplés de barbeaux. Les indigènes lui ont même signalé des crocodiles dans les aguelman du haut Tifirin ; mais ce renseignement semble controuvé ; on sait pourtant qu’Erwin de[320] Bary affirme leur existence au lac Mihero, dans le Tassili des Azguers[248].
M. Besset a trouvé au Mouidir des sources chaudes (Idjeran 38°, Djoghraf 48°) ; et Erwin de Bary en a vu une de 37° dans l’oued Mihero. Cela suppose évidemment au Mouidir et au Tassili des failles plus accusées et des nappes d’eau plus profondes que dans l’Ahnet.
L’eau plus abondante au Mouidir permet quelques misérables cultures (oasis de Djoghraf par exemple).
La partie du Mouidir que nous avons vue, et que nous décrivons, n’est guère plus élevée que l’Ahnet, elle n’en participe pas moins, dans une certaine mesure, à la plus grande richesse en eau du Mouidir lato sensu. Les pâturages y sont étendus, vallée d’In Belrem, de Taoulaoun, maader Arak. A Tahount Arak le colonel Laperrine en 1902 a vu de petits barbeaux qui avaient disparu en 1903 et qui évidemment avaient été apportés des hauts de l’oued par la crue.
Notons surtout qu’en 1903 à l’aïn Tadjemout, nous avons vu des traces de culture ; ce fut certainement un point habité, encore qu’on ne vît pas le moindre vestige de construction. En temps normal, des tentes ou des gourbis y étaient dressés en permanence : de la source part l’amorce d’une séguia ; sur une vingtaine de mètres court, ou plutôt stagne un petit canal d’irrigation, soigneusement complanté de joncs qui le recouvrent en dôme, et le protègent contre l’évaporation ; c’est rudimentaire et misérable, mais c’est l’indice incontestable d’une intention agricole.
Aussi bien Motylinski a dressé par ouï-dire une liste des ar’rem (oasis) touaregs[249] et celui de Tadjemout y figure. En 1903 la présence en troupeaux d’ânes soi-disant sauvages à proximité de la source témoignait apparemment de l’exode récent des habitants.
La venue des Français a vidé le Mouidir de ses habitants, mais il a ses propriétaires, qui reprendront, si ce n’est déjà fait, le chemin de leurs anciens pâturages. Le Mouidir lato sensu est terrain de parcours des Kel Immidir, tribu Imr’ad du Hoggar. Mais le bas Mouidir occidental (les environs de Tadjemout, le maader Arak), en un mot la région qui nous occupe, appartient aux Islamaten, autre tribu Imr’ad du Hoggar « presque agrégée à celle des Kel Immidir, avec qui ils vivent ». Sur le Mouidir occidental (plus particulièrement, semble-t-il, le maader de Taoulaoun, l’oued In Belrem), les[321] Arabes nomades d’In Salah ont ou revendiquent des droits de propriété[250].
Entrer dans plus détails nous entraînerait à exposer l’organisation politique et sociale du Hoggar. C’est une besogne qui a été bien faite par M. Benhazera[251].
Bornons-nous à constater que nous sommes ici, au Mouidir, dans une annexe du Hoggar, c’est-à-dire dans un pays ethniquement et politiquement distinct de l’Ahnet.
L’Ahnet. — L’Ahnet est séparé du Mouidir, au moins le long de l’itinéraire suivi en 1903, par une hammada désolée où les oueds Nazarif et Souf Mellen se sont creusé des lits à sec. Entre les groupements humains du Mouidir et de l’Ahnet, il y a donc semble-t-il solution de continuité assez marquée ; en tout cas, pour les indigènes, la frontière est très nette et les deux pays très distincts.
Le hasard des itinéraires nous a particulièrement familiarisés avec l’Ahnet d’un bout à l’autre et on peut en essayer une monographie.
La carte jointe a été construite pour partie avec les itinéraires Laperrine, Voinot, Villatte[252], et pour partie avec un itinéraire original, de Taourirt à Tin Senasset, au sujet duquel on trouvera en appendice des renseignements précis. Mais j’ai suivi, sans les lever, une bonne partie des itinéraires Laperrine, Voinot et Villatte.
Je ne suis pas sûr qu’il soit correct d’étendre le nom d’Ahnet à la totalité de la région considérée ; les indigènes, autant qu’on peut en juger le réservent à la moitié orientale, et donnent à la corne occidentale celui d’Açedjerad ou Achegrad : (ce sont deux variantes dialectales du même nom, correspondant à deux prononciations différentes, djoug, du même caractère, tifinar’)[253].
En tout cas le complexe Ahnet-Açedjerad est une unité géographique, économique et ethnique, domaine propre des Kel Ahnet et de leurs suzerains Taïtoq.
Bissuel donne au pays qui nous occupe le nom de « région de l’Adrar Ahnet », et Duveyrier avant lui l’avait baptisé « Baten Ahnet ». Ce sont deux appellations peu satisfaisantes. Baten Ahnet[322] s’applique à la grande falaise terminale au sud, la falaise de Glint.
Quant à la dénomination de Bissuel : région de l’Adr’ar Ahnet, elle est bien longue et vague, c’est une périphrase : le nom d’Adr’ar Ahnet, comme Bissuel l’a bien compris, s’applique à une région bien délimitée, et non pas à l’ensemble du pays, qu’il faut appeler Ahnet tout court, comme on dit Mouidir, en englobant l’Açedjerad pour la commodité de l’exposition.
L’Ahnet a eu une singulière fortune en librairie. Il a fait l’objet d’une description géographique détaillée quinze ans avant d’être exploré ou même entrevu par un Européen. En 1887 sept Touaregs de l’Ahnet, au cours d’une razzia malheureuse, furent capturés par les Chaamba, et remis aux mains du gouvernement français. Ce fut l’un d’eux qui accompagna comme guide l’infortuné Crampel. C’était l’époque où le Targui, dans l’imagination du public, après avoir été un chevalier du Moyen âge, tournait décidément au traître de mélodrame ; il fut admis, à tout hasard, que le guide avait trahi : on peut affirmer aujourd’hui qu’il n’a jamais revu son pays, ce qui laisse à supposer qu’il partagea le sort de Crampel. Ses six compagnons d’infortune, internés à Alger, furent interviewés régulièrement pendant la durée de leur détention par Masqueray, alors directeur de l’École des Lettres, et le capitaine Bissuel, officier de bureau arabe. Cette collaboration aboutit à la publication d’un dictionnaire, édité par Masqueray, et d’un ouvrage descriptif, intitulé Les Touareg de l’Ouest, par le capitaine Bissuel[254]. C’est la seule fois peut-être qu’un travail de ce genre ait été fait officiellement dans les prisons. Le livre de Bissuel est accompagné d’une carte de l’Ahnet, dont l’original fut dessiné et modelé par les prisonniers avec du sable sur le carreau de la prison. C’est elle qui a servi de base à tous les travaux cartographiques ultérieurs : carte du Sahara de notre état-major, carte de l’Afrique dans l’atlas de Stieler (Blatt I, bearbeitet von Lüdekke). Nous avons rencontré un des collaborateurs du capitaine Bissuel, Tachcha ag Ser’ ada : il était inconscient de son importance géographique, mais il gardait bon souvenir d’Alger, il l’affirmait du moins, et il exprimait en termes décents son regret de la mort de Masqueray.
La carte de Bissuel, ou plutôt de Tachcha, et le texte qui l’accompagne sont naturellement défectueux, mais beaucoup moins qu’on aurait pu le craindre. La carte figure assez nettement les différentes parties de l’Ahnet, mais non leurs rapports de position, c’est un pêle-mêle de détails justes. Par exemple, l’Adr’ar Ahnet et la montagne[323] d’In Ziza sont, pris isolément, très reconnaissables, mais l’un est placé à l’ouest de l’autre, tandis qu’en réalité il est au sud. Cette carte restera une contribution intéressante à l’étude du sens topographique chez les nomades sahariens. On sait du reste, et la carte Bissuel suffirait à prouver, combien ce sens est développé ; ç’a toujours été un objet d’émerveillement pour l’Européen que la sûreté avec laquelle un indigène suit et retrouve sa route, sans boussole à travers des solitudes uniformes : aussi bien, dans le pays de la soif, est-ce une question de vie et de mort. Nous saisissons ici les limites de ce sens topographique ; il est surtout basé sur des souvenirs visuels ; le nomade ne se représente nettement que le paysage qu’il a pu embrasser d’un seul coup d’œil ; la faculté de coordination et de représentation mentale d’ensemble lui fait défaut ; il y supplée par la sûreté de sa mémoire des détails.
En somme, Tachcha et ses compagnons de captivité ont fait honnêtement leur besogne de géographes ; aux questions qui leur étaient posées ils ont répondu, non seulement avec sincérité, mais encore avec précision ; et c’est un fait assez remarquable. Peut-être faut-il se souvenir à ce sujet que les Touaregs sont des Berbères particulièrement fermés aux influences arabes. Carette, dans ses Études sur la Kabylie, établit une comparaison intéressante entre les onomastiques arabe et berbère ; l’une lui paraît poétique et l’autre terre à terre. « Les noms berbères énoncent un fait, dit-il, les noms arabes expriment une image. » C’est ainsi qu’un défilé où on s’est massacré s’appellera Chabet-el-leham, le « défilé de la viande » ; une source près de laquelle des bandits avaient l’habitude de s’embusquer sera aïn-chreb-ou-harreb, la source « bois et fuis »[255]. Qu’on lise dans le livre de Shaw[256] « une dissertation sur la cité pétrifiée que les Arabes appellent Ras Sem ». C’était une cité morte de Tripolitaine, avec ses rues et ses boutiques bondées de passants et d’artisans dans les attitudes les plus vivantes, mais tous mués en statues d’une roche bleue ou cendrée. Son existence était considérée comme un fait positif par l’ambassadeur de Tripolitaine à Londres, qui le tenait d’un ami d’une incontestable véracité. Le consul de France, M. Le Maire, paya cinq mille francs un enfant pétrifié, apporté furtivement de la cité mystérieuse, et s’aperçut trop tard que c’était une statue endommagée de Cupidon, provenant des ruines de Leptis. Il se consola quelque temps en croyant posséder d’authentiques brioches de pierre trouvées dans la boutique d’un boulanger pétrifié, jusqu’au[324] jour où il fut avéré que c’étaient des fossiles d’oursins, de l’espèce des clypéastres. Shaw admire « la cervelle extravagante des Arabes, ces maîtres en inventions ». Il est possible que des prisonniers arabes eussent fourni à Bissuel des renseignements analogues à ceux que recueillait M. Le Maire, consul de France. Il est remarquable en tout cas qu’à une description de l’Ahnet écrite, loin de tout contrôle possible, sous la dictée d’une demi-douzaine de Touaregs, l’esprit des Mille et une Nuits soit resté aussi complètement étranger. Ce sont des cerveaux simples, dépourvus d’imagination.
Voilà qui prête incidemment à des considérations psychologiques curieuses. On admet aujourd’hui que la proportion du sang arabe dans l’Afrique Mineure est infinitésimale ; elle est habitée par une race berbère homogène et ceux que nous appelons des Arabes ne le sont que de langue. La simple substitution d’une langue à une autre suffit donc à transformer un esprit précis en rêveur ; ou bien ne faut-il pas invoquer plutôt l’influence de l’islam et du monothéisme, dont la langue arabe est le véhicule nécessaire. Naturellement on se fait aujourd’hui une image de l’Ahnet beaucoup plus précise que le tableau tracé par Bissuel.
Il n’y a pas à revenir sur la structure ; on s’est efforcé de l’analyser dans les pages précédentes ; elle n’est pas originale dans ses traits généraux puisque l’Ahnet est une réduction du Mouidir, et qu’il y a entre les deux, en quelque sorte, une simple différence d’échelle.
Pourtant le Mouidir n’a rien qui équivaille au curieux pâté de montagnes siluriennes dans le coin est et sud-est de l’Ahnet, système d’Adoukrouz et surtout Adr’ar Ahnet. On a dit que ce sont des horsts calédoniens fraîchement disséqués par l’érosion ; la raideur des pentes est exagérée par le climat qui déchausse et met à nu le squelette rocheux ; le résultat est un dédale confus d’arêtes et de pitons, séparés par des abîmes, et qui font une impression de haute montagne. (Voir pl. XLVIII, phot. 89, pl. L et LI.)
Au nord, ce monde à part est isolé et abrité par un long talus semi-circulaire haut et régulier de couches gréseuses dévoniennes, redressées à 45°. (Voir pl. XLVIII, phot. 88.) Quand on vient du Mouidir, au sortir des longues hammadas monotones, on longe le pied du talus pendant 30 kilomètres, avant de trouver une voie d’accès, les gorges de l’oued Adjam. C’est une fissure, large à peine d’une centaine de mètres, mais qui entaille la muraille jusqu’à la base ; on a l’impression d’une porte dérobée. (Voir pl. XLVI, phot. 85.)
[325]Au delà on débouche brusquement dans un paysage alpestre. Pourtant le massif d’Adoukrouz est relativement hospitalier ; ses arêtes sont isolées, contournées et découpées par de larges vallées. Autour des puits d’Adoukrouz, de Maçin, et sans doute sur d’autres points encore, s’étendent des pâturages. La région est ouverte, et les Touaregs y dressent souvent leurs tentes.
Au sud, au contraire, le horst silurien forme un seul bloc montagneux massif. C’est proprement l’Adr’ar Ahnet. Comme son nom l’indique, c’est la montagne par excellence, l’alp de l’Ahnet ; elle domine tout le pays. Les indigènes en sont très fiers, et mettent leur Adr’ar en parallèle avec la Koudia du Hoggar. Ce point de vue n’est pas défendable.
Le socle qui supporte l’Adr’ar Ahnet a 500 mètres environ d’altitude au-dessus du niveau de la mer, et, je ne crois pas, sous bénéfice d’inventaire, que les sommets dépassent 300 mètres d’altitude relative au-dessus du socle ; l’altitude absolue ne doit nulle part atteindre 1000 mètres. Nous voilà bien loin du mont Ilaman qui est au moins deux fois plus élevé. Mais les Touaregs n’ont pas de baromètre, et la Koudia elle-même n’est pas d’accès et d’ascension plus difficile que l’Adr’ar Ahnet.
Ce bloc énorme de pierre nue se dresse d’un seul jet, avec des pentes raides et presque verticales, car les strates sont redressées à 60 ou 70° ; l’escalade est difficile, parfois même dangereuse. Nous avons pu constater que sur toute la face ouest il garde cet aspect de muraille infranchissable, et, d’après Bissuel, il en est de même sur les trois autres faces. Il n’y aurait pour pénétrer au cœur de l’Adr’ar Ahnet qu’une voie d’accès praticable, et nous l’avons suivie, c’est l’étroit défilé de l’oued Tedjoudjoult. La vallée de l’oued, toujours aussi profondément encaissée, se prolonge très loin dans la montagne, son lit est constitué par une telle épaisseur de cailloux roulés que toute chance de pâturage sérieux se trouve éliminée. (Voir pl. LI, phot. 93.) Au moins en est-il ainsi jusqu’au point où nous l’avons remontée. L’Adr’ar Ahnet n’est donc pas un centre de pâturage, il ne joue pas un rôle économique : en revanche il en joue un militaire. Ce pâté montagneux inaccessible de toutes parts sauf par un couloir étroit, long et sinueux, est une admirable forteresse naturelle, la casbah de l’Ahnet. Désert en temps de paix, il devient le dernier refuge de la tribu quand elle est battue en rase campagne. A l’entrée des gorges on distingue des traces de travaux de défense, une murette en cailloux roulés dans le lit de l’oued.
De tout l’Ahnet, c’est le point que les prisonniers de Bissuel ont[326] décrit avec le soin le plus méticuleux et l’exactitude la plus approximative. Evidemment, c’est un point vital.
Des points vitaux d’un autre genre, d’ordre économique, sont les points d’eau et les pâturages ; on en a déjà étudié la distribution, le long des limites géologiques.
La vie est surtout périphérique ; au cœur de l’Ahnet (lato sensu), à l’intérieur de la zone gréseuse, il y a peu de points susceptibles de fixer les textes : la vallée d’Ouallen, qui s’étire le long de la bande argileuse intercalée entre les grès ; la cuvette synclinale d’Iglitten, où s’est conservé un paquet de méso-dévonien.
Les points vivants sont bien plus nombreux au sud et au nord des plateaux gréseux, sur la lisière. Au sud les maader « de glint » — Aït el Kha — vallée de l’oued Amdja (Tin Senasset, Ouan Tohra, Foum Imok) — Haci Maçin — Adoukrouz.
Au nord, les plaines d’alluvions bordières, qui s’étalent, semées de dunes, suivant la ligne de rupture de pente — les vallées des oueds Ifisten et Meraguen, avec la région de l’erg Ifisten : — surtout la grande plaine d’el Ouatia et de l’oued Adrem, avec les ergs Ennfous et Tessegafi.
La carte et le texte Bissuel sont très détaillés (ce qui n’empêche pas, il est vrai, la carte d’être singulièrement mauvaise) pour tout ce qui concerne cette cuvette synclinale centrale. Tout concourt à en faire une région privilégiée, elle est encadrée entre l’anticlinal de l’Adr’ar Ahnet et celui de l’Açedjerad. Vers cette cuvette convergent toutes les pentes des hamadas, et la grande majorité des oueds de l’Ahnet viennent y aboutir.
Sur le bord externe de l’Ad’rar Ahnet coule l’oued Souf Mellen qui en draine le versant oriental. Mais, à cette exception près, c’est l’oued Adrem qui est le grand collecteur de toutes les eaux de l’Ahnet. Par ses sources il draine la plus grande partie de l’Adr’ar Ahnet (oued Amdja, oued Tedjouldjoult, oued Maçin). A la traversée des hammadas il prend le nom d’oued Tar’it. (Tar’it est exactement l’équivalent berbère de notre « canyon ».) A son débouché dans la cuvette synclinale, c’est l’oued Adrem ; et toutes les eaux de la région des hammadas, comme de l’Açedjerad oriental, viennent la rejoindre.
Cette convergence des oueds produit les effets qu’on en pouvait attendre. Dans la cuvette synclinale sont accumulés les dépôts alluvionnaires, comme aussi le tourbillonnement du vent dans cet immense amphithéâtre de montagnes y a déposé des dunes.
Tout le centre de la cuvette est percé de puits (Ennfous, puits[327] nombreux en chapelet dans l’oued Adrem) ; son pourtour est jalonné de sources et d’aguelman (aïn Tikedembati, aguelman Taguerguera). A sa surface, les oueds élargis dessinent un lacis de pâturages. Si l’Adr’ar Ahnet est le centre politique et militaire, l’oued Adrem est le centre économique ; c’est là que les pâturages se pressent, et qu’on a le plus de chance de rencontrer des tentes. C’est là en effet que la petite troupe du commandant Laperrine est entrée en relations pacifiques avec les Taitoq et les Kel Ahnet, en 1903 ; c’est là encore que le capitaine Dinaux en 1905 a vu venir à lui toute la délégation de l’Ahnet, exactement à Haci Ennfouss[257].
Chose curieuse, de la région des hammadas, qui s’étend entre l’Adr’ar Ahnet et l’Açedjerad, on ne retrouve pas de traces nettes sur la carte Bissuel ; elle semble donc ne pas avoir fixé l’attention des indigènes auteurs de cette carte ; elle n’a pour eux, apparemment, aucune espèce d’intérêt pratique, c’est une étendue pierreuse inutilisable, où ils n’ont rien à faire et où ils ne vont pas.
Ce sont pourtant les hammadas entaillées de canyons qui frappent d’abord l’Européen ; elles sont l’élément caractéristique du paysage ; on conçoit aisément que ce point de vue ne soit pas celui des indigènes, qui doivent résoudre en pareil pays le problème redoutable de l’alimentation quotidienne, et pour qui les données économiques remplissent tout le premier plan de l’attention.
A ce titre économique il faut insister sur l’importance de quelques points, amorces de routes transsahariennes. Au sud de l’Ahnet s’étend un redoutable Tanezrouft traversé par deux routes seulement l’orientale qu’on pourrait appeler route d’In Ziza, et l’occidentale, ou route d’Ouallen.
Le volcan éteint d’In Ziza[258], avec ses points d’eau pérennes, est[328] d’une telle importance pour l’Ahnet que Bissuel et ses informateurs touaregs le décrivent comme en faisant partie. En réalité il est à 150 kilomètres au sud, en plein Tanezrouft, et il n’y a pas lieu de le décrire ici. Contentons-nous de dire que la route orientale, coupée d’aiguades très espacées, mais très abondantes et très sûres (In Ziza, Timassao) est beaucoup plus facile et plus suivie que l’autre. Elle aboutit dans l’Ahnet proprement dit, au voisinage de l’adr’ar Ahnet, de part et d’autre de l’adr’ar Adhafar, soit à Aït el Kha, soit dans l’oued Amdja[259] (Tin Senasset, Ouan Tohra). Aït el Kha est certainement plus rapproché d’In Ziza, mais dans les périodes de longues sécheresses le point d’eau et le pâturage sont insuffisants. Aussi, en 1905, le capitaine Dinaux, avec ses 170 animaux, a dû partir non pas même de Tin Senasset, à peu près tari, mais de Ouan Tohra.
La route occidentale quitte l’Açeddjera à Ouallen. Deporter[259] jadis, et plus récemment, comme aussi, je crois, plus exactement, M. Mussel[260], notre compagnon de voyage, ont recueilli des renseignements sur cette route d’Ouallen. Quelques points d’eau y sont mentionnés, mais incertains et médiocres : « Hassi Azenazen, qui ne cesse d’avoir de l’eau que sept ans après la pluie ... Tin Diodin et Tin Daksen. Ces deux points cessent d’avoir de l’eau deux ou trois ans avant la pluie. »
La route d’Ouallen n’a jamais encore été suivie par nos méharistes et le colonel Laperrine en 1906 n’a pas osé la prendre. Elle est mauvaise et dangereuse. En revanche par Haci Achourat elle aboutit à l’Azaouad et à Tombouctou, c’est une supériorité sur la route d’In Ziza, qui mène directement chez les Ifor’ass, mauvais intermédiaires pour un trafic transsaharien, puisque les Maures Kountas leurs ennemis leur interdisent pratiquement l’accès du Niger.
Ouallen est très anciennement connu par renseignements ; mais il n’a été vu encore que par les quelques Européens qui encadraient ou accompagnaient le détachement Mussel en mai 1905. M. Mussel ne croit pas pouvoir en donner les coordonnées géographiques[261]. C’est, je crois, que je n’ai pas pu lui communiquer en temps utile, et intégralement, les résultats de nos observations communes ; nous étions, il est vrai, mal outillés ; le sextant employé était affecté d’une grosse erreur systématique, et d’ailleurs, sous cette latitude et dans cette saison, c’est un théodolite qu’il eût fallu. Pourtant les données[329] de l’itinéraire ne peuvent pas être grossièrement inexactes. Comme on pouvait s’y attendre la position réelle d’Ouallen est notablement différente de celle qu’on lui attribuait par renseignements. L’erreur est d’un demi-degré environ en latitude et en longitude (voir par exemple Atlas Stieler et se reporter à notre appendice I, p. 342.)
Ouallen est le seul point de tout l’Ahnet où l’on puisse signaler un bâtiment, en ruines d’ailleurs. D’après Mussel « la casbah d’Ouallen aurait été construite par un marabout de la zaouïa Mouley Heïba, existant encore actuellement à l’Aoulef. Destinée, selon les uns, à servir de refuge aux gens qui revenaient du Soudan, elle aurait été construite, selon les autres, par un marabout de l’Aoulef, chassé par ses khouans, afin d’interdire l’accès des puits aux gens de l’Aoulef venant du Soudan[262] ».
Je retrouve dans mes notes que la casbah d’Ouallen fut occupée un temps par des Arabes coupeurs de route, les Oueld Moulad. En tout cas c’est un château fort, et non pas du tout le centre d’une exploitation agricole, dont on ne voit, aux alentours, ni traces, ni même possibilité ; un mauvais pâturage, un petit groupe de puits très peu profonds et abondants, voilà quelles étaient les seules ressources d’Ouallen en 1905. Les puits eux-mêmes étaient peu fréquentés, puisque, au fond de l’un d’eux nous avons trouvé une tanière de chacal.
Il faut noter que la casbah est construite en pierres sèches, elle appartient donc à une catégorie d’édifices archaïques très répandus au Sahara, de l’Atlas au Niger (à Colomb-Béchar, dans l’oued Saoura, à Charouïn, au bas Touat, ar’rem d’es-Souk et de Kidal dans l’Adr’ar des Ifor’ass). Il est intéressant de constater ici qu’une forteresse de ce genre peut se trouver dans un point comme Ouallen, où toute agriculture semble impossible.
Sur ces routes transsahariennes qui aboutissent à l’Ahnet il se fait peu de commerce ; pour l’alimenter, outre les produits de l’élevage, il faut noter qu’il existe des ressources minérales locales.
Les unes sont au Tidikelt occidental, dont les Touaregs de l’Ahnet sont les courtiers. C’est d’abord l’alun d’Aïn Chebbi ; c’est un produit assez répandu au Sahara dans les schistes du Silurien supérieur, les Touaregs l’utilisent comme mordant. Auprès d’Akabli, dans les argiles schisteuses carbonifériennes (?), les indigènes exploitent un produit minéral qu’ils appellent tomela. C’est un sulfate de fer, qui donne une couleur noire très recherchée. Alun et tomela alimentent[330] surtout les petites industries domestiques de la tente chez les Touaregs ; le travail du cuir. (Voir appendice IX, p. 357.)
Le sel de l’Açedjerad est au contraire un produit d’échange, qu’on exporte au loin, au Soudan en particulier. Ce sel se trouve quelque part dans les hauts de l’oued Meraguen, au lieu dit Tiliouin In Chikadh ; qui est très célèbre, et dont j’ai beaucoup entendu parler, sans le voir.
Touaregs de l’Ahnet. — Sur les habitants de l’Ahnet on a maintenant des renseignements précis. On en trouvera le détail dans le travail de M. Benhazera[263].
L’Ahnet est sous la suzeraineté exclusive d’une tribu noble Touareg, les Taïtoq ; il est habité par eux et par leurs imrads dont les principaux sont les Kel Ahnet (gens de l’Ahnet).
Taïtoq et Kel Ahnet ont les plus grandes affinités avec leurs congénères du Hoggar. Les Taïtoq sont des Hoggar ou Ahaggar[264] au sens littéral du mot. « En Tamaheq, dit M. Benhazera, le mot Ahaggar, pluriel Ihaggaren, veut dire noble, et s’applique indistinctement à tous les nobles. » Les Taïtoq sont une des trois familles ou tribus nobles qui se partagent l’autorité dans la confédération du Hoggar, ils se rattachent comme les deux autres, à l’aïeule commune Tin Hinan, enterrée à Abalessa dans un beau tombeau mégalithique[265].
Les Kel Ahnet se réclament aussi d’une aïeule commune aux Dag R’ali, la plus importante des tribus Imr’ads du Hoggar ; cette aïeule commune est Takamat qui est enterrée elle aussi à Abalessa, auprès de Tin Hinan, dans un redjem turriforme.
Tous ces gens-là ont donc pour patrie Abalessa, où ils ont leurs tombeaux de famille.
Les Taïtoq se sont brouillés avec l’autre grande tribu noble, les Kel R’ela (la troisième tribu ne comptant pas numériquement) ; c’est la vieille rivalité, souvent sanglante, entre Kel R’ela et Taïtoq qui donne à l’Ahnet une vie à part, une individualité politique.
Les Taïtoq ont pour tributaires (outre les Kel Ahnet), des Arabes nomades d’Akabli, les Mouazil, les Settaf, et les Sekakna, qui portent d’ailleurs le costume et l’armement des Touaregs. Il en résulte qu’Akabli est pour les Taïtoq une sorte de capitale. Leur chef, Sidi ag Gueradji, y possède une maison et y a fait de longs séjours. Toute la tribu se trouve avoir une familiarité plus intime avec la langue et[331] la culture arabe. On parle couramment arabe dans l’Ahnet, ce qui est bien loin d’être le cas au Hoggar. Il y a là pour les gens de l’Ahnet un principe d’individualisation. — La soumission des Taïtoq à l’autorité française a précédé celle des autres Touaregs, sans doute parce que, d’esprit plus ouvert, ils comprirent plus vite la situation nouvelle.
| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. LII. |

Cliché Laperrine
94. — TOUAREG ARMÉ.

Cliché Laperrine
95. — TOURNOI TOUAREG, ou plus exactement fantasia.

Cliché Laperrine
96. — UN AUTRE TEMPS DE LA FANTASIA TOUAREG
Les Taïtoq et leurs Imr’ads restent néanmoins mêlés intimement à la vie commune de la confédération Hoggar dont ils font partie. Il leur serait d’ailleurs géographiquement impossible de s’en abstraire. Les pâturages de l’Ahnet, comme tous ceux du Sahara d’ailleurs, sont trop incertains pour qu’on puisse compter exclusivement sur eux. Taïtoq et Kel Ahnet sont propriétaires ou usufruitiers de districts étendus dans l’Adr’ar des Ifor’ass, où ils voisinent avec les Kel R’ela.
Actuellement pourtant les Taïtoq ont obtenu des autorités françaises la consécration de leur autonomie ; leur chef Sidi ag Gueradji est un aménokal indépendant.
Ce que nous avons appris de plus neuf dans ces dernières années sur les Touaregs en général et les Taïtoq en particulier, c’est leur faiblesse numérique. D’après Bissuel les tribus qui habitent la région de l’Ahnet « pourraient armer deux cent cinquante combattants, auxquels viendraient se joindre dix guerriers de Sekakna et quinze des Mouazil, soit un total de 275 hommes, dont la répartition par tribus nous reste inconnue ».
Ce sont des chiffres bien modestes, 275 soldats sur 15000 kilomètres carrés ; et combien suggestive la mention de dix guerriers des Sekakna. Ces chiffres sont encore exagérés de plus de moitié.
D’après M. Benhazera les Kel Ahnet peuvent mettre sur pied une cinquantaine d’hommes ; et c’est de beaucoup la fraction la plus intéressante ; qu’on lise, chez M. Benhazera, la liste nominative des Taïtoq, comportant 28 numéros. Ce sont des pays où les recensements se font sur les doigts de la main.
Avec le travail de M. Benhazera pour base on peut essayer de tracer un tableau économique de l’Ahnet.
| CHAMEAUX | MOUTONS OU CHÈVRES | BŒUFS | PALMIERS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taïtoq | 375 | 1000 | 0 | ||
| Kel Ahnet | 600 | 1500 | 0 | ||
| Iouarouaren | 225 | 600 | 0 | 300 | (près de Silet). |
| Mouazil et Settaf | 100 | ? | 0 | ? | (Akabli). |
| 1300 | 3100 | 0 | |||
[332]En somme environ 1300 chameaux et 3000 moutons, c’est là-dessus exclusivement que les Touaregs de l’Ahnet doivent vivre. Il faut souligner l’absence à peu près totale de cultures ; à défaut de céréales on moissonne méthodiquement des graminées sauvages (le drinn) ; ce qui nous reporte en quelque sorte avant Triptolème. Les Touaregs de l’Ahnet sont plus pauvres que leurs cousins du Hoggar ; ceux-ci ont quelques bœufs et quelques cultures ; Motylinski énumère au Hoggar 35 ar’rem (oasis rudimentaires) ; l’Ahnet n’en a pas un seul. C’est encore un élément d’individualisation. Plus pauvres que les Kel R’ela, les Taïtoq sont aussi des bandits plus redoutables ; ils représentent ce qu’on pourrait appeler la fleur de la chevalerie Touareg ; redoutés et légendaires pour leur humeur batailleuse. Il leur en a cui d’ailleurs. La tribu s’est épuisée à courir les aventures. La dernière fut particulièrement tragique.
En 1906 sur une quarantaine de Touaregs, en majorité Taïtoq, partis en rezzou au Sahel marocain, 4 seulement sont revenus.
Les Touaregs[266] ont vivement excité l’intérêt des voyageurs, depuis Duveyrier jusqu’à M. Benhazera : ils sont une admirable matière à monographie ; celle en particulier qu’a écrite Duveyrier reste excellente, il serait absurde de vouloir la refaire.
Je crois seulement qu’un côté de la question mériterait d’être mis en lumière. Les Touaregs sont incontestablement de race caucasique. Je crois bien que certains caractères physiques, la taille colossale chez beaucoup d’hommes, le stéatopygie chez quelques femmes, témoignent d’un mélange avec le sang nègre qui est d’ailleurs avoué. Dans l’ensemble pourtant le sang caucasique semble s’être défendu admirablement. M. Desplagnes qui le constate l’explique par les usages matrimoniaux (matriarcat) ; le Touareg a des négresses pour concubines, mais comme « le ventre teint l’enfant », les métis qui résultent de ces unions sont considérés comme nègres et restent étrangers à la tribu. Ce point de vue est peut-être juste, au Soudan en particulier. Au Sahara une autre explication me paraîtrait possible. On a remarqué au Soudan que le nègre boit énormément, sans doute parce que sa peau est conformée pour évaporer énormément, en conséquence il a horreur du désert, le pays de la soif. La soif joue peut-être au désert, parmi les nomades, le même rôle que la malaria[333] aux oasis. Sous les palmiers la race noire, résistante à la malaria, élimine la blanche. Dans les pâturages et sur les grands chemins la race blanche, résistante à la soif, éliminerait la noire ? Cette explication repose, il est vrai, sur une hypothèse incomplètement prouvée, — que l’organisme caucasique serait plus spécialement susceptible d’acquérir « une structure xérophile », comme disent les botanistes.
Quoi qu’il en soit de l’explication le fait est constant. Il a été souvent mentionné. Un trait de ressemblance avec la race blanche, que je ne me souviens pas d’avoir vu noter ailleurs, est la précocité de la calvitie et de la canitie chez les Touaregs. Elle est d’autant plus frappante que le corps, entretenu par des exercices violents, conserve sa souplesse jusqu’à un âge avancé. Quand le vent soulève les voiles bleus, on aperçoit souvent des barbes incultes, grises ou blanches, qu’on eût été tenté de situer plutôt entre un faux col et un chapeau rond.
Les intelligences et les caractères nous font aussi une impression caucasique, fraternelle ; on a comparé les Touaregs aux chevaliers du Moyen âge (voir pl. LII, phot. 95, 96) ; on sait combien fut vive la sympathie de Duveyrier ; des personnalités comme celle d’Ikhenoukhen, le contemporain de Duveyrier, ou bien de Moussa ag Amastane et de Sidi ag Gueradji[267], qui jouent aujourd’hui les premiers rôles, nous sont pleinement intelligibles et nous attirent vivement ; tandis qu’un héros noir ou jaune, Béhanzin ou le Dé-Tham nous paraît toujours par quelque côté monstrueux ou inquiétant.
M. Chudeau voudrait rattacher les Berbères à la race de Cro-Magnon[268] ; en tout cas tout se passe comme s’ils étaient relativement près de nous, du moins comme individus, comme organismes humains.
Comme société au contraire, ils sont prodigieusement loin au delà de la barbarie, encore en pleine sauvagerie primitive. On a dit qu’ils sont à peine dégagés du néolithisme, — (bracelet de pierre polie, emmanchure néolithique de la hache en fer). — Le totémisme chez eux est encore tout frais, ils ont de nombreux tabous, le lézard de sable, la poule, le poisson ; et ils en rendent compte par des considérations de parenté : « Nous ne mangeons pas l’ourane, parce qu’il est notre oncle maternel. » Le voile qui n’est pas du tout une mesure hygiénique ne peut pas être autre chose qu’une survivance[334] d’un vieux tabou[269]. On a beaucoup admiré, par opposition à l’asservissement de la femme arabe, la situation élevée que la femme tient dans la famille et dans la société : cette admiration est très justifiée ; mais l’égalité des sexes qui sera peut-être une conquête de l’avenir était réalisée au berceau de l’humanité ; la famille Touareg a pour base le matriarcat, comme la famille primitive[270] ; « le ventre teint l’enfant », c’est-à-dire qu’il suit sa mère et qu’il ignore son père ; son plus proche parent mâle est l’oncle maternel ; les mœurs sont très libres, polynésiennes.
En effet cette coexistence d’institutions aussi anciennes, néolithisme, totémisme, matriarcat, avec une cérébralité individuelle très développée, rappelle la Polynésie. Aussi bien y a-t-il peut-être quelque analogie géographique entre des montagnes isolées au milieu du désert et les atolls du Pacifique.
Nous allons nous trouver mieux outillés maintenant pour comprendre ce que fut au Tidikelt, au Touat, etc. la conquête arabe et si l’on veut andalouse des XVe et XVIe siècles. Ces « nazaréens » dont on voit dans la Saoura les villages détruits, ces Zénètes Juifs du Gourara et du Touat, ces Barmata du bas Touat, toutes ces populations qui furent islamisées et arabisées par les marabouts de la Seguiet el Hamra, appartenaient sans doute à ce type d’humanité qui s’est conservé en pays touareg.
Ibn Khaldoun nous apprend que les Sanhadja du Sahara se convertirent à l’islamisme au IIIe siècle de l’hégire[271], lors de la conquête almoravide dont ils furent les instruments et les bénéficiaires. Mais cette conversion fut superficielle, les Touaregs n’ont ni mosquée, ni clergé, ils ne pratiquent pas la prière et le jeûne ; ils ont une réputation d’impiété parfaite auprès de leurs voisins arabes, chez qui le R’amadan par exemple bouleverse une fois l’an toute la vie domestique et publique.
Aujourd’hui encore l’Islam et la langue arabe, l’un portant l’autre, après avoir conquis le Maurétanie et le Touat, s’attaquent au bloc Touareg. Les personnages influents au Hoggar sont des marabouts kounta, le fameux Abiddin, ou bien encore Baÿ de Teleyet, qu’on pourrait appeler le directeur de conscience de Moussa ag Amastan.
Il faut définir ainsi les Touaregs : ce sont ceux des Berbères Sanhadja, qui ont échappé jusqu’ici au grand mouvement d’expansion islamique, parti au XVe siècle de la Seguiet el Hamra. On trouve en présence au[335] Sahara, sur deux domaines très distincts, d’une part des Touaregs, et de l’autre des Arabes nomades, des Maures. Il y a entre eux d’énormes différences de langue, de culture, de mœurs, de costume, d’armement, sans parler de haines inexpiables. Ce sont deux peuples différents à coup sûr et l’on voudrait dire deux races. L’histoire nous montre que ce fossé si profond est creusé d’hier ; de part et d’autre il y a les mêmes Berbères Sanhadja, mais les uns sont franchement convertis à l’islamisme, et les autres ont conservé dans la famille, dans la société, dans les mœurs, une énorme quantité de survivances préislamiques ; disons que les uns sont des civilisés et les autres des sauvages. Nous avons vu que le Tidikelt est la dernière conquête arabe, et que le résultat de la conquête fut la création des palmeraies. Comme représentants de la civilisation, c’est nous qui avons succédé aux marabouts marocains. Réussirons-nous à créer des oasis dans l’Ahnet ?
D’une façon générale, les plateaux touaregs et les causses du Tadmaït ont actuellement à peu près la vie économique qu’ils méritent. Les causses sont le pays classique des très grosses sources qui concentrent la vie sur un petit nombre de points. Les plateaux gréseux, qui sont en Europe pays de bois, semblent naturellement appelés au désert à devenir pays de pâturages.
Il semble incontestable pourtant que les Touaregs, aussi longtemps qu’ils furent les maîtres au Tidikelt y ont entravé la culture. On se rend très bien compte d’ailleurs qu’ils l’entravent au Hoggar, où elle semble appelée à prendre un certain développement[272]. L’avenir agricole du Mouidir-Ahnet est plus incertain en ce sens que les indigènes, dont la connaissance du pays est la base même de tout progrès, ne nous donnent ici aucune indication. L’avenir dépend d’un forage heureux de puits artésien, et le choix de l’emplacement est délicat.
[219]Voir la carte p. 315 et la grande carte géologique en couleurs.
[220]M. Flamand a constaté l’existence de cette faille dès 1900, ainsi qu’il a bien voulu me l’affirmer oralement.
[221]Je répète qu’une partie de tout ceci est empruntée aux conversations de M. Flamand.
[222]C. R. Ac. Sc., 23 juin 1902. M. Flamand ne précise pas la provenance des fossiles qui lui ont été envoyés par M. le capitaine Cauvet.
[223]C. R. Ac. Sc., 2 juin 1902.
[224]Documents, etc., p. 588, fig. 152.
[225]Id., p. 755.
[226]Il s’ensuit que l’expression de plissement calédonien est inexacte, puisque ce plissement n’affecte pas le Silurien supérieur. Mais cette expression est provisoirement commode encore qu’inadéquate.
[227]G.-B.-M. Flamand, Sur l’existence des schistes à graptolithes à Haci el Kheneg C. R. Ac. Sc., t. CXI, p. 954-957, 3 avril 1905.
[228]Une phrase de deux lignes dans G.-B.-M. Flamand : Mission au Tidikelt. La Géographie, 1900, p. 361.
[229]MM. Flamand et Ficheur, après un examen très sommaire, avaient rattaché ces fossiles au Carboniférien (voir E.-F. Gautier, le Mouidir-Ahnet, dans La Géographie, juillet 1904). Ce qui rend tout à fait certain, d’après M. Haug, l’âge supradévonien c’est la présence de Spirifer Verneuilli, accompagnée de Productella cf. dissimilis, etc.
[230]C. R. Ac. Sc., 4 décembre 1905.
[231]L. c.
[232]Mussel, Renseignements coloniaux, juin 1907. (Voir appendice I, p. 340.)
[233]Sur la carte géologique, il a été marqué Dévonien par erreur.
[234]C. R. Ac. Sc., 19 mars 1906.
[235]Besset, Bulletin du Comité de l’Afrique française, 1904. — E.-F. Gautier, Le Mouidir Ahnet, La Géographie, X, 1904.
[236]Je saisis cette occasion de remercier M. le commandant Lacroix, qui a bien voulu me communiquer ce travail ; — et M. Voinot lui-même à qui j’ai d’ailleurs d’autres obligations.
[237]L. c., p. 212.
[238]J’en donne en appendice. M. Flamand en a signalé : il en existe auprès du fort Miribel, d’après le colonel Laperrine.
[239]Bulletin du Comité de l’Afr. fr. Supplément de décembre 1902.
[240]Foureau, Essai de catalogue des noms arabes et berbères de quelques plantes, arbustes et arbres algériens et sahariens. Paris, Challamel, 1896. A l’user de ce catalogue on s’aperçoit que les Arabes et les Berbères ont parfois réuni sous un même nom des espèces voisines mais nettement différentes (drinn, diss par exemple). On reviendra là-dessus dans le second volume.
[241]Canis Zerda.
[242]Duveyrier, p. 222 et 225.
[243]Renseignements coloniaux, etc., 1903, no 8, p. 213.
[244]Bissuel, Les Touareg de l’Ouest, p. 67.
[245]Je sais naturellement que ces chameaux sont des dromadaires ; mais l’appellation de chameaux est aussi courante que défectueuse.
[246]Renseignements coloniaux publiés par le Comité de l’Afrique française, 1904, no 1.
[247]La Géographie, 15 juillet 1904.
[248]Schirmer, Journal de voyage d’Erwin de Bary, p. 56.
[249]Bulletin du Comité de l’Afr. fr. Supplément d’octobre 1907.
[250]Lieutenant Voinot, A travers le Mouidir, dans le supplément du Bulletin du Comité de l’Afr. fr. de septembre 1904.
[251]Maurice Benhazera, Six mois chez les Touareg du Ahaggar, Bulletin de la Société de Géographie d’Alger, 1906, 2e et 4e trimestre.
[252]Voir Bulletin du Comité de l’Afr. française : renseignements coloniaux, septembre 1904 ; et Géographie, 15 octobre 1905.
[253]Voir appendice IV.
[254]Les Touareg de l’Ouest, Alger, 1888.
[255]Exploration scientifique de l’Algérie, Études sur la Kabylie, par E. Carette, 1848.
[256]Thomas Shaw, Relating to several parts of Barbary, Oxford, 1738.
[257]Bulletin du Comité de l’Afr. fr. Renseignements coloniaux, janvier 1907, p. 15. Le capitaine Dinaux écrit Ehenfous, et sans doute a-t-il de bonnes raisons pour cela. Comme d’habitude en matière de noms touaregs l’orthographe usuelle (?), si tant est qu’on puisse invoquer un usage, a bien des chances d’être incorrecte.
[258]M. Flamand a contesté que In Ziza fût un volcan éteint (Supplément au Bulletin du Comité de l’Afrique française de mars 1905, p. 137) ; et M. Mussel revient longuement sur cette question en s’appuyant sur l’autorité de M. Flamand dont il adopte les conclusions (Supplément au Bulletin du Comité de l’Afr. fr. de juin 1907, p. 149). Une contradiction aussi formelle avec un géologue de la valeur de M. Flamand serait grave s’il avait vu In Ziza ; le jour où il ira y voir cette contradiction disparaîtra. Sur la nature volcanique d’In Ziza les nombreux échantillons de laves rapportés ne laissent aucune espèce de doute ; ils sont à l’étude au Muséum. D’ailleurs l’appareil du volcan est très reconnaissable, on voit l’emplacement de la cheminée marqué par des dykes, on distingue les coulées qui constituent la masse même de la montagne ; la roche encaissante est du gneiss. Notons pourtant que l’aguelman d’In Ziza, que j’ai donné pour un cratère lac adventice, pourrait bien être comme le veut M. Flamand une marmite de géants.
Il est naturel de rattacher l’étude de ce volcan à celle des volcans du Hoggar, dont M. Chudeau se chargera dans le second volume de la présente publication.
[259]Deporter, Extrême-Sud de l’Algérie.... Alger, 1890.
[260]Mussel, Du Touat à l’Achegrad. Bulletin du Comité l’Afr. fr. Renseignements coloniaux, mars 1907, p. 57.
[261]L. c., p. 57.
[262]L. c., p. 57.
[263]L. c., p. 371.
[264]Ahaggar est l’orthographe correcte en même temps qu’inusitée.
[265]La description la plus détaillée qui en ait été faite est celle de Motylinski. Supplément au Bulletin, etc., octobre 1907. On y trouvera une photographie du Tombeau.
[266]Il est bien entendu que Touareg (singulier Targui) est probablement dérivé du berbère Targa, qui fut au Moyen âge le nom d’une tribu Sanhadja ; — mais que aujourd’hui, les intéressés ont rejeté ce nom, qui leur a été conservé par les Arabes ; — les Touaregs se donnent à eux-mêmes le vieux nom d’Imohar ou Imochar (berbère Imaziren, Tamazirt, latin Mazyces). On trouvera tout cela et bien d’autres choses dans Duveyrier et Benhazera.
[267]Voir Benhazera, l. c., E.-F. Gautier, La Géographie, 1er semestre 1906, p. 9.
[268]Il n’est point seul. Voici un curieux passage extrait du journal Le Temps (8 mars 1904). M. Pierre Mille, écrivant de Tombouctou, décrit des Touaregs, et il note « leurs traits réguliers, leurs lèvres fines, leurs nez arrondis du bout, comme ceux des montagnards pyrénéens ».
[269]Voir là-dessus : Frazer, Le Rameau d’or, traduction Stiébel, t. I, p. 243.
[270]Voir Frazer, The golden Bough, 3e édition, part IV, p. 383 et suiv.
[271]Duveyrier, p. 325.
[272]Motylinski, Supplément au Bulletin de l’Afr. fr., octobre 1907.
APPENDICES
[339]APPENDICE I
ITINÉRAIRES ET OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES
Pour dresser les cartes de l’oued Messaoud (hors texte) et du Tidikelt-Mouidir-Ahnet (p. 315), on s’est appuyé sur trois itinéraires originaux qui sont : du Touat à Haci Sefiat, — de Zaouiet Reggan à Haci Rezegallah, — de Taourirt à Tin Senasset, par la route d’Ouallen.
Ces itinéraires ne sont pas présentés isolément, on les a reportés sur la carte générale, autrement dit on les a rapprochés des autres itinéraires antérieurement publiés.
Les itinéraires sont basés sur un nombre malheureusement petit d’observations astronomiques. Les instruments utilisés sont, outre les trois montres, un sextant et une lunette. Le sextant était en mauvais état, on a dû le faire réparer par le forgeron nègre de Taourirt (!). La lunette, par une étrange vicissitude, est celle de Cazemajou, rapportée par les tirailleurs après le massacre de la mission, et que le Comité de l’Afrique française a mis à la disposition du colonel Laperrine.
Les calculs ont été faits à l’Observatoire d’Alger, où la haute compétence et l’inépuisable complaisance de M. Trépied ont remédié en quelque mesure à la défectuosité du sextant. L’erreur instrumentale a pu être déterminée, du moins pour la période postérieure à l’opération chirurgicale de Taourirt.
Les itinéraires ont été établis à la boussole et reportés chaque jour au 1 : 100000 sur un carnet spécial. Pour l’utilisation de ce carnet on a adopté la méthode recommandée par M. Trépied[273], et on a calculé directement d’après le carnet les principales positions. On les donne ci-dessous.
Itinéraire de Haci Sefiat. — Le point de départ, Adrar, capitale administrative du Touat est assez bien déterminé ; d’après plusieurs séries d’observations de hauteurs de la polaire la latitude est : 27° 52′,6.
[340]Une occultation observée par M. Niéger donne la longitude 2° 39′,5 (ouest).
En prenant ces chiffres pour base et en calculant d’après le carnet de route on trouve :
| Haci Sefiat | φ 27° 16′,5 | L. 3° 3′,1 ouest. |
D’autre part j’ai observé en ce point quelques hauteurs de polaire qui donnent, sans correction, φ 27° 16,3. Malgré le mauvais état du sextant, cette concordance laisse à supposer que l’observation est valable.
Le point ainsi déterminé n’est pas exactement le puits de Sefiat c’est notre campement à 1500 mètres environ au nord du puits.
Enfin le puits de Sefiat n’est pas le seul de ce nom, si tant est qu’il y ait bien réellement droit. Le colonel Laperrine, revenant de Taoudéni, a trouvé un autre haci Sefiat, beaucoup plus important par φ 27° 20′ 42″ et L. 3° 12′. On l’a placé sur la carte, il se trouve à une assez faible distance au nord-ouest de son homonyme, c’est-à-dire dans la même région et peut-être dans le même oued ?
| On aura donc : | φ | L |
|---|---|---|
| Tesfaout | 27° 43′,0 | 2° 42′,8 |
| Campement d’H. Sefiat | 27° 16′,5 | 2° 3′,1 |
| Puits d’H. Sefiat | 27° 15′,7 | 3° 3′,1 |
Itinéraire de Haci Rezegallah. — L’itinéraire de Zaouiet Reggan à H. Rezegallah est celui qui présente les moindres garanties d’exactitude précise. Le point de départ Zaouiet Reggan est suffisamment déterminé puisqu’il est tout voisin de Taourirt dont les coordonnées ont été fixées astronomiquement.
En admettant pour Zaouiet Reggan φ 26° 40′,5 et L. 2° 10′,5 le calcul des positions données par le carnet de route donne :
| Haci Boura | φ 26° 8′,3 | L. 3° 1′,1 |
| Haci Rezegallah | φ 25° 51′,3 | L. 3° 25′,0 |
Itinéraire à travers l’Ahnet (Taourirt-Ouallen-Tin Senasset). — Entre Taourirt et In Ziza, en passant par Ouallen, Ouan Tohra, et Tin Senasset l’itinéraire a été levé à la boussole, et reporté au jour le jour au 1/100000 sur un carnet spécial.
Mon propre carnet d’itinéraire de Taourirt à Ouan Tohra a été souvent complété d’après celui de M. le lieutenant Mussel, mon aimable compagnon de route, qui commandait le détachement.
Au delà d’Ouan Tohra il l’a été d’après le carnet de M. le lieutenant Clore ; ce sont des garanties supplémentaires d’exactitude.
D’ailleurs il a été possible de contrôler et de corriger l’itinéraire avec l’aide d’observations astronomiques. A Taourirt, avec la lunette Cazemajou nous avons observé l’occultation de k de la Vierge (immersion du 15 mai 1905) ; calculée à l’Observatoire d’Alger cette occultation a donné — 8s 26m,9 soit 2° 6′,5 ouest. La latitude, d’après des observations[341] anciennes de M. le commandant Deleuze est 26° 42′,0. Avec le sextant réparé à Taourirt et dont l’erreur instrumentale, restée immuable puisque là soudure n’a pas bougé, a pu être être déterminée, j’ai pris à la traversée de l’Açedjerad trois séries d’observations de hauteurs de Polaire qui ont donné les latitudes suivantes :
| Haci bou Khanefis | 25° 8′,0. |
| Iglitten | 24° 53′,3. |
| Aïn Tezzaï | 24° 46′,0. |
L’état de l’instrument pourrait laisser quelques doutes sur la valeur des conclusions, mais ces doutes sont levés par la comparaison avec les observations de M. Villatte, dont l’itinéraire croise le mien en deux points, Tadounasset et Tin Taggaret.
Les observations de M. Villatte et les miennes donnent cinq latitudes qui toutes ont ceci de concordant qu’elles offrent avec les données du carnet un écart à peu près constant de 5 à 7 minutes. On a donc des données sérieuses pour corriger les latitudes du carnet entre Taourirt et Tin Taggaret.
D’autre part les observations de M. Villatte permettent d’apporter une correction aux longitudes dans la même section de l’itinéraire.
Dans la seconde section, au delà de Tin Taggaret on peut s’appuyer sur la position d’In Ziza, qui a été déterminée par M. Villatte en latitude et en longitude. Moi-même en 1903 j’avais obtenu au théodolite une latitude d’In Ziza[274] tout à fait concordante avec les observations ultérieures de M. Villatte.
La correction à apporter à l’itinéraire est très forte, beaucoup plus que dans d’autres tronçons ; ce n’est pas surprenant si on considère la nature du terrain au nord de Tikeidi et au sud de Tin Senasset. Il s’étend là de grandes superficies tout à fait arides, qu’on est forcé de traverser à marche forcée de jour et de nuit.
En répartissant l’erreur ainsi obtenue, on obtient pour les points successifs de l’itinéraire les résultats indiqués au tableau de la page suivante.
Ces itinéraires ont été reportés sur deux cartes jointes au deuxième et au septième chapitre.
La première n’est pas à proprement parler une carte, puisqu’elle n’est pas construite suivant un système de projection déterminé. C’est un simple tableau graphique de positions. Pour la seconde carte on a adopté la projection de l’itinéraire Villatte (La Géographie, 15 octobre 1905.)
En cas de discordance entre l’itinéraire graphique et les listes de coordonnées, ce sont ces dernières qui doivent faire foi.
Ces trois itinéraires ont été levés en 1905.
Dans le voyage de 1903, muni d’un théodolite qui appartenait à M. le baron Pichon, j’avais fait un certain nombre d’observations de latitudes dont le voyage ultérieur de M. Villatte a rendu inutile la publication détaillée ; mes résultats concordaient avec ceux de M. Villatte d’une[342] façon satisfaisante ; j’ai fait connaître dans La Géographie du 15 juillet 1904 (p. 99) la latitude vraie d’In Ziza, qui est de 23° 31′. Le chiffre de M. Villatte publié le 15 octobre 1905 dans La Géographie (p. 229) est exactement le même.
| LATITUDE D’APRÈS CARNET | LATITUDE CORRIGÉE | LONGITUDE D’APRÈS CARNET | LONGITUDE CORRIGÉE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacian Taïbin | 26°34′,5 | 26°33′,9 | 1°54′,8 | 1°54′,1 | ||
| Dj. Aberraz (extrémité Sud) | 26°34′,8 | 26°34′,3 | 1°49′,3 | 1°48′,6 | ||
| Bord occidental du Horst silurien | 26°28′,7 | 26°27′,8 | 1°37′,1 | 1°35′,4 | ||
| Sebkha Mekhergan (coucher 18-19 mai) | 26°21′,2 | 26°19′,8 | 1°21′,9 | 1°19′,3 | ||
| O. Arris (sortie de la Sebkha) | 25°48′,9 | 25°45′,2 | 1°10′,1 | 1° 6′,7 | ||
| Tikeidi | 25°34′,1 | 25°29′,4 | 1° 2′,5 | 0°58′,7 | ||
| Haci bou Khanefis | 25°14′,8 | 25° 8′,0 | 1° 5′,0 | 1° 1′,3 | ||
| Tête de l’oued Ifisten | 25° 2′,2 | 24°56′,2 | 1°12′,3 | 1° 9′,1 | ||
| Oued Tazelouaï (un point dans l’). | 24°55′,2″ | 24°49′,2 | 1°12′,4 | 1° 9′,2 | ||
| Ouallen | 24°44′,6 | 24°38′,6 | 1° 5′,2 | 1° 1′,3 | ||
| Sommet du plateau | 24°52′,3 | 24°46′,3 | 1° 1′,8 | 0°57′,9 | ||
| Taguellit | 24°54′,9 | 24°48′,9 | 0°55′,2 | 0°50′,9 | ||
| Iglitten | 25° 0′,2 | 24°53′,3 | 0°53′,4 | 0°49′,0 | ||
| Éperon d’Insemmen | 25° 0′,2 | 24°54′,0 | 0°44′,4 | 0°39′,5 | ||
| Meghdoua | 25° 3′,1 | 24°57′,0 | 0°31′,9 | 0°26′,4 | ||
| Tezzai | 24°52′,8 | 24°46′,0 | 0°25′,2 | 0°19′,2 | ||
| Tadounasset | 25° 0′,2 | 24°54′,2 | 0°25′,9 | 0°21′,9 | ⎰ ⎱ |
Villate. |
| Tin Tagar | 24°53′,9 | 24°48′,6 | 0°13′,7 | 0° 6′,4 O | ||
| Taloak | 24°49′,2 | 24°43′,2 | 0° 6′,8 O | 0° 0′,3 E | ||
| Dunes d’Aït el Kha | 24°41′,7 | 24°35′,7 | 0° 4′,5 E | 0°11′,4 | ||
| Foum Lacbet | 24°41′,6 | 24°35′,6 | 0°18′,3 | 0°24′,9 | ||
| Ouan Tohra | 24°34′,6 | 24°28′,6 | 0°21′,9 | 0°28′,4 | ||
| Tin Senasset | 24°19′,7 | 24°13′,7 | 0°24′,9 | 0°31′,4 | ||
| In Ziza | 23°40′,2 | 23°31′,0 | 0° 5′,3 | 0°11′,6 | ||
A la suite de mon voyage de 1902 j’ai publié, dans les Annales de Géographie, tome XII, 1903, une liste de longitudes qui, à ce moment, apportait aux cartes existantes une correction intéressante.
| LIEUX | LONGITUDES OUEST | CARTE à 1 : 800000. Service géographique. | CARTE à 1 : 500000. DU COMMANDANT LAQUIÈRE |
|---|---|---|---|
| ° ′ ″ | ° ′ ″ | ° ′ ″ | |
| Haci el Mir | 3 58 06 | 4 06 15 | 4 01 15 |
| Tar’it | 4 13 57 | 4 30 00 | 4 22 15 |
| Igli | 4 31 06 | 4 49 45 | 4 34 45 |
| Beni Abbès | 4 31 00 | 4 44 30 | 4 25 00 |
| Ksabi | 3 16 56 | » | 3 16 00 |
| Timimoun | 2 05 54 | 2 27 15 | 2 06 00 |
[343]La carte Prudhomme, qui fait autorité, a adopté des positions voisines des miennes. Si j’insiste sur ces résultats, qui n’ont plus d’intérêt aujourd’hui, c’est d’abord par piété pour la mémoire de M. Trépied, directeur de l’observatoire d’Alger, à qui seul je suis redevable d’avoir pu faire une besogne astronomique où il y avait une part de travail utile.
C’est aussi pour apporter ma contribution à la solution d’un petit problème souvent agité. Un voyageur qui n’est pas astronome n’a-t-il pas un meilleur emploi à faire de son argent que d’acheter des instruments coûteux, et de son temps que de s’astreindre à la discipline méticuleuse des observations ? Je ne pense pas que la question puisse recevoir une solution absolue, mais au Sahara du moins et sous la direction de feu Trépied, un non-professionnel rapportait des observations utilisables. Elles eussent été beaucoup plus nombreuses, si j’avais eu un meilleur outillage.
[273]Ch. Trépied, Remarques sur la carte dressée par M. Villatte à la suite de son exploration de 1904 dans le Sahara central (La Géographie, XII, 1905, p. 231-238).
[274]Publiée dans La Géographie, 15 juillet 1904, p. 99.
[344]APPENDICE II
INSCRIPTIONS
On ne s’est pas efforcé systématiquement de relever au passage les inscriptions Tifinar’ ; il serait même plus exact de dire qu’on a systématiquement évité de le faire. En présence de ces innombrables graffitti indéchiffrables, on est découragé par le sentiment de son impuissance.
Je retrouve pourtant dans mes notes quelques inscriptions soigneusement recopiées soit par moi-même, soit plus souvent par d’autres, et qu’il est préférable de réunir ici.
A Barrebi j’ai relevé, à côté des gravures, quelques inscriptions. Il en est d’arabes, tout à fait banales, comme celle dont voici la traduction « ... Dieu et le salut soit sur notre seigneur Mahomet, — Arbi ben Sleïman. » Les tifinar’ si on pouvait les lire ne seraient probablement pas beaucoup plus intéressants.
| Inscription a. | Inscription b. | Inscription c. |

|

|
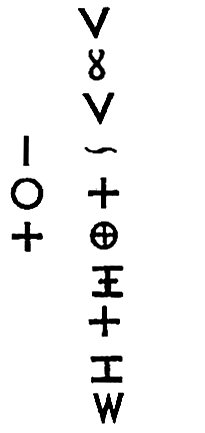
|
| Inscription d. | Inscription e. | Inscription f. |

|

|
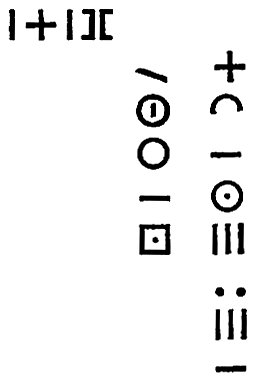
|
[345]La dernière inscription (f) a été copiée par M. le lieutenant Pinta.
J’ai relevé soigneusement des inscriptions Berbères qui se trouvent au ksar d’Ouled Mahmoud, et que les indigènes prétendaient hébraïques[275].
Il y en a quelques-unes au vieux ksar abandonné, à 1500 mètres de l’actuel ; par exemple :
Ces inscriptions Berbères sont accompagnées d’une inscription arabe que j’ai lue ainsi : « ab (?) fils de Zenati, az (?) fille de Zenati ».
Les inscriptions les plus nombreuses et les plus soignées sont au ksar actuel sur une gara centrale qui domine les maisons. Le ksar a vingt-cinq ans à peine, et les inscriptions n’ont rien de commun avec les habitants actuels qui les croient juives, et qui ont bâti dessus. Ces inscriptions, que j’ai calquées, sont très soignées, à trait profond, je les crois particulièrement anciennes.
Inscription IIbis faisant suite à la précédente sur le même rocher et un peu au-dessous
| Inscription III (sur un rocher voisin) | Inscription IV (également sur un rocher voisin). |
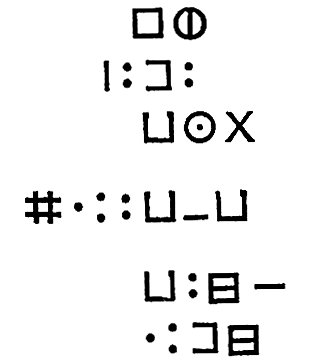
|
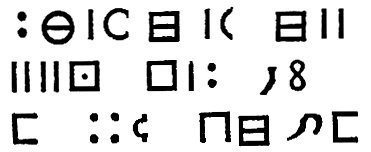
|
Sur le rocher où sont gravées ces deux dernières inscriptions on a bâti une maisonnette en pisé.
On m’avait signalé encore comme hébraïques des inscriptions situées à Abani, auprès de Tesfaout (Touat) : je me suis assuré qu’elles sont berbères[346] comme on pourra s’en rendre compte sur les belles photographies dues à M. Auger interprète militaire. (Voir pl. XVIII, phot. 35 et 36.)
Enfin M. le lieutenant-colonel Laperrine qui s’est beaucoup occupé des caractères Tifinar’ et qui les connaît bien, a recopié sur mon carnet une inscription trouvée sur une dalle calcaire dans l’oued Aglagal (sud du Tadmaït).
Inscription juive du Touat.
Elle provient du ksar de R’ormali dans l’oasis de Bouda.
La pierre sur laquelle est gravée l’inscription est encastrée à la base d’un pilier en pisé, qui a manifestement servi jadis de support à la bascule d’un puits comblé. Les indigènes ne connaissent ni le sens, ni la langue de l’inscription, ni sa date, ni son origine. De mémoire d’homme elle a toujours été au ksar de R’ormali.
La seule face visible de la pierre est un parallélogramme irrégulier d’environ 0 m. 30 sur 0 m. 25. La pierre est du grès rouge. L’inscription est d’un travail remarquable, au moins pour le pays ; sans doute la surface de la pierre n’a même pas été aplanie, les contours des lettres sont souvent éclatés ; mais leur dessin est très net, leur gravure en creux très profonde. C’est un travail peu soigné à coup sûr, mais on dirait l’œuvre d’un professionnel, non d’un sauvage qui s’amuse. Les habitants actuels du Touat seraient tout à fait incapables de produire quelque chose de comparable.
On trouvera dans les C. R. Ac. Inscr., année 1903, p. 236, le texte de cette inscription. En voici la traduction telle que la donne M. Philippe Berger.
| Ligne | 1 : | ceci est le tombeau de [Monispa ?], fille d’Amram : Qu’elle repose en Eden ! |
| — | 2 : | de [Zathaloq !] et elle est morte dans les douleurs (de l’enfantement). |
| — | 3 : | le samedi, vingtième d’Ab, qui nous apporte la paix. |
| — | 4 : | en l’année 5089. |
M. Philippe Berger fait suivre cette traduction de quelques observations suivantes.
« Ligne 1. Le nom de la défunte = Monispa, est douteux. Au contraire le nom de son père Amram est un nom très connu, et qui est parfaitement en situation ici.
« Ligne 2. Cette ligne débute par un groupe de lettres très obscur. La lettre initiale semblerait indiquer qu’il s’agit d’un nom géographique = à (ou de) Zithaloq ».... A la fin de la ligne on lit : « dans les douleurs », ou peut-être « dans sa jeunesse ».
« Ligne 4. L’année 5089 correspond à l’année 1329 de notre ère. »
[275]Cf. Comptes rendus Acad. Inscript., 1905, p. 83 et suiv.
[347]APPENDICE III
TRADUCTION D’UN MANUSCRIT ARABE CONCERNANT LA MINE DE CUIVRE DE TAMEGROUN
Je dois la communication de ce manuscrit à M. le capitaine Martin, chef d’annexe de Beni Abbès ; il est à la bibliothèque de Guerzim.
Voici comment M. Stackler, interprète militaire, le décrit :
Ce manuscrit, qui semble avoir un siècle et demi d’existence, contient beaucoup de mots qui sont à peu près ou tout à fait illisibles ; il y a même un morceau qui, à force d’avoir été plié et déplié a fini par se déchirer entièrement et a disparu.
Voici la traduction que M. Stackler a bien voulu en faire.
Renseignements sur un endroit appelé tel et tel. — « Lorsqu’on arrive à cet endroit, on demande où se trouve la colline qui a tel nom, puis on la monte jusqu’à son sommet, on s’y assied avant le lever du soleil, et on regardé du côté du sud. Cela doit se passer pendant les saisons d’été et d’automne.
« En se levant le soleil donne sur trois trous rangés l’un à côté de l’autre ; il faut aborder celui du milieu, on y trouve une caverne étroite, qu’il faut suivre jusqu’à ce qu’on arrive à deux trous situés l’un à droite, l’autre à gauche.
« Celui de droite renferme de la terre verdâtre comme du sulfate de cuivre ; c’est du minerai d’or, qui ne perd que le quart de son poids. Celui de gauche contient de la terre jaune et rouge : c’est aussi du minerai d’or qui diminue du tiers de son poids. Le trou de droite renferme également un coffre contenant moitié perles et moitié argent. Le deuxième trou, celui de gauche, contient de la terre qui semble enduite d’huile ; c’est du minerai d’or qui ne diminue que très peu ; une livre de minerai donne à peu près une livre d’or. Ce dernier minerai n’a pas besoin d’être soumis à l’action du feu, on le passe simplement dans de l’eau vinaigrée. A l’ouest[348] de la colline en question se trouvent trois redjems, et les ateliers de ceux qui extraient le métal. Il faut aborder le redjem du milieu, qui est le plus grand. En enlevant ses pierres on trouvera un morceau de tronc de palmier bouchant l’entrée d’une caverne. Il faut l’enlever et descendre jusqu’au fond de ce gouffre où l’on rencontre une porte. En ouvrant cette porte, on trouve un puits surmonté d’un pont en tronc de palmier mis en mouvement par l’influence d’un « djin ».
« Il faut égorger sur ce pont un hibou, le battre avec une tige de fenouil, et après avoir coloré cette tige du sang de l’oiseau, écrire la formule suivante : Si nous avons dicté ce Coran.... etc..., puis toujours sur le pont en question, on lit la sourate du tonnerre.
« Le pont reste immobile ; en le traversant, on trouve une maison composée de quatre chambres garnies d’or, d’argent, d’armes et de chevaux. Il faut se garder de parler. On prend alors ce qu’on veut.
« Si l’on est plusieurs, il faut entrer séparément.
« Le jour favorable pour cela est le samedi.
« Au sein du gouffre se trouvent encore deux « redjems » entre lesquels existe un trou. On y entre, et l’on trouve au fond, une terre ressemblant à des écailles de poisson. En faisant fondre une livre de cette terre on obtient une livre d’émeraudes.
« A droite de ce trou se trouve un autre trou contenant une mine de pierres de cristal et Dieu est le plus instruit.
« Le minerai d’argent est lourd et blanc, lorsqu’on en jette une partie dans un feu ardent, il fond mais il ne se sépare pas de ses impuretés. Voici cependant la manière dont on le rend pur : On le réduit en poussière, on le lave avec de l’eau et du sel, on le fait sécher et on le soumet à l’action du feu, sur du charbon, on le saupoudre enfin d’un peu (d’ahlidj ?) et le minerai se sépare de ses impuretés, coule et se réunit seul.
« Autre espèce de minerai. — Il est noir, tacheté de blanc, il tire sur le bleu. Lorsqu’on en soumet une partie à l’action du feu, la substance précieuse ne se sépare pas de ses impuretés, il faut pour l’épurer, le réduire en une poussière qu’on jette sur un brasier et qu’on arrose avec du goudron tiré du laurier-rose. Alors l’argent se sépare de ses impuretés coule au milieu des charbons et se réunit tout seul.
« Espèce de minerai d’argent. — C’est une pierre bleue, lourde, tirant sur le vert, couverte de points blancs et facile à pulvériser. Pour séparer la matière précieuse de ses impuretés, on réduit ce minerai en poussière, on le met ensuite sur un feu formé de charbons ardents, et alors, ô chercheur, lorsqu’on aperçoit une étincelle rouge qui s’en échappe, mêlée à de la fumée noire, il faut le mélanger avec du sesquicarbonate de soude et du sublimé corrosif. Le minerai se sépare alors de ses impuretés et coule en bas.
« Espèce de minerai d’or. — C’est une pierre de couleur verte, tirant sur le jaune ; elle est très lourde et renferme du soufre. Lorsqu’on la met sur le feu, elle fond et le soufre brûle. Pour la séparer de ses impuretés et pour pouvoir l’utiliser, il faut la laver avec de l’eau et du sel. L’or se détache alors de ses impuretés.
« Espèce de minerai d’or. — Il renferme des racines semblables à des[349] racines de palmier, il est formé d’une terre rouge, comme la terre dont on fait les marmites. Lorsqu’on en met sur la langue, on la trouve amère.
« On trouve également des pierres semblables à des œufs de poule dans le milieu desquels est le minerai. On le prend, on l’enduit de vinaigre et d’huile, on le fait chauffer à la vapeur, comme on fait pour le couscous, on l’étend pour le faire refroidir puis on prend un creuset ayant un bec comme un tuyau, on place un autre creuset sous le premier, de manière que le métal une fois fondu tombe dedans, on le couvre enfin de fiente de pigeon sauvage et on souffle dessus jusqu’à ce qu’il fonde. On termine en frappant trois fois dessus, avec des ossements d’un être humain mort depuis longtemps. Le minerai se purifie alors, et l’on aperçoit l’or sur la surface de l’argent. Dieu le très haut est le plus instruit de tout cela. »
Je crains bien que ce document ne soit tout à fait dépourvu d’intérêt. Ce doit être un démarquage de quelque formulaire marocain de sorcellerie métallurgique. Il faut pourtant noter deux choses.
1o Sid el Bedri ben el Meki, marabout de Guerzim, propriétaire de ce manuscrit, qui a de la littérature, le sens des affaires, la figure et la réputation d’un homme très supérieur à la moyenne des indigènes attribue à son manuscrit la plus grande importance pratique.
2o Il y a réellement à Tamegroun un bel affleurement de cuivre, et l’on y voit des traces incontestables d’anciens travaux.
[350]APPENDICE IV
ORTHOGRAPHE DE QUELQUES NOMS TOUAREGS
En matière de noms géographiques je n’ai pas essayé d’adapter systématiquement l’orthographe française à l’orthographe arabe ou berbère, j’ai même en certains cas préféré les formes usuelles aux formes correctes (Mouidir à Immidir, etc.).
En cours de route pourtant j’ai écrit certains noms touaregs, sous la dictée des indigènes et en tifinar’. En voici la liste par ordre alphabétique. J’admets d’ailleurs volontiers que d’autres indigènes eussent écrit les mêmes noms différemment.
| Achegrad | 
|
Kokodi | 
|
| Açeref | 
|
Meghdoua | 
|
| Agatan | 
|
El Meraguen | 
|
| Azelmati | 
|
Ouallen | 
|
| Chemââ | 
|
Taguellit | 
|
| Eguérér | 
|
Tamamat | 
|
| Ichahenchaguerouthnin | 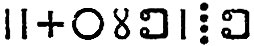
|
Tazelouaït | 
|
| Ifisten | 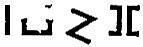
|
Tchinka | 
|
| Igamergan | 
|
Tikadouin | 
|
| Iguelitten | 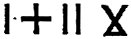
|
Timreden | 
|
| Inaláren | 
|
Tingaran | 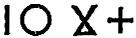
|
| Insemmen | 
|
Tikeidi | 
|
| Tsigenganat | 
|
N. B. — Les noms en italiques se rapportent à l’Adr’ar des Ifor’ass, les autres à l’Ahnet.
[351]APPENDICE V
INSCRIPTIONS ARABES
Sur une meule dormante, utilisée comme stèle funéraire dans un cimetière de l’oued Tilemsi, et que j’ai déposée au laboratoire d’anthropologie du Muséum, M. Ben Cheneb, professeur à l’École des Lettres d’Alger, a déchiffré une inscription arabe, qu’il a traduite ainsi que suit :
Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, toute âme est mortelle (Cor. III, 182). C’est le tombeau du saint, du vertueux, du jurisconsulte, du savant, du cheikh, Omar et Amin, surnommé El Amin ben Mançour ben Ahmâlâl ? ben Wankor ben Mançour. Que Dieu me pardonne et leur pardonne, à tous musulmans et musulmanes, croyants [et croyantes, ceux qui] parmi eux sont en vie [et ceux qui sont morts].
Notons que M. Benhazera, dans la grotte de Timissao, a copié une inscription arabe en caractères fort anciens, koufiques, mais qui n’a pas encore fait l’objet d’une publication détaillée.
[352]APPENDICE VI
ÉTUDE MINÉRALOGIQUE DU MATÉRIEL NÉOLITHIQUE
Les haches, pilons, meules, etc., de la région Saharienne centrale et Soudanaise, ont été soumis à M. Lacroix, professeur de minéralogie au Muséum. Les roches qui les constituent ont paru trop banales pour mériter une étude approfondie au microscope et sur plaques minces.
En voici la liste :
Grès. — Une meule en grès ; — (cimetière de l’oued Tilemsi) ;
Une meule en grès à ciment ferrugineux ; — (cimetière de l’oued Tilemsi) ;
Un fragment de mortier, avec inscription funéraire en arabe, en grès ; — (cimetière de l’oued Tilemsi) ;
Une hache en grès à ciment ferrugineux ; — (Koulikoro).
Ces outils en grès sont rares, et semblent confinés dans la région du Niger. A cette exception près tout l’outillage est fabriqué avec des roches peu ou prou métamorphiques, ou éruptives.
Quartzites. — Deux haches en quartzite métamorphique probablement à amphibole ; — (oued Silet).
Une hache en quartzite ; — (au nord de Timissao).
Une hache en quartzite ; — (Aïr).
Une hache en quartzite ; — (cimetière de l’oued Tilemsi).
Deux meules sphériques, en quartzite à gros grains ; — (cimetière de l’oued Tilemsi).
Trois meules en olive, en quartzite micacé ; — (cimetière de l’oued Tilemsi).
Une meule en olive, en quartzite ; — (cimetière de l’oued Tilemsi).
Un pilon très allongé, en quartzite chloriteux ; — (au nord de Timissao).
Chloritoschistes. — Une meule sphérique, en chloritoschite.
Un fragment de bracelet, en chloritoschiste.
Un bracelet inachevé, en chloritoschiste ; — (oued Taoundrart).
Leptynite. — Un polissoir en leptynite ; — (oued Tougçemin).
Ryolite. — Une meule sphérique en ryolite ; — (nord d’In Ziza).
Une hache sphérique en ryolite ; — (nord d’In Ziza).
[353]Diabase[276]. — Une hache en diabase ; — (oued Silet).
Une hache en diabase ; — (Gao).
Quatre haches en diabase ; — (cimetière de l’oued Tilemsi).
Granite. — Un fragment de mortier en granite altéré.
Cette liste suggère quelques observations. Aucune de ces roches ne paraît étrangère à la région étudiée ; chacune d’elles au contraire y est bien connue et fréquente ; — grès, dévonien au Sahara, et d’âge indéterminé au Soudan ; — schistes métamorphiques siluriens ; — granite et roches éruptives ; — tels sont en effet les éléments constitutifs du sous-sol. Il semble donc que les outils aient été fabriqués sur place, et non importés.
Le bracelet en chloritoschiste de l’oued Toundrart a été trouvé encore mal dégagé de la roche dans un atelier actuel ; on sait que les Touaregs fabriquent et portent encore, au-dessus du coude, des bracelets en pierre. Le polissoir de l’oued Tougçemin atteste apparemment l’existence d’un atelier ancien. Les objets en ryolite ont été trouvés à proximité d’In Ziza, qui est un volcan à coulées de ryolite.
Les objets en grès ont tous été trouvés dans la même région, les bords du Niger, et il est possible en effet que les grès soudanais à ciment ferrugineux se prêtent au travail de la pierre mieux que les grès éodévoniens du Sahara.
[276]On a entendu diabase dans le sens le plus large, roches anciennes à feldspath triclinique, et à pyroxène plus ou moins transformé en amphibole par ouralitisation. Aucune plaque mince n’ayant été étudiée, on n’a pas cherché à déterminer si la structure est ophitique ou microlithique, autrement dit si on a affaire à des diabases ou à des labradorites.
[354]APPENDICE VII
MINERAI ET BIJOUX (?) DE CUIVRE
J’ai fait analyser par M. Bouhard, chimiste diplômé de la Faculté des sciences de Paris, un échantillon de minerai de cuivre, recueilli à Tamegroun ; c’est du quartz à imprégnation de malachite ; il contenait 3,37 p. 100 de cuivre. C’est une faible proportion, surtout si on considère que l’échantillon avait été choisi à cause de sa belle apparence.
J’ai fait analyser par le même chimiste, les objets en cuivre trouvés dans le redjem d’Ouan Tohra. M. Bouhard n’a pas trouvé d’étain. Il a noté en revanche la présence d’arsenic et de fer.
M. le Dr Hamy, ayant fait analyser les objets en cuivre trouvés dans les redjems d’Aïn Sefra a obtenu des résultats analogues, il a constaté l’absence d’étain.
Ce mobilier funéraire est donc en cuivre, et non pas en bronze. Faut-il conclure que c’est un produit des mines locales, nord-africaines ? La nature des impuretés (arsenic et fer) permettra peut-être un jour d’être affirmatif sur ce point, lorsque les gisements marocains et sahariens seront mieux connus ! (?).
[355]APPENDICE VIII
NITRATES D’OULED MAHMOUD
ANALYSE DÉTAILLÉE
par M. Pouget, professeur de chimie à l’École des sciences d’Alger.
Échantillons de nitrates.
No 1. — Terre à nitrates.
| Résultats analytiques. | Composition p. 100. | |||
|---|---|---|---|---|
| — | — | |||
| Humidité | 0,9 | p. 100. | Azotate de potasse (AzO3K) | 0,9 |
| Résidu insoluble dans l’eau | 27,6 | — | Azotate de soude (AzO3Na) | 4,1 |
| Chlorure de potassium (KCl) | 5,4 | |||
| Az2O5 | 3,45 | — | Sulfate de soude (SO4Na2) | 14,2 |
| K2O | 3,9 | — | Chlorure de sodium (NaCl) | 41,4 |
| Na2O | 29,5 | — | Chlorure de magnésium (MgCl2) | 3,8 |
| Cl | 31,2 | — | Chlorure de calcium (CaCl2) | 1,2 |
| SO3 | 8,05 | — | Humidité | 0,9 |
| MgO | 1,6 | — | Résidu insoluble | 27,6 |
| CaO (traces de brome) | 0,6 | — | 99,5 | |
Remarque : L’ensemble des azotates contenu dans la substance équivaut à 5,35 p. 100 d’azotate de soude ou à 6,45 d’azotate de potasse.
No 2. — Nitrates (salpêtre).
| Résultats analytiques. | Composition p. 100. | |||
|---|---|---|---|---|
| — | — | |||
| Humidité | 4,1 | p. 100. | Azotate de potasse (AzO3K) | 56,4 |
| Résidu insoluble | 1,3 | — | Azotate de soude (AzO3Na) | 33,7 |
| Az2O5 | 52,3 | — | Chlorure de sodium (NaCl) | 2,6 |
| K2O | 25,2 | — | Sulfate de soude (SO4Na2) | 1,0 |
| Na2O | 14,1 | — | Chlorure de magnésium (MgCl2) | 0,5 |
| Cl | 2,0 | — | Chlorure de calcium | 0,02 |
| SO3 | 0,6 | — | Humidité | 4,1 |
| MgO | 0,2 | — | Résidu insoluble | 1,3 |
| CaO | 0,02 | — | 99,62 | |
[356]No 3. — Résidu de la préparation du salpêtre.
| Résultats analytiques. | Composition p. 100. | |||
|---|---|---|---|---|
| — | — | |||
| Humidité | 3,2 | p. 100. | Azotate de potasse (AzO3K) | 2,2 |
| Résidu insoluble | 0,8 | — | Azotate de soude (AzO3Na) | 1,4 |
| Az2O5 | 2,1 | — | Chlorure de sodium (NaCl) | 62,8 |
| Na2O | 47,3 | — | Sulfate de soude (SO4Na2) | 22,9 |
| K2O | 3,5 | — | Chlorure de potassium (KCl) | 3,9 |
| Cl | 41,3 | — | Chlorure de magnésium (MgCl2) | 2,1 |
| SO3 | 12,9 | — | Chlorure de calcium | 0,4 |
| MgO | 0,9 | — | Humidité | 3,2 |
| CaO | 0,2 | — | Résidu insoluble | 0,8 |
| 99,7 | ||||
Remarque. — Les nitrates contenus dans ce résidu équivalent à 3,8 p. 100 environ d’azotate de potasse, c’est-à-dire à une quantité plus grande que la moitié de celle que contient le minerai [6,45].
Le mode de préparation est donc très mauvais puisque les pertes en nitrate sont énormes, on peut approximativement les évaluer à 40 p. 100 au moins.
Le salpêtre lui-même contient encore une proportion notable d’azotate de soude bien que le chlorure de potassium soit en excès dans le minerai.
Le minerai est plutôt une terre à nitrate de soude qu’à nitrate de potasse, c’est par le traitement qu’on lui fait subir qu’on en extrait du salpêtre, le traitement transforme partiellement le nitrate de soude en nitrate de potasse grâce à la présence du chlorure de potassium.
[357]APPENDICE IX
ANALYSE D’UN ÉCHANTILLON DE TOMELA PROVENANT D’AKABLI
par M. Pouget, professeur de chimie à l’École des sciences d’Alger.
Tomela. — Masses concrétionnées, de couleur gris verdâtre, légèrement ocreuses en certains points de la surface, on y rencontre quelques cristaux blancs d’aspect fibreux.
L’analyse de la partie non cristallisée donne les résultats suivants :
| SO3 | 36,4 | p. 100. |
| Al2O3 | 10,0 | — |
| FeO | 8,2 | — |
| CaO | 1,1 | — |
| MgO | 2,4 | — |
| Silice et sable | 1,4 | — |
| Eau | 40,2 | — |
| 99,7 | p. 100. |
Les principaux éléments constitutifs sont donc le sulfate d’alumine et le sulfate ferreux.
La partie cristalline (densité 1,87) contient :
| SO3 | 38,4 | p. 100. |
| Al2O3 | 16,4 | — |
| FeO | 3,6 | — |
| Eau | 41,1 | — |
| 99,5 | p. 100. |
On peut la considérer comme un mélange de sulfate d’alumine hydraté, de sulfate ferreux, et d’un sulfate d’alumine basique ; sa composition peut être représentée par la formule
Est-ce un simple mélange, ou une espèce minéralogique ? L’analyse d’un seul échantillon ne se prêtant à aucune détermination cristallographique ne permet pas de conclure.
Pouget.
[358]APPENDICE X
NOTE SUR LES MOLLUSQUES DU SAHARA
ET PLUS PARTICULIÈREMENT DU TOUAT
Par M. Louis Germain.
Au cours de sa belle exploration, M. Chudeau a recueilli une riche série de Mollusques terrestres et fluviatiles dont il a eu l’amabilité de me confier l’étude. Ces documents viennent heureusement compléter ceux réunis par les expéditions françaises antérieures et, notamment, par la Mission Chari-lac Tchad conduite par M. A. Chevalier[277].
La collection rapportée par M. Chudeau comprend surtout des Mollusques du bassin du lac Tchad. J’ai déjà, dans une courte note[278], donné quelques indications sur les espèces nouvelles et je compte publier prochainement une étude d’ensemble sur ce sujet[279]. Je me contenterai de donner ici quelques détails sur les coquilles vivantes et fossiles provenant du Sahara, c’est-à-dire de la région dont traite le présent volume.
Planorbis salinarum Morelet.
1868. Planorbis salinarum. Morelet, Mollusques terrestres fluviatiles, voyage Dr. Welwitsch, p. 85, no 56, Tab. V, fig. 4.
Un exemplaire de cette très intéressante espèce, qui n’était connue jusqu’ici que des ruisseaux de l’Angola, a été récoltée par M. Chudeau dans les alluvions, à Abalessa. C’est en vain que le voyageur a fouillé les[359] environs de Tit dans l’espoir d’y découvrir de nouveaux Planorbes, mais je dois ajouter qu’en 1886, M. Palat a envoyé, au laboratoire de Malacologie du Muséum, un grand nombre de Planorbes subfossiles recueillis dans le Touat et qui se rapportent à ce même Planorbis salinarum auxquels sont mêlés de nombreux exemplaires du Planorbis Aucapitainieri Bourguignat[280] et un spécimen du Planorbis Rollandi Morlet[281]. Ce fait a une grande importance car il montre que le massif du Hoggar et le Touat sont sur la limite septentrionale d’extension de la faune équatoriale proprement dite, c’est-à-dire à la zone où se fait le mélange entre cette faune et celle du système européen.
Melania tuberculata Müller.
1774. Nerita tuberculata Müller, Verm. terr. et fluv. histor. ; II, p. 191.
1862. Melania tuberculata Bourguignat, Paléontologie Mollusques terr. fluv. Algérie ; p. 102.
1901. Melania (Striatella) tuberculata Pallary, Mollusques fossiles terr. fluv. Algérie ; p. 174, pl. III, fig. 32-33.
De nombreux exemplaires de cette espèce bien connue ont été récoltés à Adrar ainsi qu’à Taourirt, Tazoult et En Nefis.
Melanopsis maroccana Chemnitz.
1795. Buccinum maroccanum Chemnitz, Conchyl. Cabinet ; 1re édit. ; X, p. 285, pl. CCX, fig. 2080 et 2081.
1862. Melanopsis maroccana Bourguignat, Paléontologie Mollusques terr. fluv. Algérie ; p. 105.
1901. Melanopsis maroccana Pallary, Mollusques fossiles terr. fluv. Algérie ; p. 177.
Espèce extrêmement variable qui se rencontre abondamment dans toutes les eaux douces du sud de la Tunisie, de l’Algérie et du Maroc. M. Chudeau en a recueilli de très nombreux exemplaires vivants et fossiles provenant d’Abd el Kader, Kaberten, Zaouiet Kounta, Taourirt, Tazoult et En Nefis. Ces documents me permettront d’étudier en détail, dans mon mémoire définitif, le polymorphisme de ce Melanopsis.
Melanopsis Maresi Bourguignat.
1862. Melanopsis Maresi Bourguignat, Paléontologie Mollusques terr. fluv. Algérie ; p. 106, pl. VI, fig. 1 à 4.
1865. Melanopsis Maresi Bourguignat, Mollusques terr. fluv. recueillis par H. Duveyrier dans le Sahara ; p. 22, pl. XXVIII, fig. 18 à 21.
1901. Melanopsis Maresi Pallary, Mollusques fossiles terr. fluv. Algérie ; p. 179 ; — et pl. IV, fig. 22 [var. crenulata].
[360]Cette espèce, si reconnaissable à sa columelle droite et aux fortes costulations dont son test est orné, a été récoltée, vivante et fossile, dans l’Iguidi (Échantillons communiqués à M. Chudeau par M. le lieutenant Mussel).
Cardium edule Linné.
1767. Cardium edule Linné, Systema naturæ, Ed. XII, p. 1124.
1878. Cardium edule Tournouër, Assoc. franç. avancement Sciences ; VII, p. 608.
1901. Cardium edule Pallary, Mollusques fossiles terr. fluv. Algérie ; p. 181.
M. Chudeau a recueilli, à Taourirt, de nombreux exemplaires de cette coquille, mêlés à quelques rares spécimens de Melania tuberculata Müller. Un autre échantillon provient de Timimoun. C’est la première fois que cette espèce marine est signalée aussi loin dans le sud. On trouvera, dans le travail de Tournouër[282], de très nombreuses indications concernant ce Mollusque particulièrement intéressant.
A cette courte liste, il convient d’ajouter un tuf d’origine fluviatile recueilli dans la région de Tin Tagaret et de Taloak (Ahnet) et qui renfermait, m’a dit M. Chudeau, de nombreux exemplaires d’une coquille appartenant au genre Physa. Les échantillons de ce tuf ont, malheureusement, été perdus pendant le voyage ; mais il est probable qu’il s’agit ici d’une espèce appartenant au groupe du Physa contorta Michaud[283], si abondamment répandu dans toutes les eaux douces du nord de l’Afrique.
Il faut ajouter aussi des couches à Cardium edule et à Melania, qui ont été observées par M. Chudeau à quelques kilomètres au nord de Tikeidi (Açedjerad) ; les échantillons ont été égarés.
On voit donc tout l’intérêt qui s’attache à la connaissance faunistique de ces régions et, principalement, du massif du Hoggar dont l’exploration méthodique serait féconde en résultats. Il est permis d’espérer que de nouvelles expéditions fourniront les matériaux nécessaires pour entreprendre une telle étude.
Louis Germain.
N. B. — J’avais recueilli à Zaouiet Kounta des Melanopsis fossiles et à Temassekh des Cardium edule, qui, ayant été égarés, manquent à la liste de M. Germain. Comme coquilles je ne crois pas qu’elles fussent particulièrement intéressantes ; mais ce sont deux gisements nouveaux à ajouter aux autres. Les mollusques actuels et fossiles, d’eau douce et d’eau saumâtre, sont très abondants au Touat.
E.-F. Gautier.
[277]Chevalier (A.), L’Afrique centrale française, Récit du voyage de la Mission Chari-lac Tchad (1902-1904) ; Paris, 1907, gr. in-8o, xv-776 p., avec 111 fig. dans le texte, 9 planches et 6 cartes. J’ai publié, dans ce volume, une étude sur Les Mollusques terrestres et fluviatiles de l’Afrique centrale française, p. 457-617, avec 15 fig. dans le texte et 2 planches.
[278]Germain (Louis), Contributions à la faune malacologique de l’Afrique équatoriale ; X. Mollusques nouveaux du lac Tchad ; Bulletin du Muséum d’histoire naturelle Paris ; XIII, no 4, avril 1907, p. 269-274, fig. 19 à 23.
[279]Ce travail paraîtra, pendant l’année 1908, dans la Revue suisse de Zoologie et Annales du Musée d’histoire naturelle de Genève, publiées sous la direction de M. Maurice Bedot, professeur à l’Université de Genève.
[280]Bourguignat (J.-R.), Mollusques terrestres et fluviatiles recueillis par M. H. Duveyrier dans le Sahara [Supplément aux : Touareg du Nord, par H. Duveyrier] ; 1865, p. 24, pl. XXVIII, fig. 1 à 5 [Planorbis Aucapitainianus]. Pallary a figuré une variété major de cette espèce [Pallary (P.), sur les Mollusques fossiles terrestres, fluviatiles et des eaux saumâtres de l’Algérie, Mémoires de la Société géologique de France ; XII, 1901, p. 157, fig. 16.]
[281]Morlet (L.), Diagnoses Molluscorum novarum ; Journal de Conchyliologie ; XXVIII, 1880, p. 355 ; XXIX, 1881, p. 46 ; — et Description de Coquilles nouvelles ; ibid., XXIX, p. 344, pl. XII, fig. 4.
[282]Tournouër, Sur quelques coquilles marines recueillies par divers explorateurs dans la région des chotts sahariens ; Association française pour l’avancement des Sciences ; 7e session, Paris, 1878, p. 608-622, pl. VI.
[283]Michaud (G.), Description de Coquilles vivantes ; Actes de la Société linnéenne de Bordeaux ; III, 1829, p. 268, fig. 15-16.
[361]APPENDICE XI
OBSERVATION A PROPOS DE LA CARTE GÉOLOGIQUE DE BÉCHAR
J’ai pris pour base de cette carte l’excellente topographie de M. le lieutenant Poirmeur. Mais ma géologie se trouve sur quelques points en désaccord tel avec la sienne, que je me crois obligé de justifier en quelques mots mon point de vue.
A. — M. Poirmeur écrit (Bulletin de la Société géologique de France, 4e série, t. VI, 1906, no 8, p. 725) :
« Le Dévonien inférieur de Ben Zireg (grès et calcaires durs) a été caractérisé par des Trilobites (capitaine de Lamothe), des orthocères et autres fossiles (collections du territoire d’Aïn-Sefra). »
Ces lignes affirment qu’on a trouvé à Ben Zireg des fossiles du Dévonien inférieur, mais elles n’indiquent pas le nom du paléontologiste qui a déterminé les fossiles ; et elles ne donnent pas des indications précises sur le gisement ; en fait je ne connais pas de grès au voisinage de Ben Zireg, mais seulement des ardoises et des calcaires.
D’autre part j’ai rapporté de Ben Zireg des fossiles que M. Haug déclare carbonifériens ; ils ont été cueillis dans une formation très puissante et très homogène, ardoises et calcaires interstratifiés, qui est la seule formation susceptible d’être primaire, à ma connaissance, au voisinage de Ben Zireg.
Je suis donc forcé, jusqu’à plus ample informé, d’attribuer ces couches au Carboniférien, et non au Dévonien.
B. — M. Poirmeur (Bulletin de la Société géologique de France, 4e série, t. VI, 1906, no 8, p. 726) rattache au Trias « l’affleurement de marnes irisées de ksar el Azoudj, qui se présente comme inférieur aux couches noires de la base du Lias (?) (Rhynchonella déposée au musée du territoire d’Aïn-Sefra) ».
Cet affleurement m’est bien connu (voir pl. XXV, phot. 47 et 48). Ces marnes irisées, ou plutôt ces schistes argileux mous, sont vivement redressés, et supportent en discordance absolue le poudingue calcaire[362] pliocène, sur lequel est construit le poste. Sauf preuves du contraire, et pour des raisons de stratigraphie générale, je crois ces couches infradinantiennes ou supradévoniennes ; la présence d’une rynchonelle est fort intéressante, mais n’y contredit pas.
C. — M. Poirmeur (Bulletin de la Société géologique de France, 4e série, t. VI, 1906, no 8, p. 726) place à la base du Lias « des calcaires et grès schisteux de couleur noire, non fossilifères (base des formations secondaires, qui font face au Moumen et au Béchar, entre Ksar el Azoudj et Ben Zireg ». Cette formation m’est bien connue ; il y a en effet partout à la base des falaises des schistes noirs, et au sommet des calcaires. Seulement, si mes souvenirs sont exacts, la discordance de stratification est absolue ; les schistes sont verticaux, et les calcaires horizontaux. De plus les calcaires, au voisinage de Ben Zireg, à tout le moins, contiennent les beaux fossiles cénomaniens habituels. J’ai donc conclu que nous avons affaire à la transgression cénomanienne sur la pénéplaine primaire. J’attribue par conséquent au Cénomanien les calcaires qui, sur la carte de M. Poirmeur, sont attribués non seulement au Lias, mais encore au Jurassique supérieur dans le voisinage de Ben Zireg.
D. — La carte de M. Poirmeur (Bulletin de la Société géologique de France, 4e série, t. VI, 1906, no 8, p. 726), si je l’interprète correctement, car ici le texte n’est pas explicite, attribue au Cénomanien, non seulement les collines de Bezazil Kelba, ce qui est parfaitement correct, mais les grès houillers de Kenatsa, les poudingues pliocènes de Bou Aiech, et les grès albiens de Beni Ounif.
E. — Enfin je ne suis pas d’accord avec M. Poirmeur sur l’emploi du mot oligocène, du moins en ce qui concerne la hammada de Kenatsa et celle de Beni Abbès. Il me semble que M. Poirmeur rattache régulièrement à l’Oligocène les poudingues calcaires très durs, à rognons siliceux, qui constituent certainement le sol des hammadas précitées, et que tous les géologues algériens rattachent au Pliocène.
[363]ERRATA
On s’est efforcé, dans le texte, d’uniformiser l’orthographe des noms. Entre le texte et les cartes, on a laissé échapper quelques fortes divergences orthographiques.
Dans la carte du Mouidir-Ahnet :
| on a écrit | Açerdjerah | au lieu d’ | Açedjerad. |
| Mekergan | au lieu de | Mekhergan. | |
| Megdoua | — | Maghdoua. | |
| Tiqueidi | — | Tikeidi. | |
| Mouïdir | — | Mouidir. |
Dans la carte de Beni Abbès (p. 210) on a écrit : si Mohammed ben Ammou au lieu de ben Abbou.
[365]TABLE DES FIGURES
| Fig. | 1. — | Principaux types de redjems | 69 |
| — | 2. — | Redjems du Hoggar | 72 |
| — | 3. — | — | 73 |
| — | 4. — | Tombeau de Tin Hinan | 74 |
| — | 5. — | Tombeau de l’Aïr | 76 |
| — | 6. — | Tombes actuelles | 78 |
| — | 7. — | Tombeau de la sultane Tabeghount | 80 |
| — | 8. — | Tombeau de noble Touareg | 81 |
| — | 9. — | Monuments en pierres sèches (pavages à fleur de sol) | 83 |
| — | 10. — | Monuments en pierres sèches (pavages à fleur de sol) | 85 |
| — | 11. — | Gravures du col de Zenaga | 89 |
| — | 12. — | — | 90 |
| — | 13. — | — | 91 |
| — | 14. — | Gravures du col de Zenaga (le bélier) | 93 |
| — | 15. — | Gravures de Barrebi | 95 |
| — | 16. — | — | 96 |
| — | 17. — | — (cavalier numide) | 97 |
| — | 18. — | Gravures d’Aïn Memnouna | 99 |
| — | 19. — | Gravures de Hadjra mektouba | 100 |
| — | 20. — | Gravures de Taoulaoun (chasse au mouflon) | 102 |
| — | 21. — | Gravures de l’Oued Tar’it (méharis) | 103 |
| — | 22. — | Gravures d’Aguelman Tamana (bovidés) | 106 |
| — | 23. — | Gravures de Tin Senasset | 107 |
| — | 24. — | — d’Ouan Tohra | 111 |
| — | 25. — | Gravures de Foum Zeggag, Ouan Tohra et Timissao | 113 |
| — | 26. — | Coupe de la station néolithique d’Aïn Sefra | 121 |
| — | 27. — | Rouleaux et pilons en pierre du Sahara | 130 |
| — | 28. — | Coupe de Mouizib el Atchan | 141 |
| — | 29. — | Coupe de Sfissifa à Mizerell | 144 |
| — | 30. — | Coupe de Bou-Kaïs à Téniet Nakhla | 144 |
| — | 31. — | Coupe de l’Anter au Mezarif par le Moumen | 146 |
| — | 32. — | Coupe de l’Antar au Mezarif par le Béchar | 146 |
| — | 33. — | Coupe de Tar’it à Menouar’ar | 148 |
| — | 34. — | Coupe de Beni Ounif | 150 |
| — | 35. — | Carte du Beni Goumi | 165 |
| — | 36. — | Coupe de l’oued Saoura à Ennaya | 181 |
| — | 37. — | Coupe de Kerzaz à Oguilet Mohammed | 182 |
| — | 38. — | Coupe d’Ougarta à Tin Oraj | 183 |
| — | 39. — | Coupe à l’est de Zeramra | 185 |
| — | 40. — | Ouarourourt (coupe) | 187 |
| — | 41. — | Beni Abbès (carte) | 210 |
| — | 42. — | Coupe de Fgagira | 225 |
| — | 43. — | Coupe au S.-O. du Charouïn | 226 |
| — | 44. — | Entre Charouïn et Ouled Rached (coupe) | 226 |
| — | 45. — | Coupe de la sebkha de Timimoun | 227 |
| — | 46. — | Coupe du Timmi au dj. Heirane | 228 |
| — | 47. — | Coupe de Temassekh à Haci Sefiat | 229 |
| — | 48. — | Le carbonifère de Tazoult | 229 |
| — | 49. — | Coupe de Tesfaout à Haci Sefiat | 231 |
| — | 50. — | Carte schématique, montrant la virgation hercynienne | 241 |
| — | 51. — | Coupe schématique entre Ouargla et Timimoun | 243 |
| [366]— | 52. — | Coupe schématique de l’Aouguerout | 245 |
| — | 53. — | Falaise terminale du Tadmaït (coupe) | 278 |
| — | 54. — | Coupe d’Aïn Cheikh | 281 |
| — | 55. — | — d’Hacian Taïbin à Garet ed Diab | 283 |
| — | 56. — | Au nord de l’Adr’ar Ahnet (coupe) | 291 |
| — | 57. — | Taloak à l’Adr’ar Ahnet (coupe) | 294 |
| — | 58. — | Coupe de l’erg Timeskis à Tadjemout | 296 |
| — | 59. — | Coupe transversale de l’Açedjerad | 297 |
| — | 60. — | Carte d’Aoulef | 302 |
| — | 61. — | Carte du Tidikelt et du Mouidir-Ahnet | 315 |
CARTES HORS TEXTE
Itinéraires au Sahara, 1905, par E.-F. Gautier.
Carte du Béchar, avec transparent : carte tectonique.
Esquisse géologique d’une partie de l’Extrême-Sud algérien (Oued Saoura, Gourara, Touat), par E.-F. Gautier (en couleurs).
Essai de carte géologique de Tidikelt et du Mouidir-Ahnet, par E.-F. Gautier et R. Chudeau (en couleurs).
[367]TABLE DES PLANCHES HORS TEXTE
| Entre les pages | ||||
| Planche | I. — | 1. | Type de hammada | 2-3 |
| 2. | Type de reg. | |||
| — | II. — | 3. | Type de falaise | 4-5 |
| 4. | Un coin du Tassili auprès de Timissao. | |||
| — | III. — | 5. | Type de gara | 4-5 |
| 6. | Erg et nebka. | |||
| — | IV. — | 7. | Oued saharien | 10-11 |
| 8. | Oued Tlilia. | |||
| — | V. — | 9. | Sebkha de Timimoun | 10-11 |
| 10. | Type de Maader. | |||
| — | VI. — | 11. | Aguelman Taguerguera (en aval) | 14-15 |
| 12. | Aguelman Taguerguera (en amont). | |||
| — | VII. — | 13. | Puits de Timissao (à orifice étroit) | 14-15 |
| 14. | Type de puits soudanais à large orifice. | |||
| — | VIII. — | 15. | Oued Zousfana. Arbuste juché sur un monticule | 16-17 |
| 16. | Type de medjbed (sentier saharien) sur le reg du Touat. | |||
| — | IX. — | 17. | Le lit de la Saoura à Timr’ar’in | 20-21 |
| 18. | Une crue de la Saoura à Ksabi. | |||
| 19. | Le lit de la Saoura à Foum el Kheneg. | |||
| — | X. — | 20. | Tin Oraj. L’oued Tabelbalet enfoui sous l’erg er-Raoui | 30-31 |
| — | XI. — | 21. | Un trou d’exploitation à Taoudéni | 54-55 |
| 22. | La falaise d’érosion qui limite la cuvette de Taoudéni. | |||
| — | XII. — | 23. | Grand redjem du type le plus fruste | 60-61 |
| 24. | Redjem B d’Aïn Sefra. | |||
| — | XIII. — | 25. | Redjem D de Beni Ounif pendant les fouilles | 60-61 |
| 26. | Cimetière actuel (Charouïn). | |||
| — | XIV. — | 27. | Cercle de sacrifices | 60-61 |
| — | XV. — | 28 et 29. Mobiliers funéraires trouvés dans les régions d’Aïn Sefra et de Beni Ounif | 66-67 | |
| 30. | Gravure rupestre de Barrebi. | |||
| — | XVI. — | 31. | Gravure rupestre dans l’oued Tar’it | 100-101 |
| 32. | Gravure rupestre, à Taoulaoun. | |||
| — | XVII. — | 33. | Gravures rupestres à Ouan Tohra | 110-111 |
| 34. | Type de gravures rupestres sur granit (Hoggar). | |||
| — | XVIII. — | 35. | Inscription sur grès albien au ksar d’Abani, près Tesfaout. | 116-117 |
| 36. | Autre inscription sur grès albien au ksar d’Abani. | |||
| — | XIX. — | 37. | Type des pointes d’Ouargla | 122-123 |
| 38. | Type des pointes de la Zousfana. | |||
| — | XX. — | 39. | Djebel Orred. Vu en contre-bas du sommet de l’Antar | 140-141 |
| 40. | Sommet de l’Antar. | |||
| — | XXI. — | 41. | Dans le Béchar : col du Mouizib el Achan | 140-141 |
| 42. | Dans le Béchar : col de Téniet Nakhla. | |||
| [368]— | XXII. — | 43. | Dans le Béchar : petite palmeraie d’El Djenien | 142-143 |
| — | XXIII. — | 44. | Djebel Béchar, vu du sud | 142-143 |
| 45. | Djebel Béchar, vu du nord. | |||
| — | XXIV. — | 46. | Collines de Bezazil Kelba | 144-145 |
| — | XXV. — | 47. | Portion de la falaise de Ksar el Azoudj | 148-149 |
| 48. | Falaise de Ksar el Azoudj (vue d’ensemble). | |||
| — | XXVI. — | 49. | Falaise de Kenatsa | 154-155 |
| 50. | La Zousfana en aval de Ksar el Azoudj. | |||
| — | XXVII. — | 51. | Vue prise du ksar de Tar’it en regardant la falaise | 162-163 |
| 52. | Vue prise du ksar de Tar’it en regardant la dune. | |||
| — | XXVIII. — | 53. | Tentes Doui-Menia, de type marocain | 162-163 |
| 54. | La zaouia de Kenatsa. | |||
| — | XXIX. — | 55. | Le poste d’Igli | 180-181 |
| 56. | Sur la rive droite de la Saoura à Beni Ikhlef. | |||
| — | XXX. — | 57. | L’oued Saoura à Beni Ikhlef | 180-181 |
| — | XXXI. — | 58. | Mine de cuivre de Tamegroun | 188-189 |
| 59. | Dans le kahal de Tabelbala auprès d’Oguilet Mohammed. | |||
| — | XXXII. — | 60. | Dans la chaîne d’Ougarta. Kheneg el Aten | 188-189 |
| 61. | Hadjra Mektouba. | |||
| — | XXXIII. — | 62. | Berge droite de la Saoura au ksar de Timmoudi | 188-189 |
| 63. | Falaise de Timmoudi. | |||
| — | XXXIV. — | 64. | Dans l’erg er Raoui, une antilope Adax | 196-197 |
| — | XXXV. — | 65. | Le minaret de Kerzaz | 204-205 |
| 66. | Un quartier de Kerzaz. | |||
| — | XXXVI. — | 67. | Ksar de Zeramra | 214-215 |
| 68. | A Zeramra. Koubba du saint qui garde le bois à brûler. | |||
| — | XXXVII. — | 69. | Foggara vue latéralement | 242-243 |
| 70. | Une foggara du Timmi suivant son axe. | |||
| — | XXXVIII. — | 71. | Croisement de petites seguias | 242-243 |
| 72. | Dans l’oasis du Timmi, Kesra ou « peigne » pour la répartition de l’eau. | |||
| — | XXXIX. — | 73. | Puits à bascule dans un jardin du Timmi | 242-243 |
| 74. | Grande seguia dans l’oasis du Timmi. | |||
| — | XL. — | 75. | Au Timmi, fabrication de briques creuses | 260-261 |
| 76. | Adrar (Timmi) capitale du Touat. | |||
| — | XLI. — | 77. | Timimoun. Une rue dans la palmeraie | 260-261 |
| 78. | Timimoun. Un coin du ksar. | |||
| — | XLII. — | 79. | Une palmeraie ensablée | 260-261 |
| 80. | Timimoun. Bouchers haratin dépeçant un chameau. | |||
| — | XLIII. — | 81. | Oued Aglagal | 278-279 |
| — | XLIV. — | 82. | A Ouan Tohra. — Le Baten Ahnet | 290-291 |
| — | XLV. — | 83. | Oued Arak. Une paroi du canyon | 290-291 |
| 84. | Oued Tibratin. Large vallée dans les argiles éodévoniennes. | |||
| — | XLVI. — | 85. | Oued Adjam. Porte qui donne accès dans le horst silurien d’Adoukrouz | 294-295 |
| — | XLVII. — | 86. | Près de l’oued Adjam. Grès éodévoniens basculés le long de la faille. Vue de détail | 294-295 |
| 87. | Même sujet que 86. Vue d’ensemble. | |||
| — | XLVIII. — | 88. | Près de l’oued Adjam. La muraille de grès éodévoniens basculée au nord d’Adoukrouz | 294-295 |
| 89. | L’Adr’ar Ahnet. | |||
| — | XLIX. — | 90. | Bled el Mass | 300-301 |
| 91. | Dans l’Adr’ar Ahnet, une gorge sauvage. | |||
| — | L. — | 92. | Adr’ar Ahnet. Un ravin dans les grès siluriens | 300-301 |
| — | LI. — | 93. | Adr’ar Ahnet. Oued Tedjouljoult | 300-301 |
| — | LII. — | 94. | Touareg armé | 330-331 |
| 95. | Tournoi touareg, ou plus exactement fantasia. | |||
| 96. | Un autre temps de la fantasia touareg. | |||
[369]TABLE DES MATIÈRES
| CHAPITRE I | |
| ONOMASTIQUE | 1 |
| Les sols (hammada — reg — erg — sif — feidj ou gassi — nebka. — Sol de Timchent), 3. — Forme du terrain (gara — baten et kreb — moungar, tarit — chebka), 8. — Hydrographie (l’oued — sebkha et chott — maader — haci — aïn — r’dir ou aguelman — tilmes abankor — medjbed — tanezrouft), 10. | |
| CHAPITRE II | |
| LES OUEDS ET LES DUNES | 20 |
| I. L’oued Messaoud, 20. — Haci Rezegallah, 23. — Haci Sefiat, 24. — Le réseau des affluents, 25. — O. Tlilia. — Sebkha de Timimoun, 27. — Les oueds du Grand Erg, 28. — L’oued Tabelbalet, 30. — L’Iguidi, 31. — L’oued Messaoud actuel, 32. — L’oued Messaoud historique, 34. | |
| II. Les dunes, 41. | |
| III. Taoudéni, 55. | |
| CHAPITRE III | |
| ETHNOGRAPHIE SAHARIENNE | 60 |
| I. Les tombeaux (redjems), 60. — Terminus ad quem et a quo, 64. — Aïn Sefra, 64. — Beni Ounif, 66. — La forme, 68. — Redjems du Hoggar, 71. — Provinces orientales, 75. — Autres monuments lithiques, 83. — Conclusion, 86. | |
| II. Gravures rupestres, 87. — Station de Figuig, 87. — Station de Barrebi, 94. — Station d’Aïn Memnouna, 99. — Station de Hadjra Mektouba, 100. — Stations des oasis et du Tadmaït, 101. — Stations des plateaux touaregs, 102. — Station de Timissao, 112. — Stations Ifor’ass, 113. — Stations du Hoggar, 114. — Stations de l’Aïr, 115. — Stations du Niger et du Sénégal, et Inscriptions tifinar’, 116. — Conclusions générales, 117. | |
| III. Armes et instruments néolithiques, 121. — Station d’Aïn Sefra, 121. — Station de Zafrani, 122. — Station de Tar’it, 123. — Gisements de la Saoura et du Touat, 125. — Gisements de l’Ahnet et du Tanezrouft, 126. — Gisements de l’Adr’ar des Ifor’ass et de l’O. Tilemsi, 128. — Rouleaux, meules dormantes, 130. — Conclusion, 133. | |
| [370]CHAPITRE IV | |
| LA ZOUSFANA | 139 |
| Roches primaires carbonifériennes, 139. — Roches secondaires, 143. — Plis hercyniens, 144. — Plis atliques, 145. — L’ennoyage, 148. — Importance géographique du Vorland primaire, 150. — Gîtes minéraux du Grouz, 152. — Pluies et végétation, 154. — Régime des eaux, 155. — Nappe artésienne, 156. — Les oueds, 157. — Groupe d’oasis de Béchar, 159. — Tar’it, 161. — La vie sociale et économique, 166. — La route transsaharienne et Figuig, 170. — La question marocaine, 171. — La pacification, 174. | |
| CHAPITRE V | |
| RÉGION DE LA SAOURA | 178 |
| Sous-région d’Igli, 178. — La chaîne d’Ougarta, 180. — Les plis hercyniens, 181. —La zone Beni Abbès-Ougarta, 184. — Horst de Merhouma, 184. — Fenêtre d’Ougarta, 185. — Fenêtre de Zeramra, 186. — Fenêtre de Beni Abbès, 186. — Fenêtre des « pierres écrites », 187. — Les couches à bivalves et fenêtre d’Idikh, 188. — Structure générale, 189. — O. Saoura, 190. — L’oued Tabelbalet, 197. — Erg Atchan et Sebkha el Melah, 198. — La chaîne d’Ougarta, 199. — L’homme, 201. — Les ksars autonomes, Igli, Mazzer, Beni Abbès, Beni Ikhlef, Agdal, 206. | |
| CHAPITRE VI | |
| GOURARA ET TOUAT | 219 |
| Géologie du Gourara, 220. — Terrains crétacés, 220. — Tertiaire, 221. — Dévonien inférieur et Dévonien moyen, 222. — Dévonien supérieur et les ktoub, 223. — Carbonifère, 224. — L’allure des plissements hercyniens à Fgagira, Charouïn et aux bords de la sebkha, 225. — Failles récentes, 227. | |
| Géologie du Touat, 227. — Éodévonien, 227. — Dévonien moyen et les ktoub, 228. — Carboniférien de Temassekh, Tazoult, Aïn Cheikh, 229. — Plissements hercyniens, 230. — Crétacé, 232. — Mio-Pliocène, 234. — Les failles, 235. | |
| Hydrographie, 237. — Les Foggaras, 242. — Gourara, 244. — Touat (haut Touat et bas Touat), 249. | |
| Le XVe siècle au Sahara et dans l’Afrique Mineure, 261. — Conditions politiques et économiques, 267. — Les nitrates de potasse, 275. | |
| CHAPITRE VII | |
| TIDIKELT ET MOUIDIR-AHNET | 277 |
| Géologie du Tidikelt, 277. — Crétacé, 277. — Sous-sol primaire, 280. — Dj. Aberraz, 282. — Pli d’In R’ar, 284. — Sud d’In Salah, 284. | |
| Géologie de la pénéplaine entre le Tidikelt et le Mouidir-Ahnet, 286. — D’In Salah au Mouidir, 286. — De Taloak à Baba Ahmed, 287. — Taourirt à l’Açedjerad, 289. | |
| Géologie du Mouidir-Ahnet, 290. — Silurien de Tadjemout, 290. — Adoukrouz et Adr’ar Ahnet, 291. — Sud et nord d’Aït el Kha, 292. — L’Éodévonien, 292. — Stratigraphie, 294. — Jeunesse des diaclases, 298. — Conclusions générales, 298. | |
| Le Tidikelt, 300. — Histoire, 303. — Démographie et organisation politique, 305. | |
| La pénéplaine déserte, 308. — Plateaux touaregs, 309. — La flore, 314. — Faune, 316. — Le Mouidir, 318. — L’Ahnet, 321. — Touaregs de l’Ahnet, 330. | |
[371]APPENDICES
| I. — | Itinéraires et observations astronomiques | 339 |
| II. — | Inscriptions (Tifinar’ et Hébraïques) | 344 |
| III. — | Traduction d’un manuscrit arabe concernant la mine de cuivre de Tamegroun | 347 |
| IV. — | Orthographe de quelques noms touaregs | 350 |
| V. — | Inscriptions arabes | 351 |
| VI. — | Étude minéralogique du matériel néolithique | 352 |
| VII. — | Minerai et bijoux (?) de cuivre | 354 |
| VIII. — | Nitrates d’Ouled Mahmoud | 355 |
| IX. — | Analyse d’un échantillon de Tomela | 357 |
| X. — | Note sur les mollusques du Sahara | 358 |
| XI. — | Observation a propos de la carte géologique de Béchar | 361 |
| Errata | 363 | |
| Table des figures et cartes | 365 | |
| Table des planches hors texte | 367 | |
1702-07. — Coulommiers. Imp. Paul BRODARD. — 4-08.
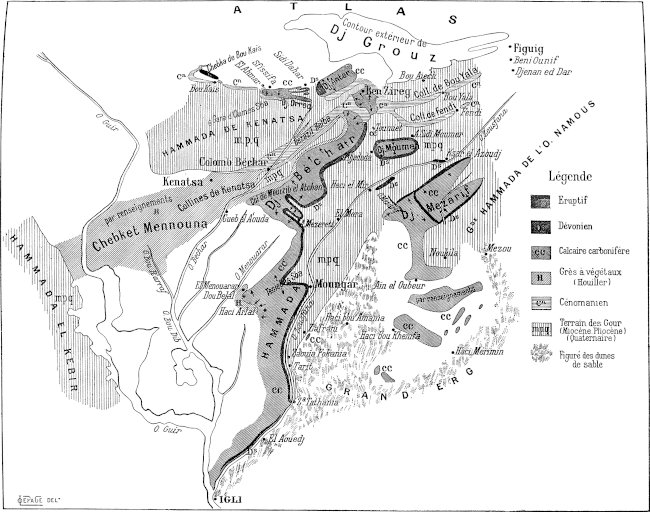
ESQUISSE GÉOLOGIQUE DE LA RÉGION CARBONIFÈRE DU BÉCHAR.
(Figure extraite du Bulletin de la Société pour l’encouragement de l’Industrie nationale, mars 1907.)
ESQUISSE
GÉOLOGIQUE
D’UNE PARTIE DE
l’Extrême-Sud-Algérien
(OUED SAOURA, GOUARA, TOUAT)
par E. F. GAUTIER
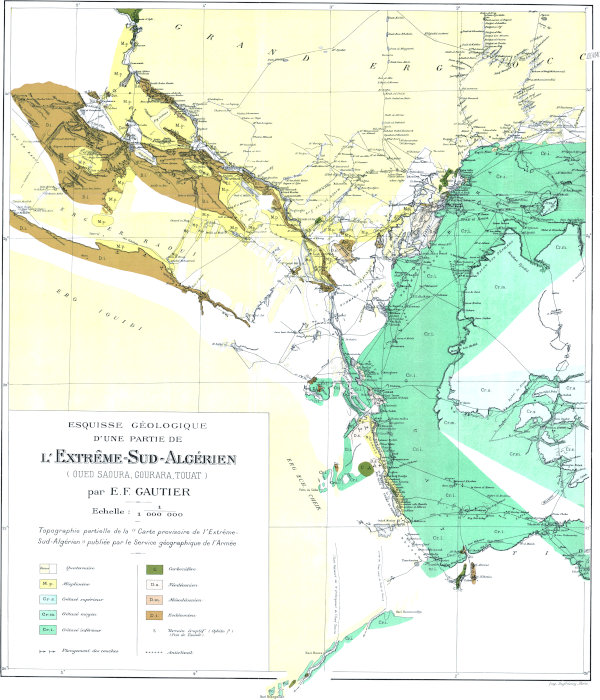
Imp. Dufrénoy, Paris.
(Grand format : partie supérieure, partie inférieure)
ESSAI DE CARTE
GÉOLOGIQUE
DU
Tidikelt ET
DU Mouidir-Ahnet
PAR
E. F. Gautier ET R.
Chudeau
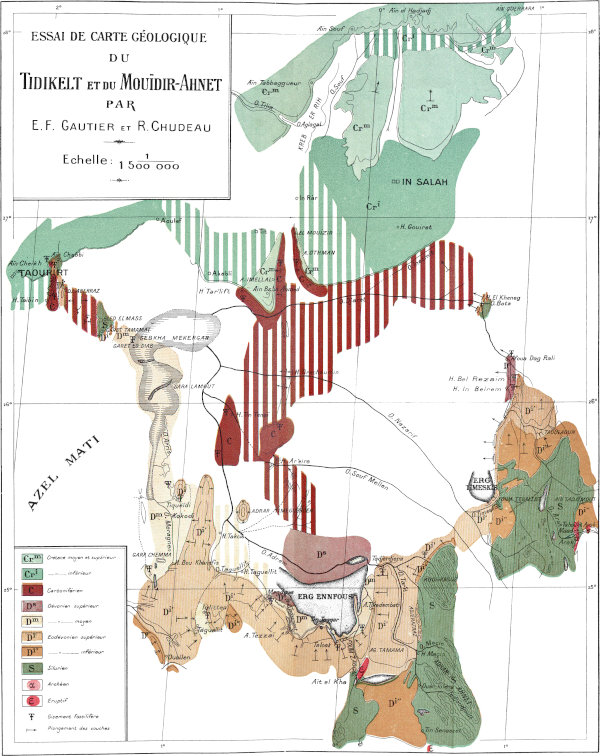
Dessiné par F. Borremans — 5, rue Hautefeuille — PARIS.
Note du transcripteur :
- Page 7, " sortir de Foum et Kheneg " a été remplacé par " Foum el Kheneg "
- Page 12, " les maadres sont parmi " a été remplacé par " maaders "
- Page 12, " à propros d’hydrographie " a été remplacé par " à propos "
- Page 22, " les deux itinaires " a été remplacé par " itinéraires "
- Page 24, " depuis Foum et Kheneg " a été remplacé par " Foum el Kheneg "
- Page 27, " (Voir pl. IV, phot. 81.) " a été remplacé par " phot. 8. "
- Page 78, fig. 6, ajouté " F " après " E E′ "
- Page 104, " (Pl. XVII, phot. 31.) " a été remplacé par " phot. 33. "
- Page 108, " et dans l’Air " a été remplacé par " l’Aïr "
- Page 126, " l’ouest du Trouat " a été remplacé par " Touat "
- Page 133, " nord-ouest (Zoufana) " a été remplacé par " Zousfana "
- Page 139, la référence absente à la note 112 a été placée après " 700 ou 800. ", dans le troisième paragraphe.
- Page 144, fig. 29, " m, p, d, mio-pliocène et quaternaire. " a été remplacé par " m, p, q, "
- Page 145, " et que de de loin on jugerait " a été remplacé par " que de loin "
- Page 150, fig. 34 " due à l’obligeauce " a été remplacé par " l’obligeance "
- Page 166, " ce sont actuellenent " a été remplacé par " actuellement "
- Page 170, " entre Guir el Zousfana " a été remplacé par " Guir et Zousfana "
- Page 210, " notes manuscristes " a été remplacé par " manuscrites "
- Page 214, " fragmentaires et iucohérents " a été remplacé par " incohérents "
- Page 236, " mouvents tectoniques " a été remplacé par " mouvements "
- Page 239, " au pemier abord " a été remplacé par " premier "
- Page 260, " amertune à l’état cru " a été remplacé par " amertume "
- Page 265, " la positon soiciale " a été remplacé par " sociale "
- Page 274, " viennent dn M’zab " a été remplacé par " du "
- Page 284, " encore plus ma connu " a été remplacé par " mal connu "
- Page 293, " Iglitten et Taksist (fig. 58) " a été remplacé par " fig. 59 "
- Page 298, " les horts siluriens " a été remplacé par " horsts "
- Page 300, " grand réseau quartenaire " a été remplacé par " quaternaire "
- Page 309, " absence oo leur insuffisance " a été remplacé par " ou leur "
- Page 315, fig. 61 " Mouïdir " a été remplacé par " Mouidir " (selon l’errata). Cela a été fait aussi pour la carte " ESSAI DE CARTE GÉOLOGIQUE... " hors texte.
- Page 317, " Les (gangas un gallinacé " a été remplacé par " Les gangas (un gallinacé "
- Page 326, " distribution, le le long des limites " a été remplacé par " distribution, le long "
- Page 335, " semblent naturellemen appelés " a été remplacé par " naturellement "
- Page 352, " Quatrzites. " a été remplacé par " Quartzites. "
- Page 353, " Ancune plaque mince " a été remplacé par " Aucune "
- De plus, quelques changements mineurs de ponctuation et d’orthographe ont été apportés.
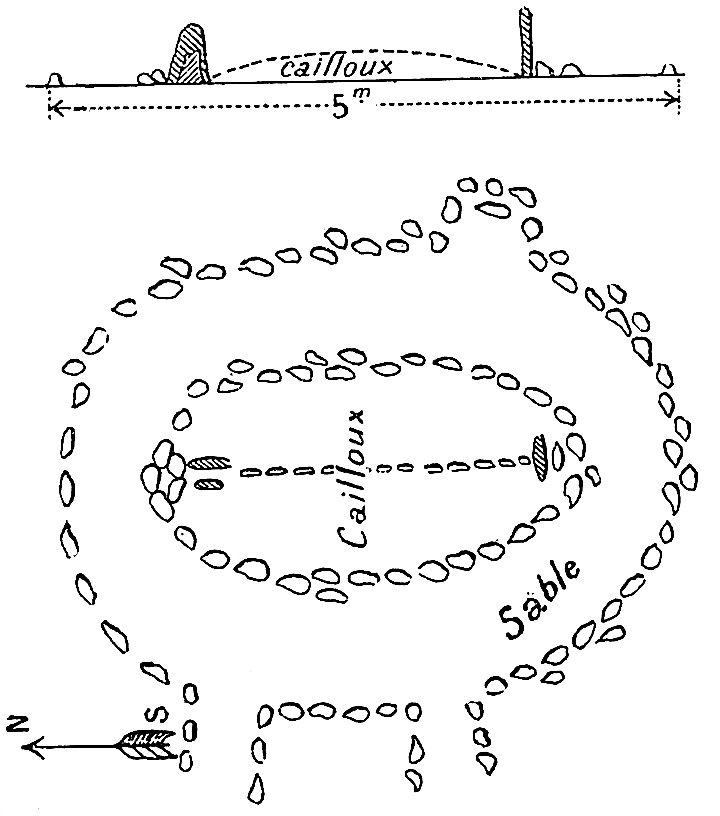
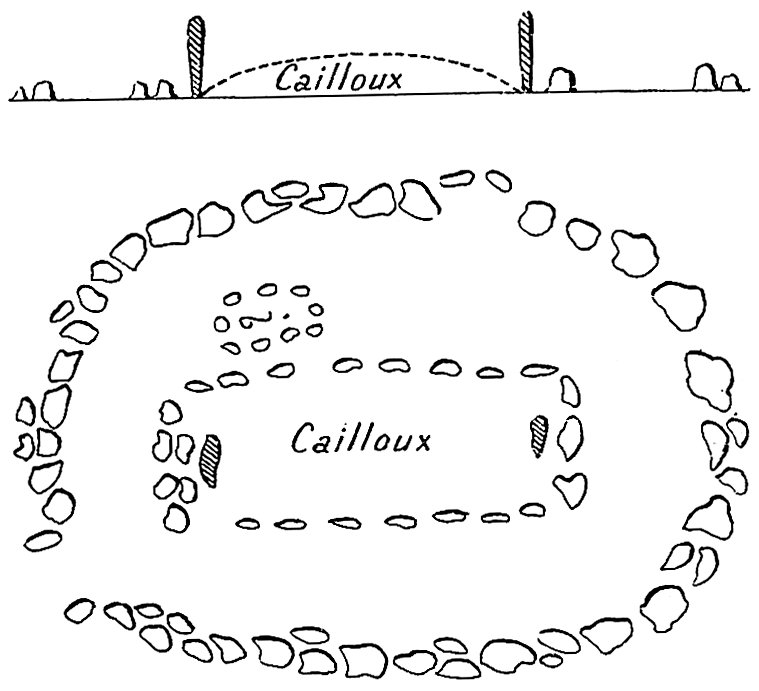
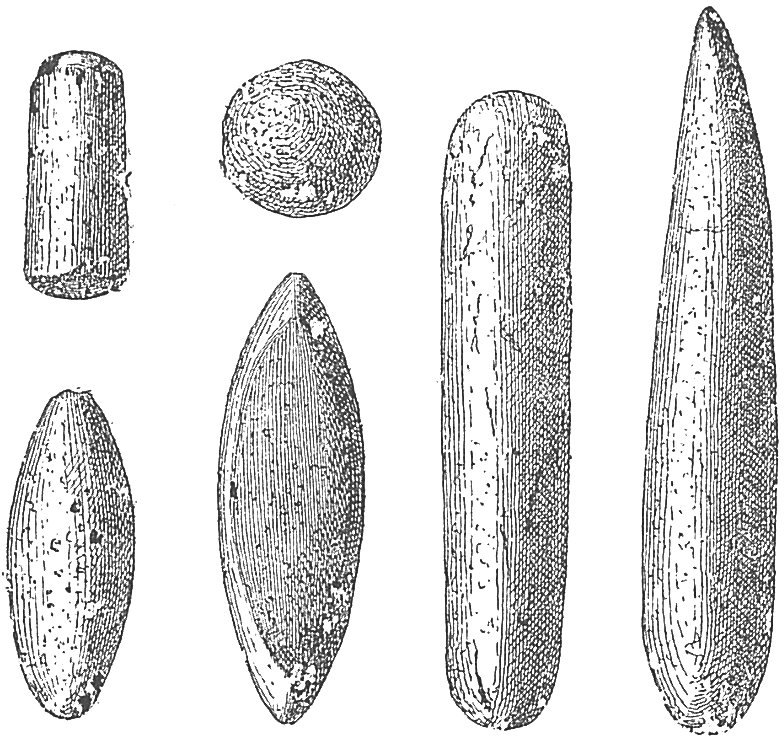
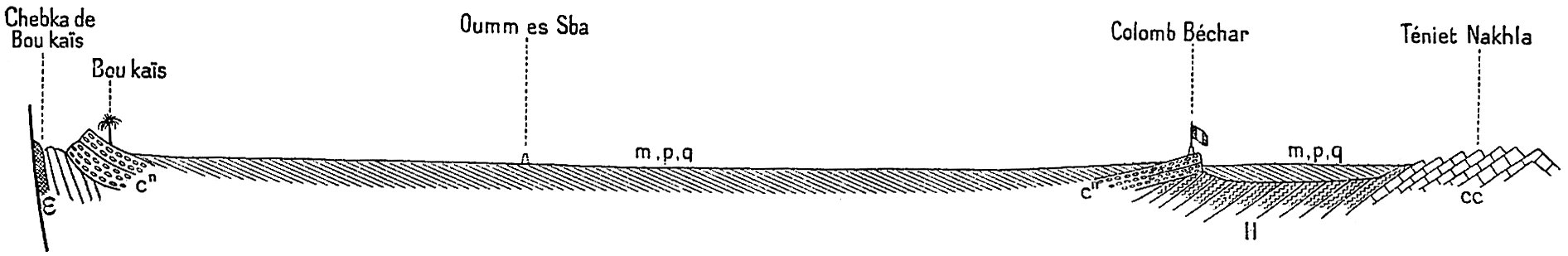
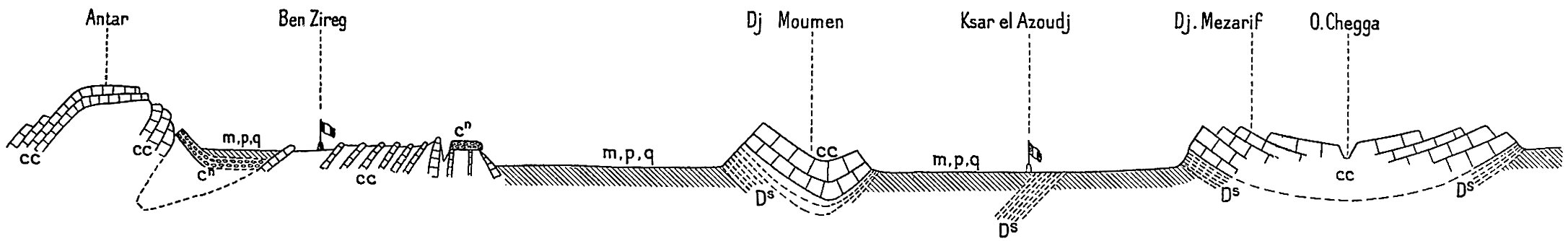
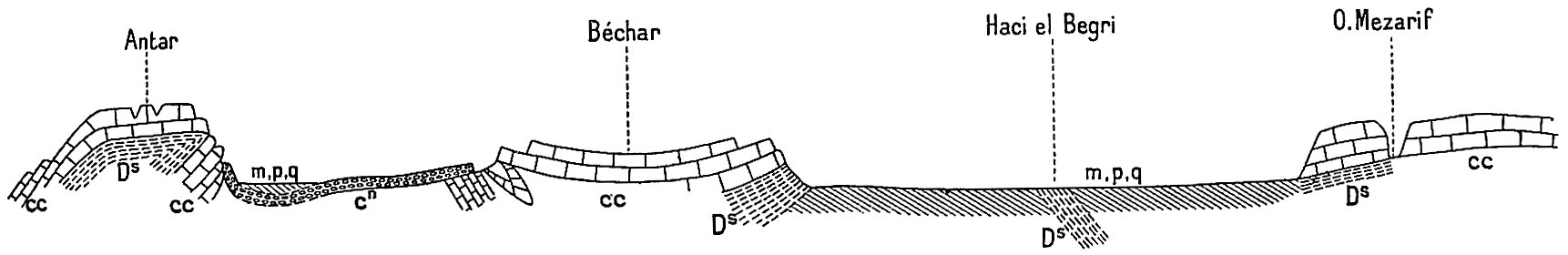
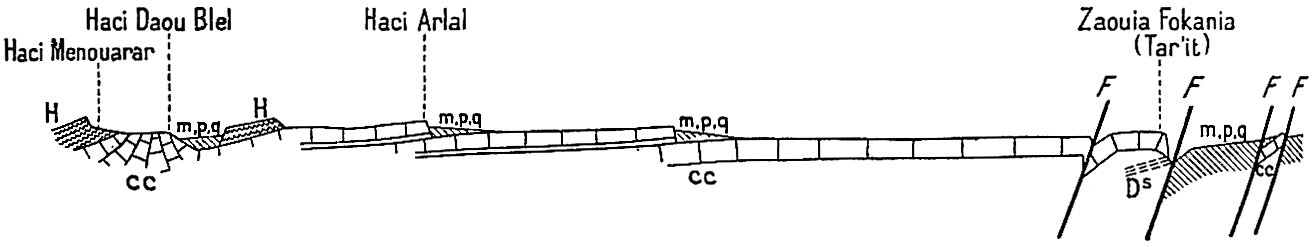
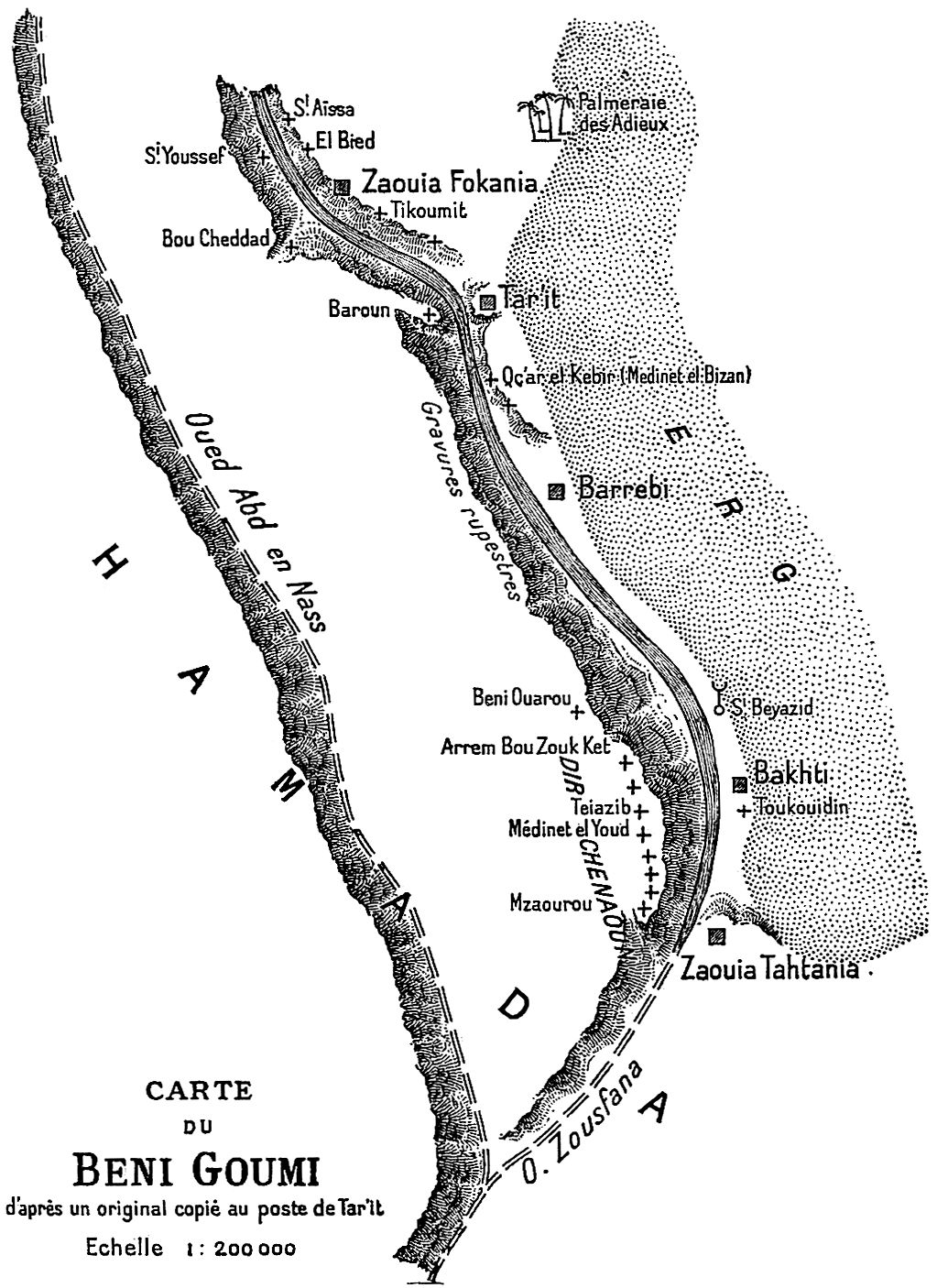
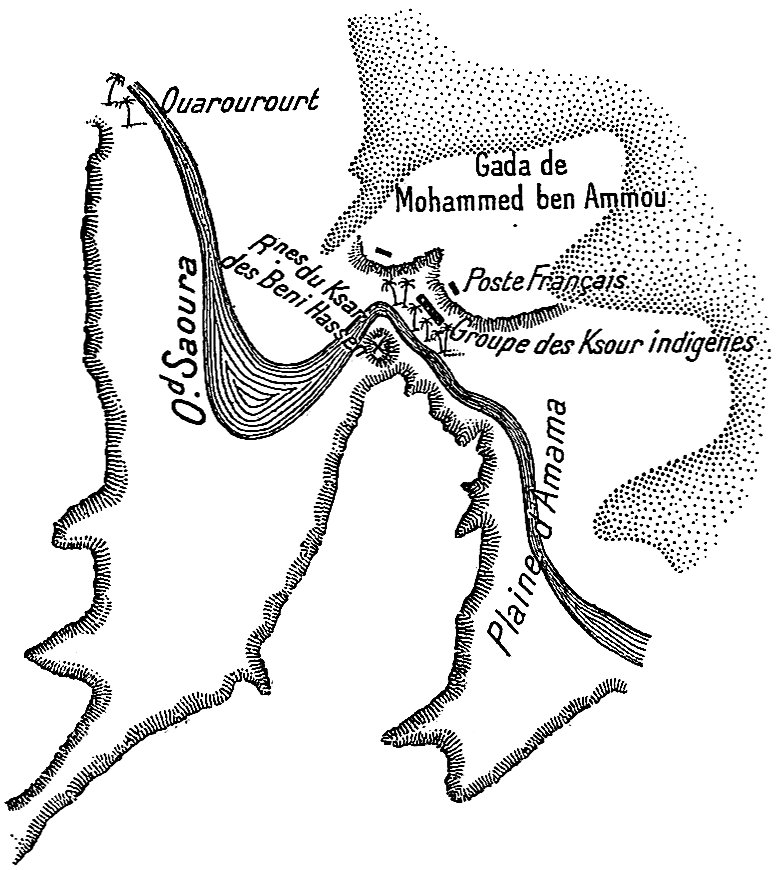
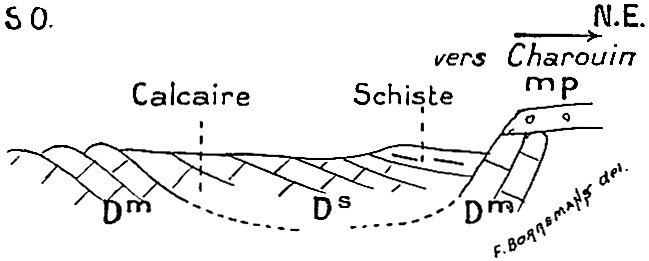
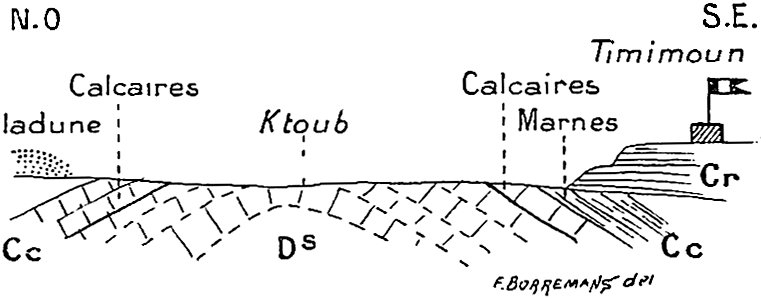
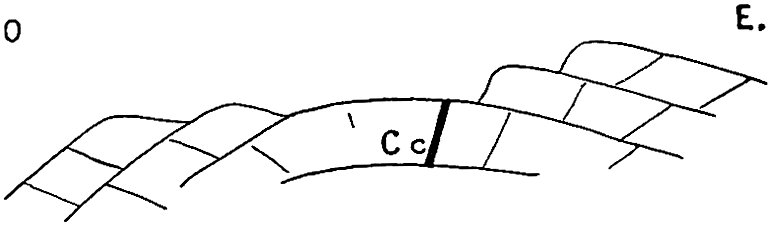
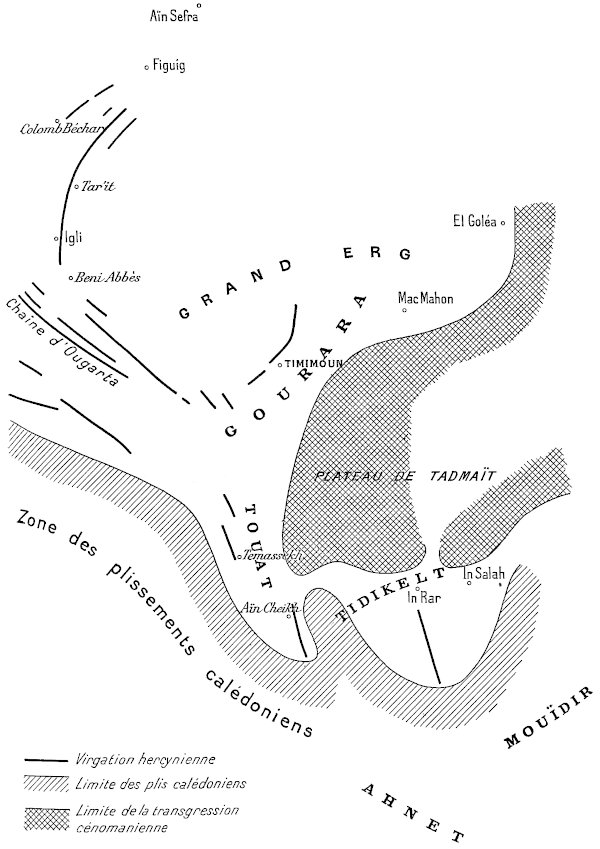
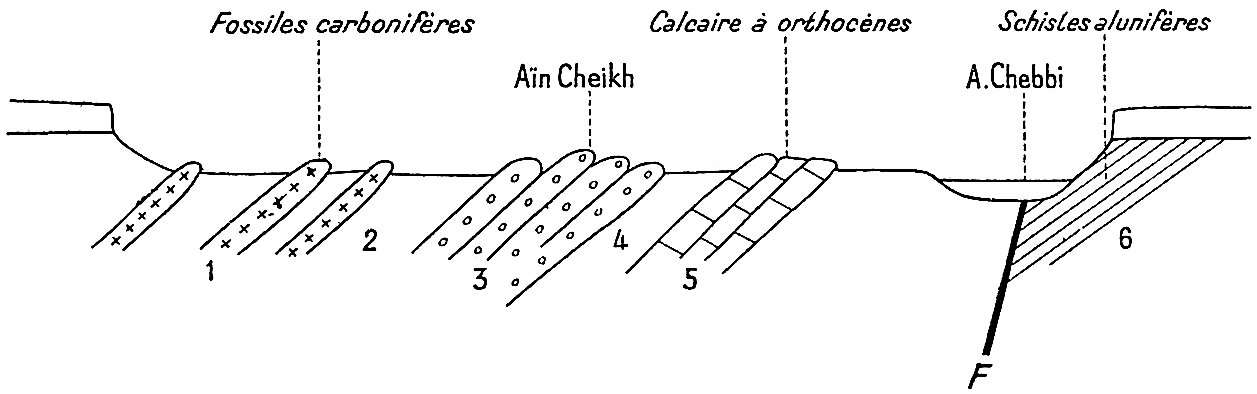
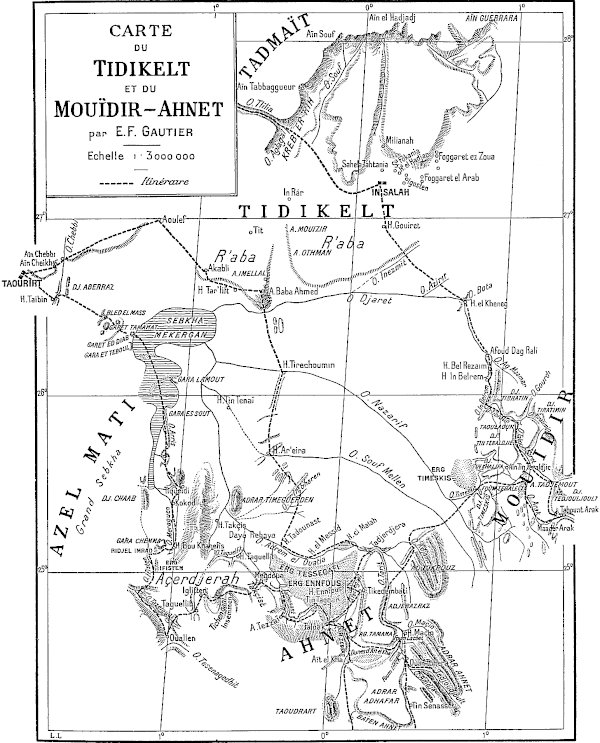
![[Inscription]](images/iapp2_1.jpg)
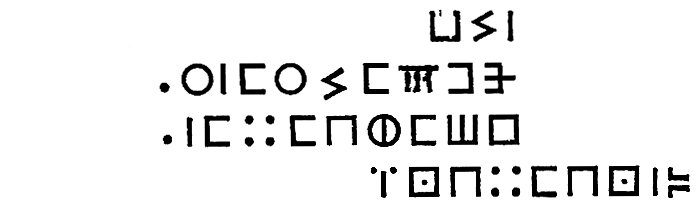
![[Inscription]](images/iapp2_2bis.jpg)
![[Inscription]](images/iapp2_5.jpg)