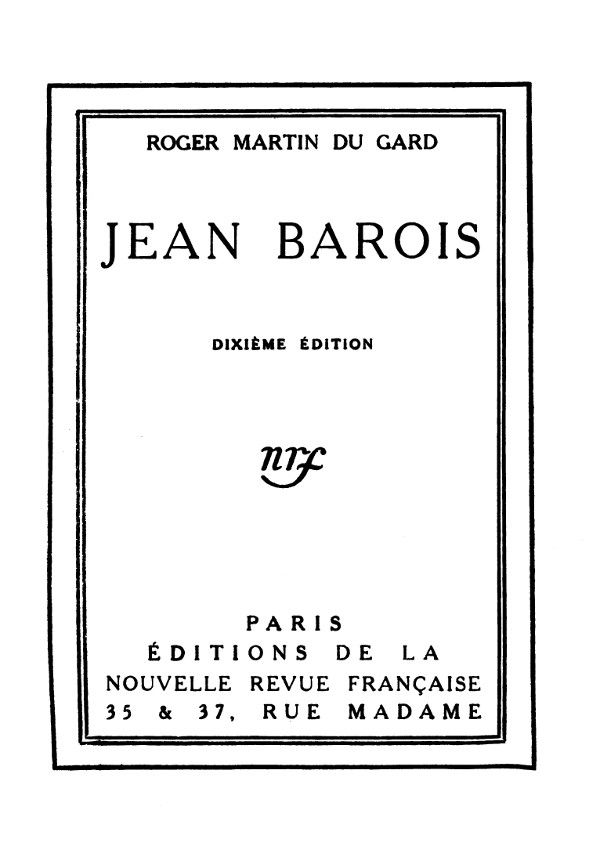
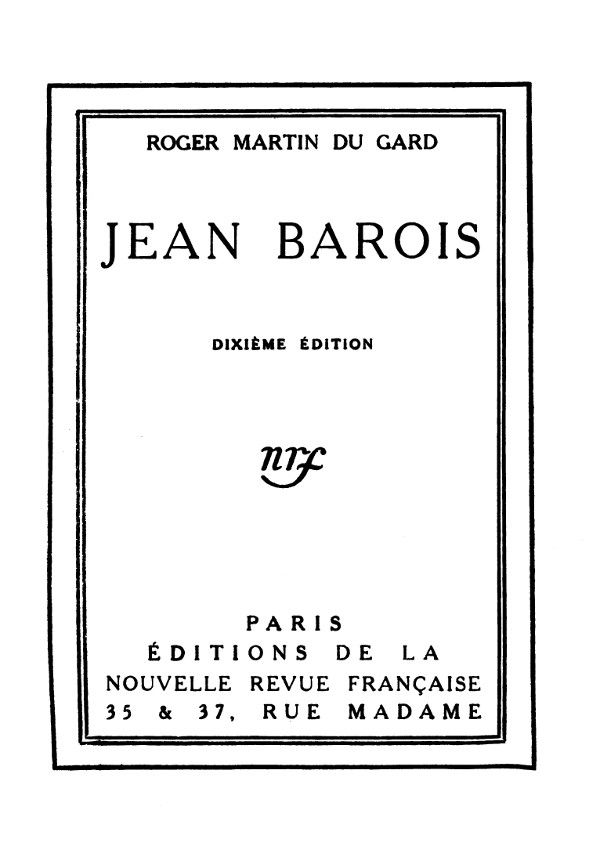
"La conscience malade, voila le théâtre de la fatalité moderne."
SUARÈS.
DIX-SEPTIÈME ÉDITION
nrf
PARIS
ÉDITIONS DE LA
NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
35 ET 37, RUE MADAME. 1921
A M. MARCEL HÉBERT.
Votre sensibilité religieuse ne peut qu'être blessée par certaines tendances de ce livre. Je le sais; et je vous remercie d'autant plus d'en avoir accepté la dédicace.
Votre nom, au seuil de ces pages, n'est pas seulement le témoignage du respectueux et vivace attachement que je vous porte depuis vingt ans. Je suis assuré qu'il me vaudra, de tous ceux qui connaissent la noblesse de votre pensée et le riche apport critique de votre œuvre, une attention plus grave et comme un reflet de cette estime qui entoure l'éloquent renoncement de votre vie.
R. M. G. (Octobre 1913.)
En 1878, à Buis-la-Dame (Oise).
La chambre de Mme Barois.
Pénombre. Derrière les rideaux, la lune strie de noir et de blanc les persiennes. Sa lueur sur le parquet, met en relief un bas de robe, une bottine d'homme qui bat silencieusement la mesure. Deux respirations; deux êtres s'immobilisant dans une même attente.
Par moments, dans la pièce voisine, le grincement d'un lit de fer; une voix d'enfant, sourde, entrecoupant des mots de rêve ou de délire. Dans l'entrebaîllement de la porte, un reflet mouvant de veilleuse.
Longue pause.
LE DOCTEUR (à voix basse).—Le bromure agit, la nuit va être plus calme.
Lourdement Mme Barois se lève et, sur la pointe des pieds,
s'approche de la porte; appuyée au vantail, le masque inerte
et douloureux, les paupières à demi baissées, elle regarde
fixement dans la chambre éclairée.
Mme Barois: grande vieille femme, au ventre déformé, à
la démarche pesante.
L'état cru de la veilleuse fouille impitoyablement son visage ravagé; la peau est jaune, distendue; des ombres soulignent la bouffissure des yeux, la chute des joues, le gonflement des lèvres, le fanon.
Une bonté rigide, un peu bornée; une douceur têtue; de la réserve.
Quelques minutes.
MADAME BAROIS (bas).—Il dort.
Elle ferme avec précaution la porte, allume une lampe et vient se rasseoir.
LE DOCTEUR (posant sa main sur celle de sa mère, et, par habitude, glissant les doigts jusqu'au pouls).—Vous aussi, Maman, ce voyage vous a épuisée.
Mme Barois secoue la tête.
MADAME BAROIS (bas).—Je sens que tu m'en veux, Philippe, d'avoir emmené Jean là-bas.
Il ne répond pas.
Le Docteur Barois: cinquante-six ans. Petit, alerte; gestes
vifs et précis.
Le poil déjà gris. Un visage fin et comme aiguisé: l'arête du nez est coupante, la moustache darde deux bouts cirés, la barbe pointe; un demi-sourire, malicieux et bon, amincit les lèvres; l'œil mobile et perçant luit à feux brefs à travers le lorgnon.
MADAME BAROIS (après une pause).—Pourtant, ici, tous me l'ont conseillé... Et Jean, qui me tourmentait pour que je l'inscrive! Il avait le pressentiment, ce petit, qu'il reviendrait débarrassé de son mal. Pendant tout le voyage, il s'est fait répéter l'histoire de Bernadette...
Le docteur retire son lorgnon: regard myope, plein de tendresse. Mme Barois se tait. Leurs pensées se reconnaissent et se heurtent: tout un passé entre eux.
MADAME BAROIS (les yeux au ciel).—Oui, tu ne peux plus comprendre... Nous ne pouvons plus nous comprendre, toi et moi, mon fils et moi! Et voilà ce qu'ils ont fait de toi, à Paris, de l'enfant que tu étais...
LE DOCTEUR.—Ma pauvre Maman, ne discutons pas... Je ne vous reproche rien. Rien, sinon de m'avoir averti lorsqu'il était trop tard pour que je dise non. Jean n'était pas capable de supporter un pareil voyage, dans un train omnibus, en troisième...
MADAME BAROIS.—Est-ce que tu ne t'exagères pas son état, mon enfant? Tu l'as retrouvé ce soir, avec de la fièvre, avec du délire... Mais tu ne l'as pas vu tout cet hiver...
LE DOCTEUR (soucieux).—Non je ne l'ai pas vu, tout cet hiver.
MADAME BAROIS (enhardie).—Depuis cette bronchite, il n'a jamais repris sa mine, c'est certain... Il se plaignait d'un point, là... Mais enfin, il n'avait pas l'air d'un enfant malade, je t'assure... Souvent le soir, il était gai, trop gai même...
Le docteur remet soigneusement son lorgnon et se penche vers sa mère; il saisit sa main.
LE DOCTEUR.—Trop gai, le soir... Oui... (Secouant la tête.) Vous oubliez trop vite le passé, Maman.
MADAME BAROIS (têtue).—Là-dessus, mon enfant, tu sais ce que je pense. Jamais je n'ai voulu croire que ta chère femme ait été ... ce que tu crois. C'est Paris qui te l'a tuée: comme tant d'autres!
Le docteur baisse la tête. Il écoute à peine. A la lueur de la lampe, il vient d'apercevoir cette main qu'il caressait machinalement: lourde main, usée et molle, tachée de rouille, aux doigts déformés. Il touche, avec un recul subit à sa petite enfance, cette alliance amincie, prête à rompre, que la jointure enflée tiendra prisonnière maintenant, jusqu'à la fin... Et spontanément, pour la première fois de sa vie peut-être, avec la tentation lâche de pleurer, de fuir, d'échapper à l'impitoyable, il porte à ses lèvres cette vieille main méconnaissable, qu'il ne confondrait pourtant avec aucune autre.
Mme Barois, gênée, retire sa main.
MADAME BAROIS (avec âpreté).—Et d'abord, Jean est de notre côté, tout à fait... C'est ton portrait, voyons! Tout le monde le dit! Cet enfant-là n'a rien de sa mère...
Pause.
LE DOCTEUR (à lui-même, sombre).—J'ai été tellement occupé, tout cet hiver... (Il s'aperçoit qu'il n'a pas répondu à sa mère. Il se tourne affectueusement.) C'est dur, le métier, dans ces cas-là, Maman... Un fils malade, à quelques heures de Paris, et se laisser prendre son temps, tout son temps, heure par heure, pour d'autres... Chaque fois qu'on inscrit un rendez-vous nouveau, penser à cette feuille d'agenda qu'on ne peut garder blanche... Ah! si je pouvais quitter tout, m'installer là, près de lui, près de vous deux!... (Tranchant.) Mais je ne peux pas. C'est impossible.
Il soulève son pince-nez, l'essuie, réfléchit quelques instants, puis le replace avec décision. La parole devient brève, affirmative,—professionnelle.
LE DOCTEUR.—Il va falloir redoubler de surveillance, nuit et jour, combattre pied à pied le mal...
Mme Barois laisse échapper un geste d'incrédulité.
Le docteur s'arrête net, enveloppe sa mère d'un coup d'œil rapide. Une seconde de désarroi: ainsi, lorsqu'au cours d'une opération il doit brusquement renverser son plan. Puis l'œil s'aiguise, se fixe; une résolution nouvelle.
Long silence.
Huit jours après, un dimanche matin.
LE DOCTEUR (entrant dans la chambre de Jean).—Bonjour, mon petit. Comment allons-nous, ce matin? La fenêtre fermée, par ce beau soleil?
Il prend les mains de l'enfant, et le place devant lui, face au jour.
LE DOCTEUR.—La langue... Bon... As-tu bien dormi, cette semaine? Pas trop? Tu t'agites toujours dans ton lit? Tu te réveilles parce que tu as trop chaud? Ah... (Une tape sur la joue.) Déshabille-toi que je t'ausculte.
Jean: un gamin de douze ans, pâlot.
Des traits fins, sans caractère. Le regard est plus personnel: caressant, réfléchi, sans gaieté.
Un torse malingre; des traînées mauves, sur la peau mince, soulignent les côtes.
LE DOCTEUR.—Voyons, maintenant... Appuie-toi, le dos au mur, comme l'autre jour; les bras pendants... Lève le menton, ouvre la bouche... C'est ça... (Il retire son lorgnon.) Respire profondément, régulièrement... Recommence...
Il écoute, le masque douloureux, l'œil clignotant, isolé du monde par sa myopie et son attention crispée.
L'angoisse du père. L'insouciance de l'enfant qui bâille et
regarde le ciel.
Longue auscultation.
LE DOCTEUR (simplement).—C'est bien, mon petit, tu peux te rhabiller... (Sourire très tendre.) Maintenant, voici ce que je te propose: nous allons descendre au jardin, tous les deux, et causer tranquillement, au soleil, en attendant que ta grand'mère soit revenue de la messe. Quoi?
JEAN.—Grand'mère ne doit pas être partie... (Timide.) C'est la Pentecôte, papa... J'aurais voulu...
LE DOCTEUR (doucement).—Non, mon petit, ce ne serait pas prudent. Il fait chaud en marchant, et l'église doit être très fraîche.
JEAN.—C'est si près...
LE DOCTEUR.—Et puis, il faut que je prenne le train de trois heures: une consultation, ce soir, à Paris... Je veux te voir un peu, tu comprends? (Changeant de ton.) J'ai à te parler, Jean, sérieusement, très sérieusement... (Un temps.) Descendons.
Le vieux logis des Barois est au sommet de la ville.
Le bâtiment du fond, adossé au clocher, étaye l'église; les deux ailes, basses, couvertes en tuiles, avancent vers la rue; un mur de prison les relie, que ferme un large portail.
L'espace ainsi clos est mi-cour, mi-jardin. Plusieurs fois par jour, le son des cloches s'engouffre dans ce puits sonore et l'emplit jusqu'à ébranler les murailles.
Le docteur emmène Jean sous le berceau de vignes vierges.
LE DOCTEUR (enjouement factice).—Allons, assieds-toi là... Nous sommes très bien, ici...
JEAN (prêt à pleurer sans savoir pourquoi).—Oui, papa.
Le docteur a son visage d'hôpital: le nez pincé, l'œil fureteur et grave.
LE DOCTEUR (fermement).—Voici ce que j'ai à te dire, Jean, en trois mots: «tu es malade»...
Pause. Jean ne bouge pas.
LE DOCTEUR.—Tu es malade, et plus que tu ne crois. (Nouvelle pause. Le docteur ne quitte pas l'enfant du regard.) J'ai voulu que tu le saches, parce que, si tu ne te soignes pas toi-même, énergiquement, ça pourrait devenir grave ... tout à fait grave...
JEAN (retenant ses larmes).—Alors... Je ne vais pas mieux?
Le docteur secoue la tête.
JEAN.—Alors, ce qui s'est passé à Lourdes? (Il réfléchit une seconde.) Peut-être que ça ne se voit pas encore...
LE DOCTEUR.—Ce qui s'est passé là-bas, moi, je n'en sais rien. Je dis seulement ceci: aujourd'hui, tel que tu es là, devant moi tu es ... très sérieusement atteint.
JEAN (demi-sourire).—Qu'est-ce que j'ai?
LE DOCTEUR (fronçant les sourcils).—Tu as... (Longue hésitation.)
Laisse-moi t'expliquer, écoute-moi, et tâche de comprendre ce que je vais te dire. Ta mère... (Il retire son lorgnon, l'essuie, et tourne vers Jean son regard myope.) Tu ne te rappelles rien de ta maman?
Jean, confus, fait un signe négatif.
LE DOCTEUR.—Ta maman, jeune fille, vivait ici, à la campagne; elle se portait bien, mais elle n'était pas très robuste. Après notre mariage, il a fallu qu'elle vienne habiter Paris, à cause de moi. Ta naissance l'a beaucoup fatiguée... (Aspiration.) C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à être malade... (Insistant.) D'abord une bronchite infectieuse... Tu sais ce que c'est?
JEAN.—Comme moi?
LE DOCTEUR.—... Elle s'en est mal remise: elle passait de mauvaises nuits à se retourner dans son lit, avec de la fièvre... (Mouvement de l'enfant.) Elle sentait toujours un point douloureux, là... (Il se penche, résolument.) Tiens, là...
JEAN (angoissé).—Comme moi?
LE DOCTEUR.—Quand je me suis aperçu qu'elle était malade, j'ai voulu qu'elle se soigne. Je lui ai dit à peu près tout ce que je veux te dire aujourd'hui. Malheureusement, elle ne m'écoutait pas... (Une pause. Hésitant sur les mots, mais d'une voix très ferme.) Ta maman, vois-tu, était une femme très bonne, douce, dévouée ... et que j'aimais profondément... Mais elle était beaucoup plus jeune que moi ... excessivement pieuse... (Avec lassitude.) Je n'ai jamais pu prendre la moindre influence sur elle... Elle me voyait, tous les jours, conseiller, guérir des gens: pourtant, elle n'avait pas confiance... Et puis, elle ne se sentait pas vraiment malade. Moi, je venais d'avoir mon service à l'hôpital, j'avais une vie très occupée je ne pouvais pas la surveiller comme il aurait fallu. Je voulais l'installer ici, au bon air; elle refusait... La toux a commencé... Il y a eu des consultations... C'était trop tard...
(Une pause) Alors ... ça a été très vite... L'été ... l'automne ... l'hiver... Au printemps elle n'était plus là...
Jean fond en larmes.
Le docteur l'enveloppe d'un regard attentif et froid, sans un
geste: il attend, au chevet d'un malade, l'effet d'une piqûre.
Quelques minutes.
LE DOCTEUR.—Je ne te raconte pas ça pour t'attrister, mon petit. J'essaye de te parler comme à un homme, parce que c'est nécessaire... Tu avais hérité de ta mère une prédisposition à être malade comme elle. Une prédisposition, tu comprends? rien de plus. C'est-à-dire que, si tu te trouvais dans certaines conditions défavorables, le même mal pouvait s'attaquer à toi.
Eh bien, tu en es là, exactement. Tu es, depuis cet automne, dans un état de ... faiblesse générale, qu'il est urgent ... très urgent de...
Jean, épouvanté tout à coup, glisse du banc et se jette au-devant de son père, qui le serre maladroitement contre lui.
LE DOCTEUR.—N'aie pas peur, mon petit, n'aie pas peur, je suis là...
JEAN (à travers ses sanglots).—Oh, je n'ai pas peur... J'ai déjà rêvé ... que j'étais au ciel...
Le docteur l'écarte d'un geste brusque, et le plante devant lui.
LE DOCTEUR (violemment).—Il ne s'agit pas de mourir, Jean, mais de vivre. Tu peux te défendre, défends-toi!
Le gamin, interloqué, cesse de pleurer. Il regarde son père. Il aurait aimé à être pris sur les genoux, câliné. Il se heurte à l'éclat froid d'un lorgnon.
Un sentiment nouveau: de la crainte, un peu de rancune; mais—l'ascendant de l'intelligence et de la force,—une confiance absolue, une foi.
LE DOCTEUR.—Tu ne sais pas... Un corps humain, ça nous paraît harmonieux, ordonné?... Eh bien, ce n'est qu'un vaste champ de bataille... Il y a là des myriades de cellules qui se heurtent et s'entremangent... Je t'expliquerai ça... Sans cesse, des millions de petits êtres nuisibles nous assaillent, et parmi eux, naturellement, la tuberculose, qui guette les prédisposés comme toi... Alors, c'est très simple: si l'organisme est fort, il repousse l'attaque; s'il est déprimé, il se laisse envahir...
(Saisissant le bras de Jean, et scandant les mots.) Il n'y a donc qu'un moyen, un seul: devenir fort, le plus vite possible, pour reprendre le dessus. La guérison est à ta portée, il suffit de la «vouloir»! Attelle-toi à cette besogne! C'est uniquement une question d'énergie, de persévérance... Comprends-tu?... L'existence tout entière est un combat; la vie, c'est de la victoire qui dure... Ah, comme tu t'en apercevrais bientôt, si tu «voulais» vraiment!
D'instinct, l'enfant est revenu se blottir contre son père.
LE DOCTEUR (l'entourant d'un bras).—Si je pouvais quitter mes malades, ma clinique, ma salle d'opération, et me consacrer à toi, mon petit, je te tirerais d'affaire, j'en réponds... (Avec force) Eh bien, ce que je ne peux pas, ce que je n'ai pas le droit de faire, tu le peux, toi, guidé par moi. (Au visage.) Veux-tu?
JEAN (dans un grand élan).—Ah, papa, je te promets... Je vais m'y mettre, va!...
Une pause.
Le docteur sourit.
JEAN (après réflexion, à mi-voix).—L'abbé Joziers va dire des messes pour moi...
LE DOCTEUR (avec douceur).—Si tu veux. Mais ça ne suffirait pas. Il y a plus pressé, pour l'instant.
Jean recule d'un pas.
LE DOCTEUR (lentement).—Comprends-moi, mon petit, et crois ce que je te dis... Je te répète que ta pauvre maman a succombé parce qu'elle n'avait pas eu confiance...
L'enfant se rapproche.
LE DOCTEUR.—Tu penses bien que je n'ai pas cherché à te blesser. Je compte même beaucoup sur ta piété pour te soutenir dans cette lutte. Seulement, vois-tu, il y a un proverbe: «Aide-toi, le ciel t'aidera.» Prie de tout ton cœur, mon enfant, mais n'oublie jamais qu'il faut subordonner tout,—même tes prières, tu entends?—au traitement d'hygiène que je vois te donner. (Avec une fougue persuasive.) Et ce traitement-là, Jean, si tu veux guérir, il faudra le suivre, je ne dis pas seulement avec bonne volonté, ni avec suite, comprends-tu, mon chéri...
A pleines volées, toutes les cloches de la Pentecôte annoncent l'Elévation.
Le docteur est obligé de hausser la voix, de crier, dans le vacarme trépidant.
LE DOCTEUR.—... je ne dis pas seulement avec courage, mais avec une passion, une ténacité enragées! Avec la volonté farouche de remonter le courant, de conquérir des forces, de repousser le mal, de repousser la mort! Avec le goût frénétique de la vie! Vivre, Jean... Si seulement, une fois, tu avais bien compris ce que c'est! Rester vivant, aimer encore ce que tu aimes, voir longtemps encore ce soleil là, sur la treille de ta vieille maison... Longtemps encore être assourdi et grisé par ces cloches... Regarde un peu autour de toi, cette lumière, ces arbres, le ciel, le clocher... (Il le secoue par les épaules.) Vivre, Jean!...
L'enfant, électrisé, frémissant, soulevé par une impulsion
nouvelle, s'est dressé tout droit devant son père, le feu aux
joues, les yeux étincelants.
Le docteur le toise longuement, gravement, et l'attire à lui.
Les cloches se taisent. Un instant encore leurs vibrations tourbillonnent
dans la cour, avant de s'évanouir dans l'espace.
Silence.
LE DOCTEUR (pesant ses mots).—Trois choses: la nourriture, l'air, le repos... Il faut bien retenir tout ce que je vais te dire...
A Buis, chez Mme Pasquelin, la marraine de Jean.
Une chambre. Pénombre. Aux vitres, crépuscule neigeux d'hiver.
Devant la cheminée, éclairé par la braise, un groupe silencieux:
Mme Pasquelin, debout, se penche vers Jean qui sanglote sur son épaule. La petite Cécile, haletante, le mouchoir sur les lèvres, incapable d'assister au chagrin de Jean, se serre contre les jupes de sa mère.
Sur le tapis, deux dépêches froissées:
«Pasquelin. Buis-la-Dame. Oise.
«Mère très ébranlée par la traversée de Paris. Opération retardée par suite de complications imprévues. Suis inquiet.
Dr Barois.»
«Pasquelin. Buis-la-Dame. Oise.
«Mère a succombé ce matin onze heures maison de santé sans avoir repris conscience. Intervention était devenue impossible. Prévenez Jean avec grands ménagements, évitez toute secousse.
Dr Barois.»
Trois ans plus tard.
Une cellule carrelée derrière la sacristie. Éclairage bas d'un
jour de souffrance. Deux chaises, deux prie-dieu. Au mur, un
christ.
L'abbé Joziers: un visage jeune; le front haut, déjà découvert;
des cheveux blonds, coupés courts et frisés. L'œil gai et
pur: la paix d'une foi simple et active. La lèvre supérieure
mince et grave; la lèvre inférieure charnue, d'une ironie un peu
provocante, mais cordiale.
Dans le regard, dans le sourire, le joyeux défi de ceux pour
qui tout est définitivement éclairci en ce monde comme en
l'autre, et qui se sentent avec sérénité les seuls dépositaires
du Vrai.
L'abbé Joziers clot soigneusement la porte et se tourne vers
Jean, les deux mains tendues.
L'ABBÉ.—Eh bien, l'ami Jean, qu'y a-t-il donc? (Gardant la main de Jean dans la sienne.) Asseyez-vous d'abord.
Jean Barois: quinze ans.
Grand, souple et charpenté. Le buste large; le cou dégagé et solide.
Une tête vigoureuse; un front carré, bordé de cheveux bruns, drus et durs. Entre les paupières courbes, légèrement plissées, qui marquent une attention vigilante, luit un regard vif et direct: le coup d'œil pénétrant de son père.
Le bas du visage est encore d'un enfant. La bouche, peu formée, mobile, change à tout instant; le menton au galbe rond, dissimule la lourdeur de la mâchoire.
Une volonté tranquille et tenace, résultat de cette lutte acharnée: quatre ans d'obstination méthodique vers la résurrection, quatre ans d'épouvantes et d'espoirs. La vie pour enjeu!
Mais la bataille est gagnée.
L'ABBÉ.—Eh bien?
JEAN.—Monsieur l'abbé, j'ai beaucoup réfléchi, avant de me décider. Depuis longtemps j'en ai envie, et je remets cette visite... Voilà... (Un temps.) Il y a des questions que je me pose aujourd'hui, qui me troublent... Un tas d'idées qui me viennent à propos de la religion. Surtout depuis que je vais prendre ces répétitions à Beauvais... (Hésitant.) J'aurais besoin qu'on discute avec moi, qu'on m'explique...
L'abbé tourne son regard décidé vers Jean.
L'ABBÉ.—Mais, rien n'est plus simple. Je me mets entièrement à votre disposition, mon enfant. Il y a des sujets qui vous embarrassent? Lesquels?
Le masque de Jean prend une gravité inattendue. Il renverse un peu le front. La tension des muscles fait tomber les coins de la lèvre, qu'ombre un duvet brun. Le regard est fiévreux.
L'ABBÉ (souriant).—Allons...
JEAN.—Monsieur l'abbé, d'abord... Qu'est-ce que c'est au juste que les libres-penseurs?
L'abbé se redresse et répond tout de suite, sans une hésitation, avec un demi-sourire satisfait. Il s'exprime avec une énergie contenue, très particulière, les dents un peu serrées, en insistant longuement sur certains mots qu'il met exagérément en vedette.
L'ABBÉ.—Les libres-penseurs? Ce sont des naïfs le plus souvent qui s'imaginent que nous pouvons penser librement. Penser librement! Mais les fous seuls pensent librement. (Riant.) Est-ce que je suis libre de penser que cinq et cinq font onze? Ou que l'article masculin se met devant le substantif féminin? Voyons? Il y a des règles partout, en grammaire, en mathématiques.—Les libres-penseurs croient pouvoir se passer de règles; mais aucun être vivant ne peut se développer, sans être attaché à quelque point solide! Pour marcher, il faut un sol ferme. Pour penser il faut des principes stables, des vérités contrôlées,—que seule la religion détient.
JEAN (sombre).—Monsieur l'abbé, je crois que j'ai des tendances à devenir libre-penseur...
L'ABBÉ (riant).—Ah, diable! (Affectueux.) Non, mon enfant, n'ayez pas peur: de cela, je réponds... Comment pouvez-vous faire une supposition pareille!
JEAN.—J'ai changé. Autrefois, j'avais une vie religieuse tranquille, jamais je n'aurais eu l'idée de réfléchir, de discuter. Maintenant, ça me prend, je cherche à m'expliquer tout ça, je n'y arrive pas, et alors, j'ai des espèces d'inquiétudes...
L'ABBÉ (très calme).—Mais, mon enfant, c'est tout à fait normal. (Mouvement de Jean.) Vous êtes à l'âge où l'on entre vraiment dans l'existence, où l'on découvre quantité de choses que l'on ignorait. On arrive à la vie d'homme avec sa religion d'enfant; l'une n'est plus en rapport avec l'autre. (Le visage de Jean s'éclaire peu à peu.) Ce n'est rien. Il s'agit de franchir vite ce passage difficile, d'étayer votre foi avec des raisonnements solides, de l'adapter à vos nouveaux besoins. Je vous aiderai.
JEAN (souriant).—Rien que de vous entendre, monsieur l'abbé, ça me fait du bien. (D'un ton plus alerte.) Autre question: un péché, par exemple, un péché habituel, qu'on connaît à fond, qu'on est fermement résolu à ne pas commettre... Bien... On prie, on prend la résolution: on croit pouvoir être rassuré... Et puis, on a beau faire, l'habitude est plus forte que le bon Dieu!
L'ABBÉ.—Mon enfant, c'est pour cela qu'il n'y a rien de plus dangereux pour la foi que le péché fréquent, même véniel. Ce sont ces secousses répétées sur la sensibilité religieuse qu'il faut éviter à tous prix.
JEAN.—Justement, monsieur l'abbé... Mais pourquoi donc est-il possible que je succombe?
L'abbé fait un geste amusé, que Jean, le regard tendu, ne remarque pas.
JEAN.—Je me demande pourquoi toutes ces tentations, pourquoi ces épreuves? Quand on est petit, on trouve tout naturel qu'il y ait des heureux et des malheureux, des bien portants et des malades... C'est comme ça, voilà tout. Mais, en réfléchissant, on est épouvanté de tant de choses, qui sont par trop injustes, par trop mauvaises... Si encore on pouvait affirmer que le malheur, c'est toujours un châtiment mérité!
Il faut bien que Dieu ait eu ses motifs pour créer le monde tel que nous le voyons; mais vraiment...
L'ABBÉ (souriant).—D'abord Dieu n'a pas créé le monde tel qu'il est. C'est l'homme, qui, par sa désobéissance au premier ordre du Créateur, est responsable de ce dont il souffre depuis.
JEAN (tenace).—Mais si Adam avait été parfait, il n'aurait pas pu désobéir... Et puis, à l'origine du monde, Dieu avait bien créé le serpent?
L'abbé, devenu sérieux, avance la main pour couper court. Il enveloppe Jean d'un regard amical, où perce malgré lui la conscience de sa supériorité.
L'ABBÉ.—Vous pensez bien, Jean, que vous n'êtes pas le premier à être frappé par ces contradictions apparentes. C'est l'objection du mal. Elle a été réfutée, depuis longtemps, et de mille manières. Vous avez très bien fait de m'en parler. Puisque cette question vous préoccupe, je vous choisirai sur ce sujet des lectures qui vous tranquilliseront définitivement.
Jean se tait, un peu déçu.
L'ABBÉ.—Je ne voudrais pas toutefois méconnaître ce qu'il y a de bon dans votre indignation: c'est par la vision de la souffrance humaine que nous pouvons fortifier en nous l'instinct de charité, et, dans ce sens, on ne peut aller trop loin. (Lui prenant la main.) Pourtant, vous êtes à l'âge, Jean, où le cœur s'ouvre, tout neuf, plein de tendresse universelle, et où ces découvertes peuvent être si cruelles qu'il est bon d'être quelque peu prévenu. Méfiez-vous, en ces matières, de votre sensibilité: il y a dans le monde beaucoup moins de mal qu'il ne vous paraît au premier abord! Réfléchissez à cela: si la somme des maux était supérieure, ou seulement équivalente à la somme des biens, mais le désordre serait partout! Au contraire, que voyons-nous? Un ordre merveilleux, qui confond notre petitesse! Chaque jour, les nouvelles étapes des pionniers de la science, nous permettent d'approfondir davantage les perfections du plan divin. Qu'est-ce que les peines individuelles des pécheurs, auprès de tant de bonté? Et puis, les blessures humaines,—que je ne nie pas, hélas! puisque mon ministère est de les panser et si possible de les guérir,—ont bien leur prix, vous le reconnaîtrez vous-même un jour, puisque c'est par elles seulement que l'homme peut progresser dans le bien, et entrer plus avant dans la voie de son salut. Or, qu'est-ce qui importe? Est-ce la vie présente, ou l'autre?
JEAN.—Mais, il n'y a pas que l'homme... Et les animaux?
L'ABBÉ.—La souffrance de toute créature est voulue par Dieu, mon enfant, comme une condition, comme la condition même de la vie: et cela doit suffire pour courber votre orgueil qui se révolte. L'existence de l'Etre Parfait, infiniment bon et tout puissant, qui a fait de rien le ciel et la terre, et qui, chaque jour, nous donne mille preuves de ses sentiments paternels pour nous, est notre meilleure garantie de la nécessité du mal en ce monde, qu'il a créé au mieux de nos besoins. Et quand bien même Ses raisons seraient impénétrables à nos facultés imparfaites, nous devrions nous incliner et vouloir avec Lui cette souffrance que nous ne comprenons pas, mais qu'Il a voulue... «Fiat voluntas tua...».
Jean se tait, les sourcils froncés, cherchant à assimiler.
Dans une cellule voisine, des voix grêles accompagnent un harmonium poussif.
L'ABBÉ.—Je vois en vous, Jean, une tendance un peu trop prononcée à la réflexion. (Souriant.) Je ne veux pas rabaisser le mérite des spéculations de l'esprit. Mais, voyez-vous, plus je vais et plus je crois que l'intelligence n'a sa véritable valeur que lorsqu'elle vise un but extérieur à elle, lorsqu'elle cherche à s'appliquer pratiquement. L'intelligence doit vivifier l'action; sans elle l'action est vaine. Mais, sans l'action, comme l'intelligence est stérile! C'est la lumière qui brûle à côté du phare et se consume pour rien. (Avec émotion et recueillement.) Vous venez à moi, mon enfant, en quête d'une direction. Eh bien, je vous pousserai toujours à agir plutôt qu'à philosopher! Cultivez votre intelligence, soit: c'est plus qu'un droit: un devoir. Mais que ce soit en vue d'un résultat humain. Si le Maître vous a confié un petit trésor, des facultés supérieures à la moyenne, faites-les fructifier; mais que la grande famille humaine en profite. Ne soyez pas celui qui a enterré son talent. Enrichissez-vous, mais pour partager. Soyez de ceux qui se donnent.
J'ai été comme vous: j'ai eu mon heure de spéculation théorique... Dieu a permis que je reconnaisse bientôt mon erreur. C'est dans l'action, dans le don de soi, dans l'abnégation et le dévouement, qu'on trouve la vraie récompense, la santé physique et morale, le véritable bonheur. Croyez-moi. Notre bonheur, que l'on va quelquefois chercher si loin, il est tout près de nous, dans quelques sentiments naturels, comme la fraternité: et tout le reste n'est rien!
Venez un de ces soirs à mon patronage. Je vous donnerai les livres dont je vous ai parlé. Et puis (le visage transfiguré d'entrain et de fierté) vous resterez un peu avec nous, vous verrez vite quels cœurs il y a là, et quel plaisir on a à se donner de la peine pour eux. (Se levant.) Allez, Jean! Il n'y a que ça de vrai: sentir qu'on fait un peu de bien autour de soi... (se frappant la poitrine, gaiement) ... qu'on communique un peu de cette chaleur que le bon Dieu nous a mise ... là...!
Le petit salon des Pasquelin.
Pièce au rez-de-chaussée, longue, étroite, encombrée de
meubles démodés.
Cécile, seule. Elle range le désordre que sa mère a laissé en
sortant.
Le jour baisse vite: octobre.
Un pas sur le pavé.
Vivement, elle court à la fenêtre et sourit: Jean traverse la rue, une serviette sous le bras.
Elle bondit gaiement au-devant de lui.
Cécile Pasquelin: seize ans.
Grande et frêle. Pas jolie: de la fraîcheur. Une souplesse élégante du cou et de la nuque. Des épaules étroites, sous une pèlerine de laine blanche.
Une tête petite, en boule; les cheveux bruns, frangés. Des yeux noirs, ronds, un peu saillants; le charme agaçant, à peine perceptible, d'une asymétrie dans le regard. La bouche: deux lèvres charnues, humides, bien rouges, très mobiles sur des dents courtes et luisantes. Sourire gai, superficiel.
Par instants, un léger zézayement.
CÉCILE.—Tu n'es pas en avance! Viens, ton lait doit être froid.
Le goûter de Jean est préparé sur un plateau. Cécile s'assied en face de lui; les yeux brillants, elle le regarde croquer sa tartine.
Ils se dévisagent en riant; pour rien, par plaisir.
JEAN.—Maintenant, au travail!
Il vide sur la table sa serviette de livres.
Cécile allume la lampe, tire les rideaux, met une bûche au au feu, et approche sous l'abat-jour sa chaire basse.
CÉCILE.—Qu'est-ce que c'est, ce soir?
JEAN.—Une préparation grecque.
Le salon est tiède. Le ron-ron de la lampe, le ron-ron du feu. Le rythme de leurs deux souffles. Un froissement d'étoffe, un froissement de feuillet.
Au tournant d'une page, au bout d'une aiguillée, leurs regards se croisent.
JEAN (d'une voix singulière).—Tiens, j'ai trouvé ce matin quelque chose... Dans Eschyle... Il parle d'Hélène, il dit: «Ame sereine comme le calme des mers...» C'est beau, n'est-ce pas? (Il la regarde.) «Ame sereine comme le calme des mers...»
Cécile ne répond pas; elle baisse la tête; elle respire à peine... Dans les parties de cache-cache, quand on voit celui qui vous cherche s'approcher sans vous voir, vous frôler presque, et passer...
Jean s'est remis au travail.
Une demi-heure plus tard.
Un talon de femme martelle le vestibule dallé. Irruption de
Mme Pasquelin.
Mme Pasquelin: petite femme noiraude, au teint jaune, aux
cheveux très noirs et frisés sur le front. De beaux yeux, légèrement
asymétriques, comme ceux de Cécile; le regard caressant
et gai; une bouche souriante, un peu pincée.
A été jolie et s'en souvient.
Preste, remuante, bavarde. La voix aigüe, l'accent rude des Picards. Toujours en mouvement, n'épargnant ni temps, ni peine, tranchant sur tout, surveillant, dirigeant, réformant toutes les œuvres catholiques de la ville.
MADAME PASQUELIN.—Vous êtes sages, mes enfants? (Sans attendre la réponse.) Prends donc un fauteuil, Cécile, je déteste te voir pliée en deux sur cette chaise basse... (Elle va au coffre à bois.) Sans moi, vous laissiez éteindre le feu!
JEAN (voulant l'aider).—Attendez, Marraine.
MADAME PASQUELIN.—Non, tu n'en finirais pas.
En un instant, elle a jeté deux bûches dans le foyer, et baissé la trappe. Elle se relève; tout en parlant, elle dégrafe son mantelet, va à la fenêtre et tire les rideaux.
MADAME PASQUELIN.—Ah, mes enfants, j'ai cru que je ne rentrerais jamais! Je suis morte de fatigue. Rien ne marche, j'ai dû me fâcher toute la journée. Je suis furieuse après l'abbé Joziers. Il a obtenu de M. le Curé que le catéchisme des garçons soit à neuf heures et demie le jeudi! Juste à l'heure où se réunit le conseil de l'ouvroir! C'est ce que j'ai dit à M. le Curé: Je ne peux pourtant pas être en haut et en bas de la ville en même temps!
Jean, veux-tu relever la trappe... Merci.
Et puis, tu sais, il est six heures un quart. Si tu veux communier avec nous demain, tu n'as que le temps de courir te confesser; l'abbé quitte l'église à la demie... (Jean se lève.) Couvre-toi bien, il y a du vent ce soir...
Le lendemain, à la messe de sept heures.
Le moment de la communion.
Mme Pasquelin se lève et s'avance vers l'autel. Cécile et Jean la suivent. Côte à côte, les yeux à terre, ils gagnent, à pas recueillis, la table sainte.
L'abbé Joziers officie. Il élève vers la nef une hostie consacrée.
L'ABBÉ JOZIERS (d'une voix contrite).—Domine, non sum dignus... Domine, non sum dignus... Domine, non sum dignus...
Cécile et Jean sont à genoux. Leurs coudes se touchent. Sous la nappe, leurs mains glacées voisinent.
Une même angoisse, maladive et délicieuse; une même attirance d'infini...
Le prêtre approche. L'un après l'autre ils tendent le front vers le ciel, entr'ouvrent les lèvres et frissonnent.
Puis leurs paupières s'abaissent sur l'intensité de leur joie.
Fusion... Deux âmes, déliées de toute adhérence humaine,
s'élèvent sans effort jusqu'il la dernière cime de l'amour,
s'étreignent subtilement en Dieu.
«Quand j'étais un petit enfant, je raisonnais comme petit enfant; mais quand je suis devenu un homme, je suis dépouillé de ce qui était de l'enfant.»
St Paul, I Cor. XIII. 11.
A Monsieur l'Abbé Joziers,
Presbytère de Buis-la-Dame (Oise).
«Paris, 11 janvier.
«Cher Monsieur l'Abbé,
«Je voudrais mieux répondre à cette confiance que vous avez en moi. Mais, hélas, je ne puis vous donner sur mon moral les bonnes nouvelles que vous attendez. Ce premier trimestre n'a guère été satisfaisant. Je me sens toujours très dépaysé dans ce Paris où tout est nouveau pour moi.
«Cependant mon existence est définitivement organisée maintenant: outre les cours préparatoires à l'École de Médecine, j'ai pris des inscriptions à la Sorbonne, pour la licence ès-sciences naturelles; de sorte que, depuis quelques semaines, je vis davantage encore au quartier latin. (Que ces détails, cher Monsieur l'Abbé, ne vous inquiètent pas; et, à ce propos, les conseils affectueux de votre dernière lettre m'ont infiniment touché. Non, ne craignez rien à ce sujet: j'ai, grâce à Dieu, le cœur assez haut pour triompher des tentations auxquelles vous avez pensé; et puis, vous oubliez le sentiment profond et pur que j'ai emporté de Buis, le projet si cher, qui est toute ma raison de vivre, et ma sauvegarde).
«Ces études de sciences me font un emploi du temps très chargé; mais elles complètent celles de médecine et m'intéressent au delà de ce que je puis vous dire. D'ailleurs que ferais-je de plus de loisirs? Mon père, comme vous le savez peut-être, vient d'être nommé professeur; son cours complique encore une vie très occupée, où je n'ai guère de place.
«Vous serez certainement satisfait de savoir que j'ai fait la connaissance d'un jeune prêtre suisse, nommé Schertz, qui se destine à enseigner l'histoire naturelle dans son pays, et qui est venu prendre ses grades à Paris. C'est un passionné de biologie; nous sommes voisins de laboratoire, et sa collaboration m'est précieuse. Toutes ces études sont extrêmement attachantes; je ne peux pas encore analyser ce que je ressens, mais certains cours me transportent: je crois qu'il est impossible de ne pas éprouver une espèce de vertige, à ces premiers contacts avec la Science, lorsqu'on commence à distinguer, pour la première fois, quelques-unes de ces grandes lois qui ordonnent la complexité universelle!
«Je m'applique, sur vos conseils, à me pénétrer de cet ordre, et à y exalter la certitude de Dieu. Mais votre optimisme communicatif me manque plus que vous ne pouvez croire. Peut-être l'amitié de l'abbé Schertz me sera-t-elle, à ce point de vue, de quelque profit? Sa gaieté naturelle, son entrain au travail, prouvent une foi robuste, dont l'appui peut venir en aide à mon déséquilibre moral.—Je le souhaite, car j'ai traversé, ces dernières semaines, des heures de dépression bien pénibles...
«Excusez-moi de vous attrister une fois de plus à ce sujet, et croyez, cher Monsieur l'Abbé, à mes sentiments de respectueuse sympathie.
Jean Barois.»
Salle à manger du Dr Barois.
La fin du dîner.
LE DOCTEUR (se levant de table).—Vous m'excusez, monsieur Schertz? (L'abbé et Jean se sont levés.) Il faut que je sois à Passy à neuf heures, pour une consultation... Je regrette de ne pas prolonger cette soirée auprès de vous, j'ai été tout à fait heureux de faire votre connaissance.—Allons, bonsoir mon petit. Au plaisir de vous revoir, monsieur Schertz... (Souriant.) Et croyez moi, je tiens beaucoup à mon idée: il faut agir d'abord, et réfléchir ensuite; la jeunesse d'aujourd'hui, elle réfléchit trop, et, n'ayant pas agi, elle réfléchit mal...
La chambre de Jean.
L'abbé est assis dans un fauteuil bas, les jambes croisées, les
coudes sur les bras du siège, les mains jointes sous le menton.
L'abbé Schertz: trente et un ans.
Un corps plat et long, gaîné dans la soutane. De grands bras musclés, aux gestes pleins de mesure.
Une tête osseuse et forte. Un teint blanchâtre. Un front fuyant, qu'exagère le port des cheveux noirs, plantés haut, et rejetés en arrière. Le visage, dénudé par le rasoir, est rendu plus glabre encore par la pauvreté des sourcils. Dans l'ombre, sous l'encorbellement rectiligne des arcades, une paire d'yeux clairs et précis; des prunelles vert-de-gris, entre des cils noirs. Le nez long, rattaché aux maxillaires par deux sillons mobiles. Les lèvres fines et gaies; par instants, blêmes et comme figées.
Gravité aimable, formaliste.
Un parler pesant, rude, un peu nasillard. Des phrases longues, des tournures peu usitées: il paraît traduire en français ce qu'il pense.
Jean, assis sur son bureau, fume en balançant les pieds.
JEAN.—Vous me faites plaisir. J'aime beaucoup mon père... (Souriant.) Croiriez-vous qu'il m'a fait très peur, pendant longtemps?
SCHERTZ.—Est-il possible?
JEAN.—Il m'intimidait. Je ne le connais vraiment que depuis quelques mois, depuis que je vis avec lui... Ah, un métier comme le sien, hausse un homme!
SCHERTZ.—Il n'y a pas seulement l'apport du métier dans une pareille richesse morale! Car, sans cela, tous les médecins...
JEAN.—Évidemment; j'admets qu'il y ait eu, chez mon père, prédisposition naturelle.
Je voulais dire ... qu'il n'a pas l'appui de la religion.
SCHERTZ (subitement intéressé).—Ah?... J'en avais le doute.
JEAN.—Oui. La famille de mon père était d'un milieu catholique très pratiquant, et lui-même a reçu une éducation foncièrement religieuse. Pourtant, depuis longtemps je crois, mon père a cessé de pratiquer.
SCHERTZ.—Et aussi de croire?
JEAN.—Je le suppose. Jamais il ne s'en est expliqué avec moi... Mais il y a un je ne sais quoi qui ne trompe pas... D'ailleurs...
Jean se tait, réfléchit une seconde en fixant l'abbé; puis, sautant de la table, il traverse la pièce à pas incertains, allume une cigarette, et se laisse tomber sur un canapé de cuir, vis-à-vis de l'abbé.
SCHERTZ.—D'ailleurs?
JEAN (après une seconde d'hésitation).—Je voulais dire que la profession de mon père est, en somme, bien dangereuse pour la foi...
Schertz: geste d'étonnement.
JEAN.—A cause de l'hôpital... Songez à l'opinion que peut avoir celui qui, tous les jours de sa vie, du matin jusqu'au soir, n'a pas d'autre fonction que de se pencher sur de la souffrance? Quelle conception peut-il se faire de Dieu?
Schertz ne répond pas.
JEAN.—Je vous scandalise?
SCHERTZ.—En aucune manière. Vous m'intéressez. C'est la vieille objection du mal.
JEAN.—Elle est formidable!
SCHERTZ (flegmatique).—Formidable.
JEAN.—Et, jusqu'à présent, nos théologiens ne l'ont, en somme jamais réfutée...
SCHERTZ.—Jamais.
JEAN.—Vous en convenez?
SCHERTZ (souriant).—Mais comment pourrais-je autrement?
Jean tire quelques bouffées en silence. Puis il jette brusquement sa cigarette et considère l'abbé bien en face.
JEAN.—Vous êtes le premier prêtre à qui je l'entende dire...
SCHERTZ.—Avez-vous distinctement posé la question à quelqu'autre?
JEAN.—Oh, souvent!
SCHERTZ.—Eh bien?
JEAN.—On m'a fait toutes les réponses possibles... Que j'étais trop sensible... Que j'étais un orgueilleux révolté... Que le mal est la condition du bien... Que l'épreuve est nécessaire pour l'amélioration de l'homme... Que, depuis le péché originel, Dieu avait voulu le mal, et qu'il faut le vouloir avec lui...
SCHERTZ (souriant).—Eh bien?
JEAN (haussant les épaules).—Des mots... Des apparences d'arguments...
Schertz: un regard aigu vers Jean; puis son masque change d'expression, s'aggrave. Il évite de relever les yeux.
JEAN.—Au fond des choses, on se heurte à un sophisme: on veut me prouver la puissance et la bonté de Dieu en faisant l'apologie de l'ordre universel; et dès que je veux faire remarquer combien cet ordre est imparfait, on me refuse le droit de porter un jugement sur cet univers, justement parce qu'il est l'œuvre de Dieu... (Quelques pas; il élève la voix.) Si bien que jamais on ne m'a permis de concilier ces deux affirmations: d'une part, que Dieu est la somme de toutes les perfections; et, d'autre part, que ce monde imparfait est son œuvre!
Il s'arrête devant l'abbé et cherche à rencontrer son regard. Mais Schertz détourne la tête. Un silence. Enfin leurs yeux se croisent; ceux de Jean voilés d'une expression anxieuse, qui questionne.
L'abbé ne peut pas se dérober entièrement.
SCHERTZ (sourire mal assuré.).—Ainsi, vous aussi, mon pauvre ami, vous voilà soucieux de ces grands problèmes...
JEAN (avec vivacité).—Qu'y puis-je? Je vous assure que je voudrais bien ne pas en être obsédé comme je le suis!
Il va et vient, les mains aux poches, secouant la tête comme s'il poursuivait intérieurement la discussion. Son visage énergique s'est encore durci: une émotion concentrée plisse le front et donne à la bouche un pli perplexe et têtu.
JEAN.—Tenez, mon cher, vous parliez tout à l'heure de mon père... Il y a une chose qui m'a toujours confusément choqué, même enfant: c'est qu'on puisse, au nom de la religion, condamner un homme comme lui, uniquement parce qu'il ne fait pas ses pâques, et ne met jamais le pied dans une église! Là-bas, à Buis, on le jugeait très sévèrement...
SCHERTZ.—Parce qu'on ne le comprenait pas.
JEAN (interloqué).—Mais vous-même, en tant que prêtre, vous êtes bien obligé de le condamner aussi?
Geste réservé de Schertz.
JEAN (avec passion).—Quant à moi, je m'y suis toujours refusé, d'instinct! Une existence comme celle de mon père, c'est une aspiration ininterrompue vers ce qui est noble et grand. Et on pourrait la flétrir,—et on devrait la flétrir—au nom de Dieu? Non, non... Des vies comme la sienne, vous savez, c'est autre chose, c'est au-dessus... (Il fait quelques pas et regarde l'abbé avec angoisse. Sur un ton morne). Et puis, le terrible, mon cher, c'est quand on réfléchit posément à ceci: Un homme comme mon père ne croit pas... Des hommes comme lui ne croyent pas... Ce ne sont pas des sauvages, pourtant? Ils ont connu notre religion, ils l'ont même pratiquée, avec ferveur. Pourtant, un jour, délibérément, ils l'ont rejetée!... Hein? On se dit: «Je crois, et eux, ils ne croyent pas... Lequel a raison?» Et malgré soi, on ajoute: «C'est à voir...» De ce jour-là, on a perdu le repos! «C'est à voir...», voilà le seuil maudit, voilà la formule liminaire de l'athéisme!
SCHERTZ (gravement).—Ah, pardon... Vous abordez là un malentendu capital! De tels hommes n'acceptent pas le culte actuel de l'Église... Mais soyez certain que la force qui les fait grands est de même nature, exactement, que celle du meilleur prêtre, du meilleur!
JEAN.—Il y a donc deux façons d'être chrétiens?
SCHERTZ (poussé plus loin qu'il ne voudrait).—Cela est possible.
JEAN.—Cependant, au fond, il ne peut, il ne doit y en avoir qu'une!
SCHERTZ.—Sans doute... Mais à travers les divergences, qui sont plus apparentes que réelles, c'est toujours la même chose, le même élan de la conscience vers la bonté et la justice infinies...
Jean l'examine avec attention, en silence.
Longue pause.
SCHERTZ (gêné).—Tenez, l'odeur de votre tabac me tente: je vais faire une sortie à mon régime... Merci...
(Voulant à tout prix dévier l'entretien.) Je vous ai apporté le cours préparatoire que vous m'avez demandé...
Jean prend les cahiers, et les feuillette d'un air distrait.
Quelques jours après.
Pension de famille, place Saint-Sulpice.
La chambre de l'abbé.
SCHERTZ (se levant promptement).—Ach! une bonne visite!...
JEAN.—Je viens bavarder avec vous jusqu'à l'heure du cours.
L'abbé débarrasse le fauteuil.
Jean fait en souriant le tour de la chambre:
Un petit bureau: une grande table à expériences; un arsenal de flacons, de porcelaines; un microscope. Sur les murs, un christ, une vue panoramique de Berne, un portrait de Pasteur, des planches anatomiques.
JEAN (riant).—Je me demande comment vous pouvez vivre dans cette atmosphère!
SCHERTZ.—C'est mon acide sulfurique...
JEAN.—Non, je parle au figuré. Je me demande souvent comment un prêtre peut vivre dans cette atmosphère scientifique.
SCHERTZ (s'approchant de lui).—Mais pourquoi donc?
JEAN.—Parce que moi,—qui ne suis pas prêtre, pourtant,—j'y respire difficilement ... et mal.
Sous le sourire, une souffrance contenue.
JEAN (s'asseyant).—Ah, j'aurais besoin, un jour, de causer longuement avec vous de vider mon sac...
SCHERTZ (rêveur).—Oui...
Son regard fait le tour de la pièce, se pose sur celui de Jean, et s'y enfonce brusquement. Puis il hésite, baisse les yeux, et réfléchit intensément quelques secondes.
SCHERTZ.—Vous le voulez?
Ils se regardent en silence, émus tous deux. Ils pressentent une de ces heures d'épanchement total, où deux âmes de jeunes hommes, préparées par l'amitié, s'étreignent spontanément et se pénètrent.
SCHERTZ (avec douceur).—Qu'y a-t-il donc?
JEAN (s'abandonnant).—Il y a que je suis dans un fichu état moral...
SCHERTZ.—Moral?
JEAN.—Religieux, plutôt.
SCHERTZ.—Depuis quand?
JEAN.—Ah, depuis longtemps, plus longtemps que je ne croyais! Il doit y avoir des années déjà, que, sans m'en rendre compte, je suis obligé de me débattre pour conserver la foi.
SCHERTZ (vivement).—Non pas la foi! Mais cette foi réceptive des enfants: ce n'est pas la même chose!
JEAN (tout à sa pensée).—Je ne m'en suis aperçu vraiment que depuis quelques mois. Paris, peut-être... L'ambiance de Paris! L'ambiance surtout de cette Sorbonne! Ces cours où l'on analyse toutes les grandes lois universelles, sans jamais prononcer le nom de Dieu...
SCHERTZ.—On ne le nomme pas, mais on parle de lui sans cesse.
JEAN (amèrement).—J'avais l'habitude d'en parler plus nettement.
SCHERTZ (avec un sourire encourageant).—Il faut seulement s'entendre. (Hésitant.) Je pourrais peut-être vous aider, cher ami; mais je suis retenu par le peu que je sais de votre vie religieuse... Où en êtes-vous réellement?
JEAN (découragé).—Je n'en sais rien moi-même. Mais ça ne va plus, plus du tout...
L'abbé s'est assis, les jambes croisées, le buste penché en avant, le menton sur ses doigts entrelacés.
JEAN.—Je suis partagé entre des tendances qui se contredisent. Un déséquilibre atroce, d'autant plus douloureux que j'ai connu le calme, la foi sereine, le bon feu intérieur... Je vous jure que je n'ai rien fait pour en arriver là: au contraire. Longtemps j'ai refusé à ma raison le droit de s'attacher à ces questions. Mais maintenant je ne peux plus. Les objections s'amoncellent autour de moi; presque chaque jour j'en rencontre une nouvelle! J'ai bien dû m'apercevoir, bon gré, mal gré, qu'il n'y a pas un seul point de la doctrine catholique qui ne soulève aujourd'hui d'innombrables contradictions... (Tirant de sa poche un fascicule de revue.) Tenez, connaissez-vous ça? Un article de Brunois: «Les rapports de la raison et de la foi» (Geste négatif de Schertz.) Ça m'est tombé sous les yeux, par hasard, il n'y a pas bien longtemps. Je n'avais jusque-là aucune idée de ce que pouvait être l'exégèse moderne, je ne soupçonnais pas ce qu'étaient les attaques de la critique historique... Quelle révélation!
C'est là-dedans que j'ai appris, pour la première fois des choses comme ceci: Que les Évangiles ont été rédigés entre les années 65 et 100 après Jésus-Christ, et que, par conséquent, l'Église s'est fondée, a existé, pourrait exister sans eux... Plus de soixante ans après le Christ! Comme si, de nos jours, sans un seul document écrit, à l'aide de souvenirs et de vagues témoignages, on voulait consigner les actes et les paroles de Napoléon... Et voilà le livre fondamental, dont l'exactitude ne doit être mise en doute par aucun catholique!
(Tournant des pages.) Que Jésus ne s'est jamais cru Dieu, ni prophète, ni fondateur de religion, si ce n'est à la fin de sa vie, grisé par la crédulité de ses disciples...
Qu'on a été très long à édifier et à préciser le dogme de la Trinité, et qu'il a fallu plusieurs réunions de conciles pour fixer la double nature du Christ, faire la part de son humanité et de sa divinité... Bref: qu'il a fallu des années de controverses pour constituer ce dogme et le rattacher avec quelque vraisemblance aux paroles prononcées par Jésus; alors qu'au catéchisme, on nous l'enseigne, ce dogme de la Trinité, dès les premières leçons, comme une vérité élémentaire, toute simple, révélée par Jésus lui-même, et si claire, qu'elle n'a jamais été contredite par personne!
(D'autres pages.) Et ça! L'Immaculée conception... Une invention presque récente! Qui n'a pris naissance qu'au XIIe siècle, dans le cerveau mystique de deux moines anglais! Qui n'a été discutée et formulée qu'au XIIIe! Dont l'unique point de départ est la faute grossière de je ne sais quel traducteur grec, lequel s'est servi à tort du mot grec παρθένος jeune fille, pour traduire l'ancien mot hébreux, qui qualifiait naturellement Marie de jeune femme...
Vous souriez? Vous saviez tout ça? (Déçu.) Alors vous ne pouvez pas bien comprendre ce que j'ai pu éprouver à de pareilles lectures... Notez que je ne sais même pas encore si c'est exact. (Schertz fait signe que oui.) Mais que cela puisse être imprimé, tout au long, avec la signature d'un savant aussi sérieux, aussi circonspect que Brunois, c'est inouï! Le ton de l'article, surtout, est déroutant: ces objections sont rappelées là incidemment, pour appuyer la thèse, sans même être discutées, comme autant de vérités acquises aujourd'hui, comme autant de points d'histoire définitivement élucidés! Simplement, un renvoi, pour indiquer où les ignorants comme moi peuvent trouver la démonstration raisonnée de chacune de ces affirmations! Et je vous cite cet article parce que je viens de le lire. Mais de tous les côtés, dans tous les domaines, je me heurte à des réfutations!
Tout le savoir moderne est donc en contradiction absolue avec notre foi?
SCHERTZ (affectueusement).—Je vous croyais en relation avec un abbé de Buis, un prêtre instruit...
JEAN.—Bah... C'est un homme actif, un saint, qui n'a jamais eu un doute sérieux, et qui d'ailleurs, si cela lui arrivait, en triompherait tout de suite, par l'action. (Sourire rancunier.) Il m'a prêté des bouquins de théologie...
SCHERTZ.—Eh bien?
JEAN (levant les épaules).—J'y ai trouvé des arguments spécieux et verbeux, présentés comme s'ils étaient inattaquables, mais que la moindre réflexion crève comme des outres gonflées. Ça ne peut convaincre que des convaincus. Je vous scandalise?
SCHERTZ.—Mais non, aucunement. Je vous comprends très bien.
JEAN.—Vrai?
SCHERTZ.—Mieux que vous ne pouvez croire...
Jean ébauche un geste étonné que Schertz arrête de la main.
SCHERTZ.—Continuez, voulez-vous?
JEAN.—Mais voilà... C'est tout... Chaque fois que je veux raisonner, avec l'espoir de consolider ma foi, ou simplement chaque fois que je cherche à analyser mon inquiétude, je sens que je porte un nouveau coup à mes croyances... C'est en cherchant à prouver sa foi qu'on l'ébranle: j'en ai fait l'expérience. J'ai beau faire: ça croule...
SCHERTZ (vivement).—Non, non.
JEAN.—Ah, je vous assure que je ferai tout pour éviter ça! (Avec abandon et angoisse.) Il existe peut-être des gens qui peuvent se passer de religion? Moi pas. J'en ai besoin, besoin, comme de manger ou de dormir. Sans religion je serais, je ne sais pas, comme un arbre dont les racines n'auraient plus de sol, plus de nutrition possible! Tout s'en irait d'un seul coup... Ah, c'est terrible, mon cher; je me sens catholique jusqu'au fond des moelles! Je m'en aperçois mieux encore depuis que j'ai tant à lutter: tout ce que je pense, tout ce que je veux, tout ce que je fais, est déterminé en moi par un sens catholique qui fait partie de ma nature; et s'il m'arrivait de perdre ce sens-là, ma vie entière reposerait pour toujours sur une absurde contradiction!
SCHERTZ.—Mais enfin, cette crise morale a des intermittences? Il y a des jours encore où vous pouvez vous rapprocher de Dieu?
JEAN (perplexe).—Je ne sais pas comment vous dire... Au fond, je n'ai pas vraiment l'impression que je m'écarte de Dieu ... même quand je doute de lui... (Souriant.) Je ne peux pas vous expliquer...
L'abbé fait signe qu'il comprend très bien.
JEAN (après avoir réfléchi).—En somme, le problème angoissant est celui-ci: Tout se tient dans la religion catholique: la foi, le dogme, la morale, l'émotion intérieure de la prière; tout se tient... (Schertz fait un geste de dénégation que Jean ne remarque pas...) Et si on en rejette une fraction, on perd l'ensemble!
L'abbé se lève, et fait quelques pas, les mains derrière le dos.
SCHERTZ.—Ach! mon ami, comme nous vivons une heure tragique de la vie religieuse des hommes!
Il s'arrête devant Jean et le considère, gravement.
SCHERTZ (d'une voix mesurée).—Voyons, pour résumer: d'une part, votre raison, qui se blesse à des points de dogme et qui refuse de les accepter; et, d'autre part, votre sensibilité religieuse, vivace, très vivace, qui a goûté Dieu, si je puis dire, et qui ne peut plus s'en passer?
JEAN.—Exactement. Sans compter une crainte instinctive, qui a ses racines dans mon enfance et dans mon atavisme, sans doute: la terreur de perdre la foi.
SCHERTZ.—Oui. Eh bien, mais c'est à peu près ce que j'ai éprouvé moi-même!
JEAN.—Ah? Quand?
SCHERZ.—Lorsque j'ai quitté le séminaire.
JEAN (impatiemment).—Et ... maintenant?
SCHERTZ (montrant sa soutane et souriant).—Vous voyez...
Il repousse de la main l'interrogation de Jean.
SCHERTZ (posément).—Voulez-vous me laisser citer mon propre exemple?
Jean lui adresse un sourire reconnaissant.
L'abbé se carre dans son fauteuil, le visage sur ses mains croisées, les paupières plissées, le regard lointain.
SCHERTZ.—Jusqu'à l'ordination, je n'avais pas beaucoup étudié les sciences, mais j'étais très attiré, depuis longtemps; et j'ai commencé à étudier, aussitôt prêtre. Je me rends bien compte, à distance, de ce qui s'est passé; et cela arrive à beaucoup. (Avec respect.) C'est la discipline scientifique! On la découvre tout à coup; on s'y soumet passionnément; elle prend possession de vous; elle vous forge un cerveau neuf. Et puis, plus tard, un jour, quand on se tourne vers le passé, tout est changé: les choses autrefois habituelles, on les regarde, et c'est comme si on les voyait pour la première fois: on les juge... Et, de ce jour-là, c'est fini, on ne peut plus ne pas juger! Pas vrai?... Voilà la discipline scientifique!
JEAN.—Oui: on ne peut plus s'empêcher de voir...
SCHERTZ (souriant).—Moi, je ne savais pas, j'ai cru que je pouvais retourner en arrière. J'ai fermé tous les livres, et je suis parti pour le monastère de Brügen. (Hésitant.) Une...
JEAN.—Une retraite?
SCHERTZ.—Une retraite. Cinq mois, pendant le plein hiver... D'abord j'ai tenté une consultation des Pères; beaucoup étaient instruits. Mais ils affirmaient, et moi je raisonnais; c'était toujours le même malentendu... Ils riaient à la fin, et disaient toujours: «Rien d'impossible pour Dieu.» Alors, quoi répondre?
L'un m'a dit, un jour: «Ce qui m'étonne, c'est qu'avec de pareilles pensées, vous n'ayez pas perdu la foi...» Ah, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. C'était vrai: ma foi n'était pas diminuée. Comme vous le disiez tout à l'heure pour vous. J'avais la conviction intérieure,—pour ainsi dire une certitude—que rien n'était modifié. Impossible d'éprouver un remords. Je me sentais soumis à quelque chose qui était plus fort que ma volonté, et, en même temps, très élevé, et si respectable...
Alors, que faire? J'ai cherché à transiger.
JEAN (secouant la tête).—Une voie dangereuse...
SCHERTZ.—J'étais bien obligé de reconnaître, devant les arguments scientifiques si nets, que la lutte était inutile. Et ne pas faire, comme certains prêtres savants, des demi-concessions, insuffisantes. Non: reculer courageusement, fier d'être sincère, et avec l'assentiment de Dieu au fond de la conscience.
(Un temps.)
Ainsi, j'ai quitté Bürgen, et je suis rentré à Berne, et je me suis appliqué à approfondir avec les livres et la réflexion, toutes ces questions.
(Gaiement.) Ach! mon ami, quand on regarde, quelle inégalité vraiment des deux camps en présence! D'un côté, les adversaires de l'Église,—je parle seulement des vrais savants, ayant fait œuvre.—Et de l'autre, nos apologistes du catholicisme, qui se lamentent et brandissent de vieux arguments tout gâtés, et finalement menacent d'anathème! A qui, malgré soi, va la confiance? L'attitude de Rome est véritablement incompréhensible; il faut l'étudier de près pour s'en convaincre! Elle attaque la science moderne en ignorant tout des faits actuels. Elle ignore jusqu'à la plus élémentaire méthode: impossible de discuter. Pour cela même, voulant soutenir trop, elle rend sa thèse entière insoutenable. J'ai eu besoin de deux années pour acquérir cette conviction, mais je ne regrette pas: grâce à ces années de travail, j'ai reconquis pour toujours la paix intérieure.
JEAN.—La paix intérieure...
L'abbé se penche en avant, comme pour demander à Jean toute son attention.
SCHERTZ.—Mon ami, je suis parvenu à cette distinction capitale:
Il y a dans le sentiment religieux deux éléments tout à fait séparés par leur nature. Premièrement: le sentiment religieux dans sa pureté, qui est, si je puis dire, l'alliance conclue avec le divin, et, en même temps les rapports intimes et privés qui s'établissent entre Dieu et les âmes religieuses. Bien.—Secondement: l'élément, je dirai dogmatique, les affirmations théoriques sur Dieu, et les rapports,—non plus intimes, mais cultuels—entre l'homme et Dieu. Comprenez-vous cela?
JEAN.—Oui.
SCHERTZ.—Eh bien, pour la sensibilité religieuse d'aujourd'hui, un seul de ces éléments est fondamental: c'est le premier, l'alliance personnelle avec Dieu.
JEAN.—Comment pouvez-vous dire: la sensibilité d'aujourd'hui? La religion n'est pas soumise à la mode!
SCHERTZ.—Ach, ceci est une parenthèse. La religion est soumise sinon à la mode, du moins au développement moral de l'humanité. Tenez: au moyen âge, est-ce qu'on ne puisait pas de grandes forces, simplement dans le sens littéral des dogmes? Aujourd'hui non; c'est un fait. Regardez les catholiques, ceux qui ont vraiment une vie intérieure: beaucoup d'entre eux ont de capitales ignorances, au sujet de la religion théorique; sans qu'ils s'en doutent, le dogme est chez eux au deuxième plan; et cela n'importe pas.
Reprenons. Je dis: pour vous, pour moi, pour un grand nombre de nos contemporains, le premier élément, la foi personnelle, est intacte. C'est la croyance dogmatique qui a perdu l'équilibre. Nous n'y pouvons rien: la religion romaine, telle qu'elle est fixée actuellement, est inacceptable pour beaucoup d'esprits ayant de la culture, et pour tous les esprits ayant des connaissances approfondies. Le Dieu qu'ils nous offrent est trop petitement humain: aujourd'hui, la croyance en un Dieu personnel, en un Dieu monarque, en un Dieu fabriquant l'univers, la croyance au péché et à l'enfer... Ach, non! Cette religion-là n'est plus à notre mesure! Elle ne contente plus, comment dire, notre soif de perfection.
Les croyances humaines sont obéissantes à l'évolution, comme toutes choses; elles marchent, allant du moins bien vers le mieux. Eh bien, la religion doit, de toute nécessité, être adaptée à l'intelligence actuelle. Rome est fautive de résister à cette adaptation.
JEAN (vivement).—Mais en condamnant, comme vous le faites, l'Église contemporaine, est-ce que c'est réellement vous qui avez raison?... N'est-ce pas, simplement, que vous êtes...
SCHERTZ (l'interrompant).—Comprenez bien ceci: dans les croyances des hommes, même en supposant que l'origine en soit divine, il y a forcément un élément humain. On commence seulement à en tenir compte. Ainsi, les orthodoxes avouent seulement depuis peu, que certains récits de la Bible et des Évangiles sont des histoires figurées. Je donnerai des exemples: Jésus descendant vers les régions inférieures de la terre... Ou bien Jésus emporté par Satan sur la montagne... Aucun théologien sérieux n'ose plus affirmer: «Oui, cette descente a eu lieu, matériellement... Oui, cette montagne a existé, matériellement.» Ils avouent aujourd'hui: «C'est figurativement.»
Eh bien, cette manière d'appeler honnêtement symbole ce qui est manifestement symbolique, voilà ce qui est bon pour des gens comme vous ou moi. Mais il faut l'appliquer, non pas comme les orthodoxes, qui le font de mauvais gré et seulement pour les légendes vraiment grossières; il faut l'appliquer à tous les faits affirmés par la religion, dès que ces faits sont inacceptables à la raison moderne. Ainsi vous avez la solution de toutes les difficultés.
Long silence.
Jean réfléchit, sans détacher les yeux du visage énergique de
l'abbé.
SCHERTZ.—D'ailleurs, il faut être bien persuadé, mon cher ami, qu'avant peu d'années, tous les théologiens instruits en arriveront là; et ils seront surpris que les catholiques du XIXe siècle aient pu si longtemps accepter le sens littéral de tous ces récits poétiques. Ils diront: «Ce sont des visions des histoires pleines de signification, mais idéales; les évangélistes les ont accueillies sans critique, ainsi que pouvaient faire des gens anciens, dénués d'instruction, et crédules.»
JEAN.—Mais un fait est un fait. Les dogmes sont vrais, ou bien ils ne sont rien.
SCHERTZ.—Ach! Le vrai et le réel, c'est deux!... L'objection que vous faites est fréquente. Mais vous dites: vérité; et vous pensez: authenticité. Ce n'est pas la même chose. Il faut s'attacher à voir la vérité, non pas dans le fait lui-même, mais dans la signification morale de ce fait... On peut accepter le sens fondamental que renferme le mystère de l'Incarnation, ou celui de la Résurrection, sans, pour cela, admettre que ce soient des événements authentiques, historiquement exacts, comme la capitulation de Sedan ou la proclamation de la République!
L'abbé se lève, tourne autour de la table et vient se camper devant le siège où Jean reste songeur.
L'abbé est ému. La gravité formaliste de son visage a disparu, laissant paraître l'intensité d'une flamme intérieure que Jean ne soupçonnait pas.
SCHERTZ (montrant, d'un grand geste, son crucifix).—Quand je suis agenouillé là, devant cette croix, et que je sens monter, du plus profond de moi, comme une vague, cet amour pour Jésus, et que ma bouche prononce: «Mon Sauveur!» Ach, ce n'est pas je vous assure, parce que je pense au dogme mystique de la Rédemption, à la façon d'un enfant du catéchisme!... Non... Mais je considère immensément, ce que Jésus a fait pour l'humanité: tout ce qui est vraiment bon dans l'homme d'aujourd'hui, tout ce qui promet de s'épanouir dans l'homme de demain, vient de lui! Et alors, je me penche, en toute raison satisfaite, devant notre sauveur, devant celui qui est le symbole du sacrifice et du désintéressement; devant la Douleur acceptée, qui rend l'homme pur!
Et quand je fais le matin, sur l'autel, ma communion de chaque jour, qui renouvelle ma force et m'élève le cœur pour la journée entière, mon sentiment est si intense que c'est bien exactement pour moi comme la Présence réelle de Dieu! Pourtant l'Eucharistie, ce n'est qu'un symbole, le symbole de l'action sensible et continue de Dieu sur mon âme; mais mon âme l'appelle, cette action, et la recherche, presqu'avidement!
Jean réfléchit. L'exaltation de l'abbé augmente, par opposition, son calme et son besoin de contradiction.
JEAN.—Je veux bien. Cependant un simple catholique, qui croit fermement aux faits matériels de l'incarnation ou de l'Eucharistie, met dans ses prières et dans ses communions bien plus que vous ne pourrez jamais y mettre, avec vos restrictions!
SCHERTZ (vivement).—Non! L'essentiel, c'est de dégager la vérité dans la mesure où elle peut être bonne à chacun de nous.
Mettons-nous sur le terrain pratique: notre raison ne peut pas accepter le dogme, c'est un fait; au contraire, le symbole que nous en dégageons est clair, satisfait notre raison, et contribue à notre amélioration. Alors, comment hésiter?
JEAN.—Est-ce que ce n'est pas amoindrir la doctrine que de la dépouiller de ses formes traditionnelles? Le christianisme a toujours été, et reste une doctrine. «Allez et enseignez toutes les nations...» C'est l'acceptation intégrale de cette doctrine qui fait le chrétien.
SCHERTZ.—Mais c'est justement pour maintenir intégralement la doctrine, qu'il faut aujourd'hui en modifier la forme! L'histoire enseigne que les dogmes, pendant des siècles, ont pu se transformer, s'accroître, être soumis à l'évolution générale: vivre, en somme. Pourquoi maintenant les laisser immobiles dans la tradition, comme des momies? Puisque nous constatons que la religion actuelle n'est plus conforme aux besoins des consciences contemporaines, pourquoi n'aurions-nous pas le droit, à notre tour, d'ajouter quelque chose au travail des théologiens devanciers?
Quatre heures sonnent à Saint-Sulpice.
L'abbé se lève et touche l'épaule de Jean, qui regarde dans le vague.
SCHERTZ.—Nous recauserons de tout ça.
JEAN (comme au sortir d'un rêve).—Ah, je ne sais plus, moi... J'ai été si longtemps habitué à donner une valeur absolue aux formes traditionnelles... Il y a, dans la religion ainsi comprise, un manque d'unité qui me choque!
SCHERTZ (agrafant sa cape).—L'inégalité est partout. Pourquoi les hommes, tous si différents les uns des autres, n'auraient-ils pas des formules variables pour adorer le même Dieu?
(Souriant.) Il faut partir.
Laissez déposer, mon ami... Et rappelez-vous l'aveu de Saint Paul: «Nous ne voyons maintenant qu'au travers d'un miroir, en énigme...» «Videmus nunc per speculum, in œnigmate...»
Ils descendent dans la rue.
Plusieurs minutes de silence, côte à côte.
JEAN (brusquement).—Il faut être logique: pourquoi continuez-vous à pratiquer, s'il est avéré que ces pratiques n'ont qu'une importance figurative?
Schertz s'arrête net, sort le menton hors de son collet, et regarde Jean comme pour savoir s'il plaisante ou non. Son visage prend aussitôt une expression de souffrance.
SCHERTZ.—Ach, vous ne m'avez donc pas compris?
Il se recueille pendant quelques secondes.
SCHERTZ (pesant ses termes).—Parce qu'il serait insensé de renoncer à cette fontaine d'eau vive qu'est une religion pratiquée!... Il faut se comporter avec la religion comme si elle était vraie dans tous ses détails, parce qu'elle est vraie ... en profondeur. Voyez, par exemple, notre prière catholique: où trouver semblable élan?
JEAN.—Vous n'avez plus besoin de formules!
SCHERTZ.—Ne le croyez pas! C'est par les formules que le divin pénètre dans notre vie. Il faut que nous acceptions tous, indistinctement, les formes du culte; mais que chacun, selon l'état de sa conscience, en fasse l'interprétation appropriée, et s'en serve selon ses besoins.
JEAN.—Alors, autant passer au protestantisme...
SCHERTZ.—Que non! Voyez cette religion individualiste et finalement anarchiste qu'est le protestantisme: là n'est pas réellement notre nature. Tandis que la forme du catholicisme, organisée, sociale...—que dire?—communautaire... Voilà la nature humaine!
JEAN.—Alors la libre-pensée toute pure!
SCHERTZ.—Non, mon ami. Nous, catholiques, nous n'aurons jamais le droit de faire cette rupture.
JEAN.—Le droit?
SCHERTZ (gravement).—Nous n'avons pas le droit de nous isoler des autres. Comment la religion a-t-elle acquis peu à peu ses indiscutables vertus sociales? Par les efforts de tous. Eh bien, rester à l'écart, c'est agir comme un individualiste.
JEAN.—Mais votre attitude est bien celle d'un individualiste!
SCHERTZ (sursautant).—Pas du tout! Choisir ses symboles, selon son développement personnel: oui; mais en se rappelant toujours que ce qui est symbole pour nous, a son équivalent dans les formules plus populaires. C'est ainsi qu'on reste lié à toutes les autres. Voilà le bon individualisme...
Jean ne répond pas.
SCHERTZ.—Mon ami, songez dont à ce qu'elle est, cette religion! Songez que pour tant d'êtres humains, elle est la seule fenêtre ouverte sur la vie spirituelle! Combien sont-ils, ceux qui jamais ne pourront aller plus loin que l'image? Et vous voudriez commettre la mauvaise action de vous séparer d'eux? Mais dans chaque sentiment religieux, il y a un germe qui est le même: comme un gémissement, comme un élan plus ou moins vigoureux de l'âme vers l'infini... Nous sommes tous semblables devant Dieu!
... Faites comme moi. Je n'ignore pas quels inconvénients il y a dans la religion actuelle: mais je n'y regarde pas. «Ora patrem tuum in abscondito...» Je pense que toutes les organisations des hommes ont des imperfections. Je pense que le catholicisme est, pour la majorité, très supérieur aux autres confessions, parce qu'il est vraiment, dans toute la valeur du terme, une association. Et j'accepte les pratiques, d'abord parce que j'y puise moi-même des forces que je ne trouverais nulle part, et puis parce que, sans elles, le catholicisme cesserait d'être cette solidarité religieuse, dont tant d'âmes ont le besoin...
L'abbé se tait.
Ils viennent de pénétrer dans les galeries de la Sorbonne,
encombrées d'étudiants.
Jean cherche à mettre un peu d'ordre dans ses idées:
—«Ce qu'il y a de certain, oui, c'est qu'il faut chercher... Jusqu'ici j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me refuser à penser; je croyais qu'il n'y avait rien à gagner par la réflexion... C'est une erreur: on ne peut pas retourner en arrière, revenir aux sentiments religieux de son enfance... C'est impossible, voilà un fait acquis... Tâchons au contraire d'aller de l'avant: il y a un moyen de reconstruire, puisque Schertz...
«Mais je me suit aperçu que je ne connais pas le premier mot de tout ça... C'est le grand point, savoir... Il faut que je travaille ça... Les dogmes... Je n'en ai retenu que le côté extérieur, cultuel. L'abbé parle toujours du fond, du fond qui est sous la forme... La forme, jusqu'ici m'a caché le fond... Approfondir, d'abord... Approfondir jusqu'au point où le sens du dogme et les exigences de la raison sont conciliables: voilà...
«C'est la seule chance d'équilibre qui me reste...
«A Monsieur l'abbé Schertz, Professeur de Chimie Biologique,
«Institut Catholique, Berne (Suisse).
«Paris, lundi de Pâques.
«Mon cher ami,
«Je vous remercie de l'affectueux intérêt que vous prenez à la santé de mon père. Il va mieux. Il a dû renoncer à ses jours de consultation et à son cours; il n'a gardé que ses matinées à l'hôpital. C'est encore beaucoup pour son état. Néanmoins ses confrères estiment qu'avec une surveillance attentive, une rechute n'est pas à craindre avant plusieurs années.
«Je suis bien en retard avec vous; ne m'en gardez pas rigueur; je suis tellement occupé cet hiver! Vos lettres me font toujours le même plaisir; elles me rappellent nos bonnes soirées d'il y a deux ans, nos discussions, nos lectures à haute voix! Hélas, cher ami, tout cela me paraît si loin... Non que j'aie perdu le bienfait de votre influence: rassurez-vous, je crois que vous m'avez pour toujours apaisé, et que je vous dois, pour la vie entière, une foi compréhensive et calme, robuste en son fond, conciliante en sa forme, le vrai soutien de tous les jours. Mais l'engrenage de ces études médicales est impitoyable: il m'est impossible d'ouvrir un livre qui ne soit pas technique!
«J'en ai d'autant moins le temps, que j'ai tenu à ne pas interrompre mes sciences naturelles; ces études m'ont toujours passionné, infiniment plus que celles de médecine, et je ne veux pas me contenter de ce brevet élémentaire qu'est la licence. Mon patron me pousse beaucoup à concourir pour l'internat dès l'an prochain. Je préférerais consacrer tout mon effort à l'agrégation. La médecine est un chemin tout tracé pour moi; le professorat de sciences naturelles, qui répond plus complètement à mes goûts, est une carrière assez aléatoire. Je ne sais que résoudre. Je ne suis pas seul en cause, vous le savez, et ma décision engage une autre vie que la mienne... Ces perplexités, que je ne puis confier à personne assombrissent souvent mon horizon.
«J'ai été bien heureux de vous savoir définitivement occupé selon vos désirs. Je regrette seulement que vos congés soient si rares: quand nous reverrons-nous, maintenant? En y pensant, je me défends mal d'un regret égoïste: je songe à tout ce que votre amitié représentait pour moi, et que je n'ai pas remplacé.
«Au revoir, cher grand ami. Envoyez-moi une bonne et longue réponse, et ne doutez pas de mon fidèle attachement.
Jean Barois.»
Une fin d'après-midi, en mai.
Jean rentre chez lui, dans le petit appartement qu'il habite
depuis que son père a quitté Paris.
Sous la porte, une lettre de Mme Pasquelin:
«Buis-la-Dame, dimanche, 15 mai.
«Mon cher Jean,
«Je ne sais pas quelles nouvelles ton père te donne de sa santé, mais j'en suis assez préoccupée, je ne trouve pas qu'il aille bien...»
Jean courbe les épaules. Cette lettre, il voudrait maintenant ne pas l'avoir ouverte.
«Depuis le printemps, surtout depuis la petite crise du mois dernier, nous le trouvons bien changé. Il a encore maigri. L'entrain qu'il avait montré tout l'hiver est tombé. Il ne suit plus sérieusement son régime; il dit qu'il est fini, qu'il ne guérira pas. C'est navrant de voir un homme qui a été si actif, inoccupé tout le jour, et seul avec son domestique, dans cette grande maison pleine de souvenirs. Nous voulions l'installer ici, il aurait profité du jardin; mais il veut rester chez lui.
«Mon cher enfant, tout cela est bien triste. Je veux te parler franchement...»
Ses mains se mettent à trembler, ses yeux se brouillent.
«... Je crois bien qu'il faut dès maintenant prévoir le cas où ton père ne se relèverait pas, et c'est pourquoi je t'écris.
«Je sais combien vous avez tous souffert, dans la famille, de la froideur de ses sentiments religieux; et j'estime que c'est un devoir pour nous, ses plus vieux amis, ses plus proches voisins, de nous préoccuper de ce lamentable état de choses. Aussi depuis que ton père est auprès de nous, je m'efforce à chaque occasion d'amener la conversation sur ce grand sujet. Mais il faudrait que tu joignes tes efforts aux nôtres, en abordant avec précaution la question religieuse dans tes lettres.»
Son bras retombe avec lassitude. Une sourde animosité.
Il passe une page. Ses yeux tombent sur: «Cécile va bien...»
—«Cécile...»
Un regard vers la cheminée, où il avait mis sa photographie. Elle n'y est plus...
—«C'est vrai, je l'ai cachée depuis qu'Huguette vient ici... Huguette!... Six heures, elle ne va pas tarder à venir...»
Un malaise poignant: Cécile et Huguette confondues dans sa pensée; les deux noms ensemble sur ses lèvres...
Il passe nerveusement la main sur son front:
—«Ça ne peut pas durer...» Et, tout à coup, le sentiment très net que c'est déjà fini: ça ne pouvait durer que parce qu'il n'y réfléchissait pas vraiment...
«... Cécile va bien, elle a un peu grandi ces derniers temps, ce qui l'a fatiguée. Elle va plusieurs fois par semaine avec son ouvrage passer l'après-midi auprès de ton père. Elle s'emploie de son mieux pendant ces longs tête-à-tête...»
Son regard mécontent se fixe.
Il aperçoit le docteur, étendu près de la cheminée; le jour baisse, Cécile est assise devant la fenêtre; son petit front bombé penche obstinément sur son ouvrage; elle insinue des mots préparés d'avance...
Cette vision lui est odieuse.
—«Pourquoi employer Cécile à cette besogne?»
Il se lève, fait quelques pas à travers la chambre; puis il se
dirige vers son bureau et ouvre un tiroir fermé à clef.
La photographie de Cécile...
Il s'approche de la lampe.
C'est une ancienne épreuve: Cécile accoudée à un dossier gothique, les mains croisées, la tête un peu de biais, les yeux souriants; elle est coiffée comme autrefois: un gros nœud sur la nuque.
Long, long regard. Exaltation croissante... Non, rien n'est changé; elle seule existe; rien autre ne compte!
Huguette! Pauvre Guette... Il sourit en pensant à la petite peine qu'elle aura, lorsqu'il lui dira:—«C'est fini, laisse-moi; reprends ta vie, je reprends la mienne... Je retourne vers celle que je n'ai cessé de porter en moi.»
Une demi-heure plus tard.
La pointe d'une ombrelle gratte à la porte.
Huguette, en toilette claire, un grand chapeau chargé de fleurs.
HUGUETTE.—Bonjour mon loup, ça va? C'est comme ça que tu me dis bonjour? Prends garde à mon chapeau...
Il la voit avec un recul inouï... Presque sans émotion.
Elle a jeté son ombrelle en travers du lit et se dégante posément.
HUGUETTE.—Ce n'est pas tout ça, mon petit... Je ne peux pas dîner avec toi. J'ai laissé Simone au Vachette, avec son nouvel ami, tu sais... Il a trois fauteuils pour ce soir à Cluny, et on dîne ensemble avant...
T'es pas fâché?...
JEAN.—Mais non...
Elle s'avance vers lui. La lampe, basse, éclaire les courbes lisses de sa robe. En haut, dans l'ombre, ses mains nues et sa bouche entr'ouverte, fraîche...
Ah, ce brusque désir d'elle! Souvenir brutal de telle place de chair plus pâle, plus satinée...
... Il la saisit, il enfonce son visage dans ses cheveux...
Il pense: «Non c'est impossible que ça finisse comme ça... Encore une nuit, et demain, demain...»
Elle s'échappe de ses bras, en riant.
HUGUETTE.—Laisse, que je me lave les mains...
Il la regarde aller vers le coin obscur de la toilette, relever soigneusement ses manches, et poser sans hésitation ses bagues dans un cendrier qui est là.
Une animosité soudaine... Il pense: «Comme elle est chez elle!... Ah, rompre, s'évader!... Tout de suite!... Ce soir!...»
Résolution définitive, qui l'apaise et l'éloigne d'elle.
Il soupire doucement. Il la regarde, attentive à ses ongles, le visage froncé, enlaidie.
C'est fini, irrémédiablement:—quelque chose de cassé, de tout à fait cassé...
HUGUETTE.—Accompagne-moi jusqu'au tramway?...
Ils sortent.
La rue de Rennes. Sept heures. Une cohue tumultueuse: la
ruée des banlieusards vers la gare Montparnasse.
Jean marche devant, pour fendre le flot.
HUGUETTE.—Voilà mon tram'... Alors c'est convenu? Si tu ne viens pas me chercher à la sortie de Cluny, je rentre directement... A tout à l'heure, mon loup... Zut, le voilà qui file!
Elle bondit, bouscule des gens...
Il suit des yeux sa silhouette noire, qui saute sur la plateforme éclairée, cueillie par le geste arrondi du conducteur.
Il est pris d'un tremblement de tout le corps.
Le tramway s'éloigne dans la nuit piquée de lumières.
Il reste là, debout, devant la terrasse d'un café. L'odeur acidulée
des absinthes. Des gens passent. On glapit les feuilles du
soir.
A Buis.
Cécile est seule dans la maison du docteur. Immobile, au
guet, l'épaule appuyée à la fenêtre entre-bâillée...
Jean et Mme Pasquelin ont surgi dans la trouée du portail.
—«Les voilà...»
D'instinct elle s'est rejetée en arrière, oppressée, le regard tendu, un sourire attendri aux lèvres...
Il marche vite... Il n'a pas changé... Il enveloppe la maison d'un regard vif, qui se heurte aux volets clos de la chambre du docteur.
Cécile court au devant de lui.
Adossée au départ de la rampe, les bras tombants, glacée, elle entend, derrière la porte, son pas fiévreux qui gravit le perron.
Il ouvre et s'arrête, tout pâle. Ses yeux n'expriment aucune joie: ils interrogent anxieusement.
CÉCILE.—Il est là-haut... il dort...
JEAN (la gorge moins serrée).—Il est là-haut? Il dort?
Son œil s'adoucit, s'émeut d'amour. Il tend sa main brûlante. Un long regard, enfin, extrêmement doux, plein de choses, où vient se fondre le regard souriant de Cécile.
MADAME PASQUELIN (ouvrant la porte du salon).—Entre là, puisqu'il dort...
Jean pense:» Ils disent: il...» Et c'est comme s'il pensait: «Mon père va mourir»...
MADAME PASQUELIN.—Assieds-toi donc. J'ai fait ouvrir le Salon; nous nous tenons là, pour qu'il n'entende pas de bruit... Ces dernières nuits, j'ai couché dans la chambre de ta pauvre grand'mère, pour être plus près... (Elle ne s'assied pas. Coup d'œil tendre.) Restez là, mes enfants, je monte. Dès que ton père sera réveillé, je viendrai te le dire.
(De la porte, avec une sorte de pudeur.) Cécile est bien contente de te voir!
Seuls.
Une seconde de silence gêné.
Cécile est debout, tête basse, une main appuyée à un guéridon, l'autre au corsage, piquant et repiquant une aiguille oubliée là.
Jean approche et prend sa main.
JEAN.—Nous payons cher le bonheur de nous revoir!
Elle relève son visage en larmes et porte à ses lèvres un doigt qui tremble.
Qu'il ne parle pas! Aucune parole ne peut dire...
L'embarras domine leur tendresse; ils se demandent s'ils ne s'attendaient pas à plus de joie...
Jean la guide vers le canapé. Elle s'assied, et reste droite, haletante... Il a pris sa main. Ils ne bougent plus.
Silence. Heure douloureuse et douce...
Jean pense:—«On a marché là-haut... Comment est-il? Très changé?...»
Il évoque le masque du docteur: son regard dur et fin; sa bouche, autoritaire jusque dans le baiser; son sourire décidé et courageux; mais tant de bonté secrète!
Il regarde les meubles du salon. Et, un à un, les souvenirs...
—«Ce fauteuil bas... Grand'mère un soir... Grand'mère qui
est morte!—Et bientôt je dirai: Mon père habitait cette
chambre, habitait cette maison, vivait... Et après, plus tard, ils
diront: Jean habitait, vivait...»
Il frissonne.
Il oubliait cette présence tiède, toute proche... La confiance
qu'elle a mise en lui, le pénètre tout à coup comme un cordial.
Cette main qu'il tient abandonnée et moite, il la porte sans
défense à ses lèvres. Plusieurs fois ... pieusement d'abord, avec
recueillement; puis avec une émotion grandissante, un bouleversement,
une violence irrésistible, accélérée, qui lui délie le
cœur.
Cécile renverse la tête. Le front enivré vacille et glisse sur l'épaule de Jean.
Alors dévotement, les lèvres sur les paupières closes... Longuement,
longuement...
Des pas, des bruits de porte.
Cécile ouvre les yeux, s'écarte.
MADAME PASQUELIN (d'une voix naturelle).—Jean... ton père est éveillé.
La chambre du docteur.
Mme Pasquelin, ouvrant la porte avec précaution, s'efface.
Jean hésite au seuil: une seconde d'atroce angoisse.
Il entre, seul.
Tout de suite, un allègement: le sourire de son père.
Le malade est soulevé sur des oreillers, les bras étendus. Pas très changé. La respiration est courte. Il regarde Jean s'approcher et lui sourit encore.
LE DOCTEUR (très bas, voix rauque).—Bien fatigué, vois-tu ... bien, bien fatigué...
Il tend la main. Jean, qui se penchait pour l'embrasser, avance la sienne. Le malade s'en empare, et soudain, les traits mortellement graves, il attire passionnément cette main, ce bras, tout son fils contre lui.
LE DOCTEUR (sanglot déchirant).—Mon petit!
Il tient ce visage d'homme entre ses paumes, et il n'y voit rien qu'un visage d'autrefois, un visage d'enfant. Il le palpe fiévreusement, il le serre fort, il l'appuie contre ses lèvres gercées, il le presse à droite, à gauche, contre le poil rude de ses joues.
LE DOCTEUR (retombant épuisé, avec un bref soupir).—Ah...
Il fait signe à Jean de ne pas bouger, de ne pas appeler; ce n'est rien... Et il s'immobilise, la tête en arrière, les paupières doucement closes, la bouche entr'ouverte, les poings comprimant les battements du cœur.
Jean, raide, le long du lit, regarde fixement son père. Une stupeur curieuse anime son chagrin:
—«Qu'est-ce qui le change à ce point? La maigreur? Non autre chose... Quoi?...»
Les pommettes du malade rosissent; il ouvre les yeux. Il aperçoit Jean: le front se plisse, la bouche se contracte. Puis les traits se détendent en un sanglotement paisible.
LE DOCTEUR.—Mon petit ... mon petit...
Ces larmes, ce balbutiement de tendresse... Un inexplicable malaise envahit Jean: est-ce qu'il ne reste plus rien de son père?
Quelques minutes passent.
Elles suffisent pour mettre le chagrin de Jean en déroute: la vie, plus forte que la mort. Malgré lui, devant ce lit, c'est à Cécile qu'il pense tout à coup: son arrivée, le choc de leurs yeux.. Un désir le saisit, impérieux, mais encore immatériel: aspiration vers il ne sait quelle étreinte des âmes, quelle pénétration intégrale et réciproque de toute pensée... Pourtant sur les lèvres il garde la tiédeur satinée de ses paupières! Un brusque goût de vivre le soulève et le heurte impatiemment contre ce lit, qui barre son élan... Puis un subit retour sur lui-même, et le rouge au visage!
Le docteur essuie ses joues mouillées; son regard naïf et tendre ne quitte pas le visage de Jean.
LE DOCTEUR.—Dis-moi... On t'a fait venir n'est-ce pas?... Mais si, je sais... Qui? le docteur?... non?... ta marraine?
Jean secoue la tête évasivement.
LE DOCTEUR (gravité soudaine et implacable).—Ils ont bien fait. Ça n'ira plus bien longtemps... Je t'attendais.
Jean, par émotion, ou par contenance, se penche vers la main abandonnée sur le lit, et l'embrasse.
Le docteur, l'air soucieux, dégage sa main pour se dresser sur les coudes: quelque chose d'important qu'il ne veut pas remettre...
LE DOCTEUR.—Je t'attendais. Écoute-moi mon petit... Je ne te laisse pas grand'chose...
Jean ne comprend pas tout de suite. Puis il ébauche un mouvement de recul.
Le malade fait signe qu'il se fatigue, qu'il ne faut pas l'interrompre.
LE DOCTEUR (avec de courtes pauses, les yeux fermés, comme s'il récitait).—J'aurais pu te laisser davantage. Je n'ai pas su. De quoi vivre tout de même. Et un nom honorable, c'est quelque chose...
Maintenant, écoute: Cécile et toi, n'est-ce pas?
Jean tressaille. Le docteur le regarde avec un sourire très tendre.
LE DOCTEUR.—Elle m'a tout raconté, cette petite. Elle te rendra heureux, je suis content. Toi, tâche qu'elle soit heureuse aussi, un peu... C'est plus difficile. Tu verras... Les femmes, on cherche à les comprendre, et c'est impossible, il faut seulement consentir à ceci: qu'elles sont autres... C'est déjà bien difficile!—Je me fais des reproches, moi, pour ta mère... (Long silence.)
Maintenant, ta santé. Tu as été ... oui... Et tu n'as pas fait ton volontariat. Mais c'est par excès de prudence. Tu es guéri, complètement, tu m'entends?—J'en ai parlé à ta marraine, en toute sincérité... Pourtant, mon petit, il faudra y penser quelquefois, ne pas te surmener, surtout plus tard, vers la quarantaine... Ça sera toujours ton point faible. Tu me promets?...
Une pause. Sourire paisible.
Rappelle-toi tout ça. C'est tout.
Il se laisse glisser au milieu des oreillers et allonge les bras avec un soupir de satisfaction. Mais bientôt, quelque chose le préoccupe à nouveau.
LE DOCTEUR (rouvrant les yeux).—Elle a été bien bonne pour moi, ta marraine, tu sais... Elle a fait beaucoup, beaucoup... Elle te dira.
Cependant il ne résiste pas au plaisir de l'annoncer lui-même.
Un sourire, d'abord esquissé comme avec souffrance, s'épanouit graduellement jusqu'à illuminer les yeux, le front, toute la face, d'un rayonnement ingénu.
Il fait signe qu'il veut parler de plus près. Jean se penche sur le lit. Le docteur lui prend le visage et l'approche de sa bouche.
LE DOCTEUR.—Jean... Ta marraine ne t'a rien dit? (Solennel.) Je me suis confessé, hier.
Il recule un peu la figure de Jean pour savourer sur ses traits l'émotion que cet aveu lui cause. Puis il l'attire à nouveau:
LE DOCTEUR.—Je devais communier aujourd'hui... Mais quand ils m'ont dit que tu venais, je t'ai attendu... Demain, avec toi ... avec vous tous...
Jean se redresse; il fait l'effort de sourire joyeusement, et détourne les yeux. Une déception confuse, irraisonnée, poignante...
LE DOCTEUR (avec un regard lointain, un peu craintif).—Tu sais mon petit, on a beau dire... (Secouant la tête.) C'est un x terrible...
Le lendemain.
La chambre du docteur. Aspect nu et grave.
L'office est terminé.
Mme Pasquelin, raidie contre toute émotion, remet en ordre
la commode qui a servi d'autel.
Le malade est assis, soulevé sur ses oreillers. Le jour des fenêtres tombe à plein, écrase la figure, fait luire le blanc de l'œil. Le front se penche, les cheveux sont en désordre; la barbe est longue, les joues creuses. Le regard, sans lorgnon, clignotant et décentré, est pensif, exalté et puéril.
Cécile et Jean se sont approchés du lit.
Ce matin leur amour ne les tourmente plus; il fait partie d'eux-mêmes; il est absolu, définitif. Une certitude les possède, d'aimer l'un et l'autre pour la première et pour la dernière fois.
Depuis hier, dans l'état du malade, un inexplicable et indiscutable changement: un calme surprenant, une détente. Indice de mieux qui les épouvante!
Le regard lointain qu'ils examinent en silence, passe sur eux et s'arrête; mais ils ne se sentent pas atteints par lui; il les traverse, les dépasse, tendu au-delà, au-delà...
Puis un sourire affectueux, mais forcé, empreint d'un irrésistible éloignement.
LE DOCTEUR (d'une voix sans timbre et pourtant nette).—Vous voilà tous les deux là... C'est bien... C'est bien... Donnez-moi vos mains.
Son sourire se fige, conventionnel. Il semble tenir un rôle et s'en rendre compte, et se hâter pour en avoir fini.
Il joue avec les deux mains qu'il a rassemblées entre les siennes.
Mme Pasquelin s'est arrêtée au pied du lit, les traits altérés.
LE DOCTEUR (à Mme Pasquelin).—N'est-ce pas? C'est très bien... Les deux petits...
Cécile en larmes, s'abat sur l'épaule de sa mère, qui attire Jean contre elle. Ils forment un groupe enlacé.
Les yeux du mourant, qui vaguaient, effleurent lentement Cécile, puis Mme Pasquelin, et soudain se fixent sur Jean avec une hostilité catégorique, une lueur aigüe de rancune ... puis une supplication déchirante, aussitôt dissipée.
Jean a compris cet éclair:—«Tu vis, toi!...»
Une pitié sans bornes...
Il voudrait donner cette vie... Il se dégage, et passionnément s'incline vers le front blême.
Mais le docteur ne bouge pas. Son masque a repris sa sérénité, son indifférence. Tardivement, il semble s'apercevoir du baiser de Jean, et ses lèvres, avec effort, essayent un bref sourire, sans que ses yeux expriment une émotion humaine.
Jean se retourne vers Cécile et ouvre les bras.
«A M. Jean Barois,
«Buis-la-Dame (Oise)
«Berne, le 25 juin.
«Très cher ami!
«La part que j'ai prise, si naturelle, à votre deuil, ne méritait certes pas une lettre aussi reconnaissante et si affectueuse. Je vous en remercie du profond du cœur. Je suis particulièrement touché de la confiance que vous me témoignez, sur le grave sujet dont vous me faites confident, et heureux de pouvoir exprimer mon avis très net.
«Non vraiment, je considère qu'il n'y a pas obstacle de conviction entre cette jeune fille et vous. Vous êtes rendu hésitant par la nature un peu rudimentaire de sa croyance et par la place trop importante qu'elle donne aux pratiques.
«Je ne vous comprends pas. Le sentiment religieux est un. Il ne sert pas d'analyser les variations qu'il peut avoir. Il y a une hauteur où tous les élans se rencontrent et se confondent, malgré que différents soient les points de départ.
«Vous opposez que si elle connaissait votre conception actuelle de la religion elle retirerait sa parole. Je le crois peut être. Mais ce serait par une erreur de jugement, et rien d'autre.
«Il serait donc, selon moi, très nuisible de l'avertir. Elle ne serait pas susceptible de comprendre quelle sorte de distinction vous faites entre la croyance légendaire et la base morale et humaine du sentiment religieux. Elle croirait au sacrilège, par naïveté. Ce serait provoquer une catastrophe par une sincérité imprudente, qui, dans l'actualité, n'est pas nécessaire. Vous seul, élevé par l'instruction et le raisonnement au-dessus du mouvement instinctif de la croyance, vous devez prendre, avec toute conscience, la décision et la responsabilité de votre bonheur.
«Que vous avez tort de craindre! Vous oubliez qu'il y a entre vous deux des ressemblances profondes! Même hérédité. Même éducation. Au surplus, vous avez une nature tellement religieuse par votre tempérament propre, que vous pourrez toujours, sans effort, suivre et approuver avec sympathie l'état d'âme de votre future femme. Et elle aussi fera évolution: non seulement l'écartement entre vous n'ira pas s'agrandissant, mais au contraire se diminuant.
«Cette idée m'est venue avec certitude du récit de la communion que vous avez accomplie l'un près de l'autre devant le lit de votre auguste père mourant. En vous mettant à genoux, vous à côté d'elle, chacun croyait au fond de lui-même à une chose différente: elle, la chair ressuscitée du Christ; vous, le symbole d'amour surhumain des hommes.—Et tout d'un coup, si élevés sont vos sentiments, qu'une même intensité d'émotion les soulève, les emporte mélangés, et il n'y a plus de séparation entre vos deux âmes! Ainsi, exactement, sera votre vie dans l'avenir.
«Excusez, très cher ami, le manque de suite de cette lettre. Je n'écris pas souvent en français.
«Je suis depuis des années le confident de votre espoir qui a fait ses preuves de fidélité et de bien fondé; il ne faut pas que des scrupules exagérés anéantissent ce bonheur, que vous méritez tous les deux.
«Votre très fidèlement attaché et dévoué,
Hermann Schertz.»
«Le mariage n'est dangereux que pour l'homme qui a des idées.»
Herzog.
«A Monsieur l'Abbé Schertz
«Professeur de Chimie Biologique à l'institut Catholique
«Berne (Suisse)
«Cher ami,
«Vous avez mille fois raison de me reprocher ce long silence. Votre rappel me prouve que votre affection n'en est pas altérée, et c'est, avant tout, ce qui m'importe.
«Je vous remercie tout d'abord de l'intérêt que vous portez à la santé de ma femme. Depuis deux ans, elle n'a cessé d'être pour moi un sujet d'inquiétude. Son accident a eu des conséquences plus graves que je ne pouvais l'imaginer, lorsque je vous en ai fait part. Des troubles de tous ordres en ont dérivé. Après dix-huit mois de soins, elle en reste encore ébranlée, au point que nous devons peut-être renoncer à l'espoir de jamais avoir d'enfant.
«C'est pour elle une bien cruelle épreuve et qui a sur son moral un
pénible retentissement.
«Ce n'est pas que je veuille chercher dans ces préoccupations privées
une excuse à la rareté de mes lettres. Bien des fois j'ai voulu vous
écrire; je ne l'ai pas fait, parce que je me sentais si éloigné des convictions
religieuses que nous partagions autrefois, que je ne savais pas
comment vous l'apprendre. Il faut se décider pourtant; nous sommes
l'un et l'autre capables, n'est-il pas vrai? de mettre notre amitié à
l'abri d'une divergence d'opinions.
«J'ai eu, dans ma vie religieuse, trois grandes étapes:
«A dix-sept ans, quand, pour la première fois, j'ai eu la notion que tout n'était pas clair dans cette religion «révélée»; quand j'ai compris que le doute n'était pas une imagination coupable, que l'on chasse en secouant la tête, mais une hantise tenace, impérieuse comme la vérité; une pointe fichée au plus profond de la croyance, et qui l'épuise, goutte à goutte.
«Puis, à vingt ans, quand je vous ai connu, quand je me suis accroché désespérément à votre interprétation conciliante du catholicisme. Vous vous souvenez, cher ami, avec quel frémissement j'ai saisi cette perche que vous me tendiez? Je vous dois quelques années vraiment sereines. Mon mariage, au début, n'a fait que consolider votre œuvre; au contact de la foi absolue de ma femme, je me suis trouvé tout naturellement enclin au respect des choses religieuses: votre conception symboliste m'offrait l'heureux compromis dont j'avais besoin, pour accepter le voisinage d'une orthodoxie, dont ma raison ne cessait de repousser les affirmations dogmatiques.
«Mais ce calme n'était qu'apparent. Une réaction inconsciente travaillait en moi.
«Comment ai-je été amené à tout remettre en question? Je ne le vois pas clairement.
«L'attitude que nous avions prise ne pouvait être définitive. Ce terrain symboliste est trop glissant: on ne peut y faire qu'un arrêt provisoire. A force d'enlever à la tradition catholique tout ce qui ne peut plus satisfaire les exigences de la conscience moderne, il ne reste bientôt plus rien du tout. Du jour où l'on admet que l'on puisse abandonner le sens littéral des dogmes—et comment ne pas admettre cet abandon, si l'on consent à réfléchir?—on légitime du même coup toutes les indépendances d'interprétation, le libre-examen, la libre-pensée toute entière.
Sans doute l'avez-vous senti comme moi? Je ne puis imaginer que vous trouviez encore la paix de conscience dans ce parti-pris équivoque. C'est jouer sur le sens traditionnel des mots; c'est une échappatoire... Il était trop fragile, votre lien entre le présent et le passé! Comment s'attarder à mi-chemin de l'affranchissement? Vouloir conserver la religion catholique pour sa valeur sentimentale, ou pour le groupement social qu'elle représente encore, ce n'est plus faire œuvre de croyant, mais de folkloriste! Je ne nie pas l'importance historique du christianisme: mais il faut loyalement avouer aujourd'hui, qu'il n'y a plus rien de vivant à tirer de ces formules,—pour ceux du moins, dont le jugement garde une activité propre.
«Aussi n'ai-je pas tardé à m'apercevoir que cette foi d'enfance et de
race dont j'avais cru si longtemps l'armature nécessaire, m'était insensiblement
devenue étrangère. Et c'est le dernier bienfait de votre action
sur mon développement moral, de m'avoir permis d'atteindre sans
déchirement la négation définitive. Je vous dois de pouvoir enfin regarder
froidement ces dogmes morts, auxquels j'avais tant prêté de ma propre vie!
«Il faut aussi tenir compte de l'influence que mon entrée à Venceslas
a pu apporter, indirectement, à la révision de mes croyances. Cela peut
paraître paradoxal, puisque c'est un collège dirigé par des ecclésiastiques;
mais les professeurs sont choisis dans l'Université, l'enseignement y est
relativement très libre, et le cours que je fais ne subit aucun contrôle.
«J'avais brigué cette chaire, sans exactement me représenter les difficultés que j'affrontais. Je n'avais guère l'habitude de parler en public. Mais, dès les premières leçons, j'ai senti passer sur mes élèves ce frémissement d'attention qui ne trompe pas...
«Voici la seconde année que leur curiosité ne s'est pas démentie. Je leur consacre tout mon temps, et, je puis le dire, le meilleur de moi. Tout ce que m'apportent chaque jour, mes études, mes réflexions privées, passe dans mes leçons. Je veux que ceux qui suivent mon cours emportent de leur bref contact avec moi, autre chose que quelques connaissances exactes; je fais le rêve d'élever leur niveau moral, d'exalter leurs personnalités, de marquer à jamais ces âmes qui s'offrent à l'empreinte: et vraiment je crois obtenir un résultat qui n'est pas indigne de tout mon effort.
«Ce cours n'est donc pas ce que vous semblez croire, lorsque vous
me demandez s'il me laisse le loisir de travailler pour moi. Il n'a rien
d'une besogne professionnelle: c'est la grande joie de ma vie, c'est mon
œuvre, c'est la consolation de tous mes ennuis. (Et, quoique je ne veuille
pas insister sur la plaie secrète que mon affranchissement a creusée dans
ma vie conjugale, vous devinez aisément que les chagrins de cet ordre ne
me sont pas épargnés.)
«Voici, mon cher ami, ce qu'est mon existence. Où en êtes-vous,
vous-même? J'espère ne pas vous avoir peiné en vous ouvrant toute ma
pensée actuelle?
«Je n'ai d'ailleurs fait que mettre en pratique un passage de Saint Luc, que vous connaissez bien:
«Personne ne met du vin nouveau dans des outres vieilles; autrement le vin nouveau rompra les vieilles outres...
«Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves; et l'un
et l'autre seront conservés.»
«Je vous serre très affectueusement les mains.
Jean Barois.»
«A Monsieur Jean Barois
«Professeur de Sciences Naturelles au Collège Venceslas
«Paris
«Très cher ami!
«Quelle indicible surprise et quelle douloureuse émotion a provoqué votre lettre, je ne saurais l'écrire! Il me semble que vous avez dû souffrir beaucoup pour devenir ainsi!
«Mais je garde encore confiance en votre jugement, et je pense que vous reviendrez un jour ou l'autre à des conceptions moins absolues. En effet, celui qui, comme vous et moi, n'est plus possédé par la foi intégrale, n'a devant lui que deux routes: ou bien l'anarchie morale, l'absence complète de toute règle et mesure; ou bien l'interprétation symboliste, qui concilie la tradition et l'intelligence contemporaine, et qui permet de conserver la haute et estimable organisation catholique. Notre religion constitue le seul ensemble auquel nous puissions relier nos élans individuels, le seul aussi qui donne à l'obligation morale une raison objective: en dehors du catholicisme, il n'y a pas de science, il n'y a pas de groupement philosophique, qui donne une raison satisfaisante au devoir.
«Pourquoi secouer les épaules, et vouloir échapper à toute autorité?
«Je refuse, comme vous, d'être un croyant automatique; mais est-ce qu'il faut pour cela refuser tout le catholicisme? Votre noble Renan l'a exprimé: «Garder du christianisme tout ce qui peut se pratiquer sans la foi au surnaturel.»
«J'ai regretté, pendant la lecture de votre lettre, l'enrôlement de votre ami Monsieur l'abbé Joziers dans les Missions. Il vous a bien manqué. Je sais que son orthodoxie est rigoureuse, mais il aurait aperçu la crise que vous avez traversée, et son cœur lui aurait inspiré le moyen de vous tendre la main avec efficacité.
«Je vous tends aussi la mienne, très cher ami, comme une fois déjà, avec tout mon encouragement. J'espère que vous ne la repousserez pas, et dans ce souhait je termine cette lettre, en vous adressant mes sentiments de dévouement et de fidèle amitié.
«Hermann Schertz.»
«P. S.—Vous avez incomplètement lu l'Évangile, car ceci est le verset suivant, qui est capital:
—«Et personne, ayant bu du vin vieux, n'en demande aussitôt du nouveau, parce qu'il dit: Le vieux est meilleur.»
«A Monsieur l'Abbé Schertz
«Professeur de Chimie Biologique à l'institut Catholique
«Berne (Suisse)
«Cher ami
«Vous comparez mon affranchissement au geste d'un gamin révolté contre une férule gênante... S'il est vrai que, depuis mon mariage, j'ai souvent eu à souffrir d'un contact plus direct et plus fréquent avec les exigences orthodoxes, croyez bien que je n'ai pas obéi à un sentiment aussi personnel, lorsque j'ai été conduit à rejeter définitivement ce qui me restait de catholicisme.
«Vous vous leurrez, en voulant interpréter au mieux de vos convenances individuelles, une religion, qui s'est nettement formulée elle-même, et qui, sans aucune ambiguité possible, rejette et condamne d'avance toute interprétation comme la vôtre. Car l'Église, avec une intransigeance préventive dont il faut bien reconnaître la logique, a pris soin d'expulser de cette communauté où vous revendiquez une place, les demi-croyants que nous étions—et que vous êtes encore...
«L'assurance de votre lettre m'autorise à vous rappeler certains paragraphes de la constitution «Dei filius» du Concile du Vatican de 1870, qui me paraissent particulièrement significatifs et que je viens de recopier à votre intention:
«Si quelqu'un ne reçoit pas dans leur intégrité, avec toutes leurs parties, comme sacrées et canoniques, les Livres de l'Écriture, comme le Saint Concile de Trente les a énumérées, ou nie qu'ils soient divinement inspirés: qu'il soit anathème!
«Si quelqu'un dit qu'il ne peut y avoir de miracles, et par conséquent, que tous les récits de miracles, même ceux que contient l'Écriture sacrée, doivent être relégués parmi les fables ou les mythes; ou que les miracles ne peuvent jamais être connus avec certitude, et que l'origine de la religion chrétienne n'est pas valablement prouvée par eux: qu'il soit anathème!
Si quelqu'un dit qu'il peut se faire qu'on doive quelquefois, selon le progrès de la science, attribuer aux dogmes proposés par l'Église un autre sens que celui qu'a entendu et qu'entend l'Église: qu'il soit anathème!
Enfin ceci, d'une limpidité cristalline:
«Car la doctrine de la foi que Dieu a révélée n'a pas été livrée comme une invention philosophique aux perfectionnements de l'esprit humain, mais a été transmise comme un dépôt divin à l'Épouse du Christ pour être fidèlement gardée et infailliblement enseignée. Aussi doit-on toujours retenir le sens des dogmes sacrés que la Sainte Mère Église a déterminés une fois pour toutes, et ne jamais s'en écarter sous prétexte et au nom d'un intelligence supérieure à ces dogmes.
«C'est donc, cher ami, l'Église qui nous ferme ses bras.
«Pourquoi se cramponner, par je ne sais quelle tendresse sentimentale qui n'est guère payée de retour, à cette vieille nourrice qui nous a repoussés, qui tient pour criminels les efforts que nous avons faits vers elle?
«Réfléchissez encore une fois à tout cela. Tôt ou tard, j'en ai la certitude, vous en viendrez à penser comme moi. Vous vous apercevrez que vous n'avez accompli que la moitié du trajet vers la lumière, et d'un bond, vous ferez le reste.
«Je vous attends dehors, à l'air libre.
«Croyez, cher ami, à toute ma fidèle affection.
Jean Barois.»
La chambre à coucher, à l'aube.
Jean soulève les paupières, et cherche d'un œil clignotant l'interstice des rideaux.
JEAN (bâillant).—Quelle heure est-il donc?
CÉCILE (d'une voix nette).—Six heures et demie.
JEAN.—Pas tard... Tu as mal dormi?
CÉCILE.—Non, mon chéri.
Il répond par un sourire indifférent et se pelotonne au fond du lit.
CÉCILE.—Samedi... Tu n'as pas de cours ce matin?
JEAN.—Non.
CÉCILE (tendre).—Mon chéri... J'ai quelque chose à te demander...
JEAN.—Quoi donc?
Un silence.—Elle s'est couchée contre lui, comme autrefois, a posé son visage au creux de l'épaule, et reste blottie, sans bouger.
CÉCILE.—Écoute.
JEAN.—Eh bien?
CÉCILE.—Tu ne vas pas te fâcher, dis?... Tu ne vas pas me faire de la peine...
Jean se soulève sur un coude et l'examine avec inquiétude. Il connaît ce regard obstiné, voilé de tendresse.
JEAN.—Qu'est-ce qu'il y a encore?
CÉCILE.—Ah, si tu commences comme ça...
JEAN.—Allons, voyons, parle... Qu'est-ce qu'il y a?
Elle n'aime pas être contrainte. Son sourire est aigre. Elle réfléchit une seconde, et se décide.
CÉCILE.—Tu ne peux pas me refuser ça...
JEAN.—Qu'est-ce que c'est?
CÉCILE.—Voilà... Tu sais qu'en ce moment je fais une neuvaine...
JEAN (le masque assombri).—Non.
CÉCILE (décontenancée).—Tu ne le savais pas?
JEAN.—Me l'as-tu dit?
CÉCILE.—Tu as bien dû t'en apercevoir...
Un silence.
JEAN (froidement).—Une neuvaine... Pourquoi?... Pour avoir un enfant?...
(Une pause.) Ainsi, tu en es là!
Cécile se jette contre sa poitrine, lui ferme la bouche d'un baiser bref, presqu'agressif.
CÉCILE (lui parlant au visage, avec une violence soudaine).—Mon chéri, mon chéri, ne me dis rien, laisse-moi... Vois-tu, je suis sûre que je serai exaucée... Mais il faut que toi aussi... Je ne te demande pas grand'chose: de venir avec moi ce soir, à Notre-Dame des Victoires... Simplement une fois, pour le neuvième jour.
Elle s'écarte et, sans le lâcher, contemple Jean, qui secoue la tête avec tristesse.
JEAN (doucement).—Tu sais bien...
CÉCILE (lui mettant sa main brûlante sur les lèvres).—Tais-toi... Tais-toi...
JEAN.—... que ce n'est pas possible.
CÉCILE (hors d'elle).—Mais tais-toi donc! Ne me dis rien... (Se coulant contre lui sans le regarder.) Tu ne peux pas me refuser ça... Un enfant, pense donc, mon chéri, entre nous, à nous ... un enfant!...—M'accompagner seulement, sans rien faire, sans rien dire; ce n'est pas grand'chose!
Tais-toi, ne me dis rien: c'est promis.
JEAN (froidement).—Non. Je ne peux pas faire ça.
Un silence.
Brusquement Cécile éclate en sanglots.
JEAN (agacé).—Ah, ne pleure pas, ça n'avance à rien...
Elle fait un effort pour retenir ses larmes.
JEAN (lui prenant les poignets).—Tu ne comprends donc pas ce que tu veux me faire faire? Tu es donc aveuglée à ce point que tu ne vois pas la laideur du geste que tu me proposes?
CÉCILE (suffoquant).—Qu'est-ce que ça te fait?... Puisque je t'en supplie...
JEAN.—Voyons, Cécile, réfléchis seulement une seconde. Tu sais bien, n'est-ce pas, que je ne crois pas à l'efficacité de cette prière, de ces cierges? Alors? Veux-tu me contraindre à jouer la comédie?
CÉCILE (dans ses larmes).—Qu'est-ce que ça te fait?... Puisque je t'en supplie...
JEAN.—Comment as-tu pu croire que j'accepterais?... Tu ne comprends donc pas, qu'en me demandant des choses pareilles, après toutes les pénibles discussions que nous avons eues ensemble, tu nous avilis tous les deux?
CÉCILE (sanglotant toujours).—Puisque je t'en supplie...
JEAN (avec brusquerie).—Non.
Cécile lève sur lui des yeux hagards.
Un silence.
JEAN (sombre).—Je t'ai expliqué ça vingt fois... Ce qu'il y a de plus propre en moi, c'est justement cette loyauté dans le doute... C'est d'attacher une si grande importance à tout acte de foi, que je ne peux plus en faire le simulacre par complaisance... Tu ne comprends rien, rien, à ce que j'éprouve!
CÉCILE (vivement).—Mais, à cette heure-là, tu ne rencontreras personne...
Jean ne saisit pas tout de suite.
Long regard d'étonnement, puis de véritable détresse.
JEAN.—C'est toi qui me donnes des raisons pareilles!
Ils demeurent allongés l'un près de l'autre, mêlant leurs tiédeurs, mais l'un à l'autre fermés, rancuneux, hostiles.
JEAN (cherchant à raisonner).—Voyons, réfléchis un instant... Cette neuvaine, je ne t'empêche pas de la faire. Je refuse seulement d'y prendre part... C'est le moindre de mes droits...
CÉCILE (violente et têtue).—Tu parles toujours de tes droits, parle donc aussi de tes devoirs! D'ailleurs, je n'ai rien à t'expliquer... Tu ne comprendrais pas. Mais il faut, il faut absolument que tu viennes avec moi ce soir; sans quoi tout est perdu!
JEAN.—Mais c'est stupide! En me menant là-bas, à mon corps défendant, qui penses-tu tromper?
CÉCILE (suppliante).—Jean, je t'en conjure, viens avec moi ce soir!
JEAN (sautant du lit).—Non, non, et non! Je ne m'oppose pas à tes croyances, mais laisse-moi libre d'agir selon les miennes!
CÉCILE (un grand cri).—Ah, ce n'est pas la même chose!
Jean se retourne vers le lit où Cécile sanglote éperdument.
JEAN (avec une tristesse profonde).—Ce n'est pas la même chose... Voilà ce qui est cause de tout! Jamais tu ne consentiras à respecter ce que tu ne comprends pas...
(Levant la main.) Ah, ma pauvre enfant, tu peux me rendre justice, je n'ai jamais prononcé une parole qui puisse ébranler ta foi! Mais, bon Dieu, il y a des instants où je souhaite de toute ma rancune que tu apprennes un jour, à tes dépens, ce que c'est que le doute—juste assez pour perdre le goût de l'absolu, et ce besoin de dominer, du haut de ta certitude!
Il s'aperçoit dans une glace, ébouriffé, pieds nus, jetant l'anathème vers le lit défait... Exaspéré contre lui autant que contre elle, il s'enfuit en claquant la porte.
Jean, seul à son bureau.
Il a des notes éparpillées devant lui.
Il écrit une page entière sans lever les yeux, puis repose sa plume avec humeur. Malgré tout son effort, il ne travaille pas: il besogne, machinalement; son application se perd dans le vide.
Il pense:
—«C'est stupide... Je ne peux rien faire ce matin... Et tout ça, pour cette histoire de neuvaine...»
Il repousse ses fiches, et reste un instant songeur.
—«Ce serait trop bête... Tout l'avenir dépend de moments comme ceux-ci. Il faut que j'aie ma liberté d'action, c'est bien le moins! Aujourd'hui ceci, demain autre chose: non!»
Il se lève, par énervement, fait quelques pas, les bras croisés, jusqu'à la fenêtre, où il stoppe net, les yeux vagues dans le ciel pluvieux.
—«Mais qu'est-ce qu'elle peut s'imaginer avec sa neuvaine? Toujours cette action directe des prières sur la volonté de Dieu... C'est d'un enfantillage!... Vraiment elle a une façon de croire, qui serait digne des sauvages de l'abbé Joziers! Cet abonnement de neuf jours ... ce nombre neuf... Elle doit s'être procuré un formulaire spécial pour femmes stériles!... Prodigieux!»
Il hausse les épaules, se dirige vers la bibliothèque, et debout, appuyé au battant vitré, semble s'attarder à la recherche d'un livre.
—«Avoir une attitude loyale vis-à-vis de soi-même. Les femmes ne comprennent rien à ce sentiment-là! «Qu'est-ce que ça te fait, puisque je t'en supplie!...» La dignité pour soi ... la dignité de la vie, pour soi-même...»
Il prend un volume au hasard, et regagne son fauteuil.
L'heure du déjeuner.
Jean se met à table, seul.
Il pense:—«Elle va rester dans sa chambre, à bouder. Elle espère que je serai sensible à cette comédie!... (Excédé.) Quand tout ça finira-t-il!»
Mais Cécile paraît.
Et Jean, levant les yeux au bruit de la porte, aperçoit un pauvre visage ravagé de douleur, plombé, maigri, labouré de larmes.
Tout ressentiment s'évanouit: une compassion soudaine, comme devant la faute d'un enfant entièrement irresponsable: une immense pitié, jaillie du plus profond de sa tendresse instinctive ... presqu'une résurrection, mais si triste, si décolorée, de l'amour d'autrefois,—qui est mort.
Sans aucun cabotinage, elle s'assied à sa place, livide.
Le repas.
Elle s'efforce de toucher aux plats. De longs silences. Devant la femme de chambre, quelques mots rapides sur sa migraine.
Jean l'examine à la dérobée: la courbe nette et têtue du front baissé; les paupières bouffies, sèches et rouges; les lèvres enflées, la bouche béante, vraiment déformée par la douleur...
Il pense avec angoisse:—«Comme je la torture!... A tort ou à raison, peu importe!. Elle souffre par moi, et c'est abominable! Ah, à quoi bon vouloir qu'elle comprenne? Je n'arriverai jamais qu'à lui faire mal. Plutôt céder que de la martyriser odieusement, pour rien!
«En somme que demande-t-elle? guère plus que ce que j'ai fait souvent, cet été, en l'accompagnant le dimanche à la messe... Tant pis pour elle, si elle ne voit pas la sottise, la laideur de cette démarche forcée...
«Allons, je ne m'obstine pas...»
Et tout de suite, par cette seule résolution intérieure, une détente, un allègement joyeux. Il goûte une jouissance voluptueuse à s'évader de son égoïsme, à être le meilleur des deux, celui qui comprend, qui pardonne, qui cède.
Il la regarde avec douceur. Elle mange docilement, sans lever les yeux.
—«Jolie, dans ses larmes... C'est monstrueux de laisser pleurer une femme! Mon père disait: «Les femmes sont autres, on l'oublie trop souvent.» Il avait raison; voilà ce qu'on obtient à vouloir les traiter en égales: de la souffrance inutile... Oui, il avait raison. Il faudrait négliger ce qui nous sépare d'elles, et s'acharner à découvrir ce qui peut nous en rapprocher...
«Oui, oui: mais pour que ce soit possible, et facile, il faudrait
encore s'aimer...»
Il se lève de table.
Elle attendait, indifférente, les yeux sur la nappe.
Il pense:—«Elle va fuir dans sa chambre... Je la suivrai, je lui dirai que je veux bien.»
Mais, comme d'habitude, Cécile se dirige vers le cabinet de Jean, où l'on a porté le café. Et elle reste debout devant le plateau, les bras tombés.
Jean va vers elle.
Il a fait un dur effort; il a piétiné un peu de sa conscience, un peu de son amour-propre, un peu de l'avenir. Il escompte cette joie qu'il lui apporte. Elle va s'abattre contre son épaule avec un sanglot attendri, et il sera payé par l'éclair reconnaissant de ses yeux.
Il se penche, il entoure sa taille. Elle se laisse manier sans résistance.
JEAN (avec un tremblement dans la voix).—Ecoute... C'est bien, j'irai ce soir avec toi, où tu voudras. Pourvu que tu ne pleures plus...
Mais elle se dégage et le repousse brutalement.
CÉCILE.—Ah, je sens que tu seras mon ennemi, toujours!
Il la considère, abasourdi.
CÉCILE (martelant les mots).—Je sais qu'il faudra que nous nous quittions, un jour, dans un an, dans deux ans, dans dix ... je ne sais pas ... mais, un jour, certainement, il le faudra! Et je te détesterai! (Éclatant en larmes.) Tu me fais déjà horreur...
Elle ébauche un geste vague des mains en avant, comme si elle allait tomber, et vient s'appuyer au bord de la table.
JEAN (amer).—C'est bien... Je pensais te faire plaisir.
Elle relève la tête, comme s'éveillant d'un cauchemar, et son visage s'adoucit. Elle s'agrippe au bras de Jean.
CÉCILE (balbutiant).—Ah oui, pour ce soir? C'est vrai, je te remercie... (Elle se baisse, et furtivement lui embrasse la main.) Merci, mon chéri.
Et brisée, le mouchoir sur les lèvres, elle quitte la pièce lentement;
de la porte, elle cherche à lui sourire.
Jean, hébété, fixe machinalement cette porte fermée.
Puis il secoue le front et les épaules, va vers la fenêtre, l'ouvre brusquement, malgré la pluie, et se penche dehors, comme quelqu'un qui s'évade d'un trou sans air.
Notre-Dame des Victoires. 8 heures du soir.
Un sépulcre. Les herses flamboyantes aveuglent, endorment,
mais n'éclairent pas.
Là, le soir, de tous les coins de Paris, les détresses qu'aucun courage ne porte plus, et les espoirs tenaces que tout a déjoués, viennent s'ensevelir côte à côte, dans l'ombre qu'épaissit la fumée des cires.
Cécile, prosternée; Jean, debout: l'un et l'autre courbés sous le poids de l'irrémédiable.
Le même soir.
Jean, revenu à sa table de travail, s'y attarde,—pour être seul.
La porte s'ouvre.
Cécile entre sans bruit, les pieds nus.
CÉCILE.—Tu ne viens pas te coucher? (Naïvement.) Tu me boudes?
Elle rit gentiment, d'un air puni.
Désarmé par tant d'inconscience, Jean ne peut s'empêcher de sourire.
Elle est en peignoir. Aucune trace de larmes. Sa coiffure de nuit la rajeunit; cheveux lâches, pincés à la nuque par un gros papillon noir. Elle a quinze ans, ce soir; elle est la frêle fiancée de Buis.
Comme une enfant, elle saute, et se perche sur les genoux de Jean.
CÉCILE.—Je ne veux pas m'endormir toute seule, après une journée pareille. Je veux que tu me dises que tout est oublié ... que tout est fini...
Jean est las de paroles.
Sans répondre, il embrasse doucement ce front câlin, qu'elle tend. Plus que jamais, ce soir, il se sent un vieil homme.
CÉCILE.—Là-bas, il fait trop froid. Je vais t'attendre. Continue, mon chéri, il ne faut pas que je t'empêche de travailler. Je vais rester sur ton genou, je ne bougerai pas.
Elle se blottit, elle s'abandonne. Le bras de Jean qui l'encercle, sent fondre le pli de sa taille, mouvante et tiède.
Ses mules de paille ont glissé; il prend dans le creux chaud de sa main, les petits pieds frileux.
CÉCILE.—Tu vois, je suis gelée..
Elle rit: un rire saccadé, provocant. Puis elle se laisse emporter la tête en arrière, riant toujours.
Maintenant, leurs yeux se croisent. Un choc bref: sous les paupières baissées de Cécile, Jean a heurté une petite lueur de joie triomphante.
Il pense brusquement:
—«Ah!... le neuvième soir... Il fallait aussi que...»
Pas même un sentiment de rancune; il la garde allongée contre lui.
Il vient de toucher du regard toutes les possibilités de la bêtise humaine, et il se sent si loin de Cécile, si loin!...
—«Les femmes sont autres...»
Quelques feuillets, d'une écriture cursive et nerveuse, au fond d'un tiroir du bureau de Jean:
Les femmes: êtres inférieurs, irrémédiablement.
Leur sensiblerie est en elles, comme un ver dans un fruit. Qui attaque tout: qui rend impuissante leur intelligence, et infirme leur cœur.
Un cerveau de petite fille, confit à l'ombre d'une ville de province: toutes les affirmations de la sottise ignorante.
Ça ne se décrasse pas.
Les femmes aiment le mystère, par instinct. Contre, rien ne peut. Encore l'aiment-elles bassement.
Si, la nuit, elles ont peur des voleurs, une veilleuse leur rend la sécurité. Le geste de l'autruche: leur geste naturel. Il leur faut une foi pour être assurées, pour n'avoir pas à chercher au delà.—(N'imaginant même pas qu'on puisse avoir soif de «vérification...»)
On ne doit se marier que lorsqu'on est bien fermement dirigé dans sa voie, et certain de n'en pas changer. Modifier sa direction après le mariage, c'est bouleverser deux vies pour une; c'est creuser entre deux êtres, que tout oblige à rester liés, un gouffre où tout le bonheur s'abîme,—sans le combler.
L'année suivante.
A Buis, le lundi de Pâques.
Le petit salon de Mme Pasquelin. Midi.
Jean et Cécile viennent d'arriver pour passer quelques jours.
L'abbé Joziers, revenu de Madagascar depuis deux mois, est venu déjeuner avec eux.
MADAME PASQUELIN.—Allons... Approchez-vous... Venez vous chauffer... Il faisait si beau ce matin!
Le ciel s'est subitement assombri, une rafale de grêle tambourine sur les vitres.
L'ABBÉ JOZIERS (de la fenêtre).—C'est une giboulée, ça ne durera pas... (A Jean.) Ce grand ami-là, comme il a changé depuis cinq ans!
JEAN.—C'est vous que je n'aurais pas reconnu! Maigri, jauni...
L'ABBÉ (riant).—Merci!
MADAME PASQUELIN.—Et encore, depuis un mois, il a vraiment meilleure mine... Il serait mort au milieu de ses nègres, si je ne l'avais fait rappeler d'autorité par Monseigneur.
L'ABBÉ (à Jean).—C'est vrai, mon cher, j'ai failli rester là-bas. Et puis le bon Dieu, prévenu par Mme Pasquelin, a dû se dire: «Mais ce gaillard-là, on peut encore en faire quelque chose... Bon pour le service!» Et me voilà...
JEAN (sérieux).—Il s'agit de réparer les avaries.
L'ABBÉ.—Oh, ça y est... Radoubé, remis à flot... (Se frappant la poitrine.) La coque était bonne! Tenez avant-hier, j'ai été jusqu'à Saint-Cyr, à pied; les jambes sont solides. Aujourd'hui, je compte aller à Beaumont, pour M. le Curé. Vous voyez, il n'est même plus question de ménagements.
(Il regarde longuement Jean tout en parlant.) Comme il a changé!
JEAN.—Tant que ça?
L'ABBÉ.—Cette moustache, maintenant! Et puis, je ne sais pas, quelque chose de nouveau, de différent... Le regard... Non, toute la physionomie...
MADAME PASQUELIN (prenant Cécile à part).—Eh bien, toi? Comment vas-tu?
CÉCILE.—Pas mal.
MADAME PASQUELIN.—Enfin, toujours rien?
CÉCILE (les larmes aux yeux).—Non.
Une pause.
MADAME PASQUELIN (plus bas; coup d'œil vers Jean, qui bavarde avec l'abbé).—Et ... lui?...
Cécile répond par un geste découragé. Profond soupir.
Après déjeuner.
L'ABBÉ JOZIERS (s'approchant de la fenêtre).—Voilà le beau temps, il faut que je me sauve. Je vais jusqu'au presbytère de Beaumont.
Jean, m'accompagnez-vous un bout de chemin?
JEAN.—Bien volontiers.
Les nuages sont passés. Une brise fraîche achève de sécher les grêlons fondus.
Un ciel lavé, immense et clair, d'un blanc à peine bleuté, s'étend sur la ville. Les rues sont propres, le soleil d'avril fait sourire les façades. Des volets blancs luisent, laqués par la pluie.
Lundi de Pâques: jour férié. Des familles en promenade.
JEAN.—Nous prenons le raccourci du cimetière?
L'ABBÉ.—Oui... (Passant sa main sous le bras de Jean.) Ça m'a fait plaisir ce déjeuner. Je craignais, d'après une de vos lettres ... et puis, d'après les réticences de votre belle-mère... (Insistant, à son habitude, sur certains mots.) Mais je vois que vous êtes heureux, l'un et l'autre, ainsi que vous le méritez tous les deux...
Jean le regarde presque gaiement; et l'abbé prend ce sourire pour un acquiescement. Quelques pas silencieux.
JEAN (avec un petit rire sec).—Le bonheur? Eh bien non, non: ce n'est pas précisément le bonheur!
L'abbé tressaille et s'arrête.
L'ABBÉ.—Vous plaisantez?
JEAN (sourire amer).—Vaut-il pas mieux en rire!
L'ABBÉ (stupéfait, un peu scandalisé).—Jean...
JEAN (haussant les épaules).—Elle est si bête, notre histoire!
L'ABBÉ.—Vous m'effrayez, Jean.
JEAN.—Que voulez-vous, c'est l'impasse...
L'ABBÉ.—L'impasse?... Mais vous vous aimez pourtant?
JEAN (sombre).—Je n'en sais rien.
Le chemin de traverse se rétrécit. L'abbé passe devant, sans répondre. Devant le calvaire, il se signe.
Ils traversent le cimetière en biais, par des sentiers mangés d'herbe.
Une porte basse ouvre en pleine campagne. La grand'route; sur l'un des accotements, des poteaux télégraphiques à perte de vue, divisent en mesures les portées des fils. Un soleil splendide et jeune, baigne les prés, les chaumes, les labours assombris par la pluie. Des pâturages, coupés de raies d'argent, dévalent jusqu'à l'Oise, dont les rives sont encore inondées: l'eau, abritée du vent, reflète un ciel immobile, d'un gris fin; les saules immergés jusqu'au menton, lèvent leurs grosses têtes noires ébouriffées.
L'abbé s'approche de Jean, qui s'est arrêté devant le paysage. Leurs regards se croisent: celui de l'abbé est préoccupé et plein de reproche.
JEAN.—Je sais bien que je suis fautif. J'ai voulu réaliser, à vingt-deux ans, un rêve stupide, fait à seize... Ça ne pouvait rien apporter de bon.
L'ABBÉ.—Au contraire, cette amitié d'enfance...
JEAN (l'interrompant avec amertume).—Permettez, permettez... Je connais bien la question, je vous assure: j'ai eu le loisir de l'approfondir!
L'abbé se tait et reprend silencieusement la marche. Cette assurance d'homme le déconcerte.
Jean devine sa surprise et y prend un mauvais plaisir: l'air vif, le soleil, la promenade, le grisent un peu. Il devient loquace.
JEAN.—A seize ans, voyez-vous, on se fait de l'amour une idée follement mystique! On place son rêve si loin, tellement hors des possibilités de la vie, qu'on ne pourrait rien trouver dans la réalité qui le satisfasse; alors on se fabrique, de toutes pièces, un objet imaginaire! Ça se fait tout seul: on prend la première venue, la plus proche... On se garde bien de chercher quel est son véritable caractère! Non... On l'enferme comme une idole dans le cercle clos de son imagination, on la pare de toutes les qualités que l'on souhaite à l'Élue,—et puis on s'agenouille devant, avec un bandeau sur les yeux... (Il rit.)
L'ABBÉ.—Mon pauvre Jean, que me racontez-vous donc...
JEAN.—L'intoxication est lente et sûre... Le temps passe, le bandeau ne tombe pas. Alors un beau jour, pour la remercier d'avoir plus ou moins longtemps personnifié vos aspirations amoureuses, sans hésiter, le sourire aux lèvres, on épouse une fillette qui vous est essentiellement étrangère...
(Une pause) Et puis, quand on a stupidement engagé sa vie entière...
Il s'arrête et regarde le prêtre bien en face.
JEAN.—... en-ga-gé sa vie... Sentez-vous ce que c'est?
L'abbé baisse la tête.
JEAN.—... Quand on se trouve enfin devant celle qu'on a choisie, et qu'on veut l'aimer, cette fois, pour de bon, dans la réalité de tous les jours, alors on s'aperçoit que l'on n'a rien de commun avec elle... Une inconnue! Peut-être une ennemie... Et c'est l'impasse!
L'ABBÉ.—Une inconnue, une inconnue... Voyons, ne me dites pas ça! vous avez été élevés l'un près de l'autre!
JEAN (avec âpreté).—Oui, et nous nous connaissions moins que l'on ne se connaît dans la plupart des mariages de présentation; parce que, dans ces cas-là, on emploie fébrilement le temps des fiançailles, à s'expliquer, à tâcher de se comprendre. C'est toujours ça... Tandis que nous n'y avons même pas pensé: nous croyions que c'était fait depuis toujours.
L'ABBÉ.—Pourtant au début, vos premières lettres...
JEAN.—Au début? Je me suis aperçu très vite que nous étions très différents, mais sans la moindre inquiétude, je l'avoue...
L'ABBÉ.—...?
JEAN.—Si vous saviez l'exaltation qui vous aveugle à ces moments-là! Ce bonheur, après lequel j'avais vu tout le monde courir en vain, je voulais si intensément qu'il fût pour moi, j'attendais avec tant de certitude cette exception de la vie en ma faveur! J'étais d'avance résolu à tout trouver parfait.
Et puis, dans les premiers temps du mariage, le rôle de l'homme est si facile! Il prend si aisément de l'influence sur sa femme! Mais qu'il se hâte! Les femmes les plus naïves ont un sens merveilleux qui les avertit vite de leur force, et les fait ressaisir bientôt tout l'empire qu'elles ont laissé prendre... Les premiers mois, allez, sont bien trompeurs! La femme, avec une inconsciente habileté, sait retenir et répéter. Elle vous tend un miroir fidèle... Mon Dieu, on s'y regarde avec plaisir... Jusqu'au jour où l'on découvre que ce qu'elle vous présente n'est qu'une image,—votre propre image... Et si pâle, si fragile, si effacée déjà...
L'ABBÉ.—Vous l'aimiez pourtant?
JEAN.—Je ne crois pas... C'est l'amour que j'aimais.
L'ABBÉ.—Elle vous aimait, elle, sans réserve!
Jean ne répond pas.
L'ABBÉ.—Elle vous aimait, et elle vous aime encore! J'en ai eu la preuve tout à l'heure, dans son sourire, dans son regard...
JEAN.—Ça, non.—Vous avez surpris, entre nous, un peu d'entrain factice... (Avec lassitude.) Un armistice, tacitement conclu pour notre retour ici, rien de plus.
L'ABBÉ.—Elle vous a aimé, Jean, je le sais bien!
JEAN.—Oui, oui... (Haussant les épaules.) A sa façon... Petite flamme permise, qu'elle a patiemment attisée pendant des années, dans la solitude, avec la permission de sa mère et de son confesseur... Petit amour bien poétique, bien «mois de Marie»...
L'ABBÉ.—Jean!
JEAN.—Laissez, je vous parle franchement. Cet amour-là, je ne le nie pas; mais il n'était pas capable de faire un miracle: et il en faudrait un, je vous assure, pour que nos deux pensées s'accordent, pour que nos deux vies viennent à n'en faire qu'une seule!
L'ABBÉ.—Mais elle était si jeune!
JEAN (avec un rire nerveux).—Ah c'est vrai: «Elle était si jeune!» (Il fait quelques pas et se retourne fébrilement.) Je le croyais! Je pensais: «Tout ce qui me déplait en elle, est provisoire...» Quelle erreur!... Cécile avait, en effet, le cœur et le cerveau d'une gamine de seize ans, qui veut juger la vie, et dont toute l'expérience, tous les points d'appui, sont ce peu de chose qu'elle a pu glaner, le dimanche, au catéchisme de persévérance...
L'ABBÉ.—Jean!
JEAN (avec une animation hostile).—Mais ce que je ne prévoyais pas, c'est que cet état embryonnaire était pour elle le point terminus, et qu'elle avait atteint son point mort!
Voilà pourtant l'exacte vérité!
Jean s'est arrêté, dans une attitude de combat, les jambes écartées, le buste frémissant, la tête en arrière, l'œil dur, les mains soulevées à la hauteur de la poitrine, et les doigts ouvert comme s'il soupesait un bloc compact.
JEAN.—Elle était très fière de sa petite jugeotte! Parbleu! Elle l'avait formée à des sources inattaquables: au sermon, dans les entretiens de quelques bonnes gens de province, ou bien dans ces bouquins théoriques à l'usage des jeunes filles chrétiennes, dans lesquels il n'y a rien, rien, qui, de près ou de loin, corresponde aux réalités qu'elles devront vivre!
L'abbé fait un pas, et pose la main sur le bras de Jean. Il le regarde au visage.
L'ABBÉ.—Jean, Jean... Vous ne parleriez pas ainsi si vous n'aviez vous-même terriblement évolué...
(Baissant la voix.) Je suis sûr que vous ne pratiquez plus!
Un silence.
JEAN (sur un ton affectueux, mais ferme.).—Non.
L'ABBÉ (avec douleur).—Ah, je comprends tout, maintenant!
Le chemin monte; on aperçoit le clocher de Beaumont.
L'abbé accélère l'allure, comme s'il cherchait à être seul.
L'un derrière l'autre, ils atteignent le haut du plateau. Un vent léger, venu de loin, les accueille. Sur le bord de la route, les fils télégraphiques tendus dans la brise, chantent.
Les maisons du hameau sont éparpillées à travers champs.
L'église est à cent mètres, gardée par les sapins pointus du presbytère.
Jean laisse l'abbé prendre de l'avance, et s'assied sur un tas
de cailloux.
Son dos chauffe au soleil. Le vent lui souffle sa fraîcheur au visage. A ses pieds, de petites feuilles sèches roulent, avec un froissement de soie.
Devant lui, la plaine.
Les ombres s'allongent, obliques. A travers les houppes défeuillées des ormes, à travers les peupliers en rideaux, brillent des façades blanches, des toits bleus. Presque personne. Une charrette avance sur un chemin qu'il ne voit pas, et les roues grincent dans la boue des ornières. Au loin, un cheval gris et un cheval roux traînent la charrue sur les courbes molles d'un vallonnement, et soulèvent sans bruit des flocons d'ouate brune. Une flaque attardée luit entre des troncs. Les nids désertés font des nœuds dans l'écheveau des branches. Les laboureurs ont atteint le bout de leur champ: avec des gestes lents, ils virent et repartent; ils montent vers Jean, et le cheval gris, dissimulant tout l'attelage, semble venir seul.
Le vent s'est tu. Les cahots de la charrette ont cessé. Les feuilles mortes reposent.
Du silence.
L'abbé revient, le front incliné.
Jean se lève et va vers lui. Le prêtre lui tend les mains; ses yeux sont pleins de larmes.
Ils redescendent la côte, sans mot dire. L'abbé marche droit devant lui, la tête basse.
JEAN (avec douceur).—Mon cher abbé, je vous ai fait de la peine. Mais tôt ou tard, il fallait bien vous l'apprendre...
L'abbé fait un geste évasif et triste.
JEAN.—Je connais le reproche habituel des croyants: «Vous vous êtes débarrassé d'une religion qui entravait votre bon plaisir.» Ce n'est pas mon cas. J'ai lutté pendant des années; vous en avez été témoin... Il le fallait. Maintenant c'est fini. J'ai repris mon équilibre.
L'abbé tourne la tête et regarde Jean avec une insistance involontaire, comme s'il cherchait à voir l'homme nouveau qu'il est devenu.
L'ABBÉ (avec désespoir).—Vous, que j'ai quitté si droit, en si bon chemin!...
JEAN.—Vous ne devez pas me mépriser. Croire ou ne pas croire, au fond, ce n'est pas ça qui importe: l'essentiel, c'est la façon dont on croit ou la façon dont on ne croit pas...
L'ABBÉ.—Mais comment, comment est-ce arrivé?
JEAN.—Je ne peux pas expliquer. J'ai eu la foi, c'est certain; maintenant, je ne peux plus m'imaginer cet état-là. Des idées qui passent comme des courants, et qui vous poussent tout naturellement dans le même sens... Et puis, ça dépend aussi des natures... Certains hommes sont, plus que d'autres, susceptibles d'accepter une formule toute faite; comme le bernard l'ermite, vous savez, qui s'installe dans la première coquille vide qu'il rencontre, et qui s'y moule. D'autres, au contraire, ont besoin de secréter eux-mêmes leur carapace...
L'ABBÉ (sombre).—Ce sont vos études qui vous ont perdu... Le poison de l'orgueil scientifique! Ah, et combien d'autres...! A force de s'absorber dans l'examen du monde matériel, on s'aveugle jusqu'à perdre le sens surnaturel, et bientôt la foi!
JEAN.—C'est possible. Quand on se sert quotidiennement des méthodes scientifiques, et qu'on a éprouvé mille fois combien elles sont propres à la recherche de la vérité, comment ne serait-on pas amené à les appliquer aux problèmes religieux?
(Tristement.) Est-ce ma faute, si la foi résiste mal à un sérieux examen critique?
L'ABBÉ (vivement).—Ah, il ne sait plus comprendre qu'avec son intelligence! L'examen critique, la raison! Est-ce que ce n'est pas à l'aide de la raison que les théologiens établissent les preuves de l'existence de Dieu et de la Révélation?
JEAN (à mi-voix).—C'est par elle aussi qu'on les renverse...
L'ABBÉ.—Mais lorsqu'il m'est prouvé, à moi, que ma raison ne peut à elle seule, embrasser dans son entier le mystère des dogmes, ni toutes les choses de l'âme, ni la solution chrétienne du problème de nos destinées, j'y vois au contraire, une preuve irréfutable de l'Autorité supra-humaine qui nous a révélé la lumière!
Jean se tait.
L'ABBÉ (prenant avantage de ce silence).—Et d'ailleurs, pouvez-vous me citer une seule vérité scientifique certaine, qui soit en opposition réelle avec un de nos dogmes?
Est-ce votre science qui vous a démontré qu'il n'y avait pas de Dieu?
JEAN (se décidant à répondre).—Pas absolument.
L'ABBÉ.—Ah!
JEAN.—La science se contente de prouver que tout, dans l'univers, se passe comme si votre Dieu personnel n'existait pas.
L'ABBÉ.—Mais la science, mon pauvre ami, uniquement assujettie à l'étude des lois naturelles, est, quand on sait voir, le plus éclatant témoignage de l'existence d'un Dieu!
JEAN (avec tristesse et fermeté).—Oh, pardon, pardon ... ne nous payons pas de mots. De ce que je crois reconnaître un Ordre, des Lois, n'allez pas conclure que je crois en Dieu: c'est un tour de passe-passe qu'on a trop employé! Non, non, nous sommes l'un et l'autre persuadés que l'univers obéit à des lois, soit;—mais mon opinion, toute expérimentale, n'est nullement compatible avec les données de la religion catholique, où Dieu est considéré comme un Être suprême, ayant une action personnelle, et des qualités précises! Ne confondons pas. Sans quoi la religion serait encore la science, comme elle l'était jadis, à l'éveil de l'intelligence humaine. (Souriant à demi.) Et ce n'est pas le cas...
L'ABBÉ (avec feu).—Alors quand, de bonne foi, vous mettez votre raison en face du christianisme...
JEAN (vivement).—Mon cher abbé, nous discuterions ainsi jusqu'à l'aube, sans nous convaincre.
(Souriant.) Je suis bien revenu de ces controverses interminables... Il y a entre un croyant et un athée, un abîme tel, qu'ils se combattraient toute une vie sans s'être compris. J'ai été souvent mis au pied du mur par des théologiens avertis et bien armés. Le plus souvent, je ne trouvais, je l'avoue, pas grand'chose à leur répondre. Mais cela n'ébranlait en rien ma conviction. Je savais, avec certitude, qu'il y avait une réponse, et qu'il aurait suffi d'un hasard, d'une association d'idées heureuse, ou d'une soirée de réflexion pour la trouver.—Des arguments? Mais on en trouve toujours, et pour toutes les causes, en cherchant un peu...
L'abbé fait un geste d'impuissance définitive.
Jean sourit affectueusement, et s'approche de lui, jusqu'à lui prendre le bras.
JEAN.—Voyez-vous, on ne se convertit pas pour des raisons logiques: voilà la certitude à laquelle je suis arrivé. On se contente d'étayer, par des arguments logiques, une conviction que l'on porte en soi: et cette conviction n'est pas motivée, comme on le croit, par des syllogismes et des raisonnements, mais par une disposition naturelle, plus forte que toutes les dialectiques.
Je crois que l'on naît prédisposé à la foi ou au doute; et que tout les raisonnements ne peuvent pas grand'chose, ni pour, ni contre...
L'abbé ne répond pas.
L'air a fraîchi tout à fait. Le soir tombe vite. Le soleil n'est
plus qu'une ligne orangée, parmi des brumes violettes, au ras de
l'horizon.
Devant eux, s'étend un blé naissant, d'un vert uni, à peine duveté par le brouillard qui se lève; et sur cette nappe soyeuse, se mêlent le reflet rosé du jour qui meurt, et l'éclat laiteux de la lune.
Ils pressent le pas.
Dans un chaume, des corbeaux s'élèvent, en rafale, pour
s'abattre plus loin, sur des pommiers noirs.
Un long silence.
L'ABBÉ.—Et ... pour votre femme ... que va-t-il arriver?
JEAN (simplement).—Ma femme? Mais il y a trois ans, au moins, que je pense tout ce que je vous ai dit ce soir... Alors?
Il n'y a aucune raison pour que ça change...
L'abbé hoche la tête, incrédule.
Au Collège Venceslas,
Huit heures du matin: l'heure de la classe.
Jean monte allègrement sur l'estrade et s'installe.
UN ÉLÈVE (s'approchant).—Pardon, Monsieur... M. le Directeur ne vous a pas remis un cahier pour moi?
JEAN.—Non, pourquoi?
L'ÉLÈVE.—M. le Directeur m'avait demandé mes notes, hier soir. Il devait me les rendre ce matin.
JEAN.—Quelles notes? Celles que vous prenez à mon cours?
L'ÉLÈVE.—Oui, Monsieur.
JEAN (le congédiant).—On ne m'a rien apporté.
Sur les bancs, un bouillonnement de cuve qui fermente. Il faut quelques minutes pour que les individualités, éparses depuis la veille, s'agglomèrent à nouveau. Les têtes se dressent et s'abaissent. Puis l'ordre renaît. Quelques pensées parasites semblent bien encore voleter par-ci par-là, à la surface. Mais le silence s'établit: la masse est étale.
Jean, levant les yeux, heurte cinquante regards convergents vers lui. Il se sent cloué à sa chaire par ce faisceau d'attentes braquées. Muette injonction, qui accélère les battements de son cœur et déclenche son élan.
JEAN.—Je vous demande aujourd'hui, Messieurs, une attention plus soutenue que jamais.
Il respire largement, enveloppe sa classe d'un coup d'œil de conquête, et poursuit.
Nous avons terminé l'autre jour, l'ensemble des leçons que je désirais consacrer à l'origine des espèces. Je sais que vous avez compris l'importance de ce problème capital. Mais je ne puis me résoudre à clore ce chapitre de notre cours, sans un regard en arrière, sans une courte récapitulation des points qui me paraissent...
La porte s'ouvre; toute la classe est debout. Le Directeur entre.
Jean s'est levé, surpris.
M. l'abbé Miriel, directeur du Collège Venceslas:
Un prêtre de soixante ans passés. Grande aisance d'allure, malgré son âge et sa forte charpente.
Un masque fin, quelque peu empâté. Le front dégarni et taché de rousseurs. Entre des paupières qui se lèvent et qui s'abaissent très vite, un regard pâle, d'une lucidité avertie et sans indulgence. Sur les lèvres minces, un sourire d'enfant, factice peut-être, mais d'un grand charme.
LE DIRECTEUR (aux jeunes gens).—Asseyez-vous, mes enfants.
Je vous prie de m'excuser. Monsieur Barois: j'avais oublié de rendre ce cahier à l'un de vos élèves... (Sourire bonhomme.) Et, ma foi, puisque je suis entré, l'envie me prend de ne pas m'en retourner sans tirer quelque profit de ma visite... Voulez-vous me permettre d'entendre un peu de votre leçon du jour?—... Non, non, ne vous dérangez pas. (Il avise un banc vide, en retrait.) Je serai très bien là... (S'asseyant.) Et je vous en prie, que ma présence ne change rien à vos habitudes...
Jean a rougi, puis pâli.
La suspicion du procédé ne lui échappe pas. Il lutte, une seconde, contre la tentation d'atténuer le sens de la leçon préparée. Mais, bravement, avec un léger tremblement de défi dans la voix, il reprend son cours.
JEAN (se tournant vers le Directeur).—Je m'apprêtais, Monsieur le Directeur, à résumer les quelques leçons que nous avons employées à l'étude de l'origine des espèces. (L'abbé incline la tête, en signe d'assentiment.)
(A ses élèves.) Je vous ai expliqué la place essentielle que Lamarck, et après lui, Darwin, doivent occuper dans cette science des origines, qui ne s'est constituée qu'après eux, et toute entière de leur héritage; Lamarck surtout; et je crois vous avoir prouvé que sa théorie de l'évolution, ou mieux, du transformisme,—découverte plus générale et moins sujette à controverses que celle de la sélection naturelle,—doit être considérée comme une vérité scientifique définitivement acquise.
Il jette un regard vers le Directeur.
L'abbé écoute, les paupières baissées, ses deux mains blanches posées devant lui, impénétrable.
JEAN.—Nous avons vu en effet, qu'avant Lamarck, la science n'expliquait aucun des phénomènes de la vie. On avait dû supposer que toutes les espèces, aujourd'hui connues, avaient été créées successivement, et chacune en possession de tous ses caractères actuels. Lamarck a véritablement trouvé le fil d'Ariane du labyrinthe universel.
J'ai longuement développé devant vous, les raisons qui doivent aujourd'hui nous faire accepter avec certitude l'existence de cette filière indéterminée d'êtres, qui nous relie à la matière universelle. Depuis la monère initiale, à peine distincte des molécules du milieu organique dont elle était formée,—ancêtre informe de nos cellules, auprès de laquelle les plus simples expressions actuellement connues de la vie, sont des produits infiniment complexes,—jusqu'aux mécanismes les plus compliqués de la physiologie et de la psychologie humaine, à travers des milliers de siècles, la pensée de Lamarck a retrouvé et fixé l'échelle des êtres et leur progression ininterrompue.
Puis,—et ceci a un intérêt d'actualité—je vous ai mis en garde contre la prétendue crise que le transformisme aurait subi, depuis la découverte des variations brusques. Vous vous souvenez, qu'à des intervalles d'immobilité de l'espèce, peuvent succéder de brusques mutations, qui s'expliquent par l'accumulation d'efforts orientés dans le même sens, pendant des séries de générations. Je vous ai démontré que si l'on veut, de bonne foi, atteindre le fond de la question, cette théorie est en tous points conciliable avec la doctrine de Lamarck.
Une pause.
Depuis l'arrivée du Directeur, Jean a senti sa classe lui échapper.
Sa parole frappe une trame distendue; et lui-même, à s'appuyer
sur ce vide, perd peu à peu l'équilibre.
Alors, renonçant à récapituler ses leçons précédentes, il change résolument de sujet.
JEAN.—J'ai cru utile de procéder rapidement à cette revision. Mais le but de notre leçon d'aujourd hui est autre.
Dès les premiers mots, sa volonté qui s'exprime dans sa voix, ressaisit les mailles dénouées. La trame brusquement retendue, offre à nouveau aux mots qu'il jette son élasticité de raquette.
JEAN.—Je veux surtout graver dans vos mémoires, et de telle façon qu'elles n'en puissent jamais perdre l'empreinte, l'importance essentielle du transformisme; son utilité indispensable pour la formation des intelligences modernes; pourquoi il est, en quelque sorte, le noyau de toute la science biologique; et comment l'on doit reconnaître, sans dépasser les limites d'une scrupuleuse exactitude scientifique, que cette nouvelle façon d'envisager la vie universelle a pu modifier entièrement les bases de la philosophie contemporaine, et renouveler dans leur fond et dans leur forme, la plupart des concepts de l'esprit humain.
Entre Jean et sa classe, s'est rétabli un incessant échange de courants. Il la sent onduler et frémir à son commandement.
Le Directeur lève les yeux. Jean croise son regard qui n'exprime rien.
JEAN.—Du jour où nous avons compris l'activité ininterrompue de «ce qui est», nous ne pouvons plus concevoir la vie comme un principe créateur de mouvement, qui viendrait animer une inertie. Lourde erreur, dont nous portons encore le poids sur nos épaules, et qui, dès l'origine de la pensée, a faussé toute l'observation des phénomènes vivants!—La vie n'est pas un phénomène dont on puisse concevoir le début, puisque c'est un phénomène qui se poursuit sans discontinuer. Ce qui revient à dire: le monde est; il a toujours été, et il ne peut pas ne plus être; il n'a pu être créé: l'inerte n'existe pas.
Du jour où nous avons compris qu'un être, à deux instants de sa courbe, ne peut en aucune façon être identique à lui-même, nous perdons de ce fait tous les points d'appui, que l'illusion individualiste des hommes avait échafaudés, pour soutenir la gageure du libre arbitre; et nous ne pouvons plus concevoir un être qui jouirait d'une liberté absolue.
Du jour où nous avons compris que notre faculté raisonnante n'est que l'apport, à travers les âges, des expériences ancestrales, apport transcris en nous sans contrôle par les lois multiples et capricieuses de l'hérédité, nous ne pouvons plus accorder la même créance aux notions absolues de l'ancienne métaphysique et de l'ancienne morale.
Car le transformisme, dont la loi domine tout, domine aussi l'évolution de la conscience humaine.
Et c'est pourquoi Le Dantec, l'un des esprits les plus avertis et les plus indépendants de la science contemporaine, a pu déclarer: «Pour un transformiste convaincu, la plupart des questions qui se posent naturellement à l'esprit humain, changent de sens: quelques-unes même, n'ont plus de sens du tout.»
Le Directeur se lève d'un mouvement sec, malgré sa carrure. Il tourne vers la chaire son masque sévère, où les yeux sont à demi-clos.
LE DIRECTEUR.—Très intéressant, Monsieur Barois... Vous mettez votre enseignement une louable chaleur, qui le rend très vivant... (Aigre sourire.) Nous en recauserons d'ailleurs...
(Aux élèves, avec une bonhomie paternelle.) Ce qu'il faut retenir de tout cela, mes enfants,—et j'anticipe sans doute sur la conclusion que Monsieur Barois allait tirer de sa leçon,—c'est l'impeccable ordonnance du plan suprême... Notre pauvre raison n'approche qu'en tâtonnant de ces grandes lois; mais elle en reste confondue... Et cet acte d'humilité devant les merveilles du Créateur est d'autant plus nécessaire, que nous vivons en un siècle où les progrès des découvertes scientifiques tendent trop à nous faire perdre le sentiment de notre petitesse et de la relativité de notre savoir... (Il s'incline avec une extrême réserve.) Je vous laisse, Monsieur Barois... Au revoir...
La porte est à peine refermée, qu'un remous houleux fait osciller l'âme mobile de la classe.
Jean, debout, rassemble d'un vif coup d'œil le faisceau des regards qui s'éparpillaient.
Communion silencieuse et passionnée, qu'aucun blâme administratif ne pourra atteindre.
JEAN (simplement).—Je continue...
A Buis, chez Mme Pasquelin, pendant les grandes vacances.
Cécile est dans ta chambre, debout, en chemise, devant la
fenêtre ouverte.
D'un geste inconscient elle caresse la courbe déformée de son ventre. Les traits, autrefois vifs, sont voilés d'indifférence: le regard lointain des femmes alourdies.
Neuf heures du matin: un ciel lisse, d'où coule un soleil
jaune et fluide comme du miel.
On frappe à la porte, qui s'ouvre aussitôt.
CÉCILE (rougissant comme une enfant).—C'est toi, maman?...
MADAME PASQUELIN.—Oui, c'est moi!
Au ton de sa mère, Cécile lève les sourcils avec angoisse.
MADAME PASQUELIN.—Tiens, regarde! (Elle brandit une brochure blanche, et saisissant son face-à-main, elle épèle): «Bulletin du Congrès de la Libre-Pensée!... Monsieur Barois, chez Madame Pasquelin!... Buis-la-Dame, Oise»...
(Un temps.) Où est-il?
CÉCILE.—Jean? Je ne sais pas.
MADAME PASQUELIN.—Tu ne l'as pas vu encore?
CÉCILE.—Non.
MADAME PASQUELIN.—Il n'est plus dans sa chambre.
CÉCILE.—Il aura été faire sa promenade.
MADAME PASQUELIN.—Alors, non seulement, vous avez chacun votre chambre, mais il ne vient même plus te dire bonjour, avant d'aller se promener?
Cécile s'assied; geste résigné et las.
MADAME PASQUELIN (jetant la brochure sur les genoux de Cécile).—Eh bien, tu lui remettras ça, toi, si tu veux... Et tu lui diras, de ma part, qu'il se fasse adresser ça ailleurs que chez moi...
D'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe... (Soulevant une enveloppe décachetée.) Je reçois ce matin un mot de l'abbé Miriel...
CÉCILE.—Le directeur de Jean?
MADAME PASQUELIN.—Il prend ses vacances en ce moment à l'évêché de Beauvais, chez son frère, «et serait heureux, si j'avais ces jours-ci l'occasion de l'y rencontrer.» Il désire me «faire une communication personnelle»...
CÉCILE (inquiète).—Que peut-il vouloir te dire?
MADAME PASQUELIN (sombre).—Hé, je n'en sais rien, ma pauvre enfant Mais je vais y aller cet après-midi, je veux en avoir le cœur net.
Elle se penche brusquement, saisit le front de sa fille et y colle ses lèvres sèches, avec une petite aspiration bruyante qui ressemble à un sanglot. Puis, relevant un visage clos et courroucé elle quitte la pièce à pas sonnants.
Deux heures plus tard.
Cécile achève sa toilette.
JEAN (entrant).—Bonjour.
CÉCILE.—Tu as vu maman?
JEAN.—Non, je suis sorti de bonne heure.
CÉCILE (désignant le bulletin).—Maman a monté ça pour toi.
La physionomie de Jean s'éveille.
JEAN.—Ah oui, je sais... Je l'attendais... Merci.
Il rompt la bande, s'assied sur le lit et feuillète les pages avec intérêt.
Cécile le suit d'un regard curieux et hostile.
Il surprend l'interrogation et ne s'y dérobe pas.
JEAN.—C'est le programme d'un congrès qui se tient à Londres cette année, en décembre...
CÉCILE (sur la défensive).—Mais ... en quoi cela te concerne-t-il?
JEAN (tranchant).—Ça m'intéresse. (Mouvement de Cécile.) Et puis on m'a demandé d'en faire un rapport, pour une revue.
CÉCILE (nettement).—Qui, on?
JEAN (brusque).—Breil-Zoeger.
CÉCILE.—J'en étais sûre!
JEAN (glacial).—Oh, je t'en prie, Cécile...
Un silence.
Jean s'est remis à feuilleter le bulletin.
CÉCILE (avec désespoir).—Je ne veux pas que tu t'occupes de ça!
Jean, sans cesser de lire, grimace un mauvais sourire.
JEAN.—Comment dis-tu? Tu ne veux pas?...
Il met la brochure dans sa poche et s'avance vers elle.
JEAN (sans acrimonie).—Écoute, ma petite, laisse-moi tranquille avec cette histoire...
Ce congrès ne se tient que tous les dix ans... (Il se promène de long en large, sans la regarder.) C'est un mouvement international, dont tu ne peux pas soupçonner le retentissement.—De plus, les matières inscrites cette année au programme, m'intéressent personnellement beaucoup. Zoeger m'avait proposé d'y prendre une part active, comme correspondant spécial de la Revue internationale des Idées, qui est, en France, l'organe de ce mouvement. J'ai failli accepter ... (Mouvement de Cécile) ... et puis, j'ai refusé à cause de mon cours à Venceslas. Mais, le moins que je veuille faire, c'est d'assister aux dernières séances, qui auront justement lieu pendant les vacances du jour de l'an, et de publier sur les conclusions du congrès, un rapport pour la section française.
C'est convenu, il n'y a plus à y revenir.
Elle ne répond rien.
Il fait quelques pas en silence, et se décide enfin à lever les
yeux vers elle.
Elle est écroulée comme un animal qu'on vient d'abattre. Ses prunelles dilatées s'emplissent d'angoisse, comme si elle allait s'évanouir.
Il s'élance, il la relève, il l'étend sur son lit.
Une pitié subite, poignante, impérieuse...
JEAN (avec une résignation morne).—C'est bien, c'est bien.. Remets-toi... Je n'irai pas, c'est entendu...
Elle reste un instant immobile, les yeux clos.
Puis elle le regarde, sourit simplement, et prend sa main.
Mais il s'écarte. Il s'approche de la fenêtre. Ah, elle est la plus forte! Avec cette souffrance vraie qui la ronge, et qu'elle étale, elle est invincible!
Il entrevoit tout ce que son renoncement lui fait perdre: l'occasion unique d'entendre résumer, combattre, défendre, passer au crible de la contradiction publique, cet ensemble d'idées, dont, depuis cinq ans, il cherche dans les ténèbres à se faire une doctrine vitale...
Un immense écœurement...
Pitié pour elle, soit: mais pitié pour lui!
JEAN (sans se retourner, d'une voix sourde et violente).—Vois-tu... Voilà pourquoi je ne serai jamais qu'un raté! Et ce n'est même pas ta faute, tu ne peux pas faire autrement... Toutes les réalités les plus pressantes de ma vie, tu ne les aperçois pas, tu ne les soupçonneras jamais! Pour toi, ce seront toujours des manies inutiles, ou, ce qui est pis, honteuses, criminelles... C'est ta nature, c'est comme ça que tu es vraiment toi! L'atmosphère que tu crées autour de moi, j'y étouffe!... Tout mon courage, toute mon activité s'y dissolvent... Le seul bonheur que tu peux m'offrir, la petite affection dont tu es capable, ne pourront jamais que me nuire, me rapetisser à ta mesure! Voilà la vérité, l'atroce vérité... Du fait que tu es là, dans ma vie, elle est gâchée, quoi que je fasse!... Et, quoi que je fasse, tu resteras là, dans ma vie, toujours! Tu briseras mes élans un à un, et tu ne t'en douteras même pas, tu n'auras jamais une lueur, pour comprendre ce que tu es!... Toute ta vie tu pleureras sur tes petits chagrins à toi...
(Explosion.) Et moi, par ta faute, je suis foutu,—irrémédiablement foutu!
Elle n'a pas fait un mouvement.
Rien autre dans son regard qu'une douloureuse surprise...
Alors, il hausse les épaules. Et, la bouche sèche, les épaules
lourdes, il quitte la chambre.
«A M. l'Abbé Miriel
Directeur du Collège Venceslas
«Paris.
«17 Août
«Monsieur le Directeur,
«Vous me permettrez tout d'abord d'être surpris que vous ayez cherché un tiers pour me faire connaître votre opinion sur mon enseignement. Sans insister davantage sur un procédé qui manque de courtoisie, pour ne pas dire plus, je veux tout de suite aborder avec vous les critiques que vous formulez à mon endroit. Je ne risque pas de m'égarer, puisque vous avez pris soin de résumer vos griefs en une note, dont j'ai obtenu communication, et qui se termine, si j'ai bien compris, par un ultimatum formel.
«Voici la quatrième année que je suis chargé par vous d'enseigner les sciences naturelles à des jeunes gens de dix-sept et de dix-huit ans. Je n'ai pas voulu me contenter d'un cours uniquement pratique, car il y a, pour le maître, une obligation supérieure à celle de préparer strictement les matières d'un examen: c'est de porter à un degré plus élevé l'éducation générale de ses élèves, et de donner des motifs d'exaltation à leurs personnalités naissantes.
«Je ne désavoue nullement l'orientation que j'ai cherché à donner à mes leçons.
«Si je me suis, en maints endroits, évadé hors des barrières que l'on a dressées, dans les établissements catholiques, autour des sciences naturelles, ce n'est donc pas par mégarde. J'estime qu'il n'y a pas d'autre arrêt pour la pensée que les limites mêmes de son élan, et que, pour ce vol, on ne prendra jamais trop d'essor.
«Votre blâme m'a donné l'occasion d'apercevoir qu'en matière d'enseignement scientifique, un homme sincère ne peut s'engager à professer selon certaines règles convenues. Un jour ou l'autre, en effet, il est amené à conclure; et ce jour-là, toute sa vie intellectuelle tend à s'exprimer: s'il a quelque dignité, comment apporterait-il, à ceux qui l'écoutent, autre chose que le résultat de ses propres réflexions, de sa propre expérience? Qu'on le veuille ou non, l'analyse scientifique des phénomènes de la vie mène droit à la philosophie.—C'est même, selon moi, la seule philosophie qui compte.
«Or il faut, pour traiter ces questions avec l'ampleur qu'elles réclament, une liberté de pensée et d'expression qui, j'en conviens, n'est guère conciliable avec l'esprit de votre maison. Je suis donc prêt à reconnaître qu'à ce point de vue, j'ai outrepassé le mandat qui m'était confié.
«Mais, comme je ne saurais modifier l'esprit de mon cours, et que je tiens essentiellement à me présenter devant mes élèves, tel que je suis, en homme libre qui s'adresse à des intelligences libres, je ne vois pas d'autre solution que de vous donner ma démission.
«Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de mes sentiments distingues.
Jean Barois.»
Cinq heures.
Au jardin.
Mme Pasquelin et Cécile cousent à l'ombre d'un parasol de
toile, près de l'espalier qui borde l'enclos.
Assises sur des chaises voisines, elles parlent bas, sans mouvoir
les lèvres.
Jean paraît au perron, sa lettre dépliée à la main. Il franchit, en
approchant, comme la résistance d'une zone hostile.
Un silence l'accueille.
JEAN.—Je veux vous tenir au courant de ma réponse à l'abbé Miriel Je lui envoie ma démission.
L'assurance de sa voix fait frissonner les deux femmes.
Mais Mme Pasquelin, d'instinct plus combattif, dissimule d'abord son anxiété.
MADAME PASQUELIN.—Ta démission? Tu plaisantes?
Cécile a laissé tomber son ouvrage sur ses genoux. Elle présente le front, lisse et bombé comme une cuirasse.
Depuis hier elle vit dans une stupeur désespérée. Le jugement du Directeur de Venceslas lui a fait prendre conscience de toute la réalité: elle s'inquiète peu de la situation compromise; elle ne pense qu'au salut éternel: Jean est un athée!...
JEAN.—Vous semblez surprises. Je me demande pourtant ce que vous pouviez prévoir? L'ultimatum...
MADAME PASQUELIN (avec vivacité).—Oh, il n'a jamais été question d'ultimatum. Tu dramatises tout!
L'abbé Miriel a été très peiné de ce que tu osais dire à tes élèves; mais il n'a jamais pensé à te congédier. Il ne le voudrait pas ... ne fût-ce que par égard pour moi. Il exige seulement que tu fasses ton cours autrement; (souriant) tu avoueras qu'il sait mieux que toi ce que tu dois faire, puisqu'il est ton Directeur...
Jean détourne les yeux sans répondre.
Mme Pasquelin veut prendre avantage de ce silence. Et avec une bonhomie factice, elle cherche à pallier le débat.
MADAME PASQUELIN.—Allons, voyons, ne fais pas de sottises. Tu t'es monté la tête. Le Directeur lui-même n'attache pas à ces incartades plus d'importance qu'il ne faut; il est prêt à les oublier. (Son sourire feint est douloureux à voir.) Allons, ne t'entête pas... Déchire cette lettre, et va lui en écrire une autre...
JEAN (avec lassitude).—Ne discutons pas. Ma décision est prise.
MADAME PASQUELIN (violemment).—Tu ne peux pas faire ça! N'est-ce pas, Cécile?
JEAN.—C'est fait.
MADAME PASQUELIN.—Non. Je te défends d'envoyer cette lettre.
JEAN (perdant patience).—Mais enfin, si l'on vous demandait à l'une ou à l'autre, de renier vos croyances religieuses pour conserver un emploi qu'est-ce que vous répondriez?
MADAME PASQUELIN (furieuse).—Comme si c'était la même chose!
JEAN.—Oui, je sais: Ce n'est pas «la même chose». Eh bien, vous vous trompez: c'est tellement la même chose, que je n'ai pas hésité une seconde! J'aurais même dû comprendre plus tôt que je n'étais pas à ma place dans ce collège de prêtres, et m'en aller de moi-même. Je regrette de m'être laissé aveugler si longtemps.
Mme Pasquelin reste perplexe. Le masque de Jean, son regard froncé, sa bouche volontaire, l'effrayent. Elle maîtrise sa colère.
MADAME PASQUELIN.—Jean, je t'en supplie... Si tu perds ce poste, qu'est-ce que tu feras?
JEAN.—Oh, soyez sans crainte; je ne manque ni de projets, ni de moyens de dépenser mon activité.
MADAME PASQUELIN.—De beaux projets! Tu ne pourras que t'ancrer plus profondément dans tes mauvaises idées!
JEAN (saisissant l'occasion).—Certes! Maintenant que je suis libre (il soulève sa lettre,) je ne me plierai plus à toutes les concessions, à tous les compromis auxquels j'ai consenti jusqu'ici, et dont j'ai honte vis-à-vis de moi-même... C'était une transition, soit: mais le temps en est révolu.
Cécile, atteinte au vif, s'est redressée.
CÉCILE.—«Maintenant que tu es libre», Jean? Et moi?
JEAN (interloqué).—Toi? Eh bien?
Ils se toisent, heurtant deux regards où ne subsiste aucune trace des tendresses passées.
CÉCILE.—J'ai été trompée par toi! J'ai été trompée par ton passé, par tes paroles, par ton attitude! Ne l'oublie pas!
MADAME PASQUELIN (se jetant à la traverse).—Crois-tu qu'elle puisse tolérer que son mari soit un athée, un ennemi de notre religion? Mais c'est abominable! Élevé comme tu l'as été!
JEAN (répondant à Cécile seule, sur un ton angoissé et sombre).—Ce qui est fait est fait. Tu souffres? Moi aussi...
Je ne peux pas empêcher mes idées d'évoluer, d'être vivantes... Ce n'est pas moi qui dois les diriger, mais elles qui doivent diriger ma vie!
CÉCILE (durement).—Non. Tant que je serai là, non!
MADAME PASQUELIN (affermie par la résistance inattendue de sa fille).—Non! Elle te quitterait plutôt! N'est-ce pas, Cécile?
Cécile, oppressée, hésite une demi-seconde, puis fait un brusque signe d'assentiment.
Jean guettait sa réponse: il hausse les épaules.
Court silence.
Mme Pasquelin regarde Cécile avec un sentiment nouveau.
Au fond obscur de son âme maternelle, il y a eu un bref éclair,
un espoir, qui oriente malgré elle ses paroles.
MADAME PASQUELIN.—C'est trop bête à la fin! Tu viens empoisonner notre vie, avec tes idées... Tes idées! Tout le monde en a, des idées! Tu n'as qu'à avoir celles de tout le monde! (Jouant le dernier atout.) Si tu ne renonces pas à cette lettre, si tu n'es pas décidé à reprendre l'existence d'autrefois, comme autrefois, Cécile ne rentrera pas à Paris avec toi!
JEAN.—Tu entends. Cécile?
Cécile est liée par son acquiescement.
CÉCILE.—Maman a raison.
JEAN.—Si je donne ma démission, tu ne rentreras pas à Paris avec moi?
CÉCILE.—Non.
JEAN (froidement, à sa belle-mère).—Vous voyez la belle besogne que vous faites.
Il saisit une chaise, l'approche de Cécile, et s'y plante à califourchon.
JEAN.—Écoute Cécile, et pas de bêtises... Je te jure que je ne plaisante pas.
(Longue aspiration.) Je pourrais te promettre des concessions nouvelles, pour sauver notre vie commune. Mais non, je veux continuer à agir loyalement. J'ai accepté pour toi le maximum des sacrifices que je peux faire, il est impossible que je persiste dans cette voie sans perdre toute dignité, toute propreté morale! Ce que tu me demandes, c'est de jouer pendant toute ma vie une lugubre comédie: c'est de paraître, par une attitude passive, par une simulation continuelle, approuver une religion que je ne peux plus pratiquer. Il faut que tu comprennes une fois pour toutes, qu'il y a là quelque chose qui dépasse les convenances personnelles. Un honnête homme ne peut pas s'engager à exprimer toute sa vie le contraire de sa pensée: fût-ce par affection... Tu ne peux pas me faire un grief de cette loyauté morale, même si elle te fait souffrir!
Pause.
Veux-tu rentrer avec moi à Paris, en octobre, comme c'était convenu?
CÉCILE (désespérément raidie).—Non.
JEAN (écartant de la main Mme Pasquelin).—Cécile: écoute-moi bien! (Un temps.) Si tu refuses de m'accompagner à Paris, si tu romps sciemment les seuls liens que je veuille encore ménager, alors, rien ne me retiendra plus... Et j'irai passer l'hiver à Londres, au congrès dont je t'ai parlé.
MADAME PASQUELIN (éclatant).—Mais tu veux donc la tuer! Dans la situation où elle...
Cécile s'est dressée et s'est rapprochée de sa mère.
CÉCILE (sanglotant).—C'est tout réfléchi. J'aime mieux te perdre tout à fait que de vivre avec un païen!
Jean se lève.
Il les contemple toutes deux, frappé soudain de leur ressemblance... Ce front busqué, cet œil rond et noir, et ce regard contrarié, dont l'émotion accuse l'asymétrie, ce regard incertain, qui dans la discussion se dérobe...
JEAN (tristement).—Tu l'auras voulu, Cécile, tu l'auras voulu...
Réfléchis jusqu'à ce soir. En me laissant partir seul, tu lèveras tous mes scrupules: tu me rendras toute ma liberté.
Je vais mettre ma lettre à la poste.
«A M. Breil-Zoeger
«Directeur de la Revue Internationale des Idées
«78, boulevard Saint-Germain
«Paris
«20 Août.
«Cher ami,
«De grands changements sont survenus, en quelques jours, dans ma vie. J'ai donné ma démission de professeur à Venceslas, et je me trouve, à tous égards, beaucoup plus libre que je ne pouvais le prévoir. Je puis disposer à ma guise de mon hiver, et faire un long séjour à Londres. J'accepterais donc très volontiers la place active que tu m'avais primitivement réservée au Congrès, si cette place est encore sans titulaire.
«Je ne resterai pas dans l'Oise jusqu'à la fin des vacances, comme je te l'avais annoncé. Je rentre à Paris ce soir.
«Peux-tu me consacrer une matinée de cette semaine?
«Bien à toi,
J. Barois.»
À Londres.
Une chambre d'hôtel
Le soir. Un plafonnier électrique verse une lumière impitoyable. Les rideaux tirés feutrent les bruits de la rue.
Breil-Zoeger est étendu sur son lit. Soulevé sur un coude, il concentre son regard sur une femme d'une cinquantaine d'années, assise à une petite table, et qui relit le compte-rendu sténographié de la séance du jour.
Jean va et vient, les bras croisés,—sous pression.
LA STÉNOGRAPHE (lisant).—... ce qu'en 1879, un Suisse, Vinet, écrivait déjà: «C'est de révolte en révolte que les sociétés se perfectionnent, que la civilisation s'établit, que la justice règne... Liberté de la presse, liberté de l'industrie, liberté du commerce, liberté de l'enseignement, toutes ces libertés, comme les pluies fécondes de l'été, arrivent sur les ailes de la tempête!»
JEAN (interrompant).—... Ici, quelques applaudissements; surtout les Suédois, les Danois, les Russes. Alors le président a pris la parole, il a résumé les débats...
Zoeger, les sourcils froncés, ponctue d'un signe d'assentiment chaque membre de phrase.
JEAN.—... Il a expliqué que tu venais d'être subitement immobilisé par une crise hépathique; puis il a donné lecture du mot où tu me désignais pour parler demain à ta place, et la proposition a passé, à l'unanimité.
ZOEGER.—Woldsmuth t'a communiqué les chiffres exacts?
JEAN.—Oui. Et j'ai prévenu Backerston que je ne siégerais pas à la commission des réformes.
Zoeger approuve de la tête.
Breil-Zoeger: la trentaine.
Né à Nancy, de parents alsaciens. Mais, dans la coupe du visage, quelque chose de japonais, qu'accentue sa maladie de foie: un teint jaune, un masque élargi aux pommettes, des sourcils bridés, une moustache maigre et tombante, un menton pointu.
L'arcade sourcillière est très saillante: au fond des orbites, les prunelles, toujours dilatées, d'un noir luisant et dur, ont une expression fiévreuse, aigüe, aride, qui contraste avec la douceur générale des traits.
La voix est monotone, sans timbre, agréable au premier abord,—mais d'une implacable sécheresse.
ZOEGER.—Madame David, cherchez donc les notes que vous avez sténographiées ces jours-ci... Un dossier vert: «Problème religieux en France.»—Merci.
JEAN.—Tu préfères que je dicte devant toi, comme ce matin?
ZOEGER.—Oui, ça vaut mieux.
JEAN.—J'ai préparé la deuxième et la troisième partie, mais en intervertissant l'ordre de ton plan. Je t'expliquerai...
Breil-Zoeger s'allonge avec une grimace de souffrance.
JEAN.—Tu souffres?
ZOEGER.—Par intermittences...
Quelques instants de silence.
JEAN (tirant des papiers de sa poche).—Nous en étions à la seconde partie:
«CAUSES DE L'ÉBRANLEMENT GÉNÉRAL DE LA FOI».
Vous y êtes, Madame David?
(A Zoeger.) Première cause: l'extension qu'ont prise depuis cinquante ans les études des sciences naturelles. A mesure que l'effort humain restreint le nombre des ignorances, dont l'homme, depuis des siècles, avait constitué sa croyance en Dieu, cette part divine se réduit inévitablement...
ZOEGER.—Tu pourrais rappeler brièvement...
JEAN.—Notez, Madame...
ZOEGER.—... quelques données scientifiques qui permettent de démontrer, dès maintenant, l'impuissance de leur Dieu sur le cours inéluctable des phénomènes, et par suite l'impossibilité du miracle, l'inefficacité des prières, et cœtera...
JEAN.—Si tu veux...
Seconde cause: Les travaux historiques.
ZOEGER.—Passe rapidement..
JEAN.—Non, c'est un point très important. Je tiens à rappeler le grand pas qui s'est trouvé fait, le jour où l'on a pu, textes en mains, décomposer la formation des légendes, et montrer que, dans cette formation, il n'est entré que des éléments humains, groupés autour d'un fait très simple, mais que la naïveté populaire a enveloppé de merveilleux.
Pour placer ensuite cette idée: Comment peut-on «croire», quand on a suivi d'âge en âge l'histoire des religions, et aperçu les diverses crédulités, toutes intransigeantes, par lesquelles le pauvre cerveau des hommes a déjà passé?
ZOEGER.—Bien.
JEAN.—Puis une transition: le progrès scientifique ne peut atteindre que les intelligences cultivées; il n'aurait pas suffi, pour ébranler une religion qui a tant de racines dans les cœurs français.
Et j'en arrive... (On frappe.) ... aux facteurs économiques et sociaux...
(Allant ouvrir.) Qu'est-ce que c'est?
UNE VOIX.—Le Times... Demander des renseignements sur l'indisposition de M. Breil-Zoeger... Sur le discours de demain...
JEAN.—Adressez-vous au 29, le secrétaire-adjoint, Monsieur Woldsmuth.
(Revenant vers le lit.) Où en étais-je? Ah, troisième cause: Facteurs économiques et sociaux. Le développement prodigieux des industries a fait sortir des campagnes des milliers de jeunes hommes, qui rompent ainsi, brutalement, les liens familiaux traditionnels...
ZOEGER.—Insiste; c'est capital, si l'on songe au nombre considérable d'usines qui fonctionnent dans un pays civilisé,—nombre qui doit fatalement s'accroître encore, et dans des proportions incalculables.
Il feuillète son dossier, en tire une fiche, et change de position, avec une contraction douloureuse.
ZOEGER (lisant).—«L'ouvrier industriel est, par fonction, rationaliste. Jeté dans un grand centre d'action, où les spéculations métaphysiques n'ont plus leur place; vivant au milieu de machines, dont les ronflements célèbrent le triomphe du travail, de l'intelligence, des mathématiques, sur la nature...» (Tendant la feuille.) Tiens, si ça peut te servir.
Continue.
JEAN.—C'est là que je veux placer le tableau, dont je t'ai parlé: La nation française, actuellement divisée en deux camps bien tranchés: d'un côté, les incrédules; de l'autre, les croyants.
Les incrédules, qui comprennent tout le prolétariat, déjà cité, et tous les intellectuels. Majorité numérique incontestable. Puis...
ZOEGER.—Ajoute donc, parmi les incrédules, les demi-instruits, les «Homais»; il y a là une réhabilitation à ébaucher... Il est vraiment trop facile de les ridiculiser, ces malheureux, parce qu'ils n'ont pas eu le loisir d'appuyer sur des études véritables leur crédulité instinctive, et que pourtant, par leur simple bon-sens, par le seul équilibre de leur santé morale, ils sont irrésistiblement poussés vers les solutions moins confuses de la science.
JEAN.—Oui, très juste.
Quant aux croyants, ils sont naturellement recrutés parmi les deux classes conservatrices: paysans et bourgeois. Les paysans vivent loin des villes, dans un cadre immuable où les traditions se perpétuent toutes seules. Les bourgeois, eux, sont en réaction systématique contre toute évolution; ils sont intéressés à la conservation intégrale de l'ordre établi, et particulièrement attachés à l'Église catholique, qui musèle depuis des siècles les appétits des déshérités; de plus, ils ont l'habitude d'expliquer la vie par des formules toutes faites, et leur bien-être serait compromis s'ils y laissaient pénétrer le doute...
Mais, entre ces deux camps distincts, oscille un nombre considérable d'indécis, écartelés entre les exigences de leur logique...
(On frappe. Avec impatience.) Entrez!
UN DOMESTIQUE.—Here is the mail, Sir...
JEAN.—Mettez ça là, je vous prie.
Le domestique dépose le courrier et sort.
JEAN (reprenant ses allées et venues).—... Les indécis ... écartelés entre les exigences de leur logique et certains besoins mystiques qu'ils ont hérité. C'est eux qui donnent à la crise religieuse de la France contemporaine son caractère trouble ... et douloureux ... trouble ... douloureux...
Son regard, brusquement, est tombé sur la pile de journaux et de lettres écroulée sur la table: il a reconnu l'écriture de Mme Pasquelin.
JEAN.—Tu permets?...
Il décachète:
«Buis-la-Dame, 14 janvier.
«Mon cher Jean,
«Cécile est accouchée hier d'une fille...
Il s'arrête. Ses yeux se brouillent; le passé lui saute au visage...
«... Elle me prie de t'en avertir. Elle me charge de te dire que si tu veux voir ta fille, tu peux venir. J'ajoute que ma maison t'est ouverte, comme par le passé, pour tout le temps que tu jugeras bon. Peut-être as-tu compris déjà que tu t'es engagé sur une fausse route, et songes-tu à réparer un peu le mal que tu nous fais, à Cécile et à moi? Tu nous trouveras dans l'état d'esprit où tu nous as laissées: prêtes à tout oublier, le jour où tu reconnaîtras ton égarement.
M. Pasquelin.»
ZOEGER.—Un ennui?
JEAN.—Non, non...
Voyons, je continue, où en étais-je?... (Sa voix se troue. Il fait un violent appel à son énergie.) Voulez-vous relire, Madame?
MADAME DAVID.—«... un nombre considérable d'indécis, écartelés entre les exigences de leur logique et certains besoins mystiques, qu'ils ont hérités. C'est eux qui donnent à la crise religieuse de la France...»
Mais Jean, assis sur le coin d'une malle, n'entend qu'un bourdonnement confus.
La gare de Buis-la-Dame.
Jean descend du train Personne n'est venu l'attendre.
Seul dans l'omnibus aux vitres branlantes, il fait lentement l'ascension de la ville. Il regarde, le cœur serré. Des rues. Des enseignes connues. Rien n'a changé. La ville émerge d'un nuage que trois mois d'absence ont épaissi: elle émerge comme un souvenir de sa petite enfance...
Il croise frileusement son gros pardessus de voyage, qui garde le goût salé de la traversée.
La maison est fermée.
Une bonne, qu'il ne connaît pas, entr'ouvre la porte. Il se glisse comme un voleur.
Dans l'escalier, il s'arrête, la main crispée sur la rampe, frappé au vif par les cris d'un nouveau-né.
Il se raidit, il atteint le palier.
Une porte s'ouvre.
MADAME PASQUELIN.—Ah, c'est toi...? Entre.
Cécile est couchée. L'enfant n'est pas dans la chambre. Il y a un grand feu bruyant dans la cheminée.
Mme Pasquelin referme la porte.
Jean s'avance vers le lit.
JEAN.—Bonjour, Cécile.
Elle répond par un sourire embarrassé. Il se penche l'embrasse au front.
JEAN.—La petite ... va bien?
CÉCILE.—Oui.
JEAN.—Et ... toi?
Mme Pasquelin est debout, Jean sent la dureté de ce regard posé sur lui.
JEAN.—Quand est-ce que...?
CÉCILE.—Lundi soir.
JEAN (comptant sur ses doigts).—Il y a six jours. (Un temps.) J'ai reçu la lettre jeudi. On avait besoin de moi... Je suis parti aussitôt que j'ai pu...
Un silence.
JEAN.—Tu as beaucoup souffert?
CÉCILE.—Ah, oui...
Autre silence.
MADAME PASQUELIN (brusque).—Est-ce que tu dînes ici ce soir?
JEAN.—Mais ... oui ... je pensais...
MADAME PASQUELIN (imperceptible nuance de satisfaction).—Tu restes quelques jours?
JEAN.—Si vous voulez.
MADAME PASQUELIN.—Bien.
Elle sort donner des ordres.
Ils restent seuls. Une gêne angoissée.
Leurs yeux se croisent. Jean se courbe à nouveau, l'embrasse tendrement, tristement. Cécile fond en larmes.
JEAN (à mi-voix).—Je resterai ici le temps que tu voudras... Jusqu'à ce que tu sois relevée... Et puis...
Il s'arrête. Il ne sait pas lui-même ce qu'il doit proposer.
Un silence.
CÉCILE (très bas, avec désespoir).—Tu n'as même pas demandé à embrasser ta fille!
Mais Mme Pasquelin rentre, la petite dans les bras.
MADAME PASQUELIN (à Cécile).—Nous oublions l'heure, avec tout ça!
Jean, qui s'avançait, reçoit le «tout ça» au visage.
Il sait qu'il doit se pencher, embrasser son enfant. Il ne le peut pas... Moitié par respect humain, devant sa belle-mère; moitié par une sorte de répugnance physique, invincible.
Avec une fausse désinvolture, il caresse, du doigt, la joue molle, le menton rouge enfoui dans la bavette mouillée.
JEAN.—Elle est très gentille...
Il s'est reculé.
Une question l'obsède: le prénom qu'ils vont donner à son enfant. Il ne songe pas que la déclaration légale est faite.
JEAN.—Comment s'appellera-t-elle?
MADAME PASQUELIN (d'un ton péremptoire).—Elle s'appelle Marie.
JEAN (comme s'il avait un effort à faire pour graver ce nom dans sa mémoire).—Marie...
Il regarde de loin ce sein gonflé qu'il ne connaît pas, où les doigts minuscules sont crispés en possesseurs. Il regarde ce petit être de chair, qui se hâte, avide de vivre. Il regarde Cécile, et ce visage nouveau, pâle, un peu engraissé, rajeuni: son visage d'autrefois...
Puis, à un geste qu'elle fait pour soutenir l'enfant, il aperçoit à sa main, la bague... Ils étaient fiancés; il arrivait de Paris, l'écrin dans la poche; il avait trouvé Cécile seule; et il s'était agenouillé de tout son être devant elle, pour lui mettre au doigt cette bague, l'anneau, la chaîne...
Tout un passé de jeunesse, de tendresse... Ah, ce désir sincère et fou qu'il avait, de donner et de prendre le bonheur!...
Il soulève un suaire: il viole l'ensevelissement des deux qu'ils ont été.
Il se sent autre. Elle aussi... Tous les deux, si différents!
Et que faire?
Vingt jours plus tard.
La chambre de Cécile.
CÉCILE.—... Je ne céderai pas.
JEAN.—Cécile!
CÉCILE.—Non!
JEAN.—Tu es sous l'influence de ta mère. Rentrons à Paris, seuls, le plus tôt possible, et je suis sûr...
CÉCILE.—Je ne partirai pas avant que le baptême ait eu lieu.
JEAN.—Soit.
CÉCILE.—Et que tu y aies assisté!
Un silence.
JEAN.—Je t'ai dit: non.
CÉCILE.—Alors, tu peux partir seul.
Autre silence.
Cécile s'approche de la fenêtre, soulève le rideau, et reste
immobile, le dos tourné, le front à la vitre.
JEAN (avec lassitude).—Ecoute... Des discussions, nous en avons tous les jours... Scènes muettes, allusions blessantes, crises de larmes... Je suis à bout... Une de plus, pourquoi faire?
Cécile ne bouge pas.
JEAN (d'une voix qu'il contraint au calme).—Il faut éviter l'irréparable... Je te répète que je suis prêt à reprendre la vie commune, notre vie d'autrefois. Je suis prêt à faire beaucoup de concessions.
CÉCILE (se retournant).—Tu mens. Tu les refuses toutes.
JEAN (tristement).—Comme tu es montée, Cécile...
Nouvelle pause.
JEAN.—Tu sais très bien, au contraire, que je suis prêt à faire des concessions pour sortir de la situation où nous sommes. Et en voici la preuve: si j'étais seul et libre, je soustrairais entièrement cette petite à l'influence de la religion; je l'élèverai de telle façon qu'elle ne se trouve pas, un jour, acculée aux atroces débats de conscience par lesquels j'ai passé...
CÉCILE (frémissante).—Tais-toi, tu me fais horreur!
JEAN.—Je te dis: voilà ce que je ferais,—si j'étais seul.
Mais nous sommes deux, c'est notre enfant; tu as sur elle les mêmes droits que moi, je ne l'oublie pas. Je te laisserai donc libre de lui donner la foi que tu possèdes toi-même. Seulement je me refuse à t'y aider, par une attitude hypocrite. Cela me parait plus que légitime...
CÉCILE (farouche).—Non, non, non! C'est ma fille, toi tu n'as aucun, aucun droit sur elle! Je ne t'en reconnais aucun! Tu les as tous perdus maintenant; c'est comme si elle avait un père infirme, ou dans un asile...
JEAN (découragé).—Cécile... Sommes-nous vraiment si loin, si définitivement loin l'un de l'autre?
CÉCILE.—Ah, oui, nous sommes loin! Et je suis lasse de lutter... Toute notre vie, ce sera la même chose... Aujourd'hui le baptême, demain le catéchisme, après-demain la première communion... J'aurai à la défendre contre toi, chaque jour, chaque minute... La défendre contre ton exemple, contre le scandale de ta vie... Non, non, je n'ai plus qu'un devoir, moi, c'est de sauver ma fille, de la sauver de toi!
JEAN.—Mais que voudrais-tu donc?
Cécile s'avance vers lui, les traits égarés.
CÉCILE.—Ce que je veux? Ah, je veux que tout ça finisse, que tout ça finisse, mon Dieu! Je ne te demande pas de redevenir ce que tu étais, je ne sais pas si tu en serais encore capable, je ne le crois pas... Mais je veux au moins que tu n'affiches pas publiquement ces épouvantables idées qui te sont venues! Je veux que tu assistes au baptême de ton enfant! Je veux que tu me promettes...
Elle éclate en larmes, fait quelques pas en chancelant et s'abat sur son prie-dieu, le visage enfoui dans ses bras.
CÉCILE (sanglotant).—... Que j'aie un mari, enfin, dont je n'aie pas honte... Que j'aie un mari, comme toutes les femmes... Que nous soyons un ménage comme les autres, enfin!...
JEAN.—Je réclame seulement pour moi la liberté que je te laisse.
CÉCILE (se relevant, hors d'elle).—Ça, jamais, jamais!
JEAN (après un silence).—Alors?
Elle ne répond pas.
JEAN.—Tu as voulu, en m'épousant, prendre de la vie plus que tu n'en pouvais porter!
CÉCILE.—C'est toi qui m'as trompée! Tu m'as menti! A moi, tu n'as rien à reprocher: je suis telle que tu m'as choisie...
JEAN (haussant les épaules; d'une voix presque basse).—Est-ce que l'on peut être jamais assez certain de l'avenir de sa pensée, pour prendre, en ces matières, des engagements éternels...?
CÉCILE (qui a écouté avec épouvante).—Apostat!
Jean la considère sans rien dire. Il mesure l'abîme.
Quelques pas à travers la chambre.
Puis il s'arrête devant elle.
JEAN (décidé à en finir).—Alors?
Cécile se tait, les mains crispées sur le front.
JEAN (glacial).—Alors?
CÉCILE (éclatant).—Va-t-en! Va-t-en!
Un silence.
JEAN (d'une voix morne).—Ah, Cécile, ne me tente pas...
CÉCILE (sanglotant).—Va-t-en!
JEAN.—Quoi, va-t-en?... Le divorce?
Cécile cesse de pleurer, écarte les doigts de son visage, et le considère avec effroi.
JEAN (les mains aux poches, avec un mauvais sourire).—Tu crois donc qu'il suffit de crier: «Va-t-en!...» Tu n'as pas l'air de te douter que, pour permettre à une femme de vivre à sa guise, et de garder son enfant, il faut un procès ... il faut des jugements...
Il parle... Mais il a brusquement senti croître en lui, malgré lui, malgré les mots qu'il dit, une ivresse nouvelle, le goût démesuré d'une liberté toute proche, un furieux appétit de vivre encore!
Il parle... Mais, au loin, devant lui, il aperçoit, et son regard ne s'en détache plus, il aperçoit au loin ... la trouée lumineuse!
«Etude de Me Mougin, Notaire,
«à Buis-la-Dame (Oise)
«12 février.
«Monsieur,
«Je suis heureux de pouvoir vous apprendre, qu'après un dernier entretien avec Madame Barois et Madame Pasquelin, et devant la menace d'un procès en divorce que ces dames désirent éviter à tous prix, il a été accédé à toutes les exigences que vous m'aviez chargé de défendre, et convenu ce qui suit:
«1° Vous reprenez toute votre indépendance. Madame Barois n'a pas l'intention d'habiter Paris, et se fixera à Buis auprès de sa Mère.
«2° Madame Barois s'occupera en toute liberté de l'éducation de sa fille; à cette seule condition, exigée par vous, que vous serez autorisé à reprendre votre fille chez vous, pendant une année complète, lorsque celle-ci aura atteint sa dix-huitième année.
«3° Madame Barois s'engage à ne pas refuser la rente de 12.000 francs que vous la contraignez à accepter annuellement. Elle est bien résolue d'ailleurs à ne rien distraire de cette somme, ni pour elle-même ni pour l'entretien de sa fille, mais à la totaliser sur la tête de l'enfant.
«Cette dernière clause a donné lieu à un long débat. Madame Barois n'y a souscrit que pour éviter le procès, et sur mon affirmation formelle que c'était pour vous une condition dirimante. Ces dames désiraient tout au moins réserver leur acceptation, afin que je puisse vous avertir de la diminution exacte causée par cet abandon à vos propres revenus (réduits à environ 5.000 francs). J'ai dû, pour éviter une nouvelle perte de temps que je savais inutile, leur avouer que j'avais cru devoir attirer votre attention sur ce point, et que vous n'aviez pas consenti à modifier vos dispositions.
«Sur la demande de Madame Barois je lui ai remis une note écrite, relative à ces divers engagements.
«Je pense m'être ainsi acquitté, selon vos desiderata, de la mission que vous m'aviez confiée. Je reste tout dévoué à vos ordres, et vous prie de recevoir mes salutations empressées.
Mougin.»
«A M. L. Breil-Zoeger,
«Hôtel des Pins, Arcachon.
«Paris, 20 mai 1895.
«Cher Ami,
«Je te remercie tardivement de ta sympathie, au cours des récents événements. Je n'ai guère eu de loisirs: il faut avoir rompu les mille liens qui amarrent une vie au monde extérieur et à son passé,—si simple que semble cette vie,—pour imaginer la ténacité de ces fils, leur multiplicité mouvante et insaisissable. J'ai employé à cette dernière lutte deux grands mois, j'y ai mis un acharnement désespéré, j'ai brisé toutes les chaînes: me voici libre!
«Tu ne peux savoir ce que j'éprouve à pousser ce cri de triomphe, toi dont la vie rétive n'a jamais supporté d'entrave.
«Libre!
«J'atteins cet affranchissement en pleine jeunesse encore, en plein courage, après un long apprentissage de la servitude, après deux années pendant lesquelles j'ai obscurément et patiemment désiré cette liberté. Elle se donne à moi, enfin, sans restrictions, je l'étreins, je la possède, je m'initie passionnément à elle, je me rive à elle pour toujours!
«Je me suis terré, seul, sans laisser d'adresse. Depuis des semaines je n'ai pas vu une figure d'autrefois, ni entendu le son d'une voix qui m'ait rappelé le passé!
«Et tout me pénètre à la fois... Un printemps merveilleux emplit ma chambre, m'entoure de soleil, d'effluves de sève, de beauté! Jamais je n'ai ressenti rien de pareil...
«Ne m'écris pas, cher ami, laisse-moi m'enivrer de solitude jusqu'à l'automne. Mais ne doute pas de ma fidèle amitié.
Jean Barois.»
Novembre.
Rue Jacob: vieille maison, porte étroite.
—M. Barois?
—Au quatrième. Vous verrez sa carte.
Un escalier branlant, parcimonieusement éclairé. Au quatrième, trois portes pareilles; un seul paillasson.
Harbaroux furète dans l'ombre des chambranles; ses yeux perçants déchiffrent:
JEAN BAROIS
DOCTEUR EN MÉDECINE ET AGRÉGÉ ÈS-SCIENCES
PROFESSEUR AU COLLÈGE VENCESLAS
80, BOULEVARD MALESHERBES.
(Les deux dernières lignes barrées au crayon.)
Il sonne.
BAROIS.—Tu es le premier! Entre...
Jean Barois: trente-deux ans.
La plénitude robuste de la jeunesse.
En moins d'un an, la physionomie s'est modifiée: un souci l'habitait; elle resplendit maintenant comme un ciel éclairci. De l'énergie en rayonne librement, et de la joie: affranchissement, certitude, confiance passionnée en l'avenir.
Une pièce claire et froide. Aux murs, des planches de sapin, portant des livres. L'éclat cru d'une lampe à gaz, dans un globe. Des fauteuils de rotin.
Sur la cheminée, un moulage, seul: l'«Esclave enchaîné», de Michel-Ange, étirant hors de la matière son corps douloureux, aux épaules rebelles.
Au fond, une porte basse, ouverte sur une chambrette où pendent des vêtements.
HARBAROUX.—Je n'étais pas encore venu chez toi.
BAROIS.—Pendant six mois, j'ai vécu comme un ours...
Harbaroux considère les sièges disposés en rond, et grimace
un sourire.
Harbaroux: un gnome malingre.
La figure, sans âge, est d'une laideur, mais d'une intelligence sataniques. Un visage étroit, s'élargissant aux tempes, puis s'effilant en lame jusqu'à la pointe d'une barbiche roussâtre. Des oreilles dressées de faune. La fente des paupières, la bouche, sont comme des trous, brutalement creusés avec une spatule dans de la cire à modeler. Regard aigu, tenace, sans douceur.
Bibliothécaire à l'Arsenal. Travailleur acharné. S'est d'abord spécialisé dans le droit du Moyen Age. Puis s'est consacré à l'histoire de la Révolution.
HARBAROUX.—Je voulais te voir seul... Ne penses-tu pas qu'il y aurait intérêt à préciser d'avance, ensemble, les sujets que nous aurons à aborder ce soir avec les autres?
BAROIS (après réflexion).—Non, au contraire.
HARBAROUX (dont le masque se contracte et se détend comme un ressort).—Ah! Pourtant...
BAROIS.—Une réunion comme celle de ce soir est, par nature, préparatoire. Ce n'est pas son efficacité pratique qui importe.
HARBAROUX.—Alors!
BAROIS.—Ce qui importe, selon moi, c'est que dès aujourd'hui il s'établisse, entre ces diverses énergies que nous venons grouper ici, un courant spontané... Comment dire? Que nous sentions, au seul fait de notre réunion, se dégager un élan commun.
HARBAROUX.—Ça ne dépend pas de notre volonté.
BAROIS (vivement).—Non: mais nous avons plus de chances de créer cette atmosphère, en laissant nos rapports s'établir librement, en nous abandonnant à nos impulsions, sans orientation préconçue. (Sourire confiant.) Laisse faire...
Barois parle posément, en achevant ses phrases, comme un homme habitué à prendre la parole en public. Sans qu'il élève la voix, la fermeté du ton maîtrise l'attention.
HARBAROUX (haussant les épaules).—Des bavardages exaltés... Chacun suivant son idée... Chacun, à tour de rôle, infligeant aux autres sa conférence... Et tout à coup, il sera deux heures du matin!
Une soirée perdue...
Barois fait un geste: «Et quand ce serait»?...
Puis, sans répondre, il allume une cigarette, d'un geste rapide qui lui est devenu coutumier. Son regard dur, mais rêveur, suit un instant l'onde bleuâtre de la première bouffée dans l'air vierge de la pièce.
HARBAROUX.—Tu fumes donc maintenant?
BAROIS.—Oui.
Un temps.
HARBAROUX.—Soit, soit... Moi, j'aurais préféré prévoir, diviser la besogne... Je crois que la fondation d'une revue demande plus de...
Un coup de sonnette.
BAROIS (se levant).—Dis-le donc...: de méthode?
Il va ouvrir.
Harbaroux, resté seul, soliloque en grimaçant.
UNE VOIX ÉRAILLÉE (dans le corridor).—Mon cher... Saisissant! Dans Lamennais, par hasard... Ne trouverez rien de mieux!...
Cresteil d'Allize paraît de dos, volubile et gesticulant. Pour
entrer, il tourne sur lui-même, et clignote en recevant au visage
la lumière crue du gaz.
François Cresteil d'Allize: vingt-huit ans.
Une taille élancée, prolongée par un cou maigre qui porte fièrement une tête petite, au crâne bombé par derrière.
Un visage court, triangulaire. Des traits tourmentés: le front large, coupé de rides; l'œil ardent et tendre; le nez provoquant; la moustache tombante, châtain foncé, cachant une bouche dédaigneuse, un sourire nerveux, désabusé.
Le parler haut, l'élégance désinvolte d'un officier de cavalerie; le geste enthousiaste, excessif.
Il a quitté l'armée, assailli de doutes, écartelé entre son éducation et l'irrésistible besoin d'affranchir sa pensée; il s'est séparé des siens, rompant net la tradition catholique et royaliste des Allize.
L'âpre rancune d'un récent évadé.
Il s'avance vers Harbaroux, prompt et souple, courbant sa
haute taille, les mains chaleureusement offertes.
CRESTEIL.—Vous avez entendu, Harbaroux? J'ai trouvé ça, tout à l'heure, dans les «Paroles d'un croyant».
Sans s'inquiéter de Barois, qui s'éclipse, appelé par un nouveau coup de sonnette, il plonge la main dans ses basques, et en extrait un volume débroché.
CRESTEIL (debout, déclamant de mémoire).—«Prêtez l'oreille! Et dites-moi d'où vient ce bruit confus, vague, étrange, que l'on entend de tous côtés!»
Breil-Zoeger, Woldsmuth, Roll et Barois, qui viennent d'entrer, s'arrêtent, collés au mur, surpris et amusés.
CRESTEIL (continuant, sans les voir).
«Posez la main sur la terre, et dites-moi pourquoi elle a tressailli?
«Quelque chose que nous ne savons pas se remue dans le monde.
«Est-ce que chacun n'est pas dans l'attente? Est-ce qu'il y a un cœur qui ne batte pas?
(Pathétique, le bras levé.) «Fils de l'homme! monte sur les hauteurs, et annonce ce que tu vois!»
Il aperçoit les nouveaux arrivants, et les enveloppe d'un regard illuminé qui les électrise.
CRESTEIL.—Je propose de graver ces lignes sous le titre de notre revue! Ce sera le plus beau et le plus concis des manifestes!
BAROIS (du fond de la pièce, frémissant).—Entendu!
Ils se regardent en souriant. L'ironie n'a pas de place ici, ce
soir.
Quelques minutes d'expansion. Du premier coup, les cloisons
étanches ont cédé: venus pour fusionner, le premier tressaillement
de l'un d'eux les unit.
Zoeger s'avance au centre du groupe: son visage oriental est
plus jaune que jamais. Une apparence de timidité: sourire
indécis, geste gêné et court;—mais, au creux des orbites, dans
l'ombre mordorée des paupières qu'il plisse comme on bande un
arc, ses prunelles noires, mouvantes, fiévreuses, implacables.
ZOEGER.—Voyons, asseyons-nous. Procédons avec un peu d'ordre. Il manque?
BAROIS.—Portal.
Sourires sympathiques.
ZOEGER (sans indulgence).—Nous ne l'attendrons pas.
Il se trouve installé au bureau de Barois, comme s'il présidait.
Harbaroux s'est assis près de lui: il veut prendre des notes.
Cresteil, pour gesticuler plus à l'aise, demeure adossé à la bibliothèque, le front haut, les bras croisés, drapé dans sa redingote comme un demi-solde.
Roll, le typographe, s'est carré dans un fauteuil de jonc: il regarde, il écoute. Ses doigts, par contenance, tortillent sa moustache de jeune ouvrier parisien.
Woldsmuth, silencieux, les épaules basses, se tient à l'écart dans l'encoignure de la cheminée, si menu qu'il semble assis.
Barois lui tend un siège. Lui-même se campe au milieu de la pièce, à califourchon sur un escabeau.
BAROIS (ouvrant une boîte sur le bureau).—Voilà des cigarettes... Nous y sommes? (Sourires.) Quand vous êtes arrivés, nous discutions, Harbaroux et moi, sur ceci: faut-il que notre première réunion soit simplement une prise de contact, libre et fraternelle... (Donnant la parole à Harbaroux.) Ou bien...
HARBAROUX.—Ou bien une première séance de travail utile, d'après un plan prémédité?
BAROIS.—Je crois que la bonne direction vient de nous être donnée par Cresteil.
CRESTEIL.—Par Lamennais...
BAROIS.—Nous ne voulons pas seulement fonder un groupement de travail; ce serait trop peu. Nous voulons, avant tout, n'est-ce pas? associer nos tempéraments. Il y faut de la spontanéité. (Cordial.) Nous voici entre nous, animés des mêmes désirs, guidés par la même conscience: que chacun apporte au foyer commun sa flamme personnelle...
Il hésite un instant, puis reprend:
Je continue, puisque j'ai commencé un véritable discours... D'où est venue l'idée première de ce groupement? (Il se tourne vers Breil-Zoeger.)
ZOEGER (vivement).—De toi.
BAROIS (souriant).—Non, nous en avons pris l'initiative ensemble...
Mais je voulais dire ceci: l'idée était dans l'air. Elle répond à une série de besoins particuliers, qui sont les mêmes pour nous tous. Les uns comme les autres, nous sentons que nous avons quelque chose à dire, que nous avons un rôle à tenir.
CRESTEIL (sombre).—Oui, le moment est venu de donner à notre vie intellectuelle un retentissement social!
Pas un sourire.
BAROIS.—Et pourtant, dès que nous cherchons à nous exprimer, à rendre le public témoin de notre effort, nous nous heurtons, comme de simples débutants, à des coteries établies, à des agglomérations de fonctionnaires littéraires, qui se sont fait un monopole de penser et d'écrire, qui ont accaparé jusqu'aux moindres porte-voix, et ne se les laissent plus arracher des lèvres! N'est-ce pas vrai?
ZOEGER.—Le seul remède: créer nous-mêmes notre organe d'expansion.
HARBAROUX.—C'est un problème d'ordre économique: pouvoir écouler sa production, sans user son temps à des démarches...
BAROIS.—... qui échouent...
CRESTEIL.—... et à de fausses camaraderies, qui avilissent!
BAROIS (posément).—Nous n'avons plus vingt ans, nous venons de passer la trentaine. C'est très important. L'ardeur qu'aujourd'hui nous mettons, d'abord à consolider, ensuite à imposer et à défendre nos idées, ce n'est plus un trop plein de jeunesse qui mousse et qui déborde: c'est la flamme même, l'essence de nos sensibilités; c'est l'attitude résolue et définitive que nous avons prise dans la vie.
Tous approuvent gravement.
CRESTEIL (avec un grand geste du bras étendu).—Et quel merveilleux coup de fouet ce doit être, que de se sentir périodiquement lu, suivi, discuté!
ZOEGER (qui, d'instinct, résume).—Agir!
HARBAROUX (sourire machiavélique).—Seulement, en pratique, tout ça, c'est assez difficile...
BAROIS (acceptant le défi).—Non. En pratique, notre projet est réalisable. (Un silence. Fermement.) Nous disposons d'un capital...
ZOEGER (de sa voix douce et nette).—Tu disposes...
BAROIS.—Nous disposons d'un capital, assez mince il est vrai, mais que j'estime pourtant suffisant, grâce au désintéressement de notre camarade Roll... (Mouvement de Roll) ... ou, s'il préfère, grâce au désintéressement de la «Société collectiviste d'impression» qu'il dirige. De plus, notre collaboration est gratuite. Nous n'aurons en somme que des frais réduits: matière première et main-d'œuvre. Nous pouvons donc nous en tirer, et vivre le temps qu'il faut pour nous faire une place au soleil. Après il faudra la défendre; mais nous serons mieux outillés pour la lutte.
ZOEGER.—C'est donc cette année, au début, qu'il importe de donner notre maximum.
BAROIS.—Parfaitement. Les différences de nos natures, malgré des tendances générales qui sont les mêmes... (Coup de sonnette. Il se lève.) ... nous assurent cette variété qui est indispensable à la composition d'une revue.
Il sort.
ZOEGER (sèchement, comme un verdict).—Nous devons réussir.
CRESTEIL (enthousiaste).—Le succès dépend de notre élan, de notre foi!...
HARBAROUX.—Dis plutôt: de la persévérance de nos efforts.
ZOEGER (avec une raide inclinaison de tête).—La foi n'a jamais accompli de miracles, qu'en apparence. Mais la volonté, oui, chaque fois qu'elle s'affirme puissamment.
Portal, poussé par Barois, fait enfin son entrée, un cigare à la bouche, souriant avec bonhomie.
PORTAL.—Voilà, voilà... (Il serre des mains.) Déjà commencé? Pas possible, vous dînez à six heures, au Quartier, comme dans Balzac...
Pierre Portal: un gars d'Alsace, blond, poupard; des yeux bleu faïence, des yeux de «bonne nature». La moustache en frange, soyeuse et couleur d'argent dédoré, virilise à peine un sourire de gosse.
Ami de toutes les femmes: teint clair, un peu fripé; regard chaud, insistant, et, par flambées, sourdement sensuel.
Quelque lourdeur: dans la démarche, dans le geste, dans la voix; dans la plaisanterie.
Des convictions ardentes, mais sans violence, fondées sur le bon sens, sur une vue juste des droits et des devoirs.
Au Palais, secrétaire de Fauquet-Talon, avocat politique intègre et énergique, deux fois ministre.
BAROIS (présentant).—Portal... Notre ami Roll...
Roll salue d'un mouvement gauche.
Depuis qu'il s'est assis, il n'a pas dit un mot. Il fixe alternativement celui qui parle. L'attitude, la physionomie, trahissent l'effort d'une intelligence moyenne, tendue à la limite de ce qu'elle peut, et s'y cramponnant.
BAROIS (affectueusement).—Eh bien, Roll, que pensez-vous de nos projets?
Il pâlit d'un coup, comme s'il avait été outragé. Puis il rougit, décroise les jambes, et se penche en avant, pour parler. Mais il ne dit rien... Et, brusquement, il se décide.
ROLL.—A l'atelier, on en voit des revues! Tous les ans, des nouvelles! Mais pas encore comme la vôtre.
CRESTEIL.—Tant mieux.
ROLL (hésitant).—Des revues pour des amateurs, des revues qui ne s'occupent d'aucun problème... (Sur un ton indéfinissable:) Des dilettantes... Il manque une revue qui soit au courant du grand mouvement social... (Une pause, puis un geste massif.) Enfin, quoi, des hommes qui comprennent c' qui s' prépare...
Cresteil, déclamatoire et farouche, fait un pas en avant.
CRESTEIL.—«Quelque chose que nous ne savons pas, se remue dans le monde!»
BAROIS.—«Fils de l'homme, monte sur les hauteurs!»...
CRESTEIL, BAROIS, ROLL (ensemble).—... «et annonce ce que tu vois!»
Ils se regardent: à peine un sourire de respect humain, qui voile une sincérité touchante.
ZOEGER (posément, sur un ton qui rappelle à l'ordre).—Il faut qu'avant six mois notre revue soit devenue l'alliée de tous les groupes isolés, s'occupant de philosophie positive ou de sociologie...
HARBAROUX (qui fume en grimaçant, la tête de biais, les yeux clignotants).—... de sociologie pratique.
BAROIS.—Naturellement.
PORTAL.—Il y a plus d'efforts individuels qu'on ne croit...
ZOEGER.—Il s'agit de les centraliser.
PORTAL.—... Tous les organisateurs de ligues sociales, d'unions morales, d'universités populaires...
CRESTEIL.—... tous les croyants sans église...
WOLDSMUTH (timidement).—... les pacifistes...
BAROIS.—En un mot, tous les généreux. Voilà notre clientèle. (S'enflammant.) Il y a vraiment un grand rôle à jouer. Coordonner ces forces qui souvent se perdent, les canaliser dans la même direction. Un beau programme!
ZOEGER.—Nous devons le réaliser, simplement, par la diffusion de notre pensée.
BAROIS.—Et par l'exemple d'une sincérité absolue.
PORTAL (souriant).—Ça, c'est quelquefois dangereux...
BAROIS.—Oh que non! Je crois à la contagion de la franchise...
Examiner tous les problèmes, ouvertement.
Ainsi, pour ma part, je pense, avec les réactionnaires, que nous traversons une crise morale. Eh bien, je suis résolu à l'avouer tout de suite. Je suis prêt à reconnaître que la morale a chancelé. C'est un fait. Je l'attribue, pour la masse, à l'anémie générale des croyances religieuses,—et pour nous, à la défaveur, au discrédit des principes abstraits que jadis nos professeurs de métaphysique nous offraient arbitrairement comme autant d'axiomes.
(A Zoeger). Tu sais, ce que nous disions l'autre jour...
PORTAL.—Mais cet aveu n'a d'intérêt que si vous proposez un remède.
BAROIS.—Ça, c'est autre chose... Cependant on peut déjà proposer certains palliatifs.
ZOEGER.—Mieux que ça. On peut montrer que, dès maintenant, il n'est pas impossible de concevoir une direction morale positive.
PORTAL.—Basée sur?
ZOEGER.—Mais, d'une part, sur l'état actuel de la science, et, d'autre part, sur l'évidence, déjà bien établie, de certaines lois de la vie...
PORTAL.—Lois bien vagues encore, et d'une application éthique difficile!
ZOEGER (qui n'aime pas à être contredit).—Pardon, mon cher, pas si vagues. Nous les préciserons, en les classant: d'abord, conservation et développement de l'individu; ensuite, adaptation de l'individu à l'existence collective, qui lui est essentielle.
HARBAROUX (approuvant).—Double devoir, auquel il faut consentir...
ZOEGER.—... L'homme oscillant entre ces deux pôles, et trouvant dans ce va-et-vient, son équilibre moral.
BAROIS.—Oui, c'est là certainement qu'est le ralliement, l'unité morale de l'avenir...
Cresteil s'avance, le front hautain, les bras soulevés: un mouvement d'expansion, naturelle et charmante.
CRESTEIL.—Ah, mes amis, quand je vous entends parler comme ce soir, je me dis que si nous arrivons à faire comprendre, non seulement ce que nous voulons, mais surtout ce que nous valons...
Portal sourit.
... Oui, parfaitement: si nous faisons bien connaître la qualité morale de notre élan, nous attirerons infailliblement à nous, en quelques mois, tous les chercheurs solitaires... tous ceux qui ont quelque chose là! (Il frappe son thorax osseux).
BAROIS (dont la flamme intérieure se traduit trop volontiers par un transport oratoire).—Et nous y arriverons, en exaltant la dignité de chacun! En contribuant à restituer leur sens plein à quelques mots français, comme droiture et probité, que nous avons laissé se décolorer dans le magasin des accessoires romantiques! En affirmant, dans tous les domaines, les droits de la pensée libre!
Regards et sourires qui s'étreignent. Effusion générale.
Puis détente.
Barois emplit les verres de bière fraîche; l'aigreur fermentée se
mêle à la fumée des cigarettes.
PORTAL (reposant son verre. Avec bonne humeur).—Et le titre?
BAROIS.—Mais il est décidé. Nous nous sommes ranges à la proposition de Cresteil: Le Semeur.
(Souriant vers Cresteil.) L'image n'est peut-être pas très neuve...
CRESTEIL.—Merci.
BAROIS.—Mais elle est simple, et répond bien à notre attitude.
ZOEGER.—Est-ce que Barois vous a communiqué la pensée qu'il a eue pour le premier numéro?
BAROIS.—Non, pas encore. Un projet, qui, je l'avoue, me tient fort au cœur... J'espère que vous y souscrirez tous, comme Breil-Zoeger.
Voici: Je voudrais consacrer nos premières pages à la glorification de l'un de nos aînés...
PLUSIEURS VOIX.—Qui? Luce?
BAROIS.—Luce.
CRESTEIL.—Ah, parfait!
BAROIS.—Attendez. J'y verrais plusieurs avantages. D'abord, ce serait manifester, par un choix significatif, quel est notre point de vue, et auquel de nos contemporains nous tendons délibérément la main. Puis, du même coup, nous affirmerions que nous ne sommes pas des démolisseurs systématiques ni des utopistes impuissants, puisque notre idéal a trouvé dans la réalité une sorte d'incarnation, puisqu'il en existe, à côté de nous, un vivant exemple.
PORTAL.—Je vous comprends. Mais n'aurons-nous pas l'air d'acheter pour nos débuts un patronage illustre?
CRESTEIL (vivement).—La personnalité de Luce est à l'abri de...
BAROIS.—Ecoutez, Portal, vraiment, si les mots désuets que j'employais tout à l'heure, droiture, propreté morale, dignité personnelle, ont jamais été applicables à quelqu'un, c'est bien à Luce! Et puis, il n'est pas question de lui demander un mot d'introduction auprès du public ni une signature à mettre en vedette. Il s'agit de lui rendre un hommage spontané et collectif. Je propose même qu'il ne soit averti de rien.
PORTAL.—C'est tout différent.
BAROIS.—Aucun de nous ne le connaît directement. Nous ne savons de lui que ses livres, ses actes, sa vie publique. De plus, c'est un isolé: en philosophie, il ne se rattache à aucun système; en politique, au Sénat, il n'a adopté aucun groupement. L'honneur que nous voulons lui faire, n'atteindra donc que lui seul, l'homme qu'il est.
N'oublions pas que nous lui devons tous une part importante de notre formation morale. J'ai pensé qu'au moment de nous jeter à notre tour dans la lutte, nous lui devions ce geste de gratitude.—Vous m'approuvez, Cresteil?
CRESTEIL (souriant à un souvenir).—Entièrement... Et j'ai bien envie de rappeler un détail personnel... C'est Luce, qui, à l'improviste, a présidé la distribution des prix, à la fin de ma rhétorique. Il y a une douzaine d'années; il venait d'être nommé ... je ne sais plus quoi...
BAROIS.—Suppléant au Collège de France, sans doute.
CRESTEIL.—Je le vois encore, sur l'estrade, au milieu des vieux professeurs, lui très jeune, à peine de quinze ans notre aîné... Un visage d'une ardeur, et en même temps d'une gravité inoubliables. Il s'est mis à parler, très familièrement, sans élever la voix, mais avec une autorité extraordinaire. En quelques minutes, il a su présenter en raccourci une vision si claire de l'homme, de la vie de l'univers; et le sujet coïncidait si heureusement avec mes préoccupations du moment, que j'y ai trouvé, je crois bien, l'orientation de mon existence.
Deux mois après, j'entrais en philosophie, mis d'avance en garde contre le spiritualisme universitaire.
ZOEGER (ricanant).—Celui que Coulangheon appelait: «une espèce de folie des grandeurs...»
CRESTEIL.—J'étais sauvé...
Un silence.
BAROIS.—Donc, c'est convenu. Notre premier fascicule débutera par un «Hommage à Marc-Elie Luce», qui sera signé: Le Semeur.
HARBAROUX (à Roll).—Aurons-nous le premier numéro pour janvier?
ROLL.—Cinq semaines? Hum... Il faudra que j'aie vos articles avant le 10.
BAROIS.—Ce n'est pas impossible... Nous avons certainement tous quelque chose de prêt. (Se tournant vers Zoeger.) N'est-ce pas?
ZOEGER.—Moi, je n'ai pas rédigé, mais j'ai tous mes matériaux.
PORTAL.—Sur?
Zoeger dévisage Portal; il hésite à répondre. Son œil froid passe la revue des physionomies, curieusement attentives.
Alors il desserre les lèvres.
ZOEGER.—Voici.
Sa voix lente, privée d'accent, paraîtrait molle, sans une résonnance finale qui déconcerte, une sécheresse tranchante comme un couperet qui tombe.
ZOEGER.—Je crois qu'il est utile, pour un premier numéro, que nos études soient délibérément tendancieuses, qu'elles affirment nettement notre tour d'esprit..
Regard circulaire qui s'assure l'approbation de tous.
ZOEGER.—Pour moi, j'ai donc l'intention de donner un article qui prépare en quelque sorte les suivants. Je me contenterai de développer cette idée générale: que,—notre seul point de départ logique pour étudier l'homme étant le milieu vital où il évolue,—la philosophie moderne, la seule qui puisse renouveler le domaine philosophique, doit être biologique, doit être une philosophie à notre niveau, au plan que l'homme occupe dans la nature; qu'en outre, cette philosophie a l'avantage d'être à cycle ouvert, puisqu'elle émane spontanément de l'état actuel des sciences; et que, nourrissant ses raisonnements des seuls faits contrôlables, elle est nécessairement alimentée par le progrès scientifique, et amenée à se transformer avec lui.
PORTAL.—Voilà qui écartera tout de suite de notre revue les neuf dixièmes des métaphysiciens...
ZOEGER (incisif).—C'est ce qu'il faut.
HARBAROUX (saisissant l'occasion).—Ce serait une bonne chose que chacun de nous puisse ainsi donner, dès aujourd'hui, un aperçu de ses projets... Notre premier fascicule se trouverait à peu près constitué dès ce soir. Est-ce ton avis, Barois?
BAROIS (depuis un instant soucieux).—Mais oui.
HARBAROUX (spontanément).—Moi, j'ai une trentaine de pages sur le mouvement des Communes au XIIe siècle, et son analogie avec les troubles sociaux de ces cinquante dernières années.
Et vous, Cresteil?
Cresteil vient s'adosser à la cheminée, dans une pose un peu prétentieuse; mais dès qu'il parle, sa voix passionnée, son regard lumineux, ses gestes violents, forcent l'attention.
CRESTEIL.—Je voudrais reprendre la question de «l'art pour l'art»... Vous savez, à propos du récent manifeste de Tolstoï. Montrer qu'elle est généralement mal posée; revendiquer avant tout, pour l'artiste, le droit—le devoir—de ne se préoccuper de rien autre, lorsqu'il secrète, que de faire beau: car c'est l'émotion désintéressée qui crée. Mais je me hâterais de concilier les uns et les autres, en prouvant que l'utile est infailliblement la conséquence du mobile esthétique. L'artiste n'a pas à prévoir, en travaillant, ce qui pourra résulter socialement de son œuvre.
ZOEGER (très attentif).—Pas plus que le savant.
CRESTEIL.—Pas plus que le savant. Ils ont à atteindre, l'un la beauté, l'autre la vérité: deux faces d'un même but. Aux masses à s'en accommoder ensuite... (De haut.) ... à y conformer leurs petites combinaisons sociales...
ZOEGER.—C'est très juste.
BAROIS (à Cresteil).—Je pensais que vous vous réserviez la paraphrase de votre citation de Lamennais?
CRESTEIL (souriant).—Non, je vous la laisse.
BAROIS (gaîment).—Je l'accepte.
J'y pensais, tout en vous écoutant. Je crois qu'il y a quelque chose à en tirer: exposer pourquoi nous l'inscrivons ainsi en exergue, et en quoi elle exprime si bien le caractère essentiel de notre tentative.
CRESTEIL.—Ce serait bien en place dans un premier numéro.
BAROIS (dont le regard s'avive).—N'est-ce pas?
PORTAL.—Quelle citation?
HARBAROUX (grincheux).—Vous n'étiez pas arrivé.
PORTAL.—Expliquez-nous votre idée, Barois.
ZOEGER.—Oui, explique-toi.
BAROIS (souriant à sa propre pensée, à mesure qu'il l'exprime).—Je reprendrais mot à mot le texte:
«Quelque chose que nous ne savons pas se remue dans le monde...»
Quel est ce frisson? L'éternel mouvement de la pensée humaine, le progrès...—Vous voyez le développement...—La gestation d'une œuvre infinie, à laquelle s'agglomèrent chacun de nos efforts, chacune de nos émotions réalisées... Et ce mouvement porte obscurément en lui toutes les solutions que nous cherchons, toutes ces vérités de demain, qui se dérobent encore à nos explorations, mais qui, à leur jour, comme tombent les fruits mûrs, se dévoileront l'une après l'autre, devant l'interrogation humaine!
CRESTEIL.—Oui, un hymne au progrès!
BAROIS (encouragé, se laissant définitivement aller à son improvisation).—Et je dirais encore ceci: Il en est, parmi nous qui sont doués d'une sorte de prescience, qui distinguent déjà ce que d'autres n'aperçoivent pas encore. C'est à ceux-là que Lamennais crie:
«Fils de l'homme, monte sur les hauteurs et annonce ce que tu vois!» Et je ferais un rapide tableau de notre vision de l'avenir... «Annonce ce que tu vois...»
Je vois: l'extension monstrueuse des puissances de l'argent; toutes les revendications les plus légitimes, écrasées et maintenues sous sa tyrannie...
Je vois: l'ébranlement de la masse laborieuse, dont le tumulte grandissant n'est que mal couvert par cette parade bruyante des partis politiques, qui, jusqu'ici, réussit seule à capter l'attention...
Je vois: la poussée régulière d'une majorité humaine, brutale, inculte, enivrée d'illusions, affamée de sécurité et de bonheur matériel, contre une minorité aveugle, encore puissante par la force des choses établies, mais dont la stabilité relative ne repose, en fait, que sur le régime capitaliste. Donc: poussée générale contre l'état capitaliste, c'est-à-dire contre l'organisation sociale de tout le monde actuel,—car aujourd'hui il y a, en somme, unité de régime dans tous les pays civilisés;—poussée formidable, dont l'histoire n'enregistre pas de précédent, et qui ne peut pas ne pas être victorieuse, parce qu'elle est la force nouvelle, le jet même de la sève humaine, l'élan actuel contre un monde fatigué, étiolé par l'affinement!
ROLL (brusquement, la gorge serrée).—Bravo!
Sourires.
Barois s'est levé, grisé par le son et la cadence de ses paroles,
surexcité par les regards qui le tiennent en vedette: les jambes
écartées, le buste offert, le menton haut, son visage mâle frémissant
d'activité, un joyeux défi dans les yeux,—il vibre...
Ivresse d'orateur, qui lui manquait depuis des mois.
BAROIS.—Enfin, après cette vue d'ensemble, il faudrait terminer par un coup d'œil sur les individus.
Que trouve-t-on en chacun de nous? Le désordre, l'incertitude. L'amélioration matérielle a démesurément développé nos faiblesses, et jamais encore elles ne se sont épanouies avec un pouvoir si dissolvant. Une épouvante inavouée de l'inconnu, plane sur la plupart des êtres cultivés: un combat se livre en chacun d'eux: toutes les forces vives des âmes, se sont soulevées, consciemment ou non, contre la survivance des impératifs mythologiques... Combat multiple, plus ou moins obscur, mais universel, et qui rend intelligibles les excès du déséquilibre social... Combat onéreux surtout, parce qu'il aboutit, dans tous les domaines, à un sensible abaissement de la conscience individuelle et, finalement, à une déperdition inquiétante d'énergie!...
(Il s'arrête, passe rapidement en revue les visages rayonnants, et sourit.) Voilà.
Une seconde de vie intense... Et brusquement, sans raison apparente, comme un fil trop tendu, son enthousiasme casse net.
Il s'assied, souriant, gêné, très las.
Quelques instants silencieux.
Il débouche une cannette, emplit les verres, et vide le sien d'un
trait.
Puis il se tourne vers Portal.
BAROIS (avec un entrain forcé).—Et vous, Portal, avez-vous pensé à nous?
PORTAL (riant).—Ma foi, non! Faites votre premier numéro sans moi. Je collaborerai au second.
CRESTEIL.—Lâcheur...
PORTAL.—Parole! Mon sujet n'est pas mûr, mais j'en ai un... (Sourires.) Vous ne me croyez pas? Tenez, voilà mon idée... Ce n'est pas exactement un article que je veux écrire... Des croquis, des notes, sur les types que je vois tous les jours, sur ceux que je connais bien, le Palais, les députés, les gens du monde... La moyenne, enfin...
CRESTEIL.—La sainte et irréductible moyenne!
PORTAL.—Oui; ceux qui sont «bien pensants», parce qu'ils ne peuvent pas être «pensants» tout court... Ces légions d'êtres, relativement instruits, policés par les usages comme des galets roulés... Ces êtres qui, pour la plupart, occupent une place dans la société, souvent même une fonction importante, et qui, cependant, vivent leur vie, à la façon des bêtes de somme... (S'amusant, progressivement, du portrait qu'il trace)... Qui s'en vont, devant eux, les yeux mi-clos entre leurs œillères, n'ayant jamais réfléchi par eux-mêmes, n'ayant jamais eu la hardiesse de réviser les vagues croyances qu'on leur a fait enfiler avec leur première culotte... Et qui mourront, dociles et incertains, n'ayant même pas eu conscience de leur incertitude, n'ayant rien aperçu de ce qui domine la vie: l'instinct, l'amour, la mort...
ZOEGER (implacable).—Hâtez-vous de les caricaturer. Portal! Ils encombrent, ceux-là, ils empoisonnent! Nous les charrierons vite hors du chemin...
ROLL (sombre).—Ils se croyent à l'abri, comme des vers dans une carcasse pourrie.
L'âpreté de leur ton contraste avec l'ironique bonhomie de Portal. Il reste un peu inquiet d'avoir attisé cette haine.
HARBAROUX.—Ils sont condamnés. Regardez-les: de père en fils, on les voit se débiliter, devenir de plus en plus amorphes, inexistants, incapables de participer à quelqu'effort neuf!
Barois se jette brusquement dans la discussion.
BAROIS.—Oui, Harbaroux, quand vous les regardez de loin, quand vous les croisez sur la route! Mais quand on a vécu au milieu d'eux, mes amis, ah! comme leur existence confite est encore vivace! (Levant le poing.) Et nuisible!
ZOEGER (avec un mauvais sourire).—Non. Ils ne sont pas si dangereux que ça. Nous les avons exclus de tout, isolés, circonscrits. Dans les incendies de forêts, on fait la part du feu: la fraction sacrifiée continue à flamber; mais elle se consume sur elle-même, sans atteindre le reste. C'est exactement la même chose.
BAROIS (lourdement).—Ah, il faut en avoir été pour comprendre cette masse immuable, cette puissance inerte qu'ils sont encore!
CRESTEIL.—C'est rudement vrai, ce que Barois dit là!
BAROIS.—Leurs nécropoles lézardées abriteront encore des générations et des générations, avant que leur race ne disparaisse! Heureux, s'ils n'arrivent pas à en sortir, pour ressaisir et aveugler une fois de plus l'opinion... Sait-on jamais?
Un silence.
HARBAROUX (méthodique).—Ne pensez-vous pas qu'il faudrait noter nos projets par écrit?
Pas de réponse; on ne semble pas avoir entendu.
Il est tard.
Aux généreux bouillonnements a succédé une vague somnolence; il plane une impalpable tristesse, un relent aigre d'enthousiasme refroidi.
CRESTEIL.—Notre premier numéro va éclater comme une fanfare!
Sa voix, de plus en plus enrouée, a perdu son timbre triomphal; elle sombre dans le silence, qui se referme sur elle, comme une eau morte.
ROLL (les yeux gonflés de fatigue).—Permettez-moi de me retirer... L'atelier, demain, à sept heures...
HARBAROUX.—Vous savez, il va être deux heures... (A Cresteil.) Au revoir.
CRESTEIL.—Mais nous partons tous...
Triste départ.
Barois, resté seul, ouvre la fenêtre, et s'accoude au bord de la
nuit glacée.
Dans l'escalier.
Descente silencieuse: Portal marche en tête, tenant un bougeoir. Tout à coup, il se retourne, avec une gaîté de noctambule.
PORTAL.—Et Woldsmuth? on l'a oublié... Qu'est-ce qu'il va nous donner d'intéressant, Woldsmuth?
Le monôme s'arrête, amusé. Les têtes se lèvent vers Woldsmuth, qui ferme le cortège. Le flambeau remonte de main à main, jusqu'à lui.
Sa face d'épagneul frisé apparaît, posée sur la rampe, dans la pénombre des étages supérieurs: au milieu des cheveux, des sourcils et de la barbe en broussaille, ses yeux, vivants et doux, clignotent derrière le lorgnon.
Il se tait.
Puis soudain, comme les autres semblent bien décidés à attendre, son visage change; une brusque roseur paraît sur les pommettes, les paupières se baissent, palpitent, et se relèvent sur un regard ardent et pitoyable.
WOLDSMUTH (avec une fermeté inattendue).—Je recopierai simplement une bien triste lettre que j'ai reçue de Russie... On a chassé six cents familles juives qui habitaient un faubourg de Kiev. Pourquoi? Parce qu'un enfant chrétien a été trouvé mort, et qu'on a accusé les Juifs de l'avoir tué pour fabriquer des azimes...
Oui, là-bas, c'est ainsi...
Alors les Juifs ont été chassés, après un massacre... Et il y a cent-vingt-six nouveaux-nés qui sont morts, parce que ceux qui avaient des enfants jeunes à porter, allaient moins vite, et ils ont dû camper deux nuits dans la neige...
Oui, là-bas, c'est ainsi... On ne le sait pas, en France...
A Auteuil.
Huit heures du matin.
Une vaste bâtisse, au fond d'un jardin blanc de givre, où s'ébrouent une demi-douzaine d'enfants.
LUCE (apparaissant sur le perron).—Allons, mes petits... Il est l'heure... Au travail!
Une galopade joyeuse. Les deux aînés,—une fillette de treize ans, un gamin de douze,—arrivent les premiers. Leur essoufflement, dans l'air froid, les enveloppe de buée. Les autres rejoignent, un à un, jusqu'à la dernière de la bande, une petite fille de six ans.
Le poêle de la salle à manger ronfle. Sur la grande table cirée s'alignent les encriers, les sous-mains, des livres de classe.
Debout à la porte de son cabinet, le père regarde.
Ils s'entr'aident gentiment, sans tapage, en liberté.
Puis le silence s'établit tout seul.
Luce, traversant la pièce, monte au premier étage.
Une chambre d'enfant. Les rideaux tirés.
Au chevet du lit, une femme, encore jeune, assise.
Luce l'interroge du regard. Elle fait signe que la petite vient de s'endormir.
Quelques secondes passent.
La mère tressaille: un coup de timbre... Le docteur?
Luce est allé jusqu'à la porte.
LA FEMME DE CHAMBRE.—Un jeune homme à qui Monsieur a donné rendez-vous... Monsieur Barois...
Barois est seul, dans le cabinet de Luce.
Une pièce sans draperies; un bureau encombré de revues étrangères, de volumes neufs, de lettres. Aux murs, des reproductions, des plans, des cartes; deux panneaux couverts de livres.
Chaque bruit du monde a son écho là.
Entrée de Luce.
Marc-Élie Luce: de petite taille. Une tête forte, mal proportionnée au corps.
Deux yeux clairs, étrangement enfoncés entre un front immense et une barbe en éventail: les yeux sont d'un gris fin, caressants et limpides; le front, dégarni, très large, bombé, surplombe le masque, accapare le crâne; la barbe est épaisse, d'un blond qui commence à blanchir.
Quarante-sept ans.
Fils d'un pasteur sans église. A commencé ses études de théologie, mais les a interrompues, faute de vocation, et parce qu'il ne pouvait accepter aucun credo confessionnel. En a seulement gardé le goût fervent des questions morales.
A publié, très jeune, cinq gros volumes: «Le passé et l'avenir de la croyance», œuvre considérable, qui lui a fait attribuer une chaire d'histoire religieuse au Collège de France.
S'est fait connaître à Auteuil par son dévouement à l'Université populaire qu'il y avait créée, et aux œuvres sociales de l'arrondissement. S'est laissé porté au Conseil Général, puis au Sénat, où il est parmi les plus jeunes: ne s'est affilié à aucun parti; revendiqué à tour de rôle, par tous ceux qui veulent assurer le triomphe de quelque noble pensée.
A fait paraître, successivement: «Les régions supérieures du socialisme». «Le sens de la vie» et «Le sens de la mort».
Il s'avance vers Barois et lui tend la main, avec une cordialité simple et imposante.
BAROIS.—Votre lettre nous a infiniment touchés, Monsieur, et je suis le porte-parole de tous...
LUCE (interrompant sans façon).—Asseyez-vous; je suis très content de faire votre connaissance.
Un parler gras, pesant, où perce l'origine franc-comtoise.
LUCE.—J'ai lu votre Semeur. (Il sourit en regardant Barois bien en face, sans fausse modestie). C'est très dangereux de recevoir les éloges de plus jeunes que soi: on y est trop sensible...
Un temps.
Il a pris sur son bureau le premier numéro, et le feuillète en parlant.
LUCE.—Un bien beau sous-titre: «Pour la culture des qualités humaines»...!
Il est assis, les jambes entr'ouvertes, les coudes sur les genoux, le Semeur entre les mains.
Barois contemple ce front, dur et comme gonflé, familièrement penché sur leur œuvre naissante... Orgueil.
Luce parcourt encore une fois la brochure, et s'arrête aux notes qu'il a crayonnées en marge. Il semble réfléchir, soupeser les feuillets... Il se redresse enfin, regarde Barois et remet le Semeur sur la table.
LUCE (simplement).—Disposez de moi, je suis avec vous.
L'accent alourdit encore la gravité de ce pacte.
Barois se tait, pris au dépourvu, très troublé. Il répugne à formuler un remercîment banal.
Ils se dévisagent: long regard ému...
BAROIS (après un court silence).—Ah! si mes camarades avaient pu entendre ces mots-là, et le timbre de votre voix!
LUCE (souriant).—Quel âge avez-vous?
BAROIS.—Trente-deux ans.
Luce l'examine avec ce sourire intéressé et sans ironie qu'il promène à travers le monde: une sorte d'étonnement enfantin, une curiosité amoureuse des choses, et pour laquelle tout est inédit et admirable.
Un temps.
LUCE.—Oui, vous avez raison. Il manquait un organe comme votre Semeur. Mais vous assumez un rôle énorme...
BAROIS.—Pourquoi?
LUCE.—Justement parce que vous serez les seuls à aborder les véritables problèmes contemporains. Vous serez très lus: lourde tâche... Songez que chacune de vos paroles aura une répercussion et que cette répercussion ne vous appartiendra pas, que vous ne pourrez pas la diriger... Bien plus, que vous l'ignorerez le plus souvent!
(Comme à lui-même.) Ah, on écrit toujours trop vite. Semer, semer... Il faut trier, analyser minutieusement ses graines, pour être à peu près sûr de ne lancer que les bonnes...
BAROIS (fièrement).—Cette responsabilité-là, nous l'avons pesée et acceptée.
LUCE (sans répondre).—Vos amis ont le même âge que vous?
BAROIS.—A peu près.
LUCE (maniant la revue).—Quel est ce Breil-Zoeger? Est-ce un parent du sculpteur?
BAROIS.—Son fils.
LUCE.—Ah! Mon père connaissait le sien; c'était un des familiers de Renan... Votre ami ne fait pas de sculpture?
BAROIS.—Non. Il est agrégé de philosophie. Nous avons travaillé l'agrégation de sciences, ensemble.
LUCE.—Son «Introduction à une philosophie positive» révèle un tempérament très personnel.
(Avec sévérité.) Mais c'est d'un sectaire.
Mouvement de Barois.
Luce relève le front, et considère Barois, presque affectueusement.
LUCE.—Vous permettez que je vous dise toute ma pensée?
BAROIS.—Je vous en prie.
LUCE.—Je voudrais étendre le reproche à tout votre groupe... (Avec douceur.) A vous, en particulier.
BAROIS.—Comment cela?
LUCE.—Vous avez pris, dès le premier numéro, une attitude très franche, très courageuse,—mais un peu jacobine...
BAROIS.—Une attitude combattive.
LUCE.—Elle me plairait sans réserves si elle n'était que combattive. Mais elle est ... agressive. N'est-ce pas vrai?
BAROIS.—Nous sommes tous ardents, convaincus, prêts à lutter pour nos idées. Il ne me déplait pas de montrer quelque intransigeance... (Luce se taisant, il continue.) Je crois qu'une doctrine puissante et jeune, est, par nature, intolérante: une conviction qui commence par admettre la légitimité d'une conviction adverse, se condamne à n'être pas agissante, elle est sans force, sans efficacité.
LUCE (fermement).—Pourtant c'est l'esprit de tolérance qu'il faut essayer d'établir entre les hommes: nous avons tous le droit d'être ce que nous sommes, sans que notre voisin puisse nous l'interdire, au nom de ses principes personnels!
BAROIS (involontairement brusque).—Oui, la tolérance, la liberté pour tous, c'est parfait,—en principe... Mais voyez où conduit le scepticisme souriant des dilettantes? Est-ce que l'Église serait encore ce qu'elle est dans notre société moderne, si...
LUCE (vivement).—Vous savez si je suis hostile à l'esprit clérical! Je suis né en 48, au milieu de décembre; et j'ai toujours eu plaisir à penser que j'avais été conçu en pleine effervescence libérale. J'abhorre toutes les soutanes et toutes les fausses enseignes, quelles qu'elles soient. Eh bien, pourtant, ce qui m'écarte des églises, bien plus que leurs erreurs, c'est leur intolérance. (Un temps. Posément.) Non, je ne serai jamais partisan d'opposer le mal au mal. Il suffit de réclamer pour tous la liberté de la pensée, et d'en donner l'exemple.
Voyez l'église catholique: elle a eu des siècles de domination; et cependant, pour ébranler ce pouvoir colossal, il a suffi que ses adversaires eussent à leur tour acquis le droit de proclamer ce qu'ils pensaient!
Barois écoute; mais, visiblement, ce silence attentif lui pèse.
LUCE (conciliant).—Que l'erreur reste libre, mais que la vérité soit libre aussi; voilà tout. Et ne nous préoccupons pas trop des suites. La vérité sera toujours victorieuse, à son heure...
(Après un temps.) Ne le croyez-vous pas?
BAROIS.—Ah, parbleu, je sais bien que, dans l'absolu, vous avez raison! Mais nous ne sommes pas maîtres de certains sentiments qui nous trahissent...
Un instant de silence.
Luce semble attendre une explication.
BAROIS (presque violemment).—Je le sais bien, que je ne suis pas tolérant! Je ne le suis plus!
(Baissant la voix.) Il faut savoir ce que j'ai souffert, pour me comprendre...
Un esprit affranchi, qui se trouve obligé de vivre dans l'intimité de personnes pieuses,—qui se voit, chaque jour, plus étroitement enserré dans ce tissu élastique et si résistant de la foi catholique,—qui sent, à propos de tout, la religion s'infiltrer dans sa vie, pénétrer ceux qui l'entourent, modeler le cœur et l'âme des siens, laisser partout son empreinte et sa direction! Celui-là, oui, il a le droit de parler de tolérance! Non pas celui qui a quelques concessions à faire, par affection; mais celui dont la vie quotidienne n'est qu'une seule concession ininterrompue!
Celui-là,—il a le droit de parler de tolérance!...
(Il se contient, lève les yeux vers Luce, et sourit péniblement.) Et alors, il en parle, Monsieur, comme on parle de la Vertu parfaite, comme on parle d'un idéal qui n'est pas humainement réalisable!
LUCE (après un instant de silence, avec douceur).—Vous ne vivez pas seul?
Le visage énergique de Barois, crispé par les souvenirs, s'illumine d'un coup; son regard s'attendrit.
BAROIS.—Si, maintenant, je suis libre! (Souriant.) Mais depuis trop peu de temps encore, pour être redevenu tolérant...
(Pause.) Excusez-moi d'avoir pris cette discussion trop à cœur...
LUCE.—C'est moi qui, sans le savoir, ai ranimé de tristes émotions...
Échange de regards affectueux.
BAROIS (spontanément).—Ça me fait du bien. J'ai besoin de conseils... Il y a beaucoup plus de quinze années entre nous, Monsieur... Vous vivez, vous, depuis vingt-cinq ans. Moi, je viens seulement de rompre, après des sursauts douloureux, toutes mes chaînes... Toutes! (Son geste cassant scinde sa vie en deux: là, le passé; ici, l'avenir. Il étend la main.) Alors, vous comprenez, j'ai devant moi une vie toute neuve, qui me paraît immense à donner le vertige... Ma première pensée, en fondant cette revue, a été de me rapprocher de vous, comme du seul point de repère que j'aperçoive à l'horizon.
LUCE (hésitant).—Je ne pourrai vous donner que ma propre expérience... (Il sourit, et montre du doigt les cartes de géographie pendues aux murailles.) J'ai toujours pensé que la vie était comme une de ces cartes des pays que je ne connais pas: pour se diriger, il suffit de s'appliquer à la lire... L'attention, l'ordre dans les pensées, la mesure, la persévérance... Voilà tout, c'est très simple.
(Reprenant sur son bureau le numéro du Semeur.) Vous êtes très bien parti, vous avez beaucoup d'atouts en main. Vous êtes entouré d'intelligences aigües et originales. Tout cela est très bien... (Réfléchissant.) Si j'avais un conseil à vous donner, pourtant, ce serait celui-ci: ne vous laissez pas trop influencer par les autres... Oui, c'est quelquefois le danger de ces groupements. Il y faut une conscience commune, c'est évident; vous l'avez: un même élan vous a rassemblés et lancés en avant. Mais ne jetez pas votre personnalité dans le creuset commun. Conservez-vous à vous-même, obstinément; ne cultivez en vous que ce qui vous est propre.
Nous avons tous une faculté particulière, un don si vous voulez, par lequel nous resterons toujours absolument distincts des autres êtres. C'est ce don-là qu'il faut arriver à trouver en soi et à exalter, à l'exclusion du reste.
BAROIS.—Mais n'est-ce pas se restreindre? Ne faut-il pas, au contraire, essayer de sortir de soi, le plus possible?
LUCE.—Je ne crois pas...
LA FEMME DE CHAMBRE (entr'ouvrant la porte).—Madame fait prévenir monsieur que le docteur est là.
LUCE.—Bien.
(A Barois.) J'estime qu'il faut rester le même, avec acharnement,—mais grandir! Tendre à devenir l'exemplaire le plus parfait du type spécial d'humanité que l'on représente.
BAROIS (se levant).—Mais ne faut-il pas agir, parler, écrire, manifester sa force?
LUCE.—Oh, une personnalité vigoureuse s'exprime toujours... Ne vous illusionnez pas sur l'utilité de la production quand même. Est-ce qu'une belle vie ne vaut pas une belle œuvre? J'ai cru aussi qu'il fallait besogner. Peu à peu j'ai changé d'avis...
Il accompagne Barois vers la porte. En passant près de la fenêtre, il écarte le rideau de percale blanche.
LUCE.—Tenez, dans mon jardin, c'est la même chose: il faut soigner la sève, l'enrichir d'année en année: et alors, si l'arbre doit porter des fruits, vous les voyez se multiplier d'eux-mêmes...
Ils traversent la salle à manger.
Les petites têtes, penchées sur les devoirs, se redressent, curieuses.
LUCE (enveloppant la table d'un vaste regard).—Mes enfants...
Barois s'incline en souriant.
LUCE (devinant sa pensée).—Oui, c'est beaucoup... Et j'en ai deux autres encore... Il y a des jours où j'aperçois tous ces yeux-là fixés sur moi, et j'en suis épouvanté... (Secouant la tête.) Il faut s'en remettre à la logique de la vie, qui doit être juste.
(Il s'est approché de la table.) Celle-là, c'est mon aînée, une grande fille déjà... Celui-là, Monsieur Barois, c'est un mathématicien...
(Il passe amoureusement sa main sur ces têtes de cheveux fins, et se retourne tout-à-coup vers Barois.)—C'est si beau, la vie...
«Je sens des flots qui se soulèvent, je sens une aurore qui naît...
Mon cœur est comme un monde...»
(Ibsen.)
En juin 1896.
Cinq heures du soir.
Une brasserie du boulevard Saint-Michel.
Rez-de-chaussée, vaste et sombre, style Heidelberg; tables massives, escabeaux, vitraux armoriés. Un peuple bruyant d'étudiants et de femmes.
A l'entresol, une pièce basse, réservée une fois par semaine au groupe du Semeur.
Cresteil, Harbaroux et Breil-Zoeger sont attablés près d'une large baie en demi-cercle, ouverte, au ras du parquet, sur le va-et-vient du boulevard.
Entrée de Barois, une lourde serviette sous le bras.
Poignées de mains.
Barois s'assied, et tire des papiers de sa serviette.
BAROIS.—Portal n'est pas arrivé?
ZOEGER.—Pas vu.
BAROIS.—Ni Woldsmuth?
HARBAROUX.—Voilà plusieurs jours que je vais à la Bibliothèque Nationale sans le rencontrer.
BAROIS.—Il m'a envoyé une dizaine de pages tout à fait curieuses, à propos des «Lois sur l'instruction».
(Il tend un paquet à Cresteil.) Voici vos épreuves. C'est un peu serré, mais nous avons tant de copie cette fois-ci...
(A Harbaroux.) Tiens...
HARBAROUX.—Merci. Quand les veux-tu?
BAROIS.—Roll les demande pour la fin de la semaine.
(A Breil-Zoeger.) Voici les tiennes. A ce propos, je voudrais te dire un mot. (Aux autres.) Vous permettez?
Il se lève et emmène Breil-Zoeger au fond de la pièce.
BAROIS (baissant la voix; affectueusement).—C'est au sujet de ton étude sur le «Déterminisme vital»... Excellent d'ailleurs; je crois que tu n'as rien écrit de plus plein et de plus sobre. J'ai commis l'indiscrétion d'en lire une partie à Luce, hier soir; j'avais tes épreuves dans ma poche... Il a trouvé ça très fort.
ZOEGER (satisfait).—Tu lui as lu le passage sur Pasteur?
BAROIS.—Non. Et justement je voulais t'en parler avant que tu ne fasses tes corrections...
Zoeger fronce les sourcils.
BAROIS (un peu gêné).—Franchement, je trouve cette page-là trop dure...
ZOEGER (avec un geste sec).—Je ne touche pas au savant; je m'occupe de Pasteur métaphysicien.
BAROIS.—J'entends bien. Mais tu juges Pasteur comme tu jugerais l'un de nos contemporains, un de ses élèves.
Je ne dis pas que sa conception philosophique de l'univers.. Mais tu oublies trop que notre matérialisme scientifique, c'est à ce spiritualiste impénitent que nous le devons!
ZOEGER (geste qui déblaye).—Je sais comme toi ce que nous lui devons,—quoique cette façon de parler ne corresponde pour moi à aucune reconnaissance sentimentale... (Un rire bref, qui dans cette face jaune, montre des dents luisantes.)
Pasteur a cru devoir prendre publiquement une attitude métaphysique bien accusée: nous avons le droit de la juger. Merci bien! On nous a trop souvent opposé son discours de réception à l'Académie, pour que nous ayons, à cet égard, le moindre scrupule!
BAROIS.—Pasteur avait une hérédité et une éducation qui l'ont empêché d'aller,—comme nous ayons pu le faire depuis, et grâce à lui—jusqu'aux conclusions philosophiques de ses découvertes. Il n'y a pas à lui tenir rigueur de n'avoir plus été assez jeune pour se transformer lui-même.
Il le regarde et attend quelques secondes. Zoeger se détourne sans répondre.
BAROIS.—Tes premières pages sont injustes, Zoeger.
ZOEGER.—Tu subis l'influence de Luce.
BAROIS.—Je ne m'en défends pas.
ZOEGER.—Tant pis. Luce manque souvent de fermeté, et quelquefois de pénétration, par manie de tolérance.
BAROIS.—Soit. (Un temps.) N'y pensons plus, tu es libre. (Souriant.) Libre et responsable...
Il rejoint sa table et s'assied.
Le garçon apporte les consommations.
BAROIS.—Etes-vous sûrs que Portal viendra ce soir?
CRESTEIL.—Il me l'a dit.
ZOEGER.—Ne l'attendons pas.
BAROIS.—C'est que j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer, et j'aurais voulu que le groupe fût au complet... Oui, mes amis, au point de vue matériel, notre Semeur continue à être en excellente voie. Je viens d'achever nos comptes semestriels. (Soulevant un registre.) Ils sont à votre disposition.
Nous avons débuté, il y a six mois, avec 38 abonnements. Nous en avons 562 ce mois-ci. De plus, il s'est vendu, le mois dernier, 800 livraisons, tant à Paris, qu'en province. Et nos 1.500 numéros de juin sont déjà épuisés.
CRESTEIL.—La collaboration de Luce nous a certainement été d'un solide appui.
BAROIS.—C'est évident. Depuis le premier article qu'il nous a donné il y a quatre mois, les abonnements ont exactement doublé. Le Semeur de juillet se tirera à 2.000. Je vous propose même de donne, à ce numéro 220 pages au lieu de 180.
ZOEGER.—Pourquoi?
BAROIS.—Voici. Les lettres reçues à propos de la revue augmentent dans une proportion considérable. J'en ai eu près de 300 à lire ce mois-ci! Je les ai classées, avec l'aide d'Harbaroux, selon les articles qui les avaient inspirées, et je transmettrai à chacun de vous celles qui le concernent. Vous verrez qu'il y en a beaucoup d'intéressantes. Je crois qu'il conviendrait de leur faire une place dans la constitution de nos numéros. Nous sommes sérieusement lus et discutés; ces lettres en sont la preuve; il faut en être fiers et ne pas enfouir dans nos tiroirs cette participation du public à notre effort. Je vous offre donc de publier chaque mois la partie la plus significative de notre correspondance, accompagnée, lorsqu'il y aura lieu... (Entrée de Portal.) Bonjour... accompagnée d'une note rédigée par l'auteur de l'article.
Portal, distrait et la figure sérieuse contre son habitude, serre la main de Cresteil, de Barois, puis s'assied.
HARBAROUX.—Et moi, vous ne me dites pas bonjour?
PORTAL (se relevant).—Je vous demande pardon. (Il sourit à peine, et se rassied.)
ZOEGER.—Nous ne vous espérions plus.
PORTAL (nerveux).—Oui, j'ai beaucoup à faire en ce moment. Je sors seulement de la bibliothèque du Palais. (Il lève les yeux et surprend des interrogations muettes.) Il y a peut-être du nouveau...
BAROIS.—u nouveau?
PORTAL.—Oui. J'ai entrevu ces jours-ci des choses ... pénibles. Je vous raconterai. Une erreur judiciaire? On ne sait pas...
Ce serait assez grave...
Ils se taisent, intrigués.
PORTAL (baissant la voix).—Il s'agirait de Dreyfus...
CRESTEIL.—Dreyfus, innocent?
BAROIS.—C'est fou!
HARBAROUX.—Une plaisanterie, voyons!
PORTAL.—Je n'affirme rien. Je vous dis le peu que je sais; et d'ailleurs, jusqu'ici, personne ne semble en savoir plus long que moi. Mais on s'inquiète, on cherche... Il paraîtrait même que l'État-Major fait une enquête. Fauquet-Talon s'en occupe activement: il m'a demandé un rapport détaillé sur le procès d'il y a dix-huit mois.
Un silence.
ZOEGER (posément, à Portal).—Il peut se glisser une erreur dans les jugements des tribunaux civils, qui fonctionnent tous les jours, pour qui la justice est une espèce de besogne. Mais un conseil de guerre, une réunion d'hommes choisis, qui ne sont pas des professionnels de la justice, qui, par conséquent sont sur leur garde, qui nécessairement y mettent une extrême circonspection...
BAROIS.—Et surtout pour une affaire de trahison, si importante... C'est un canard.
CRESTEIL.—Ça? Je vais vous le dire: c'est un coup machiné par...
WOLDSMUTH (d'une voix émue, mais sans hésitation).—... par les Juifs?
CRESTEIL (froidement).—... par la famille de Dreyfus.
BAROIS.—Tiens, vous êtes donc là, Woldsmuth? Je ne vous avais pas vu entrer.
HARBAROUX.—Ni moi.
ZOEGER.—Ni moi.
Poignées de mains.
PORTAL (à Woldsmuth).—Est-ce que vous avez aussi entendu parler de cette histoire?
Woldsmuth lève vers Portal son masque poilu, qu'assombrit une vague souffrance. Il fait oui, en baissant ses paupières ourlées de rose.
BAROIS (vivement).—Mais vous êtes bien d'avis qu'une erreur est invraisemblable?
Woldsmuth fait un geste résigné et dubitatif, comme s'il disait: «Que sait-on? Tout est possible...»
Léger malaise, accentué par un instant de silence.
BAROIS.—Tenez, Woldsmuth, je vous ai apporté vos épreuves.
PORTAL (à Woldsmuth).—Est-ce que vous connaissiez un peu ce Dreyfus?
WOLDSMUTH (avec un regard plus clignotant que jamais).—Non.
(Un temps.) Mais j'étais à la dégradation... Et j'ai vu.
BAROIS (agacé).—Vu quoi?
Les yeux de Woldsmuth s'emplissent de petites larmes. Il ne répond pas. Il regarde Barois, Harbaroux, Cresteil, Zoeger, l'un après l'autre, lentement, timidement.
Il se sent seul: un sourire résigné de vaincu.
A Monsieur J. BAROIS, 99 bis, rue Jacob, Paris.
«20 Octobre 1896
«Mon cher ami,
«Je suis dans l'impossibilité de me rendre chez vous; (un petit accident, sans gravité, mais qui m'immobilise pour quelques jours). J'aurais cependant bien besoin de vous voir. Auriez-vous la bonté de monter mes six étages, demain, ou après demain au plus tard?
«Excusez mon sans-gêne. C'est urgent.
«Votre très dévoué,
Ulric Woldsmuth.»
Le lendemain.
Une vieille maison, presqu'une cité, rue de la Perle, en plein Marais. Au sixième étage de l'escalier F, sous les toits, au fond d'un corridor, un petit logement, n° 14.
Barois sonne.
Une jeune femme vient lui ouvrir.
Trois chambres en enfilade. Dans la première, une vieille à cheveux gris, étale une lessive sur des ficelles. Dans la seconde, deux lits, deux matelats par terre; une machine à écrire devant la fenêtre. La troisième porte est fermée.
Au moment de l'ouvrir, la jeune femme se tourne vers Barois.
JULIA.—Il dort, Monsieur... Si vous n'étiez pas trop pressé?...
BAROIS (vivement).—Ne le réveillez pas, je serais désolé... Je vais attendre.
JULIA.—Ça lui fait tant de bien!
Barois la considère curieusement. Il ignorait que Woldsmuth fut marié.
Julia Woldsmuth: Vingt-cinq ans. Un type étrange.
Au premier abord, elle paraît très grande et très maigre. Pourtant le torse, sans corset dans une étoffe noire, est charnu et court. Mais les jambes, et surtout les bras, sont d'une longueur anormale.
Le visage s'effile en avant comme une lame. Ses cheveux annelés, rudes et noirs, qu'elle masse sur la nuque, allongent encore la forme de la tête. La ligne accusée du nez prolonge celle un peu fuyante du front. Les yeux très fendus mais à peine ouverts, glissent en montant vers les tempes. La lèvre supérieure, d'un dessin énigmatique, comme immobilisée dans un perpétuel début de sourire, surplombe la lèvre inférieure, sans la joindre.
D'un geste décidé, elle indique à Barois l'unique chaise de la chambre, et, sans gêne aucune, s'accroupit sur l'un des lits défaits.
BAROIS (prudemment).—Comment cet ... accident est-il arrivé, Madame?
JULIA.—Mademoiselle.
BAROIS (souriant).—Je vous demande pardon.
JULIA (sans se troubler).—Nous n'avons pas su. (Montrant les lits.) Il était minuit passé, nous étions couchées, mère et moi... (Montrant la chambre de Woldsmuth.) Nous avons entendu une petite explosion. Mais nous ne nous sommes pas inquiétées. Au contraire, j'étais contente de penser que mon oncle s'était remis à travailler, qu'il oubliait un peu cette affaire... Et puis, le matin, il nous a appelées: il avait la figure toute coupée par les éclats du verre, et brûlée...
BAROIS (intrigué).—Une explosion de quoi?
JULIA (sèchement).—Une cornue qui a éclaté au feu.
Barois se souvient tout à coup que Woldsmuth a été préparateur de chimie.
Léger silence.
BAROIS.—Je ne voudrais pas interrompre vos occupations, Mademoiselle...
Elle est accoudée au milieu des draps, las jambes croisées, et elle le dévisage librement, d'un regard sympathique et sans équivoque.
JULIA.—Nullement... Je suis heureuse de cette occasion. J'entends depuis longtemps parler de vous. J'ai lu vos études et vos chroniques dans le Semeur...
(Un temps. Sans le regarder, elle conclut, avec une franchise un peu distante.) Vous avez une belle vie.
Sa voix est gutturale, comme celle de Woldsmuth, avec, en plus, une désinvolture un peu rude.
Il ne répond rien. Etrange créature...
BAROIS (après un silence).—Woldsmuth ne m'avait pas dit qu'il s'occupait encore de chimie.
Julia tourne précipitamment la tête: un peu de fièvre dans ses prunelles fluides...
JULIA.—Il ne raconte rien, parce qu'il travaille, il cherche... Il se dit: «Quand j'aurai trouvé, je parlerai...»
Barois ne questionne pas, mais son attitude interroge.
JULIA.—Il n'a pourtant aucun mystère à faire avec vous, Monsieur Barois. Vous êtes un biologiste.
(D'une voix plus chaude.) Oncle pense qu'un jour l'homme arrivera, en réunissant certaines conditions dans un milieu parfaitement approprié, à créer de la vie... (Un sourire très simple.)
BAROIS.—A créer de la vie?
JULIA.—Ne le croyez-vous pas?
BAROIS (surpris).—Je sais que cette hypothèse n'est pas invraisemblable, mais...
JULIA (vivement).—Oncle en est sûr.
BAROIS.—C'est un beau rêve, Mademoiselle. Et, en somme, il n'y a aucune raison pour qu'il soit irréalisable... (Réfléchissant tout haut.) On sait aujourd'hui que jadis la température de la terre a été trop élevée pour que la synthèse vivante y ait été possible. Il y a donc eu un moment où la vie n'existait pas, puis un moment où la vie a existé.
JULIA.—Voilà. Et c'est cet instant précis où la vie est apparue, qu'il s'agit de reproduire...
BAROIS (rectifiant).—Permettez. Je ne dis pas tout à fait: l'instant où la vie est apparue... Je dirai: l'instant où, sous l'influence de certaines conditions, qui restent à trouver, la synthèse vivante s'est faite, entre des éléments qui existaient déjà de toute éternité.
JULIA (attentive).—Pourquoi cette distinction?
BAROIS (un peu gêné du tour technique de la conversation).—Mon dieu, Mademoiselle, parce que je crois que la locution courante: «la vie est apparue», est dangereuse... Elle correspond trop à cette manie que l'on a de toujours poser le problème d'un «commencement»...
Elle a croisé les jambes, posé le coude sur un genou, et tient son menton dans sa main.
JULIA.—Mais il est nécessaire, pour concevoir que la substance vivante existe, de supposer qu'elle a «commencé» d'être.
BAROIS (vivement).—Au contraire. Pour moi, c'est l'idée d'un début qui me semble impossible à concevoir! Tandis que j'accepte sans effort l'idée d'une substance qui «est», qui se transforme, qui évoluera éternellement.
JULIA.—... Tout l'univers se tenant...
BAROIS.—... ne formant qu'une seule substance cosmique, qui transmettrait la vie à tout ce qui émane d'elle...
(Un temps.) Vous travaillez sans doute avec votre oncle, Mademoiselle?
JULIA.—Un peu.
BAROIS.—Vous expérimentez les rayons du radium?
JULIA.—Oui.
BAROIS (rêveur).—Il est certain que les découvertes de la chimie n'ont pas laissé subsister grand'chose de l'abîme qui séparait autrefois la vie de la mort...
Un silence.
JULIA (montrant la machine à écrire).—Vous permettez que je continue mon travail? J'espère que vous n'attendrez plus longtemps...
Elle s'installe. Le cliquetis de la dactylographie emplit la pièce.
Sa silhouette se profile en sombre sur le vitrage blême. Une lumière frisante éclaire ses mains: des mains étrangères, plus claires au-dedans, d'une agilité simiesque; des doigts s'effilant en ongles jaunes plats et longs.
Cinq minutes s'écoulent.
LA VOIX DE WOLDSMUTH.—Julia!
Julia ouvre la porte.
JULIA.—Oncle, voici Monsieur Barois, justement...
Elle s'efface pour qu'il passe.
L'embrasure est étroite. Elle ne semble pas s'en apercevoir: aucun mouvement féminin de retrait. Au contraire, elle avance la tête, si près qu'il sent son souffle sur sa joue.
JULIA (bas).—Ne dites pas que je vous ai demandé d'attendre.
Il acquiesce des yeux.
La chambre de Woldsmuth est agrandie par un avant-corps vitré, ancien atelier de photographie transformé en laboratoire.
Barois s'avance vers le fond de la chambre, qui forme alcôve.
Un corps d'enfant soulève à peine les draps; si menu que la grosse tête en linge, posée sur l'oreiller, ne semble pas lui appartenir.
BAROIS.—Mon pauvre ami... Vous souffrez?
WOLDSMUTH.—Non. (Gardant sa main.) Julia va vous donner un siège...
Barois la devance et tire une chaise près du lit.
Julia sort.
WOLDSMUTH (fierté tendre, qui s'efforce de paraître paternelle).—Ma nièce.
C'est bien son timbre; mais, lui, il est méconnaissable. Un pansement d'ouate recouvre les cheveux, le nez, la barbe, ne laissant vivre qu'un sourire à demi-couvert, et les yeux marrons, sous les sourcils en broussaille.
WOLDSMUTH.—Je vous remercie d'être venu, Barois...
BAROIS.—C'est tout naturel, mon cher. Qu'y a-t-il donc?
WOLDSMUTH (la voix changée).—Ah Barois! Il faut que tous les honnêtes gens sachent enfin ce qui se passe... Il est là-bas, il va mourir de privation... Et il est innocent!
BAROIS (souriant à cette hantise de malade).—Encore ce Dreyfus?
WOLDSMUTH (dressé sur les coudes, fébrile).—Je vous en prie, Barois, je vous en supplie, au nom de tout ce qui est noble et juste, abandonnez tout parti-pris, oubliez tout ce que vous avez appris par les journaux il y a deux ans, et tout ce qu'on raconte... Je vous en supplie, Barois, écoutez-moi!
(Se laissant retomber sur l'oreiller.) Ah, on dit toujours: le bien de l'humanité... Oui, c'est facile de s'intéresser à l'humanité en général, à la masse anonyme, à ceux dont on ne verra jamais la souffrance! (Rire nerveux.) Mais ce n'est rien, ça, non. Aimer son vrai prochain, aimer ceux dont la souffrance se trouve, un beau jour, là, tout près de nous... Ça, c'est aimer, c'est être bon!
(Se redressant.) Barois, je vous en supplie, oubliez tout ce que vous savez, et écoutez-moi!
Toute la vie de cet homme, bloc informe de bandelettes, s'est réfugiée dans le regard, seul libre: regard mouvant et ardent, qui implore et qui scrute.
Barois ému, tend affectueusement la main.
BAROIS.—Je vous écoute. Ne vous exaltez pas...
Woldsmuth se recueille un instant.
Puis il tire de sous ses draps une liasse de pages dactylographiées qu'il essaye de feuilleter. Mais l'ombre, maintenant, s'est épaissie au fond de la pièce.
WOLDSMUTH (appelant).—Julia! Un peu de lumière, je te prie...
La machine à écrire stoppe.
Julia paraît, portant un petit fumeron à essence, qu'elle pose vivement sur la table de nuit.
WOLDSMUTH.—Merci.
Elle lui jette un sourire froid. Il la suit tendrement des yeux à travers ses linges, jusqu'à ce qu'elle ait disparu.
Puis il tourne la tête vers Barois.
WOLDSMUTH.—Il faut que je reprenne tout, comme si vous n'aviez jamais rien su...
(Changeant de ton.) Remontons au début de l'année 1894.
D'abord les faits, n'est-ce pas?
Donc, au Ministère de la Guerre, on constate des fuites de pièces. Puis, un jour, le chef de la section de statistique remet au ministre une lettre qui aurait été trouvée parmi les papiers de l'ambassade d'Allemagne. Une lettre autographe, une sorte de bordereau, une liste des documents que l'auteur de la lettre propose de livrer à son correspondant.
Voilà le point de départ. Bien.
On cherche un coupable. Sur cinq documents cités dans le bordereau, trois ont trait à l'artillerie: on cherche donc parmi les artilleurs de l'État-Major. D'après une analogie d'écriture, les soupçons se portent sur Dreyfus. Il est juif et peu aimé. Première enquête qui n'aboutit à rien.
BAROIS.—Vous le dites.
WOLDSMUTH.—La preuve, c'est que l'acte d'accusation n'a rien trouvé de suspect, ni dans la vie privée de Dreyfus, ni dans ses relations. Rien que des présomptions...
BAROIS.—Vous avez lu l'acte d'accusation?
WOLDSMUTH (montrant un feuillet).—J'en ai la copie. Je vous la remettrai.
Un silence.
WOLDSMUTH.—On procède alors à deux expertises des écritures. L'un des experts ne pense pas que le bordereau soit de Dreyfus. L'autre croit qu'il peut être de sa main: mais son rapport débute par une restriction capitale.
(Il cherche dans les papiers.) Voici le texte: «... si l'on écarte l'hypothèse d'un document forgé avec le plus grand soin...»
Ce qui veut dire, n'est-ce pas? L'écriture ressemble beaucoup à celle de Dreyfus, mais je ne peux pas dire si elle est de lui ou d'un imitateur.
Vous me suivez, Barois?
BAROIS (très froid).—Je vous suis.
WOLDSMUTH.—Sur ces deux expertises contradictoires, on décide l'arrestation. Oui. Sans attendre un supplément d'enquête, sans même surveiller les allées et venues de celui qu'on soupçonne... On est moralement convaincu que c'est lui. Ça suffit. On l'arrête.
Là, un incident dramatique, que je veux vous raconter.
Dreyfus est convoqué, un matin, au ministère, pour une inspection générale. On lui a recommandé, contre toutes les règles, de se présenter en civil. Premier étonnement. Remarquez que s'il avait été coupable, sa méfiance se serait éveillée et il aurait eu le temps de fuir. Mais non. Il arrive, tranquillement, à l'heure dite, et ne trouve aucun des camarades habituellement convoqués avec lui. Nouvelle surprise.
On l'introduit hâtivement dans le cabinet du chef d'État-Major général. Le général n'y est pas; mais des inconnus, en civils, sont là, massés dans un coin, et le dévisagent. Un commandant, sans lui parler de l'inspection, lui dit: «J'ai mal au doigt, voulez-vous écrire une lettre à ma place?»
Étrange moment pour demander à un subordonné ce service d'ami...
Il plane une sorte de mystère. Les paroles, les attitudes, tout est insolite.
Dreyfus s'assied, interloqué.
Aussitôt le commandant commence une dictée: des phrases choisies parmi celles du bordereau incriminé. Naturellement Dreyfus ne les reconnaît pas; mais la voix hostile de l'officier supérieur et cette atmosphère de drame qui l'enserre depuis son arrivée, le troublent: son écriture s'en ressent. Le commandant se penche vers lui, et crie: «Vous tremblez!» Dreyfus, ne comprenant pas ce mouvement d'humeur, s'excuse: «J'ai froid aux doigts...»
La dictée continue. Dreyfus s'applique à écrire mieux. Le commandant, déçu, l'interrompt: «Faites attention, c'est grave!» Et brusquement: «Au nom de la loi, je vous arrête!»
BAROIS (impressionné).—Mais ce récit, d'où le tenez-vous? L'Eclair a raconté les faits tout autrement.
(Il se lève et fait quelques pas dans la chambre obscure.) Qui vous dit que votre histoire est la vraie?
WOLDSMUTH.—Je sais d'où viennent les renseignements de l'Eclair. La scène a été dénaturée.
(Baissant la voix.) Barois, j'ai eu entre les mains la photographie de la dictée... Oui! Eh bien, l'émotion qu'elle révèle est presque insignifiante et très explicable.—En tous cas, je vous affirme qu'un traître qui se sent découvert, et à qui l'on veut faire écrire les mots mêmes dont il s'est servi pour trahir, ne se maîtrise pas à ce point, ce n'est pas possible!
Barois ne répond pas.
WOLDSMUTH.—Et puis, je sais encore autre chose. Le mandat d'arrestation a été signé un jour avant l'épreuve de la dictée; et l'arrestation était si bien décidée, quoi qu'il pût arriver ce matin-là, que la cellule de la prison était prête depuis la veille!
Barois ne répond toujours rien.
Il est assis au chevet du lit, les bras croisés, le buste droit, la tête un peu en arrière, les sourcils dressés, son menton volontaire, levé, provoquant.
Un instant de silence.
Woldsmuth parcourt ses notes. Puis il relève la tête, et se penche vers Barois.
WOLDSMUTH.—Donc, Dreyfus est incarcéré. Pendant quinze jours, au risque d'un transport cérébral, on refuse de lui expliquer son arrestation, on ne lui dit pas ce dont il est accusé.
Pendant ces quinze jours on enquête, on cherche partout. On le questionne, on le cuisine, sans résultat. On perquisitionne chez lui. On interroge sa femme avec une cruauté impitoyable, en lui laissant ignorer où est son mari, en lui persuadant même qu'elle signerait l'arrêt de sa mort si elle informait qui que ce soit de sa disparition.
Enfin, le quinzième jour, on montre à Dreyfus le bordereau. Il nie avec violence, avec désespoir: peu importe; l'instruction préparatoire est terminée.
Le parquet du Conseil de guerre est saisi. Une nouvelle instruction commence. Dreyfus est de nouveau questionné, pressé, retourné en tous sens; des témoins sont entendus; on cherche des complices, sans succès. L'enquête n'aboutit à rien de sérieux.
Alors, Barois, le ministre de la Guerre jette une première fois sa parole dans la balance. Au cours d'une interview de presse, il déclare, lui, ministre, que la culpabilité de Dreyfus est «absolument certaine», mais qu'il ne peut s'expliquer davantage.
Quelques semaines plus tard, Dreyfus est jugé à huis-clos, condamné, dégradé, déporté.
BAROIS.—Eh bien, voyons, mon cher, vous n'êtes pas ébranlé par cette condamnation? Si vraiment aucune charge sérieuse ne s'élevait contre Dreyfus, pensez-vous que des officiers...
WOLDSMUTH (avec angoisse).—Oui, je dis, j'affirme, qu'après quatre jours de débats, il a été indubitablement établi que Dreyfus n'avait eu aucune relation suspecte, que ses voyages à l'étranger, ses besoins d'argent, ses habitudes de jeu, ses liaisons amoureuses, tout ce que l'on avait lancé dans la presse antisémite, pour influencer défavorablement l'opinion, étaient des racontars sans fondement.
BAROIS (haussant les épaules).—Et, malgré ça, il se serait trouvé deux colonels, deux commandants, deux capitaines, pour... Voyons, mon cher, voyons!...
Dans le regard enflammé du malade passe comme une satisfaction de n'avoir pas convaincu Barois: plus la résistance sera vive, plus la certitude et la révolte finales, seront fortes.
WOLDSMUTH (soulevant les feuillets dactylographiés).—Toute la vérité est là.
BAROIS.—Qu'est-ce que c'est?
WOLDSMUTH.—Un mémoire, Barois, un simple mémoire... Rédigé par un inconnu, un admirable cœur, un esprit d'une clarté, d'une logique invincibles.
BAROIS.—Comment l'appelez-vous?
WOLDSMUTH (respectueusement).—Bernard Lazare.
Barois fait un geste qui signifie: «Je ne connais pas.»
WOLDSMUTH.—Il faut que vous m'écoutiez jusqu'au bout. Je n'ai pas fini; je commence... Je vous ai appelé, pour que vous sachiez, vous, ce qui se passe: mais pour autre chose aussi.
(Avec une autorité inattendue, imposante.) Barois, il faut vaincre cette conspiration de mensonges, de sous-entendus et de silences, qui bâillonne la vérité. Il faut qu'une parole accréditée se fasse entendre... Qu'un homme, dont la droiture est reconnue de tous, soit averti, soit convaincu, et que sa conscience crie tout haut, pour nous tous!
Il s'est soulevé sur les mains, et à travers ses linges, il fixe Barois, pour voir s'il a compris son désir.
Le masque de Barois, éclairé à plein par la petite flamme, reste dur et impassible.
WOLDSMUTH (précisant, avec une supplication de la voix).—Il faut, en un mot, que Luce reçoive la visite de Bernard Lazare. (Mouvement de Barois.) Il faut qu'il consente à l'entendre, sans parti-pris, avec sa seule bonne foi et sa probité.
(Brandissant les feuillets.) Il faut que cet appel soit imprimé à cent mille exemplaires!
Il y a là une mission de justice, à laquelle ni moi, ni vous, ni lui, ne pouvons plus nous dérober!
Barois fait mine de se lever.
WOLDSMUTH.—Attendez, Barois, ne vous prononcez pas. Non, non, ne me dites rien... Patientez, écoutez... (Suppliant.) Ne vous raidissez pas, Barois... Vous allez être juge: soyez seulement impartial... Je veux vous lire des fragments, je veux que vous soyez pénétré par cette longue clameur vers la justice...
(Fébrilement.) Voyons... Ceci, d'abord:
«Le capitaine Dreyfus a été arrêté à la suite de deux expertises contradictoires.
«L'instruction a été conduite de la façon la plus arbitraire. Elle n'a abouti qu'à montrer l'inanité absolue des racontars faits sur le capitaine Dreyfus, et le mensonge des rapports policiers que des témoins ont démenti et que l'accusation n'a pas osé retenir.
«La base de l'accusation reste donc une feuille de papier pelure—sorte de bordereau d'envoi, de style et d'orthographe bizarres,—déchirée en quatre morceaux et soigneusement recollée.
«D'où venait cette pièce? D'après le rapport de M. Besson d'Ormescheville, le général Joux, en la remettant à l'officier de police judiciaire, déclara qu'elle avait été adressée à une puissance étrangère, qu'elle lui était parvenue, mais que, d'après les ordres formels du ministère de la Guerre, il ne pouvait indiquer par quels moyens ce document était tombé en sa possession.
«L'accusation ne sait donc pas comment ce document non daté, non signé, est parti des mains de l'inculpé. La défense ignore par quelles voies il est revenu de l'ambassade qui le possédait. A qui la lettre était-elle adressée? Qui l'a volée ou livrée? A toutes ces questions pas de réponse.»[1].
(S'interrompant.) Ailleurs, déjà, il avait démontré l'invraisemblance de cette pièce. (Reprenant sa lecture.) Tenez:
«Ce document lui-même est-il vraisemblable? Non.
«Examinons son origine, ou plutôt l'origine qu'on lui attribue. D'après M. Montville (Journal du 16 Septembre 1896) il aurait été trouvé, à l'ambassade d'Allemagne, par un garçon de bureau qui avait l'habitude de livrer à des agents français, le contenu des corbeilles à papier. Y a-t-il jamais eu à l'ambassade d'Allemagne quelqu'un qui se soit livré à ce trafic? Oui. Cela était-il resté ignoré de l'ambassade? Non. Quand cette ambassade en eut-elle connaissance? Un an environ avant l'affaire Dreyfus. Dans quelles circonstances? Je vais le dire[2].»
(S'interrompant.) Je vous passe le récit du procès de Mme Millescamps en police correctionnelle. Vous le lirez...
(Reprenant:)
«Donc, un an avant l'affaire Dreyfus, on savait à l'ambassade d'Allemagne que les détritus de papier étaient communiqués à des agents français. Mais on ignorait, un an après, si celui qui se livrait à ce commerce n'était pas toujours à l'ambassade. On avait, par conséquent, la plus extrême méfiance, et on prenait les plus grandes précautions.
«Est-il donc admissible qu'on ait déchiré en quatre morceaux et jeté au panier un papier aussi compromettant pour un auxiliaire précieux et qu'on devait tenir essentiellement à conserver, alors qu'on savait que, selon toute probabilité, ces fragments seraient livrés au bureau de renseignements du ministère de la Guerre?
«L'origine qu'on attribue à ce bordereau n'est donc pas plausible, à moins qu'on admette sa confection par un faussaire en relations avec un personnage, depuis longtemps acquis, du bas personnel de l'ambassade d'Allemagne, et ayant pu par cette entremise introduire ce bordereau fabriqué, énumérant des pièces qui jamais n'ont été livrées, et le faire sortir ensuite par des procédés habituels.
«Etudions maintenant la vraisemblance du document. Voit-on la nécessité, pour celui qui aurait trahi, de faire accompagner son envoi d'un bordereau inutile et compromettant? Généralement la préoccupation d'un espion ou d'un traître est de ne laisser aucune trace de ses actes. S'il livre des documents, il les mettra entre les mains d'une série d'intermédiaires chargés de les faire parvenir à destination, mais jamais il n'écrira. Il faut remarquer d'ailleurs que l'acte d'accusation est fort embarrassé pour expliquer la façon dont un tel bordereau aurait pu être transmis. Est-ce par la poste? Quelle folie! Est-ce par l'intermédiaire de quelqu'un? Alors, quel besoin de remettre un bordereau? Quelle nécessité d'écrire, au lieu de donner les pièces de la main à la main?
L'absurdité de ces deux hypothèses est telle, que l'acte d'accusation a mieux aimé s'en abstenir.»[3]
(S'interrompant.) Vous me suivez, Barois?
Barois, sans répondre, l'invite à poursuivre d'un geste rude.
Il ne cherche plus à prendre une attitude. Les coudes sur les genoux, le dos ployé, le menton enfoncé dans les mains, son regard dur impitoyablement rivé à cette tête inexpressive en tarlatane dont pas un détail ne lui échappe, les narines palpitantes, les lèvres entr'ouvertes et crispées sous la moustache, il écoute, il attend la suite, le cœur battant d'anxiété, espérant encore que tout cela n'est pas vrai.
WOLDSMUTH (après l'avoir examiné silencieusement).—Je continue...
«A-t-on trouvé, pendant les deux mois d'enquête, que le capitaine Dreyfus ait eu des relations suspectes? Non. Cependant l'étrange missive dit: «Sans nouvelles m'indiquant que vous désirez me voir.» Il voyait donc le correspondant mystérieux? On a scruté sa vie, suivi tous ses pas, examiné toutes ses actions, on n'a pu citer aucune fréquentation compromettante...
«Jamais l'accusation n'a pu produire un fait, alléguer une charge pouvant faire supposer que le capitaine Dreyfus ait eu des relations quelconques avec un agent étranger, MÊME POUR LE SERVICE DE L'ÉTAT-MAJOR!
«... Quelles raisons ont pu pousser le capitaine Dreyfus à commettre la trahison dont on l'accuse? Etait-il besogneux? Non. Il était riche. Avait-il des passions et des vices à satisfaire? Aucun. Etait-il avare? Non, il vivait largement et n'a pas augmenté sa fortune. Est-ce un malade, un impulsif susceptible d'agir sans raison? Non, c'est un calme, un pondéré, un être de courage et d'énergie. Quels puissants motifs cet heureux avait-il pour risquer tout ce bonheur? Aucun.
«A cet homme que rien ne pousse au mal, que rien n'accuse, que l'enquête établit probe, travailleur, de vie régulière et honnête; à cet homme, on montre un papier mystérieux, louche, de provenance obscure: On lui dit: «C'est toi qui as écrit ceci. Trois experts l'attestent, et deux le nient.» Cet homme, s'appuyant sur sa vie passée, affirme qu'il n'a pas commis pareil acte, il proteste de son innocence; on reconnaît l'honorabilité de son existence, et, sur le témoignage contradictoire de ces experts en écriture, on le condamne à la déportation perpétuelle!»[4]
Un silence.
WOLDSMUTH.—Et voici maintenant ce que Lazare écrit sur la communication secrète:
«Cela n'eût pas suffi, en effet.
«Aussi, mis en présence de ces seules charges, le Conseil de guerre penchait vers l'acquittement.
«C'est alors que le général Mercier, malgré les promesses formelles faites au ministre des Affaires étrangères, se décida à communiquer en secret—hors la présence même de l'avocat,—aux juges du Conseil de guerre, dans la chambre des délibérations, la pièce, suprême accusation, qu'il avait gardée jusqu'à ce moment. Quelle était cette pièce?
«Elle était, dit l'Eclair, relative au service d'espionnage à Paris, et contenait cette phrase: «DÉCIDÉMENT CET ANIMAL DE DREYFUS DEVIENT TROP EXIGEANT.»
«Cette lettre existe-t-elle? Oui. A-t-elle été communiquée secrètement aux juges? Oui.
«La phrase citée par l'Eclair est-elle contenue dans cette missive?
«J'affirme que non.
«J'assure que celui qui a livré au journal l'Eclair cette pièce dont on redoutait à tel point—en raison de complications diplomatiques possibles—la divulgation, que l'on dut, à cause de son existence même, exiger le huis-clos,—j'assure que celui-là n'a pas craint, ajoutant une infamie à celles déjà commises, de falsifier ce document capital, dont la publication devait achever de convaincre chacun de la culpabilité du malheureux, qui, depuis deux ans, subit un martyre sans nom.
«La lettre apportée aux juges ne contenait pas le nom de Dreyfus, MAIS SEULEMENT L'INITIALE D.
«L'Eclair, dans son numéro du 10 Novembre 1896 ne conteste pas mon affirmation, mais il faut cependant que je la précise:
«La lettre révélée pour la première fois, malgré le double huis-clos, si je puis dire, par l'Eclair est arrivée au ministère de la Guerre par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères, huit mois environ avant l'affaire Dreyfus.
«Il est si vrai qu'elle ne contenait pas le nom de Dreyfus, qu'on s'appliqua pendant quelque temps à filer et à surveiller un malheureux garçon de bureau du ministère de la Guerre, dont le nom commençait par un D. Cette filature fut rapidement abandonnée, ainsi qu'une ou deux autres, postérieurement entreprises, puis la lettre fut oubliée. Aucun soupçon ne se portait sur Dreyfus (nouvelle preuve qu'on ne se méfiait pas de lui dès l'origine) et on ne songea à cette missive qu'après la saisie du bordereau et son attribution au capitaine Dreyfus.
«Le récit de l'Eclair du 15 Septembre 1896 n'est donc pas exact.
«Faut-il maintenant examiner la vraisemblance de cette lettre?
«Supposons qu'une puissance étrangère soit assez heureuse pour s'attacher un officier d'État-Major, et que cet officier lui livre les pièces les plus confidentielles. Il sera pour cette puissance d'un prix inestimable, elle fera tout pour se l'attacher, et prendra, de concert avec lui, toutes les précautions nécessaires pour qu'il ne puisse être soupçonné... D'autre part, cette puissance étrangère se fera un devoir, commandé par la plus élémentaire prudence, de ne pas compromettre elle-même, par d'inutiles confidences un homme si précieux, et elle se gardera bien plus encore de confier à une lettre qui peut s'égarer ou être saisie, le nom de l'officier susceptible de lui rendre de si grands services.
«Il reste donc acquis, jusqu'à ce que le gouvernement l'ait nié, que la condamnation du capitaine Dreyfus, que nulle preuve suffisante ne provoquait, a été obtenue en mettant sous les yeux des juges une lettre systématiquement soustraite à l'accusé, systématiquement soustraite au défenseur.
«Au court du procès, ils l'ont ignorée: ils n'ont donc pu la discuter, contester soit son origine, soit l'attribution qu'on faisait d'une initiale à un homme que rien d'autre ne désignait.
«Est-il admissible qu'on puisse condamner quelqu'un en lui refusant les éléments nécessaires à sa défense? N'est-il pas monstrueux qu'on puisse, hors la salle d'audience, peser sur l'esprit, sur la décision, sur la sentence des juges? Est-il permis à qui que ce soit d'entrer dans la chambre des délibérés et de dire au magistrat: «Oublie ce que tu viens d'entendre en faveur de l'homme que tu as à juger. Nous avons, nous, en main, des pièces que, par raison d'Etat ou de haute politique, nous lui avons cachées, et sur lesquelles nous te demandons le secret. Ces pièces nous en affirmons l'authenticité, la réalité.» Et un tribunal, là-dessus, a prononcé la sentence! Nul de ses membres ne s'est levé et n'a dit: «On nous demande là une chose contraire à toute équité, nous ne devons pas y consentir!»
«Et l'on avait à tel point égaré l'opinion, on lui avait tellement présenté l'homme qu'on avait condamné comme le dernier des misérables, indigne de toute pitié, que l'opinion ne songea pas à s'émouvoir de la façon dont celui qu'on lui présentait comme le plus odieux des traîtres, avait été condamné. Ceux-mêmes dont le patriotisme s'inquiète lorsqu'on touche à un officier, oublièrent les procédés employés dans cette circonstance, parce qu'on les avait convaincus, au nom de la patrie offensée, de la nécessité du châtiment, par tous les moyens.
«S'il n'en eût pas été ainsi, des milliers de voix se seraient élevées,—et elles s'élèveront peut-être demain, après que les préventions auront été dissipées,—pour protester au nom de la justice. Elles auraient dit: «Si l'on admet de semblables abus de pouvoir, des mesures aussi arbitraires, la liberté de chacun est compromise, elle est à la merci du ministère public, et on enlève à tout citoyen accusé les garanties les plus élémentaires de la défense.»[5]
Barois a laissé glisser son front dans ses mains. Immobile, le visage altéré de pitié et de chagrin, il fixe désespérément, à ses pieds, un carreau du carrelage, fendu en deux et soudé par la poussière.
WOLDSMUTH.—(Sa voix grave, cassée par la fatigue et l'exaltation, reprend, avec une sombre tristesse):
«Il est encore temps de se ressaisir. Qu'il ne soit pas dit que, ayant devant soi un juif, on a oublié la justice. C'est au nom de cette justice que je proteste, au nom de cette justice qu'on a méconnue.
Le capitaine Dreyfus est un innocent et on a obtenu sa condamnation par des moyens illégaux: il faut que son procès soit revisé.
«... Et ce n'est plus à huis clos qu'il devra être jugé, mais devant la France entière.
«J'en appelle donc de la sentence du Conseil de Guerre...
«Des faits nouveaux viennent d'être apportés au débat: ils suffisent juridiquement pour faire casser le jugement: mais au-dessus des subtilités juridiques, il y a des choses plus hautes: ce sont les droits de l'homme à sauvegarder sa liberté, et à défendre son innocence, si on l'accuse injustement!»[6]
Woldsmuth, à la limite de l'effort, retombe au creux de l'oreiller. Il a baissé les paupières; et, tout à coup, dans ce bonhomme en chiffons, il n'y a plus rien de vivant, que le tremblement des petites mains, immobiles sur le drap.
Barois se lève et, lourdement, fait quelques pas.
Puis il s'approche du lit et s'arrête, les jambes écartées, le buste frémissant, les mains entr'ouvertes à hauteur de la poitrine.
Il respire fortement, avant de pouvoir parler.
BAROIS.—En tous cas, il faut chercher, il faut savoir! Le doute est horrible...
Je vous promets que Luce recevra votre ami, dès demain.
«22 octobre 1896.
«Mon cher Barois,
«Monsieur Bernard Lazare vient de passer l'après-midi dans mon cabinet. Vous savez dans quelles dispositions d'esprit j'étais hier soir: je ne puis en changer si brusquement. Mais je confesse que cet entretien m'a profondément remué.
«Tout cela m'apparaît si grave, si plein de périls, qu'il me semblerait criminel d'improviser une attitude, ou de prendre une décision à la légère. J'ai donc refusé, pour le moment, de prêter mon nom à quoi que ce soit, tout en assurant M. Lazare de ma sympathie, qui est complète. On devine en lui un de ces hommes, pour qui tout l'appareil des puissances, la raison d'Etat, les puissances temporelles, les puissances politiques, les autorités de tout ordre, intellectuelles, mentales mêmes, ne pèsent pas une once devant un mouvement de la conscience propre[7]. C'est, de plus, un esprit lucide, dont l'argumentation est troublante.
«Il n'est pas possible de penser sans anxiété qu'une aussi effroyable injustice pourrait avoir été commise sous nos yeux. Je ne pourrais pas vivre plus longtemps en compagnie d'une semblable inquiétude.
«Je veux savoir.
«Je veux être rassuré. Je reste persuadé que la vérité est autre, qu'il y a quelque chose que nous ignorons et qui nous délivrera de cette angoisse. Aussi vais-je me consacrer à une sérieuse enquête personnelle, dont je vous communiquerai les résultats.
«D'ici là, mon cher ami, ne me parlez plus de cette pénible affaire; laissez-moi toute la lucidité et le calme que je veux mettre à cette recherche. Je vous le demande instamment. Et si vous me permettez un conseil, n'en parlez pas davantage autour de vous: l'opinion n'a été que trop agitée déjà au sujet de cette histoire, et il ne peut rien sortir de bon de ces bas-fonds soulevés.
«Mon fils aîné va tout à fait bien. Mais voici que la santé de notre chère petite Antoinette nous tourmente à nouveau; je crois que nous serons obligés de tenter l'opération. C'est un gros souci pour moi, mon cher Barois, et pour ma pauvre Lucie. Le calme bonheur est à peu près impossible dans une famille nombreuse...
«De cœur avec vous, mon cher Barois,—et plus un mot de tout cela, je vous en conjure.
Marc-Elie Luce.»
[1] Bernard Lazare, La vérité sur l'affaire Dreyfus. Stock, réédition de 1898 (p. 80 et suiv.).
[2] Op. cit. p. 72.
[3] Op cit p. 74.
[4] Op. cit. p. 81 et suiv.
[5] Op. cit. pp. 83 à 89.
[6] Op. cit. pp. 89 à 91.
[7] Cette dernière phrase, depuis: «pour qui» est empruntée à Péguy. Notre jeunesse, p 96.
A Auteuil, un matin de juillet, 1897.
Le cabinet de Luce.
La chaleur matinale d'un beau jour; l'air tremble dans les fenêtres ouvertes: entre les rideaux de percale blanche, l'éblouissement de la verdure ensoleillée, où piaillent les moineaux et les enfants.
Barois assis, attentif et silencieux.
Luce à son bureau, les mains sur le bord de la table, le buste en arrière, mais la tête légèrement penchée, comme si le poids du crâne l'entraînait en avant; dans l'ombre du front, ses yeux de visionnaire levés vers Barois.
LUCE (d'une voix contenue).—Vous comprenez, Barois, que je ne prononce pas des mots si graves sans que ma conviction soit absolue.
Quand vous êtes venu, il y a huit mois, et que vous m'avez envoyé Bernard Lazare, je sentais déjà combien l'affaire était dangereuse. Je connaissais, depuis l'article de l'Eclair, l'hypothèse d'un dossier secret... (Aprement.) Mais je me refusais à y croire! Les avertissements précis de Lazare m'ont fait peur. J'ai voulu savoir.
(Douloureusement.) Je sais.
Un temps.
(Elevant la voix.) Il y a huit mois, je n'osais pas supposer que des juges militaires, conscients de leur responsabilité, eussent pu accepter dans leurs débats l'intervention de leur propre ministre; encore moins la production par lui de pièces secrètes, à l'insu de l'accusé et de son défenseur.
Depuis, mon pauvre Barois, j'en ai appris bien davantage... J'ai appris, non seulement qu'il y avait eu un dossier secret, volontairement caché à la défense par les juges du conseil de guerre; mais, de plus, que ce dossier ne contenait même pas cette révélation indubitable, qui, sans pouvoir servir d'excuse à la faute judiciaire, eût du moins soulagé nos consciences! Qu'il ne contenait aucun document grave contre l'accusé, rien d'autre que des présomptions, faciles à interpréter, soit pour, soit contre lui!
Ses mains ponctuent l'affirmation, d'un battement sec des doigts sur le bois de la table.
(Gravement.) Je vous jure que ceci est la vérité.
Barois n'a pas tressailli. Les jambes écartées, les mains sur les genoux, il écoute. Sur son visage énergique, dans son regard ardent, une curiosité passionnée, mais aucune surprise.
LUCE (posant la main sur une liasse sanglée).—Je ne peux pas vous raconter par le menu l'enquête que j'ai faite. Voilà huit mois que je ne me suis pas occupé d'autre chose. (Bref sourire.) Vous le savez, puisque je n'ai même pas pu régulièrement donner au Semeur cet article hebdomadaire que je vous avais promis...
Mon mandat de sénateur, et d'anciennes camaraderies, m'ont permis de pénétrer partout, de contrôler moi-même toutes mes informations. Lazare m'a procuré une photographie des pièces les plus importantes. J'ai pu les examiner, seul, au calme, sur ce bureau. J'ai fait faire, par surcroît, des expertises d'écritures par les meilleurs spécialistes d'Europe. (Palpant un dossier.) Tout ça est là. Je connais maintenant l'affaire à fond: (pesant ses mots) et il ne me reste plus de doute ... plus un seul!
BAROIS (se levant).—Il faut qu'on le sache! Il faut le dire! Au ministère, d'abord.
Luce reste un instant silencieux. Puis il fixe Barois: un bon sourire, doux et triste, qui se perd dans sa barbe.
Il se penche, expansif.
LUCE.—Lundi dernier,—à cette heure-ci, tenez—j'étais au Ministère de la Guerre, face à face avec un vieux camarade, un officier qui est aujourd'hui tout-puissant à l'État-Major.
Je ne l'avais pas revu depuis environ deux ans. Il m'avait accueilli par une explosion d'amitié. Au seul nom de Dreyfus, il s'est dressé, aigre et violent, me coupant la parole, refusant la discussion, se démenant comme si j'étais venu lui chercher une querelle personnelle. J'ai été péniblement impressionné; mais je venais pour parler, et j'ai dit tout ce que je voulais dire, tout ce que j'avais patiemment recueilli, vérifié, tout ce dont j'étais sûr. Il marchait à travers son cabinet, les bras croisés, faisant craquer le vernis de ses bottes, mais silencieux, désarmé par la précision de mes renseignements. Enfin il est revenu s'asseoir, et, le plus calmement qu'il a pu, il m'a posé des questions sur l'état de l'opinion au Sénat, dans le monde des savants, des professeurs, autour de moi. Il avait l'air d'hésiter encore, de vouloir dénombrer ses adversaires avant de prendre un parti. Je lui ai saisi la main, je l'ai supplié, au nom de notre amitié, au nom de la justice: «Il est temps encore... Le scandale est imminent, mais il n'a pas éclaté. Vous pouvez le conjurer en prenant les devants: que l'initiative de la révision vienne de l'armée, et tout est sauvé. On a le droit de se tromper, mais il faut savoir reconnaître librement son erreur, et la réparer...» Je me heurtais à un silence vaguement inquiet, mais têtu, glacial.
Brusquement il s'est levé, il a mis un tiers entre nous; et il m'a congédié poliment, sans un mot d'éclaircissement, ni d'espoir...
Son visage se crispe. Un temps.
LUCE.—Alors, Barois, je suis revenu, tout doucement, à pied, en suivant la Seine. (Avec angoisse.) Et pendant un long moment, mon cher, je me suis demandé ... si ce n'était pas lui qui avait raison...
Barois ébauche un geste de surprise.
LUCE (levant la main, et la laissant retomber avec découragement).—J'ai si nettement entrevu ce que sera cette affaire, du jour où notre doute sur la culpabilité de Dreyfus sera public!
BAROIS (vivement).—Ce sera sa réhabilitation!
LUCE.—Soit. Mais ne nous leurrons pas. Ce sera autre chose encore autre chose surtout.
(Avec lourdeur.) Ce sera, mon ami, la lutte du bon droit contre la société française... Une lutte acharnée, et peut-être, en un sens, criminelle?...
BAROIS (violemment).—Oh, comment pouvez-vous...
LUCE (interrompant).—Ecoutez-moi... Si Dreyfus est innocent, ce qui est certain... (Scrupuleux.)—ou à peu près certain...—sur qui retombe la faute?
Qui vient prendre sa place d'accusé?
C'est l'État-Major de l'armée française.
BAROIS.—Eh bien ?
LUCE.—Et derrière l'État-Major, c'est le gouvernement actuel de la République, c'est-à-dire l'ordre établi, auquel nous devons notre vie nationale depuis vingt-cinq ans...
Barois se tait. Un temps.
LUCE.—Je n'oublierai jamais, Barois, ce retour le long des quais... Devant moi, ce dilemme terrible: connaître la vérité et fermer les yeux; se résigner au respect d'un jugement inique, parce qu'il a été rendu, solennellement, par l'armée et par le gouvernement, avec—il faut bien le dire—l'approbation passionnée de l'opinion. Ou bien attaquer, preuves en mains, l'erreur judiciaire, déchaîner le scandale, et, délibérément, comme un révolutionnaire, assaillir de front cet ensemble sacré; l'ordre constitué de la nation!
Barois médite quelques secondes: puis un brusque sursaut des épaules.
BAROIS.—Il n'y a pas à hésiter!
LUCE (avec simplicité).—J'ai hésité cependant. Je n'ai pas pu faire si vite bon marché de cette paix relative dans laquelle nous vivons depuis tant d'années.
(Regardant Barois avec attention.) Je comprends votre révolte, qui ne prend rien autre en considération, que la justice. Pourtant, laissez-moi vous le dire, Barois, nos attitudes ne peuvent pas être tout à fait les mêmes: dans votre ardeur à prendre parti, il y a ... comme un sentiment privé... Je ne crois pas me tromper... Il y a comme une satisfaction personnelle, comme une revanche, enfin...
BAROIS (souriant).—C'est vrai, vous avez raison... Oui, j'ai eu plaisir à me placer ouvertement de l'autre côté de la barricade... (Sérieux.) Car il n'y a pas de doute, notre adversaire d'aujourd'hui, c'est bien mon adversaire d'autrefois: la routine, l'autocratisme, l'indifférence pour tout ce qui est élevé et sincère! Ah, vraie ou illusoire, que notre conviction est plus belle!
LUCE.—Je vous comprends bien. Mais ne me reprochez pas d'hésiter, au moment où il va falloir exposer tant de laideurs aux yeux de tous, aux yeux des étrangers...
Barois ne répond pas, son regard et son sourire semblent dire: «Je vous admire de toute mon âme; que parlez-vous de reproche?...»
LUCE (sans lever la tête).—Cette semaine, Barois, j'ai passé par une crise de conscience terrible... J'ai été balloté entre mille sentiments contraires... (Douloureusement.) Jusqu'à me laisser émouvoir par mon intérêt propre... Oui, mon cher, j'ai fait le compte de ce que je risque, comme individu, si je parle, si j'attache ce monstrueux grelot ... et j'ai eu un vilain frisson...
BAROIS.—Vous exagérez.
LUCE.—Non. Il y a beaucoup de chances, vu l'état de l'opinion, pour qu'en quelques mois je sois irrémédiablement coulé.
J'ai neuf enfants mon ami...
Barois ne proteste plus.
LUCE.—Vous voyez, vous êtes de mon avis...
(D'une voix chaude.) Et pourtant, les circonstances sont telles que je ne peux pas me dérober, sans faillir à la direction même de ma vie. J'ai aimé la vérité par-dessus tout, et avec elle la justice, qui en est la réalisation pratique. J'ai toujours eu cette conviction, cent fois contrôlée par les faits, que le devoir indiscutable et le seul bonheur qui ne déçoive pas, c'est de tendre vers la vérité de toutes ses forces, et d'y conformer aveuglément sa conduite: tôt ou tard, malgré les apparences, on s'aperçoit que c'était la bonne voie.
(Lentement.) Il faut que chacun de nous consente à sa vie: et la mienne m'interdit de me taire. Ah, jamais je n'ai si clairement compris que, si le travail de tous permet à quelques-uns de vivre dans le recueillement, et si ces efforts solitaires sont nécessaires, puisque, bout à bout, ils forment le progrès,—en revanche, ce privilège ne va pas sans créer des obligations intransgressibles! Il faut les reconnaître, lorsqu'elles se présentent: en voici une!
Barois approuve d'une simple inclinaison de tête.
Luce se lève.
LUCE.—Je ne veux pas me poser en redresseur de torts. Je veux seulement que mon cri d'alarme avertisse le gouvernement, et provoque dans l'opinion un revirement de conscience qui s'impose. Après quoi, je suis résolu à livrer mon enquête telle quelle, comme un outil de travail,—et à m'effacer. Vous me comprenez? (Avec une expression de souffrance réelle.) Simplement rejeter ce doute qui m'étouffe!
Si Dreyfus est coupable,—et je le souhaite encore de toutes mes forces—qu'on le prouve, en débats publics: nous nous inclinerons. Mais avant tout, que l'on dissipe cet air irrespirable!
Il s'avance pesamment jusqu'à la fenêtre ouverte, et baigne son regard dans les fraîcheurs vertes du jardin.
Quelques instants passent.
Il se retourne vers Barois, comme s'il se souvenait tout à coup du but de sa convocation; et, familièrement, il lui met ses deux mains sur les épaules.
LUCE.—Barois, j'ai besoin d'un organe où lancer cet appel à la loyauté...
(Hésitant.) Consentiriez-vous à jeter votre Semeur dans la mêlée?
Une telle fierté relève le visage de Barois, que Luce se hâte de parler.
LUCE.—Non, non, écoutez-moi, mon ami. Il faut réfléchir.
Voilà deux ans que, pour créer cette revue, vous vous êtes donné, sans restriction. Votre Semeur est en plein élan. Eh bien, s'il devient mon porte-voix, tout est compromis; c'est la faillite probable de tous vos efforts...
Barois s'est dressé, trop bouleversé pour répondre. Une joie soudaine, un orgueil immense...
Ils se regardent. Luce a compris. Autour d'eux l'atmosphère s'alourdit. Dans le silence où bat leur double cœur, ils ouvrent les bras et s'étreignent.
C'est le commencement des exaltations surhumaines...
Huit jours plus tard.
Dans la cour de la maison qu'habite Barois, rue Jacob.
Au fond d'une remise ouverte, Woldsmuth et quelques acolytes, sont assis à une table. Breil-Zoeger, Harbaroux, Cresteil, Portal, vont et viennent.
Derrière eux, en piles blanches, 80.000 numéros du Semeur sont entassés. Odeur humide de l'impression fraîche.
D'autres ballots, cordés, sont prêts pour la province.
Le long des murs, une centaine de trimardeurs attendent en file indienne, comme à l'entrée d'une soupe populaire.
Trois heures.
La distribution commence.
Barois griffonne des chiffres sur un registre.
Les placards disparaissent, par blocs de 300, sous l'aisselle des coureurs, qui s'enfuient aussitôt vers la rue, sur leurs savates molles.
Déjà les premiers sont hors de la zone où ils doivent se taire, et, boulevard Saint-Germain, rue des Saints-Pères, sur les quais, les cris éclatent: une clameur rauque, dispersée par cent bouches haletantes:
—Numéro spécial!... «le semeur»!... Révélation sur l'affaire Dreyfus!... «conscience», lettre au peuple français, de marc-elie luce, sénateur, membre de l'institut, professeur au Collège de France...
Les passants se retournent, s'arrêtent. Les boutiques béent. Des enfants courent. Des mains se tendent.
Un vent d'orage semble éparpiller les feuilles.
En deux heures, le vol des papillons blancs s'est abattu jusque dans les quartiers extrêmes, sur la chaussée, sur les tables, au fond des poches.
Les aboyeurs reviennent, assoiffés, les bras vides.
La cour s'emplit à nouveau. Le vin coule.
Les dernières piles sont entamées, épuisées, emportées.
L'essaim bourdonnant s'échappe une seconde fois, secouant, dans le soir d'été, la torpeur de la ville chaude.
La foule s'exalte. Les boulevards grouillent.
Veillée de guerre...
Déjà, en mille endroits, des pensées françaises, soulevées par cette vague d'héroïsme, s'entrechoquent.
Une irrésistible explosion de passions a ébranlé le cœur nocturne de Paris.
Les nouveaux bureaux du Semeur rue de l'Université.
Quatre fenêtres, à l'entresol, portant, fixés aux appuis, de larges plaques de tôle, où se lit, en majuscules noires sur fond blanc: «le semeur».
Petit appartement de cinq pièces.
Dans les deux premières, des scribes, des employés, un va-et-vient commercial. La troisième, plus vaste, sert de salle de rédaction. Sur la cour, le cabinet de Barois et une chambre où travaille la sténographe.
Le 17 janvier 1898. Cinq heures du soir.
La salle de rédaction: une grande table, semée d'encriers et de buvards; au mur, un exemplaire déployé de l'Aurore du 13: «J'accuse...», et deux affiches, imprimées par Roll, reproduisant en caractères gras, la péroraison de la lettre de Zola.
Conversation bruyante: Barois, Harbaroux, Cresteil, Breil-Zoeger, Portal, et d'autres collaborateurs.
—Cavaignac a affirmé que Dreyfus avait fait des aveux, le matin de la dégradation.
—C'est faux!
—Pourtant je suis sûr qu'il est de bonne foi...
—On lui a persuadé qu'il y a un témoignage contemporain.
—D'ailleurs, il ne dit pas qu'il a vu le document!
BAROIS.—Comment! Il existerait, depuis 1894, un témoignage aussi accablant, dont la publication suffirait à annuler, d'un coup, tout le branle-bas,—et depuis quatre ans personne n'aurait pensé à le produire?
CRESTEIL.—Ça saute aux yeux!
BAROIS.—Voici les faits, tels qu'ils se sont passés...
Le silence s'établit aussitôt.
BAROIS.—Je les tiens de Luce dont l'enquête est sérieuse. Vous allez voir comme tout cela est simple.
Dreyfus s'est trouvé, le matin de la dégradation, une heure de suite avec Lebrun-Renault, capitaine de la garde républicaine. Il a protesté de son innocence avec la dernière énergie. Il a même annoncé qu'il allait la crier publiquement, si bien que le capitaine, inquiet d'un scandale possible, a cru devoir prévenir le colonel.
Ensuite Dreyfus a raconté une nouvelle épreuve, analogue à celle de la dictée, qu'il avait eu à subir quelques jours auparavant: le ministre, espérant toujours obtenir une certitude qui allégerait sa responsabilité personnelle, lui avait envoyé dans sa cellule le commandant du Paty de Clam, pour lui demander «si ce n'était pas par patriotisme qu'il aurait proposé des documents à l'Allemagne» dans le but de s'en procurer d'autres plus importants,—ce qui eût atténué sa faute et motivé un adoucissement de peine. Lebrun-Renault ne connaissait naturellement pas cette démarche. Dreyfus, qui attendait de minute en minute le commencement du supplice, était dans un état de surexcitation facile à imaginer, et parlait fébrilement sans beaucoup de suite. On comprend très bien comment ses paroles ont pu être mal comprises, mal rapportées, dénaturées en passant de bouche en bouche, et comment a pu naître l'histoire d'un échange de documents avec l'étranger.
Quant à Lebrun-Renault il n'a jamais parlé d'aveux, à cette époque. Le général Darras a fait demander, le matin même, après la dégradation, s'il n'y avait pas eu d'incident particulier; on lui a répondu que non, et il en a aussitôt rendu compte au ministre. De même, le rapport que Lebrun-Renault a fait, sa mission accomplie, au Gouverneur de Paris,—rapport que Luce a vu,—porte la mention: «Rien à signaler.»
Pensez-vous que s'il avait recueilli un aveu, sous quelque forme que ce fût, il ne se serait pas hâté de le dire? Et quand le ministre de la guerre a appris, le lendemain, les bruits vagues qui couraient dans la presse, est-ce que, s'ils avaient été le moins du monde fondés, il ne s'en serait pas préoccupé? Est-ce qu'il n'aurait pas tout de suite ordonné une enquête, afin d'avoir ce témoignage décisif? Est-ce qu'il n'aurait pas cherché à presser de nouveau Dreyfus, afin d'avoir des détails complémentaires, et afin de savoir,—question essentielle pour la sécurité nationale,—quels étaient exactement les documents livrés à la puissance étrangère?
Non, vraiment, plus on y réfléchit et plus apparaît l'irréalité de cette histoire des aveux!
CRESTEIL.—Vous devriez publier une interview de Luce sur ce sujet.
BAROIS.—Il trouve que ce n'est pas encore le moment. Il attend la déposition de Casimir-Perier, au procès Zola.
JULIA WOLDSMUTH (paraissant à la porte).—On demande M. Barois à l'appareil.
Il se lève et sort.
ZOEGER.—Quoi qu'il en soit, j'estime que l'attitude de Cavaignac est très heureuse pour nous.
PORTAL.—Heureuse pour nous?
ZOEGER.—Evidemment. Voilà un ancien ministre de la Guerre, qui, devant la Chambre, en pleine tribune, est venu affirmer solennellement qu'il existe une pièce décisive, d'après laquelle la culpabilité de Dreyfus ne peut pas être mise en doute. En bien, le jour où il sera publiquement démontré que c'est faux, que la pièce en question n'existe pas, ou que, si elle existe, c'est un document refait après coup pour les besoins de la cause et antidaté,—ce jour-là, l'opinion du pays sera fortement ébranlée! J'en fais mon affaire. Ou alors c'est qu'on nous aura changé la France!
CRESTEIL (tristement).—Vous n'avez jamais rien dit de si vrai...
PORTAL.—Tout ça va être discuté au procès Zola.
Rentrée de Barois.
BAROIS (assez troublé).—C'est Woldsmuth qui me téléphonait... Il vient d'apprendre qu'il est question de limiter la plainte contre Zola, en ne relevant que ses imputations relatives au conseil de guerre de 1894, et en négligeant les autres. Je me demande dans quel but...
PORTAL (se levant).—C'est très important!
CRESTEIL.—Mais ils n'en ont pas le droit!
PORTAL.—Je vous demande pardon.
CRESTEIL.—En quoi cela modifierait-il...?
BAROIS.—Laissez Portal s'expliquer.
PORTAL.—Ce serait très grave. Le gouvernement cherche par tous les moyens possibles, à entraver le développement de cette affaire. Or il y a un article de loi, formel, d'après lequel l'accusé ne peut fournir d'autres preuves que celles des faits articulés et qualifiés dans la citation. Autrement dit, en restreignant les termes de l'assignation, on circonscrit à volonté l'extension des débats.
CRESTEIL.—Avec ce procédé, on pourrait arriver à réduire la défense de Zola à presque rien!
PORTAL.—Mais parfaitement!
BAROIS.—C'est monstrueux... C'est un étranglement du procès.
CRESTEIL (indigné).—Ce sont des finasseries de procureur!
PORTAL.—C'est la loi.
Consternation générale.
ZOEGER (posément).—Pour ma part je n'y crois pas. Les accusations sont trop outrageantes pour être escamotées. Impossible de ne pas poursuivre celui qui a écrit et publié ça!
Il s'approche du tableau où s'étale, en gros caractères, la lettre de Zola.
(Lisant.) «J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire...!»
... «J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice...!»
... «J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées...!»
... «J'accuse le général de Boisdeffre...!»
... «J'accuse le général de Pellieux...!»
... «Enquête scélérate!»
... «Enquête de la plus monstrueuse partialité...!»
... «J'accuse les bureaux de la Guerre d'avoir mené dans la presse ... une campagne abominable, pour égarer l'opinion et couvrir leur faute...!»
CRESTEIL.—Et le défi de la fin:
... «En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi, etc...
«Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en Cour d'Assises, et que l'enquête ait lieu au grand jour!».
«J'attends![1]»
BAROIS.—Et vous croyez qu'un gouvernement peut avaler ça, sans broncher?
PORTAL.—En tout cas, Barois, il y aurait intérêt, avant que la citation ne soit rédigée, à dénoncer publiquement la supercherie.
ZOEGER.—Il faudrait que ton article éclate comme un pétard, demain à la première heure.
BAROIS.—Je vais m'y mettre.—Portal, voulez-vous me rechercher le texte exact de cette loi dont vous parlez?
PORTAL.—Puis-je téléphoner à la bibliothèque du Palais?
BAROIS (ouvrant la porte).—Mademoiselle Julia?
PORTAL.—C'est pour moi, Mademoiselle. Voudriez-vous me demander le 889-21?
BAROIS (se dirigeant vers son bureau).—Je vous laisse... Serez-vous ce soir boulevard Saint-Michel?
DIVERSES VOIX.—Oui...
BAROIS.—Je vous apporterai mon travail avant de le porter à Roll. Nous le reverrons ensemble. A ce soir...
Une heure plus tard.
La salle de rédaction est vide. Les employés sont partis. Le
garçon de bureau balaye, en attendant l'heure de la fermeture.
Barois travaille dans son cabinet.
Brusquement, la porte s'ouvre: Julia blême, le visage angoissé;
et, en même temps qu'elle, par la porte ouverte, une rumeur
étrange.
JULIA.—Monsieur Barois ... une émeute ... Vous entendez...
Barois, surpris, gagne les pièces qui donnent sur la rue. Il ouvre une fenêtre et se penche dans la nuit.
Un murmure confus.
La flamme jaune d'un réverbère, toute proche, l'aveugle. Ses yeux s'habituent peu à peu à l'obscurité: devant lui, la chaussée est encore déserte; mais, là-bas, entre les façades d'ombre, coule une masse noire qui bourdonne.
Il s'apprête à descendre, par curiosité. Le brouhaha se rapproche; des chants; quelques cris:
«Dreyfus!...»
Le groupe isolé qui dirige la colonne n'est plus qu'à cinquante mètres de la maison. Barois aperçoit des visages et des bras levés vers lui.
—Conspuez le Semeur! Conspuez Barois! Conspuez!
Il recule précipitamment.
BAROIS.—Les volets! Vite!
Il aide le garçon, affolé.
Au moment où il va barricader la dernière croisée, une canne, lancée dans les carreaux, le couvre de débris de verre.
La foule est sous les fenêtres, à quatre ou cinq mètres de lui. Il distingue le timbre différent des voix.
—Le Semeur! Vendu! Traître! A mort!
Des pierres, des bâtons, font sauter les vitres en éclat, et frappent le bois des volets.
Il reste planté au milieu de la pièce, l'oreille tendue:
—Mort à Zola! Mort à Dreyfus!
Dans la pénombre, il devine Julia, debout, immobile. Il la pousse vers son cabinet.
BAROIS.—Demandez le numéro du commissariat...
Les projectiles doivent être épuisés. Les vociférations redoublent de violence, rythmées par les piétinements:
—Mort à Luce! Mort aux traîtres!
—Mort à Barois! Vendus!
BAROIS (très pâle, au garçon).—Verrouillez la porte, et gardez le vestibule!
Il se dirige vers son cabinet, ouvre un tiroir et prend un revolver.
Puis il rejoint le garçon.
BAROIS (rage froide).—Le premier qui ose entrer, je le tue comme un chien.
Sonnerie du téléphone.
BAROIS (à l'appareil).—Allo! le commissaire? Bien... Je suis le Directeur du Semeur. Il y a une émeute, rue de l'Université, sous mes fenêtres.
Ah, déjà? Bon, merci...
Je ne sais pas; mille, quinze cents peut-être...
Le tapage continue: martèlement cadencé des semelles sur le pavé, dominé par une sorte de rugissement, d'où se détachent en notes plus aigües, des cris:
—Mort à Dreyfus! Mort à Zola! Mort aux vendus!
Subitement la clameur hésite, et cesse. Quelques instants de tumulte confus: on devine l'intervention des agents.
Puis des cris éclatent, isolés, interrompus, de moins en moins distincts.
Le piétinement s'éloigne.
L'émeute est dispersée
Barois tourne un commutateur et aperçoit Julia, tout contre
lui, debout, appuyée à une table.
Elle est tellement enlaidie par l'émotion, qu'il la fixe une seconde, pour la reconnaître: les traits crispés, le teint de plomb, le visage vieilli, durci, farouche, avec une expression bestiale et passionnée... L'instinct à nu... Quelque chose de sensuel, d'effroyablement sensuel...
Il pense: «Voilà son masque, dans l'amour...»
Le regard qu'il lui jette est brutal et pénétrant comme un viol: et elle le reçoit, comme une femelle consentante.
Puis, détente nerveuse, elle s'abat sur un siège en sanglotant.
Il quitte la pièce, sans prononcer un mot. Ses mains tremblent
d'énervement.
Il ouvre les volets.
La rue est calme, à peine plus animée qu'à l'ordinaire, si ce n'est aux fenêtres et aux balcons, par des groupes de curieux.
Sous les réverbères brisés, dont le vent couche et tord les flammes, les agents font les cent pas.
LE GARÇON.—Monsieur, c'est le concierge avec le Commissaire, pour les constatations...
[1] L'Aurore (13 janvier 1898). Lettre ouverte d'Emile Zola au Président de la République: «J'accuse...»
17 février 1898.
Au Palais de Justice: la Cour d'Assises, 10e journée du procès
Zola.
L'audience est suspendue.
Salle comble. Une foule tassée, grouillante, bavarde, gesticulant
sur place. Un semis d'uniformes, d'aiguillettes dorées,
parmi des toilettes de femmes. On se montre des têtes connues:
généraux de l'État-Major, actrices en vedette, journalistes
comédiens, députés. Le barrage noir des avocats sépare cette
houle chatoyante du prétoire vide, que domine le Christ mélodramatique
de Bonnat.
Une atmosphère âcre, étouffante, que traverse et secoue par instants une onde brusque de sympathie ou de haine, violente comme un courant électrique.
Dans les premiers rangs de l'auditoire, un groupe attentif,
parlant bas: Harbaroux, Barois, Breil-Zoeger, Cresteil d'Allize,
Woldsmuth; et parmi ces hommes, la silhouette sibylline de
Julia.
Trois heures.
Un remous profond, venu des portes, soulève la foule. Un flot neuf d'arrivants s'insinue dans les moindres interstices du public massé; des étudiants à bérets, des avocats en robe, escaladant les hautes cloisons de l'enceinte réservée, se juchent en grappes, sur la crête des portants, sur l'entablement des fenêtres.
Luce, patiemment, s'enfonce à son tour dans la cohue, qui murmure avec hostilité son nom, et parvient à gagner la place que Barois lui a réservée près de lui.
LUCE (bas, à Barois).—Je viens de là-bas.—ça va être rude. La majorité du jury penche pour l'acquittement. A l'État-Major, ils s'en rendent compte, ils sont très alarmés... Ils vont essayer de frapper un grand coup, aujourd'hui ou demain...
Un brusque silence, qui ne se prolonge pas: l'entrée de la Cour.
L'hémicycle se peuple: les magistrats, en robe rouge; les jurés, deux par deux, d'une gravité endimanchée de cortège municipal.
Emile Zola s'assied au banc des accusés, près du gérant de l'Aurore; derrière eux, les avocats: Mes Labori, Albert et Georges Clémenceau, entourés de leurs secrétaires.
Un sourd grondement ébranle la salle.
Zola et Labori se penchent vers la droite, où vient de retentir
un coup de sifflet. Zola a les deux mains jointes sur le pommeau
de sa canne, et les jambes croisées; sa face de hérisson, plissée de
rides, est soucieuse; à chaque mouvement de sa physionomie
le lorgnon brille, aiguisant la vivacité des prunelles. Il parcourt
lentement des yeux cette multitude qui le hait, et son
regard s'attarde, se repose un instant sur le groupe du Semeur.
Dans l'allée centrale, un uniforme s'avance. Des voix murmurent:—«Pellieux...
Pellieux...»
A pas décidés, le général se dirige vers la barre des témoins et s'arrête militairement.
BAROIS (à Luce).—Voilà... C'est Pellieux qu'ils lancent à l'assaut!
L'émotion de la salle est si bruyante, que le général se retourne, d'un geste impatient, et la toise, imposant tout à coup, par son visage martial, par sa prestance de grand seigneur, par l'indiscutable autorité de toute sa personne, un silence, qui, d'ailleurs, est de courte durée.
Le Président, gros homme à figure ronde, dont les lèvres rasées, entre les favoris, sont minces et closes, fait un mouvement de colère; mais il est impuissant à rétablir le calme.
Dans le brouhaha, qui peu à peu s'éteint, on distingue la voix nette du général articulant certains mots:
«—... Les termes stricts de la légalité ... l'affaire Dreyfus... Je demande à parler...[1]».
DES VOIX.—Chut! chut!
M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX.—... «Je répéterai le mot si typique du colonel Henry: «On veut de la lumière? Allons-y!»
Son timbre métallique, provoquant, sonne dans la vaste enceinte, devenue enfin silencieuse et immobile.
M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX.—«Au moment de l'interpellation Castelin, il s'est produit un fait que je tiens à signaler. On a eu, au ministère de la Guerre,—et remarquez que je ne parle pas de l'affaire Dreyfus,—la preuve absolue de la culpabilité de Dreyfus, absolue! et cette preuve, je l'ai vue!»
Il s'est tourné vers les jurés, puis vers la défense, puis vers le public. Un sourire de défi anime son masque dur d'escrimeur.
M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX.—«Au moment de cette interpellation il est arrivé au Ministère de la Guerre un papier dont l'origine ne peut être contestée, et qui dit—je vous dirai ce qu'il y a dedans:—«Il va se produire une interpellation sur l'affaire Dreyfus. Ne dites jamais les relations que nous avons eues avec ce juif.»
«Et, Messieurs, la note est signée! Elle n'est pas signée d'un nom connu, mais elle est appuyée d'une carte de visite, et, au dos de cette carte de visite, il y a un rendez-vous insignifiant, signé d'un nom de convention, qui est le même que celui qui est porté sur la pièce, et la carte de visite porte le nom de la personne...»
Une légère pause.
L'auditoire a eu un bref frémissement, et il demeure haletant,
considérant tour à tour le tribunal, le témoin, Zola qui n'a pu
réprimer un mouvement d'indignation, et les jurés, sur la figure
banale desquels il y a comme un bien-être, une impression de
soulagement.
M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX (d'une voix triomphante qui claironne).—«Eh bien! Messieurs, on a cherché la révision du procès par une voie détournée; je viens vous donner ce fait. Je l'affirme sur mon honneur! Et j'en appelle à M. le général de Boisdeffre pour appuyer ma déposition.
«Voilà ce que je voulais dire!»
Un trépignement général, prolongé, au-dessus duquel crépite un tonnerre d'applaudissements.
Luce reste les bras croisés, très pâle, son large front penché en avant, les yeux tristement levés vers le prétoire. Ses amis échangent des regards violents, chargés de révolte; mais ils demeurent abattus, immobilisés par ce coup de massue que rien ne faisait prévoir.
BREIL-ZOEGER (à mi-voix).—C'est un faux!
BAROIS (avec un haut-le-corps).—Parbleu! (Il montre du doigt un groupe d'officiers, sanglés dans leurs dolmans, levant leurs mains gantées de blanc pour applaudir frénétiquement.) Mais essaye donc de leur faire admettre ça!
Labori s'est dressé, de toute sa stature d'athlète, offrant aux coups son poitrail de lutteur. On n'entend pas ce qu'il dit. Il semble donner de son front bas contre un mur. Sa bouche est ouverte, toute ronde. Avec des gestes véhéments il s'adresse au Président qui paraît vouloir lui couper la parole.
Enfin, dans une accalmie, on distingue une interruption du Président, lancée d'une voix tranchante:
M. LE PRÉSIDENT.—«Mais, maître Labori...»
Me LABORI (exaspéré).—«Oh, Monsieur le Président...»
M. LE PRÉSIDENT (avec hauteur).—Le témoin vient de parler. Avez-vous une question à poser?»
Me LABORI.—«Permettez, Monsieur le Président, ici...»
Le timbre cuivré du général de Pellieux domine le colloque,—cinglant comme un coup de cravache.
M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX.—«Je demande que l'on appelle M. le général de Boisdeffre!»
Me LABORI (d'une voix tonnante, qui impose enfin le silence).—«Je demande, Monsieur le Président, et aujourd'hui l'incident se présente avec une gravité telle que la défense ne peut pas ne pas insister,—que la parole me soit donnée un moment, non pas seulement pour répondre à M. le général de Pellieux—encore qu'on ne réponde pas à une affirmation,—mais pour tirer immédiatement, au point de vue de l'affaire, la conséquence nécessaire qui se dégage des paroles de M. le général de Pellieux.
«Je vous demande la permission, Monsieur le Président, de dire deux mots.»
M. LE PRÉSIDENT (acerbe).—«Deux mots seulement...
Me LABORI.—«Deux mots seulement.»
M. LE PRÉSIDENT.—«A moins que vous n'ayez une question à poser?»
Me LABORI (éclatant).—«Comment aurais-je des questions à poser, en réponse à un fait absolument nouveau qui est jeté dans le débat? J'en ai une cependant, et c'est à cette question que je vais arriver.»
M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX.—«Vous avez jeté dans le débat un fait nouveau, en lisant un acte d'accusation de M. le commandant d'Ormescheville, qui était du huis-clos.»
Me LABORI (triomphant).—«Nous avançons, nous avançons!»
M. LE GÉNÉRAL GONSE.—«Je demande la parole.»
M. LE PRÉSIDENT.—«Tout à l'heure, général.»
Me LABORI.—«Je dis simplement ceci: Il vient de se produire à la barre un fait d'une gravité exceptionnelle; c'est un point sur lequel nous sommes tous d'accord. M. le général de Pellieux n'a pas parlé de l'affaire Dreyfus, il a parlé d'un fait postérieur à l'affaire Dreyfus; il n'est pas possible que ce fait ne soit pas discuté ici, ou ailleurs, dans une autre enceinte. Après une pareille chose, il ne s'agit plus de restreindre ni de rétrécir un débat d'assises. Que M. le général de Pellieux me permette, très respectueusement, de lui faire observer, qu'il n'est pas une pièce, quelle qu'elle soit, qui ait une valeur quelconque, et qui, scientifiquement, constitue une preuve, avant qu'elle ait été contradictoirement discutée. Qu'il me permette d'ajouter que nous sommes maintenant dans cette affaire,—qui, quoi qu'on veuille et quoi qu'on fasse, prend des proportions d'une affaire d'État,—en présence de deux pièces ou de deux dossiers également graves l'un et l'autre, parce qu'ils sont secrets: un dossier secret, qui a été l'instrument de la condamnation de Dreyfus en 1894, sans contradiction, sans discussion, sans défense; un second dossier secret, qui sert depuis des semaines à empêcher qu'on apporte ici autre chose que des affirmations.»
Une pause.
«Quelque respect que j'aie pour la parole de soldat de M. le général de Pellieux, je ne puis accorder la moindre importance à cette pièce.»
Un tollé furieux éclate dans la salle; des ricanements soufflètent l'avocat.
Me LABORI (faisant face à la tourmente, et, d'une voix violente, implacable, articulant tous les mots).—«Tant que nous ne la connaîtrons pas, tant que nous ne l'aurons pas discutée, tant qu'elle n'aura pas été publiquement connue, elle ne comptera pas! Et c'est au nom du droit éternel, au nom des principes que tout le monde a vénérés depuis les temps les plus reculés et depuis que la civilisation existe, que je prononce ces paroles!»
Une légère oscillation du public. L'opinion hésite. Plusieurs «Très bien!» se font entendre.
Me LABORI (plus calme).—«Par conséquent, j'arrive à un point qui, maintenant, est d'une précision telle, que ma tranquillité à tous les points de vue augmente. Je n'ai, en ce qui me concerne, qu'une préoccupation dans cette affaire: c'est celle de l'obscurité constante, c'est celle de l'angoisse publique augmentant tous les jours, grâce à des ténèbres qui s'épaississent quotidiennement, je ne dis pas par des mensonges, mais je dis par des équivoques.
«Que Dreyfus soit coupable ou innocent, qu'Esterhazy soit coupable ou innocent, ce sont là sans doute des questions de la plus haute gravité. Nous pouvons, les uns et les autres, M. le général de Pellieux, M. le Ministre de la Guerre, M. le général Gonse, moi-même, avoir là-dessus des convictions, et nous pourrons y persévérer éternellement, si l'éclaircissement complet, si la lumière absolue n'est pas faite.
«Mais ce qu'il est indispensable d'éviter, c'est que l'émotion du pays augmente et se perpétue.
«Eh bien! maintenant, sans que le huis-clos puisse être invoqué, sans que les arrêts de la Cour puissent être mis en avant, nous avons un moyen d'arriver à la lumière, à la lumière partielle...
(Avec un grand éclat.) «Car, quoiqu'il advienne, la révision du procès Dreyfus s'imposera!»
Violentes manifestations. Des cris éclatent: «Non! non! La patrie avant tout!»
Labori se redresse, d'un bond, face au public. Son regard est méprisant et brutal. Son poing de reître s'abat sur les dossiers ouverts devant lui.
Me LABORI.—«Les protestations de la foule marquent bien qu'elle ne comprend pas la gravité de ce débat, au point de vue éternel de la civilisation et de l'humanité!»
Tumulte.
Quelques applaudissements, restreints et nourris.
Labori se détourne et attend, les bras croisés, que le calme soit rétabli.
Me LABORI (continuant).—«Si Dreyfus est coupable, et si la parole de ces généraux, que je crois de bonne foi—et c'est ce qui m'émeut,—si la parole de ces généraux est fondée, si elle se justifie en fait et en droit, ils en feront la preuve dans un jugement contradictoire. S'ils se trompent, au contraire, eh bien! ce sont les autres qui feront leur preuve. Et, voyez-vous, quand la lumière sera absolue, quand toutes les ténèbres seront dissipées, il y aura peut-être dans la France un ou deux hommes qui sont les coupables, qui seront responsables de tout le mal. Qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, on les connaîtra, on les flétrira! Et puis, nous nous remettrons tranquillement à nos travaux de paix ou de guerre, Monsieur le général; car la guerre, n'est-il pas vrai, ce n'est pas quand on a des généraux à la barre, des généraux qui sont dignes de parler au nom de l'armée qu'ils commandent, ce n'est point à ce moment-là que personne la redoute; et ce n'est pas par la menace d'une guerre, qui n'est pas prochaine, quoi qu'on en dise, qu'on intimidera Messieurs les jurés!
«Je termine par une question. Vous voyez, Monsieur le Président, que je tendais à quelque chose de précis, et ici je vous remercie de m'avoir laissé la parole; je rends hommage à votre bienveillance, à votre courtoisie, à votre sentiment de la gravité de la situation.
«La question, Monsieur le Président, la voici: que M. le général de Pellieux s'explique sans réserve; et, la pièce, qu'on l'apporte ici!»
Un silence anxieux.
Mouvements d'émotion au banc des jurés, dont les yeux se
dirigent vers le général de Pellieux.
Court silence.
M. LE PRÉSIDENT.—«M. le général Gonse, qu'est-ce que vous avez à dire?»
Le général Gonse se lève et s'approche du général de Pellieux, qui lui cède sa place à la barre.
Une physionomie soucieuse; un regard terne, mais agressif; une voix qui parait étrangement molle après celle du général de Pellieux et celle de Labori.
M. LE GÉNÉRAL GONSE.—«Monsieur le Président, je confirme complètement la déposition que vient de faire le général de Pellieux.
«Le général de Pellieux a pris l'initiative, il a bien fait; je l'aurais prise à sa place pour éviter toute équivoque. L'armée ne craint pas du tout la lumière, elle ne craint pas du tout, pour sauver son honneur, de dire où est la vérité.»
Labori fait un geste d'assentiment et de confiance.
Des applaudissements.
M. LE GÉNÉRAL GONSE (avec lourdeur).—«Mais il faut de la prudence, et je ne crois pas qu'on puisse apporter publiquement ici des preuves de cette nature, qui existent, qui sont réelles, et qui sont absolues.»
Ces restrictions inattendues provoquent une houleuse inquiétude. Quelques murmures désapprobateurs. La majorité hésite, cherchant le vent.
Me Clémenceau se lève posément.
Me CLÉMENCEAU.—«Monsieur le Président, je vous demande la parole.»
Mais le général de Pellieux bondit à la barre, qu'il saisit fébrilement à deux mains, et son ton cassant domine tout.
M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX.—«Messieurs, je demande à ajouter un mot!»
Le Président, d'un geste, donne la parole au général.
Me Clémenceau se rassied.
M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX.—«Me Labori a parlé tout à l'heure de la revision, toujours à propos de la communication de cette pièce secrète au conseil de Guerre. On n'a pas apporté la preuve de cette communication...»
Cette fois l'assertion est si mal défendable,—après l'émouvante comparution de Me Salle, à qui le Président a dû défendre de dire ce qu'il savait, et après la déposition formelle de Me Demange—que la salle n'ose plus manifester, favorisant par un silence irrésolu les tonitruantes protestations des amis de Dreyfus.
Le général de Pellieux, surpris de cet accueil, hésite.
M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX.—«Je ne sais pas...»
Des ricanements l'interrompent.
Il fait un brusque demi-tour, offrant au public l'honnêteté de son visage rude, et, au fond des yeux caves, la franchise d'un regard hautain, habitué à d'autres horizons.
D'une voix sans réplique, d'une voix d'officier qui sait arrêter net une mutinerie de troupes, il cingle toutes les faces souriantes.
M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX.—«Je demande à ne pas être interrompu par des ricanements!»
Il reste quelques secondes impassible, immobilisant la foule sous son regard.
Puis, froidement, il se retourne vers le tribunal.
M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX.—«Je ne sais pas si l'on a écouté avec suffisamment d'attention la déposition qu'a faite l'autre jour le colonel Henry. Le colonel Henry a fait remarquer que le colonel Sandherr lui avait remis un dossier secret; que ce dossier secret avait été scellé avant la séance du conseil de guerre, et qu'il n'avait jamais été ouvert. J'appelle l'attention de MM. les jurés là-dessus.
«Maintenant, quant à la revision du procès Dreyfus sur cette pièce, qu'est-ce qu'il faut? la preuve...»
M. LE PRÉSIDENT.—«Nous n'avons pas à nous occuper de la revision. Cela ne peut pas se faire ici.»
M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX.—«On ne parle que de cela...»
M. LE PRÉSIDENT.—«Je sais bien, mais elle ne peut pas se faire à l'audience d'une cour d'assises, vous le savez.»
M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX.—«Je m'incline. Je m'incline et j'ai dit.»
M. LE PRÉSIDENT (s'adressant à M. le général Gonse).—«Vous n'avez plus rien à dire, général?»
M. LE GÉNÉRAL GONSE.—«Non, Monsieur le Président.»
M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX.—«Je demande qu'on appelle le général de Boisdeffre pour confirmer mes paroles.»
M. LE PRÉSIDENT.—«Voulez-vous lui faire dire de venir demain?»
Sans répondre, le général tourne à demi la tête vers la salle, et, par dessus l'épaule, à la cantonnade, en chef qui a le droit de se faire servir à tout instant, il interpelle son officier d'ordonnance.
M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX.—«Commandant Ducassé! Voulez-vous aller chercher le général de Boisdeffre, en voiture,—tout de suite!»
Il est l'Armée elle-même.
Son attitude implacable en impose à tous, à ses adversaires, à ses juges; la foule, subjuguée, hurle de joie, comme un chien qui vient d'être battu.
Me CLÉMENCEAU (se levant).—«Monsieur le Président, j'aurais à répondre quelques mots aux observations de M. le général de Pellieux.»
Il s'arrête, interrompu une fois encore par le général.
Et, debout, d'aplomb sur les jambes il suit, de cet œil vif et à peine ironique qui anime son visage plat de levantin, une courte joute entre Labori et le général de Pellieux, relative à la publication de l'acte d'accusation de 1894.
Labori, drapé dans les plis de sa robe, les bras dressés laissant voir la chemise jusqu'au coude, semble jeter l'anathème.
Me LABORI.—«M. le général de Pellieux fait appeler ici M. le général de Boisdeffre: il a raison!
«Mais ce qu'il faut bien qu'on sache, et vous verrez qu'avant quarante-huit heures mes paroles se révéleront prophétiques, c'est qu'il ne sera pas possible d'arrêter le débat avec les paroles de M. le général de Pellieux, ni avec celles de M. le général de Boisdeffre. Ce ne sont pas des paroles d'hommes, quels qu'ils soient, qui donneront de la valeur à ces pièces secrètes. Ces pièces, il faudra, ou que l'on n'en parle pas, ou qu'on les montre; c'est pourquoi je dis à M. le général de Pellieux: «Apportez les pièces, ou n'en parlez plus!»
Me Clemenceau lève tranquillement la main vers le Président.
Me CLÉMENCEAU.—«M. le Président, j'ai l'honneur de demander la parole...»
Sa sobre assurance impose, par contraste avec la superbe impétuosité de son confrère.
Me CLÉMENCEAU.—«... Le général de Pellieux nous a dit qu'au moment de l'interpellation Castelin on avait eu des preuves absolues... Est-ce donc que, jusqu'alors, on n'avait eu que des preuves relatives?»
Courte pause.
Il reste impassible, mais une ombre malicieuse plisse ses paupières bridées.
Zola, toujours appuyé sur sa canne, tourne légèrement la tête, et lui lance un bref sourire d'approbation.
LUCE (à Barois, bas).—Il sait sûrement que la pièce est fausse...
Me CLÉMENCEAU (de sa voix paisible).—«Je demande à M. de Pellieux: Comment se fait-il,—car c'est une question qu'on commence à se poser partout—comment se fait-il que ce soit dans un procès d'assises qu'une parole aussi sérieuse soit prononcée? Comment se fait-il que M. le général Billot, au cours de l'interpellation Castelin, n'ait pas parlé de ces pièces secrètes à la Chambre, et n'ait pas menacé la Chambre de la guerre, et que ce soit à une audience de la Cour d'Assises qu'on vienne prononcer les graves paroles que vous avez entendues hier, et que l'on vienne révéler les documents secrets?»
M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX (agacé).—«Je n'ai pas menacé le pays de la guerre; tout cela, c'est jouer sur les mots. Que M. le général Billot n'ait pas parlé, lors de l'interpellation Castelin, de cette pièce ou d'autres,—car il y en a d'autres, le général de Boisdeffre vous le dira,—cela ne me regarde pas; le général Billot fait ce qu'il veut.
(S'adressant aux jurés.) «Ce qui est sûr, c'est que M. le général Billot, à plusieurs reprises, l'a dit à la Chambre: «Dreyfus a été justement et légalement condamné!»
Me LABORI (se dressant, prêt à bondir).—«Ici, j'interviens pour dire qu'il y a au moins une de ces deux paroles qui est fausse, c'est: «légalement»!
M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX (provoquant).—«Prouvez-le!»
Me LABORI (brutal).—«C'est prouvé.»
Me CLÉMENCEAU (plus conciliant).—«Nous avons voulu toujours prouver; on nous en a empêchés; et si M. le général de Pellieux veut que je m'explique sur ce point, je suis prêt à le faire.»
M. LE PRÉSIDENT (se hâtant, d'un geste sec).—«C'est inutile.»
Me LABORI (incapable de se contenir).—«C'est prouvé par Me Salle, c'est prouvé par Me Demange! C'est prouvé par les publications des journaux qu'on n'a pas démenties! C'est prouvé par M. le général Mercier, qui n'a pas osé dire en face de moi, le contraire! Je lui avais envoyé par les journaux, la veille, une provocation à laquelle il a répondu par le silence, à laquelle il a répondu par une distinction, qui, à elle toute seule, est une preuve décisive. Car, lorsque j'ai dit: «Le général Mercier a livré une pièce au Conseil de Guerre, et publiquement le général Mercier s'en est vanté partout», M. le général Mercier, jetant encore dans le débat (je ne dis pas volontairement, mais peut-être inconsciemment) une équivoque, a répondu: «Ce n'est pas vrai». Et je lui ai dit: «Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Est-ce que c'est: que vous ne l'avez pas dit partout, ou est-ce que c'est au contraire: que vous n'avez pas livré de pièces?» Et il a répondu: «C'est seulement que je ne m'en suis pas vanté partout.»
«Je dis que pour tout esprit de bonne foi, la preuve est faite. La preuve, c'est que personne, malgré toute l'émotion que l'affaire a jetée dans le pays, personne ne s'est levé pour dire ce que M. de Pellieux ici n'ose pas dire: je l'en défie!»
Une pause.
(Souriant.) «Eh bien! moi, je dis que la preuve est faite.»
M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX (hautain).—«Comment voulez-vous que je vous dise ce qui s'est passé au procès Dreyfus: je n'y étais pas!»
Labori regarde les jurés, puis le tribunal, enfin l'auditoire, comme pour prendre tout le monde à témoin de cette réponse évasive.
Puis il s'incline courtoisement devant le général, avec un sourire triomphant.
Me LABORI.—«C'est bien, je vous remercie, mon général.»
Me CLÉMENCEAU (intervenant).—«M. le Président, nous avons amené ici un témoin qui tenait de la bouche d'un des membres du Conseil de Guerre qu'il y avait eu une pièce secrète communiquée aux juges. On ne nous a pas permis de l'interroger.»
Me LABORI.—«J'ai dans mon dossier deux lettres qui disent la même chose. Et j'ai une lettre, qui est d'un ami du Président de la République; ce témoin a déclaré qu'il ne viendrait pas déposer, parce qu'on l'a prévenu, que, s'il racontait le fait, on viendrait dire qu'il est inexact.»
Me CLÉMENCEAU.—«Et pourquoi le général Billot ne l'a-t-il pas dit à M. Scheurer-Kestner, quand il est allé le lui demander? Tout cela serait terminé aujourd'hui!»
M. LE PRÉSIDENT (nerveux).—«Vous direz tout cela dans votre plaidoirie.»
M. LE GÉNÉRAL GONSE (s'avançant à nouveau).—«J'ai un mot à dire au sujet de la déposition qui a été faite tout à l'heure, quand on a parlé des notes.
«J'ai dit que les notes de l'État-Major étaient secrètes: elles sont toujours secrètes; nous ne correspondons dans les bureaux de l'État-Major que par des notes, qui ont toujours le caractère secret. Et, quand on dit: note sur ceci, note sur cela, cela veut dire: note secrète.
«Maintenant, quand on vient dire que Dreyfus ne connaissait pas ce qui se passait dans les bureaux de l'État-Major en septembre 1893, c'est encore une erreur. Dreyfus a passé d'abord six mois...»
M. LE PRÉSIDENT (l'interrompant, sans courtoisie).—«Nous n'avons pas à parler de l'affaire Dreyfus...
(Aux généraux de Pellieux et Gonse.) Vous pouvez vous asseoir, tous les deux.»
Il y a un moment de stupeur.
Le Président en profite.
M. LE PRÉSIDENT (à l'huissier-audiencier sur un ton sans réplique).—Faites venir le témoin suivant!»
L'huissier hésite.
Labori s'est dressé et se penche, les bras en croix, comme s'il
voulait, de sa personne, faire obstacle à la suite des débats.
Me LABORI.—«M. le Président, il est absolument impossible, après un événement...»
M. LE PRÉSIDENT (sèchement).—«Continuons...»
Me LABORI (indigné).—«Oh, Monsieur le Président, ce n'est pas possible! Vous sentez très bien qu'un pareil incident termine le débat, s'il n'est pas vidé. Nous sommes par conséquent obligés d'entendre M. le général de Boisdeffre.»
M. LE PRÉSIDENT.—«Nous l'entendrons tout à l'heure.
(A l'huissier-audiencier.) «Faites venir le témoin suivant.»
Me LABORI (tenace).—«Permettez, Monsieur le Président...»
M. LE PRÉSIDENT (furieux, à l'huissier-audiencier).—«Appelez le témoin suivant!»
L'huissier sort.
Me LABORI.—M. le Président, je vous demande pardon, je pose des conclusions tendant au sursis!»
Le commandant Esterhazy paraît, introduit par l'huissier.
M. LE PRÉSIDENT (à Labori).—«Il y sera statué quand les témoins auront été entendus!»
Esterhazy s'avance vers la barre. La salle éclate en applaudissements.
Il est voûté, d'une maigreur de tuberculeux, le teint jaunâtre,
les pommettes fiévreuses, le regard mobile et brûlant.
Déjà le Président se tourne vers lui, lorsque Labori intervient
une dernière fois, avec une énergie exaspérée.
Me LABORI.—«Mais je demande à ce qu'il soit sursis à l'audition d'autres témoins, jusqu'à ce que M. le général de Boisdeffre ait été entendu! La Cour ne peut remettre à statuer jusqu'après qu'elle aura entendu d'autres témoins!»
Le Président, indécis, roule des yeux courroucés.
Esterhazy, les bras croisés par contenance, attend, inquiet, ne comprenant pas ce qui se passe.
Labori s'est assis, et griffonne ses conclusions.
M. LE PRÉSIDENT (d'un ton dur et insolent).—«Y en a-t-il pour longtemps, à rédiger vos conclusions?»
Me LABORI (sans lever la tête, rogue).—«Dix minutes.»
L'audience est suspendue.
Le Président fait signe à l'huissier de reconduire Esterhazy dans la salle des témoins.
L'auditoire énervé, tumultueux, l'acclame jusqu'à ce qu'il ait disparu.
Sans paraître s'apercevoir du tapage, les magistrats se lèvent et quittent gravement le prétoire, suivis des jurés, des accusés et de la défense.
L'exaspération qui fermentait, à demi retenue par la présence de la Cour, se donne libre carrière.
Dans l'air surchauffé, devenu toxique, se croisent des appels, des commentaires passionnés, des vociférations: un vacarme assourdissant.
Les rédacteurs du Semeur se groupent autour de Luce.
Portal, en robe, vient les rejoindre; un pli désabusé attriste son visage honnête, plus blond, plus poupard que jamais sous la toque.
PORTAL (s'asseyant avec lassitude).—Encore une note secrète!
BAROIS.—Qu'est-ce que c'est que cette pièce?
ZOEGER (de sa voix grêle, aux finales blessantes).—Personne, que je sache, n'en a encore entendu parler.
LUCE.—Si, je connaissais son existence. Mais je ne pensais pas qu'on osât jamais s'en servir.
ZOEGER.—De qui est-elle?
LUCE.—Elle est soi-disant écrite par l'attaché militaire italien, et elle a soi-disant été saisie dans le courrier de l'attaché allemand...
BAROIS (vivement).—Elle pue le faux!
LUCE.—Oh, ça, elle est fausse, ce n'est pas douteux. Elle est arrivée au Ministère, je ne sais pas comment, mais avec un à-propos bien étrange... Juste la veille du jour où le ministre devait répondre à la Chambre à la première interpellation relative à l'affaire, et au moment où l'État-Major commençait à se préoccuper de l'incident!
ZOEGER.—Et puis, sa teneur...
JULIA.—Nous ne savons pas ce qu'il y a dedans. Le général a cité de mémoire.
LUCE.—Mais il a affirmé que le nom de Dreyfus était mentionné en toutes lettres. Or, c'est absolument invraisemblable: cela seul suffirait à éveiller les doutes! A l'heure où la presse s'occupait déjà activement de l'affaire, il est inadmissible de supposer que ces deux attachés aient librement parlé de Dreyfus dans leur correspondance privée. En admettant qu'ils aient eu réellement des relations avec Dreyfus, jamais ils n'auraient commis cette imprudence inutile! surtout après les démentis officiels donnés à plusieurs reprises, par leurs deux gouvernements!
BAROIS.—Ça saute aux yeux!
PORTAL.—Mais qui donc peut fabriquer de pareilles pièces?
ZOEGER (avec un ricanement impitoyable).—L'État-Major, parbleu!
HARBAROUX.—C'est une officine nationale de falsifications!
LUCE (posément).—Non, mes amis, non... Là, je ne vous suis plus!
Son expression simple et résolue en impose. Seul Zoeger secoue les épaules.
ZOEGER.—Pourtant, permettez, les faits...
LUCE (très ferme, s'adressant à tous).—Non, mes amis, non... Mettons-nous en garde... L'État-Major n'est pas plus une bande de «faussaires», que nous ne sommes, nous, une bande de «vendus»... Jamais vous ne me ferez admettre que des hommes comme les généraux de Boisdeffre, Gonse, Billot, et les autres, puissent s'entendre pour fabriquer des pièces fausses!
Cresteil d'Allize, l'œil ardent, le sourire amer, le visage tourmenté, suit la querelle en lissant impatiemment sa longue moustache.
CRESTEIL.—A la bonne heure! Moi, j'ai connu le général de Pellieux autrefois: c'est l'intégrité même.
LUCE.—D'ailleurs, il suffit de l'avoir vu et entendu, pour être certain que ce qu'il affirme, il le croit: son éloquence est indubitablement celle de la sincérité. Et, jusqu'à preuve du contraire, j'estime que les autres généraux sont tous dans le même cas.
CRESTEIL.—On les trompe. Ils sont les premières dupes de ce qu'ils avancent.
ZOEGER (sourire glacial).—Vous leur supposez un aveuglement qui n'est pas vraisemblable.
CRESTEIL (vivement).—Très vraisemblable au contraire! Ah, mon cher, si vous aviez fréquenté de près les officiers...
Tenez, le groupe, là, derrière nous... Regardez-les sans parti-pris.
Une expression d'assurance bornée, soit; ça, c'est l'habitude d'avoir toujours, de droit, raison devant les hommes... Mais ces visages-là sont honnêtes, foncièrement!
LUCE.—Oui, regardez un peu la salle, Zoeger; c'est très instructif.
Que voulez-vous, ces gens-là ne sont pas accoutumés à des raisonnements subtils... Et, tout à coup, on leur présente un dilemme terrible: il y a un coupable, où est-il? Est-ce le Gouvernement, l'Armée, tous ces chefs qui viennent affirmer, solennellement, en donnant leur parole de soldats, que la condamnation de Dreyfus est juste? Ou bien est-ce ce petit juif inconnu, condamné par sept officiers, et dont on a dit tant de mal depuis trois ans qu'il en reste malgré tout quelque chose dans toutes les mémoires?
ZOEGER (hautain).—Il n'est pas difficile de remarquer que l'État-Major a reculé, chaque fois qu'il a été mis en demeure d'avancer des preuves précises.
Tout le monde, même un officier, est capable de réfléchir jusque-là.
JULIA.—Et puis, qu'est-ce que peuvent ces paroles d'honneur, lancées à tout propos, contre une argumentation serrée comme celle des mémoires de Lazare, ou des brochures de Duclaux, ou de votre lettre à vous, Monsieur Luce!
ZOEGER.—Ou même, malgré son lyrisme, la lettre de Zola!
BAROIS.—Patience! Nous approchons du but.
(A Luce.) Aujourd'hui, nous avons fait un grand pas en avant!
Luce ne répond pas.
PORTAL.—Vous n'êtes pas exigeant, Barois...
BAROIS.—C'est pourtant très clair. Suivez-moi: le général de Boisdeffre va venir, puisqu'on est allé expressément le chercher. Dès les premiers mots, Labori va l'acculer à une impasse. Il ne pourra pas refuser de verser la pièce aux débats.
Ceci fait, on la discutera, et elle ne résistera pas longtemps à un examen approfondi. Alors l'État-Major, convaincu d'avoir apporté un faux à la barre, c'est le revirement immédiat de l'opinion! C'est la révision avant trois mois!
Il parle avec des gestes rapides, d'un ton incisif. Son œil rayonne d'insolence orgueilleuse. Tout son être palpite d'espoir.
LUCE (gagné par cet entrain).—Peut-être.
BAROIS (avec un grand rire clair).—Non, non, ne dites pas: peut-être. Cette fois, je suis certain que nous la tenons!
ZOEGER (cynique, à Barois).—Et si le général de Boisdeffre trouve un biais? Ce ne serait pas la première fois...
BAROIS.—Après ce qui s'est passé? Ce n'est plus possible... Vous avez bien vu que le général Gonse a couvert le général de Pellieux.!
WOLDSMUTH (qui s'était échappé à la suspension d'audience, et qui se glisse de nouveau à sa place).—Voilà des nouvelles... L'audience va reprendre. Le général de Boisdeffre vient d'arriver en voiture!
BAROIS.—Vous l'avez vu?
WOLDSMUTH.—Comme je vous vois. Il est en civil. Un huissier l'attendait sur les marches. Il est entré directement dans la salle des témoins.
JULIA (battant des mains, à Barois).—Vous voyez!
BAROIS (triomphant).—Cette fois, mes amis, pas de reculade possible! C'est la lutte ouverte, et, pour nous, la victoire!
Retour tumultueux des auditeurs et des avocats qui avaient quitté la salle.
La Cour, au milieu du brouhaha, fait sa rentrée; les magistrats, les jurés, s'installent.
Les accusés sont introduits.
Labori gagne allègrement son banc, et reste un instant debout,
un poing sur la hanche, penché vers Zola qui lui parle en
souriant.
Le silence se fait de lui-même.
Les nerfs sont tendus jusqu'à l'exaspération. On sent que
cette fois c'est vraiment la bataille décisive.
Le Président se lève.
M. LE PRÉSIDENT.—«L'audience est reprise.»
(Puis, rapidement, sans se rasseoir.) «En l'absence de M. le général de Boisdeffre, la Cour remet la suite de l'affaire à demain.»
(Un temps.) «L'audience est levée.»
D'abord une incompréhension totale: un instant de stupeur dont la Cour profite pour s'éclipser dignement.
Les jurés n'ont pas bougé. Zola s'est retourné, surpris, vers Labori qui reste adossé à son siège, figé dans une attitude vainement menaçante.
Enfin, tout le monde comprend: la bataille est ajournée, la bataille n'aura pas lieu...
Un hurlement de déception, signal d'un indescriptible désordre. Le public, debout, tape des pieds, hue, siffle, vocifère.
Puis, lorsque le prétoire est vide, il se rue frénétiquement vers les portes.
En quelques minutes la sortie est bouchée; des femmes, pressées
dans la cohue, s'évanouissent; les visages sont en sueur;
les yeux hagards: une véritable scène de panique.
Le Semeur est resté à sa place, consterné.
JULIA.—Les lâches!
ZOEGER.—Parbleu! Ils veulent attendre les ordres!
LUCE (tristement, à Barois).—Vous voyez? Ils sont les plus forts...
BAROIS (au comble de la rage).—Oh, mais cette fois, ça ne se passera pas sans scandale! Je tiens mon article de demain. C'est trop de cynisme, à la fin! Qui berne-t-on? Quand la Chambre s'émeut, quand elle force les Ministres responsables à s'expliquer ouvertement, pour de bon, on lui répond: «Pas ici. Allez au Palais de Justice, vous saurez tout.»—Et puis, au Palais, toutes les fois qu'on veut remuer le fond de ces débats obscurs, toutes les fois que la vérité monte péniblement jusqu'à la surface et semble vouloir sortir enfin, on la repousse du pied, on la renfonce dans son marécage: «La question ne sera pas posée!»
Ah, non! il faut que ça finisse! il faut que le pays comprenne à quel point on se fout de lui!
Sourde rumeur venue du vestibule.
WOLDSMUTH.—Il va y avoir du grabuge. Courons-y!
CRESTEIL.—Par où passer?
BAROIS.—Par là! (A Julia.) Suivez-moi...
ZOEGER (enjambant les gradins).—Non, par là...
BAROIS (criant).—Rendez-vous autour de Zola, comme hier!
Ils s'échappent comme ils peuvent de la salle des assises.
Un tumulte révolutionnaire ébranle les voûtes du Palais et se prolonge dans les galeries sonores, mal éclairées, grouillantes de monde.
Des gardes municipaux, en file, l'œil effaré, s'efforcent en vain de maintenir leur ligne de barrage. Des bandes se poussent, se heurtent, s'entremêlent dans la pénombre.
Mille cris se croisent:
—Misérables! Brigands! Traîtres!
—Vive Pellieux!
—Vive l'Armée!
—A bas les juifs!
Au moment où Barois et Luce rejoignent le groupe de Zola et de ses défenseurs, un remous, venu de loin, rompant le cordon de police, les écrase contre le mur.
Barois essaye de protéger Julia.
Portal, qui connaît les aîtres, ouvre précipitamment la porte d'un vestiaire. Zola et ses fidèles s'y engouffrent.
Zola est adossé à un pilastre, nu-tête, très pâle, sans lorgnon,
les paupières à demi plissées sur ses yeux fureteurs de myope,
les lèvres serrées. Ses regards vont et viennent. Il aperçoit Luce,
puis Barois, et leur tend la main, brusquement, sans un mot.
Enfin les agents ont fait une trouée.
Le Préfet de police apparaît, dirigeant en personne le service d'ordre.
La petite phalange repart. Zoeger, Harbaroux, Woldsmuth, Cresteil, viennent se joindre à eux.
Par un détour, sous la conduite du Préfet, ils atteignent le grand escalier du boulevard du Palais.
Une foule compacte a envahi la Cour et les rues: tout le quartier, jusqu'aux murs de l'Hôtel-Dieu, appartient aux manifestants: mouvante masse grise dans cette fin de journée d'hiver, que les réverbères pointillent déjà de halos jaunes.
Des cris, des huées, des injures inintelligibles, coupées de sifflets stridents. Une clameur ininterrompue, que martèle comme un refrain: «A mort!... A mort!...»
Au seuil des marches, Zola, les traits crispés, se penche vers les siens.
ZOLA.—Les cannibales...
Puis, le cœur défaillant, mais d'un pied ferme, il descend les degrés, appuyé sur le bras d'un ami.
Un espace libre a pu être ménagé au bas du perron: sa voiture attend, encadrée de gardes à cheval.
Il veut se retourner, serrer quelques mains. Mais les hurlements
redoublent...
—A l'eau!... A mort le traître!.. A la Seine!...
—Mort à Zola!
Le Préfet de police, très nerveux, hâte le départ.
L'attelage démarre, au petit trot.
Des projectiles s'abattent, pulvérisant les vitres des portières.
Des cris âpres, sanguinaires, poursuivent, comme une meute qu'on lance à la curée, le landeau qui disparaît dans le crépuscule.
LUCE (la gorge serrée, à Barois).—Un peu de sang frais, et ce serait le massacre...
Le commandant Esterhazy paraît, suivi d'un général; on les acclame jusqu'à leur voiture.
Bientôt le cordon des agents est rompu. Barois essaye d'entraîner Julia et Luce; mais la foule est dense.
Les amis de Zola sont reconnus et conspués.
—Reinach!... Luce!.. Bruneau!... Mort aux traîtres!...
Vive l'Armée!...
Des bandes sillonnent comme des courants, le flot des curieux
monômes d'étudiants, files de malandrins, conduits par des
jeunes gens du Faubourg.
Sur tous les chapeaux, en exergue, comme un numéro de conscrit, s'étale une feuille qu'on distribue par milliers dans les rues:
RÉPONSE DE TOUS LES FRANÇAIS
A ÉMILE ZOLA
MERDE!...
Des officiers, en uniformes se frayent un chemin au milieu des applaudissements.
Des isolés, qui ont le nez juif, sont pris, entourés et malmenés
par des gamins frénétiques, qui dansent autour d'eux
des rondes de sauvages, en brandissant des torches en flammes,
faites avec des Aurores roulées; l'effet est lugubre dans la nuit
commençante.
Au coin du quai, Julia, Barois et Luce s'arrêtent pour attendre
les autres.
Tout à coup, une jeune femme, élégamment mise, se précipite vers eux. Ils s'effacent, la croyant poursuivie, prêts à la protéger. Mais, en un clin d'œil, elle a foncé sur Luce, s'est accrochée à son vêtement, et lui a arraché sa rosette.
LA FEMME (s'enfuyant).—Vieille fripouille!
Luce la suit des yeux, avec un sourire navré.
Une heure plus tard
Luce, Barois, Julia, Breil-Zoeger et Cresteil, longent à petits
pas, la grille du jardin de l'Infante.
La nuit est tout à fait venue. Un brouillard pluvieux mouille les épaules.
Barois passe familièrement son bras sous celui de Luce, qui marche, silencieux.
BAROIS.—Qu'est-ce qu'il y a, voyons? Du courage... Rien n'est perdu.
Il rit.
Luce le dévisage, à la lueur d'un bec de gaz: les traits de Barois reflètent une joie de vivre, une confiance, une activité sans bornes: c'est un accumulateur vivant.
LUCE (à Zoeger et à Julia).—Regardez-le: il dégage des étincelles...
(Avec lassitude.) Ah, je vous envie, Barois. Moi, je ne peux plus, j'en ai assez. La France est comme une femme saoule: elle ne voit plus clair, elle ne sait plus ce qui est vrai, elle ne sait plus où est la justice. Non, elle est tombée trop bas, c'est décourageant...
BAROIS (d'une voix timbrée, qui fouette les énergies).—Mais non! Avez-vous entendu ces cris, avez-vous vu cette foule en délire? Une nation qui est encore capable d'une telle effervescence pour des idées, n'a pas déchu.
CRESTEIL.—Il a raison, le bougre!
ZOEGER.—Mais oui, parbleu! Il y a du tirage, c'est entendu: mais qui s'en étonnerait? C'est peut-être la première lois que la morale intervient dans la politique. Ça ne peut pas aller tout seul!
BAROIS.—C'est une espèce de coup d'État...
LUCE (grave).—Oui, j'en ai l'impression depuis le premier jour: nous assistons à une révolution.
ZOEGER (rectifiant).—Nous la faisons!
BAROIS (glorieusement).—Et comme toutes les révolutions, c'est une minorité qui en prend l'initiative, et qui l'accomplit toute seule, à coup de passion, à coup de volonté, à coup de persévérance!
Ah, c'est une belle vie, sacredié, qu'une lutte pareille!
Luce secoue la tête, évasivement.
Julia, spontanément, se rapproche de Barois et se pend à son bras; il ne semble pas s'en apercevoir.
BAROIS (avec un grand éclat de rire, jeune et crâne).—Oui, je l'accorde, la réalité, en ce moment surtout, est laide, féroce, injuste, incohérente: mais quoi! c'est d'elle pourtant que la beauté finale jaillira un jour!
(A Luce.) Vous me l'avez répété cent fois: le mensonge, tôt ou tard, trouve son châtiment dans la vie elle-même. Eh bien, je crois à la force inéluctable de la vérité! Et si, ce soir, la partie est perdue encore une fois, courage!
Nous la gagnerons peut-être au prochain tour!
[1] La suite des débats reproduit scrupuleusement le compte-rendu sténographique de la 10e audience. (Le Procès Zola. Compte-rendu sténog. in-extenso. Paris, Stock. 1898. Tome II, pages 118 à 125.)
31 Août 1898.
Paris: léthargique et dépeuplé.
Le café du boulevard Saint-Michel. Neuf heures du soir.
Le groupe du Semeur est réuni à l'entresol.
Devant les fenêtres, qui béent sur la nuit chaude, le store de la terrasse, fait, au premier plan une surface inclinée, transparente de lumière. Au delà, le quartier latin, nocturne et désert.
Des tramways, illuminés et vides, gravissent la pente du boulevard
en grinçant sur leurs rails.
Barois a déballé devant lui sa serviette bourrée de paperasses.
Les autres, en cercle autour de lui, piquent au tas, feuilletant
brochures et journaux,
PORTAL (à Cresteil).—Vous avez des nouvelles de Luce?
Portal revient de sa Lorraine, où il a fait son séjour annuel.
CRESTEIL.—Oui, je l'ai vu dimanche, il m'a fait pitié: il a beaucoup vieilli depuis trois mois.
BAROIS.—Vous savez qu'on l'a prié—oh, très courtoisement—de renoncer à son cour du Collège de France, pour la rentrée? Il y a eu, à la fin de juin, trop de tapage autour de ses leçons. D'ailleurs tout le monde lui tourne le dos: aux dernières séances du Sénat, ils n'étaient guère qu'une dizaine à lui serrer la main.
PORTAL.—Quelle incroyable incompréhension générale!
HARBAROUX (grimaçant la haine).—C'est la presse nationaliste qui est cause de tout. Ces gens-là ne laissent pas un instant l'opinion reprendre haleine, se ressaisir!
BAROIS.—Au contraire: ils refoulent systématiquement toute la générosité inhérente à notre race, tout ce qui avait jusqu'à présent placé la France, à ses risques et gloire, en tête de la civilisation, sous prétexte de condamner l'anarchie et l'antimilitarisme, qu'ils ont la mauvaise foi de confondre avec les instincts les plus élémentaires de justice et de bonté!
Et tout le monde s'y est laissé prendre!
WOLDSMUTH (secouant sa tête de caniche, aux yeux tendres).—On obtient toujours ce qu'on veut d'un peuple, quand on sait l'exciter contre les juifs...
CRESTEIL.—Ce qui m'étonne, dans cette approbation commune, c'est que leur thèse est stupide; il suffit d'un minimum de bon sens pour l'anéantir: «L'Affaire Dreyfus est une immense machination montée par les Juifs...»
BAROIS.—Comme si une aussi prodigieuse aventure pouvait avoir été prévue, organisée de pied en cap...
CRESTEIL.—On leur objecte: «Mais, si Esterhazy était l'auteur du bordereau?» Ils ne se troublent pas pour si peu: «Eh bien, c'est que les Juifs l'auraient acheté d'avance et lui auraient fait adopter, à s'y méprendre l'écriture de Dreyfus...»
C'est d'une insoutenable puérilité...
ZOEGER.—Le mal vient aussi de ce qu'on a compliqué l'Affaire à l'infini. Cette folie d'enquêtes et de contr'enquêtes, a complètement dénaturé sa véritable origine et son sens réel. On s'est lancé passionnément sur cent pistes adjacentes, contradictoires... Ce qu'il faudrait, maintenant, c'est un coup de théâtre, qui chavire net l'opinion, et la ramène à une vue d'ensemble.
CRESTEIL.—Oui: un coup de théâtre...
BAROIS.—Nous en approchons peut-être avec cette histoire de Haute-Cour... (Tirant sur un papier de sa poche.) Tenez, j'ai encore reçu ça, ce matin... (Souriant.) Un anonyme plein d'attention...
HARBAROUX (qui a pris la feuille, lisant).
—«Je tiens de source sûre que le Ministre de la Guerre a proposé ce matin aux membres du Gouvernement de traduire les chefs du parti revisionniste devant la Haute-Cour.
«Votre nom est sur la liste, à côté de celui de M. Luce...»
BAROIS.—C'est très flatteur.
HARBAROUX (lisant).
—«L'arrestation générale est fixée au 2 septembre, à la première heure.
«Vous avez le temps d'être loin.»
Signé: «Un ami.»
BAROIS (riant à pleines dents).—Hein? Ça fouette le sang, au réveil, des petits billets de ce calibre!
ZOEGER.—C'est ton article de samedi qui te vaut ça.
PORTAL.—Je ne l'ai pas lu...
(A Cresteil.) De quoi s'agissait-il?
CRESTEIL.—De la fameuse séance de la Chambre, où, naïvement, le Ministre de la Guerre a cru sortir de son portefeuille cinq documents révélateurs, et n'a produit, en réalité, que cinq pièces fausses! Barois a magistralement établi pourquoi ces documents ne peuvent pas être authentiques...
Le gérant entr'ouvre la porte.
LE GÉRANT.—Monsieur Barois, il y a là un monsieur qui voudrait vous parler.
Barois le suit.
Au bas de l'escalier il aperçoit Luce.
BAROIS.—Vous, à cette heure? Qu'est-ce qu'il y a?
LUCE.—Du nouveau.
BAROIS.—La Haute-Cour?
LUCE.—Non... Qui avez-vous là-haut?
BAROIS.—Rien que le Semeur.
LUCE.—Alors, montons.
En voyant entrer Luce, ils se dressent tous, d'un seul mouvement anxieux.
Luce, silencieusement, serre les mains tendues et s'assied avec une involontaire lassitude; le visage maigri, tiré, fait saillir plus volumineuse encore, la masse du front.
LUCE.—Je viens de recevoir des nouvelles ... qui sont graves.
Ils se groupent autour de lui.
LUCE.—Hier ou avant-hier, il s'est passé, un drame imprévu au Ministère de la Guerre: le lieutenant-colonel Henry a été soupçonné par ses propres chefs, d'avoir falsifié les pièces du procès!
Une stupeur profonde.
LUCE.—Il y a eu aussitôt un interrogatoire d'Henry par le Ministre. A-t-il avoué? Je n'en sais rien.—En tous cas, il est depuis hier soir ... écroué au Mont Valérien.
BAROIS.—Écroué? Henry?
Une sourde explosion de joie; quelques secondes d'exaltation enivrante.
ZOEGER (d'une voix étouffée).—Nouvelle enquête! Nouveaux débats!
BAROIS.—C'est la révision!
HARBAROUX (précis).—Mais ... quelles pièces aurait-il falsifiées?
LUCE.—La lettre de l'attaché militaire italien, qui contenait, en toutes lettres, le nom de Dreyfus.
BAROIS.—Quoi? La fameuse preuve du général de Pellieux?
ZOEGER.—Celle que le Ministre a lue, il y a six semaines, en pleine tribune!
LUCE.—Fabriquée entièrement,—sauf l'en-tête et la signature, qui auraient été prises à une lettre insignifiante.
BAROIS (exultant).—Ah, ce serait trop beau!
WOLDSMUTH (en écho).—Oui ... trop beau!... Je n'ai pas confiance.
LUCE.—Ce n'est pas tout. Si l'affaire s'engage sur cette voie, il y aura bien d'autres points à éclaircir!
Qui a inventé l'histoire des aveux de Dreyfus? Pourquoi n'en a-t-il jamais été question avant 96, c'est-à-dire deux ans après la dégradation?
Qui a gratté et récrit l'adresse d'Esterhazy sur le petit bleu dénonciateur, pour pouvoir affirmer que Picquart cherchait à innocenter Dreyfus et accusait Esterhazy, à l'aide d'une pièce retouchée par lui?
WOLDSMUTH (les yeux pleins de larmes).—Ce serait trop beau... Je n'ai pas confiance...
LUCE.—En tous cas, l'arrestation a déjà des suites très importantes: Boisdeffre, Pellieux, Zurlinden démissionnent. Et il paraît que le Ministre lui-même va rendre son portefeuille.
Je le comprends, d'ailleurs: après avoir lu le faux, à la tribune, en toute bonne foi...
BAROIS (riant).—Mais c'est eux qu'il faut faire comparaître en Haute-Cour, à notre place!
LUCE.—D'autre part, Brisson est complètement retourné.
PORTAL.—Ah! enfin!
BAROIS.—Je l'ai toujours dit: le jour où un républicain de vieille race, comme Brisson, aura les yeux ouverts, il fera la revision, à lui seul!
WOLDSMUTH.—Ce qui doit le ronger, c'est d'avoir fait tirer à un million d'exemplaires le faux Henry, pour l'afficher sur tous les murs de France...
HARBAROUX (ricanant).—Ah, ah, ah!... C'est vrai! Elle est sur toutes nos mairies! Elle est dans toutes les mémoires! Elle est citée avec attendrissement, chaque jour, par toute la presse nationaliste! Ah, ah, ah!...
Et tout s'écroule d'un coup: la pièce est fausse!
PORTAL.—Sauve qui peut!
WOLDSMUTH (soudain taciturne).—Prenez garde. Je n'ai pas confiance...
BAROIS (riant).—Ah non, cette fois, Woldsmuth vous allez trop loin dans le pessimisme! Le Gouvernement n'a évidemment pas décidé l'arrestation d'Henry à la légère. Pour qu'on n'ait pas pu étouffer l'affaire, il faut que vraiment la vérité éclate avec une force irrésistible.
WOLDSMUTH (doucement).—Mais Henry n'est même pas en prison...
BAROIS.—Comment?
LUCE.—Je vous dis qu'il est au Mont-Valérien!
CRESTEIL (les traits bouleversés, tout à coup).—Mais sacredié, Woldsmuth a raison! Il n'est qu'aux arrêts: sans quoi c'est au Cherche-Midi qu'il serait!
Ils se regardent, atterrés.
Les nerfs sont tellement tendus qu'un brusque abattement succède à leur triomphe.
LUCE (navré).—Ils ont peut-être voulu se réserver le temps de chercher un biais...
CRESTEIL.—... de façon à pouvoir traiter la falsification comme un simple manquement à la discipline...
PORTAL.—Ils vont nous échapper encore une fois, vous verrez!...
WOLDSMUTH (secouant la tête).—Oui, oui ... je n'ai pas confiance...
BAROIS (nerveux).—Taisez-vous donc, Woldsmuth!
(Énergique.) C'est à nous, maintenant, à faire assez de bruit autour de l'incident, pour qu'on ne puisse pas l'escamoter...
LUCE.—Ah, si seulement Henry avait avoué, devant des témoins!
Une rumeur confuse rampe le long du boulevard. Sont-ce des crieurs qui glapissent la dernière heure?
Malgré le silence désert, leurs abois se mêlent, lointains et inintelligibles.
PORTAL.—Chut! On dirait:... «Le colonel Henry...»
LUCE.—Est-ce que la nouvelle s'ébruiterait déjà?
Ils se sont portés, d'un mouvement unanime, vers les fenêtres ouvertes, et, le corps penché, l'oreille tendue, ils écoutent, avec une soudaine angoisse.
ZOEGER (à la porte).—Garçon! Les journaux... vite!
Mais déjà Woldsmuth s'est élancé dehors.
Les cris s'éloignent, par une rue transversale.
Quelques minutes s'écoulent.
Enfin Woldsmuth, hors d'haleine, échevelé, l'œil brillant, surgit au haut de l'escalier, brandissant une feuille d'où jaillit, en manchette énorme:
SUICIDE DU COLONEL HENRY
AU MONT-VALÉRIEN
BAROIS (rugissant).—Le voilà, l'aveu!
Il se tourne vers Luce, et tous deux, le cœur bondissant, s'étreignent, sans un mot.
PORTAL, ZOEGER, CRESTEIL (allongeant le bras vers Woldsmuth).—Donnez!
Mais tous se taisent.
Woldsmuth a tendu le journal à Luce, qui, très pâle, assujettissant son lorgnon d'un geste saccadé, s'avance sous le lustre.
L'émotion alourdit sa voix.
LUCE (lisant).—«Hier soir, dans le cabinet du Ministre de la Guerre ... le lieutenant-colonel Henry a été reconnu l'auteur de la lettre, datée d'octobre 1896 ... où le nom de Dreyfus est cité en toutes lettres.
«Le Ministre ... a ordonné immédiatement l'arrestation du lieutenant-colonel Henry ... qui, dès hier soir, a été conduit ... à la forteresse du Mont-Valérien...
«Aujourd'hui ... le planton chargé de faire le service du lieutenant-colonel ... ayant pénétré dans sa cellule ... à six heures du soir ... l'a trouvé ... étendu sur son lit ... dans une mare de sang ... son rasoir à la main ... et la gorge ouverte ... en deux endroits... La mort ... remontait à plusieurs heures...
«Le faussaire s'était fait justice ..»
Le journal lui tombe des doigts.
Ils se l'arrachent; il passe de main en main: tous veulent avoir vu.
Un cri sauvage de triomphe, un long hurlement, un véritable délire...
LUCE (la gorge serrée).—Henry mort, c'est fini: il y a des choses de l'affaire que personne ne saura jamais...
Ses paroles se perdent dans l'ivresse générale.
Seul, Zoeger, qui a entendu, approuve d'un triste signe de
tête.
Woldsmuth, à l'écart, incliné sur l'appui de la fenêtre, pleure
silencieusement de joie, dans la nuit tiède.
Un an plus tard: le 6 août 1899, veille de l'ouverture des
débats de Rennes.
Dimanche après midi.
Aux bureaux du Semeur.
Barois, seul, en manches de chemise, les mains aux poches,
arpente son cabinet, préparant un article.
Il est sous-pression: son visage exalté, zébré de tics, ses regards mobiles, la joie de son demi-sourire, toute sa personne enfin, rayonne de sécurité triomphante.
Les mauvais jours sont passés.
BAROIS.—Entrez!
Ah, Woldsmuth?... Entrez, entrez...
Woldsmuth s'avance, tout menu dans son cache-poussière, la sacoche en bandoulière, une volumineuse serviette sous le bras.
BAROIS.—Qu'est-ce que vous êtes donc devenu depuis l'autre jour?
WOLDSMUTH (s'asseyant sur le premier siège rencontré).—J'arrive d'Allemagne.
BAROIS (sans surprise).—Vraiment?
(Un temps.) Je comptais bien d'ailleurs vous voir ce soir, pour vous remettre la direction, comme c'est convenu.
WOLDSMUTH.—Vous prenez tous le rapide de nuit?
BAROIS.—Non, moi seul. Les autres sont déjà à Rennes depuis ce matin... Luce avait à faire, ils l'ont accompagné.
WOLDSMUTH.—Quand dépose-t-il?
BAROIS.—Pas avant la 5e ou 6e audience...
Je suis resté pour vous passer la main et puis pour faire un dernier article, qui paraîtra demain.
WOLDSMUTH (vivement).—Ah, il y aura encore un numéro demain?
Barois, prenant cet intérêt pour de la curiosité, ramasse sur le bureau quelques feuilles volantes.
BAROIS.—Oh, presque rien, quelques lignes pour saluer l'ouverture des débats... Tenez, voilà ce que j'étais en train d'écrire:
«Nous touchons au but. Le cauchemar s'achève. Le dénouement, le verdict, n'intéresse plus; il est prévu, fatal comme le triomphe de l'équité.
«Il ne nous reste plus, aujourd'hui, que le souvenir d'avoir vécu un drame historique, à nul autre comparable; un drame à milliers de personnages, joué sur la scène du monde, et d'un intérêt si pathétique et si universel, que toute la nation, puis autour d'elle toute la civilisation, est venue y prendre part. Pour la dernière fois sans doute, l'humanité, divisée en deux messes inégales, s'est heurtée de front:—d'un côté, l'autorité, qui n'accepte le contrôle d'aucun raisonnement;—de l'autre, l'esprit d'examen, superbement dédaigneux de toutes précautions sociales.
«D'un côté, le passé,—de l'autre, l'avenir!
«Les générations futures diront «l'Affaire», de même que nous disions: «la Révolution»; et elles saluèrent, comme une coïncidence merveilleuse ce hasard qui donne à l'Ere nouvelle un millésime nouveau.
«Quel siècle, celui qu'inaugure une pareille victoire!»
Un simple coup de clairon, vous voyez...
Woldsmuth le considère avec stupeur.
Quelques secondes passent. Il approche timidement sa chaise.
WOLDSMUTH.—Dites-moi, Barois... Vous êtes donc pleinement rassuré?
BAROIS (souriant).—Oh, pleinement!
WOLDSMUTH (affermissant sa voix).—Moi pas! Je n'ai pas confiance.
Barois, qui va et vient d'un air avantageux, s'arrête, surpris.
BAROIS (haussant les épaules).—Vous nous avez toujours répété ça.
WOLDSMUTH (vivement).—Jusqu'ici, je crois que...
BAROIS.—Mais tout est changé! Nous voici avec un gouvernement neuf, bien convaincu de l'innocence, et qui s'est donné pour mission de faire la lumière. Les débats, cette fois, seront publics, sans escamotage possible. Voyons!... Douter du verdict, dans de telles conditions, ce serait supposer la culpabilité de Dreyfus!
Il rit: un rire énergique et sans arrière-pensée; le rire du bon sens et de la certitude.
Woldsmuth le regarde silencieusement. Dans son masque poilu, poussiéreux, les yeux brillent, patients, tenaces.
WOLDSMUTH (affectueusement).—Asseyez-vous donc, Barois... Je vous parle sérieusement. Je vois beaucoup de monde, moi, vous savez... (Les yeux mi-clos, sur un ton voilé, traînant, indéfinissable)... je me renseigne...
BAROIS (brusque).—Moi aussi.
WOLDSMUTH (conciliant).—Eh bien, alors, vous avez remarqué... Hein? Leur presse! Tous les faux ont été démasqués, toutes les illégalités étalées au grand jour... N'importe, elle ne désarme pas! Il faut bien qu'elle renonce à ses affirmations, mais elle se venge: elle salit indistinctement tous ses adversaires... Le rapport de Ballot-Beaupré, qui résume si loyalement toute l'Affaire, croyez-vous seulement que leurs journaux l'aient publié? C'est l'enquête d'un «vendu», qui a touché les millions juifs, comme Duclaux, comme Anatole France, comme Zola...
BAROIS.—Et puis après? Quels sont les lecteurs qui s'y laissent prendre?
Pour toute réponse, Woldsmuth sort de sa poche un paquet de journaux nationalistes, et les jette sur la table.
BAROIS (agacé).—Ça ne prouve rien. Je vous répliquerai que, depuis deux mois, le Semeur a encaissé près de 3.000 abonnements nouveaux; vous le savez comme moi.
Un grand souffle de justice et de bonté passe, enfin, sur la France.
WOLDSMUTH (remuant tristement la tête).—Ce souffle-là n'a pas effleuré les conseils de guerre...
BAROIS (après réflexion).—Soit. J'admets que les juges, parce qu'ils sont de braves militaires, aient d'avance une forte présomption contre les révisionnistes. Mais réfléchissez à ceci: l'Europe entière a les yeux fixés sur Rennes. Toute la civilisation juge avec eux. (Se levant.) Eh bien, il y a des situations qui obligent; ces messieurs seront bien forcés de reconnaître que toutes les anciennes charges qui pesaient contre Dreyfus s'évanouissent à l'examen, (Riant.)—et qu'il n'y en a pas de nouvelles!
WOLDSMUTH.—Ça dépend.
Barois enfonce les mains dans ses poches et reprend ses allées et venues en haussant les épaules. Mais le ton résolu de Woldsmuth l'intrigue: il vient se camper devant lui.
BAROIS.—Ça dépend de quoi?
Woldsmuth sourit péniblement.
WOLDSMUTH.—Asseyez-vous, Barois; vous avez l'air d'un fauve en cage...
Barois, les sourcils froncés, regagne son bureau.
WOLDSMUTH.—Vous vous rappelez l'histoire des pièces ultra-secrètes? (Geste de Barois.) Laissez-moi m'expliquer...
L'hypothèse est la suivante: On aurait volé à Berlin des lettres du Kaiser à Dreyfus et des lettres de Dreyfus au Kaiser... (Souriant.) Je n'insiste pas sur l'énormité de cette supposition...
D'après cette légende, le véritable bordereau aurait été une de ces lettres, écrite par Dreyfus sur papier ordinaire, et que l'Empereur aurait annoté de sa main dans les marges. Guillaume II s'apercevant du vol, aurait exigé la restitution immédiate des pièces saisies, en posant l'alternative d'une déclaration de guerre. Alors, avant de rendre le dossier, pour garder une preuve matérielle de la culpabilité manifeste de Dreyfus, on se serait hâté, au Ministère, de calquer le bordereau sur une feuille de papier pelure, sans reproduire, bien entendu, les annotations impériales... Et toute l'affaire serait, de ce fait, échafaudée sur une pièce calquée, fausse si l'on veut, mais reproduisant le document authentique de la trahison.
BAROIS.—L'hypothèse est tellement fragile que jamais, à ma connaissance, elle n'a été formulée en termes explicites, ni officiellement, ni officieusement.
WOLDSMUTH.—Je sais. Mais ça circule, colporté dans les salons par des officiers, des magistrats, des avocats, des gens du monde... Aucun d'eux n'avance rien de précis, mais «un ami très au courant leur a laissé entendre...» C'est un colossal secret de Polichinelle, qui chemine, avec des silences renseignés, des sous-entendus, de petits rires énigmatiques... Tout ça prépare le terrain, peu à peu. Et demain, aux débats de Rennes, quand la défense voudra pousser ces messieurs de l'État-Major à s'expliquer enfin à fond, ils esquiveront le coup... Il suffit de quelques hésitations involontaires, de quelques sourires douloureux, et tout le monde traduira: «Supposez ce que vous voudrez. Plutôt passer pour un faussaire, que de déchaîner la guerre européenne...»
BAROIS.—La guerre! Mais aujourd'hui, il n'est plus question de sécurité nationale!... Après tout ce qui a été dit et écrit, depuis trois ans, sur les attachés militaires étrangers, sur l'espionnage et le contr'espionnage allemand, qui donc serait assez naïf pour croire qu'il reste encore une seule pièce diplomatique vraiment dangereuse à divulguer? Personne! Donc, si une pièce accusatrice décisive existait réellement, il est évident que l'État-major l'aurait mise en avant, depuis longtemps, pour en finir!
WOLDSMUTH (sombre).—Croyez-moi, vous voyez trop simple. De tous temps cette question diplomatique m'a préoccupé; c'est le fil secret de l'Affaire: un fil qui n'est à aucun endroit visible, mais auquel tous les événements viennent se rattacher. Il y a là un danger terrible!
Barois, ébranlé, hésite; puis se tait.
WOLDSMUTH.—Eh bien, mon cher, il est encore temps de prévenir le coup. J'ai peu à peu constitué un dossier: rien que des faits exacts, j'en réponds: ceux sur lesquels j'avais une hésitation, je viens d'aller les contrôler là-bas, en Allemagne...
BAROIS.—Ah, c'est pour ça, que...
WOLDSMUTH.—Oui. (Ouvrant sa serviette.) J'ai donc là, de quoi anéantir d'avance le coup du «secret d'État». Mais il est grand temps d'agir.
Je vous apporte mon dossier. Publiez-le demain!
BAROIS (sérieux, après un instant de recueillement).—Je vous remercie, Woldsmuth... Mais je crois qu'aujourd'hui une pareille publication serait une faute capitale.
Woldsmuth fait un geste de découragement.
BAROIS.—Elle attirerait l'attention sur un point qui est, quoi que vous en pensiez, relégué dans l'ombre... Par esprit de riposte, on croirait peut-être devoir y revenir; tout ça remuerait l'opinion: ce serait maladroit...
L'acquittement est inévitable. Eh bien, triomphons en beauté, sans ressusciter de mesquines polémiques...
Woldsmuth, les épaules basses, replie silencieusement sa serviette.
BAROIS.—Non, laissez-moi vos notes.
WOLDSMUTH.—A quoi bon? C'est préventivement qu'il faudrait s'en servir.
BAROIS.—Je les emporterai à Rennes pour les communiquer à Luce Et, s'il est de votre avis, je vous promets...
WOLDSMUTH (une lueur d'espoir).—Oui, montrez-les à Luce, et répétez-lui bien exactement tout ce que je vous ai dit...
(Réfléchissant.) Mais il est impossible que vous les emportiez ce soir, telles quelles... Je n'ai pas eu le temps de les mettre au net... C'est un vrai fouillis... Je pensais faire le travail avec vous, pour le numéro de demain...
BAROIS.—Votre nièce est là, voulez-vous les lui dicter? Ce sera fait tout de suite...
WOLDSMUTH (dont le visage s'est éclairé subitement).—Ah? Julia est ici?
Barois se lève et ouvre la porte.
BAROIS.—Julia?
JULIA (de la pièce voisine, sans se déranger).—Quoi?
La familiarité du ton est si explicite, que Barois rougit et se tourne vivement vers Woldsmuth, qui, penché sur ses notes, n'a pas bronché.
BAROIS (maître de lui).—Voulez-vous venir un instant, je vous prie, pour sténographier...
Julia paraît. Elle aperçoit Woldsmuth. Un simple battement des paupières. Son visage insurgé signifie: «Je suis libre, n'est-ce pas?»
JULIA (durement).—Bonjour, oncle Ulric. Vous avez fait bon voyage?
Woldsmuth redresse la tête, mais sans la regarder. Elle surprend alors ce sourire affairé, oblique, dans un visage où tous les traits sont disjoints par la souffrance. Et elle comprend ce que jamais elle n'avait soupçonné...
C'est elle qui baisse les yeux, au moment où Woldsmuth lève les siens, pour répondre enfin.
WOLDSMUTH.—Hé, bonjour Julia... Tu vas bien? La maman va bien?...
JULIA (péniblement).—Très bien.
WOLDSMUTH.—Alors, veux-tu... Ce sont des fiches... Pour Barois...
BAROIS (qui n'a rien vu).—Allez donc dans son bureau, Woldsmuth, vous serez mieux qu'ici... Moi, je vais finir cet article...
A Monsieur Ulric Woldsmuth, Rédacteur au Semeur
Rue de l'Université. Paris.
«Rennes, le 13 août 1899
«Mon cher Woldsmuth,
«Vous avez lu la sténo d'hier et d'avant-hier? Vous aviez donc raison, cher ami, mille fois raison! Mais qui pouvait se douter?
«Tous ces jours-ci nos adversaires ont attendu, passionnément, cet argument décisif contre Dreyfus, qui leur est promis depuis si longtemps. Les généraux ont parlé: déception sur toute la ligne! Alors, comme l'opinion publique se refuse obstinément à admettre que cet argument n'existe pas, elle interprète certaines réticences de l'État-Major dans le sens que vous aviez prévu: et le tour est joué. Aujourd'hui on a été jusqu'à faire courir le bruit que l'Allemagne, au dernier moment, aurait imposé ce mutisme héroïque à nos officiers!
«Je vous expédie, en hâte, les feuillets que vous avez dictés à Julia avant mon départ. Ils sont, hélas, d'une urgente actualité. Breil-Zoeger qui rentre à Paris pour prendre votre place, vous les remettra ce soir, avec ce mot.
«Concertez-vous aussitôt avec Roll pour qu'ils paraissent, si possible, demain, et assurez-leur une large diffusion avant de quitter Paris.
«Apportez-en deux mille numéros à Rennes, ce sera suffisant.
«Bien tristement à vous,
Barois.»
Le lendemain, en première page du Semeur:
GUILLAUME II ET L'AFFAIRE DREYFUS.
Nous avons eu la surprise, ces dernières semaines, de voir sournoisement reparaître une hypothèse ingénieuse, qui expliquerait, pour certains cerveaux simplistes, toutes les obscurités de l'Affaire: c'est celle du bordereau sur papier fort, annoté par Guillaume II, saisi par un agent français sur le bureau impérial, qu'il a fallu rendre précipitamment devant la menace d'une guerre, et dont le bordereau sur papier pelure serait un calque, fait au Ministère de la Guerre, en vue du procès de 1894.
Nous ne prendrons pas la peine de relever les puériles invraisemblances de cette
romanesque aventure.
Nous nous bornerons à poser trois questions:
1° Si le bordereau est un calque de l'écriture authentique de Dreyfus, pourquoi ressemble-t-il mal à l'écriture de Dreyfus, tandis qu'il reproduit identiquement l'écriture d'Esterhazy?
2° S'il est vrai que les faux d'Henry s'expliquent par la nécessité de substituer des pièces inoffensives aux autographes impériaux dont l'usage était impossible, comment se fait-il que, questionné par le Ministre de la Guerre avant son arrestation, Henry n'ait pas dévoilé la légitimité de ses faux, afin de s'innocenter? Des généraux assistaient à l'interrogatoire; le général Roget en a pris la sténographie: Henry n'a donné aucun motif de ce genre à ses falsifications de pièces.
3° Si l'histoire du bordereau annoté est exacte, quand Brisson, bouleversé par le suicide d'Henry, a manifesté l'intention de reconnaître publiquement son erreur et de prendre en main la cause de la révision, pourquoi le Ministre de la Guerre, qui a fait à ce moment auprès de Brisson les plus inquiètes démarches pour empêcher ce geste, ne l'a-t-il pas simplement averti de l'intervention impériale, afin d'arrêter net ce revirement d'opinion si dangereux pour les anti-revisionnistes?
Ceci posé, nous nous contenterons d'aligner succinctement quelques faits chronologiques, dont la signification nous semble assez évidente pour se passer de commentaires:
I.—Le 1er novembre 1894, le nom de Dreyfus, espion de l'Italie ou bien de l'Allemagne, paraît pour la première fois dans les journaux. Les attachés militaires allemands et italiens s'étonnent: c'est un nom qu'ils ne connaissent même pas. Et en voici la preuve: l'ambassadeur d'Italie a remis, le 5 juin 1899, au Ministère des Affaires Etrangères, pour être transmise à la Cour de Cassation, la dépêche chiffrée, datée de 1894, de l'attaché italien qui travaillait en complète entente avec l'attaché allemand, et qui affirme secrètement à son Gouvernement qu'aucun d'eux n'a eu de relations avec ce nommé Dreyfus.
A la même époque, les États-Majors d'Allemagne, d'Italie et d'Autriche, ont fait une enquête dans tous les centres d'espionnage, sans pouvoir se procurer aucun renseignement sur ce Dreyfus.
II.—Le 9 novembre 1894, l'attaché allemand est mis en cause et nommé dans un journal français. L'ambassade d'Allemagne, après une nouvelle information, donne un premier démenti par une note à la presse. Remarquons que ce démenti n'a pu être donné à la légère: car l'Allemagne ne se serait pas exposée à avancer une dénégation, qui, ensuite et publiquement, eût pu être reconnue mensongère au cours des débats du Conseil de Guerre.
En outre, aux mêmes dates, le Chancelier de l'Empire a chargé son ambassadeur à Paris, de faire une déclaration «officielle et spontanée» au Ministre des Affaires Etrangères.
III.—Le 28 novembre paraît au Figaro l'interview du général Mercier. Le Ministre, cinq jours avant la fin de l'instruction qui devait conclure à la traduction de Dreyfus devant un conseil de guerre, y affirme la culpabilité de l'accusé: il a «des preuves certaines»; Dreyfus n'aurait offert ses «documents, ni à l'Italie, ni à l'Autriche»...
L'Allemagne, nettement visée cette fois, proteste à nouveau et très énergiquement par voie diplomatique.
La presse française n'en ayant pas tenu compte, l'Empereur, l'État-Major allemand, la presse allemande, s'irritent de voir contestée la parole qu'ils ont solennellement donnée. Le 4 décembre, il y a, sur l'ordre de l'Empereur, une nouvelle entrevue entre l'ambassadeur et notre Ministre des Affaires Etrangères: une note officielle «proteste formellement contre les allégations qui mêlent l'ambassade d'Allemagne à l'affaire Dreyfus».
IV.—Le procès a lieu.
Lorsqu'un dossier secret a été communiqué aux juges à l'insu de l'accusé et de la défense, nous affirmons qu'il n'y avait rien dans ce dossier qui pût accréditer l'histoire du bordereau annoté par l'Empereur.
Il est facile de s'en assurer en interrogeant sur ce point précis les membres du Conseil de Guerre de 1894, actuellement à Rennes.
V.—A la fin de décembre 1894, après le verdict, toute la presse accuse ouvertement l'Allemagne d'avoir exigé le huis-clos, parce que la culpabilité de Dreyfus l'intéresse directement: c'est un nouveau démenti à la parole de l'ambassadeur. Celui-ci, le 25 décembre, au lendemain de la condamnation, fait une nouvelle déclaration officielle à la presse.
Mais les journaux continuent leur campagne, parlant de pièce rendue pour éviter la guerre, etc...
VI.—Le 5 janvier 1895, jour de la dégradation, l'ambassadeur d'Allemagne reçoit une dépêche particulièrement solennelle du chancelier de l'Empire. En l'absence de notre Ministre des Affaires Etrangères, il la porte directement à notre Président du Conseil.
En voici le texte, inédit jusqu'à ce jour:
«S. M. l'Empereur, ayant toute confiance dans la loyauté du Président et du gouvernement de la République, prie votre Excellence de dire à M. Casimir-Perier que, s'il est prouvé que l'Ambassade d'Allemagne n'a jamais été impliquée dans l'affaire Dreyfus, Sa Majesté espère que le Gouvernement de la République n'hésitera pas à le déclarer.
«Sans une déclaration formelle, les légendes que la presse continue à semer sur le compte de l'Ambassade d'Allemagne, subsisteraient et compromettraient la situation du représentant de l'Empereur.
De Hohenlohe.»
Ainsi donc, l'Empereur, à bout de patience, en appelait au Président de la République, lui-même.
L'Ambassadeur a été reçu à l'Élysée le lendemain, 6 janvier. Nous savons et certifions que M. Casimir-Perier voulut considérer l'incident comme étant personnel et non diplomatique, puisque son intervention directe était demandée par l'Empereur. Il a dit lui-même depuis, qu'il était fait appel à sa loyauté d'homme privé...» (Cassation. I. 329.)
Rappelons, à ce sujet, la déposition de M. Casimir-Perier devant la Cour de Cassation. Il a d'abord affirmé, formellement, qu'il n'avait rien à dissimuler de secret:
«J'ai pu constater que mon silence (au procès Zola) a accrédité cette pensée, que j'ai, seul peut-être, connaissance d'incidents, de faits ou de documents, qui pourraient déterminer la Justice.
«Dans l'état de division et de trouble où je vois mon pays, j'estime que mon devoir est de me mettre sans réserves à la disposition de la juridiction suprême...»
Ceci ne laisse pas subsister le soupçon que M. Casimir-Perier, comme on l'a prétendu, fût lié par une parole donnée; et cette déclaration, dans sa bouche d'honnête homme, est d'une singulière netteté, il raconte ensuite la conversation diplomatique qui eut lieu, et qui motiva une note officielle de l'Agence Havas, mettant une fois pour toutes hors de cause les ambassades étrangères à Paris. Et, le surlendemain, le Kaiser se déclara satisfait.
Rappelons aussi la déposition, à la Cour de Cassation, de M. Hanotaux, qui était Ministre des Affaires Etrangères pendant le procès de 1894. Interrogé comme suit: «Avez-vous connaissance de certaines lettres d'un souverain étranger, écrites à l'époque du procès Dreyfus, et desquelles ressortirait la culpabilité de cet accusé? .—il répondit formellement:
«Je n'en ai eu aucune connaissance. Je n'ai jamais rien vu de pareil. On ne m'a jamais rien offert de tel. Je n'ai jamais été consulté sur l'existence ou la valeur de tels documents. En un mot, toute cette histoire est une fable; elle a d'ailleurs été démentie à diverses reprises par des notes communiquées aux journaux.»
Rappelons enfin pour terminer, la déposition à la Cour de Cassation de M. Paléologue, qui a été l'intermédiaire quotidien, pendant le procès Dreyfus, entre les Affaires Etrangères et la Guerre:
«Ni avant, ni après le procès Dreyfus, je n'ai été informé de l'existence d'une lettre de l'Empereur d'Allemagne, ni de lettres de Dreyfus adressées à ce souverain. Les allégations auxquelles M. le Président fait allusion me paraissent complètement erronées. La nature de mes fonctions me permet d'affirmer que, s'il avait existé des documents de ce genre, je ne l'eusse pas ignoré, sans doute.»
VII.—Le 17 novembre 1897, l'ambassadeur d'Allemagne déclare à notre Ministre des Affaires Etrangères que l'attaché militaire allemand, colonel de Schwartzkoppen, attestait sur l'honneur n'avoir jamais eu, ni directement, ni indirectement, aucune relation avec Dreyfus.»
VIII.—En 1898, avant le procès Zola, l'Empereur, impatienté, voulut faire une manifestation décisive, personnelle.
Son entourage l'en empêcha, connaissant l'état des esprits en France, et craignant qu'une insulte grave ne fût faite à la personne même du souverain, et n'entraînât à des complications inquiétantes. Il exigea néanmoins qu'une parole officielle fut donnée publiquement, en plein Reichstag.
Voici la déclaration du Secrétaire d'État aux Affaires Etrangères de l'Empire, à la séance du 24 janvier 1898:
«Vous comprendrez que je n'aborde ce sujet qu'avec de grandes précautions. Agir autrement pourrait être interprété comme une immixtion de notre part dans les affaires de la France..... Je crois d'autant plus devoir observer une réserve complète à ce sujet qu'on peut s'attendre à ce que les procès ouverts en France jettent la lumière sur toute l'affaire.
Je me bornerai donc à déclarer de la façon la plus formelle et la plus catégorique, qu'entre l'ex-capitaine Dreyfus, actuellement détenu à l'Ile du Diable, et n'importe quels agents allemands, il n'a jamais existé de relations, ni de liaisons, de quelque nature qu'elles soient.»
IX.—Cinq jours plus tard, l'Empereur vint lui-même chez notre ambassadeur à Berlin, pour lui apporter sa déclaration personnelle, et le prier de la communiquer officiellement à notre Gouvernement.
X.—Enfin, à l'heure actuelle, l'état d'esprit autour du Souverain est le même.
L'Empereur éprouve le plus impatient désir de faire un geste personnel; mais on l'en empêche, et on l'en empêchera jusqu'au bout, pour ne pas risquer que la France, par une seconde condamnation, ne donne au Kaiser un nouveau démenti qu'il ne pourrait pas supporter sans une rupture diplomatique. Cependant on est prêt à renouveler, par notes officielles, toutes les déclarations déjà faites.
Si l'on consent à supposer un instant que l'Empereur ait été réellement compromis dans une affaire d'espionnage, on peut admettre, à la rigueur, qu'il ait été, pour certaines nécessités politiques, contraint de nier la vérité par un démenti officiel.
Mais, ce mensonge diplomatique une fois commis et enregistré, aurait-il réitéré ses protestations, à chaque occasion nouvelle, et avec une si solennelle et pressante insistance?
Même en faisant abstraction de la personnalité de Guillaume II et de sa conception particulièrement chatouilleuse de l'honneur, est-ce que jamais un souverain oserait faire de si véhémentes et de si nettes déclarations, s'il risquait d'être, un beau jour, confondu devant le monde entier, par la découverte ultérieure d'une preuve décisive?
Qui ne voit dans l'attitude du Kaiser un très simple et très douloureux cas de conscience?
L'Empereur sait,—mieux que personne—l'innocence de Dreyfus; et, sans toutefois vouloir faire courir à son pays le danger d'une complication diplomatique, il cherche à le crier aussi souvent et aussi haut qu'il le peut.
Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.
LE SEMEUR.
«A M. Marc Elie Luce, Auteuil.
«Rennes, le 5 septembre 1899.
«Mon cher ami,
«Notre découragement est sans bornes. Pratiquement, la cause est perdue. Les deux semaines qui viennent de s'écouler ont décidé de l'Affaire. L'opinion des juges est établie: et ils sentent bien que la majorité est avec eux.
«Woldsmuth me reproche d'avoir trop tardé à publier son article. Je me le reproche aussi, quoique je reste sceptique sur l'efficacité qu'il aurait pu avoir. Comment s'attaquer à une fable qui n'a jamais été clairement formulée par personne? Et, le serait-elle, qu'elle resterait pareillement insaisissable, puisqu'il est admis qu'aucune trace matérielle ne peut subsister des fameux autographes impériaux. C'est le domaine des affirmations gratuites. Devant ces fumées, nous sommes sans armes; pas de lutte possible.
«Si l'opinion avait pû être retournée, elle l'eût été l'autre jour, le lendemain de votre départ, par l'attitude de Casimir-Perier, l'homme de France qui sait le mieux si oui ou non le Kaiser s'est trouvé mêlé à l'Affaire, et qui, fort de son passé intègre, est venu répéter de sa voix loyale, les yeux dans les yeux du colonel-président:
«Vous me demandez de dire la vérité, toute la vérité; je l'ai juré, je la dirai, sans réticences et sans réserves. Quoi que j'aie déjà dit dans le passé, on persiste à croire ou à dire,—ce qui, malheureusement, n'est pas toujours la même chose—que je connais seul des incidents ou des faits qui pourraient faire la lumière, et que je n'ai pas jusqu'ici dit tout ce que la justice a intérêt à connaître. C'est faux... Je ne veux sortir de cette enceinte, qu'en y laissant l'inébranlable conviction que je ne sais rien qui doive être tu, et que j'ai dit tout ce que je sais!»
«Je ne mets pas en doute la bonne foi des juges du Conseil de Guerre. Je les crois aussi impartiaux qu'ils peuvent être.
«Mais ce sont des soldats.
«Comme toute l'armée, ils sont tenus par leurs journaux dans une ignorance absolue de ce qu'est réellement l'Affaire. On a posé devant eux la question, avec un raccourci criminel: la culpabilité de Dreyfus ou bien l'infamie de l'État-Major: voilà dans quel dilemme imbécile on a enfermé ces officiers.
«Si encore ils étaient soustraits à toute influence, seuls avec leur conscience et les faits! Mais non: ils continuent, chaque soir, après les débats, à vivre dans le milieu où la trahison de l'accusé est un axiome invulnérable.
«Je ne dis pas qu'ils soient d'avance inclinés à trouver Dreyfus coupable;
mais je puis affirmer dès aujourd'hui, qu'ils voteront la culpabilité.
Et il n'en peut être autrement pour ces hommes dont la personnalité humaine
ne se dégage plus du revêtement professionnel; dont les vingt-cinq
ans d'uniforme sont collés à la peau; qui, depuis un quart de siècle,
sont façonnés par la discipline, imprégnés du sentiment hiérarchique,
fanatiques de cette armée dont l'emblème vivant est là, dans la personne
de ses chefs qui comparaissent devant eux. Comment pourraient-ils se
prononcer en faveur du juif, contre l'État-Major? Le voudraient-ils,
par instants, au fond de leurs consciences troublées, que, physiquement,
ils ne le pourraient pas. Et peut-on leur en faire reproche?
«D'ailleurs je dois convenir que l'attitude de l'accusé n'a rien qui puisse
contrebalancer le prestige des uniformes. Il a déçu la plupart même de ses
amis. A tort, selon moi. Depuis quatre ans, nous nous battons pour des
idées; mais en somme, c'est lui qui les représente: et nous nous étions
tous fait, en nous-mêmes, une image arbitraire, mais précise, de cet
inconnu. Il débarque: et, ainsi que nous aurions dû nous y attendre, la
réalité ne coïncide pas avec notre imagination.
«Beaucoup d'entre nous ne le lui ont pas pardonné.
«C'est un homme simple, dont l'énergie naturelle est tout intérieure. Il arrive, affaibli par la séquestration, par les émotions inouïes qu'il a supportées; il est malade, il grelotte de fièvre, il digère à peine un peu de lait. Comment serait-il au diapason de cet auditoire forcené, dont les trois quarts le haïssent comme un malfaiteur public, et dont l'autre quart l'adore comme un symbole? Ce rôle écrasant n'est-il pas au-dessus des forces humaines? Il n'a plus la vigueur de hurler furieusement son innocence, comme il faisait dans la cour de l'Ecole Militaire. Le peu d'énergie qui lui reste, il l'emploie, non pas contre les autres, mais contre lui-même: à ne pas se laisser abattre, à paraître un homme; il ne veut pas qu'on l'ait vu pleurer.
«C'est une conception dont la grandeur héroïque, ingrate, échappe à l'esthétique populaire. Il aurait peut-être conquis la foule par une attitude plus théâtrale: mais cet empire qu'il garde au prix d'un dur effort, est taxé d'indifférence, et ceux qui se démènent pour lui depuis quatre ans, lui en font un grief.
«Moi-même, qui ne le connaissais pas, je dois avouer que lorsque je l'ai aperçu à la première audience, malgré l'enthousiasme de nos amis, malgré l'espoir insensé que j'avais triomphalement clamé, le matin même, dans le Semeur, j'ai reçu à ce moment-là, l'avertissement intime de la défaite, un je ne sais quoi, le petit ressort qui casse net... Je l'ai caché, même à vous. Mais je puis dire que ce jour-là, j'ai senti tout à coup, avec une certitude indiscutable, que l'Affaire était perdue, mal perdue, et qu'elle ne laisserait, au fond de toutes ces âmes enflammées par elle, qu'un peu de cendre nauséabonde.
«Cette amère inquiétude ne me quitte plus.
«Vous avez bien fait de partir. Votre place n'était pas ici, dans le tumulte.
«Nous sommes à la limite de notre résistance. Songez que pour beaucoup d'entre nous c'est le second été torride, sans trêve, dans la sombre hantise de ce drame! Songez à ces journées d'attention exaspérée, dans l'atmosphère irrespirable de la salle du Conseil, où tant de témoignages suent le parti-pris et la haine! Et les soirées, pires que les jours, dans les rues, dans les cafés, pour éviter l'étouffement de la chambre d'hôtel où l'on ne peut plus dormir, des soirées—presque des nuits—à discutailler sans fin, à pointer pour la centième fois les chances de victoire ou de défaite! Si nous avons pu résister jusqu'à présent, c'est que la certitude de notre bon droit nous servait d'armature... Mais voici encore une étape douloureuse, et le repos n'est pas au bout! Combien nous en reste-t-il à franchir?
«C'est bien dur de voir notre pays, si beau, dans une pareille déchéance intellectuelle et morale! Penser qu'il y a, en ce moment, une révolte de la conscience universelle, et que la conscience française, pour la première fois depuis des siècles, n'en est pas!
«Au revoir, mon grand ami.
«Voulez-vous dire à Breil-Zoeger, que s'il a envie de revenir ici, Harbaroux propose de le remplacer à la direction du Semeur?
Barois.»
«J'apprends ce soir que Labori compte faire une démarche personnelle auprès du Kaiser, pour obtenir avant la fin des débats une dernière déclaration impériale de l'innocence de Dreyfus.
«A quoi bon? Il est déjà trop tard...»
«Barois.—103 Lycée. Rennes.
«Paris, 8 septembre.—11 h. 30.
«Suis averti télégraphiquement nouvelle protestation Gouvernement allemand, parue ce matin en note officielle dans Moniteur Empire, pour répondre appel Labori.
«Voici texte:
«Sommes autorisés renouveler déclarations que Gouvernement Impérial, afin sauvegarder dignité propre, a faites pour remplir son devoir d'humanité.
«L'ambassadeur a remis, sur ordre Empereur, en janvier 1894 et janvier 1895, à Hanotaux, Ministre Affaires Etrangères, à Dupuy, Président Conseil, et au Président République Casimir-Perier, déclarations réitérées que l'ambassade allemande en France n'avait jamais entretenu relations, ni directes ni indirectes, avec capitaine Dreyfus.
«Le secrétaire d'Etat de Bülow s'est exprimé en ces termes le 24 janvier 1898 devant commission Reichstag: «Je déclare de la façon la plus formelle qu'entre ex-capitaine Dreyfus et n'importe quel organe allemand, jamais existé relations ni liaisons quelque nature qu'elles soient.»
«Ministre Affaires Étrangères, prévenu, s'est engagé à communiquer officiellement cette protestation aux juges avant vote. Espérons encore. Faites répandre nouvelle par tous journaux locaux.
Luce.»
«Luce. Auteuil.
«Rennes, 9 septembre, 6 heures soir.
«Condamnation avec circonstances atténuantes. Dix ans détention. Contradictoire et incompréhensible.
«Vive justice quand même!
«L'affaire continue!»
Le 9 septembre 1899: le soir du verdict.
En gare de Rennes, trois trains, successivement, ont été pris
d'assaut. Un quatrième, formé de tous les wagons de rebut qui
restaient dans les garages, a démarré, péniblement, à son tour,
dans la cohue d'émeute qui grouille sur les quais.
Barois, Cresteil et Woldsmuth, les épaves du Semeur, sont
parqués dans un wagon de troisième, ancien modèle: des cloisons,
à mi-hauteur, divisent la voiture en compartiments étroits;
deux quinquets pour tout le wagon.
Les vitres sont ouvertes sur la campagne endormie. Aucun souffle. Le train roule lentement, charriant à travers l'épaisse nuit d'été un brouhaha de séance électorale.
Des vociférations se croisent dans l'air empesté des compartiments:
—Tout ça, c'est les Jésuites!
—Taisez-vous donc! Et l'honneur de l'armée?
—Oui: c'est la faillite du Syndicat...
—Ils ont bien fait! La réhabilitation d'un officier qui a été condamné par sept camarades, et déclaré coupable par le Haut-Commandement de l'Armée, compromet le salut d'un pays bien plus qu'une erreur judiciaire...
—Parbleu! Et je vais plus loin! Moi qui vous parle, admettons que j'aie été du Conseil, et que j'aie su que Dreyfus était innocent... Eh bien. Monsieur, sans hésiter, pour le bien de la patrie, pour l'ordre public, je l'aurais fait fusiller comme un chien!
CRESTEIL D'ALLIZE (se dressant, malgré lui, dans la pénombre, et dominant le tumulte de sa voix éraillée).—Il y a un savant français, nommé Duclaux, qui a déjà répondu à cet argument de la sécurité nationale: il a dit,—ou à peu près—qu'il n'y avait pas de raison d'Etat qui puisse empêcher une Cour de Justice d'être juste!
—Vendu! Lâche! Fripouille! Sale juif!
CRESTEIL (insolent).—Messieurs, je suis à vos ordres.
Les injures redoublent, Cresteil reste debout.
BAROIS.—Laissez-les donc, Cresteil...
Peu à peu, une torpeur lourde,—causée par la chaleur suffocante, l'oppression de l'obscurité, la dureté des banquettes, le cahotement du vieux matériel,—envahit le wagon.
Le tapage se localise, diminue.
Serrés dans leur coin, Barois, Cresteil et Woldsmuth causent à voix basse.
WOLDSMUTH.—Le plus triste, c'est que cette pensée estimable de rendre service au pays, a été, j'en suis sûr, le principal mobile de beaucoup de nos adversaires...
CRESTEIL.—Mais non! Vous avez toujours tendance, Woldsmuth, à croire que les autres sont mûs par des sentiments élevés, des idées... Ils sont mûs, le plus souvent, par leur intérêt, conscient ou inconscient, et à défaut de calcul, par de simples habitudes sociales...
BAROIS.—Tenez, à propos d'habitudes, je me souviens d'une scène qui m'a beaucoup frappé à la troisième ou quatrième audience.
J'étais en retard. J'arrivais par le couloir de la presse, juste au moment où les juges s'engageaient dans l'entrée. Presque en même temps qu'eux, un peu en arrière, débouchent quatre témoins, quatre généraux en grande tenue. Eh bien, les sept officiers-juges, sans avoir eu le temps de se concerter, d'un même mouvement devenu chez eux machinal et qui révèle un asservissement de trente ans, se sont arrêtés net, le dos au mur, au garde-à-vous... Et les généraux, simples témoins, ont passé devant eux, comme à la revue, pendant que les officiers-juges faisaient automatiquement leur salut militaire...
CRESTEIL (spontanément).—Ça a sa beauté!
BAROIS.—Non, mon petit, non... C'est l'ancien Saint-Cyrien qui vient de parler, ce n'est pas le Cresteil d'aujourd'hui.
CRESTEIL (tristement).—Vous avez raison... Mais ça s'explique, voyez-vous... Pour des êtres fiers et énergiques, la discipline demande un tel sacrifice de toutes les heures, qu'on ne peut pas perdre l'habitude de l'estimer au prix qu'elle coûte...
BAROIS (suivant son idée).—D'ailleurs, le verdict de tout à l'heure, c'est la répétition de cette scène du couloir... Cette condamnation d'un traître avec circonstances atténuantes, cela paraît boiteux, inepte... Mais, réfléchissez: la condamnation, c'est le salut militaire qu'ils ont fait sans s'en rendre compte, par discipline professionnelle; et les circonstances atténuantes, ça, c'est, malgré tout, l'hésitation de leurs consciences d'hommes...
L'arrivée à Paris, au petit jour.
Un silence morne emplit les wagons, qui vident sur le quai leur bétail frissonnant et blême.
Luce est là, pâle, son regard doux cherchant les amis.
Etreinte silencieuse: une immense affection, une immense tristesse. Les yeux sont pleins de larmes.
Woldsmuth embrasse la main de Luce, en pleurant.
BAROIS (après une hésitation).—Julia n'est pas avec vous?
Breil-Zoeger redresse la tête.
ZOEGER.—Non.
Quelques pas silencieux, en groupe serré.
BAROIS (timidement, à Luce).—Quoi de nouveau? (Inquiet de son mutisme.) La cassation?
LUCE.—Non, il paraît que c'est impossible, juridiquement...
BAROIS.—Alors?
Luce ne répond pas tout de suite.
LUCE.—La grâce...
CRESTEIL ET BAROIS (ensemble).—Il la refusera.
LUCE (fermement).—Non.
C'est un dernier coup, au visage.
Ils restent immobiles, debout sur le trottoir, les lèvres entr'ouvertes, la gorge serrée, sans rien voir. Leurs épaules plient...
WOLDSMUTH.—Ayez pitié de lui... Retourner là-bas? Recommencer le supplice? Et pourquoi faire?
CRESTEIL (pathétique).—Pour rester le symbole!
WOLDSMUTH (patient).—Il en mourrait. Et alors?
LUCE (avec une indulgence infinie).—Woldsmuth a raison... Au moins nous réhabiliterons un vivant...
Le même soir.
Barois a quitté de bonne heure son journal, et il s'est mis à
marcher, devant lui, froissant au fond de sa poche le billet de
Julia, qu'il a trouvé, le matin, sur son bureau:
«Tu vas revenir de Rennes, tu vas être étonné de ne pas me trouver au Semeur.
«Je ne veux pas te tromper.
«Je me suis donnée librement, je me reprends de même.
«Tant que je t'ai aimé, je t'ai appartenu, sans restriction. Mais depuis que j'en aime un autre, je te le dis avec franchise, tu ne peux plus exister pour moi. Je te préviens loyalement; c'est ma façon de te prouver jusqu'au bout mon estime.
«Quand tu liras ce mot, j'aurai repris la libre disposition de moi-même. Tu es assez énergique et trop intelligent pour ne pas comprendre, et pour te diminuer par une souffrance inutile.
«Moi je resterai toujours ton amie,
Julia.»
Il rentre rue Jacob et se laisse choir tout habillé sur son lit.
Une douleur aigüe, personnelle, malsaine, s'est greffée sur l'autre, sur ce vaste découragement qui l'a épuisé. Ses tempes sont lourdes et brûlantes.
Soudain, dans cette chambre, mille souvenirs sensuels... Un désir éperdu de revivre, à quelque prix que ce soit, certains instants précis... Il se soulève, hagard, mordant ses lèvres, tordant ses bras; puis il retombe en sanglotant sur son lit.
Il se débat, quelques secondes encore, comme un suicidé qu'un remous emporte...
Puis tout sombre en un noir sommeil.
Un coup de sonnette le réveille, le rejette, d'un saut égaré, en plein désespoir.
Il fait grand jour: dix heures...
Il va ouvrir la porte: sur le palier, Woldsmuth.
WOLDSMUTH (troublé par le visage bouffi et ravagé de Barois).—Je vous dérange...
BAROIS (agacé).—Entrez donc!
Il referme la porte.
WOLDSMUTH (évitant de le regarder).—Je vous avais cherché au Semeur ... pour ces renseignements que vous m'avez demandés... (Il relève les yeux.) J'ai pu voir Reinach... (Balbutiant.) Je suis ... j'ai...
Ils se regardent. Woldsmuth n'a pas le courage de poursuivre Et Barois comprend que Woldsmuth sait tout; il en éprouve un soulagement immense: il lui tend les deux mains.
WOLDSMUTH (avec simplicité).—Ah... Et Zoeger, un ami!
Barois pâlit, jusqu'à en perdre le souffle.
BAROIS (des lèvres).—Zoeger?
WOLDSMUTH (effaré).—Je ne sais pas ... je dis ça...
Barois reste assis, les bras raidis, les poings crispés, la tête en avant, le cerveau vide.
WOLDSMUTH (que ce silence épouvante).—Mon pauvre ami... Je me mêle de ce qui ne me regarde pas... J'ai tort... Mais j'arrive justement... Je voudrais vous aider à moins souffrir...
Sans répondre, sans le regarder, Barois enfonce sa main dans sa poche et lui tend la lettre de Julia.
Woldsmuth la lit avidement, et sa respiration devient sifflante; à travers la barbe, ses lèvres ont un tremblement flasque.
Puis il replie le feuillet, et vient s'asseoir à côté de Barois; maladroitement il lui entoure la taille de son bras trop petit.
WOLDSMUTH.—Ah, cette Julia... Je sais... On souffre, on souffre... On voudrait tuer!
(Avec un sourire poignant.) Et puis ça passe...
Tout à coup, sans faire un mouvement, il commence à pleurer, doucement, intarissablement,—comme on ne peut pleurer que sur soi-même.
Barois l'examine. Ces paroles, cet accent, ces larmes... Il soupçonne, et presqu'en même temps, il découvre la vérité.
Et aussitôt, avant toute pitié, c'est une sorte de satisfaction sombre, une diversion à sa douleur, à lui. Il est moins seul. Une crise de bonté sentimentale lui mouille les yeux.
Ah, la vie est trop cruelle...
BAROIS (humblement, comme si les mots pouvaient effacer).—Mon bon Woldsmuth, comme j'ai dû vous faire du mal...
A l'Exposition.
Le 30 mai 1900.
Sur le bord de la Seine, dans un de ces restaurants de carton,
pavoisés et fleuris, en terrasse sur l'eau.
Une trentaine de jeunes hommes, autour d'une table servie.
Les garçons viennent d'allumer les candélabres, et, dans la nuit hésitante, la lueur mate des petits abat-jour jaunes, enveloppant les cristaux et les fleurs qui penchent, crée autour du banquet qui s'achève une atmosphère languissante et recueillie.
Un léger silence.
Marc-Elie Luce, qui préside, se lève.
Ses yeux clairs, enfoncés sous le front qui fait ombre, promènent sur les convives un regard pénétrant et grave.
Puis il sourit, comme s'il voulait se faire pardonner les feuillets qu'il tient dans sa main.
Son accent franc-comtois souligne le relief des phrases et donne à son discours une bonhomie provinciale, simple et imposante.
LUCE.—Mes chers amis.
Il y a aujourd'hui un an, c'était pour nous une grande allégresse. M. Ballot-Beaupré venait de lire publiquement son rapport. Nous venions de voir toute l'Affaire revivre sous nos yeux, résumée avec une vigueur de raccourci et une exactitude de détails, qui font de ce travail un impérissable modèle. Un silence sympathique nous garantissait la conversion de ce public, qui, l'année précédente, avait hué Zola. Nous éprouvions une immense confiance à voir enfin soulevé par des mains officielles, ce poids qui nous écrasait depuis trois ans. Et nous avions tous sur les lèvres cette parole d'espoir, que M. Mornard, se tournant vers la Cour, prononçait d'une voix anxieuse: «J'attends votre arrêt comme l'aurore du jour qui fera luire sur la patrie la grande lumière de la concorde et de la vérité.»
C'est pour commémorer ces heures sacrées,—qui sont, n'est-il pas vrai, parmi les dernières heures pures de l'Affaire?—que nous sommes réunis ce soir.
Je ne reviendrai pas sur le drame douloureux de cet été. Déjà les détails s'estompent. Le souci généreux qu'a eu le Gouvernement de rendre inefficace en fait l'hésitante condamnation du Conseil de Guerre, nous permet d'attendre, avec une patience qui est nouvelle pour nous, l'instant où, par la nécessité même des choses, la vérité anéantira jusqu'aux moindres traces de l'injustice; car la force de la vérité est opiniâtre, et finit par plier les événements sous sa loi.
En réalité, la crise est traversée. L'un de nous n'écrivit-il pas, dernièrement: «La violence des hommes est comme les grands vents dans la nature: elle s'enfle et grossit comme eux, puis s'apaise et disparaît, laissant les germes à leur activité...»[1]
C'est un pénible moment de désarroi pour tous ceux qui, depuis plusieurs années, vivent en pleine intensité d'action. Ils s'arrêtent, essoufflés, comme des chiens de meute au soir de la chasse; la journée a été rude; leur rôle est terminé. Et voici qu'une angoisse nouvelle les étreint, une angoisse devant ces ruines et ces morts qui encombrent le champ de bataille... Je crois exprimer ce que nous ressentons tous, n'est-ce pas? Une angoisse devant cette France endolorie où régnent les rancunes et les dissensions.
Au fort de la lutte nous ne pensions guère aux conséquences. C'était l'argument de nos ennemis. Nous leur répondions,—et à bon escient—que l'honneur national devait passer avant l'ordre public, et qu'une illégalité, manifestement commise, fût-ce au nom de la sécurité de l'Etat, si elle est officiellement acceptée par tous, engendre des maux mille fois plus graves que le trouble passager d'un peuple: elle compromet la seule acquisition dont les hommes puissent avoir quelque fierté, ces libertés sacrées dont le sang français a jadis enrichi les nations; exactement, elle compromet le Droit et la Justice de tout le monde civilisé.
(Applaudissements.)
Mais enfin, maintenant que nous avons eu satisfaction, il faut bien
reconnaître en quelle posture l'entêtement de l'opinion publique a mis le
pays: nous sommes au lendemain d'une révolution.
Dans la période confuse qui a précédé l'issue, au cours des derniers assauts, une foule de partisans, que nous ne soupçonnions pas, est venue se mêler au groupe de penseurs actifs que nous formions jusque-là[2].
Notre humble et tenace drapeau, ils nous l'ont arraché des mains, pour le brandir ostensiblement à notre place. Ils ont envahi les espaces libres que notre travail d'assainissement social avait déblayés. Et aujourd'hui, au lendemain de la Victoire, ce sont eux qui occupent, en maîtres, le terrain. Voulez-vous me permettre une distinction qui m'est chère: nous étions une poignée de dreyfusistes; et maintenant, ils sont une armée de dreyfusards...
Que valent-ils? Je n'en sais rien. Ils font des confusions que nous nous étions sévèrement interdites, entre le militarisme et l'armée, entre le nationalisme et la France. Que feront-ils? Que sont-ils capables d'édifier sur les ruines que nous avons voulu faire? Je n'en sais rien. L'ère resplendissante dont nous avions rêvé l'avènement, se lève-t-elle avec eux?
Hélas! Ils ressemblent, par bien des côtés, A ceux que nous avons renversés: mais je ne pense pas qu'ils puissent être pires.
Pour nous, notre tâche est accomplie; la réalisation de ce que nous avons passionnément espéré, n'est pas pour nous. Ce branle-bas dont nous avons sciemment donné le signal, nous le payons presque tous de notre repos, de notre bonheur individuel.
Mes chers amis, c'est dur, c'est très dur. Je le sais comme vous: j'ai perdu mes auditeurs au Collège de France; et si j'ai été réélu au Sénat, je ne dois pas m'illusionner: aucune commission n'a fait appel à mon travail, toute la besogne se fait loin de moi. Ceux qui, actuellement, tirent de notre effort le plus manifeste profit, sont généralement aussi ceux qui se détournent de nous avec la plus inquiète méfiance... Ils ont tort: ils nous feraient supposer, qu'après avoir constaté de près le danger que nous sommes pour qui n'a pas les mains pures, notre voisinage leur fait peur...
(Sourires.)
Les moins à plaindre, ce sont les plus jeunes, ceux qui ont le temps de
refaire leur vie. Oh, pour ceux-là, le beau baptême du feu, au seuil d'une
existence consciencieuse! La flamme a dévoré tout le factice, tout le
décor, tout le carton-peint de leurs caractères: il ne reste plus que la masse
essentielle: le roc! Et quelle bienfaisante nécessité ce fut pour eux,
d'avoir à choisir, une fois pour toutes, leur direction et leurs amitiés!
J'en connais beaucoup, en somme, qui s'en tireront...
(Il sourit, quitte un instant ses feuillets des yeux, et se penche vers Barois que l'on a placé auprès de lui.)
... Notre ami Barois, tenez, dont la confiance aventureuse et la générosité ne se sont jamais démenties; qui a été, depuis le début, pour chacun de nous, un perpétuel réconfort aux jours de défaillance!
(Reprenant la lecture.) Barois demeure au centre de nous tous. C'est lui qui a la garde de notre feu sacré, ce Semeur qui est son œuvre, dont il constitue le foyer central, et autour duquel nous devons rester groupés. Voyez-le à l'œuvre, et que son exemple soit notre sauvegarde. Depuis des années, il s'est consacré à son journal, ne spéculant pas, semant sans arrière-pensée toutes ses idées, tous ses projets, sans avoir la crainte mesquine qu'on s'en empare et qu'on les réalise avant lui; ne ménageant rien,—que sa conscience! Près de lui, il y aura toujours du travail pour les hommes de bonne volonté. Le Semeur, après les tirages inouïs qu'il a eus et qui seront historiques, est revenu à une expansion mieux proportionnée à son objet: il s'adresse à une minorité, et cette minorité intellectuelle lui reste scrupuleusement attachée. Apportons-lui tous notre concours. Messieurs; apportons-lui cette part d'expérience, dont, parmi nous, les plus jeunes mêmes sont aujourd'hui pourvus,—car ces années troublées valent une vie entière. Que Barois continue à centraliser nos efforts, et à leur donner cette diffusion qui les aiguillonne et les justifie!
Et surtout, mes amis, ne nous laissons pas atteindre par le stérile découragement, qui déjà rôde et nous guette. Je sais autant que vous, combien la tentation peut être forte. (D'une voix angoissée.) Devant les difficultés que notre pays s'est préparées, lequel de nous n'a pas éprouvé un sentiment d'effroi, et senti planer sur lui l'ombre lourde d'une responsabilité? Comment en serait-il autrement? Comment ne garderions-nous pas de cette épreuve, un indélébile pessimisme? Il nous a fallu joncher le chemin de tant d'illusions!
(Redressant la tête.) Mais un pareil malaise, si légitime soit-il, ne doit pas obscurcir notre discernement. Nous nous sommes sacrifiés pour une belle cause, et cela seul importe! Ce que nous avons fait, mes amis, nous devions le faire, et s'il fallait recommencer, nous n'hésiterions pas! Répétons-nous-le, aux heures de doute et de scrupule!
La France est divisée: c'est grave, mais ce n'est pas irréparable; le pire qui puisse en résulter c'est, pour notre pays, un dommage matériel et momentané; tandis que nous lui avons sauvé l'intégrité de ses principes, sans lesquels il n'y a pas de vie pour une nation.
Songeons que, dans quelques cinquante ans, l'affaire Dreyfus ne sera qu'un petit épisode des luttes de la raison humaine contre les passions qui l'aveuglent; un moment, et pas davantage, de ce lent et merveilleux cheminement de l'humanité vers plus de bien.
Notre façon de concevoir la justice et la vérité est infailliblement condamnée à être dépassée dans les âges à venir; nous le savons; et loin d'abattre notre courage, cet espoir est le plus efficace stimulant de notre élan actuel. Le devoir strict de chaque génération est donc d'aller dans le sens de la vérité, aussi loin qu'elle peut, à la limite extrême de ce qu'il lui est permis d'entrevoir,—et de s'y tenir désespérément, comme si elle prétendait atteindre la Vérité absolue. La progression de l'homme est à ce prix.
La vie d'une génération, ce n'est qu'un effort qui en suit et en précède d'autres. Eh bien, mes amis, notre génération a fait le sien.
La paix soit sur nous.
Il s'assied.
Une grande émotion silencieuse.
[1] E. Carrière.
[2] D. Halévy. Apologie pour notre passé. (Cah. de la quinzaine. XI. 10)
Rue de l'Université, plusieurs années après.
L'immeuble entier est occupé par le Semeur. L'entrée est
encombrée de rames et de ballots. Le rez-de-chaussée et l'entresol
servent de locaux aux machines. Les autres étages sont réservés
aux bureaux de la revue et de la maison d'édition.
Au 3e étage: Rédaction.
UN EMPLOYÉ (entrant).—Monsieur Henry vous demande à l'appareil.
LE SECRÉTAIRE.—Connais pas.
L'EMPLOYÉ.—C'est pour le New-York Herald.
LE SECRÉTAIRE.—Ah, Harris? Donnez...
Il prend le récepteur.
LE SECRÉTAIRE.—Allô! Parfaitement... J'en ai parlé à M. Barois, il veut bien: mais pas de phrases, pas d'éloges, les faits, sa vie... A votre disposition; questionnez...
Depuis l'affaire Dreyfus? (Riant.) Pourquoi pas depuis 70?
Oui, la besogne actuelle, ça vaudra mieux...
Si vous voulez... D'abord ses cours du soir, aux mairies de Belleville, de Vaugirard, du Panthéon. Beaucoup d'ouvriers; au Panthéon, une majorité d'étudiants... Oui, insistez: c'est l'idée directrice: tout ce qui peut servir à faire évoluer le cerveau des masses vers la liberté de la pensée.
Maintenant, il y a son cours aux Etudes sociales, deux fois par semaine...
Cette année? Sur la crise universelle des religions. Ça fait un livre par an.
Enfin il y a le Semeur... C'est le gros morceau... deux cents pages tous les quinze jours...
Je ne sais pas, mais certainement une quinzaine d'articles personnels dans l'année. Et puis, dans chaque numéro, une chronique régulière, toutes ses idées du moment...
Non! Les Conversations du Semeur, c'est autre chose. Voilà: chaque semaine il y a une réception ici; on apporte les articles, on combine les numéros suivants. Il a eu l'idée de faire sténographier la conversation, et de publier, sous forme de Fiches, les digressions d'ordre général. Les abonnés s'en sont mêlés. Ils ont écrit pour qu'on abordât tel ou tel sujet. C'est très bon, ça met en contact avec le public: on voit les points qui préoccupent... Bref, les Fiches sont devenues les Conversations du Semeur, presqu'un volume tous les trois mois...
Allo? Soit, mais vous auriez trouvé la liste partout... D'abord les livres sur l'Affaire: Pour la vérité (1re, 2e et 3e séries), sans compter les brochures; je passe. Ensuite, les conférences, qui paraissent à la fin de chaque année: Paroles de combat, six volumes; le septième est sous presse. Et puis, quatre bouquins: son enseignement aux Etudes sociales: Les progrès de l'instruction populaire.—La libre-pensée hors de France.—Essai sur le déterminisme.—La divisibilité de la matière.
Allo! Il serait bon de dire que la conférence de dimanche au Trocadéro est tout à fait exceptionnelle, hors des habitudes de M. Barois. Insistez... Que jamais il n'a voulu prendre la parole devant tant de monde...
Hein? je ne sais pas, trois mille places, je crois; et il paraît que la moitié de la salle est déjà louée...
Oui, le nom attire, et puis le sujet: L'avenir de l'incroyance.
Merci... A votre disposition... Au revoir!
Au Trocadéro.
Le dimanche suivant; l'après-midi.
Grande animation. Des files de fiacres viennent se décharger
au bas des escaliers. Un cordon d'agents assure l'ordre.
Tout à coup, un mouvement se produit parmi les jeunes gens
qui stationnent sur le trottoir: une voiture s'est arrêtée devant
l'entrée particulière de la salle.
Barois descend, accompagné de Luce.
Les têtes se découvrent.
Les deux hommes s'engagent vivement dans l'intérieur du palais, suivis de quelques intimes.
A trois heures la salle est comble; des gens debout obstruent les dégagements.
Les rideaux s'écartent lentement, découvrant la scène vide, où Barois paraît presque aussitôt. Une immense ovation roule en tonnerre, s'élève, retombe, se relève lourdement, ondule comme un essaim qui hésite avant de prendre son vol, et subitement s'évanouit en un silence total.
Barois gravit lentement les marches de l'estrade.
Il est un nain au centre du vaste hémicycle. On distingue mal ses traits; mais son entrée rapide, la fermeté de son salut, le long et calme regard qu'il promène sur ces milliers de têtes nues concentriquement alignées autour et au dessus de lui, révèlent l'assurance d'un homme qui a le vent en poupe.
Il s'assied sans quitter la salle des yeux.
BAROIS.—Mesdames, Messieurs...
Une brève angoisse; son cœur se crispe.
Mais le silence de ces visages immobiles, la confiance de ces innombrables regards qui convergent sur lui, desserrent l'étau. Il cède à une inspiration subite: il renonce au préambule préparé, laisse retomber ses notes, et se livre, en souriant, sur un ton de causerie affectueuse.
... Mes chers amis,
Vous êtes ici deux ou trois mille ... vous n'avez pas hésité à abandonner vos occupations du dimanche pour entendre parler de l'Avenir de l'incroyance. A ce seul titre, vous êtes accourus.
Symptôme caractéristique, et combien émouvant!
Tous les peuples civilisés subissent actuellement la même crise religieuse: dans tous les coins du monde où la culture, où la pensée ont quelque autorité, un même mouvement soulève la conscience humaine, un même courant de réflexion et d'incrédulité rejette les fables des églises, un même geste d'affranchissement repousse la tutelle dogmatique de tous les dieux. La France qui, par son équilibre intellectuel, son appétit de liberté, son besoin de vérification positive, est, depuis deux cents ans, le véritable foyer de la libre-pensée dans le monde, semble avoir donné le signal de cet ébranlement. L'Italie, l'Espagne, l'Amérique du Sud, tous les pays latins où dominait le catholicisme, ont suivi son exemple. Une transformation parallèle travaille les pays protestants, l'Angleterre, l'Amérique du Nord, le sud de l'Afrique. Et ce mouvement est si général qu'il atteint, dès aujourd'hui, les centres instruits de l'Islam et du Bouddhisme, les parties civilisées de l'Afrique, de l'Inde, le Japon tout entier. Partout les églises ont dû renoncer à ce pouvoir civil qu'elles avaient exercé pendant de longs siècles et qui renforçait habilement leur puissance. Elles se sont vu retirer un à un leurs privilèges, et exclure impitoyablement du domaine temporel. En fait, il n'y a pour ainsi dire plus de religions nationales; partout, l'Etat est laïc, et il affirme sa neutralité entre les croyances dont il tolère les cultes.
Cet immense assaut de la pensée contre le bloc des religions est trop complexe pour être étudié en détail: mais j'ai voulu vous rappeler qu'il est universel, afin que vous ne fussiez pas tentés de considérer l'évolution irreligieuse de notre pays comme un événement local et sans retentissement; il est étroitement lié au frémissement parallèle de tous les peuples.
Il s'arrête.
Il avait devant lui une agglomération d'hommes, de jeunes
gens, de femmes; c'est maintenant un auditoire. La synthèse
est faite. Ses yeux, sa voix, sa pensée, sont maintenant en contact
direct avec une masse uniforme, une seule et riche sensibilité,
dont la sienne n'est plus distincte, mais forme l'élément
central et moteur.
L'Église catholique, qui se prétend au-dessus de toute loi humaine, ne s'est pas laissé assujettir au droit commun sans une vive résistance. Elle a dû capituler cependant, et reporter tout ce qu'elle garde encore d'influence, dans le domaine spirituel: dernier retranchement, dont le flot qui monte, malgré certaines apparences momentanées, ronge activement les fondations... Car l'insuffisance de la théodicée à satisfaire les esprits actuels s'accroît, dans des proportions colossales, à mesure que se succèdent les générations: chaque découverte nouvelle ajoute invariablement une objection de plus aux affirmations dogmatiques de la religion, qui, par contre, ne reçoit plus, depuis longtemps, le moindre renfort des études contemporaines.
En lutte contre cet irrésistible courant, il n'y aurait pour l'Église qu'une seule chance de salut: évoluer, afin de rendre ses formules acceptables aux consciences modernes. C'est pour elle question de vie ou de mort. Si elle ne se transforme pas, elle provoquera infailliblement, en quelques générations, une désertion générale et définitive.
Or je voudrais vous montrer qu'il est littéralement impossible que ses dogmes se modifient, si peu que ce soit. Je voudrais vous montrer que l'Église catholique est condamnée. Quoi qu'elle fasse, elle est fatalement vouée à une dissolution totale, que l'on doit, dès maintenant, tenir pour inévitable, et dont on pourrait presque fixer l'échéance!
Une doctrine philosophique peut évoluer; elle est composée de pensées humaines qui sont groupées dans un ordre arbitraire, et, par nature, provisoire. Mais une religion révélée,—dont le point de départ n'est pas sujet à correction, mais parfait dès l'origine, immuable par définition, comme l'absolu,—une telle religion ne peut varier sans se détruire elle-même. Car, pour elle, s'amender, c'est reconnaître que sa forme précédente n'était pas parfaite, c'est avouer que sa source n'est pas en Dieu, qu'il n'y a pas de révélation à son origine. Ceci est de telle évidence, que l'Église n'a cessé d'affirmer son immutabilité comme une preuve de sa provenance divine, et que, récemment encore, le concile de 1870 n'a pas hésité à déclarer: «La doctrine de la foi que Dieu a révélée n'a pas été livrée comme une invention philosophique aux perfectionnements humains, mais elle a été transmise comme un dépôt divin.»[1]
Le catholiscime est donc prisonnier de son principe essentiel.
Mais allons plus loin. Même s'il lui était loisible d'opérer sans se contredire quelque réforme dans sa doctrine, il ne pourrait s'assurer par là qu'un sursis passager.
Voici pourquoi:
Le plus élémentaire aperçu historique sur le développement des religions nous montre qu'elles sont toutes nées de la curiosité de l'homme en présence de l'univers; leur noyau initial est toujours le même: il est constitué par les premières et naïves explications que l'homme a pu trouver aux phénomènes naturels. A ce point que l'on pourrait simplifier, jusqu'à dire: il n'y a pas eu, à proprement parler, de religion primitive; depuis l'humanité balbutiante jusqu'à nous, il n'y a qu'une seule trame de pensée: la trame scientifique; rudimentaire à son origine, elle s'enrichit peu à peu. Et ce que nous désignons sous le terme de religion, c'est une des étapes de la recherche humaine, l'étape de l'affirmation déiste; c'est une simple minute de l'effort scientifique, stupidement arrêtée et prolongée jusqu'à nous par la crainte du surnaturel; en un mot, l'homme est resté dupe des hypothèses mystiques qu'il avait ébauchées pour s'expliquer le monde. Cette cristallisation accidentelle a ralenti pendant plusieurs siècles le cheminement de la science; et, dès lors, le mouvement scientifique s'est trouvé nettement distinct du mouvement religieux.
J'en reviens donc à ce que je voulais vous dire. La religion, c'est la science d'autrefois, desséchée, devenue dogme; ce n'est que l'enveloppe d'une explication scientifique dépassée depuis longtemps. Elle a perdu, en se figeant, son principe de vie; elle est morte. Si, par impossible, elle tentait aujourd'hui de se transformer, de rejoindre le progrès scientifique,—qui représente ce qu'elle devrait être normalement,—... eh bien, elle ne le pourrait pas! Elle n'a pu durer tant de siècles qu'en berçant, avec ses mensonges, l'âme apeurée des hommes, en atténuant par des promesses leur effroi de mourir, et en engourdissant leur instinct d'investigation par des affirmations gratuites et invérifiables. Le jour où elle renoncerait à cet appareil qui la rend semblable à une imagerie populaire, il ne resterait plus rien de l'armature qui lui donne encore, pour certains, une apparence de vie. Car le sentiment religieux, sur l'existence duquel elle a spéculé depuis son origine, n'a pas d'équivalent dans les cerveaux vraiment modernes: et ce serait une lourde erreur de prendre pour un résidu des croyances mystiques de nos ancêtres, ce besoin inné de comprendre et d'expliquer, qui est bien antérieur à toute sentimentalité religieuse, et qui trouve aujourd'hui sa large et complète satisfaction dans le développement scientifique de notre temps.
Il ne me semble donc pas douteux qu'une religion dogmatique comme le catholicisme soit condamnée sans recours. La rigidité fondamentale de ses formules la rend de plus en plus suspecte à ces esprits, qui ont trop souvent expérimenté la relativité de leur connaissance, pour admettre une doctrine qui se proclame infaillible et immuable.
D'ailleurs le mal qui la mine ne vient pas seulement du dehors: une paralysie progressive l'envahit et la rend inapte à vivre parmi nous.
Non, le courant actuel est indiscutablement orienté vers une société sans Dieu, vers une conception purement scientifique de l'univers!
Il s'aperçoit aussitôt que cette dernière phrase a déclenché quelque chose. La tension des yeux qui le guettent, s'accentue soudain. Il se sent dominé par une pression de la volonté collective.
Il comprend: après avoir suivi jusqu'au bout sa pensée destructive, ils ont soif de quelque mirage, ils attendent, comme des enfants, leur conte de fée.
Il n'a rien préparé, mais il obéit. Son regard devient lumineux; un sourire de visionnaire joue sur ses lèvres.
Que sera-t-elle, cette irréligion de l'avenir? Ah, qui de nous peut l'entrevoir et la décrire?
Ce que l'on peut affirmer c'est qu'elle ne sera, à aucun degré, une religion scientifique! On répète trop souvent que les savants sont des prêtres d'un nouveau culte, qu'ils remplacent une foi par une autre... Il se peut que, dans le désarroi actuel, certains d'entre nous apportent à la science qu'ils servent, un reste de religiosité héritée et sans emploi. N'y attachons pas d'importance. En fait, il n'y a plus de place pour de nouvelles idoles, et la science ne peut en être une; car l'intelligence est négative, et c'est une constatation à laquelle il faudra bien que se résignent les imaginations les plus exaltées.
Je crois que le ralliement des esprits et des cœurs, égarés encore, ne saurait tarder; et qu'il se fera, d'une part, sur le terrain de la solidarité sociale, et de l'autre, sur le terrain de la connaissance scientifique. J'entrevois la possibilité de lois morales, basées sur l'analyse de l'individu et de ses rapports avec ce qui l'entoure. Le cœur y trouvera son compte, parce qu'une telle orientation laisse à l'instinct altruiste son plein développement: en face d'une nature indifférente et qui le dépasse, l'homme semble avoir besoin de s'associer; et de ce besoin naissent des obligations morales. J'imagine aisément que ces devoirs, réglés par leur attraction les uns sur les autres, puissent établir, pour un temps, un bon équilibre social.
Pronostics vagues, simples jeux de l'esprit... Je le sais bien! (Souriant.) Mais les temps nouveaux n'ont plus de prophètes...
Ce qui est indubitable c'est que le terrain de ralliement ne sera plus métaphysique. Il nous faut en toutes choses, maintenant, une base expérimentale. Aux religions qui affirmaient connaître le sens de l'univers, succédera sans doute une philosophie positive et neutre, sans cesse alimentée par les découvertes scientifiques, essentiellement mobile, transitoire, modelée sur les mouvements de la réflexion humaine. On peut prévoir, en conséquence, qu'elle ne cessera d'élargir son horizon, et bien au delà des conceptions restreintes auxquelles nous devons actuellement borner notre vue. Remarquez déjà combien nous semble mesquin et incomplet le matérialisme sentimental d'il y a cinquante ans! Le nôtre, plus scientifique, tend déjà à s'élever au-dessus des visions qui satisfaisaient nos pères; le suivant s'en écartera davantage encore. La pensée pousse en plein inconnu son investigation; je crois que nous possédons déjà quelques bonnes méthodes de recherche... Mais que nous sommes loin de pouvoir deviner vers quels nouveaux aspects de la réalité notre élan nous mène!
Courte pause.
Son expression change. L'œil reprend sa dureté naturelle. La
voix redevient incisive.
Il baisse la tête, et palpe les feuillets épars devant lui.
Je me laisse entraîner par ces visions hypothétiques... L'heure avance, et je ne veux pas vous quitter sans avoir abordé le second point de cette causerie:
Quelle action chacun de nous peut-il avoir sur la réalisation plus ou moins rapide de ces espérances?
Cette action est immense! Pour ingrat que puisse paraître le rôle des hommes d'aujourd'hui, après ce coup d'œil complaisant vers l'avenir, il est capital, et nous ne saurions l'envisager avec trop de fermeté.
Nous sommes l'une de ces quelques générations, auxquelles incombe le soin d'opérer l'évolution scientifique: nous sommes l'une des minutes tragiques de la douloureuse agonie du passé.
Ah, mes amis, si l'on comprend quels abîmes d'angoisses morales représente chaque génération de consciences, écartelées comme sont tant des nôtres, entre ce qui a été et ce qui sera; si l'on songe que notre option plus ou moins vigoureuse, peut abréger ou prolonger la souffrance de ces milliers de sensibilités,—quelle lourde responsabilité pèse sur nous!
Eh bien, nous avons deux moyens d'agir: par notre attitude personnelle et par l'éducation de nos enfants...
Faisons ensemble notre examen de conscience, voulez-vous?
Combien d'entre nous, dont les convictions sont nettement opposées aux croyances religieuses, supportent néanmoins que la religion domine tous les actes graves de leur vie, depuis leur mariage, jusqu'à leur mort!
(Sombre.) Oui, je sais, je sais aussi bien que vous...—mieux que vous, peut-être!—tout ce que l'on peut dire pour excuser cette faiblesse, et quel morne supplice endure souvent l'homme libre qui croit devoir se soumettre à ces gestes rituels... Quels déchirements, quelles rancunes, quelles sourdes luttes entre une conscience qui voudrait être rigide, et tant de forces dissolvantes, les engagements de la tendresse, le respect d'autrui!... Mais il n'est pas moins vrai qu'il y a dans une semblable résignation une immoralité que rien, rien ne saurait légitimer! Aux heures troubles que traverse notre humanité, il n'est rien de plus grave qu'un acte de foi public, non seulement pour la dignité individuelle de celui qui l'accomplit, mais pour la répercussion illimitée qu'il peut avoir sur les irrésolutions voisines. La probité envers soi-même comme envers ceux qui nous regardent vivre, voilà, pour le moment, la plus certaine, la plus inflexible des règles morales. Et ceux qui transigent avec elle, qui, par l'incohérence de leur attitude, retardent, dans leur sphère, le cours de l'évolution commettent un crime social mille fois plus redoutable que tous les chagrins sentimentaux qu'ils auraient pu causer!
Plus impardonnable encore est leur faute, en ce qui concerne l'éducation de leurs fils.
L'esprit de l'enfant n'est pas capable de prévention: la notion du doute est le résultat d'une longue pratique des phénomènes; elle suppose l'expérience de l'erreur, une défiance de soi et de ses sensations, une défiance d'autrui. L'enfant est crédule, comme tout primitif; le sens du vraisemblable n'existe pas en lui: le miracle ne le surprend pas.
Le prêtre, à qui vous abandonnez cet esprit vierge, y marquera sans peine une empreinte ineffaçable. Il lui inspirera d'abord une crainte arbitraire de son dieu; puis il lui présentera les mystères de son culte, comme autant de vérités révélées, qui échappent et doivent échapper à l'entendement humain. Le prêtre affirme plus facilement qu'il ne prouve; l'enfant croit plus facilement qu'il ne raisonne: la concordance est parfaite... Le raisonnement est l'opposé de la foi; un cerveau que la foi a façonné, reste longtemps, sinon toujours inapte aux jugements critiques.
Et c'est l'esprit sans défense de cet enfant que vous allez confier, dès le plus jeune âge, à l'influence religieuse?
Il s'est levé, emporté par la fougue de cette indignation, où vibre un remords personnel.
C'est l'homme d'action: la polémique quotidienne lui a révélé sa puissance: il aime la lutte; si violent est son élan qu'il renverse parfois l'obstacle avant de l'avoir aperçu: une force qui se rue...
Quoi! L'Église nous maudit, elle lance l'anathème sur ce qui constitue les réalités les plus vivantes de notre existence; et c'est à elle que nous allons livrer nos enfants? Comment expliquer pareille aberration? Est-ce parce que nous gardons l'espoir secret qu'ils sauront bientôt se dégager de ces superstitions? Alors, comment qualifier cette hypocrisie?
Et puis, la grossière erreur de croire qu'en mûrissant, l'esprit secouera sans peine ces fumées! Ne vous rappelez-vous pas combien peut être tenace une foi d'enfant?... Hélas, l'homme que la religion a marqué dès l'enfance ne s'en débarrasse pas d'un simple mouvement d'épaule, comme d'un vêtement usé, devenu trop étroit! Les éléments religieux trouvent chez l'enfant un sol préparé par dix-huit siècles d'asservissement consenti; ils se mêlent inextricablement à tous les autres éléments de sa formation intellectuelle et morale. La dissociation, lorsqu'elle est possible, est longue, irrégulière, souvent incomplète, toujours douloureuse. Et combien sont-ils, ceux qui, dans les conditions actuelles de la vie, ont le loisir ou le courage de procéder à cette refonte totale de leur personnalité?
Encore ai-je jusqu'ici restreint la question: je n'ai envisagé ces dangers de l'enseignement religieux qu'à l'égard de l'individu. Mais ils menacent directement la Société. A notre époque, où les croyances religieuses sont partout ébranlées, il y a un véritable péril à laisser, dans l'âme des enfants, se souder les lois de la morale aux dogmes de la religion. Car, s'ils s'habituent à considérer ces règles de vie sociale comme autant d'ordres divins le jour probable où la certitude de Dieu vacillera dans leur esprit, tout en eux s'effondrera à la fois, et ils perdront du même coup leur direction morale.
Voilà donc, brièvement résumés, les risques que nous courons, lorsque nous agissons en pères insouciants ou trop faibles. Et sous quels principes retentissants masquerons-nous notre apathie?
Je vous entends... Nous proclamerons généreusement la neutralité!
Ah, notre devoir est difficile, je le sais. Mais ne soyons pas dupes des mots... Cette neutralité, nos adversaires ont beau nous reprocher de la violer souvent,—(est-il possible à un enseignement d'être strictement neutre?)—c'est nous seuls qu'elle entrave! Neutralité, cela veut dire aujourd'hui: effacement devant la propagande acharnée de l'Église.
Eh bien, cette situation fausse n'a que trop duré. Prenons franchement notre parti d'une lutte qui est inévitable, qui est la grande lutte de notre temps; et au lieu de la mener sourdement, acceptons-la au grand jour, avec des armes égales. Laissons les prêtres libres d'ouvrir des écoles et d'y enseigner que le monde a été créé de rien en six jours; que Jésus-Christ était le fils de Dieu-le-Père et d'une Vierge; et que son cadavre s'est échappé tout seul de son tombeau, trois jours après son ensevelissement, pour monter dans le Ciel, où il est assis, depuis lors, à la droite de Dieu! Mais soyons libres, nous aussi, d'ouvrir des écoles où nous aurons le droit de prouver, avec tout l'appui de la raison et de la science, sur quelles inqualifiables crédulités se fonde encore la foi catholique! Quand la vérité est libre et l'erreur aussi, ce n'est pas l'erreur qui triomphe! La liberté, oui, mais pas seulement pour l'abbé du catéchisme: la liberté pour la raison, la liberté pour l'enfant!
Il s'avance sur le bord de l'estrade, le visage dressé, les prunelles ardentes, les mains tendues.
Ah, mes amis, je voudrais terminer sur ce cri: la liberté pour l'enfant!
Je voudrais secouer toutes vos consciences, je voudrais surprendre dans vos regards le feu des résolutions nouvelles!
Souvenons-nous de ce que nous avons souffert pour extirper de nous le vieil homme... Souvenons-nous de cet incendie qui nous a dévasté... Souvenons-nous de nos terreurs nocturnes, de nos révoltes, de nos confessions désespérées... Souvenons-nous de nos d'angoisses et de nos agenouillements...
Pitié pour nos fils!
[1] Concile du Vatican Ch. IV.
La même année, quelques mois plus tard.
Barois hèle un fiacre, place de la Madeleine.
BAROIS.—Au Semeur, rue de l'Université.
Il claque la portière.
La voiture ne démarre pas. Coup de fouet; une ruade.
BAROIS.—Allons! je suis pressé...
Nouveau coup de fouet. Le cheval, une bête jeune et rétive, hésite, se cabre, lève les naseaux et part comme une flèche.
Il enfile la rue Royale, traverse d'un trait la place de la Concorde, et s'élance dans le boulevard Saint-Germain.
Quatre heures de l'après-midi. Circulation intense.
Le cocher, arcbouté sur son siège, incapable de maîtriser l'animal, parvient à le diriger, à grand'peine.
Un tramway poussif barre la route.
Pour le dépasser, l'homme lance sa voiture à gauche, sur les rails libres. Il n'a pas vu le tramway qui vient en sens inverse...
Impossible de ralentir... Impossible de passer entre les deux véhicules...
Barois, blême, se jette en arrière, contre les coussins. La
vision de son impuissance au fond de cette boîte, la certitude de
l'inévitable, pénètrent en lui, comme la foudre.
Il balbutie: «Je vous salue, Marie, pleine de grâces...»
Un fracas infernal de vitres pulvérisées..
Un choc mortel...
Du noir...
Plusieurs jours après.
Chez Barois, à la tombée du jour.
Woldsmuth, sur une chaise, près de la fenêtre, lit sans faire
un mouvement.
Barois est étendu sur son matelas, les jambes noyées jusqu'aux hanches dans du plâtre.
Il n'a recouvré sa pleine conscience que depuis quelques heures; et, pour la dixième fois, il reconstruit mentalement l'aventure:
—«Il y avait la place, si celui de droite n'avait pas accéléré...
«Ai-je eu le temps de sentir le frôlement de la mort? Je ne sais plus... J'ai eu peur, une peur atroce.. Et puis le hurlement des freins bloqués...»
Il sourit involontairement: entre la mort et lui, tout le bouillonnement de sa vie présente, reconquise!
—«Curieux, cette peur qu'on a de mourir... Comment peut-on craindre la suppression de toute pensée, de toute sensation, de toute souffrance? Craindre de ne plus être?
«Peut-être est-ce uniquement l'inconnu qui terrifie? C'est évidemment la seule sensation qui nous soit totalement nouvelle; personne n'a, dans son hérédité, la moindre expérience de ça...
«Et pourtant, un homme de science, qui a le temps de réfléchir quelques secondes, doit se résigner, sans beaucoup de peine. Quand on a bien compris que la vie n'est qu'une suite de transformations, pourquoi s'effrayer de celle-là? Ce n'est pas la première... Ce n'est vraisemblablement pas la dernière...
«Et puis, quand on a su employer son existence, quand on a lutté, quand on laisse derrière soi, qu'est-ce qu'on peut regretter?
«Je suis bien sûr, moi, de m'en aller, très calme...»
Soudain, son visage se contracte. Il reste épouvanté, anéanti.
Il vient de revivre la minute tragique, et, brutalement, il s'est rappelé le seul cri venu à ses lèvres:
«Je vous salue Marie...»
Une heure s'écoule.
Woldsmuth tourne ses pages, sans bouger.
Pascal apporte une lampe; il ferme les volets et s'approche de son maître; sa figure plate de Suisse, aux cheveux ras, aux yeux larges et clairs, est bonne à regarder. Mais Barois ne l'aperçoit pas; son regard est fixe; son cerveau fonctionne avec une activité déréglée; sa pensée est extraordinairement lucide, clarifiée comme l'atmosphère des montagnes après l'orage.
Enfin son visage, crispé par l'effort cérébral, se détend progressivement.
BAROIS.—Woldsmuth...
WOLDSMUTH (se levant avec précipitation).—Vous souffrez?
BAROIS (d'une voix brève).—Non. Ecoutez-moi. Asseyez-vous là.
WOLDSMUTH (qui lui a pris le poignet).—Vous avez un peu de fièvre... Restez tranquille, ne parlez pas.
BAROIS (dégageant son bras).—Asseyez-vous là, et écoutez-moi. (Avec colère.) Non, non, je veux parler! Je ne me rappelais pas tout... J'oubliais le plus beau...
Woldsmuth! Au moment où j'ai vu que j'étais perdu, savez-vous ce que j'ai fait?
Eh bien, j'ai prié la Sainte Vierge!
WOLDSMUTH (conciliant).—Ne pensez plus à tout ça... Il faut vous reposer...
BAROIS.—Non, je n'ai pas le délire. Je parle sérieusement, je veux que vous m'écoutiez. Je ne serai tranquille que lorsque j'aurai fait ce que je dois faire...
Woldsmuth s'assied.
BAROIS (les yeux brillants, les pommettes rouges).—A ce moment-là, moi, Jean Barois, je n'ai pensé à rien d'autre, j'ai été soulevé par un espoir fou, j'ai supplié de tout mon être la Sainte Vierge de faire un miracle!... (Il rit violemment.) Ah, mon cher, après ça, on peut être fier de son armature!
(Il redresse le buste, resté libre.) Alors, vous comprenez, je suis hanté par l'idée que ça pourrait recommencer... Ce soir, cette nuit, est-ce que je sais, maintenant? Je veux rédiger quelque chose, protester d'avance. Je ne serai pas tranquille avant.
WOLDSMUTH,—Oui, demain, je vous promets. Vous me dicterez...
BAROIS (avec une violence irrésistible).—Tout de suite, Woldsmuth, tout de suite, vous entendez! Je veux tout écrire moi-même, ce soir! Je ne pourrais pas dormir... (Se passant la main sur le front.) D'ailleurs, c'est là, tout prêt, je ne me fatiguerai pas... Le plus dur est fait...
Woldsmuth cède. Il soulève Barois sur deux oreillers, et lui donne son stylographe, du papier. Puis il reste debout, contre le lit.
Barois écrit, sans une hésitation, sans lever les yeux, d'une écriture droite et ferme.
«Ceci est mon testament.
«Ce que j'écris aujourd'hui, ayant dépassé la quarantaine, en pleine force et en plein équilibre intellectuel, doit, de toute évidence, prévaloir contre ce que je pourrai penser ou écrire à la fin de mon existence, lorsque je serai physiquement et moralement diminué par l'âge ou par la maladie. Je ne connais rien de plus poignant que l'attitude d'un vieillard, dont la vie toute entière a été employée au service d'une idée, et qui, dans l'affaiblissement final, blasphème ce qui a été sa raison de vivre, et renie lamentablement son passé.
«En songeant que l'effort de ma vie pourrait aboutir à une semblable trahison; en songeant au parti que ceux dont j'ai si ardemment combattu les mensonges et les empiètements, ne manqueraient pas de tirer d'une si lugubre victoire, tout mon être se révolte, et je proteste d'avance, avec l'énergie farouche de l'homme que je suis, de l'homme vivant que j'aurai été, contre les dénégations sans fondement, peut-être même contre la prière agonisante du déchet humain que je puis devenir. J'ai mérité de mourir debout, comme j'ai vécu, sans capituler, sans quêter de vaines espérances, sans craindre le retour aux lentes évolutions de la germination universelle.
«Je ne crois pas à l'âme humaine, substantielle et immortelle.
«Je ne crois pas que la matière s'oppose à l'esprit. L'âme est la somme des phénomènes psychiques, comme le corps est la somme des phénomènes organiques. L'âme est une résultante occasionnelle de la vie, une propriété de la matière vivante. Je ne vois aucune raison pour que l'énergie universelle qui produit le mouvement, la chaleur et la lumière, ne produise pas la pensée. Les fonctions physiologiques et les fonctions psychiques sont solidaires; et la pensée est une manifestation de la vie organique, au même titre que les autres fonctions du système nerveux. Je n'ai jamais constaté de la pensée hors de la matière, hors d'un corps en vie; je n'ai jamais rencontré qu'une substance unique, la substance vivante.
«Que nous l'appellions matière ou vie, je la crois éternelle: la vie a toujours
été et produira la vie éternellement. Mais je sais que ma personnalité
n'est qu'une agglomération de particules matérielles, dont la désagrégation
entraînera la mort totale.
«Je crois au déterminisme universel, et que notre dépendance est absolue.
«Tout évolue; tout réagit; la pierre et l'homme; il n'y a pas de matière inerte. Je n'ai donc aucun motif pour attribuer plus de liberté individuelle à mon activité que je n'en attribue aux transformations plus lentes d'un cristal.
«Ma vie résulte d'une lutte incessante entre mon organisme et le milieu où je baigne: j'agis donc, à chaque instant, selon mes réactions particulières, c'est-à-dire pour des raisons qui n'appartiennent qu'à moi seul: ce qui donne aux autres l'illusion que je suis libre de mes actes. Mais en aucun cas je n'agis librement: aucune de mes déterminations ne pourrait être différente de ce qu'elle est. Le libre arbitre équivaudrait au pouvoir d'accomplir un miracle, de dévier les rapports des causes aux effets. C'est une conception métaphysique, qui prouve simplement l'ignorance où nous avons été si longtemps, et où nous sommes encore, des lois auxquelles nous obéissons.
«Je nie donc que l'homme puisse en rien influer sur sa destinée.
«Le bien et le mal sont des distinctions arbitraires. Je concède qu'elles
ont une utilité pratique, tant que la notion de responsabilité, qui ne se
fonde sur rien de réel, sera nécessaire à l'échafaudage de notre organisation
sociale.
«Je crois que, si tous les phénomènes de la vie ne sont pas encore analysés,
ils le seront un jour.
«Quant aux causes premières de ces phénomènes, je crois quelles sont hors de notre plan de vision, et inaccessibles à nos recherches. L'homme, par suite de sa place limitée dans l'univers, être relatif et fini par essence, ne peut pas avoir la notion de l'absolu et de l'infini; il s'est forgé des mots pour exprimer ce qui n'est pas comme lui, mais il n'en est pas plus avancé: il est victime de son langage; ces mots ne correspondent, pour l'entendement humain, à aucune réalité précise. Elément d'un tout, il est naturel que l'ensemble lui échappe.
«Se révolter contre cette nécessité, c'est s'insurger contre les conditions planétaires de ce monde.
«J'estime donc qu'il est vain d'échafauder, pour expliquer l'inconnaissable, des hypothèses qui n'ont aucune base expérimentale. Il est temps que nous nous guérissions de notre délire métaphysique, et que nous renoncions enfin aux «pourquoi» sans réponse, que notre hérédité mystique nous incite encore à poser.
«L'homme a, devant lui, un champ d'observation pratiquement illimité. Peu à peu, la science reculera si loin les bornes de ce qui n'est pas constatable, que si l'homme s'employait à comprendre tout le réel qui est à sa portée, il n'aurait plus le temps de gémir sur ce qui échappe irrémédiablement à ses facultés.
«Je suis certain que la science, en apprenant aux hommes à savoir ignorer, procurera à leurs consciences un équilibre qu'aucune foi n'a jamais su leur offrir.
Jean Barois.»
D'une main lourde, il achève lentement sa signature.
Puis sa volonté tendue se rompt. Sa face congestionnée devient brusquement livide. Il se renverse dans les bras de Woldsmuth.
Les feuillets s'éparpillent sur les draps.
Woldsmuth, d'une voix anxieuse, appelle Pascal. Mais déjà
Barois soulève les paupières, et sourit aux deux hommes.
Quelques instants plus tard, sa respiration régulière révèle un
profond et calme sommeil.
Cinq ans plus tard.
Un matin.
Barois achève de déjeuner.
PASCAL.—Il y a là un abbé, qui voudrait voir Monsieur.
BAROIS.—Un abbé?
PASCAL.—Il n'a pas voulu dire son nom.
Barois entre dans son cabinet.
Un prêtre âgé, debout à contre-jour: l'abbé Joziers.
L'ABBÉ.—Je ne me suis pas fait nommer, je n'étais pas sûr d'être reçu... (Il rencontre le regard joyeux de Barois, et baisse la tête.) Bonjour, Jean.
Depuis plus de dix ans, aucune voix amie ne l'a appelé «Jean»... Ses yeux s'emplissent de larmes; il tend les mains. L'abbé les saisit.
Ils sont un instant l'un contre l'autre sans parler.
L'abbé Joziers: la soixantaine.
Le corps, maigre et long, est demeuré alerte. Mais le visage est d'un vieillard: les cheveux sont tout gris; la peau est jaune, fripée; aux coins des lèvres, deux entailles, par où les joues semblent s'être vidées de leur chair.
Barois, familièrement, avance un siège. L'abbé s'y assied avec réserve.
Barois aussi a changé: il a maigri; il porte ses cheveux emmêlés sur le front; le regard est plus pensif; la moustache noire, striée de blanc, masque maintenant la révolte de la bouche.
L'ABBÉ.—Je ne viens pas en ami, vous vous en doutez bien... Je viens, parce qu'on me l'a demandé, et qu'il n'y avait personne d'autre pour faire cette démarche...
Vous devinez sans doute pourquoi?
Barois secoue négativement la tête; sa bonne foi est évidente.
L'abbé était venu, indigné; et, devant ce regard loyal, il se sent incliné à plus d'indulgence: «C'est un irresponsable...» Mais il reprend son rôle; et l'affection ancienne redescend au fond de son cœur.
L'ABBÉ (agressif).—-Vous avez récemment fait une leçon publique, je ne sais à quelle occasion, sous ce titre: Documents psychologiques pour l'évolution contemporaine de la foi.
BAROIS (intrigué).—Oui.
L'ABBÉ.—Vous y êtes délibérément sorti du domaine des idées générales, pour donner des détails ... dont le caractère autobiographique est manifeste. Les fragments que j'ai dû lire, font allusion à des circonstances de votre jeunesse, de votre mariage ... qui y sont étalées ... avec une absence de ... respect...
BAROIS (sèchement).—Vous allez un peu loin. Les détails dont vous parlez sont anonymes et présentés sous une forme scientifique, qui écarte toute autre interprétation. J'ai étudié un grand nombre de cas psychologiques, dont une partie m'était fournie par des correspondants, médecins en province, et dont quelques autres, je le reconnais, m'étaient personnels...
L'ABBÉ (haussant le ton).—C'est là où vous vous trompez, Jean. Ces détails n'appartiennent pas à vous seul. (Amèrement.) J'ai eu la douleur de perdre, à votre sujet, bien des illusions déjà. Mais je ne croyais pas qu'il me faudrait un jour vous rappeler à votre plus élémentaire dignité d'homme. Il y a des analyses intimes dont le secret est inviolable. On n'expose pas à la curiosité d'un public, quel qu'il soit, pour quelque motif que ce soit, les sentiments d'une femme, qui est et qui reste la vôtre, qui est la mère de votre enfant!
Barois reçoit le coup au visage, sans un geste de protestation.
Il devient pourpre.
Des souvenirs s'abattent sur lui, en rafale: au fond de sa conscience, un passé, qui n'était qu'enseveli, ressuscite.
L'ABBÉ.—Un journal franc-maçon de l'Oise a relevé dans vos paroles ce qui pouvait blesser Mme Barois, et...
Barois n'écoute pas. Il regarde l'abbé avec une expression concentrée, lointaine. Blesser sa femme?... Pas une seule fois, depuis leur séparation, l'idée ne lui est venue qu'elle pût encore être blessée par lui!
Il a besoin de se ressaisir. Il gagne sa table de travail, comme un refuge, et s'assied lourdement, les mains crispées sur les bras de son fauteuil, son fauteuil quotidien.
BAROIS.—Oui, je comprends maintenant... Mais c'est si involontaire!
Le regard de l'abbé est incrédule.
BAROIS (vivement).—Vous ne le croyez pas? Ah, rendez-vous compte: je vis ici, seul, depuis plus de dix ans; je ne vois personne; quelques amis, des collaborateurs... Je suis terriblement occupé... Je n'ai pas le temps de regarder en arrière; et puis, ce n'est pas dans ma nature... Je n'ai jamais aucune nouvelle de Buis: une fois par an, un clerc de notaire m'avertit que la pension a été versée: et c'est tout.
L'abbé le considère avec stupéfaction.
BAROIS.—Je vous étonne? c'est la pure vérité. Le passé est le passé, j'en suis sorti; il est loin, il est mort pour moi; je n'y pense jamais, jamais.
Quand j'ai préparé le cours en question, j'ai cherché avant tout des documents authentiques, exacts. J'en ai pris dans ma propre expérience, sans hésiter. Evidemment, ces souvenirs ne m'appartenaient pas entièrement... C'est vrai...
(S'interrogeant.) Je me suis peut-être conduit comme un goujat...
Il fixe le sol.
Ses mains ont un imperceptible tremblement.
Ah, je suis très contrarié, d'avoir été, sans le vouloir, la cause... (Spontanément.) Expliquez-lui, dites-lui bien tout ce que je...
L'ABBÉ (désarmé par tant d'inconscience).—Non, Jean, il vaut mieux que je ne répète pas tout ce que vous venez de me dire là...
Un silence.
L'abbé prend son chapeau.
BAROIS.—Vous n'êtes pas pressé... (Il hésite.) Donnez-moi quelques nouvelles. Est-ce que... Cécile vit toujours chez sa mère?
Le visage du prêtre reste fermé; il fait un signe affirmatif.
BAROIS.—Et elles mènent toujours la même vie? Les patronages, les ouvroirs?
L'ABBÉ (désapprobateur).—Mme Barois donne aux œuvres le temps qu'elle ne consacre pas à sa fille.
BAROIS.—Ah, oui, l'enfant ... qui a maintenant ... voyons ... treize ans...? Hein? (Naïvement.) Comment est-elle, cette petite? A-t-elle une bonne santé?
Il croise le regard de l'abbé; sa phrase s'achève dans un sourire gêné.
BAROIS.—Je vous parais être un monstre? Que voulez-vous... (Geste brutal.) J'ai rayé tout ça! C'est passé, c'est fini! Ma vie, elle est toute ailleurs, et elle me passionne exclusivement! Pourquoi feindrais-je? Souvenez-vous: cette petite, j'étais déjà parti en Angleterre, quand elle est née... Elle ne m'intéresse vraiment à aucun titre, elle n'a rien de moi...
L'ABBÉ (qui le considère soigneusement).—Si. J'en suis même frappé depuis ce matin: elle vous ressemble.
BAROIS (la voix changée).—Elle me ressemble?
L'ABBÉ.—L'expression générale... Le regard... Le menton...
Nouveau silence.
L'abbé se lève.
Il s'en va, mécontent de Barois, mécontent de lui-même, gardant pour lui ce qu'il eût aimé dire, emportant de cette visite une rancœur nouvelle.
BAROIS (qui l'accompagne vers la porte).—Et ... vous habitez toujours à Buis?
L'ABBÉ.—Monseigneur m'a confié la cure de Buis, il y aura quatre ans à la Fête-Dieu...
BAROIS.—Je ne savais pas.
Ils ont atteint le vestibule.
L'ABBÉ (avec une soudaine rancune).—Ah, nous sommes cruellement éprouvés, là-bas, par votre nouvelle loi des Congrégations!
BAROIS (souriant).—Ce n'est pas parce que je m'obstine à réclamer la liberté de la pensée, ou parce que j'ai combattu l'injustice, que je suis solidaire de tout ce qui se fait en France...
L'abbé qui avait déjà entr'ouvert la porte du palier, la referme doucement, et se retourne.
BAROIS.—Si vous suiviez, même de loin, le périodique que je dirige ... (L'abbé laisse échapper un geste de répugnance qui provoque un nouveau sourire de Barois.) ... vous sauriez que je n'ai cessé d'appliquer à l'Église les principes qui nous animaient pendant l'Affaire: exactement les mêmes. (Mélancolique.) Nous y avons perdu, d'ailleurs, bien des abonnés... Peu importe. J'ai protesté de toutes mes forces, en voyant le gouvernement s'appuyer sur les dreyfusards de la nouvelle couche, pour trahir le vote de la Chambre et faire exécuter la loi dans un tout autre esprit que celui où elle avait été conçue.
L'ABBÉ (froidement).—J'enregistre avec satisfaction ce que vous me dites là... Mais si vous apercevez combien ce qui se fait aujourd'hui en France est vil, je déplore que vous n'en voyiez pas la cause et combien lourde est la responsabilité qui vous en incombe, à vous, et à vos amis... (Avec gravité.) Au revoir.
BAROIS (serrant sa main).—Cette rencontre m'a fait un grand plaisir, je l'avoue... Quoique je regrette profondément ce qui vous a amené: dites-le à ... à Buis...
(Avec un sourire forcé.) D'ailleurs, soyez rassuré pour l'avenir... Oui, il paraît que je me détraque ... (la main sur le cœur) ... par là... Défense de parler en public, ménagements... Un tas de misères...
L'ABBÉ (affectueux).—Vraiment? Mais rien de grave?
BAROIS.—Non, si je suit raisonnable.
L'ABBÉ (ardemment).—Il faut l'être! Votre vie n'est pas terminée, elle ne peut pas finir comme ça...
BAROIS (coupant court).—J'ai plus que jamais la certitude d'être dans ma voie, et de la suivre, comme je dois!
L'ABBÉ (hochant la tête).—Au revoir.
A Auteuil.
Une après-midi de printemps.
Luce est assis dans son jardin à l'ombre des marronniers. Des taches de soleil tremblent sur son front et sur sa barbe blanchie. Reposé et triste, il regarde devant lui. Sur ses genoux, un journal déplié.
En caractère gras:
LES CENDRES DE ZOLA AU PANTHÉON
CORTÈGE OFFICIEL.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET LES MINISTRES.
LES MESURES DE POLICE.
LA BAGARRE.
Tout à coup son visage s'éclaire: à travers les arbustes, Barois vient vers lui.
Leurs mains s'étreignent.
Pas d'explications superflues...
Ils s'asseyent, en silence; ils sont résolus à ne pas épancher leurs cœurs. Mais la même pensée se croise dans leurs regards: ce défilé théâtral, dont ils ont été exclus, cette parade de foire pour glorifier leur grand Zola, cet accaparement d'un nom qui signifie loyauté et justice, pour couvrir une politique d'intérêt!
LUCE (mélancolie profonde).—Le beau soleil, n'est-ce pas?
Barois approuve de la tête, longuement.
Peu importent les mots...
Quelques secondes passent.
Puis Luce fait un nouvel effort.
LUCE.—Et vous, cher ami, comment va?
BAROIS.—Pas mal. Depuis que j'ai interrompu mes cours, je vais même bien.
LUCE.—Et le Semeur?
Barois regarde Luce; rire silencieux.
BAROIS.—Vous rappelez-vous votre surprise quand vous avez appris les désabonnements, après ma campagne contre les exagérations de l'antimilitarisme?
LUCE.—Eh bien?
BAROIS.—Eh bien, tenez, j'ai voulu tenter une épreuve... (Il rit à nouveau, et tout à coup s'arrête, comme s'il craignait de laisser monter un sanglot.) J'ai choisi vingt des nôtres, vingt combattants de la première heure; depuis trois mois j'ai cessé de leur envoyer le Semeur. (Articulant.) Pas un seul ne s'en est aperçu: je n'ai pas reçu une lettre de réclamation!
(Une pause.) Tenez, voilà ma liste.
Mais Luce repousse le papier de la main.
BAROIS (quelques allées et venues sous l'ombrage des arbres).—Bah... Ce ne serait rien, si l'on se sentait toujours aussi combattif, aussi jeune...
LUCE (spontanément).—Vous, Barois?
BAROIS (fierté involontaire; souriant).—Je vous remercie...
Mais c'est exact pourtant: je remarque depuis plusieurs mois des symptômes qui me préoccupent... Des heures de fatigue, des tendances à devenir sceptique, trop indulgent... (Avec lassitude.) Il y a des soirs où je me sens terriblement seul...
LUCE (adroitement).—Vous n'êtes pas seul quand vous êtes à votre table de travail!
BAROIS (se redressant).—Ça, c'est vrai! J'ai tant à faire encore!
Il passe ses doigts à travers ses cheveux, et fait quelques pas. Son regard se fixe, s'éteint.
BAROIS.—Oui, mais tenez, quelque chose qui est mauvais signe: maintenant, quand j'ai un prétexte à quitter mon bureau, une démarche, une course, en bien, au lieu d'enrager, comme autrefois, je ... je suis plutôt... Hein? Vous n'éprouvez pas encore ça, vous?...
LUCE (amusé).—Non.
BAROIS.—Et puis, par moments, j'ai l'impression que la part des souvenirs devient plus importante que celle des acquisitions nouvelles... Je résiste, je m'astreins à lire tout ce qui paraît. Mais, malgré tout, je me sens moins souple, comme engourdi par un poids mort..
LUCE.—L'expérience!
BAROIS (sérieux).—Peut-être... Le sentiment qu'on serait encore apte à tout comprendre, et que pourtant, on est un peu entravé, physiquement... Une sorte d'insoumission de l'organisme... Très pénible.
Sourire incrédule de Luce.
BAROIS (sans répondre à ce sourire).—Pendant longtemps on croit que la vie est une ligne droite, dont les deux bouts s'enfoncent à perte de vue aux deux extrémités de l'horizon: et puis, peu à peu, on découvre que la ligne est coupée, et qu'elle se courbe, et que les bouts se rapprochent, se rejoignent... L'anneau va se boucler... (Souriant à son tour.) On va devenir un vieux qui ne sait plus que tourner dans son cercle!
LUCE.—Oh, oh, oh...
(Brusquement il se dresse.) Ah, les braves cœurs, les voilà tous!
Au fond de la cour, trois hommes surgissent de l'ombre de la voûte: Breil-Zoeger, Cresteil d'Allize et Woldsmuth.
LUCE (bas, vivement).—Dites-moi... Est-ce que Cresteil a perdu quelqu'un de proche?
BAROIS (de même).—Personne ne sait. Il est en grand deuil depuis quinze jours.
Effusions silencieuses.
LUCE (simplement, après quelques secondes de gêne).—L'un de vous y a-t-il été?
ZOEGER.—Non.
CRESTEIL (de sa voix rauque).—Ils ont bien senti qu'il fallait choisir: eux, ou nous!
Il est plus décharné que jamais. Le front s'est dégarni, exagérant le port hautain de sa tête. Sa peau, collée sur les méplats du crâne et sur la courbe du nez, a l'aspect du buis.
WOLDSMUTH (exprimant la pensée de tous).—Quand on se rappelle les obsèques de Zola, les vraies!...
LUCE.—Nous n'étions, autour de ce mort, que des cœurs purs...
ZOEGER (ricanant).—Nous n'avions pas besoin de police pour protéger les ministres!
Le noir de ses yeux est dur comme une pierre taillée. Sa maladie de foie le ronge, sans le vaincre: il la porte au flanc comme un cilice.
BAROIS.—Et, lorsqu'Anatole France s'est levé, vous souvenez-vous de ce frisson, de cette vaillance qui nous a saisis? Quand il a dit: «Je ne lirai que ce qu'il faut dire, mais je dirai tout ce qu'il faut dire...» Et que la France était la patrie de la Justice...
WOLDSMUTH (rassemblant ses souvenirs).—Attendez...
«Il n'y a qu'un pays au monde dans lequel ces grandes choses pouvaient s'accomplir... Qu'elle est belle, cette âme de la France, qui, dans les siècles passés, enseigna le Droit à l'Europe et au monde!...»
Ils écoutent, les yeux sur sa broussaille qui grisonne, et où luisent deux disques de verre fumé.
Cresteil rompt le charme.
CRESTEIL (rire amer).—Ah, oui, tout était beau, c'était du cristal!
Et qu'en est-il résulté? Hein? Nous avons crevé l'abcès: nous comptions sur la guérison: et maintenant, c'est la gangrène!
Luce fait un geste de la main.
Breil-Zoeger hausse les épaules.
CRESTEIL.—En avons-nous assez vu!... La gabegie politique, les abus d'autorité, le mercantilisme partout! Les spoliations anticléricales, le contre-sens antimilitariste... Enfin,—faillite générale!
ZOEGER (sèchement).—La politique d'aujourd'hui, je ne la défends pas. Mais elle n'est pas pire, en tout cas, que celle qu'on faisait avant l'Affaire!
BAROIS (après un instant de perplexité).—Ma foi, je ne sais pas...
LUCE (vivement).—Ah, ne regrettons rien, Barois, ne regrettons rien!
ZOEGER.—Si le gouvernement d'alors avait été digne de son poste, ce n'est pas nous qui eussions fait la lumière, c'est lui!
LUCE.—Vous ne regardez que les choses mauvaises, mon pauvre Cresteil. Vous ne voyez pas les bonnes qui se préparent. La République porte en elle-même une vertu précieuse: elle est le seul régime perfectible par nature. Laissez la démocratie s'organiser à nouveau...
CRESTEIL.—Il est tout de même inadmissible que ceux dont tous les actes politiques trahissent nos intentions, revendiquent effrontément notre héritage! Rappelez-vous l'histoire des fiches! Ceux qui s'étaient permis d'organiser officiellement la délation dans l'armée, n'ont pas hésité, devant la Chambre, à s'abriter derrière nos principes!
ZOEGER.—Verbiage de tribune!
BAROIS (tristement).—Et puis, c'est une loi historique: les vainqueurs prennent immédiatement les vices des vaincus. On dirait qu'une immoralité spéciale et contagieuse suinte directement du pouvoir.
CRESTEIL (sombre).—Non. La vérité, c'est que tout ce qui a été touché par cette affaire, tout ce qui est né d'elle, est resté empoisonné.
LUCE (sur un ton de reproche).—Cresteil...
CRESTEIL.—Pourquoi nier l'évidence? Depuis le dossier secret de 94, jusqu'au dessaisissement de la Chambre Criminelle, en passant par le procès Esterhazy et par le procès Zola, la route est jalonnée d'irrégularités!
(Avec exaspération.) Et ça n'est pas le plus fort! Quand nous avons abouti à la condamnation de Rennes,—et puis, à la grâce... (Il paraît prendre plaisir à rouvrir toutes les blessures)... ceux dont l'activité n'était pas détruite jusque dans ses racines, gardaient, malgré tout, l'espérance d'un triomphe final. Mais c'était encore trop pour notre destinée de laissés-pour-compte! Il fallait que nous fussions irrémédiablement trahis! Alors, tout le sens de l'Affaire, tout ce pour quoi nous avions sacrifié notre vigueur, notre repos, tout a sombré dans l'acceptation d'une illégalité définitive: la cassation sans renvoi d'un tribunal qui n'avait pas le droit de la prononcer, et qui n'a pas reculé, pour faire la justice, devant le viol flagrant de la Loi! Ah, ah...
LUCE.—Cresteil...
ZOEGER (de sa voix atone et sarcastique).—Estimez-vous qu'un nouveau conseil de sept officiers quelconques, improvisés juges, eût été plus qualifié que la Cour de Cassation, la plus haute juridiction civile?
Barois croise le regard de Luce et détourne le sien sans prendre la parole.
CRESTEIL.—Ce n'est pas ainsi que la question doit être posée, Zoeger. On a raconté que la Cour de Cassation était cuisinée depuis deux ans,—et il est positif qu'en ces deux ans, bien des sièges ont reçu de nouveaux titulaires... Mais ce n'est pas à ces points de vue-là que je désire me placer.
(Avec une élégance dédaigneuse.) Je dis seulement qu'il y avait une façon plus propre de conclure, sans obtenir, en dernier ressort, l'assentiment de juges civils, après d'interminables ergotages de juristes et de scribes autour de l'article 445. Je dis que pour annuler l'injustice de Rennes, il fallait le verdict éclatant d'une autre juridiction militaire. Et je dis que l'Affaire en est restée, pour toujours, comme une plaie qui suppure, et qui ne pourra pas se fermer!
BAROIS (sans conviction).—C'était tout recommencer.
CRESTEIL.—Tant pis!
BAROIS.—Les forces humaines ont des limites.
CRESTEIL.—Barois, vous pensez exactement comme moi, à ce sujet, vous l'avez assez souvent répété dans votre Semeur!
Barois baisse la tête en souriant.
CRESTEIL.—D'autant plus que l'occasion d'un nouveau conseil de guerre était magnifique!... Les généraux, ceux-là mêmes dont les réticences avaient emporté la condamnation de 99, venaient de démentir formellement, à l'enquête de la Chambre Criminelle, l'histoire du bordereau annoté par le Kaiser! Il eût donc suffi de leur faire répéter leurs dépositions devant les juges-officiers, et l'acquittement était assuré!
LUCE.—A quoi sert de récriminer? Votre pessimisme est excessif, Cresteil,—même aujourd'hui!
BAROIS (se levant).—Nous avons l'air d'être venus là tout exprès, pour étaler les déceptions de nos cinquantaines...
ZOEGER (montrant le journal déplié à terre; rire bref).—C'est notre jour des cendres...
Sourires.
Barois s'approche de Luce pour prendre congé.
CRESTEIL (brusque, à Barois).—Vous rentrez par le Bois? Je vous accompagne...
LUCE.—Voyez-vous, le grand mal, c'est que le peuple français n'est pas un peuple moral: et pourquoi? parce que, depuis des siècles, la politique et l'intérêt priment le droit. C'est une nouvelle éducation à faire... Notre but n'est pas atteint, c'est vrai, mais il n'est pas manqué pour ça, il est en voie de réalisation. (Serrant la main de Cresteil.) Vous aurez beau dire, Cresteil, c'est un fameux siècle, celui qui a commencé par la Révolution et qui finit par l'Affaire!
CRESTEIL (avec une sombre désinvolture).—C'est aussi celui de la fièvre, des utopies et des incertitudes, des échafaudages hâtifs et des malfaçons. Nous ne savons pas. On l'appellera peut-être le siècle de la camelote!
Une allée du Bois.
Fin de journée, très douce.
Cresteil, énervé, presse le pas.
CRESTEIL (sur un ton différent, confidentiel).—Quand je me retrouve avec les autres, vous avez vu, je m'emballe, j'ai des airs convaincus... Mais quand je suis rendu à moi-même, ah la la! Non, mon cher, c'est fini, je ne peux plus me payer de mots... J'en ai trop vu, je sais trop bien ce qu'est la vie, la foire que c'est, la vie!... Le bien, le devoir, la vertu, allons donc! Des déguisements de nos instincts égoïstes, notre seule réalité. Ah, fantoches!
BAROIS (ému).—Voyons, voyons, mais c'est pitoyable, ce que vous me racontez-là!
CRESTEIL (durement).—On est comme on est. Encore une chose que je n'ai bien comprise que depuis peu. Je n'ai pas demandé à vivre, ni surtout à vivre la vie que j'ai vécue...
BAROIS (en dernier recours).—Vous ne travaillez donc pas en ce moment?
CRESTEIL (éclatant de rire).—Oui, mes livres! Je suis un beau type de raté, hein?... L'art! C'est comme la Justice et comme la Vérité, c'est un de ces mots qui ne représentent rien, qui sont plus creux qu'une noix véreuse, et pour lesquels je me suis enivré d'abnégation! L'Art! L'homme, cet infirme, veut ajouter à la nature, il tient à créer! Créer! Lui! C'est du dernier grotesque!...
Barois écoute, le cœur terré, comme on écoute la rafale, les arbres tordus, tous les gémissements de la tempête...
CRESTEIL.—Savez-vous, mon cher? Si j'avais mon existence à recommencer, j'anéantirais en moi toute ambition, je me «payerais ma tête», jusqu'à ce que j'aie bien renoncé à croire en quoi que ce soit! Je m'appliquerais à n'aimer la vie que sous ses formes minimes,—les seules qui ne contiennent pas trop d'amertume à avaler en une fois... Ramasser le bonheur par miettes... C'est la seule chance que l'homme ait d'en récolter un peu ... avant de mourir ... puisqu'il faut toujours en arriver là ... au trou...
Il a prononcé les derniers mots avec une angoisse poignante. Barois l'examine, surpris.
Cresteil s'est tu. Il fait quelques pas, et tout à coup, comme s'il était à bout de souffle et de volonté, il étend le bras vers une allée transversale.
CRESTEIL.—Je vous quitte, je vais par là...
Barois le regarde fuir, dans son deuil, dégingandé, le dos rond, les basques au vent.
«A Monsieur l'Abbé Joziers
«Curé de Buis-la-Dame (Oise).
«26 décembre.
«Mon cher ami,
«Maître Mougin, sur la demande de Madame Barois, vient de me rappeler, qu'au terme de nos conventions, je suis en droit d'exiger que ma fille passe un an auprès de moi, puisqu'elle atteint dans quelques semaines sa dix-huitième année. Je veux éviter que ma réponse ne soit transmise par voie de notaire: ai-je eu tort de penser que vous ne refuseriez pas ce rôle d'intermédiaire?
«Je vous serais donc reconnaissant de remercier Madame Barois de l'initiative qu'elle a prise, et de lui exprimer, sous la forme que vous jugerez la meilleure, les raisons qui me font décliner cette offre.
«Ces raisons, je vous les donnerai avec ma sincérité coutumière.
«Au moment de notre rupture, j'ai voulu me réserver la possibilité d'intervenir, à un moment donné, dans l'éducation de ma fille. Mais les circonstances ont bien changé. Depuis dix-huit ans, vous le savez, je n'ai revu ni ma femme, ni l'enfant. J'abuserais vraiment de mon droit, en réclamant aujourd'hui la moindre parcelle d'une existence dans laquelle je n'ai tenu jusqu'ici et ne tiendrai jamais aucune place. D'ailleurs, pour vous dire toute ma pensée, les sentiments que ma fille doit nécessairement éprouver pour ce Père inconnu, lui rendraient, comme à moi-même, un pareil rapprochement intolérable.
«Il n'y a donc pas lieu de changer quoi que ce soit à nos situations respectives, et j'ai compté sur vous pour délier ma femme de tout engagement à ce sujet.
«Je vous prie de croire à ma gratitude, et d'accepter l'assurance de ma sympathie dévouée.
Barois.»
Quelques jours après. Neuf heures du matin.
Barois, levé tard, achève en flânant sa toilette.
Il n'a rien à faire: c'est le 1er janvier.
Pascal apporte un paquet de cartes et de lettres.
PASCAL.—Monsieur dînera-t-il ici?
Barois s'est approché du plateau et trie le courrier.
BAROIS.—Non, non... disposez de votre soirée. (Coup d'œil hésitant.) Vous devez avoir de la famille, des amis?
PASCAL (placide).—Ma foi, non: si Monsieur n'est pas là, je dînerai de bonne heure et j'irai au cinéma.
BAROIS (le rappelant).—Eh bien, alors, Pascal, préparez-moi donc à dîner ici... Hein? N'importe quoi, à l'heure que vous voudrez: je ne bouge pas de la journée. Les restaurants sont si bêtes, les jours comme aujourd'hui...
Il ouvre quelques lettres. Puis il aperçoit le timbre de Buis, et, sans hâte, déchire l'enveloppe.
«Presbytère de Buis-la-Dame.
«31 décembre.
«Mon cher Jean,
«Je serai toujours prêt, en souvenir du passé, à être votre porte-paroles.
«Je me suis acquitté de la présente tâche avec d'autant plus de zèle, que toute autre solution m'eût semblé singulièrement inconsidérée. Votre décision épargne à Madame Barois de nouvelles épreuves, et c'est justice: la pauvre femme mérite d'être un peu récompensée du digne renoncement de sa vie.
«Je croirais cependant manquer envers vous d'une certaine loyauté, en vous cachant que c'est Marie qui a obligé sa mère à vous faire écrire par Maître Mougin. Vous voyez à quel point les sentiments filiaux que vous prêtez à la chère enfant, sont différents de ceux qu'une éducation profondément chrétienne a su développer en elle.
«Je vous serre la main,
M. L. Joziers, pr.»
Barois est debout contre la fenêtre; il lui faut un instant pour se ressaisir. Il regarde l'enveloppe, puis la chambre, puis la rue.
Il reprend la lettre, posément, cherchant de bonne foi à concentrer sa pensée:
—«Pourquoi Joziers dit-il: Je manquerais d'une certaine loyauté.....? C'est qu'il a bien le sentiment que ce dernier paragraphe change du tout au tout mon point de vue.....
«Si c'était une exigence de ma part, un caprice, je dirais non... Ou bien, si j'avais eu le dessein d'avoir sur elle une influence secrète, je dirais non... Mais ce n'est pas ça: c'est elle qui...
«Alors? Pourquoi pas?»
Il sourit.
—«C'est tout de même curieux que ce soit elle qui ait tenu
à me rappeler l'échéance. Et malgré sa mère, en somme, puisque
mon refus épargne à Cécile de nouvelles épreuves? Cécile a
donc très peur que je ne renonce pas à nos conventions; et la
petite a dû avoir à lutter ferme... Il faut qu'elle y tienne bien!
«Du diable, par exemple, si je devine pourquoi! Curiosité? Invraisemblable... Elle doit avoir très peur de quitter Buis, sa mère, sa grand'mère, ses habitudes; et surtout pour venir ici! Qu'est-ce qui s'est passé dans cette tête de dix-huit ans?
«En tous cas, il a fallu une volonté extraordinaire pour obtenir le consentement de Cécile. Ça prouve qu'elle a de l'énergie, des idées à elle... C'est bien étrange... Joziers m'a laissé entendre, autrefois, qu'elle me ressemblait un peu... Nous avons peut-être aussi des traits de caractère communs, la même ténacité? Qui sait? Peut-être certaines tournures d'esprit qui sont les mêmes?... Elle cherche peut-être à comprendre, à reviser ce qu'on lui a appris?... Elle se débat peut-être là-bas, comme moi jadis?... Elle vient peut-être vers moi, pour respirer plus librement, pour s'affranchir?»
Il s'attarde complaisamment; il aperçoit en lui un foyer de tendresse inemployée qu'il ignorait...
Puis il hausse les épaules.
—Mais non... Les sentiments que l'éducation chrétienne a su
développer en elle..... Ah, je divague, ils la tiennent bien!»
Un geste d'impatience.
—«Bon... Je souffre maintenant à l'idée que cette gamine
inconnue est de l'autre côté de la barricade! Et il y a dix minutes,
rien ne m'était plus indifférent que sa piété! Je deviens
stupide..... (Souriant.) C'est qu'il n'y a pas plus de dix minutes
qu'elle existe pour moi, qu'elle a manifesté son existence, qu'elle
est autre chose qu'un nom ... Marie.....»
Il déplie la lettre pour la troisième fois.
Et à mesure qu'il la relit, il sent sa réflexion impuissante contre la décision irrévocable que chaque mot de cette lettre incruste davantage en lui.
Un après-midi de février.
Pascal, entendant la clé dans la serrure, s'avance vers la porte.
BAROIS.—Me voilà, Pascal: tout est prêt?
Pascal sourit familièrement.
Barois fait le tour de son cabinet, comme s'il passait l'inspection. Rien ne traîne; le bureau seul est en désordre. Sur la cheminée, L'Esclave enchaîné de Michel-Ange s'épuise toujours en son effort stérile.
Il gagne hâtivement l'autre partie de l'appartement: deux chambres, communiquant par un cabinet de toilette; la plus grande est tendue de toile claire, et meublée à neuf.
Regard d'ensemble angoissé et satisfait.
Il redresse un abat-jour, tâte le radiateur, consulte sa montre, et retourne dans son cabinet.
BAROIS.—Pascal, nous avons oublié quelque chose!... Vous allez descendre quatre à quatre... Une belle botte de fleurs blanches... (Montrant la grosseur.) Et blanches, vous entendez?
Cinq minutes plus tard.
On a sonné.
Barois, qui errait de long en large, pâlit.
—«Et cet imbécile n'est pas revenu!»
Il se dirige vers le vestibule, hésite, et ouvre la porte.
L'abbé Joziers entre le premier, précédant une jeune fille et une femme de cinquante ans, simplement mise.
BAROIS.—Mon domestique est justement..... (Poussant la porte de son cabinet.) Entrez donc...
L'abbé passe, puis la jeune fille.
Barois s'apprête à les suivre; mais la femme de chambre marche résolument dans les pas de sa maîtresse, et frôle Barois, sans s'effacer.
L'ABBÉ (gravement).—Bonjour Jean. Je vous amène votre fille... Et Julie, la fidèle Julie... (Geste ecclésiastique.) Deux de mes meilleures paroissiennes...
Barois ébauche un mouvement vers Marie, qui se tient droite, le visage empourpré. Elle est petite, brune, fraîche de teint.. Une image s'impose à lui, aigüe: Cécile à vingt ans!
Elle avance une main qu'il serre.
Puis, un court silence.
La porte s'ouvre. Pascal paraît, un bouquet à la main. Il s'arrête,
et, tranquillement, sourit.
BAROIS.—Je l'avais envoyé chercher quelques fleurs... (Vers Marie.) C'est si sévère, un appartement d'homme...
Ils sont debout, les uns devant les autres, inertes. Marie baisse à demi les paupières. Julie ne quitte pas Barois des yeux. L'abbé promène un regard désapprobateur.
Barois sent qu'il faut à tout prix rompre ce mutisme.
BAROIS (à Marie).—Voulez-vous ... que je vous montre votre chambre? (Il fait un pas vers la porte, et se retourne vers l'abbé.) Venez-vous avec nous?
Son coup d'œil signifie: «Venez voir où elle habitera, pour pouvoir en parler là-bas...»
L'abbé les suit.
Dans cette chambre pleine de jour, ils sont encore plus mal à
l'aise que dans le cabinet aux teintes neutres; et ils restent pareillement
plantés au milieu de la pièce.
Barois prodigue des renseignements.
BAROIS.—Ici, votre cabinet de toilette. Et ici, la chambre de ... Julie. Vous voyez, vous ne serez pas trop isolée... (A Pascal qui apporte les bagages.) Devant la fenêtre...
Sa joie est tombée, il n'en peut plus: une amertume envahissante... Il faut en finir.
BAROIS (à Marie, dont le regard fuit).—Eh bien, nous allons vous laisser ... n'est-ce pas?... Vous devez avoir envie de déballer vos affaires...
L'ABBÉ.—D'ailleurs, il va falloir que je reprenne mon train. Ma chère petite, je vais vous dire au revoir.
Marie le regarde, et ses yeux grands ouverts se mouillent lentement. Immobile, elle paraît prête à s'élancer dans les bras du vieil abbé, qui s'approche, et, paternellement, l'embrasse au front.
L'ABBÉ.—Au revoir, Marie.
Le ton est affectueux et ferme. On y sent cette indifférence pour la vie quotidienne de ceux qui ont toujours vécu pour l'autre. Il semble dire: «Je vous plains, mais vous avez appelé cette épreuve; et Dieu n'est-il pas avec vous?»
Barois conduit l'abbé dans son cabinet.
Ses lèvres tremblent, sa volonté est tendue, à se briser. Il sourit péniblement.
BAROIS.—A quelle heure est votre.....
Il ne peut achever; il s'assied lourdement à son bureau, la tête dans ses mains, le corps brusquement secoué de sanglots. Ce souvenir obsédant de Cécile jeune..... Ces yeux d'enfant, pleins d'anxiété..... Et lui, qu'une tendresse sans issue étouffe soudain..... Ah, la responsabilité de créer une autre chair, capable de souffrir!
L'abbé assiste, impassible, les bras joints, les doigts enfouit sous les manches. Il pense au roc frappé par Moïse; mais sa pitié est volontairement contenue.
Barois se relève, s'essuie les yeux.
BAROIS.—Excusez-moi... Tout ça m'a secoué; je suis si nerveux maintenant... (L'abbé a repris son bréviaire et son chapeau.) A quelle heure est donc votre train?
Deux heures plus tard.
Barois n'a cessé d'aller et de venir de la fenêtre à la porte,
prêtant l'oreille à tous les bruits de la maison.
Il n'y tient plus. A pas rapides, il se dirige vers la chambre de Marie.
Silence.
Il frappe.
Quelques mouvements effarés.
MARIE.—Entrez.
Debout, dans le soir, deux ombres se détachent sur la pâleur de la croisée. Elles viennent de se lever précipitamment; leurs deux chaises sont là, deux épaves au milieu de la pièce.
Le cœur de Barois se serre.
BAROIS.—Vous êtes donc sans lumière?
Il tourne le commutateur, et reçoit au visage le regard de Julie; un chapelet pend au bout de son bras. Marie, les paupières rougies et baissées, esquisse un geste gauche.
BAROIS.—Vous avez déjà défait vos malles? Vous manque-t-il quelque chose? (A Julie.) Demandez bien tout ce dont vous aurez besoin... Pascal est un brave garçon, il vous rendra tous les services possibles...
(A Marie.) Eh bien, voulez-vous que nous allions dans mon cabinet, en attendant le dîner?... Je vous montre le chemin.
Elle le suit, résignée.
Il se retourne.
BAROIS.—J'ai l'air de vous mener à la guillotine...
Elle essaye de sourire, mais cette voix affectueuse lui donne
envie de pleurer.
Dans le cabinet, Barois allume toutes les lumières et avance
gaiement un fauteuil, sur le bord duquel Marie s'assied.
Il se sent aussi gêné qu'elle,—et ridicule, à cause de son
âge.
Marie:
Le front est étroit, un peu bombé. Une peau de brune, avec des roseurs transparentes et des pourpres soudaines, d'un éclat de fleur. Des yeux clairs et sans douceur, d'un gris bleu inattendu sous les sourcils noirs, qui ont le même dessin tourmenté que ceux de son père. Le menton accuse une volonté d'homme. Mais la finesse du nez, la gaieté qui erre autour de la bouche, corrigent ces duretés.
Le charme d'une jeunesse saine et fière.
BAROIS.—Oui, je comprends très bien que ce soit dur, très dur, cette séparation, Paris, cet appartement inconnu ... et puis moi..... (Elle esquisse un mouvement de politesse intimidée.) Si, si, je me rends bien compte..... Moi-même, tenez, je suis là, devant vous, je ne sais plus comment dire ce que je pense... (Elle sourit gentiment. Il s'enhardit.) Et pourtant, c'est vous qui avez eu l'idée de passer deux mois ici... Je n'aurais jamais osé le demander... Eh bien, vous y voilà, il n'y a aucune raison pour que nous ne fassions pas bon ménage... Aucune, n'est-ce pas?
Elle tente un visible effort.
MARIE.—Non, mon père.
Il pense avec humeur: «Comme au confessionnal.»
Sa physionomie devient sérieuse.
BAROIS.—Je ne sais pas du tout ce que ... on vous a raconté sur moi...
Elle rougit brusquement, et l'interrompt par un geste de protestation. Il heurte un regard qui résiste. Il continue, sur un ton camarade.
BAROIS.—En tous cas, puisque vous avez désiré me connaître (Interrogation sous-entendue.), je suis décidé à m'expliquer franchement. Je puis paraître avoir eu des torts irréparables vis-à-vis de votre mère et de vous. Je ne nie pas que j'aie certains reproches à me faire mais il y a du pour et du contre... Vous êtes bien jeune, Marie, pour être mêlée à ces questions: je le ferai le plus discrètement, le plus loyalement possible.
Au mot «loyalement» elle a relevé le front.
PASCAL (solennel).—Mademoiselle est servie.
Elle se tourne à demi, surprise.
BAROIS (souriant).—Vous voyez, je ne compte déjà plus... Vous êtes chez vous. (Se levant.) Allons à table. Ce soir si vous n'êtes pas fatiguée, nous causerons de tout ça.
Après le dîner.
La glace est rompue.
Marie entre la première dans le cabinet et aperçoit les fleurs enveloppées.
MARIE.—Oh, il fallait les mettre dans l'eau...
BAROIS (à Pascal qui porte le café).—Tenez, Pascal, donnez-donc vos fleurs à Julie, elle saura les...
MARIE (vivement).—Mais non, donnez... Avez-vous un vase assez grand?
Pascal lui apporte ce qu'elle demande; il la regarde faire le bouquet, et sort sans cesser de sourire.
BAROIS.—Marie, vous avez fait la conquête de Pascal.
Elle rit.
BAROIS.—Du café?
MARIE.—Non, jamais.
BAROIS.—Eh bien, voulez-vous me servir le mien, puisque vous êtes maîtresse de maison? Une demi-tasse... C'est tout ce qu'on me permet maintenant... Merci.
Ils sourient, comme deux enfants qui jouent aux grandes personnes.
BAROIS (brusquerie affectueuse).—Voyez-vous, Marie, depuis que vous êtes là, je me pose la même question: pourquoi a-t-elle désiré venir?
Un silence.
BAROIS (de sa voix chaude).—Oui, pourquoi?
Marie ne sourit plus. Elle subit, sans un clignement de cil, le regard de Barois; puis elle secoue la tête. Elle semble dire: «Non. Plus tard peut-être... Aujourd'hui, non.»
Six semaines après.
Aux bureaux du Semeur, dans le cabinet du Directeur.
LE SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION.—L'article de M. Breil-Zoeger sur les instituteurs?
BAROIS (regardant l'heure).—Faites passer autre chose.
Il se lève.
LE SECRÉTAIRE.—C'est qu'il va y avoir quatre mois bientôt...
BAROIS (debout).—Je ne dis pas le contraire. Mais je ne veux pas publier ça, sous cette forme... Il faudra que je voie Breil-Zoeger.
LE SECRÉTAIRE.—Eh bien, l'article de Bernardin?
BAROIS.—Si vous voulez.
LE SECRÉTAIRE.—Je voulais vous demander aussi ce qu'il faut répondre à Merlet.
BAROIS.—Ça ne presse pas, mon ami. Je n'ai pas le temps ce soir. Nous verrons demain.
Il prend son chapeau et son pardessus.
En passant devant la gare d'Orsay, il lève la tête:
—«Quatre heures moins le quart... Je rentre tous les jours un peu plus tôt... Je finirai par ne plus sortir de chez moi...
«Je finirai... Non! puisqu'elle va partir dans trois semaines...»
Une angoisse déchirante. Il hâte le pas. Il entrevoit un coin de son cabinet, et, sous la lampe, un front dans l'ombre, une nuque caressée de lumière.
Il sourit en marchant.
—«Elle s'est installée là comme chez elle! Ce petit air décidé, cette assurance, ces timidités! Et sachant toujours ce qu'elle veut... Elle m'en impose. Elle a quelque chose de sain, de parfaitement équilibré: c'est un tout, un anneau fermé.
«Non, je n'ai aucunement les sentiments d'un père... J'ai un sentiment paternel, ce qui n'est pas la même chose. Un père se sent une autorité, des droits. Rien de semblable. J'ai cinquante ans passés, elle en a dix-huit: voilà ce qu'il y a de paternel entre nous. Ce que j'éprouve pour elle, au fond, c'est tout bêtement une inclination sentimentale, une sympathie ... amoureuse... Mais oui, pourquoi avoir peur des mots?...»
Il gravit l'escalier, allègrement. Il répète avec complaisance:
—«Une inclination amoureuse...»
Le visage rond de Pascal.
BAROIS.—Mademoiselle est là?
PASCAL.—Non, Monsieur. Mademoiselle n'est pas rentrée.
Une déception; puis une poignante tristesse: dans trois semaines, ce sera tous les jours ainsi.
MARIE.—Bonjour, Père.
Elle entre, en toilette sombre, les joues fraîches, les yeux vifs.
BAROIS (souriant de plaisir).—Comme vous rentrez tard aujourd'hui...
Il regrette déjà sa phrase: il vient d'apercevoir la tranche dorée du paroissien qu'elle dépose sur la cheminée, pour enlever son chapeau.
MARIE (simplement).—C'est le premier jour de la retraite...
Quelques minutes plus tard, elle revient portant deux années reliées du Semeur. Elle fait glisser sa charge sur le bureau.
MARIE.—Voilà: j'ai fini. Qu'est-ce que vous me donnerez, maintenant, père?
BAROIS.—Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous désirez?
Le ton signifie: «Vous savez bien que je ne comprends rien à vos lectures.»
MARIE (gaiement).—La suite.
BAROIS.—Ce volume-là va jusqu'en décembre dernier. Il n'y a eu que huit numéros depuis. (Se tournant vers un casier.) Ils sont là. Mais si vous ne voulez lire que mes articles, ce n'est pas le peine, je n'ai rien publié depuis janvier. (Il rit.) Vous devinez pourquoi?
MARIE.—Est-ce que vraiment je vous empêche de travailler?
BAROIS (souriant).—Non, vous ne m'empêchez pas de travailler, ce n'est pas ça... Mais depuis que vous êtes là, je travaille moins, voilà tout... Je n'en ai plus le même désir...
Il la regarde. Elle semble éprouver un réel remords. Cependant, quelle importance pour elle, qu'il écrive ou non? Au contraire, elle devrait se réjouir d'interrompre la production maudite...
BAROIS (repris par la pensée du départ).—Je peux bien le dire. Vous avez mis dans ma vie quelque chose qui n'y était pas, dont je ne soupçonnais même pas le prix... Une présence, une affection... Je parle de l'affection que je ressens, moi... (Elle esquisse une rectification, et rougit.) Enfin, il n'y a pas à dire: l'idée que vous allez bientôt me quitter, m'est très dure, très dure...
MARIE (gentiment).—Je reviendrai...
Il la remercie d'un sourire âgé.
Un temps.
BAROIS.—Je me suis attaché à vous, Marie, et pourtant vous m'êtes une énigme, vous êtes indéchiffrable!
Elle fronce les sourcils: sur la défensive.
BAROIS (montrant du doigt le paroissien).—Je sens qu'il y a là un abîme entre nous: je le sens tous les matins, quand je vous vois revenir de la messe... Et, à d'autres moments, quand vous êtes ici, le soir, près de moi, recherchant dans le Semeur tout ce que j'ai écrit, lisant mes livres, demandant des explications, et les écoutant sans broncher comme si vous étiez curieuse de libre-pensée,—il me semble alors que vous n'êtes pas si loin!... Ah, c'est vrai, je ne vous comprends pas...
Marie est debout, le genou sur un fauteuil, les mains nouées sur sa jupe, le corps abandonné. Son regard seul est actif. Elle jette un coup d'œil aux Semeur qu'elle a rapportés, semble brusquement prendre un parti, et se laisse glisser dans le fauteuil.
MARIE.—J'ai voulu tout lire, d'abord...
Elle s'arrête. Sa voix alourdie marque la contraction de cette petite âme, au seuil de l'entretien toujours reculé.
Barois rencontre son regard bleu: et il a l'intuition qu'elle s'est interrompue pour lancer vers Dieu un appel de courage.
Il cherche à l'aider.
BAROIS.—Si je comprenais seulement pourquoi vous avez désiré venir?
Elle le fixe, l'œil chargé de pensées.
MARIE.—Par épreuve.
Il ne réprime pas son amertume. Elle s'empourpre et baisse les yeux: son front est rond comme un bouclier.
MARIE (vite).—Je veux être religieuse, père...
Barois sursaute. Elle relève la tête.
MARIE.—Je savais que vous aviez perdu la foi. Alors j'ai voulu vous connaître, vivre de votre vie, étudier vos œuvres, subir votre influence: c'était l'épreuve décisive de ma vocation... (Fièrement.) Et je suis contente d'être venue!
Long silence.
BAROIS (morne).—Vous voulez être religieuse, Marie?
Il surprend alors une certaine façon qu'elle a de sourire: une crispation des lèvres, dépouillée de joie; et, en même temps, un regard qui se fige, assuré, légèrement ironique, mais terne et sans vie.
BAROIS (soulevant les bras, d'un geste las, sans la regarder).—Je ne m'y attendais guère... Je me disais: «Pourquoi est-elle là?» J'ai fait vingt hypothèses. Finalement je m'étais dit: «Elle va essayer de me convertir...»
Son rire éclate, puéril, nerveux, trop vif.
BAROIS (agacé).—Eh bien, ce n'aurait pas été si mal, pour une future religieuse!
Marie a repris son sérieux. Elle va chercher son paroissien, le feuillète, et le tend à son père.
BAROIS (lisant).—«Je voudrais que vous fussiez tous comme moi; mais chacun a son don particulier, selon qu'il le reçoit de Dieu.»
MARIE (souriant).—Vous me croyez bien orgueilleuse! Si Dieu vous désirait pour lui, est-ce qu'il aurait besoin de moi? C'est donc qu'il a d'autres vues sur vous... (Secouant la tête.) Non, non, chacun cherche son devoir où il peut. Moi j'ai le bonheur de l'avoir trouvé devant moi, simple et facile. Vous pas. Je vous plains... (Hésitation.) Je ne peux que vous plaindre, père... Mais essayer, moi, de vous convertir, vous!
BAROIS.—Et vous n'avez pas craint, en soumettant votre foi à mon influence...
Marie secoue la tête.
MARIE.—D'abord, je savais bien que si vous aviez ces idées-là, c'était, comment dire...—d'une façon élevée... On ne peut pas vous en vouloir..
BAROIS.—Comment le saviez-vous?
MARIE.—Je le savais.
BAROIS (pris d'une curiosité étrange).—C'est votre mère, qui...?
Marie rougit brusquement et fait un imperceptible signe d'assentiment.
Il n'insiste pas.
Il va vers sa bibliothèque, l'ouvre, et, pensif, manie quelques volumes.
BAROIS.—Voyons, Marie... Vous avez lu: Les raisons de ne pas croire, huit articles qui se suivent?
MARIE.—Oui.
BAROIS.—Et ça: Le dogme devant la science?... Et ça: Les origines comparées des religions?...
MARIE.—Oui.
BAROIS (repoussant le battant vitré).—Vous avez lu tout ça, en y appliquant votre esprit,—et ce que vous aviez cru vrai jusque-là ne vous a pas semblé...
Il voudrait dire: «Vous ne me ferez pas croire que tout le labeur d'une vie comme la mienne, employée à combattre la religion par des arguments précis, puisse se briser contre votre foi d'enfant!»
Mais il s'arrête: il vient de reconnaître le sourire et le regard butés de Marie.
MARIE (cherchant à formuler sa pensée).—Mais, père, si ma certitude était à la merci des objections, ce ne serait plus une certitude...
Elle sourit, naïvement cette fois. Et Barois entrevoit une vérité psychologique.
Il pense:
—«Une certitude qui n'offre pas de prise aux objections... Qu'est-ce qu'elle veut dire? Que les difficultés de la religion ne peuvent pas exister pour elle, parce qu'elle possède, a priori, une certitude? Ce qui veut dire qu'elle a mis d'avance sa foi au-dessus de tout raisonnement; et que, même si sa raison se laissait convaincre par les objections, sa foi n'en serait pas même effleurée, parce qu'elle est au-dessus, hors d'atteinte!
«C'est enfantin... et inattaquable!»
BAROIS (doucement).—Mais cette certitude, Marie, sur quoi donc l'asseyez-vous si solidement?
Elle se contracte; mais elle ne veut pas se dérober.
MARIE.—Quand on a éprouvé ce que j'ai éprouvé, père... Je ne sais pas comment vous dire... La présence même de Dieu... Dieu qui pénètre l'âme, qui l'inonde d'amour, de bonheur... Ah, quand on a éprouvé ça, ne fût-ce qu'une fois dans sa vie, tous ces raisonnements que vous échafaudez pour vous prouver à vous même que votre âme n'est pas immortelle, qu'elle n'est pas une parcelle de Dieu, tous vos raisonnements, père...! (Un sourire souverain...)
Barois ne répond pas.
Il pense:
—«Ce que j'ai éprouvé... Là-contre, il n'y a rien à faire, il n'y aura jamais rien à faire!
«Si seulement je pouvais empêcher qu'elle ne prenne une résolution irréparable...»
BAROIS.—Est-ce que votre mère vous encourage dans cette voie?
Marie baisse la tête avec une expression douloureuse et têtue.
BAROIS (stupéfait).—Comment? Vous ne lui avez rien dit encore?
Marie ne répond pas.
BAROIS.—Mais pourquoi? Vous pensez donc qu'elle s'y opposerait?
Un temps.
BAROIS.—Voilà le meilleur des avertissements: il est en vous-même... Quel que soit votre désir d'être religieuse, vous sentez, devant une pareille décision, tant de chagrins à franchir, que vous n'avez même pas osé...
MARIE (prête à pleurer).—Pourquoi lui aurais-je fait cette peine dès maintenant? J'ai pitié. Maman n'a jamais été heureuse...
Elle a parlé vite, sans réfléchir. Elle rougit.
Barois ne semble pas avoir compris. Il se penche vers elle.
BAROIS.—Marie, écoutez-moi... Je ne veux pas discuter avec vous; il ne s'agit pas de votre foi. Vous avez lu dans mes articles tous les arguments que je pourrais développer; ils ne vous ont pas convaincue,—n'en parlons plus...
(Longue aspiration.) Vous voyez, ce n'est pas le libre-penseur qui parle... C'est simplement l'homme de cinquante ans, l'homme de bon sens, qui a vu des idées se modifier au cours d'une même vie! S'engager, à vingt ans, se lier pour toujours... Quelle folie! Des serments éternels! Songez à tout ce qui peut encore se passer en vous et que vous ne soupçonnez pas, à tout ce que l'âge, et la réflexion, et les circonstances, pourront modifier...
Geste de Marie: «Oh, je suis bien sûre de moi!»
BAROIS.—Mais rien que votre atavisme devrait vous faire frémir d'inquiétude! Tous les instincts qui m'ont affranchi, moi, quand j'avais votre âge, ils sont en vous, quoi que vous fassiez, plus ou moins obscurs, plus ou moins mâtés, mais ils sont, et ils peuvent remonter brusquement à la surface et bouleverser votre vie!
Voyons, Marie, comment pouvez-vous affirmer que vous ne douterez pas? Pouvez-vous soutenir que vous n'ayez jamais eu un seul doute? Rentrez en vous, voyons... Il n'est pas possible que jusqu'ici... (Il montre les tomes du Semeur.) Aucun, aucun doute ne vous a frôlée?
MARIE.—Aucun, je vous assure... Jamais.
Ses yeux brillent de candeur. Il la considère en silence.
Un temps.
MARIE.—Non, le monde est trop vide... Rien n'est grand, rien ne dure...
BAROIS.—Croyez-vous qu'il n'y ait pas de place sur terre pour un cœur qui veut s'agrandir?
Elle l'examine longuement, avec respect, avec compassion.
MARIE.—Oui, père, j'ai souvent pensé à vous, depuis que je suis ici... Vous n'avez pas eu la chance de connaître la grâce, vous n'avez pas senti ce que c'est qu'un regard de Dieu: et pourtant vous êtes bon, et juste. Mais comme vous avez dû vous donner du mal! C'est tellement plus simple d'être bon pour l'amour de Dieu!
BAROIS.—Croyez-vous qu'il soit plus beau d'abdiquer toutes les responsabilités, tout le labeur de la vie, de s'en remettre une fois pour toujours à une règle monastique,—plutôt que de prendre courageusement la tâche qui se présente, et de l'accomplir, par les chemins de tout le monde? Ce que vous désirez, c'est un suicide de la pensée et de l'action!
MARIE (souriant à son rêve).—Le don de soi...
BAROIS.—Ah, qu'est-ce qu'il est, ce don de soi, au seuil d'une vie qui sera dure, comme toute vie humaine, si ce n'est le sacrifice des devoirs les plus élémentaires? Et ne vantez pas les mérites de la soumission! c'est un anesthésiant qui endort la douleur à mesure qu'elle la cause. Vous êtes jeune, ardente, intelligente, et vous aspirez au néant de la vie contemplative? Est-ce digne de vous?
MARIE.—Vous parlez comme tous les autres; vous ne pouvez pas deviner... (S'exaltant avec des réminiscences.) Je suis une privilégiée, cela crée des devoirs.. Toutes ne sont pas appelées; mais celles que Dieu choisit, doivent se donner sans restriction. Elles sont le rachat de tous ceux qui vivent en faisant à Dieu la plus petite part possible ... et de ceux qui ne lui en font pas du tout...
BAROIS (brusque).—C'est ma rançon que vous voulez payer?
MARIE.—Je ne vous demande pas de me comprendre, père...
Oui, ces vœux, ils acquittent un peu la dette de la famille, ils réparent un peu ... ce que vous avez pu faire par vos livres... (Tendrement.) Et qui sait si cette vocation n'a pas été voulue par Dieu, en échange d'une âme qui est belle, très belle, et qui, sans ça, serait damnée?
Son regard est devenu une surface plate et dure où le regard d'autrui, où l'interrogation et le doute d'autrui, ne pénètrent plus.
Barois pense:
—«Quelle religion, celle qui peut amener des cerveaux humains à un tel écart de la réalité, et les y faire tenir!
«Ça ne repose sur rien... Le plus humble bon sens en aurait raison, si les esprits ne se trouvaient pas d'avance préparés par des siècles de servitude sereine...
«Ça mijote dans les âmes d'enfants, tenu à feu doux par les surexcitations du catéchisme, les communions brûlantes... Ça monte à un tel degré de chaleur artificielle qu'une vie toute entière peut en être réchauffée!...
«Et c'est là que Marie trouve cet équilibre qui fait mon admiration depuis que je la vois vivre?
«Dans combien d'années, après combien de générations hésitantes, la vérité scientifique donnera-t-elle cet apaisement total?
«Jamais peut-être...»
«A Monsieur Marc-Elie Luce, Auteuil.
«Mon cher ami,
«Je pensais vous rencontrer cet après-midi à notre réunion, et vous annoncer que je profite des vacances de Pâques pour faire une absence de quinze jours. J'ai tant de questions à régler avant de quitter Paris que je ne suis pas sûr de pouvoir aller vous serrer la main.
«J'aurais eu pourtant bien des choses à vous dire. J'ai passé, ces dernières semaines, par des émotions bien inattendues, bien cruelles.
«Ma fille désire entrer au couvent...
«Vous imaginez ce que j'ai pu éprouver. Rien ne me le laissait soupçonner. Au contraire, l'intérêt qu'elle avait pris, depuis son arrivée, à lire tout ce qui porte atteinte au catholicisme, me faisait illusion. Je vous en ai parlé déjà. Je me trompais étrangement. Le sentiment religieux a pris chez elle une forme qui le rend invulnérable à nos raisonnements. Je crois que sa nature résolue et intuitive a souffert de la vie de province, et qu'elle s'est défendue en se donnant une activité intérieure démesurée. La religion dogmatique de l'Église n'est plus pour elle qu'un cadre, précis mais large, dans lequel son sentiment personnel s'est exagérément développé; et ce qui domine aujourd'hui sa sensibilité, ce n'est pas le dogme, c'est l'élan spontané de sa petite âme vers l'infini,—et l'illusion qu'elle l'embrasse!
«Il n'est pas douteux, qu'avec le fond de santé et l'intelligence claire qu'elle possède, sa croyance d'enfant eût pu évoluer si elle avait attaché au dogme l'importance qu'elle accorde aux aspects sentimentaux de la foi. Mais il n'en est rien. Et l'état mystique où elle atteint aujourd'hui est autoritatif, au point de lui donner une certitude absolument irréfutable du monde spirituel.
«Nous qui sommes habitués à plier notre sensibilité au travail de notre
raison, nous n'avons aucune idée de ces certitudes-là. Marie a éprouvé le
contact de Dieu, et nous sommes aussi désarmés devant une auto-suggestion
de cette espèce, que nous sommes impuissants à convaincre un malade
de l'irréalité de ses hallucinations. Rien ne fera comprendre à Marie, que
ce milieu surnaturel où elle a projeté le meilleur d'elle-même (et que ses
dispositions extatiques lui permettent de percevoir nettement) n'est qu'un
mirage, un égarement de sa sensibilité, un conte de magicien qu'elle se
répète à elle-même depuis des années.
«Mon cher ami, je sais que vous ne m'approuverez pas. Mais en présence
de cette situation sans issue, les dispositions où vous m'aviez laissé, les
conseils que vous m'aviez donnés pour amener cette enfant à substituer
progressivement une vérité féconde à son erreur, m'ont paru sans objet.
J'ai vu mon impuissance à la convaincre, et en même temps, quelle force
elle puise à se tromper. Elle m'est apparue façonnée par la religion et pour
la religion... Devant un ensemble si fort, j'ai reculé... Une telle foi, c'est
évidemment un mensonge, mais c'est aussi du bonheur humain: son
bonheur! Vous êtes père—et plus que moi; vous me comprendrez peut-être.
Autrefois j'aurais dit: la vérité d'abord, fût-ce au prix de la souffrance.
Aujourd'hui je ne sais pas, je ne peux plus dire de même. Je me
tais, et je crois l'aimer plus en me taisant, malgré mon chagrin, qu'en
m'acharnant à détruire ce qui est le secret de son activité.
«J'ai obtenu de passer encore les vacances de Pâques avec elle. Ce séjour, qui aura été dans ma vie quelque chose d'inattendu et de délicieux, je veux le finir comme un beau rêve, par un voyage dans un pays de lumière et de fleurs.
«Nous partons après-demain pour les lacs italiens.
«A mon retour, je sais d'avance l'amertume que je trouverai à ma solitude. Je ne veux pas y penser. J'aurai bien besoin de vous, et je sais que vous ne vous refuserez pas: c'est la pensée consolante qui me permettra de revenir seul.
«Au revoir, mon grand et cher ami. Je vous serre la main très affectueusement.
Barois.»
A Pallanza.
Avril. Six heures du soir.
Une barque plate sur l'eau.
Marie et Barois sont assis à l'arrière, côte à côte, tournant le dos à la ville, dont l'animation ne les atteint plus.
Autour d'eux, le lac palpite à peine. Un glissement mou et lent, dans une lumière grise, à la fois intense et voilée. La lune est si haut dans le ciel qu'il faudrait renverser la tête pour la voir; son éclat, diffus dans la buée, isole la barque au centre d'une immensité silencieuse et blême.
A l'avant, le torse du rameur s'incline et se relève; la chemise,
le pantalon de toile, forment deux clartés nébuleuses; son visage,
ses mains, ses pieds nus, sont noirs comme ceux d'une icône.
Barois ne peut détacher sa pensée de la séparation prochaine.
Marie, le front renversé, hors du temps et de l'espace, diluant
son âme dans la fluidité du ciel et de l'eau, s'enivre, comme s'il
n'y avait plus rien entre elle et Dieu.
Soudain, une bouffée odorante, chaude comme l'haleine d'une
bouche: les roses, les giroflées, les iris, les citronniers, les eucalyptus
de l'île San Giovanni. La main de Barois cherche celle de
Marie, qui, penchée en arrière, laisse traîner dans le sillage son
bras nu; la fraîcheur résistante de l'eau encercle leurs deux
poignets.
Sept coups sonnent à un campanile; sur l'autre rive, un
écho répète les sept coups, durement, comme un gong.
Ils reviennent vers Pallanza.
Julie les attend sous le péristyle, deux dépêches à la main: Mme Pasquelin vient de mourir.
Neuf heures, le même soir.
Barois, ayant bouclé sa malle, s'accoude au balcon de sa chambre.
Devant lui, le lac couleur de perle. Au-dessous de lui, la place: une vie désordonnée: des chants, un orchestre, des trompes de tramways, un bruit de foire.
Un gros vapeur illuminé verse sa fourmillière sur le ponton.
—«Pauvre petite... Ces quinze jours qu'elle m'a donnés... Ah!... Ce que je vais me sentir seul...»
Le vapeur, d'un coup, s'éteint. Il était sombre et semé de lumières; il devient blanchâtre et percé de trous noirs, comme une carcasse abandonnée. Il tremblote lourdement au clapotis de l'eau, et le peu de vie qui lui reste s'exhale dans le panache hésitant de sa fumée.
A Buis.
Veillée mortuaire: deux cierges; le lit; les cornettes des religieuses.
Cécile, épuisée par un long agenouillement, est prostrée dans un fauteuil. Ses paupières irritées se ferment à demi: sa pensée s'évade, s'élance au-devant de Marie:
«A l'aube, elle sera là, je ne serai plus seule...»
Mais, au fond d'elle-même, sa pensée est: «A l'aube, ils seront là...»
Elle se remémore ce qu'elle a appris sur Jean, par sa fille, par Julie. Elle se passe la main sur le visage.
—«Il va me trouver changée...»
Elle ne l'a pas revu depuis dix-huit ans, et soudain son image
surgit, dans l'épanouissement de la trentaine...
Elle se lève précipitamment; et, pour ne plus penser qu'à la
morte, elle retourne s'agenouiller au bord du lit.
Depuis son arrivée à Buis, Barois n'a pas quitté sa chambre d'hôtel.
Une moisissure, qui tombe sur les épaules, suinte des murs comme un brouillard.
Il est resté assis tout le jour devant son feu, les joues brûlantes, le dos transi, tournant entre ses doigts la lettre de Marie:
«Mon cher Père,
«Le service a lieu demain matin, mais maman vous demande de ne pas y assister. Elle a été sensible à votre sympathie et elle me charge de vous dire que si vous êtes encore à Buis demain, elle sera heureuse de vous remercier elle-même de ce que vous avez fait pour moi. Venez à six heures, il n'y aura plus personne.
«Je vous embrasse tristement.
Marie.»
La nuit tombée, Barois n'y tient plus, et se glisse dehors.
D'abord la ville basse, comme s'il fuyait le coin qui l'attire. La vie paisible des rues, le soir; les étalages qu'on rentre, automatiquement, depuis un demi-siècle; le même vacarme sur le passage de l'omnibus branlant; les mêmes enseignes, grinçant aux mêmes angles... Tant de fixité!...
Il remonte maintenant vers l'église. Il ne se souvenait pas que la pente fût si raide. Essoufflé, le cœur battant, il passe devant le presbytère, il arrive à sa rue...
Elle est déserte. Un courant d'air glacé la balaye toujours. La maison de la grand'mère Barois... Une à une, les fenêtres des chambres, celle où il couchait, celle où son père est mort... Le grand portail: A LOUER. Et, debout, le beffroi noir.
Puis, quelques pas: la maison des Pasquelin.
Cécile est là, avec Marie... Marie, qui va demeurer ici maintenant!
Cette lueur derrière les volets, le corps sans doute...
Il s'immobilise, envahi par son enfance...
L'horloge du clocher... Il sourit; les larmes lui viennent aux yeux.
Autour de lui, la bise impitoyable; il relève en frissonnant le col de son pardessus d'Italie.
Puis, grelottant, il regagne son hôtel.
Le feu s'est éteint. On le rallume. Il allonge les jambes vers la
maigre flambée. Le passé danse dans les flammes: l'abbé Joziers,
Cécile, les fiançailles...
—«Je me suis marié comme un imbécile!...»
Il tremble de froid, d'angoisse. Des souvenirs l'accablent.
—«C'est difficile, de vivre...»
Le lendemain; six heures du soir.
Barois, rongé de fièvre, toussotant, arrive devant la porte close
des Pasquelin.
Le même timbre, les mêmes socques de la servante sur le carrelage. Un mot de province lui vient aux lèvres: la coutume d'une maison...
Dans le petit salon, Cécile, en noir, est assise sous la lampe, devant une pile de faire-part.
Il la reconnaît si mal qu'il n'a pas de peine à être comme un étranger.
BAROIS.—J'ai bien compati à votre chagrin...
Elle s'est levée. Elle le regarde: elle ne s'attendait pas à cette maigreur; et, dans la physionomie quelque chose d'inconnu la déroute.
CÉCILE.—Merci Jean.
Elle tend la main. Il la serre avec une effusion polie, comme à des obsèques.
Il est surpris qu'elle ait tant changé; il n'avait pas réfléchi qu'elle continuait, depuis dix-huit ans, à vivre, un à un, les mêmes jours que lui. C'est bien elle, cependant: le front bombé, le regard inégal, ce zézayement intimidé... Tout à l'heure, il ne l'imaginait même pas: et maintenant, il ne conçoit pas qu'elle aurait pu se faner autrement.
Marie rompt le silence.
MARIE.—Prenez ce fauteuil, père.
CÉCILE (s'asseyant).—Je vous remercie de la façon dont vous avez reçu Marie... Vous avez été très bon pour elle, je vous remercie.
BAROIS (machinalement).—C'était tout naturel.
Il rougit aussitôt.
BAROIS.—Est-ce que votre mère s'est vu mourir?
CÉCILE.—Non. Elle avait tant de fois reçu les sacrements depuis sa première attaque... D'ailleurs, le dernier jour, elle n'avait plus sa tête, la paralysie gagnait. (Pleurant.) Elle n'a reconnu personne.
Cette voix larmoyante réveille en lui une résonnance inattendue.
MARIE.—Maman, il faudrait donner à père une des dernières photographies de grand'mère?
Cécile jette un regard biais vers Jean, qui a baissé le front.
CÉCILE (hésitation).—Si tu veux, mon enfant.
Ils restent seuls.
Ce tête-à-tête, dans ce cadre...
Leurs regards se croisent, se fuient. Ensemble, obscurément,
ils espèrent le mot d'oubli, d'amitié...
Mais la porte s'ouvre. De nouveau Marie est entre eux.
La minute est passée.
Ils peuvent se séparer, maintenant, ils n'ont plus rien à se dire.
«Paris, le 25 avril.
«Je m'adresse à Mademoiselle pour lui annoncer que depuis son retour, Monsieur est bien malade d'une pleurésie. Il est si faible qu'il ne parle presque plus. Le médecin est revenu ce matin avec deux autres; ils sont restés longtemps auprès de Monsieur, ils ont dit qu'ils enverraient une garde, et ils m'ont demandé si Monsieur avait de la famille.
«Je crois bien faire en prévenant Mademoiselle,
«Votre serviteur dévoué,
Pascal.»
Deux jours après. Le soir.
Marie est dans la chambre de Barois, avec le médecin.
Cécile est assise sur la banquette du vestibule. Rien ne la
retenant plus à Buis, elle a voulu accompagner sa fille à Paris.
Mais devant la gravité du mal, Marie s'est réinstallée chez son
père. Et Cécile, déracinée, s'est cloîtrée dans la chambre d'une
pension voisine, d'où elle ne sort que pour venir aux nouvelles.
Le médecin paraît, suivi de Marie.
MARIE.—Revenez vite, docteur, ne nous laissez pas seuls...
Ses traits sont décomposés. Elle s'effondre sur l'épaule de sa mère.
Cécile n'ose plus interroger.
MARIE.—Il a changé, depuis midi, d'une façon effrayante. Le docteur ne répond plus de rien. Il a demandé une autre consultation, pour ce soir. Il ne veut pas essayer une nouvelle ponction, sans l'avis des autres...
CÉCILE (voix brisée).—Il souffre?
MARIE.—Un peu moins. (Sanglotant.) La garde dit que c'est mauvais signe... Ah, laissez, ça me fait du bien de pleurer! C'est affreux... Il m'a appelée tout à l'heure... Il a prononcé votre nom, deux fois...
Un silence.
MARIE (brusquement).—Maman, entrez le voir...
Cécile ne résiste pas; c'est la dernière fois, la mort est dans la maison. Elle est épouvantée de cet irréparable qui va sceller leur rupture pour l'éternité.
Jamais elle n'a si douloureusement senti ses torts...
Elle traverse, en évitant de regarder, le cabinet de travail;
elle entre dans la chambre; elle aperçoit le lit, le visage livide.
Il ouvre les yeux et la reconnaît sans la moindre surprise. Elle saisit sa main, elle veut y mettre ses lèvres. Mais il l'attire, il se soulève vers elle, et la regarde jusqu'au fond des yeux, avec désespoir.
BAROIS.—Cécile, tu sais, je vais mourir...
Elle secoue la tête, crispant sa volonté pour ne pas fondre en
larmes.
Mais l'infirmière s'approche avec des ventouses.
Pascal soutient le corps. Marie écarte les plaques d'ouate. Ils sont tous trois penchés sur le malade. Cécile aperçoit un peu de chair pâle.
Elle s'est reculée. Elle est là, en visiteuse, avec son voile de crêpe, ses gants noirs. Un accablement sans borne...
Elle gagne la porte. Jette un dernier regard vers le lit, et s'enfuit en sanglotant.
Trois semaines plus tard.
Barois est dans son bureau étendu sous une couverture. Il fixe avec anxiété Breil-Zoeger, debout devant lui.
ZOEGER.—Nous y étions tous.
BAROIS.—Qui conduisait le deuil?
ZOEGER.—Le père Cresteil, en colonel.
BAROIS.—Ah, il avait encore son père? Il n'en parlait jamais...
ZOEGER.—Tout était mystérieux dans sa vie.
BAROIS.—Et tu ne sais toujours pas ce qu'il allait faire à Genève?
ZOEGER.—Non. Mais je suppose qu'il allait se tuer, simplement. Il devait logiquement en arriver là... (Un temps.) Des détails poignants: il avait brûlé tout ce qui pouvait le faire reconnaître: il s'était même rasé la moustache, en wagon! La police a mis quatre jours à retrouver son identité... Hein? cette hantise, non seulement de mourir, mais de disparaître...
BAROIS (les yeux pleins de larmes).—Ah, mon pauvre ami, que la vie est...
Il n'achève pas. Breil-Zoeger ne répond rien; de son œil jaune, il mesure les ravages de la pleurésie.
Barois avait des cheveux noirs, emmêlés; beaucoup sont tombés, en quelques jours. Les yeux sont creusés, le regard est las, les paupières alourdies; le corps se tasse au fond de la chaise-longue. Les mains reposent, molles.
BAROIS (triste sourire).—Tu me trouves changé?
ZOEGER (de sa voix douce et coupante).—Oui.
Un silence.
BAROIS.—J'ai été très touché, vois-tu, très touché...
Breil-Zoeger l'examine froidement, sans répondre. Puis il se lève pour partir.
ZOEGER.—Woldsmuth s'est chargé de l'article nécrologique. Je lui dirai de te l'apporter.
BAROIS.—Non, je t'assure, je ne peux encore m'occuper de rien. Prends toutes les décisions... Avant de t'en aller, voudrais-tu me donner un tome du Semeur ... 1900, le deuxième semestre... Merci.
Resté seul, il feuillète le volume avec une préoccupation maladive. Enfin il retrouve cet article dont le souvenir l'obsède; il le parcourt; puis, lentement, il relit la dernière page:
«Pourquoi craindre la mort? Est-elle si différente de la vie? Notre existence n'est qu'un passage incessant d'un état à un autre: la mort n'est qu'une transformation de plus. Pourquoi la craindre? Qu'y a-t-il de redoutable à cesser d'être ce tout, momentanément cordonné, que nous sommes? Comment peut-on s'effrayer d'une restitution de nos éléments au milieu inorganique, puisque c'est en même temps un retour assuré à l'inconscience?
«Pour moi, depuis que j'ai compris le néant qui m'attend, le problème de la mort n'existe plus. J'ai même ... plaisir ... à penser que ma personnalité n'est pas durable... Et la certitude que ma vie est limitée ... augmente singulièrement le goût ... que j'y prends...»
Il laisse retomber le livre sur ses genoux. Il est écrasé par ce qu'il a osé écrire, jadis, sans savoir...
Pascal ouvre la porte.
Cécile paraît, suivie de Marie.
MARIE.—Comment vous trouvez-vous, père, aujourd'hui?
BAROIS.—Mieux, mieux... Bonjour Cécile. Vous êtes bonne de venir me voir.
Marie se penche.
Il l'embrasse, et s'adresse à elle, en souriant.
BAROIS.—La maladie nous apprend combien nous avons besoin des autres...
Cécile s'est assise sur le bord d'un fauteuil. Le jour l'éclaire durement. Barois remarque son visage bouleversé.
Marie reste debout, contre la fenêtre; elle aussi, a pleuré.
MARIE (répondant au regard de Barois).—Père, j'ai parlé à maman de ma vocation religieuse... Je lui ai dit que vous consentiez...
BAROIS (vivement).—Moi, Marie?... Mais je n'ai pas à consentir!
Cécile fait un mouvement.
CÉCILE.—Vous avez connu le projet de Marie avant moi, Jean. Est-il possible que vous ne l'en ayiez pas détournée?
MARIE (fixant Barois).—Dites tout ce que vous pensez, père!
Il fait un effort pour rassembler ses idées.
BAROIS (à Cécile).—Je lui ai fait des objections. Une telle vocation est trop loin de moi pour que je puisse comprendre... Mais j'ai trouvé Marie si résolue ... et, d'avance, si heureuse...
Il ne peut s'expliquer davantage sans rouvrir des blessures dont il respecte maintenant les cicatrices; et il regarde tristement sa femme et sa fille, qui souffrent l'une par l'autre.
Marie est toujours debout; le regard est terne; elle tend son front, où la pensée semble volontairement figée.
Une image s'impose à Barois: Cécile, l'année de la rupture...
Et c'est alors qu'il découvre combien Cécile a changé: plus rien d'obstiné, rien d'inerte: une douleur qui palpite... Les larmes coulent sur ses joues. Un atroce débat la divise: l'instinct se révolte contre la foi: elle ne peut se résoudre à livrer son enfant, même à Dieu.
CÉCILE (dont le cœur éclate).—Ah, vous avez cédé, vous, mais ça ne vous est pas difficile! Qu'elle soit avec moi à Buis, ou bien qu'elle soit dans un couvent... (Zézayant.) Mais moi, si seule aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je devienne, si elle s'en va?...
Marie esquisse un geste involontaire; ses yeux vont de l'un à l'autre...
Ils ont compris, tous les deux, et se détournent.
Un silence.
"Nostra vita a che val?"
Leopardi.
Dix-huit mois plus tard.
Aux bureaux du Semeur, un jeudi, jour de réception du Directeur.
Barois, dans son cabinet, avec Portal.
PORTAL.—Vous y écrivez moins souvent.
BAROIS.—C'est vrai, mais je n'ai pas la fatuité de croire que ce soit la vraie cause... D'autant que le Semeur s'est renouvelé, et que nous avons maintenant quelques jeunes, de premier ordre.
PORTAL.—Parbleu, vous avez contre vous, la réaction nouvelle. Dans tous les domaines, c'est le même recul.
Barois s'approche frileusement du brasier de coke, et s'assied dans la cheminée, les épaules basses, les coudes sur les genoux.
BAROIS.—La mode n'y est plus; ça tourne, c'est la loi de la vie. On n'a qu'un temps... (Il tend ses mains au foyer.) Moi-même, quand j'écris maintenant, je n'ai plus la spontanéité d'autrefois! J'y mets la même conviction, mais, comment dire, malgré moi, par le seul effet du temps qui s'est écoulé, cette sincérité est devenue quelque chose de tout fait, un outil, un procédé...
Pause.
PORTAL (enjoué).—Et votre enquête sur la jeunesse? Vous ne l'abandonnez pas, je pense?
BAROIS.—Non, j'attends même aujourd'hui une visite à ce sujet. (Las.) Mais, au fond, j'ai eu tort d'entreprendre ça; les jeunes sont des énigmes pour moi. Voilà plus d'un mois que je n'ai touché à cet article...
Il est vrai que mon déménagement m'a mis en retard pour tout.
PORTAL.—Vous êtes tout à fait installé?
BAROIS (assombri).—A peu près...
(Il se dirige vers la croisée.) Tenez, vous voyez, là-haut, ces trois fenêtres?... Ça n'est pas grand, mais je m'y ferai. Mon appartement était vraiment devenu trop lourd. (Souriant.) Les affaires ne sont pas brillantes...
(Il continue, avec la visible satisfaction de confier les détails de son existence.) En somme, mon cher, j'ai eu de la chance de trouver ça dans la maison! Les jours de brouillard, ou même d'humidité, j'étais obligé de rester confiné chez moi. Tandis que, de là-haut, vous comprenez ... en me couvrant bien ... je peux toujours descendre jusqu'ici...
PORTAL (gagnant la porte).—Allons, je viendrai vous surprendre un de ces soirs; nous bavarderons...
BAROIS.—Oui, comme autrefois...
Resté seul, il regarde le feu. Puis il se lève, cherche des papiers dans un carton, et s'installe à son bureau.
Quelques minutes.
Il griffonne dans les marges.
Brusquement il repousse les feuillets, et sonne.
BAROIS (au garçon).—Voulez-vous voir si M. Dalier est à la rédaction?
Peu après, entre un jeune homme de vingt-cinq ans.
Dalier: petit, les jambes courtes, mais le buste dilaté; la tête
forte.
Visage blanc et maigre, entièrement rasé. Lèvres fines, un peu dédaigneuses. Lorgnon.
Barois l'enveloppe d'un coup d'œil, et se renverse légèrement en arrière.
BAROIS.—Je viens de parcourir votre article, mon ami. Ça ne va pas, mais pas du tout... (Mouvement de Dalier.) Je ne dis pas qu'il soit mal construit: mais il ne peut pas être publié tel quel, dans notre revue.
Dalier debout: surpris, réservé.
Barois choisit quelques feuilles et les lui tend.
BAROIS.—Tenez... Si c'est là votre conception personnelle du sentiment religieux, tant pis pour vous. Le Semeur ne peut pas s'en faire l'écho.
DALIER.—Mais, monsieur, je ne comprends pas; c'est bien dans ce sens-là que M. Breil-Zoeger m'avait dit...
BAROIS (brusquerie inattendue).—M. Breil-Zoeger a le droit d'envisager la question comme bon lui semble! Mais le Directeur de la revue, c'est moi. Et jusqu'à nouvel ordre, je ne laisserai pas paraître, dans un périodique que je dirige, un article aussi étroitement sectaire!
Son visage s'empourpre, puis pâlit.
Un silence.
Dalier fait un pas en arrière pour se retirer.
Barois passe sa main sur son front; d'un geste, il invite Dalier à s'asseoir.
BAROIS (ton voulu de causerie).—Voyez-vous Dalier, vous escamotez une partie de la réalité... C'est trop commode.
Moi aussi j'ai proclamé toute ma vie la faillite des religions,—et je crois même y avoir contribué, dans ma sphère... Mais la faillite des religions dogmatiques: et non la faillite du sentiment religieux. (Hésitant.) Ou, si j'ai fait la confusion, ce qui est possible, c'est que je n'avais pas compris ce qu'est le sentiment religieux, et qu'il échappe, par définition, à l'action de l'esprit critique. (Il regarde Dalier bien en face.) La forme dogmatique des religions, voilà ce qui ne compte pas; mais le sentiment religieux, lui, subsiste, et c'est une ânerie de le nier, mon ami, croyez-moi: je puis le dire, puisque je l'ai fait... Quand une forme artistique est périmée, l'art ne disparaît pas avec elle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement la même chose.
Dalier se tait, mais sa physionomie exprime un avis nettement opposé.
BAROIS.—D'abord vous êtes trop jeune pour pouvoir parler de ces questions-là. Vous venez de traverser la première crise, vous en êtes à l'affranchissement absolu, sans restriction...
DALIER (positif).—Il n'y a pas eu la moindre crise religieuse dans ma vie jusqu'à présent, et je crois pouvoir prétendre qu'il n'y en aura pas.
Barois: sourire incrédule.
DALIER (mécontent).—Je vous affirme, monsieur, que je ne sais pas ce que vous voulez dire. Chez moi, l'athéisme est inné. Mon père, mon grand-père étaient athées. Ma raison n'a jamais eu à lutter contre ma sensibilité, pour me faire accepter que le ciel soit vide; et, dès que j'ai eu l'âge de réfléchir, j'ai compris que les causes s'engendrent, les unes les autres, aveuglément, sans but, et que rien dans l'univers ne nous permet de supposer une direction, ni un progrès... Ce sont des mouvements, voilà tout.
BAROIS (après l'avoir considéré).—il y a peut-être des gens absolument dénués de sens religieux, comme il y a des daltoniens par exemple... Mais il est évident que ce sont des exceptions: ils ne doivent pas généraliser d'après eux. Et puisque vous ignorez tout du sentiment religieux, pourquoi en parlez-vous? Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Votre logique vous amène à des solutions qui vous paraissent simples, rationnelles, définitives: et pourtant, toute conscience religieuse les rejettera, je vous l'affirme, comme absolument insuffisantes à expliquer l'intensité de la vie intérieure!
DAMER.—Mais monsieur, vous-même, vous avez soutenu, vingt fois, devant moi...
BAROIS (soucieux).—Eh bien, c'est possible. Mais aujourd'hui je vous dis que si l'on déracine les dogmes, le sentiment religieux persistera. Il prendra une forme différente. Regardez autour de vous: tout l'effort de la raison n'a pu l'ébranler, au contraire! Le sentiment religieux, il se laïcise déjà, il est partout! Dans tout ce qu'on tente, d'un bout à l'autre du monde, pour défendre le droit, pour préparer un avenir social meilleur, une répartition plus équitable des biens et des devoirs! La charité, l'espérance et la foi... Mais c'est exactement ce que, sans employer les mêmes termes, je m'efforce de pratiquer depuis que je suis affranchi. Alors? N'est-ce qu'une question de mots? Qu'est-ce qui me guide obscurément vers le bien, sinon la permanence en moi d'un sentiment religieux qui a survécu à ma foi? Et d'où vient qu'il y ait, en chacun de nous, ce même principe de perfectionnement?
Non, non, la conscience humaine est religieuse, en son essence. Il faut l'admettre comme un fait... Le besoin de croire à quelque chose!... Ce besoin-là est en nous comme le besoin de respirer.
(A Dalier, qui semble prêt à l'interrompre.) Dites!
DALIER.—C'est au nom de ce besoin-là qu'on a toujours légitimé les préjugés,—les erreurs!
Barois le regarde longuement. Il semble hésiter.
BAROIS.—Et s'il y avait des erreurs ... qui fussent utiles,—du moins pour l'état actuel de l'humanité...—est-ce que ces erreurs-là ... à notre point de vue humain ... ne ressembleraient pas singulièrement à des vérités?...
DALIER (sourire imperceptible).—J'avoue que je suis surpris, monsieur, de vous entendre plaider le droit à l'erreur...
Barois ne répond pas tout de suite.
BAROIS (penché en avant, sans regarder Dalier).—C'est parce que je me suis rendu compte, mon ami, qu'il existe des êtres, des êtres qui vivent, qui aiment,—des êtres qui sont aimés!—auxquels l'erreur est mille fois plus nécessaire que la vérité, pour cette raison qu'ils l'assimilent entièrement, qu'elle les fait vivre! Tandis que la vérité les laisserait mourir d'inanition, comme des poissons tirés sur la terre ferme... Et à ces êtres-là, nous n'avons pas le droit ... non, nous n'avons pas le droit...
Il lève la tête et heurte le regard de Dalier.
Vous me regardez? Vous vous dites: «Décidément le patron est fini...» (Sourire indifférent.) Je n'en sais rien, vous avez peut-être raison.
La vérité, oui... La vérité quand même! C'est le grand mobile des consciences, tant qu'elles sont jeunes. Plus tard, on perd cette assurance: on admet la possibilité d'erreurs provisoires, individuelles; on préfère l'indulgence à la stricte justice...
Un temps.
Que voulez-vous, on est à peu près forcé de se contredire en vieillissant... On s'est donné, trente ans de suite, la tâche de rendre la vie plus complète, plus harmonieuse: et on s'aperçoit qu'en somme, on n'a pas perfectionné grand'chose... On se demande même quelquefois si, à la pratique, le neuf vaut toujours l'ancien?... Alors, on ne sait plus... Comment ne pas se contredire? Quand on est sincère, quand, année par année, on a acquis le sens total de la réalité, il est impossible de n'être que logique...
DALIER (dur).—Vous sembleriez dire que l'homme n'est pas capable de profiter jusqu'au bout des enseignements de la raison seule!
Barois le regarde longuement. Pause.
BAROIS (inattentif).—On est jeune—je l'ai été!—on va, on va... Jusqu'au moment où l'on comprend qu'il y aura une fin à tout ça... A partir de ce moment-là!... Oh, on est prévenu longtemps d'avance, on a tout le temps de s'y habituer... Même, au début, on ne sait pas ce que c'est; la confiance, l'entrain fléchissent; on se dit: «Qu'est-ce que j'ai donc, maintenant?» Et puis, doucement, peu à peu, on se sent tiré en arrière... Et il n'y a pas de résistance possible!
A partir de ce moment-là, vous verrez, mon petit, comme on considère différemment les choses...
Il sourit péniblement...
Dalier sent vibrer sa jeunesse: un plaisir sportif, à arracher le flambeau aux mains qui tremblent!
DALIER (vivement).—En tous cas, je ne vois vraiment aucun moyen de modifier mon article selon vos vues actuelles.
Un garçon remet à Barois une carte de visite.
BAROIS.—Faites attendre, je sonnerai.
Un temps.
DALIER.—Il faudrait refaire tout le travail. (Ferme.) Je ne le pourrais plus.
Barois, distrait, roule la carte entre ses doigts. Puis il se tourne vers Dalier avec lassitude.
BAROIS.—Eh bien, faites comme vous voudrez.
Dalier sorti, il s'approche de la cheminée, active les charbons, et sonne.
Tout à coup, il hausse les épaules.
—«C'est stupide... J'aurais dû m'y opposer carrément.»
Le garçon introduit deux jeunes gens d'une vingtaine d'années.
BAROIS.—Monsieur de Grenneville?
GRENNEVILLE.—C'est moi, monsieur. Permettez-moi de vous présenter mon camarade Maurice Tillet, un normalien.
De Grenneville: mince, taille moyenne; sobre élégance.
Un visage fin, sans dominante. Très français. Petite moustache blonde.
Regard sincère, décidé. Sur les lèvres, une nuance de fatuité ironique.
Dans l'ensemble, ce mélange d'assurance et de retenue, que
le bon élève d'une institution religieuse conserve jusqu'à sa première
aventure.
Tillet: grand, robuste, un peu gauche.
La figure largement taillée; des yeux bruns, vivants et précis; un grand nez; la bouche fendue; une barbe noire, peu fournie.
De fortes mains qui disparaissent dans les poches dès qu'il veut parler, et qui, par réflexion, en ressortent aussitôt.
GRENNEVILLE.—La lettre que vous avez reçue en réponse à votre enquête, est de nous deux.
BAROIS.—Veuillez vous asseoir, messieurs. Je vous remercie de vous être dérangés. (A Grenneville.) Comme je vous l'ai écrit, j'ai l'intention de publier votre étude in-extenso. Elle est de beaucoup la plus intéressante que nous ayons reçue jusqu'ici. Mais, puisque je dois l'accompagner d'un commentaire ... (Souriant) ... critique, j'ai été très heureux d'avoir cette occasion de causer avec vous.
(A Tillet) Vous êtes encore à l'Ecole Normale?
TILLET.—Oui, monsieur. Je commence ma seconde année.
BAROIS.—Normale-lettres, naturellement?
TILLET.—Normale-sciences.
BAROIS (à Grenneville).—Et vous, monsieur, je crois que vous préparez l'agrégation de philosophie?
GRENNEVILLE.—Non, monsieur. Je ne suis que licencié. Je fais mon Droit, et ma dernière année de Sciences politiques.
Barois prend sur son bureau un dossier qu'il feuillète. Il fait un effort pour concentrer son attention.
BAROIS.—Il y a d'abord dans votre réponse quelque chose qui, je l'avoue, m'a choqué infiniment: c'est le mépris manifeste en lequel vous tenez vos aînés, quoi qu'ils aient fait. Croyez qu'il n'y a dans cette observation rien de personnel: c'est le principe qui me surprend. Car ce n'est pas seulement insouciance de jeunesse: votre arrogance a quelque chose d'assuré, de réfléchi, d'intentionnel. (Souriant.) Nous aussi, nous étions convaincus d'avoir raison; mais il me semble que nous respections davantage ceux qui nous avaient précédés. Nous avions,—comment dire?...—une certaine modestie; ou, plus exactement, le sentiment que nous pouvions nous tromper... Vous, au contraire, vous paraissez certains de représenter seuls la partie saine de la jeunesse...
Et pourtant, il y a bien à dire! Car enfin le nationalisme que vous prêchez, est, par définition, une anomalie; ce n'est pas une attitude naturelle pour un peuple; c'est une posture de combat, une parade défensive!
GRENNEVILLE (voix jeune, un peu caustique).—Tout à fait exact. Il est en effet regrettable que la France soit, en ce moment, obligée de se contracter pour expulser d'elle un germe qui serait mortel,—exactement comme un organisme vigoureux dans lequel se serait introduit un corps étranger.
BAROIS.—Ce germe, c'est?
GRENNEVILLE (offensif).—-L'anarchie.
Il s'arrête, prêt à la riposte.
Barois le regarde placidement.
GRENNEVILLE (demi-sourire).—Vous ne nierez pas, monsieur, que notre pays soit en proie à une véritable anarchie? Anarchie raisonnée, sans éclats, mais généralisée, et progressivement destructive... La cause n'en est pas secrète: la majorité, lorsqu'elle a perdu ses croyances traditionnelles, a perdu en même temps sa mesure d'appréciation, les éléments les plus nécessaires à son équilibre.
BAROIS.—Mais ce que vous appelez anarchie, c'est tout simplement la vitalité intellectuelle d'une nation! Il n'y a pas plus de dogmes en morale qu'en religion. La loi morale, ce n'est qu'un ensemble de convenances sociales, et cet ensemble est, par nature, provisoire, puisqu'il doit, pour garder sa valeur pratique, évoluer en même temps que la société: or cette évolution n'est possible que s'il y a, dans la société, ce ferment que vous appelez anarchique, ce levain sans lequel aucun progrès ne peut lever.
TILLET.—Si vous appelez progrès cette succession de soubresauts incohérents!
BAROIS.—Les transitions sont brusques parce que les états se succèdent à intervalles de plus en plus rapprochés: jadis la morale variait d'un siècle à l'autre; actuellement, elle varie d'une génération à la suivante: c'est un fait, il faut l'accepter.
Léger silence.
Les jeunes gens échangent un coup d'œil.
TILLET.—Nous ne sommes pas autrement surpris, de vous voir défendre cette anarchie. Vous avez été, comme vos contemporains, élevé par des écrivains révolutionnaires, insurgés contre tout ce qui avait une stabilité...
BAROIS (plaisantant).—Taine?
TILLET.—Parfaitement! Depuis Gœthe jusqu'à Renan, Flaubert, Tolstoï, Ibsen, tous!...
Barois hausse les épaules sans cesser de sourire.
GRENNEVILLE (pitié tranquille).—Le XIXe siècle tout entier, des Déclarations de 89 à Jaurès, en passant par Lamartine et par Gambetta, est empoisonné par ce romantisme: d'un bout du siècle à l'autre, c'est le même verbiage, pittoresque peut-être, mais dénué de direction et de pensée...
TILLET.—... ou plutôt gonflé de pensées généreuses, mais sans la moindre compréhension du réel. Rien de logique: des nuées. Aucun rapport entre les mots et la vérité sociale.
BAROIS (conciliant).—Ne pensez-vous pas que les mots, quels qu'ils soient, s'appauvrissent mécaniquement de leur sens, quand on les agite à tous les carrefours, pendant un siècle? Ces mots que vous rejetez aujourd'hui comme des coques vides, vous en avez assimilé, malgré vous, le suc...
Ils font, ensemble, le même geste de protestation.
BAROIS.—Et vous-mêmes? Croyez-vous que vous ne vous grisez pas à votre tour de mots creux?
(Il saisit sur son bureau le dossier de l'enquête, et le soulève.) «Discipline», «Héroïsme», «Renaissance», «Génie national»!... Croyez-vous qu'avant quinze ans d'ici ce tintamarre verbal ne paraîtra pas dépourvu de toute pensée précise!
GRENNEVILLE.—Les termes passeront peut-être de mode, mais les fortes réalités qu'ils expriment, dureront. «Nationalisme», «Classicisme», ce ne sont pas des formules vagues: ce sont des pensées claires; ce sont même les pensées les plus claires et les plus riches de notre civilisation!
TILLET (précis).—Le malentendu vient peut-être de ce que nous employons le mot pensée dans une acception différente de la vôtre. Pour nous, toute pensée qui ne se concilie pas avec la vie active jusqu'à se confondre avec elle, n'est pas une pensée: elle n'est rien, elle n'existe pas. On peut, j'en conviens, dire que la pensée doit diriger la vie; mais il faut que ce soit la vie qui fasse naître cette pensée directrice, et qui l'alimente, et qui la règle.
GRENNEVILLE.—Votre génération, contrairement à la nôtre, se contentait de théories abstraites, qui, non seulement ne développaient pas en elle le désir d'agir, mais contribuaient à le stériliser. (Fat.) Ce jeu de mandarin, qui aboutit à une complète inactivité, répugne aujourd'hui à la France nouvelle, à la France de la menace allemande, à la France d'Agadir...
BAROIS (se révoltant enfin).—Mais vous considérez toujours vos aînés comme des rêveurs, incapables de vouloir et d'agir! C'est une monstrueuse injustice,—j'allais dire une monstrueuse ingratitude!
Est-ce que la génération qui a fait l'affaire Dreyfus mérite d'être qualifiée d'inactive? Aucune génération, depuis la Révolution, n'a eu davantage que la nôtre à lutter, à payer de sa personne! Beaucoup d'entre nous ont été des héros! Si vous l'ignorez, allez apprendre votre histoire contemporaine! Notre goût de l'analyse était autre chose qu'un stérile dilettantisme, et notre passion pour certains mots qui vous semblent aujourd'hui sonores et vides, comme «Vérité» et «Justice», a pu être, à son heure, inspiratrice d'action!
Courte pause.
GRENNEVILLE (respectueux et froid).—Vous revendiquez bien haut ce court moment, où certains d'entre vous ont consenti—et pour quelle cause!—à descendre dans l'arène. Remarquez justement combien cette crise a été brève, et vite suivie de découragements célèbres...
Barois ne répond pas.
GRENNEVILLE (avec douceur).—Non, Monsieur, cette génération-là n'était pas taillée pour la lutte: elle n'était pas susceptible de durée.
TILLET.—La preuve, c'est que son activité, pendant ces heures troubles de l'Affaire, s'épanchait au hasard. A tel point qu'aujourd'hui l'Affaire Dreyfus paraît, à ceux qui n'y étaient pas, une mêlée d'énergumènes sans doctrines et sans chefs, se lançant au visage des mots à majuscules!
GRENNEVILLE (sans lâcher prise).—Et voyez les résultats! Qu'est devenu notre régime parlementaire? Vous avez reconnu vous-même, dans Le Semeur, la faillite de vos espérances, et que les réalisations de vos amis avaient trahi vos intentions!
Barois ébauche un geste vague.
Que leur dirait-il? Ils se servent d'armes qu'il a lui-même forgées. D'ailleurs, empêcherait-il ces esprits simplistes de juger l'arbre à ses seuls fruits?
TILLET (concluant).—Les mœurs de la politique actuelle, voilà où nous ont conduits ceux qui, depuis tant d'années, méconnaissent notre génie national. Il est grand temps de nous soumettre à une discipline. Il nous faut une république, où les droits et les devoirs soient différemment répartis.
BAROIS (surpris).—Seriez-vous républicains?
TILLET.—Certes!
BAROIS.—Je ne le croyais pas.
TILLET (vivement).—Malgré de sérieuses divergences d'opinion, malgré le développement incontestable du parti monarchique, la majorité de la jeunesse reste ardemment démocrate.
BAROIS.—Tant mieux...
GRENNEVILLE.—C'est d'ailleurs le sentiment intime de la nation.
BAROIS.—Je m'étonne que vous n'estimiez pas le gouvernement républicain incompatible avec vos principes de hiérarchie et d'autorité.
GRENNEVILLE.—Pourquoi donc? Il s'agirait seulement de l'améliorer.
TILLET.—Il s'agirait de réformer le régime parlementaire pour épurer les habitudes politiques; et de dévier le principe de la souveraineté nationale, qui ne correspond en fait à rien de précis, vers la souveraineté des syndicats professionnels ou autres groupements constitués. Cela reviendrait au même, du reste, avec l'ordre et la mesure en plus.
BAROIS (souriant).—C'est encore sur ces points-là, voyez-vous, que nous pourrions nous entendre le mieux. Je souhaite que la jeune couvée parvienne à réglementer notre régime, et à faire passer les préoccupations sociales avant les agitations des partis politiques...
GRENNEVILLE (avec assurance).—Ce but, nous l'atteindrons tout naturellement, lorsque nous aurons davantage accrédité dans le pays notre morale traditionnelle.
BAROIS (souriant toujours).—Et qu'est-ce que vous appelez «notre morale traditionnelle?»
GRENNEVILLE.—La morale catholique.
Barois ne sourit plus; il les regarde posément.
BAROIS.—Car vous êtes tous deux catholiques? Catholiques pratiquants?
GRENNEVILLE.—Oui.
BAROIS.—Ah...
Une pause.
BAROIS (avec une angoisse soudaine).—Répondez-moi loyalement, messieurs; est-ce que vraiment, aujourd'hui, la grande majorité des jeunes gens est catholique?
GRENNEVILLE (brève hésitation).—Je ne sais pas; je sais seulement que nous sommes très nombreux. Parmi les plus jeunes, parmi ceux qui sortent du collège, je crois qu'il y a une majorité incontestable de pratiquants. Parmi nous, leurs aînés de quatre ou cinq ans, je crois pouvoir affirmer qu'il y a approximativement autant de croyants que d'incrédules; mais ceux qui n'ont pas la foi le regrettent pour la plupart, et agissent en toutes circonstances comme s'ils l'avaient.
BAROIS.—Je vous avoue que cette restriction enlève, selon moi, à cette moitié d'entre vous, toute autorité pour une propagande catholique!
TILLET.—C'est parce que vous ne comprenez pas leur sentiment. S'ils défendent une foi qu'ils ne partagent pas,—mais qu'ils voudraient pouvoir partager,—c'est qu'ils ont reconnu ses vertus actives. Ils ont eux-mêmes expérimenté ces vertus; ils éprouvent une recrudescence d'activité à être enrôlés parmi les défenseurs de la religion. Et, tout naturellement, ils contribuent, par leur effort raisonné, à l'épanouissement d'un ensemble moral qu'ils savent le meilleur possible.
BAROIS (après réflexion).—Non, je ne puis admettre que la protestation religieuse d'un individu qui n'a pas la foi, ait quelque sens. Votre explication est spécieuse, mais elle n'atténue pas ma sévérité pour certains de vos chefs spirituels... Ils n'ont vraiment pas assez voilé le mépris aristocratique que leur inspirent les masses. Toutes les fois qu'ils sont acculés au mur, leur échappatoire équivaut à cet aveu: «La religion est faite pour le peuple, comme le bât pour l'âne; mais nous ne sommes pas bêtes de somme.» Ce qui revient à dire, sans plus, qu'ils considèrent le catholicisme comme une excellente garantie sociale. Mais eux, ils préfèrent se réserver le privilège de la vérité.
(S'animant.) J'ai toujours obéi à un principe diamétralement opposé: j'estime que toute vérité doit d'abord être répandue; qu'il faut affranchir les hommes aussi largement qu'on le peut, sans se préoccuper s'ils sont prêts à faire tout de suite un bon emploi de leur affranchissement; enfin, que la liberté est un bien dont on n'apprend à se servir que petit à petit, et seulement par un usage démesuré!
Silence courtois et désapprobateur.
BAROIS (haussant les épaules).—Mais je vous demande pardon de cette profession inutile... Il s'agit seulement de vous. (Un temps.)
Votre lettre montre assez bien ce qui peut vous attacher au catholicisme; mais elle n'explique pas le chemin qui vous y a mené. Sans doute une foi d'enfant, qui n'a jamais été ébranlée?
GRENNEVILLE.—En effet,—pour moi du moins. J'ai reçu une éducation catholique; j'ai même eu une enfance assez fervente. Pourtant, vers les quinze ans, j'ai subi une éclipse... Mais la foi était en moi, et elle a reparu d'elle-même, pendant que je suivais à la Sorbonne les cours pour la licence de philosophie.
BAROIS.—Pendant que vous suiviez les cours de philosophie à la Sorbonne?
GRENNEVILLE (très naturel).—Oui, monsieur.
Barois n'insiste pas.
Il se tourne vers Tillet.
BAROIS.—Vous aussi, monsieur, vous avez toujours été pratiquant?
TILLET.—Non. Mon père était professeur de sciences naturelles, en province, et il nous a élevés dans une libre-pensée absolue. Aussi ne suis-je venu au catholicisme que très tard, pendant ma préparation à Normale...
BAROIS.—Une véritable conversion, alors?
TILLET.—Oh non, rien de brusque, aucune exaltation. Je suis arrivé au port, naturellement, après avoir cherché à atterrir un peu partout... Et j'ai compris ensuite que j'aurais pu, par la seule logique, m'éviter tous ces tâtonnements; il est tellement évident que seul le catholicisme apporte à notre génération ce dont elle a besoin!
BAROIS.—C'est là ce que je comprends mal...
TILLET.—Rien n'est plus simple, cependant. Pour stimuler notre volonté d'action, il nous faut, de toute nécessité, une discipline morale. Il nous faut un cadre immuable et tout fait, pour endiguer définitivement ces restes de fièvre intellectuelle qui nous viennent de vous, et dont nous avons, malgré tout, quelques traces dans le sang.
Eh bien, la religion catholique nous offre tout ça. Elle étaye notre personnalité de son pouvoir et de son expérience, fondés sur une épreuve de vingt siècles. Elle exalte notre sens de l'action, parce qu'elle s'adapte à toutes les nuances de la sensibilité humaine, et qu'elle confère un merveilleux supplément de vie à ceux qui l'embrassent sans marchander. Or, tout est là: il nous faut aujourd'hui une foi capable de décupler notre activité.
BAROIS (qui a suivi attentivement).—Soit. Mais enfin, cette défaveur que vous affichez complaisamment pour l'intelligence spéculative, ne va pas jusqu'à vous laisser dans l'ignorance de certaines vérités, acquises aujourd'hui par la science, et qui ont ruiné les bases de cette religion dogmatique?
Comment l'acceptez-vous alors, dans son intégrité? Comment conciliez-vous, par exemple...
TILLET (vivement).—Mais nous ne cherchons pas à concilier, monsieur... La religion est sur un plan; la science est sur un autre. Les savants ne pourront jamais atteindre la religion, dont les racines sont hors de leur portée.
BAROIS.—Mais l'exégèse attaque directement ... dans ses origines mêmes...
GRENNEVILLE (sourire tranquille).—Non, nous ne nous comprenons pas...
Ces difficultés auxquelles vous faites allusion, elles n'existent pas pour nous. Quelle valeur peut avoir la contestation d'un professeur d'hébreu, qui tire ses arguments d'une comparaison de vieux textes, à côté de la certitude intime de notre foi? (Riant.) Je vous assure, je suis stupéfait de penser que des affirmations de cette qualité ont pu avoir une influence décisive sur la croyance de nos aînés!
TILLET.—Au fond, la logique d'un raisonnement historique ou philologique n'est qu'apparente: elle ne peut rien contre le cri du cœur. Lorsqu'on a éprouvé personnellement l'efficacité pratique de la foi...
BAROIS.—Permettez. Cette efficacité, à laquelle vous revenez toujours, il y a bien des convictions philosophiques qui...
TILLET.—Mais nous les avons passés en revue, tous vos systèmes! Depuis votre fétichisme de l'évolution, jusqu'au mysticisme romantique de vos philosophes athées! Non! Notre vitalité renaissante exige d'autres appuis que ceux-là! Nous aspirons à nous passionner, mais nous voulons que ça en vaille la peine! Votre génération ne nous a rien légué qui puisse servir de règle à une existence pratique.
BAROIS.—Toujours ce même refrain: la vie pratique! Vous ne paraissez pas vous douter que cette recherche exclusive de résultats palpables et immédiats, est au détriment de votre noblesse intellectuelle!
Nous étions moins intéressés!
GRENNEVILLE.—Pardon, monsieur, pardon... C'est qu'il ne faudrait pas confondre vie active et vie simplement pratique... (Souriant.) Je vous affirme que nous continuons à penser, et même que nos pensées s'élèvent assez haut. Mais elles ne se perdent plus dans les nuages, et c'est un incontestable progrès. Nous les asservissons à des besoins précis. Tout ce qui est abstraction stérile nous fait horreur, comme une lâcheté devant la vie et devant les responsabilités qu'elle impose.
BAROIS.—C'est la faillite de l'intelligence.
TILLET.—De l'intellectualisme, tout au plus...
BAROIS.—Tant pis pour vous, si vous ne connaissez plus l'ivresse de la raison et de la pensée pure...
TILLET.—C'est consciemment que nous ayons substitué le goût du devoir présent à ces méditations fumeuses qui n'aboutissaient qu'à faire des sceptiques et des pessimistes.
Nous avons une superbe confiance en nous.
BAROIS.—Je le vois bien. Nous aussi, nous avions confiance!
TILLET.—Ce n'était pas une confiance de même nature, puisque la vôtre ne vous a pas empêchés de sombrer dans le doute...
BAROIS.—Mais le doute n'est pas uniquement cette position négative que vous croyez! Allez-vous nous faire un grief de ne pas avoir trouvé la clef de l'énigme universelle? Les recherches de ces cinquante dernières années ont établi que la plupart des affirmations dogmatiques qui passaient pour exprimer la vérité, ne la renfermaient pas. Et c'est déjà quelque chose, à défaut de posséder la vérité, que d'avoir bien repéré les endroits où elle n'est pis!
GRENNEVILLE.—Vous vous êtes heurté à l'inconnaissable, et vous n'avez pas su lui faire dans votre vie sa véritable place, en y découvrant un principe de force. Vous étiez parti de cette conviction a priori, que l'incrédulité était supérieure à la foi, et vous...
BAROIS.—Ainsi vous êtes assez peu conscients pour parler de convictions a priori! Vous qui êtes les dupes de la première théorie toute faite que l'on vous a proposée! Vous me faites penser au bernard-l'ermite, qui s'installe dans la première coquille inhabitée qu'il rencontre... C'est comme lui, que vous êtes entrés dans le catholicisme! Et vous vous y êtes moulés, au point de vous imaginer maintenant,—et de faire croire—que cette enveloppe vous est naturelle!
GRENNEVILLE (souriant).—C'est un procédé qui peut avoir de grands avantages... Il suffit pour le justifier qu'il nous vaille un accroissement de courage.
TILLET.—Pour vivre, il faut une direction. Le principal est d'en choisir une qui ait fait ses preuves, et de s'y tenir!
BAROIS (pensif).—Je n'ai pas encore compris ce que vous y gagnez...
GRENNEVILLE.—Nous y gagnons une sécurité qui vous a toujours manqué!
BAROIS.—Je ne vois pas davantage ce que vous apportez de nouveau ou d'utile. Tandis que je vois fort bien ce que vous apportez de nuisible: une agitation volontairement perturbatrice, qui interrompt, qui compromet l'effort de vos devanciers, et qui risque de retarder, sans profit, leur entreprise...
GRENNEVILLE.—Nous apportons notre goût de l'action, capable, à lui seul, de régénérer l'esprit français!
BAROIS (perdant patience).—Mais vous parlez toujours de l'action, de la vie, comme si vous en aviez acquis le monopole! Nul n'a plus passionnément aimé la vie que moi! Et pourtant cet élan m'a jeté exactement à l'opposé de vous: il vous a donné la nostalgie de la foi; et moi, il m'en a irrémédiablement détaché!
Long silence.
BAROIS (avec lassitude).—L'homme n'est peut-être pas capable de profiter, plusieurs générations de suite, des enseignements de sa raison...
Il s'arrête. Il a prononcé cette phrase machinalement, et voici qu'il la reconnaît: c'est celle que Dalier lui opposait, il y a une heure...
Dalier!
Suffit-il maintenant qu'on le contredise, dans un sens ou dans un autre, pour provoquer de sa part une égale révolte?
Toujours fuyante, la vérité?
Il passe la main sur son front. Il aperçoit ces deux enfants,
raidis dans leur certitude...
Ah, non, certes, ce n'est pas là qu'elle est, la vérité!
BAROIS.—Ça tourne... Je pourrais être votre père, et nous ne nous comprenons plus: c'est la loi...
Ils échangent un bref sourire, qui le blesse à vif.
Il les toise: il les découvre enfin tels qu'ils sont.
BAROIS.—Mais ne vous faites pas d'illusion, messieurs, sur votre rôle... Vous n'êtes pas autre chose qu'une réaction. Et cette réaction était tellement inévitable, que vous n'avez même pas la gloriole de l'avoir provoquée: c'est l'oscillation du pendule, le reflux mécanique, après le flux... Un moment à attendre: la mer monte quand même!
GRENNEVILLE (agressif).—A moins que nous ne soyons le début d'une évolution dont vous ne soupçonnez même pas les conséquences!
BAROIS (sèchement).—Non. Une évolution n'aurait pas cet aspect brusque, arbitraire, défensif...
Il est debout et il se met à rire en sentant renaître la combativité de jadis. Il arpente la pièce, les poings aux poches, l'œil vif et direct, la lèvre moqueuse.
BAROIS.—Vous représentez un mouvement social, c'est indéniable mais un mouvement isolé, sans tenants et sans aboutissements possibles: vous n'avez qu'un intérêt documentaire. Vous parlez haut; vous voulez re-créer l'univers; vous datez le monde d'une ère nouvelle, qui correspond ingénûment avec votre vingtième année... Vous affirmez,—avant d'avoir pris le temps matériel d'apprendre et de juger.
Voulez-vous me permettre d'aller plus loin encore?
Il y a, à l'origine de votre attitude, un sentiment que vous n'avouez pas,—peut-être parce qu'il n'est pas très glorieux,—mais surtout, je crois, parce qu'il est obscur et que vous n'en avez pas pris conscience: c'est un vague sentiment de peur...
Mouvement des jeunes gens.
BAROIS.—Oui... Sous ces grands mots d'ordre, de courage national, il y a un peu ce que vous croyez y mettre; mais il y a encore autre chose: un assez vulgaire instinct de conservation!
Depuis votre naissance, vous avez senti que les hardiesses du XIXe siècle finiraient par ébranler une à une les bases, sur lesquelles l'équilibre social est encore assis; vous avez senti qu'en sapant l'arbre malade sur lequel vous avez votre nid, les aînés,—ces mandarins, ces dilettantes, ces impuissants!—allaient vous faire faire un plongeon un peu trop brusque dans l'avenir... Et vous vous êtes raccrochés, d'instinct, à tout ce qui peut étayer votre instabilité, pour quelque temps encore: vive la force, messieurs, vive l'autorité, la police, la religion! Ce sont les seules digues aux libertés des autres; et vous avez clairement compris que ces libertés-là ne pouvaient s'exercer qu'au détriment de votre situation personnelle! Le progrès marchait un peu trop vite: vous bloquez les freins... Vous n'avez pas le cœur assez solide, vous avez le vertige...
Vos protestations d'activité manquent un affaiblissement de la pensée française, qui a besoin de repos, peut-être, pour avoir trop longtemps de suite poussé sa pointe dans l'inconnu. Soit; c'est d'ailleurs une vieille histoire: il a existé une autre société de privilégiés, qui n'a pas osé faire la Révolution, et qui l'a payé de quelques têtes...
Les jeunes gens se sont levés; leur attitude déférente et hostile
exaspère Barois. Sa fougue vient se briser contre le sourire
impertinent de deux gamins.
Un silence.
GRENNEVILLE.—Vous nous excuserez de ne pas vous suivre sur ce terrain-là... Je crois que nous avons dit tout ce que nous avions à dire.
Barois leur tend la main.
BAROIS.—Je vous remercie de votre visite. Votre lettre paraîtra tout entière. Le public jugera.
GRENNEVILLE (à la porte).—Vous avez la certitude, monsieur, que votre génération «a poussé une pointe dans l'inconnu?» (Il sourit.) C'est fort heureux, sans quoi la vieillesse de vos amis s'annoncerait bien amère... Je remarque seulement combien ces vérités soi-disant libératrices, ont mal affranchi la plupart de vos contemporains!
BAROIS (tranquille).—Peut-être. Mais elles libéreront complètement nos descendants... (Souriant.)—et les vôtres, messieurs!..
Dans l'escalier du Semeur.
Marie, en montant, croise un petit vieillard.
MARIE.—Bonjour, docteur.
LE MÉDECIN (se découvrant avec politesse).—Mademoiselle...
MARIE.—Je suis la fille de M. Barois.
LE MÉDECIN (souriant, la main tendue).—Excusez-moi, Mademoiselle.
MARIE.—Je suis bien heureuse de vous rencontrer, docteur. Je voudrais tant être renseignée sur la santé de mon père! (Poussant la porte d'un bureau vide.) Puis-je vous retenir un instant?
LE MÉDECIN (la suivant).—Mais, Mademoiselle, il me semble que vous vous inquiétez à tort. Notre malade va ce soir aussi bien que possible. Dans quelques jours...
Marie l'arrête et le regarde franchement, de ses yeux masculins.
MARIE.—Vous pouvez me dire la vérité, docteur. Je me trouve dans des circonstances spéciales: je suis à la veille d'entrer au couvent, en Belgique. Dans quelques mois, j'aurai vu mon père pour la dernière fois... (Se dominant.) Je vous donne ces détails pour que vous compreniez... Ce n'est pas la crise actuelle qui me préoccupe. Je sens que mon père a quelque chose de grave, de très grave: il a tant changé depuis deux ans!
LE MÉDECIN.—Mon Dieu, Mademoiselle, c'est certain... M. Barois est atteint dans son état général... (Il se reprend aussitôt.) Mais c'est un mal qui ne l'empêchera pas de vivre longtemps encore, avec des précautions, une bonne hygiène... A l'âge de M. Barois, il faut bien s'attendre à quelques misères...
MARIE (pressante, le masque dur).—Il ne peut pas guérir, n'est-ce pas!
Le médecin hésite, mais un coup d'œil le décide à la franchise; il secoue négativement la tête.
Court silence.
LE MÉDECIN.—Je vous le répète. Mademoiselle, c'est un mal à très longue échéance... L'excès de travail, la parole en public surtout, ont attaqué peu à peu le cœur. D'autre part, votre père a présenté, étant enfant, des signes de ... d'anémie. Il a été traité énergiquement, et on était parvenu à enrayer le mal, puisqu'il ne s'en est pas ressenti pendant plus de quarante ans! Malheureusement il a eu cette pleurésie, que nous avons soignée ensemble, voici...
MARIE.—Deux ans.
LE MÉDECIN.—... Alors, il s'est produit une chose qui arrive quelquefois: l'inflammation des bronches facilite la pénétration des germes, et fait évoluer tout à coup la tuberculose assoupie... (Mouvement de Marie.) Oui, même après quarante années d'arrêt, c'est fréquent; des lésions anciennes se réveillent... Mais, je vous le répète. Mademoiselle, chez les vieillards ces maladies-là sont très lentes, avec des symptômes atténués, de longs arrêts, puis des reprises...
MARIE (les yeux fixés sur le médecin).—Et, ce qu'il vient d'avoir, c'est une de ces reprises?
LE MÉDECIN.—Oh, très bénigne... Votre père a pris froid, l'autre jour; il n'en faut pas davantage pour que l'état général s'en ressente.
MARIE.—Je vous remercie, docteur C'est tout ce que je voulais savoir.
Le logement de Barois: deux pièces basses, une cuisine.
Barois est allongé près de la fenêtre, d'où il s'intéresse aux
allées et venues de la cour.
Marie, les manches relevées, un tablier sur sa robe, remet de l'ordre dans la chambre.
BAROIS.—Je vous en conjure, Marie... La femme de ménage rangera ça demain matin.
MARIE.—Elle ne revient donc pas le soir?
BAROIS (souriant).—Non.
MARIE.—Et qu'est-ce qui fait votre dîner?
BAROIS.—La concierge. (Gaiement.) Vous savez, quand on est seul, ce n'est pas long, un dîner...
MARIE (après une pause).—Avouez, Père, que Pascal vous manque? Je vous l'avais bien dit...
BAROIS (gêné).—Mais non. Je suis parfaitement soigné, je ne manque de rien... D'ailleurs je n'avais pas la place de loger un domestique ici.
Un silence.
Marie reprend ses rangements. Barois la suit des yeux.
Elle passe à sa portée: il saisit sa main et l'appuie à ses lèvres. Elle sourit; mais leurs regards sont lourds d'arrière-pensées.
BAROIS (jouant avec la main de Marie).—Moi qui me faisais une fête de ces huit jours à Paris, avant votre noviciat! Et toutes vos visites auront été des séances de garde-malade!
MARIE.—Vous viendrez me voir à Wassignies...
A l'évocation du couvent, ses pommettes rosissent.
BAROIS.—Les novices ne sont donc pas cloîtrées?
MARIE.—Si. Mais on vient leur dire adieu, la veille de la prise du voile...
Une larme glisse sur son sourire.
Barois lâche sa main.
BAROIS.—Votre mère ne se soucierait guère de me rencontrer là-bas...
Sa voix est indifférente, à peine interrogative. Mais il la dévisage de biais, anxieusement.
Elle fait un signe de protestation.
BAROIS (ton léger, où perce du plaisir).—Et puis, ma pauvre Marie, je ne suis plus en état de voyager...
Un appartement modeste, rue de Passy.
Luce, à sa table de travail.
Il retire hâtivement ses lunettes en voyant entrer Barois, et
va vers lui.
LUCE.—Je suis bouleversé, mon cher ami... Que s'est-il passé?
Barois, essoufflé par les trois étages, s'assied lourdement, le poing sur le cœur; son sourire demande quelque répit.
LUCE (après un instant).—Je n'ai trouvé dans votre mot aucun motif plausible...
BAROIS.—Je vous en prie, mon vieil ami, ne cherchez pas à me convaincre. Ma décision est prise.
Luce fait un geste d'incompréhension, et va s'asseoir à son bureau.
BAROIS.—J'y pensais depuis longtemps, ce n'est pas un coup de tête.
LUCE (attentif).—Remettez-vous à un nouveau travail, Barois, et vous verrez, vous retrouverez vite l'équilibre!
BAROIS.—Je suis incapable de faire un projet. (Soucieux.) D'ailleurs je vais avoir à m'absenter bientôt... Vous savez, cette cérémonie en Belgique... Ma fille...
LUCE (vivement).—Ah... Eh bien, attendez, croyez-moi; ne prenez aucun parti avant votre retour.
Barois devine sa pensée; il sourit péniblement.
BAROIS.—Non, ce n'est pas ça... Je ne suis plus, ni physiquement ni moralement, le chef qu'il faut au Semeur. L'entrain n'y est plus. Le public s'en aperçoit bien. Et les collaborateurs! En fait, la direction m'échappe de jour en jour: ce sont les jeunes venus qui donnent le ton, maintenant. Moi je suis le vieux, débordé et suspect... (Sourire amer.) Et puis, voilà assez longtemps que Breil-Zoeger attend la place...
Il tire de sa poche un manuscrit plié qu'il pose sur le bureau.
BAROIS.—Tenez. J'ai voulu vous soumettre ça: une sorte de confession, de testament... J'ai l'intention d'y consacrer un numéro du Semeur. Pour ne pas m'en aller comme un vaincu, vous comprenez? Un dernier numéro, tout entier pour moi seul. Après, je me tairai.
LUCE.—Vous ne pourrez pas!
BAROIS.—Pourquoi donc? Justement, les médecins me prescrivent le repos; ils veulent que je quitte Paris, que je m'installe en banlieue, au grand air...
LUCE.—Un homme comme vous ne se condamne pas volontairement au silence!
BAROIS.—Oh si!... Il y a des stations, dans la vie, où il faut savoir s'arrêter, se tourner sur soi-même et prendre une détermination.
LUCE (penché).—Supposez un instant que les rôles soient renversés; que je sois venu vous dire: «Je quitte tout, je renonce à vivre...»
BAROIS.—Ah, vous, vous n'en auriez pas le droit! Mais ce n'est pas la même chose.
LUCE.—Je n'ai rien que vous n'ayez vous-même...
BAROIS.—Vous avez une sagesse qui accepte tout ce qui arrive... C'est la différence qu'il y a entre le bonheur et le malheur.
LUCE (souriant).—Il est si facile de ne chercher son bonheur que dans les satisfactions de la raison!
BAROIS (farouche).—Elles ne me suffisent plus!
Une pause.
BAROIS.—J'en ai assez de me débattre dans une vie dont le sens m'échappe...
Luce est assis, les bras croisés, les yeux à terre. Aux derniers mots de Barois, il lève son regard pensif et reste un instant avant de répondre.
LUCE.—Voilà le point malade... Mais pourquoi vouloir à tout prix porter un jugement définitif sur la vie? Pourquoi toujours poser ces problèmes insolubles?
BAROIS (violence soudaine).—Pourquoi? Mais parce que, si je disparais, moi, avant d'en avoir la clef, mon effort n'aura abouti à rien! Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, à moi, Barois, de penser que dans deux mille ans, on en saura peut-être un peu plus que nous? Cette énigme, c'est moi seul qu'elle oppresse!
LUCE.—Il faut se rappeler que Moïse n'est pas entré en Terre promise...
BAROIS (avec une animosité involontaire).—Ah, je ne sais vraiment pas comment vous êtes fait! On dirait que vous ne vous êtes jamais trouvé en tête à tête avec la mort! Vous avez eu des chagrins, pourtant, des deuils. Après la mort de votre femme...
LUCE (d'une voix subitement voilée).—Oui, à ce moment-là, j'ai désespéré de tout... Pendant plusieurs semaines. (Relevant le front.) Et puis un matin, dans le jardin,—nous habitions encore Auteuil,—je me souviens, j'ai vu à nouveau les arbres, le soleil, les petits... Peu à peu, j'ai remonté la pente.
BAROIS.—Moi, voyez-vous, je n'ai plus une heure de paix, depuis que je sens mon tour approcher! Autrefois je me disais: «Oui, elle viendra, elle me prendra, comme les autres...» (La main au cœur.) Mais maintenant je sais par où, et tout est changé! Je sens son crampon qui a mordu là, qui m'attire par ce lambeau de chair malade, qui m'attire, moi, mon œuvre, la joie que j'aurais à vivre...
Ah, je ne peux pas me résigner à ce néant!
Un silence.
LUCE.—Nous ne voyons pas les choses de même. Pour moi, la vie et la mort se sont toujours confondues. C'est la suite du même mystère... Et j'envisage ainsi le problème depuis tant d'années, que je n'ai plus la moindre velléité de révolte!
BAROIS.—Votre consentement est au-dessus de mes forces!
LUCE.—Je ne consens pas! Mais je ne m'insurge pas non plus. Je me sens si peu de chose dans l'agencement des lois universelles... Je me suis habitué à n'être qu'une parcelle d'univers qui accomplit sa destinée; je me relie au passé et à l'avenir: je me devine, par avance, prolongé par ceux qui feront, après moi, la même œuvre que moi. (Souriant.) Je vous répète que les satisfactions de la raison ont pour moi une extrême importance: ce que la mort a de rationnel, quand on l'envisage ainsi, me la fait accepter aussi naturellement que la naissance.
BAROIS.—Je vous envie.
LUCE.—Mais ce calme est à la portée de chacun!
Barois secoue la tête.
LUCE (ton de reproche).—Je vous assure que si j'étais, comme vous, paralysé par la mort, je me contraindrais à réagir. Nous sommes un fragment de vie universelle,—peut-être le seul qui ait conscience de lui-même: cette conscience nous fait un devoir de vivre le plus possible.
Vous, Barois, vous qui aimiez tant la vie!
BAROIS (avec désespoir).—Mais je l'aime plus que jamais, mon ami, et c'est bien ce qui m'empêche d'accepter qu'elle puisse finir! Plus j'aime la vie, et moins je me résigne aux conditions dans lesquelles il faut vivre. Pourquoi la conscience, si c'est pour contempler le néant?
Luce le regarde sans répondre.
BAROIS.—Le néant... J'ai beau me raisonner, je ne peux plus sortir de là!
LUCE.—Vous vous laissez dominer par votre moi. C'est fréquent, lorsqu'on vieillit: la personnalité devient plus précise, plus pesante; on est moins sollicité par l'extérieur, on concentre ses facultés sur soi... Il faut lutter contre cette ankylose!
BAROIS (s'abandonnant).—Ah, mon pauvre Luce, comment ne pas désespérer de tout? Voyons! A quoi ont abouti nos efforts? Récapitulez nos déceptions, depuis l'Affaire! Partout le mensonge, l'intérêt, l'injustice sociale, comme avant! Où est-il le progrès? Y a-t-il une seule de nos certitudes qui se soit imposée, grâce à nous? Au contraire, je constate plutôt un recul, puisque les jeunes nous renient, et qu'ils ont pris le contre-pied de tout ce qui nous avait paru définitif! Quelle pitié! Voilà que beaucoup d'entre eux se soumettent intégralement au catholicisme! Est-ce qu'ils ignorent nos attaques? Non, mais ils y ont trouvé des réponses en accord avec les besoins de leurs tempéraments, et ils sont assurés, autant que nous l'étions nous-mêmes! Ils ont même découvert de subtils détours pour réhabiliter le libre arbitre, et pour s'en faire une raison d'agir! Ce sont des faits, mon cher...
Nous aurons beau travailler à améliorer le sort des autres, à les affranchir, toute la nature travaille contre nous: toutes les injustices, toutes les erreurs renaissent avec chaque couvée neuve, et c'est toujours la même lutte, et toujours la même victoire du fort sur le faible, du jeune sur le vieux, éternellement!
LUCE (très ferme).—Non, je ne peux pas vous suivre, je ne peux pas voir le monde si mauvais que vous le faites... Non... Au contraire, je vois qu'en somme, malgré des écarts, qui me désespèrent autant que vous, c'est tout de même l'ordre et le progrès qui finissent par gagner, peu à peu... Vue d'ensemble, l'humanité avance. C'est incontestable. Aucun esprit de bonne foi ne pourra le nier.
Barois se met à rire.
BAROIS.—Avouez donc que la croyance au progrès est un postulat optimiste qui est nécessaire à votre équilibre personnel!
Le progrès? L'outillage, les méthodes, oui, tout ce qui dépend de l'observation et de l'exercice, a progressé... Mais dans le fond qu'y a-t-il de nouveau depuis les philosophes grecs? Sur la vie, sur la mort, nous n'en savons pas plus qu'eux... Conjectures! Impossible d'affirmer ni de nier avec certitude l'existence de l'âme, la liberté...
LUCE.—C'est déjà beaucoup d'avoir bien prouvé que tout se passe comme si l'âme et la liberté n'existaient pas.
BAROIS.—Ces acquisitions négatives et provisoires ne me contentent plus!
LUCE (tristement).—Vous aussi, Barois, vous voilà atteint par la contagion? Ah, je reconnais que nous vivons à une époque bouleversée... Mais comment ne sentez-vous pas que c'est l'avenir qui germe sous cette souffrance! Tu enfanteras dans la douleur...
Vous n'avez pas prononcé le cri du ralliement actuel, mais il était déjà sur vos lèvres: la faillite de la science... Formule commode! Une classe ignorante la répète depuis dix ans, et la jeune génération s'en est emparée, sans révision; car c'est plus facile à affirmer qu'à vérifier... (Avec orgueil.) Pendant ce temps-là, elle travaille, la science en faillite, et son apport s'accroît peu à peu: les théories qu'elle avait provisoirement ébauchées, elle les retouche quotidiennement, elle les consolide par de nouvelles découvertes... Elle avance sans répondre,—et c'est elle qui aura le dernier mot!
Il se lève et fait quelques pas, les mains derrière le dos.
LUCE.—C'est une réaction inévitable... Stupidement, on a voulu exiger de la science beaucoup plus qu'elle ne pouvait donner à ses débuts,—peut-être même plus qu'elle n'est susceptible de donner jamais. On a cru tout possible d'elle. Et maintenant il y a des esprits scientifiques, comme vous, qui se laissent aveugler par leur point de vue individuel: ils se disent naïvement, quand sonne leur soixantaine: «Voilà trente ans que je travaille. En ces trente années, mon existence à moi s'est chargée d'événements... Eh bien, pendant ce temps, la science, qu'a-t-elle fait? Je ne vois guère qu'elle ait progressé.»
La faillite de la science, mon ami, résulte tout simplement de la disproportion qui existe entre la brièveté de notre vie d'hommes, et la lente évolution des connaissances. Vous et les autres, vous êtes le jouet d'une apparence: vous êtes comme nos ancêtres qui ont affirmé pendant des siècles l'inertie du monde minéral, parce qu'au cours de leur rapide existence ils n'arrivaient pas à observer de modification sensible dans la composition d'un caillou!
Barois l'écoute avec une incurable indifférence.
BAROIS.—Oui... autrefois ce genre de raisonnement me satisfaisait. Maintenant non. J'y vois un agencement logique: mais rien de tout ça ne m'atteint à l'endroit où je souffre...
Un silence.
BAROIS.—(Les larmes aux yeux.) Ah, c'est affreux de vieillir...
LUCE (vivement).—Mais vous êtes plus jeune que moi!
BAROIS (grave).—Je me sens très vieux, mon cher. Je suis une machine usée; les leviers n'obéissent plus. Le cœur bat la breloque. J'ai là ... (il touche sa poitrine) comme un soufflet percé... Le moindre refroidissement me met au lit, avec la fièvre... Je suis fini, je me sens incapable de fournir une étape nouvelle...
LUCE (sans conviction).—Vous traversez une période de dépression qui passera...
BAROIS (avec rancune).—Mais vous ne sentez donc pas les années, vous! Le cerveau qui fléchit, les habitudes qui se figent... L'isolement, le vide sentimental, l'impossibilité de prendre quelque chose à cœur... Ah, sapristi, je les sens bien, moi! Ma vie est bloquée; c'est une impression atroce, je suis incapable d'activité: je n'ai plus qu'une mortelle envie ... d'avoir envie d'agir!
Et quand je me retourne vers le passé, qu'est-ce que j'y trouve? Qu'est-ce que j'ai fait?
Mouvement de Luce.
BAROIS (l'interrompant).—Evidemment, j'ai écrit, j'ai aligné des mots, j'ai échafaudé des argumentations... Je laisse des livres, des articles qui ont eu leur actualité... Mais croyez-vous que je sois dupe? que je m'illusionne sur la pauvreté de tout ça?
LUCE.—Vous méconnaissez votre vie, Barois, ce n'est pas digne. Vous avez cherché; vous avez trouvé des parcelles de vérité: vous les avez divulguées généreusement; vous avez contribué à extirper quelques erreurs, et à préserver quelques certitudes qui vacillaient; vous avez défendu la justice, avec une ferveur communicative, qui a fait de vous, pendant quinze ans, l'âme vivante d'un parti...
(Simplement.) Je trouve votre vie très belle.
Une fierté dans les yeux de Barois.
Il sourit et tend la main.
BAROIS.—Merci, mon ami... Autrefois, ces paroles-là m'auraient remis d'aplomb... Je ne rêvais pas d'autre oraison funèbre...
Mais maintenant...
Un silence.
BAROIS.—A quoi pensez-vous?
LUCE.—Je viens d'avoir, en vous regardant, cette idée: que beaucoup de ceux qui nous ont précédés ont dû éprouver cette angoisse... Ces hommes,—à qui nous sommes redevables de tout ce que nous avons pu faire—ont dû avoir ce même désespoir, ont dû s'imaginer que leur effort était inutile... (Un temps.) Allez, allez, Barois, la vérité, c'est qu'il n'y a pas une bonne graine qui se perde, pas une idée qui ne germe un jour, pas une parcelle de conscience acquise, qui disparaisse. Savons-nous si l'une des pensées que nous avons émises, vous ou moi, ne sera pas le point de départ d'une découverte, qui libérera davantage l'avenir? Il suffit, pour avoir fait du bon ouvrage, de s'être donné, humainement, toute sa vie. Quand on a semé le mieux et le plus possible, on peut s'en aller en paix, et céder la place à d'autres...
BAROIS (sombre).—Mais je ne suis pas aussi sûr que vous d'avoir semé le bon grain...
Luce le considère avec un découragement infini.
BAROIS.—J'ai totalement changé d'attitude devant l'univers. Je ne sais plus où j'en suis, voilà la vérité...
Certains jours, comme aujourd'hui, je ne peux plus accepter comme vrai ce que j'ai défendu jusqu'ici. Je sens bien que je n'arriverais pas à me prouver logiquement l'inanité de mes convictions passées; mais,—je ne sais comment dire,—c'est presque physiquement que je les repousse: je les repousse parce qu'elles ne m'ont apporté que des déceptions!
LUCE.—Vous ne raisonnez plus...
BAROIS.—Ah, on peut raisonner quand on a trente ans, quand on a la vie devant soi pour changer d'opinion, une sève qui bouillonne, du bonheur plein les veines! Mais quand on se sent près du terme, on est tout petit devant l'infini...
(Très lentement, les yeux perdus.) On a, par dessus tout, un désir vague ... le désir d'on ne sait quoi ... qui serait le remède à toutes les transes...
Un peu de paix, un peu de confiance... quelque chose sur quoi s'appuyer ... pour n'être pas trop malheureux, pendant le temps qui reste encore...
Il redresse la tête.
Luce, qui souriait mélancoliquement, rencontre son regard:
son sourire s'évanouit.
Long silence.
Après un instant, Barois semble se ressaisir. Il tend son manuscrit à Luce.
BAROIS.—Tenez, lisez ça, voulez-vous?
Vingt minutes passent.
Le jour décroît.
Luce s'est levé, pour s'approcher de la fenêtre. Une symphonie de blancheurs: la vitre blême, le rideau de mousseline, son front pâle, sa barbe, les feuillets...
Les coins de la chambre s'emplissent de grisaille.
Barois, les yeux fixes, attend.
Luce tourne la dernière page. Il la lit jusqu'au bout, attentivement;
la main qui tient le manuscrit s'abaisse; il retire ses
lunettes; ses paupières se plissent à chercher Barois dans la
pénombre.
LUCE.—Mon pauvre ami, que voulez-vous que je vous dise? Je ne peux plus rien pour vous, maintenant...
(Après une pause.) Non ... je ne peux plus rien pour vous, moi...
A Wassignies-sur-Lys, près de Gand.
La voiture de Barois longe un mur de couvent et s'arrête
devant un portail, qui s'entr'ouvre aussitôt. Il traverse une
cour déserte, hésite, et se dirige vers le perron central; lorsqu'il
atteint la dernière marche, la porte close s'ouvre devant lui.
Vestibule dallé. Le battant se referme. Une ombre s'approche, le visage caché sous un voile noir.
Il la suit.
Elle marche vite, agitant sans interruption une claquette de
bois. Des couloirs. La religieuse pousse une dernière porte,
s'efface pour qu'il passe, et donne un tour de clef derrière lui.
Le parloir: vaste salle au carrelage luisant, divisée en deux,
sur toute la hauteur, par un lattis de bois à claire-voie.
Une femme est là, en noir, immobile, écroulée sur une chaise. Il reconnaît Cécile; il s'avance. Elle tressaille et tend la main, sans pouvoir articuler un mot.
Il s'assied près d'elle.
Quelques minutes.
Dans la cour, un carillon léger, se met à sonner ses quatre
heures.
Aussitôt, de l'autre côté du grillage, paraissent trois religieuses, de même taille, la figure voilée de noir. Deux d'entre elles vont s'agenouiller devant une statue de la Vierge. La troisième s'approche, et, à l'aide d'une clef, fait jouer un panneau de la clôture; puis elle va rejoindre les autres, qui récitent une dizaine de chapelet.
Cécile et Barois sont debout, les nerfs à vif.
Cécile écarte les lèvres comme si elle allait mourir.
La dizaine s'achève...
L'une des religieuses se signe, et s'avance. Elle écarte son voile...
Cécile pousse un cri étouffé et l'étreint convulsivement; puis elle se détache brusquement pour la dévisager, comme si elle craignait d'être trompée; et, gémissant de tendresse, elle la serre de nouveau contre son cœur.
Marie se redresse, et sans se dégager, tend la main à son père; il l'embrasse en pleurant. Leurs yeux se rencontrent; Barois retrouve ce regard anxieux, durci, ce sourire crispé, qui est chez elle le signe extérieur de la foi; mais, dans son expression passée, il n'y avait pas tant de lumière.
MARIE.—Par pitié, maman, ne pleurez pas... Dieu vous donnera la force, la consolation... (La voix a perdu son timbre. Elle ajoute, malgré elle:) Si vous saviez comme je suis heureuse!
Cécile halète sur son épaule, zézayant des plaintes vagues.
CÉCILE.—Qu'est-ce que je vais devenir, Marie... Qu'est-ce que je vais devenir...
Marie tient sa mère doucement appuyée contre elle, et lui caresse le front.
MARIE (se tournant vers Barois).—Père, j'ai lu votre manifeste... Oui, c'est la dernière faveur que j'aie demandée... (Elle le considère, les yeux dans les siens. Et, brusquement, avec un éclat d'espoir:) Père, ces pages-là appellent Dieu!...
Barois secoue négativement la tête.
Cécile sanglote toujours, n'écoutant rien, balbutiant:—«Qu'est-ce que je vais devenir... Qu'est-ce que je vais devenir...»
Les regards de Marie vont de l'un à l'autre. Son cœur s'amollit une dernière fois de pitié humaine. Elle se penche pour atteindre la main de son père, et l'attire doucement près de sa mère.
MARIE (bas).—Ah, j'ai tant prié... (A peine perceptible:) Ne vous séparez plus, maintenant...
Les religieuses, au fond de la pièce, se sont relevées.
Elles approchent.
Marie les entend venir derrière elle; son corps frémit; son masque s'épouvante. Elle s'arrache des bras de Cécile, et glisse dans ceux de son père: à peine a-t-il le temps de sentir sous ses lèvres la soie du petit front bombé... Elle se détache: d'un geste éperdu, elle étreint encore une fois sa mère, qui la regarde avec des yeux fous...
Puis elle se recule vivement.
Le voile retombe.
Une religieuse referme soigneusement le grillage.
Personne ne verra plus ce visage vivant.
Cécile reste foudroyée, les mains tendues, les lèvres ouvertes. Tout à coup elle chancelle, et se serait abattue si Barois ne l'avait saisie.
Elle s'accroche à lui.
CÉCILE (dans un souffle).—Ne me quittez pas, Jean... ne me quittez pas...
La porte s'ouvre.
La tourière fait entendre sa claquette.
Barois soutenant Cécile, l'entraîne vers la sortie.
Une heure plus tard.
Dans une arrière-salle de l'auberge. On a traîné deux fauteuils
devant le poêle. Une lampe suspendue éclaire un souper
auquel ils n'ont pas touché.
Barois, assis en retrait, aperçoit Cécile de dos, courbée, le
chapeau cabossé glissant sur les bandeaux défaits; par instants
elle tourne la tête, et, pour étouffer une reprise de sanglots,
presse son mouchoir sur ses lèvres enflées.
Il est abattu par la fièvre; chaque pulsation du cœur lui fait mal; sa sensibilité est à nu. Le bruit de ces larmes ressuscite des émotions lointaines.
Il songe au passé, sans amertume: la solitude d'hier, celle qui l'attend demain, sont pires que la mésentente de jadis.
—«Elle a dit: Ne me quittez pas... Un cri de désespoir peut-être?
«Ah, si elle veut...
«Mais pratiquement, c'est bien difficile...
«Qu'elle vienne habiter avec moi dans la banlieue? Elle ne pourrait pas s'y faire; sa vie active, ses patronages...
«Alors? Je ne peux pourtant pas aller habiter dans la maison de la mère Pasquelin...»
Involontairement il termine sa pensée à voix haute:
BAROIS.—... ça ne serait possible, que si vous consentiez à quitter votre maison ... à venir habiter celle de ma grand'mère...
Cécile se retourne.
Barois rougit.
Elle hésite, le temps de bien comprendre. L'émotion la fait loucher.
Puis, de son fauteuil, avec un abandon reconnaissant, elle allonge la main jusqu'à la sienne.
«... pareil à qui suivrait pour se guider une lumière que lui-même tiendrait en sa main...»
A. Gide.
«... N'éteins pas le lumignon qui fume...
Son odeur même nous sert de guide...»
Ibsen.
A Buis, dans la vieille maison Barois.
Premiers jours de l'été.
Dix heures du matin.
La chambre de Cécile.
Elle a rassemblé là tous les meubles du petit salon de Mme Pasquelin.
Elle est assise à son bureau. Robe noire. Bandeaux lisses. Un livre de comptes ouvert devant elle. D'autres registres, étiquetés: Quêtes, Vestiaire.
CÉCILE.—Entrez...
C'est Jean.
Elle achève son addition, appuie le buvard, et tourne la tête. Sourire affectueux.
CÉCILE.—Comment vous sentez-vous, ce matin?
JEAN.—Pas mal.
CÉCILE.—Un temps merveilleux...
Jean s'avance vers la fenêtre.
L'appui est chaud. La cour est pleine de lumière.
JEAN.—Il doit faire bon au soleil...
Cécile range ses cahiers, avec des gestes étroits. Puis elle pique un chapeau sur sa tête, et glisse un cahier sous son bras.
CÉCILE.—Je vais porter ça à l'abbé Lévys.
Jean descend l'escalier derrière elle. La porte du vestibule est ouverte; l'éclat du perron est éblouissant.
Quelques pas, aveuglé. Le soleil cuit la chair des épaules.
Les premières pivoines, les premières fraises; les feuilles vertes de la treille.
Une demie sonne au clocher.
Il lève les yeux; son regard longe le pan de pierre ocre et se
perd dans la profondeur bleue: un ciel qui vient de loin et qui
passe, un ciel qui fait le tour du monde.
Il gagne, à petits pas, le banc de la tonnelle. Il écarte les bras
sur le dossier tiède, pour que toute cette clarté, toute cette
chaleur le baignent. Ses mains sont roses de soleil.
Apaisement.
Il pense:
—«Je suis là, dans ce printemps... Je ne le comprends pas. Mais il s'empare de moi, il me soumet à lui.
«Il doit y avoir d'immenses cycles d'idées dans lesquels notre pensée ne s'est pas aventurée encore... Des idées qui dépassent nos hypothèses de l'âme, de Dieu; des idées qui accorderaient nos contradictions... Ah!...»
Quelques minutes plus tard.
Jean regagne lentement la maison.
Le timbre du portail.
Un abbé pénètre dans la cour, aperçoit Jean et s'approche.
JEAN.—Mme Barois vient de sortir, Monsieur.
Le prêtre hésite.
L'ABBÉ.—Permettez-moi de me nommer: l'abbé Lévys.
JEAN (du haut du perron).—Mme Barois sera désolée. Je crois qu'elle allait justement vous voir.
L'ABBÉ (geste évasif, qui relègue Mme Barois et ses œuvres à l'arrière-plan de ses préoccupations).—Je m'en voudrais, Monsieur, de ne pas saisir cette occasion... Mon arrivée à Buis est encore très récente. Mais depuis que j'habite la même ville que vous, j'ai le désir de vous rencontrer.
Jean s'incline légèrement.
L'ABBÉ.—Oh, je sais que vous vivez très seul. Mais je me serais fait un titre, pour enfreindre la consigne, d'avoir été pendant douze ans,—je ne dis pas un de vos abonnés (il montre sa soutane)—mais l'un de vos lecteurs...
JEAN (stupéfait).—Vous suiviez le Semeur?
L'ABBÉ.—Régulièrement. (Baissant les yeux.) J'y ai même collaboré, si l'on peut dire, par des lettres non signées, que vous avez publiées à plusieurs reprises...
JEAN (redescendant deux marches).—Vraiment? Ah, je ne me doutais guère...
Mais je vous tiens debout sous ce soleil... Voulez-vous entrer un instant? Mme Barois ne tardera pas.
Il guide l'abbé jusqu'à l'ancien salon, son cabinet, qu'il a
meublé avec les épaves de sa vie active: ses bibliothèques, son
bureau, et, sur la cheminée, seul et nu, le douloureux Esclave
enchaîné de Michel-Ange, immuablement arrêté dans son effort.
L'abbé Lévys: long, maigre.
Masque régulier, zébré de tics nerveux. Une peau jaune, bossuée. Un regard tantôt distrait, tantôt fixe. Des lèvres mobiles, dont le sourire est une grimace triste.
JEAN (intrigué).—Je suis si surpris que nous ayions eu un prêtre parmi nos correspondants!... Dans quel esprit lisiez-vous donc notre Semeur?
L'ABBÉ.—En y faisant, le plus souvent, de graves restrictions; mais toujours avec intérêt, et souvent avec sympathie...
Jean fait un geste d'étonnement.
L'ABBÉ.—Ne croyez-vous pas qu'à un certain niveau de pensée, lorsqu'on est décidé à prendre au sérieux la vérité et à suivre sa conscience, il est bien difficile d'être de son parti, sans être aussi un peu de l'autre?
Jean l'examine, sans répondre.
L'ABBÉ (après un temps).—C'est M. Breil-Zoeger qui a pris votre succession?
JEAN.—Non. C'est un jeune, un nommé Dalier, un sectaire. Mais il n'est que le prête-nom de Zoeger, qui a toujours aimé se tenir dans la coulisse.
L'ABBÉ.—Vous ne vous en occupez plus du tout?
JEAN (brusque).—Oh, non, plus du tout! Et je vous prie de croire que je désapprouve entièrement la tournure anarchiste, de plus en plus accusée, qu'ils donnent à leur revue!
L'abbé garde le silence.
JEAN.—D'ailleurs, je n'ai plus aucune relation avec eux. J'ai rompu définitivement. (Prenant des brochures sur une étagère.) On m'envoie les fascicules, par habitude; mais, voyez, je n'ai même pas coupé les derniers... A quoi bon? Je n'y trouve que des sujets d'irritation!
(Il fronce les sourcils, et éparpille les revues devant lui; puis il cherche à dévier la conversation.) Je ne suis plus en correspondance qu'avec Marc-Elie Luce, et un vieil ami des mauvais jours, Ulric Woldsmuth.
L'ABBÉ.—Le chimiste?
JEAN.—Vous le connaissez?
L'ABBÉ.—J'ai lu son livre.
Jean sourit, enchanté.
JEAN.—Ah, voilà un beau caractère! Trente ans, qu'il cherche l'origine de la vie... Trente ans, sans une défaillance...
L'ABBÉ (coup d'œil circulaire).—Mais ... vous travaillez toujours?
JEAN (haussant les épaules).—Non. Je m'occupe. En ce moment, je traduis,—pour moi—le journal d'un mystique anglais...
(Sourire pénible.) J'ai mis quelque temps à m'habituer à cette existence de mollusque... Mais ma santé ne me permet plus autre chose. Je vivote, en prenant des précautions, l'hiver au coin du feu, l'été au soleil... (L'éclat des yeux contraste avec la résignation des paroles.) Que voulez-vous, Monsieur l'abbé, c'est la vie...
Il soulève quelques numéros du Semeur et les laisse tomber un à un sur la table.
JEAN.—Ah, les jeunes ont vite fait de vous désarçonner!
Une pause.
JEAN (Le front baissé).—Voyez-vous, on est trop sévère pour les ratés... Leur effort n'aboutit pas directement, c'est vrai; mais il n'est pas perdu pour ça... Hein?... Aucun effort n'est perdu...
L'ABBÉ (étonné).—Je ne pense pas que vous fassiez allusion à une expérience personnelle?
Jean le remercie d'un sourire.
L'abbé regarde curieusement ce Barois qu'il ne soupçonnait pas.
JEAN (après quelques minutes de réflexion, repris par une hantise familière).—J'ai trop longtemps cru que la science, à elle seule, pourrait établir, entre les hommes, la paix, l'unité... Eh bien, non.
L'ABBÉ (prudemment).—Pourtant... si vous ne vous placez qu'à ce point de vue du rapprochement des peuples, la science, en moins de cent ans, a fait à peu près autant que le bouddhisme—et même que le christianisme—en vingt siècles!
JEAN.—Peuh... Voyez les résultats pratiques: qu'est-ce que le peuple y a gagné? Un matérialisme au ras du sol, qui est vraiment sans beauté... Qui, surtout, est stérile...
L'abbé hésite. Ce n'est pas lui pourtant qui doit plaider pour la science...
JEAN (distrait).—... Ce qui semblerait prouver, au fond, que l'homme ne vit pas seulement de travail, de vérité. Il lui faut son dimanche: peu importe la formule...
L'ABBÉ. (Passion soudaine).—Oui, peu importent les formules, puisqu'aucune n'est encore assez vaste pour contenir tout le Parfait, l'Infini. Dieu... Ce ne sont en somme que des façons différentes de nommer une attraction, qui est la même pour tous!
Jean le regarde avec attention.
JEAN.—Alors, si je vous comprends bien, vous, prêtre catholique, vous ne condamneriez pas irrémédiablement un être, qui, toute sa vie, aurait préféré sa formule à la vôtre?...
L'ABBÉ (instinctivement).—Non.
Sous l'insouciance de la voix, il a perçu l'anxiété de l'interrogation.
Un silence.
L'ABBÉ.—Je me souviens d'un personnage d'une pièce scandinave, qui disait...
Il se lève: Cécile vient d'entrer.
Elle ne laisse pas paraître sa surprise.
L'ABBÉ.—J'espérais vous éviter cette course, Madame, mais je suis arrivé trop tard.
CÉCILE (lui remettant le registre).—Voici nos comptes à jour.
Elle éprouve une gêne à parler devant Jean, et dans cette pièce inhospitalière, dont elle ne franchit jamais le seuil.
CÉCILE.—J'aurais aussi diverses décisions à prendre pour la souscription des écoles... Voulez-vous m'accompagner là-haut un instant?
L'ABBÉ.—Je vous suis. (A Jean.) Je m'excuse, Monsieur, d'avoir ainsi abusé...
JEAN (spontanément).—Votre visite m'a fait beaucoup de plaisir.
Cécile est sortie, laissant la porte ouverte.
JEAN (d'un autre ton).—Vous n'avez pas achevé ce que disait votre scandinave...
L'ABBÉ.—«Quand il s'agit de la foi, c'est l'affaire du bon Dieu. Notre devoir, à nous, est d'être sincères.»[1]
JEAN.—C'est une belle parole...
[1] Bjornstjerne Bjornson. Au delà des forçes.
«12 octobre, (après un long entretien avec M. Barois.)
«J'allais à lui, dans un mouvement de sympathie coupable: j'allais au polémiste dont le nom était pour moi le symbole de la pensée libre. J'allais à lui comme au seul être d'ici à qui parler de mes préoccupations.
«Et j'ai trouvé un pauvre homme, plus malheureux que moi, plus déchiré,
plus pitoyable!
«Je ne l'ai pas vu tout de suite tel qu'il est.
«J'espaçais mes visites, par discrétion: c'est lui qui m'envoyait chercher, sans but, pour me voir. Je remarquais son souci d'aiguiller la conversation vers les questions religieuses. Je ne m'y dérobais pas; je cherchais même à lui faire deviner le pénible état de ma conscience. Mais il ne me semblait pas pouvoir distinguer l'homme sous le prêtre: mon caractère sacerdotal l'attirait seul. Pourtant il ne se départait pas d'une attitude agressive à l'égard du catholicisme. Il ne cessait de m'opposer des arguments d'ordre scientifique, dont, pour mon supplice, je connaissais bien la valeur: mais il le faisait avec je ne sais quelle restriction, et comme s'il s'attendait bien à les voir réfuter. Ce que je faisais, d'instinct.
«Peu à peu, j'ai compris. Physiquement, il est rongé par la tuberculose pulmonaire des vieillards: c'est un fantôme, aux yeux brillants, miné presque chaque jour par la fièvre, et périodiquement repris par des poussées congestives qui aggravent ses lésions. Moralement, son état est pire encore: il est rongé par le doute de ce qu'il a cru vrai, et par la peur de mourir. Il se cramponne à ses convictions passées: mais elles ne sont plus pour lui qu'un sujet d'angoisse.
«Je pensais trouver en lui un conseil: et c'est moi qui peux lui porter secours!
«Je ne songe pas à me soustraire à ce devoir inattendu: mais les circonstances ont quelque chose de tragique... Pourquoi faut-il que le prêtre, appelé à guider cet athée vers Dieu, soit un pauvre tourmenté, que les doutes ravagent lui-même depuis dix ans?
«Peut-être est-ce bien ainsi, peut-être suis-je mieux préparé qu'un autre à soigner cette plaie?
«Je m'y appliquerai de tout mon cœur, et je ferai en sorte qu'il ne soupçonne jamais de quelles mains incertaines, de quelles mains tremblantes, je lui apporte ce Dieu qu'il cherche!
«2 novembre.
«Il a des moments de lucidité terribles, dès qu'il passe quelques jours sans fièvre.
«Aujourd'hui il m'a interrompu avec un regard singulier:—«A certaines heures,—tenez, en ce moment,—je parviens à me dédoubler, et une partie de moi-même juge, comme j'aurais jugé il y a quinze ans, ce que je suis devenu... Je me demande alors si je n'étais pas, de toute éternité, voué à la servitude?»
«En parlant, il tendait la main vers un plâtre de Michel-Ange qui est sur sa cheminée:—«Regardez-le! Il ne peut pas lever un bras libre!... Peut-être n'ai-je fait, comme lui, pendant des années, que le simulacre de l'affranchissement...»
«10 novembre.
«Ce matin:
—«J'en ai assez des négations scientifiques! elles n'ont pas plus
d'autorité pour nier que d'autres pour affirmer. Mais votre dogmatisme
religieux me rebute, au même titre. Je sais ce qu'il vaut: j'y ai été pris,
assez longtemps!»
«16 janvier.
«Je l'ai trouvé couché, sans courage.
«Sur son lit, il y avait un numéro du Semeur qu'il venait de recevoir. Il l'a ouvert. A la dernière page, un écho intitulé: Une nouvelle conversion, et quelques lignes mordantes qui le visaient. Il a haussé les épaules; mais je l'ai senti profondément blessé.
«Il a changé la conversation. Nous n'avons abordé aucun sujet précis.
«Comme j'allais me retirer, après un silence, il m'a regardé:»—Je suis un mystique, au fond... Et pourtant je ne crois à rien...»
«Je lui ai répondu:—«Vous ne croyez à rien? On croit toujours à quelque chose. Chacun, au fond de soi, a son Dieu caché auquel il retourne pieusement, auquel il se sacrifie tous les jours.»
«Mais il a secoué la tête, d'un air sombre:»—Non, je vous dis que je ne crois à rien... J'erre dans le noir, je voudrais...» Il a baissé la voix, mais je crois avoir entendu: «... la paix ... pour mourir.»
«25 janvier.
«J'ai pu revenir sur le même sujet. Nous discutions encore une fois les preuves de l'existence de Dieu.
«Il m'a dit:—«Vos preuves ne prouvent rien, sinon que vous, Lévys, vous croyez en Dieu. Et elles ne prouvent absolument rien d'autre. Si ces preuves avaient quelque valeur, croyez-vous qu'il y aurait des athées?»
«J'ai répliqué:—«Mais il n'y a pas de véritables athées! Vous-même, vous n'avez jamais cessé d'être un croyant! Votre confiance dans le progrès, dans l'avenir de la science, votre croyance même au triomphe de l'athéisme, qu'était-ce, sinon un principe de foi?
«Vous croyez qu'il y a un but dans la nature, vous croyez à l'ordre éternel des lois; cet ordre-là, il a produit la conscience humaine, la vôtre; et par là, il a introduit dans l'univers l'idée de justice: cet ordre-là, c'est Dieu!»
«Il a réfléchi quelques secondes:—«Oui. Mais un Dieu indéterminé Le vôtre est déterminé. Et c'est là que la superstition commence.»
«Que répondre?
«7 mars.
«Chaque fois que je le quitte, je me reproche de n'avoir pas su trouver, dans ma foi qui hésite, le mot, l'accent qu'il eût fallu. Et, chaque fois que je le revois, je suis stupéfait du résultat inespéré de mes froides paroles.
«Non que mes raisonnements l'aient convaincu. Mais, ils sont une réponse aux difficultés qu'il avait soulevées. Je m'aperçois que le pire serait de rester coi, et qu'à toutes ses attaques il faut opposer une contradiction, même chancelante. Avant tout il a besoin d'une solution simple, une, et surtout catégorique.
«Rien ne m'a si bien fait comprendre que la foi n'est pas seulement un acte de l'intelligence, une conviction, mais un acte de la sensibilité et de la volonté, un sentiment de confiance, un désir de soumission.
«19 mars.
«L'Évangile prend une grande importance dans sa vie intérieure. Il en tire de fréquentes citations. Il a contracté l'habitude d'y recourir quotidiennement, comme à l'unique source de poésie qui le satisfasse.
«D'ailleurs il lit peu, et de moins en moins. Je le trouve généralement seul, dans un fauteuil de son cabinet, les pieds au feu, et sur les genoux, un journal qu'il n'a pas déplié.
«3 juin.
«Jusqu'ici je lui développais surtout les raisons sentimentales de croire le besoin de consolation; la nécessité d'une justice finale, d'un dédommagement; le désir d'une direction dans la vie.
«Il est particulièrement sensible à la beauté de la vie chrétienne; je lui en multiplie les exemples. Il me considère alors, de ses yeux vitreux, avec une expression d'envie. L'autre jour il m'a dit:—«Cette beauté, à elle seule, suffirait à justifier la foi,—si le fruit suffisait à justifier l'arbre... Et peut-être est-ce défendable, après tout?...»
«Aujourd'hui, l'entretien a été particulièrement animé. Il se sentait réconforté par ces premiers beaux jours, qui lui permettent de sortir. Nous avons fait une promenade, au soleil, en causant. Il m'a demandé de préciser certains dogmes. Il a paru très frappé d'apprendre que la théologie comprend des éléments divers, dont la valeur est fort inégale; qu'il ne faut pas confondre les dogmes essentiels de la foi, relativement peu nombreux, avec les doctrines communément reçues; et, qu'à tout prendre, il y a beaucoup de questions, comme l'efficacité des indulgences par exemple, sur lesquelles les catholiques sont libres d'avoir des opinions très différentes. Je lui ai même dit combien les dogmes du purgatoire et de l'enfer sont moins explicites qu'on ne le croit généralement, et combien il reste de marge aux croyants les plus orthodoxes, pour l'interprétation de ces dogmes.
«J'ai peut-être insensiblement forcé la note, tant j'ai senti que mes paroles le rassérénaient. D'ailleurs je ne pense pas être sorti des limites que l'apologétique moderne s'est fixée...
«28 juin.
«Je rentre, le cœur serré. Il m'a inspiré aujourd'hui une pitié indicible.
«Il était couché, très affaibli par les accès de fièvre de la nuit. Cette semaine pluvieuse et malsaine a provoqué une petite toux qui l'épouvante.
«Mme Barois m'a dit que le médecin ne s'en inquiétait pas outre mesure, et qu'il comptait sur l'été pour en venir à bout. Mais lui, avait un visage ravagé. Il m'a dit, avec un frisson: «—Ah, j'ai cru mourir cette nuit»; puis, d'une voix angoissée, comme une confidence: «—J'ai peur de la mort...»
«Jamais encore il n'avait directement abordé ce sujet.
«Je le regardais, subissant la contagion de cette terreur, et ne voulant pas le laisser paraître. J'étais resté debout contre le lit. Il avait gardé mes doigts dans sa main.
«—La première fois que j'en ai eu peur, tenez, c'était ici, dans la cour ... devant le cercueil de ma grand'mère. J'avais onze ou douze ans, je venais d'être très malade. J'étais devant le catafalque, je regardais les fleurs, les bougies, et brusquement je me suis dit: Et si elle n'est plus du tout, du tout, du tout?...»
«Il a ajouté d'une voix bizarre: «Qu'est-ce que c'est, la mort? La désorganisation de l'être que je suis, dont ma conscience fait toute l'unité... Alors? Disparition de la conscience, de l'âme?...»
«Il me dévisageait en parlant. Je le sentais parvenu à ce point de faiblesse morale où l'on ne peut plus supporter que les hypothèses consolantes.
«Jamais je n'ai si fortement éprouvé la puissance sacerdotale dont je suis revêtu, moi, si indigne... Je lui ai crié, presque violemment: «—Ah, moi aussi, j'aurais beau m'étourdir, si je n'avais pas une foi absolue en la vie future, l'idée de la mort paralyserait toutes mes forces! Mais la croyance à l'immortalité fait partie de ma conscience, et les pires obstacles qu'on puisse lui opposer sont des objections faciles à anéantir!»
«Il n'abandonnait pas ma main. Il m'écoutait avec une anxiété qui faisait mal. J'ai continué:
«—D'où vient ma conscience? D'une simple organisation nerveuse de mon cerveau? Le cerveau, les nerfs,—la vie, la mort? Mais vous ne voyez pas que ce sont des mots qui tous renferment un égal mystère! Ce sont des étiquettes, ce ne sont pas des explications!
«Je sens en moi une notion du divin, un sentiment de la perfection, qui ne peuvent pas être de pures sécrétions de mon cerveau imparfait et périssable. Je sens en moi l'existence d'une vie idéale, dont je ne trouve le point d'origine dans aucune partie de mon corps. Je sens en moi deux sortes de rapports, absolument distincts: ceux que j'ai avec le monde matériel, par l'intermédiaire de mes organes, et ceux que j'ai avec le monde spirituel. La mort, par la désagrégation des éléments matériels, supprime toute la première série de ces rapports; mais elle ne supprime pas la seconde. Et c'est là que je mets toute ma foi en la survivance de ma personnalité morale!»
«C'est alors qu'il m'a dit, lentement, avec un regard suppliant qui quêtait une réponse décisive:—«Mais ... une conscience n'existe qu'avec cette double forme de relations... Qu'est-ce que c'est qu'une conscience qui n'a plus de relation avec le monde matériel?»
«J'ai balbutié:—«Peu importe de se faire de la vie future une idée nette; l'important est que cette vie future soit certaine!»
«Il a lâché ma main.
«J'ai deviné que je l'avais atrocement déçu. La pitié m'a permis un suprême effort.
«Je me suis penché vers lui, répondant à sa pensée plus qu'à ses paroles:
—«Vous avez soif de certitude. Puisque la faiblesse de notre intelligence vous a refusé la vérité stable, pourquoi ne la demandez-vous pas à Dieu?»
«Il a fait un geste de désespoir.
«J'ai continué:—«Moi, prêtre, je ne puis vous apporter que des raisonnements. Mais Dieu peut vous toucher de sa grâce!...» Et avec toute l'autorité convaincante dont j'étais capable:—«Espérez, espérez... Ne vous défendez pas contre la foi... Ouvrez votre cœur, ne vous contractez pas, laissez pénétrer l'amour infini du Consolateur...»
«Puis j'ai pris les Evangiles qui étaient sur la table, et j'ai cherché le passage de St Marc: «Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a jeté de la semence en terre. Qu'il dorme, qu'il se lève de nuit et de jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment.»
«A mesure que je parlais, je voyais ses traits se détendre et son angoisse fondre. Il a renversé la tête, il pleurait.
«Moi, je ne pouvais détacher mes yeux de ce visage. Ainsi, c'est là que vient aboutir l'élan d'une pareille existence! Trahi par ce corps ravagé qui l'abandonne à moitié de sa course... Trahi par sa pensée, qui le portait vers un but inaccessible... Ah, trahison, trahison universelle!
«Le même soir.
«Comme elle est belle la religion qui apporte un remède à de pareilles
souffrances! Elle seule peut donner le courage de vivre et de mourir,
elle qui transforme l'effroi du mystère en une attraction sublime... La
plupart d'entre nous ont bien davantage besoin de paix intérieure que de
vérité; la religion leur est une autre nourriture que la science. Et c'est une
belle mission que d'être ce messager d'espoir.
«Non, je ne quitterai pas l'Église. Je ne la perdrai pas... Je ne pourrais
pas la perdre... Comment renier la tradition qui a fait l'humanité ce
qu'elle est?
«J'étais insensé! Me séparer d'elle parce qu'elle est en retard sur la
science humaine? Je comptais pour rien cet attachement de cœur, qu'aucune
volonté pourtant ne parviendrait à rompre!
«Evidemment le sens littéral des dogmes me paraît aussi difficile à accepter
aujourd'hui qu'il y a un an. Mais je me sens incapable de me créer
hors de leur ombre, une unité, un équilibre.
«Je me contenterai, pour pouvoir vivre, de m'attacher à l'esprit plus qu'à la lettre. L'efficacité morale de la foi reste pour moi intacte.
«Ah, j'ai trop donné à l'Église de moi-même, j'ai trop connu la sueur d'agonie du jardin des oliviers! L'Église m'a trop supplicié, elle m'a fait verser trop de larmes, et elle m'a fait trop de bien...
«Nous sommes rivés l'un à l'autre, indissolublement...»
Fin de juillet.
Un matin.
L'abbé Lévys traverse hâtivement la cour. Visage bouleversé.
Cécile l'attend. Elle lui saisit les deux mains; elle ne peut articuler un mot; ses yeux s'emplissent de larmes.
L'abbé monte rapidement l'escalier. Jean habite la chambre dans laquelle son père est mort.
Il est couché, les bras étendus, les traits apaisés. En apercevant l'abbé, il sourit.
JEAN.—Je vous remercie d'être venu tout de suite. Je ne pouvais plus attendre...
Un sourire joyeux, confiant, extraordinaire. C'est la grâce aujourd'hui, qui rayonne sur ces lèvres, dans ce regard...
L'abbé comprend; son cœur bat, ses mains tremblent; tout l'équivoque de sa foi s'évanouit; il redevient, en un instant, pour un instant, le prêtre fervent qu'il a été.
Alors il s'approche de Jean et prend sa main.
L'ABBÉ.—Dites-moi tout ... tout...
Le regard de Jean s'attarde dans la fenêtre ouverte; puis, de très loin, vient se poser sur l'abbé.
JEAN.—Ce qui s'est passé? (Un effort pour démêler les souvenirs d'un rêve.) Laissez-moi reprendre... Hier soir, nous nous sommes rencontrés au presbytère, n'est-ce pas? Mais vous n'avez rien remarqué, et je ne pouvais rien vous dire...
Devant le corps de ce pauvre abbé Joziers, je venais d'avoir ... (son œil s'illumine) ... la perception nette de l'âme!
Mouvement de l'abbé.
JEAN.—J'étais assis, je ne pouvais pas détacher mes yeux de ces traits pétrifiés; je cherchais l'ancienne ressemblance: mais il y avait une différence essentielle que je ne découvrais pas. Je cherchais une comparaison. Je me disais: «Ce corps est là comme une boîte vide...» Vide! ç'a été une révélation: le corps était là, et ce n'était plus rien. Pourquoi? parce qu'il avait perdu ce qui l'animait... L'heure saisissante de la dissociation était arrivée; la personnalité, ce qui faisait l'homme, s'était évanouie, était ailleurs! Autant l'idée de survivance spirituelle me paraissait inexplicable, autrefois; autant l'idée contraire me paraît maintenant absurde.
Oui, l'âme existe! Il m'a suffi d'un regard sur ce lit pour constater sa disparition, et pour être frappé par la plus élémentaire, la plus indubitable évidence!
L'abbé serre fébrilement sa main.
JEAN.—Je commençais à souffrir; mais je dominais mon mal pour ne pas interrompre ce tête-à-tête, qui m'ouvrait la possibilité d'une vie éternelle...
Enfin le domestique m'a ramené ici. Il m'a couché tout de suite; une crise effroyable... Oppressions, arrêts du cœur, étouffements... J'ai cru que j'allais mourir.
Alors je me suis adressé à Dieu, de toutes mes forces: mais je sentais qu'il ne m'écoutait pas... J'ai voulu être seul. Ma femme ne voulait pas me quitter; je l'ai suppliée de s'éloigner. J'ai encore essayé de prier, sans pouvoir... Enfin les douleurs se sont calmées, j'ai éprouvé un soulagement sensible. Mais j'étais faible, faible... Je me sentais inerte, et si peu de chose, un souffle ... j'étais certain que j'allais mourir...
Ah, l'atroce nuit! J'avais la tête en feu et le cœur tout refroidi, tout resserré, comme si l'ombre l'écrasait... Mon cerveau travaillait, à vide... J'étais pris entre deux courants contradictoires: je cherchais à prier, je faisais des efforts désespérés pour appeler l'attention de Dieu; et, à chaque élan, une voix, en moi, me disait: «Non, non, non... Personne ne te répondra!... Personne... Tu vois bien qu'il n'y a personne...»
Il parle lentement, sans amertume, sa main dans celle du prêtre, son regard ne quittant pas le ciel matinal.
J'étais si faible, j'ai perdu conscience, j'ai dormi sans doute. Mais, tout en dormant, je ne cessais pas de sentir une lutte au-dessus de moi, et j'avais la certitude obscure que la volonté de Dieu finirait par triompher.
Et puis, il m'a semblé qu'on parlait, et j'ai ouvert les yeux. J'ai même cru entendre si distinctement mon nom, que j'ai dit: «Quoi?» pensant que c'était ma femme... Mais j'étais seul.
J'avais dormi longtemps. Il faisait petit jour. J'entendais la respiration du domestique, dans le cabinet... Moi qui ai maintenant le sommeil si lourd et le réveil si lent, je me suis trouvé tout de suite lucide, extraordinairement lucide, et comme allégé d'une façon miraculeuse.
Alors j'ai fait un nouvel effort pour prier.
La voix qui disait: «Non, non...» s'était tue. A la place de mon impuissance, de cet affreux sentiment du néant, j'avais une espèce de certitude imprécise, une confiance... Je percevais sur moi comme un secours, comme une affection...
(Sourire radieux.) Je ne sais pas comment expliquer... L'impression de sortir de léthargie après plusieurs années de sommeil... L'impression de sortir d'un tunnel, de trouver la lumière, de commencer vraiment une nouvelle vie!... Un immense bonheur intérieur... La paix surtout, la paix ... le calme...
Je sens que je n'ai plus à chercher, que ma volonté est comme fondue, que je vais obéir avec délices, que tout est clair, que tout est pur...
Tout a un sens...
Il tourne la tête. Son regard rencontre celui de l'abbé, dont le visage anxieux reste incliné vers lui.
JEAN (ouvrant les bras).—Alors je vous ai fait venir, mon ami, pour me confesser...
Marc-Elie Luce est introduit dans le salon de Buis, où se trouve l'abbé Lévys.
L'ABBÉ (s'avançant).—Je suis chargé, monsieur, par Mme Barois, de vous prévenir que notre malade est à peine remis de sa dernière rechute... Il a besoin de ménagements...
LUCE (inquiet).—Mais je ne demande qu'à lui serrer la main. Si vous supposez qu'une conversation...
L'ABBÉ (embarrassé).—Non, monsieur, je ne pense pas qu'une conversation ... sur des sujets... Enfin, sans rien qui puisse provoquer un effort cérébral...
Luce sourit: une indulgence nuancée d'amertume.
LUCE.—Vous pouvez rassurer Mme Barois, monsieur l'abbé... Barois m'a prévenu de sa conversion, et je ne viens pas ici pour le contredire...
L'abbé rougit. Tics nerveux.
LUCE (froid).—D'ailleurs, je n'ai que peu de temps: je compte reprendre le train de trois heures.
L'ABBÉ (vivement).—La gare est très proche, par le raccourci... Et si vous voulez bien, je vous montrerai moi-même le chemin...
Jean a voulu se lever.
Il s'est fait habiller, et asseoir devant son bureau, qui est maintenant dans sa chambre,—car il ne descend plus.
Ses vêtements de drap noir, boutonnés, flottent autour de
lui. Une parade mortuaire: le col baîlle; la peau colle au
crâne; une barbe peu fournie comble la cavité des joues; les
lèvres brident sur les dents; les ongles sont en corne jaune.
A l'entrée de Luce, il cherche à deviner le progrès de son
mal. Mais Luce vient vers lui, souriant, impassible.
JEAN (tout de suite).—Vous vous demandez, n'est-ce pas, comment c'est arrivé?
Luce ne comprend pas.
Cette voix éteinte et rauque...
Jean soulève un petit crucifix, qui est près de son mouchoir,
sur le bureau désert.
Une gêne.
JEAN (buté).—Comment c'est arrivé? Je n'en sais rien... Mais ce n'est pas le premier comment ni le premier pourquoi qui nous échappent! (Il sourit bizarrement.) «Invocavi et venit in me spiritus sapientiæ.» Depuis longtemps je ne croyais plus aux idées...
LUCE (évasivement).—Oui, c'est le cœur qui mène à la foi...
JEAN.—Ah, mon ami, c'est bon... On sent qu'on pénètre enfin la vie, qu'on voit l'univers par le dedans...
(Vivement, comme s'il craignait une objection.) Et puis c'est une solution pratique qu'il nous faut...
Luce acquiesce par un sourire affectueux.
Jean a glissé au fond de son fauteuil. Son regard a la fixité
d'yeux de verre, enchâssés dans un masque de cire.
Luce évoque le Barois, qui, pour discuter, se campait, les jambes écartées, tête de biais, sourcils dressés...
Jean le regarde; et tout à coup, un petit rire silencieux.
JEAN.—Je vous plains, mon pauvre ami... Vous résistez encore, vous... Vous vous débattez...
Luce, surpris, proteste doucement. Mais le sourire de Jean est obstiné.
JEAN.—Vous vous débattez, comme je faisais... Je connais ça... (Haussant les épaules.) A quoi bon? Vous savez bien que vous y viendrez aussi...
Il saisit la petite croix et la soulève à nouveau.
JEAN.—Voyez comme je me suis résigné à mourir, pour revivre auprès de Lui!
L'intonation est angoissée.
Luce l'examine d'un regard compatissant: il a mesuré d'assez
près l'abîme, pour ne plus mépriser ceux qui ont le vertige. Mais
il ne trouve rien à répondre.
Quelques minutes s'écoulent.
Luce se lève.
Jean le voit partir, presque sans regret. Une couche d'impressions neuves s'interpose maintenant entre son équilibre actuel, sa foi,—et son passé. Il prend la main tendue. Luce est très pâle.
JEAN.—Nous avons été deux semeurs de doutes, mon vieil ami. Que Dieu nous pardonne...
Luce descend l'escalier, le cœur serré.
Il entre dans le salon; la fuite d'une jupe.
LUCE (à l'abbé).—Pourrai-je saluer Mme Barois?
L'ABBÉ.—Je ne pense pas que Mme Barois soit rentrée... D'ailleurs, si nous voulons gagner la gare à pied, il va être l'heure...
Luce n'insiste pas.
Dehors, froid vif et sec.
Aussitôt franchi le portail, l'abbé se tourne.
L'ABBÉ.—Eh bien, comment l'avez-vous trouvé?
Luce fait un arrêt, à peine sensible, regarde l'abbé, et reprend sa marche. Il n'a plus, avec ce prêtre, les mêmes motifs qu'avec Jean pour dissimuler.
LUCE.—Il est méconnaissable... Il ne reste plus rien de son intelligence: il vit aujourd'hui, d'une faible lueur de sensibilité...
L'ABBÉ (défensif).—-Vous faites erreur: croyez bien qu'il a longuement discuté, avant de trouver sa voie!
LUCE (avec amertume).—Discuter? Mais il ne le pouvait déjà plus lorsqu'il a quitté Paris!
(Posément.) Non. Ce pauvre Barois est, comme tant d'autres, une victime de notre époque. Sa vie, a été celle de beaucoup de mes contemporains: elle est tragique...
Il se tourne vers l'abbé, oubliant le prêtre; dans son regard, cette curiosité amoureuse et perspicace, qui a été la poésie de son existence.
LUCE.—Son éducation catholique s'est brisée, un jour, contre la science: toute la jeunesse cultivée passe par là. Malheureusement, notre conscience morale, dont nous sommes si vaniteux, nous la tenons, par hérédité, de plusieurs centaines de générations mystiques. Comment rejeter un pareil patrimoine? C'est lourd... Tous n'arrivent pas à fortifier suffisamment leur raison pour qu'elle reste jusqu'au bout victorieuse. Aux jours de tempête, tant d'instincts, tant de souvenirs, l'assaillent! Toutes les faiblesses sentimentales d'un cœur humain...
La plupart, en pleine force d'âge, donnent bien, comme Barois, le coup d'épaule qu'il faut pour s'affranchir. Mais viennent les déceptions, viennent les maladies, la menace finale, c'est la déroute: vous les voyez recourir bien vite aux contes de fées qui consolent...
L'abbé, le menton dans sa cape, hâte le pas.
LUCE (triste).—Vous lui avez offert la survie, et il s'y est accroché désespérément, comme tous ceux qui ne peuvent plus croire en eux, qui ne peuvent plus se contenter de la vie réelle...
Mouvement de l'abbé.
C'est votre mission, je sais bien... Et je dois reconnaître que l'Église a acquis en ces matières une incomparable expérience! Votre au-delà est une invention merveilleuse: c'est une promesse placée si loin, que la raison ne peut pas interdire au cœur d'y croire, s'il en a envie, puisqu'elle échappe, par définition, à tout contrôle...
Ah, c'est la trouvaille de votre religion, monsieur l'Abbé, d'avoir su convaincre l'homme qu'il ne doit plus chercher à comprendre!
L'ABBÉ (relevant la tête).—C'est la loi de Jésus lui-même, monsieur. Il ne démontre pas, il ne raisonne pas; il dit: «Croyez en moi.» Il dit, plus simplement encore: «Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive...»
Un temps.
LUCE (malgré lui).—Une belle conversion! Vous pouvez être fier.
L'ABBÉ (s'arrêtant).—Oui, j'en suis fier!
Une bise soudaine, au tournant de la rue, fait claquer son manteau. Il brave Luce d'un regard sombre, ambigu.
L'ABBÉ.—Etiez-vous capable de le consoler? Moi, je lui ai apporté le calme; je lui ai montré des horizons de clarté. Vous n'avez su lui proposer que des visions sans espérance!
LUCE (avec mesure).—Pourquoi «sans espérance»?
Mon espérance, c'est de croire que mes efforts vers le bien sont indestructibles! Et elle est si forte, ne vous en déplaise, que les triomphes partiels du mal ne la découragent pas...
Mon espérance, à moi, n'exige pas, comme la vôtre, l'abdication de ma raison: au contraire, ma raison l'étaye. Elle me prouve que notre vie n'est ni un mouvement à vide, ni une simple occasion de souffrir, ni une course au bonheur individuel; elle me prouve que mes actes collaborent au grand effort universel; et partout elle me fait découvrir des motifs d'espérer! Partout je vois la vie naître de la mort, l'énergie naître de la douleur, la science naître de l'erreur, l'harmonie naître du désordre... Et, en moi-même, ces évolutions-là se produisent tous les jours.
Oui, je lui ai offert une foi, moi aussi, et qui valait bien la vôtre, monsieur l'Abbé.
L'ABBÉ.—Elle n'a pu lui suffire: c'est un fait!
(Violence inattendue.) Et même si vous pensez que je lui ai offert un mensonge, vous devriez être heureux que j'aie pu, par n'importe quel moyen lui rendre la paix!
LUCE.—Je ne connais pas deux morales. On doit arriver au bonheur, sans être dupe d'aucun mirage, par la seule vérité.
Un temps.
LUCE.—Ah, nous aurons été un moment pathétique de l'histoire de la science, le moment le plus aigu sans doute de son conflit avec la foi!
L'ABBÉ (brusque impatience).—Vous êtes d'un autre temps, monsieur Luce ... du temps où l'on coupait inconsidérément les ponts qui nous relient au passé. Vous croyez à la régénération sociale, et vous avez pu renoncer à la prière, à la survivance spirituelle... Mais vous ne savez pas voir autour de vous: ce temps-là est déjà loin! Vous n'avez pas aperçu le réveil général d'un besoin religieux, que vos sèches théories ne pourront jamais satisfaire!
(Rire révolté.) Un athée ne comprendra jamais ce qui se passe dans l'âme d'un homme qui prie...
LUCE (souriant).—Ce sont des défaillances inévitables. Mais cette incroyance raisonnée que nous avons conquise, au prix souvent de pénibles souffrances, ne peut pas être perdue: elle s'imprime, peu à peu, jusqu'au fond des moelles de notre race, et libère d'autant l'humanité à venir!
L'ABBÉ (farouche).—Non, l'homme ne pourra jamais se passer de Dieu... La vie est dominée par la mort; et seule la religion apprend à l'attendre, à la subir,—quelquefois même à la désirer.
LUCE (le masque contracté).—La mort est dans la logique de la vie. J'accepte l'idée de mort comme j'accepte l'idée de naissance.
L'ABBÉ (sourire cruel).—Oui, pour le moment! Oui, vous vous portez assez bien pour «accepter» la mort!
Mais je vous le dis, monsieur Luce, le jour où vous sentirez qu'elle approche, qu'elle est là, ah! vous verrez quel piètre appui vous trouverez dans vos négations stériles!
La place de la gare, que sillonne un va-et-vient de piétons et
de véhicules.
Luce s'arrête. Une ombre s'est creusée sous ses yeux gris.
LUCE (voix lourde).—A mon âge,—autant dire au seuil de la mort—on est sincère, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'heure où l'on a envie de faire des phrases...
Eh bien, je vous affirme que j'envisage la mort avec toute la sérénité dont l'homme est capable,—avec la même sérénité que vous!
L'abbé détourne la tête.
LUCE.—Qu'est-ce qui vous adoucira le moment fatal? c'est la paix d'une conscience tranquille... Cette sérénité-là, je puis l'avoir au même titre que vous...
L'ABBÉ (ton âpre, sans regarder Luce).—Mais ce que vous n'aurez pas, vous, c'est un prêtre, un envoyé de Dieu, pour venir se pencher sur votre agonie, et, d'un seul geste d'absolution, effacer jusqu'au souvenir de ce que vous aurez fait de pire!...
LUCE (doucement).—Je n'en ai pas besoin.
Il est devenu blême, tout à coup.
Un sourire d'orgueil. Il tend sa main à l'abbé.
LUCE.—Au revoir, monsieur l'Abbé... Sans rancune...
Et pourtant vous venez de me faire mal... J'avais presqu'oublié que je suis condamné, et vous venez de m'en faire souvenir,—durement...
Geste de l'abbé.
LUCE (souriant toujours).—Je sais que dans deux, trois, quatre mois, tout au plus, il faudra que je subisse une opération, qui est sans espoir... Et si je suis venu voir Barois, c'est parce que je me sais encore plus sûrement perdu que lui-même...
L'ABBÉ (bouleversé).—Vous vous exagérez, peut-être...
LUCE (cessant de sourire).—Oh, ce n'est pas que je regarde la mort sans épouvante... Non... Mais je la regarde! (Il frissonne.) J'en ai peur, autant qu'un autre, parce que ma chair est lâche: mais c'est une peur physique.
Moralement, allez, je reste bien d'aplomb!
Il traverse le trottoir, d'un pas ferme.
L'abbé le suit des yeux jusqu'à ce qu'il ait disparu.
«Mon cher Barois,
«Depuis que Luce est mort, je veux vous écrire. Mais j'ai eu le côté droit ankylosé à la suite d'une petite congestion, et j'ai été retardé.
«Les médecins avaient résolu de tenter l'opération. Il s'y était soumis sans illusion. Il avait demandé quinze jours pour ranger ses papiers. Il m'a prié de l'aider, et je ne l'ai plus quitté.
«Un jour, en classant les notes du livre qui reste inachevé, il a vu que je pleurais. Il est venu à moi, et il m'a dit un mot qui le résume:—«Vous, Woldsmuth? Mais quoi? c'est la vie... Ne nous laissons pas aveugler par l'individuel...»
«L'opération a eu lieu.
«Elle a réussi au delà de toutes les espérances. Le chirurgien lui-même semblait oublier que ce n'était qu'une rémission; nous tous avec lui. Le dix-huitième jour, Luce était debout, on le laissait rentrer chez lui. Il disait: «Je vais me remettre au travail, j'ai tant à faire encore!»
«C'est à partir de ce moment-là que le mieux a cessé, brusquement.
Il l'a senti tout de suite: les symptômes reparaissaient, un à un. Il reculait
toujours le moment d'avertir ses enfants; et eux, qui s'apercevaient du
changement, feignaient de croire à sa guérison.
«J'y allais tous les jours. Avec moi, il parlait de sa mort, sans répit.
«Il me disait:
—«J'ai de la chance d'être ainsi prévenu d'avance, de pouvoir me préparer à l'acceptation. C'est le dernier acte qui me reste à accomplir pour avoir fait ce que je devais. Je me suis toujours efforcé de rendre ma vie conforme à mes idées, pour donner à celles-ci leur maximum de force; il me reste à mourir, sans dévier; il me reste à montrer que je n'ai pas peur de la mort, que je la vois venir, que je l'accueille, que je meurs en confiance...
«Le retentissement d'une fin sereine est immense, sur notre pauvre troupeau affolé de condamnés à mort! Socrate l'avait bien compris. Plus on relit le récit de ses derniers jours, plus il est clair que Socrate n'a pas consenti à se faire acquitter. Il avait soixante-dix ans; il avait fini d'enseigner; il a eu la suprême sagesse de vouloir agir, une fois encore, par une mort qui ne fût pas passive, qui fût la preuve dernière de l'assurance de son cœur. Je me souhaite une pareille fin.»
«Puis un trouble passait sur son visage:
—«Et pourtant, on dit que souvent ceux qui l'ont attendu avec le plus de calme, sont justement ceux qui, au moment de mourir, se laissent aller à la plus grande révolte...»
«Mais il ajoutait, précipitamment:
—«Une révolte nerveuse, bien entendu...»
«Pas un seul jour je n'ai vu fléchir cette adhésion à la vie et à la mort. Et pourtant il a bien souffert!
«Il faisait le bilan de son existence. Un matin, après une nuit d'insomnie, il m'a dit:
—«C'est une consolation pour moi de m'apercevoir combien ma vie aura été harmonieuse. Pendant que l'on vit, on se désespère de ne pas pouvoir mettre plus d'unité dans ses actions. Mais maintenant, je vois que je n'ai pas à me plaindre. J'ai rencontré tant d'êtres tourmentés, insatisfaits, sans cesse emportés en deçà ou au delà de leur centre de gravité!
«Mon existence, à moi, n'a pas connu ces secousses; elle pourrait
s'exprimer par deux ou trois mots simples et clairs. Cela me donne, en
m'en allant, un sentiment de paix. Je suis né avec de la confiance en moi,
en l'effort quotidien, en l'avenir des hommes. J'ai eu l'équilibre facile.
Mon sort a été celui d'un pommier de bonne terre, qui porte régulièrement
ses fruits.»
«La dernière semaine a été particulièrement cruelle.
«Puis, la veille du jour où il est mort, les souffrances ont diminué.
«Ses petits enfants, les aînés, sont entrés un instant dans sa chambre. Il ne parlait déjà presque plus. Il les a vus venir, il leur a dit:—Allez-vous-en, mes petits, adieu, il ne faut pas que vous voyiez ça...»
Vers six heures, on allumait les lampes, il a regardé autour de lui comme pour s'assurer que tous ses enfants étaient réunis. Il avait un regard extraordinaire. Il semblait pouvoir dire la vérité sur tout. Il semblait que s'il avait pu s'expliquer encore, il eut dit, sur lui, sur sa vie, sur la vie de tous les hommes, la parole décisive, libératrice... Mais il s'est soulevé sur un coude, et il a seulement dit, d'une voix étouffée, comme s'il s'éveillait:
—«Ah, c'est la mort, cette fois...»
«Ses filles n'ont pu retenir leur douleur. Elles étaient à genoux autour de son lit. Alors il a posé ses mains sur toutes ces têtes, et il a murmuré, pour lui seul:
—«Qu'ils sont beaux, mes enfants!»
«Puis il s'est renversé sur l'oreiller.
«C'était le soir. Il est mort, au matin, sans avoir rouvert les yeux.
«Voilà ce que je voulais vous écrire, mon cher Barois, parce que je sais
que cette mort peut vous faire du bien, comme à moi. Elle nous console
de toutes les choses mauvaises que nous avons rencontrées sur notre
chemin.
«J'ai la certitude après avoir vu mourir Luce, que je n'ai pas eu tort,
d'avoir foi en la raison humaine.
«Pour moi, j'ai de si faibles yeux maintenant, que je ne travaille plus
guère au laboratoire. J'écris: je récapitule mes recherches sur l'origine
de la vie. Elles n'ont pas atteint leur but, mais je lègue à ceux qui me suivent,
les résultats que j'ai acquis. Le temps est un facteur essentiel du
progrès; il est vraisemblable qu'un jour un autre trouvera ce que j'ai
cherché; et c'est une pensée très apaisante.
«Votre dévoué,
Ulric Woldsmuth.»
Depuis le matin, Jean délire.
Huit heures du soir.
Il s'éveille. Lassitude extrême.
La pièce est sombre.
Autour du lit, le va-et-vient des vivants prolonge son cauchemar.
Tout à coup, près de Cécile qui tient la lampe, l'abbé Lévys,
étole au cou: entre ses doigts, les burettes.
Une frayeur folle: la réalité...
Son regard court d'un visage à l'autre.
JEAN.—Je vais mourir? Dites? Je vais mourir?
Il n'entend pas la réponse. Une quinte le prend à la gorge, lacère ses poumons, l'étouffe.
Cécile se penche. Il l'enserre de ses deux bras, passionnément.
Elle le force à s'allonger. Il se laisse faire, épuisé, les yeux clos, le souffle sifflant.
A travers sa fièvre, des phrases latines... La fraîcheur de l'huile sur ses oreilles, sur ses paupières, sur ses paumes...
Sa transpiration baigne les draps.
JEAN.—Ah, délivrez-moi!... Ne me laissez pas souffrir!...
Ses mains battent l'air.
Elles rencontrent les manches de l'abbé et s'y cramponnent, comme à Dieu.
JEAN.—Vous êtes sûr qu'il m'a pardonné? (Un effort surhumain. Il se dresse.) L'enfer!...
Sa bouche s'ouvre pour un cri d'épouvante.
Un râle mouillé...
L'abbé tend le crucifix. Il le repousse, hagard. Puis il aperçoit le Christ: il s'en empare, il se renverse en arrière, et, frénétiquement l'écrase sur ses lèvres.
La croix trop lourde, glisse de ses doigts.
Ses membres n'obéissent plus, s'éloignent. Le cœur bat à
peine. Le cerveau fonctionne à une vitesse déréglée.
Une brusque tension de tout l'être: en chaque point du corps,
en chaque parcelle vivante, le summum de la souffrance humaine!
Quelques soubresauts.
L'immobilité.
A l'aube.
Cécile et l'abbé, seuls dans la chambre.
Cécile prie, le front dans les mains.
Elle revoit sa vie, année par année. Dans cette même chambre, un matin de sa jeunesse, elle a communié avec Jean, au chevet du docteur...
Le jour naissant pénètre par les volets entr'ouverts. Un feu vif dans la cheminée; sur le mur, derrière le cadavre plus rigide, des reflets de flamme dansent.
L'abbé est assis. Il regarde le mort: les muscles du visage sont raidis; la peau est gélatineuse; les cheveux gris sont durs, piqués dans le crâne; le cou ne semble pas avoir pu porter la tête.
Une incomparable sérénité.
Cécile ouvre successivement les tiroirs du bureau. Elle cherche
quelque volonté posthume. Elle ne trouve rien.
Mais, dans le cartonnier, sous les dossiers, une enveloppe:
«A OUVRIR APRÈS MOI.»
Elle rompt le cachet, parcourt les premières lignes, pâlit.
Elle marche vers l'abbé, et lui tend les papiers.
Il s'approche de la fenêtre.
Une grande écriture, ronde et ferme:
«Ceci est mon testament.
«Ce que j'écris aujourd'hui, ayant dépassé la quarantaine, en pleine force et en plein équilibre intellectuel, doit, de toute évidence, prévaloir contre ce que je pourrai penser ou écrire à la fin de mon existence, lorsque je serai physiquement et moralement diminué par l'âge ou par la maladie. Je ne connais rien de plus poignant que l'attitude d'un vieillard, dont la vie tout entière a été employée au service d'une idée, et qui, dans l'affaiblissement final, blasphème ce qui a été sa raison de vivre, et renie lamentablement son passé.
«En songeant que l'effort de ma vie pourrait aboutir à une semblable trahison, en songeant au parti que ceux dont j'ai si ardemment combattu les mensonges et les empiètements, ne manqueraient pas de tirer d'une si lugubre victoire, tout mon être se révolte, et je proteste d'avance, avec l'énergie farouche de l'homme que je suis, de l'homme vivant que j'aurai été, contre les dénégations sans fondement, peut-être même contre la prière agonisante du déchet humain que je puis devenir.
«J'ai mérité de mourir debout, comme j'ai vécu, sans capituler, sans quêter de vaines espérances, sans craindre le retour aux lentes évolutions de la germination éternelle...»
L'abbé frissonne. Ce rappel si net, si volontaire...
Il tourne la page:
«Je ne crois pas à l'âme humaine, substantielle et immortelle...»
«Je sais que ma personnalité n'est qu'une agglomération de particules
matérielles, dont la désagrégation entraînera la mort totale...»
«Je crois au déterminisme universel...»
«Le bien et le mal sont des distinctions arbitraires...»
Il n'achève pas.
Il replie les feuillets, et les rend à Cécile.
Il fuit l'interrogation de son regard.
Elle recule délibérément vers la cheminée. Il devine son geste. Il pourrait l'empêcher.
Mais ses yeux restent fixés sur la mort, et il ne fait pas un mouvement.
Il pense que depuis longtemps déjà, Barois ne peut plus se
défendre... Il pense à l'Église, qui a su alléger ce départ, et à qui
le sacrifice est dû,—peut-être...
Une flamme claire illumine la chambre.
Le Verger d'Augy,
Avril 1910.–Mai 1913.