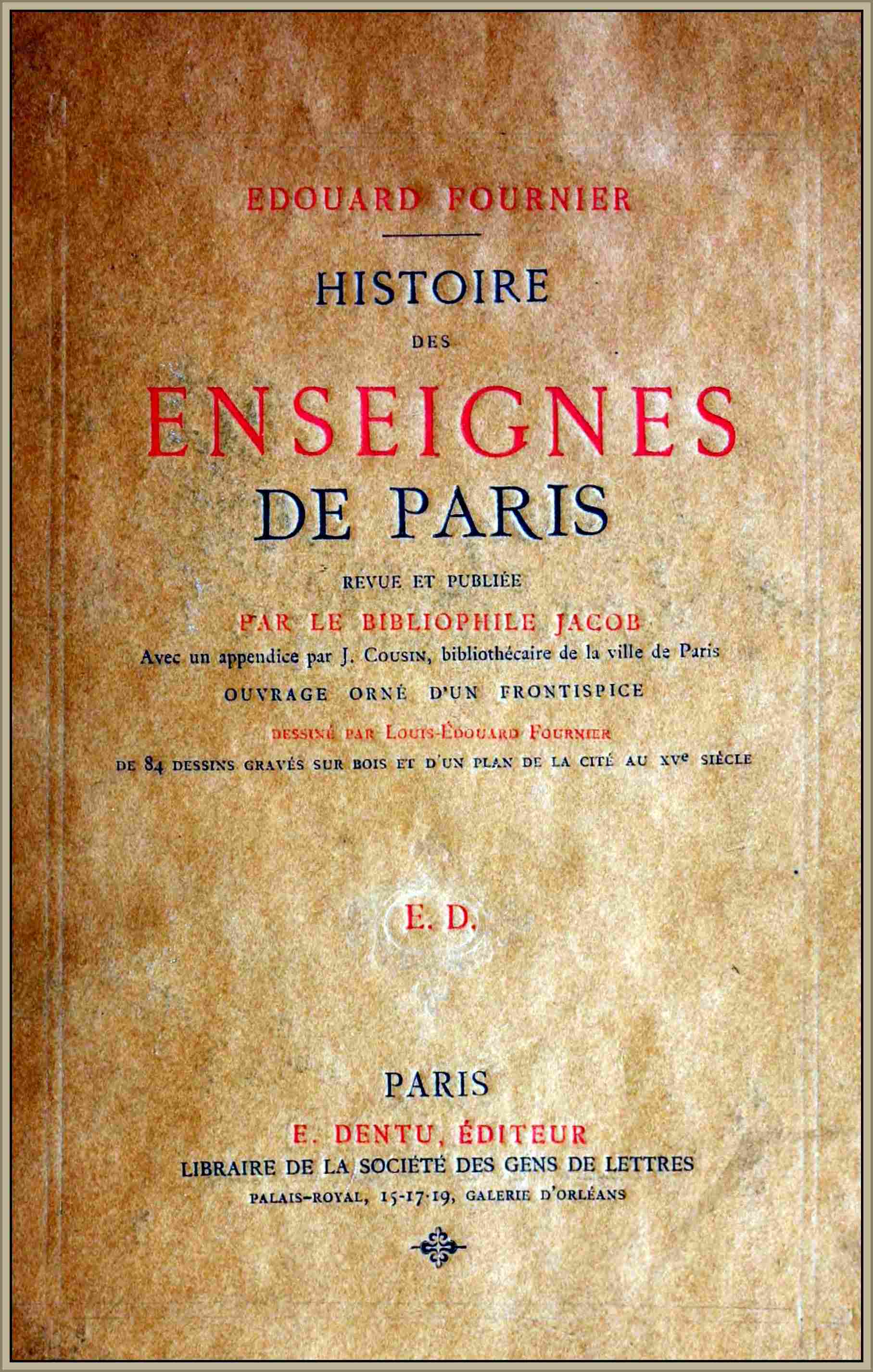
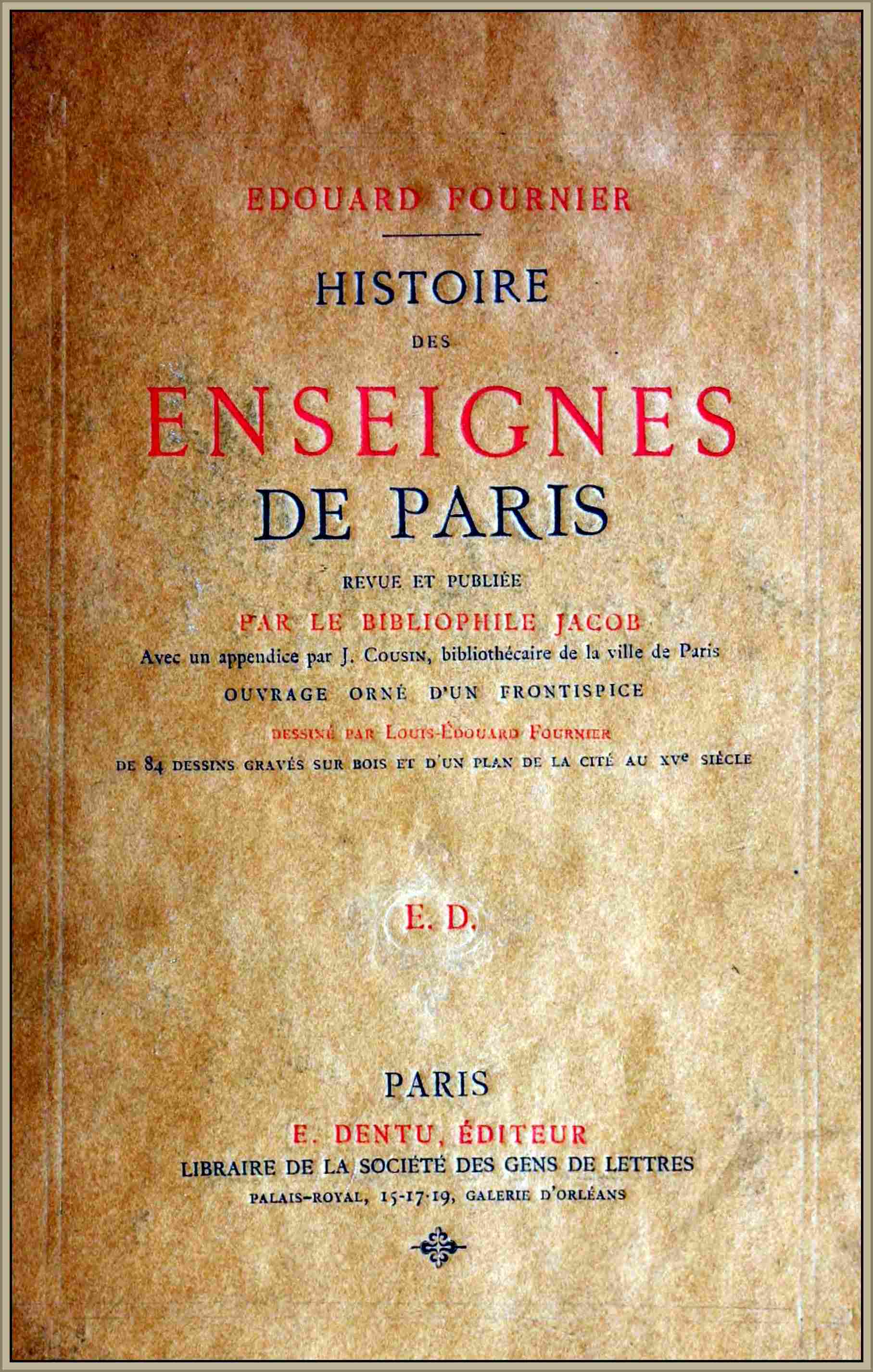
LIBRAIRIE DE E. DENTU, ÉDITEUR
DU MÊME AUTEUR
| Le Vieux-Neuf, histoire ancienne des inventions et découvertes modernes, 3 vol. gr. in-18 | 15ᶠ. | » |
| Paris Capitale, 1 vol. gr. in-18 | 3 | 50 |
| Histoire du Pont-Neuf, 2 vol. in-18 | 6 | » |
| La Comédie de Jean de La Bruyère, 2 vol. in-18 | 6 | » |
| L’Esprit des Autres, 1 vol. in-18 elzévir | 5 | » |
| L’Esprit dans l’Histoire, 1 vol. in-18 elzévir | 5 | » |
| Paris démoli, 1 vol. in-18 elzévir | 5 | » |
| Le Mystère de Robert le Diable, 1 vol. gr. in-18 | 3 | 50 |
PARIS.—IMPRIMERIE CHAIX (S.-O.).—14010-4.
EDOUARD FOURNIER
REVUE ET PUBLIÉE
PAR LE BIBLIOPHILE JACOB
Avec un appendice par J. Cousin, bibliothécaire de la ville de Paris
OUVRAGE ORNÉ D’UN FRONTISPICE
dessiné par Louis-Edouard Fournier
DE 84 DESSINS GRAVÉS SUR BOIS ET D’UN PLAN DE LA CITÉ AU XVᵉ SIÈCLE

PARIS
E. DENTU, ÉDITEUR
LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES
PALAIS-ROYAL, 15-17-19, GALERIE D’ORLÉANS
——
1884
Droits de traduction et de reproduction réservés.
{ix}{viii}
A MADAME VEUVE ÉDOUARD FOURNIER
Vous avez été, pendant plus de vingt-cinq ans, l’inspiratrice et pour ainsi dire la collaboratrice intime de tous les ouvrages de votre mari. C’était vous qu’il consultait avant de les entreprendre, c’était à votre jugement éclairé qu’il aimait à les soumettre avant de les livrer au public. C’étaient aussi vos encouragements qui lui donnaient confiance en son talent si varié et si original; c’était votre approbation qui lui garantissait celle du public: vous avez ainsi pris part à tous ses succès. Il est donc bien naturel que je vous offre, que je vous dédie, Madame, la dernière œuvre d’Édouard Fournier, cette Histoire des Enseignes de Paris, qui fut si longtemps un de ses projets favoris, qui s’est trouvée mêlée en quelque sorte à toutes ses études sur l’archéologie parisienne et qui, cependant, n’était pas encore achevée, quand une mort imprévue et prématurée est venue interrompre son œuvre favorite.
Ce fut moi, vous le savez, qui publiai en 1851 le premier ouvrage de ce laborieux et intelligent érudit, sa belle Histoire de l’Imprimerie et des Imprimeurs. Il n’est plus là aujourd’hui, pour écouter les conseils de mon amitié et de mon expérience.{x} C’est sous l’empire de ce triste et pieux souvenir que j’ai consenti à surveiller, à diriger la publication d’un ouvrage posthume qui eût été peut-être son meilleur livre, s’il avait eu le temps de le compléter et de le terminer. Je puis dire que cette tâche délicate une fois acceptée, je l’ai remplie sous vos yeux, Madame, en regrettant sans cesse que l’auteur n’ait point assez vécu pour perfectionner son œuvre, pour l’achever lui-même.
Je souhaite que cette œuvre ne soit pas inférieure à ses autres ouvrages, si savants, si curieux, si intéressants et si justement estimés, car je suis heureux d’en laisser tout l’honneur à sa mémoire, en publiant l’Histoire des Enseignes de Paris sous vos auspices, Madame, et en inscrivant votre nom en tête du dernier ouvrage de votre cher et regretté mari.
1ᵉʳ mars 1884.
Paul LACROIX
Bibliophile JACOB.
{xi}
IL est bien regrettable que ce livre n’ait pas été achevé par Édouard Fournier, qui l’avait commencé il y a plus de vingt ans et qui n’a pas cessé, pendant ce long intervalle de temps, de chercher la forme qu’il lui donnerait et de réunir çà et là les matériaux qui pourraient lui servir dans la composition de son ouvrage. Le sujet qu’il se proposait de traiter était alors tout à fait neuf, et il eût été le premier à s’en occuper, s’il avait composé et publié cet ouvrage à l’époque même où il avait déjà fait une ample moisson de tant de matériaux qu’il a employés un peu partout, dans des feuilletons de journaux, dans son Paris démoli, dans les Enigmes des rues de Paris, dans ses Chroniques et Légendes des rues de Paris, dans l’Histoire du Pont-Neuf, dans son Histoire de la Butte des Moulins, et jusque dans le Vieux-Neuf.{xii}
Les dessins et la plupart des gravures sur bois qui devaient illustrer les Enseignes de Paris étaient exécutés depuis plus de quinze ans par les soins et sous les yeux de M. E. Dentu, et l’auteur tardait encore non seulement à remettre son manuscrit à l’imprimeur, mais encore à remplir les lacunes de son travail et à en compléter l’ensemble. Il s’exposait ainsi à se voir devancé par un concurrent qui aurait eu moins de souci que lui de faire un bon livre. Le sujet était tentant, il est vrai, engageant même, à vue de pays, mais on n’avait qu’à l’aborder pour en reconnaître l’étendue et les difficultés. Beaucoup d’érudits et de littérateurs essayèrent de s’en emparer, mais ils y renoncèrent, en présence de la longueur des recherches, et ils se contentèrent les uns et les autres d’effleurer le sujet qu’il eût fallu approfondir.
Avant qu’Édouard Fournier eût projeté d’écrire cet ouvrage sur les enseignes, il n’y avait eu que quatre essais: Petit Dictionnaire critique et anecdotique des Enseignes de Paris, par un Batteur de pavé (H. de Balzac), 1826; Petite Revue des Enseignes de Paris, par un Allemand, 1826; les Enseignes, article d’Ernest Fouinet, inséré dans le Mercure de France, en 1834, et Recherches historiques sur les Enseignes des maisons particulières, par E. de La Quérière, 1852. Le Petit Dictionnaire de Balzac ne faisait mention que des enseignes qu’on voyait à Paris en 1825; la Petite Revue n’était qu’un ca{xiii}nard de colporteur, où l’on se moque de la mauvaise orthographe des enseignes; l’article de Fouinet ne contenait que des généralités curieuses, et la brochure de La Quérière parlait moins des enseignes de Paris que de celles de Rouen et des autres villes de France. L’exemple cependant était donné: il fut suivi, quelques années après, par un savant archéologue, Adolphe Berty, qui publia, en 1860, deux articles sur les anciennes enseignes des maisons de la Cité, dans la Revue archéologique, et par cinq ou six journalistes, qui trouvèrent chacun matière à deux ou trois articles de fantaisie et d’histoire sur les enseignes: Firmin Maillard, dans le Journal de Paris; Jean de Paris, dans le Figaro; Alfred de Bougy, dans la Presse; Hector Malot, dans le Journal pour tous; Amédée Berger, dans le Journal des Débats; J. Poignant, dans le Gaulois; etc.
Ces articles, ces essais n’avaient servi qu’à faire désirer davantage le livre d’Édouard Fournier, que M. E. Dentu annonçait toujours et qui n’était pas encore près de paraître. L’auteur, en effet, tout en travaillant à son ouvrage, n’en avait pas encore bien arrêté le plan; ses notes me prouvent qu’il avait hésité, à cet égard, jusqu’au dernier moment, et la publication du grand ouvrage de M. Blavignac, architecte de Genève, Histoire des Enseignes d’hôtelleries, d’auberges et de cabarets (Genève, Grosset et Trembley, 1878, in-8º de 542 pages), n’avait fait sans doute qu’augmenter l’indé{xiv}cision d’Édouard Fournier. Fallait-il diviser le livre en deux et même en trois parties distinctes? Les enseignes dans l’antiquité, les enseignes de Paris, et les enseignes en France et à l’étranger? Fallait-il se borner à l’histoire ancienne et moderne des enseignes de Paris? Fallait-il, comme l’a fait M. Blavignac, classer les enseignes par figures et par sujets, comme la Science des armoiries a rangé alphabétiquement les blasons des familles? Fallait-il, à travers ces milliers d’enseignes de toutes les époques, aller à l’aventure, sans autre règle que le caprice, en rassemblant çà et là des faits bizarres et inconnus, des particularités intéressantes, des anecdotes diverses, des renseignements archéologiques, des mélanges d’érudition et de philosophie? La mort, une mort imprévue et presque subite, est venue mettre un terme à ces incertitudes de composition, à ces embarras, à ces doutes sur le choix d’un plan définitif, en faisant tomber la plume des mains du laborieux et consciencieux écrivain, qui avait mis tant d’années à préparer son dernier ouvrage, et qui, pour avoir voulu le faire plus complet, plus parfait que les autres, n’a pas eu le temps de le finir.
La digne veuve d’Édouard Fournier m’a confié religieusement tous les manuscrits, toutes les notes, tous les imprimés, tous les documents enfin, rassemblés par son mari, pour exécuter l’ouvrage que M. E. Dentu n’attendait pas sans impatience depuis plus de quinze{xv} ans et que l’auteur promettait sans cesse dans le délai le plus rapproché, car Édouard Fournier était un de ces écrivains consciencieux qui ne croient jamais avoir fait assez de recherches pour la préparation de leurs ouvrages historiques.
Je me suis mis à l’œuvre aussitôt, et j’ai fait usage, avec un soin minutieux, des innombrables matériaux qu’il avait accumulés pour son travail. Après avoir adopté un plan systématique qui ne comprenait que les enseignes de Paris à toutes les époques, avec une introduction très sommaire sur les enseignes dans l’antiquité, j’ai distribué en trente et un chapitres tout ce qu’Édouard Fournier avait préparé, noté, indiqué, écrit pour l’Histoire des Enseignes de Paris, en élaguant, en laissant de côté seulement ce qui concernait les enseignes des autres villes de France.
Après quoi, j’ai retouché, remanié, augmenté, complété ceci et cela, en esquissant de mon mieux les chapitres dont l’idée avait été oubliée ou laissée de côté par le maître de l’œuvre; en me pénétrant bien de la pensée que je n’étais pas ici l’auteur, mais le simple éditeur de cette œuvre posthume. Je n’ai pas cherché, je l’avoue, à imiter la manière et les procédés de métier littéraire qui ont fait le succès de l’intelligent et spirituel savant, auquel je ne voulais rien enlever de ce qui lui appartenait; je me suis contenté de remplir simplement et modestement les lacunes de{xvi} l’ouvrage, qui était sien et qui restera sien dans l’importante collection de ses œuvres historiques sur le vieux et le nouveau Paris. Je crois devoir déclarer néanmoins que ce livre eût été infiniment supérieur à ce qu’il est, si Édouard Fournier avait pu l’achever et le publier lui-même.
Ma tâche accomplie sous les auspices d’un pieux devoir de vieille amitié, je laisse à mon jeune ami Louis-Édouard Fournier, qui a obtenu le grand prix de Rome l’année même où il perdait son digne père, le soin de représenter dans une ingénieuse allégorie, en tête de cet ouvrage qu’elle caractérise, le Génie de l’érudition, une lampe à la main, étudiant le sens héraldique des armes de la ville de Paris et s’efforçant, en présence du Sphinx antique, d’expliquer les énigmes de l’histoire et d’en éclairer les ténèbres: Tenebras historiæ illuminat eruditio.
Paul LACROIX,
Bibliophile JACOB
{xviii}{xvii}
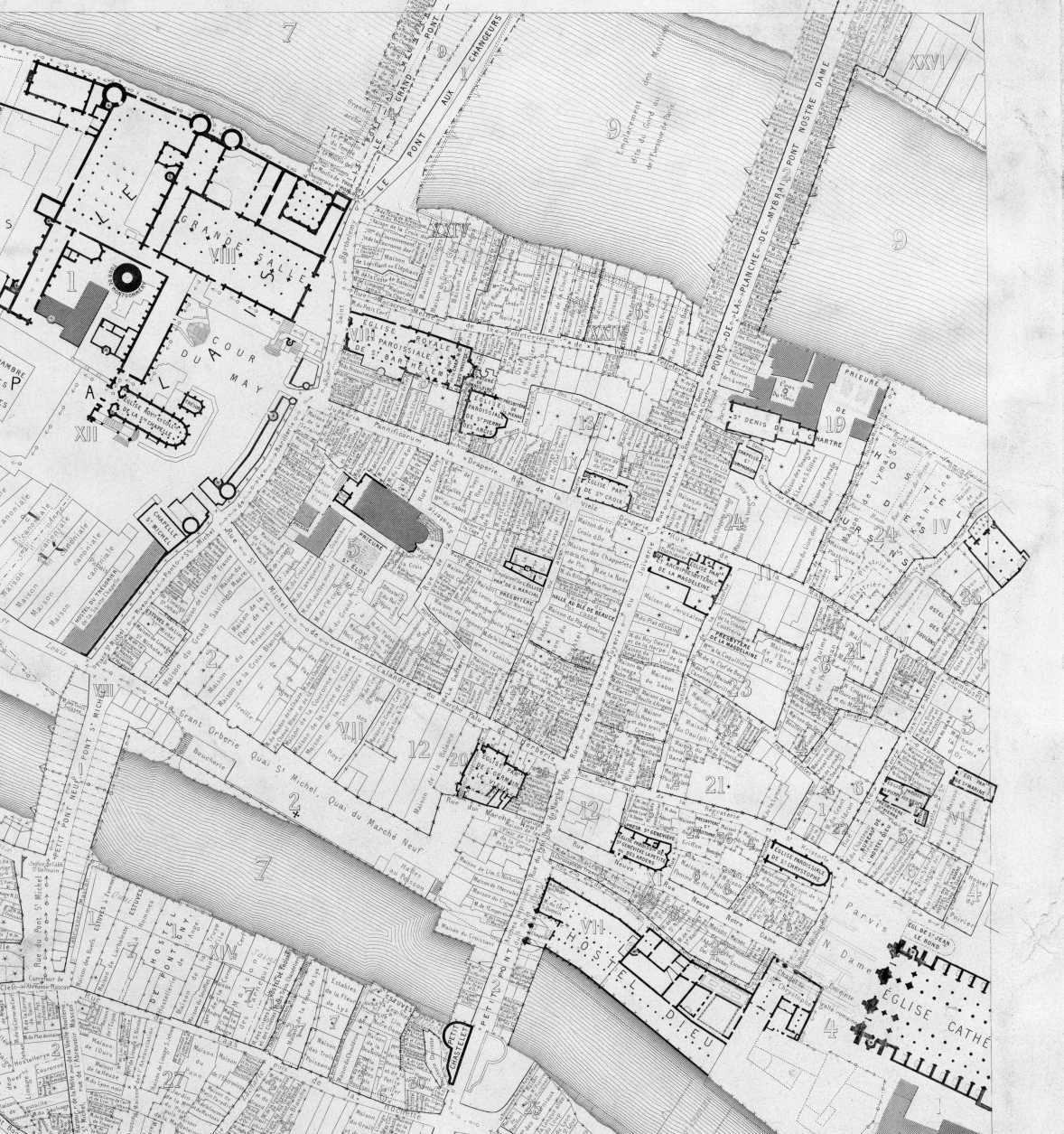
ON peut dire avec assurance que les enseignes ont existé, depuis les temps les plus reculés, chez tous les peuples, chez les Égyptiens comme chez les Hébreux, chez les Assyriens comme chez les Grecs, partout enfin où il y avait des inscriptions publiques sur les monuments et des monnaies portant des caractères ou des signes graphiques, car les enseignes ne sont que des emblèmes ou des inscriptions. Mais, jusqu’à présent, l’érudition n’a pas pris la peine de rechercher leur origine et de constater leur existence dans l’histoire des mœurs de l’antiquité égyptienne, hébraïque, assyrienne et grecque. C’est seulement chez les Romains que la science s’est{2} occupée de prouver, d’après le texte des auteurs latins et par le témoignage incontestable de quelques monuments figurés, qu’il y avait des enseignes de toute espèce dans la Rome antique et dans les principales villes de l’empire romain.
Cependant, si l’abbé Barthélemy n’a pas parlé des enseignes dans son savant Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, vers le milieu du IVᵉ siècle avant l’ère vulgaire, Zell, professeur de littérature ancienne à l’université de Fribourg, a voulu combler cette lacune en citant un passage d’Aristote, qui pourrait faire croire que les enseignes remonteraient chez les Grecs à la plus haute antiquité[1]; mais notre professeur s’avise tout à coup de changer un mot (χαμήλων, au lieu de χαπήλέων) dans ce passage d’Aristote, et les raisons assez concluantes qu’il donne de ce changement de mot viennent détruire toute l’économie de sa dissertation. Les malheureuses enseignes ne s’en relèveraient pas, si le savant helléniste ne démontrait pas ensuite que les hôtelleries (λέσχαι) furent presque contemporaines des temps héroïques et qu’elles ont été d’abord établies dans les îles Ioniennes. C’est là qu’une esclave insolente veut renvoyer Ulysse, dans l’Odyssée d’Homère, et le commentateur d’Homère, Eustathius, qui vivait au XIIᵉ siècle de notre ère, prétend que les λέσχαι étaient des édifices à portiques ouverts, où l’on entrait à pied ou à cheval. Athénée ne comptait pas moins de 360 de ces hôtelleries en Grèce, au IIᵉ siècle depuis Jésus-Christ hôtelleries qui étaient caractérisées par des enseignes{3} ou par des écriteaux, car il fallait distinguer les λέσχαι des πανδοκεῖα, οù l’on ne recevait que des étrangers. Quant aux cabarets, καπηλεῖα, dont les patrons étaient infâmes comme les lenones (maquereaux), ils avaient sans doute aussi des enseignes, pour qu’on ne les confondit pas avec les οἰνῶνες, boutiques où l’on vendait du vin en détail.
On peut supposer quelle était l’enseigne ordinaire des débitants de vin, la pomme de pin étant consacrée à Neptune et à Bacchus, car les tonneaux étaient enduits de poix-résine, pour empêcher le vin de filtrer entre les douves de ces barriques, dans l’intérieur desquelles l’eau de mer ne pouvait pénétrer quand on les transportait dans des barques. Le vin contenu dans de pareils tonneaux sentait la poix-résine, mais le peuple trouvait à ce vin-là une saveur particulière. Plutarque ne nous dit pas que la pomme de pin fût l’enseigne des cabarets grecs, mais il rechercha pourquoi elle était dédiée en même temps à Neptune et à Bacchus[2]. La tradition s’est maintenue depuis deux mille ans et plus, en perdant peut-être son sens mythologique, car, de nos jours, les cabarets de la Grèce sont encore décorés de la pomme de pin traditionnelle[3]. Ce n’était pas le seul emblème qui fût le signe distinctif des cabarets. Les monnaies de Byzance, cette ville de débauche et d’ivrognerie, étaient surchargées d’emblèmes. «Les images qui y sont représentées, disions-nous dans un autre ouvrage que nous citerons plus d’une fois dans celui-ci, nous sembleraient copiées sur les enseignes des cabarets grecs, si quelque chose nous donnait à croire que{4} les cabarets eussent des enseignes. Ce ne sont que grappes de raisin avec leurs pampres, amphores à larges anses, à large ventre, ou bien des têtes de Bacchus couronnées de lierre[4].»
Chez les Romains, il n’y a plus de doute, l’enseigne est partout et son usage s’applique à tout. L’enseigne (insigne) des galères ne différait pas beaucoup des enseignes de marchands. C’était une figure sculptée ou peinte, à l’avant d’un vaisseau, pour représenter l’objet dont le navire portait le nom. Une autre figure, placée à l’arrière et nommée tutela (protection), représentait la divinité à qui la sauvegarde du navire était confiée[5]. Ces divinités tutélaires présidaient aussi à la garde des cités, et on voyait, sur les portes de quelques villes romaines, l’image sculptée de Pan, dieu des champs, comme il est dépeint dans ces deux vers d’un poète du Vᵉ siècle:
N’était-ce pas là une enseigne portant un nom de dieu ou de ville? Il n’y a pas de peuple qui ait fait plus d’usage des inscriptions que les Romains. Ces inscriptions, accompagnées d’images sculptées ou peintes, étaient alors de vraies enseignes, signa, et avaient dès lors toutes sortes de destinations, dans la vie publique comme dans la vie privée. Ainsi, les poids employés pour le commerce indiquaient{5} souvent le nom du marchand qui s’en servait et le genre de marchandises qu’il vendait. En février 1830, en déblayant trois maisons antiques, à Rome, on trouva dans une boutique trente-huit poids en bronze avec cette légende: Eme et habebis (Achète, tu l’auras)[7]. Toutes les maisons de Rome, sous les empereurs, avaient, au lieu de numéros, des enseignes muettes représentant leur nom, ou des écriteaux sur lesquels leur nom était inscrit. On sait, par exemple, que le poète Martial, qui vivait sous le règne de Titus, était logé à l’enseigne du Poirier (ad Pyrum). Ces maisons avaient jusqu’à huit ou dix étages, et quiconque exerçait un commerce ou une industrie était libre de l’annoncer au moyen d’une enseigne, en sorte que les maisons étaient, du haut en bas, bariolées d’enseignes peintes ou sculptées avec des inscriptions. Cette multitude d’enseignes ou d’écriteaux devait employer un grand nombre de peintres ou barbouilleurs, qui n’avaient pas d’autre métier; c’étaient probablement ceux que Pline[8] appelle rhyparographi, qui n’exécutaient dans leurs tableaux que des sujets bas et grossiers.
Les premières enseignes, selon Pline, avaient été des trophées et des boucliers, qui non seulement portaient des noms propres, peut-être avec indication d’une qualité professionnelle, mais encore qui offraient des peintures caricaturales: «Je vous montrerai tel que vous êtes, dis-je, un jour, à Helvius Mucia (c’est Cicéron qui parle).—Montrez, me répondit-il. Alors j’indiquai du doigt, dans le bouclier symbolique de Marius, sous les boutiques neuves, la{6} figure d’un Gaulois tout contrefait, tirant une langue énorme, et les joues enflées[9].»
Il y avait aussi des enseignes à combat, sans doute pour les marchands qui vendaient soit des armes de guerre et des cuirasses, soit des objets divers destinés aux combats du cirque. Horace en parle, quand il fait dire à Dave, dans une de ses satires: «Le jarret tendu, je regarde les combats de Fulvius, de Rutuba et de Placideanus, ces combats si fidèlement retracés avec de la couleur rouge ou du charbon[10].»
C’étaient surtout les hôtelleries, les cabarets et les marchands de vin qui se distinguaient par leurs enseignes. Ces derniers s’étaient contentés longtemps d’annoncer leur marchandise par une couronne de lierre suspendue à la porte, le lierre étant consacré à Bacchus; une sentence de Publius Syrus dit qu’il n’est pas besoin de suspendre une branche de lierre pour vendre du vin (Vino vendibili suspensa hedera non opus est). L’enseigne d’un cabaret se composait ordinairement de quelque figure hideuse, ou d’un bas-relief en terre cuite, dont le sujet était relatif à la profession du tavernier[11]. Les hôtelleries, selon l’opinion de plusieurs antiquaires, avaient souvent des figures d’animaux pour enseignes. Il y eut, à Rome, dans le quartier des Esquilies, quartier rempli de cabarets, une rue de l’Ours coiffé (vicus Ursi pileati), et ce nom venait certainement de l’enseigne d’un cabaret, que la tradition semble rappeler, au même endroit, puisqu’on y trouve encore l’Osteria del Orso, là même où l’on a découvert{7} des inscriptions antiques qui désignent ainsi la localité (ad Ursum pileatum)[12]. L’enseigne d’un autre cabaret représentait un ours en toge (Ursus togatus)[13].
Parfois l’hôtelier se nommait lui-même sur son enseigne, qui était gravée sur pierre au frontispice de sa maison, comme le prouve cette inscription curieuse, trouvée en France[14]:
En voici la traduction: «Ici, Mercure te promet le gain, Apollon la santé, Septimanus l’hospitalité. Celui qui apportera son dîner s’en trouvera mieux. Après cela, étranger, regarde où tu veux loger.»
On pourrait, d’après le sens de l’inscription, supposer que Septimanus avait mis son auberge sous les auspices de Mercure et d’Apollon.
Une autre inscription, citée dans les Miscellanées de Spon[15], nous apprend qu’Éros, affranchi de Lucius Afframius, était venu, avec sa femme Procilla, de Tarascon à Narbonne, pour s’y faire hôtelier (hospitalis), sous l’enseigne du Coq gaulois ou plutôt du Gaulois à tête de Coq (a Gallo gallinaceo). Une autre enseigne d’hôtellerie,{8} représentant un combat de rats et de belettes, aurait fourni, dit-on, à Phèdre, contemporain des premiers empereurs de Rome, le sujet et le titre d’une de ses plus jolies fables.
Les plus vieux usages se conservent surtout dans le peuple. Ainsi, les moulins à vent ou moulinets, qui se voient encore au-dessus de la porte de beaucoup de cabarets et qui semblent être un caprice de cabaretier, sont signalés, sous le nom de sucula, dans les comédies de Plaute, et leur présence à l’entrée d’une taverne signifiait que le vin fait tourner les têtes, comme le vent les ailes d’un moulin. Les cabarets et les popines (cuisines populaires) de l’ancienne Rome avaient aussi des enseignes en nature, c’est-à-dire un étalage de bouteilles et de flacons, de viandes et de légumes, arrangés avec art, comme les montres de nos boutiques. Ces sortes d’enseignes parlaient aux yeux mieux encore que les plus ingénieuses inventions des peintres et des sculpteurs. Les marchands d’eau, qui sont encore presque aussi nombreux que les marchands de vin, en Italie comme en Espagne, n’ayant rien à montrer dans leur étalage pour affriander les gourmands, imaginaient des tableaux d’enseigne capables de piquer la curiosité du public. Ainsi l’architecte Mazois, dans son grand ouvrage sur les antiquités de Pompéi, dit y avoir vu une peinture qu’il n’a pas reproduite, laquelle représentait les compagnons d’Ulysse changés en bêtes par les philtres enivrants de Circé. Cette fresque, qui servait d’enseigne à un thermopole (thermopolium), boutique où l’on vendait des boissons chaudes, conseillait aux ivrognes de redouter les effets du vin. Les enseignes des mauvais lieux, meritoria et lupanaria, étaient moins{9} morales; et, sans parler des écriteaux attachés aux portes des meretrices ou femmes de débauche, avec leurs noms et leurs qualités plus ou moins malhonnêtes (voy., dans Tacite, la description des hauts faits de l’impératrice Messaline, qui se prostituait, sous le nom de Lycisca, dans un lupanar), ces lieux infâmes, situés généralement aux environs des théâtres, des cirques et des bains, dans les quartiers qu’habitait la population la plus abjecte de la ville, étaient signalés, le jour, par l’image monstrueuse d’un phallus, et, le soir, par la faible clarté d’une lampe phallophore. Plus tard, le phallus paraît avoir été remplacé, à la porte des mauvais lieux, par une pierre en forme de coin, qui avait la même signification.
Les fouilles de Pompéi ont mis à découvert un grand nombre d’enseignes, peintes, sculptées en pierre ou moulées en terre cuite, la plupart sans inscription, mais encore fixées à la place qu’elles occupaient au-dessus ou à côté des boutiques de marchands. Il est souvent difficile de reconnaître la profession qu’elles caractérisent. Ainsi, un petit bas-relief en terre cuite, représentant une chèvre, pouvait être l’enseigne d’une étable de chèvres, sinon d’un vendeur de lait ou de fromages de chèvre. Le nom du marchand était parfois écrit ou peint, sur le mur, à côté du bas-relief ou de la peinture. Beaucoup de ces tableaux, peints grossièrement à la cire rouge, représentent une figure grimaçante, ou bien les denrées mêmes qui se vendaient dans la boutique; un marchand de vin avait pris pour enseigne deux esclaves portant sur leurs épaules une gaule à laquelle est suspendue une amphore. On a cru pouvoir attribuer à un professeur de pugilat ou à un gladiateur une peinture{10} représentant deux hommes qui combattent. On a moins de doute sur la destination d’un tableau qui représente un homme fouettant un enfant. C’était là, certainement, l’enseigne d’un maître d’école. Enfin, l’éléphant, qu’on employait autrefois au transport des fardeaux et des marchandises, devait être l’enseigne d’une hôtellerie, où logeaient des voyageurs et des marchands étrangers[16].
Les enseignes emblématiques étaient si bien appropriées à l’esprit du peuple romain, que l’édile faisait peindre, sur les monuments publics, des figures de serpents, et cette simple image, comprise de tout le monde, avait le même sens et la même autorité que cette inscription de police, plus explicite, qu’on retrouve partout dans les villes modernes: Défense de déposer ici aucune ordure, sous peine d’amende. Le serpent, consacré à Esculape, commandait le respect et inspirait une sorte de crainte religieuse[17].{11}
NOUS n’avons pas trouvé, dans l’ancien droit coutumier, la moindre disposition légale relative à l’établissement des enseignes de Paris. Il est bien certain, cependant, que leur usage, devenu si général depuis la fin du xiiiᵉ siècle, avait donné lieu à des règlements de police qui ne sont pas venus jusqu’à nous, puisque le commissaire Nicolas de la Mare n’en fait pas mention dans son Traité de la Police, dont il avait emprunté tous les matériaux aux archives du Châtelet. Il est impossible, en effet, que ces innombrables enseignes, de toutes dimensions, qu’on{12} suspendait à l’entrée des maisons et au-dessus des ouvroirs ou boutiques, n’aient pas exigé des mesures d’ordre, de surveillance et de sécurité, que l’intérêt du public rendait absolument nécessaires. Ces enseignes, en pierre, en terre cuite, en bois, ou même en métal, la plupart attachées avec des anneaux à des potences de fer, qui faisaient saillie de deux ou trois pieds sur la rue, étaient un danger permanent pour les passants, surtout lorsque le vent les secouait en tous sens et menaçait à chaque instant de les arracher de leurs pivots mobiles et de leurs charnières rouillées. Quelques-unes de ces enseignes avaient un poids énorme; d’autres s’avançaient jusqu’au milieu de la rue ou s’élevaient de plus d’un mètre au-dessus de l’auvent des boutiques.
Les proportions des auvents n’étaient pas moindres; ils servaient d’abri pour les marchandises ou pour les marchands, contre le grand soleil et contre la pluie. Ils se succédaient l’un après l’autre, se touchant et même se superposant, dans toute la longueur d’une rue, de sorte qu’on pouvait, en côtoyant les boutiques, n’avoir presque rien à craindre des averses et des coups de soleil. Ces auvents, placés trop bas, entravaient le passage des charrois et des voitures; placés plus haut, ils empêchaient l’air et la lumière de circuler dans ces ruelles étroites où s’amoncelaient les odeurs des boues et des ruisseaux. Nous ne voyons nulle part que les marchands aient payé un droit à la ville pour avoir une enseigne, tandis que le droit d’avoir un auvent sur rue était taxé par le garde de la voirie, sans doute d’après la grandeur de cet auvent. Ce droit d’auvent fut acquis, moyennant 40 sous, le{13} 6 novembre 1448, du garde de la voirie, pour la maison du Château frileux, située dans la rue de Jouy[19]. Il est probable que ce furent les marchands eux-mêmes qui demandèrent la suppression des auvents, qui avaient tellement envahi les rues, que les enseignes n’étaient plus visibles. Celles-ci, d’ailleurs, s’étaient multipliées en s’agrandissant tous les jours et en se disputant l’une l’autre une place au soleil. Ce fut d’abord aux auvents que s’attaqua la police de la voirie: ils furent donc déclarés gênants et nuisibles, en 1554, par une ordonnance de police, qui tomba bientôt en désuétude, puisque les auvents reparurent, plus envahissants que jamais[20]. Il y eut donc lutte continuelle entre les auvents et les enseignes, jusqu’à la destruction complète des premiers, qui subsistèrent encore plus d’un siècle, lorsqu’on eut fait disparaître une partie de leurs inconvénients en réduisant leur largeur et en fixant la hauteur qu’ils pouvaient avoir. Malgré l’existence des règlements de voirie contre les saillies qui causaient un embarras sur la voie publique, les enseignes, qui, à vrai dire, ne gênaient pas la circulation, échappèrent aux persécutions de la police. Les corps de métiers avaient assez de puissance et de crédit pour maintenir leurs enseignes, en dépit des réclamations de la classe bourgeoise. Les auvents avaient été tour à tour supprimés et rétablis, diminués et augmentés. Pendant les troubles de la Fronde, lorsque la capitale était bloquée par l’armée royale, les échevins ordonnèrent aux habitants d’abattre tous les auvents de leurs{14} maisons[21]. Il est probable que les enseignes reçurent alors une première atteinte et que les plus encombrantes partagèrent le sort des auvents. Elles avaient bravé trop longtemps les lois de la voirie, et l’on peut croire que quelques accidents décidèrent le lieutenant de police à sévir contre elles. Nous lisons, dans une lettre de Guy Patin[22], en date du 2 novembre 1666: «On réforme ici les auvents des boutiques, qui étoient trop grands; à quoi les commissaires du Châtelet sont fort occupés. Il y en a même deux d’interdits de leurs charges pour n’y avoir pas vacqué avec assez d’exactitude; mais on ne diminue pas les tailles, ni les impôts du Mazarin.» Les auvents avaient sans doute des défenseurs influents, car ceux-ci, par représailles, dénoncèrent les abus des enseignes, et la jurisprudence du Châtelet leur donna raison. Voici comment Charles Robinet, dans ses Lettres en vers à Madame[23], raconte cette rigoureuse prohibition des grandes enseignes:
Cette réduction de la grandeur exagérée des enseignes ne suffisait pas encore à l’auteur des Lettres en vers, car il expose en ces termes les vœux de l’opinion publique, au sujet de certaines enseignes accusées d’impiété:
C’était la première fois que les enseignes avaient à se défendre contre une attaque aussi violente, car l’ordonnance de 1577, relativement aux enseignes d’hôtelleries[24], qu’on soumit alors à des règles fixes, n’avait pas même inquiété les marchands, qui professaient le plus souverain mépris pour les hôteliers et aubergistes, lesquels ne fai{16}saient partie d’aucune corporation[25]. Les enseignes ne manquaient pas de protecteurs, qui obtinrent des concessions de la part du lieutenant de police La Reynie. La dimension des enseignes fut fixée de manière à ce qu’elles ne payassent aucun droit au fisc, quand elles ne dépassaient pas cette dimension uniforme et qu’elles étaient appliquées solidement au mur. Quant aux enseignes saillantes, elles furent autorisées, ou plutôt tolérées, à condition qu’elles payassent le droit d’être suspendues, à telle hauteur réglementaire, au-dessus du pavé du roi[26].
Les enseignes se vengèrent sur les auvents, qui furent dès lors irrévocablement détruits; puis, elles reprirent petit à petit leurs anciennes proportions, sous la tolérance de la police, si bien qu’en 1679 elles avaient reparu aussi grandes qu’elles l’étaient avant l’ordonnance de La Reynie. Les marchands attachaient tant d’importance à leurs enseignes, qu’ils payèrent tout ce qu’on voulut, et les enseignes pendantes, dont la taxe continuait à s’élever, se gardèrent bien de venir se coller honteusement à la muraille. Il n’y en eut jamais un plus grand nombre, et La Reynie signalait leur éclatante réapparition en 1688. L’autorité ne fit qu’exiger un modèle de potence plus solide, pour suspendre ces enseignes, et un droit plus fort, pour la permission qu’il fallait acheter à prix débattu.
En même temps, la pose de toute nouvelle enseigne et{17} le changement d’une enseigne ancienne donnèrent lieu au payement d’un droit attribué au voyer[27]. Le bureau de la voirie, qui modifiait à son gré les us et coutumes du régime des enseignes marchandes et immobilières, exerça toute espèce de vexations contre les propriétaires de ces enseignes. Les syndicats des corporations résistèrent et surtout protestèrent; mais, comme il s’agissait toujours de droits à payer, les contraventions finissaient par des amendes et des indemnités au profit du voyer et de la voirie. Tout était bon pour tirer de l’argent des enseignes; et quand, en vertu de l’édit de 1696, Charles d’Hozier, juge d’armes, reçut la mission de dresser le recueil général des armoiries qui pouvaient être portées ou revendiquées en France, afin de les soumettre au payement d’un droit fiscal, une immense quantité de propriétaires d’enseignes furent compris au nombre des gens à armoiries, parce que leurs enseignes avaient arboré des prétentions nobiliaires, ou simulé des armes de fantaisie, ayant plus ou moins un caractère héraldique. L’enseigne était désormais un bon produit pour le fisc.
Un édit du mois de mars 1693 avait, d’ailleurs, permis de dresser un état précis et détaillé de différentes espèces sur lesquelles il était dû des droits aux commissaires de la voirie. Il suffira d’indiquer les principaux articles concernant les enseignes[28]:
«Article XII.—Pour les enseignes grandes ou petites, y compris la potence, s’il y en a, ou autres accompagne{18}ments, qu’elles soient suspendues au-dessus ou au-dessous de l’auvent (on voit que les auvents avaient regagné du terrain), en quelque nombre qu’il y en ait à la même maison, un seul droit de quatre livres; mais pareil droit pour chaque marchand ou artisan, dans la même maison. Si, après l’année révolue, il était fait ou exposé quelque nouvelle enseigne, nouveau droit de quatre livres.
»Article XIII.—Pour tous les tableaux appliqués sur les trumeaux et jambages des portes, ou de la boutique, en quelque nombre qu’ils soient à la même maison, pour le même marchand, un seul droit de quatre livres.
»Article XXI.—Pour les bustes aux maisons ou encoignures, indiquant la profession, quelque nombre qu’il y en ait, le tout en une même maison, un seul droit de quatre livres.
»Article XXII.—Pour les cadrans indiquant la profession, un seul droit de quatre livres.
»Article XXVIII.—Aucun propriétaire ou locataire des maisons, boutiques ou échoppes ne pourra faire poser, établir ou échanger aucune desdites choses ou espèces, qu’il n’ait obtenu préalablement la permission, par écrit, desdits commissaires.»
Ces articles, si simples en apparence, donnaient prétexte à toutes sortes de difficultés qui se traduisaient par des amendes ou par des exactions. Il n’y avait pas un changement d’enseigne qui n’amenât des tracasseries non seulement de la part des commissaires de la voirie, mais encore de la part des voisins; car les tribunaux avaient décidé qu’une enseigne étant une propriété, nul ne pouvait la prendre dans la même ville, surtout si le commerce{19} et la profession étaient identiques chez deux concurrents qui se disputaient la même enseigne. De là des querelles, des procès et des arbitrages. On était bien loin de l’âge d’or des enseignes, où chacun était libre de choisir et d’adopter l’enseigne qui lui plaisait, sans être accusé de plagiat, de contrefaçon ou de concurrence malhonnête, alors que chaque rue avait quelquefois deux ou trois enseignes semblables pour des métiers différents. Il est certain, dans tous les cas, que les ordonnances de police, qui réglaient d’une manière uniforme les dimensions de l’enseigne, furent appliquées avec la dernière rigueur, car le docteur anglais Lister le constate en ces termes, dans le récit du voyage qu’il fit à Paris en 1698: «On ordonna, il y a quelque temps, aux marchands, d’abattre toutes leurs enseignes à la fois, sans permettre de les avancer, à l’avenir, de plus d’un pied ou deux au-delà du mur, ou d’avoir plus de telle dimension, assez petite, en carré. On obéit à l’instant; en sorte que ces enseignes n’obstruent plus les rues et font, grâce à leur petitesse ou à leur élévation, aussi peu de figure que s’il n’y en avait point[29].»
Depuis le numérotage des maisons, au XVIIIᵉ siècle, la plupart des enseignes, que ce numérotage rendait inutiles, avaient disparu, il est vrai, et il ne restait plus que les enseignes des marchands. Ces derniers étaient las de subir la tyrannie et la vénalité des commissaires de la voirie. Ceux-ci proposèrent une réforme générale des enseignes, dans le courant de l’année 1761, et{20} ils obtinrent des Trésoriers de France une ordonnance qui devait produire de nouveaux droits et de nouveaux profits, sous la direction du bureau de la voirie. D’après cette ordonnance, toutes les enseignes, sans exception, devaient être placées à quinze pieds de hauteur au-dessus du pavé des rues et n’excéder les murs des maisons que de deux ou trois pieds. «Sous prétexte, dit Barbier dans son Journal[30], qu’elles seront moins exposées à se détacher dans les grands vents et qu’elles incommoderont moins les fenêtres voisines, mais aussi peut-être pour quelques raisons de droits et de profits.» Les six Corps de marchands s’émurent de l’ordonnance des Trésoriers de France, qu’ils regardèrent avec raison comme un moyen de tirer l’argent des bourses. Ils se réunirent d’office en assemblée générale et firent rédiger un mémoire dans lequel on appréciait la dépense considérable que l’ordonnance imposait aux gens à enseignes, vu la difficulté de mettre de niveau toutes les enseignes qui étaient de grandeur inégale et dont la plupart devraient être entièrement changées. Le mémoire fut présenté au lieutenant de police, qui accorda aux six Corps de marchands la permission verbale de supprimer les enseignes saillantes et de les appliquer en tableau sur les murs des maisons, dans les trumeaux des croisées. «Ce qui offusquera encore moins, dit Barbier, les fenêtres du premier étage et la lumière des lanternes le soir.» Les six Corps de marchands s’engagèrent à faire exécuter, dans l’es{21}pace de deux mois, par tous les membres de leur corporation, le changement qu’ils avaient accepté dans le système général des enseignes, et le lieutenant de police décida que toutes les Communautés d’arts et métiers, qui ne faisaient pas partie des six Corps, seraient tenues de se conformer au même engagement, sans ordonnance de police publiée et affichée. Chaque Corps et chaque Communauté devaient, à tour de rôle, aviser à faire enlever les enseignes saillantes et à les mettre en placard contre les maisons. Pendant plus d’un mois, on ne vit dans les rues, où la circulation des voitures fut presque interrompue, que des ouvriers travaillant, sur des échelles, à déplacer et à replacer les enseignes, aux frais des six Corps de marchands et des Communautés de métiers. Ce changement général fut approuvé par tout le monde, et l’aspect des rues y gagna beaucoup. «En tout cas, dit Barbier, cela fera repentir le bureau de la voirie de la réforme qu’il voulait imaginer, par la perte des droits que lui produisaient les changements et embellissements continuels que l’on faisait aux enseignes.»
Les auvents subsistaient encore, réduits, il est vrai, à des proportions restreintes, mais les enseignes saillantes ou pendantes étaient définitivement condamnées, d’après l’avis des six Corps de marchands. «Les enseignes saillantes, disait une ordonnance du lieutenant de police, en date du 17 décembre 1761, faisaient paraître les rues plus étroites, et dans les rues commerçantes elles nuisaient considérablement aux vues des premiers étages, et même à la clarté des lanternes, en occasionnant des ombres préjudiciables à la sûreté publique; elles formaient un péril{22} perpétuellement imminent sur la tête des passants, tant par l’inattention des propriétaires et des locataires sur la vétusté des enseignes ou des potences, que par les coups de vent, qui en ont souvent abattu plusieurs et causé les accidents les plus funestes.» Dans la même ordonnance, le lieutenant de police n’avait pas manqué d’adresser quelques reproches aux marchands, en leur attribuant les abus qu’il s’agissait de détruire. «Les marchands et artisans, disait-il, ont tellement négligé de se conformer aux règlements de police, notamment à l’ordonnance de 1669 par de La Reynie concernant l’élévation, la largeur et la saillie de leurs enseignes, qu’il semble qu’à l’envi les uns des autres chaque marchand ou artisan se pique d’enchérir sur son voisin ou son confrère, par la hauteur, le volume et le poids de son enseigne. Il y en a même qui, dans les professions les plus communes, ont poussé l’excès jusqu’au point de placer au-dessus de leurs boutiques les attributs de leur métier et des figures, soit en massif, soit en relief, qui, bien loin de servir à la décoration de la ville, comme on pourrait présumer que telle a été leur intention, choquent les yeux des citoyens, par leur énormité, ôtent les vues aux voisins, et mettent les passants, surtout lors des grands vents, dans le cas de craindre d’en être écrasés[31].» En conséquence, le lieutenant de police ordonnait donc que tous les particuliers, de quelque qualité et condition qu’ils fussent, seraient tenus d’appliquer les enseignes contre les murs des boutiques ou magasins par eux occupés, et d’en supprimer totalement les potences, dans le délai d’un mois.{23}
Il paraît que tous les particuliers ne s’étaient pas empressés d’obtempérer à l’injonction du lieutenant de police, car le Bureau des finances crut devoir ordonner, dans les premiers jours de janvier 1762, que conformément à l’ordonnance du lieutenant de police, dans le courant du présent mois toutes les enseignes en saillie fussent supprimées, plaquées et scellées contre le mur, et ayant tout au plus quatre pouces de relief, ainsi que les étalages des auvents. Une feuille périodique, l’Avant-coureur, publia, dans son numéro du 11 janvier 1762, de sages réflexions sur une mesure de police et de voirie qui était déjà exécutée presque partout, et qui allait transformer de la manière la plus satisfaisante la physionomie des rues de Paris. «Nous devons dire, objectait le journaliste, que, même avant la publication des deux ordonnances, la plus grande partie des marchands en avaient prévenu l’effet, sur la simple invitation de M. le lieutenant général de police, et que les yeux étaient déjà flattés de ne plus voir dans les rues ce bariolage obscur et dangereux, qui les déparait. Il est heureux pour nous que les magistrats préposés pour la sûreté publique aient bien voulu concourir entre eux à détruire un usage qui ne pouvait qu’être nuisible, à tous égards, aux citoyens. Le premier bien d’une réformation si utile est de rétablir entre les marchands l’égalité que le luxe des enseignes avait détruite; le second, c’est de procurer la sûreté des citoyens et l’embellissement de la capitale; et, comme tout ce qui est avantageux tend à la perfection, on doit espérer qu’aux enseignes plaquées succéderont les bas-reliefs, des tableaux et autres véritables ornements, qui honoreront les arts, en même temps qu’ils embelliront{24} leurs places.» Les vœux du journaliste (sans doute, de Querlon ou La Dixmerie) furent exaucés, quarante ans plus tard; car la mode des enseignes peintes, et souvent peintes par des artistes de grand talent, commença sous le Directoire, prit tout son développement sous l’Empire et brilla de tout son éclat pendant la Restauration.
La jurisprudence des enseignes paraissait désormais établie par l’ordonnance de M. de Sartine, à laquelle s’étaient soumis tous les marchands et artisans. Il y eut cependant quelques contradicteurs et opposants, qui se refusèrent à retirer les enseignes pendantes et saillantes, qu’ils regardaient comme une possession acquise depuis l’ancienne ordonnance de La Reynie et l’édit du mois de mars 1693. On plaida, et longuement, ainsi que pour la plupart des procès de ce temps, et l’on est surpris de voir que le droit de voirie pour les enseignes fut fixé par un arrêt du Parlement, le 11 mai 1765, arrêt qui rappelait les anciennes ordonnances relatives aux grandes et petites enseignes, supportées par des potences et faisant saillie à trois pieds du mur dans les grandes rues et de deux pieds et demi dans les petites. Le rappel de ces ordonnances impliquait seulement le droit de voirie, qui avait été de 4 livres par chaque enseigne et qui fut maintenu au même taux, bien que les enseignes ne fussent plus saillantes et suspendues à des potences. Nous croyons que ce droit de voirie a été dû et payé jusqu’à la révolution de 1789. Au reste, les enseignes étaient toujours autorisées, approuvées et même censurées par la police[32]. Cependant nous sommes{25} à peu près sûr que, depuis 1789 jusqu’en 1800, la police avait autre chose à faire qu’à s’occuper des enseignes. Elles n’ont pas été néanmoins oubliées dans le Code civil: «Une enseigne d’établissement commercial est une propriété légitime que chacun doit s’abstenir de léser, en se l’appropriant ou l’imitant de manière préjudiciable.» (Art. 544.) Cet article était sans doute sujet à bien des interprétations, puisqu’un jugement de l’année 1821 a dû en établir la jurisprudence, en disant: «Un établissement commercial en possession d’une enseigne peut exiger qu’un établissement plus nouveau et de même nature change une enseigne qui ferait confondre les deux établissements, surtout si l’identité avait donné lieu à des méprises.»
La préfecture de police ne s’est pas désintéressée aujourd’hui des enseignes de Paris, quoique la plupart de ces enseignes ne soient plus représentées que par des tableaux figurés ou par de simples inscriptions. Voici la note curieuse qui a été communiquée au Figaro et qui fut insérée dans le numéro du 10 décembre 1871:
«On s’occupe, depuis quelques jours, à la préfecture de police, de faire le relevé de toutes les enseignes de Paris, depuis les plus modestes jusqu’aux plus somptueuses, travail formidable auquel sont employées plus de cent personnes et qui, néanmoins, ne sera pas terminé avant la fin du mois de février 1872. L’énumération de toutes ces enseignes formera quinze à vingt volumes in-folio, d’environ 1,200 feuilles chacun. Ce recueil, assurément très original et très curieux à consulter, même pour les amateurs, sera mis gratuitement à la disposition des personnes qui auront un renseignement à prendre ou une réclamation à{26} formuler. Toutes les enseignes nouvelles y seront inscrites, dès qu’elles se produiront, et, afin d’éviter les omissions, une ordonnance ministérielle obligera les commerçants et industriels à faire, à ce sujet, une déclaration à la préfecture de police.»
Nous ne pensons pas que cette ordonnance ministérielle ait été faite.{27}
IL est incontestable que les enseignes qui existaient dans la Gaule romaine, comme dans l’ancienne Rome (et plusieurs inscriptions antiques en font foi), ont continué d’être en usage chez les Francs, qui se façonnèrent peu à peu à la civilisation gallo-romaine. Le mot latin signum, employé par Quintilien[33], au Iᵉʳ siècle, pour désigner une enseigne de boutique, était changé, dans la basse latinité, en insignium, qui devint dans la vieille langue française: ensigne, ensaigne, ensaingne, ensengne, etc., en prenant plusieurs sens différents, parmi lesquels celui d’enseigne de boutique ou de marchand nous paraît avoir été appliqué plus tard que les autres. Nous n’en trouvons pas d’exemple, en effet,{28} avant la fin du XIIIᵉ siècle. Le mot et la chose existaient cependant bien antérieurement, mais le mot ne figure pas dans le Livre des métiers, rédigé par Étienne Boileau, sous le règne de Louis IX; toutefois, dès ce temps-là, la rouelle d’étoffe jaune, que les juifs étaient tenus de porter au-dessus de la ceinture, s’appelait déjà leur enseigne accoutumée. Les maisons avaient donc, de même que les gens, leur signe ou leur enseigne, et Jean Boutillier pouvait dire, dans sa Somme rurale, au milieu du XIVᵉ siècle: «A peine de vie, ou de membre, ou d’estre flastry, ou enseigné d’enseigne publique.» C’était un écriteau que le condamné avait sur la poitrine, en allant au pilori. Il faut s’étonner que Lacurne de Sainte-Palaye n’ait pas donné, dans son Dictionnaire historique de l’ancien langage françois, une seule citation qui confirme l’emploi du mot enseigne dans l’acception qui le caractérise le mieux.
Voici les différentes définitions du mot, dans le Dictionnaire étymologique de la langue françoise, par Ménage: «C’est une marque particulière, qui, aidant à discerner quelque personne ou quelque chose d’avec une autre, la fait connoître: l’enseigne d’une maison, d’une hôtellerie; d’une compagnie des gens de pied; une enseigne qui se portoit autrefois au chapeau ou en quelque autre endroit; l’enseigne d’un sergent ou d’un messager, qui est une chose semblable à ce que l’on appelle l’émail, à l’égard des hérauts d’armes; et de là cette façon de parler: à telles enseignes; d’insigne ou d’insignium.» Furetière, dans son Dictionnaire universel, bien postérieur à celui de Ménage, est plus explicite dans les définitions du mot enseigne: «Ce mot signifie ce qu’on pend devant un logis pour faire connoître que{29} dans ce logis on vend ou l’on fait quelque chose qui regarde le public. Ainsi les bassins blancs pendus devant un logis marquent un barbier, et des bassins jaunes un chirurgien. Un clou, pendu au-dessus d’une porte, montre que l’on vend du vin dans le logis. De la paille et des petits paniers, pendus devant une maison, avertissent qu’on y vend du lait et de la crème.» Ces définitions sont empruntées presque textuellement au Dictionnaire françois de Richelet, publié en 1680.
On a lieu d’être surpris que l’enseigne n’ait pas donné naissance à un plus grand nombre de ces proverbes, qui sont à la fois la raison et la malice du peuple[34]. Il n’en est pas un seul antérieur au XVIᵉ siècle. Gabriel Meurier, dans son Trésor des sentences, a recueilli celle-ci formulée en deux lignes rimées:
Dans les Adages françois de la même époque, on trouve ce conseil proverbial: «Ne t’y fie qu’à bonne enseigne.» Cette expression si usuelle et non moins proverbiale: «Être logé à la même enseigne,» s’emploie encore, dans le sens figuré, pour dire: Éprouver le même malheur, la même perte, le même embarras. On dit qu’un homme est logé à l’enseigne de la lune, ou bien qu’il a couché en plein air. On dit d’un méchant portrait ou tableau qu’il est bon à faire une enseigne à bière. Enfin, l’Académie a maintenu dans son Dictionnaire ce vieux proverbe: A bon{30} vin, point d’enseigne; signifiant que ce qui est bon n’a pas besoin d’être recommandé. Il faut citer encore cette locution au figuré: «L’enseigne promet plus qu’elle ne tient.»
Nous croyons que les enseignes des maisons étaient en usage avant les enseignes des boutiques, car les boutiques, avec leur étalage de marchandises, annonçaient ainsi suffisamment ce qu’elles offraient au passant, tandis que les maisons, n’étant pas numérotées, n’avaient aucun signe extérieur qui les fît distinguer l’une de l’autre. On leur donna donc des noms d’enseignes, et ces enseignes furent représentées par des images en tableau ou en relief. La maison prenait aussi le nom de celui qui l’habitait. Le Livre de la taille de Paris pour l’an 1292[35], sous le règne de Philippe le Bel, n’indique pas une seule enseigne de maison ni de boutique[36]. Les bourgeois et les nobles n’ont pas d’autre qualification que leur nom propre; les gens du peuple, marchands ou artisans, sont désignés par leur profession: ainsi Jehan d’Orliens, le paintre; Nicolas de Tours, armeurier; Bernier le tailléeur; Simon le bahutier (fabricant de coffres); Nicolas le brodéeur. Voici comment les maisons se trouvent indiquées par le nom de leur propriétaire ou locataire: «La quinte Queste de la paroisse Saint-Germain, du coing de la meson Lambert Bouche jusques au coing de la Hiaumerie et tout contremont la grant rue, jusques au quarrefour de{31} la Porte, et du quarrefour de la Porte, jusques à la rue des Lavendières; au renc par devers la meson mestre Pérard de Troyes, et tout contremont la rue des Lavendières, par devers la meson Jean Augier jusques à la meson Lambert Bouche.» Dans le Livre de la taille de Paris en 1313[37], les enseignes des maisons et des boutiques ne figurent pas davantage; mais on peut, en deux ou trois endroits, deviner leur existence, quoique les noms et les professions des propriétaires ou des locataires soient simplement mentionnés, comme dans la Taille de 1292. Plusieurs rues sont citées, dont la dénomination provenait certainement de la principale enseigne qu’on y voyait: la rue au Lyon, près la porte Saint-Denis; la rue au Cine (cygne), dans la Cité; la rue de l’Image Sainte-Katherine; or, dans cette petite rue de la Cité, qui n’a que trois personnes soumises à la Taille, la première était: Guillain l’image, tavernier, lequel payait 36 sols parisis, et l’image n’était autre que l’enseigne de la taverne. Dans la rue à l’Ecureil, qui devait aussi son nom à une enseigne, cette enseigne paraît être celle de Richard de Bray, buffetier (vendeur de vin). Mais tous les gens de métiers n’avaient pas encore des enseignes, car le quêteur de taille eût sans doute adopté ce genre de désignation, si l’enseigne avait existé, dans cet intitulé d’un chapitre de la quête: «Parmi la viez rue du Temple, à commencer des Blans-Manteaux, à dextre, au rang où le serrurier demeure, jusques à la rue Anquetin le Faucheux.» Voilà un serrurier qu’on ne nomme pas et qui, sans doute, n’avait pas d’enseigne.{32}
Adolphe Berty est le premier archéologue qui ait soigneusement recherché les enseignes des anciennes maisons, pour deux quartiers de Paris, dans les Trois Ilots de la Cité[38] et dans la Topographie historique du vieux Paris[39]. Cet immense dépouillement de pièces d’archives est malheureusement resté inachevé, par suite de la mort de l’auteur. Ce sont les travaux de Berty qui nous ont appris que toutes ou presque toutes les maisons avaient un nom d’enseigne, sinon une enseigne effective; que ces noms et ces enseignes changeaient de temps à autre, quand les maisons changeaient de propriétaire; que ces noms et ces enseignes se répétaient à l’infini, en sorte que chaque rue avait souvent, comme les rues voisines, une maison de la Corne de Cerf, du Grand Godet, du Croissant, de la Croix blanche, du Pied de Biche, du Cheval noir, ou du Cheval blanc, ou du Cheval rouge, du Plat d’Étain, du Sabot, etc. Ces différents noms, sans cesse employés et répétés, n’impliquaient pas la présence d’une enseigne plastique; mais quelques-uns dépendaient de certains signes extérieurs, de certains détails matériels; ainsi est-il très probable qu’une maison du Pied de Biche ou du Griffon devait son nom à une sonnette emmanchée d’un pied de biche ou d’une patte de vautour; de même, une maison de la Corne de Cerf ou de la Corne de Daim avait sans doute un véritable bois de cerf ou de daim au-dessus de la porte.
Ce qui est bien constaté dans cette nomenclature de{33} toutes les maisons d’une rue ou d’un quartier, c’est que la plupart n’ont pas de désignation avant l’an 1200, et que les enseignes qui se montrent dans le cours du XIIIᵉ siècle sont fort rares; mais ces enseignes deviennent nombreuses au XIVᵉ siècle, et presque générales dans le siècle suivant; elles subsistent encore en partie au XVIIᵉ siècle, pour disparaître au XVIIIᵉ siècle à peu près complètement. Quand l’enseigne est qualifiée d’image, on peut assurer qu’il s’agit d’une statue en pierre, en plâtre ou en bois: ordinairement, c’était l’image d’un saint ou d’une sainte, à qui la maison était, pour ainsi dire, dédiée. Dans son archéologie des Trois Ilots de la Cité, Berty ne cite qu’une maison à enseigne, qui existait au XIIIᵉ siècle: celle du Paon blanc, mais il indique une dizaine de maisons dont les enseignes dataient du XIVᵉ siècle: maison des Trois Chandeliers (1358), maison des Balances (1343), maison du Châtel (1369), maison du Pot d’étain (1381), maison de l’Échiquier (1363), maison de la Clef (1387), maison du Panier (1346), maison du Chat (1345), maison du Paradis (1343), maison de la Seraine ou Sirène (1353), maison de l’Unicorne ou Licorne (1367), maison du Chapeau (1364), maison du Grand Godet (1364), maison du Chapeau rouge, etc. Nous nous bornerons à mentionner, toujours dans les trois îlots de la Cité, quelques maisons à image qui ne remontent pas au-delà du XVᵉ siècle: maison de l’Image Saint-Jacques (1415), maison de l’Image Notre-Dame (1427), maison de l’Image Saint-Nicolas (1456), maison de l’Image Saint-Pierre (1455). Il n’y a que la maison de l’Image Saint-Kristofle qui soit du XIVᵉ siècle (1385).
Les mêmes enseignes de maisons se retrouvent dans les{34} études de Berty sur la région du Louvre et des Tuileries[40], si ce n’est que les enseignes sont, en général, d’une époque bien postérieure. Quelques-unes ne datent que du XVIIIᵉ siècle, comme les suivantes: maison du Puits sans vin (1713), maison des Barreaux rouges (1700), maison du Grand Monarque (1719). Il n’y a que deux enseignes du XIVᵉ siècle: la maison des Trois Morts et trois Vifs (1334), dans la rue Saint-Honoré, et la maison du Pied de Griphon (1397), dans la rue du Chantre. Parfois, le propriétaire choisit une enseigne analogue à son nom: la maison de la Croix de fer appartient à Jacques Croix; la maison de la Moufle à Guillaume Mouflet. En certains cas, le changement d’une enseigne accuse une intention malicieuse: la maison du Saint-Esprit (1489), dans la rue du Champ-Fleuri, devient, en 1582, la maison de la Pantoufle; une vieille maison, qui n’avait pas eu d’enseigne jusqu’au milieu du XVIIᵉ siècle, prend tout à coup, en 1671, l’enseigne burlesque du Chat-lié, par allusion à certain Robert Challier, qui avait été propriétaire d’un hôtel voisin. Quant à l’enseigne suspecte du Dieu d’amours (1530), dans la rue Saint-Honoré, elle annonçait peut-être un mauvais lieu, comme il s’en trouvait beaucoup dans le vieux Paris, et tous avec des enseignes plus ou moins spéciales. Mais, en revanche, les bons sentiments pouvaient se faire jour à l’aide d’une enseigne: dans la rue Fromenteau, une vieille maison, qui avait pris pour enseigne, après la mort de Henri IV (1610), la Figure du feu roy Henry, changea d’enseigne, sans changer d’image ou de tableau, et s’intitula Maison de l’ami du cœur. Dans la même rue, Gilles Baudouyn, contrôleur de la Maison{35} du roi, donna pour enseigne, en 1657, à la maison qu’il possédait, le Portrait de Louis XIII. Gabrielle d’Estrées avait, dans cette même rue Fromenteau, un petit hôtel, que Henri IV acheta pour elle à M. de Schomberg, mais cet hôtel, ainsi que tous les hôtels des seigneurs et des nobles, ne portait pas d’autre enseigne qu’un écusson aux armes de Phelypeaux, qui en avait été le possesseur lorsqu’il eut acquis l’ancien hôtel de la Rose. La belle Gabrielle aurait dû rétablir cette enseigne-là.
La police d’autrefois n’avait rien à voir dans les enseignes, et la plus grande liberté était laissée aux propriétaires qui voulaient se donner le plaisir d’attacher à leur maison une enseigne burlesque, joyeuse ou même gaillarde. Il y avait seulement un léger droit à payer au voyer, pour changement d’enseigne. Dans la rue Saint-Honoré, la maison de l’Image Saint-Jean (1408) prit, en 1624, l’enseigne de la Vache couronnée. Rien n’était plus fréquent alors que de couronner, dans une enseigne, la vache, le bœuf, le cheval, le singe et même l’âne. On ne voyait, dans ces singuliers couronnements, aucune injure à la royauté. Ainsi la maison du Bœuf couronné (1416), qui avait adopté l’Image de Saint-Martin en 1489, devait, en 1719, échanger son saint contre un tableau représentant le Grand Louis ou le Grand Monarque. C’était une épigramme contre le Régent, duc d’Orléans, que d’inaugurer une enseigne de Louis le Grand à deux pas du Palais-Royal et de l’hôtel du cardinal Dubois.
Cette enseigne du Grand Monarque avait été une flatterie des bourgeois de Paris, sous le règne de Louis XIV. On la retrouve, dans divers quartiers, avec les dates de 1680{36} à 1700. Dans la rue Jean-Saint-Denis, près de la rue Saint-Honoré, elle avait succédé, en 1687, à l’enseigne de la Grimace, qui datait de 1603 et qui était peut-être un souvenir de ce bateleur populaire surnommé maître Grimache. Les rébus et les jeux de mots fournissaient des enseignes plaisantes à certains propriétaires de ce quartier. Par exemple, on trouvait, là comme partout ailleurs, des maisons Au Cygne de la Croix (1687), où le calembour (Signe) pouvait seul expliquer la présence d’un cygne au pied d’une croix. L’enseigne de l’Étrille fauveau (1577) reproduisait en rébus le sujet de ces vers de l’épître du Coq-à-l’âne, composée par Clément Marot:
Un autre rébus de Picardie, la Vertu de l’assurance, c’est-à-dire de l’A sur anse (1613), dans une enseigne de la Cité, rue du Chantre, ne fut peut-être pas beaucoup plus compréhensible, en créant l’enseigne de la Petite Vertu, dont nous ne connaissons pas la représentation figurée (1680). Il était encore plus facile de comprendre l’enseigne des Gracieux, que la prononciation transformait en Gras scieux et que le peintre avait représentés sous la figure de trois gros hommes sciant du bois.
Les alentours du vieux Louvre avaient conservé un grand nombre de très vieilles maisons, construites au commencement du XIVᵉ siècle, mais dont les enseignes primitives avaient été changées plusieurs fois depuis leur fondation. La maison de l’Image Saint-Pierre (1700), appartenant à{37} l’Hôtel-Dieu, n’avait pas moins de 500 ans; elle avait d’abord porté l’enseigne de l’Étrille (1353). Dans la rue des Poulies, la maison du Papegaut (Perroquet) n’avait cette enseigne que depuis 1426, mais elle en avait eu sans doute une autre, puisqu’elle était déjà construite en 1364. Une maison voisine, bâtie à la même époque, avait porté l’enseigne de la Licorne, en 1491; elle subsistait encore au commencement du XVIIIᵉ siècle et prenait alors le nom d’Hôtel des Parfums. Enfin, une des plus anciennes maisons du quartier, la maison des Trois Morts et trois Vifs (1334), avait été décorée, dès l’origine, d’un bas-relief sculpté, représentant la sombre légende si célèbre au moyen âge et contemporaine de la Danse macabre, selon laquelle trois chevaliers, allant s’ébattre à la chasse, étaient accompagnés à leur insu par trois squelettes chevauchant à côté d’eux et les conduisant à la mort. L’enseigne subsista pendant plus de deux siècles; la maison était encore debout en 1696, mais elle avait bien changé de destination, puisqu’elle portait alors pour enseigne l’Ile d’amour et qu’elle devait être occupée par des femmes de mauvaise vie.
La publication du premier volume de l’Inventaire sommaire des Archives hospitalières a fait connaître un grand nombre de maisons, la plupart très anciennes; mais toutes ces maisons, appartenant à l’Hôtel-Dieu, qui en était devenu propriétaire par le fait de donations et de legs charitables, avaient été louées au commerce et à l’industrie. C’est donc aux métiers de Paris qu’il faut rapporter la plupart de ces enseignes, qui ne furent pas changées tant que l’Hôtel-Dieu conserva la propriété des maisons. Cependant, ce fut la veuve Nicole de Villiers qui{38} fit don, à l’Hôtel-Dieu, en 1531, d’une maison à l’enseigne du Chat qui pêche, maison sise dans la rue du Petit-Pont. Le Château frileux, au coin de la rue Saint-Pierre-aux-Bœufs, dans la Cité, et la maison voisine de l’Écu de France, située au parvis Notre-Dame, avaient été loués au Bureau de la Ville, qui y siégea jusqu’en 1747. On peut encore citer une très belle maison, à l’enseigne de l’empereur Marc-Aurèle, dans la rue Taranne: elle avait été léguée à l’Hôtel-Dieu, le 2 septembre 1661, par Françoise Servais, veuve de Louis de Vanderbuch, dit Aved, peintre du roi. On trouvera, dans le chapitre des enseignes de marchands[41], la nomenclature de beaucoup de maisons à enseignes, que les administrateurs de l’Hôtel-Dieu louaient à bail et qui ne changèrent pas de nom, la plupart du moins, pendant trois ou quatre siècles, quoique ces maisons fussent occupées par des commerçants et des gens de métiers, plutôt que par des bourgeois et des familles du tiers état.
On peut, ce me semble, établir une différence notable entre les enseignes des maisons et celles des boutiques. Les enseignes des maisons étaient ou devaient être sculptées en pierre, ou modelées en terre cuite, quelques-unes contemporaines de la maison elle-même et ayant été engravées au ciseau dans la muraille même au-dessus du fronton de la porte; elles étaient généralement peintes ou dorées. Les images ou statuettes reposaient sur des piédestaux en pendentifs, ou s’abritaient dans des niches ogivales, plus ou moins ornementées et fleuronnées à la manière du style gothique. Un très petit nombre de ces{39} images étaient en métal, mais beaucoup sans doute en bois colorié. Il faut comprendre parmi ces enseignes les inscriptions et les monogrammes, qui ne figuraient pas seulement au-dessus de l’entrée principale, et qui souvent se trouvaient répétés en différents endroits de la façade. Malheureusement, le Paris ancien ayant à peu près disparu, depuis soixante à soixante et dix ans, par suite de la reconstruction des maisons, il est bien peu d’enseignes sculptées qui aient échappé aux démolisseurs.
Ainsi on voyait encore, à la fin du XVIIᵉ siècle, dans la rue Saint-André-des-Arcs, la maison de Jacques Coictier, le médecin de Louis XI, laquelle conservait au-dessus de la porte la représentation figurée d’un arbre chargé de fruits, avec cette devise en rébus: A l’Abricotier. Mais cette maison, bâtie sur l’ancien emplacement de l’hôtel de Navarre, près de la porte de Bucy, à l’endroit même où s’ouvre aujourd’hui le passage du Commerce, n’était plus celle de l’Éléphant, que Louis XI avait donnée à son médecin et que les héritiers de celui-ci firent rebâtir; on sait pourtant que la maison de l’Éléphant avait, sur le mur de sa cour intérieure, l’image sculptée d’un oranger ou d’un abricotier, chargé de fruits; ce qui expliquerait le changement de l’enseigne de l’Éléphant[42].
La belle enseigne de la Cour du Dragon, dans la rue de l’Égout-Saint-Germain, vis-à-vis de la rue Sainte-Marguerite, a survécu à ces deux rues disparues depuis vingt ans. Faisant suite à la rue Sainte-Marguerite, cette cour ou passage devait porter le même nom, et l’architecte{40}
avait eu l’idée de lui donner pour enseigne le dragon légendaire sous la forme duquel le diable apparut à sainte Marguerite et l’avala d’une seule bouchée; assez délicatement pour que la sainte ayant fait le signe de la croix dans les entrailles même du monstre en pût ressortir saine et sauve.—Et voilà pourquoi sainte Marguerite était invoquée par les femmes en couches. La porte monumentale au-dessus de laquelle on voit ce dragon issant d’un cartouche évidé, les ailes étendues et la tête fièrement dressée contre la console d’une fenêtre du premier étage, superbe sculpture du xviiᵉ siècle, qui donne une idée de ce qu’était naguère la statuaire des enseignes, se trouve aujourd’hui presque au coin du boulevard Saint-Germain et de la rue de Rennes,{41} au nº 50 de cette dernière. Par contre, on a détruit, vers la même époque, une maison de la rue du Four, ornée d’une enseigne représentant la Fontaine de Jouvence, petite sculpture du XVIᵉ siècle, un peu mutilée, dans laquelle cette fontaine semble placée sous l’invocation de Vénus dominant la vasque supérieure: une femme puise de l’eau, et de l’autre côté, un vieillard rajeuni s’éloigne. Cette jolie enseigne a été conservée; elle fait partie des collections si intéressantes du musée Carnavalet, ainsi que l’enseigne du Chapeau fort, grand feutre couvrant un fort bastionné, sculptée sur la façade de la maison d’un chapelier, rue de l’École-de-Médecine (XVIIIᵉ siècle).
Il ne reste plus guère de maisons anciennes portant des inscriptions et des monogrammes; signalons cependant, rue de la Huchette, au nº 14, la maison de l’Y, enseigne de chaussetier (lie-grègues), qui est entaillée dans la pierre,{42} au milieu d’un rond à bordure architectural et reproduite dans la ferrure des balcons. Il n’y a plus trace, dans la rue Mignon, d’une petite maison à porte cochère, sur laquelle on lisait cette inscription latine: «In fundulo, sed avito,» que Benserade traduisait plaisamment par ces mots: «Je suis gueux, mais c’est de race[43].» L’interprétation des monogrammes offrait encore plus de difficultés et d’obscurités que les devises et les rébus, qui, selon le caprice des propriétaires, s’attachaient au frontispice des maisons. Depuis le milieu du XVIᵉ siècle, par exemple, Catherine de Médicis avait fait sculpter, sur les colonnes des Tuileries, une foule de symboles mystérieux, avec des H et des C ou D entrelacés. Mais personne n’avait pu les expliquer avant l’abbé Terrasson, qui, le premier, en 1762, dans son Histoire de l’ancien hôtel de Soissons, y a reconnu les chiffres du roi et de Catherine de Médicis et des signes allégoriques de la viduité de la reine. L’helléniste J.-B. Gail a reproduit dans son Philologue[44] ce passage de Brantôme[45], qui explique une partie de l’énigme: «Nostre reyne, autour de sa devise que je viens de dire, y avoit fait mettre des trophées, des miroirs cassez, des éventails et pennaches rompus, des carquans brisés, et des pierreries et perles espandues par terre et les chaînes toutes en pièces, le tout en signe de quitter toutes bombances mondaines, puisque son mary estoit mort.» Quant au chiffre, qu’on a pris tour à tour{43} pour le monogramme de Diane de Poitiers et celui de la reine et de Henri II, Catherine, peut-être confondant à dessein, l’avait fait insculpter non seulement sur les colonnes du palais des Tuileries, mais encore sur l’arcade de la rue de Jérusalem, construite et sculptée par Jean Goujon, et sur la colonne qui lui servait d’observatoire et qui seule subsiste du palais qu’avait bâti pour elle l’architecte Jean Bullant sur l’emplacement de la Halle au blé actuelle[46].
Il est à regretter que les érudits du XVIᵉ siècle n’aient pas{44} recueilli les belles inscriptions grecques qui avaient été gravées sur les maisons du poète Baïf et du jurisconsulte Pasquier. C’étaient là des enseignes bien dignes de ces illustres savants.
Nous avons dit que les hôtels des grands seigneurs ne portaient pas d’autres enseignes que leurs armoiries sculptées, peintes ou dorées, souvent avec leurs devises. Au commencement du XVIIᵉ siècle, il y eut quelques inscriptions plus simples et plus faciles à comprendre, car la langue héraldique n’était pas à la portée de tout le monde: le nom du propriétaire fut donc inscrit avec ses titres sur le linteau de la porte d’honneur de son hôtel, quelquefois avec la date de la construction de cet hôtel. Plus tard, on abrégea cette inscription, et le cardinal de Richelieu avait fait graver ainsi, en lettres d’or, ces deux mots seulement: Palais Cardinal, au-dessus de la principale entrée de son palais. Cette inscription elliptique fut, au dire de Sauval, dix ans durant, et bien maltraitée et bien contrôlée tout ensemble[47]. «Balzac, en 1652, ajoute Sauval, prétendoit que cette inscription n’étoit ni grecque, ni latine, ni françoise; et pour lors écrivit qu’il ne pouvoit souffrir des incongruités en lettres d’or, et ce frontispice fastueux, par l’ordre de ses supérieurs. Outre que cette critique ne fut pas trop bien reçue pour un Socrate chrétien, dont il avoit pris la qualité, c’est que pas un grammairien ne prit son parti, tant s’en faut: on prétendit que c’étoit un gallicisme, et même consacré par un usage aussi vieux que l’Hôtel-Dieu, les Filles-Dieu, la place Maubert.» La même critique{45} se renouvela plus tard, avec plus d’acrimonie, lorsque le chancelier Séguier eut fait graver ces deux mots: Hôtel Séguier, au-dessus du portail de son hôtel, dans la rue de Grenelle-Saint-Honoré, hôtel qui n’avait pas eu d’inscription, quand il appartenait au duc de Bellegarde et à Gabrielle d’Estrées, duchesse de Liancourt. «Si Balzac eût vu une telle usurpation, dit Sauval, peut-être s’en fût-il plaint aussi bien que de celle du Palais Cardinal.»
Ces inscriptions, qui sont de véritables enseignes de maison, ont toujours été en usage depuis, même en pleine République de 1793; on a lu longtemps sur le fronton de la porte de l’hôtel de la Trémoille, au nº 50 de la rue de Vaugirard, cette inscription bizarre: Hôtel de la Fraternité. Quelques hôtels ont gardé de ces temps un souvenir singulier; c’est ainsi qu’on lit encore sur l’hôtel du quai de la Tournelle, portant le double numéro 55, 57, cette inscription: Hôtel ci-devant de Nesmond; un de ses voisins était et est demeuré l’Hôtel du ci-devant président Rolland. Des inscriptions semblables se retrouvent encore, au Marais notamment. Au reste, les enseignes et les dénominations des maisons étaient moins monotones et plus pittoresques que les numéros par rue, comme à l’origine du numérotage, ou par section circulaire, comme cela se fit d’une façon assez peu intelligible à l’époque du Directoire. Nous regretterons donc, pour la distraction des yeux et de la pensée, cette multitude d’enseignes variées, parfois si singulières et si amusantes, qui témoignaient du caprice ingénieux des bourgeois de Paris; nous ne sommes pas fâché de voir surgir çà et là quelques protestations à cet égard. Par exemple, quand la rue de Rivoli, en vertu de{46} la loi du 4 octobre 1849, fut prolongée jusqu’à l’Hôtel de ville, M. Henri Labrouste, architecte de la maison nº 122, fit sculpter sur la façade, par Thomas Gruyère, un grand bas-relief portant la date de 1855, à l’usage de cadran solaire et symbolisant le temps vrai et le temps moyen: le Temps vrai élève un miroir sur lequel rayonne l’heure de midi; le Temps moyen consulte une horloge. Trois petits génies complètent l’allégorie: à droite, le Matin versant la rosée; à gauche, le Soir couronné d’étoiles; au milieu, le Midi tenant un flambeau et des dards; au-dessous on lit cette inscription morale et philosophique: Vera intuere, media sequere (contemple le temps vrai, mais suis le temps moyen[48]).{47}
LES enseignes des marchands ont été certainement bien postérieures à celles des maisons; ces enseignes, qui servaient à distinguer entre elles les industries et à empêcher de confondre une maison de commerce avec une autre, n’étaient pas d’une nécessité absolue, puisque toutes les maisons eurent leurs enseignes depuis la fin du xiiiᵉ siècle et que l’enseigne de la maison suffisait pour la boutique. Celle-ci, d’ailleurs, avait en quelque sorte son enseigne parlante, puisque les marchandises qu’on devait y trouver étaient exposées plus ou moins simplement aux regards du public. Cet étalage, il est vrai, n’avait aucune analogie avec les pompeux et brillants étalages de nos magasins. La boutique, qu’on nommait fenêtre ou ouvroir, au{48} moyen âge, ne ressemblait guère, en effet, à une boutique du Palais-Royal ou des boulevards du Paris moderne. C’était généralement une salle basse du rez-de-chaussée, très obscure et très enfumée, communiquant de plain-pied avec la rue, par une porte étroite, toujours ouverte, excepté dans les plus grands froids; une large baie, sans vitrage, représentait une espèce de fenêtre, qui ne se fermait que la nuit avec des volets, et devant cette fenêtre, à hauteur d’appui, une tablette assez étroite servait à l’exposition permanente des marchandises ou des denrées qui s’offraient en nature au choix des passants. Ce qui rendait les boutiques si sombres à l’intérieur, c’était moins le peu de largeur des rues que les auvents énormes destinés à protéger les passants et les marchandises contre la pluie et le soleil. Les enseignes ne pouvaient être visibles, dans la rue, que si elles débordaient la ligne des auvents et se balançaient dans l’air au-dessus d’eux, à l’extrémité de longues potences en fer.
Il en résulta naturellement que les marchands se contentèrent longtemps des enseignes de leurs maisons, sans en ajouter à leurs boutiques, d’autant plus que la plupart des maisons étaient fort étroites, quoique très élevées, et n’avaient pas plus d’une boutique, avec deux fenêtres de façade. On s’explique ainsi comment toutes les maisons furent garnies d’enseignes, longtemps avant que les boutiques en eussent aussi pour leur propre compte. Il est, d’ailleurs, bien difficile de reconnaître les enseignes, qui appartenaient aux boutiques plutôt qu’aux maisons, car les unes et les autres, qui devaient différer de forme, d’aspect et de disposition, représentent d’ordinaire les mêmes images et affectent les mêmes dénominations. Ainsi, dans{49} nos archives domaniales, les chartes et les actes qui concernent la propriété foncière des maisons de Paris n’indiquent que les enseignes de ces maisons et passent sous silence celles des boutiques. On a lieu de s’étonner que les érudits qui ont parlé des enseignes en général, aient négligé de faire aucune distinction entre ces deux catégories d’enseignes, n’ayant ni la même origine, ni le même but, ni le même caractère. Nous ne serions pas éloigné de croire que les changements d’enseigne, si fréquents aux XVᵉ et XVIᵉ siècles, accusent non seulement des changements de propriétaires dans les maisons qui changeaient d’enseigne, mais des changements de commerce et d’industrie dans les boutiques qui dépendaient de ces maisons. D’après les renseignements certains que nous fournissent trois sources principales de documents authentiques—savoir: deux articles d’Adolphe Berty sur les Trois Ilots de la Cité, publiés en 1860 dans la Revue archéologique; trois volumes de la Topographie du vieux Paris (quartier du Louvre et quartier Saint-Germain), par le même auteur, et l’Inventaire des Archives hospitalières de Paris—les maisons, à quelques rares exceptions près, sont mentionnées sans aucune désignation, avant le XIVᵉ siècle; c’est seulement au XVᵉ siècle que les enseignes apparaissent de tous côtés et qu’elles subissent souvent deux ou trois transformations dans le cours de ce siècle-là; ces transformations d’enseigne et ces changements de nom se continuent pendant les deux siècles suivants; à partir de l’édit de police de 1661, les enseignes de maison disparaissent presque complètement et cèdent la place aux enseignes de marchand.
L’enseigne la plus ancienne qu’on ait citée jusqu’à pré{50}sent[49], serait celle de la Corbeille, aux Champeaux, c’est-à-dire sur l’emplacement même où Philippe-Auguste avait fait construire les Halles en 1180; or, cette maison à enseigne, qui aurait existé, à cet endroit-là, vingt-six ans plus tard (1206), nous semble bien problématique, et le fait mériterait d’être appuyé sur une preuve incontestable, qu’Adolphe Berty n’a pas donnée avec son exactitude ordinaire dans son beau travail sur les Enseignes de Paris avant le XVIIᵉ siècle. On a cité aussi, sous la date de 1212, une autre enseigne, celle de l’Aigle, dans le cloître Notre-Dame; mais la preuve fait également défaut à cette citation. Dans tous les cas, ce ne serait pas là une enseigne de marchand. C’est dans nos chapitres consacrés aux hôtelleries et aux cabarets[50] qu’on trouvera plusieurs enseignes dont l’existence est bien constatée et qui datent de la même époque à peu près. Quant aux images de saint et de sainte qui peuvent avoir servi d’enseignes à des boutiques aussi bien qu’à des maisons, nous en parlerons dans le chapitre des enseignes de corporation et de confrérie[51]. Il s’agit, toutefois, de rechercher ici quelles sont les premières enseignes qui peuvent avoir été appendues par des marchands aux maisons où ils avaient leurs ouvroirs. Ces enseignes seraient donc, à notre avis, celles qui offrent quelque instrument de travail ou quelque autre objet applicable à telle ou telle profession, à tel ou tel commerce. Il suffira de relever ces enseignes marchandes, dans les savantes recherches d’Adolphe Berty sur trois{51} îlots de la Cité et sur le quartier du Louvre; la Cité et le Louvre étant les deux plus anciens quartiers de Paris.
CITÉ[52]. RUE DE LA JUIVERIE. Maison de la Heuse, ou de la House, c’est-à-dire de la Botte, vers 1400; ce serait la maison d’un cordonnier.—Maison de la Chausse de Flandres, vers 1450; ce serait la maison d’un chaussetier, fabricant ou vendeur de chausses, de bas, etc.—Maison des Trois Chandeliers, 1358. Ce pouvait être la maison d’un marchand de chandelles.—Maison des Balances, 1343. Peut-être la maison d’un balancier ou vendeur de poids et balances, à moins que ce ne fût le dépôt des balances publiques ou du Poids du roi.—Maison du Pot d’étain, 1381. Ce doit être un ferblantier, qu’on appelait alors un Potier d’étain. En 1575, c’était la maison de la Roue de fer, sans doute l’officine d’un ferronnier.—Maison des Connils blancs, 1468. C’est sans doute la maison d’un éleveur de lapins domestiques.
RUE DES MARMOUSETS. Maison de la Nef d’argent, 1432. Pouvait être la maison d’un orfèvre, la nef d’argent étant un grand vase à boire ou une pièce d’orfèvrerie, qu’on ne voyait que sur la table des princes et des grands seigneurs.—Maison du Plat d’étain, 1433. Encore un potier d’étain.—Maison de la Clef, 1387. N’est-ce pas la maison d’un serrurier?—Maison de la Housse-Gilet, 1415. Maison ou boutique d’un tailleur ou couturier.
RUE AUX FÈVES. Maison du Billart, 1423. Fabrique de billes ou balles, pour les jeux de mail ou de paume, etc.—Maison de la Cage, au XVᵉ siècle. N’est-ce pas un{52} marchand de poisson, qui avait une cage ou boutique à garder du poisson vivant?—Maison du Panier, 1346. Peut-être un vannier qui fabriquait des paniers de jonc et d’osier.—Maison du Heaume, 1429. Pourquoi ne serait-ce pas la demeure ou la boutique d’un armurier?
RUE DE LA LICORNE. Maison du Sabot, 1487: maison ou boutique d’un sabotier, sinon d’un cordier, le sabot étant un outil de deux espèces, employé par ces deux métiers.
RUE DU HAUT-MOULIN. Maison du Pourcellet, 1375. N’est-ce pas un charcutier qui demeurait là?—Maison du Chapeau, 1364, ou du Chaperon, 1445. Est-ce un fabricant ou vendeur de coiffures de tête?—Maison du Grand Godet, 1364. Marchand de hanaps, de coupes, de verres à boire.—Maison du Paon blanc, 1391.
RUE DE GLATIGNY. Maison du Cercel, c’est-à-dire du Cerceau, en 1362. Cette maison était une taverne.
QUARTIER DU LOUVRE[53]. RUE DE BEAUVAIS. Maison du Gobelet d’argent. Peut-être un orfèvre?—Maison du Coq, 1519. Un poulailler?
RUE CHAMPFLEURY. Maison du Gros tournois, 1373. Un changeur ou un banquier?—Maison de la Pantoufle, 1582. Une boutique de pantouflier.—Maison du Patin, 1573. C’est, à coup sûr, un cordonnier pour dames.—Maison de l’Entonnoir, 1591. Un tonnelier? Cette maison changea trois fois d’enseigne, à la fin du XVIIᵉ siècle, pour se placer tour à tour sous la protection de la Ville de Mantes, de la Ville de Munster et de la Ville de Bruxelles.—Maison de l’Étrille, 1353. Était-ce une écurie ou un cabaret, qu’on{53} appelait ainsi au figuré?—Maison des Deux Coignées, 1451. A coup sûr, c’est un charpentier.
RUE DU COQ. Maison de la Chausse, 1401. Un chaussetier, bonnetier.—Maison des Trois Poissons, 1489. Un pêcheur ou un poissonnier, marchand de marée.—Maison du Van, 1490. Un vannier, ouvrier en osier, sinon un vanneur ou bluteur de farine.
RUE FROMENTEAU. Maison de la Couronne, 1420. Les couronnes d’or étaient les armes parlantes des orfèvres.—Maison du Pan, sorte de filet de chasse, 1425. Fabrique de filets.—Maison de la Cuillère, 1524. Un potier d’étain, ne fabriquant que des cuillers. Mais, en 1571, ce fut la maison de la Cuiller de bois, quand le potier d’étain eut cédé la place à un boisselier, fabricant d’objets de ménage en bois.—Maison de la Teste de Bélier, 1574. Un abattoir, ou un échaudoir.—Maison du Fer à cheval, 1550. Maréchal ferrant.
RUE SAINT-HONORÉ. Maison du Cheval rouge, 1350. Sans doute une hôtellerie.—Maison du Papegaut ou Perroquet, 1426. Un oiselier, vendeur d’oiseaux rares?—Maison des Trois Serpettes, 1568. Un fabricant de coutellerie.—Maison du Bœuf, 1378. Un boucher.—Maison du Heaulme, 1378. Un heaumier, fabricant de casques et armures de tête.—Maison de la Huchette, 1432. Menuisier, fabricant de huches et de bahuts.—Maison de la Croix d’or, 1415. Orfèvre.—Maison de la Pelle, 1410. Fabricant d’outils de bois.—Maison de la Clef, 1411. Serrurier.—Maison du Plat ou du Pot d’étain, 1489. Potier d’étain.—Maison de la Crosse, 1489. Orfèvre.—Maison du Bœuf et du Mouton, 1413. Boucher.—Maison{54} du Godet, 1413. Potier d’étain ou plombier, fabricant de gobelets.
Nous avons remarqué que, parmi les enseignes que nous laissons de côté, en recueillant les précédentes, quelques-unes portaient les noms de différentes villes de France et de l’étranger. Ces enseignes, ce nous semble, peuvent être attribuées à des marchands, qui avaient signalé ainsi, soit le lieu de leur naissance, soit leurs rapports commerciaux avec les villes qui figuraient sur ces enseignes. Voici donc, à titre de spécimens, quels sont les noms de ville qui avaient été mis sur des enseignes, dans ces anciennes rues de la Cité et du quartier du Louvre que nous venons de parcourir sous la direction du savant archéologue Adolphe Berty.
CITÉ. RUE DES MARMOUSETS. Maison de Jérusalem, 1508. Le propriétaire de cette maison était un marchand et bourgeois de Paris, nommé Jean Legras, qui avait fait le voyage de la terre sainte, peut-être pour son commerce, et qui, en 1557, fit une fondation de vingt livres de rente annuelle, à prendre sur sa maison, en faveur de la confrérie du Saint-Sépulcre, ayant son siège dans l’église du couvent des Cordeliers.
RUE FROMENTEAU. Maison de la Ville de Tours, 1600.
RUE CHAMPFLEURY. Maison de la Ville de Mantes, 1680, puis, de la Ville de Munster, 1687; puis, de la Ville de Bruxelles, 1700. On peut supposer que cette maison, que nous avons citée déjà plus haut, était une auberge, qui a cherché successivement sa clientèle parmi les voyageurs de Mantes, de Munster et de Bruxelles, en changeant chaque fois de propriétaire.{55}
RUE SAINT-HONORÉ. Maison de la Ville de Cornouaille, 1687. C’était assurément une auberge.—Maison de la Ville de Lude, 1687.—Maison de la Ville de Lunel, 1687.
RUE JEAN-SAINT-DENIS. Maison de la Ville de Lyon, 1668.—Maison du Bois de Boulogne, 1680[54].
La plupart de ces enseignes, avec des noms de ville, sont du XVIIᵉ siècle; on ne peut donc pas supposer que la représentation de chaque ville était sculptée en relief sur la pierre, comme cela avait eu lieu au moyen âge. Il y eut peut-être quelques tableaux dans lesquels l’imagination des peintres avait fait les frais d’une vue de la ville que l’enseigne annonçait; mais il est plus probable que l’enseigne se bornait à une simple inscription.
Quant aux enseignes héraldiques, telles que l’Écu de France, l’Écu de Bretagne, l’Écu d’Orléans, etc., c’étaient ordinairement des hôtelleries qui se les attribuaient, pour s’en faire un titre d’honneur et de recommandation. Mais les marchands ne se privaient pas de les prendre aussi, dans l’intérêt de leur commerce (nous en dirons quelque chose dans le chapitre des enseignes armoriées[55]). Ils ne craignaient pas, pour ce fait, d’être recherchés et inquiétés par les juges d’armes attachés à la Maison du roi. Les marchands se permettaient tout dans leurs enseignes, si ce{56} n’est de blesser l’honnêteté publique, et pourtant cette enseigne drôlatique, Au Q couronné, a subsisté rue de la Ferronnerie, depuis 1680 jusqu’à nos jours, sans avoir mis en émoi la pudeur de la police. On assure même que plus d’un des propriétaires du Q couronné eut le bonheur de faire fortune, grâce à son enseigne, qui était encore plus impertinente que celle où l’on voyait figurer le Bœuf couronné et la Vache couronnée. Cependant il faut bien dire que M. l’abbé Dufour a rectifié l’opinion de M. de La Quérière, qui s’étonnait d’avoir rencontré, en 1828, cette enseigne qu’il qualifiait d’irrévérencieuse: «C’est tout simplement la marque d’un balancier, dit M. l’abbé Dufour. Les balanciers habitaient alors cette rue et prenaient pour enseigne la lettre qui leur servait à poinçonner leurs produits[56].»
C’est au XVᵉ siècle que l’enseigne des marchands règne partout dans Paris et prend la place de l’enseigne des maisons. A partir de cette époque, pas une boutique, pas une échoppe qui n’ait son enseigne, modeste ou triomphante, religieuse ou libertine, sévère ou plaisante, bizarre ou ridicule. Nous pouvons, en quelque sorte, nous représenter cette variété d’enseignes, comme si nous nous promenions dans les rues du Paris de ce temps-là, en lisant et en commentant une facétie en prose intitulée: le Mariage des quatre fils Hémon et des filles de Damp Simon[57], laquelle n’est autre qu’une nomenclature des enseignes de Paris, imprimée et sans doute réimprimée plus d’une fois à la fin du XVᵉ siècle. Il y avait alors devant la grande Boucherie, près du grand Châtelet, une enseigne des Quatre fils Aimon, tous quatre montés sur le même cheval. Cette enseigne rappelait un roman de chevalerie, que tout le monde connaissait, et ce fut là sans doute ce qui fit le succès de l’enseigne, qui avait une sorte de célébrité. Une marchande de la rue du Cygne emprunta au même roman le sujet d’une autre enseigne, celle des Trois Filles de Damp Simon, qu’on pouvait regarder comme le pendant de l’enseigne des Quatre fils Aimon. Quand on avait vu la première, on voulait voir la seconde. La badauderie parisienne se chargea de la renommée des deux enseignes. Un littérateur de carrefour prit de là occasion d’inviter, en quelque sorte, toutes les{58} enseignes de Paris au mariage des Quatre fils Aimon avec les Trois filles du seigneur Damp Simon.
Voici comment s’est fait le mariage, «avec tout l’ordre qui a été gardé au banquet». Tout par enseignes, enseignes partout. La Grâce du Saint-Esprit, du bout de la rue des Lavandières, est descendue sur l’Image Saint-Pierre, du chevet de l’église Saint-Gervais; et, à la requête des Trois Rois de Cologne, de la Grande-Rue-Saint-Jacques, et des Trois Roines, du grand ouvrouer (ouvroir), on veut faire, au carrefour Saint-Innocent, le mariage des Quatre fils Aimon, de devant la Boucherie, avec les Trois filles de Damp Simon, devant l’église Saint-Leu et Saint-Gilles, et, pour avoir une quatrième épousée, on songe à prendre la Pucelle Saint-Georges, au bout de la rue Trousse-Vache. Quant aux filles de la noce, qui devront tenir compagnie aux épousées, on a les Trois Pucelles, qui sont devant la porte de maître Jean Turquet, et la Nonnain qui ferre l’oue (l’oie), au ponceau (rue du Ponceau) de la rue Saint-Denis.
Quel doit être le parement des épousées? Les Fermiaux (agrafes) de la rue Quinquampoix, les diamants et les ceintures de la Couronne et de la Fleur de lys, du cimetière Saint-Jean. Les épousées auront, en outre, la Couronne, du carrefour de la Porte-de-Paris. Tous ceux qui viendront à la fête auront les Chappelets, de la porte Baudet, et les Gands, de la rue des Arsis. Les Ménestriers de la salle de danse qui est dans la rue de la Tonnellerie mèneront les épousées à l’église aux sons de leurs instruments. Les seigneurs de la noce seront le Chevalier au cygne, de la rue des Lavandières, Samson fortin (le fort), de la rue de la Harpe, et l’Image Saint-Georges, de la rue des Barres;{59} les rois et les chevaliers logeront au Château de Pontoise, rue de la Cossonnerie; les reines et les dames, au Palais du Terme (des Thermes), rue de la Harpe.
Le mariage aura lieu au Moutier (église), rue de la Cossonnerie; puis, en la Chapelle du carrefour du Temple, rue des Gravilliers, devant l’Image Notre-Dame. Le Cardinal, de la Pierre-au-Lait, célèbrera le mariage; le Prêcheur, du chevet de l’église Saint-Jacques, chantera la messe; l’Ange, de devant l’église Saint-Gervais, et celui de la rue aux Fèvres, de devant l’église Saint-Innocent, tiendront les cierges. Avant la cérémonie religieuse, il faudra que les époux aillent faire leurs serments, en présence du Dieu d’amours, de devant le Palais, et en face d’un autre Dieu d’amours, de la Pierre-au-Lait: jurant que le mariage sera bon et valable, par la Fête-Dieu, du bout de la rue de la Grande-Truanderie; par le Petit-Saint-Antoine, des Halles, et par le Vaudeluque (fanfaron), de la rue des Lombards. Les Champions, de la Croix-Hémon, combattront contre tout homme qui dira le contraire.
Il faudrait maintenant choisir un homme sage, discret et clairvoyant, qui sache ordonner la dépense et tout le fait des noces. Ce sera l’Homme aux deux têtes, à la porte aux Peintres. On lui remettra donc l’argent, à savoir le Gros Tournois, de la cave de Pontis, et celui du Petit-Pont; et, pour savoir s’ils sont de poids, on les pèsera aux Balances, de la Croix-du-Tiroir. Puis, nous les mettrons en la Huchette, de la rue Saint-Martin, laquelle sera fermée avec la Clef, du cimetière Saint-Jean, et celle de la rue des Ecouffes. Ensuite, quand il s’agira de les prendre, pour faire les achats, on les mettra dans les Bourses, du Petit-Pont et{60} dans celles de la porte Baudet, de la porte du Cloître-Notre-Dame et des Halles. Quand il s’agira de faire les Garnisons (provisions), on les prendra à la Grange du Petit-Pont; le blé sera criblé à la Cave et au Van, en la rue du Roi-de-Sicile, et, pour le porter au moulin, afin d’en faire le pain de la fête, nous le mettrons sur l’Ane rayé, en la Vannerie, ou sur celui de la Verrerie, pour l’aller moudre au Moulinet, en la Vannerie, ou aux autres Moulinets, devant Saint-Séverin et auprès de l’église Saint-Côme et Saint-Damien.
Quant au vin, il faut le chercher aux Bouteilles, devant le Palais, ou au Barillet, devant Sainte-Opportune. Au banquet, les rois et les reines boiront à la Coupe d’Or, de la Savonnerie, ou à la Coupe d’Argent, du marché Palu, et les autres convives boiront au Grand Godet, rue de la Lanterne, en la Cité; aux Gobelets, en Grève; au Voirre (verre), rue de Jouy. On cuira le pain, les tartes, pâtés et flans, au four Ganquelin, rue de l’Arbre-Sec.
Venons-en aux apprêts du banquet. On trouvera le Queux (cuisinier), au bout de la rue aux Anglais; le Chaudron, devant l’Hôtel-Dieu et à la Vieille-Monnaie; la Poële, au bout de la rue des Parcheminiers; le Pot de Cuivre, devant le parvis Notre-Dame; le Gril, rue de la Mortellerie, ou bien près de l’église Saint-Benoît, en la rue Saint-Jacques; le Jaunet (lard jaune), rue Saccalie; le Lard taillé, au carrefour Guillory; le Trépied, au carrefour du Temple; le Soufflet, à la bastille Saint-Denis, ou rue des Deux-Portes; le Mortier, rue Saint-Josse, ou rue Aubry-le-Boucher, et le Pestel (pilon), devant le Palais; le Verjus, à la Treille, rue de la Calandre; l’eau, pour faire le potage, à la Fontaine de Jouvence, et l’eau, pour laver la vaisselle, au{61} Puits, lequel appartient à sœur Colette, qui fait si bien les bonnes saucisses, rue d’Arsis.
Or, comme il importe de faire compte des pots de cuivre et d’étain, on ira chercher les Tableaux en la rue Saint-Merry. Quant à la vaisselle d’étain, on prendra les Plats rue Tirechappe; les Quatre Ecuelles, en la rue des Prêcheurs; le Pot d’étain, à la porte aux Peintres, et à l’enseigne des Déchargeurs, rue Geoffroi-le-Sueur.
A présent, les viandes pour les rois et les reines, comme pour le commun. On prendra le Lièvre devant l’église du Saint-Sépulcre; le Veau, devant Saint-Merry; le Taureau, devant Saint-Bon; les Deux Moutons, rue de l’Hirondelle, derrière le collège d’Autun; le Chapon, devant Saint-Antoine; le Coq et la Géline (poule), rue des Lavandières; les Connins (lapins), rue de la Mortellerie, et rue de la Juiverie; les Coulons (pigeons), devant la Tête-Noire, Grande-Rue-Saint-Martin. Et, pour faire les entremets, on prendra le Paon à la pointe Sainte-Eustache; les Deux-Cygnes, rue de la Harpe; le Faisan, rue Tirechappe; les Perdrix, rue Hautefeuille, devant les Cordeliers; les Tourterelles, en la rue du Four.
Tous ceux qui serviront les rois et les reines seront vêtus de draps, qui se vendent aux Poulies, rue des Blancs-Manteaux, et ils trancheront avec des Couteaux, qui sont devant Sainte-Croix en la Cité. On mettra le relief du repas de noces aux Trois Corbillons, rue de la Tannerie, pour distribuer ce relief aux Quinze-Vingts, rue Maudetour.
On se pourvoira des meubles nécessaires pour la salle du banquet: la Table roulante, rue de la Saunerie; les Tréteaux, en la Grande-Rue-Saint-Jacques; la Chaire (siège), au{62} Petit-Pont; le linge, au Fardel (fardeau), rue Saint-Denis; le Chandelier, rue Saint-André-des-Arts, afin d’y mettre les Chandelles de la rue Mauconseil.
Pour les convives qui ne mangent que du poisson, on aura les Deux Saumons, de la porte Montmartre; le Gournau (gournal, espèce de rouget), de la rue de la Saunerie; le Turbot, de la rue Saint-Julien-le-Pauvre; le Barbeau, de devant les Béguines, en la rue Geoffroy-l’Anier; la Raie, de la rue Geoffroy-Langevin; la Lamproie, sous les piliers des Halles, où l’on fabrique la cervoise (bière) pour ceux qui ne boivent pas de vin.
Pour issue de table, on prendra le Cerf, en la rue Baillehoé, ou en la rue de la Calandre; le Sanglier, devant l’église Saint-Julien, en la rue Saint-Martin. Quant aux fruits, on les trouvera à la Pomme, devant le Saint-Sépulcre; le Poirier, au bout de la rue du Temple; le Noyer, aux Fossés-Saint-Germain; le Figuier, au bout de la rue des Nonaindières, et le Mûrier, au Champ-Gaillard.
Précautions à prendre pour garder la fête: on aura Ysoré et Guillaume au court nez, en la place Maubert; puis, nous tiendrons l’Huis de fer, de la rue de la Saunerie, et celui de la rue Aubry-le-Boucher. Les champions seront armés de l’Haubergeon, de devant Saint-Michel, en la Cité; des Deux Heaumes, de la porte Baudet, le petit et le grand; des Gantelets, du carrefour Saint-Séverin, et du Gantelet, de la rue de Georges-la-Mer, à la Barre-du-Bec; de l’Épée, de la rue Saint-Denis; de l’Écu de France, de la rue Neuve-Notre-Dame, ou de celle de la Vannerie, ou de celle de la porte de Paris; et, pour se mieux défendre, n’ont-ils pas la Massue, de la rue Jean-Tison?{63}
Il y aura quelques joyeux ébattements pendant le dîner, savoir: l’Homme sauvage, de la rue aux Fèvres, ou celui de la Bûcherie, au Petit-Pont; les Trois Mores, de la rue Saint-Martin, qui danseront et feront danser l’Ours et le Lion, de la rue Michel-le-Comte, ou ceux de devant l’église Sainte-Marine, et les Singes, en la rue de Vieille-Pelleterie; ils montreront la Grimace, de la rue Saint-Denis, la Truie qui file, des Halles, et la Truie qui vole, de la rue des Lombards.
Après le dîner, les convives pourront s’amuser à l’Échiquier, qui est auprès de l’église de la Madeleine, et avec les Dés, en la rue Thibaut-aux-Dés.
Et qui voudrait aller en chasse au gibier, pourrait avoir le Grand Cornet, du chevet de l’église Saint-Jean; le Cheval blanc, de la rue Neuve-Notre-Dame; le Cheval rouge, de la rue de la Verrerie; le Cheval noir, de la rue Regnault-le-Fèvre; le Cheval vert, de la rue Pierre-au-Lard. Il faudrait, en outre, la Selle, en la rue de la Tabletterie, ou celle de la rue Saint-Denis; la Heuse (botte), de la porte Baudet, et celle de la rue Saint-Martin; les Éperons, de la rue Saint-Denis; les Brides et les Freins, de la rue Perrin-Gasselin. Et, s’il pleut, ils auront contre la pluie la Housse-Gilet, de la porte Saint-Denis, et celle de la rue de la Harpe; le Chapeau rouge, de devant Saint-Jean-en-Grève, et les Moufles (gants de chasse), du pont Perrou, pour porter le Faucon, qui est devant le petit Saint-Antoine, ou pour aller prendre les Trois Canettes, devant les Moulins du Temple.
Que si les reines et les dames veulent s’ébattre à la promenade, elles auront le Chariot, de la porte Saint-Honoré. Quand elles voudront se promener par eau, elles{64} auront la Nef d’argent, au bout de la rue des Poulies, et celle de devant l’hôtel d’Anjou, pour voir pêcher à la Nasse, en la rue de Darnetal, et pour prendre les Trois Bequets (brochets), près l’église Saint-Magloire, et les Trois Poissons, de la Savonnerie.
Quant aux gens du commun peuple, ils pourront aller voir le Jeu de Paume, de Braque, au Poncelet, et celui de la rue Grenier-Saint-Ladre. Ils viendront jouer aux Billes et au Billard, en la rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie. Ils peuvent encore aller veiller aux champs et souper à la Pierre de Bailly, devant le Beau roi Philippe. Ils peuvent aussi aller se mettre au Lit, à l’abreuvoir Popin: c’est à savoir qu’il faut chercher la coulte (couvre-pied) et le coussin (oreiller), les draps et les couvre-chefs (bonnets), au Fardeau, déjà nommé, et le lit sera couvert de la Penne (édredon), d’auprès l’église Saint-Séverin, et nos gens iront coucher, quand l’Horloge, devant Sainte-Catherine, sonnera.
Aucune description ne donnerait une idée plus complète et plus pittoresque des enseignes de Paris, si nombreuses et si variées en ce temps-là. On a remarqué que les mêmes enseignes se trouvaient dans des quartiers différents. On a pu constater aussi que la plupart des enseignes de marchand étaient analogues à leur genre de commerce et à leur profession. Mais, dans cet ingénieux Mariage des quatre fils Hémon[58], il n’est fait mention que de cent{65} cinquante enseignes[59], entre lesquelles il n’en est que trois ou quatre plaisantes, comme la Nonnain qui ferre l’oie, la Truie qui file, la Truie qui vole, etc. Or, on doit estimer à plus de trois mille le nombre des enseignes, qu’on voyait à Paris en ce temps-là, relatives à l’industrie, au commerce et à la marchandise.{66}
C’EST le peuple, le bas peuple surtout, qui a baptisé les rues de Paris au moyen âge, et leurs parrains sont restés tout à fait inconnus. Le nom, une fois trouvé et donné, n’était pas toujours accepté par les habitants de la rue, que la voix publique avait dénommée sans demander leur avis. Il arrivait aussi que le premier passant venu changeait ce nom de son autorité privée, si le nom n’était pas à son gré et ne lui semblait pas convenir à la rue qui le portait. De là, les différents noms attribués simultanément à la même rue, qu’il n’est pas toujours aisé de reconnaître sous ces noms multiples qu’on rencontre dans des actes authentiques de la même époque. Voilà pourquoi l’histoire des anciennes rues et ruelles de la{67} capitale est si difficile à éclaircir complètement, aux XIVᵉ et XVᵉ siècles, comme aux XVIᵉ et XVIIᵉ. Les rues, en effet, ne reçurent en quelque sorte leur état civil que vers l’année 1728, lorsque René Hérault, lieutenant général de police, s’occupa non seulement de créer le numérotage des maisons, mais encore de fixer d’une manière définitive les noms des rues. C’est lui qui commença, en cette année-là, à faire poser, à l’entrée et à la sortie de chaque rue, des plaques de tôle sur lesquelles étaient inscrits les noms que l’usage paraissait avoir consacrés. Ces noms avaient été peints en gros caractères noirs sur des feuilles de fer-blanc découpées de la même grandeur et clouées à l’angle des rues, sur la première et la dernière maison de chaque rue ou ruelle. Quant aux numéros, ils étaient également peints, au-dessus des portes des maisons, en couleur blanche sur fond de couleur bleue ou rouge. On n’avait pas adopté, dès l’origine, la division des numéros pairs et impairs; les numéros se suivaient d’un bout à l’autre de la rue, revenant ensuite par l’autre côté, de façon que le dernier se retrouvait en face du premier.
On ne tarda pas à s’apercevoir que l’emploi des plaques de tôle portant le nom des rues était sujet à bien des accidents. Ici, les gens du quartier, mécontents de ce qu’on avait donné la préférence à un nom qui leur plaisait moins qu’un autre, arrachaient ces plaques ou les mutilaient, en effaçant le nom qu’elles portaient. Là, le propriétaire de la maison à laquelle on avait attaché, sans son consentement, une plaque nominative, la faisait disparaître, sous prétexte de faire réparer, ou gratter, ou badigeonner cette maison. Le lieutenant général de police crut devoir inter{68}venir, et publia une ordonnance, en date du 30 juillet 1729, défendant d’endommager les plaques qu’on avait apposées aux deux extrémités de chaque rue, et enjoignant aux propriétaires des maisons où ces plaques seraient attachées, de faire mettre, en leur lieu et place, de grandes tables de pierre de liais, où seraient gravés en creux les noms des rues, dans le cas où ces propriétaires auraient à faire enlever lesdites plaques pour des travaux à exécuter aux façades de leurs maisons, ou bien si ces plaques avaient été détériorées par quelque cause que ce fût. Le continuateur de De La Mare constate, en 1738, que les propriétaires se prêtèrent volontiers à l’exécution de cette sage ordonnance et prirent même l’initiative de poser des plaques aux encoignures intermédiaires entre les deux extrémités de la rue[60]. Plusieurs de ces plaques sont aujourd’hui conservées au musée Carnavalet. Il y a quarante ans, on voyait encore, au coin de bien des rues de Paris, l’ancien nom gravé sur une pierre de liais encastrée dans le mur de la première maison de ces rues-là, car, depuis que la rue avait eu son nom inscrit sur la pierre, avec approbation du lieutenant de police, personne n’avait plus songé à changer ce nom officiel, si bizarre, si étrange, si incompréhensible qu’il pût être. Ces noms de rue séculaires se trouvaient ainsi placés sous la sauvegarde de la tradition.
Combien d’anciennes rues devaient leurs noms à des enseignes qui, la plupart, n’existaient plus depuis longtemps, mais dont quelques-unes étaient encore à la même place depuis deux ou trois siècles! Il n’est peut-être pas sans intérêt de rechercher aujourd’hui ces noms de rue,{69} qui sont comme des épitaphes sur des tombeaux. Beaucoup de rues n’ont pas même laissé de trace, et c’est à peine si l’on parvient à préciser l’endroit qu’elles occupaient; mais il suffira de rappeler ici leurs noms, en rapprochant ces noms des enseignes qu’ils représentent et qui ont été quelquefois la cause de leur renommée populaire. Dans cette rapide nomenclature on verra que les enseignes et les rues qu’elles ont nommées vivent un peu plus longtemps que les simples mortels; en revanche, les unes et les autres sont oubliées encore plus vite que les hommes qui ont eu des enfants et des amis. On peut dire d’une enseigne fameuse et d’une rue plus ou moins fréquentée, qu’on supprime tout à coup, selon le bon plaisir du service de la voirie: Sic transit gloria mundi. Voici donc, par ordre alphabétique, quelles étaient et quelles sont encore les rues qui ont dû leurs noms à des enseignes[61]:
* Rue des Deux-Anges, quartier Saint-Germain-des-Prés. Deux images d’anges, placées aux extrémités de cette rue, lui avaient donné ce nom.
* Rue de l’Arbalète, quartier Saint-Benoît. Elle a pris son nom d’une enseigne de l’Arbalestre, qui était au coin de cette rue, nommée, au XIVᵉ siècle, rue des Sept-Voies, antérieurement à l’enseigne.
* Rue de l’Arbre-Sec, quartier du Louvre. Ce nom, que la rue portait déjà au XVᵉ siècle, lui venait d’une enseigne{70} de maison, qu’on y voyait encore du temps de Sauval, près de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois.
Rue de l’Arche-Dorée, quartier Saint-Paul, ancien nom de la rue de l’Étoile: selon Jaillot, elle devait son nom à une enseigne de l’Arche, qui pendait à une maison appartenant à un sieur Dorée.
Rue Aumaire, quartier Saint-Martin-des-Champs. Cette rue se prolongeait jadis au-delà de la rue Frépillon et prenait, à cet endroit, le nom de rue de Rome, à cause de l’enseigne d’une maison.
Rue du Pont-aux-Biches, quartier Saint-Martin. Ce nom lui venait d’un petit pont ou ponceau, construit sur un égout, et d’une enseigne des Biches.
Rue du Bout-du-Monde, quartier Saint-Eustache. Ainsi nommée d’une enseigne en rébus, où l’on avait représenté un bouc, un duc, sorte d’oiseau, et un globe terrestre figurant le monde.
Rue de la Calandre, quartier de la Cité. «Le plus grand nombre des auteurs, disent Hurtaut et Magny, conviennent qu’elle a pris son nom d’une enseigne, mais ils ne s’accordent point sur la représentation de cette enseigne. Les uns disent que c’était un de ces insectes qui rongent le froment et qu’on nomme aussi charançon; les autres, une espèce de grive que les Parisiens appellent calendre; d’autres disent que c’est une espèce d’alouette, nommée calandre; d’autres enfin, que c’est une machine avec laquelle on tabise et on polit les draps, les étoffes de soie, et Sauval dit que c’est là la véritable origine du nom de cette rue.»
* Rue des Canettes, quartier du Luxembourg. Elle tire son nom de l’enseigne des Trois Canettes.{71}
* Rue des Petits-Carreaux, quartier Saint-Denis. Elle tire son nom d’une enseigne qu’on y voyait encore à la fin du dernier siècle.
* Rue du Cherche-Midi, quartier de la Croix-Rouge. Selon Sauval, c’était le nom d’une enseigne, où l’on avait peint un cadran et des gens qui y cherchaient midi à quatorze heures. «Cette enseigne, ajoute-t-il, a semblé si belle, qu’elle a été gravée, et mise à des almanachs tant de fois, qu’on ne voyait autre chose. On en a fait un proverbe: Il cherche midi à quatorze heures, c’est un chercheur de midi à quatorze heures.» L’enseigne fut remplacée depuis par une enseigne sculptée en pierre, qui subsiste encore.
* Rue du Gros-Chenet, quartier Montmartre. L’enseigne d’une maison, située au coin de la petite rue Saint-Roch, lui avait donné son nom.
* Rue Cloche-Perce, quartier Saint-Antoine. Nom altéré de Cloche-percée, que la rue portait autrefois à cause d’une enseigne qu’on y voyait encore en 1636.
Rue du Cœur-Volant, quartier du Luxembourg. Elle devait son nom à une enseigne peinte, qui représentait un cœur avec des ailes, dit le Cœur volant.
Rue du Coq, quartier du Louvre. Cette rue a tiré son nom de la maison du Coq, qui avait pour enseigne un coq en bas-relief, armes parlantes de l’ancienne famille Le Coq.
Rue des Coquilles, quartier de la Grève. Elle fut ainsi nommée à cause de l’hôtel des Coquilles, situé en cette rue et décoré, sur la façade, de coquilles sculptées figurant l’enseigne de la maison; il existe encore, à l’alignement de la rue de Rivoli.{72}
Rue de la Corne, quartier du Luxembourg. Ainsi nommée de la corne de cerf qui pendait pour enseigne d’une maison, au coin de la rue du Four.
* Rue du Croissant, quartier Montmartre. Une enseigne représentant la lune dans son croissant lui avait fait donner ce nom.
Rue de la Croix-Blanche, quartier Sainte-Avoie. Nom d’une enseigne.
* Rue du Cygne, quartier des Halles. Nom d’une enseigne au XIIIᵉ siècle.
Rue des Cinq-Diamants, quartier Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Nom de l’enseigne d’une maison de cette rue.
Rue de l’Écharpe, quartier Saint-Antoine. Nom d’une enseigne.
* Rue des Deux-Écus, quartier Saint-Eustache. Elle tire son nom de l’enseigne d’une maison.
* Rue de l’Épée-de-bois, quartier de la place Maubert. Nom d’une enseigne.
Rue de l’Étoile, quartier Saint-Paul. Elle doit son nom à l’enseigne d’une vieille maison qu’on appelait le Château de l’Étoile.
Rue de la Femme-sans-tête, quartier de la Cité. Elle avait pris son nom d’une enseigne satirique, qui représentait une femme sans tête, tenant à la main un verre de vin, avec cette légende: Tout en est bon.
* Rue des Quatre-Fils, quartier du Temple. Ainsi nommée à cause de l’enseigne des Quatre Fils Aimon, représentés, en costume de guerre, sur le même cheval.
Rue de la Fontaine, quartier de la place Maubert. Ainsi nommée de l’enseigne d’une maison.{73}
Rue des Fuseaux, quartier Sainte-Opportune. Elle avait pris son nom de l’enseigne d’une maison, représentant trois fuseaux.
* Rue de la Harpe, quartier Saint-André-des-Arts. On l’appelait déjà, au XIIIᵉ siècle: vicus Citharæ. Son nom lui vient de cette enseigne, qu’on voyait encore, il y a un siècle, à la seconde maison à droite, au-dessus de la rue Mâcon.
* Rue de l’Hirondelle, quartier Saint-André-des-Arts. Ce nom lui vient de l’enseigne d’une vieille maison qu’on appelait l’hôtel de l’Arondale.
* Rue de la Huchette, quartier Saint-André-des-Arts. Ce nom lui vient de l’enseigne d’une maison au XIIIᵉ siècle.
Rue de la Lanterne, quartier de la Cité. Nom d’une enseigne, en 1397. Cette enseigne, qui était celle d’une maison située au coin de la rue des Marmousets, paraît avoir été mentionnée, en ces termes, dans la Taille de 1292: «Agnès, de la Lanterne, regrattière.»
* Rue du Petit-Lion, quartier du Luxembourg. Nom de l’enseigne du Petit Lion.
Rue des Trois-Maures, quartier Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Elle doit son nom à l’enseigne d’une auberge, fameuse au XVIᵉ siècle.
Rue du Petit-Moine, quartier de la place Maubert. Elle tirait son nom d’une enseigne.
Rue du Noir, quartier de la place Maubert. Cette rue devait son nom populaire à l’enseigne du More ou Maure.
* Rue des Oiseaux, quartier du Temple. Elle doit son nom à une enseigne.
* Rue du Paon, quartier Saint-André-des-Arts. Nom d’une enseigne. Il y avait dans le quartier de la place Maubert{74} une autre rue du Paon, nommée aussi par une enseigne.
* Rue de la Perle, quartier du Temple. Elle devait son nom à l’enseigne d’un jeu de paume.
* Rue du Plat-d’étain, quartier Sainte-Opportune. Elle a pris son nom de l’enseigne d’un hôtel qu’on y voyait encore au XVIᵉ siècle.
Rue du Poirier, quartier Saint-Martin-des-Champs. Nom d’une enseigne.
* Rue des Prêcheurs, quartier des Halles. Ce nom lui a été donné, au XIVᵉ siècle, à cause de l’enseigne d’une maison qu’on appelait l’hôtel du Prêcheur.
Rue de Rats, quartier de la place Maubert. Nommée ainsi, dès le XIIIᵉ siècle, à cause d’une enseigne.
Rue du Roi-Doré, quartier du Temple. Ce nom lui vient d’un buste du roi Louis XIII, qu’on avait placé à l’entrée de cette rue et que le peuple appelait le roi doré, parce que ce buste était doré.
* Rue du Sabot, quartier Saint-Germain. Nom d’une enseigne. Cette rue s’était d’abord appelée rue de l’Hermitage, qui fut également le nom d’une enseigne.
Rue de Venise, quartier de la Cité. Nommée ainsi à cause d’une enseigne à la Ville de Venise.
* Rue des Quatre-Vents, quartier du Luxembourg. Nom d’une enseigne.
Ce n’étaient pas là les seules rues qui tirassent leurs noms des enseignes de maison ou de boutique, et l’on pourrait en citer un certain nombre d’autres qui sont évidemment nommées par les enseignes, quoique la tradition se taise à leur égard. Il était aussi tout naturel que le nom de la rue, emprunté à une enseigne, ne survécût pas à cette enseigne{75} quand celle-ci avait disparu. Voici encore quelques rues signalées par J. de La Tynna comme ayant des noms qui provenaient également des enseignes[62].
Le pont aux Meuniers, qui traversait le grand bras de la Seine à côté du pont au Change, fut reconstruit à la fin du XVIᵉ siècle par un entrepreneur nommé Marchand, qui lui donna son nom; mais le peuple, qui baptisait volontiers les rues de Paris, changea le nom de ce nouveau pont et le nomma le pont aux Oiseaux, parce qu’on avait peint, sur la façade de chacune des maisons élevées de chaque côté dudit pont, un oiseau différent pour servir d’enseigne.
La rue du Chaudron, dans le faubourg Saint-Martin, devait son nom à une enseigne qui existait encore en 1816.
* La rue de la Clef, dans le quartier Saint-Médard, avait pris ce nom d’une enseigne de maison à la fin du XVIᵉ siècle.
Le passage de la Croix-Blanche, dans la rue Saint-Denis, était ainsi nommé à cause d’une enseigne.
* La rue de l’Éperon, quartier Saint-André-des-Arts, avait porté successivement plusieurs noms, avant le dernier, qui lui vint d’une enseigne, en 1636.
La place des Trois-Maries, sur le quai de l’École, portait ce nom, dès 1554, à cause de l’enseigne d’une maison.
Le passage de la Marmite, dans la rue des Gravilliers, avait le nom d’une enseigne, qu’on voyait encore, en 1816, rue Phelipeau, en face de ce passage.
* La rue du Petit-Lion-Saint-Sauveur, dans la rue Saint-Denis, avait subi de nombreuses variations de nom, dans{76} lesquelles le lion se trouvait toujours, pour rappeler l’enseigne d’une maison, qui subsiste encore au nº 4 et représente un lion sculpté au-dessus de la porte.
Le passage du Panier-Fleuri, dans le cul-de-sac des Bourdonnais, portait le nom de l’enseigne d’un marchand de vin voisin.
* La rue Servandoni, quartier Saint-Sulpice, eut d’abord deux noms, provenant l’un et l’autre de deux enseignes: rue du Pied-de-biche et rue du Fer-à-cheval.
La rue du Pot-de-fer, quartier Saint-Sulpice, devait aussi son nom à une enseigne, comme une autre rue du quartier Saint-Marceau, laquelle avait pris, en 1586, le même nom, à cause d’une enseigne analogue.
Le passage et la cour du Puits-de-Rome, dans la rue des Gravilliers, étaient ainsi nommés, parce que l’enseigne d’une maison voisine leur avait donné ce nom-là. C’est ainsi que, dans la rue Montorgueil, le passage du Saumon conserve encore le nom de l’ancienne enseigne de la maison qui lui sert d’entrée.
Il y avait, au XIVᵉ siècle, dans la rue Saint-Denis, une ruelle de l’Ane-Rayé, qui devint le cul-de-sac des Peintres. L’enseigne de l’Ane rayé représentait un zèbre.
* La rue Cloche-Perce, qui devait son nom, comme nous l’avons dit, à l’enseigne de la Cloche percée, eut à subir, pendant huit ou dix ans, du temps de Sauval, un changement de nom, par le fait d’une autre enseigne de la Grosse Margot, «qu’avoit mis là un tavernier fameux pour son bon vin»; on l’avait nommée rue de la Grosse-Margot[63].{77}
Au reste, les rues de Paris, au moyen âge, changeaient si souvent de noms, par suite de changement d’enseignes qui avaient la vogue à tour de rôle, qu’il est maintenant bien difficile de constater topographiquement la place de ces rues. Il en est une que Hurtaut et Magny n’ont pas mentionnée et qui ne figure pas, à son ordre alphabétique, dans le Dictionnaire de J. de La Tynna, quoique ce dernier l’ait citée, sans aucun détail, à l’article de la rue de la Petite-Truanderie, dans le quartier Montorgueil. C’est, en effet, le nom de cette rue de la Petite-Truanderie, qui fut métamorphosé, à cause d’une enseigne, vers le milieu du XVIIᵉ siècle, et qui devint, tant que dura l’enseigne, la rue du Puits-d’Amour. Ce puits public existait encore, dans cette rue, quoique à demi ruiné, du temps de Sauval, qui dit y avoir vu tirer de l’eau. On lisait, sur la margelle, cette inscription en lettres gothiques:
C’était quelque amoureux, sans doute, qui avait fait réparer le vieux puits, en souvenir de la triste aventure qui rendit ce puits célèbre, sous le règne de Philippe-Auguste, quand Agnès Hellebic s’y précipita par désespoir d’amour. Depuis lors, les amants se donnaient rendez-vous au Puits d’Amour. «Avec le temps, dit Sauval, son nom a passé à une maison proche de là, et comme ce nom a paru galant à un marchand qui la loue, il a fait repeindre l’enseigne et l’a rehaussée de couleurs fort vives, et même, afin de mieux représenter la fable, il y a figuré un puits, tout entouré de belles filles et de jeunes garçons, avec un petit Amour qui{78} décoche des flèches sur eux, et ces paroles au bas: Au Puits d’Amour. Or, comme d’autres marchands ont trouvé cette enseigne fort à leur gré, et d’autant plus qu’ils s’imaginent que les enseignes plaisantes, ou qui se font remarquer, attirent les chalands, les uns l’ont tout à fait copiée, les autres se sont contentés de l’imiter[64].»{79}
LE plus grand nombre des enseignes étaient des tableaux, peints plus ou moins naïvement, et cela, dès les premiers temps de l’usage des enseignes de marchand. On peut dire avec certitude que toute enseigne pendante était peinte sur bois, à l’exception de quelques enseignes ouvrées en fer, dont le poids pouvait être supporté par la potence à laquelle on suspendait l’enseigne. Quant à ces peintures, elles devaient être généralement exécutées d’une manière convenable, car la corporation des peintres, comme toutes les corporations de métier, exerçait une rigoureuse surveillance sur les ouvrages que ses membres seuls, ayant droit et privilège de maîtrise, se chargeaient d’exécuter eux-mêmes ou de faire exécuter, sous leur responsabilité, par leurs compagnons et leurs apprentis; voilà{80} pourquoi un maître peintre, si habile et si célèbre qu’il fût, ne refusait jamais des travaux de peinture décorative, qu’on pouvait croire indignes de lui. Le même artiste qui peignait des fresques pour les églises et les hôtels avec un réel talent ne dédaignait pas de peindre des enseignes pour les marchands. Nous n’avons pas cependant de document écrit que nous puissions citer à l’appui de cette assertion plausible et presque incontestable, car il ne nous est resté aucune de ces enseignes du XVᵉ et du XVIᵉ siècle, que nous attribuons au pinceau des artistes de la confrérie de Saint-Luc plutôt qu’à la brosse maladroite de quelques ignorants barbouilleurs. Dans le Compte de l’ordinaire de la Prévôté de Paris, année 1463, nous trouvons le nom de Jean de Boulogne, dit de Paris, qui avait fait «un écu de France, peint à l’huile, de fin or et azur, mis et assis sur l’entrée de la porte de l’hôtel du Roi, près des Tournelles.» Or, cet écu de France n’était autre qu’une enseigne, et le peintre Jean de Boulogne, dit de Paris, paraît être le fameux Jean de Paris, alors bien jeune, qui était originaire de Lyon, mais qui se serait intitulé Jean de Boulogne, parce qu’il avait étudié son art dans l’atelier d’un bon peintre bolonais[65].
Nous ne parlerons donc ici que des enseignes exécutées par des sculpteurs, des ferronniers, des plombiers, des tailleurs en bois, des potiers en terre et des émailleurs. Quelques ouvrages de ces artistes ou artisans sont venus jusqu’à nous et peuvent du moins servir de témoignage pour attester l’existence d’une foule d’enseignes de la même espèce. Nous avons déjà dit que la plupart des enseignes{81} de maison devaient être sculptées et, par conséquent, adhérentes au mur. On ne saurait supposer, en effet, qu’un bas-relief en pierre ou même en terre cuite ait pu se suspendre à une potence, si forte qu’on l’eût faite en vue de soutenir un pareil poids. Les spécimens de ces enseignes sculptées qui subsistent encore dans Paris, après tant d’années et surtout après tant de démolitions successives, ne nous donnent qu’une idée très insuffisante de ce que pouvaient être les belles enseignes de cette espèce, dues à des sculpteurs de premier ordre; car les imagiers du XVᵉ siècle, qui travaillaient la pierre avec tant d’adresse et qui façonnaient une multitude de petites figures d’anges et de saints pour les églises gothiques, étaient certainement les mêmes qui exécutaient les enseignes sculptées des maisons et des boutiques.
La rue de la Harpe devait son nom à une de ces enseignes sculptées, et cette enseigne s’y voyait encore vers la fin du siècle dernier, au dire de Jaillot[66], sur la façade «de la seconde maison, à droite, au-dessus de la rue Maçon». A. Berty, dans son étude sur les Enseignes de Paris avant le dix-septième siècle, n’a pas admis l’opinion de Jaillot. «Cette maison de la Harpe, située près de la rue Maçon (et qui a disparu il y a une centaine d’années), dit-il, n’est pas la même que le domus ad Citharam, qui a donné son nom à la rue et qu’on trouve mentionné au XIIIᵉ siècle.» Mais A. Berty ne nous dit point à quel endroit de la rue était l’enseigne de la Cithare, à cause de laquelle la rue avait été nommée vicus Citharæ dans un contrat{82} de 1247, et en 1272 rue du Harpeur ou vicus Regnialdi citharistæ, dans le Cartulaire de la Sorbonne. Alfred de Bougy[67] semble avoir voulu plaisamment mettre dos à dos les deux savants archéologues parisiens, en cherchant ailleurs la maison qui portait l’enseigne primitive de la rue: «Serait-ce par hasard, dit-il, la maison placée à l’angle des rues de la Harpe et Saint-Hyacinthe-Saint-Michel, où l’enseigne du marchand de vin figure (en bois peint) le saint roi David jouant de la cithare?» Alfred de Bougy savait bien que la vieille rue Saint-Hyacinthe avait été ouverte en dehors de l’enceinte de Philippe-Auguste et que le roi David ne pouvait en aucun cas être confondu avec Regnault le Harpeur ou le Cithariste.
L’enseigne en pierre sculptée qui avait donné son nom à la rue de la Calandre, dans la Cité, représentait probablement un grillon sous une forme monstrueuse, car dès l’année 1280 la rue avait pris le nom de Kalendra ou Calandre; on appelait ainsi autrefois le grillon, qui était l’hôte habituel du four banal et qui faisait un bruit perçant et continuel, après la cuisson du pain. On l’appelle aujourd’hui cafard à Paris, où il infeste les fournils des boulangers. Ménage voulait que cette enseigne eût représenté d’abord une alouette, que l’on nommait aussi Calandre. «La rue de la Calandre de Paris, dit-il, a pris son nom d’une calandre qui y pendoit pour enseigne[68].» Sauval se serait-il donc trompé en supposant que le nom de la rue venait de la machine de bois, nommée calandre, qui sert à polir et à calandrer les draps et les étoffes? «Vers le milieu de cette{83} rue, dit-il, pend une enseigne, à demi rompue, où cette grande machine est peinte..., et pour moi, je m’étonne que l’abbé Ménage ait dit qu’elle devoit son nom à une enseigne d’alouette[69].» En effet, la rue de la Calandre était voisine de la Vieille Draperie. L’enseigne sculptée de la Calandre avait disparu alors, mais on en a vu longtemps encore, jusque vers 1860, une de la même époque, celle des Trois Poissons, sculptée dans un médaillon, sur la façade d’une maison de la rue de la Saunerie, nº 14, près du quai de la Mégisserie[70].
La rue de la Licorne, qui ne prit ce nom qu’au XVᵉ siècle, quand on y montra une prétendue licorne vivante, s’appelait auparavant, dès le XIVᵉ siècle, rue des Obloiers, parce que c’était dans cette rue que se fabriquaient les oblées ou oublies, qui ne sont autres que ces minces cornets de plaisir qu’on vend, le soir, dans les rues. Les marchandes de plaisir ont succédé aux oublayeurs et oublieux du moyen âge. Ces derniers avaient laissé sur un mur, dans la rue de la Licorne, un souvenir de leur industrie pâtissière: c’était l’enseigne sculptée de la Gerbe de blé, car l’oublie était faite avec de la fleur de farine. Quant à l’enseigne de la Licorne, qui perpétuait le nom de la rue, la tradition ne dit pas si elle était peinte ou sculptée.
L’enseigne sculptée de la rue du Cherche-Midi n’est pas certainement celle qui avait donné son nom à la rue où elle se trouve. Sauval ne parle pas de cette enseigne sculptée, mais d’une autre qui était peinte, que l’enseigne actuelle a sans doute remplacée. Cette dernière, qui fait corps avec la{84} maison du nº 19, forme un médaillon suspendu au milieu d’un encadrement d’architecture: il représente un astronome en costume antique traçant un cadran solaire sur une tablette que lui présente un petit génie. On lit au-dessous: Au Cherche-Midi. Cette sculpture, bien composée et bien exécutée, paraît être du XVIIIᵉ siècle.
L’enseigne sculptée de la Fontaine de Jouvence, que nous avons déjà mentionnée[71], dans la rue du Four-Saint-Germain, est du XVIᵉ siècle; elle figurait au-dessus de la porte de la maison de la Fontaine, construite avant l’année 1547. Cette sculpture, malheureusement mutilée, et qu’on{85} peut voir au musée Carnavalet, est d’un très bon style. La statue, posée au milieu de la fontaine, est une Vénus, qui a été brisée presque complètement, sans doute à cause de sa nudité. La femme qui puise de l’eau dans la fontaine est décapitée; mais l’homme qui s’éloigne à gauche, emportant un sac sur son épaule, est intact. Serait-ce un vieillard que la fontaine de Jouvence vient de rajeunir? A. Berty s’est trompé étrangement en croyant que cette sculpture était du commencement du XVIIIᵉ siècle[72].
Il faut nous borner à citer quelques autres enseignes sculptées qui subsistent encore, ou du moins qui étaient à leur place il y a quelques années: Au Centaure, rue Saint-{86}Denis, au coin de la rue des Lombards, à côté du Mortier d’argent, presque en face du Chat noir, très bonne sculpture du XVIIᵉ siècle, qu’on a eu la barbarie de mettre en couleur;—Aux Bons Enfants, chez un marchand de vin de la rue Saint-Martin: ce sont des enfants qui donnent des fruits et du pain à un pauvre vieillard; sculpture lourde et sans art: l’artiste a mis un chien basset aux pieds du vieillard, quoiqu’il ait eu la prétention de faire un bas-relief dans le
style grec académique;—une enseigne sculptée, Aux Bons Enfants, chez un marchand de vin, rue de la Huchette;—Au Bon Conseil, qu’on voyait chez un marchand de vin de la rue Mauconseil et qui a disparu récemment: deux enfants, nus et couronnés de lierre, étaient à table; une espèce de Bacchus, assis sur un tonneau, leur versait à boire; de l’autre côté, une femme, également nue, suppliait ce gros homme de ménager la raison des deux enfants;—Au Soleil d’or, encore un marchand de vin, rue Saint-Sauveur, nº 84, tout près de la rue Montmartre: sous les{87} rayons de ce soleil, d’un jaune vif, trois enfants font la vendange et dégustent le vin nouveau; de chaque côté du
soleil sont des raquettes, ce qui indique clairement l’existence d’un jeu de paume dépendant jadis du débit de vin.
On voyait aussi sur le quai de la Mégisserie deux enseignes sculptées, le Vieux Pêcheur et le Galant Jardinier; mais les architectes, qui ont démoli les maisons anciennes et rebâti les nouvelles, n’étaient pas payés pour s’intéresser à ces{88} vieilles enseignes, coloriées comme des images de plâtre, qu’on a remplacées l’une par un tableau, l’autre par une statuette en bois coloriée. Rue de la Lingerie, nº 15, une enseigne en bois sculpté peint en bronze et argent représente le Bon Samaritain.
Il y avait autrefois des enseignes à figures en plâtre et en terre cuite, mais elles n’étaient pas faites pour résister longtemps aux accidents de la vie parisienne. Les enfants s’amusaient à les abattre à coups de pierres. Les enseignes sculptées en bois et peintes au naturel faisaient meilleure résistance, mais la pluie et le soleil en venaient à bout tôt ou tard, si l’on n’avait pas soin de les repeindre souvent pour les préserver de la destruction. Il fallait peindre aussi les enseignes en fer, qui ne craignaient que la rouille.
C’étaient quelquefois de bons ouvrages de ferronnerie, élégants et légers, travaillés, presque sculptés au marteau. Les marchands de vin appréciaient beaucoup ce genre{89} d’enseigne, qui ne se détériorait pas, à condition qu’on en renouvelât la peinture tous les dix ans. Un marchand de vin de la rue Saint-Honoré, nº 33, près de la rue de la Ferronnerie, a encore une très jolie enseigne en fer forgé: A l’Enfant Jésus. Ce divin enfant est représenté debout sur la lettre H dans son monogramme, entre deux ceps de vigne. L’enseigne Au franc Pinos, qui représente une grappe de raisin suspendue au centre d’un enroulement de vigne, en
fer forgé, existe encore également chez un marchand de vin dont la boutique fait le coin de la rue des Deux-Ponts et du quai Bourbon. Le pinot, ou plutôt pineau, est une espèce de raisin noir qui fait le meilleur vin de Bourgogne et dont Rabelais vante les qualités. Un autre marchand de vin, nº 6, quai de l’École, aujourd’hui quai du Louvre, avait fait exécuter en fer son enseigne: Au Petit Suisse. Celui-ci monte la garde au milieu d’une treille; le tout est très haut en couleurs, comme si c’était un tableau de foire.{90} Cette jolie enseigne, Au Petit Suisse, est répétée, avec une tout autre composition locale et sous un autre costume,
pour annoncer la boutique d’un marchand de fromages de
Gruyère, rue Montorgueil. L’enseigne des Trois Rats était aussi en fer, les rats trottinant au milieu d’un ornement en{91} forme de cœur ou de vase. L’enseigne A la grâce de Dieu, rue Montmartre, est la plus ancienne de toutes les enseignes en fer, car elle doit remonter à l’époque de la régence du duc d’Orléans. C’est un petit personnage, en costume du temps, avec la perruque et nu-tête, dans une barque, qui est censée en péril de mer, au milieu d’une sorte de cartouche en fer battu, affectant la forme d’un écran.
Les enseignes sculptées n’étaient souvent que des bustes ou des statues. On sait, par exemple, que le buste de Molière, qu’Alexandre Lenoir avait fait placer en 1799 sur la façade d’une maison de la rue de la Tonnellerie, qu’on regardait alors comme la maison natale de cet homme célèbre, a été depuis peint en noir par un barbare qui en a fait une enseigne: A la Tête noire. Cette singulière manie de barbouiller de noir ou d’autre couleur foncée les sculptures en pierre blanche s’est signalée encore tout récemment, au boulevard des Capucines, en déshonorant la belle maison neuve où est établi un grand magasin d’étoffes, A la Ville de Lyon: les deux nymphes, couchées non{92}chalamment sur la console de la porte cochère, œuvre exquise du statuaire Jalley, ont été noircies du plus brillant noir pour cacher leur voluptueuse nudité.
Retournons à nos enseignes d’autrefois et allons chercher dans la grande rue du faubourg Saint-Antoine, nº 187, une autre Tête noire, qui est celle d’un vrai nègre, sculptée en médaillon colorié; une autre encore au nº 44, mais peinte sur bois et qui sert de fétiche à la boutique d’un marchand de meubles. Près de là, dans le même faubourg, nº 26, se trouve le Gryphon, très jolie enseigne sculptée, et tout à côté, le Vaisseau marchand. En revenant vers le centre, dans la rue Saint-Antoine, nous trouvons, au nº 134, une statue de la Truie qui file, en livrant ses mamelles à ses petits pourceaux: cette statue en pierre, qui est sculptée très naïvement, très spirituellement, faisait la joie de nos pères, et il y en avait à Paris trois ou quatre autres, notamment celle de la rue des Poirées, reproduisant la même fileuse avec des variantes de détail. On a conservé aussi, rue de la Tonnellerie, une enseigne, A l’ancienne Renommée, qui est{93} une assez bonne statue, debout sur la boule du monde. Quant au Nègre du boulevard Saint-Martin et au Chinois de
la rue La Fayette, l’un et l’autre ayant des cadrans d’horloge dans le ventre, ils ont été si bien peinturlurés et dorés, qu’on
ne sait pas s’ils sont en pierre ou en zinc, et que nous les regardons comme des joujoux de Nuremberg taillés en plein{94} bois avec un simple couteau par quelque bûcheron artiste de la forêt Noire.
Il y avait jadis en France beaucoup de ces tailleurs de bois, qui faisaient mieux que des enseignes, et qui ne laissaient pas nos églises de village manquer de statues de saints et de saintes, qu’un coloriage intelligent ne déparait pas trop, quand on les avait placées dans leurs niches. C’étaient ces mêmes artistes d’instinct et de sentiment qui élabouraient ces merveilleux triptyques, ces superbes retables qui font encore notre admiration par le nombre, la variété et le caractère des figures qui y sont rassemblées. Quand les travaux d’église vinrent à leur manquer, ils se consacrèrent, malgré eux, à des œuvres profanes. Ils exécutèrent les dernières enseignes sculptées en bois, dans lesquelles ils faisaient quelquefois des images de saints ou des sujets de sainteté, et ils entreprirent aussi de grands ouvrages de boiseries, ornementées, d’après des dessins d’architectes-décorateurs. On verra encore, sur le quai Bourbon, presque au coin de la rue des Deux-Ponts, un curieux modèle de ce travail de sculpteur ornemaniste, dans une devanture de boutique du XVIIIᵉ siècle, très pure de dessin et très élégante, malgré sa simplicité[73].
Quelques bons tailleurs en bois ont trouvé à s’employer, dans ces derniers temps, pour la fabrication de plusieurs enseignes sculptées. On voyait une de ces enseignes, celle d’un charcutier, rue Neuve-des-Petits-Champs, nº 2:{95} A l’Homme de la Roche de Lyon. Nous dirons quel était cet homme, dans le chapitre des anecdotes relatives aux enseignes[74]. M. Poignant a décrit ainsi cette statue[75]: «C’est une statue en bois, de grandeur naturelle, représentant un homme vêtu en chevalier; de la main gauche étendue, il tient une bourse; la droite s’appuie sur une lance. Elle
paraît dater de la Restauration.» M. Poignant cite une autre sculpture d’enseigne, qui date de 1840; ce sont les figurines qui décorent des deux côtés la devanture de la boutique d’un opticien, rue de l’Échelle; l’une représente un officier{96} de marine qui relève le point de latitude avec un sextant; l’autre, un matelot qui regarde avec un télescope. «La justesse du mouvement, dit M. Poignant, la fermeté de l’exécution, font de ces statuettes deux fantaisies artistiques qui ne manquent pas de valeur.» L’enseigne du magasin de nouveautés: Aux Statues de Saint-Jacques, rue Étienne-Marcel, entre les rues aux Ours et Saint-Denis, n’a demandé que de menus frais d’installation; car les statues qui la composent proviennent de l’ancien hôpital de Saint-Jacques-de-Compostelle, fondé en 1298, lequel s’élevait à l’endroit même où l’on vend maintenant aux dames des objets de toilette et de mode. Ces deux statues en habits de pèlerin ne datent pas sans doute de l’origine de l’hôpital, que la Révolution avait fait disparaître; elles sont du XVIᵉ ou du XVIIᵉ siècle. On les trouva presque intactes en creusant les fondations de ce magasin, et le propriétaire, après les avoir fait restaurer en 1854, les plaça comme une enseigne sur l’entablement de la maison qu’il faisait bâtir. On dit que ces vénérables statues lui ont porté bonheur.
Sous le règne de François Iᵉʳ, les artistes italiens que le roi avait amenés en France, et qui travaillaient pour lui à l’hôtel de Nesle et au château de Madrid, eurent l’ingénieuse idée d’encastrer, dans l’architecture des édifices qu’on faisait construire alors à Paris et en province, des émaux et des plaques de faïence représentant des sujets, des emblèmes et des ornements. On employait aussi ces faïences émaillées au carrelage des galeries et des salles dans les châteaux et les hôtels. Il est à peu près certain que ce genre de décoration fut appliqué aux enseignes des marchands, puisqu’on avait fait entrer des inscriptions non seulement sur les grandes{97} pièces de faïence encadrées dans la pierre monumentale, mais encore dans les carreaux qui servaient au pavement intérieur des maisons. Il ne s’est conservé aucune de ces enseignes en faïencerie, mais on peut voir au musée de Cluny quelques-unes des plaques émaillées qui décoraient le château de Madrid, au bois de Boulogne.
Il y avait, cependant, au nº 24 de la rue du Dragon (faubourg Saint-Germain), entre les deux fenêtres du premier étage d’un hôtel garni, une véritable enseigne en émail du XVIᵉ siècle, avec cette légende dans la bordure jaune qui entourait le médaillon: Au fort Samson. Ce médaillon, d’un très beau style, représentait non pas Samson, mais Hercule terrassant le lion de Némée. On l’attribuait{98} à Palissy, et le propriétaire de la maison y avait fait mettre cette inscription: Ancienne demeure de Bernard Palissy en 1575. Le médaillon attira la curiosité des amateurs, et le propriétaire refusait toujours de le vendre, jusqu’à ce que l’offre d’un prix considérable l’eût enfin décidé à le laisser enlever de la place que ce précieux souvenir du grand verrier céramiste avait gardée depuis trois siècles. On l’a remplacé par un médaillon colorié de même dimension représentant une tête d’homme.
Il est certain que l’atelier où Palissy fabriquait ses émaux et rustiques figulines n’était pas éloigné de sa demeure, et cet atelier devint sans doute, sous le règne de Henri IV, la verrerie de Saint-Germain-des-Prés. Le médecin Jean Heroard a écrit dans son Journal, à la date du 4 juin 1666, cette note où il met en scène le Dauphin qui fut Louis XIII: «Il se joue à une petite fontaine faite dans un verre, qui lui venoit d’être donnée par les verriers de la verrerie de Saint-Germain-des-Prés; s’amuse à une vaisselle de poterie, où il y avoit des serpents et des lézards représentés; y faisoit mettre de l’eau, pour les représenter vivants[76].»
Sous le premier Empire, Napoléon avait fait venir d’Italie un groupe d’ouvriers mosaïstes, qui avaient entrepris de fabriquer des enseignes en mosaïque; mais ces essais, coûtant fort cher, furent peu appréciés et ne trouvèrent pas de clientèle. Plus tard, on remplaça la mosaïque en petits cubes de verre émaillé, par des mosaïques en plus gros cubes de pierres de couleur, et l’on en fit des tableaux{99} qu’on incrusta dans le dallage des trottoirs et des passages devant les boutiques. Ce furent les enseignes sur le sol, au lieu des enseignes sur les murs. Ces essais ont été repris récemment sous les galeries du Palais-Royal. Ce n’était pas, du reste, une invention moderne, puisque des mosaïques du même genre sont encore intactes, depuis dix-neuf siècles, dans les maisons antiques d’Herculanum et de Pompéi.{100}
IL y avait, dans le vieux Paris, beaucoup de maisons d’encoignure, construites entre deux rues et s’avançant à angle droit sur une petite place ou un carrefour. L’encoignure de ces maisons, généralement bâties en bois, était formée par une grosse pièce de charpente, simplement équarrie ou sculptée avec plus ou moins de soin, laquelle s’élevait toujours jusqu’au premier étage et quelquefois montait jusqu’à la toiture. Cette pièce de bois s’appelait cornier ou poteau cornier. On comprend que ce poteau, faisant face à une place sur laquelle débouchaient plusieurs rues, était l’endroit le plus favorable pour l’exhibition d’une enseigne, que cette enseigne fût celle d’une maison ou bien celle d’une boutique. Cette enseigne était de différente{101} espèce, selon la fantaisie du propriétaire ou du marchand. Tantôt on y posait une image ou statue de saint, sur un piédestal pendentif ou dans une niche; tantôt on n’y mettait qu’un buste en pierre, ou en bois, ou en plâtre, doré ou colorié de couleurs éclatantes; tantôt on y appendait, à l’extrémité d’une potence en fer, une enseigne ordinaire représentant les armes parlantes d’un commerce ou caractérisant le nom de la maison du coin. On sait combien ces maisons d’encoignure furent recherchées par certaines industries qui s’adressaient directement au bas peuple et aux passants. On peut assurer que l’enseigne en rébus: Au bon Coing, fut une de celles qui répondaient le mieux à la position avantageuse d’un cabaret ou d’une rôtisserie, occupant une maison d’encoignure. C’est ce genre d’enseigne qui est indiqué dans un des articles de l’édit de 1693, relatif aux enseignes de Paris: les bustes, aux maisons en encoignure, indiquant la profession, ne payaient qu’un seul droit de 4 livres. Quant aux maisons d’encoignure où il y avait des images de saint dans des niches, si ces images, devant lesquelles on allumait, la nuit, une lampe ou une lanterne, n’existent plus, leurs niches sont restées vides, en grand nombre, dans les vieux quartiers.
Mais nous ne voyons pas que les ordonnances de police aient distingué nominativement les poteaux corniers, qui étaient de véritables enseignes de maison, enjolivées de sculptures et présentant quelquefois des sujets pieux ou allégoriques qui se déroulaient sur toute la hauteur du poteau ou du pilier. Ils étaient cependant fort nombreux, et, dans notre jeunesse, nous nous rappelons en avoir vu couverts de figures en ronde bosse peintes ou dorées; malheu{102}reusement il n’en subsiste plus, à notre connaissance, qu’un seul dans la rue Saint-Denis, dont nous allons parler tout à l’heure. Il y en avait un, plus curieux que tous les autres, et le plus remarquable par son exécution, comme par le sujet qu’il représentait: c’était celui de la maison des Singes; mais la destruction de ce rare et précieux monument remonte à la fin de l’année 1801.
La Décade philosophique, dans sa livraison du 10 nivôse an X (31 décembre 1801), publiait la note suivante, dont nous ne citons qu’une partie:
«On travaille, à Paris, dans la rue Saint-Honoré, à la démolition d’une ancienne maison, dont on fait remonter la date au XIIᵉ siècle. Elle est construite en bois, à la manière du temps, et a servi plus d’une fois de modèle à nos peintres, lorsqu’ils avaient à traiter des sujets puisés dans l’histoire de France des temps reculés. Le citoyen Vincent l’a représentée dans son beau tableau du président Molé.
»Cette maison a été quelquefois décrite, mais on n’a point fait assez d’attention à un poteau cornier, tout couvert de sculptures, qui forme l’angle de l’édifice. Cependant le sujet qui y est représenté est très curieux. Le lecteur nous saura gré sans doute d’entrer dans quelques détails sur ce poteau que l’on peut regarder comme un monument.
»La masse du poteau a la forme d’un grand arbre, duquel s’élèvent des branches garnies de fruits. On voit plusieurs singes qui cherchent à l’envi à grimper autour, pour atteindre les fruits. Mais un vieux singe, tranquille et tapi au bas de l’arbre, présente d’une main un des fruits que{103} les jeunes ont fait tomber par les secousses qu’ils ont données à l’arbre.
»En parcourant les Fables de La Motte, on en trouve une sur le gouvernement électif, dont la vue du poteau semble lui avoir suggéré l’idée; nous n’en citerons que les derniers vers:
»On voit que c’est absolument la même allégorie que celle représentée sur le poteau cornier. L’architecture de nos pères était sans doute de bien mauvais goût, si nous la comparons à l’architecture actuelle, mais convenons pourtant qu’elle parlait à l’imagination.
»Nous apprenons, à l’instant même, que le gouvernement a donné l’ordre de déposer le poteau cornier au musée des Monuments français.»
Plaignons les vandales révolutionnaires qui ne savaient pas ce qu’ils faisaient. Ils détruisaient là non seulement un monument unique des anciennes enseignes de Paris, mais encore la maison où Molière était né, le 15 janvier 1622.
On connaissait mal en 1801 la maison natale de Molière, qu’on était allé chercher rue de la Tonnellerie, parce que Jean Poquelin, le père de notre grand comique, habitait une maison, qu’il avait achetée seulement en 1633, sous{104} les Piliers des Halles, devant le Pilori, maison qui portait alors pour enseigne l’Image de Saint Christophe. C’est à Beffara que l’on doit la découverte de la véritable maison dans laquelle naquit Molière. «Cette maison, dit Eudore Soulié[77], était connue sous le nom de maison des Cinges, à cause d’une très ancienne sculpture qui la décorait, et elle se trouvait à l’angle des rues Saint-Honoré et des Vieilles-Étuves.» L’extrait d’un manuscrit de la Bibliothèque nationale contenant les noms des propriétaires et locataires des maisons de la rue Saint-Honoré, est venu prouver que Jean Poquelin, malgré l’acquisition de la maison à l’enseigne de Saint-Christophe sous les Piliers des Halles, n’avait pas quitté la maison des Singes, qu’il occupait antérieurement à la naissance de J.-B. Molière, en 1622. C’était là certainement que se trouvait sa boutique de tapissier. Voici l’extrait relatif à cette maison natale de notre illustre parisien: «Année 1637. Maison où pend pour enseigne le Pavillon des Singes, appartenant à M. Moreau et occupée par le sieur Jean Pocquelin, maistre tapissier, et un autre locataire; consistant en un corps d’hôtel, boutique et cour, faisant le coin de la rue des Étuvées (Vieilles-Étuves): taxée huit livres.[78]» On ne nous dit pas si la taxe avait pour objet l’enseigne pendante du Pavillon des Singes, que Jean Poquelin y fit sans doute ajouter, parce que le poteau cornier de la maison ne lui paraissait pas suffire pour annoncer sa boutique de tapissier. On peut croire que cette mai{105}son si curieuse, qui datait du XIIᵉ ou du XIIIᵉ siècle, était représentée, avec son poteau cornier, dans l’enseigne peinte du Pavillon des Singes.
Le poteau cornier de la maison natale de Molière fut donc transporté dans les magasins du musée des Monuments français, mais on ne trouva pas sans doute le moyen de l’utiliser dans l’organisation définitive du musée. On avait bien eu l’idée de reconstruire cette maison, comme un intéressant spécimen de l’architecture en pans de bois du moyen âge; mais les entrepreneurs ou les charpentiers qui travaillaient pour le musée employèrent ce vieux bois sculpté, dans leurs constructions, comme bois de charpente. «Il se perdit là où on avait voulu qu’il se conservât, avons-nous déjà dit dans un de nos ouvrages[79]. Lorsqu’au mois de janvier 1828, Beffara voulut le voir et le faire dessiner, on lui répondit qu’il avait été détruit et employé dans les bâtiments[80].» On trouvera, à la page 27 du tome III du Musée des Monuments français, par Alexandre Lenoir, une gravure au trait de ce poteau cornier, dessinée par Bureau et gravée par Guyot. Une autre gravure, à l’eau-forte, par Chauvel, a été publiée dans le Moliériste (juillet 1879), avec un intéressant article de M. Romain Boulenger.
Nous avions remarqué autrefois, avons-nous dit il n’y a qu’un instant, dans des maisons d’encoignure, un certain{106} nombre de poteaux corniers qui représentaient des sujets allégoriques ou religieux, entre autres la généalogie de la famille du roi David, commençant à son père Isaïe et finissant à son dernier descendant Jésus-Christ. On appelait ces poteaux des arbres de Jessé, mais ils ont tous été détruits, croyons-nous, avec les diverses maisons dont ils formaient l’enseigne, à l’exception d’un seul, cité par Viollet-le-Duc dans son Dictionnaire raisonné de l’Architecture française, situé au coin d’une maison qui faisait l’angle de la rue Saint-Denis et de celle des Prêcheurs: «Ces poteaux corniers sont souvent façonnés avec soin, ornés de sculptures, de profils, de statuettes, choisis dans les brins les plus beaux et les plus sains. On voit encore des poteaux corniers, bien travaillés, dans certaines maisons de Rouen, de Chartres, de Beauvais, de Sens, de Reims, d’Angers, d’Orléans. On en voit encore un, représentant l’Arbre de Jessé, à l’angle d’une maison de la rue Saint-Denis, à Paris, datant du commencement du XVIᵉ siècle[81].» Cet arbre de Jessé, de grande dimension, monte jusqu’au faîte de la maison.
LES corporations de métier remontaient à la plus haute antiquité, puisque les artisans et les marchands de l’ancienne France étaient groupés par associations distinctes, ayant leurs statuts et leur organisation spéciale, avec des insignes et des costumes particuliers. Le même état de choses a dû exister, dès les premiers temps de l’ancien Paris, lorsque Lutèce, après la conquête des Gaules par Jules César, devint une ville gallo-romaine; mais les renseignements historiques font défaut à ce sujet, jusqu’au XIIᵉ ou XIIIᵉ siècle, là où apparaissent de rares et incertains documents sur l’histoire des enseignes. Si, comme nous le supposons, les enseignes, au XIIᵉ siècle, n’étaient que les insignes des métiers, ces insignes ou en{108}seignes devaient être distribués, comme des armes parlantes ou des indications figurées, entre les différentes rues consacrées aux métiers et qui en portaient les noms. Mais déjà, à cette époque reculée, telle rue, qui conservait un nom de métier et, par conséquent, de corporation, avait laissé s’échapper et se transporter ailleurs la plupart des artisans ou des marchands, qui, ne pouvant plus trouver assez de place pour leur commerce ou leur industrie dans la rue où avait été originairement concentré ce commerce ou cette industrie, s’étaient répandus, de proche en proche, dans les rues voisines et dans tous les quartiers de la ville. Ainsi, nous ne doutons pas que primitivement la rue affectée à un métier et qui lui devait une dénomination usuelle n’ait eu, à chacune de ses extrémités, une enseigne unique caractérisant le métier, lequel y avait pris naissance, et qui l’avait, pour ainsi dire, baptisée.
Mais ces rues, dans lesquelles chaque métier avait été centralisé dès l’origine[82], n’étaient déjà plus, à la fin du XIIIᵉ siècle, réservées exclusivement aux métiers dont elles gardaient le nom. Nous en trouvons la preuve incontestable dans la Taille de 1292: la rue de la Saunerie n’avait plus qu’un saunier, sur onze sauniers qui demeuraient alors à Paris; la rue de la Charronnerie, trois charrons sur dix-huit; la rue de la Ferronnerie, deux ferrons sur onze; la rue de la Savonnerie, trois savonniers sur huit; la rue des Plâtriers, un plâtrier sur trente-six; la rue de la Poulaillerie, onze poulaillers sur trente-six; la rue de la Pelleterie, quatre{109} pelletiers sur deux cent quatorze; la rue de la Sellerie, vingt-cinq selliers sur cinquante et un; la rue de la Petite-Bouclerie, quinze boucliers, ou fabricants de boucles, sur cinquante et un; la rue de la Barillerie, un barillier sur soixante et dix; la rue de la Buffeterie, pas un seul buffetier ou marchand de vin sur cinquante-six; la rue des Écrivains, un écrivain sur vingt-quatre, etc. Ce tableau comparatif prouve d’une manière incontestable que les métiers avaient abandonné leur centre natif et s’étaient dispersés dans Paris, ce qui semblerait indiquer la nécessité des enseignes individuelles pour les gens de métier qui s’éloignaient du quartier général de leur commerce. Cependant, à cette époque, les enseignes des maisons et des boutiques étaient à peine employées. Le savant M. Franklin n’en parle même pas, en décrivant les rues de Paris au XIIIᵉ siècle: «Les marchands, dit-il, se retrouvaient, au seuil de leurs sombres boutiques, guettant les passants et s’efforçant, par mille moyens, d’attirer leur attention; aussi les règlements de police leur interdisaient-ils d’appeler l’acheteur avant qu’il eût quitté la boutique voisine. Les marchandises étaient étalées devant la fenêtre, sur une tablette faisant saillie au dehors; un auvent de bois, accroché en l’air, protégeait les chalands contre la pluie.» Guillot de Paris, en effet, ne fait aucune allusion aux enseignes, dans son Dit des Rues de Paris, composé et rimé en 1300[83].
Il est bien certain, toutefois, que les corporations, les communautés et les confréries de métier existaient alors,{110} avec leurs bannières, qui n’étaient, à vrai dire, que des enseignes portatives, puisque chacune représentait les armoiries ou le patron, le saint protecteur de la corporation, de la communauté ou de la confrérie. La corporation comprenait l’ensemble de tous les artisans d’un même métier, maîtres, compagnons et apprentis; la communauté n’était qu’un groupement charitable et religieux d’une partie de ces artisans, en vue d’un travail localisé ou d’une œuvre collective; la confrérie était l’association fraternelle de tous les membres de la corporation, vis-à-vis de l’Église et de la société civile. L’enseigne, qui n’était encore que l’insigne public des trois fractions d’un même corps de marchands, avait passé, de la bannière que l’on portait, dans toutes les cérémonies publiques, en tête de la corporation ou de la confrérie, aux écussons des flambeaux, qui ne servaient que pour les enterrements des associés; le même insigne reparaissait sur les médailles à l’effigie du saint patron, sur les jetons de présence aux assemblées de la confrérie et sur les enseignes de pèlerinage, qui s’attachaient au chapeau ou à la coiffure de chaque confrère. Ce fut là l’enseigne patronale, que les maîtres de la corporation faisaient placer en sculpture ou accrocher en peinture à la porte de leurs maisons. Ce furent là, en dehors des nombreux insignes de saints indiquant l’invocation d’un patronage particulier, les maisons qu’on distinguait sous le nom de maisons de l’enseigne de tel saint ou de telle sainte. On ne les trouve ainsi indiquées qu’à partir du XIVᵉ siècle, où elles ne cessèrent plus de se multiplier jusqu’en 1600.
Voici maintenant quelles étaient les principales corpo{111}rations et confréries qui avaient des maisons à enseigne[84]: Saint Yves: les avocats et les procureurs.—Saint Antoine: les vanniers, les bouchers, les charcutiers et les faïenciers.—Saint Michel: les boulangers et les pâtissiers.—Saint Éloi: les orfèvres, les bourreliers, les carrossiers, les ferblantiers, les forgerons et les maréchaux ferrants.—Saint Laurent: les cabaretiers et les cuisiniers.—Sainte Barbe: les artilleurs et les salpêtriers.—Saint Simon et Saint Jude: les corroyeurs et les tanneurs.—Saint Joseph: les charpentiers.—Sainte Catherine: les charrons.—Saint Cosme et Saint Damien: les chirurgiens.—Saint Crépin et Saint Crépinien: les cordonniers et les bottiers.—Saint Jacques: les chapeliers.—Saint Blaise: les drapiers.—Saint Gilles: les éperonniers.—Saint Maurice: les fripiers et les teinturiers.—Saint Clair: les lanterniers et les verriers.—Saint Louis: les maquignons et les barbiers.—Saint Nicolas: les mariniers, les épiciers.—Sainte Anne: les menuisiers, les tourneurs et les peigniers.—Saint Martin: les meuniers.—Sainte Cécile: les musiciens.—Saint Roch: les paveurs.—Saint Pierre: les serruriers.—Sainte Marie-Madeleine: les tonneliers.—Saint Vincent: les vinaigriers.
Quelques métiers avaient mis leurs confréries sous les auspices de certaines grandes fêtes de l’Église. Par exemple: les tailleurs célébraient leur fête patronale à la Trinité et à la Nativité de la Vierge; les chandeliers et les{112} épiciers, à la Purification; les couvreurs, à l’Ascension; les rôtisseurs, à l’Assomption, etc.
On s’explique ainsi combien il y avait de maisons à l’image de Notre-Dame. Nous n’en ferons pas le relevé, dans la Topographie générale du vieux Paris, par Adolphe Berty, mais nous croyons intéressant de rechercher, dans les trois premiers volumes de ce grand ouvrage, la plupart des maisons qui eurent des images de saint et de sainte pour enseignes, avec les dates que l’auteur avait soigneusement recueillies dans les Archives de la ville de Paris[85]. On remarquera que, sauf quelques exceptions, ces maisons à image sont du XVᵉ et du XVIᵉ siècle. Nous commençons par dépouiller les deux articles de Berty sur Trois Ilots de la Cité[86].
CITÉ. RUE DE LA JUIVERIE. Saint Pierre, 1455.—Saint Michel, 1600.—Sainte Catherine, 1503.—Saint Julien, 1575.—Saint Nicolas, 1519.—Saint Jacques, 1415.—Saint Pierre, 1430.—Saint Christophe, 1528.—Sainte Marguerite, 1502.
RUE AUX FÈVES. Saint Antoine, 1574.—Saint Jean-Baptiste, XVᵉ siècle.
RUE DE LA CALANDRE. Images Saint Marcel et Sainte Geneviève, 1507.—Saint Christophe, 1385.—Saint Nicolas, 1450.
RUE DE LA LICORNE. Image Notre-Dame, 1525.{113}
RUE DE LA LANTERNE. Image Sainte Barbe, 1534.—Saint Yves, 1513.
QUARTIER DU LOUVRE. RUE CHAMPFLORY. Image du Saint-Esprit, 1489.—Saint Nicolas, 1489.—Notre-Dame, 1575.—Saint Eustache, 1530.—Saint Julien, 1624.
RUE DU CHANTRE. Image Sainte Anne, 1687.—Saint Claude, 1687.—Sainte Barbe, 1515.—Sainte Geneviève, 1603.
RUE DU COQ. Image Saint Martin, 1440.—Saint François, 1687.—Notre-Dame, 1687.—Saint Jacques, 1687.
RUE FROMENTEAU. Image Saint Hugues, 1582.—Notre-Dame, 1427.—Saint-Béal, 1550.—Notre-Dame, 1567.—Saint Louis, 1491.—Saint Simon et Saint Jude, 1550.—Saint Jacques, 1700.—Saint Nicolas, 1477.—Saint Jacques, 1406.
RUE SAINT-HONORÉ. Image Saint Jean-Baptiste, 1489.—Saint Claude, 1637.—Saint Martin, 1378.—Saint Jacques, 1508.—Saint Jean, 1408.—Notre-Dame, 1489.—Sainte Barbe, 1530.—Saint Michel, 1439.
RUE SAINT-JEAN-SAINT-DENIS. Image Saint Jean, 1700.—Sainte Geneviève, 1623.—Saint Louis, 1603.—Saint Claude, 1603.—Saint François, 1700.
RUE SAINT-THOMAS-DU-LOUVRE. Image Saint Jacques, 1450.—Sainte Anne, 1575.
QUARTIER DU BOURG SAINT-GERMAIN. RUE DES BOUCHERIES. Image Saint Jacques, 1467.—Saint Michel, 1420.—Sainte Catherine, 1429.—Saint Jacques, 1319.—Saint Jean, 1509.—Saint Pierre, 1411.—Sainte Marguerite, 1595.—Saint François, 1522.—Saint Martin,{114} 1523.—Saint Antoine, 1523.—Sainte Geneviève, 1435.—Saint Nicolas, 1475.
RUE DE BUSSY. Image Saint Claude, 1535.
RUE DES CANETTES. Image Notre-Dame, 1446.
Ces images de Notre-Dame, de saints et de saintes étaient, pour la plupart, les enseignes des maisons appartenant à des membres de corporation et de confrérie, ou louées et habitées par eux. Les confréries furent supprimées et abolies, à plusieurs reprises, pendant le XVIᵉ siècle, mais on les rétablit sur de nouvelles bases, et elles continuèrent à subsister en conservant toujours les mêmes patrons, qui n’avaient pas quitté leurs enseignes. Les corporations furent changées en jurandes, sous le règne de Louis XVI, pour donner satisfaction aux économistes du XVIIIᵉ siècle; mais ces réformateurs impitoyables dédaignèrent de faire la guerre aux saints et aux saintes, qui avaient été, durant plus de quatre siècles, les gardiens respectés des métiers et de la marchandise. Les enseignes qui rappelaient ces saints patrons ne disparurent que pendant la Révolution, ce qui ne les empêcha pas de reparaître plus tard dans toute leur gloire sur les enseignes. Mais c’en était fait des corporations, des communautés et des confréries, qui n’avaient pas laissé d’autres traces que ces enseignes commémoratives, que les artisans et les marchands eux-mêmes ne comprenaient plus.
Les confréries marchandes, dont l’histoire est encore à faire, car le rarissime Calendrier des Confréries de Paris, par J.-B. Le Masson, ne nous en offre qu’une nomenclature très abondante, ces confréries avaient chacune des administrateurs, des officiers, des revenus, des rentes et des pro{115}priétés. Elles avaient aussi, outre leurs bannières à l’image du saint patron ou portant leurs armoiries, des enseignes grotesques ou plaisantes, pour les maisons où elles tenaient leur siège et leur bureau. La fameuse Truie qui file était une de ces enseignes de confréries. «Celle de la Truie qui file, qu’on voit à une maison du marché aux Poirées, rebâtie depuis peu, dit Sauval[87], est plus remarquable et plus fameuse par les folies que les garçons de boutique des environs y font à la mi-carême, comme étant sans doute un reste du paganisme.»
Mais Sauval ne nous dit pas quelles étaient ces folies[88]. L’enseigne des Sonneurs des Trépassés était aussi une enseigne de confrérie, enseigne peu décente à une époque où l’on sonnait dans les rues la mort des bourgeois de Paris. Cette enseigne en rébus représentait une pluie de sous neufs et brillants, tombant sur des poulets tués[89]. La maison où pendait cette enseigne (Sauval ne nous dit pas où elle était placée) servait sans doute aux joyeux repas de la confrérie. C’est aussi dans les Comptes de la Prévôté de Paris, publiés à la suite de l’ouvrage de Sauval, que nous trouvons quelques indications sur les confréries et sur{116} leurs maisons. La confrérie de la Madeleine, fondée en l’église Saint-Eustache, touchait, en 1421, dix sols parisis de rente sur une maison de la rue Montorgueil, qui avait appartenu à maître Jean de la Croix.
La confrérie aux Bourgeois, qu’on appelait la Grande Confrérie, était la plus riche des confréries de Paris. Voici la mention de deux maisons qui lui appartenaient en 1448 et en 1450: «Maison scise rue de la Cossonnerie, à l’enseigne Saint Michel, qui fut à la grande Confrairie aux Bourgeois de la ville de Paris, donnée à rente par Mᵉ Girard Gehe, curé de Saint-Cosme, abbé de ladite grande Confrairie; Mᵉ Pierre de Breban, conseiller du roi en sa Chambre des Généraux, doyen de ladite confrairie; sire Michel Culdoë, bourgeois de Paris, prévost d’icelle grande Confrairie, pour quatre livres parisis de rente.» Cette note nous apprend que la confrérie avait à sa tête un abbé, un doyen et un prévôt. Ce furent ces officiers qui vendirent, en 1450, une des maisons de leur confrérie: «Maison scise rue Saint-Denys, à l’enseigne du Cocq blanc, scise entre les rues Perrin-Gasselin et de la Tabletterie, vendue par les abbé, doyen et prévost de la confrairie aux Bourgeois de la ville de Paris, pour quatre livres parisis de rente.» Citons encore une autre confrérie qui avait une maison à enseigne antérieurement à l’année 1463: «Maison scise en la Vieille-Tixeranderie, faisant le coin d’une petite ruelle par laquelle on va de ladite rue de la Vieille-Tixeranderie au Martroy Saint-Jean, tenant d’une part à un Hostel, où jadis souloit pendre l’enseigne de la Heuse (la botte), qui appartient à la confrairie de la Conception Nostre-Dame aux marchands et vendeurs de vin{117} à Paris, fondée en l’église Saint-Gervais, et qui à présent appartient à Jean Raguier[90].» Un dernier souvenir peu édifiant des anciennes confréries parisiennes; c’est encore Sauval qui nous le fournira: «Croiroit-on bien qu’au Saint-Esprit (à l’hôpital du Saint-Esprit, qui attenait alors à l’Hôtel de ville), il y a une confrérie de Notre-Dame de Liesse, fort riche et composée de gens à leur aise, mais de condition médiocre, qui n’y admettent personne qu’à condition de leur faire un grand festin et qui dissipent en banquets fort fréquens les richesses que leurs devanciers n’avoient amassées que pour mieux honorer Dieu et faire des aumônes? Aussi y a-t-il presse à être leur traiteur, et n’en prennent-ils point qui n’ait le goût friand, et à cause de cela est perpétuel et bien payé. Les compagnons d’entre eux n’appellent point autrement leur confrérie, que la Confrérie des Goulus[91].»
Les enseignes professionnelles des métiers devaient être fort nombreuses dès le XIVᵉ siècle; mais, comme elles dépendaient presque exclusivement des boutiques, elles n’ont pas été indiquées dans les documents relatifs aux immeubles; car ces sortes d’enseignes suivaient toutes les vicissitudes d’un commerce qui les amenait et les emportait avec lui. Ainsi, nous ne trouvons qu’un petit nombre d’enseignes de métier, dans les curieuses recherches de Berty sur les quartiers de la Cité, du Louvre et du bourg Saint-Germain. Par exemple, rue de la Juiverie, la Heuse, ou la Botte, XVᵉ siècle, et la Chausse de Flandre, 1450; rue du Four-Basset, le Gland d’or, 1600, et le Heaume, 1429; devant{118} Saint-Nicolas-des-Champs, le Pesteil ou le Pilon, 1395; rue Saint-Honoré, l’Éperon d’or, 1603; rue Champfleuri, les Deux Coignées, 1451; le Heaume, 1378; le Rabot, 1572; la Pelle, 1410, etc.
Les marchands, ou vendeurs proprement dits, qui ne fabriquaient pas leur marchandise, tels que les drapiers, les épiciers, les pelletiers, les lingers, etc., préféraient des enseignes de fantaisie, qui convenaient également à toute espèce de commerce et qui ne caractérisaient pas spécialement leur profession. De là les Bras d’or, les Barbes d’or, les Soleils d’or, les Étoiles d’or, les Escharpes d’or, etc., qui prouvaient surtout que l’or sous toutes ses formes avait les préférences du commerce.
Les enseignes de boutique et d’ouvroir étaient de dimension généralement modeste, avant le XVIIᵉ siècle, quand elles devaient prendre place au-dessus de la porte d’entrée de la boutique et, par conséquent, sous l’auvent. Le système des armes parlantes convenait le mieux à la plupart des métiers et des industries, car c’était là l’indication la plus naturelle et la plus simple de chaque genre de fabrique et de vente: il suffisait de la représentation figurée d’un pot ou d’un plat d’étain pour annoncer l’ouvroir d’un ferblantier; rien n’indiquait mieux la boutique d’un chapelier qu’un chapeau; la boutique d’un bonnetier, qu’un bonnet; la boutique d’un serrurier, qu’une clé. Mais, au XVIIᵉ siècle, tous ces attributs de métier prirent des proportions exagérées et bientôt monstrueuses: «Ces enseignes, dit Mercier[92], avoient pour la plupart un volume colossal et en relief; elles donnoient{119} l’image d’un peuple gigantesque, aux yeux du peuple le plus rabougri de l’Europe. On voyoit une garde d’épée de six pieds de haut, une botte grosse comme un muids, un éperon large comme une roue de carrosse, un gant qui auroit logé un enfant de trois ans dans chaque doigt; des têtes monstrueuses; des bras armés d’un fleuret, qui occupoient toute la longueur de la rue[93].» La plupart de ces objets, que l’orgueil du marchand grossissait à l’envi, pendaient à de longues potences en fer et oscillaient dans l’air, au gré du vent, en jetant, la nuit, de larges ombres qui rendaient nulle la faible clarté des lanternes. Ce fut l’ordonnance de police du mois de novembre 1669 qui obligea tous les gens de boutique à réduire leurs enseignes à la même dimension, «13 pieds et demi, depuis le pavé de la rue jusqu’à la partie inférieure du tableau, qui n’auroit que 18 pieds de largeur sur 2 pieds de haut.» Les potences, auxquelles les tableaux d’enseigne devaient être accrochés, furent aussi réduites à des dimensions uniformes. Le modèle de ces potences nous a même été conservé, dans le Traité de la Police de Delamarre (liv. XI, tit. IX), avec l’adresse du fabricant privilégié, qui fournissait les ferrements, moyennant le prix de 17 livres; c’était le sieur Nicolas de Lobel, serrurier du roi, rue Coquillière, proche Saint-Eustache, vis-à-vis la rue des Vieux-Augustins.{120}
Tant que La Reynie fut lieutenant général de police, on respecta ses ordonnances, et les enseignes restèrent soumises au règlement qui avait diminué considérablement leurs dimensions: «Les enseignes n’obstruent plus les rues, écrivait le docteur anglais Lister dans son Voyage à Paris en 1698, et font, grâce à leur petitesse ou à leur élévation, aussi peu de figure que s’il n’y en avait point.» Mais un siècle après l’ordonnance de 1669, il n’était plus question de la police des enseignes, qui avaient repris des proportions énormes, aussi gênantes que dangereuses pour le public, eu égard au peu de largeur des rues et à la hauteur excessive des maisons. Il fallut l’ordonnance de police de M. de Sartine, du 27 décembre 1761, pour forcer les marchands à supprimer les potences «et tous les massifs et reliefs servant d’enseignes, pour les convertir en tableaux appliqués sur les murs, en suivant les dimensions obligées.» Cette ordonnance, mise à exécution dans le plus court délai et maintenue avec rigueur, eut pour objet de faire rentrer dans le néant la ridicule et hideuse fantasmagorie des enseignes de métier[94].{121}
ON peut affirmer, sans essayer de le prouver par des documents certains, que, dès les premiers temps du moyen âge, les hôtelleries et les auberges de Paris avaient des enseignes, comme dans tout le monde romain; car il est impossible de supposer l’existence d’un asile de jour et de nuit pour les voyageurs, sans un signe distinctif, sans une enseigne annonçant à l’extérieur la maison hospitalière qui attend des hôtes étrangers et qui leur offre à toute heure le gîte et la nourriture. Cette enseigne n’était peut-être qu’une branche d’arbre, ou bien une couronne de feuillage, ou bien un bouchon de paille, ou bien tout autre objet indicateur, mais ce devait être un signe spécial et généralement admis, qui permettait à tout individu arri{122}vant dans une ville ou dans un pays sans y connaître personne et sans en savoir la langue, de trouver là, moyennant pécune, à se loger et à vivre. On peut dire avec certitude que la plus ancienne enseigne a été celle d’une hôtellerie. Cependant nous ne citerons pas d’enseigne d’hôtellerie, à Paris, antérieurement à 1302. Ce fut en cette année 1302 que l’adroite faussaire flamande Jeanne de Divion, complice de Robert d’Artois, qui disputait à sa tante Mahaut la succession du comté d’Artois, vint descendre à l’hôtellerie de l’Aigle, dans la rue Saint-Antoine, pour y préparer en secret de faux actes destinés à servir les machinations de son patron[95]. Cette hôtellerie, dépendant des propriétés de l’abbaye de Saint-Maur-des-Fossés et située près de la porte Baudoyer, avait pour enseigne l’Aigle, qui rappelait peut-être qu’un camp romain, Castrum Bagaudarum, occupait jadis la place de Saint-Maur-des-Fossés.
Il faut aller à la fin du XIVᵉ siècle pour trouver à Paris les noms des enseignes de deux autres hôtelleries; elles avaient laissé d’excellents souvenirs au poète Eustache Deschamps, qui les regrettait, en les comparant aux auberges d’Allemagne, où l’on faisait maigre chère. Voici quelques vers de sa ballade sur les ennuis du séjour d’Allemagne:
La Cossonnerie ou Coqçonnerie était la poulaillerie des Halles, le marché au gibier et à la volaille. Il a laissé son nom à la rue où il se tenait[96]. Monstrelet, dans ses Chroniques, cite quatre bonnes hôtelleries parisiennes, sous le règne de Charles VI: l’hôtel à l’enseigne de l’Épée, rue Saint-Denis; l’hôtel de l’Ours, à la porte Baudet ou Baudoyer; le logis de l’Arbre-Sec, rue de l’Arbre-Sec, et l’hôtel de la Fleur de lys, près le Pont-Neuf[97]. Il y avait, dans le même temps, une hôtellerie non moins renommée, à l’enseigne du Château de fétu (château de paille?), situé dans une partie de la rue Saint-Honoré, appelée alors rue du Château-Fétu, et qui s’étendait depuis la rue Tirechappe jusqu’à la Croix du Tiroir[98]. On lit dans la Chronique de Froissart[99]: «Si descendirent les chevaliers d’Angleterre, messire Thomas de Percy et les autres, en la rue qu’on dit la Croix-du-Tirouer, à l’enseigne de Château de fétu.» Cette hôtellerie devait être assez importante, pour que des seigneurs de si haut parage vinssent y loger avec tout leur train; aussi, lorsque les Anglais se furent emparés de la ville de Paris, au nom du roi d’Angleterre Henri V, avant la mort de Charles VI, le Château de fétu fut compris dans les confiscations domaniales de l’occupation anglaise.
On peut se faire une idée de l’état confortable de certaines hôtelleries, dès ces époques reculées, lorsqu’on voit les{124} ambassadeurs des souverains étrangers loger dans ces hôtelleries, avec une nombreuse suite d’officiers, de valets et de chevaux. Sous le règne de Louis XII, en 1500, les ambassadeurs de l’empereur Maximilien, en arrivant à Paris, furent conduits, par le prévôt des marchands et les échevins, dans la rue de la Huchette, à la maison de l’Ange, «qui étoit fort belle pour ces temps-là, dit Sauval, et là, ils étoient défrayés de tout aux dépens de la ville». En 1552, sous le règne de Henri II, un ambassadeur du roi d’Alger étant venu trouver le roi de France à Châlons, avec des chevaux et des juments arabes, le roi écrivit au prévôt des marchands pour lui ordonner de recevoir très honorablement cet ambassadeur et de «lui montrer tout ce qu’il avoit envie de voir à Paris... Quelques jours après, dit Sauval, cet ambassadeur descendit à la rue de la Huchette, à l’hôtellerie de l’Ange[100].» Le prévôt des marchands et les échevins allèrent en grande pompe lui faire la révérence et lui donnèrent, pour le garder, une escorte d’arbalétriers de la Ville, qui veillaient jour et nuit à la porte de son logis, pour empêcher le peuple d’entrer dans l’hôtellerie.
S’il y avait alors un certain nombre de belles et opulentes hôtelleries, où descendaient les voyageurs de distinction qui se rendaient à Paris, de tous les points du monde, pour visiter cette grande capitale, qui passait pour la ville la plus curieuse et la plus intéressante de l’Europe, Paris renfermait une multitude d’auberges de bas étage, espèces de coupe-gorge et repaires de malfaiteurs, où la police allait{125} ramasser le gibier de potence, qui peuplait les prisons du Châtelet avant de faire l’ornement des gibets de la place de Grève. Les Registres criminels du Châtelet, à la fin du XIVᵉ siècle, citent une foule d’enseignes de ces tavernes, où l’on tuait, où l’on volait sans cesse les marchands qui avaient le malheur de s’y être arrêtés pour passer la nuit[101]. Parmi celles de ces enseignes mal famées qui reviennent le plus fréquemment sous la plume du greffier Alleaume Cachemare, on remarque l’Écrevisse, place Baudoyer; l’Écu de Saint-Georges, rue de la Harpe, et surtout l’Écu de France, rue de la Truanderie. L’auberge du Plat d’étain, située au bas de la rue Saint-Jacques, était aussi un des mauvais lieux où les archers du prévôt de Paris faisaient les plus fructueuses captures pour la justice criminelle du Châtelet. L’hôtellerie du Pestel (le pilon), dans la rue de la Mortellerie, théâtre ordinaire des repues franches de la bande du poète Villon, rassemblait ces joyeux compagnons qui revenaient de la maraude, tout chargés de victuailles qu’ils avaient dérobées chez les marchands[102]. Villon n’a pas omis de célébrer, dans son Grand Testament, ce repaire de voleurs:
Il y eut de tout temps des hôtelleries de cette espèce, que nous appelons maintenant des garnis et qui conservent{126} encore, sous ce nom-là, les traditions de la race des gens de pince et de croc, comme ils se qualifiaient eux-mêmes à l’époque de Villon. Ces garnis de bas étage n’étaient souvent que des maisons de débauche, tel que celui représenté dans la ballade où Villon décrit ses honteuses amours avec la grosse Margot. Cette ballade, affreusement pittoresque, eut assez de célébrité parmi les souteneurs de filles et les piliers de mauvais lieux, pour qu’une hôtellerie de la rue Cloche-Perce se soit donné l’enseigne de la Grosse Margot, qui subsistait encore à la fin du XVIIᵉ siècle[103]. Du reste, il y avait dès lors, comme à présent, des hôtelleries, des auberges, des garnis, pour toute sorte de clientèle, suivant le proverbe du temps: Telle hôtellerie, telles gens. Il y avait même des hôtelleries spéciales pour les voleurs de profession, vagabonds et gens sans aveu: la maison de l’Enseigne verte, dans la rue Saint-Denis, était une de ces hôtelleries signalées aux recherches des limiers du lieutenant général de la police[104].
Aucune de ces anciennes hôtelleries où les voyageurs, les marchands étrangers venaient loger à pied ou à cheval, n’existe plus sans doute à Paris, du moins avec son caractère et son aspect d’autrefois; mais nous en trouvons la description plus ou moins complète dans quelques vieux livres, comme le Roman comique de Scarron, et dans quelques relations de voyageurs, comme le Journal de deux Hollandais à Paris en 1657-58. On en a un tableau exact et fort curieux dans une enseigne de marchand de vin qu’on voyait naguère{127} au quai du Marché-Neuf et qui représentait une vieille auberge, située près de l’ancienne boucherie du Marché Neuf, construite ad hoc au XVIᵉ siècle, et démolie en 1804 pour faire place à la Morgue, que les dernières transformations du quai de la Cité ont fait aussi disparaître.
Une petite pièce rimée du XVᵉ siècle, intitulée le Pèlerin passant, nous fait connaître quelles étaient les principales hôtelleries du temps de Louis XI ou de Charles VIII. Cette pièce est un monologue, que débitait, dit-on, sur le théâtre, un seul acteur, et qui servait d’intermède entre une farce et une moralité. L’auteur, ou peut-être l’acteur lui-même, se nommait Pierre Taherie[105]. Le Pèlerin passant, c’est-à-dire le voyageur, en arrivant à Paris, descend à l’Écu de France, qui était une hôtellerie assez convenable; mais il ne nous{128} dit pas où elle se trouvait située, et il ne donne pas davantage l’adresse des autres auberges, qu’il va chercher ensuite dans différents quartiers. Notre voyageur, jugeant qu’il dépense trop à l’Écu de France, s’en va demander gîte à l’Écu de Bretagne, dont l’hôtesse, dame de bien, de noble race et bien famée, ne reçoit que des gens de son pays. Le Pèlerin se présente successivement à l’Ancre et à l’Écu d’Alençon, sans pouvoir tomber d’accord sur le prix de son hébergement. Il s’arrête enfin au Chapeau rouge et se félicite d’avoir rencontré la meilleure hôtellerie de la ville, du moins à en croire les apparences:
Mais le difficile était d’y avoir une chambre; on y voyait une foule de gens
Notre Pèlerin n’a pas la même patience; il va frapper à la porte de l’Écu d’Orléans, mais la porte était close et la maison déserte. L’hôte avait quitté son métier pour entrer au service du roi. Force est donc de chercher gîte ailleurs et au plus proche; c’est à l’Écu de Bourbon que le Pèlerin espère le trouver: c’était
Notre voyageur, qui a l’estomac vide, se hâte de se trans{129}porter à l’Écu de Châteaudun. Pas de chance; l’hôtellerie est pleine, et tout ce qu’il peut obtenir, c’est la repue (le dîner ou le souper). Enfin il est admis à l’Écu de Calabre pour y passer la nuit. Il y fut assez mal, puisqu’il en partit le lendemain dans l’espoir de trouver mieux; il ne fut pas plus heureux, dit-il:
Mais il n’y resta pas longtemps, car cet aubergiste phénomène vint à mourir, et la bourse du Pèlerin passant étant presque épuisée, il résolut de retourner chez lui et s’embarqua sur un bateau qui descendait la Seine pour faire escale à Saint-Ouen; là, il logea dans une auberge riveraine, au Port Saint-Ouen, où sans doute on lui fit crédit; le lendemain, il voulut se faire héberger dans une autre auberge, au Port Saint-Jore:
Était-ce encore une auberge de village ou une maison hospitalière, dans laquelle le pauvre pèlerin trouva un asile sans bourse délier?
Il ressort du monologue de Pierre Taherie que les hôtelleries, au XVᵉ siècle, avaient ordinairement pour enseigne l’écu d’armoiries d’un pays ou d’un haut et puis{130}sant seigneur. Nous avons donné ailleurs la raison de ce vieil usage, qui persiste encore dans quelques villes de France: «La raison en est, disions-nous[106], dans l’appel que les hôteliers pouvaient faire ainsi à tous les nouveaux arrivés d’un même pays, joyeux de venir prendre gîte sous le patronage du nom de la province, et de se donner pour point de ralliement l’enseigne portant les armes de leur seigneur.» Cet usage paraît avoir changé dans le cours du XVIᵉ siècle, car le maréchal de Vieilleville dit, dans ses Mémoires, que les enseignes des hôtelleries sont «au nom des saints et saintes»[107].
Ces images de saints et de saintes furent remplacées par des croix, lorsque le protestantisme eut mis à l’index les saints et les saintes. On comprend que les hôtelleries, ouvertes à tout le monde, sans distinction de croyance religieuse, devaient éviter d’éloigner le voyageur, à la seule inspection de leurs enseignes. Les images de saints furent remplacées par des croix, qui n’inquiétaient alors la religion de personne. Il y eut aussitôt des croix de tous les métaux et de toutes les couleurs: Croix d’or, d’argent, de fer, de cuivre; Croix blanche, rouge, noire, etc. La couleur verte étant vue de mauvais œil, à cause du Bonnet vert, qui avait fait considérer le vert comme la couleur emblématique des faussaires et des filous, nous doutons fort que les honnêtes gens allassent loger volontiers à l’hôtel du Val de Gallye ou de la Croix verte; mais{131} Richelet, dans la préface de son Dictionnaire françois, nous apprend que la meilleure hôtellerie du XVIIᵉ siècle était celle de la Croix d’or.
Les voyageurs qui voulaient voir Paris et y faire un séjour plus ou moins prolongé étaient assez nombreux pour assurer un bon revenu aux hôtelleries où ils venaient descendre; aussi ces hôtelleries avaient-elles pour enseignes les noms des grandes villes étrangères. Deux gentilshommes de Hollande, qui firent un voyage à Paris en 1657[108], allaient prendre leurs repas dans une auberge de cette espèce: «On y traitoit assez mal, disent-ils, et c’estoit une de celles où il ne va que des estrangers: aussi a-t-elle pour enseigne la Ville de Hambourg. Il y avoit sept ou huit Allemands assez bien faicts, et nous nous estonnasmes qu’ils souffrissent qu’on leur fist si pauvre chère. La pluspart de ces messieurs s’attroupent aux païs estrangers et s’adressent et se logent chez ceux de leur nation. Par le premier, ils ne profitent guère et ne connoissent que peu ou point la nation qu’ils visitent, et par le second, ils sont trompez et maltraitez de ceux de leur nation dont ils se servent, qui abusent du peu de connoissance qu’ils ont du païs où ils sont.»
Ces Hollandais, à leur arrivée, étaient descendus à l’auberge où s’était déjà logé un de leurs compatriotes, au faubourg Saint-Germain, rue des Boucheries, à l’enseigne du Prince d’Orange. Ils ne voulurent pas suivre un de leurs compagnons de voyage, qui s’en allait loger «chez Monglas, en la rue de Seine, à la Ville de Brissac.» Tallemant des{132} Réaux, dans ses Historiettes, a parlé de cette auberge: «L’hôte et l’hôtesse sont huguenots, dit-il, et sont assez exacts; c’est une honnête auberge, et tout est plein de gens de la Religion (réformée) à l’entour.»
Ce fut vers ce temps-là que les hôtelleries de Paris prirent le nom d’hôtels, comme pour faire concurrence avec les habitations des grands seigneurs. «Il y a à Paris, écrivait le docteur Lister en 1698, un grand nombre d’hôtels, c’est-à-dire d’auberges publiques, où on loue des appartements. Ce nom s’applique aux maisons des seigneurs et des gentilshommes, dont le nom est le plus souvent écrit en lettres d’or sur un marbre noir placé au-dessus de la porte[109].» Beaucoup de ces hôtelleries remontaient à une époque très ancienne, et elles avaient conservé leur enseigne primitive, sur laquelle on lisait encore, suivant les prescriptions de l’ordonnance de 1579: Hostellerie, ou Taverne, par la permission du Roy. La plupart cependant s’étaient soustraites, en prenant le titre d’hôte., aux règlements tyranniques de cette ordonnance, qui enjoignait aux hôteliers de faire inscrire sur leur porte, en gros caractères, les prix que les voyageurs auraient à payer; par exemple: Dînée du voyageur à pied, 6 sols. Couchée du voyageur à pied, 8 sols. Sur beaucoup d’enseignes, on lisait: Icy on fait nopces et festins, et cette inscription s’est maintenue, avec son orthographe, presque jusqu’à nos jours. On lisait aussi cette autre inscription, qui ne sert plus que dans quelques villes de province lointaines: Icy on loge à pied et à cheval. Les hôteliers avaient ainsi à se débattre{133} au milieu d’une foule de lois et de règlements plus ou moins tyranniques.
Le Livre commode de Nicolas de Blegny[110] nous donne les noms et les adresses des principaux hôtels de Paris à la fin du XVIIᵉ siècle, en indiquant bien des enseignes; mais il ne nous dit pas que les hôtels qui portaient des noms de pays avaient pour enseignes les armes de ces pays. Les noms de province et de seigneurie commandaient toujours des écussons armoriés pour enseignes; quant aux noms de ville, on a lieu de croire qu’ils autorisaient les hôteliers à faire peindre au naturel, comme on disait alors, sur les enseignes de leurs hôtelleries, une vue de ces villes françaises ou étrangères. Venons maintenant à la nomenclature des hôtels de second ordre, en différents quartiers. Le sieur de Blegny n’en cite que deux de premier ordre: l’hôtel de la Reine Marguerite, rue de Seine, et l’hôtel de Bouillon, quai des Théatins (actuellement quai Malaquais), dans lesquels on trouvait des appartements magnifiquement garnis pour les grands seigneurs, anciens hôtels princiers, l’un et l’autre, et qui, sans doute, n’avaient pas besoin d’autre enseigne que leur grande notoriété alors qu’ils étaient habités, le premier, par la Reine Margot, le second, par le duc de Bouillon. Les bons hôtels, recommandés par le Livre commode, étaient les suivants: le Grand Duc de Bourgogne, rue des Petits-Augustins; l’hôtel d’Écosse, rue des Saints-{134}Pères; l’hôtel de Taranne, l’hôtel de la Savoie et l’hôtel d’Alby, rue de Charonne; l’hôtel de Lille, l’hôtel de Bavière, l’hôtel de France, et la Ville de Montpellier, rue de Seine; l’hôtel de Venise et l’hôtel de Marseille, rue Saint-Benoît; l’hôtel de Vitry, l’hôtel de Bourbon, l’hôtel de France et l’hôtel de Navarre, rue des Grands-Augustins; la Ville de Rome, rue des Marmousets; l’hôtel de Perpignan, rue du Haut-Moulin; l’hôtel de Tours, rue du Jardinet; l’hôtel de Beauvais, rue Dauphine; l’hôtel d’Orléans, rue Mazarine; l’hôtel du Saint-Esprit, rue Guénégaud; l’hôtel de Saint-Aignan, rue Saint-André; l’hôtel de Hollande, l’hôtel de Béziers, l’hôtel de Brandebourg, l’hôtel de Saint-Paul, et le grand hôtel de Luynes, rue du Colombier.
Le sieur de Blegny cite ensuite des hôtels d’un ordre inférieur, où l’on mangeait à table d’auberge, c’est-à-dire à table d’hôte, pour 40 sols, 30 sols, 20 sols et 15 sols: 1º l’hôtel de Mantoue, rue du Mouton; l’hôtel de l’Ile-de-France, rue Guénégaud, etc.; 2º l’hôtel de Château-Vieux, rue Saint-André; le petit hôtel de Luynes, rue Gît-le-Cœur; à la Galère, rue Zacharie; aux Bœufs, et aux Trois Chandeliers, rue de la Huchette, etc.; 3º l’hôtel d’Anjou, rue Dauphine; le Petit Saint-Jean, rue Gît-le-Cœur; au Coq hardi, rue Saint-André; à la Galère, chez le sieur Vilain, rue des Lavandières; à la Croix de Fer, rue Saint-Denis; au Pressoir d’Or, et à l’hôtel de Bruxelles, rue Saint-Martin; à la Croix d’Or, rue du Poirier; à la Toison d’Or, rue Beaubourg, etc.; 4º à la Ville de Bordeaux, et à l’hôtel de Mouy, rue Dauphine; l’hôtel Couronné, rue de Savoie; au Petit Trianon, rue Ticquetonne; à la Ville de Stockholm, rue de Buci; à la Belle{135} Image, rue du Petit-Bourbon; au Dauphin, rue Maubuée, etc.
Les auberges où l’on mangeait à 10 sols sont même désignées dans le Livre commode: au Heaume, rue du Foin; au Paon, rue Bourg-l’Abbé; au Gaillard Bois, rue de l’Échelle; au Gros Chapelet, rue des Cordiers; à l’hôtel Notre-Dame, rue du Colombier. Le sieur de Blegny n’oublie pas deux ou trois auberges où il y avait trois tables différentes, à 15, à 20 et 30 sols: à la Couronne d’Or, rue Saint-Antoine; au Petit Bourbon, quai des Ormes; à l’hôtel de Picardie, rue Saint-Honoré.
Les restaurants et les restaurateurs n’existaient pas encore, mais on avait, en différents quartiers de la ville et des faubourgs, des traiteurs et marchands de vin, «qui font nopces, ou qui tiennent de grands cabarets, et où il se fait de grands écots.» Dans ces maisons-là, on ne couchait pas, on ne logeait pas, en général; on ne faisait qu’y boire et manger. Le Livre commode nomme les propriétaires de ces établissements: Clossier, à la Gerbe d’or, rue Gervais-Laurent; Blanne, à la Galère, rue de la Savaterie; Bedoré, au Petit Panier, rue Tirechappe; Robert, au Cloître-Saint-Merry; Aubrin, à la Croix blanche, rue de Bercy; Martin, aux Torches, cimetière Saint-Jean; Guérin, à la Folie, rue de la Poterie; Payen, au Petit Panier, rue des Noyers; Cheret, à la Cornemuse, rue des Prouvaires.
Nicolas de Blegny ne s’arrête pas là; il cite, avec leurs enseignes, d’autres endroits où «on peut aussi boire et manger proprement et agréablement»: au Louis, près le Jeu de paume de Metz; à la Porte-Saint-Germain, rue des Cordeliers; à la Reine de Suède, rue de Seine; aux Carneaux, rue des Déchargeurs; à la Petite Bastille, rue de Béthizy; au{136} Petit Père noir, rue de la Bûcherie; aux Trois Chapelets, rue Saint-André-des-Arts; à la Galère, rue Saint-Thomas-du-Louvre; au Soleil des Perdreaux, rue des Petits-Champs; au Panier fleuri, rue du Crucifix-Saint-Jacques-de-la-Boucherie; à la Boule blanche, près la porte Saint-Denis, et au Jardinier, faubourg Saint-Antoine. Mais les bons endroits que le sieur de Blegny recommande aux fins gourmets et aux grands buveurs n’étaient, en réalité, que des cabarets, quoique les auberges et les maisons garnies dans lesquelles il y avait des tables d’hôte fussent cent fois plus nombreuses qu’elles ne le sont dans le Livre commode; car, d’après les Annales de la Cour et de la Ville, pour les années 1697-1698, t. II, p. 185, «il y avoit eu dans Paris un si grand abord d’étrangers, que l’on en comptoit quinze à seize mille dans le faubourg Saint-Germain seulement. Le nombre s’accrut encore bientôt de plus de la moitié, en sorte que, au commencement de l’année suivante, on trouve qu’il y en avoit trente-six mille dans ce seul faubourg.»
Nous n’avons pas l’intention de reconstituer l’état des hôtelleries, à propos de leurs enseignes, sous le règne de Louis XIV; nous nous bornerons à rappeler que si le nombre de ces hôtels et maisons garnies ne fit que s’accroître avec le nombre des voyageurs qui venaient voir les monuments et les curiosités de la capitale de la France, J.-C. Nemeitz, conseiller du prince de Waldeck, qui visita cette capitale en 1715, bien que la traduction française de son Séjour à Paris n’ait été publiée qu’en 1727[111], nous apprend qu’il y{137} logea lui-même dans une grande hôtellerie où se trouvaient, en même temps que lui, des étrangers appartenant à dix nations différentes. Mais il ne songe pas à signaler les principales hôtelleries; il constate seulement que les plus agréables et les plus fréquentées étaient celles du faubourg Saint-Germain, et il nomme l’hôtel Impérial, rue du Tour, qui n’est autre que la rue de Tournon; l’hôtel de Hambourg, tout contre; l’hôtel d’Espagne, rue de Seine; l’hôtel de Nîmes, dans la même rue; l’hôtel d’Anjou, rue Dauphine; la Ville de Hambourg, au bas, rue des Boucheries; l’hôtel d’Orléans, rue Mazarine; l’hôtel de Modène, rue Jacob; et d’autres hôtels, situés dans la rue de Tournon, qui était la plus recherchée des voyageurs, à cause du voisinage du Luxembourg: le grand hôtel d’Entragues, l’hôtel de Trévise et le petit hôtel de Bourgogne. C’était dans les hôtels de la rue de Tournon que les ambassadeurs et les seigneurs étrangers louaient de préférence des appartements pendant leur séjour à Paris; l’hôtel officiel des ambassadeurs extraordinaires ayant été établi dans cette rue, à l’ancien hôtel du maréchal d’Ancre.{138}
LES cabarets eurent longtemps, au moyen âge, la même enseigne que dans l’antiquité. Cette enseigne n’était autre qu’un rameau de verdure, une branche de sapin, une couronne de lierre, ou tout autre bouquet de feuillage, qu’on appela bouchon, dès la première formation de la langue française. Le bouchon de paille et la branche de laurier n’indiquaient que les mauvais lieux. Au surplus, cabaret et mauvais lieu souvent ne faisaient qu’un[112]. Comme le peuple, dans certains patois, prononçait bouchou, au lieu de bouchon, bien des cabaretiers remplaçaient le rameau ou la branche d’arbre par un chou[113]. Le cabaret lui-même prit le nom de{139} bouchon, qui est encore usité, mais dans le sens le moins favorable; on l’appelait aussi buffet, qu’on transforma en buvette. La rue des Lombards était, au XIIIᵉ siècle, la rue de la Buffeterie. On n’ouvrait pas un cabaret sans devoir un droit de buffetage (buffetagium) au seigneur féodal de la terre où ce cabaret pouvait être établi, et ce droit, qui se payait tous les ans, comprenait le droit de lever bouchon, car il n’y avait pas de cabaret sans enseigne. Le Cartulaire de Saint-Magloire, à Paris, nous apprend que les moines du couvent prélevaient le buffetage sur les cabarets de leur domaine territorial[114].
Vers la fin du XIVᵉ siècle, l’enseigne ordinaire des cabarets avait changé, parce que la plupart de ces cabarets étaient des caves, où l’on vendait du vin au pot et au tonneau. Un cercel ou cerceau pendait à l’entrée de la taverne, à la place du bouchon. Nous voyons, en 1362, un propriétaire autorisé à suspendre à la porte de sa maison «un cercel à taverne, ou autre enseigne[115]». Monteil cite, au XVᵉ siècle, plusieurs cabarets où pendait un cerceau: on y vendait du vin de sauge et de romarin. Il y avait dès lors plus d’un cabaret fameux, entre autres la maison du Chat (1340), rue aux Fèves, dans la Cité; plus tard, ce cabaret avait modifié son enseigne et portait le nom de maison du Chat blanc (1429-1497); c’est sous ce nom qu’il subsista au même endroit jusqu’à nos jours. Lorsqu’il disparut, vers 1860, avec le reste de l’impasse où il s’était maintenu pendant cinq siècles, il n’avait plus pour habitués que des vagabonds et des voleurs,{140} qui y venaient passer la nuit. Le cabaret de la Pomme de Pin n’était pas moins célèbre, du temps de Rabelais, qui le nomme avec d’autres où les écoliers de Paris tenaient leurs assises; il fait dire par son écolier Limousin (liv. II, chap. VI de Pantagruel): «Nous cauponisons (mangeons), ès tavernes méritoires de la Pomme de Pin, du Castel, de la Magdaleine et de la Mulle, belles spatules vervecines (épaules de mouton), parforaminées de petrocil (assaisonnées de persil).»
Noël du Fail, dans les Baliverneries ou Contes nouveaux d’Eutrapel, en 1548[116], cite deux ou trois cabarets qui avaient la vogue, notamment celui du Croissant, rue Saint-Honoré,
et celui de l’Étoile, sans donner l’adresse de ce dernier. Pierre de l’Arrivey, dans sa comédie de la Vefve, signalait encore, au commencement du XVIIᵉ siècle, le renom des cabarets de la Pomme de Pin et des Trois Poissons: «Si je vais au Palais, tous ces clercs sont à l’entour de moy; l’un me mène aux Trois Poissons, l’autre, à la Pomme de Pin[117].» Agrippa d’Aubigné, dans les Aventures du baron de Fæneste, nous fait savoir que la vieille renommée de la Pomme de Pin n’était pas déchue et qu’elle balançait encore celle du Petit More, qui avait la clientèle des poètes. Théophile fait l’éloge{141} de ce cabaret, dans sa Description du voyage de Saint-Cloud:
Il vante aussi, dans une satire, deux autres cabarets, qui n’eurent pas moins de vogue sous le règne de Louis XIII:
Vers cette même époque, un livre facétieux, dont l’auteur n’est pas connu[119], passe en revue les principaux cabarets de Paris.
Un homme, que sa femme venait de battre pour l’avoir vu sortir d’un cabaret borgne, vient «en Parnasse» supplier Apollon «qu’il luy pleust luy donner une ample et entière congnoissance de toutes les maisons d’honneur, que Bacchus possède dans Paris.» Apollon ne refuse pas de lui indiquer les cabarets les plus estimés: d’abord la Pomme de Pin, sur le pont Notre-Dame, «qui commence néanmoins à descheoir du crédit qu’elle avoit le temps passé.» Mais, ajoute Apollon, «si vous avez nouvelle que la presse soit à la Pomme de Pin,{142} prenez la peine de vous transporter au Petit Diable.» Apollon conseille à son homme, dans le cas où il passerait devant le Palais, d’aller hardiment déjeuner à la Grosse Tête. Après avoir entendu la messe à Saint-Eustache, celui qui aurait fait vœu de dîner en ce quartier-là ne doit pas chercher d’autres rendez-vous qu’au renommé logis du célèbre Cormier. Celui qui sort du théâtre de l’Hôtel de Bourgogne, encore tout échauffé par l’éloquence admirable de M. Bellerose, ne saurait mieux faire que d’aller rafraîchir aux Trois Maillets. Ceux qui se trouveront au faubourg Saint-Germain, après avoir joué à la paume ou à la boule, seront tout portés, pour prendre leur collation, à Saint-Martin, à l’Aigle royal, à la Pomme de Pin. Mais Apollon les arrête ici, en leur criant: «N’allez plus à Clamar, si vous ne voulez pas qu’on vous traite en crocheteurs; son maistre l’a fait rayer du nombre des cabarets illustres.» Apollon recommande à ceux qui viennent de solliciter leurs procès au Châtelet d’entrer ensuite au Grand Cornet, sans se faire tirer l’oreille, ou bien à la Table du valeureux Roland, maison insigne et fameuse; quant à ceux qui auraient peur d’être écorniflés par quelque recors ou sergent, ils doivent aller, un peu plus loin, à la Galère ou à l’Échiquier, «pour divertir la mélancolie qui n’abandonne jamais les pauvres plaideurs.»
Êtes-vous obligé de suivre la Cour et sortez-vous du Louvre à l’heure du dîner, vous trouvez devant vous le premier cabaret de France, celui de la Boesselière; mais il ne faut pas y entrer sans avoir au moins une pistole dans sa bourse. Avez-vous une bourse moins garnie, on vous conseille de pousser jusqu’aux Halles et de passer{143} une heure aux Trois Entonnoirs pour y goûter d’un charmant vin de Beauce. Si vous allez jouer au mail, vous ferez bien de prendre des forces en buvant une bouteille de vin à l’Écu ou à la Bastille.
Celui qui va se promener avec sa maîtresse aux marais du Temple, peut avoir une belle chambre au cabaret de l’Écharpe. Celui qui passe par la rue des Bons-Enfants ne doit pas se dispenser de visiter l’hôtel du Petit Saint-Antoine, un des bons cabarets de la ville de Paris. Quiconque se sentira l’estomac indisposé pour avoir trop bu la veille, n’aura qu’à boire encore pour se remettre le cœur, et s’il se trouvait par hasard aux environs du cimetière Saint-Jean, il fera bien de s’arrêter au logis des Torches pour y prendre une potion cordiale, capable de ressusciter un mort. Enfin voici le plus friand cabaret, qu’Apollon nous gardait pour la bonne bouche, c’est celui des Trois Cuillers, ou Cuillères, dans la rue aux Ours.
Tous ces cabarets avaient des enseignes peintes ou sculptées, quelquefois dorées ou argentées. Les ordonnances de la Ville et de la Cour des Aides prescrivaient aux cabaretiers, taverniers, logeurs et autres, qui vendaient le vin en détail, de mettre des enseignes aux endroits où se faisait la vente. A défaut d’enseigne, le vendeur de vin plaçait sur sa porte un bouchon, ou un moulinet emblématique, annonçant que le vin fait tourner la tête. Les gentilshommes, les plus grands seigneurs, allaient au cabaret pour faire bombance et boire à tire-larigot. Pierre de l’Estoile, dans son Journal de Henri IV (année 1607), affirme que la dépense était de six écus par personne, au Petit More et à la Hure, rue de la Huchette. Le poète Théophile, qui s’entendait en caba{144}ret aussi bien qu’en poésie, nous a laissé cette peinture d’un ivrogne qu’il rencontrait souvent au Petit More:
Ce Petit More reparaît sans cesse dans les chansons bachiques, sous le règne de Louis XIII:
C’était le rendez-vous des plus vaillants buveurs. La Comédie des Chansons[122], qui fut peut-être représentée à l’Hôtel de Bourgogne avant 1640, en a fait un tableau assez peu décent:
Pierre de l’Estoile place le cabaret du Petit More dans la{145} rue de la Huchette; mais il y eut sans doute plus d’un cabaret portant la même enseigne, car nous en voyons encore un, dans la rue de Seine, à l’entrée de la petite rue des Marais, aujourd’hui Visconti, et nous ne doutons pas que son enseigne ne soit du XVIIᵉ siècle.
La même comédie nous a conservé aussi un couplet de chanson bachique, sur le cabaret de Cormier, à l’enseigne du Cerf:
Le dernier couplet nous donne à penser que Cormier, vers 1639, avait changé l’enseigne de son cabaret, en y{146} arborant un cormier ou sorbier, comme un plaisant synonyme de son nom. Guillaume Colletet, qui fut un des habitués de cet illustre cabaret, conseillait ainsi, à un poète buveur d’eau, de changer de boisson, en allant chez Cormier:
Ce sont les poètes qui ont fait, au XVIIᵉ siècle, la renommée des cabarets qu’ils fréquentaient de compagnie. Chapelle a célébré, en vers spirituels, la réunion de ses amis, à la Croix de Fer, où Molière parlait plus qu’il ne buvait. Saint-Amant allait, de préférence, avec une autre coterie poétique, chez Sercy, rue de Seine, à la Petite Galère. C’est dans ce cabaret qu’il est mort, le 29 décembre 1661, après une maladie de deux jours, à laquelle la bonne chère et le bon vin n’étaient pas étrangers. Les jeunes gens de la Cour, qui ne dédaignaient pas de suivre les poètes au cabaret, donnèrent l’idée d’une entrée de ballet, dansé devant le roi, à l’occasion de la naissance du Dauphin, en 1638: cette entrée représentait les enseignes des cabarets de Paris, et Dassoucy en avait fait les vers[124].
Nous avons écrit ailleurs l’histoire des cabarets de Paris[125], et, dans cette histoire, nous n’avons eu garde d’oublier les enseignes, la seule chose dont nous ayons à nous occuper{147} ici. On ne saurait s’étonner de la notoriété que ces enseignes eurent du temps de Louis XIV. Chaque classe de la société, chaque corps d’état avait son cabaret privilégié. Les clients ordinaires de la Tête noire, située près du Palais, étaient les clercs de la basoche et les chantres de la Sainte-Chapelle. Les avocats, les juges eux-mêmes ne dédaignaient pas de se rafraîchir, à la Tête noire, avant et après les audiences, car il n’y avait pas de buvette dans la grand’salle du Palais. La veuve Bervin, dans le voisinage du cimetière Saint-Jean, tenait un cabaret, à l’enseigne du Mouton blanc, où Racine et Boileau ne croyaient pas se compromettre en y dînant avec l’avocat Brilhac. C’est dans ce cabaret que Racine eut la première pensée de sa comédie des Plaideurs. Chapelle fit infidélité au bouchon de la Croix de Fer, quand il entraîna ses amis à la Croix de Lorraine, qui avait meilleure table et meilleur vin; Molière et Boileau ne refusèrent pas de l’y suivre, avec le comte de Lignon et l’abbé de Broussin. Nous craignons bien que la Croix de Fer n’ait jamais réussi à reconquérir ses anciens hôtes, que lui avait enlevé la Croix de Lorraine. Au surplus, Chapelle fut toujours inconstant à l’égard des cabarets, parce qu’il les aimait tous et qu’il était connu de tous. Il trônait surtout, quand il ne songeait qu’à s’enivrer en tête-à-tête avec une bouteille, à la taverne de l’Ange, ou bien à celle de la Pomme de Pin, rue de la Licorne, dans la Cité. Ce dernier cabaret, qui avait peut-être vu Rabelais humant la purée septembrale, garda sa vieille renommée jusqu’à la fin du XVIIᵉ siècle, où l’ancien maître de la Pomme de Pin, nommé Desbordes-Grouyn, enrichi dans son commerce et plus encore dans les gabelles, avait cédé sa maison à l’excellent cuisinier Cresnay.{148}
Chaque cabaret rassemblait en quelque sorte sous son enseigne un fidèle bataillon de buveurs et de goinfres. Les amoureux dînaient et soupaient à l’Écharpe, qui donna son nom à une petite rue du quartier du Marais; les friands de l’ordre des Coteaux, c’est-à-dire les vrais connaisseurs en toutes sortes de vins, tenaient leurs assises chez Lamy, aux Trois Cuillères, rue aux Ours; les gros mangeurs faisaient bombance chez Martin, aux Torches, près du cimetière Saint-Jean; d’autres à la Galère, rue Saint-Thomas-du-Louvre; d’autres enfin, chez l’hôte du Chêne vert, à la porte de l’Enclos-du-Temple. Les comédiens et les gens de théâtre, qui ne frayaient pas volontiers avec le commun du public, avaient leurs cabarets attitrés, où ils se trouvaient à leur aise entre eux; c’étaient: pour ceux du Palais-Royal, avant la mort de Molière, le cabaret des Bons Enfants, dans la rue du même{149} nom, et son voisin le cabaret l’Alliance, où le comédien Champmeslé allait toujours, lors même que son théâtre fut transporté rue Guénégaud. Les cabarets s’étaient multipliés autour de l’Hôtel de Bourgogne, jusque vers les places de Montorgueil; il y avait là un cabaret fameux, au Croissant, comme dit l’auteur anonyme de l’Ode à la louange de tous les cabarets. Quand la troupe de l’Hôtel de Bourgogne, réunie à celle du Palais-Royal, vint s’établir, en 1680, dans la rue Guénégaud, ces cabarets, surtout ceux des Deux Faisans et des Trois Maillets, ne chômèrent pas et prospérèrent davantage, les comédiens italiens ayant remplacé les comédiens français. Le théâtre du Palais-Royal, occupé alors par l’Académie royale de musique, que Lully y avait transportée du faubourg Saint-Germain, fournissait de nouveaux habitués, à l’Épée de Bois, de la rue de Venise, taverne adoptée par les musiciens et les danseurs. Quiconque allait d’habitude au cabaret voulait s’y rencontrer avec ses pairs et compagnons; ainsi les maîtres ès arts et autres membres du corps universitaire avaient leurs agapes pédantesques au cabaret de la Corne, transféré de la rue des Sept-Voies à la place Maubert; aux Trois Entonnoirs, près des Carneaux, et surtout à l’Écu d’Argent. Les moines, les prêtres même ne craignaient pas d’entrer au cabaret, et surtout au Riche laboureur, dans l’enclos de la Foire Saint-Germain, et à la Table Roland, dans la Vallée de Misère, près du Châtelet.
Mais il faut nous arrêter à la fin du XVIIᵉ siècle, pour ne pas refaire notre Histoire des Hôtelleries et Cabarets, à laquelle nous renvoyons le lecteur, et nous terminerons ce chapitre, déjà trop long, par une simple nomenclature empruntée au{150} Livre commode des Adresses de Paris en 1691 et 1692, en ne citant que les cabarets dont le sieur de Blegny a mentionné les enseignes. Nous avons déjà parlé de plusieurs de ces cabarets, renommés pour les vins fins et pour la bonne viande; mais leur rappel, dans le Livre commode, prouvera qu’ils n’avaient rien perdu, à la fin du XVIIᵉ siècle, de leur réputation bachique et culinaire; nommons donc Lamy, aux Trois Cuillères, rue aux Ours; Loisel, aux Bons Enfants, près le Palais-Royal; Fitte, au Grand Louis, rue Bailleul; Berthelot, à la Conférence, rue Gervais-Laurent; Dumonchel, au Soleil d’Or, rue Saint-André; Dutest, à la Corne, rue Galande; de Sercy, à la Petite Galère, rue de Seine, etc. Mais déjà les cabarets du bon ton ne s’intitulaient plus que traiteurs, tout en conservant leurs enseignes plus que séculaires; il n’y eut bientôt des cabarets que pour le peuple, et ceux où les gens du monde s’aventuraient encore quelquefois pour faire la débauche étaient aux Porcherons, à la Courtille, au Port-à-l’Anglais, à la Salpêtrière, etc. Ce fut alors que les cafés prirent naissance à Paris, et ils se distinguèrent des cabarets en se refusant toute espèce d’enseigne.{151}
IL n’y a pas d’enseignes de métiers qui aient donné lieu à plus de débats, à plus de conflits, à plus de procès que les enseignes des barbiers, car les barbiers ont été en querelle permanente avec les chirurgiens, les étuvistes et même les médecins. Leur corporation était sans doute très ancienne, mais leurs statuts primitifs étant tombés en désuétude au XIVᵉ siècle, le roi Charles V leur en donna de nouveaux en 1362, lesquels furent confirmés seulement en 1371 par lettres patentes adressées au prévôt de Paris[126]. Voici l’analyse des articles V et VI de ces statuts de la commu{152}nauté des barbiers de la ville de Paris. «Ils ne pourront exercer leur métier, si ce n’est pour saigner et pour purger, les cinq fêtes de Notre-Dame, les jours de saint Cosme et saint Damien, de l’Épiphanie et des quatre fêtes solennelles. Ils ne doivent pas pendre leurs bassins les jours de fête qui suivent les fêtes de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, sous peine de cinq sous d’amende, savoir: deux sous pour le roi, deux sous pour le maître et un sou pour le garde ou lieutenant du métier.» Ces bassins, que les barbiers ne devaient pas pendre à leurs boutiques, en certains jours de fête, sous peine d’amende, étaient les armes parlantes de leur métier, et, par conséquent, leur enseigne. Cette enseigne-là était donc mobile et alternative ou journalière, puisqu’on devait la décrocher à certains jours. Mais les barbiers avaient une autre enseigne fixe et stable, qui n’était jamais mieux à sa place que les jours de fête religieuse, puisque c’était l’image de saint Louis, leur patron.
Le Livre des Métiers, d’Étienne Boileau, prévôt de Paris sous le règne de saint Louis, donne les statuts des estuveurs ou baigneurs, et ne mentionne pas ceux des barbiers, qui n’avaient pas le droit d’exercer leur métier dans les étuves; mais, dès cette époque, les barbiers, du moins quelques-uns, s’occupaient de chirurgie et de tout ce qui constituait la médecine manuelle, que les mires ou médecins proprement dits dédaignaient de pratiquer eux-mêmes, notamment la saignée et le pansement des clous, bosses, apostumes et autres plaies. Charles V compléta en ce sens les statuts des barbiers par son ordonnance du 3 octobre 1372, où il déclarait que les pauvres n’avaient pas les moyens de recourir aux chirurgiens, qui sont gens de grand état et de grand{153} salaire. Par une ordonnance de 1383, Charles VI augmenta et confirma les privilèges des barbiers au point de vue chirurgical. Des lettres patentes de Charles VII, datées de juin 1444, achevèrent de transmettre aux barbiers une partie des attributions de la chirurgie, et leur permirent en quelque sorte de faire ouvertement concurrence aux chirurgiens. Les barbiers avaient ajouté déjà aux armes parlantes de leur métier celles de la chirurgie, c’est-à-dire les trois palettes peintes en rouge, qu’ils suspendaient à leurs bassins professionnels. La palette était une petite écuelle de métal destinée à recevoir le sang dans les saignées et pouvant contenir environ quatre onces de ce sang, qu’on mesurait, pour ainsi dire, en le tirant de la veine. On comprend les discussions et les contestations, auxquelles ces trois palettes et ces bassins fournissaient des prétextes continuels, qui amenèrent quantité de procès entre la communauté des barbiers et le collège des maîtres chirurgiens.
Nous n’avons à nous occuper que des enseignes de l’un et de l’autre corps de métier, lesquelles furent en cause dans ces procès débattus au Parlement, et qui avaient souvent donné lieu à des jugements de simple police pour contravention; car, par un arrêt du 26 juillet 1603, le Parlement avait autorisé les barbiers à s’intituler: maîtres barbiers-chirurgiens, et à faire figurer dans leurs enseignes les bassins ou plats à barbe et les trois palettes de la saignée; mais, parmi les barbiers, beaucoup n’avaient pas subi l’examen d’anatomie et de chirurgie pratique, qu’ils étaient tenus de passer devant les maîtres-jurés de la communauté pour avoir le droit de saigner et de panser les pauvres malades; ceux-là ne devaient donc pas, sous peine d’amende,{154} arborer les trois palettes emblématiques au-dessous de leurs bassins. Quant aux maîtres barbiers-chirurgiens, ils se permirent de changer quelque chose à leur qualification, et ils s’intitulaient, de leur autorité privée, sur leurs enseignes, chirurgiens-barbiers, ce qui fut matière à nouveaux procès, après lesquels les barbiers durent se contenter du titre de barbiers-chirurgiens. En revanche, les chirurgiens eurent, à leur tour, des procès à soutenir contre les barbiers, qui les accusaient de contrefaire leur enseigne professionnelle et de prendre indûment quelquefois le titre de barbier; les chirurgiens, qui saignaient comme les barbiers, prétendaient aussi faire la barbe comme eux: ces chirurgiens-là n’étaient que des barbiers-chirurgiens; ils avaient des enseignes, de même que les barbiers, et des enseignes presque semblables. Le cas était épineux, la question difficile à résoudre, car les chirurgiens produisaient des lettres patentes du roi Jean, en date du 5 avril 1353, qui les autorisaient à raser et saigner, avant que les barbiers eussent obtenu du roi Charles V leurs statuts, qui n’avaient d’analogie que sur ces deux points. Les chirurgiens pouvaient donc pendre des bassins à leur porte, comme enseigne de leur profession, et, en outre, des boîtes d’onguents qui ressemblaient assez aux palettes des barbiers. On plaida, on replaida, et le Parlement, reconnaissant que le droit des chirurgiens à prendre des bassins pour enseigne était antérieur à celui des barbiers, déclara que ces derniers n’en auraient pas moins, par leurs statuts, l’entière possession de leurs bassins et de leurs palettes d’enseigne. Mais, pour établir une juste distinction entre les chirurgiens et les barbiers, il fut décidé, par un nouvel arrêt, que les chirurgiens auraient des bassins de cuivre avec trois boîtes,{155} et les barbiers, des bassins d’étain ou de plomb avec trois palettes[127].
Les chirurgiens renoncèrent eux-mêmes à toute espèce d’enseigne, lorsqu’ils eurent exclu de leur corps les chirurgiens-barbiers et les chirurgiens-apothicaires; les barbiers reprirent alors possession de leurs bassins et de leurs palettes de cuivre. Monteil, dans son Histoire des Français de divers états[128], avait fait dire à un maître chirurgien, dès le XVᵉ siècle: «Le public devrait bien distinguer leurs enseignes des nôtres, en bas desquelles ne pendent pas des plats à barbe, mais des boîtes; le public devrait bien aussi ne pas ignorer que nous sommes maîtres chirurgiens jurés.»
Les barbiers n’étaient plus que chirurgiens lorsque la mode voulait qu’on portât la barbe longue; mais ils redevenaient barbiers dès que l’on en revenait à couper la barbe. De là sans doute les alternatives de misère et de fortune de la barberie. On peut voir, d’après la Taille de 1492, que les barbiers de Paris étaient au nombre de 151, et comme chacun d’eux avait à payer pour sa part 8 à 12 sous, ce qui était comparativement une imposition assez élevée, on peut en conclure qu’ils faisaient assez bien leurs affaires à cette époque[129]. Tous, il est vrai, n’étaient pas aussi habiles, malgré les promesses de leurs enseignes. Ainsi, vers 1500, Pierre Gringore les traitait assez mal,{156} dans son poème des Faintises du monde qui règne, où il dit avec dédain:
C’est que sous le règne de Charles VIII les Français avaient rapporté des guerres d’Italie l’habitude de laisser croître leur barbe. Cette habitude persista toujours, avec les guerres d’Italie, sous Louis XII et sous François Iᵉʳ, qui avait inauguré la mode des grandes barbes. Il y eut alors plus de chirurgiens que de barbiers, quoiqu’une bien singulière mode fût aussi venue d’Italie en ce temps-là. Hommes ou femmes se rasaient ou se faisaient raser impitoyablement tout le poil du corps, comme nous l’apprend ce rondeau, qui constate l’étrange service qu’on réclamait des barbiers:
Ce rondeau prouve que, malgré les prescriptions des anciens statuts, les barbiers du temps de François Iᵉʳ pouvaient exercer leur métier dans les étuves, de telle sorte qu’ils s’intitulaient alors barbiers-étuvistes. Mais les barbiers devaient avoir plus tard leur revanche, et Mercier disait, en 1782, dans son Tableau de Paris: «Douze cents perruquiers, maîtrise érigée en charge, et qui tiennent leurs privilèges de saint Louis, emploient à peu près six mille garçons. Deux mille chamberlans font en chambre le même métier, au risque d’aller à Bicêtre; six mille laquais n’ont guère que cet emploi. Il faut comprendre dans ce dénombrement les coiffeuses. Tous ces êtres-là tirent leur subsistance des papillotes et des bichonnages.» Il y avait donc, à Paris, en 1782, 1200 perruquiers, c’est-à-dire barbiers, car dès lors l’usage des perruques tendait à disparaître; or, ces barbiers exerçaient leur métier dans douze cents boutiques, peintes en bleu d’azur, couleur de la livrée du roi saint Louis, et ces douze cents boutiques portaient chacune l’enseigne pendante des deux bassins de cuivre, accompagnés de trois palettes.
Le perruquier, né malin, comme le vaudeville, agrémentait souvent son enseigne de devises et de vers, plus ou moins mal orthographiés, dans le goût de cette inscription, copiée sur la boutique d’un perruquier du village de Sarcelle:
Les barbiers auraient mieux fait de s’en tenir à l’inscrip{158}tion qu’on leur avait permis de placer sur leurs boutiques, lorsqu’ils furent érigés en corps de métier, en 1674: Céans on fait le poil proprement, et on tient bains et étuves. Ils s’intitulaient, dans leurs lettres de maîtrise: Barbiers, baigneurs, étuvistes et perruquiers; ils ne se mêlaient plus de chirurgie, mais ils avaient le droit de vendre, en gros et en détail, des cheveux et toutes sortes de perruques, de poudre, de savonnettes, de pommades, de pâtes de senteurs et d’essences[131].
Les barbiers, de tous temps, furent plaisants et facétieux; ils le montraient bien, même jusque sur les enseignes, dont l’invention leur appartenait. De cette catégorie fut l’enseigne qu’on voyait naguère dans la cour du Dragon et qui représentait une femme essayant de débarbouiller un nègre, avec cette inscription philosophique: Au temps perdu.
Les chirurgiens, après d’interminables procès soutenus contre les barbiers, furent en querelle pendant de longues années avec les médecins, et sans doute avec les épiciers, puisqu’ils vendaient, en vertu de leurs statuts, des drogues et des onguents, comme les apothicaires, qui avaient été incorporés dans la communauté des épiciers, mais qui ne se laissèrent pas absorber par cette corporation, ainsi que le prouve le long procès qu’ils intentèrent à Guy Patin et qui ne tourna pas à leur profit. Ils s’étaient alors séparés, bon gré mal gré, des épiciers, et quoiqu’ils eussent le même patron que leurs anciens confrères qui s’étaient mis sous la protection de saint Nicolas, ils avaient adopté pour enseigne le serpent d’Esculape. Ils y joignaient sans doute des inscriptions latines, pour relever leur profession. Les chirurgiens avaient recours quelquefois à ce procédé, lorsqu’ils ne craignaient pas d’imiter les marchands, en se donnant le luxe d’une belle enseigne peinte. Tel était ce chirurgien demeurant à Paris, près de Saint-Martial, lequel avait fait peindre un tableau de la Charité de saint Louis, pour s’en faire une enseigne, et qui obtint de l’amitié de Santeuil[132] ce distique, qu’il fit graver en lettres d’or, au-dessous de son{160} tableau, destiné à braver la haineuse jalousie des médecins:
Au reste, les médecins eux-mêmes ne dédaignaient pas de sacrifier parfois à la vanité de l’enseigne. Le médecin Mouriceau, qui fit, en 1681, le Traité des femmes grosses, donnait ainsi son adresse, à défaut de l’adresse de son libraire: Paris, chez l’Auteur, au milieu de la rue des Petits-Champs, à l’enseigne du Bon Médecin. Au XVIIIᵉ siècle, médecins et chirurgiens se seraient crus déshonorés s’ils avaient mis des enseignes sur la façade des maisons qu’ils habitaient, mais ils avaient des adresses imprimées et gravées, qu’ils distribuaient dans leur quartier. Nous ne citerons que la suivante, finement gravée par Chalmandrier, d’après un dessin de Marillier, qui l’avait enjolivée de bouquets de roses et surmontée d’un groupe d’amours sérieusement occupés à se soigner les dents: Le sieur Delafondrée, chirurgien dentiste, seul élève associé de M. Fauchard, rue et près les Grands Cordeliers.
La plupart des dentistes, n’étant pas chirurgiens, caractérisaient du moins leur profession par des armes parlantes, qui n’étaient autres que des dents énormes, ou, plus modestement, par des râteliers de belles dents blanches à faire envie aux pauvres édentés; ce qui se voyait encore de nos jours, au Palais-Royal, dans les tableaux dentaires de Désirabode.
Nous avons trouvé aussi plusieurs adresses gravées, avec des attributs et des emblèmes agréables qui recomman{161}daient des boutiques d’apothicaires, avant que ces indispensables auxiliaires de la médecine se fussent métamorphosés en pharmaciens. Nous nous arrêterons de préférence à une enseigne sculptée, et très élégamment sculptée, qu’on voit encore rue Saint-Denis et qui porte cette légende: Au Mortier d’Argent. Son voisin le Centaure, dont nous avons donné le dessin page 85, et le Bon Samaritain, de la rue de la Lingerie, sont des enseignes de marchands droguistes.
M. L.-C. Silvestre a publié en 1867 un bien curieux ouvrage[133] en recueillant seulement les marques des imprimeurs et des libraires du XVIᵉ siècle, et cet ouvrage s’augmenterait de plusieurs volumes, si l’on s’avisait de rechercher l’origine et le sens de ces marques, qui étaient souvent énigmatiques et difficiles à expliquer. Les marques qui figuraient ordinairement dans les livres imprimés aux XVᵉ, XVIᵉ et XVIIᵉ siècles, soit à la fin du texte, soit sur le titre du volume, servaient souvent d’enseignes aux imprimeurs et aux libraires, mais non d’une manière absolue et géné{163}rale, car, dans bien des cas, la marque n’avait aucune analogie avec l’enseigne, qui était celle de la maison dans laquelle s’établissait l’imprimeur ou le libraire. Un ouvrage spécial et complet sur les marques et les enseignes des imprimeurs de Paris était donc un travail de bibliographie très intéressant, et nous ne sommes pas étonné que plusieurs érudits y aient songé avant M. Silvestre. «On m’a fait lire, dit Jean-Bernard Michault, de Dijon[134], l’ouvrage manuscrit de votre jeune auteur sur les enseignes et les vignettes emblématiques des imprimeurs. M. de La Monnoye m’a dit autrefois qu’un de ses amis avoit travaillé sur la même matière.»
Les deux ouvrages annoncés par La Monnoye et Michault n’ont jamais paru.
Nous n’avons pas à nous occuper ici des marques proprement dites; nous nous bornerons à relever celles qui ont un rapport direct avec notre sujet, et à faire connaître sommairement la plupart des enseignes de l’imprimerie et de la librairie, depuis l’année 1470 jusqu’au règne de Henri II, en 1574[135].
L’invention de l’imprimerie remonte certainement à 1440, et peut-être au delà, mais elle ne fut introduite en France{164} qu’en 1470, par un prieur de Sorbonne, Jean de la Pierre, qui fit venir d’Allemagne trois imprimeurs, Martin Krants, Ulric Gering et Michel Friburger, pour imprimer sous ses yeux plusieurs ouvrages théologiques. Ces trois Allemands avaient apporté avec eux leur matériel d’imprimerie, caractères mobiles, presses et outillage typographique. Ce fut dans la maison de Sorbonne, où ils étaient logés, qu’ils imprimèrent leur premier livre, intitulé: Epistolæ Gasparini Pergamensis, petit volume in-4º. Ce volume ne portait pas encore de marque, et leur atelier, installé dans les bâtiments de la Sorbonne, n’avait pas, ne pouvait pas avoir d’enseigne. Ils en prirent une, en 1475, quand ils transportèrent leur imprimerie dans la rue Saint-Jacques, près les charniers de l’église Saint-Benoît, et cette enseigne, le Soleil d’Or, ne fut pas mise, comme marque, sur les livres qu’ils imprimèrent, quoiqu’ils n’oubliassent pas de la mentionner dans leur adresse.
Les trois premiers imprimeurs travaillaient encore dans le local de la Sorbonne, lorsque Pierre Cesaris et Jean Stol, qui venaient des Pays-Bas, s’établirent rue Saint-Jacques, près les Jacobins, à l’enseigne du Soufflet vert. C’est là qu’ils imprimèrent, en 1473, le Manipulus Curatorum. Pierre Cesaris fut un des quatre premiers libraires-jurés. Leur établissement dans la rue Saint-Jacques, au centre du quartier de l’Université, prouve qu’ils avaient voulu se placer sous les auspices du corps universitaire, pour faire concurrence aux scribes et aux libraires, qui copiaient et vendaient, en ce même quartier, des livres manuscrits. Ces scribes et ces libraires n’avaient pas de boutiques, mais ils attachaient aux fenêtres de leur domicile de longs rouleaux, sur lesquels{165} étaient annoncés les livres qu’ils offraient en vente[136]. On comprend que l’industrie des écrivains, qui avait prospéré pendant le moyen âge, ne put soutenir la concurrence redoutable de l’imprimerie, et que les libraires, qui s’étaient mis alors en boutique avec des enseignes semblables à celles de tous les marchands, vendirent cent fois plus de livres imprimés qu’ils n’avaient vendu de livres manuscrits. Le nombre de ces libraires s’accrut considérablement, à mesure que les livres se multipliaient avec les progrès de l’imprimerie. Nous devons nous borner à citer ceux de ces libraires qui faisaient imprimer des livres avec leurs noms et leurs marques.
Pierre Le Caron, qui imprima en 1474 un des premiers livres français: l’Aiguillon de l’Amour divin, de saint Bonaventure, traduit par Jean Gerson, demeurait rue Quinquampoix, à l’enseigne de la Rose blanche; il alla loger ensuite rue Neuve-Saint-Merry, à l’enseigne des Rats; puis, rue de la Juiverie, à l’enseigne de la Rose. Pasquier Bonhomme, qui publia les Grandes Chroniques de France, en trois volumes in-folio, imprimés en son hôtel, rue Neuve-Notre-Dame, avait pour enseigne l’Image de Saint Christophe.
Antoine Vérard, un des plus habiles et des plus actifs imprimeurs de son temps, puisqu’il imprima ou fit imprimer plus de cent ouvrages in-folio et in-quarto, avec des figures sur bois, demeura d’abord, et jusqu’en 1499, sur le pont Notre-Dame, à l’enseigne de Saint Jean l’Évangéliste; il changea plusieurs fois de domicile, mais il garda toujours la même enseigne, au carrefour de Saint-Séverin, rue Saint-{166}Jacques, près le Petit-Pont, et devant la rue Notre-Dame. Il eut plusieurs marques d’imprimeur et de libraire, qui ne rappelaient en rien son enseigne favorite. Cette enseigne était aussi celle qu’avait adoptée Michel Lenoir, qui avait sa boutique de libraire, en 1496, sur le pont Notre-Dame; mais lorsqu’il alla demeurer, en 1505, au bout du pont Notre-Dame, devant Saint-Denis de la Chartre, il prit pour enseigne l’Image Notre-Dame; plus tard, en s’établissant rue Saint-Jacques, il choisit une autre enseigne: A la Rose blanche couronnée. Il n’est pas facile de s’expliquer ces mutations d’enseigne, si fréquentes chez les imprimeurs et les libraires; nous croyons pourtant, d’après certains rapprochements de noms, qu’elles résultent simplement du changement de domicile et que les enseignes des maisons devenaient la plupart du temps les enseignes des boutiques.
Antoine et Louis Caillaud, imprimeurs, demeuraient, en 1497, rue Saint-Jacques, près les Jacobins, à l’enseigne de la Coupe d’Or; Pierre Levet, imprimeur, en 1495, rue Saint-Jacques, aux Balances d’Argent; Pierre Le Rouge, imprimeur, en 1490, rue Neuve-Notre-Dame, à la Rose. Ce dernier imprimeur avait fait graver une marque, dans laquelle la rose de son enseigne était surmontée d’une fleur de lis couronnée et accotée de deux faucons. Cette marque est une des plus anciennes que nous ayons rencontrées dans un livre du XVᵉ siècle. A cette époque, presque tous les libraires étaient en même temps imprimeurs, ou du moins ils prenaient indifféremment l’un ou l’autre titre professionnel; aussi, l’Allemand Wolfgang Hopyl, qui imprimait presque tous les beaux livres d’heures, illustrés{167} d’encadrements et de gravures sur bois, que publiait Simon Vostre, s’intitula plus d’une fois libraire, dans ses nombreux changements de domicile et d’enseigne, depuis 1489 jusqu’en 1517, rue Saint-Jacques, à Sainte Barbe; puis, dans la même rue, près l’église Saint-Benoît, à Saint Georges, et ensuite au Tréteau; enfin, près les Écoles de Décret, à l’enseigne des Connils, c’est-à-dire des Lapins.
Georges Metelhus, imprimeur, en 1494, rue Saint-Jacques, près le Petit-Pont, à l’enseigne de la Clef d’Argent; Philippe Pigouchet, imprimeur-libraire de livres d’église, rue de la Harpe, près le collège de Damville, ensuite près l’église de Saint-Cosme et Saint-Damien, prend l’enseigne du Palmier, qui reparaît dans sa marque d’imprimeur, où ce palmier, chargé de fruits, est sous la garde d’un homme et d’une femme sauvages. Jean du Pré, également imprimeur de livres d’église, demeurait, en 1492, rue Saint-Jacques, «en l’hôtel où pendent pour enseigne les Deux Cygnes»; sa marque de libraire, que porte le titre d’une édition gothique des Lunettes des Princes, par Jean Meschinot, représente les deux cygnes de son enseigne, soutenant un écusson vide, au milieu de fleurs, entre deux anges qui jouent de la harpe et du psaltérion.
L’imprimeur Durand Gerlier, qui avait pour enseigne l’Étrille Fauveau, quand il demeurait rue des Mathurins, de 1489 à 1493, se transporta, en 1498, rue Saint-Jacques, à l’Image Saint Denis; Guyot Marchand, qui imprima en 1491 une belle édition de la Danse macabre, dans le grand hôtel du Champ-Gaillard, derrière le collège de Navarre, avait une singulière marque, qui reparaissait sans doute sur son enseigne de la Bonne foi: les deux notes de musique sol et{168}
la, suivies des mots superposés fides sur ficit, et au-dessous, deux mains jointes, au milieu des nuées, «pour faire allusion, dit La Caille dans son Histoire de l’Imprimerie, à ces paroles du Pange lingua: Sola fides sufficit.» Georges Wolff, imprimeur allemand, occupait, en 1492, les ateliers d’Ulric
Gering, rue de Sorbonne, avec son enseigne: au Soleil d’Or; mais, lorsqu’il se fut associé avec son compatriote Philippe Cruzenach, il porta son imprimerie, rue Saint-Jacques, à l’enseigne de Sainte Barbe. Jean Lambert, qui était libraire rue Saint-Séverin, en 1492, ne conserva pas son enseigne de la Corne de cerf, quand il vint s’établir, comme imprimeur, devant le collège Coqueret, où il jugea conve{169}nable de pendre l’Image de Saint Claude au-dessus de sa boutique. Jean Trepperel, imprimeur-libraire, qui imprima et publia un grand nombre de romans de chevalerie, avait d’abord pour enseigne l’image de Saint Laurent, quand il demeurait sur le pont Notre-Dame, en 1491; il changea de saint et d’enseigne, en allant demeurer rue Saint-Jacques, en 1498, à l’Image Saint Yves; il n’y resta pas longtemps et passa dans la rue de la Tannerie, à l’enseigne du Cheval noir; en 1502, sa veuve tenait boutique, rue Neuve-Notre-Dame, à l’Écu de France. On s’explique ces changements d’enseigne par ces changements de domicile.
C’était, d’ailleurs, une habitude presque générale chez les imprimeurs et les libraires, du moins à la fin du XVᵉ siècle et au commencement du XVIᵉ. Jean Philippi, imprimeur allemand, établit ses presses, en 1495, rue Saint-Jacques, à l’Image de Sainte Barbe; puis, il les transporta bientôt, rue Saint-Marcel, à l’enseigne de la Sainte-Trinité. Un autre imprimeur allemand, Jean Higman, imprimait d’abord, en 1489, dans la maison de Sorbonne, cet asile tutélaire de l’imprimerie; il alla demeurer, au Clos-Bruneau, près les Écoles de Décret, à l’enseigne des Lions; ensuite, il se fixa rue Saint-Jacques, à l’Image Saint Georges. La rue Saint-Jacques sera désormais, comme au moyen âge, le grand marché de la librairie. Jean Driart s’y installe, à l’enseigne des Trois Pucelles, en 1498, pour y imprimer la plus belle édition du Mystère de la Destruction de Troie la grant. Antoine Nidel, qui était maître ès arts avant de se faire imprimeur, ne s’éloigne pas du collège Coqueret et du collège de Montaigu en créant une imprimerie, à l’enseigne{170} de la Cathédrale, dans le quartier des relieurs, qu’on appelait le Mont Saint-Hilaire, entre la rue Saint-Hilaire et la rue des Sept-Voies. Deux imprimeurs s’établissent, la même année, Félix Baligant, sur la montagne Sainte-Geneviève, près le collège de Reims, à l’Image Saint Étienne, et Geoffroy de Marnef, rue Saint-Jacques, près l’église Saint-Yves, à l’enseigne du Pélican. Ce dernier s’était associé à ses deux frères Jean et Enguilbert, en réunissant leurs trois enseignes dans une marque collective, qui représentait leur association «par trois symboles, dit La Caille, des grues qui font leur nid en volant, un perroquet qui parle, un pélican qui donne la vie à ses petits, avec trois bâtons» où sont les initiales de leur trois prénoms.
Il faut maintenant citer les imprimeurs et les libraires qui ouvrent leurs ateliers et leurs boutiques, avec enseignes, sous le règne de Louis XII. C’est, en 1498, le libraire Jean Petit, rue Saint-Jacques, à l’enseigne du Lion d’Argent, et dans la même rue, près des Mathurins, à la Fleur de lys d’Or. Ce libraire est un de ceux qui, de son temps, ont fait imprimer le plus de livres, puisqu’il entretenait, à lui seul, les presses de quinze imprimeurs. Il avait réuni, dans sa marque de libraire, le lion et la fleur de lis, qui figurèrent l’un après l’autre dans les deux enseignes de ses boutiques. Thomas du Guernier, qui exerça pendant plus de vingt-six ans comme imprimeur et comme libraire, et qui imprima un grand nombre de romans de chevalerie, demeurait d’abord, rue de la Harpe, à l’Image Saint Yves; il resta dans la même rue, en transportant son établissement près le Pilier vert, à l’enseigne du Petit Cheval blanc. Denis Roce, qui ne fut que libraire, demeurait rue Saint-Jacques, près{171} l’église Saint-Benoît, où la plupart des libraires avaient leur sépulture; il prit pour enseigne l’Image Saint Martin, et pour marque, par allusion à son nom de Roce, un rosier portant des roses, avec son écusson armorié, soutenu par deux griffons.
Les imprimeurs allemands et belges qui venaient s’établir à Paris y faisaient encore fortune. Jodocus Badius Ascensius, après avoir été professeur au collège de Lyon, se fit imprimeur à Paris, vers 1502, rue Saint-Jacques, «au-dessus de l’église Saint-Benoît, près du Gril», à l’enseigne des Trois Luxes (brochets); il devint libraire, pour vendre les excellentes éditions de classiques latins, qu’il publiait lui-même. Nicolas Wolff, de Bade, qui mettait sur ses éditions: Impressi arte et industria ingeniosissimi viri N. W. Allemani, imprima d’abord dans le cloître Saint-Benoît, aux Trois Tranchoirs d’Argent; ensuite rue de la Harpe, à l’enseigne des Rats. Thomas Kées, de Wesel, imprimait à l’enseigne du Miroir, près le collège des Lombards. Alexandre Aliate, Belge, n’exerça que quelques mois, en 1500, rue Saint-Jacques, devant le Collège de France, à l’Image Sainte Barbe. Thielman Kerver, arrivé d’Allemagne en 1500, fonda une des plus importantes maisons d’imprimerie et de librairie, qui devait durer plus d’un siècle; il demeurait d’abord sur le pont Saint-Michel, à l’enseigne de la Licorne; ensuite, rue des Mathurins et rue Saint-Jacques, toujours avec la même enseigne, qu’il ne changea que vers la fin de sa vie, pour prendre celle du Gril; mais ses successeurs reprirent celle de la Licorne, qu’ils faisaient figurer dans leur marque typographique. Berchtold Rembolt, de Strasbourg, avait adopté l’enseigne d’Ulric Gering, le Soleil d’Or, en créant{172} son imprimerie rue Saint-Jacques; mais, en allant s’établir près du Collège de France, il prit pour enseigne l’Image Saint Christophe. Sa veuve, qui épousa en 1513 Claude Chevallon, rentra, avec le Soleil d’Or, dans la maison que son premier mari avait habitée rue Saint-Jacques. Claude Chevallon était si fier de son enseigne, qu’il la mit dans sa marque, au-dessus de son écusson, soutenu par deux chevaux dressés debout, pour faire allusion par un rébus à son nom de Chevallon (cheval long).
Les autres imprimeurs et libraires qui parurent du temps de Louis XII étaient tous Français, mais ils n’exercèrent pas longtemps, à l’exception de quatre ou cinq. Gaspard Philippe imprimait, en 1502, rue de la Harpe, aux Trois Pigeons; Nicolas de la Barre, en 1509, rue de la Harpe, devant l’Écu de France, aux Trois Saumons; puis, rue des Carmes, devant le collège des Lombards, à l’Image de Saint Jean l’Évangéliste; Antoine Bonnemère, en 1508, rue Saint-Jean-de-Beauvais, devant les grandes Écoles de Décret, à l’Image Saint Martin; Guillaume le Rouge, en 1512, rue Saint-Jean-de-Latran, à la Corne de Daim; Nicolas des Prez, en 1508, rue Saint-Étienne-du-Mont, au Miroir. Il y eut plusieurs imprimeurs célèbres dont les débuts datent de ce règne-là, mais qui n’acquirent toute leur réputation que sous le règne suivant. François Grandjon, très habile graveur et fondeur de caractères, de même que ses deux frères Jean et Robert, demeurait rue Saint-Jacques, près l’église Saint-Yves, à l’Image Saint Claude, et devant le couvent des Mathurins, à l’Éléphant; Gilles de Gourmont, le premier qui imprima du grec à Paris, et qui devint imprimeur du roi, habitait rue Saint-Jacques, aux Trois Couronnes, mais il rem{173}plaça cette enseigne par celle de l’Écu de Cologne, sans changer de domicile. Ses deux frères, Jean et Robert, imprimeurs comme lui, demeuraient au Clos-Bruneau, près le collège Coqueret, à l’enseigne des Deux Boules. Guillaume Anabat, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, depuis 1500 jusqu’en 1505, à l’enseigne des Connils (lapins), imprimait de superbes livres d’heures, remplis d’images gravées sur bois, pour Gilles Hardouyn, demeurant au bout du Pont-au-Change, à l’enseigne de la Rose, et pour Germain Hardouyn, qui avait sa boutique de libraire devant le Palais, à l’Image Sainte Marguerite. Enfin, Guillaume Nyverd, successeur de Pierre Le Caron, en 1516, conserva cette fameuse imprimerie, dans le même local, rue de la Juiverie, à l’enseigne de la Rose, qui céda la place, on ne sait pourquoi, à l’Image Saint Pierre.
Le nombre des libraires augmentait à mesure que diminuait celui des imprimeurs. Il y eut un libraire du roi, Guillaume Eustace, qui demeurait, en 1508, rue de la Juiverie, à l’enseigne des Deux Sagittaires, qui furent reproduits dans toutes les marques de ce libraire, jusqu’à ce que sa boutique fût transférée, dans la rue Notre-Dame, à l’enseigne de l’Agnus Dei. Il faut citer, parmi les autres libraires de ces temps-là, Poncet Lepreux, qui fit imprimer à ses frais une immense quantité de livres en tous genres, depuis 1498 jusqu’en 1552; pendant 55 ans, il n’eut que deux domiciles, rue Saint-Jacques, devant les Mathurins, à l’enseigne du Loup, et même rue, au Croissant. Citons encore deux autres libraires de la même époque, Jean Lefèvre, rue Saint-Jacques, à l’enseigne du Croissant; Jacques Ferraboue, en 1514, sur le Petit-Pont, devant l’Hôtel-Dieu, à l’en{174}seigne du Croissant. Galiot du Pré, chef d’une nombreuse famille de libraires qui se succédèrent jusqu’en 1570, ouvrit boutique, sur le nouveau pont Notre-Dame, en 1512, à l’enseigne de la Galée, par allusion à son prénom de Galiot, qui signifiait aussi un navire à voiles et à rames. Il avait donc fait poser son enseigne dans sa marque, avec cette devise de bon augure: Vogue la Galée.
Sous François Iᵉʳ, où le nombre des livres imprimés se multiplie à l’infini, la place est prise et disputée par les fils et les descendants des anciens imprimeurs et libraires; nous n’avons donc à mentionner que les nouveaux venus dans l’imprimerie et la librairie, avec de nouvelles enseignes. Commençons par les imprimeurs, qui la plupart travaillaient pour les libraires et ne publiaient plus de livres. On ne peut imaginer combien de poésies et de vieux romans de chevalerie, d’ouvrages de morale et de philosophie, furent mis au jour sous le règne de François Iᵉʳ. Guillaume Lebret imprimait, avec Jean Réal, en 1538, dans le Clos-Bruneau, à la Corne de Cerf, puis à la Rose rouge. Jean Réal se sépara de son associé en 1548, et imprima seul, rue du Mûrier, à l’Image Sainte Geneviève; puis, rue Traversine, au Cheval blanc. Pierre Gromors imprimait, à l’enseigne de la Cuillère, près l’église Saint-Hilaire, en 1521; au Phénix, près le collège de Reims, en 1538. Simon de Colines, qui était à la fois imprimeur et libraire, de 1510 à 1550, changea souvent de demeure et d’enseigne: en 1526, il avait sa boutique, près le collège de Beauvais, au Soleil d’Or; en 1527, sa marque de libraire nous fait supposer qu’il avait pris pour enseigne: aux Connils (lapins); en 1531, son enseigne représentait le Temps, barbu et poilu, maniant sa faux, avec{175} cette devise: Hanc aciem sola retundit virtus. Jean Messier, associé d’abord avec Jean du Pré, imprimait en 1517, rue des Poirées, près le collège de Cluny, à l’Image Saint Sébastien; Nicolas Savetier, rue des Carmes, à l’Homme sauvage; Guillaume de Bozzozel, rue Saint-Jacques, près des Mathurins, au Chapeau rouge; Nicolas Prévost, rue Saint-Jacques,
à l’Image Saint Georges; Pierre Leber, rue des Amandiers, à l’enseigne de la Vérité; Gilles Couteau, rue Grenier-Saint-Ladre, à l’enseigne du Grand Couteau; Pierre Regnault, rue Saint-Jacques, aux Trois Couronnes de Cologne; Pierre Sergent, rue Notre-Dame, à l’Image Saint Nicolas; Denis Janot, qui fut nommé imprimeur du roi, en 1543, rue Notre-Dame, contre l’église Sainte-Geneviève-des-Ardents, à l’Image Saint Jean-Baptiste. Enfin, Michel Vasco{176}san, qui fut libraire et imprimeur, de 1530 à 1576, et qui peut être considéré comme le plus excellent imprimeur du XVIᵉ siècle, demeurait rue Saint-Jacques, à l’enseigne de la Fontaine, là où Jodocus Badius avait établi sa presse, à son arrivée à Paris, en 1502; aussi, Vascosan avait-il représenté dans sa marque d’imprimeur cette presse avec l’inscription: Pressum ascensianum.
Voici maintenant les enseignes de quelques-uns des meilleurs libraires de cette époque: Alain Lotrian, de 1518 à 1539, rue Notre-Dame, à l’Écu de France; Regnault Chaudière, 1516-1551, rue Saint-Jacques, à l’Homme sauvage; Pierre Bridoux, rue de la Vieille-Pelleterie, à l’enseigne du Croissant; Jean Hérouf, rue Notre-Dame, à l’Image de Saint Nicolas; Nicolas Chrestien, près le collège de Coqueret, à l’Image Saint Sébastien; Jean Roigny, rue Saint-Jacques, au Basilic, et ensuite aux Quatre Éléments; Ambroise Girauld, 1526-1546, rue Saint-Jacques, au Lion d’Argent; même rue, au Roi David; même rue, au Pélican; Jean Macé, 1531-1582, au Mont Saint-Hilaire, à l’Écu de Bretagne; puis au Clos-Bruneau, à l’Écu de Guyenne; Vincent Sertenas, 1538-1554, rue Notre-Dame, à l’Image Saint Jean l’Évangéliste; puis, même rue, à la Corne de Cerf; Étienne Robert, dit le Faucheur, libraire et relieur du roi, sur le pont Saint-Michel, à la Rose blanche. Geoffroy Tory, peintre, graveur et libraire, 1512-1550, le premier qui obtint un privilège du roi pour l’impression d’un nouveau livre d’heures, demeura successivement sur le Petit-Pont, joignant l’Hôtel-Dieu, rue Saint-Jacques, devant l’Écu de Bâle et, même rue, devant l’église de la Madeleine, et conserva toujours sa fameuse enseigne du Pot cassé, qu’il avait dessinée lui-{177}même sur sa marque de libraire, avec cette touchante devise: Non plus, qui rappelait sa douleur à la mort de sa fille, etc.
Je m’arrête ici, en me reprochant de m’être laissé entraîner trop loin dans cette aride et monotone énumération
d’imprimeurs et de libraires, sans autres détails que leurs adresses et leurs enseignes. J’ai tenu à montrer ainsi que ces enseignes et ces adresses changeaient souvent, dans l’exercice de leur profession; que leur industrie et leur commerce étaient concentrés dans un petit nombre de rues du quartier de l’Université, et que leurs enseignes différaient souvent de leurs marques typographiques. On nous per{178}mettra[137] d’ajouter à ces renseignements un peu arides, malgré leur intérêt, une nomenclature sommaire des marques ou enseignes que certains imprimeurs et libraires de Paris ont mises sur des livres sortis de leurs presses ou de leurs boutiques, quoique ces livres ne portent pas leurs noms, ni l’indication du lieu d’impression. Ce n’étaient pas là des éditions clandestines, mais c’étaient bien des éditions anonymes, et nous avouons ne pas comprendre le but et l’intention des éditeurs, qui se cachaient ainsi sous leurs enseignes.
L’Abel, de l’Angelier.—L’Abraham, de Pacard.—L’Amitié, de Guillaume Julien.—Le Basilic et les Quatre Éléments, de Roigny.—Le Bellérophon, de Perier.—La Bonne Foi, de Billaine.—Le Caducée, de Wechel.—Le Cavalier, de Pierre Cavalier.—Le Cordon du Soleil, de Drouart.—Le Chêne vert, de Nicolas Chesneau.—Les Cigognes, de Pâris.—Le Saint-Claude, d’Ambroise de la Porte.—Le Cœur, de Huré.—Le Compas, d’Adrien Perier.—La Couronne d’Or, de Mathurin du Puis.—L’Éléphant, de François Regnault.—Les Épis mûrs, de Du Bray.—L’Espérance, de Gorbin.—L’Étoile d’Or, de Benoît Prevost.—La Fontaine, de Vascosan.—Autre Fontaine, des Morel.—La Galère, de Galiot du Pré.—L’Hercule, de Vitré.—La Licorne, de Chappelet.—Autre Licorne, de Kerver.—Le Loup, de Poncet le Preux.—Le Lys blanc, de Gilles Beys.—Le Lys d’Or, d’Ouen Petit.—Le Mercure arrêté, de David Douceur.—Le Mûrier, de Morel.—Le Grand{179} Navire, de la Société des libraires de Paris, pour les impressions des Pères de l’Église.—L’Occasion, de Fouet.—L’Olivier, des Estienne.—Autre Olivier, de Chappelet.—Autre Olivier, de Patisson.—Autre Olivier, de Pierre l’Huillier.—La Paix, de Jean Heuqueville.—La Palme, de Courbé.—Le Parnasse, des Ballard.—Le Pégase, de Wechel.—Autre Pégase, de Denis du Val.—Le Pélican, de Girault.—Le Phénix, de Michel Joly.—La Pique entortillée d’une branche et d’un serpent, de Frédéric Morel.—Autre, de Jean Bien-né.—Le Pot cassé, de Geoffroy Tory.—La Presse ou l’Imprimerie, de Badius Ascencius.—La Rose dans un cœur, de Corrozet.—La Ruche, de Robert Fouet.—La Salamandre, de Denis Moreau.—La Samaritaine, de Jacques du Puis.—Le Saturne, ou le Temps, de Colines.—Le Sauvage, de Buon.—Le Serpent mosaïque, de Martin le Jeune.—Le Soleil, de Guillard.—La Toison d’Or, de Camusat.—La Trinité, de Meturas.—La Vérité, de David.—La Vertu, de Laurent Durand.—Les Vertus théologales, de Savreux.—La Vipère de saint Paul, de Michel Sonnius.
Cette liste aurait pu être aisément doublée, mais, telle qu’elle est, elle doit suffire pour indiquer des enseignes qui étaient alors tellement bien connues, qu’elles suppléaient en quelque sorte aux noms des imprimeurs et des libraires qui les avaient adoptées et mises en honneur.{180}
EN rassemblant les notes qui m’ont servi à préparer mon édition du Livre commode des Adresses de Paris, publié en 1691 et 1692 par le sieur de Blegny, sous le pseudonyme d’Abraham du Pradel, je m’étais beaucoup préoccupé de rechercher quelles étaient les enseignes des lieux publics de Paris, tels que les étuves, les théâtres, les jeux de paume, car ces enseignes devaient exister encore, du moins la plupart, à la fin du XVIIᵉ siècle; et il est certain que, dans le siècle précédent, il n’y avait pas à Paris une seule maison qui n’eût son enseigne, soit nominale, soit figurée. Ainsi les académies (nous ne parlons pas des Académies royale des sciences, des inscriptions et belles-lettres, des beaux-arts ou de sculpture et de peinture, encore moins de{181} l’Académie française), si nombreuses depuis le règne de Louis XIII, eurent incontestablement des enseignes, et pourtant nous n’avons pas réussi à les découvrir, soit pour les académies des jeux ou des brelans publics, soit pour les académies proprement dites, instituées par des particuliers pour l’éducation de la noblesse. Ces académies n’étaient que des manèges d’équitation, des salles d’escrime, des écoles de musique, de danse, etc., et par conséquent elles s’annonçaient aux passants par des enseignes permanentes et par des écriteaux indicatifs. Notre édition du Livre commode[138], où les enseignes des marchands ne sont signalées qu’en très petit nombre, ne donnera donc pas les enseignes des académies, ni celles des autres lieux publics, enseignes qu’une enquête plus heureuse que la nôtre parviendra peut-être à mettre au jour.
Il en est une, cependant, que je viens de découvrir en feuilletant la Bibliothèque de l’École des Chartes et qui a été commune à toutes les académies de danse au XVIIᵉ siècle. Quand Louis XIV, qui aimait la danse au point de la pratiquer en maître, eut créé l’Académie royale de danse, en 1662, le roi des ménétriers, Guillaume du Manoir, joueur de violon du cabinet du roi et l’un des vingt-cinq de la grande bande, intenta un procès aux maîtres à danser, et ce, au nom de la communauté et de la confrérie de Saint-Julien des ménétriers. Ce procès en Parlement ne dura pas moins de trente ans et fut terminé par une déclaration du roi, du{182} 2 novembre 1692, en vertu de laquelle la communauté de Saint-Julien fut maintenue dans la jouissance de son privilège de donner, concurremment avec l’Académie royale de danse, soit des lettres de maîtrise de joueur d’instruments, soit des leçons de danse. Voici un curieux extrait du factum pour Guillaume du Manoir: «De tous temps, la plupart des maîtres à danser ont eu et ont encor un violon pour enseigne, non pas pour désigner qu’ils montrent à jouer de cet instrument, mais pour marquer qu’ils montrent la danse et la liaison qu’il y a entre la danse et le violon; et, de fait, au-dessous du violon qui leur sert d’enseigne on écrit toujours ces mots: Céans on montre à danser, et, de plus encor, lorsqu’on veut exprimer qu’un écolier va apprendre cet exercice ou celui de l’épée, on dit vulgairement qu’il va à la salle[139].»
Cette citation nous permettra de supposer l’existence d’une autre enseigne pour les académies où l’on apprenait l’escrime. Leur enseigne avait été une épée tenue par une main gantée, et cette enseigne était placée sans doute au-dessus de la porte de toutes les maisons où il y avait une salle d’armes pour l’exercice de l’épée. Nous avions remarqué, en effet, dans les notes de Berty sur la topographie des quartiers du Louvre et du bourg Saint-Germain, plusieurs maisons de l’Épée, et même une maison de l’Épée rompue. Il en devait être de même des enseignes de tous les maîtres joueurs d’instruments, qui avaient une salle de musique: les joueurs de luth exposaient pour enseigne un{183} luth; les joueurs de cor de chasse, un cor; les joueurs de hautbois, un hautbois, etc. D’après ce système, une académie pour l’équitation prenait pour enseigne un cheval ou une tête de cheval, sinon une selle, un mors, une bride. Quant aux académies des jeux, comme elles avaient été défendues, la plupart n’avaient garde de se trahir par quelque autre signe extérieur qu’une simple lanterne, qui devait être indispensable en un temps où les rues de Paris n’étaient pas éclairées.
Si l’Académie royale de danse, dont nous venons de parler plus haut, avait au moins un violon pour enseigne, on peut supposer que l’Académie royale de musique se donna aussi le luxe d’une enseigne et y mit en montre tous les instruments de son orchestre, lorsque cette académie, créée par Lully en vertu des lettres patentes que le roi lui avait accordées au mois de mai 1672, s’établit d’abord dans une salle provisoire, qui n’était qu’un jeu de paume, «près Luxembourg, vis-à-vis Bel-Air», suivant l’adresse que nous fournit l’opéra des Fêtes de l’Amour et de Bacchus, représenté et imprimé en 1672. Lully avait attribué certainement une enseigne à son théâtre, puisqu’il en avait appliqué une à sa maison, qu’il bâtissait simultanément au coin de la rue Sainte-Anne et de la rue Neuve-des-Petits-Champs. Cette vieille maison existe encore, avec sa décoration que nous avons appelée une enseigne lyrique: «Au-dessus de la haute fenêtre qui occupe le milieu de la principale façade, disons-nous dans un de nos ouvrages[140], se voient comme sculptés dans la pierre plusieurs des attributs qui rappellent le pre{184}mier propriétaire. Ce sont des instruments de musique, une timbale, des trompettes, une guitare, etc. Des masques de théâtre servent de clefs de voûte aux cintres du rez-de-chaussée et sont une allusion à l’origine de la fortune de celui qui fit bâtir cette demeure.»
L’enseigne d’un théâtre était aussi un éclairage de lanternes, mais ces lanternes portaient peut-être une inscription qui devenait lumineuse le soir des représentations. Le Duchat avait dit, dans une note de la préface de son édition des œuvres de Rabelais, commentées par lui (1711), que le nom du Théâtre ou Jeu des Pois pilés venait d’une enseigne: «Espèces de farces morales connues sous le nom de Poids pilés, et appelées de la sorte parce qu’à la maison où on les représentoit, à Paris, pendoit pour enseigne une pile de poids à peser.» (Voir Fœneste, liv. III, chap. X.) Mais Le Duchat s’est démenti lui-même dans une note sur ce passage des Aventures du baron de Fœneste, par Agrippa d’Aubigné, où il représente les pois pilés comme une purée de pois, à laquelle on faisait allusion avec dédain en parlant{185} des premières et grossières farces du théâtre français. Nous ne sommes pas éloigné de croire que Le Duchat avait raison dans sa première interprétation du nom de ce théâtre des Poids pilés, qui avait son siège aux Halles et probablement dans une grande maison, une espèce de halle fermée où était le Poids du Roi. Cette halle ou maison était située dans la rue de la Buffeterie ou des Lombards. Il suffira de citer un seul document contemporain de l’époque où le jeu des pois pilés fut établi dans le quartier des Halles par la joyeuse bande des Enfans sans souci: «Lettre de l’an 1471, du quatorzième octobre, par laquelle Marguerite de la Roche-Guyot vend au Chapitre le Poids le Roi, avec le lieu où il se tient en la rue de la Buffeterie, alias des Lombards, avec le Poids de la Cire, deux mille sept cens soixante-quatorze livres, 12 sous[141].»
On peut donc dire avec certitude que l’enseigne du Poids du Roi était une pyramide de poids empilés, par ordre de grosseur, en commençant par les plus gros et en finissant par les plus petits. Il y avait d’ailleurs plusieurs maisons du même genre pour le pesage des marchandises. Berty, dans sa Topographie du vieux Paris, cite une maison des Balances, en 1372, dans la rue du Coq. La rue des Billettes avait aussi pris son nom de l’enseigne des billes, ou du billot, qu’on pendait à la maison où se payait quelque péage au profit du roi ou de la ville[142].
Les étuves, qui s’étaient tant multipliées depuis le XIIIᵉ siècle, avaient également des enseignes, mais nous{186} n’en avons pu découvrir que deux[143], l’une dans le Compte des confiscations de Paris en 1421, pour les Anglais qui étaient alors maîtres de la ville, l’autre dans le Compte du Domaine de Paris pour un an fini à la saint Jean-Baptiste 1439: «Maison en laquelle a estuves à femmes, scise rue de la Huchette, où est l’enseigne des Deux Bœufs, faisant le coin de ladite rue, près de l’Abreuvoir du Pont-Neuf.»—«Hôtel de l’Arbalestre, dans la rue de la Huchette, tenant du côté du Petit-Pont à l’hostel de Pontigny, et du côté du pont Saint-Michel, à l’hostel des Bœufs, etc.; à l’Arbalestre, il y avoit estuves pour hommes, et aux Bœufs, estuves pour femmes.» Sauval, qui nous offre ce renseignement précieux par sa rareté, avait dit dans son Histoire des Antiquités de la ville de Paris[144]: «Vers la fin du siècle passé, on a cessé d’aller aux étuves. Auparavant elles étaient si communes, qu’on ne pouvoit faire un pas sans en rencontrer.» De ces étuves, il était resté jusqu’à nos jours des noms de rues: rues des Vieilles-Étuves-Saint-Martin, rue des Vieilles-Étuves-Saint-Honoré, la ruelle des Étuves, près la rue de la Huchette, etc. Mais les enseignes de ces étuves, enseignes qui étaient sans doute curieuses pour l’histoire des mœurs, n’avaient pas même laissé un souvenir.
Des étuves et des maisons de baigneurs aux maisons de débauche, il n’y avait qu’un pas. Le savant Duméril, dans son ouvrage sur les Formes du mariage, soutient qu’au moyen âge un bouchon de paille servait d’enseigne aux prostituées, et aujourd’hui même un lien de paille est encore employé dans les rues pour indiquer un objet quelconque{187} à vendre. Mais les mauvais lieux avaient d’autres enseignes plus caractéristiques, la prostitution formant un corps de métier. Ainsi, l’abbé Perau, dans ses additions à la Description historique de la ville de Paris, par Piganiol de la Force[145], affirme que le nom du quartier du Gros-Caillou n’a pas eu d’autre origine qu’une maison de débauche: «Il faut dire, à présent, l’origine de ce nom singulier de Gros Caillou, qui lui fut donné après son nom très ancien de la Longray. Dans le lieu où est aujourd’hui sise l’église, étoit une maison publique de débauche, à laquelle un caillou énorme servoit d’enseigne, et l’on fut obligé d’employer la poudre pour le détruire et élever en sa place la croix qui y est aujourd’hui et l’église à la place de la maison.» L’abbé Perau n’a pas eu égard au nom primitif de la Longray, qui peut avoir été le nom vulgaire d’une pierre druidique, d’une espèce de dolmen: le long grais ou gray. En effet, Jaillot, dans ses Recherches sur la ville de Paris, dit que ce gros caillou était une borne servant de limite entre les seigneuries de Saint-Germain-des-Prés et de Sainte-Geneviève. L’enseigne de la maison de débauche n’en était pas moins la tradition populaire du quartier.
On connaît du moins avec certitude les enseignes d’un grand nombre de jeux de paume, qui ont été souvent nommés dans l’histoire et dont Adolphe Berty a recueilli les noms seulement pour les quartiers du Louvre et du bourg Saint-Germain.
Le Journal d’un bourgeois de Paris, sous le règne du roi Charles VII, mentionne le jeu de paume du Petit Temple{188} rue Grenier-Saint-Lazare, où l’on voyait la belle Margot jouer à la paume avec la main nue, en guise de raquette. L’Illustre Théâtre, où Molière fit ses débuts de comédien avec la troupe des Béjart, s’installa, en 1643, dans le jeu de paume des Métayers, situé près de la porte de Nesle; il fut transporté ensuite au jeu de paume de la Croix noire, situé rue des Barrés, près du port Saint-Paul; puis enfin, il alla
terminer sa carrière dramatique, en 1646, au jeu de paume de la Croix blanche, rue de Bucy. Ce sont là les faits les plus intéressants de l’histoire des jeux de paume, que nous ne nommerons pas tous, car on n’a pas relevé encore leurs annales dans tous les quartiers du vieux Paris, où ils furent si nombreux au XVIIᵉ siècle, lorsque la paume était l’exercice favori de la jeunesse. Ils ont disparu, la plupart, depuis que le jeu de billard, qui a remplacé la paume, s’est intronisé dans les estaminets et les cafés. Un des derniers jeux{189} de paume qu’on ait vus à Paris, dans la rue Saint-Victor, avait une enseigne fort curieuse pour l’archéologie, puisqu’elle représentait deux joueurs en action, avec le costume qu’ils portaient il y a cent cinquante ans environ. Nous attribuerions aussi à un jeu de paume, sinon à un marchand de raquettes et d’éteufs ou de balles de paume, l’enseigne d’une maison: A la Raquette, que nous avons fait dessiner, il y a vingt ans, au coin de la rue Charlemagne et de la rue des Nonnains-d’Hyères.
Contentons-nous de donner comme spécimen la liste des jeux de paume désignés par leurs enseignes, tels que Berty les a trouvés dans l’ancien bourg de Saint-Germain-des-Prés.
Rue des Boucheries. Maison et jeu de paume du Dauphin, aboutissant à la rue des Quatre-Vents, en 1523.—Jeu de paume du Château de Milan.
Rue de l’Ancienne-Comédie. Jeu de paume de l’Écu de Savoie, en 1523.—Jeu de paume de l’Écu, en 1592, dans le grand hôtel de l’Écu de France.
Le jeu de paume de l’Écu de Savoie occupait un espace de terrain si considérable, qu’on y bâtit au XVIIIᵉ siècle plu{190}sieurs maisons, dont les enseignes furent l’Écritoire, la Talemouse, la Tour d’Argent, le Champ des Oiseaux, l’Ane vert, les Clefs, et la Rose rouge. Ces noms d’enseigne n’annonçaient pas des maisons très respectables.
Le jeu de paume de l’Étoile, qui existait en 1547, fut remplacé, à la fin du XVIIᵉ siècle, par la nouvelle salle de la Comédie française, au nº 14 de la rue de l’Ancienne-Comédie, qui lui doit son nom.
Rue de Seine. Les jeux de paume furent plus nombreux dans cette rue-là que dans tout le quartier Saint-Germain. Voici les noms des principaux: Jeu de paume de Fort Affaire, 1588.—Jeu de paume des Deux Anges, 1593.—Jeu de paume des Trois Cygnes, 1595.—Jeu de paume du Soleil d’Or, 1595.—Jeu de paume de la Bouteille, 1600.—Jeu de paume Saint-Nicolas, 1617.—Jeu de paume des Trois Torches, 1687.
Terminons par une remarque qui a échappé à Berty, le dépisteur de tous ces jeux de paume: c’est que le jeu de paume des Métayers, près de la porte de Nesle, où Molière parut sur la scène pour la première fois avec la troupe de l’Illustre Théâtre, a subsisté bien plus longtemps qu’en 1790. Nous sommes presque certain qu’il conservait sa première destination, sans avoir changé d’aspect, en 1818, ayant toujours ses deux entrées, l’une dans la rue de Seine et l’autre dans la rue Mazarine. Il ne fut détruit qu’en 1823, lors de l’ouverture du passage du Pont-Neuf; mais on reconnaît, au nº 42 de la rue Mazarine, l’entrée et l’allée obscure qui conduisaient au jeu de paume. En 1818, tous les habitants du quartier, fidèles gardiens de la tradition, appelaient encore ce vieux jeu de paume le Théâtre de Molière.{191}
ON s’est demandé souvent autrefois proverbialement: «Où vont les vieilles lunes?» On aurait pu se demander aussi: «Que deviennent les vieilles enseignes?»
Sans doute, la pluie, la sécheresse, le soleil, l’humidité et la poussière faisaient leur œuvre sur ces enseignes, exposées à toutes les intempéries de l’air et des saisons, pendant de longues années; mais si on ne les repeignait pas, si on ne les nettoyait pas de temps à autre, on les changeait trois ou quatre fois dans un siècle, et les vieilles enseignes n’étaient pas condamnées à faire des fagots pour allumer du feu. Il y avait sans doute des vendeurs et des acheteurs pour ces vieilles enseignes, qui passaient d’une maison à une autre et servaient tour à tour à recommander différentes indus{192}tries et différents commerces; car l’enseigne n’avait pas toujours un rapport direct et caractérisé avec la profession de l’artisan, qui la choisissait par caprice ou par hasard. C’étaient aussi les mêmes enseignes qu’on voyait répétées dans le même quartier et dans la même rue, elles ne différaient souvent que de couleur: s’il y avait trois Croix, trois Lions, trois Chevaux, trois Pots, trois Cages, trois Paniers, à côté l’un de l’autre, chacune de ces enseignes se distinguait par une couleur spéciale, de manière à ce que les mêmes signes distinctifs, représentés et dénommés dans plusieurs enseignes voisines, ne fussent jamais confondus entre eux, puisqu’ils n’avaient pas d’autre objet que de désigner une maison ou une boutique; ainsi la Croix d’Or n’était pas la Croix d’Argent, le Grand Lion n’était pas le Petit Lion, le Cheval blanc n’était pas le Cheval rouge, le Pot d’Étain n’était pas le Pot de Cuivre, la Cage bleue n’était pas la Cage noire, le Panier vert n’était pas le Panier fleuri.
Les signes distinctifs des enseignes ne variaient donc pas à l’infini, comme on paraît le croire, et leur ressemblance même n’avait rien qui pût déplaire au marchand ou au propriétaire. Il suffisait qu’il n’y eût pas deux enseignes absolument semblables dans la même rue. Un changement d’enseigne ne pouvait être déterminé que par une circonstance indépendante de l’enseigne elle-même, car ordinairement l’ancienneté d’une enseigne en faisait la valeur. Aussi, nous avons remarqué que si la maison changeait d’enseigne deux ou trois fois en un siècle, la boutique n’en changeait pas, à moins de changer de destination commerciale. Ce sont là des raisons qui nous font penser que les enseignes ne se détruisaient pas, en cessant d’appartenir à telle maison ou{193} à telle boutique, et que l’acquéreur ne manquait pas, pour les transporter d’un lieu à un autre et pour leur donner une nouvelle existence en les attachant à un nouveau commerce ou à un nouveau local. Cependant, nous n’avons pas réussi à découvrir quels étaient les marchands qui à une époque reculée vendaient les vieilles enseignes d’occasion, en les faisant réparer et repeindre.
Ce n’est qu’au XVIIIᵉ siècle que nous trouvons ces marchands-là: «Chez les marchands de ferraille du quai de la Mégisserie sont des magasins de vieilles enseignes, dit Mercier[146], propres à décorer l’entrée de tous les cabarets et tabagies des faubourgs et de la banlieue de Paris. Là, tous les rois de la terre dorment ensemble: Louis XVI et Georges III se baisent fraternellement, le roi de Prusse couche avec l’impératrice de Russie, l’Empereur est de niveau avec les Électeurs; là, enfin, la tiare et le turban se confondent. Un cabaretier arrive, remue avec le pied toutes ces têtes couronnées, les examine, prend au hasard la figure du roi de Pologne, l’emporte, l’accroche et écrit dessous: Au Grand Vainqueur.» Mais il ne s’agit ici que de têtes peintes représentant des portraits de rois et de reines, qui étaient en faveur, à ce qu’il paraît, auprès des cabaretiers de Paris et de la banlieue. Ces marchands de ferraille avaient à leur disposition les peintres d’enseigne pour rafraîchir et enjoliver la marchandise au plus juste prix: «Un autre gargotier demande une impératrice; il veut que sa gorge soit boursouflée, et le peintre, sortant de la taverne voisine, fait présent d’une gorge rebondie à toutes les princesses{194} de l’Europe.» La police, si tracassière et si épineuse pour tant de sujets indifférents, ne prenait pas sous sa protection ces pauvres souverains, auxquels le peintre donnait «un air hagard ou burlesque, des yeux éraillés, un nez de travers, une bouche énorme.» On se contentait d’exiger que la légende de l’enseigne ne fût pas injurieuse.
«Quand je vois, ajoute philosophiquement Mercier, toutes ces vieilles enseignes, pêle-mêle confondues, comme on les change, comme on les marchande; quand je songe aux destinées qui promènent de cabarets en cabarets ces grotesques portraits de souverains; au vent qui les ballotte, aux épithètes dont le barbouilleur, ennemi de l’orthographe, les décore, à leur dernier emploi enfin, qui est de guider les pas chancelants des ivrognes, il me prend envie de composer, sur ces métamorphoses et sur ces vicissitudes de la royauté, un petit dialogue où ces augustes enseignes converseraient entre elles à la porte des bouchons.»
Les vieilles enseignes peintes, qui traînent dans la crotte, à la porte des marchands de bric-à-brac, et qui ne rencontrent plus une âme charitable pour les recueillir et les sauvegarder, eurent pourtant de nos jours un bon saint Vincent de Paul, qui daigna prendre en pitié ces peintures dégradées et abandonnées. Le prince de Pons, élève d’Abel de Pujol, s’était pris d’admiration pour tous les anciens tableaux et surtout pour les plus enfumés et les plus écaillés, dans lesquels il s’imaginait retrouver les œuvres originales des plus célèbres peintres grecs de l’antiquité. Les vieilles enseignes se prêtaient naturellement à son innocente folie: il en avait rempli son atelier, et il passait sa vie à les débarbouiller, à les nettoyer, à les repeindre à la grecque, après{195} avoir cherché à découvrir sous les couleurs et les vernis quelques précieux vestiges d’une peinture d’Apelle ou de Parrhasius. Ce musée d’enseignes retomba dans le bric-à-brac de dernier étage, à la mort du prince de Pons, qui était parvenu, sous la préoccupation de son étrange manie, à gâter, à sacrifier de très beaux tableaux de maîtres, et à couvrir des plus horribles barbouillages d’enseigne les meilleures peintures[147].
M. A. Bonnardot a recueilli l’enseigne d’un cabaret de la ruelle de l’Abreuvoir-Popin (voir la figure ci-dessus, page 127), qui représente cette ruelle si pittoresque quelques années avant sa démolition, vers 1825. Elle débouche sur la Seine par l’Arche Popin, que surmonte, du côté du quai, la maison de quincaillerie à l’enseigne des Deux Clefs. M. Bonnardot a fait graver cette enseigne si curieuse dans sa monographie du Châtelet de Paris à travers les âges.
On comprend que d’excellents tableaux se soient ainsi égarés et perdus quelquefois parmi les enseignes qui avaient tenu leur place au soleil. Mille circonstances, inappréciables au point de vue rétrospectif, pouvaient faire du meilleur tableau ancien ou moderne une simple et modeste enseigne. On raconte qu’à l’époque de la Révolution un charbonnier de Paris avait acheté une tête de Greuze, une de ces têtes de jeune fille si remarquables par l’expression naïve et voluptueuse à la fois du modèle, ainsi que par l’éclat et la vérité du coloris. A cette époque il y avait sur tous les quais et{196} sur tous les ponts une exposition permanente des plus précieuses épaves du XVIIIᵉ siècle artistique, et ces trésors de l’art français ne trouvaient pas, même à vil prix, d’acheteurs, car les vrais sans-culottes ne se piquaient pas d’être des connaisseurs, et les connaisseurs qui n’étaient pas encore arrêtés et emprisonnés comme suspects craignaient de se compromettre en achetant les reliques de l’ancien régime. Notre charbonnier n’avait rien à craindre de ce côté-là. Le tableau acheté pour quelques francs, il le barbouilla consciencieusement avec de la poussière de charbon ou de la suie, car cette peinture lui semblait trop brillante et trop blanche et rose pour l’usage qu’il en voulait faire, puis il la cloua, sans cadre, au-dessus de sa boutique, en la prenant pour enseigne, avec cette inscription: A la belle Charbonnière. L’enseigne resta pendant dix ou quinze ans à tirer l’œil du client, qui, en venant chercher un boisseau de charbon, ne manquait pas d’admirer la belle charbonnière. Enfin un amateur passa par là, vit l’enseigne, y reconnut une peinture de Greuze sous la teinte noire qui la recouvrait, et le tableau, une fois nettoyé et reverni, alla reprendre la place qu’il méritait dans une des plus célèbres galeries de la Restauration. C’est là que le charbonnier retrouva un jour son enseigne. «Si je l’avais accrochée à ma boutique dans ce bel état de fraîcheur, dit-il, je me serais fait moquer de moi, car les charbonniers ne se débarbouillent que le dimanche.»
Nous racontons ailleurs (chapitre des PEINTRES D’ENSEIGNE) l’histoire de l’enseigne que Watteau avait faite pour son ami Gersaint, le marchand de tableaux du pont Notre-Dame, et qui fut achetée à très haut prix par M. de Julienne, pour entrer ensuite dans un Musée comme un des chefs-d’œuvre{197} du maître. On aurait à citer plus d’une histoire de ce genre, car les grandeurs et les décadences de l’enseigne furent de tous les temps et de tous les pays. Nous avons vu, chez un de nos plus chers amis (Paul Lacroix), une admirable peinture de Frans Hals, qui représente le portrait du timonier de l’amiral Tromp, attablé dans un cabaret, buvant et fumant avec délices, et qui fut pendant plus d’un siècle l’enseigne d’un musico d’Amsterdam. M. Paul Lacroix a trouvé aussi une enseigne d’un marchand d’estamples (sic), peinte en camaïeu brun, figurant un coin d’atelier de graveur au XVIIIᵉ siècle, avec une gravure de portrait d’homme, en cours d’exécution, entourée des outils de l’artiste.
M. Poignant s’écriait, en 1877, dans une très intéressante étude sur les enseignes de Paris[148]: «Dans quels{198} coins moisissent, si elles moisissent encore, les belles enseignes de la Restauration: les Architectes canadiens, rue Dauphine; les Deux Gaspard[149], les Deux Philibert, les Trois Innocents, boulevard Poissonnière et boulevard Bonne-Nouvelle? Où sont les Danaïdes, l’Avocat Patelin, le Débarquement des Chèvres du Thibet, qui, de 1820 à 1830, faisaient l’admiration des badauds et la joie des enfants?
Ce vers de Villon, qui termine cette plaintive évocation au sujet des enseignes de Paris aujourd’hui disparues, peut-être négligées et oubliées dans quelque ville de province ou de l’étranger, peut-être passées à l’état de planches dans quelque ouvrage de menuisier, peut-être brûlées et détruites; ce vers de Villon, si mélancolique et si touchant, revient plusieurs fois dans la ballade célèbre où le poète se demandait ce qu’étaient devenues Héloïse, Jeanne d’Arc et bien d’autres femmes illustres que la mort avait mises en poussière depuis tant d’années et qui eurent les honneurs de l’enseigne dans un temps où l’enseigne ne respectait rien.
On s’explique comment des écrivains et des poètes romantiques se sont passionnés pour de vieilles enseignes, et comment ils ont poussé la passion jusqu’à les enlever nuitamment, à leurs risques et périls, comme le berger Pâris enleva Hélène. Un ami de Jules Janin nous a raconté que ce prince des critiques, après avoir fait partie de la bande joyeuse de Romieu, qui s’amusait à décrocher les enseignes dans le faubourg Saint-Germain et à les changer de bou{199}tique, à la plus grande stupéfaction des propriétaires de ces enseignes, s’était amendé et avait pris l’enseigne au sérieux, à tel point qu’il en avait emporté chez lui deux ou trois des plus portatives pour orner son cabinet de travail, ou plutôt sa petite chambre de la rue Saint-Dominique-d’Enfer. «Ce sont là, disait-il, mes trophées de jeunesse.»
Un autre fantaisiste de la plume, un véritable curieux dans toute l’acception du mot, mon bon confrère Champfleury, avait bien voulu m’adresser une aimable et spirituelle lettre, dont je me permets de transcrire ce passage: «J’ai, à la maison, une enseigne du XVIIIᵉ siècle, en bois sculpté, enseigne de marchand de vin, avec une légende incompréhensible. Je l’ai décrochée, il y a tantôt trente ans, dans une nuit de folles aventures, et je ne m’en repens pas, ayant sauvé un monument du quai de la Mégisserie à l’époque des racoleurs: un garde-française, assis dans un cabaret aux murs duquel sont accrochés de nombreux brocs, tend son pot en l’air. Dans un ruban contourné au-dessous de la sculpture, on lit: Au Ban (?). L’enseigne était coloriée; les habits du soldat portent traces du rouge, et le travail du bois, quoique grossier, est curieux par son cartouche. Ce fut ma fin de jeunesse, quoique à l’occasion je me sente encore capable de recommencer un Musée de la nature de celui dont j’ai fait l’aveu dans les Souvenirs des Funambules (p. 243 à 245, édition Lévy). Je ne vous cite pas ce passage par gloriole, mais ce sont des dates que ces décrochements d’enseigne. Les collégiens décrochent-ils encore aujourd’hui des enseignes? L’enseigne a-t-elle aujourd’hui le côté tentateur d’autrefois? J’appelle votre attention sur ces briseurs d’images de la fin de la Restauration. Ce{200} fut une école, de 1830 à 1844; j’en devins un des plus ardents sectaires[150].»
Mon confrère Champfleury, en commettant ce pieux larcin, semblait prévoir que les enseignes peintes et sculptées ne tarderaient pas à disparaître, et qu’il fallait en conserver à tout prix les derniers monuments authentiques. Quant à la légende de son enseigne, qui avait été certainement, comme il l’a si bien deviné, celle d’une boutique de racoleur au XVIIIᵉ siècle, faut-il lire: Au Ban, ou bien: Au Bau? Le ban était, en termes de féodalité, «la convocation que le prince faisait de la noblesse pour le servir à la guerre,» suivant la définition du Dictionnaire de l’Académie française; mais, en plein XVIIIᵉ siècle, on ne parlait plus guère de ban. Il faut donc lire: Au Bau, sur cette vieille enseigne. Le pauvre imprudent ou innocent racolé, qui se laissait enrôler au service du roi en vidant des pots de vin bleu avec son pêcheur d’hommes ou son vendeur de chair humaine, ne savait peut-être pas que le bau de l’enseigne du marchand de vin n’était autre qu’un grand filet que l’on traîne dans la rivière et qui ramasse tout ce qu’il rencontre sur son chemin.{201}
ON ne connaît qu’un très petit nombre de ces sortes d’enseignes, qui ont dû être fort multipliées, mais dont le souvenir n’a été ni recueilli ni conservé. Nous les diviserons en deux catégories distinctes, en donnant à chacune d’elles un ordre chronologique, d’après les faits indiqués et commémorés jusqu’en 1789, sans comprendre dans cette double nomenclature les enseignes modernes, qui ont eu souvent un caractère et même une origine historiques, mais qui se trouveront mieux à leur place dans l’ensemble de cet immense Pandémonium de tableaux d’enseignes que le Paris du XIXᵉ siècle s’était fait pour obéir au goût du jour et au despotisme de la mode.
Les deux catégories d’enseignes que nous allons passer{202} en revue dans ce chapitre comprendront: 1º les enseignes qui se rattachent ou qui semblent se rattacher à des personnages de notre histoire; 2º les enseignes qui ont trait à des traditions, à des usages, à des événements historiques de toute nature et qui représentent à diverses époques les idées et les préoccupations du peuple de Paris.
Il y avait en 1718, «derrière le cloître Saint-Marcel», au faubourg Saint-Marceau, une hôtellerie à l’enseigne de la Reine Blanche[151], appartenant à Mᵐᵉ Peloton. Cette enseigne rappelait non seulement que les veuves des rois de France prenaient le nom de reines Blanches, puisque ces veuves devaient porter toute leur vie le deuil de leur mari, en vêtements blancs; mais encore elle désignait une maison bâtie sur l’emplacement d’un hôtel de la Reine Blanche, que Blanche de Navarre, seconde femme de Philippe de Valois, avait occupé, durant son veuvage, «dans le voisinage peut-être de l’église Saint-Marcel, et d’une rue qu’on ne nomme point autrement, dit Sauval, que la rue de la Reine-Blanche[152]». L’hôtel de la Reine Blanche subsistait encore en 1392, puisque c’est là que Charles VI faillit être brûlé vif dans la tragique mascarade des Hommes sauvages. Sauval a trouvé dans les pièces d’archives du vieux Paris la mention de plusieurs autres hôtels appartenant aux Reines Blanches[153]. Faut-il attribuer une pareille origine à l’enseigne d’un cabaret qui existait autrefois à l’entrée du passage du{203} Dragon, en face de la rue Gozlin, jadis rue Sainte-Marguerite, et qui s’était ouvert sous les auspices du Dragon de la Reine Blanche? Quelle était cette reine Blanche? Peut-être celle qui avait habité, selon la légende, un vaste hôtel de la rue du Vieux-Colombier, presque au coin de la rue de l’Égout-Saint-Germain, sur laquelle s’ouvrait alors l’entrée du passage. Quant au Dragon, c’était certainement celui qui figure encore au-dessus de la porte monumentale du passage et dont nous avons donné la figure à la page 40 de ce livre.
A la fin du XVIᵉ siècle, l’enseigne historique s’était montrée dans celle du château de Milan, qui rappelait l’occupation du duché de Milan par les Français pendant le règne de Louis XII. La ville de Calais fut reprise sur les Anglais, en 1558, par le duc de Guise, et le souvenir de cette importante conquête, qui rattachait à la France une de ses bonnes villes maritimes qu’elle avait perdue depuis 1347, survivait à l’événement, vingt-six ans plus tard, dans une enseigne représentant la prise de Calais[154]. On peut affirmer, du moins, que cette enseigne mémorable ne faisait pas allusion au siège que cette ville avait soutenu contre Édouard III. Il est difficile de préciser quelle pouvait être une autre enseigne historique, A l’Armée de Charles-Quint, que Noël du Faïl avait signalée dans ses Baliverneries ou Contes nouveaux d’Eutrapel, imprimés pour la première fois en 1548. Eutrapel se vante d’avoir su attraper monnoie, ce qui le rendit «sain et sauf, jusques à l’hostel, avec l’espée et la dague, bien en poinct, non pas comme toy, dit-il à Lupolde, comme toy{204} qui vendis, dès Palaiseau, ton braquemard, revenant à Paris, lorsque la peur s’y vint loger à l’enseigne de l’Armée de l’empereur Charles-Quint[155]». Nous supposons que cette armée était celle qui envahit la Provence en 1536, et qui, après avoir répandu l’épouvante dans tout le royaume, fut bientôt forcée de se retirer, en perdant la moitié de ses soldats, décimés par la maladie et la disette. Au reste, la mention de cette enseigne, peut-être imaginaire, ressemble fort à une boutade satirique.
L’enseigne du Petit Suisse, qu’on voit encore sur le quai du Louvre, doit être un souvenir du corps de garde des Suisses, qui était là tout auprès, vers le milieu du XVIIᵉ siècle[156]: «Entre cette maison (le Petit-Bourbon) et le Louvre, disent deux Hollandais qui vinrent à Paris en 1657, il y a une petite place où l’on voit les corps de gardes françois et suisses: ils s’y mettent en haye toutes les fois que le roy sort, et presque tous les matins, lorsque S. M. va entendre la messe à la chapelle du Petit-Bourbon[157].» L’enseigne du Puits, que l’on voyait autrefois dans la rue de la Ferronnerie, avait aussi une tradition, sinon une origine historique. Selon nos deux voyageurs hollandais, qui ne quittèrent la rue Saint-Denis qu’à l’endroit où elle aboutit avec celle de la Ferronnerie, «on y montroit encore le puits où le traistre Ravaillac se cacha pour oster la vie à Henri IV[158].» On a vu longtemps dans la rue de la Ferronnerie l’enseigne du Cœur{205} couronné percé d’une flèche, pendant à la maison en face de laquelle le roi fut tué. Ce Cœur couronné, qui est expressément désigné dans les Lettres de Malherbe, fut remplacé par un buste de Henri IV. Il y avait aussi dans la rue Froidmanteau, qui a disparu lors de la construction du nouveau Louvre de Napoléon III, une enseigne: Au roi Henri, lequel n’était pas Henri IV, puisque la maison et l’enseigne dataient de 1563[159]; mais la maison ayant été reconstruite en 1606, on conserva l’enseigne en l’appliquant à Henri IV, dont la statue en pierre subsista jusqu’en 1792; cette statue, détruite par la Révolution, avait été remplacée, sous la Restauration, par une mauvaise peinture à l’huile[160].
Nous avons un curieux exemple de la renaissance de l’enseigne historique plus d’un siècle après l’événement qu’elle reproduisait. Le comte d’Egmont, qui avait voulu délivrer les Pays-Bas du joug des Espagnols, fut arrêté par ordre du duc d’Albe et décapité en 1568; quelques hôteliers de Paris, sans doute en haine des Espagnols, imaginèrent de représenter sur leur enseigne, en 1648, la tête du comte d’Egmont posée dans un plat, comme celle de saint Jean-Baptiste. Mazarin, à cette époque, préparait déjà le traité des Pyrénées et le mariage du roi avec l’infante d’Espagne Marie-Thérèse: défense fut faite, sous peine de prison et d’amende, de prendre pour enseigne cette tête coupée[161]. Nous avons vu chez notre confrère et ami M. Paul Lacroix un tableau représentant la tête, dans un plat, du comte d’Eg{206}mont, bonne peinture qui pourrait avoir été une enseigne.
Il y avait dès lors des enseignes sur lesquelles le jeune roi Louis XIV était représenté, avec le titre d’empereur, qu’il se donnait, en effet, dans ses relations diplomatiques avec les souverains mahométans, qui se qualifiaient de même, comme l’empereur du Maroc[162]. Il ne faut pas oublier non plus que les marchands étrangers qui ouvraient boutique à Paris se plaisaient souvent à évoquer dans leurs enseignes une réminiscence de leur pays: ainsi, pendant la guerre terrible que Louis XIV faisait à la Hollande, un marchand hollandais, établi à Paris, où le retenait son commerce, avait pris pour enseigne: A la Paix perpétuelle[163]. La police, si défiante et si chatouilleuse à cette époque, ne paraît pas s’en être préoccupée plus que de l’enseigne suivante: «Au mois d’octobre 1742, raconte Barbier dans son Journal historique et anecdotique du règne de Louis XV, tous les passants, et surtout les étrangers, s’arrêtent pour lire une enseigne, élevée dans la rue Saint-Antoine, qui annonce la boutique par ces mots: A l’Empereur des François; elle a paru singulière et occasionne beaucoup de raisonnements.»
Quant aux enseignes qui portaient des inscriptions historiques, il fallait souvent s’en défier, car elles étaient tantôt antérieures et tantôt postérieures à la date qu’on pouvait leur assigner. Par exemple, l’hôtel Jean-Jacques Rousseau, rue des Cordiers, avait pris cette enseigne plusieurs années après l’époque où J.-J. Rousseau y avait demeuré lors de{207} son premier voyage à Paris; et une seconde fois en 1745. L’hôtel de l’Empereur Joseph, rue de Tournon, qui s’appelait d’abord hôtel de Tréville, paraît avoir pris ce nom et cette enseigne quelques années avant le voyage que l’empereur Joseph II fit à Paris, sous le nom de comte de Falkenstein, en 1777; seulement, après le séjour de l’empereur, il compléta son enseigne en s’intitulant hôtel de l’Empereur Joseph II[164]. On s’exposait aussi à faire d’étranges erreurs en cherchant une enseigne célèbre dans une rue où elle n’avait jamais été. Les historiens de la Révolution se sont répétés l’un l’autre en racontant que la veille du 10 août 1792 Westermann, Santerre et les autres chefs de la conspiration révolutionnaire, qui devaient le lendemain attaquer la royauté dans le palais des Tuileries, s’étaient rassemblés secrètement à l’hôtel du Cadran bleu, dans la rue Saint-Antoine, pour dresser les plans de leur entreprise; mais il n’y eut jamais d’auberge du Cadran bleu dans la rue Saint-Antoine. C’est dans la rue de la Roquette que cette auberge existait d’ancienne date, et c’est là qu’eut lieu la réunion des conjurés[165].
J’arrive à la seconde catégorie des enseignes historiques ou commémoratives: ce sont celles qui n’ont pas de date certaine et qui semblent avoir été inaugurées en mémoire de quelque fait plus ou moins connu et plus ou moins authentique. C’est en quelque sorte le témoignage figuré d’une tradition parisienne.{208}
Il y avait à Paris, en 1280, une enseigne de maison, A la Ville de Jérusalem, enseigne qui ne pouvait être qu’un souvenir des croisades, et même de la dernière, celle de Louis IX, qui se termina par la mort de ce saint roi, devant Tunis, le 25 août 1270. C’était peut-être aussi une pieuse réminiscence de la part d’un pèlerin au retour de la terre sainte[166]. L’enseigne de l’Arbre sec, lequel donna son nom à une rue qui le porte encore, était également un souvenir de quelque pèlerinage en Orient. Cette tradition orientale est ainsi rapportée dans le livre de messire Guillaume de Mandeville[167]: «A deux lieues d’Ébron est la sépulture de Loth, qui fut fils au frère Abraham, et assez près d’Ébron est le Membré, de qui la vallée prend son nom. Là il y a un arbre de chein, que les Sarrazins appellent Jape, qui est du temps Alozohuy, que l’on appelle l’Arbre sech, et dit-on que cet arbre a là esté depuis le commencement du monde, et estoit tousjours vert et feuillu, jusques à tant que Nostre-Seigneur mourust en la croix; et lors il seicha, et si firent tous les arbres par l’universel monde, ou ils chéirent, ou le cuer dedans pourrist, et demourèrent du tout vuides et tout creux par dedans: dont il y en a encore maint par le monde.»
Les récits mensongers des voyageurs, au retour de leurs voyages dans les pays lointains, s’étaient reflétés pour ainsi dire dans les enseignes, qui représentaient des animaux extraordinaires ou fabuleux, des plantes imaginaires, des curiosités naturelles plus ou moins étranges et fantastiques. Ainsi, on avait vu longtemps dans la rue de la{209} Licorne une enseigne représentant cet animal, qu’on disait avoir été amené d’Afrique à Paris sur la fin du XVᵉ siècle, et dont la corne avait été déposée, après sa mort, dans le Trésor de l’abbaye de Saint-Denis. Ainsi retrouvait-on, dans les enseignes, la Syrène, l’Hydre aux sept têtes, le Mouton végétal, la Fontaine ardente, le Merle blanc, le Singe vert, etc.; en un mot, toutes les bêtes prodigieuses, toutes les singularités de la nature tropicale qui avaient figuré dans les relations de voyages aux Indes depuis celles de Marco Polo et de Mandeville. Il y a eu au XVIIIᵉ siècle, par exemple, quinze ou vingt enseignes sur lesquelles le singe vert était représenté; aujourd’hui nous ne connaissons qu’une seule enseigne, aux Singes verts, dans le passage Choiseul.
L’enseigne du Puits d’Amour, dont nous avons parlé plusieurs fois[168], devait son nom à un ancien puits situé à la pointe d’un triangle que formaient les rues de la grande et de la petite Truanderie avec celle de Mondétour. Une jeune fille nommée Hellebik, dont le père tenait un rang considérable à la cour de Philippe-Auguste, se voyant trahie et abandonnée par son amant, s’était précipitée dans ce puits et y avait trouvé la mort qu’elle cherchait. Ce fut l’origine de la célébrité du Puits d’Amour. Un écrivain moderne, qui ne cite aucune autorité sérieuse, rapporte qu’un prédicateur, qui prêchait à Saint-Jacques de l’Hôpital, dénonça en chaire avec tant de zèle et d’éloquence «les rendez-vous qu’on se donnait tous les soirs à ce puits, les chansons qu’on y chantait, les danses lascives qu’on y dansait, les serments qu’on s’y faisait, comme sur un autel, et tout ce qui s’ensuivait, que les pères et mères, les dévots et les dévotes s’y transportèrent à l’instant et le comblèrent[169]». Sauval, en effet, rapporte qu’il l’avait vu presque comblé. Il n’y eut probablement pas d’autre Puits d’Amour, mais on vit les enseignes du Puits d’Amour se répéter dans différents quartiers, car, disait Henry Sauval, «plusieurs marchands ont trouvé cette enseigne faite à leur gré, et d’autant plus qu’ils s’imaginèrent que les enseignes plaisantes, ou qui se font remarquer, attirent les chalands[170]».
L’enseigne du Chien, rue des Marmousets, au coin de la{211} rue des Deux-Hermites, était celle d’une maison qui fut rebâtie sur l’emplacement d’une autre maison démolie, au XVᵉ siècle, en vertu d’un arrêt du Parlement contre le pâtissier qui faisait des pâtés de chair humaine avec les corps des victimes auxquelles son voisin le barbier avait coupé la gorge. Il n’y avait pas de légende mieux établie dans la Cité, et l’on se rappelait traditionnellement que la place où s’élevait la demeure des deux scélérats était restée vide et maudite pendant un siècle. Une haute borne, appuyée contre la maison et profondément enfoncée dans le sol, conservait, affreusement mutilée, l’image du chien qui fit découvrir l’effroyable association du barbier et du pâtissier[171]; l’animal grattait la terre de ses pattes et tenait un os dans sa gueule. En 1848, une fruitière y adossait son étalage et achevait de la dégrader. Un antiquaire, M. Th. Pinard, fit sur la pauvre pierre commémorative une notice qui fut publiée, avec le dessin qui l’accompagnait, dans la Revue archéologique de cette année-là[172]. Lors de la transformation de la Cité sous le règne de Napoléon III, le bibliophile Jacob adressa un mémoire à M. Haussmann, préfet de la Seine, pour le prier de vouloir bien faire surveiller l’enlèvement de la borne historique de la rue des Marmousets; ce qui fut fait vers 1864. Cette pierre fut déposée dans les magasins de la ville et réservée pour le Musée archéologique municipal. Nous ignorons ce qu’elle est devenue depuis.{212}
Nous avions vu, il y a vingt-cinq ans, dans la rue du Monceau-Saint-Gervais, une ancienne enseigne, avec cette inscription: A l’Orme Saint-Gervais. Elle représentait un vieil arbre, à l’écorce rugueuse, dont le pied était entouré d’un parapet de pierre en forme de puits. Il est probable que c’est la même enseigne qu’on retrouve aujourd’hui dans la rue du Temple. L’orme de Saint-Gervais est resté debout, en face de l’église, pendant plus de trois siècles: c’était sous son ombrage que se tenait autrefois, après la messe, un tribunal de simple police; c’était là aussi que se payaient certains impôts de voirie. Cet arbre vénérable a subsisté longtemps après la reconstruction de l’église sous Louis XIII; les vues gravées au XVIIIᵉ siècle le repré{213}sentent encore bordé de sa margelle de pierre. Ingres avait fait don au Musée de la ville de Paris d’une peinture du XVIᵉ siècle représentant les danses populaires sous un arbre qui pourrait bien être l’orme de Saint-Gervais, dans les branches duquel les musiciens ont établi leur orchestre en plein vent. L’attribution peut sembler un peu risquée; en tout cas, on en peut juger de visu au musée Carnavalet, où se trouve encore ce curieux tableau échappé par miracle à l’incendie de 1871.
Une image de saint Fiacre, qui servait d’enseigne à une maison de la rue Saint-Antoine où on louait des carrosses, donna, selon Sauval, le nom de fiacre à ces carrosses de louage, sous le règne de Louis XIII. Quinze ou vingt ans plus tard, un certain Nicolas Sauvage, facteur du maître des coches d’Amiens, loua dans la rue Saint-Martin, vis-à-vis de celle de Montmorency, une grande maison appelée, dans quelques anciens papiers terriers, l’hôtel Saint Fiacre, «parce qu’à son enseigne étoit représenté un autre saint Fiacre, qui y est encore,» dit Sauval. Nous avons établi ailleurs que le premier qui s’avisa d’avoir de ces sortes de voitures publiques s’appelait Fiacre et demeurait rue Saint-Thomas-du-Louvre. Il devint le parrain de ses successeurs. N’est-il pas tout naturel que deux des premiers se soient installés dans des maisons portant l’enseigne de Saint Fiacre[173]? «Non seulement, ajoute Sauval, le nom de fiacre fut donné aux carrosses de louage et à leurs maîtres, mais aussi aux cochers qui les conduisoient, et même je pense que cette manière de gens a pris saint Fiacre pour patron.» Malheureusement, ce{214} nom ne fut pris qu’en mauvaise part, lorsque les entrepreneurs ne fournirent plus au public que de vieux chevaux fourbus, des carrosses mal tenus et sans rideaux, et des cochers mal habillés et malpropres.
L’enseigne des Trois Canettes, au numéro 18 de la rue de ce nom, est peut-être le produit de la légende de la cane de Montfort. «Je m’assure aussi, écrit Mᵐᵉ de Sévigné à Mademoiselle de Montpensier (30 octobre 1656), que vous n’aurez jamais ouï parler de la cane de Montfort, laquelle tous les ans sort d’un étang avec ses canetons, passe au travers de la foule du peuple en canetant, vient à l’église et y laisse de ses petits en offrande.» Cette légende a été recueillie, par un chanoine de Sainte-Geneviève, dans le Récit véritable de la venue d’une cane sauvage depuis longtemps en{215} l’église de Saint-Nicolas de Montfort (ou Montfort-la-Cane, Ille-et-Vilaine), dressé par le commandement de Mademoiselle[174]. Enseigne et légende, c’était tout un, autrefois.
L’enseigne du Louis d’argent, que la voix populaire au XVIIIᵉ siècle avait surnommé le Louis des Frimaçons, était alors le point central de la réunion des membres de la première société secrète des francs-maçons. Ce fut dans le cabaret de la rue des Boucheries, cabaret dont le patron était un traiteur anglais nommé Hure, que fut constituée, le 7 mars 1729, la première loge des francs-maçons de Paris, par Lebreton, imprimeur de l’Almanach royal[175].
Nous finirons ce chapitre en rappelant une enseigne historique qui ne fut comprise par personne, lorsqu’un charcutier lyonnais nommé Cailloux vint l’arborer, en 1777, sur sa boutique à l’entrée de la rue des Petits-Champs (aujourd’hui nº 5): A l’Homme de la Roche de Lyon. Cette enseigne était encore inexplicable pour les Parisiens, quand M. Étienne, successeur du charcutier lyonnais, la fit repeindre en 1816. On lisait, en effet, dans la Chronique de Paris, numéro du 29 juillet 1816: «Les fortes têtes du quartier cherchent en vain quel rapport il y a entre un chevalier et des saucissons.» Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire ici, en la complétant un peu, la notice que Balzac a consacrée à l’Homme de la Roche de Lyon: «Bon Dieu! qu’ai-je aperçu? Un chevalier cuirassé, dont le front est couvert d’un casque à visière, au milieu des boudins en bois, des saucisses, des hures en peinture, em{216}blèmes chers aux gastronomes de la petite propriété. Mais, se demande-t-on, que fait, au milieu des pieds de cochon, ce preux chevalier? Pourquoi cette bourse qu’il offre à tout venant? Or, sachez qu’il y avait autrefois à Lyon un certain M. Jean Fléberg, né à Nuremberg en 1485, grand guerrier en même temps qu’officier de bouche de François Iᵉʳ, qui, riche et généreux, dotait de 300 francs, chaque année, vingt-cinq jeunes filles, comme de raison sages, et dans ce temps-là il y en avait beaucoup; qui sauva la ville d’une famine, fonda son célèbre hôpital, et mourut en 1546 à l’âge de soixante-deux ans. On lui a élevé un monument dans le quartier qu’il habitait, appelé la Roche ou le Bourgneuf, et deux fois la reconnaissance des Lyonnais a relevé le monument que le vernis du temps n’avait pu conserver. M. Étienne, en se plaçant sous les auspices de Jean Fléberg, a voulu prouver qu’il était de Lyon; mais, compatriote de l’Homme aux bienfaits, a-t-il hérité des pieuses dispositions de l’Homme de la Roche? Ceci ne nous regarde pas; tout ce que nous pouvons dire, c’est qu’il a une boutique fort appétissante et une enseigne riche en souvenirs.
«Nous oubliions de dire que Louis XVI a ordonné, en mémoire de Fléberg, que trois filles sages seraient dotées encore tous les ans. Allons, jeunes beautés, sages et modestes, on donne encore à Lyon trois prix de vertu[176]!»
M. Dronne, successeur de M. Étienne, a pieusement, de nos jours, redoré son enseigne (nous allions dire son{217} blason); et le fac-simile de l’antique statue de Jean Fléberg illustre toujours la devanture de la boutique, où, tout en perfectionnant l’art de la charcuterie, il a trouvé moyen de consacrer à son histoire un beau volume curieusement illustré[177].{218}
LES documents nous manquent pour donner à ce chapitre l’étendue et l’importance qu’il devrait avoir, car on ne saurait douter que dans une foule de circonstances les enseignes n’aient servi à exercer des vengeances ou des représailles plus ou moins motivées, plus ou moins déguisées, et cela sans doute à toutes les époques. Mais dans la plupart des cas il suffisait de la décision et de l’injonction d’un commissaire de police pour faire disparaître l’enseigne qui causait du scandale ou qui excitait des rumeurs dans le quartier. Il y eut certainement, néanmoins, des inspirateurs d’enseigne plus obstinés et plus batailleurs que d’autres pour défendre devant les tribunaux de simple police, ou même devant les Chambres et la Cour du{219} Parlement, le droit de maintenir une enseigne qui n’était ni indécente, ni injurieuse, ni impie, mais qui blessait seulement la susceptibilité exagérée de quelques particuliers. Ce sont les pièces de ces procès à propos d’enseignes qu’il faudrait rechercher dans la poussière des archives judiciaires, mais nous n’avons trouvé, sur ce sujet curieux, que des indications sommaires et assez vagues. On peut, toutefois, se faire une idée du rôle que les enseignes jouaient dans les querelles des bourgeois et des marchands, quand on se rappelle l’usage que le clergé du moyen âge fit d’une espèce d’enseigne, en plaçant à l’entrée du chœur de Notre-Dame un marmouset hideux, en pierre, qui n’était autre que la caricature du savant jurisconsulte Pierre de Cugnière, avocat du roi sous le règne de Philippe de Valois. Pierre de Cugnière avait osé, dans l’assemblée des États généraux de 1329, s’attaquer à l’autorité ecclésiastique, en soutenant les droits du roi, le temporel contre le spirituel: ce fut pour se venger de cet adversaire que son image satirique devint pendant plus de deux siècles un objet de mépris et de dérision, ne servant qu’à éteindre les cierges de la cathédrale. Le peuple, ignorant l’origine de ces insultes vindicatives, allait brûler des cierges devant l’enseigne de M. de Cugnet et les éteignait sous le nez de ce marmouset couvert de cire et noirci de fumée.
Un petit livre populaire, intitulé les Rues de Paris et imprimé en gothique vers 1493, assure qu’on brûlait ainsi pour deux cents livres de bougies par an, et dans beaucoup d’églises de France on voyait à quelque encoignure de l’édifice une enseigne du même genre, une{220} figure grimaçante, qu’on employait aussi à éteindre les cierges[178].
Il ne faisait pas bon se mettre en lutte avec le clergé, même sur la question des enseignes, mais les luttes de cette espèce furent sans doute assez rares et finirent toujours par la condamnation et la suppression des enseignes que l’autorité ecclésiastique avait jugées attentatoires au respect des choses saintes. Nous avons rappelé ailleurs (chap. XVI), d’après Tallemant des Réaux, le procès que le curé de Saint-Eustache dut intenter contre un cabaretier de la rue Montmartre, qui avait pris pour enseigne la Tête-Dieu. Cette enseigne était certainement injurieuse, moins par son nom de Tête-Dieu que par la représentation de cette tête, car il y eut des enseignes en l’honneur de la Véronique qui ne scandalisèrent personne. Ces enseignes impies, ou plutôt simplement indécentes, ne se montrèrent probablement qu’à l’époque des guerres de religion, au XVIᵉ siècle.
C’est également à cette époque qu’il faut faire remonter l’apparition momentanée de pareilles enseignes. «On n’épargnait pas même la religion, dit M. Amédée Berger dans son excellent travail sur les enseignes[179], et souvent la police fut obligée d’intervenir pour faire enlever des inscriptions telles que le Juste Prix (le Christ enchaîné), le Cerf mon (le sermon), le Cygne de la croix (le signe de la croix), le Singe en batiste (le saint Jean-Baptiste), et autres incon{221}venances qui se trouvaient jusque sur les façades des maisons de débauche.» Nous avions cru reconnaître, dans un passage des Règles, Statuts et Ordonnances de la Caballe des filous, pièce facétieuse du XVIIᵉ siècle, la caricature de ce Singe en batiste: «Un homme de chambre, botté, fraisé comme un veau, gauderonné comme un singe», et nous avions dit, à ce propos: «Une vieille enseigne de Paris représentait un de ces magots ainsi accoutrés, avec cet affreux calembour pour légende: Au Singe en batiste[180].» Ce n’est pas le personnage de cette caricature que la police avait pu mettre à l’index, mais seulement l’inscription, qui n’était qu’un jeu de mots malsonnant. Pierre de l’Estoile, dans son Journal du règne de Henri IV, rapporte une facétie non moins impertinente, que s’était permise, en 1610, un des écrivains satiriques qui raillaient impunément la Ville et la Cour, sous le pseudonyme de maître Guillaume, lequel avait rempli l’office de fou du roi. Le savant canoniste Jacques Gillot, conseiller au Parlement de Paris, ayant rassemblé et publié, par ordre de Henri IV, un recueil des Libertés de l’Eglise gallicane, on supposa que maître Guillaume avait écrit au pape: «Je vous advise que j’ay mis un bouchon et une enseigne aux Libertés de l’Eglise gallicane, pour dire qu’ici se vend le bon vin.» Nous ne croyons pas, cependant, que les Libertés de l’Eglise gallicane aient donné lieu à une enseigne politique, dont le sens eût échappé à presque tout le monde.
«La politique avait peu de part à cette ornementation des rues, dit M. Amédée Berger dans son étude sur les{222} enseignes[181], et nous ne connaissons, en fait d’allusion aux affaires du temps, que le fait de ce marchand parisien, cité par Monteil, qui, pendant le siège de Paris, voulant bien vivre, et à peu de frais, avec tout le monde, avait écrit d’un côté de son enseigne: Vive le roi! et de l’autre: Vive la Ligue! et qui, suivant les circonstances, tournait et retournait son tableau.» Il faut descendre jusqu’à la Révolution de 1789 pour voir l’enseigne politique se produire effrontément, mais non pas toujours sans péril. On n’avait pas eu jusque-là d’autres enseignes politiques que celles des logements imaginaires que la satire attribuait aux plus grands personnages de l’Etat. Nous donnerons quelques détails sur ces enseignes imaginaires dans notre chapitre XX.
Mais si l’enseigne satirique n’osait pas s’attaquer en pleine rue aux chefs du Gouvernement et critiquer leurs actes par des caricatures ou des inscriptions plus ou moins transparentes, elle ne se faisait pas faute de vengeances personnelles, en ridiculisant des individualités quelquefois honorables et dignes de respect. Nous avons déjà vu, page 34, une maison prendre, en 1671, l’enseigne burlesque du Chat lié, par allusion malveillante à un propriétaire voisin qui s’appelait Challier. «Il y a, rapporte Tallemant des Réaux, un plumassier de la rue Saint-Honoré qui a pris pour enseigne le Grand Cyrus et l’a fait habiller comme le maréchal d’Hocquincourt[182].» En effet, Mˡˡᵉ de Scudéry, dans son roman du Grand Cyrus, où la plupart des personnages sont des contemporains avec des noms perses et grecs,{223} avait représenté le maréchal d’Hocquincourt sous les traits du roi Cyrus. Il ne semble pas que le maréchal se soit fâché d’être métamorphosé en héros de roman et travesti en matamore dans une enseigne. A cette époque la caricature s’était emparée des Espagnols, qu’on représentait partout avec le costume le plus extravagant et le plus ridicule. Abraham Bosse en avait fourni le meilleur type dans ses estampes. On peut supposer que ces Espagnols grotesques ne furent pas épargnés sur les enseignes, puisque, par raillerie, les montreurs de bêtes savantes habillaient à l’espagnole leurs chiens et leurs singes, avec larges fraises gauderonnées.
Une enseigne qu’on peut regarder comme une satire ad hominem se voyait dernièrement encore, rue de l’École-de-médecine, au coin de la rue de l’Ancienne-Comédie. Il est probable que sa mystérieuse singularité n’a pas nui à sa conservation. «On voit sculpté sur une grande pierre{224} incrustée dans le trumeau qui sépare les deux croisées du premier étage de la maison, dit E. de la Quérière dans ses Recherches historiques sur les Enseignes (1852), un chapeau rond, à larges bords, dont un côté est retroussé dans la forme usitée parmi la bourgeoisie du temps de Louis XIV. Ce chapeau est comme suspendu au-dessus d’une lunette de fortification, autrement dit ouvrage à cornes. Le sculpteur avait-il voulu faire de cette enseigne une malicieuse épigramme? Nous serions porté à le croire.» C’était sans doute l’enseigne d’un chapelier. La légende portait: Au Chapeau fort, équivoquant sur le mot Château fort; mais bien aussi sur les ouvrages à cornes que ledit couvre-chef était destiné à coiffer. L’enseigne du Chapeau fort est aujourd’hui conservée au musée Carnavalet.
Tallemant des Réaux nous raconte ainsi une vengeance par le moyen de l’enseigne: «Un commis borgne ayant exigé d’un cabaretier des droits qu’il ne lui devoit pas, le cabaretier, pour se venger, fit représenter le portrait du commis, à son enseigne, sous la forme d’un voleur, avec cette inscription: Au Borgne qui prend. Le commis, s’en trouvant offensé, vint trouver le cabaretier et lui rendit l’argent des droits en question, à la charge qu’il feroit réformer son enseigne. Le cabaretier, pour y satisfaire, fit seulement ôter de son enseigne le p, si bien qu’il resta: Au Borgne qui rend, au lieu du Borgne qui prend[183].»
Bonaventure d’Argonne raconte aussi la querelle d’un oiselier avec les Jésuites, à propos d’une enseigne: «Il y avoit autrefois dans la rue Saint-Antoine, à Paris, un oise{225}lier qui prenoit la qualité de gouverneur, précepteur et régent des oyseaux, perroquets, singes, guenons et guenuches de Sa Majesté. Ces grands titres paroissoient écrits en lettres d’or, dans un riche cartouche, au-dessus de la boutique de ce personnage. La plupart des passans qui lisoient ce bel écriteau n’en faisoient que rire, mais quelques pédans qui pensèrent y être intéressés, prenant la chose au point d’honneur, en firent du bruit et s’en plaignirent comme d’une profanation des titres les plus glorieux de la république des lettres. La chose vint aux oreilles du digne précepteur, et il disoit: «Je ne sais pas à qui en ont ces Messieurs. Mes écoliers valent bien les leurs, ils sont mieux instruits, et ne sont ni si sots ni si barbouillez.» L’abbé Boisrobert, à qui j’ai ouï raconter cette histoire, ajoutoit qu’il n’y avoit que du plus ou du moins entre les écoliers de cet homme et ceux de nos collèges, tout n’aboutissant qu’à faire faire aux uns et aux autres de certaines grimaces, ou dire des mots qu’ils n’entendent point[184].»
Le sujet de l’enseigne était quelquefois plus innocent que la légende, et l’on pouvait, par le commentaire, ajouter à cette légende un caractère de malignité qu’elle n’avait pas originairement. Ainsi, à la fin du premier Empire, quand Béranger eut publié sa fameuse chanson du Roi d’Yvetot, un marchand de vin de la rue Saint-Honoré, près de la rue, aujourd’hui disparue, de la Bibliothèque, tira de la chanson son enseigne. Il commanda et exposa au-dessus de sa boutique un joli tableau qu’il ne supposait pas certainement devoir prendre jamais un caractère séditieux. C’est{226} ce qui arriva cependant; on y vit, comme dans la chanson, une critique des guerres continuelles de Napoléon, et la police ordonna la disparition de l’enseigne. C’est alors que le rusé marchand la plaça dans l’intérieur de sa boutique, où elle est encore, au numéro 182 de la rue Saint-Honoré. La police n’entendait pas raillerie en matière d’enseignes.
La conscription, en s’établissant révolutionnairement avec toutes ses rigueurs, n’avait pas fait disparaître cependant les anciens bureaux de racolage du quai de la Ferraille, où l’enseigne du Racoleur attirait nombreuse clientèle depuis plus d’un siècle. L’arrêt d’expulsion de ces agents d’enrôlement volontaire se trouva formulé gaiement dans ce refrain d’un couplet de M. de Piis, secrétaire général de la préfecture de police:
Il y eut aussi, à cette époque, comme en tout temps, des querelles, des altercations, des procès pour cause de contrefaçon d’enseigne. Le fameux bureau de tabac de la Civette, place du Palais-Royal, fut en guerre ouverte contre toutes sortes de Civettes, qui avaient l’audace de dresser pavillon à peu de distance, sinon en face de l’enseigne primordiale. La contrefaçon usait de ruse pour jouir impunément du bénéfice de la concurrence.
Dans le nouveau passage Delorme, qui avait alors le privilège de centraliser la promenade des flâneurs, un marchand{228} nommé Mercier, ayant placé sa boutique sous l’invocation du Beau Dunois, que la romance de la reine Hortense venait de mettre à la mode, le locataire de la boutique voisine fit peindre, pour son enseigne, un beau chien blanc moucheté de brun, avec cette inscription: Au Beau Danois. Les rieurs prolongèrent le débat des deux marchands, mais la police refusa d’intervenir en faveur du héros de la romance.
La police de nos jours a été aussi prudente en restant neutre dans l’exhibition d’une enseigne, des plus cocasses, qu’un écrivain public avait apposée sur son échoppe, place de l’Hôtel-de-ville. Nous ne pouvons mieux faire que de transcrire la note publiée, à cet égard, dans le Figaro du 1ᵉʳ décembre 1881: «Cette enseigne est un mascaron ou tête d’homme, à face grimacière, à dents cassées, à chevelure abondante, grosses lunettes, bonne plume d’oie derrière l’oreille, et une paire de cornes magistrales sur lesquelles sont écrits en majuscules ces mots: Demandes en séparation, qui réjouiront le cœur de M. Naquet. Mais pourquoi des cornes? C’est l’enseigne d’un écrivain public, qui, pour bien indiquer sa spécialité aux aspirants au divorce, a arboré les redoutables appendices que les épouses folâtres font pousser sur le front des maris que vous savez.»{229}
NOUS ne reparlerons pas ici des images de saints et de saintes qui ornaient autrefois les enseignes de la plupart des maisons et des boutiques de Paris. Ces images multipliées témoignaient sans doute de la dévotion, qui était alors homogène et générale dans toutes les classes de la population parisienne; mais la plupart de ces bienheureuses images représentaient les corporations, les confréries et les métiers. Quelques-unes, il est vrai, rappelaient les noms de baptême des propriétaires ou des locataires de la maison; d’autres avaient été sans doute inaugurées par le fait d’une vénération spéciale à l’égard de tel ou tel saint, ou par suite d’un vœu particulier en leur honneur. Quant aux images de Notre-Dame, qui étaient si nombreuses dans{230} les enseignes, il faut les attribuer à cette dévotion si sincère, si touchante qu’on avait pour la sainte Vierge Marie, pour la mère de Jésus, le fils de Dieu et le rédempteur des hommes. La piété naïve du moyen âge rendait un culte permanent de respect et d’adoration à ces innombrables Notre-Dame, que les enseignes mettaient sous les yeux du peuple dans toutes les rues de la ville.
Il y eut aussi, depuis le XIIᵉ siècle jusqu’au XVIᵉ, des statues de la Vierge, dans des niches, à l’angle des rues, et quoique ces statues en pierre ou en bois, souvent peintes ou dorées, ne fussent que des enseignes, on leur rendait une espèce de culte public. Non seulement on allumait, la nuit, une lampe devant la niche qui contenait la Notre-Dame, mais encore on y suspendait des ex-voto et des médailles de confréries, on y attachait des bouquets de fleurs, surtout aux grandes fêtes de la sainte Vierge. Les passants saluaient et faisaient le signe de la croix, sans s’arrêter, quand ils avaient à traverser la rue; les femmes et les enfants s’agenouillaient et marmottaient une courte prière, quoique cette Notre-Dame ne fût souvent qu’une simple enseigne d’hôtellerie ou de cabaret. Ce n’étaient pas seulement les Notre-Dame qui avaient droit à ces hommages de la part des bonnes gens du peuple. Beaucoup d’images de saints et de saintes, qui n’étaient que des enseignes aux portes des maisons et des boutiques, avaient aussi des lampes qui brûlaient devant elles pendant la nuit. Ce pieux usage dura jusqu’au milieu du XVIᵉ siècle. Vers cette époque, plusieurs statues ou images de Notre-Dame furent l’objet d’outrages et de profanations qui diminuèrent le nombre de ces enseignes vénérées. C’est à partir de ce temps-là que les{231} niches qui contenaient des statues de Notre-Dame furent grillées, pour les préserver du fanatisme iconoclaste des huguenots, qui les brisaient à coups de pierres. On a lieu de s’étonner que quelques-unes de ces madones de la rue soient arrivées jusqu’à nous à peu près intactes. Le protestant Agrippa d’Aubigné remarquait avec quelque dépit qu’à la fin du XVIᵉ siècle il y avait encore dans toutes les rues de Paris un saint ou une Vierge dans sa niche[185].
Nous pouvons nous faire une idée du nombre d’enseignes de dévotion qu’on voyait dans les rues de Paris, en citant, d’après Berty, celles qui pendaient aux maisons dans les quartiers de la Cité, du Louvre et du bourg Saint-Germain.
CITÉ. RUE DE LA JUIVERIE, maison de l’Annonciation Notre-Dame (1485). RUE DE LA CALANDRE, maison du Paradis (1345). RUE SAINT-CHRISTOPHE, maison du Couronnement de la Vierge (1450).
LOUVRE. RUE CHAMPFLEURY, maison du Saint-Esprit (1489). RUE DU CHANTRE, maison ayant un Crucifix sur l’huis (1489), maison du Nom de Jésus (1687). RUE JEAN-SAINT-DENIS, maison du Saint-Esprit (1575), maison du Bon Pasteur (1680). RUE SAINT-HONORÉ, maison de l’Annonciation Notre-Dame (1432), maison de l’Enfant Jésus (1687), maison du Saint-Esprit (1575). RUE DU COQ, maison du Nom de Jésus (1623).
BOURG SAINT-GERMAIN. RUE DES BOUCHERIES, maison de l’Annonciation Notre-Dame (1522), maison de la Trinité (1527), maison du Seygne (cygne) de la croix. RUE DE BUCY, maison de l’Annonciation (1547). RUE DU FOUR,{232} maison de l’Agnus Dei, maison de la Véronique (1595). RUE DU PETIT-LION, maison de l’Image Notre-Dame (1523). RUE DE SEINE, maison de l’Arche de Noé (1654). RUE DES CANETTES, maison du Chef Saint-Jean (1500).
C’étaient là des enseignes de maison, et non des enseignes de boutique, qui furent beaucoup plus nombreuses et qui changèrent souvent, au XVIᵉ siècle, quand la religion réformée fit la guerre aux images de la Vierge et des saints; au XVIIᵉ siècle, quand l’influence des poètes athées de l’école de Théophile, de Saint-Amant[186] et de Desbarreaux s’exerça jusque sur les enseignes de dévotion, qui poursuivaient leurs regards dans toutes les rues de Paris et qui leur adressaient une sorte de reproche, même à la porte des cabarets; au XVIIIᵉ siècle, enfin, quand l’action sarcastique des philosophes et des encyclopédistes répandit dans les familles bourgeoises l’hérésie d’une nouvelle secte d’iconoclastes irréligieux. Puis, vint la révolution de 93, qui n’eut pas de peine à faire disparaître les dernières enseignes, dans lesquelles s’était perpétuée une pieuse tradition de nos ancêtres. On ne s’expliquerait pas que quelques-unes de ces vieilles enseignes aient pu échapper à la fureur inquisitoriale de la persécution républicaine, si l’on ne savait pas les miracles de courage, d’adresse et de dévouement que la foi chrétienne a pu faire par l’entremise des simples et des faibles. Les enseignes de cette espèce, qui ont traversé impunément une époque terrible où elles étaient proscrites sous peine de mort, avaient été sans doute{233} enlevées de la place qu’elles occupaient et mises en lieu sûr, sinon recouvertes de plâtre ou cachées derrière d’autres enseignes indifférentes. Nous signalerons, parmi ces rares épaves du grand naufrage des enseignes pieuses, deux enseignes sculptées du XVIIᵉ siècle, Au Caveau de la Vierge, rue de Charonne, et A l’Annonciation, rue Saint-Martin; une autre du XVIᵉ siècle, Au Bon Samaritain, nº 15, rue de la Lingerie; une enseigne en fer forgé, A l’Enfant Jésus, rue Saint-Honoré, etc. (voir ci-dessus, à la page 88).
Ces enseignes furent peut-être respectées comme objets d’art, mais nous ne croyons pas qu’on ait sauvé alors une seule des statues de la Vierge, si multipliées dans l’ancien Paris, et qu’on voyait encore avant 1789 en toutes les rues, la plupart dans des niches ou sur des piédestaux extérieurs. Beaucoup de ces statues étaient honorées, depuis des siècles,{234} d’une sorte de culte muet, qui se traduisait par des génuflexions
et des signes de croix; quelques-unes, parmi ces
statues, avaient même été sanctifiées dans la tradition locale,{235} par des récits de guérisons miraculeuses; quelques-unes aussi méritaient d’être conservées, dans les musées, sous le rapport de la beauté ou de la singularité de leur exécution artistique. La charmante statue de la Vierge, en marbre, qui, jusqu’en 1844, servit d’enseigne à la boulangerie Barassé, rue du Faubourg-Saint-Antoine, nº 186, provenait de l’abbaye Saint-Antoine-des-Champs, et avait été achetée en 1790 à la liquidation de l’abbaye. Elle appartient aujourd’hui à M. A. Barassé, notaire à Crécy-en-Brie[187].
L’histoire de l’une de ces saintes images a été racontée par Tallemant des Réaux[188] avec plus de malice que de naïveté: «Il y avoit sur le pont Nostre-Dame une enseigne de Nostre-Dame, comme il y en a en plusieurs lieux. Durant un grand vent, je ne sçay quels sots se mirent dans la teste qu’ils avoient veu cette image aller d’un bout à l’autre du fer où elle estoit pendue; chose qui ne se pouvoit naturellement, car le vent peut bien faire aller une enseigne d’un costé et d’autre ou l’arracher tout à fait, mais non pas la faire couler le long de ce fer. Après cela ils s’imaginèrent qu’elle avoit pleuré et jetté du sang; enfin, cela alla si loing, que Monsieur de Paris fut contraint de la faire apporter, de peur qu’on n’en fît une Nostre-Dame à miracles. Pour une bonne fois, il devroit défendre de mettre des choses saintes aux enseignes, comme la Trinité et autres semblables.»
L’enseigne du pont Notre-Dame, qui avait paru se mouvoir, qui avait pleuré, qui avait jeté du sang, exaltait au{236} plus haut degré la superstition de la foule; mais il y eut de bons chrétiens qui s’indignèrent de cette comédie pieuse, et les protestants se mirent de la partie pour demander que les images de sainteté ne figurassent plus dans les enseignes. La Notre-Dame qui avait causé tout ce bruit étant remplacée par une nouvelle, qui, au sortir des mains de l’imagier, n’avait fait encore aucun miracle, un quidam, resté inconnu, lui tira, dit-on, un coup de pistolet, qui aurait blessé cette image si réellement, que le sang sortait de la plaie. Tout Paris y courut pour voir l’effet du miracle; par malheur, on ne pouvait reconnaître la blessure faite à l’objet de la vénération publique que par les yeux de la foi. On n’en fit pas moins une gravure qui eut beaucoup de vogue[189]. Ce n’était pas la première fois que ces attentats s’adressaient à des Notre-Dame exposées dans les rues de Paris. Le plus sage eût été de les ôter, mais on n’osa pas chicaner et contrarier les habitudes de la population bourgeoise et marchande. On continua donc de laisser les symboles les plus vénérés de la religion figurer parfois de la manière la plus indécente dans les enseignes.
Ce fut à ce sujet que le poète dramatique Edme Boursault écrivit au commissaire Bizoton cette lettre très sensée, quoique très plaisante: «N’est-ce pas une allusion grossière, mais criminelle, de faire peindre un cygne à une enseigne, avec une croix, pour faire une équivoque sur le signe de la croix? Ne devroit-on pas condamner à une grosse amende un misérable cabaretier qui met à son enseigne un cerf et un mont, pour faire une ridicule équi{237}voque à sermon? Ce qui autorise des ivrognes à dire qu’ils vont tous les jours au sermon, ou qu’ils en viennent! Ne fait-il pas beau voir un cabaret avoir pour enseigne: Au Saint-Esprit, pour faire une impertinente allusion au nom du Maître, et quoique je le croie assez honnête homme pour n’y penser aucun mal, ne sait-il pas que le cabaret, étant un lieu de débauche, ce n’est pas là que le Saint-Esprit doit être placé? J’en dis autant de la Trinité, de l’Image Notre-Dame, et de je ne sais combien de saints qui servent d’enseignes de cabaret et qui enseignent peut-être encore pis. J’ai vu, dans une fort petite rue, qui donne d’un bout dans la rue Saint-Honoré et de l’autre dans celle de Richelieu, une de ces petites auberges ou gargotes où l’on prend des repas à juste prix, et voici quelle enseigne il y avoit: c’étoit Jésus-Christ que l’on prenoit au jardin des Oliviers ou jardin des Olives, et pour inscription de l’enseigne: Au juste pris, pour faire voir qu’on mangeoit là dedans à juste prix. Je fus si indigné contre le marchand qui avoit trouvé cette odieuse équivoque, que je ne pus retenir mon zèle, tout indiscret qu’il étoit. Je fis du bruit et menaçai même d’aller chercher un de vos confrères pour la faire abattre, et comme les commissaires sont plus craints de la populace qu’ils n’en sont aimés, la menace que je fis eut son effet, et quand je repassai l’enseigne n’y étoit plus[190].»
Tallemant des Réaux cite un autre trait de l’insolence impie des cabaretiers de Paris: «Un fou de cabaretier de la rue Montmartre avoit pris pour enseigne la Teste-Dieu; le feu curé de Saint-Eustache eut bien de la peine à la luy{238} faire oster; il fallut une condamnation pour cela[191].» La police avait droit sans doute de faire décrocher les enseignes indécentes qui blessaient les yeux ou la conscience du public, mais une enseigne outrageante pour la religion devait certainement amener devant les tribunaux l’auteur de l’impiété ou de l’hérésie qui s’était produite, en pleine rue, de propos délibéré ou avec préméditation. On doit supposer que, dans le cours du XVIᵉ siècle, le Parlement eut à juger plus d’un procès de cette espèce. Il est avéré que les images de saints, et surtout les statues de la sainte Vierge, étaient, à cette époque, exposées à des insultes continuelles de la part des protestants, et qu’il fallut souvent garantir par des grilles ou des barreaux de fer ces statues et ces images contre les attaques nocturnes, qui se renouvelaient fréquemment, malgré la terrible pénalité que pouvaient entraîner de pareils attentats.
Lorsque les premiers imprimeurs furent venus d’Allemagne, de Hollande et de Suisse pour s’établir à Paris, ils annoncèrent, par des enseignes ou des marques mystiques accompagnées de citations de l’Écriture sainte, leur industrie, qu’on regardait comme émanée d’une inspiration divine; puis, quand les idées de réformation religieuse qui étaient entrées dans les esprits depuis Wiclef ou Jean Huss prirent une forme et un corps de doctrine sous l’influence de Luther, de Zwingle et de Mélanchthon, les imprimeurs se trouvaient tout préparés à recevoir ces idées et à les répandre; il en résulta que la Réforme se propagea rapidement dans l’imprimerie et la librairie de Paris. On peut dire avec certitude{239} que libraires et imprimeurs devinrent la plupart sympathiques à ce mouvement général du protestantisme, que les savants et les lettrés avaient si puissamment encouragé à la cour de François Iᵉʳ. Voici quelques marques ou enseignes typographiques dont les devises sont tirées de la Bible et des Évangiles. Jean André, libraire: un cœur au milieu des flammes, avec ce mot, Christus, et au-dessous, cette inscription: Horum major charitas (c’est-à-dire: le plus grand amour des vrais chrétiens); Conrad Badius, libraire et imprimeur: un atelier d’imprimerie, avec ces mots traduits de l’Écriture: A la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain; mais quand cet imprimeur se fut retiré à Genève pour se consacrer à l’impression des ouvrages de Calvin, il adopta une autre marque, représentant le Temps, qui fait sortir du fond d’une caverne la Vérité nue, avec ce distique pour devise:
Gilles Corrozet, libraire, avait pris pour marque et pour enseigne: un cœur, chargé d’une rose (rébus sur Cor rozet), avec ces paroles du livre des Proverbes: In corde prudentis requiescit patientia; Nicole de la Barre, imprimeur: un cœur, contenant son monogramme, surmonté de signes hiéroglyphiques, avec cette sentence biblique: Benedicite et nolite maledicere, hæc dicit Dominus (Bénissez, et gardez-vous de maudire, dit le Seigneur); Michel Fezandat, le libraire éditeur de Rabelais: un serpent, au milieu d’un bûcher, s’élance sur une main qui sort d’un nuage, et cherche à la mordre, avec ces mots: Ne la mort, ne le venin; Alain Lotrian, libraire: un écusson, à son monogramme, entre un évêque et un docteur, avec cette devise: Nulluy ne peut Jésus-Christ décevoir, etc. Les libraires et les imprimeurs attachés sincèrement à la religion catholique n’hésitaient pas à faire figurer le Christ dans leurs marques et leurs enseignes: par exemple, le libraire Jean de Brie avait dans sa marque saint Jean-Baptiste soutenant un écusson qui porte l’Agnus Dei; Guillaume Du Puy faisait représenter dans son enseigne Jésus et la Samaritaine s’entretenant auprès d’un puits.
Ce n’étaient pas là les derniers beaux jours de l’enseigne sacrée, qui se maintint en honneur jusqu’en 1789, malgré l’opposition d’un grand nombre de propriétaires, qui se refusaient à donner à leurs maisons le caractère d’un établissement catholique ou protestant. Cependant on conservait les anciennes enseignes de dévotion, et on en créait de nouvelles dans les nouveaux quartiers de Paris. Ainsi, en 1628, un propriétaire, qui fit bâtir dans la rue Mazarine quatre maisons, à la place d’une seule, que le siège de{241} Paris avait ruinée pendant la Ligue, leur donna pour enseignes: le Port de salut, l’Image Sainte Geneviève, l’Image Sainte Catherine et la Trinité[192]. En cette même rue, la même année 1628, le nommé Salomon Champin, qui avait fait élever une maison neuve, au coin de la rue de Seine, lui donnait pour enseigne le Jugement de Salomon, pour faire allusion à son propre nom de baptême, car nous n’osons pas supposer que ce Salomon Champin était juif. Ce n’est que de notre temps qu’une enseigne juive a pu, sans aucune difficulté, être inaugurée au-dessus de la boutique d’un cordonnier israélite de la rue Croix-des-Petits-Champs, enseigne peinte, qui représentait Moïse, avec ses cornes de feu, descendant du mont Sinaï et présentant les tables de la loi au peuple d’Israël[193].{242}
NOUS n’avons jamais eu l’intention de rassembler ici toutes les anecdotes relatives aux enseignes de Paris; ce serait un livre à faire, plutôt qu’un chapitre de cet ouvrage. Une pareille entreprise exigerait trop de temps et trop de recherches, car il faudrait feuilleter tous les volumes d’histoire qui ont été écrits depuis qu’il y a des enseignes de maison et de boutique, c’est-à-dire depuis le XIIᵉ ou le XIIIᵉ siècle. Nous devons donc nous borner à réunir un petit nombre d’anecdotes anciennes et modernes que nous n’avons pas eu l’occasion de citer dans le cours de notre travail.
Nous ne sommes pas parvenu à découvrir quelle était l’enseigne de la maison de Nicolas Flamel, dans la rue des{243} Écrivains, au coin de la rue Marivault, près de l’église Saint-Jacques de la Boucherie. Nous supposons que cette enseigne était l’écritoire que Flamel avait adoptée comme armes parlantes et qu’il avait fait sculpter au-dessous de son monogramme N F, sur la petite porte de son église paroissiale Saint-Jacques de la Boucherie. On voyait à la façade de sa maison de la rue des Écrivains son image et celle de sa femme Perennelle, entaillées dans la pierre; ces deux sculptures naïves, mais assez grossières, subsistaient encore vers le milieu du dernier siècle[194]. L’emplacement de cette maison du célèbre écrivain hermétique n’est plus reconnaissable, depuis les démolitions qui ont permis d’ouvrir le square de la Tour Saint-Jacques, mais on le trouve bien indiqué dans les Comptes et ordinaires de la Prévôté de Paris en 1450: «Rue de la Pierre au lait (nouvelle dénomination de la rue des Écrivains). Maison en ladite rue, près de l’église Saint-Jacques de la Boucherie, à l’opposite de la ruelle du porche Saint-Jacques, à l’enseigne du Barillet, tenant d’une part à un hôtel de l’Image Saint Nicolas, qui fut à feu Nicolas Flamel, et de présent à Ancel Chardon, et d’autre part à un hôtel où pendoit l’enseigne du Gril[195].» Ces trois maisons nous paraissent avoir appartenu à Nicolas Flamel; l’enseigne du Barillet n’était autre que celle de l’Écritoire; l’enseigne de Saint Nicolas représentait le patron de l’écrivain, et l’enseigne du Gril faisait allusion au gril ou à la grille que les secrétaires du roi et des grands{244} seigneurs mettaient au-devant de leur signature particulière. Toutes les enseignes et tous les emblèmes que Nicolas Flamel avait fait sculpter ou peindre sur les maisons qu’il possédait à Paris, en les accompagnant d’inscriptions religieuses ou mystiques en vers, furent enlevées, à prix d’argent, par les souffleurs ou les alchimistes, qui croyaient y voir le secret de la Pierre philosophale.
L’enseigne du Cheval d’airain, qui désignait en 1581 une maison de la rue de Tournon, rappelait que cette maison, occupant l’emplacement du nº 27 actuel, avait été acquise, en 1531, pour le roi François Iᵉʳ, sous le nom d’un certain Pierre Spine, qui y fit construire des bâtiments et des hangars destinés à la fonte d’une statue équestre confiée au fondeur florentin Jean Francisque. Pierre Spine était sans doute l’entrepreneur de l’œuvre, puisqu’il dut fournir 10,000 livres de cuivre, dont six milliers environ entrèrent dans la fonte du cheval, qu’on appela le Cheval de bronze; mais il paraîtrait que la statue qui devait être sur ce cheval ne fut pas exécutée. Quant au statuaire, auteur du modèle en terre, nous croyons que c’était un artiste français, nommé François Roustien, qui touchait 1200 livres tournois de pension annuelle. On ne sait quel était ce cheval de bronze, fondu par ordre de François Iᵉʳ, ni quelle fut sa destinée. On avait cessé d’y travailler, au mois de juillet 1539, lorsque, par lettres patentes délivrées sous cette date, le roi fit don de la maison du Cheval d’airain à l’illustre poète Clément Marot, «pour ses bons, continuels et agréables services»[196]. Quelques historiens ont pensé que le Cheval de bronze qui{245} fut placé sur le terre-plein du Pont-Neuf, avec la figure de Henri IV, fondue par Jean de Bologne et son élève Tacca, n’était autre que le cheval d’airain coulé en 1531 dans l’atelier de Pierre Spine, et resté jusque-là sans destination dans les magasins de l’État. Le procès-verbal retrouvé dans l’un des pieds du cheval[197], quand le monument fut démoli le 12 août 1792, est venu détruire cette opinion. Nous avons raconté ailleurs l’histoire de cette statue, cheval et cavalier[198].
La maison des Carneaux, dans la rue des Bourdonnais, ne devait pas avoir d’autre enseigne que les armes de la Trémoille, car c’était un véritable châtel à carneaux ou créneaux que cette maison seigneuriale, «fief de la Trémoille, dit Sauval, dont relèvent quantité de maisons tant de la rue des Bourdonnois que de celle de Béthisy[199]». De là le nom de Carneaux, donné à tout le quartier qui entourait cet ancien hôtel, dont il n’existait plus d’apparent qu’un beau donjon renfermant un escalier à vis, quand les architectes de la ville le firent démolir, en 1841, sous prétexte d’alignement. Cet hôtel, qu’il était facile de restaurer de fond en comble et qui eût offert un admirable spécimen de l’architecture du XIVᵉ siècle, avait été depuis bien des années envahi par le commerce, qui y arbora l’enseigne de la Couronne d’or, en sorte que l’hôtel de la Trémoille ne s’appelait plus que l’hôtel de la Couronne d’or. Un marchand enrichi{246} avait alors pris la place de l’illustre Guy de la Trémoille, favori du duc de Bourgogne, ce vaillant seigneur «entre les mains de qui Charles VI mit l’oriflamme en 1393» et dont les actions éclatantes firent sortir sa famille de «l’obscurité du Poitou».
Si une enseigne de marchand parvint à éclipser le nom d’une des plus glorieuses familles de France, nous voyons d’un autre côté un grand artiste, dont l’origine était certainement très vulgaire, se faire un grand honneur de cette origine et ajouter à son nom de famille le nom de l’enseigne qu’il ne rougissait pas d’avoir vu pendre à sa maison natale. Le plus fameux architecte français du XVIᵉ siècle, «Jacques Androuet, Parisien, comme l’a dit expressément La Croix du Maine dans sa Bibliothèque françoise, fut surnommé du Cerceau, qui est à dire Cercle, lequel nom il a retenu pour avoir un cerceau ou cercle pendu à sa maison, pour la remarquer et y servir d’enseigne; ce que je dis, en passant, pour ceux qui ignoreroient la cause de ce surnom.» Jacques Androuet du Cerceau était né vers 1540, dans une maison du faubourg Saint-Germain, où son père vendait du vin aromatisé et se trouvait ainsi obligé de se conformer aux ordonnances qui prescrivaient aux marchands de vin de sauge et de romarin, ou mélangés de substances aromatiques et liquoreuses, de pendre un cerceau à la porte de leur boutique. Jacques Androuet, dit du Cerceau, signa de son surnom les premières études d’architecture qu’il grava et publia d’abord à Orléans, où il paraît avoir passé sa jeunesse, sans doute parce que son père avait des vignobles et des caves dans l’Orléanais. Quand il revint à Paris et qu’il y recueillit les Dessins et{247} Portraits de la plupart des anciens et modernes bâtimens et édifices de la capitale, il se préparait à mettre au jour, sous les auspices de la reine mère Catherine de Médicis, les deux grands volumes Des plus excellents bâtimens de France, «dressés par Jacques Androuet, dit du Cerceau.» On rapporte même que cet habile architecte, devenu l’architecte de la reine mère et du roi, acheta une maison à l’entrée du petit Pré aux Clercs, à la porte de Nesle, et qu’il donna pour enseigne à cette maison le Cerceau, qui rappelait son origine et son surnom, «comme une espèce de titre seigneurial[200]».
Pierre Costar, écrivain prétentieux de l’école de Balzac, n’avait ni l’esprit ni le talent de Jacques Androuet du Cerceau; il fut poursuivi toute sa vie par le souvenir de son père, qui était chapelier, sur le pont Notre-Dame, à l’Ane rayé, c’est-à-dire au Zèbre. Cet honnête chapelier n’avait pas épargné la dépense pour faire élever son fils comme un savant; aussi le fils n’eut-il rien de plus à cœur que de prouver qu’il n’était pas fait pour fabriquer et vendre des chapeaux. Il commença par changer son nom de famille, qui était Coustard et non Costar, et, pour se dépayser encore davantage, il alla s’établir en province, où il passa la plus grande partie de sa vie. Ami de Voiture et de Chapelain, il eût été membre de l’Académie française, s’il avait voulu résider à Paris, où il était né; mais l’Ane rayé fut toujours pour lui une sorte de spectre qui le poursuivait partout. Il affectait de se croire et de se dire provincial; aussi Tallemant des Réaux raconte-t-il que «quelqu’un lui dit poli{248}ment qu’il feroit tort à Paris de lui ôter la gloire d’avoir produit un si honnête homme, et que, quand même il le nieroit, Notre-Dame pourroit fournir de quoi le convaincre.» Plaisante allusion à l’Ane rayé du pont Notre-Dame.
Une curieuse anecdote, que nous puisons à une source quelque peu suspecte, tendrait à faire admettre que le lieutenant de police, au XVIIIᵉ siècle, avait l’œil ouvert sur les enseignes et qu’il ne les regardait pas toujours avec indifférence. Voici ce qu’on lit dans les Mystères de la Police[201], ouvrage anonyme, dont l’auteur n’est autre que l’ardent journaliste de la Commune, Auguste Vermorel: «Une marchande de modes avait fait peindre, avec assez de soin, dans son enseigne, un abbé choisissant des bonnets et courtisant les filles de la boutique; on lisait, sous cette enseigne: A l’Abbé Coquet. Hérault, lieutenant de police en 1725, dévot et homme assez borné, voit cette peinture, la trouve indécente et, de retour chez lui, ordonne à un exempt d’aller enlever l’Abbé Coquet et de le mener chez lui. L’exempt, accoutumé à ces sortes de commissions, va chez un abbé de ce nom, le force à se lever et le conduit à l’hôtel du lieutenant général de police. «Monseigneur, lui dit-il, l’abbé Coquet est ici.—Eh bien! répond le magistrat, qu’on le mette au grenier.» On obéit. L’abbé Coquet, tourmenté par la faim, faisait de grands cris. Le lendemain: «Monseigneur, lui dirent les exempts, nous ne savons plus que faire de cet abbé Coquet, que vous nous avez fait mettre au grenier; il nous embarrasse extrêmement.—Eh! brûlez-le, et laissez-moi tranquille!» Une{249} explication devenant nécessaire, la méprise cessa, et l’abbé se contenta d’une invitation à dîner et de quelques excuses.» C’était l’enseigne de la marchande de modes que le lieutenant général de police avait ordonné de faire enlever et de mettre au grenier. Par bonheur, les exempts n’allèrent pas jusqu’à brûler le pauvre abbé, comme on leur en donnait l’ordre. Cette même anecdote est racontée plus longuement, et avec beaucoup de bonne humeur, par Jules Janin, dans Paris et Versailles il y a cent ans (Paris, Firmin Didot, 1874, in-8º); mais il ne nous dit pas d’où il a tiré son histoire.
Il est à regretter que les renseignements nous manquent tout à fait sur les enseignes des marchandes de modes de Paris, car ces enseignes devaient être inventées et peintes par les artistes élégants et gracieux que Charles Blanc a caractérisés sous le nom de peintres des fêtes galantes. Il est impossible que Lemoine, Natoire, Boucher, Eisen, et leurs imitateurs, n’aient pas mis la main à ces enseignes qui convenaient si bien à leur imagination accoutumée à s’égarer dans l’Olympe des Amours et des Grâces. Nous possédons des adresses gravées qui nous donnent une idée très avantageuse de ce que devaient être ces enseignes. Nous savons que la marchande de modes de Mᵐᵉ du Barry avait pour enseigne: Aux traits galants; mais nous ignorons absolument de quelle manière l’artiste avait représenté ces traits galants. Nous avons vu une estampe, faite d’après une enseigne, qui représentait des Amours ou des Génies femelles coiffés de bonnets et de chapeaux, mais armés d’arcs et de flèches qu’ils lançaient à droite et à gauche. N’étaient-ce pas les traits galants de la mar{250}chande de modes? Au reste, une marchande, sous la Restauration, voulut imiter l’enseigne de la protégée de Mᵐᵉ du Barry, et elle mit au-dessus de la porte de sa boutique un tableau que l’histoire ne décrit pas, avec une inscription: A la Galanterie. Les demoiselles du magasin ne s’accommodèrent pas de cette inscription, qui semblait faite pour leur donner un renom suspect; elles se révoltèrent contre la marchande de modes et de galanterie. Il y eut même bataille de femmes, et l’enseigne disparut, pour l’honneur du beau sexe.
Une enseigne qui pouvait être aussi impertinente que celle de la Galanterie porta malheur à son éditeur responsable. «Il y avait, raconte M. E. de la Quérière, il y avait un éveillé de cordonnier, à la rue Saint-Antoine, à l’enseigne du Pantalon, qui, quand il voyait passer un arracheur de dents, faisait semblant d’avoir une dent gâtée, puis le mordait très serré et criait au renard! Un arracheur de dents, qui savait cela, cacha un petit pélican (pince de dentiste) dans sa main et lui arracha la première dent qu’il put attraper; puis, il se mit à crier au renard!» C’est Tallemant qui rapporte ce fait, dans le chapitre des Naïvetés et Bons Mots[202]; mais il ne nous dit pas quelle était cette enseigne du Pantalon. Un caleçon à pieds, un haut-de-chausses avec les bas, ou bien le bouffon masqué, qui fut un des personnages typiques de la Comédie italienne? Une enseigne analogue, A la Culotte, osa se produire, en pleine Restauration, sous l’œil pudibond de la Censure. Balzac nous apprend que cette enseigne s’étalait impunément au-dessus{251} de la boutique de M. Detry, bandagiste, bourrier, gantier, culottier, rue du Four-Saint-Germain, nº 55: «L’enseigne représente une main qui tient une culotte de peau de daim, dont on faisait jadis usage, et au milieu de laquelle est placée une oie, oui, une oie... Qu’est-ce que cela signifie? demande-t-on en ricanant. Eh! messieurs, lisez la légende: Prenez votre culotte et laissez tomber là mon oie. Entendez-vous? Pas si bête, M. Detry, pas si bête[203].»
Il y a, il y aura toujours des enseignes menteuses, comme des enseignes trompeuses. L’hôtel du Bon La Fontaine, dans la rue de Grenelle-Saint-Germain, a pour enseigne depuis plus de cent cinquante ans un buste de La Fontaine, avec l’inscription: Au Bon La Fontaine, et personne dans le quartier n’oserait soutenir que l’auteur des Fables et des Contes n’a pas logé dans cet hôtel, auquel il aurait laissé son nom. Horace Walpole y alla descendre, sous le règne de Louis XVI, pour dire, à son retour en Angleterre, qu’il avait couché dans la maison même du grand poète français La Fontaine. Or, ce fut un neveu du fabuliste qui donna son nom à cet hôtel, en devenant propriétaire de l’immeuble, au XVIIIᵉ siècle.
L’enseigne du Fidèle Berger, rue des Lombards, date du milieu du XVIIIᵉ siècle; elle avait été peinte par un élève de Boucher, et le confiseur qui tenait ce célèbre magasin de bonbons fut longtemps le fournisseur obligé de la moitié des baptêmes de Paris. Le sujet de cette enseigne, où l’on voyait une bergère en costume d’opéra-comique, la houlette en{252} main, assise au milieu de ses moutons et recevant de son fidèle berger une boîte de dragées, n’était que la marque de fabrique de cette maison de confiance. «Qui ne connaît ce riche et doux établissement? écrivait Balzac en 1826[204]: c’est là que l’hypocondre vient chercher des pistolets en chocolat; que le parrain court acheter les dragées du baptême, et que l’auteur de vingtième ordre apporte ses charades, ses énigmes et ses rébus. Afin de conserver son antique vogue, M. Desrosiers place, au jour de l’an, des gendarmes à sa porte.» Nous ne savons pas si M. Desrosiers était encore le patron du Fidèle Berger, au jour de l’an 1838, mais le 6 janvier de cette année-là on représenta pour la première fois, au théâtre de l’Opéra-Comique, une pièce en trois actes, intitulée: le Fidèle Berger, dont Adam avait fait la musique. Le poème, composé par Scribe et Saint-Georges, fut si mal reçu du public, que la représentation se termina au milieu du tumulte et des sifflets, et c’est à peine si le chanteur Chollet, qui s’était surpassé dans son rôle, put nommer les auteurs. On accusa le propriétaire du magasin et de l’enseigne du Fidèle Berger d’avoir monté la cabale qui fit tomber cette pièce, où la confiserie parisienne semblait tournée en ridicule. Ce fut en vain qu’on essaya de la relever dans les représentations suivantes: la cabale des confiseurs était toujours à son poste, et le Fidèle Berger dut disparaître de l’affiche de spectacle, sans avoir porté atteinte à la vieille renommée de l’enseigne de la rue des Lombards.
Je ne saurais mieux finir ce chapitre qu’en racontant les{253} grandeurs et les décadences de deux enseignes du Paris moderne, mais sans nommer le bourreau et la victime, qui appartenaient à deux familles honorables. La génération actuelle n’a pas gardé le souvenir de l’immense mystification du Chou colossal. C’était, en 1836 ou 1837, une enseigne fort modeste de la rue Saint-Honoré. Cette enseigne représentait seulement un chou, d’assez belle venue et d’une couleur verte tout à fait réjouissante. La boutique ne contenait rien que des caisses et des boîtes chinoises, plus ou moins authentiques, assez semblables à celles qui figurent chez les marchands de thé. Sur le comptoir, une balance de cuivre et des sacs de papier de Chine. Au milieu de la boutique, un énorme vase en faïence chinoise, d’où s’élevait un chou gigantesque, haut de six ou sept pieds, ayant au moins quinze pieds de circonférence. Ce chou extraordinaire était entièrement desséché et, pour en mieux assurer la conservation, on l’avait soigneusement repeint et verni comme un tableau. M. X..., l’inventeur du Chou colossal, avait fait annoncer dans tous les journaux et sous toutes les formes de l’annonce que ce chou, originaire de la Chine, n’était pas plus difficile à cultiver que le chou ordinaire et arrivait aisément à une grosseur monstrueuse, qui lui donnait un poids de 15 à 25 kilogrammes. M. X... avait compté sur la crédulité naïve de tous les planteurs de choux de la France et de l’étranger. Ils accoururent, en effet, de toutes parts, et ils achetèrent, au prix de 20 francs la livre et même davantage, des graines de chou ordinaire, que leur vendait le plus sérieusement du monde l’auteur de cette prodigieuse spéculation. Il s’était promis de faire sa fortune en moins d’une année, et il l’aurait faite si la passion du{254} jeu n’eût dérangé les plans de son audacieuse escroquerie.
M. X... était marié, mais sa femme, une honnête et digne femme, n’avait pas voulu s’associer aux faits et gestes de son mari; elle l’avait abandonné aux inévitables conséquences de l’entreprise du Chou colossal, et, en se séparant de lui, elle était allée, rue de Richelieu, ouvrir un magasin de lingerie et occuper une superbe boutique, décorée dans le style moyen âge avec des statuettes et des inscriptions gothiques, à l’enseigne du Sergent d’armes. Cette dame était fort ingénieuse et très habile, mais elle avait malheureusement dépensé aux bagatelles de l’enseigne une partie des fonds que son jeune frère avait mis à sa disposition. Le succès de la boutique moyen âge et du Sergent d’armes n’eut qu’un temps; les affaires de la lingerie ne prospéraient déjà plus au moment où celles du Chou colossal n’avaient produit partout que de petits choux cabus et quelquefois même de petits choux de Bruxelles. Notre escroc, ruiné par le jeu, ne ferma boutique que pour échapper aux revendications de ses dupes et aux poursuites de la justice. Il osa se présenter chez sa pauvre femme pour lui demander une somme d’argent avec laquelle il pût quitter la France. Cette somme, la pauvre lingère ne l’avait pas; elle n’avait même plus les moyens de la trouver. Furieux, désespéré, le misérable tira un poignard et en frappa sa femme, qui gisait mourante à ses pieds, lorsque le frère, qui était près de là, dans l’appartement de sa sœur, accourut aux cris, un pistolet à la main: «Scélérat! cria-t-il, en dirigeant son pistolet sur l’assassin; fais-toi justice et sers-toi de ton poignard pour te soustraire à l’échafaud!» Et,{255} comme l’assassin, tremblant, ne savait plus que répondre, il lui mit le pistolet dans la main et le força de se brûler la cervelle. Le misérable tomba mort auprès de sa victime. L’enseigne du Sergent d’armes et celle du Chou colossal disparurent à la fois.{256}
NOUS avons lu quelque part que les armoiries de la noblesse ne sont pas antérieures aux enseignes des artisans et des marchands, et que les unes, comme les autres, furent inventées presque en même temps et dans le même but, qui était de se distinguer et de se faire connaître. La définition du mot ENSEIGNE, que nous avons déjà citée (voir p. 28), d’après le Dictionnaire étymologique de la langue françoise, par Ménage, donne raison, en effet, à ce rapprochement historique, qui n’a pas été fait avec intention de rabaisser les armoiries de la noblesse: «Enseigne, dit Ménage, c’est une marque qui, aidant à discerner quelque personne, ou quelque chose, d’avec une autre, la fait connaître: l’enseigne d’une maison, d’une hôtellerie, d’une{257} compagnie de gens de pied; une enseigne, qui se portoit autrefois au chapeau ou en quelque autre endroit; l’enseigne d’un sergent ou d’un messager, qui est une chose semblable à ce qui s’appelle l’émail, à l’égard des hérauts d’armes; et de là cette façon de parler: à telles enseignes; d’insigne ou d’insignium.» L’un et l’autre mot latin étaient employés, au moyen âge, pour désigner également l’écu armorié d’un noble et l’enseigne d’une boutique. Il est donc tout naturel que, dès l’origine, les enseignes des maisons et des marchands se soient approprié les armoiries de la noblesse.
Ces armoiries, d’après l’opinion des historiens les plus judicieux, ne remonteraient pas au-delà des croisades. On ne saurait pourtant confondre les armoiries nobiliaires avec les emblèmes figurés et les hiéroglyphes de fantaisie qui furent de tout temps représentés sur les boucliers et les drapeaux (insignia) des gens de guerre, car il fallait bien qu’un chef, couvert d’armes défensives qui lui cachaient le visage, portât sur lui quelque insigne destiné à le faire reconnaître de ses soldats dans la mêlée d’une bataille. Ce sont ces signes caractéristiques et qualificatifs qui devinrent, à l’époque des croisades, la marque distinctive de la noblesse militaire et qui formèrent par la suite les armoiries héréditaires des familles nobles. La première croisade date de 1090. Il est possible que les enseignes proprement dites aient paru vers la même époque dans les villes, quoique la première enseigne connue ne date que du commencement du XIIIᵉ siècle. N’est-il pas permis de supposer que parmi les croisés qui avaient pris l’enseigne de la Croix sur leurs vêtements il y en eût quelques-uns qui, empêchés de partir pour{258} la croisade, arborèrent sur leurs maisons la croix, qu’ils s’honoraient d’avoir prise comme un vœu de faire tôt ou tard le voyage de la terre sainte? Ce serait là une explication rationnelle de l’usage multiplié et général du signe de la Croix dans les enseignes de maisons et de boutiques, Croix rouges, Croix blanches, Croix d’or ou d’argent, qui représentaient une espèce de croisade des enseignes.
On ne saurait, d’ailleurs, méconnaître l’analogie singulière et incontestable qui existe entre les figures de l’écu armorial et celles des plus anciennes enseignes. On voit dans les enseignes, comme dans les armoiries, les mêmes figures empruntées à tous les objets qui ont une forme et un nom dans la création de Dieu et dans celle des hommes; bien plus, par les enseignes, ces figures sont reproduites avec les couleurs et les émaux variés qu’elles ont dans les armoiries. Il n’y a de différence que dans le champ ou le fond sur lequel les figures sont peintes: la couleur ou le métal de ce champ n’a pas d’importance dans une enseigne; il est, au contraire, un des caractères de l’armoirie. On trouverait dans l’Indice armorial (1635) de Louvan Geliot non seulement la sommaire explication de tous les mots utiles au blason des armoiries, mais encore presque tous les noms des figures que représentaient les enseignes. Ici, ces figures appartiennent à la nature humaine: le corps de l’homme, sa tête, son bras, sa main, sa jambe, etc.; là, à la nature physique: le soleil, la lune, le croissant, les étoiles, etc.; ici, à la nature animale: le lion, le cheval, le chien, le loup, le serpent, le poisson, etc.; là, à la nature végétale: l’arbre, la feuille, la fleur, le fruit, etc. Puis, viennent toutes les figures des instruments, des ustensiles, des objets divers{259} qui sont l’œuvre de l’homme: dans les armoiries, on remarque de préférence quantité d’objets matériels de la vie chevaleresque et nobiliaire; dans les enseignes, beaucoup d’objets qui rappellent la vie bourgeoise et marchande. En un mot, enseignes et armoiries offrent l’image diversifiée de tout ce qui frappe les yeux et la pensée dans l’existence des peuples. C’est en 1150 qu’on vit apparaître le Blason ou l’Art héraldique, qui posa les règles de l’ordonnance des armoiries; ce fut certainement vers ce temps-là que les enseignes, par la loi de l’imitation, prirent au blason tout ce qu’elles pouvaient lui prendre.
M. Firmin Maillard, qui a fait une très bonne notice sur les enseignes[205], n’a pas remarqué les rapports analogiques que nous constatons entre les enseignes et les armoiries, à l’origine des unes et des autres; mais il énumère cependant nombre d’enseignes de Paris, la plupart très anciennes, qui auraient dû l’éclairer sur le rapprochement naturel qu’on peut faire des armoiries et des enseignes, du moins à leurs origines communes et simultanées. M. F. Maillard indique seulement le blason comme une des sources où les faiseurs d’enseignes ont puisé: «Les animaux, les astres, la religion, le blason, les ustensiles, les outils, fournissaient aussi leur contingent aux enseignes; les animaux, dans une grande proportion, et, chose curieuse, les outils dans la moindre; ainsi nous trouvons le Lion d’Or, le Lion d’Argent, le Cheval de toutes les couleurs, le Cygne, le Dauphin, le Mouton, les Lévriers, les Coulons (pigeons), le Paon, le Coq, les Singes, les Connins (lapins), la Limace, les Pource{260}lets, l’Écrevisse, le Papegaut (perroquet), la Hure de Sanglier, le Pied de Biche, la Queue de Renard, et la Corne de Cerf, qui est une des plus anciennes et qui toujours a été employée; et pour les outils, le Maillet, le Rabot, la Navette, les Ciseaux, la Faux et la Serpe.» Comment M. Firmin Maillard ne s’est-il pas aperçu que la plupart de ces enseignes étaient des emprunts faits aux armoiries? On rencontrait jadis dans les vieilles enseignes de Paris d’autres emprunts, encore plus caractérisés, qui accusaient davantage la fréquente similitude de l’enseigne du blason et de l’enseigne de la rue. Aussi, sans parler du Signe de la Croix, qui rattache sans doute aux croisades les enseignes, nous aurions à signaler, parmi celles que Berty a relevées et qui étaient les plus anciennes de la Cité et du quartier du Louvre, la maison du Heaume, la maison de l’Epée, la maison de l’Epée rompue, la maison de la Housse, etc.
On sait que les armoiries adoptèrent une foule d’animaux chimériques, qui ne s’étaient montrés que dans les récits des voyageurs crédules ou menteurs, qui, au retour de leurs voyages dans des pays lointains et presque inconnus, ne manquaient pas de charger de contes et de détails extraordinaires leurs récits, d’autant plus curieux qu’ils étaient incroyables. Le blason et les enseignes firent leur profit de ces inventions fantastiques. «Les sauvages, les arbres secs, les singes verts et autres merveilles des pays lointains, dit M. Alfred Maury[206] avec beaucoup d’ingéniosité, étaient mis peut-être sur les enseignes des auberges,{261} par flatterie pour les voyageurs, comme échantillons des souvenirs et surtout des belles vérités qu’ils rapportaient de loin.» En effet, la description des animaux imaginaires défrayait alors les relations des voyageurs. La licorne et le paon blanc étaient au nombre de ces animaux, quoiqu’on eût apporté à Paris, au XIIIᵉ siècle, un paon blanc et une prétendue licorne, qui laissèrent leurs noms à deux rues, où on les montrait au public moyennant une modique redevance; on y avait vu aussi plus d’une fois des hommes sauvages, d’une taille énorme, avec de longs cheveux et une grosse barbe touffue; mais les singes verts, que des voyageurs se vantaient d’avoir rencontrés en Afrique, on ne les vit jamais que sur les enseignes et sur quelques écussons d’armoirie tout à fait réfractaires aux lois du blason. Quant à l’Arbre sec, dont le blason s’était emparé plus volontiers que des Singes verts, c’était, nous l’avons dit, un arbre mystérieux, dont il est question dans les anciens fabliaux et que les pèlerins qui revenaient de Jérusalem assuraient être allés voir non loin de la vallée de Josaphat. Quelques autres croyances fabuleuses, le Phénix, la Sirène, etc., avaient été aussi consacrées par les armoiries et les enseignes.
Les hôtels construits ou habités par des familles nobles portaient comme enseignes, au-dessus de la porte d’entrée, les armes sculptées ou peintes de ces familles. Ces écussons nobiliaires excitèrent sans doute la convoitise des marchands, qui voulurent aussi avoir des armoiries pour enseignes, et qui placèrent leur industrie ou leur commerce sous la protection de l’Écu de France ou d’un autre écu armorié de province ou même d’abbaye. Personne n’y trouvait à redire, et l’on voyait de tous côtés se multiplier{262} ce genre d’enseigne. Nous croyons, cependant, que l’Écu de France n’était pas à la libre disposition de tous les marchands qui voulaient le prendre pour enseigne, et qu’il appartenait de préférence aux fournisseurs privilégiés du roi et des princes du sang. Les hôtelleries, qui payaient une forte redevance pour avoir droit de logis public, et peut-être aussi comme droit d’enseigne, se trouvèrent bien de la prise de possession d’un écusson royal ou princier, français ou étranger. Voici, d’après Adolphe Berty, une petite liste des anciennes maisons à écussons que cet archéologue avait rencontrées, à différentes dates, dans quelques rues de la Cité, du quartier du Louvre et du quartier Saint-Germain-des-Prés. On pourra, d’après cette énumération, se faire une idée de la multitude d’enseignes du même genre qui devaient exister aux mêmes époques dans les autres quartiers de Paris.
CITÉ. rue aux Fèves, maison de l’Écu de France (1423-1600). rue Saint-Christophe, maison de l’Écu d’Orléans (1425-1601), maison de l’Écu de Bretagne (1545-1575). rue de la Licorne, maison de l’Écu de Bourgogne (1633). rue de la Lanterne, maison de l’Écu de Pologne (1575-1605).
QUARTIER DU LOUVRE. rue du Chantre, maison de l’Écu de Bretagne (1700). C’était une hôtellerie qui avait eu tour à tour l’enseigne du Cheval rouge et celle du Cheval blanc; maison de l’Écu de France (1489). rue du Coq, maison de l’Écu (1687), maison de l’Écu de France (1399). rue Fromenteau, maison de l’Écu de France (1572-1655); autre maison avec la même enseigne (1571). rue Saint-Thomas-du-Louvre, maison de l’Écu de Navarre (1531-1628); rue Saint-Honoré, maison de l’Écu de Navarre{263} (1531). Elle devint, en 1640, maison de l’Écu de France, après avoir été maison du Cheval rouge; ce devait être une hôtellerie. Maison de l’Écu de Pologne (1586-1640), maison de l’Écu vert (1624), maison de l’Écu de Bretagne (1410).
QUARTIER DU BOURG SAINT-GERMAIN. rue Saint-Jean-Saint-Denis, maison de l’Écu de Berry (1308). rue des Boucheries, maison de l’Écu de France (1405-1695). rue-neuve-Saint-Lambert, plus tard rue de Condé, maison du Petit Écu de France (1517-1648).
Nous avons rencontré, dans les Comptes du Domaine de Paris pour l’année 1421[207], l’écu d’un prince de la maison de France, égaré dans une des rues les plus malhonnêtes de la ville: «De Jean Jumault, etc. Pour les rentes d’une maison, cour et estables, ainsi que tout se comporte, scéant à Paris en la rue Grate..., près de Tire..., où pend l’enseigne de l’Écu de Bourgogne, étant en la censive du roi». Cette maison, qui devait être une hôtellerie mal famée, nous rappelle, à quatre siècles en arrière, la fameuse chanson de Vatout intitulée: l’Écu de France. Mathurin Régnier n’eût pas rougi de loger à cette enseigne, lui qui, dans ses vers, envoie sa chambrière jusques à l’Escu de Savoie. Ces enseignes à l’écu étaient encore en faveur au XVIIIᵉ siècle, mais elles disparurent toutes pendant la Révolution, quand elles eurent été mises hors la loi par la République. On raconte qu’une enseigne de cette espèce, la dernière qui ait protesté contre les enseignes à la Guillotine, fit trancher la tête à son imprudent défenseur, lequel osa répondre devant le tribunal révolu{264}tionnaire que, pour témoigner de son respect aux règlements de la police républicaine, il ferait peindre sur son enseigne la France sans un écu.
Les artisans et les marchands avaient toujours été fiers de mettre un écu armorié sur leur maison ou sur leur boutique. Ne pouvant se faire anoblir individuellement, même à prix d’argent, ils demandèrent et obtinrent, en juillet 1629, des armoiries pour cinq des six grands corps de métiers, et cela, grâce à l’influence de Christophe Sanguin, seigneur de Livry, prévôt des marchands[208]: il fut donc permis aux marchands merciers, grossiers et joailliers de la ville de Paris de prendre pour armoiries trois nefs d’argent à bannière de France, un soleil d’or à huit rais en chef, entre deux nefs, sur champ de sinople; aux marchands drapiers: un navire d’argent à bannière de France, flottant, un œil en chef, sur champ d’azur; aux marchands épiciers et apothicaires: un coupé d’or et d’azur, et sur l’azur une main d’argent tenant des balances d’or, et sur l’or deux nefs flottantes, aux bannières de France, accompagnées de deux étoiles à cinq pointes de gueules, avec la devise en haut: Lances et pondera servant; aux marchands bonnetiers: cinq nefs d’argent aux bannières de France, une étoile d’or à cinq pointes en chef, sur champ violet pourpre; aux marchands de vin, qui avaient remplacé les pelletiers dans les six corps: un navire d’argent à bannière de France, flottant, avec six autres petites nefs d’argent à l’entour, une grappe de raisin en chef, sur champ d’azur. Dieu sait si les membres de ces cinq corps se firent faute d’exposer sur leurs enseignes{265} ces belles armoiries blasonnées par d’Hozier, juge d’armes de France! Les orfèvres, qui n’avaient pas voulu recevoir d’armoiries nouvelles, déclarèrent se contenter de celles qu’ils tenaient de saint Louis: de gueules, à la croix denchée d’or, cantonnée au premier et au quatrième d’une couronne d’or, et au second et au troisième d’un ciboire couvert d’or; au chef d’azur semé de fleurs de lis d’or sans nombre, avec cette devise: In sacra inque coronas. Plusieurs communautés, envieuses de ces armoiries attribuées aux six corps, se donnèrent, de leur propre autorité, des armes parlantes, dans un écu factice, où les couleurs et les émaux n’étaient pas toujours conformes aux lois de la science héraldique. Les perruquiers, qui faisaient remonter au règne de saint Louis l’origine de leur corporation, se contentèrent d’un écusson d’azur avec des fleurs de lis sans nombre. Tous ces inventeurs d’armoiries marchandes eurent à payer, en guise d’amende, ou à titre de confirmation, le droit d’armoiries, quand l’édit du roi de 1696 ordonna de prélever, sans examen contradictoire, ce droit sur tous ceux qui avaient des armoiries ou qui s’étaient targués d’en avoir. La vanité des bourgeois et des marchands fut mise ainsi à contribution au profit du roi. Ils y gagnèrent, toutefois, de n’avoir plus à craindre les recherches et les vexations des juges d’armes, qui enregistrèrent d’office, ne varietur, ces armoiries de métiers. Ce fut, en quelque sorte, l’établissement de la noblesse marchande: «J’ai vu, dit Charles Maurice[209], les boutiques des perruquiers de Paris peintes en bleu d’azur sur toute{266} leur étendue extérieure, et parsemées de fleurs de lis. C’était un privilège de leur corporation.»
Les marchands, très friands de noblesse, parvenaient souvent à faire souche de nobles. On sait que le duc de Villeroy descendait d’un marchand de poissons enterré aux Innocents. Sous Louis XIII, Castille, gendre d’un président du Parlement, était marchand à l’enseigne des Trois Visages; il s’anoblit d’une étrange manière, en se faisant passer pour le descendant d’un bâtard de Castille. Sa grande fortune fit le reste, la fortune étant, comme on disait, la meilleure savonnette à vilain. Un satirique du temps de Louis XIV[210] a raconté ainsi un de ces anoblissements de marchands, et l’anecdote suivante vient à l’appui de cette dédaigneuse révélation de Ménage: «Les armoiries des nouvelles maisons sont, la plus grande partie, les insignes de leurs anciennes enseignes.»
L’enseigne se mariait souvent avec l’écusson nobiliaire, qu’elle redorait. Ainsi, en 1690, Fleuriau d’Armenonville ayant épousé la fille de Gilbert, le marchand de draps à l’enseigne des Rats, on le chansonna sur l’air de Pierre Bagnolet, alors fort à la mode, et les Rats revenaient dans chaque couplet. Le seigneur d’Armenonville n’en fit pas moins bonne figure avec la dot de sa femme, lorsqu’on chantait autour de lui:
Le contrôleur général Philibert Orry avait bravement arboré sur son écu le Lion grimpant, enseigne du libraire Orry, son grand-père; et l’on a prétendu que les mains apaumées du blason des Potiers, ducs de Gèvres, etc., n’étaient autre chose que les gants qui servaient d’enseigne à leur aïeul le marchand pelletier.
Il ne faut pas oublier que l’enseigne a quelquefois fait le nom d’une famille, qui s’est anoblie avec son sobriquet d’enseigne. Les Trudaine, par exemple, qui s’élevèrent par la noblesse échevinale à la noblesse de cour, et qui comp{268}taient dans leur famille, au XVIIIᵉ siècle, un prévôt des marchands, deux membres de l’Académie des sciences, un économiste, ami de Turgot, et deux poètes, amis d’André Chénier, devaient leur nom à l’enseigne d’un de leurs ancêtres. Cette enseigne, la Truie qui daine, c’est-à-dire la Truie qui fait la daine ou la dame, avait formé le surnom de Truie daine, et ce surnom, en passant par la bouche du peuple, laissa le nom de Trudaine[212] au marchand, qui le légua à ses enfants avec sa fortune honorablement acquise et sa réputation d’honnête homme, si dignement continuée par ses descendants.{269}
CES sortes d’enseignes, qui ont eu un moment de vogue vers la fin du XVIᵉ siècle, parmi le peuple de Paris, ne nous paraissent pas avoir existé avant la première moitié de ce siècle-là. On trouve, en effet, dans Rabelais, de véritables rébus, auxquels il ne manque que d’être représentés en figures. Clément Marot, dans son épître du Coq-à-l’âne, qui doit être de l’année 1536 ou 1537, a parlé le premier du rébus de Picardie, et en a donné un spécimen, en disant:
Plusieurs enseignes de cette époque, en effet, avaient{270} adopté ce rébus de l’Estrille fauveau. Tabourot, dans ses Bigarrures du Seigneur des Accords, dont le premier livre a paru d’abord en 1572, s’est donc trompé, quand il ne fait remonter la mode des rébus qu’à l’année 1567 ou 1568. Voici comme il raconte l’origine de cette drôlerie plus amusante que spirituelle[213]: «Sur toutes les folastres inventions du temps passé, j’entends depuis environ trois ou quatre ans en ça, on avoit trouvé une façon de devise par seules peintures, qu’on souloit appeler de Rébus, laquelle se pouvoit ainsi définir, que ce sont peintures de diverses choses ordinairement cognues, lesquelles, proférées de suite sans article, font un certain langage; que ce sont équivoques de la peinture à la parole. Est-ce pas dommage d’avoir surnommé une si spirituelle invention de ce mot rébus, qui est général à toutes choses et lequel signifie des choses...? Quant au surnom qu’on leur a donné de Picardie, c’est à raison de ce que les Picards, de tous les François, s’y sont infiniment plus adonnez et délectez.» Étienne Tabourot nous offre ensuite de nombreux exemples des rébus de Picardie, qu’il va chercher jusqu’en Italie; mais nous n’avons à nous en occuper qu’au point de vue des enseignes de Paris.
«Je vay donc commencer, dit-il, à ce que j’ay remarqué, et premièrement aux enseignes de Paris, car ce sont rébus équivoquaux sur le langage usité en icelles, lequel, comme tesmoigne Glarean, De opt. lat. græcique sermonis pronontiat., attribué par aucuns à Erasme, abhorre les R R et{271} ne les prononce sinon à demy, au lieu de S, comme Jerus Masia.» Ainsi, pour les enseignes en rébus, on avait soin de reproduire en quelque sorte le langage du peuple de Paris, avec sa prononciation, dans les figures qu’on employait pour l’interpréter. Cette prononciation populaire était représentée aussi exactement que possible dans une enseigne que Sauval a citée, sans aucune observation[214], et qui n’a pas été bien comprise depuis par ceux qui l’ont mentionnée d’après cette citation. Cette enseigne, selon Tabourot, était placée «devant le logis d’un invitateur pour les morts», c’est-à-dire d’un clocheteur des trépassés, qui allait, de rue en rue, sonnant sa clochette, avertir les parents et les amis de venir assister aux obsèques d’un mort. «Elle est ainsi, dit Tabourot: un os, un sol neuf, des poulets morts, autrement trespassez, qui se prononce, selon leur dialecte: Os sou neu poulets trespassez, c’est-à-dire: Aux sonneurs pour les trespassez. Son voisin, le reprenant, disoit qu’il devoit peindre de ces trinquebaleurs de cloches, qui portent une robbe courte d’audience, allans par les rues de Paris.»
Tabourot décrit, à la suite de cette enseigne, quatre autres enseignes, qui étaient également parisiennes et du même dialecte que la précédente: une seule de ces enseignes était connue, comme la première; c’est celle qui avait fourni le nom de la rue du Bout-du-monde et qui a subsisté jusqu’au milieu du siècle dernier. «Selon le mesme dialecte, dit Tabourot, on a fait ceste-ci, d’un soldat qui appareille une poulle, et y a au dessous: Au compagnon pour la pareille, quasi dicat: Poule appareille.{272}
«Un os, un bouc, un duc, un monde sont prins pour dire: Au bout du monde.
«Aux babillars, pour dire un homme qui bat des billars.
«A la place Maubert est celle-ci: Au poing d’or et moins d’argent, rapportée par un poing doré et une main argentée.»
Citons encore deux rébus d’enseigne, qui pourraient bien, surtout le second, avoir figuré sur des enseignes de Paris. «Un G d’or et un G d’argent signifie de mesme: J’ay d’or, j’ay d’argent, car on prononce jé, au lieu de j’ay.
«Aux Chassieux, pour des chats qui scient un plat de bois, quasi: Aux chats sieurs.»
Ces rébus de Picardie, qui s’étaient glissés jusque dans les armoiries, avaient eu sans doute plein succès dans les enseignes, mais ces enseignes ont bientôt disparu, et nous n’en retrouvons qu’un petit nombre qui datent de l’origine du rébus. Les plus anciennes sont celles des libraires; la plus compliquée est celle de Guillaume Godard, qui demeurait sur le pont au Change, devant l’horloge du Palais, à l’enseigne de l’Homme sauvage; voici la description de ce rébus, gravé sur cinq lignes au verso du titre d’une édition des Heures de Nostre-Dame à l’usaige de Paris, imprimée en 1513; 1ʳᵉ ligne: un salut d’or, monnaie du temps, un os, NS, la Vierge Marie à genoux devant Jésus crucifié; ce qui signifiait: Saluons Marie priant Jésus en croix; 2ᵐᵉ ligne: N, un os, le signe abréviatif de la syllabe con, une scie, une anse, deux éperons, une sappe ou prison, ce qui signifiait: En nos consciences espérons sa paix; 3ᵉ ligne: le signe abréviatif de je, A, Dieu le père, un monticule, un cœur, et la note de musique mi, ce qui signifiait: J’ay à Dieu mon cœur mis; 4ᵉ ligne: le signe abréviatif de je, une{273} poire, un parc de chasse ou de pêche en osier, A, X, ce qui signifiait: J’espère paradis; 5ᵉ ligne, un loup, un ange, A, Dieu le père, C, ce qui signifiait: Louange à Dieu soit. Le rébus de l’enseigne de Jean de Brie, gravée également sur le titre d’un livre d’Heures à l’usaige de Paris, nous donne l’adresse du libraire et de son associé Jean Bignon, demeurant
rue Saint-Jacques en 1512: In vico Sancti Jacobi, à la Limace, cy me vend et achate. Cette légende, moitié latine, moitié française, est ainsi représentée: Ī, une vis, un coq, un saint Jacques en costume de pèlerin, A, la note de musique la, une limace, une scie, ME, un van, EA, une chatte. Un autre libraire, nommé Jehan de la Landre, dont nous pouvons nous représenter l’enseigne en rébus, demeurait,{274} en 1566, au jeu de paume des Rats bottés, dans le faubourg Saint-Marceau[215].
Sauval cite quatre enseignes en rébus, sans nous apprendre dans quelles rues elles se trouvaient: «Quant aux enseignes, dit-il, le ridicule qui s’y trouve vient d’un mauvais rébus: A la Roupie, une pie et une roue; Tout en est bon, c’est la Femme sans tête; la Vieille Science, une vieille qui scie une anse; Au Puissant Vin, un puits dont on tire de l’eau[216]».
L’enseigne du Puits sans vin, ou Puissant Vin, devait être assez commune à Paris, puisque Berty nous indique une maison du Puits sans vin, dans la rue Saint-Honoré, avec la date de 1713. Une autre enseigne, sculptée en bas-relief et peinte, qu’on voit encore dans la rue Mouffetard, à la porte d’un épicier qui y a fait ajouter, de chaque côté, en pendentifs, deux pains de sucre, avec cette légende: A la bonne Source, représente deux francs lurons qui tirent de l’eau d’un puits et qui pourraient bien avoir figuré autrefois à la porte d’un marchand de vin dans une enseigne du Puits sans vin. Berty a signalé encore, sans le savoir, une enseigne en rébus, dans la rue Fromenteau, où se trouvait la maison du Mal assis, en 1568: le mal assis était généralement un coq perché sur une patte. Quant à la maison du Chat lié, dans la même rue, en 1671, cette enseigne en rébus faisait allusion, nous l’avons dit, au nom de Robert Challier, qui avait été propriétaire d’un hôtel voisin[217].{275}
Le Signe de la Croix, un cygne au pied d’une croix qu’il enlace avec son cou, et le Bon Coing, avec ce fruit odorant, qui veut dire le bon coin, se retrouvent encore sur beaucoup d’enseignes de Paris, sans avoir changé de sens ni de caractère depuis des siècles. Nous avons aussi, en plusieurs endroits, notamment rue Saint-Denis, rue des Deux-Écus, et rue Vauvilliers, la fameuse enseigne du Chat qui pelote, représentant un chat qui jongle avec des pelotes de fil ou de coton. Il y avait aussi le Chat qui pêche dans une ruelle qui descendait de la rue de la Huchette jusqu’à la rivière, et qui avait pris le nom de cette enseigne. Mais nous hésitons fort à reconnaître avec quelques érudits un{276} peu trop imaginatifs que toutes les enseignes au Chat fussent des rébus, lors même qu’on nous prouverait que le peuple voyait dans l’enseigne du Chat qui pelote cette équivoque assez difficile à en tirer: Chaque y pelote, c’est-à-dire chacun y fait sa pelote. On a voulu traduire aussi le Chat qui pêche par cette légende insignifiante: Chaque y pêche, c’est-à-dire chacun vient s’y fournir de ce qu’il lui faut. Les rébus de nos pères, avec leurs assonances approximatives, étaient plus intelligibles et plus ingénieux que les nôtres.
L’enseigne en rébus: A l’Assurance (un A sur une anse) remonterait au XVIIᵉ siècle, quoique Sauval ne l’ait pas citée; celle du Saint Jean-Baptiste (singe en baptiste), représentant un singe avec une collerette et des manchettes, nous paraît une invention plus bizarre que spirituelle. Les rébus des enseignes modernes sont la plupart des réminiscences du passé, et ce ne sont pas les plus curieux qui ont été conservés ou remis en vogue. Dans tous les cas, on n’a pas gardé ceux qui ne seraient plus compréhensibles, en raison de l’altération de la langue, comme les Gras scieurs, dans lesquels il fallait voir les Gracieux. Mais on rencontre encore aujourd’hui, dans les faubourgs, des enseignes qui ont toujours le même attrait pour le populaire des vieux quartiers de Paris, comme les suivantes: aux Contents (au comptant), à l’Épi scié (à l’épicier), au Verre galant (au vert galant), au Canon de la Bastille (place de la Bastille), au Canon de Bordeaux, au Grand I vert (au grand hiver), aux Vieux par chemins (aux vieux parchemins), etc.[218]{277}
«L’enseigne de l’Épi scié, ou des Épis sciés (épiciers), dit M. J. Poignant, cette enseigne, qui jusqu’en 1855 a fleuri au-dessus d’un café borgne du boulevard du Temple, servait peut-être au XVIIIᵉ siècle à illustrer les officines de ces honorables industriels.» Nous avons vu ce rébus de l’épi scié (l’épicier) dans un livre de la fin du XVIᵉ siècle. Quant à la fameuse enseigne de la Femme sans tête, il appartenait à la galanterie française de lui faire réparation d’honneur, en appliquant l’impertinente légende de Tout en est bon, non plus à une femme décapitée, mais à un porc doré des pieds à la tête[219]. Enfin nous avons recueilli, dans le quartier des{278} Halles, au fameux débit de consolation de Paul Niquet, le dessin de son enseigne en rébus, peinte sur le mur, avec beaucoup de talent, dans un cadre ornementé du meilleur goût: elle représente une mappemonde portant écrit le mot POLE, un nid avec trois petits oiseaux qui piaillent, un groupe de vaisseaux qui élèvent leurs mâts derrière le quai d’un port, la lettre N avec apostrophe dans une haie, des empreintes de pas, et un Maure assis, la hache à la main. L’obscurité même du rébus fait le plus grand attrait de l’enseigne, qu’il faut traduire tout bonnement par ces cinq mots: Paul Niquet n’est pas mort.{279}
LES enseignes avec inscriptions latines devaient être très nombreuses aux XVᵉ et XVIᵉ siècles, mais ces enseignes pédantes n’étaient pas faites pour le populaire. Nous ne parlerons pas ici des inscriptions pieuses avec citations bibliques ou évangéliques: nous en avons parlé dans les chapitres XI et XVI. Voilà longtemps que ces inscriptions ont disparu, même dans le quartier de l’Université. Nous n’en citerons qu’une, qui accompagnait le portrait d’un charlatan célèbre du XVIIᵉ siècle, nommé Carmeline, lequel tenait ses assises sur le Pont-Neuf. «Carmeline, qui étoit un fameux arracheur de dents et en remettoit d’autres en leur place, avoit fait mettre, à côté de son portrait exposé enveüe sur la fenestre de sa chambre, qui regarde le Cheval de bronze,{280} le mot de Virgile sur le Rameau d’or, au sixième livre de l’Énéide:
et l’application en est heureuse[220].» La citation virgilienne pouvait se traduire ainsi, en style de dentiste: «Une dent enlevée, une autre dent ne manque pas de la remplacer.»
On voyait encore, il y a quelques années, une inscription latine gravée sur la façade d’une maison fort ancienne, au coin des rues de la Calandre et de la Cité, au-dessus de la boutique d’une lingère, qui ne pouvait donner aucun renseignement sur cette inscription, que les antiquaires cherchaient vainement à expliquer:
Ces trois lignes sont aisées à traduire: «La ville me décapita, le roi me rétablit, un médecin m’augmenta.» Le bibliophile Jacob a donné une explication ingénieuse de cette inscription énigmatique: «On pourrait supposer, dit-il[221], que le voyer de Paris ayant fait abattre un ou deux étages de cette maison, qui était trop haute, elle fut rétablie dans son premier état, d’après les ordres du roi, et encore exhaussée par un médecin qui la possédait; mais nous croyons plutôt qu’un crime détestable avait été commis dans{281} une maison qui s’élevait à cet endroit, laquelle fut démolie et la place laissée vide, en mémoire du crime, par arrêt du Parlement. Le roi seul avait le droit d’infirmer un arrêt de ce genre, en permettant de bâtir sur le terrain vague et infâme.» Deux pages plus loin, le Bibliophile semble donner la preuve de sa supposition: «Le samedi 24 janvier 1604, raconte Pierre de l’Estoile dans son Journal du règne de Henri IV, un gentilhomme anglois tua, en une maison de la rue de la Calandre, un élu de la ville, qui lui avoit donné un soufflet, et eut sa grâce du roi, pource qu’il étoit Anglois.»
Les inscriptions étaient ordinairement plus intelligibles, et elles servaient souvent à expliquer ce qu’il y avait d’obscur et d’inusité dans les enseignes. Ainsi, il y a quelques années, on voyait dans le quartier du Temple une enseigne représentant deux escargots qui se faisaient amoureusement les cornes, avec cette légende: A la sympathie. Il eût fallu certainement une inscription pour rappeler que cette enseigne, assez étrange, avait été inaugurée vers 1851, à l’occasion d’une des plus bizarres mystifications qui eussent jamais préoccupé la société bourgeoise de Paris. Le poète romancier Méry, qui eut le génie et presque le privilège de ces énormes mystifications publiques, se prit à raconter dans les journaux qu’un savant naturaliste, Jules Allix, qui devint plus tard membre de la Commune, avait découvert qu’il existait une telle sympathie entre les escargots mâles et femelles, qu’en séparant deux de ces mollusques, qu’on trouvait collés l’un à l’autre pendant la saison de leurs amours, on pouvait les employer en guise de télégraphe électrique, de telle sorte qu’ils continuaient de communiquer{282} ensemble à des distances incommensurables. Par exemple, on gardait l’un en France, dûment mis en chartre privée, et l’on envoyait l’autre en Amérique bien enfermé dans une boîte; alors, grâce à la sympathie mystérieuse qui unissait les deux escargots, il était facile d’établir entre eux un courant d’électricité, qui se produisait simultanément de l’un à l’autre, en caressant légèrement avec les barbes d’une plume l’extrémité des cornes de ces deux escargots. Le professeur Allix était très sérieusement convaincu et personne ne douta d’abord de la réalité de cette découverte, qui provoqua bientôt un immense éclat de rire. Mais, deux ans après, l’enseigne des Deux Escargots survivait seule au souvenir du puff propagé par Méry et Girardin pour mystifier le bourgeois. Nous croyons qu’une enseigne qui, il y a peu d’années, se voyait à l’entrée de la rue Laffitte, chez un gantier, était encore plus aisée à comprendre que celle des Deux Escargots. Le gantier avait fait inscrire sur sa boutique: Aux Deux Sœurs, et au dessous: Nos peaux seules font nos gants. Les deux sœurs n’étaient autres que deux chèvres!
Les enseignes à proverbes et devises devaient être très nombreuses au XVIᵉ siècle, mais il n’en reste peut-être pas une seule en place. Cette espèce d’enseigne fut surtout appréciée de certains libraires et imprimeurs de Paris, qui évitaient de donner un caractère religieux et surtout protestant à leurs enseignes.
Voici, d’ailleurs, un petit spécimen de ces devises, en grec, en latin et en français, joyeuses ou philosophiques, littéraires ou professionnelles, qui étaient peintes sur des enseignes de libraires ou d’imprimeurs, généralement au-{283}dessous de leurs marques typographiques, qu’on retrouvait gravées sur tous les livres sortant de leur imprimerie ou de leur librairie: Jean Bignon portait autour de son écusson une sorte de gibecière entre trois grenades: Repos sans fin, sans fin repos.—Jean Barbier, au Palmier: Honneur partout.—Jean Bonfons, rue Neuve-Notre-Dame, à l’enseigne Saint-Nicolas: une colombe sur un arbre entouré d’un serpent: Estote prudentes sicut serpentes, et simplices sicut columbas.—Gilles Couteau, un grand couteau et deux petits, plantés au milieu d’arbustes: Du grant aux petis[222].—Simon de Colines, le Temps qui fauche: Hanc aciem sola retundit virtus.—Galiot du Pré, une galiote ou galée: Vogue la galée (jeu de mots sur la galée, espèce de cadre à rebord où le compositeur d’imprimerie met les lignes à mesure qu’il les compose).—François Estienne, un cep de vigne chargé de grappes de raisin: Πλέον έλαίου ἤ οἴνου. Plus olei quam vini.—Gilles de Gourmont, l’écu de ses armoiries soutenu par deux cerfs ailés et ayant pour cimier saint Michel qui terrasse le démon (il avait été anobli par le roi):
Denis Janot, un chardon: Nul ne s’y frotte.—Pierre le Brodeux, à l’Oranger, avec son écu d’armoiries: Lege cum prudentia, stude cum sapientia, metue cum patientia.—Frédéric Morel, avec un arbre feuillu: Πᾶν δέηδρον άγαθὁν χαρποὔς χαλους ποιεί.—Gérard Morrhy, la fée Mélusine: Nocet empta dolore voluptas.—Denis Roce, son{284} écu soutenu par deux griffons: A l’aventure tout vient à point qui peut attendre.—Geoffroy Tory, le Pot cassé, dans lequel poussent des fleurs: Non plus, et au dessous: Omnis tandem marcessit flos.—Pierre Vidoue, la Fortune: Audentes juvo.—Laurent Le Petit: un écusson soutenu par deux licornes:
Il faut remarquer que la devise, qui se rapportait souvent à un emblème ou à un rébus, pouvait n’avoir aucune analogie avec l’enseigne proprement dite. Cette devise-là était généralement énigmatique, car elle avait trait à quelque détail intime de la vie ou du caractère de l’homme. Ainsi la devise de Geoffroy Tory était-elle aussi difficile à comprendre que sa célèbre enseigne du Pot cassé. Geoffroy Tory prit cette devise (non plus) et adopta cette enseigne (le Pot cassé), après la perte qu’il avait faite d’une fille bien-aimée. Parfois, une enseigne pouvait être aussi peu compréhensible qu’une devise. Pourquoi une maison de la rue Saint-Antoine avait-elle en 1361 l’enseigne de l’Ours? C’est{285} que cette maison appartenait à l’abbaye d’Ours-champs[223]. Or, nous retrouvons encore cette vieille enseigne de l’Ours dans la rue du faubourg Saint-Antoine. Pourquoi une maison de la rue du Renard-Saint-Sauveur avait-elle pour enseigne, en 1382, un renard, qui donna son nom à la rue? C’est que cette maison appartenait à maître Robert Renard[224].
Ces enseignes analogiques furent peut-être l’origine des enseignes imaginaires et des satires à l’enseigne qui eurent tant de vogue pendant les XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, où elles amusaient alors la cour et la ville. Ces enseignes imaginaires apparaissent, dès le commencement du XVIᵉ siècle, dans le monologue en vers intitulé: le Pèlerin passant, que nous avons analysé au chapitre des enseignes d’hôtelleries. Ce monologue semble avoir été imité très ingénieusement dans l’envoi du Paysan françois à la reine Marie de Médicis, que l’auteur supplie de lui donner bon gîte:
Dans les Logements de cour de Louis XIII[226], l’auteur choisit ces logements à différentes enseignes, comme s’il était le maréchal des logis de la cour. Il marque le logis du roi à l’Aigle impériale; il aurait désiré loger la reine au Dauphin, mais, faute de mieux, il la loge à l’Espérance. Il retient trois logements, au lieu d’un, pour le cardinal de Richelieu: la Couronne ducale, l’Ancre et l’Écu de Bretagne. Il loge assez malheureusement Monsieur, frère du roi, au Grand Serf. Il marque l’Homme d’Argent, pour M. le prince de Condé; la Cage, pour M. le comte de Soissons; mais les deux princes préfèrent loger à la Bannière de France; Il loge M. de la Valette à l’Épée royale; le chancelier, au Cerf volant; le général des galères Pont-Courlay, au Chameau; le P. Joseph, au Chapeau rouge; le grand maître de l’artillerie, à la Harpe; le surintendant des finances Bullion, au Mortier; Bouthillier, autre financier, au Bras d’Or; le trésorier du Houssay, au Cheval bardé; le président de la Chambre des comptes, Cornuel, à la Galère; M. d’Émery, à l’Écu de Savoie; les secrétaires, à la Main d’Argent; la nièce de Richelieu, Mᵐᵉ de Combalet, qui voulait avoir l’Écu de Bourbon, et qui ne peut pas même se loger à l’Écu d’Orléans, sera contrainte de prendre l’Abbaye. L’Écu de Milan est réservé à M. de Créqui; un grand prélat, qu’on ne nomme pas, devra loger au Moulin à vent.
Sous le règne de Louis XIV, en 1677, les logements ont bien changé, avec les personnes à loger; le duc de Mazarin loge à la Seringue, près les Petites-Maisons; Madame de Bourbon, à la Linotte, rue du Moulinet; Mademoiselle, à{287} l’Espérance, rue Dauphine. Dans une Mazarinade de 1649, le château de Saint-Germain étant occupé par la reine d’Angleterre, force est de chercher dans la ville les logements de la cour de France; voici quelles étaient les enseignes de ces logements: «Nous choisîmes, pour le roy, le Mouton; Monsieur fut logé au Papillon, et la reine, au Chapeau rouge; mais, parce que le logis et principalement les chambres étoient mal accommodés, nous y logeâmes son train, et sa personne eut pour elle le Saucisson d’Italie, bien qu’il luy fût fort agréable pour la gentillesse; les filles furent logées à la Petite Vertu; M. le cardinal fut logé à la Harpe, la Couronne luy ayant été desniée.»
Sous le règne de Louis XV, les enseignes imaginaires prêtèrent fort aux épigrammes. Nous allons citer les meilleures que l’on en tira dans le petit pamphlet intitulé: Noms et demeures des principaux acteurs du théâtre d’aujourd’hui. «Le roi loge à la Beauté couronnée, rue des Innocents; le cardinal de Fleury, à la Cassette de Diamants, rue des Mauvaises-Paroles; le Moliniste, au Fil retors, rue d’Enfer; M. Hérault loge à l’Occasion, rue Tirechape; le garde des sceaux Chauvelin, à la Petite Vertu, rue Cloche-Perce; M. le chancelier d’Aguesseau, à la Casaque retournée, rue de Judas; le cardinal de Rohan, au Bon Valet, rue des Aveugles; la nouvelle Sorbonne, à la Carcasse, rue des Aveugles; le peuple, à la Besace, rue des Martyrs[227].»{288}
IL y eut de tout temps des enseignes bizarres, extravagantes, saugrenues, qui n’en avaient pas moins de vogue et de célébrité. Quelques-unes, comme celle de la Truie qui file, eurent une popularité extraordinaire et furent reproduites dans toutes les villes de France, au moyen âge, sans qu’on puisse bien se rendre compte de ce que signifiaient ces figures caricaturales et sans doute satiriques qu’on retrouvait sur les sculptures des chapiteaux de colonnes et de piliers, dans la plupart des cathédrales gothiques, ainsi que sur les encadrements fleuronnés des Heures manuscrites. Cette Truie qui file, dont le type original est encore visible dans une enseigne sculptée de la rue Saint-Antoine (voir chap. V, p. 92), se montre dans les tours de pages en miniature des{289} manuscrits liturgiques, comme dans les ornements sculptés de l’architecture des XIIIᵉ et XIVᵉ siècles. Cette Truie qui file apparaît, dès l’année 1301, comme enseigne d’une maison de la Halle-aux-Poirées, appartenant à l’Hôtel-Dieu, et cette maison portait encore la même enseigne en 1654[228]. Il y avait une autre Truie qui file, en 1389, dans la rue Grenier-Saint-Ladre[229]. Cette Truie qui file, dans laquelle les savants ont voulu reconnaître la reine Pedauque, c’est-à-dire la reine Berthe, femme du roi Robert, était, suivant d’autres érudits, une création légendaire et fabuleuse des romans de la Table ronde. On pourrait disserter à perte de vue sur cette tradition fabuleuse du moyen âge. Rien n’était plus populaire que cette enseigne-là; elle est citée dans les conteurs du XVIᵉ siècle, notamment dans le Moyen de parvenir de Béroalde de Verville; on la retrouve dans le Ballet de la Mi-Carême, dansé à la cour sous le règne de Louis XIII: deux fous vont visiter la Truie qui file, sans soupçonner que ce soit une enseigne[230]. Devant cette petite sculpture en pierre, les garçons de boutique, les apprentis, servantes et portefaix des halles se livraient à toutes sortes de folies, le jour de la mi-carême. Cette enseigne était assez connue pour qu’on y fît souvent allusion dans la conversation. Lorsqu’au mois de juin 1593, le duc de Feria, ambassadeur du roi d’Espagne, vint proposer aux États de la Ligue de faire nommer par le roi, son maître, un prince français{290} catholique qui monterait sur le trône de France, le duc de Mayenne ne trouva pas bonne cette proposition. Alors un des fougueux prédicateurs qui étaient à la solde de l’Espagne monta en chaire, à Saint-Merry, pour prêcher le duc de Mayenne, et dit de lui «qu’une quenouille eut été plus propre qu’une épée à ce gros pourceau,» et tout le monde comprit cette allusion à la Truie qui file[231].
Le vieux Paris pouvait alors montrer plusieurs enseignes du même genre, qui n’avaient pas autant de notoriété, mais qui ne devaient pas être moins plaisantes: l’Ane qui viole, un âne qui jouait de la viole; la Nonnain qui ferre l’oue (l’oie), près de la chapelle de Braque[232]; la Pie aux Piats (ses petits); la Vieille qui bat le cabas, c’est-à-dire qui cherche à tromper le monde; l’Étrille Fauveau, allusion au vieux roman de Fauvel, etc. Plusieurs de ces enseignes n’ont pas pour nous un sens appréciable. C’étaient des équivoques, des entend-trois ou des amphibologies, des énigmes, des contrepeteries, etc. Nous avons remarqué deux ou trois maisons à l’enseigne du Bastoy, c’est-à-dire du Battoir: n’était-ce pas des lavoirs, où les lavandières exposaient en écriteau leur devise professionnelle, qu’Étienne Tabourot a consignée dans les Bigarrures du Seigneur des Accords: «Les lavandières ont un proverbe ordinaire: Si vous l’avez, ne le prestez pas; si vous ne l’avez pas, prestez-le-moy, qui s’entend d’une palette ou battoir propre à laver les draps?» L’équivoque consiste dans le mot lavez ou l’avez. Les équivoques{291} des enseignes n’étaient pas plus décentes au XVIIIᵉ siècle qu’au XVIᵉ, témoin l’enseigne du serrurier Ledru: «Au-dessus du petit portail de la Foire Saint-Germain, qui fait face à la rue des Quatre-Vents, écrivait Auguste Poullain de Saint-Foix en 1805, on lisait encore, l’année dernière, cette inscription:
«Cette inscription a, dit-on, fait la fortune du serrurier qui en est l’auteur; elle a existé pendant longtemps. L’équivoque, au reste, ne provenait que de la façon dont les mots étaient écrits.» Cette enseigne que tout Paris alla voir était donc une de celles qui, d’après l’opinion candide du neveu de l’auteur des Essais historiques sur Paris, «ne font point d’honneur au goût des Français». Il en cite une autre, qui était un chef-d’œuvre d’absurdité, quoique ce fût l’enseigne d’un habile ingénieur opticien: «Dans la rue Saint-Antoine, en face de la rue Geoffroy-Lasnier, on découvre un aigle assez mal figuré. Cet aigle tient dans son bec un mouton qui n’a pas la dixième partie de la grosseur de l’oiseau; à peine le voit-on. Au-dessous, cette inscription: «Avec mes ailes je coupe les vents, et le baromètre sous moi annonce les changements de temps[233].» Il y a eu d’ancienne date, il y aura toujours des sots, même en matière d’enseignes. On a vu longtemps, rue Mouffetard, nº 108, un marchand{292} d’habits, qui s’était donné cette enseigne: A l’Asticot. Le tableau représentait un pêcheur à la ligne, qui, croyant avoir pris un goujon, tirait de l’eau une culotte.
Les sages-femmes ont eu, de tout temps, la spécialité des enseignes équivoques et gaillardes, qui faisaient une partie de leur notoriété. Balzac décrit deux de ces enseignes dans son Petit Dictionnaire, et nous n’avons pas négligé de les reproduire dans notre chapitre XXIV, parce qu’elles sont accompagnées de vers. Nous citerons ici une autre{293} enseigne de sage-femme et la plus réjouissante de toutes, avec une plaisante inscription: J’ouvre la porte à tout le monde. Cette enseigne facétieuse a longtemps amusé les flâneurs sur le quai Saint-Paul.
Certaines enseignes ont constamment mis en éveil la curiosité des passants, qui ne les comprenaient pas et qui cherchaient à en trouver le sens. Telle fut l’enseigne à l’Y. Le sieur de Blegny, sous le pseudonyme d’Abraham du Pradel, cite dans son Livre commode des Adresses de Paris, en 1692, une de ces mystérieuses enseignes à l’Y: «Les aiguilles et les épingles, dit-il, se vendent en gros, près la Croix du Tiroir, à la Loupe d’Or, et, rue de la Huchette, à l’Y.» Le commentaire que j’ai joint à mon édition du Livre commode[234] présente une assez amusante étymologie: «Cette dernière enseigne a besoin d’être expliquée, ai-je dit. Autrefois on appelait le haut-de-chausses: grègues, grèques, à cause de la ressemblance avec les courtes et larges culottes des Grecs. Le nœud de ruban, que les merciers vendaient pour l’attacher au pourpoint, se nommait lie-grèques. Or, c’est de ce mot, un peu modifié, que vient notre enseigne. De lie-grèques, en forçant légèrement la prononciation, on eut l’Y, et la fameuse lettre fut ainsi acquise aux merciers. Elle a, d’ailleurs, la forme d’une culotte, les jambes en l’air, et par là convient d’autant mieux, comme armes parlantes, à ces marchands de culottes et de caleçons.» Adolphe Berty nous avait appris que l’Y grégeois existait dès 1527 dans les enseignes de Paris. Était-ce la même enseigne que celle signalée par le sieur de Blegny? Était-ce{294} la même que celle que l’on voyait encore, en 1854, quai Saint-Michel, et que relevait cette inscription: Maison fondée en 1690? Était-ce la même que celle qui a été sculptée sur la façade de la maison qui porte le nº 14 dans la rue de la Huchette? (Voir chap. III, p. 41-43.) Question peu importante, mais difficile à résoudre. Dans tous les cas, les enseignes à l’Y sont encore fréquentes chez les merciers de province, qui ne connaissent pas, à coup sûr, l’origine de leurs enseignes.
Alfred Bougy avait imaginé une autre interprétation de l’Y des enseignes, et nous l’aurions adoptée sans doute, si son auteur n’eût pas attribué ces enseignes aux bonnetiers, tandis qu’elles ont toujours appartenu exclusivement aux merciers; or, merciers et bonnetiers formaient deux corps d’état absolument distincts et différents. Mais l’explication proposée par Alfred Bougy est assez ingénieuse pour qu’on n’y renonce pas sans regret, la voici: «On se demande souvent pourquoi les bonnetiers mettent, de très ancienne date, sur leurs devantures, un Y et quelquefois plusieurs. J’ai toujours pensé, quant à moi, que les marchands de bas ont trouvé original de s’annoncer au moyen d’un caractère muni de deux jambes et figurant assez bien un saltimbanque qui fait l’arbre fourchu. Ce même caractère convient également aux marchands de chemises et de camisoles de tricot, car ils peuvent dire que l’Y est pourvu de deux bras qu’il lève théâtralement vers le ciel pour implorer la faveur d’une bonne et nombreuse clientèle[235].»
Le comte de Laborde, qui avait trouvé l’Y grégeois dans{295} les inventaires de bijoux du XIVᵉ siècle, n’a pas songé à le chercher sur les enseignes des merciers; il s’est contenté de faire observer que cet Y, sur des fermails ou des anneaux d’or, pouvait représenter la forme d’une croix ou plutôt du Christ crucifié[236]. Nous y voyons plus volontiers, comme sur quelques marques et enseignes de libraires, l’emblème symbolique du libre arbitre: la route aboutissant à deux voies inégales, via lata, via arcta.
Il est une autre lettre de l’alphabet, le V, auquel on avait donné, en le colorant de vert, un sens fixe, qui se représentait invariablement dans les enseignes à rébus. Ainsi le comte de Laborde, dans son Glossaire des émaux et bijoux du Musée, décrit, d’après un inventaire des ducs de Bourgogne, un annel d’or, émaillé de W verts, sous la date de 1399[237]. Ces W verts voulaient dire: Vertus. Nous devons avouer ne pas comprendre cette interprétation généralement admise. Ainsi Tabourot, dans ses Bigarrures du Seigneur des Accords, nous présente cette devise: Pensées en vertu sont nettes, dans un rébus qui pourrait bien avoir figuré sur l’enseigne d’un fabricant de sonnettes: un V vert, dans lequel sont implantées une tige de pensées et deux sonnettes. La première édition des Mémoires de Sully, imprimée en deux volumes in-folio, au château de Sully, en 1638, à l’enseigne des Trois V verts, c’est-à-dire des Vertus, offre ces V peints en vert, avec la légende: Foy, Espérance, Charité. La lettre S, traversée par une barre, a dû sans doute figurer aussi en rébus sur des ensei{296}gnes, comme à la fin des lettres d’amour et d’amitié, car Tabourot n’a pas oublié cette lettre-rébus, qu’il explique ainsi: «Une S fermée par un traict, pour dire fermesse, au lieu de fermeté.» Le sens de ce rébus était si bien hors d’usage, que les savants de notre temps, qui ne lisent pas les Bigarrures du Seigneur des Accords, s’étaient mis en quête de cette explication et se sont disputé l’honneur de l’avoir trouvée, sans l’avoir cherchée sur les enseignes.{297}
LE savant M. Louis Courajod, dans l’excellente étude qu’il a consacrée à la Curiosité, en tête du Livre-Journal de Lazare Duvaux[238], n’a pas oublié de mentionner ces adresses gravées, qui sont ordinairement la reproduction fidèle des enseignes des marchands. «Ces marchands, dit-il en parlant de ceux qui composaient l’état-major de la bijouterie au XVIIIᵉ siècle, outre leurs enseignes dont Watteau nous a laissé un spécimen remarquable[239], avaient encore des adresses, c’est-à-dire qu’ils faisaient graver des planches{298} de cuivre indiquant leur demeure, le symbole sous lequel ils avaient établi leurs boutiques, énumérant les différents objets qu’ils offraient aux acquéreurs, et figurant les principaux attributs de leur commerce. Comme ils commandaient fort souvent ces adresses aux plus habiles dessinateurs et aux meilleurs graveurs de leurs contemporains, on composerait une jolie collection en rapprochant les gracieux cartouches qui contiennent leurs noms, leurs demeures et les ingénieux symboles qui personnifiaient leur industrie.» M. Courajod ne parle que des enseignes-adresses ou adresses-enseignes les plus intéressantes, pour le dessin et la gravure, que les marchands-bijoutiers du XVIIIᵉ siècle avaient fait exécuter, et qui leur servaient non seulement d’annonces et de prospectus, mais encore de factures de leurs marchandises.
Ces gravures, dont l’usage remonte certainement aux premières années du XVIIᵉ siècle, nous font connaître le sujet et la disposition d’un certain nombre d’enseignes qu’il serait impossible d’apprécier sur une simple désignation. Ainsi, au XVIIIᵉ siècle, l’enseigne d’une boutique où se vendaient des objets de mode et de luxe était entourée généralement d’ornements dans le style rococo, avec des attributs et des emblèmes peints ou dorés. Nous n’avons découvert aucune de ces adresses-enseignes avant l’année 1660 environ, mais nous attribuons à leur invention et à leur emploi dans le commerce de Paris une date antérieure au plus ancien spécimen connu, qu’on ne saurait considérer comme l’essai d’un nouveau système d’annonce marchande. Nous devons donc nous borner à passer en revue chronologiquement les enseignes-adresses que nous avons vues et dont la plupart nous sont communiquées par un célèbre ama{299}teur[240]; ce sera la meilleure manière de mettre sous les yeux du lecteur les principales enseignes de Paris pendant plus d’un siècle.
Nous ne devons pourtant pas négliger de mentionner une espèce d’affiche-enseigne que M. Alfred Bonnardot a trouvée dans un recueil de pièces concernant la vente de l’hôtel de Bourgogne, en 1543, et qui servait à indiquer des places de terrain à vendre, selon les pourtraicts et figures qui auroient esté faicts et attachez sur des tableaux de bois, ès portes desdits hostels, ès portes du palais du Chastelet et autres lieux. «Ce détail est curieux relativement aux ventes d’immeubles, nous fait observer M. Bonnardot; il s’agit probablement ici d’une affiche peinte[241].»
Il y a, dans l’œuvre d’Abraham Bosse, au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale, quatre ou cinq adresses-enseignes gravées de marchands, qui ne portent pas de date, mais qu’on peut placer sous l’année 1660, à l’époque où l’artiste, ayant perdu beaucoup de sa réputation, était forcé d’accepter des travaux presque indignes de lui. Ces adresses-enseignes, dessinées et gravées par Abraham Bosse, devaient être plus nombreuses que celles qui nous ont été conservées, car Mariette, dans ses notes manu{300}scrites, en mentionne trois autres que la Bibliothèque nationale ne possède pas. La plupart de ces adresses-enseignes devaient servir de passe-partout, en quelque sorte, pour tous les marchands, qui pouvaient y ajouter à la plume leurs noms et des détails relatifs à leur commerce car elles laissaient en blanc la place de l’enseigne et du nom du marchand; ainsi trois des adresses-enseignes que nous avons sous les yeux représentent trois femmes, avec les attributs de la Fidélité, de la Renommée et du Commerce soutenant un écriteau sur lequel on lit: Nº AU, et un espace blanc réservé pour l’addition manuscrite. Comme les armoiries de la ville de Tours sont au bas de la page, on doit supposer qu’elles ont été faites pour des marchands de la ville de Tours, la ville natale d’Abraham Bosse, qui s’y retira et qui y mourut. Sur une de ces adresses-enseignes, les armoiries de Tours ont été remplacées par ces mots: Fabrique de Isaac Chardon. Toutes ces gravures sont anonymes. Celle qui pourrait avoir été faite pour un marchand de Paris offre l’Agneau pascal portant une croix avec une oriflamme; on lit au bas: Gans de l’Agneau Pascal. Cette pièce a 80 millimètres de haut sur 108 de large. Nous croyons que l’Agneau Pascal était une enseigne de Paris, et Pascal le nom du marchand[242].
La plus ancienne de ces enseignes-adresses, avec des noms de marchands de Paris, c’est-à-dire la première de cette espèce que nous ayons pu découvrir, est celle de deux marchands d’étoffes de soie: c’est une eau-forte,{301} format in-4º, qui ne porte pas de date, mais Hennin l’a placée, sous la date de 1682, dans sa grande collection d’estampes historiques[243]. La voici:
«A la Teste noire. Verdier et Dumazelle, marchands, rue des Bourdonnois, à la Teste noire, vendent toutes sortes d’étoffes de soye, de draps d’or et d’argent, des taffetas, popeline, moires, ras de Saint-Maur, grisettes, et généralement toute sorte de soyerie, en gros et en détail.»
Il y a, dans la collection alphabétique des Portraits, à la Bibliothèque nationale, une autre eau-forte, de format in-8º, sans date, mais signée par Ertinger, né à Colmar en 1640, ce qui nous permettrait de reporter cette pièce à l’année 1676 ou 1678; en voici la description:
«Au Buste de Monseigneur. A la rue Dauphine, vis-à-vis la rue d’Anjou, à Paris, M. Savin peint, à l’huile, à fresque, à détrempe et en miniature, des Tableaux d’Histoire sainte, grecque et latine, Métamorphoses, Portraits, etc.; dessine et peint Médailles, Devises, Emblèmes, Blason, Perspective, Architecture civile et militaire, décorations pour les Églises et les Spectacles, ornemens pour les Maisons religieuses et séculières, desseings pour les graveurs et pour ouvrages en broderie sur satin, moire et taffetas, rehaussés d’or et d’argent, etc. Il enseigne à dessiner et à peindre avec facilité, et a plus de 200 tableaux à vendre sur toute sorte de sujets et en miniature.»
La troisième enseigne-adresse connue est de la plus grande beauté et porte une date certaine; elle est de format in-folio, dessinée dans le goût de Lebrun et admirable{302}ment gravée par Antoine Dieu; si elle reproduit fidèlement l’enseigne de la boutique de ce peintre, elle nous donne une grande idée de ce que pouvaient être les enseignes à cette époque.
«Au Grand Monarque. Le sieur Dieu, Mᵉ peintre, à Paris, sur le Petit-Pont, proche la porte de l’Hostel-Dieu, fait et vend toutes sortes de tableaux, tant d’histoire que de dévotion et autres; tous les Portraits de la Cour, grands et petits, en bordures ovalles et quarrées; bordures tant dorées que d’autres façons, pieds de pendules, pieds de porcelaines, crucifix sur velours et autres ouvrages de sculpture et dorure, images de vélin, de cole de poisson et roche de toutes façons, et généralement toute sorte d’ouvrages de peinture, sculpture, dorure, et le tout à prix raisonnable et en tient magazin en gros et en détaille. 1698.—Ant. Dieu inv. et sculps.»
Cette adresse est surmontée du portrait de Louis XIV, en buste, couvert d’une armure, dans un cadre ovale, soutenu par deux Renommées; au-dessous, à droite, la France, sous les traits d’une nymphe couronnée de lauriers, tenant une pique à la main, foule aux pieds la Discorde vaincue.
Citons encore une gravure, de même format, plus naïve et moins finement exécutée, qui paraît être du même temps, mais qui n’a pas de date. Ce n’est plus un peintre, c’est un simple perruquier suisse:
«Aux Treize Cantons suisses. Le Petit Suisse, marchand perruquier, fait et vend toutes sortes de perruques et des plus à la mode, vend aussi toutes sortes de cheveux de France, d’Angleterre, de Hollande, Flandre, Allemagne{303} et d’autres des plus beaux, en gros et en détail: demeurant à Paris, sur le quay de l’Orloge du Palais, entre les deux grosses tours. Ladame scul.»
Au-dessous de l’inscription de l’enseigne, dans un encadrement formé des armes des treize cantons, est représenté le portrait d’un personnage, en tête à perruque, posée sur un tapis fleurdelisé, avec cette légende: C. Patu, autrement renommé le Petit Suisse. Ce Patu, qui devait être fameux pour les perruques, comme les grands perruquiers Binet et Pascal, n’est pourtant pas nommé dans le Livre commode d’Abraham du Pradel (Nicolas de Blegny).{304}
Voici encore une petite adresse-enseigne des dernières années du règne de Louis XIV:
«Au Perroquet, rue Petite-Truanderie, proche les Halles, la veuve Beltemont, marchande teinturière, vend toutes sortes de fils, etc. Paris, 1711.»
Nous abordons la régence du duc d’Orléans avec une enseigne-adresse qui n’a pas de date, mais dont les équivoques du texte et de la gravure annoncent que l’esprit gaulois veut reprendre tous ses droits, au risque d’effaroucher les derniers représentants du règne de Mᵐᵉ de Maintenon: A la Vice d’Or couronnée. C’est une vis de forme assez étrange, qui est représentée, sous une couronne, au-dessus du cadre ornementé, où figurent tous les instruments et outils de la coutellerie.
«A la Vice couronnée. Hebert, maître coutellier à Paris, rue de l’Arbre-Scec, à la Vice d’Or couronnée, fait de bons razoirs, lancettes, couteaux, cizeaux, trépans et toutes sortes d’instrumens servans aux chirurgiens et barbiers, et vend de très bonnes pierres à razoirs, comme aussi de bons cuirs.»
Au-dessous, de chaque côté, deux Amours assis, tenant l’un une serpette, et l’autre une sorte de cisaille, qui affectent des formes inusitées, lesquelles avaient leur raison d’être sous la Régence.
C’est encore une enseigne-adresse de coutelier qui nous offrira la date de 1715, mais sans jouer sur les mots, comme la pièce précédente; les instruments de la coutellerie sont également représentés au-dessous du nom de l’enseigne:
«Au Pied de Biche. Jacques Aumounin, maître coutellier,{305} à Paris, demeurant rue du Mail, à l’enseigne du Pied de Biche, etc., 1715.»
Nous sommes en pleine Régence, avec l’enseigne des Trois Pucelles, qui, néanmoins, n’a pas de date. Cette enseigne, surmontée de la couronne royale, est agrémentée dans le style rococo, avec des éventails de toute espèce.
«Aux Trois Pucelles, rue Saint-Denis, entre la Fontaine des Saints-Innocents et la Picardie, Prevoteau vend toutes sortes d’éventails de nacre, yvoire, baleine, montés en peau, papier et taffetas, des plus à la mode; tient aussi magasin de dentelle noire, blonde de soye, taffetas pour mantelets; le tout en gros et en détail. A Paris.»
Puis viennent deux enseignes-adresses de joailliers, qui n’ont pas de date, mais qui sont du même temps, c’est-à-dire du commencement du règne de Louis XV; ces deux joailliers ont la même enseigne et la même adresse, l’un ayant succédé à l’autre:
«A la Gerbe d’Or, rue Saint-Antoine, vis-à-vis la vieille rue du Temple, Dessemet, marchand orfèvre, joaillier, fait, vend et achète toutes sortes d’ouvrages d’orfèvrerie, tant en or qu’en argent, achète les galons brûlés ou non brûlés et les vieilles vaisselles; il vend et achète toutes sortes de jettons. Le tout à juste prix.»
L’enseigne est dans un ovale rococo, terminé en corne d’abondance, d’où s’échappent quantité de menus bijoux, et tout à l’entour figurent les objets d’argenterie qui composent le commerce de l’orfèvre.
L’adresse-enseigne de La Chambre, marchand orfèvre{306} joyailler, est tout à fait semblable à celle de Dessemet; on n’y a changé que le nom du marchand.
Deux enseignes-adresses de doreurs, datées, dont l’une offre ces jeux de mots qui témoignaient du caractère jovial et de l’esprit facétieux de certains marchands de Paris:
«Au Coq lié de Perles, rue de la Verrerie, vis-à-vis les murs de l’église Saint-Mery, Collié, maistre marchand doreur, argenteur sur métaux, etc. 1726.»
Ce Collié ou Coq lié eût sans doute mieux réussi, avec son calembour, au XVIᵉ siècle qu’au XVIIIᵉ. Son confrère Passevin avait une enseigne plus simple et moins bizarre.
«A la Providence, rue de la Verrerie, au coin de la rue des Coquilles, Passevin, maistre et marchand doreur. Paris, 1725.»
Son enseigne-adresse, sans image, avait été imprimée par P. Gissey, rue de la Vieille-Boucherie, à l’Arbre de Jessé.
On mettait sans façon sur des adresses comme sur les enseignes les portraits des princes morts et vivants, et lors même que ces portraits étaient horriblement peints, personne n’y trouvait à redire, car le marchand ne songeait qu’à placer son commerce sous une bonne recommandation, en cherchant sa clientèle parmi les gens de cour.
«Au Duc de Bourgogne, quay de Gesvres, maison de la Coquille d’Or, Boucard fait et vend toutes sortes de bonnes éguilles, épingles d’Angleterre et de Paris, cire d’Espagne, cure-dents, fers à coëffer, dez à coudre de Blois et de Paris, et toutes sortes d’aiguilles à tapisseries de Langres et de Blois, etc. 1728.»
«Au Prince de Condé, Bruno, doreur ordinaire des{307} équipages et vennerie de Monseigneur le Duc, qui demeuroit cy devant rue des Prouvaires, près Saint-Eustache, demeure présentement rue des Mauvais-Garçons, faubourg Saint-Germain, au Prince de Condé. Paris, 1733.»
Nous avons, pour les années 1735 et 1737, un tabletier, un fondeur et deux quincailliers, avec de bien singulières enseignes[244]:
«Au Singe verd, rue des Arsis, proche Saint-Mery, Auxerre, tabletier, etc. 1735.»
Ce singe vert est représenté jouant seul au trictrac.
«A la Renommée des Trois Chandeliers, rue des Arcis, du côté de la rue de la Haute-Vannerie, La Vache, fondeur, etc., 1737.»
L’enseigne représente une Renommée, sonnant de la trompette, au milieu d’une quantité d’objets d’église et de luxe mondain, parmi lesquels sont trois chandeliers de différentes formes.
«Au Mulet chargé. La Mulle et Doublet, marchands, rue de la Monnoie, près le Pont-Neuf, vendent et achètent toutes sortes d’armes et de marchandises de clinquaillerie, etc. 1737.»
Le mulet chargé de l’enseigne rappelait au client que les deux marchands La Mulle et Doublet portaient une double charge dans leur commerce et demandaient un peu d’aide.
Mais les enseignes-adresses avaient produit de si heureux résultats pour les marchands qui y avaient recours, que chacun s’ingéniait à faire mieux que son voisin. Gersaint, qui avait eu la bonne fortune de recomman{308}der son magasin par une enseigne peinte de la main de Watteau, voulut avoir une adresse-enseigne dessinée et gravée par Boucher. Cette adresse est ainsi décrite par M. Louis Courajod: «Un Chinois ou un Japonais, la tête et les épaules couvertes d’une épaisse fourrure qu’il soulève, et tenant une pagode à la main, est assis sur un cabinet de vernis de la Chine. Il semble contempler au-dessous de lui divers objets disposés au pied d’une console, sur laquelle est posé le cabinet de la Chine. Ce sont les principaux meubles vendus par les marchands de curiosités, entre autres des tableaux, un coq de porcelaine, un miroir des Indes, des éventails, des manchettes, des rouleaux d’estampes, un cabaret, des coquillages, des pièces de minéralogie, une guitare, etc[245].» L’adresse est gravée au bas de l’estampe:
«A la Pagode, Gersaint, marchand jouailler, sur le pont Notre-Dame, vend toute sorte de clinquaillerie nouvelle et de goût, bijoux, glaces, tableaux de cabinet, pagodes, vernis et porcelaines du Japon, coquillages et autres morceaux d’histoire naturelle, cailloux, agathes et généralement toutes marchandises curieuses et étrangères, à Paris, 1740.»
Toutes les adresses-enseignes n’étaient pas aussi intéressantes, et bien souvent le marchand ne faisait pas des frais de gravure pour son enseigne, qu’il se contentait d’indiquer sur ses adresses, comme dans celle-ci:
«A la Belle Teste, Pevèrie, maître-tourneur, demeu{309}rant rue aux Ours, au coin de la rue Quinquempoix, fait et vend toutes sortes d’ouvrages au tour, savoir: fauteuils et chaises des plus à la mode, bidet, double bidet et chaises à deux dos, chaises fauteuils et angloises en verd pour les jardins, rouets à filer des plus fins; montre à filer, sans intérêts; dévidoir, quenouille, guéridon, porte-écran à la mode, testes à coëffer pour les dames, des plus parfaites, testes à perruques, métiers à broder et à travailler en tapisserie, jeux de quilles de Siam, et autres, boëtes, fiolles, poulies à puits, bâtons à perroquets et bâtons à faire le chocolat, le tout à juste prix, à Paris, 1739.»
Le luxe augmente, et aussi l’amour de la dépense: les dames de la cour donnent le ton, et toute la bourgeoisie riche s’efforce de les surpasser en prodigalités et en folies. Une enseigne-adresse, gravée avec un goût exquis, de la grandeur d’une carte à jouer, par un artiste nommé Le Villain, qui l’avait encadrée de roses, invitait ainsi les femmes du monde à venir chez le bijoutier dépenser l’argent de leurs maris et de leurs amants:
«A la Tabatière d’Or, Tellier, marchand joailler bijoutier, vend des bijoux d’or et d’argent, sacs à ouvrage, éventails, nœuds d’épée, et tout ce qui concerne la bijouterie; revend aussi des ouvrages en pierreries du plus nouveau goût, donne à ses pierres l’éclat et le jeu du diamant, rend les couleurs et nuances à celles qui lui sont présentées; il vend des bagues et doublets qui imitent le feu, vend les parfums, fait les envois dans tout le royaume et chez l’étranger. A Paris.»
Les hommes ne restent pas en arrière, quand il s’agit de briller à la cour et à la ville; on sème l’or à pleines{310} mains, pour acheter tout ce qui se fait en or et en argent, pour la toilette, le mobilier et les équipages. Nous avons sous les yeux cette jolie vignette d’enseigne-adresse gravée par Bellanger et dans laquelle le Soleil d’Or est tout encadré de roses:
«Au Soleil d’Or, Vieille Rue du Temple, au coin de la rue Barbette, vis-à-vis l’hôtel de Soubise, ci-devant rue Saint-Denis. Vᵉ Gallot tient magasin de galons or et argent fin, filés or et argent, paillettes or et argent, tout ce qui concerne l’ornement d’église tant en galons d’or et d’argent, tant fin que faux et en soie, tout ce qui concerne le meuble en crette de soie, cordons, glands, franges or et argent, tant fin que faux, tout ce qui concerne la voiture tant or et argent qu’en soie, guides et tresses, tout ce qui concerne la broderie en or et argent, le tout à juste prix. A Paris.»
Ce n’est plus Louis XV qui règne, c’est Mᵐᵉ de Pompadour ou la Dubarry. L’enseigne-adresse, qui est devenue une délicieuse gravure signée Eisen ou Marillier, pénètre dans tous les boudoirs, et les femmes ne sortent plus que pour aller à des rendez-vous dans les petites-maisons des grands seigneurs et des financiers, ou pour faire des emplettes.
Ici on va chercher des étoffes et des chiffons:
«Au lever de la Reine, Bellehure tient magasin de gazes et de dentelles, linons, taffetas de toutes qualités, satin, rubans gros grain et autres, coiffure de marli brodé, vraie soie d’Angleterre à filet, et fil anglois à filet, cordons de montres et bourses à cheveux; il tient aussi des modes et des plumes dans tous les genres, garnit les robes et fait des commissions pour la province, 1770.»{311}
Là, on ne trouve que des fleurs artificielles, qui font déjà tort aux fleurs naturelles et qui se vendent à des prix extraordinaires:
«A la Gloire du Zéphire, rue Bourbon-Villeneuve, au coin de la rue Saint-Claude. Wenzel tient fabrique et magasin de fleurs. A Paris.»
Une femme à la mode a chez elle une collection d’éventails, et cette collection s’accroît tous les jours:
«A l’Éventail des Quatre-Saisons, à Paris, rue Greneta, Josse, l’aîné, tient fabrique d’éventails de toutes sortes de goûts et de prix, en gros et en détail, pour la France et les pays étrangers. Il se charge de faire traiter toutes sortes de sujets; il les raccommode, fournit les feuilles et les bois séparément, le tout à juste prix.»
Dans cette jolie enseigne-adresse, le cadre qui la contient est surmonté d’un éventail ouvert, et dans le bas, un paon déploie sa queue en éventail de plumes.
Une autre enseigne-adresse, renfermée dans son cadre couronné d’une guirlande de roses, est un tableau représentant le port de Dunkerque, sur lequel retombe à demi un rideau portant cette légende:
«Au Petit Dunkerque, quai de Conti, au coin de la rue Dauphine, Granchez tient le grand magasin curieux de marchandises françoises et étrangères, en tout ce que les arts produisent de plus nouveau, et vend, sans surfaire, en gros et en détail.»
Cette belle enseigne du Petit Dunkerque décorait la maison qui fait le coin du quai Conti et de la rue Dauphine; il y avait, en ce magasin, un amas d’objets d’art et de curiosité, venus des quatre points du monde, et tous{312} les jours, de midi à cinq heures, la file de voitures de maîtres s’étendait au-delà du collège Mazarin[246]. Il en était de même dans vingt endroits de Paris, où des boutiques, bien connues par leurs enseignes, voyaient affluer les acheteurs et surtout les acheteuses. Mais la Révolution approche, précédée de trois ou quatre années de stériles agitations politiques, et quand aura sonné le tocsin de 89, les équipages cesseront de se croiser dans les rues, les boutiques les mieux achalandées seront tout à l’heure désertes, et bientôt les plus belles enseignes, qui faisaient l’orgueil des marchands, auront disparu, avec ces coquettes et gracieuses images que l’art du dessin et de la gravure se plaisait à reproduire avec tant de variétés sur les adresses de l’aristocratie du commerce parisien.{313}
LES cartes du jeu de piquet et le tableau du jeu de l’oie ont été le point de départ d’une foule d’imitations plus ou moins ingénieuses, dans lesquelles on ne changeait rien à la marche du jeu primitif, en changeant seulement les figures. On ne peut donc s’étonner que les enseignes aient fourni matière à un nouveau jeu de l’oie et à un nouveau jeu de cartes.
Malheureusement, nous ne pouvons parler du jeu de l’oie des enseignes que d’après des souvenirs un peu confus qui datent de notre première jeunesse. Quant au jeu de cartes des enseignes de Paris, nous n’en possédons que quelques cartes, qui serviront du moins de spécimens pour constater l’existence de ce jeu, qui doit avoir été composé{314} et mis en vente vers 1820, à l’époque où les enseignes étaient à l’apogée de leur gloire.
Le jeu de l’oie des enseignes ne différait du jeu de l’oie ordinaire que par les cent sujets représentés que les joueurs avaient à parcourir, selon la chance des nombres amenés à chaque coup de dés. Le jeu, dessiné, gravé et colorié sur une feuille de papier, à l’instar du jeu de l’oie ordinaire, se composait de cent cases numérotées, dont chacune d’elles offrait une enseigne, prise au hasard d’après la fantaisie du dessinateur. Il y avait, comme dans le jeu de l’oie, les bons et les mauvais numéros, caractérisés par des enseignes de bon ou de mauvais augure, qui rapportaient au joueur un gain préfixe ou bien qui lui faisaient payer une amende: on restait enfermé, à l’enseigne des Barreaux noirs, jusqu’à ce qu’on fût délivré par un autre joueur, lequel prenait la place du premier, si le nombre apporté par le jet des dés l’amenait au même point; à l’enseigne de l’Ange gardien, on était payé par tout le monde; à l’enseigne du Bon Puits, on avait deux coups à jouer l’un après l’autre; à l’enseigne de la Tête de Mort, on quittait la partie, en laissant son enjeu; à l’enseigne de l’Écrevisse, on reculait de dix cases en arrière; à l’enseigne de la Victoire, on sautait dix cases en avant; à l’enseigne de la Boule de Neige, le coup était nul; enfin, après avoir parcouru les cent cases du jeu avec plus ou moins de vicissitudes, on gagnait la partie, en arrivant au nº 100, qui portait l’enseigne du Paradis. Il fallait, pour ne pas perdre toute espèce de chance favorable, passer par-dessus les enseignes de l’Enfer et du Purgatoire. Nous croyons que ce jeu de hasard avait été inventé vers 1804, au moment de{315} la réouverture des églises et du rétablissement du culte, car, de dix numéros en dix numéros, on rencontrait une enseigne religieuse, comme les enseignes de l’Église, de la Chapelle, du Couvent, etc. Sous la Restauration, ce jeu fut renouvelé et appliqué plus exactement aux enseignes en vogue de Paris, dont il représentait fidèlement les sujets en quatre-vingt-dix petits tableaux numérotés, avec indication de la spécialité et de l’adresse des commerçants. La disposition est toujours celle du jeu de l’oie; mais celui-ci ne se jouait pas avec des dés; c’est une espèce de loto qui se tire par billets et rappelle les combinaisons de la loterie royale, ayant, comme elle, quatre-vingt-dix numéros. Les enseignes sont gravées avec un certain soin et non coloriées, du moins dans l’exemplaire unique que nous avons vu à la Bibliothèque de la ville. En voici le titre, inscrit au centre de la spirale, avec la règle du jeu: «Le jeu de paris en miniature, dans lequel sont représentés les enseignes, décors, magasins, boutiques des principaux marchands de Paris, leurs rues et numéros. Éditeur, Mᵐᵉ veuve Chéreau, rue Saint-Jacques, nº 10.»
Quatre-vingt-dix enseignes y sont figurées, depuis la Famille des Jobards (marchand de tabac, rue du Faubourg-du-Temple, nº 19), portant le nº 1, jusqu’au Retour d’Astrée (magasin de nouveautés, boulevard des Panoramas, nº 12), représenté dans la case triomphale nº 90, tenant d’une main la corne d’abondance et de l’autre la branche de lis, qui date cette estampe des environs de 1815. Les numéros gagnants sont: 13, la Toison d’Or.—20, la Vestale.—26, Cendrillon.—40, la Corne d’Abondance.—54, les Trois Lurons.—59, la Chaste Suzanne.—77, le Diable à quatre.{316}—80, Gargantua.—84, le Grand Orient, et 90, le Retour d’Astrée. Les perdants sont: 1, la Famille des Jobards.—7, la Fille mal gardée.—32, Ma Tante Aurore.—39, les Forges de Vulcain.—44, le Panier percé.—64, le Ci-devant Jeune Homme.—69, les Trois Innocents.—73, les Deux Magots.—88, le Gastronome, et 89, la Barque à Caron. La plupart de ces enseignes ne figurent plus dans le Dictionnaire anecdotique de Balzac, publié dix ans plus tard.
Nous avons vu aussi à la bibliothèque Carnavalet une suite de seize vignettes assez finement gravées et coloriées, sous la rubrique commune Enseignes de Paris. Ce sont des enveloppes destinées à ces grands bonbons plats et carrés dont on garnissait jadis le dessus des boîtes de jour de l’an. Le certificat du dépôt porte la date de 1826, la même que celle du Petit Dictionnaire des Enseignes, auquel ces vignettes pourraient servir d’illustration. Nous y remarquons: les Deux Magots, le Coin de rue, le Pauvre Diable, le Gastronome, les Forges de Vulcain, le Soldat laboureur, la Fille mal gardée, le Banquet d’Anacréon, qui ont fleuri jusqu’à nos jours. Tout cela sent fort la publicité payante, qui commençait dès lors à se faire la dent.
Le jeu de cartes des enseignes était, au contraire, tout à fait inoffensif et simple. Il n’avait pas même été imaginé comme moyen d’annonce et de réclame, au profit des marchands, auxquels on empruntait leurs enseignes, sans daigner les nommer. Nous ignorons aussi de combien de cartes se composait ce jeu innocent, qui devait faire le passe-temps des arrière-boutiques. On le jouait sans doute à deux, à quatre, à six, et toujours par nombre pair, car{317} les joueurs devaient tous avoir le même nombre de cartes. Ces cartes se divisaient en deux catégories distinctes: les cartes à demandes et les cartes à réponses, placées un peu au hasard sous les auspices de telle ou telle enseigne. Chaque carte, entièrement gravée, offrait le dessin d’une boutique surmontée de son enseigne, le tout assez joliment colorié; au-dessous de cette image, on lisait soit la description de l’enseigne, soit une réflexion philosophique ou humoristique à son sujet; puis, au bas, sur deux colonnes, une double Demande ou une double Réponse, que les joueurs échangeaient entre eux. C’était là un simple jeu de questions, plus décent que beaucoup d’autres du même genre.
Citons, comme échantillon, quelques légendes de ces cartes, avec les demandes ou les réponses, qui en émanent plus ou moins naturellement.
Au Pauvre Diable. «Une jeune demoiselle, touchée de la situation d’un mendiant, lui offre avec grâce de quoi apaiser sa faim. Le malheureux paraît transporté de reconnaissance, en voyant tant d’humanité dans une aussi jolie personne.» Balzac, dans son Petit Dictionnaire[247], mentionne la même enseigne, qui était celle d’un marchand de nouveautés, rue Montesquieu, au coin de la rue Croix-des-Petits-Champs, et la décrit autrement: «Un jeune homme, dans la figure duquel on aperçoit une sorte de distinction, bien qu’il soit sous la livrée de l’indigence, paraît supplier une jeune fille. Que lui demande-t-il? Ses faveurs? Non, non, mais sa bienveillance.»{318}
Voici les deux demandes en rimes qui se lisent au-dessous de la carte du jeu des enseignes:
Voici maintenant deux réponses, à l’enseigne de la Pèlerine, avec une légende assez gaillarde, qui a la prétention d’être instructive: «Il est d’usage, en Espagne comme en Italie, de faire des pèlerinages, les demoiselles pour obtenir des maris, les dames pour devenir mères. Les jeunes gens fréquentent souvent ces lieux, pour éviter aux dames la fatigue de recommencer le voyage.» Balzac nous apprend que cette enseigne était celle d’un magasin de mercerie, rue Saint-Honoré, nº 275, et que la propriétaire de ce magasin l’avait adoptée, d’après une romance en vogue qui courait les rues de Paris[248]. Les réponses qui suivent cette enseigne s’en rapprochent tant bien que mal.
Passons à l’enseigne de Jean de Paris et à ses demandes. La légende nous donne le sujet de cette enseigne: «Le roi, surnommé Jean de Paris, vivement épris de la fille d’un pêcheur, afin de gagner le cœur de sa belle, ne dédaigne pas de prendre le costume de cette profession. Le père le surprend aux genoux de sa fille et devient furieux. Le roi, pour se soustraire à sa juste indignation, est forcé de se{319} faire reconnaître.»—Balzac critique fort cette enseigne d’un magasin de soieries, rue du Bac, nº 4. «Quoi! la princesse de Navarre se laisse baiser la main par Jean de Paris! s’écrie le grand sénéchal, avec un étonnement tout à fait comique. Eh bien! oui, l’indifférente princesse connaît enfin les délices de l’amour. Sur l’enseigne de la rue du Bac, c’est comme dans l’opéra, si ce n’est cependant que dans la pièce la princesse a l’air noble et la mise élégante, tandis que sur le tableau elle ressemble à une cuisinière endimanchée, et Jean de Paris à un conscrit. N’oublions pas de dire que le peintre, infiniment ingénieux, a mis un chêne centenaire, tout entier, dans la tête de l’héroïne et que cela produit un effet... Et le sénéchal donc, il est sublime comme un intendant[249].»
Au Diable boiteux. «Le Diable boiteux, dit la légende du jeu de cartes, délivré du pouvoir magique qui le retenait dans une bouteille, voulant marquer sa reconnaissance à son libérateur, lui fait remarquer l’intérieur des maisons et lui fait connaître les mœurs, les différents quartiers et les vices de toutes les classes de la société.» Dans Balzac, «le Diable boiteux est l’enseigne d’un magasin de nouveautés, rue de la Monnaie, nº 23, et c’est une demoiselle qu’il prend sous sa protection, et le petit bonhomme{320} à béquilles suffit pour la préserver des séductions d’une légion de diables qui ont un comptoir pour champ d’honneur et pour arme une demi-aune[250].»
A la Blanche Marguerite. «Une jolie demoiselle, éprise d’un page, interroge une fleurette que l’on nomme marguerite, en l’effeuillant pour savoir si elle est aimée un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Elle en était à la troisième fleur qui lui ôtait toute espérance, lorsque son amant, caché dans un arbre, s’empresse de la désabuser.» Balzac n’a pas décrit cette enseigne.
A la Belle Anglaise. «Les Anglaises sont belles et fières; on les dit sages, mais, pour l’amabilité, la finesse, l’esprit, la beauté et le plaisir, on préfère les Françaises.» Balzac fait l’éloge de cette enseigne d’un magasin de soieries, rue Saint-Denis, nº 94: «Le dessin de cette enseigne est assez artistement entendu; le peintre avait probablement un modèle. Ah! si c’était la maîtresse de la maison! Mais pourquoi pas[251]?»{321}
A la Balayeuse. «Par leurs jolies balayeuses, depuis nombre d’années les marchands de lingerie attirent les chalands.» Silence de Balzac sur la Balayeuse, qui était une sorte de falbala garnissant le bas de la robe des femmes et qu’on a remis à la mode il y a trois ou quatre ans.
A la Pie voleuse. «Une servante du village de Palezo (sic), accusée, jugée et exécutée pour un prétendu vol, a été reconnue innocente, après son exécution, par la découverte d’une pie, qui était l’auteur du vol.» Rien de Balzac sur la Pie voleuse.
Voilà tout ce que nous possédons de ce beau jeu des Enseignes de Paris sous la Restauration... Mais j’oublie qu’il en reste encore une carte, à l’Ange gardien, dont la Réponse pouvait bien annoncer la fin du jeu: «La Providence, pour sauver un jeune enfant près de tomber dans un précipice, se sert de la tendre sollicitude de l’Ange gardien.» Balzac a connu cette enseigne d’un magasin de lingeries, rue Saint-Honoré, et il lui consacre quelques lignes du dernier galant: «Ce magasin doit, en effet, être bien gardé par son enseigne, car il n’est voleur qu’elle ne puisse effrayer.{322} Il est vrai de dire que les dames des lingeries sont fort attrayantes, et qu’il faudrait n’avoir pas le sou pour ne pas acheter cravates, mouchoirs de poche, etc., etc.» Cet et cætera en dit plus qu’il n’est gros, et la Demande du jeu promet tout ce que la Réponse devait tenir:
Hélas! le jeu s’arrête là, au plus bel endroit, et les enseignes se taisent sur le reste.{323}
LES enseignes, accompagnées d’inscriptions en vers français, même en vers grecs et latins, devaient être nombreuses au XVIᵉ siècle, alors que le goût et la mode des inscriptions étaient si généralement répandus, qu’on alla jusqu’à attribuer au roi François Iᵉʳ ce quatrain[252] en l’honneur d’Agnès Sorel, qu’il aurait composé quand il visita, à Loches, le tombeau de cette maîtresse de Charles VII.
Le sentiment de cette inscription célèbre était meilleur que le style du roi chevalier, qui, ayant fait rétablir la tombe de la belle Laure, à Avignon, voulut en composer lui-même l’épitaphe, qui fut gravée sur le monument et qui ne fera pas mauvaise figure au milieu de cette poésie d’enseignes:
François Iᵉʳ voulut aussi que son poète valet de chambre, Clément Marot, consacrât quelques vers à la mémoire de la muse bien-aimée de Pétrarque[253]. L’exemple de François Iᵉʳ fut généralement suivi sous son règne, et jusqu’à la fin du siècle on faisait composer, par les poètes les plus renommés, des épitaphes en vers, qui étaient gravées sur les tombeaux[254]. La poésie était en honneur; les distiques grecs, latins et français illustraient aux jours de fêtes publiques les arcs de triomphe en toile peinte, les fontaines en torchis et les décors de l’Hôtel de ville. Il est tout naturel que les{325} inscriptions en vers soient descendues de ces monuments d’apparat sur les enseignes.
Malheureusement, ces enseignes enlevées ou détruites, on n’en a pas conservé les vers, si ce n’est dans quelques marques typographiques de libraires et d’imprimeurs[255]. On sait que ces marques n’étaient souvent que la représentation de leurs enseignes, qui sont ordinairement indiquées dans l’adresse même du libraire ou de l’imprimeur[256]. La plupart des marques typographiques datent du XVIᵉ siècle, et, comme nous l’avons déjà dit (voir chap. XVI, Enseignes de sainteté et de dévotion), elles ne laissent pas douter qu’un certain nombre des libraires de Paris ne fussent secrètement attachés à la réformation luthérienne ou calviniste.
Nous citerons seulement quelques distiques et quelques quatrains, gravés autour de ces marques ou imprimés au dessous. La marque de Conrad Badius, qui, après avoir exercé l’imprimerie à Paris, transporta ses presses à Genève, pour pouvoir professer librement la religion nouvelle, représente le Temps qui retire du puits la Vérité; ce distique est imprimé à droite et à gauche du sujet qu’il interprète:
Le libraire Jean Trepperel, qui fit paraître un grand nombre de vieux romans de chevalerie en prose, avait mis ce distique autour de son enseigne à l’Écu de France:
Gilles de Gourmond, imprimeur privilégié du roi, avait ajouté ce distique à ses armoiries, soutenues par deux licornes, sous les auspices de saint Georges:
L’imprimeur Le Petit Laurens, qui avait aussi dans sa marque deux licornes soutenant un cercueil couvert d’un poèle de deuil, avec ce nom: la Blanche, ne nous explique pas un sujet aussi lugubre dans ce distique philosophique:
Voici maintenant des quatrains qui expriment tous la dévotion, catholique ou protestante. Le libraire Jean Denis, dont la marque représente un docteur enseignant un berger, avec l’image du Christ dans une sphère, fait parler ainsi son berger:
Le fameux libraire des rois Louis XII et François Iᵉʳ, Antoine Vérard, qui fut à la fois dessinateur et graveur sur bois, avait fait inscrire ces quatre vers, chargés de fautes{327} grammaticales et d’abréviations, autour de sa marque, représentant un cœur, avec ses initiales, soutenu par deux aiglons et protégé par les armes de France:
Jean Bouyer et Guillaume Bouchet, libraires et imprimeurs, qui avaient affronté un bœuf et un mouton héraldiques au-dessus de leurs initiales, faisaient cette prière à Dieu, dans leur enseigne:
Cette inscription, assez pauvrement rimée, inscrite en lettres gothiques autour de la marque, était heureusement presque illisible. Les cinq vers suivants, gravés autour de l’enseigne de Guillaume Nyverd, laquelle représentait l’Annonciation, n’étaient pas beaucoup plus faciles à déchiffrer, quoique ces vers fussent sans le moindre doute empruntés à quelque poète du temps, qui avait voulu représenter par des images allégoriques l’Incarnation de Jésus-Christ:
Michel et Philippe Lenoir, père et fils, libraires et imprimeurs, en faisant soutenir par deux nègres un écusson d’armoiries, pour faire allusion à leur nom, se plaisaient à répéter ce petit quatrain autour de leur enseigne emblématique:
Enfin, André Bocard, libraire et imprimeur, qui avait placé dans sa marque l’écusson de l’Université et celui de la Ville de Paris, au-dessous de l’écu de France, avait fait inscrire autour de son enseigne le quatrain suivant, qui s’adressait moins à Dieu qu’à ses saints:
C’est assez pour faire connaître les enseignes poétiques des libraires et des imprimeurs parisiens du XVIᵉ siècle.
Nous rapprocherons de ces enseignes une inscription d’une date plus récente (sans doute du siècle suivant), qui était gravée au-dessus de la porte d’un passage conduisant de l’ancien cimetière de Saint-Séverin à la rue de la Parcheminerie. Il est probable que cette inscription édifiante, en jeux de mots, était surmontée de quelque peinture funèbre, comme celle qui existait autrefois à l’entrée du charnier de l’église Saint-Paul:
Vers le même temps on avait placé un buste de Henri IV, avec un distique latin, sur la façade du nº 3 de la rue Saint-Honoré, maison devant laquelle ce roi fut assassiné par Ravaillac, et qui a été démolie vers 1869, quand on a fait passer par là la large rue des Halles. Ce buste avait fini par devenir une enseigne, dont ces deux mauvais vers faisaient la légende:
Ce qui signifie mot à mot: «La présence de Henri le Grand réjouit les citoyens, que l’amour a joints à lui par un pacte éternel.» En dernier lieu le buste et l’inscription servaient d’enseigne à un marchand de draps. Nous comprendrions, pour un tailleur, l’enseigne du roi Dagobert; mais Henri IV? L’inscription seule, gravée en lettres d’or sur une plaque de marbre noir, se retrouve encore aujourd’hui au musée Carnavalet. Quant au buste de Molière, qu’Alexandre Lenoir avait fait poser, sous les Piliers des Halles, devant la maison où l’on croyait que notre grand comique était né, ce buste était devenu aussi une enseigne pour un marchand revendeur de vieilles étoffes, mais on avait eu la pudeur de le peindre en noir, en l’appelant la Tête noire, et Molière n’y était pas nommé, ni en prose ni en vers. Au surplus, les enseignes à la Tête noire étaient alors assez communes à Paris, mais elles n’avaient pas le même{330} type. Celle d’un marchand de meubles, dans la rue du Faubourg-Saint-Antoine, offre un type de nègre coiffé d’un turban, qu’on nommera peut-être un jour Othello ou Toussaint-Louverture.
Nous avons lu dans les poètes du XVIIIᵉ siècle différentes inscriptions en vers pour des cadrans solaires, mais comme nous ne savons point où ces cadrans solaires étaient posés, peut-être dans des cours d’hôtels aristocratiques, nous nous bornerons à citer une inscription de ce genre, qui avait été demandée à Voltaire dans sa jeunesse, et qui fut, dit-on, longtemps visible sur l’enseigne d’un horloger du quartier Saint-Gervais:
Si cette inscription eût été signée du nom de son auteur, l’enseigne aurait fait la fortune de l’horloger et de ses successeurs. Les vers d’enseigne, en effet, n’étaient pas toujours faits par des poètes. Ainsi l’enseigne d’un boulanger,{331} qu’on voyait encore, il y a peu d’années, entre la rue Saint-Paul et l’église Saint-Paul-Saint-Louis, représentait deux mitrons en costume à qui le maître boulanger montrait un de ses pains, et l’on ne pouvait guère attribuer les vers suivants qu’à un boulanger ou à un mitron:
Si les boulangers se mêlaient de faire des vers pour leurs enseignes, les artistes décrotteurs, comme ils se qualifiaient depuis le Directoire, rimaient aussi pour attirer le client. Voici un échantillon de leur poésie, tel qu’on l’admirait, en 1804, sur l’enseigne de leur boutique du passage des Panoramas:
Les enseignes avec inscriptions en vers, à Paris, étaient encore au nombre de dix à douze, en 1826. C’est Balzac qui a pris la peine de les recueillir lui-même, pour les faire passer à la postérité, dans son curieux Petit Dictionnaire des Enseignes[259]. On sait combien Balzac s’intéressait aux enseignes{332} et avec quel soin il les mentionnait dans ses romans, quand il les jugeait dignes d’y figurer. Nous n’avons donc plus qu’à faire ici quelques emprunts à la monographie alphabétique publiée par Balzac.
Il y avait alors, en 1826, un artiste en cheveux, c’est-à-dire un coiffeur, qui, pour s’assurer la clientèle des étudiants en droit et en médecine, avait fait peindre, sur la devanture de sa boutique de la rue Saint-Jacques, nº 121, deux vers grecs, que Balzac n’a pas cités, et deux vers latins, qui ne prouvent pas que le patron, M. Chatelet, avait fait ses humanités:
Ce qui a la prétention de vouloir dire: «Ici un art ingénieux façonne les cheveux à la mode du jour, et d’une main habile y ajoute de nouveaux agréments.» Cet affreux latin était mis là pour justifier l’enseigne: Au savant Perruquier; l’une et l’autre inscription, la grecque et la latine, se voyaient encore vers 1840. Deux autres coiffeurs avaient fait aussi un touchant appel, en vers, aux dames et aux messieurs. Lambert, qui s’intitulait perruquier-coiffeur, rue Notre-Dame-de-Nazareth, nº 28, était certainement l’auteur de ce double distique, écrit des deux côtés de sa boutique; ici, côté des hommes:
Là, de l’autre côté, côté des dames:
«C’est une chose convenue, dit Balzac, qu’en fait de poésie il n’y a que les coiffeurs, et nous n’hésitons pas à dire qu’en fait de vers M. Lacroix a mis le sceau à la réputation du corps.» Lacroix, perruquier-coiffeur, rue Basse, Porte Saint-Denis, nº 8, avait mis ce quatrain au bas de son tableau d’enseigne représentant Absalon pendu par les cheveux aux branches d’un arbre:
Balzac a oublié un coiffeur de ce temps-là, Michalon, père du peintre de ce nom, demeurant alors rue Feydeau et faisant des vers enragés de coiffeur, qu’il exposait en tableaux à tous les coins de ses salons de coiffure.
Le Petit Dictionnaire des Enseignes de Paris cite trois magasins de nouveautés (non pas des livres, mais des chiffons), avec des enseignes en vers:
Primo: Au Nœud gordien, Palais-Royal, galerie de pierre, nº 233:
C’est là ce que dit la demoiselle de magasin, peinte sur l’enseigne, à un élégant jeune homme qui achète une cravate et qui ne répond pas en vers.
Secundo. Au Soldat cultivateur. M. Marchandon, marchand de nouveautés, faubourg Saint-Antoine, nº 77, avait{334} fait faire à prix réduit, dans l’atelier du peintre Vigneron, la copie de son tableau du Soldat laboureur, dans lequel le soldat est représenté bêchant son champ et faisant sortir de terre des débris d’armes et d’ossements qui annoncent que l’agriculture a repris possession d’un ancien champ de bataille. Les vers explicatifs sont pris dans les Géorgiques de Virgile, traduites par Delille:
C’était peu réjouissant pour les demoiselles du faubourg, qui allaient acheter manchettes, cols et foulards.
Tertio. A la Pèlerine. Magasin de mercerie, rue Saint-Honoré, nº 275, avec ces petits vers imités d’une chanson en vogue:
Enfin, Balzac avait découvert deux sages-femmes, outre la fillette sage de la Pèlerine, lesquelles osaient appliquer chacune deux vers à leur délicate profession. La première, qui ne se nommait pas sur son enseigne, demeurait rue Jean-Jacques-Rousseau, nº 23: cette enseigne représentait une belle accouchée et son accoucheuse très élégante et fort jeune; puis, le papa tout fier de sa progéniture, et le petit frère caressant le nouveau-né. La morale de cette scène{335} intime est exprimée dans ces deux vers inscrits en tête du tableau:
Chez la seconde sage-femme, Mᵐᵉ Vachée, rue de Buci, nº 2, on restait interdit devant une enseigne dont la description ne saurait être plus complète qu’elle l’est dans le Petit Dictionnaire de Balzac: «Cette dame, dit-il, voit s’échapper d’une machine qu’on ne peut mieux comparer qu’à un four, une nuée d’enfants habillés des costumes de différents états, et elle leur adresse ces vers:
«Dans le lointain, la déesse elle-même, un pied sur une roue, emblème de sa mobilité, semble inviter à la suivre la foule des jeunes mortels auxquels Mᵐᵉ Vachée vient de donner la lumière. Mais des juifs, des usuriers, des nymphes folâtres les séparent.» Nous avons donné plus haut (p. 292), le dessin à peu près semblable, d’une autre enseigne de sage-femme.
Une des dernières enseignes en vers qu’on ait vues à Paris était celle d’un tailleur, au coin de la rue d’Ulm et de la rue des Postes; mais nous ne savons pas si le peintre était venu en aide à la poésie, car nous n’en connaissons que ce quatrain, qui vaut tout un poème:
Nous regrettons de n’avoir pas parlé des écriteaux poé{336}tiques, qui sont de véritables enseignes sans figures: ainsi toute la jeunesse du quartier latin a connu ce facétieux brocanteur de la rue de l’École-de-médecine, qui, chaque matin, apposait sur les objets hétéroclites de son commerce les plus étranges annonces en prose et en vers; la prose était de sa façon, les vers sortaient de la fabrique d’un poète crotté, qui ne manquait pas d’originalité et qui trouvait les plus incroyables drôleries relatives à l’origine des marchandises d’occasion.
Les contemporains de la révolution de 1830 se rappellent aussi les affiches en vers que le marquis de Chabannes, pair de France, chansonnier, journaliste et rimeur politique, improvisait tous les jours pour annoncer ses brochures, ses chansons, ses prospectus, qu’il distribuait et vendait lui-même, au Palais-Royal, dans sa boutique de la galerie d’Orléans, que la police eut tant de peine à faire fermer, après avoir cent fois saisi, enlevé et déchiré les affiches, au milieu des éclats de rire des spectateurs.
Enfin, en faisant appel à nos souvenirs personnels, nous revoyons encore, vers 1840, rue Neuve Saint-Augustin, non loin de la place de la Bourse, une boutique mystérieuse qui étalait au-dessus de son vitrage dépoli un grand tableau représentant un monsieur mis à la dernière mode, prenant vivement congé d’une dame non moins élégante. Au bas, se lisait ce distique révélateur:
CETTE espèce d’enseignes est tout à fait moderne, car elle ne date que de l’époque où les grandes enseignes, peintes comme des tableaux et quelquefois rivalisant avec eux, furent adoptées par la mode avec une sorte de passion essentiellement parisienne. On peut fixer une date précise pour le commencement des enseignes qui reproduisirent quelque scène de la pièce en vogue. Ce fut seulement sous l’Empire que parurent les premiers essais de ce genre nouveau d’enseignes, qui ont attiré presque exclusivement l’attention des curieux de ce qu’on appela dès lors le Musée des rues. Il n’y a que les pièces de théâtre, à grand succès, qui aient mérité la consécration de l’enseigne. C’étaient donc, chaque année, quatre ou cinq enseignes nou{338}velles, qui rappelaient au public les grands succès récents. Le type de l’enseigne devenait ainsi populaire, et la vogue de la pièce profitait à l’industriel qui l’avait adopté. Les enseignes théâtrales firent fureur pendant plus de cinquante ans; elles s’étaient, pour ainsi dire, emparées de la ville entière, et le succès d’une pièce de théâtre n’était jamais mieux constaté que par l’apparition d’une enseigne qui en portait le nom.
On peut affirmer que l’idée de faire des enseignes de ce genre n’était jamais venue à l’esprit des marchands avant le Directoire; du moins n’en connaissons-nous qu’une seule, l’enseigne du Huron, consacrant, en 1769, le succès d’un opéra-comique de Grétry, et dont nous parlerons plus loin, au chapitre XXIX. Les succès les plus extraordinaires, comme celui de Jeannot, ou les Battus paient l’amende, le proverbe-comédie-parade de Dorvigny, représenté trois cents fois de suite chez Nicolet, ou comme celui du Mariage de Figaro, qui fit autant de bruit qu’une révolution, ces succès ne donnèrent pas lieu à la création d’une seule enseigne. Le moment n’était pas venu, quoique depuis 1761 les enseignes, appliquées contre le mur des maisons, au lieu d’être suspendues à des potences en fer dans des cadres mobiles, se prêtassent mieux à l’exposition de tableaux. On comprend que le goût du spectacle, si décidé et si général chez les habitants de Paris, se soit traduit par cette innovation dans le système des enseignes, en un temps où le nombre des théâtres avait triplé. Il faut dire aussi qu’avant ce temps-là les marchands menaient une vie très retirée et très parcimonieuse, sans songer à imiter les habitudes des autres classes de la société, qui ne se faisaient pas faute d’aller à{339} la comédie. Les enseignes des boutiques ne subirent l’influence du théâtre que quand les boutiquiers commencèrent à se montrer et à s’acclimater dans les salles de spectacle.
Nous trouvons cependant que les ballets de cour eurent, dans la première moitié du XVIIᵉ siècle, certaines analogies avec plusieurs enseignes de Paris. Ainsi l’enseigne primitive du Cherche-Midi, qui a précédé celle dont nous avons parlé plus haut, page 84, était sans doute bien antérieure au ballet des Chercheurs de midi à quatorze heures, ballet qui fut dansé, au Louvre, en présence du roi, le 29 janvier 1620. Ce ballet[260], que nous ne connaissons que par un petit programme en vers très libres, a peu de rapport avec l’enseigne qui représentait des gens de diverses conditions, cherchant l’heure de midi sur un cadran dont les aiguilles marquaient quatorze heures, comme dans les horloges d’Italie. Les chercheurs de midi à quatorze heures, qu’on appelait des cherche-midi, étaient de pauvres hères faméliques en quête du dîner, qu’ils ne trouvaient pas à quatorze heures, car on dînait partout à midi. Un roman picaresque d’Oudin, sieur de Préfontaine[261], nous apprend le véritable rôle d’un cherche-midi, que le ballet mit en scène sous les traits du joueur de gobelets, du batteur de fusil, du ramoneur, du vendeur de lunettes: «La grande nécessité où j’estois m’ayant pourveu d’un office de cherche-midy, j’allois parfois en des couvents, mais j’y trouvois petite chance, au moins pour moy, car, pour les moynes, ils faisoient une telle chère, que,{340} si la fumée de leurs bons morceaux qui me passoient devant le nez avoit esté rassasiante, cela m’auroit bien nourry.» Un autre ballet de cour, qui a pour titre la Fontaine de Jouvence[262], imprimé en 1643 et par conséquent dansé cette année-là au château de Saint-Germain, pourrait bien avoir été inspiré par la jolie enseigne du XVIᵉ siècle dont nous avons parlé et qui attirait tous les regards dans la rue du Four-Saint-Germain. Enfin, dans un ballet du roi, à la naissance du Dauphin, en 1643, les Enseignes de Paris faisaient leur entrée sous la figure d’une femme qui se plaignait des dégâts que les grands vents lui avaient causés dans les derniers orages. Voici deux strophes que Dassoucy avait mises dans la bouche de cette fée des enseignes[263]:
A partir de là, comme si toutes les enseignes de Paris avaient été décrochées et brisées par l’ouragan, elles ne{341} reparaissent plus au théâtre que dans deux chétifs vaudevilles: l’un, de Martainville: Pataquès, ou le Barbouilleur d’enseignes, joué en 1803; l’autre, de Brazier, Moreau et La Fortelle, Tout pour l’enseigne, représenté le 18 avril 1815. Ces deux petites pièces ne réussirent pas. C’est que les marchands et leurs commis ne souffraient pas qu’on se gaussât de leurs enseignes. Scribe et Saint-Georges l’apprirent à leurs dépens, quand leur opéra-comique, en trois actes, le Fidèle Berger, dont Adolphe Adam avait fait la musique, fut outrageusement sifflé, à la première représentation, le 11 janvier 1838. Les auteurs n’avaient pas trop ménagé la confiserie parisienne, mise en scène sous la bannière de la vieille enseigne du Fidèle Berger: on se battit au parterre, et les perturbateurs qui furent arrêtés étaient tous des confiseurs: «Ces gaillards-là, dit Scribe, seraient capables de m’empoisonner avec leurs dragées de baptême.» Il ne fit pas imprimer sa pièce, qui n’a paru que dans la dernière édition de ses Œuvres complètes; le musicien essaya de la faire jouer à Bruxelles, où elle fut traitée en douceur[264]. Les confiseurs du Fidèle Berger n’étaient plus là. Marchands à enseignes et auteurs dramatiques furent depuis en parfaite intelligence, lorsque les enseignes des premiers contribuèrent grandement à la renommée des seconds.
Il est impossible d’entrer ici dans quelques détails sur les pièces de théâtre auxquelles on accorda les honneurs de l’enseigne depuis cinquante ou soixante ans; nous nous bornerons donc à citer, d’après le Petit Dictionnaire critique et anecdotique des Enseignes de Paris, celles de ces{342} enseignes inaugurées sous les titres mêmes des pièces de différents genres, aux succès desquelles les marchands avaient attaché celui de leur commerce. Il suffit de rappeler que ces pièces étaient encore très connues en 1826, bien que quelques-unes remontassent aux premières années de l’Empire; plusieurs, d’une date plus ancienne, comme le Diable à quatre de Sedaine, les Trois Sultanes de Favart, et la Partie de chasse de Henri IV, par Collé, avaient été reprises avec éclat et étaient restées au répertoire.
Les tableaux dont on faisait des enseignes furent souvent composés et exécutés par de véritables peintres. Nous parlerons, dans le chapitre XXIX, Musée des enseignes, de ceux qui sortaient de l’atelier des meilleurs artistes.
L’Académie royale de musique reconnaissait des opéras et des ballets de son répertoire dans les enseignes suivantes: Aux Bayadères, boulevard des Italiens, nº 9, Nouveautés. Les Bayadères, opéra en trois actes, paroles de Jouy, musique de Catel, représenté le 8 août 1810.—A la Vestale, rue Montmartre, au coin de la rue de Cléry, Nouveautés. La Vestale, tragédie lyrique de Jouy, musique de Spontini, fut représentée le 11 décembre 1807.—A la Lampe merveilleuse, Demarais, lampiste, illuminateur du Gouvernement. Aladin, ou la Lampe merveilleuse, opéra-féerie en cinq actes, par Étienne, musique de Nicolo et de Benincori, fut représenté le 6 février 1822.—Au Triomphe de Trajan, M. Payen, tailleur, rue de Richelieu, nº 77. Le Triomphe de Trajan, tragédie lyrique en trois actes, par Esmenard, musique de Lesueur et de Pertuis, fut représenté le 23 octobre 1807.
Passons au Théâtre-Français, qui avait vu, en plein Di{343}rectoire, apparaître l’enseigne des Trois Sultanes, un des plus beaux tableaux d’enseigne de Paris, pour annoncer le magasin de mesdames Delatour, lingères, rue Vivienne, au coin de la rue Colbert.—A Marie Stuart, Nouveautés, rue Saint-Denis, nº 392. Marie Stuart, tragédie de Pierre Lebrun, représentée en 1820.—Aux Templiers, rue Feydeau, nº 16, Michalon, coiffeur. Les Templiers, tragédie de Raynouard, représentée en 1805.—A la Fille d’honneur, rue de la Monnaie, au coin de la rue Boucher. La Fille d’honneur, comédie en cinq actes et en vers, par Alexandre Duval, représentée en 1819.—A Valérie, rue Saint-Denis, nº 309, magasin de nouveautés. Valérie, comédie, en trois actes et en prose, par Scribe et Melesville, représentée en 1822.—Aux Deux Cousines, magasin de nouveautés, rue Coquillière. L’Éducation, ou les Deux Cousines, comédie en cinq actes et en vers, par Casimir Bonjour, fut représentée en 1824.
Le théâtre de la porte Saint-Martin avait fourni, à lui seul, deux fois plus d’enseignes que l’Opéra et le Théâtre-Français: Au Vampire, magasin de nouveautés, rue Saint-Antoine.—Au Bourgmestre de Saardam, Grisard, drapier, rue Saint-Honoré, nº 53.—Aux Petites Danaïdes, Potier, confiseur, boulevard Saint-Martin, nº 57. (Il ne faudrait pas confondre l’acteur avec le confiseur, malgré la similitude du nom: le fameux comédien Potier avait créé le rôle du Père Sournois, dans les Petites Danaïdes, de Gentil et de Désaugiers.)—Au Solitaire, Malard, marchand de nouveautés, rue du Faubourg-Saint-Denis, nº 68.—A Joko, ou le Singe du Brésil.—A Polichinel (sic) vampire.—A la Fille mal gardée.—Aux Ramoneurs.—Au Déserteur, etc.{344}
Les enseignes drôlatiques se rapportaient surtout à des pièces du théâtre des Variétés, dans lesquelles avaient figuré les premiers acteurs de ce théâtre, Brunet, Potier, Odry, Vernet, Bouffé, etc., comme le Désespoir de Jocrisse, le Ci-devant Jeune Homme, etc. Le théâtre du Vaudeville inspirait des sujets d’enseignes gaies et plaisantes, sans être bouffonnes, comme les Deux Gaspard du faubourg Saint-Denis, dont nous avons donné la figure page 197, les Deux Edmond, le Petit Matelot, Monsieur Dumolet, Monsieur Pigeon (le héros d’Une Nuit de la Garde nationale), dans la rue de Seine, etc. Il y avait aussi les enseignes patriotiques, ou chauvinesques, que le Vaudeville, les Variétés, le Cirque Olympique, et même le Gymnase, auraient dû fournir en plus grande quantité, mais que la crainte de la Censure interdisait souvent aux commerçants les plus paisibles; nous en pourrions néanmoins citer une vingtaine, entre{345} autres, les Deux Sergents, dans la rue Saint-Honoré, en face la rue du Coq, aujourd’hui Marengo; Fanfan la Tulipe, Michel et Christine, le Soldat laboureur, le Chien du Régiment, François les Bas-bleus, à l’angle du faubourg Montmartre et de la rue Fléchier, etc.
Presque tous les grands succès du Gymnase dramatique, dus la plupart à l’infatigable fécondité du talent de Scribe, furent signalés par l’apparition de nouvelles enseignes, qui augmentaient et prolongeaient la vogue de Malvina, ou le{346} Mariage d’inclination, du Mariage enfantin, de la Carotte d’Or, du Gamin de Paris, du Comédien d’Étampes, etc.[265].
Les spectacles du boulevard du Temple, la Gaîté,
l’Ambigu-Comique, le Cirque Olympique, les Funambules, etc., avaient eu aussi de grands succès populaires, et, par conséquent, ces succès s’étaient affirmés par un grand nombre d’enseignes boutiquières, qui duraient beaucoup plus longtemps que ces pièces de différents genres,
telles que l’Oiseau bleu, les Deux Pierrots, qui sont toujours en place, au coin de la rue Saint-Jacques et de la rue de la Huchette (voir figure p. 349), les Innocents, les Quatre Sergents de la Rochelle, du boulevard Beaumarchais, etc. Mais, comme tout passe ici-bas, les plus beaux drames, les plus merveilleuses féeries, les plus amusantes pantomimes, les mimodrames les plus éblouissants n’avaient qu’un temps, et, après cent ou deux cents représentations, étaient{348} absolument oubliés, en sorte que les enseignes nées de leur vogue pouvaient à peine leur survivre. Voilà comment la plupart des enseignes qui rappelaient à la foule les mélodrames de Guilbert de Pixérécourt disparurent avant le célèbre auteur de la Femme à deux maris, de Cœlina, ou l’Enfant du Mystère, du Chien de Montargis et de Latude.
Les pièces en musique, les opéras-comiques, dont les airs deviennent si populaires, quand l’orgue de Barbarie les propage, multiplièrent les enseignes peintes d’après nature, avec les portraits des plus célèbres chanteurs et chanteuses du théâtre de l’Opéra-Comique: A la Clochette, Au Chaperon rouge, A Joconde, A la Somnambule, A la Dame blanche, etc.{349}
La révolution du 24 février 1848 marqua le déclin du règne de ces sortes d’enseignes à Paris. Les marchands conservèrent celles qui avaient fait la réputation de leurs maisons de commerce; mais il fallut bien reconnaître, petit à petit, que les enseignes en tableaux étaient démodées; puis, certains propriétaires trouvèrent à redire à ces enseignes, qui pouvaient parfois diminuer la valeur d’un immeuble. On avait aussi constaté qu’une enseigne peinte à l’huile, étant toujours exposée à l’air, subissait à son détriment les variations de la température; on devait donc, de temps à autre, la faire revernir ou même la soumettre à de plus sérieuses réparations. Bien d’autres raisons achevèrent de discréditer ce genre d’enseignes. On avait pourtant évité avec soin, malgré le succès énorme de certaines{350} pièces de théâtre, telles que la Vie d’un joueur, l’Auberge des Adrets, le Faussaire, Cartouche, etc., de donner à tel ou tel magasin une enseigne qui pouvait prêter à des allusions ou à des rapprochements désagréables. On vit donc peu à peu disparaître les enseignes empruntées à des pièces de théâtre, sous prétexte qu’une ancienne pièce n’avait plus de sens aux yeux d’une génération nouvelle. La suppression de ces enseignes, souvent fort coûteuses, gagna de proche en proche, et le public n’eut pas l’air de s’en apercevoir. Ce fut le commencement de la décadence de toutes les enseignes peintes. On s’était convaincu, par expérience, que si les annonces de la quatrième page des grands journaux politiques, inaugurées en 1837 par Emile de Girardin et Dutacq, coûtaient plus cher que les plus belles enseignes, elles rapportaient dix fois davantage. L’annonce et la réclame, qui détrônaient décidément l’enseigne, finirent pourtant par avoir la leur, au nº 31 de la rue Croix-des-Petits-Champs, où s’étale en belle place une assez pauvre figure d’une Renommée gigantesque, en mosaïque grisaille sur fond d’or, avec cette légende éloquente: Ars famæ[266].
Il existe encore, ainsi qu’on a pu le voir au cours de cet ouvrage, un assez grand nombre d’anciennes enseignes peintes, mais on n’en fait plus guère de nouvelles, bien que, devenant plus rares, on doive peut-être les remarquer davantage. Nous n’avons pas à faire l’histoire de ces enseignes de la dernière heure, quoique plusieurs soient encore des signes{351} de la tradition; nous n’en citerons qu’une, qui produisit tout l’effet de curiosité qu’on pouvait attendre d’une enseigne: Aux Mystères de Paris, ancienne maison Bourdillot, 6, rue du Temple, Guibert, spécialité de blanc et lingerie. Le succès des Mystères de Paris, d’Eugène Sue, valait bien une enseigne. Il est bon de rappeler que le Juif errant, dont le succès fut encore plus grand, avait été accueilli au théâtre avec la même faveur que le roman parmi les lecteurs, mais pas un marchand n’osa s’attribuer une aussi fâcheuse enseigne, sous peine d’être montré au doigt, comme un juif dénoncé par son enseigne.
Nous ne pouvons cependant oublier cette enseigne, plus moderne, d’un chapelier du boulevard de Sébastopol, nº 28 bis, qui aurait pu figurer dans le chapitre consacré aux enseignes singulières: A l’Hérissé, figure d’un homme à crinière de porc-épic, s’élevant d’un demi-mètre au-dessus de sa tête, et difficile à coiffer, assurément, pour tout autre que l’ingénieux industriel qui l’arbore au-dessus de sa boutique depuis une vingtaine d’années[267].{352}
LA Révolution commence en 1789, et l’on peut dire, avec Colnet[268], que l’enseigne va parcourir toutes les phases de cette révolution. «Au lieu de rester, comme nous l’avons vue jusqu’ici, dit M. Amédée Berger, tantôt patronale, c’est-à-dire portant l’effigie du saint, protecteur de la corporation, tantôt parlante et représentant les outils du métier, ou enfin imaginaire avec des figures capricieuses et insignifiantes, nous allons la voir devenir politique[269].» Il y avait eu sans doute, et peut-être de tout temps, des{353} enseignes politiques, mais ce n’était qu’une exception, au lieu d’être une généralité. Ainsi l’avénement de Louis XVI au trône avait été signalé par l’enseigne de la Poule au pot, accompagnée de ces vers satiriques:
Colnet remarque très judicieusement que les enseignes, à partir de cette époque, semblent faites pour retracer les mœurs du jour et les révolutions des idées. En 1789, après le 14 Juillet, «tout est à la Bastille, dit M. Amédée Berger: l’image de la vieille prison est représentée de cent façons diverses; on la voit sur tous les murs; les hommes portent, sur leurs habits, des boutons représentant les différents épisodes de la journée du 14 Juillet, et les femmes se coiffent avec des bonnets garnis de deux rangs de créneaux en dentelle noire. Pendant l’année 1790, tout devient à la Fédération, et en 1791, c’est le tour de Monsieur Veto.»
L’enseigne suivait le mouvement des esprits: «Il y en avait de révolutionnaires, dit M. J. Poignant[270], il y en avait de contre-révolutionnaires, et comme le Parisien est essentiellement de l’Opposition, ces dernières étaient les mieux achalandées; il y en avait de gaies, il y en avait de tristes, il y en avait d’indifférentes.» Les hôtels garnis, dont le nombre augmentait sans cesse avec la population flottante de{354} Paris, avaient changé leurs enseignes pour se disputer les voyageurs qui arrivaient de la province plutôt que de l’étranger; un de ces hôtels, dans la rue de Richelieu, prenait l’enseigne des États-Généraux; un autre, celle de l’Assemblée nationale, un autre celle du Grand Necker.
Le plus somptueux d’entre eux existe encore; c’est le grand hôtel Mirabeau de la rue de la Paix. L’histoire de son enseigne est assez piquante, et nous a été contée par le petit-fils du fondateur. Ce brave homme, originaire du village du Lys, aux environs de Senlis, était venu, comme tant d’autres, chercher fortune à Paris vers 1789. Il avait ouvert à la Chaussée-d’Antin, qui n’était encore qu’un élégant faubourg, un modeste hôtel meublé qu’il baptisa Hôtel du Lys. Vinrent les premiers troubles de la Révolution, qui dépopularisèrent la fleur de lis à tel point, que l’enseigne du Lys, toute géographique qu’elle était, devenait compromettante. Mirabeau venait de mourir dans un hôtel de la Chaussée-d’Antin, voisin de l’hôtel garni; il n’avait pas dédaigné de venir s’asseoir à la table d’hôte avec des amis politiques, la rue de la Chaussée-d’Antin avait reçu son nom par acclamation populaire; l’hôtel adopta aussi cet illustre patronage, sous lequel il traversa vaillamment les mauvais jours de la Terreur, l’Empire et, ce qui est plus surprenant, la Restauration, que tous les hôteliers de Paris accueillirent avec enthousiasme. Le petit hôtel avait grandi; de la rue du Mont-Blanc, il était passé rue du Helder, puis rue Napoléon, dès son ouverture en 1806. A la rentrée des Bourbons, il conserva fièrement son enseigne, tandis que la rue abdiquait piteusement son nom pour prendre celui de rue de la Paix. Il ne paraît pas disposé à l’abandonner.{355}
On reconnaît bientôt l’affaiblissement du respect des choses religieuses par la disparition successive des images de saints qui avaient été les premiers patrons de l’enseigne, et qui n’étaient pas moins fêtés dans les rues de la capitale que dans le calendrier. On fait enlever, sans bruit et sans scandale, certaines enseignes trop royalistes; on efface certaines inscriptions trop favorables à l’ancien régime: par exemple, le meilleur confiseur de la rue des Lombards, qui recommandait sa maison par l’enseigne du Grand Monarque, corrige cette enseigne en l’intitulant: Au Grand Vainqueur; mais les royalistes lui gardent rancune d’avoir débaptisé cette enseigne renommée, et ils lui tournent le dos pour donner leur clientèle aux magasins du Fidèle Berger et des Deux Amis, deux boutiques voisines dont les enseignes n’ont rien à démêler avec la politique.
Après l’arrestation du roi et de la famille royale à Varennes (juin 1791), l’Assemblée nationale rend un décret qui ordonne d’effacer partout les emblèmes de la royauté. Ce décret s’attaque surtout aux enseignes sur lesquelles figurent les armes royales et les insignes royaux. Quelquefois le commerçant, irrité de la guerre tyrannique faite à son enseigne, résistait autant que possible à ces misérables tracasseries, exercées contre lui au nom du peuple. Un restaurateur, à l’enseigne du Tigre royal, ayant été sommé par la municipalité de supprimer l’épithète de royal, la remplaça par celle de national et eut l’audace de faire inscrire, à la porte de son établissement: Au Tigre national[271]. Le frontispice d’un Almanach de 1792 représente des ouvriers{356} enlevant des enseignes qui portaient le nom ou les armes du roi, ainsi que les symboles du gouvernement monarchique.
Depuis que l’armée des princes se formait à Coblentz dans le but de venir délivrer Louis XVI, prisonnier de l’Assemblée nationale, les bureaux des racoleurs fonctionnaient à Paris avec une fiévreuse activité pour donner des hommes à l’armée royale, qui avait besoin de nouvelles recrues en prévision d’une guerre d’invasion. D’autre part, ces bureaux s’étaient multipliés depuis que le ministère payait la prime d’engagement, et leurs enseignes, exclusivement militaires et patriotiques, avaient remplacé partout des enseignes bachiques et affriolantes, qui eurent toujours tant d’empire sur les pauvres dupes du racolage. De cette époque datent certaines enseignes qui ont subsisté jusqu’à nos jours, et qui faisaient appel à la bonne volonté des remplaçants, dont la conscription autorisait légalement le trafic, comme une espèce de marché de chair humaine. Il n’y a pas longtemps que nous avons vu disparaître le Petit Tambour, au coin de la rue de Bièvre; le Grenadier, rue Corneille, etc.; l’Ancien Tambour, quai de la Tournelle, existe même encore, ainsi que les Deux Sapeurs de la rue Jean-Jacques-Rousseau.
C’est en 1793, après le 10 Août, que la fermeture des églises porta le dernier coup aux statues de piété que la dévotion de nos aïeux avait érigées au coin des rues et sur la façade des maisons. On ne fit pas grâce à celles que le zèle de quelques courageux propriétaires s’efforçait encore de protéger. C’est alors que le buste de Marat remplaça la statue de la Vierge dans la rue aux Ours et qu’un restau{357}rateur de la rue Saint-Honoré inaugura l’enseigne du Grand Marat, avec une double inscription; savoir, d’un côté: Il
fut l’ami du peuple et observateur profond, et de l’autre côté:
Ne pouvant le corrompre, ils l’ont assassiné. «En même temps, ajoute M. Amédée Berger, comme le comique a toujours{358} chez nous sa place à côté des plus lugubres souvenirs, un marchand de la rue Saint-Eustache placarda l’enseigne suivante au-dessus de sa porte: Aux cols, brassières et ceintures nationales, avec cette incroyable inscription: «Les hommes étant convenus de porter la cocarde aux trois couleurs, comme signe de patriotisme, il est étonnant que les femmes ne soient décorées, ni pour elles ni pour leurs enfants, de rien qui puisse prouver leur civisme. C’est pour faciliter ce moyen qu’on vient de fabriquer des ceintures et des brassières aux trois couleurs, qui ne laissent aucun doute sur les principes de ceux qui les porteront.»
Sous le règne de la Terreur, il n’est pas prudent de jouer avec les enseignes, et le plus sage est de les ôter tout à fait plutôt que d’en modifier le sujet et le titre. Aussi faut-il être notoirement républicain pour oser se donner le luxe d’une enseigne nouvelle, car tout était matière à suspicion et à dénonciation. Un cabaretier de Sèvres, qui avait de longue date une belle enseigne: Au rendez-vous des marins d’eau douce, s’imagina que le tutoiement révolutionnaire n’était pas suffisamment observé dans le mot rendez-vous, qu’il changea en rends-toi, et l’on put lire sur cette enseigne: Au rends-toi des marins d’eau douce. Malheur à qui eût osé conserver sur son enseigne une croix, une couronne, ou un écusson d’armoiries!
Le moment était si lugubre et si redoutable, que personne n’avait le cœur d’être plaisant, même sur une enseigne; mais du moins la plaisanterie pouvait cacher la peur. Ainsi un marchand, nommé Basset, avait joué sur son nom en se donnant un chien pour enseigne et en l’intitu{359}lant: Au Basset[272]. Un autre, qui demeurait sur la place Vendôme, avait cru se faire de son enseigne un paratonnerre politique en y inscrivant une phrase de Robespierre relative à l’Être suprême[273]. La police, à cette époque terrible, trouvait le temps d’éplucher les enseignes et de les mettre toutes au diapason de la circonstance. Après la création du Calendrier républicain, adopté par la Convention le 24 novembre 1792, un arrêté du Bureau central de Paris enjoignit aux cabaretiers de substituer, sur leurs enseignes, aux mots: bière de mars, ceux-ci: bière de germinal[274].
M. Firmin Maillard a caractérisé ainsi les enseignes de la Terreur: «Brutus, Spartacus et quelques autres martyrs de la liberté deviennent des héros d’enseignes. C’est à la Lanterne nationale ou à la Carmagnole que vont se désaltérer les garçons bouchers: ils arrivent au cabaret, drapeau déployé, drapeau sur lequel il y a un énorme couteau et ces six mots écrits au bas: «Tremblez, aristocrates, voici les garçons bouchers!» Voilà leur enseigne! mais rien ne peut égaler celle du libraire Tisset, «coopérateur des succès de la République française.» L’abominable homme restait rue de la Barillerie, nº 13, et il avait au-dessus de sa porte une guillotine enluminée entre les montants de laquelle se trouvaient inscrits les noms des personnes qui devaient être exécutées dans la journée. Du reste, cet aimable personnage éditait une liste de condamnés qu’il appelait: Compte rendu aux Sans-Culottes, par très haute, très puissante et très expéditive dame{360} Guillotine, rédigé et présenté aux amis de ses prouesses, par Tisset.»
Alors on pouvait dire qu’au-dessus de la France, il y avait une enseigne terrible, sur laquelle flamboyaient ces trois mots, qui depuis ont pris quelque chose de solennel: A la Terreur! Puis, tout finit avec des Notre-Dame-de-Thermidor, hommage ridicule, mais honnête, rendu à Mᵐᵉ Tallien, qui eut assez d’empire sur son mari pour le forcer à jouer sa tête en décidant la Convention à mettre fin au règne sanglant des Jacobins, par la révolution du 9 Thermidor.
Toutes les enseignes n’ont pas disparu pendant la Révolution; ainsi qu’on a pu le voir par celles que nous avons citées, beaucoup de figures en pierre ou en bois trouvèrent grâce devant le vandalisme brutal de la populace, quand{361} elles n’avaient aucun sens politique, comme le Lion d’Argent, charmant détail de la maison nº 1 de la rue des Prouvaires, dont la gracieuse ornementation est un des rares spécimens intacts du style Louis XV; le Lion ferré, de la rue Saint-Martin, le Vieux Satyre, de la rue Montfaucon, et surtout comme l’Hercule, de la rue Grégoire-de-Tours, alors rue des Mauvais-Garçons-Saint-Germain, que les républicains du quartier avaient pris sous leur sauvegarde, en le surnommant le Vieux Sans-Culotte, et qui, comme les trois qui précèdent, existe encore aujourd’hui.
On vit renaître les enseignes non politiques et inoffensives sous le Directoire, mais d’abord en très petit nombre. La Terreur avait donné des leçons de prudence et de réserve{362} aux plus aventureux[275]; on hésita quelque temps, avant de se remettre à vivre au dehors, pour ainsi dire. Dans les premiers jours de défiance et de trouble qui suivirent la grande délivrance de Thermidor (27 juillet 1794), on avait eu l’idée de faire inscrire sur les portes des maisons les noms des personnes qui habitaient ces maisons; on renonça bientôt à
cette inquisition intolérable. La Révolution avait tué l’industrie des peintres d’enseignes; on ne les vit renaître de leurs cendres qu’au milieu du Directoire. En attendant, on avait remplacé les enseignes comme on avait pu. Mercier, dans{363} la description qu’il fait du Palais-Égalité, ci-devant Palais-Royal, en 1799, nous fournit à ce sujet un détail bien singulier: «Les tableaux sortis des cabinets curieux, les gravures libertines, les romans érotiques, servent d’enseignes
à une foule de prostituées logées aux mansardes[276].» On ne faisait alors aucun cas des meilleurs tableaux anciens, qui pourrissaient dans la boue chez les marchands de bric-à-brac. Sébastien Mercier, dans un autre endroit du même ouvrage, raconte qu’un savetier avait pris, pour en faire{364} l’auvent de son échoppe, un superbe tableau de maître, représentant la Cène.
Les premières enseignes peintes qui reparurent à Paris furent celles des restaurants, des cafés, des marchands de comestibles: c’est de ce temps-là que datent l’enseigne de l’hôtel des Américains, rue Saint-Honoré, près de l’Oratoire; la Flotte Sainte-Barbe, rue Saint-Martin; le Gourmand, de Corcellet; le Bœuf à la Mode, de la rue de Valois; le Veau qui tette, de la place du Châtelet, aujourd’hui rue des Halles; l’enseigne des Trois Frères provençaux, etc. Après les établissements de gastronomie, les débits de tabac eurent des enseignes, telles que la Bonne Prise, encore à sa place au nº 7 de la rue Saint-Jacques, la Civette, de la place du Palais-Royal et la Grosse Carotte. «Saint-Germain-l’Auxerrois[277],{365} respecté, disent les frères de Goncourt, a tout à côté de lui une renommée nouvelle, une enseigne fameuse: la Grosse Carotte, ce débit de tabac qui rivalise avec la célèbre Carotte américaine des Halles.» Le jardin Turc, dont la vogue commençait à se prononcer au boulevard du Temple, n’avait trouvé rien de mieux, pour remplacer une enseigne peinte, que d’avoir à sa porte des Turcs, de vrais Turcs, en costume, qui fumaient indolemment leur pipe, de midi à minuit[278]. C’était le premier essai des tableaux vivants.{366}
A LA fin du Directoire, il y eut comme une renaissance des enseignes, à Paris. Beaucoup de celles qu’on avait mises au grenier, au début de la Révolution et surtout pendant la Terreur, reprenaient leur ancienne place sur les boutiques, sans aucun changement ou avec de légères modifications exigées par l’état social et politique. Ce fut bientôt une mode, une fureur, une folie. On ne souffrait plus qu’une boutique qui avait acquis une clientèle respectable fût dépourvue d’enseigne. Il fallait donc en faire peindre de nouvelles, en toute hâte, et les peintres en lettres, qui venaient de traverser la Révolution, n’y avaient pas gagné du côté de l’art et de l’orthographe. Ces enseignes improvisées, qui semblèrent sortir de terre{367} pour se répandre dans tous les quartiers et toutes les rues, ne faisaient pas honneur à la peinture française, à l’esprit français et à la langue française. C’était un affreux désordre d’enseignes horribles, ou ridicules, de toutes formes et de toutes grandeurs, qui se disputaient le terrain et qui n’obéissaient qu’à la loi du plus fort ou du plus effronté. On avait commencé, pour leur faire place, par effacer l’odieuse inscription: Liberté, Égalité, Fraternité, ou la Mort, qui s’était imposée, comme une épitaphe sépulcrale, sur tous les murs et sur toutes les portes, en guise d’enseigne révolutionnaire.
«Le Consulat, dit M. Amédée Berger, à qui nous laissons la parole, faute de pouvoir mieux dire, le Consulat eut beaucoup à faire pour nettoyer les murailles de Paris, qui s’étaient singulièrement illustrées depuis la Révolution: les reliefs et les massifs se balançaient de plus belle au-dessus des passants alarmés; et en présence des inscriptions les plus grossières, le besoin d’un nouveau Caritidès se faisait de nouveau sentir.» La réforme fut radicale, et une ordonnance de Bureau central du canton de Paris, en date du 1ᵉʳ frimaire an VIII (novembre 1799), obligea tous les boutiquiers à supprimer les enseignes pendantes, à les remplacer par des tableaux incrustés dans les murs, enfin «à corriger dans les enseignes tout ce qui pouvait s’y rencontrer de contraire aux lois, aux mœurs et à la langue française». Pour prévenir tout abus, on devait soumettre d’avance à l’autorité la copie des inscriptions que l’on avait l’intention de placer au-dessus des boutiques, et il était interdit de modifier le texte approuvé par l’administration[279].{368} Cette intrusion pédantesque de la police dans la liberté des enseignes ne plut pas à tout le monde. «En attendant que l’on s’occupe de la restauration des lettres, disait avec dédain le dramaturge Arnault dans une note de journal, on procède à la correction des enseignes. Nos édiles ont pris, en effet, un arrêté excellent sous plusieurs rapports. Des magistrats qui savent lire ne veulent plus que des écrivains ne sachent pas écrire[280].» On lisait, le 1ᵉʳ décembre 1810, dans le Mercure de France, une autre note, qui doit être de Jouy, puisqu’il l’a intercalée depuis dans son Hermite de la Chaussée d’Antin: «M. Caritidès (personnage des Fâcheux de Molière) voulait, avec raison, qu’on réformât la détestable orthographe des enseignes, et l’on vient de faire droit, en 1810, au placet qu’Éraste fut chargé, par lui, de présenter à Louis XIV, en 1661. Tant de grossières absurdités vont enfin disparaître, et il ne restera plus à désirer aux beaux esprits les plus minutieux que de voir s’établir une sorte d’analogie entre les enseignes et les professions. Ce défaut était moins choquant autrefois qu’il ne l’est aujourd’hui; il y avait quelque raison pour qu’un cordonnier fût à l’Image de saint Crépin, un tabletier au Singe d’ivoire, un marchand de tabac à la Civette. Mais quelle espèce de rapport peut-on établir entre le Masque de fer et des bonnets de coton, entre Jocrisse et un joaillier, la Vestale et une lingère, le Petit Candide et un bureau de loterie, la Bonne foi et un tailleur? Nous ne manquons pas de mauvais plaisants tout prêts à trouver là des sujets d’épigrammes.» L’orgueilleux Étienne de Jouy ne pardonnait pas à la lingère{369} qui lui avait emprunté une scène de son opéra de la Vestale pour en faire une enseigne. «Sous l’Empire, dit Amédée Berger, une révolution s’était opérée dans l’aspect des rues marchandes de Paris: le magasin avait supprimé la vieille boutique, et alors avait commencé une curieuse lutte de façades, d’étalages et d’enseignes. Chacun voulait avoir son enseigne, et un marchand du faubourg Saint-Denis, ne sachant à quel saint se vouer, écrivit au-dessus de sa boutique: A n’importe quoi.» M. Auguste Luchet complète cette description dans un chapitre sur les Magasins de Paris[281], où il étudie la métamorphose de la boutique en magasin: «On perdit deux cents, trois cents aunes d’étoffe en guirlandes d’étalage. On n’eut point d’enseignes, on eut des tableaux, des tableaux à l’huile, peints sur toile, que l’on payait jusqu’à mille écus: luxe inouï, incroyable, qui pendant dix ans donna un aspect fantastique aux rues Saint-Honoré, Saint-Denis, Neuve-des-Petits-Champs, et commença la pompe merveilleuse des boulevards de Paris.»
La monomanie d’enseignes peintes avait pourtant donné lieu à bien des critiques dès l’année 1810; on lisait dans la Chronique du Mercure de France, le 29 décembre de cette année-là: «Les calembours, bannis du théâtre, semblent vouloir se réfugier sur les enseignes. Un marchand gainier, nommé Aymon, a trouvé très spirituel de prendre pour enseigne: Aux Quatre Fils Aymon. Un marchand de tableaux du passage du Panorama, du nom de Pierre Legrand, a fait peindre au-dessus de sa porte le portrait du Czar; au-dessous est écrit: Au Czar, Pierre Legrand, marchand{370} de tableaux. Enfin, un libraire connu a joué sur son nom plus agréablement encore, en l’inscrivant ainsi: A la Sagesse de Charron, libraire. C’est à présent qu’on peut dire avec vérité que l’esprit court les rues; on s’en aperçoit quand on le retrouve dans les salons[282].»
Lady Morgan, ci-devant miss Owenson, qui visitait la France en 1816, a formulé des critiques analogues sur les enseignes de Paris[283]: «Je ne connais véritablement rien de plus amusant, à Paris, que les allusions classiques et les devises sentimentales qu’on trouve dans les enseignes, et l’absurdité de leur application ajoute beaucoup au ridicule de leur effet. Je remarquai au-dessus de la porte d’un boucher, dans la rue Saint-Denis, une enseigne représentant un bouquet d’œillets fanés, avec ces mots: Au Tendre Souvenir. La Tentation de saint Antoine, en relief, est suspendue à côté de la Fille mal gardée, et les Trois Pucelles figurent sur les fenêtres d’un tailleur pour l’armée, qui, pour attirer des pratiques, s’intitule Tailleur civil et militaire, tandis que saint Augustin promet de «reblanchir à neuf les vieilles plumes». L’Ange gardien s’annonce pour «faire des envois à l’étranger», et la Religieuse offre son «magasin de nouveautés, au plus juste prix». Au Bienvenu, au Revenant, aux Bons Enfants, aux Amis de la Paix, sont des enseignes arborées bien souvent pour attirer le chaland. La Belle Hélène et les Trois Sultanes étalent leurs charmes dans tous les quartiers pour séduire les gens et intéresser le goût ou le sentiment du passant imprudent. La morale même est{371} appelée à l’aide du sentiment, et les marchandises les plus chères sont achetées au Gagne-Petit ou mises en vente à la Conscience.» Les observations critiques de Lady Morgan sont moins justes quand elle suppose que les enseignes des boutiques pourront un jour fournir des armoiries aux futurs parvenus; que la noblesse s’élèvera du comptoir à la pairie, et que ces nouveaux mystères héraldiques défieront la sagacité des Œdipes du blason: «Le plus habile généalogiste n’expliquera pas aisément un écusson portant sur champ d’argent une Vache habillée à la mode de 1816, ou sur champ de gueules deux Mandarins se donnant la main en signe de fraternité. Comment devinera-t-on, en voyant ces étranges armoiries, que les ancêtres de la nouvelle noblesse vendaient du bœuf à la mode, à l’enseigne de la Vache parée, rue du Lycée, et des cachemires de l’Inde, à l’enseigne des Deux Magots, rue de Seine?»
En 1825, les enseignes étaient parvenues au plus haut point de leur splendeur et de leur prospérité. Le moment parut bon à Balzac pour faire la nomenclature et la description des plus remarquables, en rassemblant ainsi les matériaux de leur histoire sous la Restauration. Son Petit Dictionnaire critique et anecdotique des Enseignes de Paris, volume in-32, de 160 pages, est devenu fort rare, quoiqu’il ait été tiré et vendu à un grand nombre d’exemplaires. On l’a réimprimé intégralement dans la dernière édition des Œuvres complètes de Balzac. Nous ne jugeons donc pas utile de l’analyser et d’en extraire les passages les plus piquants, après l’avoir souvent cité dans le cours de notre travail. C’est pourtant le répertoire le plus considérable qu’il y ait des enseignes de{372} Paris, en 1826. Il nous a semblé, toutefois, nécessaire et intéressant de donner une simple liste des enseignes qui y sont décrites, et de classer ces enseignes par ordre de profession et de commerce, pour faire ressortir autant que possible les analogies plus ou moins bizarres qui peuvent exister entre les différents corps d’état et leurs enseignes.
Commençons par les marchands de nouveautés, qui, comme Balzac le fait remarquer, ont la plus grande part dans cette longue liste de tableaux d’enseignes.
A l’Assomption, rue Saint-Honoré, nº 375.
Aux Bayadères, boulevard des Italiens, nº 9.
A la Belle Ferronnière, rue du Faubourg-Saint-Antoine.
A la Belle Jardinière, rue de la Lanterne, nº 13.
Aux Bonnes d’Enfants, rue Saint-Honoré, nº 279.
Au Coin de Rue, au coin de la rue des Bons-Enfants.
A la Clochette, place de l’École.
Au Croissant, rue Dauphine, nº 44.
Au Château d’Eau, boulevard Saint-Martin, nº 27.
A la Caravane, rue de Richelieu, nº 82.
Au Chaperon rouge, rue Saint-Honoré, nº 326.
A la Curieuse, rue de la Monnaie, au coin de la rue Baillet.
Au Drapeau libérateur, rue du Petit-Carreau, nº 26.
Au Diable boiteux, rue de la Monnaie, nº 23.
Aux Deux Magots, à l’angle des rues de Seine et de Buci.
Aux Deux Cousines, rue Coquillière.{373}
Aux Dames françaises, rue de Buci, nº 2.
A la Dame du Lac, rue Saint-Martin, nº 257.
A l’Éclipse de 1820.
A la Fille d’honneur, rue de la Monnaie, au coin de la rue Boucher.
A la Frileuse, rue Saint-Denis, nº 370.
Au Gagne-Denier, rue Saint-Antoine, nº 219.
Au Général Foy, rue Poissonnière, nº 44.
Au Grand saint Michel, rue de la Vieille-Bouclerie, nº 9.
A la Fontaine de Jouvence, rue des Moineaux, nº 3.
A Jean Bart, rue Royale, marché Saint-Martin, nº 20.
A Joconde, rue Saint-Denis, nº 191.
Au Lien des Nations, rue du Faubourg-Montmartre, nº 87.
Au Mariage enfantin, rue Sainte-Anne, nº 55.
Au Nœud gordien, Palais-Royal, galerie de pierre, nº 233.
Au Pauvre Diable, rue Montesquieu, au coin du Passage.
Au Petit Matelot, quai et île Saint-Louis.
A la Petite Jeannette, boulevard des Italiens, nº 3.
Au Polichinel vampire, rue Saint-Martin, en face le Conservatoire.
A Monsieur Pigeon, rue de Seine.
A Pygmalion, rue Saint-Denis, au coin de la rue de la Heaumerie.
A la Pucelle d’Orléans, rue Saint-Honoré.
A Saint-Denis de la Châtre, rue de la Juiverie, nº 21.
Au Serment, rue Saint-Denis, nº 408.
Au Soldat cultivateur, rue du Faubourg-Saint-Antoine, nº 77.
Au Soldat laboureur, rue Saint-Denis, nº 110.{374}
Au Solitaire, rue du Faubourg-Saint-Denis, nº 68.
A Valérie, rue Saint-Denis, nº 309.
Au Vampire, rue Saint-Antoine.
Aux Vêpres siciliennes, rue Saint-Denis.
A la Vestale, rue Montmartre, au coin de la rue de Cléry.
Au Zodiaque de Paris, rue du Temple, nº 47.
Combien en reste-t-il aujourd’hui de ces magasins qui ont dû leur renommée et leur vogue à des enseignes habilement peintes, empruntées la plupart à des pièces de théâtre, dont l’immense succès avait coïncidé avec l’ouverture des maisons qu’elles recommandaient au public?
Lingères. A l’Ange gardien, rue Saint-Honoré, nº 359.
A la Baigneuse, rue Montesquieu, nº 5.
A la Bonne Ouvrière, rue du Faubourg-Saint-Denis, nº 1.
Au Frère de la Charité, rue Saint-Denis, nº 171.
A la Négresse, rue Saint-Honoré, nº 285.
Au Paysage, rue Saint-Martin, nº 144.
A la Parisienne, rue Saint-Denis, nº 289.
A la Religieuse, rue Saint-Lazare, nº 72.
A la Somnambule, rue Saint-Honoré, nº 242.
Aux Trois Sultanes, au coin des rues Vivienne et Colbert.
Bonnetiers. A la Barque à Caron, rue du Bac.
Au Bon Fabricant, au coin des rues de la Calandre et de la Barillerie.
Au Bon Henri, rue Neuve-des-Petits-Champs, nº 30.
Au Cotonnier, rue Neuve-des-Petits-Champs, nº 67.
A Monsieur Dumolet, rue Montesquieu.
Au Grand Mogol, rue Saint-Martin, nº 287.
A la Mère de Famille, rue du Faubourg-Saint-Denis, nº 8.
Au Moine saint Martin, marché Saint-Martin.{375}
Au Saint Nom de Jésus, rue Vieille-du-Temple, nº 62.
Au Sabot fourré, rue du Faubourg-Saint-Antoine, nº 51.
Au Tableau des Samoïèdes, rue des Deux-Ponts, nº 22.
Magasins de soieries et d’étoffes. A la Belle Anglaise, rue Saint-Denis, nº 94.
Au Grand Turc, rue Saint-Honoré, nº 248.
A l’Irlandaise, rue Vivienne, nº 17.
A la Perle, rue Neuve-des-Petits-Champs, nº 35.
A la Reine Mathilde, rue Feydeau, nº 17.
A Jean de Paris, rue du Bac, nº 4.
A la Toison de Cachemire, rue Vivienne, nº 14.
Drapiers. Au Bourgmestre de Saardam, rue Saint-Honoré, nº 53.
Au Buste de Henri IV, rue Saint-Honoré, nº 3.
Aux Deux Frères, rue Montesquieu, nº 5.
Aux Deux Edmond, rue Saint-Denis, nº 220.
A l’Invariable, rue Dauphine, près de la rue d’Anjou.
Aux Médecins français, rue Saint-Martin, nº 262.
Aux Montagnes russes, rue Neuve-des-Petits-Champs, au coin du Perron.
Merciers. A la Barbe bleue, rue du Four-Saint-Germain, près l’Abbaye.
Aux Décorations françaises, rue Saint-Denis, nº 8.
A la Fileuse, rue Saint-Denis, nº 80.
A la Gasconne, rue Saint-Honoré, nº 21.
A la Lilliputienne, rue Montmartre, nº 104.
A l’Oiseau bleu, rue du Faubourg-Saint-Antoine, nº 69.
A la Pèlerine, rue Saint-Honoré, nº 275.
Au Petit Petro, rue Saint-Denis, nº 150.
A la Villageoise, rue du Faubourg-Saint-Antoine, nº 27.{376}
Fourreurs. Au Grand Hercule, rue des Fourreurs, nº 18.
Au Manteau d’Hermine, rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés, nº 17.
Au Renard, rue des Fourreurs, nº 19.
Au Roi de Danemarck, rue Saint-Honoré, nº 213.
Marchand de tulles. Au Roi d’Angleterre, rue Vivienne, nº 11.
Marchande de modes. A la Glaneuse, Palais-Royal, galerie de bois, nº 225.
Boutiques de corsets. Aux Deux Sœurs, boulevard des Panoramas, nº 13.
A Ninon, boulevard Poissonnière, nº 14.
Plumassiers. A l’Autruche, rue Saint-Denis, nº 354.
Au Lever de l’Aurore, rue Saint-Denis, nº 293.
Tailleurs. Au Triomphe de Trajan, rue de Richelieu, nº 72.
Au Roi de Cœur, rue du Temple.
Chapeliers. Aux Architectes canadiens, rue Dauphine, nº 3.
Au Chapeau sans pareil, boulevard Bonne-Nouvelle, nº 11.
A l’Ermite de la chaussée d’Antin, rue Caumartin, au coin de la rue Neuve-des-Mathurins.
A l’Observateur des Modes, boulevard des Italiens, nº 11.
Aux Véritables Chasseurs canadiens, rue Dauphine, nº 63.
Cordonniers, bottiers. A la Belle Indécise, boulevard Bonne-Nouvelle, nº 33.
A la Botte sans couture, Palais-Royal, galerie de pierre.
A l’Hortensia, boulevard Bonne-Nouvelle, nº 15.
A la Pantoufle verte, rue de Richelieu, en face le Théâtre-Français.{377}
A Saint Crépin, rue Saint-Honoré, nº 242.
Coiffeurs. A Absalon, rue Basse, Porte Saint-Denis, nº 8.
Au Savant Perruquier, rue Saint-Jacques, nº 121.
Aux Templiers, rue Feydeau, nº 16.
A la Toilette Psyché, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, nº 5.
Bijoutiers. A la Belle Anglaise, Palais-Royal, nº 156.
Au Cheval indien, Palais-Royal, galerie de pierre, nº 146.
A la Juste Balance, rue Saint-Martin, nº 196.
Au Mouton blanc, quai Lepelletier, nº 10.
Aux Trois Agneaux d’Or, quai Lepelletier, nº 5.
Bijoux faux. A l’Écrin, rue Notre-Dame-de-Nazareth, nº 15.
Quincailliers. A Charles VII, rue de l’École-de-médecine, nº 35.
Au Cheval d’Or, rue Saint-Denis, nº 371.
A l’Espérance, rue du Faubourg-Saint-Antoine, nº 11.
A la Flotte d’Angleterre, rue de la Barillerie, nº 5.
Aux Forges de Vulcain, au coin de la rue de la Barillerie et du Marché aux fleurs.
Au Pilote, rue de Seine, nº 79.
Au Vaisseau marchand, rue Saint-Martin, nº 186.
Ornements d’église. A Fénelon.
Armurier. Au Faisceau, rue de Richelieu, nº 64.
Selliers. Au Courrier français, rue de Grenelle-Saint-Honoré, nº 63.
Aux Jockeis, boulevard Montmartre, nº 14.
Aux Courses de Newmarket, boulevard de la Madeleine, nº 15.
A la Renommée, rue du Bac, nº 28.{378}
Epinglier. Au Désir de la France, la Paix, rue Saint-Denis, nº 298.
Opticien. A la Longue vue, place des Victoires.
Bureau de loterie. A la Clef du bonheur, rue de Richelieu, nº 87.
Papiers peints. Au Comédien d’Étampes, rue de Grenelle-Saint-Germain, nº 5.
Aux Deux Chinois, boulevard Saint-Martin, nº 8.
Aux Deux Indiens, boulevard Bonne-Nouvelle, nº 47.
Aux Innocents, boulevard Bonne-Nouvelle, nº 7.
Aux Orientaux, boulevard des Italiens, nº 15[284].
Aux Quatre Saisons, rue Saint-Denis, nº 126.
Marchands de meubles. A la Borne d’Or, Faubourg-Saint-Antoine, nº 20.
Au Griffon, rue du Faubourg-Saint-Antoine, nº 26.
Faïenciers. Aux Chiens de fayence, rue du Petit-Lion Saint-Sulpice, nº 22.
Au Désespoir de Jocrisse, rue du Bac, nº 33.
Au Petit Poucet, rue Montfaucon, nº 4.
Chaudronnier. Au Mouton d’Or, rue de Saintonge, nº 8.
Lampiste. A la Lampe merveilleuse, rue Vendôme, nº 25.
Tourneur sur métaux. A la Tête d’Archimède, rue de Ménilmontant, nº 54.
Teinturier. Au Grand saint Maurice, quai du Marché-Palu.
Bandagiste. A la Culotte, rue du Four-Saint-Germain, nº 55.{379}
Aubergiste. A la Conquête de la Toison d’or, rue du Faubourg-Saint-Antoine, nº 66.
Oiselier. A l’Arche de Noé, boulevard du Temple, nº 47.
Marchand de chiens. Au Chien fidèle, boulevard des Italiens, au coin de la rue de la Grange-Batelière.
Horloger en bois. Au Petit Moulin à vent, rue des Coquilles, nº 10.
Marchand de parapluies. A l’Ombrelle à Jocko, rue de la Chaussée-d’Antin, nº 4.
Imprimeur. A la Presse royale, rue Saint-Denis, nº 317.
Cartier. Au Roi Salomon, rue Sainte-Anne, nº 39.
Sages-femmes. A l’Accouchée, rue Jean-Jacques-Rousseau, nº 23.
A la Fortune des Enfants, rue de Buci, nº 2.
Pharmaciens. Au Mortier d’Or, rue des Lombards.
Au Polygone, rue du Four-Saint-Germain, nº 37.
Parfumeur. A la Belle Athénienne, rue Saint-Honoré, nº 198.
Débits de tabac. Aux Bons Bretons, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, nº 13.
A la Civette, rue Saint-Honoré, au coin de la galerie de Nemours.
A la Carotte d’Or, quai Saint-Michel, nº 44.
Au Diable à quatre, rue Saint-Denis, nº 381.
Au Fumeur sans pareil, rue du Temple, nº 61.
Grainetiers. Au Capousta ou Chou de Sibérie, boulevard des Capucines, nº 13.
A la Renommée des bonnes semences, rue de Sèvres, nº 1.
Boulanger. A la Providence, rue du Faubourg-Saint-Honoré, nº 40.{380}
Épiciers. Aux Trois Maures, rue de la Harpe, nº 27.
A la Truie qui file, marché aux Poirées, nº 24.
A la Providence, rue d’Enfer, au coin de la rue Saint-Dominique.
Soude et potasse. A la Dame Jeanne, rue Boucherat, nº 10.
Distillateur. A la Maison gothique, rue Saint-Martin, nº 40.
Estaminets. Au Jardin des Épiciers, Faubourg-Saint-Denis.
Au Jardin de l’Écu, même rue.
Au Jardin du Cheval blanc, même rue.
Charcutiers. Au Grand saint Antoine, Porte Saint-Denis.
A la Hure d’Or, rue des Boucheries-Saint-Germain, nº 5.
A l’Homme de la roche de Lyon, rue Neuve-des-Petits-Champs, nº 5.
A Ypsilanti, rue du Gros-Caillou, nº 27.
Marchands de comestibles. Au Bon Vivant, rue de Richelieu, nº 15.
Aux Deux Perdrix rouges, place de la Pointe-Saint-Eustache, nº 13.
Aux Deux Gastronomes, boulevard Poissonnière, nº 9.
Au Gourmand, Palais-Royal, galerie du Lycée.
Au Pique-Assiette, rue du Bac, nº 15.
A Sainte Geneviève, place de la Pointe-Saint-Eustache, nº 2.
Confiseurs. A la Belle Angélique, boulevard des Italiens, nº 23.{381}
A la Belle Marraine, boulevard du Temple, nº 47.
Au Cacaotier, boulevard des Italiens, nº 20.
Au Chat noir, rue Saint-Denis, au coin de la rue de La Reynie.
Au Chocolatier, passage de l’Ancre.
Au Fidèle Berger, rue des Lombards.
A la Fidélité, rue de la Paix, nº 5.
Au Paradis terrestre, rue Montorgueil, nº 21.
A la Petite Gourmande, rue Neuve-Saint-Augustin, nº 13.
Aux Petites Danaïdes, boulevard Saint-Martin, nº 57.
A Vert-Vert, rue Neuve-des-Petits-Champs, nº 91.
Restaurateurs. A l’Amiral Coligny, rue Béthisy, nº 18.
Au Bœuf à la Mode, rue du Lycée, près du Palais-Royal.
Au Banquet d’Anacréon, boulevard Saint-Martin, nº 53.
Au Cadran bleu, boulevard du Temple, au coin de la rue Charlot.
Au Capucin, rue des Fossés-du-Temple, au coin de la rue d’Angoulême.
A la Flotte de commerce, rue Saint-Denis, nº 271.
Au Réveil-Matin, rue des Cordiers, nº 9.
Au Veau qui tette, rue de la Vrillière, place du Châtelet.
Marchands de vin. A la Bonne Fontaine, rue de Charonne, nº 1.
Aux Bons Enfants, place de Grève, nº 2.
Au Cocher, quai des Célestins.
Aux Contents, place du Palais-de-Justice, nº 8.
A la Côte d’Or, rue du Faubourg-Saint-Denis, nº 86.
Au Cardinal, rue Vieille-du-Temple, nº 94.
A l’Épi scié, boulevard du Temple, nº 4.{382}
A la Fontaine de l’Éléphant, rue Saint-Antoine, au coin de la rue du Petit-Musc.
Au Grenadier français, rue de la Ferme, nº 7.
Au Jocko de la Montagne, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, nº 33.
Au Lion d’Or, rue Saint-Denis, nº 371.
Au Mât de Cocagne, rue du Maure, nº 44.
Au Mont Blanc, rue Saint-Lazare, en face de la rue de la Chaussée-d’Antin.
A la Partie de chasse de Henri IV, rue de Saintonge, au coin du boulevard.
Au Père Noé, rue Mandar, nº 6.
Au Port Saint-Paul, rue des Barrés, nº 4.
A la Porte Saint-Honoré.
A la Pucelle d’Orléans, rue du Faubourg-Saint-Martin, nº 3.
A la Renommée de la Bonne Friture, rue de Charonne, nº 4.
Au Rocher, rue Basse-Saint-Denis, nº 22.
Au Roi Clovis, rue Descartes, au coin de la rue Saint-Victor.
Au Tambour-Major, rue du Faubourg-Saint-Denis, nº 36.
Au Temple de Bacchus, rue d’Ulm, nº 4.
Aux Trois Lurons, rue Bourbon-Villeneuve, nº 18.
Aux Vignes de Tonnerre, rue Saint-Jacques, nº 145.
A Xantippe, rue de l’Oursine, nº 294.
Cette nomenclature, classée par ordre systématique, des plus notables enseignes de Paris en 1826, permettra d’établir les rapports plus ou moins éloignés qui existaient entre le sujet de l’enseigne et le commerce du marchand qui l’avait{383} choisi. Un très petit nombre de ces enseignes était antérieur à la Révolution; quelques-unes dataient du Directoire. Souvent le titre de l’enseigne ne donnait aucune idée du sujet représenté: ainsi l’Invariable était Atlas portant le globe du monde; la Dame Jeanne n’était qu’une cruche de
grès, destinée à contenir de l’eau de Javelle; la Belle Indécise laissait flotter son indécision entre deux paires de souliers; le Réveil-Matin était tout simplement un coq annonçant le point du jour; la Belle Angélique, pour faire un rébus digne d’un confiseur, attendait Médor à côté d’un beau pied d’angélique, qui ne figure pas dans le poème de l’Arioste; le Lien des Nations, c’était le commerce qui réunissait des marchands venus des quatre parties du monde; les Architectes canadiens, c’étaient des castors construisant leur habi{384}tation aquatique; le Bon Fabricant, c’était un capucin tissant au métier une paire de bas. Quant aux enseignes des magasins de nouveautés, ces enseignes, les plus belles, les mieux peintes et les plus agréables à voir, n’offraient aucune analogie avec le genre de commerce qu’elles recommandaient aux chalands, puisqu’elles étaient empruntées la plupart à des pièces de théâtre qui avaient eu la vogue et dont le souvenir n’était pas encore effacé.
Balzac n’a pas manqué de signaler, dans son Petit Dictionnaire, celles de ces enseignes qui se distinguaient par un mérite d’exécution artistique et qui pouvaient être considérées comme de bons tableaux décoratifs. L’Assomption passait pour une véritable peinture de maître: on la laissait couverte d’un rideau, lorsqu’on croyait devoir la préserver des intempéries de l’air, soit de la pluie, soit du soleil. Le Banquet d’Anacréon n’avait aucun caractère d’imitation de l’art antique, mais les femmes qui entouraient le vieux poète de Téos étaient représentées avec tout l’éclat du coloris de l’école de Girodet et semblaient avoir été peintes, à moitié ivres, d’après nature, dans un souper au Rocher de Cancale. La Barque à Caron était une très bonne toile, où l’on reconnaissait aussi le pinceau d’un élève de Girodet. L’enseigne des Bayadères offrait un groupe gracieux de trois jolies personnes, que l’artiste avait très habilement costumées à l’orientale. L’enseigne du Château d’Eau était un charmant paysage qui avait peut-être figuré au Salon et qui dans tous les cas y eût été remarqué. L’enseigne du Général Foy exposait un portrait fort ressemblant de l’illustre orateur que le parti libéral avait perdu l’année précédente. Quant aux Forges de Vulcain, c’était «un beau tableau d’enseigne,{385} dit Balzac; la figure de Vulcain ne manque ni d’expression ni de chaleur.» Le Grand saint Michel était une copie convenable du chef-d’œuvre de Raphaël, que les jeunes peintres ne se lassaient pas de copier au musée du Louvre, et le Soldat laboureur pouvait passer pour une ingénieuse réminiscence d’un tableau de Vigneron, reproduit partout en gravure, en lithographie, et même en peinture de devant de cheminée.
Cinq ans avant la publication du Petit Dictionnaire des Enseignes, Dufey de l’Yonne[285] avait donné une assez triste idée de celles qu’on voyait alors dans les faubourgs de Paris. «La réforme, disait-il, qui s’opère depuis quelques années dans le choix et l’exécution des sujets d’enseigne, ne s’est pas encore étendue au faubourg Saint-Antoine. On n’y trouve pas même le facile mérite de la variété. Les Têtes noires et les Boules blanches y sont souvent répétées, et il doit en résulter de singuliers quiproquos pour les marchands qui se sont partagé l’honneur d’en bigarrer leurs boutiques. Il n’y a pas de quartier où les enseignes soient plus multipliées. Elles présentent parfois d’assez bizarres rapprochements: j’ai vu au-dessus du tableau d’une sage-femme un Ours dansant.» Dufey s’étonne plus loin de rencontrer, dans la même rue du Faubourg-Saint-Antoine, nº 11, un magasin de bustes et de figures en pied, coloriés, ayant pour enseigne: Au Grand Frédéric. «Ces figures coloriées, dit-il, pourraient être fort prisées à Berlin, mais j’aime à retrouver le goût français dans l’atelier du nº 7; point de couleur sur les plâtres; un meilleur choix dans les{386} objets exposés en montre, et pour enseigne: Au Rendez-vous des artistes.»
La rue Saint-Antoine avait sa Truie qui file, sculptée en relief, comme celle du marché aux Poirées, mais à cette époque, paraît-il, rehaussée d’or et de couleurs. «Quel est, disait Dufey, ce grand écusson, tout éclatant de dorure, qui décore un magasin, à main gauche, en descendant la rue Saint-Antoine? J’approche, et je distingue la Truie qui file[286]. C’est l’enseigne la plus riche et la plus bizarre de ce quartier. Les monstruosités ont été longtemps à la mode pour les sujets d’enseigne.»
On essaya alors de revenir aux enseignes sculptées, statuettes ou bas-reliefs, dans le genre du Pêcheur, du Galant Jardinier et du Coq hardi, qui décorent encore trois boutiques du quai de la Mégisserie; comme celles du Saint Mi{387}chel, de l’Homme armé et de l’Arbre sec, qui avaient donné leur nom à des rues. On voit paraître successivement le Nègre, du boulevard Saint-Martin, et le Chinois, de la rue Lafayette, dont les abdomens renferment des horloges, et, plus tard, le Vélocipède, du boulevard de Sébastopol. Mais les enseignes peintes gardèrent longtemps la préférence. «Cette fureur, dit Amédée Berger[287], dura jusqu’à 1830 et au delà; on changea d’enseigne selon la vogue du moment, et les héros de la mode, les lions du jour, virent tous leur image reproduite sur les murailles de la ville. Les Montagnes russes, Jocko, Cadet Roussel, Jocrisse, la Girafe, firent fureur tour à tour, et chaque marchand les adopta. C’est de cette époque (l’Empire et la Restauration) que datent les enseignes artistiques et théâtrales, qui, prenant le titre des tableaux célèbres et des pièces applaudies, reproduisirent les scènes fameuses et retracèrent le costume et jusqu’aux traits des artistes aimés du public. L’opéra, la tragédie, le drame, le vaudeville, le roman, toute notre littérature, en un mot, sont représentés dans cette immense galerie, qui n’a fait que s’accroître, chaque jour, depuis le commencement du siècle.» De ce temps-là aussi date l’enseigne du Grand Condé, de la rue de Seine, au coin de l’ancienne rue des Boucheries, aujourd’hui absorbée par le boulevard Saint-Germain, enseigne qui va disparaître à son tour.
Les causes principales qui amenèrent la décadence des enseignes en tableaux peints furent l’augmentation prodigieuse du nombre des omnibus et des voitures de toute sorte; puis les révolutions de la rue, 1830, 1832, 1848, etc.{388} Les enseignes n’avaient pas été ménagées dans ces commotions révolutionnaires, qui, dans l’espace de dix-huit ans, avaient si souvent changé les rues en champ de bataille.
Beaucoup d’enseignes avaient été mutilées par les balles, et l’émeute populaire s’était acharnée sur quelques-unes, dans lesquelles on voulait détruire les emblèmes et les souvenirs de la royauté déchue. C’était une dépense assez forte à supporter, que de faire restaurer une belle ensei{389}gne ou de la remplacer par une nouvelle. Aussi bien, le passage des lourdes voitures, omnibus, chariots et messageries, dans les rues étroites, affectées au commerce, empêchait les passants de s’arrêter pour regarder les enseignes; c’eût été s’exposer à se faire écraser dans un moment de distraction et d’imprudence. On jugea, d’ailleurs, que le public qui va dans un magasin qu’il connaît, ne songe pas à en admirer l’enseigne. Il y avait économie bien entendue à supprimer une dépense inutile, en renonçant à ces enseignes coûteuses, qui ne produisaient pas autant d’effet sur la vente des marchandises qu’une simple annonce de journal. On vit encore quelques nouvelles enseignes peintes, de véritables tableaux, comme celle des Mystères de Paris, dont nous parlions tout à l’heure, ou bien des enseignes excentriques, comme celle d’un tailleur de la rue des Petits-Champs, qui avait figuré les lettres de son nom avec des os de mort, attirer, occuper un instant les flâneurs; mais le nombre des enseignes allait diminuant, et la plupart des marchands finirent par se persuader que le titre seul de l’enseigne, sans aucune représentation peinte ou plastique, suffisait pour accompagner l’adresse d’une boutique en lui servant de raison commerciale, et la recommander aux clients qui avaient été satisfaits de leurs achats.{390}
ON peut dire avec assurance qu’il n’y a pas eu d’imagiers et de peintres d’enseignes proprement dits avant le XVIIIᵉ siècle. Jusque-là les artistes sculpteurs et peintres formaient des corporations dans lesquelles tous les membres avaient les mêmes droits de confrérie, vis-à-vis les uns les autres, sans jamais prétendre à l’égalité de talents. Le meilleur peintre était compagnon avec le plus exécrable barbouilleur, et chacun se rendait justice et prenait son rang, selon le mérite et la qualité de ses œuvres, dans l’exercice de sa profession et de son métier. L’Académie de Saint-Luc comprenait donc, sans distinction de personnes, les peintres en bâtiments et les peintres d’histoire, des statuaires de premier ordre et des fabricants de figures{391} décoratives en plâtre. La différence des travaux n’était constatée que par la différence des prix demandés et payés. La création de l’Académie royale de peinture en 1648 n’eut pas d’autre but que de faire un choix entre les artistes, à la suite d’un concours où chaque candidat donnait la mesure de son savoir-faire. Il y eut encore, sans doute, quelques académiciens qui ne dédaignèrent pas d’exécuter des enseignes, lorsque l’œuvre était payée à sa valeur; mais, généralement, les enseignes n’étaient plus peintes ou sculptées que par les derniers élèves de l’Académie de Saint-Luc et par les plus pauvres membres de la corporation des peintres et des imagiers.
La sculpture et la peinture des enseignes de Paris avaient de quoi occuper alors une grande quantité d’artistes, et malgré la modicité du prix de ces ouvrages, on peut estimer que la multitude des labeurs de cette espèce représentait tous les ans une dépense considérable, car, chaque année, on exécutait à Paris quinze cents à deux mille enseignes, et le nombre des membres de la corporation des peintres et des imagiers ne s’élevait pas à plus de 250. Il faut rappeler aussi qu’avant le XVIIIᵉ siècle, un artiste, quel que fût son talent, acceptait communément tous les travaux qui lui étaient offerts et en réglait l’exécution d’après la destination de ces travaux. Ainsi, au XVIᵉ siècle, les plus grands sculpteurs, les plus grands peintres, attachés à la Maison du roi, ne se croyaient pas déshonorés pour avoir décoré des appartements et des galères, sculpté des corniches et des chambranles, peint à la détrempe des lambris et des battants de portes, des coffres et des tentures. Il y avait donc, en ce temps-là, parmi les enseignes, d’excellents tableaux{392} peints sur bois, d’admirables bas-reliefs, modelés en plâtre ou en terre cuite, de superbes statues taillées en pierre. Nicolas de Blegny dit expressément, dans son Livre commode des Adresses de Paris: «Il est difficile de mettre les prix justes aux ouvrages de la sculpture et peinture, particulièrement aux tableaux et statues; c’est suivant les maîtres qui y sont employés que le prix doit être réglé, parce que c’est la beauté qui en règle la valeur; aussi, les curieux qui voudront avoir du beau de l’un des deux arts, doivent s’informer des bons maîtres, qui ne laissent rien sortir de leurs mains que de bien fini.» Le sieur de Blegny, à la suite de ces sages observations, n’indique aucun prix d’estimation pour les peintures, mais il nous apprend que si une figure de pierre de saint Luc, grande comme nature, vaut 75 livres, une pareille figure, faite par un habile homme et bien finie, vaut au moins 300 livres.
On préférait autrefois les enseignes sculptées aux enseignes peintes, parce qu’elles duraient longtemps et qu’elles n’étaient pas sujettes, comme les secondes, à des détériorations résultant des intempéries de l’air et des saisons. On peut dire même que, dans l’origine et jusqu’au milieu du XVᵉ siècle, il n’y avait que des enseignes de pierre sculptées en ronde bosse. La plus ancienne qui s’était conservée, et qui datait probablement de cette époque, était la fameuse Truie qui file, petit bas-relief plaisant et naïf, qui se trouvait au nº 24 du marché aux Poirées, au coin de la rue de la Cossonnerie. On comptait encore plus de cinq à six cents enseignes sculptées, dans Paris, au commencement du siècle; aujourd’hui, le nombre en a beaucoup diminué. La plupart d’entre elles étaient grossièrement travaillées et{393} d’après un mauvais modèle; mais plusieurs pouvaient être considérées comme de bons ouvrages d’art. Ainsi, la Fontaine de Jouvence, rue du Four-Saint-Germain, que nous avons décrite ailleurs (chap. V), était une fort jolie sculpture du XVIᵉ siècle, qui a subi de regrettables mutilations. On citait naguère, avec éloge, parmi ces enseignes sculptées, le bas-relief de la Chaste Suzanne, rue aux Fèves, dans la Cité. «Ce bas-relief, que la perfection de son style, dit E. de La Quérière, avait fait attribuer à Jean Goujon, fut acheté, à un prix très élevé, par un amateur, et aujourd’hui un moulage en plâtre occupe sa place.» Dans la même rue, auprès de la maison où était l’enseigne de la Chaste Suzanne, on voyait un autre bas-relief, en ronde bosse, sculpté dans le mur de façade d’une maison voisine, au-dessus de la porte: c’était l’enseigne de la Gerbe d’Or, ayant de chaque côté une brebis dressée sur ses pattes de derrière, dans un cadre de feuillage; au-dessous de cette sculpture du XVIᵉ siècle, une console en pierre, formant piédestal, était ornée d’une sculpture bizarre: une tête d’homme à moustaches, laquelle se terminait en gaine avec des ornements. Le travail de cette sculpture était commun et grossier. L’enseigne de la Petite Hotte, dans la rue des Prêcheurs, nº 30, offrait un meilleur travail de la même époque: «Dans une niche en pierre, dit E. de La Quérière, on voit une petite hotte, supportée par un cul-de-lampe orné de feuilles d’eau et surmontée d’un dais également sculpté. La hotte est remplie de fruits à pépins et nous paraît avoir servi d’enseigne à un marchand fruitier.» Près de la place Maubert, rue de Bièvre, nº 12, est encore un saint Michel, en pierre, haut de 75 centimètres; c’est une sculpture assez bizarre de la fin{394} du XVᵉ siècle[288]. L’enseigne du Puits d’Amour, que nous avons déjà citée en racontant la vieille légende qui s’y rattache, était certainement bien postérieure à cette légende; elle se trouvait au nº 15 de la grande Truanderie, mais le boulanger, ayant transporté son four à l’angle de la rue de la petite Truanderie, avait fait enlever l’enseigne pour la replacer sur sa nouvelle demeure[289]. Citons encore celle du Cheval blanc, avec la date de 1618, qui était au nº 19 de la rue de l’Arbre-Sec; le Chien rouge, de la rue de la Ferronnerie, sculpture peinte; l’Étoile dans les nuages, au nº 19 de la rue Greneta, enseignes aujourd’hui disparues.
Il reste encore quelques bonnes enseignes en pierre du XVIIᵉ siècle; entre autres, celle des Quatre Vents, rue du Faubourg-Saint-Denis; celle du Cherche-Midi, au nº 19 de la rue qui porte ce nom, en beau style académique de la fin du siècle; celle du Centaure, au coin de la rue Saint-{395}Denis et de la rue des Lombards, grand bas-relief d’exécution magistrale; celle de l’Annonciation, de la rue Saint-Martin,
etc. Voici des enseignes qui paraissent appartenir à la première moitié du XVIIIᵉ siècle: le Gagne-Petit, de la
rue des Moineaux, tout récemment transporté Avenue de l’Opéra; un autre Gagne-Petit, tout à fait différent et fort curieux pour les détails du costume et de l’attirail, rue des Nonnains-d’Yères; la Barbe d’Or, au nº 21 de la rue{396} des Bourdonnais, très élégante sculpture d’ornement; le Petit Maure, au nº 26 de la rue de Seine, médaillon un peu lourd; une Renommée, au nº 31 de la rue de la Ferronnerie, jolie statuette dorée; le Panier fleuri, quai Saint-Michel, sculpture d’artisan; le Chat noir, au nº 32 de la rue Saint-Denis, figurine en haut-relief, reproduite à chacune des encoignures de la maison et peinte en noir (voir figure page 346); enfin, le Repos d’Hercule, sculpture en demi-bosse, qu’on voyait, il y a vingt ans, au nº 100 de la même rue, entre les fenêtres du second étage de la maison. Nous
ne rappellerons pas ici quelques autres enseignes sculptées, d’un assez bon travail, que nous avons déjà décrites ailleurs (notamment chapitre V), mais nous ne devons point oublier un beau mascaron du XVIIIᵉ siècle, représentant une tête de satyre chargée d’un panier de fruits et formant le claveau d’une voussure de porte, à l’angle d’une maison de la rue Montfaucon. Le marchand qui a fait de cette porte architecturale l’entrée de sa boutique, s’est approprié comme enseigne la sculpture décorative, en la baptisant: Au Vieux Satyre. Mentionnons aussi la Flotte d’Angleterre, tableau en relief, représentant trois vaisseaux, assez bien{397} sculptés, au-dessus d’un magasin de quincaillerie déjà établi en 1750 rue de la Barillerie, nº 15, et qui s’est transporté au nº 24 du boulevard de Sébastopol, lors des démolitions effectuées dans la Cité en 1857. Tout près de ce magasin étaient les Forges de Vulcain, dont nous avons déjà parlé et qu’on retrouvera plus loin. Ce n’est pas un bon sculpteur, mais un simple praticien imagier, qui a fait l’enseigne assez connue des Trois Canettes, puisqu’elle a donné son nom à la rue des Canettes: elle représente, au nº 18 de cette rue, trois canettes barbotant dans l’eau, sous les yeux de la mère cane. Cette naïve sculpture, assez gracieuse (voir figure page 214), avait remplacé sans doute au XVIIIᵉ siècle l’enseigne primitive, qui datait du XVᵉ; ce petit bas-relief entouré d’un cartouche rococo, avec une tête de Minerve en pendentif, était peint, comme l’enseigne des Trois Poissons, fort habilement sculptés au milieu des roseaux, dans un médaillon de forme ovale, au nº 14 de la rue Saint-Germain-l’Auxerrois[290].
On est en droit de supposer que ceux de ces bas-reliefs, de ces médaillons, de ces statues en pierre qui ont survécu jusqu’à nos jours, durent leur conservation au mérite de l’œuvre ou à la singularité de la composition. Mais combien d’autres enseignes, sculptées par des imagiers de médiocre talent, ont été détruites, à la restauration ou à la reconstruction des anciennes maisons, dans les vieilles rues de Paris! Ces imagiers n’étaient pas plus habiles que la plupart des peintres d’enseigne, qui leur succédèrent à partir du XVIᵉ siècle et dont la profession finit par tomber, après{398} le XVIIIᵉ, dans un mépris devenu proverbial. Les peintres qui s’adonnaient à ce genre de travail n’étaient plus guère alors, en effet, que des apprentis, de pauvres élèves d’ateliers, ou des artistes déclassés par la débauche et la misère. La plus cruelle injure qu’on pouvait adresser à un artiste, c’était de l’appeler peintre d’enseigne.
La chanson, la satire, le théâtre ont ridiculisé les peintres d’enseignes, surtout au XVIIIᵉ siècle. Il y en eut un, nommé Jérôme, qui devint, dès 1760, le type de ces peintres de bas étage. Favart, dans l’Écosseuse, parodie de l’Écossaise, de Voltaire, avait fait rire le public de l’Opéra-Comique aux dépens de ce Jérôme. C’est le contrebandier La Rose, qui demande à Marianne quel était son âge quand elle fut séparée de ses parents: Marianne répond qu’elle avait cinq ans, «au départ de son père, et dix à la mort de sa mère.» La Rose s’écrie: «Comme tout ça s’arrange!» Puis, il chante en aparté:
Il déploie alors un portrait à la silhouette (dessin fait sur l’ombre du visage, placé de profil); ce qui fait beaucoup rire le gros public[291]. Jérôme, peintre d’enseignes de jeu de paume, fut dès lors le représentant caractéristique de son métier. Charles-Nicolas Cochin, dans une de ses brochures satiriques sur le Salon de 1769, le fit reparaître, avec les qualités de râpeur de tabac et riboteur. Cette spirituelle critique{399} est intitulée: Lettre sur les peintures, gravures et sculptures qui ont été exposées en cette année au Louvre par M. Raphaël, peintre de l’Académie de Saint-Luc, entrepreneur général des enseignes de la ville, faubourgs et banlieue de Paris, à M. Jérosme, son ami, râpeur de tabac et riboteur (Paris, Delalain, 1769, in-8º de 49 pages). Il publia ensuite la Réponse de M. Jérosme, râpeur de tabac et riboteur, à M. Raphaël, etc. (Paris, Joubert, 1769, in-8º de 33 pages). L’Académie de Saint-Luc, que l’Académie royale de peinture poursuivait de ses dédains et de sa jalousie, était ainsi représentée comme la pépinière des peintres d’enseignes. Aucune injure n’était épargnée à ces malheureux peintres, et lorsque le suisse Denker exécuta une suite d’estampes pour le Tableau de Paris, de Sébastien Mercier, il grava un atelier de peintre d’enseigne dans lequel figurent diverses enseignes burlesques avec leur orthographe traditionnelle. J.-B. Pujoulx, qui avait été peintre avant de se faire écrivain d’art et de théâtre, prend vivement la défense des peintres d’enseignes, ce qui fait supposer qu’il avait plus d’un de ces ouvrages sur la conscience: «Si vous conseillez, dit-il, à un peintre qui meurt de faim, de faire quelque tableau de fantaisie, en attendant un amateur qui l’achète, il vous répondra qu’on ne vit pas d’espérance; si vous lui commandez une enseigne, fût-ce une Rose rouge ou un Lion d’Or, il la fera sans difficulté, car il faut vivre, et dans le fond, même en consultant son amour-propre, quel déshonneur y a-t-il de faire une enseigne[292]?»
Nous montrerons bien, dans le chapitre suivant, que les{400} plus grands peintres se sont rendus coupables d’une ou de plusieurs enseignes.
Il est à regretter qu’on n’ait pas recueilli des documents sur les meilleurs peintres d’enseignes, qui ne seraient pas indignes de figurer dans l’histoire de la peinture, non seulement à cause de leur talent, si dévoyé qu’il fût, mais en raison de leur originalité. Un de ces artistes, nommé Davignon, mourut, en 1842, des suites d’un accident qui devait être assez fréquent dans les travaux des peintres d’enseignes. Nous lisons dans le Bulletin de l’Alliance des arts[293]: «Le peintre en lettres Davignon, qui s’était fait une réputation par son talent, son insouciance et sa prodigalité tout artistique, est mort à l’Hôtel-Dieu. Depuis deux jours Davignon travaillait à l’enseigne d’un marchand de vin, place du Châtelet; le troisième jour, au matin, l’artiste ayant fait, à ce qu’il paraît, des libations plus abondantes que de coutume, monta à l’échelle, mais arrivé à la hauteur du premier étage la tête lui tourna, il perdit l’équilibre et tomba sur le pavé! Relevé à l’instant même, tous les secours lui furent prodigués; puis, sur sa demande, on le transporta à l’Hôtel-Dieu, où, après plusieurs jours de souffrance, il expira. Davignon était un autre Lantara; il travaillait pour boire, il buvait pour travailler, et il s’est tué à la porte d’un marchand de vin.»
Les peintres en lettres étaient aussi peintres d’enseignes et surtout peintres des tableaux de foire, qui sont de véritables enseignes, faisant ainsi concurrence à certains saltimbanques qui se chargent d’exécuter eux-mêmes les{401} étonnantes et mirobolantes bagatelles de la porte, qu’ils exposent devant la baraque de leur théâtre en plein vent. «O matrones de Rubens! s’écrie Jean de Paris, un de nos plus brillants feuilletonistes; ô soldats gigantesques! Crocodiles épouvantables! femmes à barbe, qui montrez avec tant de grâce votre jambe dodue! vous faites mon bonheur. Cependant vous m’intéressez moins que ceux qui ont peinturluré vos épaules puissantes, vos râteliers redoutables et vos charmes rebondis. Les signatures les plus fréquentes au bas de ces compositions criardes sont celles d’Auclair, dont l’atelier est situé sur la montagne Sainte-Geneviève; de Cocural, qui opère sur les hauteurs de Belleville; d’Abel Trinocq, et de Desmaret, qui de sa fenêtre voit les Buttes-Chaumont.» Nous sommes surpris de ne pas retrouver parmi les noms de ces maîtres de l’enseigne peinte celui de David, qu’on ne confondra pas avec le grand peintre Jacques-Louis David, mais qui cependant, à un degré très inférieur sans doute, avait acquis une espèce de célébrité par ses ouvrages de peinture, destinés exclusivement à l’exposition permanente du Salon de la rue.
Combien de peintres habiles, sinon éminents, qui s’étaient distingués dans deux ou trois expositions de peinture, sont tombés par degrés dans la triste catégorie des peintres d’enseignes! Il faut se rappeler un temps peu éloigné, où les peintres, ne pouvant pas vendre leurs tableaux, mouraient de faim. C’est dans ce temps-là qu’un artiste, qui n’était pas sans mérite, avait fait un tableau à la fois comique et navrant, tableau qui représentait sans doute son propre intérieur peint d’après nature, et qui n’était pas destiné à devenir l’enseigne d’un éditeur d’es{402}tampes de la rue Saint-Jacques, avec cette légende douloureuse: Au Peintre dans son ménage.
Ne pourrait-on pas dire que le Français, né malin, comme dit Boileau, dans l’Art poétique, naquit aussi peintre d’enseignes? Voici ce qu’on écrivait de Gallipoli, en juin 1854, au Morning Chronicle, journal anglais de Londres: «Un marchand au détail, qui était venu s’établir ici, a fait une grande fortune qu’il doit au talent artistique d’un capitaine d’état-major français. Il avait besoin d’une enseigne: le capitaine auquel il s’adressa lui peignit un zouave et un{403} highlander, tous deux en grand uniforme, se donnant la main et trinquant cordialement. Ce tableau, quoique fait à la hâte et négligé dans plusieurs détails, a eu le succès le plus complet dans les deux armées, et y a fait plus de sensation que tous les chefs-d’œuvre du Louvre ou de la Galerie nationale. Des pachas turcs, des officiers anglais, des négociants arméniens, ont offert de l’acheter à un prix très élevé, mais le marchand a obstinément refusé de le vendre, et il a déclaré qu’il l’emporterait partout avec lui, comme un trophée et l’origine de sa fortune.» Ainsi le dernier épisode de la guerre de Crimée aura été le triomphe de l’enseigne d’un marchand de vin et liqueurs!{404}
IL y a longtemps qu’un autre a dit avant moi: «S’il était possible de réunir les plus belles enseignes qui ont été peintes par de grands maîtres et de bons artistes, pour les marchands de Paris, on aurait une des collections de peinture les plus intéressantes et les plus curieuses: ce qu’on appelle le Salon de la rue deviendrait alors le Musée des Enseignes.» C’est un coin de ce musée que nous allons décrire par ordre chronologique, sans avoir sous les yeux, malheureusement, tous les originaux qui sont aujourd’hui égarés, ou perdus, ou détruits.
Jean Lepautre (né à Paris en 1617 et mort en 1682), qui fut dessinateur et graveur plutôt que peintre, avait peint l’enseigne d’un armurier ou d’un fourbisseur, lequel demeu{405}rait sur le pont au Change. Cette enseigne, A la Valeur, représentait un combat à l’arme blanche très mouvementé et très finement dessiné. Ce joli tableau fut acheté par un riche financier. Nous n’en possédons plus que la gravure. Jean Lepautre avait gravé aussi son adresse, qui pouvait
bien être l’enseigne de sa boutique ou de son atelier. Les graveurs marchands d’estampes avaient tous des enseignes peintes. Nous en avons vu une, très curieuse en ce genre, chez notre vieil ami Paul Lacroix: elle représente un portrait d’homme, sans doute celui de l’artiste, attaché aux quatre coins sur un carton, comme pour servir de modèle à la gravure; d’un côté, un médaillon de Louis XV jeune;{406} de l’autre, plumes, crayons et tous les attributs du graveur, avec une inscription à moitié oblitérée, sur laquelle on ne peut lire que les mots: MARCHAND D’ESTAMPLES (sic).
La superbe enseigne due au talent de Ant. Watteau et faite pour Gersaint, son ami, a figuré longtemps à l’entrée de la boutique de ce marchand de tableaux et d’objets d’art, sur le pont de Notre-Dame. Par la suite, elle fut achetée par M. de Julienne, qui lui donna une place honorable dans sa galerie, après l’avoir fait réparer, et qui la fit plus tard graver par P. Adeline. On a cru longtemps que cette charmante peinture, qui représen{407}tait l’intérieur de la boutique de Gersaint, toute garnie de tableaux et remplie d’amateurs des deux sexes, regardant et achetant des objets d’art, était absolument perdue, mais elle n’était qu’égarée. M. Edmond de Goncourt découvrit qu’une partie de la toile qui composait ce grand tableau, haut de cinq pieds sur neuf, avait passé dans le cabinet d’un abbé Guillaume, à la mort duquel ce fragment de l’original avait été acquis par la Prusse, en 1769. «J’écrivais alors en Allemagne, dit M. Edmond de Goncourt[294], et j’apprenais que ce morceau de l’enseigne n’était pas perdu, mais qu’il avait été complété par l’achat du second fragment, fait je ne sais à quelle époque et dans quelle vente; en sorte que l’enseigne, tout entière, mais encadrée dans deux cadres, est aujourd’hui dans le vieux palais de Berlin (chambre d’Élisabeth, chambre rouge).» Voilà une enseigne qui a eu des aventures, avant de se compléter et de trouver un asile définitif dans un musée impérial! On suppose que le second fragment, séparé du premier pendant un siècle et demi, s’était retrouvé par hasard dans l’atelier d’un peintre, nommé Auguste, élève d’Ingres, et premier prix de Rome, lequel mourut à Paris vers 1848. M. Edmond de Goncourt avait vu ce fragment d’enseigne chez le baron de Schwiter, mais, selon lui, c’était «une peinture bien grosse et ne donnant aucune idée d’un travail où Watteau avait mis sa dernière fièvre».
Gersaint ne s’était pas contenté d’une enseigne peinte par Watteau; il avait fait, en outre, dessiner son adresse par Boucher, et cette adresse, dont il n’existe qu’une seule{408} épreuve à la Bibliothèque nationale, aurait été gravée par le comte de Caylus, en 1740. Elle représente un Chinois ou un Japonais, la tête et les épaules couvertes d’une épaisse fourrure, tenant une pagode à la main, assis sur un cabinet de vernis de la Chine, et qui semble contempler, au-dessous de lui, tous les objets qu’un marchand de curiosités entassait alors dans son magasin. Il serait très possible que le dessin de Boucher eût fourni le modèle d’une enseigne peinte, que Gersaint avait fait exécuter, après avoir cédé sa première enseigne à M. de Julienne. Les amateurs ne dédaignaient pas, comme on le voit, de chercher, parmi les enseignes, quelques bons tableaux pour leur galerie. L’enseigne du Petit Dunkerque, à la descente du Pont-Neuf, entre la rue de Nevers et la rue Dauphine, qui datait de 1767, représentait le port de Dunkerque avec l’arrivage des vaisseaux, qui apportaient de l’Inde et de la Chine la plupart des curiosités qu’on recherchait avec passion pour l’ornement des appartements et que vendait là Granchez, l’heureux propriétaire du célèbre magasin[295]. Cette enseigne, longtemps admirée, était de Joseph Vernet, selon les uns; de La Croix, de Marseille, selon les autres: elle fut acquise enfin, aux approches de la Révolution, et remplacée par un simple vaisseau en fer assez finement forgé, qui sert aujourd’hui d’enseigne à un marchand de vin, mais qui rappelle au moins l’ancienne marine qui l’avait précédé.
Une bonne peinture d’enseigne avait été souvent le coup d’essai d’un jeune peintre. Siméon Chardin, élève de{409} Coypel, dut à une enseigne son premier succès. Cette ovation de l’enseigne est ainsi racontée par Haillet de Courenne dans son Éloge de Chardin[296]: «Un chirurgien, ami de son père, demanda au jeune homme de lui faire un plafond ou enseigne pour mettre au-dessus de sa boutique; il y voulait des instruments de son art: bistouris, trépans et autres. Ce n’était pas ce que Chardin se proposait: il peignit une nombreuse composition de figures. Le sujet était un homme, blessé d’un coup d’épée, qu’on avait apporté dans la boutique d’un chirurgien qui visitait sa plaie pour le panser. Le commissaire, le guet, des femmes et autres figures remplissaient la scène: tout y était plein de feu, de remuement et d’intérêt. Le tableau n’était que heurté, mais traité avec goût. L’effet en était singulièrement piquant. Un jour, bien avant que personne fût levé dans la maison du chirurgien, il le fait poser en place. Le chirurgien voit de sa fenêtre la foule des passants qui s’arrêtaient devant sa porte, ce qui l’excite à demander de quoi il est question. Il voit ce plafond. Il fut tenté de se fâcher, n’y retrouvant plus rien des idées qu’il se souvenait d’avoir confiées à son peintre, mais les éloges du public pacifièrent un peu son humeur: il ne se plaignit que très modérément. On juge bien que le tableau fit du bruit; on s’empressa d’aller en juger. Toute l’Académie connut les talents du jeune Chardin.» Ce tableau, de neuf ou dix pieds de long, passa de la boutique du chirurgien dans la collection du{410} graveur Lebas, mais on ne sait pas ce qu’il est devenu depuis.
Si Chardin débuta par une enseigne, Greuze en fit une lorsqu’il était déjà en possession de toute sa renommée. Ce fut après la brillante réussite de l’opéra-comique du Huron, composé par Marmontel et mis en musique par Grétry. La représentation de cette pièce en deux actes, qui eut lieu à la Comédie italienne le 20 août 1769, fut un véritable triomphe pour le musicien et le point de départ de sa réputation musicale. Peu de jours après, Greuze, qui s’était pris d’amitié pour Grétry, alla le trouver et lui dit: «Viens avec moi; je veux te faire voir une peinture qui te fera grand plaisir.» Il le conduisit près de la Comédie ita{411}lienne et lui indiqua du doigt une enseigne fraîchement peinte: Au Huron, Nicolle, marchand de tabac. Grétry entra tout ému dans la boutique et acheta une livre de tabac. «Quel bon tabac!» disait-il plus tard[297]. On ne sait ce qu’est devenue l’enseigne du Huron.
Nous serions en peine de dire à quelle époque l’hôtel de Villette, quai Voltaire, au coin de la rue de Beaune, fut décoré d’une enseigne en l’honneur de Voltaire, mort, le 30 mai 1778, au premier étage de cet hôtel, où il avait pris domicile lors de son arrivée de Ferney, trois mois auparavant. Il est probable que cette enseigne commémorative ne put être placée sur la maison mortuaire qu’à la suite de la révolution de 1789, car, antérieurement, le nom de Voltaire était à l’index, et ce n’est qu’en 1792 qu’on donna ce nom au quai des Théatins, sur lequel se trouvait l’hôtel du marquis de Villette. L’enseigne A Voltaire, la seule que le propriétaire de l’hôtel ait tolérée sur son immeuble, peut dater de la même époque. Mais elle a été remplacée, de nos jours, par une véritable peinture{412} d’enseigne, un portrait forain plus prétentieux que réussi.
Une autre enseigne, un peu moins ancienne, contemporaine de la fabrication du similor, qui prêta un brillant trompe-l’œil aux faux bijoux du Directoire, portait ce titre: A l’Impossible, et représentait un Merveilleux s’élançant dans les airs pour prendre la lune. C’était un très joli tableau, très bien exécuté, dans le genre de Boilly: le similor lui a survécu, et le tableau méritait de survivre au similor. On le retrouverait peut-être dans l’œuvre de Boilly.
L’Incroyable figure encore sur une enseigne de Gautier, chemisier, rue de Rivoli, vis-à-vis de la place Lobau; ce tableau, assez bien peint, a précédé les incroyables si populaires de la Fille de Madame Angot.{413}
Carle Vernet, qui excellait dans la caricature, peignit plusieurs enseignes; on en a gravé une, dans le Musée des Familles, en 1866. Une enseigne peinte par un bon peintre ne reste pas longtemps l’ornement de la rue et va tôt ou tard figurer dans le cabinet d’un amateur. Cependant, nous avons vu celle du Bœuf à la Mode, qui date du Directoire, garder sa place jusqu’à présent, à l’entrée d’un restaurant fameux de la rue de Valois; elle n’a rien d’agréable, il est vrai, pour faire un tableau de cabinet, quoiqu’elle soit très bien peinte par Swagers. Il en existe d’ailleurs une bonne gravure par S.-C. Ruotte.
Le premier tableau de Prudhon avait été une enseigne, celle d’un chapelier, «ornée d’un bonhomme prodigieux», disait un journaliste, le 20 janvier 1874, en annonçant l’ouverture de l’exposition de toutes les œuvres de Prudhon, à l’École des beaux-arts.
De Géricault il y eut aussi une enseigne, qui annonçait encore, en 1841, la forge d’un maréchal ferrant, non pas à Paris, mais sur la route de Saint-Germain en Laye, au coin de la grande rue du village de Roquencourt. Plusieurs autres enseignes, représentant un cheval ou plusieurs chevaux, furent attribuées aussi, avec plus ou moins de probabilité, à Géricault, comme le célèbre Cheval blanc de l’auberge de Montmorency.
On attribuait également à Horace Vernet l’Hirondelle, assez bien peinte, qu’on voyait représentée volant à tire-d’aile sur le plafond du café de Foy, au Palais-Royal. On racontait qu’un ouvrier maladroit, chargé de repeindre ce plafond, y avait fait une tache qu’il essayait vainement de faire disparaître. Horace Vernet, âgé de vingt ans, aurait alors pris{414} des mains de l’ouvrier le pinceau et la palette et, grimpant à l’échelle, se serait amusé à transformer la tache qui déshonorait le plafond en un charmant oiseau que le café de Foy a conservé jusqu’à la fin de son règne. Cette hirondelle n’était pas indigne du talent preste et vif d’Horace Vernet, mais ce grand artiste, qui ne rougissait pas d’avoir fait des caricatures plaisantes et satiriques, se montrait blessé de ce qu’on lui attribuât cette peinture anonyme.
Au contraire, Abel de Pujol ne désavouait pas le moins du monde les enseignes qu’il avait faites, et il en gardait soigneusement les croquis dans ses cartons, lors même qu’il fut membre de l’Académie des beaux-arts. Ces croquis spirituels, on les vit parmi ses compositions, à la vente de ses dessins, en décembre 1861, et ils ne manquèrent pas d’amateurs. La Chronique des Arts, du 15 décembre, enregistrait le fait: «Les projets, les croquis se sont pieusement distribués entre quelques amis du mort. Nous citerons, comme curiosité, huit compositions d’enseignes, et particulièrement celle de Monsieur et Madame Denis s’offrant cette prise de tabac qui fit tant rire nos pères et tant rougir nos mères, et celle de la Fille mal gardée, magasin situé jadis dans la rue de la Monnaie. N’est-ce pas une note curieuse dans l’histoire d’un académicien?» Où sont-elles à présent, ces enseignes qui étaient de vrais tableaux décoratifs?
Il ne faut pas oublier un très bon tableau d’enseigne qui date du Directoire, ou plutôt du Consulat; le nom de l’artiste, qui peignait ce tableau vers 1801, n’est pas connu, mais la maison Corcellet, qui rivalise avec la maison Chevet, depuis près d’un siècle, pour la vente des comestibles, a{415} toujours conservé son enseigne: Au Gourmand[298]. «Un bon gros vivant, costumé comme on l’était encore sous la Restauration: ailes de pigeon, queue de rat, culotte courte, bas chinés, souliers à boucles, est assis devant une table et travaille à faire envie à Gargantua. Il y a beaucoup d’esprit et une grande justesse de mouvement dans cette figure.» M. Poignant[299], à qui nous empruntons la description et l’éloge de cette plaisante enseigne, ne paraît pas avoir soupçonné que ce gourmand n’était autre que Grimod de la Reynière, peint d’après nature, à l’époque du Consulat, lorsqu’il allait publier son fameux Almanach des Gourmands, en tête duquel il est représenté tel qu’il l’était sur l’enseigne de Corcellet.
C’est M. Poignant qui nous fournit encore la description d’une autre enseigne gastronomique, dont l’auteur était aussi un assez bon peintre qui n’a pas signé son œuvre et ne s’est pas fait connaître: «Un autre tableau, également bien exécuté et reproduisant le même sujet: Au Gourmet, sert d’enseigne à un charcutier, place de l’Ecole. Celui-ci a joui un instant d’une notoriété publique, quand il fut mis en place, vers 1820. On voulut voir, dans ce personnage attablé, une ressemblance avec le roi Louis XVIII. Les passions politiques s’en mêlèrent. Les partis opposés se donnaient rendez-vous sur la petite place de l’Ecole; des rassemblements se formaient, des horions pleuvaient. Si l’on avait su quel était le peintre de l’enseigne, on lui aurait{416} fait un mauvais parti.» C’était un fâcheux renom, pour un peintre d’histoire, que d’être cité comme peintre d’enseigne! Il y en eut plus d’un, cependant, qui fut peintre d’enseigne malgré lui. Un peintre, nommé Marcel, qui n’était pas sans talent, eut un grand tableau deux fois refusé au Salon, la première fois sous le titre de Passage de la Bérésina, et la seconde fois sous celui de Passage de la mer Rouge. Cette toile finit par être vendue comme enseigne à un marchand qui l’intitula: Au port de Marseille.
Gavarni, dont le coquet et gracieux talent s’essaya d’abord à dessiner des modes, n’était pas peintre, mais il était excellent dessinateur. Après avoir dessiné des cartes d’adresse de marchands, entre autres celles de Mesler, graveur sur métaux, il consentit, vers 1836, à peindre une enseigne: Aux deux Pierrots, au bas de la rue Saint-Jacques, et le succès de cette enseigne faillit le décider à faire de la peinture. «Combien d’enseignes valent mieux que des tableaux!» L’enseigne des Deux Pierrots avait été criblée de balles pendant l’insurrection de juin 1848; elle fut depuis restaurée, mais en même temps défigurée, puisqu’elle ne donne plus qu’une idée très imparfaite de ce qu’était l’œuvre primitive; au reste, Gavarni avait pris soin de la reproduire lui-même en lithographie[300].
Champmartin, dont les tableaux d’histoire et surtout les portraits avaient été fort remarqués aux Salons anté{417}rieurs à la révolution de Juillet, voulut prouver qu’il n’était pas un peintre incorrigiblement royaliste; il peignit, pour un magasin de la rue Saint-Nicaise, au coin de la rue de Rivoli, une enseigne qu’il aurait pu signer: Au Tambour de Juillet. Cette enseigne représentait un ouvrier en costume de travail, les bras nus, battant la charge sur une barricade, au milieu de la fumée des fusillades. Quelquefois un peintre en vogue ne dédaignait pas de vendre la copie d’un de ses tableaux pour en faire une enseigne, et cette copie était peinte dans son atelier par un de ses élèves. Telle était l’enseigne d’un cordonnier de la rue du Bac: A la Grâce de Dieu! Cette enseigne n’était autre qu’une copie fidèle d’un tableau que Steuben avait exposé en 1827: Pierre Iᵉʳ enfant, poursuivi par les Strélitz jusqu’aux pieds de la statue de la Vierge. «Le tableau n’était pas bien bon, dit M. Poignant; l’enseigne ressemble au tableau[301].»
Nous avons entendu dire que plus d’un peintre de l’école romantique s’était donné le plaisir de faire une enseigne et de chercher un succès populaire en dehors des concours et des académies. On nommait, parmi ces essayeurs du Salon de la rue, Eugène Delacroix, Poterlet, Jeanron et d’autres. Il faut se rappeler que les tableaux d’Eugène Delacroix, envoyés à l’Exposition de peinture, étaient alors refusés par le jury académique[302]. Quoi qu’il en soit, on pour{418}rait citer quelques enseignes peintes par des jeunes gens qui, comme Nanteuil et Baron, suivaient avec passion les
errements de l’école romantique. Il en est une surtout, A Maître Albert, au nº 56 du boulevard Saint-Germain, près{419} de la rue de Bièvre, qu’on attribuait à Delacroix, et qui offre, en effet, des analogies avec la composition, le style et la couleur des ouvrages de ce grand peintre.
Cette belle enseigne représente le célèbre philosophe Albert le Grand expliquant les livres d’Aristote aux écoliers de l’Université de Paris, en 1215. Une pareille enseigne est bien là à sa place, à deux pas de la vieille rue du{420} Feurre ou du Fouarre, où se tenaient les écoles au moyen âge[303].
On admirait beaucoup, à l’angle de la rue de la Barillerie et du quai aux Fleurs, l’enseigne des Forges de Vulcain. Cette peinture, très éclatante en couleur, n’était pas sans mérite, comme le déclarait Eugène Delacroix, qui s’arrêtait toujours pour la regarder. On y voyait Vénus, entièrement nue, s’appuyant sur l’épaule de Vulcain.
En 1860, tout ce côté de la rue de la Barillerie disparut pour faire place au tribunal de commerce. Le magasin de quincaillerie, exproprié, transporta son matériel et son enseigne place du Châtelet, à l’entrée de la rue Saint-Denis, nº 3. Mais la vieille peinture ne parut plus digne des splendeurs du nouveau quartier, le propriétaire la fit reproduire, en faïence émaillée, par l’un de nos plus illustres peintres céramistes modernes, M. A. Jean. C’est une œuvre vraiment remarquable, la plus grande composition de ce genre qui existe à Paris. La reproduction du nu, d’une teinte uniforme, dans ces proportions qui exigent un grand nombre de carreaux de rapport, offrait une difficulté dont l’artiste n’a pu triompher qu’en donnant aux chairs un ton sensiblement jaune, qui traduit mal l’éclat de la blonde Vénus.{421}
DEPUIS l’origine des enseignes de Paris, il est permis d’affirmer, même en l’absence de toute espèce de preuve, que leurs inscriptions laissaient beaucoup à désirer sous le rapport de la langue et de l’orthographe, d’autant plus que la langue était à peine formée au XVᵉ siècle et que l’orthographe ne fut pas établie avant la fin du siècle suivant. Il n’y avait, à cette époque, que bien peu d’écrivains, poètes ou prosateurs, qui sussent écrire grammaticalement, et si l’orthographe était déjà perfectionnée dans les bonnes éditions de Henri Estienne et de Michel Vascosan, elle pouvait passer pour inconnue dans l’usage de la vie ordinaire. Il est donc aisé d’imaginer quelle était alors la barbarie des légendes de la plupart des enseignes, dans un temps où la{422} grande majorité des Français ne savait ni lire ni écrire; quant à leur orthographe, elle devait être des plus fantaisistes, puisque les personnes même de la cour, les plus distinguées par la culture de leur esprit, ne rougissaient pas d’accuser à cet égard une ignorance complète dans leurs lettres particulières. On n’avait généralement aucune idée de la bonne orthographe, et la plupart des femmes de la haute société, par exemple, n’étant point là-dessus plus instruites que les femmes et les filles des marchands, il n’y avait pas lieu d’exiger des peintres d’enseignes qu’ils respectassent davantage les lois de la grammaire et de l’orthographe.
Ce fut sans doute, de la part de Molière, une grande audace que d’oser faire paraître, dans sa comédie des Fâcheux, et cela en présence de la cour de Louis XIV, le personnage de Caritidès, qui avait l’impertinence de vouloir présenter un placet au roi pour la réforme de l’orthographe des enseignes. Voici quel était le commencement de ce placet, qui s’attaquait indirectement à la plupart des nobles spectateurs, assistant alors (1661) à la première représentation de cette comédie, au château de Vaux, chez le surintendant Fouquet:
«Sire,
«Votre très humble, très obéissant, très fidèle et très savant sujet et serviteur, Caritidès, Français de nation, Grec de profession, ayant considéré les grands et notables abus qui se commettent aux inscriptions des enseignes des maisons, des boutiques, cabarets, jeux de boule et autres lieux de votre bonne ville de Paris, en ce que certains ignorants, compositeurs desdites inscriptions,{423} renversent, par une barbare, pernicieuse et détestable orthographe, toute sorte de sens et de raison, sans aucun égard d’étymologie, analogie, énergie ni allégorie quelconque, au grand scandale de la république des lettres et de la nation française, qui se décrie et se déshonore par lesdits abus et fautes grossières envers les étrangers, et notamment envers les Allemands, curieux lecteurs et spectateurs desdites inscriptions:
»Supplie humblement Votre Majesté de créer, pour le bien de son État et la gloire de son empire, une charge de contrôleur, intendant, correcteur, reviseur et restaurateur général desdites inscriptions.»
Les éclats de rire qui accueillirent cet étrange placet cachaient peut-être un certain embarras de la part des grands seigneurs, qui auraient été fort en peine de signaler les abus d’orthographe qu’il fallait corriger sur les enseignes. On pourrait supposer aussi que le placet du sieur Caritidès existait réellement, et avait été fourni à Molière par le jeune roi, pour faire honte à ses courtisans de leur mauvaise orthographe. Ce Caritidès pourrait bien être le type de Jean de Soudier, sieur de Richesource, qui tenait chez lui une école de philosophes orateurs et qui prétendait prouver que tous les écrivains, même les plus célèbres, outrageaient, dans leurs écrits, les principes de la langue française[304]. Il est très probable que quelque intraitable puriste avait adressé au lieutenant de police, sinon{424} au roi, une supplique pour la réformation de l’orthographe des enseignes.
«Les enseignes n’ont jamais brillé par l’orthographe,» dit M. Firmin Maillard dans son étude sur les enseignes[305]. Il est donc avéré que le projet du sieur Caritidès a été bien des fois renouvelé, sans plus de succès; car nous rencontrons jusqu’à nos jours les mêmes protestations contre l’orthographe des enseignes, sans que jamais l’édilité parisienne se soit décidée, avant l’époque du Directoire, à contrarier la liberté individuelle à propos d’orthographe, d’autant plus que ces protestations indignées ne venaient pas en ligne directe de l’Académie française. Nous avons rappelé plus haut (page 367) l’ordonnance du Bureau central du Canton de Paris, en date du 1ᵉʳ frimaire an VIII (novembre 1799), obligeant les boutiquiers à diverses modifications dans le mode d’application de leurs enseignes, et à y corriger «tout ce qui pouvait s’y rencontrer de contraire aux lois, aux mœurs et à la langue française.» Nous rencontrons une phrase à ce sujet dans l’ouvrage d’Henrion, intitulé: Encore un Tableau de Paris (Paris, Favre, an VIII, in-12): «Le Département a sagement proscrit les enseignes grotesques et leur orthographe vicieuse.» Il paraîtrait que la Révolution du 18 Brumaire, en créant le Consulat, accorda une sorte de répit aux enseignes condamnées; huit ou neuf ans plus tard, elles n’avaient pas encore été corrigées administrativement, selon le bon plaisir des Caritidès du Directoire, car l’auteur-éditeur du Cicérone parisien, le libraire A.-G. Debray, fulminait ainsi contre ces enseignes déshonorantes,{425} dans son Indicateur, imprimé en 1808: «Rien de plus grotesque que le style et l’orthographe de la plupart des écriteaux et des enseignes de Paris; on peut dire que, sous ce rapport, la langue n’est nullement ailleurs aussi grièvement insultée que dans la capitale, et cela est véritablement honteux. Mais combien ces fautes grossières contre la langue ne sont-elles pas plus ridicules encore lorsqu’elles se rencontrent dans des inscriptions faites par ordre de l’autorité! On vient de terminer un nouveau numérotage des rues, et je vis dernièrement écrit en beaux caractères, à trois endroits différents: Carfour de l’Odéon. Cela fait vraiment pitié. Quand donc nommera-t-on un censeur des écriteaux? Et quelle opinion veut-on que l’étranger prenne des habitants de la grande ville, lorsqu’il voit partout l’ignorance et la sottise étalées sur les murs?» Le censeur des écriteaux n’avait pas été nommé, et les enseignes sans orthographe continuaient à blesser les yeux des bons Français, amis de la grammaire.
Les libraires semblaient s’être entendus pour faire une levée de boucliers contre les enseignes saugrenues et mal orthographiées. Ce n’était pas l’honnête Debray qui avait commencé l’attaque, c’était le fameux éditeur des Révolutions de Paris, le révolutionnaire Louis Prudhomme, qui, après avoir publié les Crimes des Reines de France et les Crimes de Marie-Antoinette, dénonça les crimes anti-orthographiques des enseignes, dans son Miroir de l’ancien et du nouveau Paris (1805, 2 vol. in-18, t. II, p. 208-10). J.-B. Salgues, qui n’était pas libraire, mais qui travaillait sans cesse pour les libraires, traita aussi ex professo la question de l’orthographe des enseignes dans un recueil intitulé: De Paris,{426} des mœurs, de la littérature et de la philosophie (Paris, J.-G. Dentu, 1813, in-8º). Salgues, pour mieux dire leur fait aux barbouilleurs d’enseignes fautives et condamnables, a écrit la lettre d’un peintre d’enseigne à un commissaire de police. «J’avais cru, dit-il dans cette lettre, qui ressemble à une pétition pour obtenir la place à créer d’inspecteur et censeur des enseignes de Paris, j’avais cru que ma science me ferait remarquer; que, loin d’être confondu avec ces barbouilleurs de carrefours qui insultent Vaugelas et outragent Ronsard, on citerait mes ouvrages et mon nom avec estime et reconnaissance; que la renommée publierait mes chefs-d’œuvre et m’inscrirait avantageusement parmi les hommes qui s’élèvent au-dessus du commun de leurs confrères et honorent leur profession; mais, monsieur, rien de tout cela n’est arrivé, et quoique j’aie peint plusieurs fois la Renommée, pour annoncer la bière au pot et le riz au lait, l’ingrate m’a laissé dans l’oubli. Je vois chaque jour l’ignorance de mes confrères triompher, et les règles de l’orthographe indignement profanées par des mains barbares et sacrilèges. Comment, monsieur, dans une ville telle que Paris, au milieu d’une foule d’Académies, de Lycées et d’Athénées, ne s’élève-t-il pas un homme courageux qui dénonce tant de scandales?»
L’homme courageux, c’était lui, c’était J.-B. Salgues, qui aspirait à être désigné comme inspecteur et correcteur des enseignes de Paris, car la création de cette place était à l’ordre du jour. Il donna ensuite, à l’appui de ses justes critiques, l’indication de quelques enseignes monstrueuses qu’il avait relevées dans Paris et contre lesquelles les grammairiens criaient vengeance. «Croiriez-vous, monsieur,{427} que, sur la porte d’un savant instituteur, je lus, en grosses lettres: COURS D’ARITEMÉTIQUE ET DE GÉOMETERIE? Plus loin, une marchande de modes annonçait qu’elle vendait de bonnes piques; c’étaient des bonnets piqués qu’elle voulait dire. J’ai remarqué, au-dessus d’une porte d’auberge, qu’on y donnait à mangé à l’Ange gardien. Et, pour peindre d’un seul trait tous les désordres de ce genre, j’ai vu, il y a quelques années, dans un chef-lieu de canton, ces mots écrits sur le cabinet d’un fonctionnaire public: BURO DU JUGE DE PET.» Le peintre d’enseigne dans la peau duquel s’était mis le bonhomme Salgues finissait par déclarer que «toutes les inscriptions devaient être revues par un écrivain-juré.» Malgré ses offres de service, Salgues ne fut pas choisi pour remplir la place à laquelle il aspirait. On institua un inspecteur vérificateur des épitaphes dans les cimetières de Paris, mais on ne créa pas cette place de censeur des enseignes, qui avait donné l’éveil à de modestes ambitions.
Il eût fallu alors un volume entier pour recueillir les inscriptions d’enseignes qui auraient offert matière à la censure des descendants du sieur Caritidès. L’opinion publique, on doit le reconnaître, a eu plus d’autorité que ne pouvait en avoir un agent officiel de la police pour mettre à l’index et faire disparaître, en fort peu de temps, ces incongruités orthographiques. A mesure que se répandirent la connaissance et la pratique de l’orthographe, les inscriptions qui prêtaient à la critique ne tardèrent pas à être corrigées ou effacées. Cependant Dufey de l’Yonne, constatait, en 1820[306], qu’un peintre d’enseigne, chargé de{428} restaurer, rue du Faubourg-Saint-Antoine, une ancienne inscription, y avait ajouté, de son chef, une magnifique faute d’orthographe, en écrivant: Boulangerie générale des Marchées. «C’est sur le dernier mot, dit Dufey, de l’Yonne, que se trouve la correction, encore toute fraîche.» Il signalait aussi, dans la même rue, cette inscription, qui datait de plus de cent ans, et qu’on avait laissée intacte au-dessus d’un hôtel garni qui portait le nº 58: Hotelle du Bel Air. Beaucoup d’enseignes de la même époque s’étaient conservées jusqu’à nos jours avec l’ancienne orthographe traditionnelle, à la porte des cabarets et des marchands de vin: Un tel, fait nopces et festins.
Quand le Pont-Neuf était d’un bout à l’autre le rendez-vous des décrotteurs et des tondeurs de chiens, chacun de ces industriels se constituait un écriteau plus ou moins naïf et bizarre, dont il était l’inventeur; ces inscriptions étaient émaillées des fautes d’orthographe les plus originales. Balzac a pourtant passé sous silence ces chefs-d’œuvre de l’enseigne en plein vent. Il ne cite, dans son Petit Dictionnaire critique et anecdotique des Enseignes de Paris, qu’une seule inscription de cette catégorie: «Au Chien fidèle, Beilliard, marchand de chiens, boulevard des Italiens, au coin de la rue de Grammont. Tond chiens et chats, châtre les uns, coupe les autres. Vat en ville, et sa femme aussi, et prend des pensionnaires.» Toutes les enseignes de tondeurs de chiens portaient alors cette expression sacramentelle et encourageante: Vat en ville. On voyait, en ce temps-là, rue de l’Hôpital-Saint-Louis, cette belle et engageante inscription: N..., jardinier, terassier, entrepran jardint, terrases, et se charge aussi de les rambleyères. Enfin, le chef-d’œuvre de{429} l’orthographe d’enseigne se trouvait, sur la route d’Ivry, à cent pas de la barrière d’Italie: A la bote d’hoillegnons.
Au XVIIIᵉ siècle, l’orthographe fantastique et phénoménale affligeait tellement la vue des passants, qu’un digne prêtre, nommé Teisserenc, bachelier et théologien, imagina de rendre les enseignes utiles et intéressantes, au moyen d’un nouveau système d’inscriptions, lequel serait appliqué sous la direction de l’autorité; il voulait d’abord «fixer, à chaque espèce d’écriteau et d’enseigne qui regarderait le même métier et la même matière, une forme et une couleur particulière, pour les distinguer des autres: ce qui formerait une variété la plus agréable et la plus utile.» On voit que le style du réformateur des enseignes aurait eu besoin de subir une réforme académique pour être intelligible et grammatical.
Puis, «comme la première utilité qu’on doit tirer des enseignes, c’est celle du maître de l’enseigne et de sa profession», il faudrait, dit-il, «faire un nombre d’écriteaux suffisants qui portassent les principaux outils, ouvrages, ou marchandises de la même profession, etc., et le nombre fixé pour chaque profession.
»Dans les écriteaux qui marqueraient un fait historique, ajouter l’année en laquelle ce fait est arrivé, comme: A la Bataille de Fontenoy, 1745, chez un tel, marchand.» L’inscription serait nécessairement correcte sous la surveillance de l’autorité. Cet écriteau n’empêcherait pas le marchand d’y ajouter la peinture qu’il voudrait et l’explication détaillée du fait lui-même.
Enfin, outre les écriteaux explicatifs, les enseignes pourraient offrir le portrait et les noms du roi, des princes et{430} des autres seigneurs, les portraits des grands hommes, tous les ordres de chevalerie et toutes les espèces de monnaies françaises et étrangères. Ce système ingénieux correspondait à celui que l’auteur avait projeté pour les noms des rues, auxquels il proposait d’ajouter des noms de pays et de ville, avec plus ou moins de détails géographiques et historiques. L’ouvrage que l’abbé Teisserenc avait consacré à son projet est intitulé: Géographie parisienne, en forme de dictionnaire, contenant l’explication de Paris ou de son plan, mis en carte géographique du royaume de France, pour servir d’introduction à la Géographie générale (Paris, chez la veuve Robinot, 1754, in-12). Les feuilles périodiques parlèrent de cet ouvrage comme de l’œuvre d’un fou, mais ce fou, docte et intelligent, fut comblé d’éloges par un autre fou, plus ardent et plus violent, qui s’étonna qu’une idée si neuve et si originale n’eût pas été mise aussitôt à exécution pour l’instruction du peuple.
Aujourd’hui le public est devenu difficile et fait lui-même la police de ses enseignes. Il n’y eut qu’un cri d’indignation, dans le quartier de l’Hôtel de ville, quand un marchand de chaussures ouvrant sa boutique, lors de la visite de Nasser-ed-Din à Paris, en 1873, écrivit au-dessous d’un fulgurant portrait du Schah, en grand uniforme, avec tous ses diamants: au Chah de Perse. Le commissaire de police intervint et enjoignit au cordonnier philologue de corriger la chose. Mais celui-ci lui démontra, Littré en main, que le nom du souverain persan s’écrivait indifféremment Chah ou Schah, et que, par conséquent, il avait bien le droit de faire l’économie d’une lettre sur son enseigne. L’affaire fit scandale, les journaux s’en mêlèrent; mais, en fin de{431} compte, le malin cordonnier trouva moyen de satisfaire l’autorité et de réaliser en même temps l’économie d’une lettre, en adoptant une troisième orthographe; il fit peindre sur sa boutique: Au Shah de Perse, inscription qui subsiste, quoique le portrait ait disparu depuis peu. Nasser-ed-Din fut enchanté, paraît-il, de sa popularité et de sa ressemblance, quand on lui fit remarquer l’enseigne en question, dans une de ses tournées à travers Paris, où il n’admira franchement que deux choses, ainsi que son Journal de voyage en fait foi, les exercices du Cirque et la belle prestance de M. le préfet de la Seine. L’ingrat personnage ne mentionne pas le portrait-enseigne de la rue de Rivoli.{432}
DEPUIS la révolution du 4 Septembre 1870, la dernière heure des enseignes de Paris paraît avoir sonné. Le jour même où cette révolution s’accomplissait, sans émeute et sans résistance, les enseignes furent plus compromises que les hommes; on s’attaqua de préférence à celles dont le sujet semblait avoir quelque complicité avec l’Empire et porter plus ou moins le cachet napoléonien; on ne fit pas même grâce aux souvenirs militaires de l’armée française; tout ce qui rappelait ou pouvait rappeler, de près ou de loin, la première ou la seconde époque impériale, fut condamné sans forme de procès et proscrit sans rémission. Dans l’espace de vingt-quatre heures, on enleva ces enseignes maudites et vouées à la haine des bons républicains, et{433} l’on effaça consciencieusement toutes les inscriptions qui les concernaient. Il y avait pourtant un progrès sensible dans les mœurs de la populace, qui ne s’attaqua point matériellement aux enseignes et qui se contenta de les voir disparaître. A peine si quelques-unes furent insultées et maltraitées avant leur enlèvement.
C’était la cinquième fois, depuis 1814, que la politique prenait à parti ces pauvres enseignes, que la chute d’un gouvernement rendait tout à coup compromettantes et coupables; non seulement les plus beaux magasins perdaient avec leurs enseignes le fleuron de leur couronne, mais encore une foule d’industriels, qui avaient attaché à leurs marques de fabrique les emblèmes de l’Empire, de la Royauté ou de la République, reconnaissaient que ces emblèmes, après leur avoir été favorables, pouvaient tout à coup leur devenir dangereux et nuisibles. Il y avait toujours eu, à Paris, deux ou trois cents enseignes que la réaction mettait hors la loi chaque fois que le gouvernement venait à changer en France; il y avait aussi mille ou douze cents boutiques qui, au moment d’un cataclysme révolutionnaire, se trouvaient plus ou moins menacées pour avoir appelé la protection du gouvernement déchu, en acceptant comme un honneur l’étiquette impériale, royale ou républicaine. Cet état de choses, toujours identique dans ses résultats, donna donc à réfléchir aux marchands les plus naïfs, et chacun jugea prudent de s’abstenir désormais, dans son enseigne, de toute manifestation politique. Or, comme on peut voir de la politique dans ce qui lui ressemble le moins, on en vint tout naturellement à supprimer l’enseigne. On se souvenait en effet que, selon le temps et les circonstances,{434} l’enseigne avait été une forme caractérisée d’opposition, de protestation ou de flagornerie.
Les enseignes ne se relevèrent guère de cette proscription vague et indistincte. Nous avons indiqué déjà, dans les chapitres précédents, les autres raisons qui les firent abandonner peu à peu par un grand nombre de commerçants, et nous n’y reviendrons pas ici. Signalons seulement la grande part que prirent naturellement à la disparition des anciennes enseignes, dont beaucoup étaient si intéressantes, les démolitions opérées à Paris dans ces vingt-cinq dernières années. Les anciennes enseignes n’ayant été remplacées presque nulle part, et ce genre d’annonce commerciale tendant à passer de mode, on comprend que la rareté des enseignes se soit faite de jour en jour. Aussi peut-on prévoir que celles qui existent encore finiront par disparaître à leur tour, quoique, même parmi les plus récentes, quelques-unes soient vraiment jolies: telles, par exemple, la Petite Fermière, de la rue Lepic; la Fraternité, au nº 54 de la rue Monge, etc., tableaux ingénieux et assez bien peints.
Peut-être l’enseigne sculptée survivra-t-elle cependant, mais plus artistique et par conséquent plus rare, si l’on peut considérer comme durable l’espèce de résurrection qu’elle a subie depuis une dizaine d’années en entrant comme motif d’architecture dans la décoration générale de la maison, transformation dont nous avons donné déjà des exemples et dont nous reparlerons tout à l’heure.
En tout cas, nous demandons grâce pour quelques-unes des anciennes enseignes qui subsistent encore, qu’on doit regarder comme de véritables œuvres d’art, et qui présentent un curieux spécimen de ce que furent les enseignes{435} sculptées dans leur beau temps; par exemple, il serait très regrettable de voir détruire l’enseigne du Griffon, rue du Faubourg-Saint-Antoine, sculpture très fine et très élégante du XVIIIᵉ siècle, dans un médaillon d’architecture; le Vieux Satyre, au coin des rues du Four et Montfaucon; l’enseigne du Cherche-Midi, celle de la cour du Dragon, le
Centaure, de la rue des Lombards, le Soleil d’Or, de la rue Saint-Sauveur, la Truie qui file, de la rue Saint-Antoine, l’Arbre de Jessé, au coin de la rue des Prêcheurs, les Trois Canettes, l’Hercule, rue Grégoire-de-Tours, le Lion d’Argent, rue des Prouvaires, enseignes dont nous avons reproduit les figures.
Il y a des enseignes, comme plusieurs de celles que nous venons de citer, qui dureront aussi longtemps que{436} les maisons sur lesquelles l’artiste les a taillées dans la pierre de la façade; comme aussi le Croissant, de la rue Montorgueil, nº 9; une enseigne d’architecte, au nº 57 de la même rue; le Mouton, de la rue du Four; un curieux et très bon bas-relief, grandeur nature, non signé, mais daté de 1868, représentant deux ouvriers prenant des mesures
sur une pierre de taille, et divers attributs du métier, au nº 12 de la rue Monge, indiquant sans doute que la maison est celle d’un entrepreneur ou d’un architecte. Mais vienne à passer par là le tracé d’une nouvelle voie, et voilà tout à bas, sans que peut-être on songe à porter l’enseigne intéressante ou curieuse au musée Carnavalet, gardien naturel de tout ce qui se rattache à l’histoire de Paris.
Ainsi, hélas! qu’a-t-on fait du Pélican, qu’on voyait encore, en 1862, déchirant ses flancs pour nourrir ses{437} petits, sur le quai du Marché-Neuf, presque en face de la Morgue; du Petit Saint-Antoine, de la rue Saint-Sauveur, au coin de la rue Montorgueil, sculpture grossière, mais
originale et intéressante par son caractère archaïque, bien que ne remontant pas au delà du XVIIᵉ siècle? Que sont devenus la Bouteille d’Or, grand bas-relief de la rue de la
Cité, et le Puits, de la rue Saint-Honoré, tableau peint dans un cadre de sculpture fleuronnée d’assez bon style; et tant d’autres enseignes curieuses? Pauvres enseignes, à peine reste-t-il de vous un souvenir!
En renonçant à l’enseigne, on en a conservé cependant{438} le titre, comme une espèce de raison commerciale, et ce titre est resté en inscription sur la boutique, aussi bien que sur les factures et les prospectus des marchands. Cette enseigne nominative est une sérieuse propriété que le commerçant a le droit de défendre vis-à-vis des contrefacteurs. Aussi la plupart des maisons de commerce en vogue se distinguent-elles par leurs enseignes nominales, inscrites en grosses lettres au frontispice des magasins. Le possesseur
titulaire d’une enseigne se montre très jaloux de son droit acquis, lorsque la concurrence essaye de le lui disputer: de là des procès qui ont souvent donné lieu à des dommages-intérêts considérables. Quelques-unes de ces enseignes sont devenues des fiefs, que leurs propriétaires n’échangeraient pas contre des duchés-pairies, s’il en était encore. C’est à la nouveauté que revient la palme dans ce genre d’illustration: le Louvre, le Bon Marché, le Printemps, etc., remplissent l’univers de leurs noms,—c’est-à-dire de leurs{439} enseignes,—et vous pouvez être certain que, pour une femme, ce grand nom historique: le Louvre, n’éveille plus aujourd’hui l’idée du royal palais ni du merveilleux musée, mais celle du magasin «le plus vaste du monde». D’autres, comme Pygmalion, les Statues de Saint-Jacques, le Gagne-Petit, relevés en façade sur les grandes rues nouvelles, ont ressuscité l’enseigne sculptée, en la faisant concourir à la décoration générale de la maison; ce sont quelquefois de véritables œuvres d’art. Le magasin de Pygmalion expose en cariatides, de chaque côté de son entrée principale, un Pygmalion et une Galathée fort habilement modelés. Les Statues de Saint-Jacques sont d’anciennes statues, retrouvées sur l’emplacement de Saint-Jacques de l’Hôpital. Les frères Saint, jouant sur leur nom de famille, ont décoré la façade de leur magasin de toilerie, rue du Pont-Neuf, des statues fort bien exécutées des saints patrons des quatre frères. D’autres encore que des magasins de nouveautés ont également adopté l’enseigne décorative. Le journal le Figaro s’est installé, en 1874, dans un très élégant hôtel qu’il a fait construire, rue Drouot, avec une façade des plus luxueuses, au milieu de laquelle son patron tient tout naturellement la place d’honneur, parmi de nombreux ornements présentant partout les armes de la maison, un F et une plume croisés. La statue, qui est en bronze, est l’œuvre très réussie de MM. Amy et Boisseau[307]. Enfin,{440} rue des Écoles, on voit, non loin du square Monge, une maison couverte de sculptures dorées, plus riches que de bon goût, mais surmontée du buste de l’illustre mathématicien, qui est bien à sa place tout près de l’École polytechnique, dont il fut l’un des fondateurs. Signalons encore, dans la rue Bergère, l’ornementation de l’hôtel du Comptoir d’escompte, bâti vers 1880, où figurent, avec les statues du Commerce et de l’Industrie, des médaillons en mosaïque sur fond d’or représentant les cinq parties du monde. Mais ce sont là, jusqu’à présent, des exceptions et nous craignons bien que les enseignes matérielles et décoratives, qui semblaient être naguère l’accessoire obligé des boutiques, ne reprennent jamais entièrement possession de leurs antiques prérogatives.
On a cherché, néanmoins, à les remplacer de différentes manières et même à plus grands frais. On inventa des tableaux mécaniques, qui n’étaient, à vrai dire, que des enseignes en ronde bosse, compliquées et ingénieuses; mais si ces enseignes mouvantes avaient le privilège d’attirer beaucoup de spectateurs émerveillés et tenus en contemplation, ces spectateurs n’étaient que des curieux qui fournissaient bien peu de chalands. On inventa ensuite les enseignes lumineuses, qui produisirent d’abord beaucoup d’effet et qui, le soir, encombraient de badauds{441} immobiles les boulevards et les rues où elles étaient offertes en spectacle aux passants. On n’a pas oublié celles d’un magasin de toilettes de femme, boulevard Saint-Denis, au coin de la rue du Faubourg-Saint-Martin: il y a quinze ou vingt ans, dès que la nuit était assez obscure, les dix fenêtres de l’entresol de ce magasin se changeaient en transparents, où l’on voyait successivement les portraits en pied de Rachel dans tous ses rôles et dans tous ses costumes.
On tenta aussi de remettre à la mode un genre d’enseigne vivante, qui avait eu grand succès, sous le Directoire, lorsqu’on installa aux portes du Jardin turc, sur le boulevard du Temple, de véritables Turcs, en chair et en os, choisis parmi les plus beaux hommes qu’on avait pu trouver pour ce rôle fatigant et stationnaire, que les belles-de-nuit se plaisaient à rendre difficile. On avait tenté depuis un essai analogue, au Palais-Royal, dans le café des Mille Colonnes, où l’on exhibait à la porte les monstrueuses nudités de la Vénus hottentote, que l’on peut aller voir en squelette, dans la salle des monstres humains, au Cabinet d’histoire naturelle du Jardin des Plantes.
Mais ce qui devait contribuer le plus à la décadence des enseignes, ce furent les affiches illustrées, qui n’étaient qu’un nouveau procédé de publicité commerciale, imité des toiles peintes que les bateleurs exposent dans les foires pour attirer les curieux, par la représentation figurée des animaux rares et extraordinaires qu’on voit au naturel dans leurs baraques. Ces affiches parlantes, avec des figures dessinées ou peintes, ont existé dans l’ancienne Rome; on en voit encore quelques-unes à Pompéi, et ces affiches étaient{442} réellement des enseignes, quand l’image de deux serpents peints en noir sur une muraille défendait au passant de s’y arrêter pour satisfaire un besoin naturel. Nous trouvons à chaque pas, dans nos rues, des inscriptions municipales qui expriment la même défense que les deux serpents de l’antiquité romaine. Les affiches illustrées, qui n’ont reparu que de nos jours, n’ont pas tardé à ressusciter l’enseigne à l’état éphémère, mais sans cesse renouvelable avec des variantes continuelles. Ce n’est plus l’enseigne à demeure, immobilisée au-dessus d’une boutique: c’est l’enseigne qui se multiplie à l’infini et s’étale à la fois sur tous les murs de Paris; c’est l’enseigne qui se montre à tout le monde, dans toutes les rues de la capitale et qui ne disparaît, au bout de quelques jours, que pour reparaître bientôt sous une nouvelle forme, avec de nouvelles promesses et de nouvelles couleurs.
On avait d’abord imité, dans ces enseignes murales, les proportions gigantesques des anciennes enseignes de Paris au XVIIIᵉ siècle, alors qu’on voyait pendre à la boutique d’un marchand de vin une bouteille grosse comme celles que Rabelais a mises dans les mains de Gargantua, et à la boutique d’un cordonnier une botte énorme, telle qu’en portaient les ogres des contes de fées. On aperçoit encore, sur quelques grands murs nus, qui attendent le moment où ils seront cachés par de hautes constructions, les derniers échantillons de ces immenses affiches: A la Redingote grise, avec l’image grandiose de la fameuse redingote du Petit Caporal, c’est un marchand d’habits; A la Vigne de la Terre promise, avec un cep de vigne chargé de grappes de raisin qui donneraient chacune de{443} quoi remplir un litre, c’est un marchand de vin; Au Chapeau rouge, avec le modèle de ce chapeau à larges bords qui coifferait bien une des statues assises de la place de la Concorde, c’est un chapelier. Cette bigarrure d’affiches peintes d’une façon presque indélébile, à des hauteurs prodigieuses, partout où un mur nu leur a permis de se déployer, aurait bientôt fait de Paris la ville des enseignes colossales, si l’affiche illustrée, de petite dimension, en noir et en couleurs, n’était venue mettre les annonces des marchands à la portée des yeux du passant, dans toutes les rues où la paroi d’une muraille libre pouvait être conquise et louée par l’afficheur.
Il y a bien cinquante ans que ce système d’affiches marchandes a été inauguré à Paris, d’abord avec une extrême réserve, et surtout au profit de la librairie, qui annonçait ainsi ce qu’elle nommait des nouveautés. La plupart des affiches étaient en noir, avec des gravures sur bois; plus tard, les dessins dont elles étaient ornées furent coloriés au pinceau, et, à une époque plus rapprochée, ce coloriage se fit avec des tampons d’imprimeur; puis, enfin, avec le secours de la lithographie en couleurs.
Aujourd’hui, ces chromo-lithographies qu’on affiche sur les murs sont de véritables enseignes qui ont l’apparence de gouaches et d’aquarelles.
Nous ne saurions mieux faire apprécier l’intérêt et la curiosité de ces tableaux de papier peint qu’en décrivant, d’après un article de journal (le Petit Parisien, 20 janvier 1883), la singulière et splendide collection d’affiches illustrées que M. Dessolier est parvenu à réunir dans vingt volumes in-folio maximo, contenant plus de 7 000 pièces,{444} divisées en trois séries: la première comprend les affiches relatives aux publications de librairie; la seconde, les affiches des théâtres, bals et concerts; la troisième, qui n’est pas la moins intéressante, les affiches-enseignes du commerce et de l’industrie. On peut imaginer les efforts d’intelligence, de patience et d’adresse qu’il a fallu mettre en œuvre pour rassembler, depuis quarante ans, une pareille collection, qui, nous l’espérons, viendra un jour prendre sa retraite à la bibliothèque de la Ville.
«Les premières affiches illustrées, dit le Petit Parisien, collectionnées par notre héroïque amateur, ne remontent pas au delà de 1830. Il possède les affiches dessinées par Raffet, pour le Némésis et le Napoléon en Égypte, de Barthélemy et Méry; pour le Compagnon du tour de France, de George Sand; pour une Bible, pour l’Algérie ancienne et moderne. Il y a des affiches, dessinées par Tony Johannot, par Meissonier (avec grandissement, par Gavarni); par Célestin Nanteuil, pour Robert Macaire et Don César de Bazan; par Manet, par Félix Braquemont, ainsi que toutes les ravissantes fantaisies de Chéret, aujourd’hui le maître triomphant de l’affiche d’art, illustrée et coloriée.
»Cette collection, où la Confiturerie Saint-James et les Machines à coudre coudoient les plus délicieuses excentricités de Chéret et de Grévin, donne d’innombrables renseignements sur les mœurs, les costumes, les voyages, les succès d’un jour, les spectacles, les modes, les plaisirs, les préoccupations, les caprices quotidiens, les folies sociales et politiques de Paris depuis un demi-siècle.»
Le journaliste, dans la piquante énumération de ces affiches, n’a oublié que les enseignes des marchands, qui{445} figurent aussi avec éclat dans la précieuse et originale collection de M. Dessolier.
Quant aux enseignes de Paris, peintes ou sculptées, que les démolitions successives de tant de vieilles maisons ont fait recueillir, quelques-unes ont été transportées au musée Carnavalet. Notre ami M. Jules Cousin a bien voulu en faire pour nous un petit catalogue descriptif et raisonné, qui formera l’Appendice naturel de l’Histoire des Enseignes de Paris.{447}{446}
APRÈS le Musée des enseignes, qui fait l’objet de notre vingt-neuvième chapitre, venons aux enseignes des musées.
Aujourd’hui que le goût des choses du passé s’est largement développé, par un sentiment général de réaction contre le vandalisme aveugle qui a promené à travers Paris la pioche municipale d’abord et ensuite la flamme de la Commune,—à peu près aussi criminelles l’une que l’autre aux yeux de l’archéologue et du vrai Parisien,—il n’est si vulgaire souvenir d’autrefois qui ne passe à l’état de relique et n’excite l’intérêt des curieux. Le nouveau musée Carnavalet, spécialement consacré à l’histoire de Paris, ne pouvait négliger les anciennes enseignes, malheureusement bien rares déjà quand on commença à le former. Les démolis{448}seurs de la noble cité se préoccupaient médiocrement de ces pauvres enseignes et même des monuments historiques plus importants; pourvu que les grandes voies stratégiques s’ouvrissent et que les millions vinssent remplir la caisse des spéculateurs, tout était pour le mieux dans le nouveau Paris uniforme et maussade qu’ils avaient rêvé, et qu’ils ont malheureusement réalisé. Pardonnons-leur, mes frères, car ils n’ont jamais su ce qu’ils faisaient!
Le principal instigateur de ce grand massacre du passé eut pourtant un semblant de remords, inspiré sans doute par les lamentations de ces nomades de Parisiens et par les observations des quelques athéniens égarés dans son entourage, auxquelles d’ailleurs il ne comprenait rien. «Les gens de qualité s’intéressent-ils à ces petites drôleries? demanda-t-il entre deux adjudications.—Oui, monsieur le baron.—Je m’y intéresserai donc.» Et c’est ainsi que fut institué le musée historique municipal, destiné à recueillir les épaves de la grande dévastation.
Ce musée—assez mal dirigé d’ailleurs à ses débuts, et que MM. Ferdinand Duval et Hérold durent ramener dans la bonne voie par un vigoureux coup de balai—recueillit de 1867 à 1870, dans le chaos des démolitions, quelques enseignes curieuses.
Deux ou trois seulement avaient auparavant trouvé asile à l’hôtel de Cluny. Ce sont:
La Truie qui file, de la rue de la Cossonnerie, petit bas-relief du XVIᵉ siècle en pierre peinte, et les Trois Barbeaux, de la rue Saint-Germain-l’Auxerrois, belle enseigne du XVIIᵉ siècle, dont nous avons déjà parlé ci-dessus, p. 392 et 397.{449}
Nous ne savons de quelle maison provient une autre enseigne en fer repoussé, donnée au même musée par M. Mathieu Meusnier; elle représente, dans un encadrement formé de rinceaux et de figures chimériques, les outils du tonnelier.
La collection d’enseignes conservées à Carnavalet est beaucoup plus riche.
Nous avons déjà mentionné et représenté la Fontaine de Jouvence (p. 41), le Chapeau fort (p. 223), le Chat noir, de la rue Saint-Denis, enseigne de la maison où, dit-on, est né Eugène Scribe, souvenir qui lui donne plus de prix que la renommée de sa confiserie.
Une autre très jolie enseigne de la rue Saint-Denis, nº 77, vient d’être offerte au musée par le propriétaire, M. Faynaud, en train de reconstruire sa maison; c’est l’Éducation de la Vierge, charmant bas-relief de la fin du XVIᵉ ou du commencement du XVIIᵉ siècle, qui décorait le trumeau central du premier étage, entre les deux fenêtres de l’étroite façade. La Vierge enfant, malheureusement décapitée, épelle sur un livre tenu par sainte Anne, sa mère.
L’enseigne du Puits de Rome, jadis rue Phélipeaux, se voit à l’entrée de la bibliothèque; le puits et l’inscription sont tracés en or sur une plaque de marbre noir:
Dans l’escalier de dégagement de l’ancien Bureau des Drapiers, réédifié au fond du jardin, ont été groupées les autres enseignes, presque toutes en fer repoussé. Il est regrettable que l’on n’ait pas pris note de la provenance en temps utile;{450} il serait aujourd’hui fort difficile de la constater, à moins de faire appel aux souvenirs de ceux qui ont pu les voir en place il y a quelque vingt ans. Avis aux visiteurs du musée.
Voici d’abord quatre enseignes de serruriers particulièrement soignées, car le maître forgeait son enseigne lui-même, et tenait à donner par là un échantillon avantageux de son talent:
1º Très belle potence fleuronnée, formée de rinceaux sortant d’une corne d’abondance, mêlés de feuillages et de cartouches très compliqués; une grande clef, également ornée, pend à l’extrémité de la tige.{451}
2º Une autre clef suspendue à une potence, dans le même genre, mais plus simple et plus petite.
3º Deux clefs passées en sautoir et surmontées d’une couronne de fleurs de lis.
4º Enfin deux clefs dorées ordinaires.
Ces quatre enseignes paraissent dater du XVIIIᵉ siècle.
Serait-ce encore un serrurier qui aurait pris pour enseigne ce grand cadran d’horloge en fer forgé et ajouré, au-dessous duquel flambe un cœur couronné? La devise devait être: A l’Exactitude. L’exactitude est de tous les métiers; et ce grossier cadran de fer qui n’offre aucune trace de dorure ne conviendrait guère à un horloger. Il paraît être du XVIIᵉ siècle.
Du même temps serait ce casque largement empanaché qui rappelle celui de l’ancienne statue de Louis XIII, sur la place Royale, et les galantes coiffures des Romains du carrousel de 1662 ou des héros d’opéra. Cette enseigne de heaumier armurier pourrait bien être contemporaine du Grand Cyrus; mais nous doutons fort qu’elle provienne de Paris, où nous l’aurions certainement remarquée avant sa mise au rebut.
Nous reconnaissons, par exemple, les Trois Rats (p. 90), et le profil du Grand Necker coiffé de la perruque dite à queue de rat. Loin de nous la pensée malséante d’établir une comparaison quelconque entre ces rongeurs et le ministre populaire des beaux jours de 89. Nous trouvons même assez irrévérencieux que cette illustre tête ait servi d’enseigne à un perruquier.
Nous préférons de beaucoup pour cet usage la Perruque à marteaux peinte sur une plaque de tôle qui figure tout à{452} côté. Le sens n’est pas douteux et le modèle est plus rare, la simple peinture ne résistant pas, comme le relief, aux intempéries de la rue.
Voici un grand éperon à chaîne, du XVIIᵉ siècle, propre à figurer, à côté du casque ci-dessus mentionné, à la porte d’un éperonnier; nous doutons aussi de son origine parisienne; il nous paraît trop remarquable pour n’avoir pas attiré l’attention sur place.
Autant en dirai-je de cette enseigne classique en forme de bannière, suspendue à sa belle potence fleuronnée du commencement du XVIIᵉ siècle. La bordure est élégamment ajourée dans le goût flamand, elle représente d’un côté, en peinture sur fond d’or, saint Jean-Baptiste accompagné de l’agneau pascal; de l’autre, les outils du métier de foulon: une cuve, une presse à drap et un fouloir. Cette belle en{453}seigne aurait été, dit-on, retrouvée dans un grenier; mais on ne peut désigner la maison. Je la croirais plutôt sortie de la boutique d’un marchand de bric-à-brac, qui aura eu la bonne fortune de la récolter dans quelque tournée de province.
Je reconnais, au contraire, sans qu’il soit besoin d’en préciser l’origine, les enseignes ordinaires de nos marchands de vin:
Ici le Bon Coing doré et appétissant; là le Gros Raisin ou la Belle Grappe enclos dans une couronne de pampres.
Voici la Fontaine de Bacchus: trois futailles superposées coulant vermeil dans une large cuve; le tout se détache sur un fond composé de deux flèches en sautoir, enguir{454}landées de pampres et surmontées d’une tête de Silène. Jolie composition en fer repoussé et colorié.
Un peu plus haut, ce petit Bacchus en bois ou en plâtre doré, à cheval sur un baril, est tout moderne. Il provient du fameux cabaret du Lapin blanc de la rue aux Fèves, illustré par Eugène Sue, ou plutôt d’après Eugène Sue; car il est constant qu’à l’époque de la publication des Mystères de Paris la rue aux Fèves, si elle recélait plusieurs tapis-francs, n’en possédait aucun à l’enseigne du Lapin blanc. Un Méridional, le père Mauras, eut l’idée d’exploiter la popularité du roman, et fonda après coup, dans ladite rue, un cabaret du Lapin blanc, auquel il ne fallut pas dix ans d’existence pour devenir authentique. Le cabaretier montrait jusqu’à la cave où s’étaient passées les scènes les plus palpitantes de la chronique du prince Rodolphe et de la tendre Goualeuse. La clientèle y croyait et les étrangers y venaient voir. Il ne fallut rien moins que la démolition de toute la Cité, en 1860, pour démolir en même temps la légende devenue authentique; le père Mauras essaya vainement de la transplanter, avec ses tables et son comptoir, dans le quartier Sainte-Geneviève, où elle ne put reprendre racine. M. Heuzey, ancien acteur des Variétés, qui avait connu les êtres, a raconté la chose par le menu dans son Histoire de la Cité. Elle valait la peine d’être notée ici.
Voici encore la Gerbe d’Or, accostée de deux bouquets d’épis. Nous en avons parlé plus haut; elle a toujours de nombreux similaires dans différents quartiers de Paris, non seulement chez les boulangers, mais chez les orfèvres, joailliers, etc.
Le Petit Moine et le Petit Lion se valent comme plastique;{455} l’un n’a pas l’air moins rébarbatif que l’autre; le premier égrène dévotement son chapelet, le second passe fièrement, la tête de face, léopardé en terme de blason.
Voici le Bras d’Or commun; un vigoureux biceps tendu horizontalement.
Puis une autre paire de bras plus intimes, rentrant dans la catégorie des enseignes en rébus: Aux Bras croisés; un bras d’homme habillé et un bras de femme découvert, croisés en sautoir.
Nous aurons terminé cette rapide revue quand nous aurons indiqué, dans la salle de la Révolution, un navire en fer repoussé, sur champ de gueules, qui pourrait bien être une enseigne des Armes de Paris (XVIIIᵉ siècle); et un fort curieux poteau du XVIᵉ siècle, en chêne sculpté, provenant d’une maison du faubourg Saint-Honoré.
Est-ce une enseigne ou un simple blason de communauté? Ce poteau carré était-il primitivement à l’extérieur ou à l’intérieur du bâtiment?
Quoi qu’il en soit, il nous appartient de droit, car la sculpture, fort élégante et du plus pur style Henri II, représente, soutenu par un enlacement de lauriers, un écusson chargé d’une paire de ciseaux ouverts, cantonnée en chef d’une fleur de marguerite, en flanc et en pointe de trois croissants. Ce sont, à très peu près, les armoiries des tailleurs de robes de la ville et faubourgs de Paris, et il n’est{456} pas téméraire de supposer qu’à un moment cette galante corporation, parisienne entre toutes, ait remplacé les simples houppettes de passements qui accompagnaient les ciseaux ouverts de ses armoiries[308] par les croissants du Roi et la fleur symbolique de la princesse Marguerite.
FIN{457}
| Pages. | ||
| Introduction | ||
| Origine des enseignes dans l’antiquité | 1 | |
| I. | Jurisprudence et police des enseignes à Paris | 11 |
| II. | Origines des enseignes en France, inscriptions et monogrammes, enseignes des maisons et des hôtels | 27 |
| III. | Enseignes des marchands, du XIIIᵉ au XVIᵉ siècle | 47 |
| IV. | Noms des rues, provenant de leurs enseignes | 66 |
| V. | Enseignes sculptées, forgées, émaillées; enseignes en pierre, en bois, en plomb, en fer, en terre cuite, en émaux ou faïence | 79 |
| VI. | Enseignes d’encoignure, ou poteaux corniers | 100 |
| VII. | Enseignes des corporations, des confréries et des métiers | 107 |
| VIII. | Enseignes des hôtelleries et des auberges | 121 |
| IX. | Enseignes des cabarets et des marchands de vin | 138 |
| X. | Enseignes des barbiers, des étuvistes, des chirurgiens, des apothicaires et des médecins | 151 |
| XI. | Enseignes des imprimeurs et des libraires | 162 |
| XII. | Enseignes des académies, des théâtres, des lieux publics, des tripots et des mauvais lieux | 180 |
| XIII. | Les vieilles enseignes | 191 |
| XIV. | Enseignes historiques et commémoratives | 201 {458} |
| XV. | Enseignes satiriques et épigrammatiques | 218 |
| XVI. | Enseignes de sainteté et de dévotion | 229 |
| XVII. | Anecdotes sur quelques enseignes | 242 |
| XVIII. | Enseignes armoriées | 256 |
| XIX. | Enseignes en rébus | 269 |
| XX. | Enseignes à inscriptions, à proverbes, à devises et enseignes imaginaires | 279 |
| XXI. | Enseignes singulières, grotesques, ridicules | 288 |
| XXII. | Les enseignes-adresses des marchands | 297 |
| XXIII. | Le jeu des enseignes de Paris | 313 |
| XXIV. | Enseignes avec inscriptions en vers | 323 |
| XXV. | Enseignes relatives à des pièces de théâtre | 337 |
| XXVI. | Les enseignes pendant la Révolution | 352 |
| XXVII. | Les enseignes au XIXᵉ siècle | 366 |
| XXVIII. | Imagiers et peintres d’enseignes | 390 |
| XXIX. | Musée des enseignes | 404 |
| XXX. | Orthographe des enseignes | 421 |
| XXXI. | Déchéance des enseignes et règne des affiches | 432 |
| Appendice. Les enseignes du Musée Carnavalet | 447 | |
PARIS.—IMPRIMERIE CHAIX (S.-O.).—14040-4.{460}{459}
LIBRAIRIE DE E. DENTU
DU MÊME AUTEUR
| L’Esprit des Autres, recueilli et raconté, 6ᵉ édit., 1 vol. in-18 elzévir | 5 | » |
| L’Esprit dans l’Histoire, recherches et curiosités sur les mots historiques. 4ᵉ édit., 1 vol. in-18 elzévir | 5 | » |
| Le Vieux-Neuf, histoire ancienne des découvertes modernes, nouvelle édition, 3 vol. in-18 | 15 | » |
| Paris-Capitale, 1 vol. in-18 | 3 | 50 |
| La Comédie de Jean de La Bruyère, 2 vol. in-16 | 6 | » |
| Histoire du Pont-Neuf, 2 vol. in-16 | 6 | » |
| Le Mystère de Robert le Diable, 1 vol. grand in-18 | 3 | 50 |
LIVRES D’AMATEURS
| Arsène Houssaye.—Molière, sa Femme et sa Fille, 1 vol. in-folio, illustré de gravures et eaux-fortes 1 | 00 | » |
| —Histoire du 41ᵉ Fauteuil de l’Académie française, nouvelle édition, ornée de portraits, 1 vol. in-8º, sur papier vergé de Hollande | 20 | » |
| Edmond et Jules de Goncourt.—Sophie Arnould, d’après ses mémoires et sa correspondance, 1 vol. petit in-4º, avec portraits et fac-similé | 10 | » |
| —L’Amour au XVIIIᵉ siècle, 1 vol. in-16, avec eaux-fortes | 10 | » |
| —La Saint-Huberty, d’après ses mémoires et sa correspondance, par Ed. de Goncourt, 1 vol. in-16, avec vignettes et eaux-fortes | 8 | » |
| Jules Claretie.—Un enlèvement aux XVIIIᵉ siècle, d’après des documents tirés des Archives nationales, 1 vol. in-16, avec eaux-fortes de Lalauze | 10 | » |
| Champfleury.—Le Violon de faïence, nouvelle édition, 1 vol. in-8º, avec illustrations en couleurs 2 | 5 | » |
| —Histoire de la Caricature, 5 vol. gr. in-18 jésus, orné de 500 vign. | 25 | » |
| —Henry Monnier, sa Vie et son Œuvre, 1 vol. in-8º, orné de 100 gravures, fac-similé | 10 | » |
| —Les Vignettes romantiques, histoire de la littérature et de l’art de 1825 à 1840, 1 vol. gr. in-8º jésus, orné de 150 gravures, fac-similé | 50 | » |
| Emmanuel Gonzalès.—Les Caravanes de Scaramouche, suivies de Giangurgolo et de Maître Rageneau, avec une préface par Paul Lacroix, 1 vol. in-16, avec vignettes et eaux-fortes, encadrement en couleur | 10 | » |
| Catulle Mendès.—Pour lire au bain, avec 150 dessins de Besnier, 1 vol. petit in-8º | 10 | » |
| Auguste Saulière.—Ce qu’on n’ose pas dire, 1 vol. gr. in-18 jésus, orné de 50 vignettes et 10 eaux-fortes de Henry Somm | 10 | » |
| Henri Monnier.—Scènes populaires dessinées à la plume, nouvelle édition, illustrée de 80 dessins de l’auteur, 2 v. in-8º de chacun 650 pages | 20 | » |
| Charles Vincent.—Chansons, Mots et Toasts, précédés d’un Historique du Caveau par E. Dentu, 1 vol. in-8º, avec portraits et vignettes à l’eau-forte par Le Nain | 10 | » |
EN PRÉPARATION
Le Nouveau Decaméron, par les plus illustres conteurs de notre temps, dix journées, ornées de vignettes et eaux-fortes, par les principaux artistes.
PARIS, IMPRIMERIE CHAIX (S.-O.).—14414-4.
FOOTNOTES:
[1] Ferienschriften (Écrits rédigés pendant les vacances). Fribourg, 1826.
[2] 23ᵉ question du livre V des Symposiaques, ou Propos de table.
[3] Voyage en Grèce, par Pierre Lebrun, 1824, in-8º.
[4] Histoire des hôtelleries, cabarets, etc., par Francisque Michel et Édouard Fournier. Paris, 1854, gr. in-8º, t. Iᵉʳ, p. 49.
[5] Dictionnaire des Antiquités romaines, par Antony Rich, traduit par Cheruel. Paris, Firmin Didot, 1861, verbo Insigne.
[6] Rutilius Numantianus, Itinerarium.
[7] Ferussac, Bulletin des sciences historiques, t. XVIII, 1831, p. 348.
[8] Historia naturalis, lib. XXXV, cap. 37.
[9] Cicero, de Oratore, lib. II, 66.
[10] Horat., Satir., lib. II, 7.
[11] Quintil., Inst. orat., VI.—Dezobry, Rome au siècle d’Auguste, 3ᵉ édit., 1870, t. Iᵉʳ, p. 169.
[12] Grævius, t. III, 30, et XII, 396.—Aringhi, Roma subterranea, II, 19.—Galsano Volpi, Vetus Latium, VI, 160.
[13] Mariæ Turgii, Notæ ad inscriptionem Ursi togati.
[14] Dom Martin, la Religion des Gaulois, liv. Iᵉʳ.
[15] Miscellanea eruditæ antiquitatis, cura et studio J. Sponii. Lugduno, 1685, in-fol., p. 199.
[16] Breton, Pompeia.—Mazois, les Ruines de Pompéi, in-fol., t. II.—Recherches historiques sur les enseignes, par de La Querrière. Rouen, 1852, in-8º, p. 2 et 3.
[17] Persius, satir. I.—Dict. des Antiquités romaines et grecques, par Rich, trad. par Cheruel, au mot Anguis.
[18] Voy., outre les ouvrages cités:—Dictionnaire des arrêts, par P.-J. Brillon. Paris, 1727, in-fol., t. III, au mot Enseigne.—Dictionnaire universel de police, par Des Essarts. Paris, 1787, in-4º, t. III, au même mot.
[19] Inventaire sommaire des Archives hospitalières, 1870, in-4º, p. 171, nº 2577.
[20] Levasseur, Histoire des Classes ouvrières en France. Paris, Guillaumin, 1859, t. II, p. 35.
[21] Le bon François, au véritable Mazarin déguisé sous le nom de Franc bourgeois de Paris. Paris, Nicolas Vivenay, 1651, in-4º. Voyez la Bibliographie des Mazarinades, par Moreau. Paris, Renouard, 1850, 3 vol. in-8º, t. Iᵉʳ, p. 180, nº 586.
[22] Lettres de Guy Patin, édit. de Reveillé-Parise. Paris, Baillière, 1846, 3 vol. in-8º, t. III, p. 625.
[23] Lettre du 2 novembre 1669.
[24] Levasseur, Histoire des Classes ouvrières en France, t. II, p. 33.
[25] Et, au contraire, une ordonnance de Henri II, de 1556, prescrivait—pour la confusion des hérétiques—qu’au lieu d’enseigne, chaque propriétaire mettrait sur le portail de sa maison l’image d’un saint.
[26] De la Mare, Traité de la Police, continué par Lecler de Brillet, t. IV, p. 332-37.
[27] Dictionnaire universel de Commerce, etc., par Jacq. Savary des Brullons. Paris, Estienne, 1723, 2 vol. in-fol., article Enseignes.
[28] Traité de la Police, continué par Lecler de Brillet, t. IV, p. 422.
[29] Voyage de Lister à Paris en 1698, traduit pour la première fois, publié et annoté par la Société des Bibliophiles français. Paris, 1872, gr. in-8º, p. 30.
[30] Chronique de la Régence et du règne de Louis XV, ou Journal de Barbier, première édition complète. Paris, Charpentier, 1857, in-12, t. VII, p. 416.
[31] Voir le chapitre LXVI, t. Iᵉʳ du Tableau de Paris, de Mercier.
[32] La Poix de Freminville, Dictionnaire ou Traité de Police générale. Paris, 1769, in-4º, p. 304 et 305.
[33] Institutiones oratoriæ, VI, 3, 28.
[34] Le Livre des Proverbes français, par Le Roux de Lincy. Paris, Ad. Delahays, 1859, 2 vol. in-12, t. II, p. 166.
[35] Publié par H. Géraud, dans la collection des Documents inédits. Paris, Imp. royale, 1837, in-4º.
[36] Plusieurs archéologues ont cru pourtant reconnaître la désignation d’une enseigne de maison dans cette mention que la Taille de 1392 a faite d’une petite marchande: «Agnès de la Lanterne, regratière.» On sait, en effet, qu’en 1411 il y avait une maison de la Lanterne dans la rue des Marmousets.
[37] Publié, par Buchon, dans la Collection des Chroniques nationales françaises, t. IX.
[38] Revue archéologique (livraisons du 1ᵉʳ avril et du 1ᵉʳ juin 1860).
[39] Dans la collection de Documents sur l’histoire de Paris, publiée sous les auspices du Conseil municipal. Région du Louvre et des Tuileries, t. Iᵉʳ. Paris, Impr. impér., 1866, in-4.
[40] Ad. Berty, Topographie historique du vieux Paris, t. Iᵉʳ, p. 47 et suiv.
[41] Voir ci-après le chapitre III.
[42] Ces renseignements sont tirés d’une savante notice, encore inédite, de M. le docteur Chéreau, sur Jacques Coictier et sa famille.
[43] Description historique de la ville de Paris, par Piganiol de la Force, 1765, t. VII, p. 64.
[44] Le Philologue, par J.-B. Gail. Paris, Gail neveu, 1819, t. VI, p. 96 et 97.—Le même, t. IX, p. 101 et suiv., p. 119.
[45] Œuvres de Brantôme, les Dames illustres, édit. de la Haye, 1740, t. Iᵉʳ, p. 60 et suiv.
[46] Voir, à ce sujet, les Enigmes des rues de Paris. Paris, E. Dentu, in-18, 1860, p. 280-285, et l’Esprit dans l’histoire, 5ᵉ édit., p. 158.
[47] Histoire et Recherches des Antiquités de la ville de Paris, par Henri Sauval, 1733, 3 vol. in-fol., t. II, p. 358.
[48] Revue universelle des Arts, publiée par Paul Lacroix (bibliophile Jacob). Paris et Bruxelles, 1855, t. Iᵉʳ, gr. in-8º, p. 390-91.—Une notice explicative imprimée chez Lahure fut affichée sur la maison même en 1855. Elle est reproduite in extenso dans la Revue d’architecture de César Daly, t. XIII, col. 202.
[49] Voir un article de M. Firmin Maillard, intitulé: les Enseignes, qui a paru dans le Journal de Paris, nº du 1ᵉʳ octobre 1869.
[50] Voir ci-après les chapitres VIII et IX.
[51] Voir ci-après le chapitre VII.
[52] Revue archéologique, nº du 1ᵉʳ avril 1860, p. 203 et suiv., et du 1ᵉʳ juin, p. 66 et suiv.
[53] Topographie du vieux Paris, par Ad. Berty. Quartier du Louvre. Paris, Imp. impériale, 1866, grand in-4º, t. Iᵉʳ, p. 18 et suiv.
[54] Outre les deux feuilles du Louvre et le fragment des trois îlots de la Cité, Ad. Berty a laissé à peu près achevées deux feuilles de son admirable plan archéologique de Paris antérieur au XVIᵉ siècle, dans lesquelles sont indiquées toutes les enseignes de la partie centrale de la Cité et de l’Université. Il serait monotone de les détailler ici rue par rue; nous en donnerons en appendice l’inventaire général alphabétique.
[55] Voir ci-après le chapitre XVIII.
[56] Bibliographie artistique, historique et littéraire de Paris avant 1789, par l’abbé Valentin Dufour. Paris, A. Laporte, 1882, in-8, p. 290.—Ajoutons que les balanciers n’ont pas encore déserté ces parages et qu’un peu plus haut, dans la même rue, existe un magasin à l’enseigne du P couronné qui, toutefois, est moins ancienne, ne datant que de 1779.
[57] Cette pièce, sans lieu ni date, se compose de huit feuillets petit in-8º gothique. Elle a été mise en langage plus moderne, mais avec bien des fautes, dans une réimpression faite, à Rouen, en 1630. Dans l’analyse détaillée que nous allons en faire, nous rajeunirons le texte et l’orthographe, pour faire mieux comprendre les noms des enseignes et la place qu’elles occupaient dans les rues de Paris, à la fin du XVᵉ siècle.
[58] La Bibliothèque nationale possède un ancien manuscrit (nº 4681), dont le titre est différent de l’imprimé; voici ce titre: Cy ensuit un esbatement du mariage des IIII fils Hémon, où les enseignes de plusieurs hôtels de la ville de Paris sont nommées. C’est le texte de ce manuscrit que A. Jubinal a reproduit dans les Mystères inédits du quinzième siècle (Paris, Techener, 1837, in-8º, t. 1ᵉʳ, p. 369).
[59] «La plupart des enseignes que nous venons de citer d’après le fabliau des Fils Hémon, dit Amédée Berger, se retrouvent dans les Comptes de la Prévôté de Paris, des années 1399 à 1573, recueillis et publiés par Sauval, à la fin de son dernier volume.» Recherches sur les Enseignes (Journal des Débats du 25 mai 1858).
[60] Traité de la Police, in-folio, t. IV (1738), p. 347.
[61] Nous empruntons cette nomenclature au Dictionnaire historique de la Ville de Paris, par Hurtaut et Magny, qui l’ont eux-mêmes extraite de Jaillot. Paris, Moutard, 1779, 4 vol. in-8º, t. IV, de la page 259 à la page 499. Nous avons marqué seulement d’un astérisque les noms de rue qui subsistent encore depuis la dernière classification des voies publiques de la capitale.
[62] Dictionnaire topographique, historique et étymologique des Rues de Paris, par J. de La Tynna, deuxième édition. Paris, Smith, 1816, in-12.
[63] Histoire et Recherches des Antiquités de Paris, par Henri Sauval. Paris, 1724, in-folio, t. Iᵉʳ, p. 126.
[64] Sauval, Histoire et Recherches des Antiquités de Paris, 1724, in-folio, t. Iᵉʳ, p. 285.
[65] Histoire et Recherches des Antiquités de Paris, par H. Sauval, 1724, t. III, p. 372.
[66] Recherches critiques, historiques et topographiques sur la Ville de Paris, par J.-B.-M. Jaillot, 1772-75, quartier de l’Université.
[67] Les Enseignes de Paris, feuilleton de la Presse du 21 juillet 1856.
[68] Dictionnaire étymologique de la Langue françoise, 1669, in-folio, au mot Calandre.
[69] Histoire et Recherches des Antiquités de Paris, 1724, t. Iᵉʳ, p. 121.
[70] Recherches sur les Enseignes de Paris, par Amédée Begrer, dans le Journal des Débats, 25 mai 1858.
[71] Voir ci-dessus, chap. II, p. 41, où cette enseigne est représentée.
[72] Topographie historique du vieux Paris, par A. Berty. Région du faubourg Saint-Germain. Imprimerie nationale, 1876, in-4º, p. 164, où l’on trouve la reproduction de l’enseigne, d’après une photographie.
[73] De l’autre côté de la Seine, au nº 70 du quai de l’Hôtel-de-ville, se trouve une enseigne d’un genre particulier et que nous croyons unique à Paris; c’est celle du Loup botté: un de ces animaux, empaillé et énorme, et chaussé de bottes, monte la garde devant la boutique d’un cordonnier.
[74] Voir chap. XVII, Anecdotes sur les enseignes.
[75] Les Enseignes de Paris, par l’Homme qui lit, 2ᵉ article dans le Gaulois du 8 juillet 1877.
[76] Journal de Jean Heroard, sur l’enfance et la jeunesse de Louis XIII, publ. par Eud. Soulié et Ed. de Barthélemy. Paris, Firmin Didot, 1868, t. Iᵉʳ, p. 190.
[77] Recherches sur Molière et sa famille, par Eud. Soulié. Paris, Hachette, 1863, in-8º, p. 12.
[78] Histoire de la vie et des œuvres de Molière, par J. Taschereau, troisième édition. Paris, J. Hetzel, 1844, in-12, p. 206.
[79] Le Roman de Molière, par Édouard Fournier. Paris, E. Dentu, 1863, in-12, p. 174.
[80] Manuscrits de Beffara, à la Bibliothèque nationale, t. III, p. 144. Voir, sur ce poteau cornier, les articles 219 et 220 de l’Iconographie moliéresque, par Paul Lacroix. Paris, Fontaine, 1876, in-8º, p. 62 et 63.
[81] Dictionnaire raisonné de l’Architecture française. Paris, Morel, 1864, gr. in-8º, t. VII, p. 475.
[82] Les Rues et les Cris de Paris au XIIIᵉ siècle, précédé d’une étude sur les rues de Paris au XIIIᵉ siècle, par Alfred Franklin. Paris, Léon Wilhem, 1874, in-12, pp. 38 et suiv.
[83] Le Dit des Rues de Paris (1300), par Guillot de Paris, avec préface, notes et glossaire, par Edgard Mareuse. Paris, Librairie générale, 1875, in-12.
[84] Le Calendrier des Confréries de Paris, par S.-B. Le Masson, avec des notes, par l’abbé Valentin Dufour. Paris, Léon Willem, 1875, in-12, pp. XXVI et suiv.
[85] Topographie historique du vieux Paris, par Adolphe Berty. Région du Louvre et des Tuileries. Paris, Imprimerie impériale, 1866, in-4º, t. Iᵉʳ.—Continuée par H. Legrand. Ibid., id., 1868, in-4º, t. II.—Région du faubourg Saint-Germain, par A. Berty; complétée par L.-M. Tisserand. Paris, Imprimerie nationale, 1876, in-4º.
[86] Revue archéologique, livraisons des 1ᵉʳ avril et 1ᵉʳ juin 1860.
[87] Histoire des Antiquités de la ville de Paris, 1724, t. III, p. 57.
[88] La Truie qui file, des Halles, qui est citée dans le Mariage des quatre fils Hémon et des filles de Damp Simon (voir ci-dessus, p. 63), était certainement le type le plus ancien de cette enseigne légendaire. Il y avait à Paris plusieurs autres enseignes sculptées analogues, entre autres rue Saint-Antoine. Nous avons donné le dessin de cette dernière, qu’on voit encore à sa place et qui doit reproduire assez exactement l’enseigne primitive du marché aux Poirées, quoique la sculpture soit de la fin du XVIᵉ siècle.
[89] Cette enseigne en rébus est représentée par une gravure en bois, dans la plupart des éditions des Bigarrures du seigneur des Accords (Étienne Tabourot).
[90] Les mêmes Antiquités de Paris, t. III, p. 309, 347, 367.
[91] Sauval, t. II, p. 619.
[92] Tableau de Paris, nouvelle édition augmentée. Hambourg et Neuchâtel, 1782, in-12, t. Iᵉʳ, p. 118.
[93] Rappelons, à ce propos, les figures colossales, non plus à poste fixe, mais roulantes, qu’on a vues depuis une vingtaine d’années circuler dans les rues de Paris, représentant qui un chapeau, qui une botte, une marmite, ou un homme, dans le ventre duquel est installé le siège du cocher, etc. Certaines sont même éclairées à l’intérieur pour la nuit. Rue de Rivoli, près la rue du Pont-Neuf, on voit un gigantesque planteur américain coiffé d’un large chapeau de paille, qui sert d’enseigne à la porte d’un marchand de ce genre de coiffures.
[94] Les Enseignes de Paris, par Amédée Berger (Journal des Débats, 1ᵉʳ juin 1858).
[95] Histoire des Hôtelleries, Cabarets, etc., par Francisque Michel et Édouard Fournier. Paris, 1854, 2 vol. gr. in-8º, t. II, p. 224.
[96] Voir Sauval, La Tynna, Lacurne de Sainte-Palaye.
[97] Tome Iᵉʳ de l’édition gothique de Verard, sans date, les Chroniques de France, d’Angleterre et de Bourgogne, chap. CXV, CLXXVII, etc.
[98] Histoire des Antiquités de Paris, par H. Sauval, t. III, p. 284.
[99] Tome IV, chap. XXIV de l’édition gothique, sans date.
[100] Histoire des Antiquités de Paris, t. II, p. 92 et 93.
[101] Registre criminel du Châtelet de Paris, du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392, publié pour la première fois par la Société des Bibliophiles français. Paris, 1861-62, 2 vol. gr. in-8º.
[102] Voir, à la suite des Poésies de François Villon, le Recueil des histoires de repues franches, composé par un de ses élèves.
[103] Histoire des Antiquités de Paris, par Sauval, t. Iᵉʳ, p. 126.
[104] Histoire des Français des divers États, par A.-A. Monteil. Paris, Victor Lecou, 1833, in-12, t. IV, p. 94.
[105] Ce monologue, qui fait partie d’un manuscrit du XVIᵉ siècle décrit dans le Catalogue du duc de la Vallière, sous le nº 3304 (aujourd’hui à la Bibliothèque nationale), a été publié, par Francisque Michel et Leroux de Lincy, dans le Recueil de farces, moralités, sermons joyeux, etc. Paris, Techener, 1831-37, 4 vol. pet. in-8º.
[106] Histoire des Hôtelleries, Cabarets, etc., par Francisque Michel et Édouard Fournier. Paris, 1854, gr. in-8º, t. Iᵉʳ, p. 263.
[107] Voir ses Mémoires, p. 71 et 72, dans la collection des Mémoires pour servir à l’histoire de France, publiés par Michaud et Poujoulat.
[108] Journal d’un Voyage à Paris en 1657-58, publié par A.-P. Faugère. Paris, Benjamin Duprat, 1862, in-8º, p. 30 et suiv.
[109] Voyage de Lister à Paris, en 1698, trad. de l’anglais. Paris, pour la Société des Bibliophiles, 1873, gr. in-8º, p. 30.
[110] Le Livre commode des Adresses de Paris, par Abraham du Pradel. Nous nous servons à la fois des deux éditions de 1691 et de 1692, qui présentent quelques différences, qu’il nous paraît inutile de rapporter, à la première ou à la seconde édition, sans tenir compte des suppressions que l’auteur, Nicolas de Blegny, a cru devoir faire dans la réimpression de son livre. Voir notre édition, 2 vol. in-18, Paris, P. Daffis, 1878-1879.
[111] Séjour à Paris, c’est-à-dire Instructions fidèles pour les voyageurs de condition, par le sʳ J.-C. Nemeitz. Leide, Jean van Abcoude, 1727, 2 vol. in-12.
[112] Des Formes du mariage, par Duméril, p. 52 et 78.
[113] Voir le Dictionnaire de la Langue françoise, de Furetière, au mot Bouchon.
[114] Du Cange, Glossarium ad scriptores mediæ et infimæ latinitatis, 1678; au mot Buffetagium.
[115] Revue archéologique, t. VI, p. 384.
[116] Contes et Discours d’Eutrapel. Paris, 1732, 2 vol. in-12; t. Iᵉʳ, pp. 235, 254.
[117] Les Comédies facétieuses de Pierre de l’Arrivey, Champenois. Rouen, Raphaël du Petit-Val, 1611, in-12, p. 150.
[118] Le Parnasse satyrique du sieur Théophile, 1660, pet. in-12, pp. 139 et 218.
[119] Les Visions admirables du Pèlerin du Parnasse, ou Divertissement des bonnes compagnies et des esprits curieux, par un des beaux esprits de ce temps. Paris, chez Jean Gesselin, sur le Pont-Neuf, 1635, in-8º, pp. 204 et suiv.
[120] Satire, dans le Parnasse satyrique du sieur Théophile, 1660, pet. in-12, p. 129.
[121] IIIᵉ livre des Chansons pour dancer et pour boire, par Pierre Ballard. Paris, 1628, in-fol.
[122] Cette pièce anonyme a été imprimée, à Paris, chez Toussaint Quinet, 1640, in-12.
[123] Poésies diverses de M. Colletet. Paris, 1636, in-12, p. 410.
[124] Poésies et Lettres de M. Dassoucy. Paris, 1653, in-12, p. 96.
[125] Histoire des Hôtelleries, Cabarets, Hôtels garnis, Restaurants et Cafés, et des anciennes Communautés et Confréries d’hôteliers, de marchands de vin, etc., par Francisque Michel et Édouard Fournier. Paris, Seré, 1855, 2 vol. gr. in-8º.
[126] France. Dictionnaire encyclopédique, par Ph. Le Bas. Paris, Firmin Didot, 1840, t. II, p. 121, article Barbiers. Excellent article et très complet, qui doit être de Ch. Louandre.
[127] L’Improvisateur Français, par Salentin (de l’Oise). Paris, Gousin, 1804, in-12, t. II, p. 384.
[128] Quatrième édition. Paris, Victor Lecou, 1853, in-12, t. II, p. 305.
[129] Paris sous Philippe le Bel, d’après les documents originaux, par H. Géraud. Paris, imp. de Crapelet, 1837, in-4º, p. 486.
[130] Œuvres de Clément Marot, édition de Lenglet du Fresnoy. La Haye, P. Gosse et J. Neaulme, 1731, in-12, t. VI, p. 257.
[131] Dictionnaire de la Langue françoise ancienne et moderne, de Pierre Richelet. Lyon, Bruyset, 1728, 3 vol. in-fol., au mot Barbiers.
[132] Santolii Opera, 1698, 2ᵉ part., in-12, p. 178.
[133] Marques typographiques ou Recueil des monogrammes, chiffres, enseignes, etc., des libraires et des imprimeurs qui ont exercé en France de 1470 jusqu’à la fin du XVIᵉ siècle. Paris, 1867, 2 vol. petit in-4º.
[134] Mélanges historiques et philologiques. Paris, Tilliard, 1754, 2 vol. in-12, t. II, p. 365.
[135] M. le baron J. Pichon, président de la Société des Bibliophiles français, et, sans contredit, le premier bibliophile que l’érudition française s’honore de posséder, a bien voulu nous confier un exemplaire de l’Histoire de l’Imprimerie et de la Librairie, de La Caille (Paris, Jean de La Caille, 1689, in-4º), tout chargé de notes, de différentes mains, et parmi ces notes, celles de M. le baron Pichon ne sont pas les moins importantes. C’est dans ce précieux exemplaire que nous avons trouvé la suite presque complète des enseignes des imprimeurs et des libraires qui ont imprimé et publié des livres à Paris jusqu’en 1688.
[136] Historia Universitatis parisiensis, a Cæs. Egass. Bulæo. Paris, 1665-75, in-fol., t. IV, cap. Librariis.
[137] Dictionnaire historique de la ville de Paris, par Hurtaut et Magny. Paris, Moutard, 1779, in-8º, t. III, pp. 352 et suiv., d’après la Bibliothèque des Artistes, t. II, chap. VI.
[138] Le Livre commode des Adresses de Paris pour 1692, par Abraham du Pradel (Nicolas de Blegny), suivi d’appendices, précédé d’une introduction et annoté par Édouard Fournier. Paris, Paul Daffis, éditeur-propriétaire de la Bibliothèque elzévirienne, 1878-80, 2 vol. in-12.
[139] Recherches sur l’histoire de la corporation des ménétriers et joueurs d’instruments de la ville de Paris, par B. Bernhard. Bibliothèque de l’École des Chartes, 1843-44, t. V, pp. 266 et suiv.
[140] Paris démoli, nouvelle édition, revue et augmentée. Paris, E. Dentu, 1882, in-16, p. 236.
[141] Histoire des Antiquités de la ville de Paris, par Henri Sauval, 1733, t. III, p. 82.
[142] Sauval, t. Iᵉʳ, p. 117.
[143] Sauval, t. III, p. 115 et 136.
[144] Sauval, t. II, p. 650.
[145] Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. Paris, Libraires associés, 1765, t. VIII, p. 339.
[146] Tableau de Paris. Nouvelle édition, augmentée. Amsterdam, 1783, in-12, t. V, p. 109.
[147] Voir, sur le prince de Pons, une curieuse notice dans l’Histoire des Mystificateurs et des Mystifiés, par Paul Lacroix (bibliophile Jacob). Bruxelles et Leipzig, Aug. Schenée, 1856, in-16, t. Iᵉʳ, p. 151 et suiv.
[148] Feuilleton du Gaulois, 5 juillet 1877.
[149] Celle-ci existe encore rue Saint-Denis.
[150] Cette curieuse enseigne appartient aujourd’hui à M. E. Dentu, notre éditeur.
[151] Voir Dictionnaire critique de biographie et d’histoire, par A. Jal. Paris, Plon, 1872, gr. in-8º, p. 1279.
[152] Histoire et Recherches des Antiquités de la ville de Paris, par Henry Sauval, 1733, t. II, p. 182.
[153] Voir, sur divers hôtels de la reine Blanche, nos Chroniques et Légendes des rues de Paris. Paris, E. Dentu, 1864, in-18, p. 370.
[154] Les Enseignes de Paris, par J. Poignant, feuilleton du Gaulois, 5 juillet 1877.
[155] Contes et Discours d’Eutrapel, par Noël du Faïl, seigneur de la Herissaye. S. N. (Paris), 1732, 2 vol. in-12, t. II, p. 98.
[156] Voir plus haut, p. 90, chap. V.
[157] Journal d’un voyage à Paris en 1657-1658, publié par A.-P. Faugère. Paris, Duprat, 1862, in-8º, p. 79.
[158] Même Journal d’un voyage à Paris, p. 27.
[159] Archives hospitalières: Quinze-Vingts, p. 156.
[160] Recherches historiques sur les Enseignes, par E. de la Quérière, 1852, p. 14.
[161] Magasin pittoresque (1854), t. XXII, p. 136.
[162] Bibliographie des Mazarinades, par Moreau, t. III, p. 150.
[163] Œuvres de Monsieur de Fontenelle, nouv. édit. Paris, Saillant, 1677, 11 vol. in-12, t. V, p. 502.
[164] Voir nos Énigmes des rues de Paris. Paris, E. Dentu, 1860, in-18, p. 147.
[165] Mémorial parisien, ou Paris tel qu’il fut, tel qu’il est, par P.-F.-S. Dufey (de l’Yonne). Paris, Dalibon, 1821, in-12, p. 213.
[166] Revue archéologique, t. IV, p. 213, et t. VI, p. 376.
[167] Bibliothèque nationale, manuscrits du Roi, nº 8292, in-fol.
[168] Voir ci-dessus, p. 77.
[169] Essais historiques sur Paris, par de Saint-Foix, 3ᵉ édition, Paris, Duchesne, 1763, in-12, t. Iᵉʳ, p. 322 et suiv.
[170] Histoire et Recherches des Antiquités de la ville de Paris, par Henry Sauval. Paris, 1733, in-fol., t. Iᵉʳ, p. 183.
[171] Curiosités du vieux Paris, par P.-L. Jacob. Paris, Delahays, 1858, in-12, p. 77.
[172] Tome V, première partie, p. 157. Voir aussi nos Chroniques et Légendes des rues de Paris. Paris, E. Dentu, 1864, in-18, p. 364 à 368.
[173] Voir nos Énigmes des rues de Paris, p. 57 à 64, et notre Vieux-Neuf, Paris, E. Dentu, 3 vol. in-18, t. II, p. 44.
[174] Voir le Recueil A. B. C., vol. C., p. 57 et suiv.
[175] Histoire physique, civile et morale de Paris, par Dulaure, 2ᵉ édition, augmentée. Paris, Guillaume, 1828, 10 vol. in-8º, t. VIII, p. 83.
[176] Petit Dictionnaire critique et anecdotique des Enseignes de Paris, par un Batteur de pavé. Paris, chez les Marchands de nouveautés (Imprimerie de H. Balzac), 1826, in-32, p. 63 et suiv.
[177] Charcuterie ancienne et moderne, traité historique et pratique, par L.-F. Dronne, charcutier. Paris, 1869, 1 vol. in-8º.
[178] Voir l’article Cugnière (Pierre de), dans la Nouvelle Biographie générale de Firmin Didot, et l’Histoire physique, civile et morale de Paris, par J.-A. Dulaure. Paris, Guillaume, 1821, t. II, p. 596.
[179] Articles du Journal des Débats, des 25 mai et 1ᵉʳ juin 1858.
[180] Variétés historiques et littéraires, revues et annotées par Edouard Fournier. Paris, P. Jannet, 1855, t. III, in-12, p. 156.
[181] Articles du Journal des Débats, cités plus haut.
[182] Les Historiettes de Tallemant des Réaux, édit. de Monmerqué. Paris, Delloye, 1840, 10 vol. in-12, t. X, p. 143.
[183] Les Historiettes de Tallemant des Réaux, seconde édition, annotée par Monmerqué. Paris, Delloye, 1840, 10 vol. in-12, t. X, p. 42.
[184] Mélanges d’histoire et de littérature, recueillis par M. Vigneul-Marville. Amsterdam, Elie Yvans, 1700, 3 vol. in-12, t. II, p. 45.
[185] Histoire universelle, par Théodore Agrippa d’Aubigné. Maillé, Jean Mousset, 1616-20, 3 vol. in-fol., liv. IV, chap. VI.
[186] Il mourut dans la rue de Seine, chez Monglas, son hôte du Petit Maure, dont nous avons reproduit l’enseigne ci-dessus, p. 145. (Voir Énigmes des rues de Paris, p. 177.)
[187] Bulletin de la Société de l’histoire de Paris, 1883, p. 52. Notice par M. Hipp. Bonnardot.
[188] Les Historiettes de Tallemant des Réaux, 3ᵉ édition, publiée par Monmerqué et Paulin Pâris. Paris, Techener, 1855, 9 vol. in-8º, t. IV, p. 151.
[189] Mémoires de Michel de Marolles. Paris, Ant. de Sommaville, 1656, pet. in-fol., p. 153.
[190] Nous avons déjà cité cette curieuse lettre dans l’Histoire des Hôtelleries et des Cabarets, 1851, t. II, p. 297.
[191] Historiettes de Tallemant des Réaux, 3ᵉ édition de Monmerqué et Paulin Pâris. Paris, Techener, 1855, t. IV, p. 151.
[192] Topographie historique du vieux Paris, par Berty et Tisserand: Bourg Saint-Germain. Paris, Imprimerie nationale, 1876, in-4º, p. 211.
[193] Les Enseignes de Paris, par Alfred de Bougy, feuilleton de la Presse du lundi 21 juillet 1856.
[194] Dictionnaire des termes du vieux françois, ou Trésor de recherches et antiquités gauloises, par Borel; nouvelle édition, augmentée. Paris, Brisson, 1750, in-fol., p. 80.
[195] Histoire et Recherches des Antiquités de Paris, par H. Sauval, 1733, t. III, p. 348.
[196] Topographie du vieux Paris. Bourg Saint-Germain, par Berty et Tisserand. Paris, Impr. nationale, 1876, in-4º, p. 83 et 84.
[197] Lafolie, Mémoires historiques relatifs à la statue de Henri IV, 1819, in-8º, p. 76, et appendice 263.
[198] Voir notre Histoire du Pont-Neuf. Paris, première partie, E. Dentu, 2 vol. in-18, p. 131.
[199] Histoire et Recherches des Antiquités de Paris, par Sauval, 1733, t. II, p. 125.
[200] Recherches historiques sur les Enseignes des maisons particulières, par E. de la Quérière, 1852, p. 13.
[201] Paris, Librairie centrale, 1864, in-12, p. 37.
[202] Les Historiettes de Tallemant des Réaux, seconde édition, in-12, publiée par Monmerqué, chap. CCXCIII.
[203] Petit Dictionnaire critique et anecdotique des Enseignes de Paris, par un Batteur de pavé. (A bon vin point d’enseigne.) Paris, chez les Marchands de nouveautés, 1826, in-32, p. 127.
[204] Petit Dictionnaire critique et anecdotique des Enseignes de Paris, 1826, nº 32, p. 51.
[205] Voir le feuilleton du Journal de Paris, 1ᵉʳ octobre 1859.
[206] Histoire des forêts de la Gaule et de l’ancienne France, précédée de recherches sur l’histoire des forêts de l’Angleterre, de l’Allemagne, etc. Paris, Leleux, 1850, in-8º, p. 20.
[207] Antiquités de Paris, par Sauval, 1733, t. III, p. 275.
[208] Sauval, t. II, p. 471 et suiv.
[209] Histoire anecdotique du théâtre, de la littérature, etc., tirée du coffre d’un journaliste, par Charles Maurice. Paris, Plon, 1856, 2 vol. in-8º, t. Iᵉʳ, p. 46.
[210] Discours satyriques et moraux, ou Satyres générales (par Louis le Petit). Rouen, Richard Lallemand, 1686, in-12, p. 24.
[211] Recueil de Maurepas, à la Bibliothèque nationale, manuscrit, t. VII, p. 43 et 44.
[212] Revue rétrospective, livraison du 30 octobre 1836, p. 35.—Il est à remarquer néanmoins que les Trudaine portent dans leurs armes trois daims, qui rappellent et symbolisent plus noblement leur nom patronymique.
[213] Les Bigarrures et Touches du Seigneur des Accords, par Étienne Tabourot, dernière édit., revue et de beaucoup augmentée. Rouen, David Geoffroy, 1621, in-12, folio 4 et suivants.
[214] Sauval, t. III, p. 157.
[215] Note communiquée par M. le baron Pichon, qui l’avait prise dans les archives d’un notaire de Paris.
[216] Sauval, t. III, p. 57.
[217] A. Berty, Topographie du vieux Paris, quartier du Louvre, 1869, t. Iᵉʳ, p. 41. Voir, plus haut, p. 34 et 222.
[218] Voir les notices sur les Enseignes, par Firmin Maillard, J. Poignant et Amédée Berger, publiées dans le Journal des Débats, le Gaulois et le Journal de Paris.
[219] Les Enseignes de Paris, par Amédée Berger, feuilletons du Journal des Débats, 15 mai et 1ᵉʳ juin 1851.
[220] Chevræana, ou Pensées d’histoire, de littérature, etc. Amsterdam, 1700, 2 vol. in-12, t. Iᵉʳ, p. 142, et notre Histoire du Pont-Neuf, première partie, p. 208.
[221] Curiosités de l’histoire du vieux Paris, par P.-L. Jacob, bibliophile. Paris, Ad. Delahays, 1858, in-12, p. 62.
[222] Voir la figure, p. 175.
[223] Archives hospitalières de Paris, in-4º, p. 152.
[224] Dictionnaire topographique, historique et étymologique des Rues de Paris, par J. de la Tynna, 2ᵉ édit. Paris, Smith, 1817, in-12, p. 508.
[225] Le Paysan françois, sans nom de lieu, 1609, in-8º.
[226] Pièce inédite tirée des Manuscrits de Conrart, à la Bibliothèque de l’Arsenal, t. X, p. 225 et suiv.
[227] Mélanges historiques, satyriques et anecdotiques de Boisjourdain, sur la fin du règne de Louis XIV et la Régence. Paris, Chèvre et Chauson, 1807, 3 vol. in-8º.
[228] Inventaire sommaire des Archives hospitalières, réimprimé par M. Michel Moring. Paris, Picard, 1882, in-4º, nᵒˢ 2253 et 2450.
[229] Registre du Châtelet, publié par la Société des Bibliophiles, t. II, p. 502.
[230] Victor Fournel, les Contemporains de Molière. Paris, Firmin Didot, 1866, in-8º, t. III, p. 335.
[231] Mémoires pour servir à l’histoire de France (extrait des Journaux de l’Estoile). Cologne, chez les Héritiers de Herman Demen, 1719, 2 vol. in-8º, t. II, p. 127.
[232] Histoire de la ville de Paris, par l’abbé Lebeuf, édition de Cocheris, t. Iᵉʳ, p. 368.
[233] Essais historiques sur Paris, pour faire suite aux Essais de M. Poullain de Saint-Foix, par Aug. Poullain de Saint-Foix. Paris, Debray, an XIII (1805), 2 vol. in-12, t. Iᵉʳ, p. 194-195.
[234] Cette édition fait partie de la Bibliothèque elzévirienne, 1878, 2 vol. in-12.
[235] Les Enseignes de Paris, feuilleton de la Presse, du lundi 21 juillet 1856.
[236] Notice des émaux, bijoux et objets divers du Musée du Louvre, par de Laborde. Documents et Glossaire. Paris, Vinchon, 1853, in-12, p. 131.
[237] Même Notice, p. 131.
[238] Livre-Journal de Lazare Duvaux, marchand bijoutier ordinaire du Roy. Paris, pour la Société des Bibliophiles, 1873, 2 vol. in-8º, fig. L’étude de M. Courajod ne remplit pas moins de 221 pages.
[239] Voir notre chapitre XXVIII, sur les imagiers et les peintres d’enseignes.
[240] C’est dans la collection iconographique de M. le baron Pichon, président de la Société des Bibliophiles français, que nous avons trouvé ces vingt et une adresses-enseignes gravées, dont quelques-unes sont d’une grande importance et d’une insigne rareté. Mon vieil ami Paul Lacroix avait publié, avant nous, dans son Dix-huitième Siècle (Paris, Firmin Didot, 1875, gr. in-8º), quelques pièces de ce genre, très remarquables au point de vue de la gravure, empruntées également à la précieuse collection de M. le baron Pichon.
[241] Histoire artistique et archéologique de la Gravure en France, par Alfred Bonnardot. Paris, Deflorenne, 1849, in-8º.
[242] Abraham Bosse, Catalogue de son œuvre, par Georges Duplessis (Revue univers. des Arts, publiée par Paul Lacroix (bibliophile Jacob). Paris, Renouard, 1857, in-8º, t. VI, p. 337.)
[243] Tome LIX de la collection d’estampes léguée à la Bibliothèque nationale par ce savant iconographe.
[244] Revue des Documents historiques, publ. par Étienne Charavay, quatrième année. Paris, A. Lemerre, 1876, p. 58.
[245] Cette eau-forte de Boucher, restée absolument inconnue, a été signalée par M. Courajod, qui l’a fait graver en fac-simile par L. Gaucherel, pour mettre ce fac-simile en tête du Livre-Journal de Lazare Duvaux.
[246] Voir notre Histoire du Pont-Neuf, première partie, p. 272 à 275.
[247] Petit Dictionnaire critique et anecdotique des Enseignes de Paris, 1825, p. 83.—Cette enseigne du Pauvre Diable a subsisté jusqu’à l’année 1878.
[248] Petit Dictionnaire critique et anecdotique des Enseignes de Paris, p. 84.
[249] Petit Dictionnaire critique et anecdotique des Enseignes de Paris, p. 133.
[250] Petit Dictionnaire critique et anecdotique des Enseignes de Paris, p. 41.
[251] Ibidem, p. 21.
[252] Voir notre Esprit dans l’histoire, Paris, E. Dentu, 1883, in-18 elzévir, p. 122-124. Ce quatrain a eu bien des variantes.
[253] Voir, dans les Œuvres de Clément Marot, édition de Lenglet du Fresnoy, la Haye, 1731, t. II, à la page 71, le huitain intitulé: Du Roy et de Laure, et à la page 13 l’épigramme: A soy-mesme, de Madame Laure.
[254] Clément Marot et tous les poètes de cour jusqu’à Ronsard ont fait un grand nombre de ces épitaphes, qu’on appelait des tombeaux et qu’on aurait pu qualifier d’enseignes de la mort, puisqu’elles étaient gravées sur les marbres ou les pierres des sépultures.
[255] Manuel du Libraire et de l’Amateur de livres, par Jacques Brunet, 5ᵉ édition. Paris, Firmin Didot, 1864, 6 vol. gr. in-8º. Voir, dans le tome V, aux pages 1694-1707, la liste alphabétique des libraires et imprimeurs dont les marques typographiques sont figurées dans cette cinquième édition.
[256] Il en est à peu près de même pour les marques de commerce, qui sont généralement la reproduction très réduite de l’enseigne. Cependant quelques magasins, qui n’ont pas d’enseignes proprement dites, ont des marques spéciales; le magasin du Louvre, par exemple, a pour marque un lion appuyé contre un L majuscule.
[257] Histoire physique, civile et morale de Paris, par J.-A. Dulaure. Paris, Guillaume, 1821, in-8º, t. Iᵉʳ, p. 77.
[258] Souvenirs de Paris en 1804, par Auguste Kotzebue, traduits de l’allemand (par Guilbert de Pixérécourt). Paris, Barba, 1805, 2 vol. in-12, t. II, p. 340.
[259] Petit Dictionnaire critique et anecdotique des Enseignes de Paris, par un batteur de pavé, avec cette épigraphe: «Au bon vin pas d’enseigne.» Paris, chez les Marchands de nouveautés, au Palais-Royal. Imprimerie de H. Balzac, rue des Marais Saint-Germain, nº 17. 1826, in-32.
[260] Ballets et Mascarades de Cour, sous Henri IV et Louis XIII, recueillis par Paul Lacroix. Genève, J. Gay, 1868-70, in-12, t. II, p. 213.
[261] L’Orphelin infortuné. Paris, 1660, in-8º, p. 243-44.
[262] Ballets et Mascarades de Cour, t. VI, p. 73.
[263] Poésies et Lettres de M. Dassoucy. Paris, J.-B. Loyson, 1653, pet. in-12, p. 96.
[264] A. Pougin, Adolphe Adam, sa Vie et ses Œuvres.
[265] Puisque nous reparlons ici d’Eugène Scribe, rappelons qu’il est né, en 1791, rue Saint-Denis, où son père tenait un magasin de soieries, au Chat noir (Lefeuve, les Anciennes Maisons de Paris, t. III, p. 58). Cette enseigne abrite aujourd’hui, au nº 32, une boutique de confiseur.
[266] A propos de l’emploi de la mosaïque, assez rare dans les enseignes de Paris, mentionnons l’ornementation en mosaïque polychrome, figurant des attributs guerriers, qui entoure la façade monumentale du Panorama construit, depuis trois ou quatre ans, rue Saint-Honoré, nº 251, sur l’emplacement de la salle Valentino. (Note de l’éditeur.)
[267] On lit dans le Figaro du 27 février 1884: «Il y a encore des enseignes amusantes. Hier, nous en avons remarqué une assez drôle, dans le haut de la rue Pigalle. Cette œuvre d’art, due au pinceau d’un illustre inconnu, a pour but d’attirer l’attention des passants sur les mérites des escargots de Bourgogne, débités par un marchand de vin restaurateur. L’artiste a ainsi conçu son œuvre: dans le haut du tableau, le Père éternel et le bon saint Pierre émergent des nuages et conversent ensemble, en regardant au-dessous d’eux une bande de terrain sur laquelle se promène allégrement un escargot d’appétissante apparence. Une légende traduit ainsi les paroles des personnages célestes: «Pierre, tire le cordon. Il faut que j’aille voir de plus près sur la terre cette bête que je ne connais pas et que je ne me souviens pas d’avoir créée.—Ne vous dérangez pas, Seigneur, c’est un excellent escargot de Bourgogne qui voyage comme échantillon pour la maison X..., de la rue Pigalle.» Et le bon Dieu semble dire à saint Pierre: «Merci du renseignement; on apprend à tout âge.» (Note de l’éditeur.)
[268] L’Hermite du faubourg Saint-Germain, par Ch. Colnet. Paris, Pillet, 1825, 2 vol. in-12.
[269] Étude sur les Enseignes de Paris (Journal des Débats, 25 mai et 1ᵉʳ juin 1848).
[270] Les Enseignes de Paris, feuilleton du Gaulois, 7 juillet 1877.
[271] Les Enseignes, par Firmin Maillard, feuilleton du Journal de Paris. 1ᵉʳ octobre 1859.
[272] Histoire de la Société française pendant la Révolution, par les frères de Goncourt. Paris, E. Dentu, 1854, in-8º, p. 269.
[273] Voir la Feuille du jour, nº 177.
[274] Réimpression du Moniteur universel, in-4º, t. XIX, p. 266.
[275] Journal littéraire de Clément, 1795, t. II, p. 19.—Un peu plus tard reparurent quelques enseignes de dévotion (voir notre chapitre XVI), telles que l’Image Notre-Dame, sous l’invocation de laquelle s’était mis, dès 1701, un commerce de droguerie de la rue des Lombards, transféré aujourd’hui boulevard de Sébastopol, nº 14.
[276] Le Nouveau Paris, par le citoyen Mercier. Brunswick, 1800, 6 vol. in-12, t. III, p. 94.
[277] Au sujet d’une sculpture assez bizarre qui décore la partie supérieure du chevet de cette église, et qui peut passer pour une véritable enseigne en rébus, voir nos Enigmes des rues de Paris, p. 301.
[278] Histoire de la Société française sous le Directoire, par Edmond et Jules de Goncourt. Paris, E. Dentu, 1855, in-8º, p. 88 et 93.
[279] Étude sur les Enseignes de Paris, par Amédée Berger (Journal des Débats, 25 mai et 1ᵉʳ juin 1858).
[280] Œuvres de A.-V. Arnault. Paris, Bossange, 1827, t. VIII, p. 120.
[281] Le Livre des Cent et un. Paris, Ladvocat, 1834, in-8º, t. XV, p. 243.
[282] Le Mercure de France, t. XLV, p. 482.
[283] La France, par Lady Morgan. Paris, Treuttel et Wurtz, 1817, 2 vol. in-8º, t. II, p. 57.
[284] Cette maison, faisant l’angle de la rue de Grammont, et remplacée par l’hôtel du Crédit lyonnais, appartenait alors à M. Pérès, maître serrurier, auquel on doit la belle grille du Palais de justice. (Note de l’éditeur.)
[285] Mémorial parisien, ou Paris tel qu’il est, etc. Paris, Dalibon, 1821, in-12, pages 4, 31, 35 et 214.
[286] Voir la figure page 92.—Mentionnons dans la même rue, plus près de la Bastille, l’enseigne du Chat botté, assez jolie statuette en bois colorié qui décore la boutique d’un cordonnier.
[287] Étude sur les Enseignes de Paris (Journal des Débats, 25 mai et 1ᵉʳ juin 1858).
[288] Cette sculpture décorait l’entrée du collège de Saint-Michel, fondé au XIVᵉ siècle par l’évêque de Paris Guillaume de Chanac et doté en 1510 par Antoine de Pompadour. C’est dans ce collège qu’avait été admis comme domestique-élève le futur cardinal Dubois (Lefeuve, Anciennes Maisons de Paris, t. Iᵉʳ, p. 397-400).—Rappelons en passant que cette rue de Bièvre avait eu pour habitant Dante pendant son séjour à Paris, et qu’il allait suivre les cours des professeurs de la rue du Feurre ou Fouarre, tout près de là.
[289] Recherches historiques sur les Enseignes des maisons particulières, suivies de quelques inscriptions murales, par E. de La Quérière. Rouen, François, 1852, in-8º, p. 53 et suiv.
[290] Aujourd’hui au musée de Cluny.
[291] Mémoires et Correspondance littéraire, dramatique et anecdotique de C.-S. Favart. Paris, Léopold Collin, 1808, 3 vol. in-8º, t. Iᵉʳ, p. 94.
[292] Paris à la fin du XVIIIᵉ siècle, ou Esquisse historique et morale des monuments et des ruines de cette capitale, etc., par J.-B. Pujoulx. Paris, Mathé, 1801, in-8º, p. 14.
[293] Livraison du 10 septembre 1842, p. 38; Bulletin publié sous la direction de Paul Lacroix (bibliophile Jacob).
[294] Catalogue raisonné de l’œuvre, peint, dessiné et gravé, d’Antoine Watteau, par Edmond de Goncourt. Paris, Rapilly, 1875, in-8º, p. 88 à 90.
[295] Voir notre Histoire du Pont-Neuf. E. Dentu, édit., 1862, 2 vol. in-18; t. Iᵉʳ, p. 270-274.
[296] Mémoires inédits sur la vie et les ouvrages des membres de l’Académie royale de peinture et de sculpture, publiés par L. Dussieux, E. Soulié, Ph. de Chennevières, etc. Paris, Dumoulin, 1854, 2 vol. in-8º, t. II, p. 421.
[297] Grétry, par Arsène Houssaye, dans la Revue de Paris, numéro du 4 juillet 1841.
[298] Voir ci-dessus, à la page 363, cette enseigne, la seule peut-être qui n’ait pas quitté sa place depuis le Directoire, sauf qu’elle est maintenant à l’intérieur du magasin au lieu d’être au dehors.
[299] Les Enseignes de Paris, par M. Poignant, feuilleton du Gaulois, 7 juillet 1877.
[300] Voir la remarquable monographie d’Edmond de Goncourt, intitulée: Gavarni, p. 404.—Voir ci-dessus, page 349, la reproduction de cette enseigne, qui existe encore au coin des rues de la Huchette et Saint-Jacques.
[301] Les Enseignes de Paris, feuilleton du Gaulois, 8 juillet 1877.
[302] A propos d’Eugène Delacroix, mentionnons, boulevard du Montparnasse, à quelques pas du boulevard des Invalides, au-dessus d’un magasin de meubles, une copie de son beau tableau représentant Dante conduit par Virgile au séjour des Damnés. Cette enseigne, qui n’a pas d’inscription, est en assez mauvais état, mais on peut voir encore qu’elle a été peinte par un artiste de quelque talent, sans doute un élève du maître.
[303] Voir plus haut, p. 394, une note à ce sujet.—Cette enseigne, qui était telle que nous la dépeignons quand nous en avons fait prendre copie, aurait aujourd’hui bon besoin d’être restaurée; à peine en reconnaît-on le dessin.
[304] Ce Richesource, qui se posa en défenseur de la langue écrite et parlée pendant trente-cinq ans, publia, en 1680, le Camouflet des auteurs négligents en faveur des jeunes orateurs, in-12, et il ne ménagea pas plus les auteurs en renom que s’il avait eu à leur reprocher les monstrueux abus orthographiques et grammaticaux des enseignes de Paris.
[305] Journal de Paris, feuilleton du 1ᵉʳ octobre 1859.
[306] Mémorial parisien, ou Paris tel qu’il fut, tel qu’il est. Paris, Dalibon, 1821, in-12, p. 31.
[307] Tout récemment, en février 1884, le journal la France a inauguré un hôtel somptueux, élevé par l’architecte Ferdinand Bal, sur l’emplacement de l’ancien marché Saint-Joseph. L’angle, en pan coupé, sur la rue du Croissant et la rue Montmartre, est décoré au sommet d’un génie, placé devant un exemplaire typique du journal et montrant au public une pièce de 10 centimes, prix du numéro. Au-dessous, dans un médaillon lauré, est le buste d’Émile de Girardin, fondateur du journal, et plus bas, un bras de bronze, sortant de la muraille, dépose son bulletin dans une urne électorale.—Le Petit Journal montre, au-dessus de l’immeuble où il est installé depuis plus de vingt ans, rue Lafayette, nº 61, une énorme pièce de 5 centimes, entourée de lauriers et autres attributs; encore l’annonce du prix du numéro du journal. (Note de l’éditeur.)
[308] A. Forgeais, Plombs historiés trouvés dans la Seine; 1ʳᵉ série. Méreaux des corporations d’arts et métiers. Paris, 1862, in-8º, p. 125.