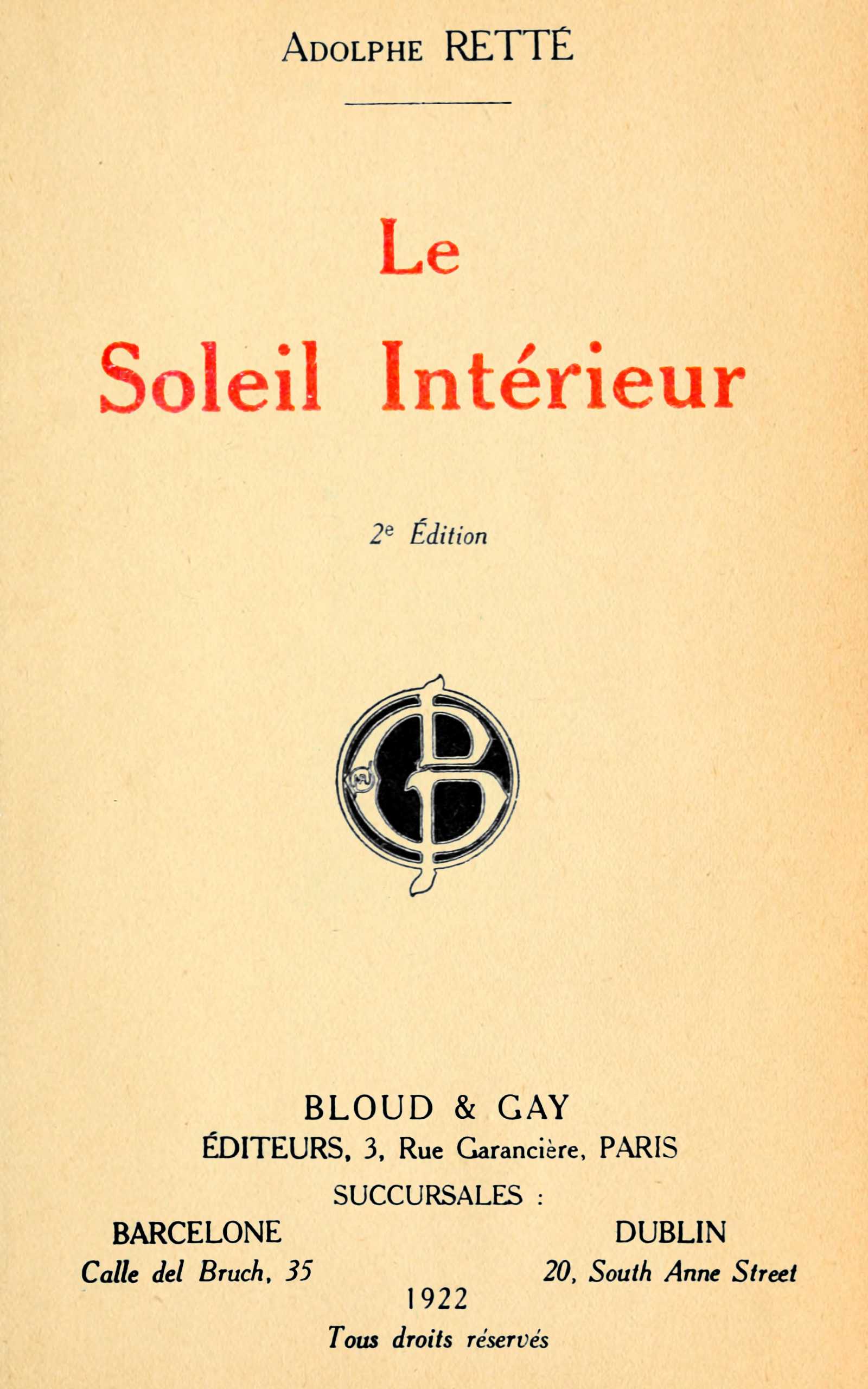
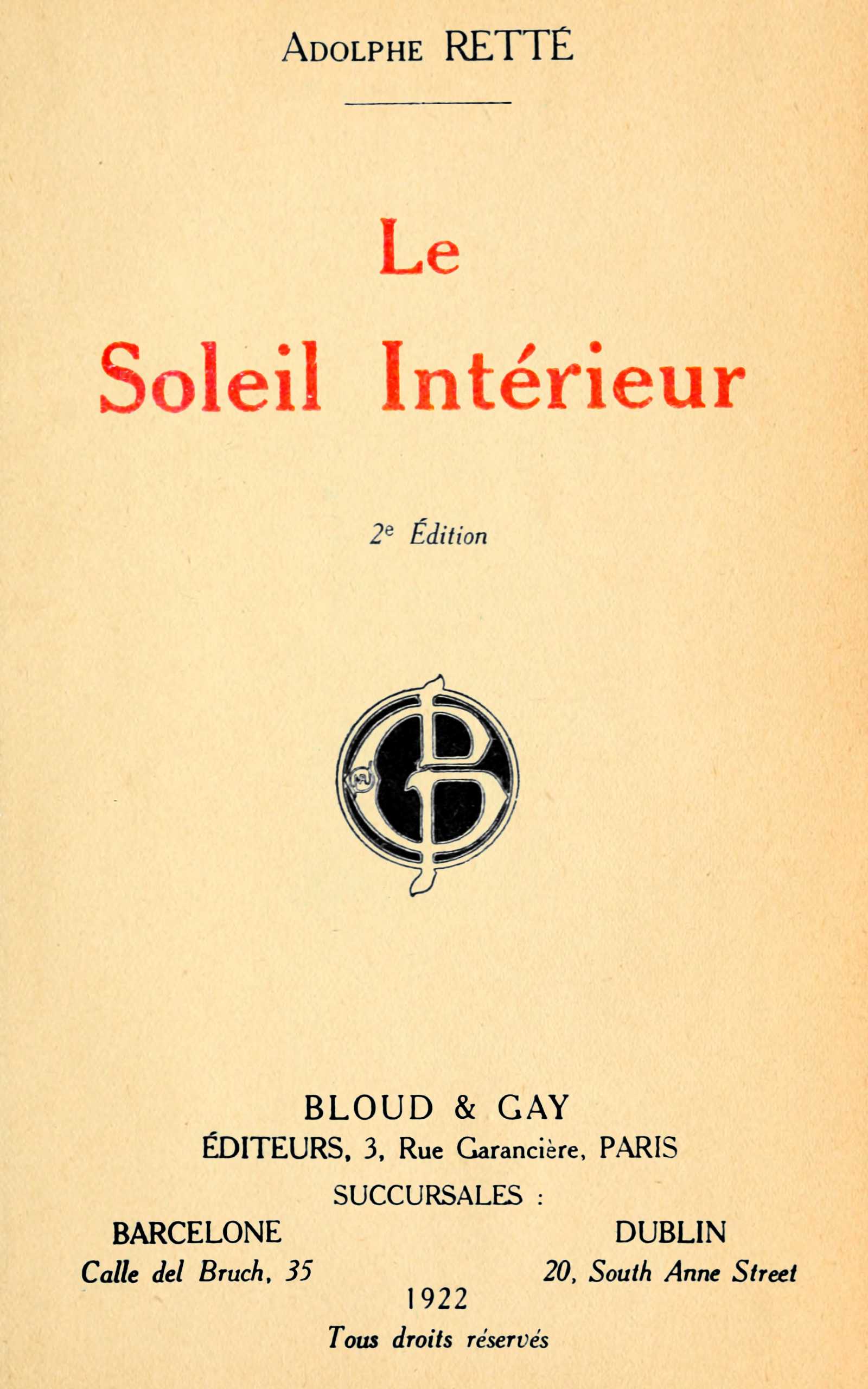
ADOLPHE RETTÉ
2e Édition
BLOUD & GAY
ÉDITEURS, 3, Rue Garancière, PARIS
SUCCURSALES
BARCELONE
Calle del Bruch, 35
DUBLIN
20, South Anne Street
1922
Tous droits réservés.
DU MÊME AUTEUR
Du diable à Dieu. — Récit d’une conversion.
Le règne de la Bête. — Roman.
Un séjour à Lourdes. — Journal d’un pèlerinage à pied ; impressions d’un brancardier.
Sous l’Étoile du Matin. — Essai de psychologie religieuse.
Dans la lumière d’Ars. — Récit d’un pèlerinage.
Au pays des lys noirs. — Souvenirs politiques et littéraires.
Quand l’Esprit souffle. — Récits de conversions.
Ceux qui saignent. — Notes de guerre.
Sainte Marguerite-Marie. — Vie de la révélatrice du Sacré-Cœur, d’après les documents originaux.
Lettres à un Indifférent, apologétique réaliste.
Notes sur la psychologie de la conversion. — Brochure.
Les miracles de Lourdes. — Brochure.
Au chapitre XIV de l’Évangile selon saint Jean, il est rapporté que Jésus, parlant à ses disciples, leur dit :
« L’Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu’il ne le connaît point, vous, vous le connaîtrez, parce qu’il sera en vous… »
Et plus loin :
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole et mon Père l’aimera ; et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure… »
Pénétrée de cette divine présence, sainte Térèse compare l’âme où elle se manifeste à « un cristal limpide » au centre duquel Dieu rayonne comme un soleil. Elle établit la réalité sensible de cet astre qui, « par essence et par puissance », vivifie de sa flamme les contemplatifs humbles et souffrants dont le cœur est pareil à celui d’un enfant.
Le faux sage se détourne du Soleil intérieur pour chercher des clartés parmi les marais décevants où croupissent les sciences humaines. Les phosphores de la décomposition l’hallucinent ; ses regards se saturent de mirages ; il en poursuit les prestiges à travers des brumes où les feux follets livides de son orgueil dansent, s’éclipsent, se rallument, l’entraînent toujours plus loin du foyer de grâce et finissent par l’égarer dans ces ténèbres extérieures dont il est dit qu’elles ne comprennent pas la lumière.
Alors, quel trouble en lui ! Quel tumulte de notions contradictoires ! Le doute universel s’infiltre dans ses veines. Sa raison tourbillonne comme une feuille sèche, au souffle de « l’Esprit de négation ». Les systèmes et les doctrines qu’il échafaude croulent l’un après l’autre. Il erre en trébuchant parmi des ruines vêtues de mousses aux nuances cadavéreuses. Et mille fantômes l’escortent.
Il s’écrie, avec le douloureux Baudelaire :
Bientôt il se diluera dans la nuit sans étoiles du désespoir, si Dieu ne lui envoie une grâce de conversion qui l’oblige de rebrousser chemin vers le Soleil méconnu.
Les trop prudents, ceux qui s’efforcent d’établir une cote mal taillée entre le service de Dieu et celui de Satan, cherchent à se tenir à la limite entre la région qu’illumine l’astre aux clartés de foi, d’espérance et de charité, et la contrée où se bousculent les nuées inquiètes de l’amour-propre. Ils usent leurs jours à tenter un bizarre mélange d’ombres et de lumière. Ils n’aiment pas Dieu, mais, comme ils le craignent, ils calculent la mesure dans laquelle ils lui obéiront sans trop déplaire au Démon. L’Apôtre a beau leur dire : « Ne vous conformez pas à ce siècle », ils lui répondent : « Il faut être de son temps. »
Mais si ce temps, ainsi que le fait le nôtre, s’enfonce dans un matérialisme épais et noir comme poix ? — Tant pis pour Dieu ! Ils s’y englueront en multipliant les excuses et en promettant de se repentir après qu’ils auront léché, pendant des années, le cambouis des portes de la Géhenne.
Cependant, comme le dit encore sainte Térèse, « les puissances de leur âme qui remplissent les fonctions d’alcade, d’intendant et de maître d’hôtel font très mal leur office ». Privées du principe régulateur, elles s’entre-heurtent dans l’anarchie. A cause de leur mauvaise conscience, ils vivent dans l’incertitude et le chagrin…
Mais les Simples, les véritables enfants de Dieu qui demeurent, avec une tranquille confiance, fondus dans le rayonnement du Soleil intérieur, ceux-là connaissent les joies de la paix dans la certitude. Même lorsque la croix pèse sur leurs épaules, ils se félicitent de souffrir avec Notre-Seigneur. Et c’est pourquoi, selon la promesse du Bon Maître, ils sont « entièrement dans la lumière sans aucun mélange d’obscurité. Tout est lumineux en eux. Ils sont éclairés comme par une lampe toute brillante. »
Dans les pages qui vont suivre, on essaya d’évoquer quelques-unes de ces âmes solaires. Durant leur existence terrestre, elles subirent bien des tribulations ; souvent elles eurent à savourer le mépris des personnes — positives. Mais, en compensation, divers amoureux de Jésus vinrent se réchauffer à leur flamme.
Aujourd’hui, où, même chez beaucoup de fidèles, il est de bon ton de réduire le sens surnaturel de la vie à un minimum, où la lanterne fumeuse du sens commun est trop souvent considérée comme une étoile de première grandeur, certains ne goûteront guère les « exagérations » des prédestinés dont l’histoire va être rapportée.
Toutefois, peut-être se trouvera-t-il un certain nombre d’âmes chrétiennes pour apprécier ces élus de la vraie Lumière parce qu’ils n’aimèrent que Dieu, ne vécurent que pour Dieu, ne connurent que cette seule sagesse : la folie de la Croix, et ne voulurent rien savoir de plus.
Il y a des Saints dont la trace de clarté, en ce monde fuligineux, se marque pour l’action. Ils sont fondateurs d’ordres, réformateurs, promoteurs de dévotions nouvelles. Mais d’autres se manifestent si vibrants, si sensibles au moindre souffle de l’Esprit, que leur existence se résume en un cri d’adoration perpétuelle. Ils sont tellement « ivres de ce vin de l’amour de Dieu » dont parle sainte Térèse, qu’ils titubent à travers la vie en trébuchant contre tous les cailloux de la route, en se heurtant à l’angle de tous les murs. Les choses de la matière ne les touchent que pour les faire souffrir. Les gens de piété formaliste les envisagent avec méfiance à cause de leurs allures décousues. Les abstracteurs de quintessence théologique dissèquent leurs propos sans bienveillance, s’offusquent de leurs gestes, blâment les excès de leur charité, concluent fort souvent, qu’une sainteté aussi scandaleuse devrait être réprimée au nom de la discipline commune. Cependant, comme une flamme insolite règne autour de ces « exaltés », les Simples qui, d’instinct, s’y réchauffent, les vénèrent et se lamentent lorsqu’on leur enlève ces « Irréguliers » dont le verbe ardent verse du soleil dans les âmes ingénues.
Saint Joseph de Cupertino fut l’un de ces Bienheureux hors-la-loi. Son originalité lui valut la prison, peut-être parce que son exemple aurait multiplié ces « fous à cause de Jésus-Christ » à qui saint Paul réserve des éloges sans restriction.
Il apparut à une époque où, sous prétexte de Renaissance, le paganisme ressuscitait dans les esprits et dans les mœurs. En apparence, sa place eût été parmi ces premiers disciples de saint François d’Assise qui s’intitulaient eux-mêmes « les jongleurs du Bon Dieu ». Mais, au commencement du XVIIe siècle, il produisit à beaucoup l’effet d’un anachronisme, d’un survivant tardif du moyen âge égaré dans un temps peu propice au miracle.
Or il semble bien que la Providence l’ait suscité afin d’avérer, une fois de plus, qu’elle demeure la maîtresse de démentir, quand il lui plaît, les conjectures où la pauvre raison humaine voit des axiomes. Pour sa part, Joseph démontra que les lois de la pesanteur ne sont pas toujours faites pour les Saints.
Parmi les dires des contemporains sur l’Homme-Volant de Cupertino, on trouve des légendes baroques dues à l’imagination populaire et aussi des railleries à base de scepticisme émises par des métaphysiciens goguenards ou trop subtils. C’étaient de ces Florentins lettrés qui jugeaient l’Évangile par trop fruste au regard des rêveries chatoyantes qu’ils aimaient à cultiver dans les jardins de Platon.
Si l’on écarte ces gauches enluminures et ces persiflages de raffinés, il reste une série de témoignages précis provenant de prélats pondérés qui furent les admirateurs du Saint et qui, après l’avoir étudié, devinrent ses amis les plus fervents. Il reste aussi les faits, vérifiés avec prudence et minutie, dont l’Église s’autorisa pour placer Joseph sur ses autels. De l’ensemble se dégage une figure tout imprégnée de lumière surnaturelle. Dans les lignes qui vont suivre on essaiera d’en donner une esquisse.
Joseph naquit à Cupertino, petit village du royaume de Naples, le 17 juin 1603, dans des circonstances fort tristes. Son père, menuisier, ayant fait de mauvaises affaires, les gens de justice vinrent pratiquer une saisie et expulser la famille au moment même où sa mère ressentait les premières douleurs de l’accouchement. Elle se réfugia dans une étable délabrée et mit au monde son enfant sur quelques brins de paille à demi pourris.
Le père, de tempérament jovial et insoucieux, ne s’affecta pas beaucoup de ce revers, qui lui valut, d’ailleurs, l’emploi de concierge du château. Car le seigneur du pays voulut l’avoir sous la main pour se divertir de ses saillies. Par la suite, ce philosophe rustique ne s’occupa guère de sa progéniture.
La mère offrait un caractère tout différent. Morose, aigrie par l’indigence, elle se montrait d’une dévotion étroite et littérale. Joseph étant encore tout petit, elle le châtiait avec rigueur, à la moindre étourderie, comme s’il se fût agi de fautes graves. Donc, entre cet homme qui riait toujours et cette femme qui ne riait jamais, l’enfant grandit, privé de toute affection humaine. Il ne paraît point en avoir souffert, Dieu l’ayant prédestiné à la vie intérieure la plus intense.
En effet, ce qui le particularise d’une façon éminente c’est ce fait que, dès l’âge de quatre ans, il plongea dans l’oraison au point d’ignorer à peu près complètement ce qui se passait autour de lui. Ses sens prenaient à peine contact avec l’univers. Son âme, imprégnée du soleil d’amour qui rayonnait et brûlait au centre le plus profond de son être, n’était qu’effleurée par les impressions venues de l’extérieur. Celles-ci ne pénétraient pas ; il les écartait sans même s’en apercevoir et demeurait noyé dans un océan d’or fluide qui absorbait toutes ses puissances. Ce qu’il contemplait en lui c’était la Sainte-Face tout éclatante de tendresse infinie ; ce qu’il entendait, c’étaient des paroles que nul dialecte humain ne saurait traduire. Lorsque, à des intervalles éloignés, il s’arrachait douloureusement de son union perpétuelle à Jésus, il promenait sur le monde un regard étonné. Même alors, il n’en percevait pas le mécanisme social. Il le découvrait comme un lieu de ténèbres où furetaient des chacals, où s’agitaient des ombres plaintives. Pour la nature, elle lui apparaissait un grand rêve peuplé de symboles qui reproduisaient, sous des formes moins parfaites, les images merveilleuses dont il avait coutume en ses ravissements.
Seule, la musique religieuse réussissait à l’émouvoir : les accords de l’orgue, le chant liturgique le faisaient tressaillir. Il se mettait à pleurer, sa bouche murmurait des mots mystérieux qui se scandaient bientôt en un vague poème d’adoration jusqu’à ce que l’entourage, qui n’y comprenait rien, lui imposât silence.
On comprend que, fondu de la sorte en Dieu, Joseph eût de la peine à s’assimiler les rudiments de l’instruction. Sa mère constatant qu’il n’apprenait qu’avec la plus grande difficulté le texte du catéchisme et qu’il ne pouvait presque rien retenir par cœur, se récriait sur sa bêtise. D’autres fois, l’accusant de paresse et de mauvaise volonté, elle le rouait de coups.
« Elle m’a tellement battu, disait-il plus tard, en souriant, que les épreuves du noviciat ne me furent pas grand’chose en comparaison. »
A l’école, ce fut pis. Incapable de fixer son attention, l’enfant n’entendait, pour ainsi dire, rien du tout. Le maître avait beau le fustiger avec fureur, le traiter de bourrique et d’idiot, taxer de dissipation ses extases, Joseph n’apprit à lire qu’au prix d’un âpre tourment. Son écriture demeura toujours fort incorrecte. Quant au calcul, ce demeura pour lui la plus impénétrable des énigmes.
Ses camarades, le surprenant, à toute minute, l’œil écarquillé, les lèvres entr’ouvertes, en admiration devant des spectacles qui leur restaient invisibles, l’avaient surnommé : gueule béante. Ils lui jouaient mille tours cruels et le bafouaient sans trêve. Mais lui ne semblait point s’en chagriner. Il prenait ses récréations à l’écart ; elles consistaient à cueillir des fleurs de pissenlit ou des primevères ; puis se glissant dans le chœur de l’église paroissiale, il les déposait sur une marche de l’autel, s’agenouillait et égrenait un chapelet, pendant des heures, sans rien dire. Parfois, le sacristain survenait, lui reprochait d’apporter « des saletés » dans le sanctuaire et le mettait à la porte en lui tirant les oreilles.
La sainteté se paie. C’est pourquoi Dieu qui, comme le dit Job, crucifie admirablement ses élus, lui envoya la maladie. Joseph comptait un peu plus de sept ans quand il fut gratifié d’un abcès de l’intestin qui, perçant au dehors et mal soigné par un chirurgien ignare, menaça de tourner à la gangrène. En même temps, il attrapa la pelade ; son crâne s’excoria ; ses cheveux tombèrent par plaques ; et il en garda les marques toute sa vie.
L’enfant endurait de telles tortures qu’il lui arrivait de jeter quelques cris et de se plaindre un peu. Alors sa mère le secouait rudement et lui interdisait le plus léger soupir en disant que c’était un péché.
Mais le pauvre petit la suppliait : — Maman, portez-moi tout de même à la messe, disait-il un jour, je ne me sens bien que là.
C’était vrai, cette femme — si dure mais très pieuse en somme — avait admiré maintes fois son recueillement depuis l’introït jusqu’au dernier Évangile. Elle s’attendrit, le prit dans ses bras, et fit ce qu’il demandait. Pendant toute la durée du Saint Sacrifice, elle remarqua qu’il ne semblait plus souffrir. Et, de fait, il ne souffrait plus. Son âme allait se blottir dans le tabernacle et son corps devenait insensible au mal qui le rongeait.
Les actes de canonisation rapportent que Joseph fut guéri par un ermite qui, invoquant Notre-Dame de Grâce, lui fit une onction d’huile bénite. Mais la maladie s’était prolongée pendant quatre années au cours desquelles il fut charcuté, scarifié à l’aveuglette par le médicastre.
Dès que l’enfant fut guéri, l’on tint conseil pour examiner ce qu’on pouvait tirer de lui. Sa vocation, c’était de vivre entre ciel et terre, mais personne ne s’en doutait. Le pédagogue déclara qu’il renonçait à infuser la science dans ce cerveau rebelle. La mère, qui aurait souhaité le faire étudier pour la prêtrise, déplorait la ruine de son ambition. Le père promulgua : — Il est stupide… Tâchons de lui mettre un métier dans les mains ; peut-être à la longue, arrivera-t-il à gagner sa vie.
On le colloqua donc en apprentissage chez un cordonnier.
Jamais expérience n’échoua d’une façon aussi totale. Joseph n’apprit ni à manier l’alène, ni à battre le cuir, ni à poisser le fil. Il gâchait l’ouvrage et, malgré les coups de tire-pied que son patron lui prodiguait, il ne réussit jamais à faire tenir ensemble une semelle et une empeigne. Ou bien, absorbé en Dieu, il demeurait, les bras ballants, très loin de sa tâche. Ou bien, comme, d’après une clause de son contrat, stipulée sur sa demande, il allait à la messe tous les matins, il s’y enfonçait dans la contemplation au point de négliger parfois de se rendre à la boutique. C’est qu’alors son âme revivait la Passion du Sauveur ou pénétrait dans le mystère de la Sainte Trinité. « Il s’identifiait, dit son biographe, aux personnes divines et les communications merveilleuses qu’il en recevait se prolongeaient aussi longtemps que ses oraisons. »
Inepte en apparence, il réalisait ainsi la vie intérieure la plus riche et la plus féconde qui se puisse concevoir. Si rien ne s’en manifestait au dehors, c’est parce qu’à cette époque l’influx surnaturel dominait avec tant de despotisme toutes ses facultés qu’il lui était impossible d’expliquer ce qui se passait dans son esprit et dans son cœur.
Au surplus, à qui se serait-il confié ? — Pas au desservant de la paroisse qui, par ignorance ou par incurie, ne sut jamais distinguer la voie extraordinaire où Dieu engageait cet enfant. Et pourtant, Joseph possédait une intelligence très nette puisque, plus tard, dans le milieu monastique où il se développa, il sortit de la stupeur adorante où l’avait tenu si longtemps l’action divine sur son âme pour définir avec précision la ligature dont il avait été l’objet jusqu’à son adolescence.
Mais le brave cordonnier ne vit en lui qu’un bousilleur pas même bon à rapetasser des savates.
— Et puis, ajoutait cet homme positif, il ne veut manger que des fruits, du pain et de la soupe aux herbes. Il ne boit que de l’eau. De l’eau, je vous demande un peu !… Comme si le vin n’était pas l’ami de l’ouvrier ! Plusieurs fois, il est resté deux ou trois jours sans se mettre à table. Quand je lui en ai demandé la raison, il a pris son sourire niais pour me répondre : « J’ai oublié. » Le résultat, voilà !
Et il brandissait un croquenot difforme, en révolte contre toutes les règles de la cordonnerie.
— Je le garderais vingt ans comme apprenti, conclut le patron, qu’il ne ferait pas mieux. Qu’on me délivre de ce nigaud !…
Joseph fut donc rendu à sa famille. Il avait alors dix-sept ans. Il se demandait que devenir quand il reçut intérieurement l’ordre de se faire religieux. Déjà, il avait pensé au cloître, mais d’une façon vague et avec le sentiment qu’il convoitait une chimère. Or, cette fois, le Bon Maître, dont il distinguait sans cesse la présence au fond de son âme, qu’il aimait autant qu’il en était aimé, le Roi de lumière, qui lui avait prescrit le jeûne et l’abstinence, lui indiquait formellement la route à suivre. Plein de joie, il demanda tout de suite à ses parents la permission d’endosser le froc. Ils la lui accordèrent sur-le-champ, la mère parce qu’elle était très pieuse, le père, parce que, comme beaucoup de gens, il estimait que le monastère est un refuge tout indiqué pour les faibles d’esprit.
Il se trouva que deux oncles de Joseph, Francisco Desa et Giovanni Donato, appartenaient à la congrégation des Frères Mineurs de l’ordre de Saint François d’Assise. Il eût été normal que leur neveu entrât dans le couvent où ils avaient fait profession et s’y formât sous leurs auspices. Mais l’humilité ne comptant pas au nombre de leurs vertus, ils eurent honte d’un parent dont la réputation d’hébétude les offusquait. Ils ne voulurent même pas l’examiner : « C’est un illettré, un balourd, qu’il sera impossible d’élever jamais au sacerdoce », s’écrièrent-ils. Et ils inculquèrent leur prévention au Supérieur qui refusa tout net et sans examen d’admettre le postulant.
Cet échec ne découragea point le jeune homme. Au contraire, l’impulsion irrésistible qui le portait à la vie conventuelle ne cessa de s’accroître. S’il ne parvenait guère à exprimer ce qui se passait en lui, c’était avec lucidité qu’il obéissait à la Volonté toute-puissante qui avait pris le gouvernement de son âme. Il concevait qu’au monastère seulement les grâces dont il se sentait comblé s’épanouiraient dans toute leur splendeur.
Sans perdre de temps, il alla trouver le Père provincial des Capucins de Martina et le supplia de l’accepter comme convers puisqu’on le jugeait inapte au chœur. Pour la première fois de sa vie, il déploya de l’éloquence, disant son horreur du monde et son désir passionné de s’incarcérer dans l’amour de Jésus-Christ. Son humilité, son esprit d’abnégation, la flamme mystérieuse qui brillait dans ses prunelles émurent le provincial. Il fut convenu qu’on l’essaierait, si piteuse que fût sa renommée.
Joseph prit donc l’habit en août 1620 sous le nom de frère Étienne.
Mais ses tribulations ne faisaient que commencer. Dieu, le maintenant sans cesse au sommet de la vie unitive, entendait l’imposer aux moines, comme aux laïques, ainsi qu’un être d’exception de qui la seule présence serait un défi aux principes les plus avérés du sens commun.
A peine le Saint fut-il entré au noviciat, que la contemplation le ressaisit tout entier. Souvent, du matin au soir, il semblait aveugle et sourd, de sorte que ses confrères, ne comprenant rien à son état, l’avaient surnommé « le cadavre ambulant ».
Le Supérieur soupçonnait bien que cette infirmité pouvait avoir une cause d’ordre surnaturel. Mais, d’autre part, la vie de communauté exigeait que chaque religieux se rendît utile d’une façon ou d’une autre. Peut-être qu’en désignant Joseph pour un emploi facile à remplir, on tirerait de lui quelques services sans entraver son oraison. Il le donna donc comme adjoint au frère chargé du réfectoire, en recommandant de ne lui passer aucune négligence. Ce faisant, il espérait se rendre compte s’il avait affaire au plus étrange des contemplatifs ou à un paresseux de carrière qui simulait l’idiotie pour s’épargner tout effort.
L’expérience eut un résultat propre à susciter le courroux du Père économe. Maladroit au plus haut degré, Joseph ne mit jamais le couvert sans casser deux ou trois plats et cinq ou six assiettes. Par punition, on lui enguirlanda le cou avec les débris. Mais il ne parut pas s’en apercevoir. Et il allait, tout cliquetant d’un bruit de vaisselle entrechoquée, sans même se douter qu’il était un sujet de dérision pour l’entourage.
A plusieurs reprises, il mit du pain noir au lieu de pain blanc sur les tables. Comme on lui signifiait de donner plus d’attention à ce qu’il faisait, il répondit, avec naïveté, qu’il était incapable de distinguer l’un de l’autre. C’était parfaitement exact ; mais le frère réfectorier crut que Joseph se moquait de lui. Il porta plainte et le pauvre extatique reçut une rude pénitence, qu’il accepta sans le moindre murmure. Puis on le changea d’office : on lui confia le soin de balayer les cloîtres. — Joseph accepta joyeusement cette besogne quasi machinale et il s’y mit avec ardeur. La bonne volonté ne lui faisait pas défaut ; seulement il arriva ceci que, neuf fois sur dix, au bout d’une minute, il était ravi en Dieu. Laissant alors tomber son balai, il s’agenouillait sur les dalles et oubliait tout jusqu’à ce qu’on vînt le secouer.
Enfin on le chargea uniquement de tirer l’eau d’un puits pour la transvaser dans un récipient qui servait aux ablutions de la communauté. Cette tâche ne demandait qu’une heure par jour. Or pas une seule fois le Saint ne réussit à remplir le tonneau. Pendant un mois on le vit errer, le seau à la main, l’air absent : il ne se rappelait plus ce qu’il avait à faire.
Ainsi de tout. Parmi les convers laborieux, il semblait une cigale chez les fourmis.
Quant à la formation religieuse, il fut impossible de la lui donner. Aux exercices, il troublait ses voisins et rompait la psalmodie par de grands soupirs ou des cris d’amour sans rapport avec le rituel. Aux instructions, il paraissait écouter le Père Maître. Mais si celui-ci lui posait une question, il balbutiait quelques phrases confuses ou gardait le silence. Humble, du reste, très convaincu de son ignorance, un jour qu’un de ses compagnons lui reprochait de n’être propre ni aux travaux matériels ni à la vie spirituelle, il lui demanda :
— Par charité, mon Frère, apprenez-moi ce que signifient ces mots : la vie spirituelle ?
— La vie spirituelle, répondit l’autre, c’est d’arriver au chœur le premier et d’en sortir le dernier.
Cette définition sommaire était offerte de bonne foi, le convers possédant un de ces esprits limités pour qui observer la règle d’une façon mécanique c’est réaliser la perfection. Mais Joseph y vit une réprimande méritée, car il avait fait cent fois sa coulpe pour des retards invraisemblables. Il baissa la tête et ne répliqua rien.
Cependant le Saint dépérissait à vue d’œil. D’abord le feu divin qui lui embrasait l’âme minait ses organes. Cette vie spirituelle dont, sans en avoir la notion, il présentait un modèle achevé, l’épuisait. Ensuite, les railleries des autres novices, les observations réitérées de ses supérieurs le suppliciaient ; il sentait qu’on ne supporterait pas toujours ses manquements continuels à la discipline. L’inquiétude le rongeait, car il ne parvenait pas à comprendre comment Dieu, lui ayant octroyé la vocation, le laissait inapte à la vie monastique. En effet, quel contraste : au centre de son âme, la lumière absolue — tout autour, d’opaques ténèbres !
La catastrophe qu’il redoutait se produisit enfin. Considérant, au bout de neuf mois d’essai, que Joseph ne s’adaptait nullement à la règle commune, excédé de rapports et de récriminations, le Provincial jugea qu’il était sage d’arrêter l’expérience. Quelques religieux, plus perspicaces que leurs collègues, et, entre autres, le Père Maître lui représentèrent pourtant que les « excentricités » de Joseph constituaient peut-être l’indice de grâces extraordinaires et que ses vertus étant évidentes, il y aurait lieu de patienter encore. Mais la majorité réprouvait toute indulgence, blâmait tout délai : à la porte, l’original qui ne se conduisait pas comme tout le monde !
Il en va parfois ainsi dans les monastères, quand les hommes de la lettre prédominent et non les hommes de l’esprit. Quiconque s’y différencie de la masse routinière, tranche sur le milieu incolore par l’éclat d’une personnalité anormale, suscite de l’antipathie et des malveillances. Il gêne, et, d’instinct, le troupeau des médiocres cherche à l’éliminer. On doit reconnaître que chez Joseph la sainteté se manifestait d’une façon si particulière qu’il constituait un embarras pour une communauté. Toutefois, si les Capucins de Martina avaient brûlé de cette Charité que recommande saint Paul, ils auraient perçu la crise d’incubation mystique que subissait leur frère. Se plaçant au point de vue du surnaturel, ils l’auraient chéri et ménagé en vénérant l’opération divine sur cette âme. Malheureusement, ils raisonnèrent selon la nature. Dès lors, ils ne virent en lui qu’un déséquilibré bon à expulser ou à enfermer.
La prison viendra bientôt. Pour le moment, ce fut l’éviction.
« Lorsqu’on lui ôta l’habit religieux, rapporte son premier biographe, il eut un sentiment, si vif de son incapacité, de sa faiblesse, de ce qu’on nommait son extravagance, que, depuis, au seul souvenir de cette scène on l’a vu s’évanouir tant il en restait frappé. Dans un âge plus avancé, il racontait qu’en cette minute, il s’était senti comme arracher la peau de la chair. Pour comble de misère, une partie de ses vêtements laïques, le chapeau, les bas, la casaque s’étaient égarés. On le mit dehors demi-nu. »
Ces moines étaient de sinistres pingres, car enfin ils auraient pu, au moins, lui faire l’aumône d’un bonnet, d’une paire de sabots et d’une veste !
Ce ne fut pas encore le point extrême de l’épreuve. Le monde réservait au Saint un accueil semblable à une fondrière hérissée de ronces farouches et d’orties hargneuses. Il avait résolu de gagner Vetrara, petite ville où son oncle Francisco prêchait le carême, afin de lui exposer sa détresse et de mendier un abri. Il suivait la route quand il fut attaqué par des chiens qui mirent en loques les haillons dont il était couvert. Il eut grand’peine à fuir leurs morsures.
Il boitillait, tout meurtri, lorsque, un peu plus loin, des bergers le prirent pour un espion des brigands qui ravageaient, pour lors, la contrée et fondirent sur lui en hurlant des menaces et en brandissant leurs triques. Ils l’auraient assommé si l’un d’entre eux ne l’avait reconnu et ne s’était interposé. Joseph gisait sur le talus, très pâle et tout défaillant, car il avait quitté le monastère à jeun.
— Je meurs de faim, répondit-il à leurs questions. Pris de pitié, ils lui donnèrent un quignon de pain qui le réconforta un peu.
A Vetrara, l’oncle le reçut comme avec une fourche.
— Tu n’es qu’un imbécile et un propre à rien, s’écria-t-il, qu’est-ce que tu vas devenir à présent ? Ne compte pas sur moi : je me ferais scrupule d’assister un rebut de cloître tel que toi… Dans ta maison c’est l’indigence et pire, car je t’apprends que ton père est mort insolvable. Il t’a laissé pour héritage trois mille écus de dettes dont tu devras répondre. Je te préviens que les créanciers te cherchent pour te fourrer en prison. Que vas-tu faire ?
Joseph, blême comme un linceul, se tenait devant lui, sans rien dire. L’oncle insistant d’une voix tonnante, il se signa puis fit un geste d’abandon total ; et deux grosses larmes coulèrent lentement sur ses joues.
Francisco eut quelque peu vergogne de sa dureté :
— Je te garderai ici jusqu’à Pâques, reprit-il, après je te reconduirai à Cupertino, et là, tu te débrouilleras comme tu pourras.
A Cupertino, dès que sa mère apprit son renvoi, elle entra dans une furieuse colère. Elle vociféra : — « Tu as trouvé le moyen de te faire chasser de la sainte maison où l’on avait eu tant de mal à obtenir ton admission. Dieu sait quelles sottises tu as dû commettre !… Mais je t’en avertis, je n’entends pas nourrir ton oisiveté. Sors d’ici, vagabond, va-t’en où il te plaira ; ou bien qu’on t’emprisonne ; cela m’est fort égal… »
Cependant le Saint ne suppliait ni ne cherchait à se justifier. Courbé sous l’invective maternelle, les yeux clos, il voyait, au-dedans de lui-même, Jésus-Christ saigner sur la croix. Il participait à l’agonie du Maître et il se sentait si complètement identifié à Lui qu’il ne parvenait pas à fixer son attention sur les choses de la terre. Car il ne faut pas oublier qu’au stade de la vie unitive où il se trouvait alors, chacune de ses souffrances se confondait avec celles que Notre-Seigneur eut à subir au cours de sa Passion. Le Joseph apparent semblait de pierre aux outrages et aux sévices. Le Joseph intérieur éprouvait des tortures indicibles sur la Voie douloureuse. Mais cela, il ne pouvait l’exprimer, les puissances de son âme demeurant liées à l’égard du monde.
Quand la mère fut à bout de reproches et de lamentations, elle considéra son fils déplorable et ses entrailles s’émurent.
— C’est un idiot, murmura-t-elle, mais après tout, c’est mon enfant !…
L’idée lui vint de courir au monastère de la Grottella où l’autre oncle, Giovanni Donato, remplissait les fonctions de Maître des novices. A la Grottella il y avait une chapelle où l’on honorait l’image d’une Madone miraculeuse et, de ce fait, le sanctuaire possédait droit d’asile. Joseph s’y réfugiant échapperait aux poursuites des créanciers.
Donato ne voulut d’abord rien entendre. Ses préventions contre son neveu étaient trop ancrées pour qu’il l’admît au noviciat. Sur ce point, il se montra irréductible. Puis comme la mère insistait en sanglotant et lui représentait que l’arrestation de Joseph les déshonorerait tous, par amour-propre familial, il trouva un biais : le jeune homme porterait l’habit du tiers-ordre sous le vocable d’oblat et, en cette qualité, il aurait la charge de soigner la mule de la maison.
La mère consentit à tout. Le jour même, elle amena Joseph au monastère et prit congé de lui en lui signifiant de faire bien attention à sa conduite, car ce serait la dernière fois qu’on lui viendrait en aide. Ce qui fut confirmé par le Père Donato.
C’est alors que prit fin l’épreuve imposée au Saint pendant toute son enfance et la première partie de sa jeunesse. Son esprit se dénoua, il put, sans trop de distractions, remplir son emploi, suivre un dialogue, donner quelques preuves d’intelligence et manifester sa vocation. L’allégresse de se voir de nouveau sous clôture le transfigurait. Sa gaîté, son empressement à rendre service, son amour de la règle, son adaptation rapide aux coutumes monastiques firent augurer qu’on pourrait peut-être utiliser son bon vouloir.
Ce n’est point, d’ailleurs, qu’il fût exempt de peines, car à cette même époque, le Mauvais, flairant en lui un adversaire qui deviendrait redoutable, l’attaqua par les sens en l’obsédant d’images luxurieuses.
Joseph ne se laissa pas déconcerter par ces fangeuses manigances. Pour vaincre la chair, « à la nudité des pieds, à la rudesse du cilice, il joignit une étroite chaîne de fer qui ceignait ses reins et ses épaules. Il jeûnait tous les jours et ne donnait que quelques heures au sommeil, consacrant le reste de la nuit à l’oraison ».
Il couchait à l’écurie, auprès de la mule qu’il avait prise en affection et qu’il soignait fort bien. Son lit se composait de trois planches avec une peau d’ours comme couverture et un sac de paille pour oreiller. Par surcroît, quand le Démon le tourmentait avec persistance, il se flagellait en se servant d’une discipline garnie de molettes d’éperons si bien que les murs étaient tout éclaboussés de son sang.
L’oncle Donato, surpris de son changement et voulant l’observer de plus près, prit l’habitude de l’emmener avec lui lorsqu’il allait prêcher ou quêter dans les villages des environs. Chemin faisant, il l’interrogeait sur la religion. Joseph répondait avec simplicité. Mais ce qui frappa le Père c’est que les propos de son neveu, d’un ton naïf et imprévu, révélaient une connaissance approfondie des Mystères. Il ignorait le vocabulaire théologique ; il employait, pour décrire sa parfaite union au Bon Maître, un langage primesautier, des termes rustiques, des comparaisons familières. Tel quel, il débordait de science infuse. On aimerait à donner quelques exemples à l’appui ; malheureusement les relations contemporaines se bornent à constater le fait sans rapporter ses propres paroles.
Bref, Donato reconnut avec stupéfaction que, durant sa longue période d’apparente torpeur, le jeune homme avait réalisé les états d’oraison de l’ordre le plus élevé et que Jésus-Christ lui-même avait pris soin de verser la Lumière en son âme. Selon qu’il est dit dans l’Évangile, « des choses qui sont cachées aux prudents et aux sages » furent montrées à ce tout-petit — à cet humble qui ne se doutait même pas de son privilège.
A la suite de cette enquête, le Père, tout à fait revenu de ses préventions, estima que, pour le bien de la communauté, il serait sage d’admettre au noviciat un sujet aussi exceptionnel. D’après son avis, Joseph fut conduit à Altamira, au mois de juin 1625. Une congrégation provinciale y était réunie qui examina le postulant et reconnut son aptitude à la cléricature. De retour à la Grottella, Joseph reçut donc l’habit religieux et commença son année de probation. Pour la piété, le zèle, l’obéissance, il fut irréprochable. De plus, son humeur enjouée et son extrême douceur le faisaient aimer de tout le monde. Mais quant aux études il y échoua d’une façon totale. Il semble évident que Dieu se réservait l’action directe sur cette âme et n’entendait pas que les méthodes ordinaires lui fussent appliquées.
En effet, comme on le préparait à recevoir les ordres, Joseph eut beau faire effort pour s’assimiler les matières prescrites, c’était comme s’il eût versé de l’eau dans un crible. Il n’apprit qu’avec la plus grande difficulté les éléments du latin et ne parvint jamais à lire correctement le bréviaire ni le missel. « Il croyait avoir beaucoup fait lorsqu’à grand’peine il réussissait à en articuler distinctement quelques syllabes. » D’après ce détail, on devine que la scolastique lui demeura une rébarbative étrangère.
Le Père Donato, maître des novices, ne savait que résoudre. D’une part, il y avait cette évidence : Joseph irradiait le Surnaturel divin autour de lui. D’autre part, comment canaliser, plier au ministère une sainteté qui restait imperméable à l’enseignement traditionnel ?
Le temps du noviciat s’écoula parmi ces incertitudes. Elles ne furent pourtant pas un obstacle pour la profession. Les vertus de Joseph se manifestaient si éclatantes que, malgré sa nullité comme étudiant, il y fut admis par un suffrage unanime.
Restait le plus malaisé, c’est-à-dire l’accession au sacerdoce. Joseph considérait en tremblant les in folio formidables dont il lui fallait absorber la substance ; il en épelait quelques lignes puis, n’y comprenant goutte, il s’écriait, les larmes aux yeux : — Appelez-moi Frère Ane !…
C’est, du reste, le surnom sous lequel il se désigna durant toute son existence.
Il s’y reprit à cent fois pour se meubler l’esprit de définitions abstraites et de formules dogmatiques. Toujours en vain. Vérifiant que, par ses moyens naturels, il n’obtenait aucun résultat, il eut recours à la Sainte Vierge, tout comme un enfant qui demande à sa mère de lui seriner l’alphabet.
— Aidez le petit âne à porter son fardeau ! lui dit-il.
« Ensuite, a-t-il raconté plus tard, je m’adonnai à la pénitence et à la méditation des merveilles de ma bonne Mère et je ne restai plus une heure sans avoir présente à l’esprit cette bienheureuse Vierge de la Grottella qui me faisait des grâces continuelles et attirait en elle toute mon âme. »
Marie lui donna un signe indubitable de sa prédilection. Voici comment le biographe de Joseph rapporte le miracle :
« Il est de fait qu’il ne réussit jamais à expliquer aucun des Évangiles de l’année sauf celui qui commence par les mots : Beatus venter qui te portavit (St Luc, XI). La Mère de Dieu qui voulait élever si haut l’intelligence de son serviteur, prit plaisir à lui révéler le sens d’un texte dont elle est l’objet et à l’introduire elle-même dans le sanctuaire.
« Joseph apprit donc uniquement les paroles de cet Évangile ; il en comprit la signification et la portée et se présenta hardiment à l’examen. L’évêque de Nardo, Jérôme de Franchis, qui pressentait sa sainteté, lui conféra sans difficulté les ordres mineurs et le sous-diaconat. Il était disposé à l’ordonner diacre lorsqu’on lui rappela qu’aux termes des canons, l’examen préalable était de rigueur. L’évêque prit le livre des Évangiles et l’ouvrit au hasard. Mais il semble qu’un ange ait dirigé sa main, car le passage qu’il rencontra fut précisément celui qui commence par Beatus venter. Il ordonna à Joseph de l’expliquer. Le Saint se prit à sourire et, les yeux fixés au ciel, il commenta le texte comme s’il eût été un maître en théologie. En conséquence, il fut reçu au diaconat. »
Pour la prêtrise, l’examen devait être passé à Bogiardo par Baptiste Deti, évêque de Castro, prélat qu’on surnommait, à cause de sa sévérité, « la terreur des ordinands ». Joseph se présenta en compagnie de quelques-uns de ses confrères, sujets d’élite dont la science épouvantait, par comparaison, le pauvre Frère Ane. Les premiers interrogés répondirent, en effet, d’une manière fort brillante. L’évêque, supposant que les autres étaient tous aussi bien préparés, arrêta l’épreuve et déclara qu’il recevait tous les candidats. Ainsi Joseph, qui devait passer le dernier, fut admis sans avoir été interrogé.
L’ordination eut lieu le 4 mars 1628.
Le voici prêtre. La question se posait maintenant de l’emploi à lui donner.
Il ne fallait pas compter sur lui pour la récitation des offices car, disent les actes de la canonisation, « pendant plus de trente-cinq ans, les supérieurs durent exclure frère Joseph des cérémonies du chœur et des processions, attendu que, par ses extases et ses ravissements, il troublait les exercices ».
De même, il lui fut toujours impossible de dire régulièrement le bréviaire. Ou bien il s’évadait dans la contemplation sitôt qu’il en avait lu quelques lignes. Ou bien, il feuilletait le volume, comme au hasard, poussant des cris d’amour et versant des larmes chaque fois qu’il rencontrait le nom de Jésus.
On dut renoncer également à l’appliquer au ministère de la confession : neuf fois sur dix, à peine assis au confessionnal, il entrait en ravissement et n’entendait pas les pénitents qui se pressaient autour de lui.
Or le Supérieur remarqua qu’il possédait un genre d’éloquence tout personnel et que quand il parlait de Dieu, c’était en des termes si frappants, avec des images si émouvantes qu’à l’entendre on se sentait pénétré d’une foi plus vive et d’un zèle plus ardent pour la religion. Il résolut donc de vouer le Saint à la prédication. Il lui commanda de parcourir la province et de parler au peuple partout où il se trouverait. Joseph obéit quoiqu’il eût bien préféré le silence et le recueillement dans sa cellule.
Tout de suite, le succès fut énorme, mais non pas auprès des doctes et des mondains.
Ceux-ci, en général, s’offusquaient des verdeurs de sa diction ou lui reprochaient de négliger les préceptes de l’art oratoire. Mais les gens du peuple étaient transportés et aussi maintes âmes ferventes de toutes conditions. Il conquit encore nombre de débauchés que sa parole arrachait à leurs vices et précipitait, tout sanglotants de repentir, aux pieds de Jésus.
Il est malaisé de donner un exemple de sa manière. D’abord on ne peut rendre le feu de son regard, le rayonnement de sa face, l’ampleur de ses gestes, le son de cette voix qui retentissait tantôt comme une cloche de bronze tantôt comme une flûte de cristal. Un de ses auditeurs a dit : « Avant d’entendre le frère Joseph, j’avais l’âme froide et dure comme un bloc de glace. Tandis qu’il parlait, je la sentis fondre et devenir pareille à de l’eau bouillante ; et je me mis à aimer Dieu comme jamais je n’avais eu la moindre idée de le faire. »
Ce qui s’oppose aussi à l’exposé de son éloquence c’est que la plupart de ses harangues ne sont venues à nous que fragmentaires et fort souvent édulcorées par des chroniqueurs pieux mais timides. Ces scribes, très amis de la périphrase et de l’euphémisme, s’effaraient à cause de la rudesse et de la netteté des discours du Frère. Ils les ont gauchement délayés en ce style « mucilagineux » — comme disait Huysmans — où trop d’écrivains pieux ont coutume d’engluer le Verbe dont ils ont reçu le dépôt.
Voici, cependant, un passage d’un des sermons prononcés par le Saint où il semble que ses expressions aient été à peu près conservées :
« Eh bien, gens de toute petite foi, vous me montrez vos coffres-forts et vos magasins bondés de marchandises ! Vous en êtes très fiers et c’est là que vivent vos âmes. Mais moi, je vous dis que vos âmes, comme ces boutiques et ces trésors, sont pleines de vermine et d’ordure. Au contraire, il y a dans les magasins de Dieu des provisions que nul dégoûtant insecte n’oserait attaquer. Si vous aviez la foi, Dieu prendrait plaisir à vous prodiguer ses richesses incorruptibles et vous auriez part à sa puissance. Car l’homme fidèle peut ce qu’il veut pourvu qu’il veuille ce qu’il doit. Dieu l’a dit. Oseriez-vous supposer qu’il a quelque raison pour nous mentir ?… »
Le sermon terminé, la foule escortait Joseph comme s’il l’avait enchaînée à sa suite. Les uns pleuraient et confessaient tout haut leurs fautes. D’autres lui demandaient des conseils pour mieux vivre. Il répondait à tous et ne malmenait que ceux qui s’adressaient à lui mûs par un sentiment de curiosité profane. A ceux-là, il répondait : « Allez voir Polichinelle. Le frère Ane n’a rien à vous dire ! »
Mais la multitude le poursuivait quand même, l’acclamait et ne pouvait se déprendre de lui. C’est parce qu’il était en quelque sorte un accumulateur de divinité : la Grâce émanait de lui par effluves ; à l’approcher, à le toucher, il semblait qu’on s’imprégnât d’une lumière purifiante dont les rayons pénétraient profondément dans les âmes pour les renouveler et les sanctifier.
Nul orgueil ne lui venait de ces triomphes. Les ovations le mettaient au supplice. Dès qu’il lui était possible, il donnait sa bénédiction en ces termes : Potentia Patris, sapientia Filii, virtus Spiritus sancti defendat vos ab omni malo[1]. Puis il se dérobait et courait s’enfermer dans sa cellule. Et il fallait un ordre exprès de son supérieur pour qu’il en sortît et reprît sa tâche d’illuminateur des consciences obscurcies.
[1] Que la puissance du Père, la sagesse du Fils, la force du Saint-Esprit vous défende de tout mal.
C’est à l’époque de ces prédications que Joseph reçut les deux privilèges qui constituent sa marque spéciale parmi les Saints et qui lui valurent autant de souffrances que de célébrité : le don d’être élevé au-dessus de terre par une explosion d’amour de Dieu et le don de lire dans les âmes comme si c’étaient des manuscrits déroulés soudain devant ses regards.
Rappelons-nous d’abord que le ravissement en Dieu lui était habituel. Il ne se passait guère de jours sans que, pendant plusieurs heures, il ne s’éclipsât de l’univers périssable pour monter se fondre, en esprit, dans l’essence incréée. En ces occasions, son corps semblait anéanti. Ses yeux restaient ouverts mais privés de la faculté de voir. Ses oreilles ne percevaient aucun bruit sauf les ordres du Supérieur. Ses membres devenaient rigides et insensibles. En cet état, certains religieux qui le jalousaient et prétendaient que, simulant l’extase, il jouait une comédie, le piquaient avec des aiguilles. Plusieurs même prenaient un plaisir barbare à lui appliquer des charbons ardents sur la peau. Or, soumis à un traitement aussi cruel, il ne donnait pas signe de vie. Exactement, il ne le sentait pas. C’est seulement lorsque l’extase avait pris fin qu’il commençait à souffrir des blessures ainsi faites. Il n’adressait, d’ailleurs, aucun reproche à personne.
Le cardinal Lauria, qui l’observa de près et publia une relation détaillée de son enquête, rapporte à ce sujet le propos suivant du Saint :
« Il me dit : — Compatriote, sais-tu ce que me font les Frères quand me viennent mes étourdissements[2] ? Ils me lardent avec des pointes, me brûlent les mains et me tordent les doigts. Et me montrant ses paumes couvertes d’ampoules il ajouta : — Voilà leur ouvrage ! Puis il se mit à rire sans manifester la moindre rancune de ces abominations. »
[2] Il appelait ainsi, par humilité, ses ravissements et ses extases.
Le même prélat note que lui avant demandé ce qu’il voyait dans l’extase, Joseph lui répondit :
« C’est assez difficile à expliquer. Je suis comme transporté dans une galerie, qui resplendit de choses nouvelles et belles, devant une glace où, d’un seul regard, j’embrasse les merveilles qu’il plaît à Dieu de me montrer. »
Un autre jour, il précisa un peu davantage : « Quelquefois, dit-il, je vois les attributs de Dieu d’ensemble réunis sans que mon esprit les puisse différencier ni diviser. D’autres fois, je les vois séparés et distincts. Je leur découvre des beautés toujours nouvelles. Mes regards plongent dans des merveilles dont chaque partie, aussi bien que le tout, étonne mon intelligence. »
C’est un des phénomènes les plus admirables de la vie unitive que cette vision intellectuelle de la Trinité. On comprend que Joseph ne pouvait qu’en affirmer la présence en lui et que toute dissertation aurait été vaine car pour exprimer le mystère le plus impénétrable de la religion, les mots humains font défaut.
Aspiré peu à peu par la Divinité, le corps du Saint ne tarda pas à suivre l’envolée de son âme. Ses pieds quittaient le sol d’un élan irrésistible ; il poussait un grand cri et demeurait suspendu en l’air, les bras en croix, la face lumineuse, ou bien il traversait l’espace avec rapidité comme s’il eût été soutenu par des ailes invisibles.
Les témoignages surabondent qui attestent ce miracle. Les plus probants ont été retenus pour les actes de la canonisation.
Voici des exemples :
« En ma qualité de berger, dépose un pâtre, je gardais les troupeaux proche de la Grottella. La veille de Noël, Frère Joseph nous vint trouver, moi et mes camarades, et nous dit : — Ne voulez-vous pas, la nuit prochaine, venir jouer de vos musettes dans l’église, en signe de joie pour la naissance de Jésus-Christ ?
« Sur cette invitation, nous nous réunîmes en grand nombre, avec nos musettes et nos fifres. Frère Joseph, d’un air joyeux, vint à notre rencontre. Nous entrâmes dans l’église tous ensemble, lui en tête, nous derrière, vers onze heures du soir, et, dans la nef, nous commençâmes à jouer de tous nos instruments. Nous vîmes alors Frère Joseph, tant il était joyeux, se mettre à danser au son de notre musique. Mais, tout à coup, il soupira et poussa un grand cri. En même temps, il s’éleva au-dessus des dalles et, du milieu de l’église, il vola, comme un oiseau, sur le maître-autel où il embrassa le tabernacle. Or de la place où il s’envola au maître-autel, il y a bien cinquante mètres. Mais le plus beau de l’affaire, c’est que l’autel étant couvert de flambeaux allumés, Frère Joseph ne renversa ni une bougie ni un chandelier. Il resta ainsi à genoux sur l’autel un quart d’heure environ ; après quoi, il reprit terre, sans l’assistance de personne et sans rien déranger. Il nous dit alors : — Mes enfants, c’est assez ; soyez béni pour l’amour de Dieu !… Nous étions fort effrayés de dévotion et tout stupéfaits. Et je dis : — Sûrement, c’est un miracle… »
En une autre occasion, l’amirante de Castille, ambassadeur d’Espagne, voulut voir Joseph. « Il l’entretint au parloir. A la suite de la conférence, il alla trouver sa femme à l’église et lui dit : — Je viens de parler à un autre saint François. L’ambassadrice éprouvait un vif désir de voir, elle aussi, le serviteur de Dieu. Elle sollicita cette faveur. Le custode fit commander à Joseph, dont il connaissait la répugnance à s’approcher des femmes, d’aller dans l’église, en vertu de la sainte obéissance et d’y conférer avec l’ambassadrice et les dames de sa suite. Le Saint répondit en souriant : — Je pratiquerai l’obéissance, mais je ne sais si je parlerai.
« Il sortit donc de sa cellule et se rendit à l’église par une petite porte située en face d’un autel où il y avait une statue représentant Marie conçue sans péché. Entrer, voir la statue, pousser un cri, s’élever en l’air, passer sur la tête de l’amirante et des dames et franchir en volant une distance de douze pas pour aller embrasser les pieds de la Madone, tout cela ne fut que comme une seule et même chose. Le Saint resta, un bon moment détaché de terre, et en ravissement. Puis, poussant un nouveau cri, pareil au premier, il revint en volant à l’endroit d’où il était parti. Il salua la Madone, baisa la terre et, ensuite, le visage caché dans son capuchon, la tête baissée, regagna sa cellule… »
Le prêtre qui déposa du fait ajoute : « Quelques jours après, j’allai à la cellule du frère. Nous conférions de choses spirituelles. Le discours tomba sur son aversion à traiter avec les femmes. Je lui demandai comment il s’était décidé à voir l’ambassadrice et ses dames. Il me répondit qu’il ne s’était rendu à l’église qu’à contre-cœur et par obéissance. — Mais, dit-il avec un sourire, la Bienheureuse Vierge m’a obtenu la grâce que ces dames n’ont rien pu me dire ni moi leur parler. La machine s’est détraquée de sorte que je ne les ai pas même aperçus…
« Par là, il indiquait le ravissement qui, en effet, l’avait empêché de voir et de parler. »
La raison de son éloignement pour les dévotes intempestives ne provenait pas d’un manque de charité mais de la confusion et de la gêne que lui avaient causés, en maintes circonstances, les empressements, les gesticulations et les clameurs des assistantes à ses sermons. Le sexe féminin se montre parfois aussi envahissant qu’indiscret. Joseph en avait souffert et c’est pourquoi il le tenait à distance.
Il arrivait aussi que le Saint emportait quelqu’un de ceux qui se trouvaient à sa portée au moment de son envol. Le fait se produisit lors de son séjour au monastère d’Assise. Les actes de canonisation le rapportent en ces termes : « Le jour de la fête de l’Immaculée Conception de l’an 1642, les novices chantèrent en musique les vêpres de la solennité. Le serviteur de Dieu voulut assister à la cérémonie. Après vêpres, survint dans la chapelle le custode du couvent, le père Palma qui lui demanda : — Frère, que fais-tu là ?
« Frère Joseph, ravi en extase durant l’office et tout illuminé encore des rayons de la gloire divine, regarde le custode et du doigt indiquant l’image de la Madone : — Père Palma, dit-il, Marie est belle !… Après un moment, d’un accent de joie et de bonheur, il reprit : — Père custode, dis avec moi : Belle Marie !
« En prononçant ces mots, le Saint, dont l’ardeur croissait par degrés, se rapproche du Père, embrasse, l’étreint, puis crie à toute voix : — Belle Marie ! Belle Marie !… Au même instant ses pieds se détachent du sol, il s’élève dans l’espace, entraînant avec lui le custode qu’il tient enlacé. On vit alors les deux hommes voler vers le ciel, jusqu’à la hauteur du plafond, l’un par lui-même, l’autre par l’effet d’un ravissement qui n’était pas le sien. Lorsque les deux religieux furent redescendus, le custode s’en alla et je ne sais ce qui dominait en lui de la dévotion ou de la frayeur. Les novices, muets d’étonnement, regardaient Joseph en tremblant. Le serviteur de Dieu, d’un air confus, leur dit : — Mes petites brebis, prenez patience, j’ai longtemps dormi… Et ayant baissé son capuchon sur son visage, il retourna dans sa cellule ».
On a noté plus de soixante-dix envols du Saint en public durant son dernier séjour à Cupertino. Ailleurs, ils furent innombrables si bien que son biographe a pu dire, sans exagération, que Joseph « passa la moitié de son existence entre ciel et terre ». Et cela est d’autant plus exact que, la plupart du temps, lorsqu’il disait sa messe, le Saint s’élevait à quelques pouces du plancher après la Consécration et ne reprenait pied qu’au dernier Évangile.
On aura remarqué cette phrase du berger relevée au procès de canonisation : « Nous vîmes alors Frère Joseph, tant il était joyeux, se mettre à danser au son de notre musique. » Or ce ne fut pas la seule fois que le Saint témoigna d’une allégresse aussi débordante. De passage à Naples, on le vit, dans l’église Saint-Grégoire, « décrire un cercle rapide en dansant sur ses genoux et chanter à pleine voix : — Vierge bienheureuse ! Vierge bienheureuse ! »
Plus tard, à Osimo, « le matin de Noël, il construisait une crèche dans sa cellule et invitait les Pères et les novices à danser et à chanter avec lui devant l’Enfant-Jésus. »
Oubliant que David a dansé devant l’Arche, les religieux se scandalisaient, comme le firent les lévites autour du Roi Psalmiste, et refusaient de s’associer à ces pieuses cabrioles. Mais il n’avait cure de leurs mines renfrognées et il se laissait aller sans fausse honte à la joie qui le transportait.
Ces danses, ces envolées, comme les extases et les ravissements du Saint, montrent combien la sensation profonde de la présence divine en lui l’affranchissait des liens terrestres. La splendeur des aspects du Paradis qui lui remplissaient l’imagination, le mettait tout hors de lui au point qu’il perdait le contrôle de ses actes. Le soleil intérieur flamboyait d’une façon si ardente, le pénétrait d’une telle chaleur et d’un tel rayonnement qu’il devenait pareil à un sylphe s’ébattant à travers les magnificences d’un beau jour d’été. Même s’il avait tenté de se contenir, il n’y serait point parvenu. Mais il n’y songeait guère. Aussi spontané qu’un enfant, il obéissait à l’action surnaturelle avec d’autant moins de scrupule que toujours elle le conduisait à manifester le miracle permanent dont il était le théâtre. Car ce n’était pas seulement à l’église qu’il s’enlevait de terre, c’était partout où le menaient ses pas. On rapporte qu’un prêtre Dom Antonio Chionello, se promenant avec lui dans un jardin, lui montra l’azur sans nuages et lui dit : — Frère Joseph, que Dieu a fait un beau ciel !… « A ces mots, comme si Dom Antoine l’eût invité à monter au ciel, le Saint pousse un grand cri, s’élève dans l’air et, d’un seul vol, va se poser à genoux sur la cime d’un olivier. La branche se balançait comme sous le poids d’un oiseau. Il resta là, ravi en Dieu, une demi-heure environ. Puis, revenu à lui, il demanda, d’un air embarrassé, à Dom Antonio comment il ferait pour descendre. L’ecclésiastique alla chercher une échelle et Joseph descendit. »
Une phrase du Saint révèle la violence de l’impulsion qu’il subissait chaque fois qu’il était projeté dans l’espace. Comme le cardinal Lauria lui demandait pourquoi il poussait une grande clameur en quittant le sol, il répondit : « La poudre de guerre, lorsqu’elle s’embrase dans l’arquebuse, éclate en un vaste bruit ; ainsi éclate mon cœur embrasé de l’amour divin. »
On comprend aussi que, favorisé d’une vue directe immédiate, presque continuelle de la Sainte Trinité, de la Vierge et des Saints, il ne pouvait se rendre attentif aux œuvres humaines. Pendant un séjour qu’il fit à Rome, l’évêque de Potenza, Mgr Claver le conduisit dans les sanctuaires célèbres et voulut lui faire admirer les tableaux et les statues qui les ornaient.
« Mais, raconte ce prélat, il marchait les yeux baissés au point de ne pas voir le pavé qu’il foulait. — Frère Joseph, lui dis-je, regardez donc toutes les merveilles qui nous entourent !… Il garda les paupières baissées et me répondit : — Je crois, je crois, je ne veux pas autre chose que ma foi… »
Non, le Saint n’était ni un esthète ni un amateur d’art. Il était mieux que cela : un grand poète vivant des odes sublimes au lieu de les écrire. Possédant le Paradis dans son âme, en quoi des peintures, même accomplies, des marbres, même supérieurement taillés, l’auraient-ils intéressé ? Au regard des images éblouissantes qui se succédaient en son esprit, les inventions les plus radieuses d’un Michel-Ange ou d’un Vinci ne pouvaient lui être que les volutes d’un brouillard importun. Il regardait sans cligner cet astre absolu : la Face de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Il n’avait donc pas besoin d’effigies forcément imparfaites pour s’en suggérer l’incomparable beauté.
Le don de lire dans les âmes se manifestait chez Joseph de deux façons : ou bien, d’un coup d’œil jeté sur le visage de ses interlocuteurs, il découvrait ce qui se passait dans leur conscience, les pensées les plus secrètes — celles dont on a honte vis-à-vis de soi-même — les tares les mieux dissimulées, les péchés d’habitude. Ou bien, constatant, en une seconde, l’état de péché mortel où ces âmes croupissaient, il sentait une puanteur se dégager d’elles, si virulente, qu’elle le suffoquait. Dans l’un et l’autre cas, il prévenait, sans ménagement, les coupables et les sommait de se purifier.
Mille récits avèrent cette clairvoyance redoutable. Voici le résumé de quelques-uns.
Un jour, en voyage, Joseph rencontra, fort à l’improviste, dans une auberge, un gentilhomme très satisfait de lui-même et qui, menant une vie assez régulière, suivant les idées du monde, n’éprouvait pas, disait-il, le besoin de se confesser, sauf à Pâques.
A dîner ce personnage expliquait, avec complaisance, qu’il était l’ordre même et se targuait d’une grande aptitude aux rangements. Joseph se lève, fait le tour de la table, vient se rasseoir tout contre le vaniteux et, lui dardant un regard aigu dans les prunelles, lui dit : « Mon ami, tes affaires ne sont pas bien rangées… » L’autre se récrie. Mais le Saint hochant la tête : « Crois-moi, mets de l’ordre dans ta valise !… »
Il n’ajouta rien. Mais le gentilhomme se sentit percé à jour. Il comprit, d’une intuition brusque, que sa quiétude orgueilleuse n’était pas justifiée et il courut au plus prochain confessionnal.
Une autre fois, Joseph croisa, sur une route, un garçon d’une vingtaine d’années, connu pour être un grand coureur de filles. Le Saint ne l’avait jamais vu, auparavant. Néanmoins, il s’arrêta, saisit le paillard au bras et lui dit à l’oreille : « Frère, tu as la figure très sale, va te laver. »
Aussitôt, comme dans un miroir, le jeune luxurieux découvrit la malpropreté dégoûtante de son âme. Il saisit le symbole, fit pénitence et mena, par la suite, une vie régulière.
Le Saint ne montrait pas toujours autant de ménagement. Souvent, c’était à haute et intelligible voix qu’il dénonçait le péché d’impureté. Sur quoi, quelqu’un lui ayant demandé ce qu’il entendait au juste par cette comparaison de la figure sale, il répondit : « Ce n’est pas une image ; les sensuels, je vois réellement leur visage noir comme du charbon. Leur saleté me fait souffrir et j’ai si fort envie de les voir blancs devant le Seigneur que je suis obligé de les avertir. »
En un cas du même genre, il nettoya de son ordure un domestique du cardinal Facchinetti qui était venu lui apporter une lettre de son maître.
L’ayant envisagé, il lui appliqua un léger soufflet en criant : « Tu n’as pas honte, attaché comme tu l’es à un excellent cardinal, d’avoir la figure aussi sale ? Vite, trotte te débarbouiller. »
Le messager alla se confesser et revint.
« A la bonne heure, dit le Saint, te voilà net, ne recommence plus. »
Quand c’était par l’odeur qu’il découvrait le péché, il dissimulait encore moins le dégoût qui lui soulevait le cœur.
Un dignitaire qui, sous des apparences de grande correction, s’adonnait à un vice contre nature, entra, un jour, dans sa cellule pour l’entretenir d’intérêts ecclésiastiques. A peine eut-il passé le seuil que Joseph se leva d’un bond et cria d’une voix terrible : « Tu pues ! Tu pues ! Au bain ! Au bain !… »
Et il ouvrit la fenêtre au large, en faisant signe à l’autre de s’éloigner et en se bouchant les narines.
L’interpellé qui avait précisément coutume d’observer une propreté raffinée sur son corps, s’offensa. Il se mit à protester. Mais Joseph le chassant du geste : « Comment veux-tu que je parle ? Tu m’empoisonnes !… »
Outré de colère, le sodomite se retira. Il méditait d’abord de se plaindre au Supérieur et de faire punir ce chétif moine qui lui avait manqué de respect. Mais la réflexion lui vint ; la grâce opéra. Il se sentit pénétré de terreur et de contrition et il réforma ses mœurs.
Comme nous l’avons vu, la seule tribulation que le Saint tentât d’écarter de lui, c’était la curiosité profane. Il lui déplaisait déjà beaucoup d’avoir, sans qu’il le cherchât, de pieux témoins de ses envolées et de ses ravissements. Il s’y résignait parce qu’on lui avait dit que la publicité de ces merveilles procurait souvent la gloire de Dieu. Mais il ne tolérait pas d’être visité comme une bête curieuse ou comme un phénomène bizarre. Quand le fait se produisait, il savait très nettement rabrouer ceux ou celles qui, par futilité, troublaient son recueillement et violaient sa retraite comme ils seraient entrés dans une baraque de la foire pour y contempler un veau à six pattes ou y admirer un charlatan expert aux tours de passe-passe.
C’est ainsi que, pendant son séjour au monastère d’Assise, il donna une leçon à quelques patriciennes aussi frivoles que chatoyantes.
La marquise de Médicis s’était formée une société d’un certain nombre de caillettes à particules. D’habitude, ces dames évaporées papotaient comme la pluie sur les toits. Entre elles, il n’était question que de fanfreluches à la mode ou des mérites langoureux de leurs sigisbées. Mais, je ne sais comment, certaine après-midi, le nom du frère Joseph fut prononcé. Toutes alors se mirent à cacouler ainsi que le font les oies à la picorée.
« Ma chère, dit l’une, c’est paraît-il, on ne peut plus amusant à regarder la suspension de ce moine.
— Si nous faisions la partie d’aller le voir ? proposa la marquise.
— Oui, oui, c’est cela ! Ce sera charmant !
— Seulement, afin d’être sûres de ne pas nous déranger pour rien, nous essaierons de provoquer son ravissement. On dit que c’est facile. On n’a qu’à prononcer le nom de Jésus ou celui de Marie et, tout de suite, le frère s’envole.
— Oh ! que c’est drôle… Vite, courons là-bas ! »
Aussitôt fait que dit. — Mais à peine la folle compagnie eut-elle franchi le seuil de l’église où le Saint se tenait en oraison que celui-ci, se retournant soudain, perçut, d’un regard, la niaiserie désœuvrée de ces âmes légères. Élevant la voix, il les apostropha d’un ton sévère : « Croyez-vous que je sois une grenouille qu’on fait sauter en lui tendant un chiffon rouge ? N’êtes-vous pas honteuses de venir ici par dissipation ? Dehors, dehors ! Et que Dieu vous pardonne !… »
La marquise de Médicis, déposant du fait, ajouta que cette algarade si justifiée l’avait convertie et termina son récit par ces mots : « J’étais confuse comme une poule mouillée et je conclus de l’incident que Frère Joseph pénétrait le secret des cœurs. »
Il le pénétrait, en effet, si bien que, parfois, quand les autres religieux sortaient de l’office — d’où, comme on l’a vu, son exubérance d’amour de Dieu l’exilait — il arrêtait l’un ou l’autre, disant à celui-ci : « Toi, tu as dormi pendant plus d’un quart d’heure. » A celui-là : « Toi, tu as pensé que toutes ces récitations étaient insipides. » A un troisième : « Pourquoi t’es-tu permis de feuilleter l’antiphonaire en bâillant au lieu de louer le Seigneur ? »
« Il ne se trompait jamais », déclarent les actes.
Enfin, pour souligner à quel degré d’acuité se portait sa clairvoyance touchant la vie intérieure de ceux qui venaient l’entretenir, citons un dernier fait.
Le Père Francisco, des Mineurs Observants, rapporte : « La première fois que j’allai conférer avec le Frère Joseph, quoiqu’il ne m’eût jamais vu, il me décrivit, point par point, tous les actes ou événements de mon existence et notamment des choses de conscience qui ne pouvaient être connues que de Dieu seul. Et il m’annonça, selon la plus exacte vérité, beaucoup de choses qui m’arrivèrent par la suite. Je puis ajouter qu’un de mes pénitents m’a confié, en dehors de la confession, qu’étant lié d’amitié avec le Frère Joseph, il éprouvait, en sa présence, une vive confusion, sentant que ce frère devait connaître un péché de sa jeunesse dont il s’était confessé depuis longtemps. Un jour, frère Joseph lui dit : — Si tu veux être sincère, je te dirai quelque chose. L’autre ayant autorisé à parler, le frère lui raconta la faute dont il s’agit, lui dit qu’il avait omis de s’en confesser d’abord, qu’il l’avait déclarée ensuite et que c’était à cause de ce souvenir qu’il avait honte en sa présence. Cet homme n’avait cependant confié son secret à personne. Il déclara à Joseph que tout cela était vrai… »
Un homme qui tutoie tout le monde, qui morigène les grandes dames, qui expose à la lumière les profondeurs fangeuses de certaines âmes, qui ne ménage aucun amour-propre, suscite forcément des haines et des rancunes. De plus, certains de ses confrères ne digèrent pas qu’il les reprenne pour leurs négligences à l’office ou pour leur dextérité à tourner, plus ou moins subtilement, la règle. D’autres le jalousent à cause de son action irrésistible sur les foules. Des piocheurs d’in-folio virent, avec mauvaise humeur, son pouvoir de ramener, en un tour de main, au bercail de l’Église force brebis vagabondes que les arguments de théologiens patentés n’avaient pu convaincre. Parce que le feu d’amour divin qui le brûle le fait danser de joie devant le Saint-Sacrement, des Pharisiens s’encolèrent. Des esprits pointus, qui contesteraient volontiers à Dieu le droit de se mêler des affaires de ce monde, lui font un grief de ses envolées et les tiennent pour des prestiges diaboliques. Enfin il froisse les uns par sa franchise, scandalise les autres par sa rusticité, inquiète les âmes routinières par les outrances de son zèle. Nous l’avons déjà dit : trancher sur l’ensemble ; c’est ce que n’importe quelle réunion d’hommes pardonne le plus difficilement aux grandes âmes et surtout à celles où habite l’Esprit-Saint.
Toutes ces malveillances, toutes ces rancunes, tous ces aveuglements, toutes ces vanités écorchées vives se coalisèrent et finirent par trouver un interprète. Ce fut un vicaire épiscopal dont Joseph avait eu l’occasion de flairer l’âme. Il la trouva malodorante et ne sut cacher l’impression pénible qu’il en ressentit.
Le vicaire furieux rédigea une dénonciation où l’injure alternait avec la calomnie. Les faits et les gestes du saint étaient présentés sous le jour le plus défavorable. Le libelle se terminait par ces mots : « En résumé, on voit circuler dans la province un braillard de trente-trois ans. Il se donne pour un autre Messie, traîne les populations après lui et les charme par de soi-disant prodiges que cette plèbe, incapable de discernement, accueille comme authentiques. J’ai cru qu’il fallait empêcher le mal de devenir incurable… »
Le vicaire cacheta sa lettre et l’envoya aux Inquisiteurs de Naples. Or, à peine la missive fut-elle partie que sa raison s’égara ; en même temps il tomba gravement malade. Pendant plusieurs jours, il divagua d’une telle force qu’on le jugea tout à fait aliéné. Dieu vengeait son serviteur. A l’article de la mort, par une grâce de miséricorde, le calomniateur recouvra son bon sens. Il confessa ses fautes, dit ses remords, avoua ses mensonges touchant le Saint et ne passa de vie à trépas qu’après avoir reçu les derniers sacrements.
Depuis assez longtemps, l’Inquisition tenait Joseph à l’œil. Il courait tant de récits contradictoires sur la personne du Saint, sur sa doctrine, ses actes et les merveilles dont il était l’instrument que les gardiens officiels de la foi en vinrent à le soupçonner d’hérésie et même de possession diabolique. La diatribe du vicaire leur fournit un motif d’examiner un personnage aussi déconcertant. Ils lancèrent un mandat d’information par lequel ils lui ordonnèrent de comparaître devant leur tribunal. Tandis qu’on l’examinerait, il serait détenu chez les Mineurs conventuels de Naples.
Le Supérieur du monastère de la Grottella se montra très affligé de cette mesure ; ayant eu le loisir d’éprouver la sainteté du Frère, il avait toujours fermé l’oreille aux insinuations des envieux et il admirait la blancheur absolue de cette âme qu’une grâce spéciale soulevait au-dessus des contingences humaines. Après avoir atermoyé, il communiqua la décision des Inquisiteurs à Joseph, il lui parla de temporiser. « J’écrirai au Saint-Office, conclut-il, et peut-être obtiendrai-je un contre-ordre. » Mais Joseph, dont la soumission à l’Église n’admit jamais de réserves, refusa tout délai.
« Il accueillit avec respect, dit son biographe, l’ordre du tribunal et, peiné qu’on en contestât la justice, il chercha, autant qu’il était en lui, à compenser l’hésitation du Supérieur par son empressement à se mettre en route. Les murmures de ceux qui soutenaient que l’offense faite à sa personne lésait la congrégation entière le trouvèrent insensible. »
Il quitta donc Cupertino, qu’il ne devait jamais revoir, le 21 octobre 1638. « Toute la bourgade et le pays environnant s’émurent. On s’abordait en pleurant et en criant : — Quelle perte nous faisons !… Cependant Joseph restait aussi calme que s’il fût allé à un triomphe. »
A Naples, les Mineurs Conventuels l’accueillirent assez mal. D’abord, le fait que l’Inquisition s’occupât de lui, le leur rendait suspect. Ensuite son « étrangeté » leur déplaisait comme un signe d’indépendance et presque comme un blâme des pratiques étroites où se confinait leur dévotion.
Joseph, étant d’une extrême sensibilité, souffrit de leurs rebuffades. Il ne se plaignit, ni ne récrimina. Mais il avait le cœur affreusement serré et il éprouvait un sentiment d’extrême solitude qui allait jusqu’à l’angoisse d’autant que, par surcroît, le soleil intérieur semblait avoir sombré dans des ténèbres irrémissibles. Ne plus sentir en lui la présence de Jésus c’était le pire malheur qu’il pût concevoir. Il se crut abandonné de Dieu. Et il passa des heures à verser des larmes silencieuses dans un coin de sa cellule. Mais comme il tâchait de balbutier une formule de résignation, saint Antoine de Padoue lui apparut dans une gloire et lui dit : — Réjouis-toi, Frère Joseph, Dieu t’aidera, la Mère de Dieu t’aidera, notre Père saint François t’aidera également !…
« Dès lors, il reprit sa gaîté coutumière ; rassuré par cette apparition, il se présenta hardiment devant le tribunal. »
Il eut à subir trois interrogatoires dont le secret n’a pas été révélé ; on sait seulement qu’ils furent minutieux et prolongés et que les juges furent témoins d’un ravissement et d’une envolée qui portèrent dans leur esprit la conviction que l’inculpé soumis à leur enquête n’avait rien de commun avec le Mauvais Esprit.
Ils proclamèrent donc, sans restriction, l’innocence de Joseph. Mais, en même temps, ils ordonnèrent qu’on lui fît quitter la région et qu’on le tînt désormais le plus possible à l’écart du monde.
Cette sentence permet de conjecturer que les policiers du Saint-Office ne tenaient pas beaucoup à favoriser la clairvoyance du Saint en ce qui touche l’état des âmes ; qu’elle continuât de se manifester à l’égard des laïques, ils n’y auraient peut-être pas trouvé trop d’inconvénients. Mais comme elle n’épargnait point le clergé, ils estimèrent, sans doute, que la hiérarchie, la discipline et le décorum auraient à en pâtir. Dieu avait choisi Joseph comme dénonciateur des péchés qui se dissimulent dans les consciences obscurcies. Les Inquisiteurs ne lui contestaient pas sa mission. Seulement, par l’effet d’une prudence peut-être trop — humaine, et aussi, par esprit de corps, ils firent le possible pour en entraver l’exercice — pour « mettre la lumière sous le boisseau ».
Ils envoyèrent le Saint à Rome ; il se présenterait au Père Larina, général de l’Ordre et lui remettrait une lettre qui contenait probablement des instructions dépourvues de mansuétude. En effet, le Père Larina reçut le Saint d’une façon très sèche, lui parla d’un ton sévère et « le traitant comme un coupable, lui assigna une étroite réclusion en attendant qu’on disposât de lui ».
Le Saint, qui goûtait fort les humiliations, y trouvant un remède à l’amour-propre, ne prononça pas un mot pour son apologie. Sûr d’aimer Dieu et d’être aimé de Lui, il accepta joyeusement son incarcération.
Quelques privilégiés ayant obtenu permission de le visiter, le plaignaient et s’étonnaient de sa soumission.
« J’obéis, j’obéis, répondit-il, tout va bien puisque Dieu fait que je me laisse guider par l’obéissance comme l’aveugle par son chien. »
Cependant le bruit de ses vertus se répandait de plus en plus dans Rome. C’est en vain qu’on épaississait les murailles entre les âmes et lui, Dieu se jouait de ces vaines précautions et faisait filtrer la lumière surnaturelle à travers les moellons qu’on lui opposait.
C’est ainsi qu’un prélat de la cour pontificale, Nicolas Albergati, eut occasion de vérifier qu’entre autres dons extraordinaires, le Saint possédait celui de prophétie. Voici son témoignage :
« Étant venu aux Saints-Apôtres dans la pensée de visiter le frère Joseph, je ne trouvai personne pour me conduire à lui, mais j’appris qu’il logeait près du clocher. Je montai un escalier et je me rencontrai en face avec un religieux qui, sans m’avoir jamais vu, me salua en ces termes, que je reproduis textuellement : — Eh ! comment un cardinal vient-il visiter un pauvre moine bon à rien ? L’humilité du langage de mon interlocuteur me fit supposer que ce pouvait être le frère Joseph. En effet, c’était lui. Je l’avertis que je n’étais pas cardinal. Mais il me répondit en riant : — C’est bon ! C’est bon ! Nous nous entretînmes environ une demi-heure et je me retirai très édifié.
« Le même jour, après dîner, j’étais chez moi. Un conventuel se fit introduire et se présenta comme le compagnon du frère Joseph. Il m’apprit que celui-ci venait de lui dire : — Un prélat, avec qui j’ai parlé ce matin, a semblé prendre en plaisanterie quelques mots de cardinalat. Nous verrons bientôt si je me suis trompé ou non.
« Je congédiai le religieux de la manière qu’eût fait à ma place tout homme sensé. La prédiction s’est pourtant vérifiée. »
En effet, quelques mois plus tard, Albergati fut promu cardinal par le pape Innocent X. Il ne s’y attendait nullement.
Les faits de ce genre se comptent en grand nombre dans l’histoire du Saint.
Cependant, quelque soin qu’on mît à le tenir au secret, Rome commençait à s’occuper de lui. Les cinq ou six ecclésiastiques qui parvinrent jusqu’à lui et qui l’entretinrent ne cachaient pas leur étonnement et leur admiration. D’autres l’avaient vu s’élever de terre à l’église. On en parlait dans tous les coins de la ville. Ces rumeurs et les commentaires qu’ils suscitaient arrivèrent aux oreilles du Pape qui voulut le voir.
C’était alors Urbain VIII, pontife très occupé de politique et qui montrait du goût pour les choses de la guerre. Il aimait à tracer des plans de fortifications, établissait des manufactures d’armes, fondait de l’artillerie, accumulait des munitions et recrutait des soldats.
Soit dit en passant, lorsque, au cours des âges, on rencontre de ces Papes guerriers que le soin d’accroître le domaine du Saint-Siège ou de le militariser absorbe à ce point, on ne peut s’empêcher d’éprouver quelque surprise. Car enfin passer des revues, conduire des sièges, livrer des batailles, tenir la poudre sèche et les sabres bien affûtés, est-ce un rôle qui convienne au représentant de celui qui a dit : « Je laisse ma paix avec vous, je vous donne ma paix ? » Si Notre-Seigneur avait approuvé les armes et les combats, après que saint Pierre eut coupé l’oreille droite de Malchus, il aurait peut-être prescrit à l’apôtre de lui trancher aussi l’oreille gauche. Au contraire, il fait remettre le glaive au fourreau, et il déclare : « Celui qui tire l’épée, périra par l’épée. » Pourquoi tels de ses Vicaires se sont-ils conduits comme si cette parole de l’Évangile était lettre morte ?
Je sais : il y avait le pouvoir temporel et, par suite, un domaine à sauvegarder. Mais précisément ces territoires il fallut les administrer, les défendre contre les convoitises des empereurs, des rois et des républiques ; certains papes cédèrent même à l’ambition de l’arrondir aux dépens du voisin. Or si l’on récapitule l’histoire de l’Église, on s’apercevra tout de suite qu’elle relate une série de catastrophes et d’humiliations, provenant, presque toutes, du fait que le Souverain Pontife assumait une double tâche : d’une part, mener au salut éternel les âmes de bonne volonté selon la tradition apostolique, d’autre part, guerroyer et politiquer comme si le royaume de Jésus-Christ eût été de ce monde.
Je me trompe peut-être mais il me semble que les désastres infligés sans cesse au pouvoir temporel et finalement le rapt des États romains par la maison de Savoie démontrent que Dieu n’approuvait guère ce dualisme.
Le pouvoir temporel n’existe plus. La Papauté s’en trouve-t-elle diminuée ? Nullement, car libéré du souci d’agir en prince de la terre vis-à-vis des princes de la terre, le successeur des Apôtres peut se donner, désormais, tout entier à sa mission surnaturelle.
Il y eut Jules II qui endossait la cuirasse, prenait des villes d’assaut, excommuniait tour à tour le Roi de France et les Vénitiens selon qu’il disputait à celui-là, ou à ceux-ci des provinces sur lesquelles ni lui ni ses compétiteurs n’avaient beaucoup de droits. — Et il y eut Pie X, le saint Pape, objet de notre vénération fidèle. Méprisant les finasseries diplomatiques, foudroyant l’hérésie, dénué de biens terrestres, riche de l’Esprit Saint il répandit un si large rayonnement sur l’univers spirituel que, depuis son décès, nous portons encore son deuil.
Pour en revenir à Urbain VIII, on doit reconnaître que, tout en donnant de l’attention à la stratégie, il ne négligeait pas entièrement le ministère des âmes. La réforme des ordres monastiques l’occupa. C’est pourquoi quand il apprit que Joseph était considéré par certains comme un élément de trouble dans la famille franciscaine, par d’autres, comme un modèle de sainteté que ses frères feraient bien d’imiter, il voulut examiner lui-même l’homme qui suscitait ces opinions contradictoires. Il commanda donc au Père Larina de le lui amener.
Le Général était bien revenu de sa méfiance à l’égard du Saint. C’est qu’en effet, un esprit droit ne pouvait le fréquenter un peu de temps sans rendre justice aux vertus incomparables que Dieu manifestait en cette âme. Excellent religieux, le Père se félicitait donc qu’un tel foyer d’amour divin flambât auprès de lui.
Le jour fixé pour l’audience arriva. Le Pape, entouré de deux prélats, se tenait assis dans l’une des salles du Vatican où Joseph et le Général furent introduits sitôt entrés.
Comme le Saint se prosternait pour baiser les pieds du saint Père, un de ces ravissements impétueux dont il avait coutume s’empara de lui. Il poussa un grand cri, quitta le plancher, et resta les bras étendus, les yeux au ciel, à la hauteur du chapiteau des colonnes qui supportaient la voûte.
« Pénétré d’une religieuse terreur, rapportent les actes, le Souverain Pontife se tourna vers le Général et lui dit : — Si frère Joseph meurt sous mon règne, je déposerai du prodige dont je suis témoin. »
Joseph ne redescendit sur le plancher que quand le Père Larina le lui eut commandé au nom de la sainte obéissance.
Le Pape, toujours fort ému, le congédia sans lui poser de questions. Mais, peu après, il ordonna de garder le Saint en réclusion dans un couvent de l’Observance, ailleurs qu’à Rome.
Quoique très peiné de perdre le Frère, le Général se hâta d’obéir et, donnant des instructions pour que sa clôture demeurât très étroite, il l’envoya dans un monastère d’Assise.
J’espère, dans les lignes précédentes, avoir fixé les principaux traits de la physionomie du Saint. Je ne m’étendrai donc pas sur les incidents qui marquèrent sa réclusion à Assise d’abord, puis à Petra Rubea, à Fossombrone et enfin à Osimo où il passa les dernières années de sa vie. Notons seulement que, partout, on le maintint en clôture et que, partout aussi, malgré les précautions prises pour le dérober à l’empressement des fidèles, les Grands comme la multitude venaient à lui, attirés par un aimant mystérieux, et rompaient toutes les barrières. Ses ravissements, ses envolées persistaient, soit devant témoins, soit qu’il fût seul dans sa cellule. Il continuait à faire des miracles, à lire dans les âmes. Il obtenait des conversions d’hérétiques — par exemple celle d’un duc de Brunswick, luthérien opiniâtre qui avait déconcerté la dialectique des théologiens les plus autorisés et qui fut conquis à la vraie foi par l’éloquence brûlante du prisonnier.
Tant de merveilles que Dieu opérait par l’humble moine auraient dû convaincre ses gardiens qu’ils n’avaient pas affaire à un possédé et les déterminer à lui rendre le libre exercice de sa mission. Mais point : ils reconnaissaient volontiers l’empreinte divine sur ses prodiges ; ils louaient l’orthodoxie de ses propos ; ils rendaient justice sans restrictions à ses vertus ; et, cependant, ils redoublaient d’efforts pour que l’éteignoir ne cessât de coiffer cet irréductible luminaire.
Le biographe de Joseph ne sait trop comment s’y prendre pour expliquer un aussi étrange entêtement. Faute de mieux, afin de ne froisser personne, il emploie des termes vagues et courtois.
Il écrit : « Le tribunal de l’Inquisition, qui avait constaté la sainteté de Joseph à Naples, et le pape Urbain VIII avaient, dans leur sagesse, jugé convenable et nécessaire de tenir un si riche trésor en réserve pour Dieu qui saurait manifester les œuvres de son serviteur. »
Fort bien. Seulement, lorsque mille faits eurent démontré cette sainteté jusqu’à l’évidence, pourquoi ne pas lui donner carrière ? Pourquoi prolonger pendant vingt-cinq ans une épreuve dont rien ne semble légitimer la rigueur ?
Avec quelque scrupule qu’on étudie les documents contemporains, on en revient toujours à la même conjecture : la faculté redoutable que Joseph possédait de lire dans le fond des cœurs gênait beaucoup de dignitaires du clergé, sans doute parce qu’ils savaient que leur propre tréfonds ne fournirait rien d’édifiant à la clairvoyance du Saint. Par suite, ne pouvant dissimuler à Dieu l’état de leur conscience, ils s’évertuaient, du moins, à le cacher aux hommes.
Cette hypothèse s’appuie sur l’histoire ; en effet, les chroniques nous apprennent qu’au temps où vécut Joseph, le sel de la terre, en Italie et surtout à Rome, s’était fort affadi.
La clôture que Joseph subit à Osimo fut encore plus stricte que les précédentes. Des cardinaux et des prélats irréprochables, qui l’aimaient tendrement, le vénéraient et répondaient de sa doctrine, étaient intervenus pour qu’on lui rendît sa liberté. Mais le Pape alors régnant, Innocent X, ne crut pas devoir les écouter. Il ordonna que le Saint eût une chapelle et un jardin à part, fût mis sous la surveillance d’un compagnon « spécialement choisi » et qu’on ne le laissât voir à personne sauf à quelques religieux du monastère « d’une discrétion et d’une sagesse éprouvées », disent les Actes. Ce régime insolite le laissa on ne peut plus paisible. Comme il l’avait toujours fait, il se soumit sans se plaindre ni demander le motif de sa captivité. Tous les matins, il se confessait, se préparait au saint sacrifice par une longue méditation puis disait sa messe avec un incomparable recueillement. Elle durait environ une heure « non compris le temps des extases ». Le reste du jour était employé tout entier à l’oraison, soit qu’il se tînt dans sa cellule, soit qu’il se promenât dans l’enclos qui lui était réservé. On lui apportait sa nourriture après le repas des Frères. Comme depuis longtemps son estomac ne supportait plus la viande, il avalait, debout, un peu de soupe maigre, trois bouchées de pain et quelques légumes cuits sans assaisonnement. Vu son état de faiblesse, le supérieur lui avait prescrit l’usage du vin. Par obéissance, il en prenait donc ; mais il ne put se résoudre à le boire pur et il le coupait largement d’eau.
Son gardien ne semble pas s’être beaucoup préoccupé de lui, car on a noté qu’à plusieurs reprises, deux jours de suite, il oublia de lui apporter à manger. Le Saint ne lui fit, d’ailleurs, aucune observation. Très probablement, il ne s’était même pas aperçu de cette négligence.
Tel quel, il s’estimait on ne peut plus heureux. A un religieux qui lui demanda s’il ne s’ennuyait point, il répondit : « — J’habite une ville, mais je me sens comme au fond d’une forêt ou plutôt je suis en paradis. »
A un autre qui l’interrogea sur l’emploi de son temps : « — Je me tiens en Dieu. » Cette brève indication suffit : il se tenait en Dieu, c’est-à-dire que, fondu, par anticipation, dans les splendeurs et les ferveurs de la Béatitude, il ne percevait plus les choses du monde que comme un amas de nuées confuses formant un cercle brumeux autour du lac de lumière où son âme demeurait immergée.
Il accueillait avec un sourire amical ses visiteurs mais il ne leur parlait pas beaucoup. Certains jours, il se contentait même de les inviter à chanter avec lui de petits cantiques ingénus qu’il avait composés.
Il avait alors la voix « merveilleusement claire et douce ». Ceux qui l’ont entendue disent qu’elle évoquait le tintement d’une cloche de cristal. Ils ajoutent : « Son chant faisait pleurer, excitait à l’amour de Dieu et révélait, on ne sait comment, l’infinie pureté de son cœur. »
Affable avec tous, le Saint avait pourtant un favori. C’était un chardonneret dont on lui fit cadeau. Il se garda de le mettre en cage : « Va, lui dit-il, jouis de la liberté que Dieu t’a donnée. Je n’exige de toi qu’une chose : quand je t’appellerai, tu viendras et nous louerons ensemble le Seigneur. »
Il en fut ainsi ; l’oiseau voltigeait à son gré dans le jardin, se posait tantôt sur un arbuste, tantôt sur la fenêtre de la cellule. Dès que Joseph l’appelait, il venait se poser sur son épaule et accompagnait de ses roulades les hymnes entonnés par le Saint.
C’est dans ce recueillement extrême, dans ce détachement de toutes choses que le saint passa les six dernières années de son existence. Au mois d’août 1663, il tomba malade d’une fièvre d’abord intermittente, bientôt continue qui eut promptement raison de son corps que la flamme d’amour insatiable qui brûlait en lui avait miné. On fit venir un médecin qui le tourmenta de saignées et de remèdes saugrenus. Joseph les acceptait docilement mais il avait un certain sourire qui signifiait qu’il ne se faisait pas d’illusion sur leur efficacité.
Quand on lui demandait comment il se sentait, il répondait, au début de sa maladie : — Le petit âne commence à gravir la montagne.
Plus tard, quand le mal s’aggrava : — Le petit âne a gravi la moitié de la montagne.
La veille de sa mort, il dit d’un ton enjoué : — Le petit âne est arrivé au sommet de la montagne ; il ne peut plus se traîner ; c’est ici qu’il va laisser sa pauvre dépouille.
Le 18 septembre il entra en agonie. La communauté se réunit dans sa cellule et voici comment les Actes rapportent sa fin :
« Il voulut recevoir le saint viatique, ce qu’il fit avec une piété angélique et des transports d’amour. Il demanda ensuite l’extrême-onction ; quand l’huile sainte toucha ses membres, il s’écria, d’une voix forte et sonore, malgré sa faiblesse : — Mon Dieu, quelle musique, quels parfums dans votre paradis… Je suis heureux !…
« Il se fit lire ensuite la profession de foi et demanda à ses frères le pardon de ses fautes envers eux. Mais tous versaient des larmes car nul n’avait rien à lui reprocher.
« A mesure que l’agonie faisait des progrès, le désir de quitter la terre s’accroissait chez le saint, car il répéta plusieurs fois la parole de Saint Paul : — Je désire être dissous, et être avec le Christ !…
« Après on récita, en langue vulgaire, l’Ave maris Stella. Le malade, qui avait toujours tant aimé la Madone, parut en éprouver du contentement et il chanta tout doucement un des cantiques qu’il avait composés : Salut ma Reine, ma rose sans épines ; prie pour moi, fille d’amour, que je ne meure pas dans le péché !
« Il s’abandonna ensuite à des mouvements et à des transports très animés. Interrogé si c’étaient des effets de l’amour de Dieu, il répondit que oui et il se mit à sourire avec une telle expression de ravissement que sa joie se communiqua aux assistants. Alors une splendeur éblouissante illumina son visage et, dans ce même moment il rendit sa grande âme à son Créateur. C’était quelques minutes avant minuit. Joseph avait soixante ans et trois mois. »
Un jour, prêchant sur la Trinité, le Saint prononça ces mots : « De même que le feu, substance une, produit continuellement la lumière et la chaleur ; de même la nature divine du Père produit continuellement la lumière qui est le Fils et en même temps la chaleur qui est l’Esprit. »
Cette phrase résume toute son existence. Parce que cette chaleur et cette lumière régnaient en lui, rayonnaient autour de lui, des âmes, qu’enveloppaient les glaces et les ténèbres du péché, le méconnurent et le persécutèrent. La prudence humaine disposa des écrans entre ce foyer d’amour et la multitude accourue pour se réchauffer à son contact. Joseph souffrait tout sans une plainte, sans un reproche. Il possédait Dieu ; que lui importait le reste ?
Au surplus, dès qu’il eut quitté la terre, ainsi qu’il arrive si souvent dans l’histoire des Saints, les méfiances, les rancunes et les préventions fondirent comme de la neige au soleil. A peine quelques années s’étaient écoulées que l’Église le plaçait sur ses autels. Et parmi ceux qui instruisirent le procès de canonisation, l’on retrouve quelques-uns de ses plus acharnés contradicteurs de naguère.
Il y a dans la légende du Saint un gracieux épisode qui semble une page détachée de la Légende dorée ou des Fioretti. On s’en voudrait de ne pas le rapporter.
Du temps où Frère Joseph vivait à la Grottella, il était souvent appelé au monastère des Pauvres Clarisses de Cupertino pour les besoins spirituels de la maison. Un jour, il dit, en souriant, aux Sœurs qu’il leur enverrait un petit oiseau afin de stimuler leur zèle. Et, en effet, le lendemain, elles virent un passereau d’espèce inconnue se poser sur la fenêtre du chœur. Il reparut tous les soirs et tous les matins ; il ne manquait aucun office. Et il accompagnait le chant des religieuses par une mélodie qui provoquait en elles la ferveur et l’émulation. L’office achevé, l’oiseau disparaissait. Il revint ainsi, tous les jours, aux mêmes heures, durant cinq années. Une insulte qui lui fut faite par une religieuse le mit en fuite. Les Sœurs s’en plaignaient.
« — L’oiseau a eu raison de s’en aller, dit Joseph, pourquoi l’avoir menacé ?… » Le Saint promit pourtant que le fugitif reviendrait. Et, en effet, l’oiseau reparut. Non seulement il se montra au chœur mais il y établit sa demeure. Il se perchait tantôt sur le cadre d’un tableau, tantôt sur un prie-Dieu et il se laissait caresser. Une des Sœurs lui ayant attaché un grelot à la patte, il resta encore deux mois dans le couvent ; mais le jeudi saint, il disparut et ne se montra ni le vendredi ni le samedi. Nouvelles plaintes au Frère Joseph.
« Le Saint répondit : — Je vous l’avais donné comme musicien ; il ne fallait pas en faire un sonneur de cloche. Maintenant il est allé veiller près du tombeau de Notre-Seigneur. Je le ferai revenir mais plus de grelot, n’est-ce pas ?
« Comme il l’avait promis le passereau revint le jour de Pâques et il n’abandonna le monastère que quand le Saint quitta lui-même Cupertino. »
Voici le physique du Saint d’après son biographe :
Joseph était d’une taille élevée et d’une conformation régulière. Sa charpente osseuse était très forte, ses muscles vigoureux. Son visage, aux traits fortement accentués, offrait, d’habitude, une expression de gaîté presque enfantine. Il avait les yeux noirs, perçants et lumineux. Ses cheveux et sa barbe, d’une teinte foncée dans sa jeunesse, blanchirent de bonne heure.
On ne connaît de lui nul portrait authentique, mais étant donné cet aspect robuste et viril, on espère que l’imagerie religieuse du XXe siècle s’abstiendra d’infliger à Joseph une de ces physionomies de crétin anémique et doucereux dont elle a pris la navrante habitude d’outrager les Saints.
La fête de saint Joseph de Cupertino se célèbre le 18 septembre. L’office est celui des confesseurs non-pontifes avec un introït, une oraison, un offertoire et une communion propres.
L’oraison fait allusion aux envolées du Saint et commence ainsi : O Dieu qui, après que votre Fils unique eut été élevé de terre, avez voulu attirer tout à Lui…
L’offertoire se rapporte à ses prisons ; le voici : Pour moi, pendant qu’ils me tourmentaient, j’étais couvert d’un cilice ; j’humiliais mon âme par le jeûne et je répandais ma prière dans mon sein.
On invoque saint Joseph de Cupertino pour le succès des examens.
Il y a quelques années, je fus attiré vers Catherine de Cardonne par sainte Térèse qui, au XXVIIIe chapitre du Livre des Fondations, en parle avec de grands éloges et rapporte qu’elle lui apparut, en vision intellectuelle, à une époque où la Réformatrice du Carmel subissait de fortes entraves à sa mission. La Sainte résume, en quelques traits saillants, la vie de cette solitaire puis elle ajoute :
« Je la vis sous la forme d’un corps glorieux, entourée de plusieurs anges. Elle me dit de ne pas me lasser de fonder des monastères et de continuer mon œuvre. Je me sentis remplie de joie et du désir de travailler pour Dieu. »
Ce qui m’avait particulièrement frappé, dans ce récit, c’était la fuite de Catherine au désert et, aussi, le fait que, vêtue en homme, elle avait eu la part principale dans la fondation d’une communauté de Carmes déchaussés.
Je voulus en savoir plus long. Mais, tout d’abord, j’eus beau m’enquérir, interroger l’un, l’autre, parmi les experts en histoire ecclésiastique, personne ne se trouva pour me procurer les renseignements dont j’étais avide. Dans ces cas-là, on dirait que les documents mettent une sorte de malice à se dérober aux recherches.
Je commençais à me décourager et je n’y pensais presque plus, lorsqu’ils me furent mis sous la main d’une façon tout à fait fortuite.
Je séjournais alors dans une abbaye de Cisterciens mitigés dressant son clocher pointu, cerné de pins et de cyprès, au centre de cette île Saint-Honorat qui désigne l’entrée du golfe de Cannes.
Il y avait là une bibliothèque fort bien garnie où, grâce à l’obligeance des bons religieux, j’avais reçu l’autorisation de pratiquer des fouilles. Se plaire aux livres cela console d’être obligé de fréquenter les hommes. Je passais donc des matinées à fureter de rayons en rayons. Parfois je me tenais à quatre pattes pour déchiffrer les titres des in-folio massifs qui s’alignaient dans la pénombre au ras du plancher. Plus souvent, grimpé au sommet d’une échelle roulante, je cueillais un volume sur une tablette du haut. Si le contenu m’intéressait, je restais perché des heures, comme un merle sur une branche. L’échelle craquait et oscillait ; mais je ne m’avisais pas qu’il serait beaucoup plus confortable de descendre, emportant ma trouvaille, et de m’asseoir sur l’une des quatre chaises qui se miraient dans le parquet luisant de cire de la longue salle.
A cette époque, le forçat de la plume que je suis, ayant conquis quelque loisir, n’était point tracassé par le souci de prendre des notes ni de jeter des lambeaux palpitants de ses pensées en pâture aux rotatives voraces. Je lisais, sans méthode, pour mon plaisir, happant six lignes ici, un chapitre là, ouvrant un livre, le balayant d’un coup d’œil, le remettant en place pour passer à un autre, puis à un troisième, selon le caprice du moment ou le hasard des rencontres.
Comme j’étais tranquille ! La vie, cette chape de plomb qui pèse sur nous d’un poids si rude, s’allégeait. Le Père bibliothécaire, retenu par des offices fréquents, ne faisait que de rares apparitions. Il s’occupait, bouche close, à des rangements et ne m’adressait la parole que s’il me trouvait le nez en l’air, les mains ballantes, rêvassant dans le vide. Alors, il m’indiquait, en quelques mots, tel émouvant recueil fleuri de légendes où il estimait que je découvrirais de quoi me parfumer l’âme.
En dehors de ces brèves apparitions, je demeurais l’unique habitant de la cité des bouquins. Ainsi que le recommande l’Imitation, je me tenais in angello cum libello, « dans un petit coin, avec un petit livre » heureux d’oublier les vaines agitations du siècle et ses tapages ridicules. Le silence bienfaisant m’enveloppait d’une atmosphère veloutée, à peine rompu par de graves sonneries de cloches appelant la communauté à tierces ou à sexte ou par une grosse mouche absurde qui, furieuse de s’être fourvoyée là, bourdonnait à travers la salle et se cognait contre les vitres, à la recherche d’une issue.
Trois larges fenêtres donnaient sur la mer. Mais je ne m’y accoudais pas souvent car je goûte peu cette Méditerranée dont l’inertie et l’azur invariable semblent bien monotones à qui connut les marées grandioses et les nuances sans cesse changeantes de l’Océan.
Ce ne fut pas du temps perdu celui que je consumai dans cette chère bibliothèque : à force d’en feuilleter les livres, je me formai un petit musée intérieur où s’alignaient, gravées à l’eau-forte, d’austères physionomies de Saints, de fines miniatures à l’aquarelle, enlevées sur fond d’or, de Bienheureuses suaves et de ces tableaux des vieux âges où le sang des martyrs ruisselle en pourpre glorieuse.
Un jour, j’aperçus dans un coin une armoire à panneaux pleins que je n’avais pas encore explorée. Je l’ouvris et je tombai sur un pêle-mêle de livres débrochés, entassés là pour la reliure. Un in-quarto gris, tout poussiéreux, tout frippé faisait saillie au-dessus du tas. Je le tirai, j’essuyai la poudre qui le déshonorait et je lus ce titre : Histoire générale des Carmes et des Carmélites de la réforme de sainte Térèse, composée par le R. P. François de Sainte-Marie, carme déchaussé.
Il y avait cinq tomes, tous plus délabrés les uns que les autres. J’en ouvris un à l’aventure et, à la première page, je trouvai ceci : livre quatrième contenant la vie de Catherine de Cardonne et la fondation du couvent de la Roda.
C’était une aubaine, étant donné que, depuis longtemps, je battais les buissons, en quête de détails sur cette femme extraordinaire.
Tout content de ma découverte, j’emportai les volumes dans ma cellule et je me mis, sans retard, à les lire — non seulement celui qui traitait de la Solitaire mais les autres, parce qu’ils parlaient longuement de sainte Térèse. Car j’ai une telle prédilection pour la lumineuse vierge d’Avila, je dois tant à ses œuvres que je m’assimile avec joie tout ce qui se rapporte à son existence et à son action.
D’ailleurs, l’écrit du bon Père François de Sainte-Marie est d’une lecture fort attrayante. Cet Espagnol raconte avec une exquise bonhomie des choses admirables et, de plus, comme il est imprégné d’humanisme, il émaille ses phrases d’allusions aux poètes grecs et latins, de comparaisons empruntées à la Fable qui leur donne une saveur toute particulière. Cela fait que sa narration ressemble un peu à un eucologe dont les pages seraient naïvement encadrées de nymphes et de muses d’après l’antique.
Voici un exemple de sa manière. Évoquant la Mère Anne de Saint-Augustin, religieuse éminente du Carmel de Villeneuve de la Xara, il s’écrie : « Si Théocrite a pu écrire que Lacédémone, après avoir donné le jour à Hélène, qui cependant fut la cause de la ruine de Troie, n’avait plus besoin d’autre gloire, que ne nous est-il pas permis de dire de celle qui a si merveilleusement édifié l’Espagne ? »
Je vous le demande, Théocrite appelé en témoignage de la sainteté d’une moniale ne fournit-il pas, en effet, un argument décisif ? Il faudrait être affligé d’une dévotion bien revêche pour n’en point convenir.
Tel quel, le pieux, docte et ingénu biographe m’enchanta de tous points. C’est donc d’après les notes que je pris sur sa relation, sur quelques autres documents et aussi d’après mes songeries alentour que je vous offre une esquisse — au fusain — de cette amoureuse un peu farouche de Notre-Seigneur : Catherine de Cardonne.
Catherine de Cardonne naquit à Naples en 1519. Elle était la fille illégitime d’un seigneur Raymond marquis de Padulé et d’une demoiselle dont la chronique a cru devoir taire le nom, tout en mentionnant qu’elle était proche parente de la princesse de Salerne. L’enfant perdit sa mère de très bonne heure ; le père ne se souciant pas de la reconnaître, elle fut recueillie par la princesse qui lui donna une gouvernante et la fit élever dans un coin de son palais.
François de Sainte-Marie, après avoir cité Euripide et Platon, qu’on ne s’attendait pas à rencontrer en cette histoire, rapporte que dès son bas âge, elle montra ce goût de la solitude qu’elle devait manifester si largement plus tard. Contemplative et douée déjà pour l’oraison, elle fuyait les réunions et les fêtes et passait volontiers les nuits assise au bord de la mer. Elle admirait le reflet des étoiles sur les eaux. Peu à peu, à force de s’absorber dans cette ombre murmurante où tremblaient des lueurs argentées, son âme se détachait de la terre pour monter se perdre amoureusement en Dieu.
Dans le courant de l’existence, c’était une petite fille très silencieuse chez qui l’on remarquait une grande dévotion à la Vierge, un attrait caractérisé pour les cérémonies de l’Église et une extrême charité à l’égard des indigents.
Elle avait huit ans lorsque Dieu lui donna un premier signe des grâces qu’il lui réservait. Elle se tenait en prière dans son oratoire. Soudain, son père, mort depuis peu, lui apparut tout enveloppé des flammes du Purgatoire et paraissant souffrir beaucoup. L’enfant le reconnut tout de suite. Elle eut d’abord si peur qu’elle voulut s’enfuir. Mais alors une voix intérieure lui dit qu’il n’y avait là, ni trouble de son imagination, ni prestige diabolique et que la vision était véritable. Rassurée, elle se remit à genoux et demanda : « Mon père, que désirez-vous que je fasse pour vous ? »
L’âme, élevant une voix lamentable, lui répondit : « Ma fille, j’endure un cruel tourment et je le subirai jusqu’à ce que tu aies satisfait pour mes péchés. »
Catherine, toute brûlante, elle-même, de compassion promit de le faire. Et, en effet, s’étant procurée secrètement la clef du grenier, elle alla s’y cacher plusieurs jours de suite et s’infligea des disciplines si rudes qu’elle se mit le corps tout en sang. La douleur lui arrachait parfois des cris. Mais, comme elle l’avait calculé, l’endroit était trop retiré pour que personne vînt mettre opposition à sa pénitence. Aussi, corroborant son martyre de ferventes prières, elle obtint la délivrance de son père. Un soir de la semaine suivante, il lui apparut de nouveau, tout resplendissant de lumière et lui dit : « Ne fais plus rien pour moi, ma fille ; Dieu accepte tes souffrances et je vais maintenant au ciel jouir de sa gloire. »
Ensuite, il lui prédit qu’elle serait fiancée mais qu’elle ne se marierait pas et qu’elle se donnerait toute au service de Jésus-Christ qui ressentait pour elle une tendresse particulière.
A la suite de cette œuvre de rachat, Catherine sentit que son amour de Dieu allait augmentant sans cesse. Elle s’y donna d’une façon si généreuse que son détachement du monde et sa faculté d’oraison mentale s’en accrurent. Vis-à-vis du prochain, elle se montrait si prévenante et si douce que tout le monde l’aimait. On lui reprochait seulement son goût de la retraite, ses habitudes taciturnes et le peu de cas qu’elle faisait de la toilette.
Comme elle touchait à sa treizième année, elle fut demandée en mariage. Certes ses avantages extérieurs n’y entraient pour rien, car elle était de complexion chétive et disgracieuse quant à la démarche. En outre, elle offrait aux regards un teint basané, de petits yeux en pépins de pomme, un long nez assez pareil à un bec de flûte, des dents ternes et mal rangées et des bras maigres qui ressemblaient assez aux fuseaux des filandières.
Mais le gentilhomme qui sollicita sa main, la voyant en faveur auprès de la princesse, estimait que, par cette union, il se pousserait à la cour du vice-roi et obtiendrait quelque emploi lucratif.
Catherine refusa d’abord son consentement. La princesse s’en irrita. Par son ordre, l’entourage et particulièrement la gouvernante du palais poursuivaient la jeune fille de représentations excessives. On lui peignit sa répugnance pour le mariage comme une ingratitude à l’égard de sa bienfaitrice ; on lui servit l’argument que, bâtarde, laide et pauvre, elle devait s’estimer très heureuse du mari fort imprévu qui s’offrait à elle. Bref on l’obséda d’une façon si opiniâtre que, de guerre lasse, elle finit par céder.
Elle a dit depuis que, suivant l’assurance qui lui avait été donnée par son père dans la vision rapportée ci-dessus, elle espérait que le mariage n’aurait pas lieu. Et même si elle devait en passer par là, elle pensait persuader à son mari qu’ils vécussent ensemble comme sainte Cécile le fit avec son époux. Elle ajoutait en riant : « Ce n’aurait pas été un grand sacrifice pour lui car voyez ma figure !… »
Mais les choses n’allèrent pas si loin. « Le fiancé, dit le Père François, ne se possédait pas de satisfaction. Sa joie fut de courte durée. Peu après, Dieu lui envoya une douleur de côté. Éclairé d’en haut, il comprit que son mal était grave, se résigna chrétiennement et fit une sainte mort que les mérites et les prières de sa vertueuse fiancée ne contribuèrent pas peu à lui obtenir. »
A la suite de ce décès, Catherine, craignant de nouvelles sollicitations matrimoniales et sentant s’augmenter son aversion pour le monde, obtint de sa protectrice la permission d’entrer dans un couvent de Capucines comme résidente laïque. Elle ne voulut, d’ailleurs, pas prendre le voile. Car, à cette époque, la vocation religieuse ne la sollicitait nullement. Et elle éprouvait déjà cet éloignement pour les communautés de femmes qui, plus tard, comme nous le verrons, fit d’elle non une Carmélite mais — un Carme.
Chez les Capucines, sa vie spirituelle devint de plus en active ; ses journées et souvent ses nuits étaient toutes d’oraison. Elle demeurait si perdue en Dieu que, quand les circonstances l’obligeaient de donner quelque attention aux choses de l’extérieur, ce n’était qu’avec un pénible effort qu’elle parvenait à y fixer sa pensée.
Un prodige montra bientôt à quel point le ciel la favorisait. Un soir de Noël, les moniales chantaient matines dans le chœur du haut de leur église. Selon ses habitudes d’indépendance, durant cet office, Catherine se retira dans le chœur d’en bas et s’agenouilla devant un autel que surmontait une statue de la Vierge à l’Enfant. Tandis qu’elle priait, il lui vint un tel ravissement d’amour qu’il lui sembla qu’elle allait défaillir.
« Tout à coup, dit son biographe, la sainte Mère détacha son Fils de son sein virginal et, l’ayant posé sur la table de l’autel, elle joignit les mains en signe d’adoration, puis inclina sa tête royale pour exprimer le même sentiment. A cette vue, interdite, transportée d’étonnement, Catherine se mit à pousser des cris si forts que les religieuses interrompirent les matines et descendirent en toute hâte. Quand, à leur tour, elles aperçurent l’Enfant sur l’autel et la Mère en adoration, elles unirent leurs voix à celle de Catherine et remplirent le saint lieu de louanges et de bénédictions. »
Catherine aurait souhaité qu’on gardât le secret sur ce miracle. Mais les religieuses ne l’écoutèrent pas et se hâtèrent d’en répandre le bruit dans la ville. A partir de ce moment, les Napolitains tinrent la jeune fille pour leur médiatrice auprès de Dieu et ils furent persuadés que sa présence parmi eux leur portait bonheur.
Catherine serait peut-être restée jusqu’à sa mort dans ce monastère, si la politique n’était venue modifier le cours de son existence.
Le royaume de Naples se trouvait alors sous la domination espagnole. L’homme le plus influent du pays était le prince de Salerne. Croyant avoir à se plaindre des procédés de la Cour de Madrid à son égard, il entraîna quelques membres de la noblesse dans une conjuration pour émanciper sa patrie. Afin d’accroître ses chances de réussite, il demanda au roi de France une aide en troupes et en argent, lui affirmant qu’en retour, Naples et son territoire accepteraient volontiers sa suzeraineté.
Le complot fut découvert presque aussitôt que formé. Le prince de Salerne, averti de son arrestation imminente, prit la fuite et se réfugia en France. Ses domaines furent confisqués et une condamnation à mort prononcée contre lui.
Les rigueurs ne s’arrêtèrent pas là. Comme la princesse de Salerne, femme de beaucoup d’esprit et d’une rare beauté, réunissait autour d’elle une société nombreuse et choisie, on insinua au roi d’Espagne qu’elle formerait sans doute le dessein de continuer les intrigues de son mari. La suggestion n’était pas justifiée car la princesse n’avait cure de politique. Mais Philippe II était d’un caractère trop ombrageux pour ne pas accueillir ces soupçons. C’est pourquoi il lui donna l’ordre de se rendre à Valladolid en lui faisant entendre que Naples ne la reverrait jamais plus. Résister à la volonté royale, il n’y fallait pas songer. Or l’exil semblait d’autant plus dur à la princesse que, parmi les nombreux gentilshommes, dames d’honneur et domestiques qui constituaient sa maison, elle n’en distinguait aucun qui fût d’esprit assez judicieux pour l’aider à se diriger dans le milieu nouveau où force pièges l’attendaient.
L’idée lui vint alors d’emmener Catherine avec elle. Ayant eu lieu d’apprécier le jugement droit et l’esprit de décision qui constituaient les qualités principales de sa protégée, elle n’hésita pas à lui proposer de la suivre en Espagne.
Mais Catherine refusa tout net : « Il n’est pas à propos, dit-elle, que je sorte de cette sainte maison, où je vis retirée, comme c’est ma vocation pour m’en aller à la cour. Ce serait, pour moi, retomber tristement du ciel sur la terre. Madame, la manière de vivre qu’il me faut à moi, c’est la solitude d’un ermite, loin du monde. Parmi les tumultes des courtisans, je vous serais un embarras plutôt qu’un appui car là-bas, c’est l’art de mentir qui est en faveur et moi, je ne sais pas dissimuler mes impressions. Souffrez donc que je reste ici. »
J’ai tenu à citer les propres paroles de Catherine en cette occurrence parce qu’elles ouvrent un jour significatif sur sa personnalité. On y sent une âme volontaire, éprise d’indépendance, rebelle aux conventions sociales. Déjà l’on peut pressentir qu’elle ne reculera devant rien lorsqu’il s’agira d’assurer sa solitude en Dieu.
La princesse ne se tint pas pour battue. Elle revint à la charge avec les plus vives instances : « Considérez, dit-elle, ma jeunesse, les dangers de la cour, la licence des courtisans, la malignité des langues. Votre compagnie me sera un soutien dans mes chagrins et une sauvegarde pour mon honneur. Votre réputation de vertu me mettra bien dans l’esprit du Roi. Voyant auprès de moi une personne telle que vous, il comprendra que je ne médite aucune entreprise contre son pouvoir. »
Des raisons aussi pressantes ne laissèrent pas d’ébranler Catherine. D’autre part, de bons prêtres et des dames pieuses de l’entourage ayant joint leurs sollicitations à celles de la princesse, la recluse finit par admettre qu’elle avait un devoir de conscience à remplir. Sans argumenter davantage, elle accepta le rôle difficile de chaperon d’une jeune femme en butte à toutes sortes de convoitises et de jalousies.
Le voyage se fit aussitôt ; et les deux exilées arrivèrent à Valladolid dans le courant de l’année 1557. Catherine avait donc alors trente-huit ans.
Aussitôt installée à la cour, la princesse déploya le plus grand luxe. La richesse de ses ameublements, l’abondance de sa table, ses profusions la firent considérer comme une sorte d’arbitre des élégances. « C’était, dit le Père François, le culte de l’or et de la pourpre. » Comme, en outre, elle était douée d’une beauté piquante et qu’elle montrait beaucoup de brillant dans la conversation, force galantins de la noblesse et même les princes de la maison royale s’empressèrent autour d’elle. Dès lors, ce ne furent que réceptions, festins, promenades, gambades, sérénades et roucoulades.
Catherine blâmait cette existence dissipée et ne ménageait pas les reproches à sa parente, lui rappelant qu’elle était la femme d’un banni et que sa situation commandait de la réserve. Mais la princesse, gâtée par les flatteries de ses adulateurs, prit assez mal la réprimande. « J’ai soin de vous tenir toujours auprès de moi, dit-elle, et vous m’accompagnez chaque fois que je sors ; cela ne vous suffit-il pas ? Voudriez-vous que je me confine dans un coin de mon palais, sans voir personne ? Je mourrais d’ennui s’il me fallait partager les austérités où vous vous complaisez ! Au surplus, je ne fais rien de mal et je n’entends pas me donner le ridicule de rabrouer ceux qui me trouvent bien et qui me le disent avec politesse. Ayez donc l’obligeance, à l’avenir, de garder vos observations pour vous… »
Ce n’était pas ainsi que Catherine avait envisagé leur séjour à Valladolid. Certes elle n’avait jamais conçu le dessein de transformer la princesse en une de ces affolées de dévotion qui collent aux confessionnaux comme de la glu et qui se croiraient sur la pente de la damnation si elles cessaient une minute d’égrener des patenôtres. Mais elle estimait que la réputation et peut-être aussi la vertu de sa jeune, jolie et inconséquente cousine couraient bien des risques parmi les godelureaux qui jabotaient et faisaient la roue dans ses salons.
Rebuffée, elle n’insista point. Cependant, elle redoubla de vigilance, car, désespérant d’inculquer à la princesse l’à-propos d’une vie plus retirée, elle appréhendait quelque étourderie qui la perdrait auprès du Roi. C’est pourquoi elle se promit de se mettre en travers chaque fois que les madrigaux élèveraient leur température à l’excès.
Le cas se produisit à de fréquentes reprises. Et, toujours, Catherine asséna aux soupirants quelqu’une de ces phrases en coup de trique dont elle avait coutume. Si bien que les seigneurs la traitaient, entre eux, de vilaine corneille croassante. Mais ils n’osaient pas le lui dire parce qu’il y avait dans l’attitude de ce bout de femme un je ne sais quoi d’imposant qui les obligeait de baisser le nez dès qu’elle les regardait seulement en face.
Parmi les empressés autour de Mme de Salerne, on remarquait un jeune prêtre nommé Augustin Cazalla. Il était fort bien fait de sa personne et possédait une grande réputation comme prédicateur. Par contre, des gens bien informés l’accusaient de mœurs dissolues et les théologiens suspectaient, non sans motif, l’orthodoxie de sa doctrine. Le fait est qu’il avait adopté, en secret, les principes de l’hérésie luthérienne et qu’il s’appliquait, sous des formes prudentes, à la propager. Il développait le plus souvent en chaire cette proposition de Luther :
« La foi nous sauve sans les œuvres » et le corollaire : « le péché nous domine ; quoi que nous fassions, nous ne saurions nous abstenir de le commettre ; mais la loi morale (cause de notre chute, parce que nous ne pouvons l’observer) le Christ l’a accomplie pour nous. Il suffit donc de croire en lui pour être sauvés. »
On voit tout de suite à quelle corruption peut mener ce sophisme. C’était bien sur quoi comptait Cazalla qui, au fond, n’avait pour objectif que de dépraver ses admiratrices afin d’en faire les jouets de sa sensualité.
Bien entendu, dans ses sermons comme dans ses entretiens particuliers, il se gardait d’afficher crûment ses opinions. Il les dissimulait sous une phraséologie pompeuse ou les diluait en métaphores melliflues. Par exemple, dit le Père François, « il exagérait la miséricorde de Dieu, le bonheur et les avantages de la foi qui ne raisonne pas avec les passions. Sans cesse, il exaltait les mérites de Jésus-Christ et les satisfactions qu’il a offertes pour nous. Il exagérait les fruits de la Rédemption et soutenait qu’elle nous a libérés de tous nos péchés et de toutes les peines qui leur sont dues. A l’entendre, le christianisme n’était plus qu’affranchissement et licence. En outre, jamais il ne soufflait mot de l’obligation de faire pénitence, de la nécessité de la confession, de la soumission aux commandements de Dieu, aux lois de son Église. Toute sa doctrine n’était qu’un poison présenté dans une coupe d’or. Et avec cet appât, il séduisit tous ceux qui prétendent élargir la voie étroite et sont toujours à la recherche de directeurs complaisants au vice. »
Comme Cazalla était fort à la mode auprès des dames de la Cour dont un grand nombre ne juraient que par lui, la princesse, « moins versée en fait de religion qu’en pratiques mondaines », s’engoua de l’adroit hérétique. Celui-ci s’aperçut rapidement de l’influence qu’il prenait sur cette tête légère. Il multiplia ses visites et, sous couleur de haute spiritualité, enguirlanda la jeune femme de propos mignards où ses charmes extérieurs étaient vantés comme le symbole des perfections de son âme.
La princesse, enchantée de ce marivaudage érotico-théologique, n’en apercevait point les périls. Mais Catherine veillait. Tout d’abord, son sens droit et surtout les lumières que Dieu lui donnait, lui avaient fait distinguer l’impiété foncière et la malfaisance de la doctrine que prêchait Cazalla. Mais elle se tint encore bien plus en garde quand elle eut démêlé à quelles sales convoitises aboutissaient tant de discours fleuris.
Aussi, chaque fois que l’hypocrite venait au palais, elle se tenait assise à côté de la princesse, ne la quittait pas d’une minute, réfutait, en quelques mots secs et méprisants, les aphorismes équivoques, et dardait sur le rhéteur un regard si aigu que celui-ci s’en trouvait tout déconcerté.
La pauvre princesse fort peu clairvoyante n’aperçut dans la façon d’agir de Catherine qu’un manque aux convenances mondaines. Se piquant, elle-même, de politesse raffinée, elle prit un jour à part sa cousine et lui reprocha vivement ses mauvaises manières à l’égard d’un « si éminent docteur ».
Mais Catherine ne se laissa pas intimider.
« — Madame, dit-elle à la princesse, un loup se cache sous la peau de cette brebis. Prenez garde, on vous recommande l’amour de Dieu sans la crainte ; cela conduit à l’abîme. Rappelez-vous que si, une fois, Notre-Seigneur a découvert sa gloire, toute sa vie ne fut qu’abnégation, croix, pénitences, pauvreté. Quand on cherche à vous persuader le contraire, on vous trompe par un calcul ignoble. Ce malheureux prétend flatter le corps de Votre Excellence et moi je veux le bien de votre âme. Puisque vous m’avez arraché à ma retraite pour cet office, souffrez que j’y travaille. Je ne me tairai pas, car un sentiment intérieur m’avertit que cet homme porte la marque de Satan. Bon gré, mal gré, il faut que je le crie ; et puissé-je vous garantir de ses entreprises !… »
La princesse qui, très sincèrement, ne se croyait pas en danger, taxa de bigoterie intolérante la méfiance de Catherine. Puis sans insister davantage, elle haussa les épaules et rompit l’entretien.
Mais Cazalla en voulait terriblement à cette maîtresse-femme qui l’avait percé à jour. Il résolut de se venger. A cet effet, le lendemain, en chaire, il prit pour texte la parole de saint Paul : Taceat mulier in ecclesia et la développa non d’après l’enseignement traditionnel mais pour invectiver contre les impudentes qui osaient se mêler d’enseignement religieux. Il appuya longuement là-dessus ; et comme, tout en défilant ses périodes, il ne quittait pas Catherine des yeux, nul ne douta de son intention de lui administrer une humiliante leçon.
Durant tout le sermon, Catherine était demeurée impassible. Mais quand, le même soir, Cazalla se présenta au palais, elle eut un mouvement de répulsion tellement accusé que l’hérétique, qui pensait l’avoir matée, lui demanda, d’un ton goguenard, si elle avait peur de lui.
Catherine le considéra un bon moment avec une expression de physionomie qui marquait autant d’horreur que de pitié. Puis, comme il renouvelait sa question, elle lui dit, en détachant ses mots : « Vous êtes perdu ! Tandis que vous parliez, Dieu m’a montré des tourbillons de feu sortant de votre bouche et j’ai senti l’odeur de l’enfer… »
L’hérétique, prenant cet avertissement terrible pour une expression de rancune arrachée à l’orgueil blessé, reprit avec dérision : « Bah ! bah ! si vous avez réellement vu des flammes sortir de ma bouche, ce devaient être celles du Saint-Esprit ! »
Ce blasphème ne réduisit pas Catherine au silence. Elle joignit les mains et, les yeux fixes comme si quelque vision formidable se reflétait en ses prunelles, d’une voix basse mais très distincte, elle répéta : « C’était le feu de l’enfer… Vous êtes perdu ! »
A ce coup, Cazalla se sentit envahi d’une terreur insurmontable. Il se leva en s’écriant : « Madame, taisez-vous ! »
Mais à peine avait-il poussé cette clameur qu’il pâlit, chancela, balbutia et, soudain prit la fuite comme si le Mauvais étendait déjà sa griffe sur lui.
Aussitôt la princesse et les dames présentes firent cent reproches à Catherine. Et même les domestiques la blâmaient à la sourdine. Mais la voyante ne se laissa pas émouvoir. On eut beau lui dire qu’elle était bien osée de vilipender ainsi un docteur applaudi par le grand monde, elle secoua la tête en répétant : « Il ne prêchera plus ; il brûle et il brûlera. »
« Toutes ces femmes, écrit le Père François, furent mécontentes ; dans leur simplicité, elles criaient au scandale. »
Néanmoins, l’événement ne tarda pas à sanctionner la prédiction de Catherine. Depuis un certain temps, l’Inquisition menait, en grand secret, une enquête sur Cazalla. Non seulement la preuve fut acquise de ses mauvaises mœurs mais encore on découvrit qu’il avait formé, avec deux de ses frères et trente autres personnes, une intrigue pour faire pénétrer l’hérésie luthérienne en Espagne. Des mesures avaient été prises en conséquence.
Le samedi suivant, Cazalla fit annoncer qu’il prêcherait. L’église où le sermon devait être prononcé était pleine de ses admirateurs. Pendant la messe, Mme de Salerne et ses amies raillaient Catherine entre elles et lui donnaient à entendre, par des clignements d’yeux et de petits mots aigres-doux, qu’elles n’étaient pas loin de la tenir pour une illusionnée. Catherine, sans rien perdre de son calme, se contenta de répondre : « J’ai vu et vous verrez. »
Au moment où l’on pensait que Cazalla allait sortir de la sacristie pour monter en chaire, on vit arriver, à sa place, un familier de l’Inquisition annonçant, à haute voix, qu’il était inutile d’attendre le prédicateur parce que le Saint-Office venait de l’arrêter.
Le redoutable tribunal donna, par la suite, une grande publicité aux raisons de doctrine et d’ordre social qui motivaient l’arrestation. Il en résulta que les partisans de Cazalla s’aperçurent avec effroi que, par ignorance ou étourderie, ils avaient failli se compromettre en soutenant un ennemi de l’Église. Ils se hâtèrent de le renier avec ensemble.
Le renom de Catherine s’en accrut. « Les gens du palais, dit le biographe, éprouvaient un peu de confusion ; ils apprenaient à reconnaître la faveur que Dieu leur avait faite en plaçant, parmi eux, une personne qui avait l’esprit de prophétie. » Quant à la princesse, comprenant enfin à quel danger elle venait d’échapper, elle ne cessait de remercier Catherine et la suppliait de lui pardonner d’avoir méprisé ses avertissements.
« Remercions Dieu seul ; il m’a fait voir ce qui allait arriver, répondit Catherine, et prions pour ce malheureux… »
Le procès de Cazalla et de ses complices dura plus d’un an. A la fin, ils furent condamnés, livrés au bras séculier et brûlés vifs sur la grande place de Valladolid, le 21 mai 1558. Ainsi s’accomplit, point par point, la prédiction de Catherine : — il brûle (déjà du feu de l’enfer), et il brûlera (bientôt sur le bûcher).
En ce temps-là, on ne badinait point avec l’hérésie. N’empêche qu’on peut tenir pour atroces et répugnants les procédés de l’Inquisition. Elle eût enfermé Cazalla, dont les erreurs se prouvaient génératrices d’anarchie et de corruption, la chose aurait été fort admissible. Mais le faire cuire, c’était préparer un sujet de déclamation aux sectateurs de la déesse Raison qui aiment fort guillotiner leurs adversaires mais qui s’indignent quand ceux-ci les mettent en grillades. En résumé, la barbarie obtuse des rôtisseurs comme celle des coupeurs de tête apparaissent, j’imagine, également abominables au regard de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
L’engouement prolongé de la princesse de Salerne pour la faconde de l’hérétique l’avait desservie auprès de Philippe II. D’autre part, l’esprit de méfiance qui caractérisait ce roi lui faisait voir d’un mauvais œil l’empressement des grands seigneurs autour d’une jeune femme dont la beauté, le charme et l’entrain lui semblaient des moyens d’intrigue contre les prérogatives de sa couronne. Comme en outre, elle s’estimait lésée par la confiscation des biens de son mari et qu’elle ne s’en taisait pas, il craignit qu’elle ne se formât un parti de Napolitains séditieux et de Castillans frondeurs qui ne tarderait pas à nouer quelque complot. Très probablement, primesautière et versatile, la princesse ne songeait à rien de pareil. Mais pour Philippe II, soupçonner et sévir c’était tout un.
C’est pourquoi, un jour qu’elle était venue lui rendre hommage, il lui déclara, d’un ton rogue, qu’il fallait qu’elle quittât, sur-le-champ, Valladolid et se rendît, pour n’en plus sortir, à Tolède. Il ajouta qu’il se chargeait lui-même de veiller sur ses intérêts et qu’il prendrait soin d’expliquer que la cause de cet exil n’entachait en rien son honneur.
« Cette sentence, dit le biographe, malgré le vernis d’or dont elle était revêtue, frappa la princesse d’un coup mortel qui, en peu de temps, la conduisit au tombeau. La langue d’un roi est un glaive acéré et le souffle de sa bouche tue ceux qui placent leur félicité en ce qu’on appellerait mieux leur malheur. »
Avant de mourir, la princesse fit un testament où elle recommandait au roi les personnes de sa maison. Philippe pourvut, d’une façon convenable, au sort des subalternes. Quant à Catherine de Cardonne, il la tenait depuis longtemps en grande estime et il n’avait pas oublié la clairvoyance surnaturelle dont elle avait fait preuve contre Cazalla. Désireux de s’attacher une personne aussi avant dans la faveur divine, il lui commanda de quitter Tolède et il la plaça, comme surintendante, chez son ministre favori don Rui Gomez de Silva. Non seulement elle y aurait la haute main sur la domesticité mais encore elle dirigerait l’éducation des deux infants : don Juan d’Autriche — frère naturel de Philippe et futur vainqueur de Lépante — et le prince héritier don Carlos.
Catherine avait espéré que, la mort de la princesse la libérant d’obligations subies à contre-cœur, elle pourrait se retirer dans quelque monastère. Mais elle n’osa se dérober aux ordres du roi. Rui Gomez, homme fort pieux et qui admirait l’extrême ferveur de Catherine, constata bientôt que les pratiques de la dévotion ne l’empêchaient nullement d’administrer, avec un ferme bon sens, la fortune dont elle avait reçu le soin. Il la pria donc d’ordonner toutes les dépenses du palais et de veiller aux revenus.
Catherine accepta moyennant trois conditions : on lui attribuerait un logement à l’écart où elle pût se créer une retraite loin du mouvement de la Cour ; le ministre lui laisserait prendre, sur les fonds dont elle assurerait la gérance, de quoi faire l’aumône aux hôpitaux, soulager les malades, marier des orphelines indigentes et donner aux pauvres des aliments ; enfin, elle arrangerait sa propre existence à sa guise, sans qu’on lui fît d’observations.
Le ministre souscrivit à tout. Il n’eut pas lieu de s’en plaindre, car sa fortune prospéra. « Il avait coutume de dire que depuis que Catherine exerçait l’intendance de sa maison, ses biens s’accroissaient chaque jour. »
Libre de ses actes, et tout en remplissant avec une parfaite exactitude son office, Catherine s’organisa la vie ascétique et pénitentielle où la portait son amour de Dieu.
Sa nourriture se réduisait à peu près à rien. Elle ne mangeait jamais de viande, jeûnait quatre fois par semaine, se contentant, ces jours-là, de quelques feuilles de chou cuites à l’eau avec une pincée de sel. Souvent même, elle ne prenait rien. D’autres fois, elle pétrissait un peu de farine qu’elle faisait cuire sous la cendre. Elle couchait sur une paillasse peu garnie et ne portait que des chemises de bure rousse. En dessous, un cilice rude comme râpe ou une chaîne de fer nouée autour des reins.
Chaque jour, elle récitait les psaumes de la pénitence, l’office des morts, celui de la Sainte Vierge et celui du Saint-Esprit. Elle s’était fabriqué une discipline à crochets dont elle se déchirait les épaules.
Un soir, elle se flagellait si rudement que Rui Gomez, entendant le sifflement des lanières, crut qu’elle allait se mettre en pièces. Il vint à sa chambre pour la prier de se ménager. Mais, comme il avait la main sur la poignée de la porte, il se rappela la promesse qu’il avait faite de ne jamais entraver la pénitente dans l’exercice de son zèle. Il s’en retourna chez lui, plein d’épouvante et de vénération.
« Cet exemple, écrit le Père François, fit sur lui une impression si salutaire que, depuis ce moment, il s’attacha à imiter son intendante pour la discipline et pour la vertu. Ceci fut cause que Catherine lui voua beaucoup d’amitié. » Ce qu’elle aima surtout en lui, ce fut son inépuisable charité. « Elle disait souvent que les aumônes du ministre lui servaient de sauvegarde contre les embûches de ceux à qui sa grande élévation inspirait de la jalousie et que, plus tard, elles lui abrégeraient les peines du purgatoire, ce qui arriva en effet. »
Ce fut une tâche assez ardue pour Catherine que celle de former le caractère des jeunes princes. Don Juan se montrait d’une turbulence excessive. Quant à don Carlos, sa faiblesse d’esprit confinait presque à l’imbécillité. A force de soins et par un habile mélange de douceur et de fermeté, elle réussit pourtant à leur inculquer des habitudes religieuses. Elle avait surtout à combattre en eux l’orgueil du rang que les flatteries de l’entourage tendaient sans cesse à développer. Si, dans ce sens, elle obtint quelques résultats, ce fut par la franchise un peu bourrue de ses réprimandes.
Une anecdote révélera sa méthode.
Elle gardait, dans une armoire, des pâtisseries sèches et des confitures qu’elle leur donnait pour leur goûter. Or un jour, poussés par la gourmandise et profitant de son absence, les princes s’entendirent pour piller la cachette. La trouvant fermée, ils enfoncèrent la porte avec une telle violence qu’ils brisèrent les pots et les assiettes. Il s’ensuivit un gâchis de marmelades et de sirops où s’enlisaient les biscottes et les gaufrettes. Ils contemplaient, tout effarés, le dégât lorsque Catherine survint.
D’un coup d’œil, elle saisit ce qui venait de se passer. Alors, sans élever la voix mais sur un ton sévère qui fit trembler et rougir les enfants, elle leur dit : « Je m’étonne que Vos Altesses, qui auront un jour à commander les hommes, se soient conduits comme des valets sournois. J’espère que ceci vous servira de leçon et qu’à l’avenir le souci de votre dignité vous empêchera de vous ravaler de la sorte… »
Comme, lorsqu’ils se conduisaient bien, les princes la trouvaient pleine de tendresse et de sollicitude, ils la prirent en affection. « Ils l’appelaient mama », dit, avec bonhomie, le biographe.
Par tout ce qui précède, nous pouvons maintenant nous représenter la personne morale de Catherine en ses traits essentiels : une volontaire exempte des faiblesses habituelles à son sexe ; une intelligence droite en qui le bon sens s’alliait à ce don d’ordre surnaturel : le discernement des esprits.
Sans doute, quelques-uns la jugeront malgracieuse, un peu trop… virago. Mais il ne faut pas demander à un pommier sauvage et qui repousse la greffe de porter des pêches d’espalier. Et l’on verra bientôt qu’étant prédestinée à fournir un exemple d’ascétisme, elle n’eût jamais réalisé ce que Dieu attendait de son énergie si elle avait souffert que le contact du monde ébréchât l’acier bien trempé de son âme.
Appréciée du Souverain, possédant la confiance du premier ministre, gouvernante des Infants, on l’enviait et on l’adulait. Mais elle avait un sens trop aigu de la réalité pour se laisser prendre aux surfaces. Sous la politesse des gens de cour, elle apercevait de bas calculs et des abîmes de vilenie. Pleine d’un dédain viril — qui n’allait pas sans quelque pitié — elle jugeait à sa valeur la société chatoyante qui bruissait autour d’elle.
« Ici, se disait-elle, sous l’écorce de la douceur, les paroles cachent le fiel de la haine. Ceux qui se prétendent amis sont autant de traîtres occupés à se nuire les uns aux autres. On se baise mutuellement les mains et l’on voudrait se sucer le sang. On reçoit un affront comme une faveur, avec l’espoir de le rendre au double. Quiconque ne déguise sa pensée doit s’attendre aux pires iniquités. Il n’est pas de turlupin juché sur des tréteaux hasardeux qui égale ces courtisans dans l’art de feindre des sentiments qu’ils n’éprouvent pas. Et leur religion !… Un masque d’hypocrisie sur des visages que ronge une lèpre de vices. Et le roi, lui-même : avec toute la puissance dont il est investi, son élévation lui devient une chaîne qui en fait l’esclave de ses flatteurs. Il se repaît de fumées et de vent ; mais, au fond, il sait bien que personne ne l’aime… Ah ! l’horrible existence que celle de tous ces malheureux : quelques années à papilloter dans l’illusion, puis le cercueil et la pourriture !… Ils pourrissent déjà. Et quelles âmes ils vous apporteront à juger, Seigneur ! »
Cependant, le soleil divin, qui rayonnait dans son âme, lui prodiguait sans cesse de nouvelles lumières pour la détacher du monde. De plus en plus, il lui dessillait les yeux ; de plus en plus il embrasait son cœur, l’illuminait et l’inclinait vers la vie dans la retraite ; — souvent, il lui montrait, environné d’une gloire éblouissante, Jésus au désert.
Si violemment qu’elle se sentît sollicitée de fuir la cour, Catherine éprouvait de l’éloignement pour la clôture dans un monastère de femmes. D’une façon indicible, elle se rendait compte que Dieu la voulait ailleurs. — Où cela ? Elle ne parvenait pas à le distinguer. Et puis, du point de vue purement humain, que de barrières à franchir pour se dégager du labyrinthe où elle tâtonnait encore ! Obtenir l’agrément du prince Ruy Gomez, il n’y fallait pas songer ; en parler au roi, elle n’osait. Consulter des amis ? Elle ne s’en connaissait point qui fussent assez sincères pour lui donner un conseil désintéressé. Parmi ses relations, chacun craindrait de déplaire au maître en l’encourageant au départ.
C’est ainsi que, suivant ses propres termes « la lumière qui brillait en elle lui devenait une cause d’incertitudes et une source de ténèbres ».
Dans cette angoisse, un jour qu’elle se sentait encore plus triste que de coutume, elle se prosterna devant Dieu, en un transport de larmes et de prière, et le supplia, d’une façon si véhémente, de l’éclairer, que la divine Charité se laissa émouvoir. Notre-Seigneur lui répondit par la bouche d’un Crucifix qu’elle portait sur elle : « Va, je t’aiderai. Quitte la cour. Refugie-toi dans une caverne où tu vaqueras librement à l’oraison et à la pénitence. »
Ces paroles si nettes lui remplirent tout d’abord l’âme de consolation. Mais le Démon, qui déteste tout héroïsme, intervint alors et, selon sa tactique coutumière, se servit de son imagination, comme d’une loupe, pour lui grossir les obstacles et la pousser au découragement.
Sous son influence, elle balança :
« Vivre en ermite, se dit-elle, jamais je n’en aurai la force. Et puis je suis femme et, par conséquent, exposée à toutes sortes de dangers si je me retire dans une campagne isolée. Ensuite, où entendre la messe ? A qui me confesser ? Prendre un parti aussi extraordinaire sans consulter serait imprudent. Or si je consulte, on me refusera l’autorisation car quelle apparence qu’on me permette de résider toute seule au désert ? Si je ne consulte pas, on pourrait, à juste titre, m’accuser de témérité. »
Après bien des alternatives, elle décida enfin de tout dire à son confesseur habituel. Celui-ci était un prêtre mondain, routinier, inapte à diriger les âmes généreuses et que toute aspiration d’ordre élevé offusquait comme un outrage au sens commun.
« En ce temps, écrit le biographe, le clergé séculier était devenu d’une telle timidité, il avait mis si complètement en oubli les grandes grâces dont Dieu s’est plu à combler les saints et les saintes qui ont mené la vie érémitique, qu’un pareil dessein parut une folie au confesseur. Ni la pureté d’âme de Catherine, ni ses hautes vertus, ni la droiture de ses intentions, ni les miracles que Dieu avait faits en sa faveur, ni même la réponse qu’elle avait reçue de la bouche de Jésus-Christ ne firent impression sur lui. Il déclara qu’il y avait là une illusion diabolique. »
D’autres prêtres, à qui Catherine soumit son projet, conclurent de même. Aucun n’admit qu’elle préférât la solitude à la situation brillante qu’elle occupait.
Catherine, ainsi blâmée, faillit renoncer à son projet. Mais elle ne recouvra point la paix : son âme restait troublée car les appels de Dieu se faisaient toujours plus pressants.
Elle eut alors l’inspiration de consulter le Père François de Torrès, de l’Ordre des Frères mineurs, qui avait une grande réputation de ferveur et de sagesse. « Assuré de la volonté divine par des entretiens prolongés avec Catherine, il approuva son dessein, laissant à son choix et aux circonstances que le temps amènerait le moyen de l’exécuter. »
A la même époque, elle eut l’heureuse fortune de rencontrer saint Pierre d’Alcantara qui, « pénétrant dans les immensités de la lumière du Seigneur, dédaignait les clartés vacillantes de la fragile raison humaine ». Non seulement le Saint entra dans ses vues mais encore il l’encouragea à réaliser son projet sans retard et lui promit de l’aider de ses prières.
Alors Catherine n’hésita plus.
Lorsqu’elle avait pris un parti, elle n’était point femme à en différer l’exécution. Elle décida d’abord de se couper les cheveux et de revêtir un habit masculin. « Sainte Eugénie et sainte Euphrosyne ont fait ainsi, se disait-elle ; si, grâce à ce déguisement, elles ont pu vivre, sans péril, parmi les hommes, pourquoi ne serais-je pas garantie comme elles dans les montagnes ? » Et quand il lui revenait de légers doutes sur le genre de vie où Dieu l’appelait, elle ajoutait : « Ces inspirations si fortes, si continues, si pressantes que je ressens ne peuvent venir du démon, elles sont trop contraires à ses intérêts. Elles ne viennent point non plus de la chair qui a tout à perdre dans ce projet, ni du monde dont elles me poussent à fuir la frivolité. Mon Dieu, puisque c’est vous qui me parlez, et puisque je fais mon possible pour vous obéir, prenez-moi par la main et conduisez-moi dans la solitude où il vous plaira que je vous serve… » Elle fut exaucée et voici comment.
Don Rui Gomez venait d’acheter une bourgade nommée Estréméra et il fut obligé de s’y rendre afin d’en régler l’administration. Catherine lui demanda de l’accompagner dans le but de prendre quelque repos car l’éducation des infants la fatiguait beaucoup. Le ministre, qui goûtait fort sa compagnie, ne manqua pas d’acquiescer d’autant que, la sachant d’esprit judicieux, il comptait qu’elle lui donnerait des conseils pratiques pour l’organisation de son nouveau domaine.
Pendant ce séjour à Estréméra, Don Rui reçut la visite d’un Père Piña, prêtre de grande vertu qui, après avoir fait le pèlerinage de Rome, menait une existence retirée dans la montagne au-dessus du village. On le disait très éclairé en ce qui concerne les voies extraordinaires. Catherine le connaissait un peu, lui ayant jadis fait l’aumône à Valladolid. Son arrivée en ce moment lui persuada que Dieu l’envoyait pour l’aider dans l’accomplissement de ses désirs.
Aussitôt, elle lui demanda un entretien particulier. Dès qu’il fut auprès d’elle, elle se sentit toute pleine de confiance en lui. Elle lui conta sa vie et lui décrivit son oraison. Ensuite elle lui exposa son dessein sans oublier de faire valoir que le Père François de Torrès et saint Pierre d’Alcantara l’approuvaient.
Elle conclut : « Les difficultés qui me restent à vaincre ne sont pas insurmontables. Il ne me manque plus qu’une chose, c’est qu’un homme de Dieu me prête son appui et consente à m’accompagner dans la recherche d’un endroit solitaire parce que je ne connais pas le pays. Une voix intérieure me dit que c’est vous qui devez être mon guide dans cette entreprise. Pour cela, il me faut une tunique de bure semblable à celle que vous portez vous-même et un capuce comme celui des religieux. Mon visage maigre, brun et assez laid m’aidera à dissimuler mon sexe. J’ai la voix forte la démarche masculine, de la suite dans les idées, de l’énergie ; tout cela n’est pas d’une femme et contribuera certes à mon déguisement. D’ailleurs Dieu lui-même, qui me sollicite d’une façon si puissante, nous aplanira la route[3]. »
[3] Le plus souvent, ici comme ailleurs, je reproduis les propres expressions de Catherine dans le récit qu’elle fit par la suite de sa vocation. — Ce qui la spécialise, c’est l’opinion peu favorable qu’elle se donnait des femmes. On l’aura remarqué, et nous aurons l’occasion de le constater encore.
Le Père Piña, si expérimenté qu’il fût quant aux effets de la Grâce sur les âmes de bonne volonté, admira cette intrépidité jointe à tant de confiance en Dieu. Toutefois, pour ne rien hâter, il fit quelques objections que Catherine réfuta sans peine. Alors, plus qu’à demi convaincu, il lui demanda trois jours afin de réfléchir et de prier.
Ce délai à peine écoulé, il revint et dit à Catherine qu’il se tenait à son entière disposition. Par son conseil, un ancien chapelain de Rui Gomez nommé Martin Alonso fut mis dans le secret. Celui-ci, natif de la Roda, au diocèse de Cuenca, indiqua, dans son pays, certains endroits qui conviendraient à une anachorète et promit, avec joie, son aide pour assurer la fuite de Catherine. Il fut décidé que les deux prêtres, après l’avoir accompagnée la laisseraient, déguisée en homme, dans la solitude et s’en retourneraient chacun chez soi en gardant un parfait silence sur l’expédition. Par la suite, Martin Alonso viendrait la voir de temps en temps et lui apporterait quelques provisions.
Le soir du jour fixé pour son départ, Catherine écrivit une longue lettre au prince Rui Gomez. Elle lui exposa les motifs qui l’obligeaient de quitter la cour ; elle s’efforça surtout de lui faire comprendre que ce n’était pas un caprice qui dictait sa résolution mais qu’elle obéissait à l’appel de Dieu. Elle termina en le conjurant, au nom de leur amitié et des services qu’elle lui avait rendus, de ne point faire de recherches pour la retrouver, le prévenant que, même si l’on découvrait son refuge, elle ne consentirait jamais à revenir et irait se cacher ailleurs.
La lettre fut placée en un endroit où il était facile de l’apercevoir. Ensuite, la nuit étant tout à fait venue et tout le monde dormant dans le palais, elle se disposait à rejoindre ses deux confidents qui se tenaient blottis, sous un porche dans une rue voisine, quand un obstacle se présenta auquel la fugitive n’avait pas pensé ; les portes de la maison étaient fermées à double tour et elle n’en possédait point les clefs. Elle résolut alors de passer par une des fenêtres du rez-de-chaussée ; mais voici que des barreaux de fer les garnissaient.
Comme elle restait perplexe, elle vit soudain le Crucifix qu’elle portait suspendu au cou s’élever devant ses yeux et elle l’entendit lui dire : Suis-moi. Et en même temps, sans qu’elle pût se rendre compte de la façon dont le miracle s’opérait, elle se trouva dehors.
Ravie d’admiration, débordante de reconnaissance, elle s’encourut à toutes jambes vers ses deux compagnons de route. Ceux-ci, en l’attendant, avaient été partagés entre la crainte et l’espérance. Prêtres de bonnes mœurs, inexpérimentés quant aux enlèvements, ils avaient passé deux heures à trembler au moindre bruit. Le craquement des chaussures d’un passant attardé, les vocalises d’un chat en escapade galante, le friselis de la chute d’une feuille, tout leur donnait l’alerte. Ils ne respirèrent à l’aise que quand ils virent Catherine poindre dans l’ombre.
Dès qu’elle eut repris haleine, elle leur raconta le prodige dont elle venait d’être favorisée. Ils se récrièrent d’allégresse, disant qu’il y avait sûrement là un nouveau signe que Dieu approuvait sa fuite.
A la clarté de l’aube naissante, ils lui coupèrent les cheveux et l’aidèrent à s’habiller en ermite. Puis se partageant le bagage sommaire de Catherine, ils prirent, en hâte, le chemin de la solitude cependant que l’évadée murmurait cette prière : « Seigneur, puisque ma retraite est l’œuvre de votre droite, puisque vous m’avez exemptée des faiblesses de la femme, gardez-moi une âme virile afin que je reste toute à vous, à jamais. »
Après quelques heures de marche, ils arrivèrent à la chapelle de Notre-Dame d’Altamira, desservie par un prêtre duquel Catherine, s’étant confessée, reçut la communion. De là, ils gagnèrent Cuenca et demandèrent à l’évêque d’autoriser l’anachorète à se fixer dans son diocèse. Le prélat, qui prit Catherine pour un homme glabre et assez vilain d’aspect, donna son consentement sans difficulté.
S’étant ainsi mis en règle, les voyageurs reprirent la route de la Roda. Ils commençaient à gravir la pente d’une montagne, quand Catherine s’arrêta net en disant : « C’est ici que Dieu m’ordonne d’établir ma demeure. N’allons pas plus loin. »
Martin Alonso fit d’abord un peu d’opposition, alléguant qu’on n’était pas arrivé à l’endroit qu’il avait en vue. Mais Catherine refusa de poursuivre et le Père Piña l’appuya. « Il faut, affirma-t-il, qu’elle suive son inspiration. » Alonso en tomba d’accord et mit fin à ses objections.
Ils cherchèrent quelque caverne où la solitaire pût s’abriter des intempéries. Mais ils ne découvrirent, au milieu d’un épais taillis de cistes, de lentisques et de chênes verts, qu’une excavation « plus propre à servir de tanière à un renard que de logis à un ermite. L’entrée en était fort basse et l’intérieur si exigu en hauteur comme en largeur qu’il y avait à peine la place pour une personne même d’une taille aussi petite que celle de Catherine. » Or elle déclara que ce terrier lui convenait de tous points.
Les prêtres tressèrent alors, avec des tiges de genêts flexibles, une claie qu’ils appliquèrent contre l’ouverture de façon à dissimuler l’entrée aux passants. Puis cette sorte de tombeau ainsi accommodé, ils prirent congé de Catherine en la bénissant et en lui laissant trois pains.
« Trois pains, s’écrie le père François, voilà donc toute la provision de celle qui avait connu les mets de la table du roi ! Eh bien, elle éprouva plus de satisfaction à les manger avec des fruits sauvages que devant les plats raffinés de naguère. »
La « tanière » était située sur le territoire de Vala de Rei, à deux lieues de la Roda, à une petite distance de la rivière du Jugar et à une demi-lieue du monastère de la Fuen-Santa édifié quelques années auparavant, par les religieux Trinitaires dans cette solitude[4].
[4] On trouvera l’emplacement de ces diverses localités et de la « tanière » de Catherine sur la carte placée dans le livre des Fondations, tome IV des œuvres complètes de sainte Térèse, édition des Carmélites de Paris (1909).
C’est en l’an 1562 que Catherine s’établit de la sorte au désert.
Une fois seule à mi-côte de cette montagne déserte, Catherine se sentit tout inondée de joie. Son âme baignait dans la chaude lumière intérieure qui lui faisait sentir la présence de Dieu. Il lui sembla que la nature se transfigurait autour d’elle ; et parce que Notre-Seigneur lui permettait de souffrir à son exemple pour le rachat des péchés qui déforment la pauvre humanité, sa gratitude s’exhala en un cantique véhément dont voici à peu près les versets :
« O monde, je te donne un libelle de divorce ! Adieu, hommes d’autant plus acharnés à vous nuire que vous vivez plus près les uns des autres. Adieu l’égoïsme, l’avarice, l’envie, la luxure dont la puanteur me suffoquait pendant que je dépérissais parmi vous. Avec l’aide de la Vierge, des anges et des saints, je ferai une telle pénitence que Dieu l’acceptera peut-être en compensation de vos égarements ; et si Jésus m’octroie la couronne d’épines, les fouets de sa flagellation, les clous rédempteurs je ne cesserai pas de les lui offrir pour le salut du troupeau des âmes qui courent vers le feu de l’enfer comme les moutons vers l’abreuvoir.
« Vous, arbres qui frémissez doucement, qui ployez sous l’étreinte fraîche des brises, vous m’apprendrez à m’incliner au souffle du Saint-Esprit. Oiseaux harmonieux, c’est selon vos cadences que je chanterai notre Créateur. Rivière, tu seras mon amie et mon institutrice. Tu m’apprendras à chercher l’amour divin comme tu cherches la mer, ton principe et ton centre. Je me perdrai en Dieu comme tu te perds dans l’océan pour y mourir et y trouver une nouvelle vie. Terre qui, toujours foulée aux pieds, ne cesse malgré cela de nous prodiguer tes dons, comme toi je rendrai aux hommes le bien pour le mal qu’ils m’ont fait. Toi, Soleil, de même que tu répands ta clarté sur tous les mortels sans distinction, tu me verras prier pour les bons comme pour les méchants.
« Seigneur, rends-moi docile à tes lois immuables, fais que je te serve avec autant d’innocence que ces créatures de ta bonté : le soleil glorieux, la rivière miroitante, les oiseaux diaprés comme un arc-en-ciel, les arbres pleins d’ombres transparentes et d’ors mouvants.
« Jésus, je suis à toi, je suis avec toi, je suis en toi comme tu es à moi, avec moi, en moi !… »
Cette effusion passionnée montre que ce ne fut point une misanthropie hargneuse qui poussa Catherine au désert mais bien la plus ardente charité. Elle fuyait les hommes pour mieux les aimer. Appliquant cette grande loi de compensation qui, comme nous l’apprennent les Mystiques inspirés, règle toutes choses en ce bas monde, elle souffrait pour ceux qui se révoltent contre la souffrance. L’esprit dont se nourrissait sa pénitence est indiqué par ceci que, d’après son propre témoignage, son oraison portait d’habitude sur la retraite de quarante jours que Notre-Seigneur fit au désert et sur son abandon au Jardin des Olives.
« Je le voyais si seul, dit-elle plus tard, si affligé sous la résille de sang qui lui couvrait la figure, que je me blottissais à ses pieds, que je fondais en larmes et que je lui demandais de me faire souffrir comme Lui afin qu’il me fût permis d’expier le lâche sommeil des disciples… Et pour ce qui regarde la Sainte Quarantaine, j’étais heureuse d’avoir faim parce qu’il avait faim et je lançais des pierres à Satan qui osait tourmenter mon Maître adoré. »
On voit qu’elle possédait le sens exact de la vie ascétique. Pour l’ascète, le temps n’est qu’une fiction ; la Passion de Jésus-Christ dure toujours et la perversité humaine ne cesse d’en renouveler les tortures. S’identifier à Lui au point de partager constamment son sacrifice, tel est le désir qui créa les Carmels et les Trappes. Folie pitoyable au regard des « gens pratiques », héroïsme sans pareil, et qui conduit à la sainteté au regard du Rédempteur. Et c’est pour avoir acquis, par leur bravoure, la science totale de l’abnégation que « les Saints sont comme des flammes blanches dans la nuit noire de la vie », comme le dit si bien Pierre van der Meer de Walcheren[5].
[5] Voir son beau livre Journal d’un Converti, page 106.
L’installation de la Solitaire dans son terrier ne lui demanda pas beaucoup de soins. Son mobilier comprenait en tout et pour tout le Crucifix qu’elle avait porté sur elle et un sac contenant quelques livres de piété, des disciplines, des cilices de rechange et une ceinture de fer hérissée de pointes à l’intérieur dont, certains jours, elle se ceignait les reins. Quand elle voulait dormir, elle s’étendait, sans couverture, à même sur le sol raboteux et se servait, en guise d’oreiller, d’une grosse pierre apportée du dehors. Son sommeil ne durait jamais plus de trois ou quatre heures. De l’entrée de son logis au sommet de la montagne, elle planta quatorze croix de buis sommairement façonnées qui lui furent les stations de la montée au Calvaire.
La question des repas fut réglée de la façon la plus simple. Quand elle eut consommé les trois pains laissés par ses compagnons, elle se nourrit des végétaux qu’elle trouvait autour de son logis. Suivant la saison, elle mangeait des mûres, des faînes, de l’oseille sauvage, les jeunes pousses de fougères. Parfois aussi, elle se mettait à quatre pattes et broutait les gramens. Comme elle s’était interdit d’allumer du feu, jamais elle ne fit cuire quoi que ce soit.
Elle s’était si bien habituée à cette alimentation sommaire que, plus tard, elle eut beaucoup de peine à en supporter une autre. Encore son estomac ne digérait-il facilement que le pain noir mêlé de beaucoup de son. Et un jour que, la voyant épuisée, son directeur voulut l’obliger d’absorber une sardine, elle fut si malade qu’on se garda de recommencer l’expérience.
Les jours de fête et les dimanches, elle allait entendre la messe et recevoir les sacrements à la Fuen Santa et souvent elle faisait sur les genoux la demi-lieue qui séparait la colline du monastère. Elle choisit pour confesseur un religieux du couvent à qui elle ne révéla point son identité. En lui parlant, quoi qu’elle eût la voix naturellement forte, elle la grossissait encore pour mieux dissimuler son sexe. A l’église, elle se mettait dans un coin obscur de manière à ne pas se faire remarquer. Cependant son recueillement était si profond que quoiqu’elle ne frayât avec personne, elle finit par éveiller l’attention.
« Les campagnards, dit le Père François, et tous ceux qui venaient aux offices, observèrent l’ermite et, comme ils n’en avaient jamais vu d’autre ni même entendu parler de rien de semblable, elle excita leur curiosité. A la sortie, quelques-uns voulurent l’interroger ; mais elle ne répondait pas. Quand elle regagnait sa solitude, certains cherchaient à la suivre pour découvrir le lieu de sa retraite. Alors elle se mettait à courir, faisait mille détours et prenait une route si opposée qu’ils étaient bientôt forcés de renoncer à leur entreprise. Mais ce n’était pas sans de grandes souffrances qu’elle se dérobait de la sorte parce que, marchant nu-pieds, elle s’ensanglantait en passant à travers les ajoncs et autres plantes épineuses. »
Mais si Catherine évitait les hommes, elle ne manquait cependant pas de société. Les animaux, qui peuplaient les halliers autour de sa retraite, prirent l’habitude de lui rendre visite. L’instinct leur faisait sentir qu’elle était incapable de les maltraiter ou de verser leur sang. La vertu d’innocence qui émanait d’elle les attirait comme un mystérieux aimant. Aussi, bientôt, les lapins de garenne et les perdrix accoururent en bandes ; pour la divertir ils formaient des rondes ou bien se culbutaient par jeu, avec mille attitudes comiques. Elle les regardait en souriant et n’intervenait que pour les réprimander avec douceur quand ils se prenaient de querelle. Ils lui obéissaient parfaitement. Elle accueillait de même les couleuvres qui, par les temps froids, se glissaient dans le terrier et se serraient contre elle afin de se dégourdir à la chaleur de son corps. Les ramiers roucoulants se perchaient sur les branches voisines et lui donnaient des concerts. Une odeur exquise — dont il sera parlé plus loin — se dégageant d’elle, les abeilles la prenaient pour une grande fleur, se posaient sur sa figure mais se gardaient de la piquer. Elle eut aussi un renard familier qui venait la voir à heures fixes et qui observait la loi qu’elle lui imposa de ne faire aucun mal aux bêtes inoffensives de son entourage.
Toutes ces créatures lui devinrent des symboles de la vie en Dieu et lui fournirent des thèmes pour l’oraison perpétuelle où son âme demeurait absorbée. Comme les arbres, les buissons, la rivière étincelante, le paysage entier prenaient également en ses contemplations une valeur d’allégorie correspondant à ses états intérieurs et un sens mystique, elle vivait un vaste poème à la gloire de Dieu, un hymne essentiel dont elle se sentait elle-même l’une des strophes.
Toutefois, c’était surtout par les belles nuits d’été que son âme se dilatait par delà les forces humaines et atteignait au ravissement. Souvent, dès que la rougeur incendiée du crépuscule avait fini de s’éteindre, la Solitaire montait s’asseoir au sommet de la colline. Là, respirant les effluves qui s’élevaient de la terre, calcinée par tout un jour de soleil torride, et l’arome résineux des pins, elle prêtait l’oreille aux vagues chuchotements des feuillages assoupis, aux crépitements sourds des genêts brûlés ; et ces rumeurs diffuses lui rendaient plus sensible le silence infini des espaces nocturnes.
Alors elle levait les yeux vers le zénith et frissonnait d’admiration à considérer le scintillement innombrable des étoiles. Peu à peu elles lui apparaissaient comme des pierreries incrustées aux portes de saphir sombre des palais du Très-Haut. Puis les astres se rapprochaient d’elle en traçant des sillages de feu ; leurs flamboiements de pourpre et d’azur se mêlaient, formaient des tourbillons aux nuances de nacre, d’argent en fusion et d’or vermeil. Puis ils devenaient des anges volant à grandes ailes sous les arches de diamant de la Voie Lactée.
Ensuite sa vision se transformait et d’imaginative devenait intellectuelle. Elle concevait, dans le temps d’un éclair, l’ordre sublime qui réglait le mouvement de toutes ces sphères, qui traçait leur gravitation autour de la Sainte-Trinité radieuse. Puis son âme montait encore davantage et allait se perdre dans l’abîme de la Lumière incréée… Les mots font défaut pour exprimer ce qu’elle ressentait à ce point culminant de son extase…
D’autres fois, la nuit se passait, pour Catherine, en colloques avec Dieu et les Saints. Malheureusement, on ne possède que peu de détails sur ces entretiens dont elle gardait le secret par humilité.
Voici ce que le biographe en écrit : « Elle en a pourtant fait part à certaines personnes pour qui elle n’avait rien de caché. Parmi ces rares confidents fut le Père Barthélemy du Saint-Sacrement, fervent religieux que la Mère Catherine vénérait comme un grand serviteur de Dieu et aimait comme un frère. Il atteste lui avoir entendu raconter qu’elle avait été souvent visitée par Notre-Seigneur, sa très sainte Mère et d’autres saints, en particulier le prophète Élie. Seulement, lorsqu’il fut interrogé, il ne se rappelait plus que l’ensemble de ces différentes visions, ce qui fut cause qu’il ne put les indiquer que d’une manière générale. »
L’âme de Catherine était si purifiée de toute souillure terrestre, son corps, tellement réduit en esclavage que les tentations n’avaient plus de prise sur elle. La Solitaire était, en effet, parvenue à ce degré suprême de la vie unitive qu’on nomme le mariage spirituel ; c’est-à-dire que, totalement imprégnée des rayons du soleil intérieur, elle demeurait imperméable aux noirs nuages chargés de péchés que le démon poussait contre elle. La présence de Dieu se manifestant d’une façon permanente dans tout son être, c’est à travers Lui, en Lui, et par Lui que sa volonté, son entendement, son imagination remplissaient leur office.
Mais afin qu’elle ne tombât point dans la présomption, le Seigneur permit à Satan d’exercer sur elle des sévices d’ordre physique.
L’Esprit pervers ressentait une haine formidable contre cette pénitente qui, par la vertu de son oraison, formait bouclier entre ses attaques et les âmes qu’elle avait en charge. Quand il eut constaté que toute sa malice ne parvenait pas à l’induire au mal, il résolut de la vaincre par la terreur.
Souvent, la nuit, lorsqu’elle prenait un peu de sommeil ou lorsqu’elle se tenait en prières, il remplissait le hallier de sifflements aigus et de blasphèmes qui semblaient vociférés par des voix d’hommes ivres. D’autres fois, il grognait comme un troupeau de porcs ou se mettait à braire, pendant des heures, comme un âne en folie.
Une nuit, comme elle regagnait sa tanière, après une longue contemplation à la cime de la montagne, il se dressa devant elle sous la forme d’un spectre de taille gigantesque qui fixait sur elle un regard plein de lueurs sulfureuses. Catherine, sans s’émouvoir, lui présenta son Crucifix et articula, d’une voix calme, le nom de Jésus. A l’instant, le fantôme se dissipa dans l’ombre, comme une brume chassée par le vent.
En une autre occasion, Satan lui apparut sous la figure d’un crapaud d’une grosseur monstrueuse. Malgré cette taille insolite, Catherine crut qu’elle avait affaire à un crapaud véritable parce que les animaux de cette espèce pullulaient sur la colline. Elle prit le balai dont elle usait pour approprier son logis et jeta le batracien dehors. Mais en culbutant sur lui-même, il la heurta d’une telle force qu’elle roula jusqu’au bas de la pente avec lui et se déchira le corps parmi les rocs pointus et les ronces. Sans proférer une plainte, elle se releva et traça dans l’air le signe de la croix. Aussitôt, le batracien éclata comme une bombe et disparut en répandant une odeur infecte.
Parfois aussi, le démon l’entourait de bêtes féroces dont la multitude semblait emplir la contrée jusqu’à l’horizon. Il y avait des tigres, des lions, des hyènes qui rugissaient et glapissaient en grinçant des dents et en étendant leurs griffes comme pour la mettre en pièces.
Mais Catherine, devinant que c’était la milice de l’enfer qui l’assaillait de la sorte, leur présentait le Crucifix et leur disait : « Lâches valets, croyez-vous que votre nombre m’épouvante ? Oserez-vous attaquer Celui-ci qui vous a vaincus d’avance ? Grâce à Lui seul, je resterai aujourd’hui la même qu’hier et, pourvu qu’Il daigne me conserver sa grâce, je le serai encore demain. Sous sa sauvegarde, O bêtes absurdes, je me moque de vous !… »
Le mépris qu’on fait de ses prestiges étant la parade que le Prince de l’orgueil craint le plus, Satan et sa bande se hâtaient alors de disparaître…
Ayant ainsi échoué dans sa tentative pour réduire la Solitaire par la frayeur, le Démon essaya des mauvais traitements. Certaines nuits, il la roua de coups depuis le crépuscule jusqu’à l’aube.
« Ces attaques, raconta plus tard Catherine, se sont produites surtout avant que ma retraite fût découverte. Dans ce temps, le diable me battait d’une façon si opiniâtre que j’étais toute meurtrie et que je restais parfois couchée une journée entière dans la pensée que j’allais mourir. Mais Dieu ne tardait pas à me donner de nouvelles forces pour braver l’enfer. »
Elle garda, néanmoins, longtemps les marques de la fureur où son héroïsme jetait le Maudit. — Apollonie de Tobar et ses sœurs, pieuses femmes des environs, ont déposé, qu’ayant eu à soigner Catherine, elles découvrirent sur ses épaules des tumeurs violacées du volume d’une orange et douloureuses au toucher. Elles lui en demandèrent la cause. La Solitaire leur répondit en riant : « Ce n’est rien ; c’est le Démon qui m’a pincée pour que je déguerpisse d’ici. Mais il a été bien attrapé car j’offrais ces contusions à mon Jésus, en mémoire de la plaie que la croix imprima sur son épaule pendant la montée du Calvaire. En retour, il m’a donné l’énergie de tenir tête au Puant sans reculer d’un pas… »
Et elle ajouta en hochant la tête : « Ah ! s’il n’y avait eu que moi, j’aurais été bien vite mise en déroute. Mais il y avait mon Maître aimé. Je me réfugiais en lui et je ne craignais plus rien. »
Commentant ces paroles, sainte Térèse en dit au Livre des Fondations : « Dans le récit de ses combats, Catherine se montrait d’une simplicité et d’une humilité admirables. Comprenant qu’elle n’avait rien pu par elle-même, elle demeurait fort éloignée de toute idée de vaine gloire. Elle ne se plaisait à manifester les grâces qu’elle avait reçues de Dieu que pour faire louer et bénir son saint nom. »
Il y avait trois ans et quelques mois que Catherine vivait dans la solitude lorsque sa retraite fut découverte et sa personnalité réelle divulguée aux habitants du pays. Dieu, ayant fait d’elle un chef-d’œuvre d’ascétisme, voulut désormais qu’elle fût offerte à ceux de ses contemporains qui aspiraient à la perfection de la vie religieuse comme un modèle qu’il leur serait profitable d’imiter.
Voici l’incident qui la remit en contact avec la société.
Un berger, du nom de Bénitez, homme très simple et d’une piété naïve, flânait un jour sur la colline. Soudain, au détour d’un sentier, il se trouva nez à nez avec Catherine qui ramassait des glands sous les chênes. La rencontre fut si brusque que, tout d’abord, la Solitaire déconcertée ne songea pas à fuir. Dès qu’elle se fut reprise, elle fit un mouvement pour s’écarter. Mais Bénitez, posant la main sur son bras, lui tint le langage suivant : « Frère ermite, je te reconnais bien. Dans mon village et dans toute la montagne on souhaite beaucoup te mieux connaître parce qu’en te voyant, à l’église de la Fuen Santa, si recueilli et si caché sous ta capuce, on t’a pris en amitié. Mais tu ne t’es jamais laissé joindre… Maintenant que je te tiens, laisse-moi te dire que nous serions tous heureux de t’être utiles. Dis-moi où tu loges, parce que je veux partager avec toi ce qu’on me donne pour ma nourriture. Et certainement que si je parle à mon maître, comme il est très dévot et qu’il a un grand désir de te venir en aide, il trouvera bon que je t’assiste. Pour commencer, laisse ces glands aux bêtes, voici un morceau de pain ; demain je t’en apporterai encore… »
Catherine se sentait toute troublée et toute chagrine de cette rencontre. Considérant la bonne intention de Bénitez, elle fit effort sur elle-même et lui répondit, avec douceur, qu’elle acceptait le pain mais qu’ayant résolu de n’avoir aucun rapport avec le monde, elle refusait de lui indiquer le lieu de sa retraite ni un endroit où il pourrait l’aborder de nouveau.
Ayant dit, elle s’enfuit dans une direction opposée à celle de son terrier. Quand elle fut hors de vue, elle commença de manger le pain dont elle avait d’ailleurs un extrême besoin car elle jeûnait depuis plusieurs jours. Ce ne fut pas sans peine qu’elle parvint à le mâcher : depuis si longtemps qu’elle se sustentait d’herbes et de fruits, ses gencives étaient devenues tendres et délicates et la croûte dure et grossière lui mettait la bouche en sang.
Rapportant cette tribulation, elle ajouta : « J’étais bien contente d’imposer cette pénitence à mon corps tout en lui donnant sa réfection. »
Ensuite, elle se mit à réfléchir. Elle se doutait que Bénitez ne manquerait pas d’explorer la colline à sa recherche. Cette éventualité la décida à se tenir enfermée quelque temps dans la tanière dont elle espérait qu’il ne découvrirait pas l’emplacement. Tout de suite, elle s’y tapit et ramenant la claie contre l’ouverture, elle la fixa, par les côtés, avec des liens de jonc tressés naguère en prévision d’une mésaventure de ce genre.
Cependant Bénitez jugea que la retraite de Catherine ne pouvait être très éloignée de la clairière où la rencontre s’était produite. Ayant marqué l’endroit, il y revint le lendemain et, le prenant pour point de départ, se mit à battre les buissons tout alentour. Ce furetage le mena sur un versant où il découvrit que l’herbe foulée dessinait une piste étroite qui aboutissait à un monticule. Il la suivit et arriva devant la claie. Sûr de ne pas se tromper, il secoua cette clôture fragile. Comme les verrous improvisés lui opposaient un peu de résistance, étant un homme d’esprit pacifique, il ne voulut pas employer la force pour arriver jusqu’à la Solitaire. Mais, élevant la voix, il la supplia de lui ouvrir. Catherine, d’abord, s’y refusa. Mais le berger insista et déclara qu’il ne bougerait point avant de l’avoir vue.
De guerre lasse, elle finit par céder.
Quand Bénitez la découvrit, accroupie dans l’obscurité de ce trou, il témoigna une grande joie, disant que son maître et les gens du village seraient on ne peut plus satisfaits d’apprendre qu’il avait enfin trouvé le refuge de l’anachorète que tous vénéraient. Mais Catherine désolée : « — Je vous le demande en grâce, s’écria-t-elle, gardez-moi le secret !…
— Je ne puis, répondit Bénitez, j’ai promis à mon maître de l’avertir au cas où je réussirais à vous joindre. »
Et pour éviter des instances plus pressantes, il s’esquiva non sans avoir déclaré à Catherine qu’il reviendrait lui apporter du pain.
Une fois seule, la Solitaire éclata en sanglots : son cœur se brisait à la pensée qu’il faudrait rompre son tête à tête avec Dieu et, par-dessus toutes choses, elle redoutait les louanges que son genre de vie allait lui attirer.
Elle se prosterna, le front sur les cailloux, et supplia Jésus de lui épargner cette amertume.
Mais aussitôt Notre-Seigneur lui répondit : « Prends courage. Le temps est venu où je veux qu’on connaisse ce que j’ai fait de toi. Et ainsi, pour ma gloire, tu procureras le bien d’un grand nombre d’âmes. »
Dès qu’elle eut reçu cette lumière, elle se sentit toute fortifiée ; et elle attendit avec calme et résignation que le bon Maître lui désignât le nouveau mode d’existence auquel il la vouait.
Le patron de Bénitez ne garda pas le silence. De par lui, le bruit se répandit rapidement dans la contrée environnante que la retraite de l’ermite était enfin découverte. On ne parla plus que de cela dans tous les villages. Et même, certains, qui l’avaient épiée, publièrent que Catherine pourrait bien être une femme déguisée en homme. Quelques prêtres des paroisses voisines s’émurent de ces propos. Ils craignirent qu’on ne fût en présence d’une aventurière qui, sous prétexte de vie érémitique, s’adonnait peut-être à des choses peu édifiantes. La pauvre Catherine aurait eu beau leur alléguer l’exemple de sainte Eugénie et de sainte Euphrosyne, il est probable qu’elle n’aurait pu réussir à les convaincre. Afin de réprimer le scandale, ils se rendirent donc au terrier un matin que la Solitaire était à la messe et ils y découvrirent des papiers qui levèrent leurs doutes quant à son sexe. C’étaient des lettres de don Juan d’Autriche apportées par Martin Alonso qui, selon sa promesse, était venu rendre deux ou trois visites à Catherine. Avec l’approbation de celle-ci, il avait confié au prince les raisons de sa fuite, son travestissement et sa pénitence, en lui demandant le secret absolu. Don Juan l’avait promis et observé. Il lui suffisait d’être rassuré sur le sort de sa gouvernante. Cependant, comme il lui portait une grande affection et gardait le vif souvenir des soins qu’elle lui avait prodigués, sans demander à connaître l’endroit où elle s’était retirée il lui écrivit ces lettres très tendres où il lui donnait le nom de « mère ».
Les prêtres, les ayant lues, s’ébahirent. D’une part, ils voyaient maintenant qu’ils avaient affaire à une femme de bien et non à une gourgandine. D’autre part, interprétant le texte à la lettre, ils s’imaginèrent que Catherine était réellement la mère de don Juan et ils se demandèrent quelle conduite tenir à l’égard d’une personne qu’ils croyaient de sang royal.
Perplexes, ils allèrent demander conseil aux religieux de la Fuen Santa. Le confesseur de Catherine déclara qu’homme ou femme, noble ou roturière, il la tenait pour une merveille de sainteté et il recommanda de la laisser tranquille, ajoutant que sa présence était une bénédiction pour le pays. Tous se rendirent à son avis. Cependant un Père Véga, dignitaire du couvent, résolut de poursuivre l’enquête. A cet effet, il se rendit au terrier où Catherine l’accueillit avec déférence.
Elle se montra très humble mais — à son insu — il y avait en elle quelque chose de si imposant que le Trinitaire n’osa pas la questionner. Leur entretien porta seulement sur l’oraison de la pénitente. Or, tout en causant, le moine feuilletait, d’un doigt machinal, le livre d’Heures de Catherine qui se trouvait posé sur le sol, à côté de lui. A un moment, il y jeta les yeux et y lut ces mots tracés à l’encre sur la feuille de garde : la princesse d’Eboli a donné ces Heures à doña Catherine de Cardonne.
Or, le Père Véga avait prêché diverses fois à Madrid dans le temps de la fuite de Catherine ; il était au courant de la position qu’elle avait occupée à la Cour et du mystère qui pesait sur sa disparition.
Ne voulant pas affliger la Solitaire en la prévenant tout de suite que son incognito était percé, il ne lui dit rien. Mais, de retour au monastère, il raconta sa découverte à qui voulait l’entendre. Puis il conclut, comme le confesseur, qu’il fallait la laisser en repos et même lui permettre de conserver son habit masculin. « Cela convient, dit-il, au mâle courage qu’elle a montré en se retirant dans ce désert. »
Mais le branle était donné. Catherine ne connaîtra plus la solitude : pendant plusieurs années elle sera « le flambeau sur la montagne » vers qui s’orienteront des multitudes empressées.
Le renom que sa pénitence extraordinaire valut à Catherine ne demeura pas limité au diocèse de Cuenca mais s’étendit à une grande partie de l’Espagne, de sorte que de véritables pèlerinages s’organisèrent à l’intention d’obtenir des miracles par son entremise.
« Il y avait des jours, écrit le biographe, où les routes étaient couvertes d’hommes et de femmes, de bêtes de somme et de chariots. Des témoins oculaires affirment qu’il était besoin alors que des hommes très robustes se tinssent autour d’elle pour la garantir contre la presse et empêcher qu’elle fût étouffée. On prit aussi l’habitude de la faire monter sur un lieu élevé d’où elle dominait la foule et lui donnait sa bénédiction. »
On verra plus loin que ce geste insolite attira de grands ennuis à Catherine.
Parmi ces visiteurs, il n’en manquait pas qui étaient venus par curiosité plutôt que par dévotion. Mais l’amour de Dieu dont ce corps chétif constituait le foyer rayonnait autour de la Solitaire d’une façon si intense qu’à l’approcher ils se sentaient transformés, versaient des larmes et se mettaient à prier pour obtenir le pardon des fautes de leur vie passée.
Ce n’était d’ailleurs pas que Catherine leur tînt de longs discours. Elle se contentait de faire le signe de la croix et elle disait à tous : « Que Jésus-Christ vous donne la foi ! » Ensuite elle les envoyait se confesser et communier à la Fuen Santa. Et ils s’en retournaient chez eux convertis.
Elle agissait de même avec les malades qu’on ne tarda pas d’apporter sur la colline. Elle obtint, paraît-il, de nombreuses guérisons. Au rapport du Père François, « ces faits n’ont pas été constatés juridiquement mais ils n’en sont pas moins certains, ayant été attestés, sous serment, par des personnes dignes de toute créance ».
On pense bien que les villageois des environs redoublaient de zèle pour témoigner leur vénération à celle qu’ils appelaient, avec simplicité, la bonne femme[6]. Si elle les avait laissés faire, ils l’auraient comblée de nourritures diverses. Son confesseur lui ayant donné l’ordre de renoncer aux herbes et aux fruits sauvages, elle obéit mais elle n’acceptait que du pain. Encore exigea-t-elle qu’il fût noir et rassis. Les jours de grande fête et les dimanches, elle le trempait dans un peu d’huile d’olives.
[6] Buena Mujer. On l’appelait aussi la madre Cardona : la mère Cardonne. Mais Catherine elle-même prenait toujours le nom de mujer pecadora : la femme pécheresse. Et c’est ainsi qu’elle signait ses lettres. Voir livre des Fondations, page 115, note 2.
A la même époque, un accident la fit changer de logis. « Un soir, étant dans son terrier, elle s’aperçut que les parois, détrempées par de longues pluies, s’affaissaient et s’écroulaient autour d’elle. Elle prit la fuite en toute hâte pour ne pas être ensevelie sous les débris. Mais quelque diligence qu’elle fît, elle ne put échapper complètement au danger : atteinte par la masse de terre humide elle fut renversée et demeura prise jusqu’à la ceinture dans la boue. Elle fit effort pour se dégager mais elle n’y put réussir parce que ses forces étaient épuisées. Elle passa toute la nuit dans cette position, offrant à Dieu le sacrifice de sa vie et n’ayant d’autre désir sinon que sa sainte volonté s’accomplît sur elle dans la manière qu’il lui plairait.
« Le matin, des bergers, qui passaient par là, la retirèrent de cette fange et ayant ensuite fouillé la terre ils retrouvèrent les cilices et les disciplines dont elle faisait usage. Pour réparer l’accident, les villageois lui creusèrent une grotte plus spacieuse et mieux abritée contre les vents et les averses. Ils y mirent une porte plus solide que la claie et y placèrent une planche pour lui servir de lit.
« Dans cette demeure, écrit le Père François, qui aime les images pompeuses, elle était moins à plaindre que la reine Sémiramis dans ses palais superbes. »
Catherine était installée depuis peu dans la caverne due à l’industrie dévote des paysans quand elle reçut la visite d’un Père Augustin qui s’était détourné de sa route pour se rendre compte de ce que pouvait être au juste cette Solitaire dont tout le monde parlait. Ce religieux venait à elle plein de méfiance.
« Il s’agit probablement, pensait-il, d’une bohémienne qui, par des simagrées et des jongleries, a surpris la bonne foi des gens de ce pays. Ou peut-être est-ce simplement une femme mal équilibrée et pleine d’orgueil qui cherche à s’attirer des louanges par l’apparence d’une vie extraordinaire. Quoi qu’il en soit, je saurai bien la démasquer. »
Dès qu’il fut en tête-à-tête avec Catherine, il lui déclara, d’un ton rude, qu’elle ne lui en imposait pas, qu’il la considérait comme une présomptueuse, éprise de vaine gloire et qu’elle ferait mieux de se retirer dans un village où elle ne ferait plus parler d’elle.
Catherine lui répondit avec tant de douceur et montra tant d’humilité que, tout de suite, l’Augustin sentit ses préventions s’affaiblir. Il se mit alors à l’interroger sur son oraison. Elle lui en décrivit, d’une façon si précise, les différentes phases et, ce faisant, elle révéla un tel amour de Dieu, que bientôt, le moine plein d’admiration, fut convaincu qu’il était en présence d’une âme exceptionnelle dont le mode d’existence correspondait à des grâces d’un ordre tout à fait supérieur.
Catherine termina son exposé par ces mots : « Il me semble, mon Père, que Notre-Seigneur a voulu cette retraite. Je n’ai rien fait pour provoquer l’affluence des pèlerins vers moi. Loin de m’en réjouir, j’en souffre beaucoup et je serais heureuse de m’y soustraire. Si je la supporte, c’est, comme je viens de vous le confier, parce que mon Maître adoré me l’imposa… Du moins, je le crois. Si, plus éclairé que moi, vous en jugez autrement, je suis toute prête à disparaître car j’aimerais mieux mourir que de risquer le salut de mon âme par infatuation.
— Non, non, répondit l’Augustin, Dieu vous a visiblement conduite dans cette solitude. Je comprends maintenant qu’il serait téméraire de mettre obstacle à ses desseins ; restez ici, puisque le voisinage de la Fuen Santa vous donne la facilité de recevoir les sacrements. C’est moi qui me suis trompé. Je retire tout ce que je vous ai dit de blessant et je me recommande à vos prières. »
Puis il la bénit et se retira. Et il publia partout les vertus de la pénitente.
Cependant cet entretien laissa des traces dans l’esprit de Catherine d’autant plus qu’il coïncidait avec certaines idées que Dieu lui envoyait, avec persistance, depuis quelque temps.
Elle se disait : « J’ai maintenant l’impression que si je continue à vivre dans l’isolement, je cesserai de mériter la faveur divine. Quelqu’un me dit intérieurement qu’il faut que je me fasse religieuse, que je prenne désormais la voie de l’obéissance et que je soumette ma volonté à celle d’autrui. Si c’est Jésus qui me parle, je suis toute prête à entrer dans un monastère… Mais alors pourquoi m’inspire-t-il tant d’éloignement pour les communautés de femmes ? Chaque fois que ma pensée se porte de ce côté, je me peins, malgré moi, mille faiblesses inhérentes au sexe, des règles mal observées ou mitigées à l’excès ; et la société féminine, qui ne me plut jamais beaucoup, m’apparaît davantage encore inconciliable avec ce que Dieu attend de moi… J’entrerais volontiers dans une communauté d’hommes. Mais ce n’est plus possible puisque j’ai perdu le bénéfice de l’incognito. »
Dans cette incertitude, la pensée lui vint d’un moyen terme qui pourrait tout concilier : rester dans sa grotte et fonder, à côté, un monastère de religieux.
Elle prononcerait ses vœux entre leurs mains, les reconnaîtrait pour ses supérieurs et se mettrait sous leur direction. Ainsi, sans abandonner la vie érémitique, elle suivrait une règle et joindrait au mérite de l’obéissance une garantie contre les illusions du sens propre.
Avec l’esprit de décision qui la caractérisait, elle s’occupa tout de suite de réaliser son projet. Elle proposa d’abord la fondation à des Pères Franciscains qui étaient venus la voir. Ceux-ci l’approuvèrent fort et en parlèrent à leurs supérieurs. Mais quand on en vint à l’exécution, toutes sortes de difficultés surgirent, la chose traîna en longueur. Catherine comprit alors que Dieu réservait à d’autres qu’aux fils de Saint-François l’accomplissement de l’œuvre qu’elle méditait.
Mais à qui ? — Elle eut beau réfléchir, sa pensée ne se fixa sur aucun Ordre connu d’elle.
Ne sachant que résoudre, un jour qu’elle se sentait encore plus pressée de suivre la volonté divine, elle se prosterna en s’écriant : « Seigneur, je vous en conjure, montrez-moi ce qui est le plus conforme à votre bon plaisir. »
Aussitôt, elle eut une vision : « Notre-Seigneur lui apparut tout resplendissant de lumière et de beauté et lui présenta l’habit des Carmes déchaussés. Croyant qu’il voulait l’en revêtir tout de suite, elle étendit la main pour le prendre. » Mais, dans le même moment, ses forces l’abandonnèrent. Inondée d’une joie surhumaine par la présence de Jésus, elle tomba sur le sol et perdit connaissance. — Quand elle revint à elle, la vision avait disparu.
Catherine en garda néanmoins le souvenir très précis de l’habit qui lui avait été montré. Seulement, de quelle congrégation était le vêtement ? Elle l’ignorait, parce qu’à l’époque où elle quitta la cour, la réforme du Carmel n’étant pas encore commencée, les Carmes de la Mitigation s’habitaient d’une façon beaucoup moins austère.
Dans son incertitude, elle redoubla de prières et de supplications. « Sa divine Majesté, dit le Père François, l’éclaira de la manière suivante. Par son ordre, notre Père saint Élie se montra à elle revêtu d’un habit semblable à celui qu’elle avait discerné entre les mains de Notre-Seigneur. La vue du prophète, qu’elle reconnut pour avoir joui de sa présence en des visions antérieures, lui fut une manifestation plus claire de la volonté divine et lui confirma l’assurance qu’il existait dans l’Église des religieux portant cet habit. Elle en ressentit une joie extrême… »
Cette allégresse ne dura pas. Notre-Seigneur, afin de la garantir contre l’amour-propre, lorsqu’il la renverrait dans le monde pour vaquer à la fondation dont il lui avait inspiré la pensée, lui retira le sentiment de sa présence. Le soleil intérieur s’éclipsa. Elle sentit son âme affreusement déserte et sombra dans cette nuit obscure qui constitue l’épreuve la plus rude de la vie unitive. En même temps, la nature, que ne transfigurait plus la lumière surnaturelle dont elle avait pris l’habitude, lui sembla terne et désolée. L’oraison lui apparut comme une étendue sablonneuse où s’absorbaient les eaux vives de la Grâce. Tout exercice de piété lui devint pénible, presque ennuyeux. Elle passa des jours à se répéter : « Mon Dieu pourquoi m’avez-vous abandonnée ? »
Dans cet état de déréliction, elle en vint à se persuader que toutes les faveurs dont Jésus l’avait naguère comblée étaient illusoires, que le Démon avait fait d’elle son jouet et s’était complu à l’égarer en lui désignant, par de fausses visions, une tâche qu’elle ne pourrait jamais accomplir.
Errant ainsi dans des ténèbres absolues, elle perdit le goût de vivre ; elle frôla les confins du désespoir. Son corps émacié, que ne soutenait plus son âme débilitée, fléchit à son tour. Elle tomba gravement malade.
Le bruit s’en répandit dans la contrée. Et c’est alors que des villageoises pieuses vinrent la soigner et découvrirent sur ses épaules les marques des assauts diaboliques dont il a été parlé plus haut.
Mais les soins et les remèdes ne purent rien contre le mal dont Catherine souffrait ni même les encouragements de son confesseur dont les discours lui semblaient un bourdonnement dépourvu de signification.
Telle fut l’opération que Notre-Seigneur pratiqua sur la Solitaire pour incruster définitivement dans son esprit la persuasion que, par elle-même, elle n’était qu’impuissance et misère. De la sorte elle acquit cette humilité totale et qui émerveillait tout le monde lorsqu’elle se retrouva parmi les laïques.
Quand il la vit au point d’abaissement où il la voulait, le bon Maître mit fin à l’épreuve. Un jour, à l’aube, Catherine se sentit si faible qu’elle crut que l’agonie allait commencer. Elle joignit les mains, fit un acte d’abandon puis murmura ces mots : « Seigneur, je vais donc mourir sans savoir si c’est vous qui m’avez inspiré le désir de vous glorifier comme religieuse soumise à l’obéissance !… »
Elle achevait à peine la phrase que Notre-Seigneur lui apparut, ayant à ses côtés deux Carmes déchaussés. Il sourit à Catherine : aussitôt l’obscurité se dissipa ; l’astre vivifiant se ralluma dans son âme ; la santé revint d’un seul coup.
Elle se leva ; tout heureuse, elle rendit grâces et se sentit une vigueur nouvelle pour mener à bien son projet d’un monastère d’hommes à bâtir auprès de sa grotte.
Toutefois, elle ignorait encore où s’adresser pour découvrir les moines qui lui avaient été montrés dans ses visions. Mais, sûre d’être dans la voie de Dieu, elle avait le pressentiment qu’Il ne tarderait pas à lui donner assistance.
Et, en effet, quelques jours après elle reçut la visite d’un de ses amis récents, Jean de Villoria, homme d’oraison très élevée qui ne connaissait pas ce qu’elle avait résolu d’accomplir. Sans autre préambule, il lui dit : « Mère Cardonne, j’ai vu souvent — est-ce des yeux du corps ou de l’âme, je ne sais — une procession de religieux, qui gravissaient cette montagne, tenant des cierges à la main et vêtus d’un habit de grosse bure de couleur tannée, avec un manteau blanc, l’un et l’autre courts et austères. Ils avaient les pieds nus. Tout en eux respirait le recueillement et l’union à Dieu. Je suis incapable de deviner ce que cela signifie. Mais j’ai vu et c’est la vérité que je dis… »
« Ces paroles, écrit le biographe, persuadèrent à Catherine qu’il devait s’agir d’un Ordre encore inconnu que Dieu se disposait, avec un soin tout particulier, à instaurer dans le monde, si déjà il n’existait. Ce fut pour elle un sujet de grande consolation de penser qu’elle en ferait partie », puisque la vision de Villoria concordait si parfaitement avec les siennes propres.
A partir de ce moment, elle commença de s’informer auprès de tous ceux qui la venaient voir s’ils connaissaient un endroit où se trouvaient des religieux vêtus de bure rousse avec un manteau blanc. Tous lui répondirent que non. Mais elle, sûre de son fait, reprenait : « Il y en a, et vous l’ignorez, ou il y en aura car cette caverne doit leur appartenir et ils fonderont ici un monastère où Dieu sera très fidèlement servi. »
Quelques jours après, survint un paysan qui fréquentait les foires de la province et qu’elle avait chargé de s’informer.
Il lui dit : « Bonne femme, ma mère Cardonne, je viens de voir à Pastrana des religieux tout semblables à ceux que vous m’avez décrits. Le prince Rui Gomez leur bâtit un couvent en dehors de la ville, sur la montagne Saint-Pierre. Et ils habitent, en attendant, des grottes pareilles à la vôtre. »
Catherine fut transportée de joie à la pensée que c’était son ami Rui Gomez qui faisait cette fondation. Elle résolut, sans perdre de temps, de se mettre en rapport avec lui.
Voici, brièvement rapportée, l’origine du monastère de Pastrana. Un certain Père Ambroise Mariano s’était adjoint, auprès de la ville, quelques compagnons qui, épris comme lui de solitude et d’oraison, s’adonnèrent à la vie érémitique dans les cavités de cette montagne Saint-Pierre mentionnée ci-dessus. Au bout de quelques mois, Mariano, craignant que ce petit groupe d’anachorètes, qui ne relevait d’aucune congrégation régulière, ne fût dissous par les autorités ecclésiastiques, résolut de faire le voyage de Rome pour y solliciter du Pape une approbation et une règle. Dans ce but, il se rendit d’abord à Madrid afin d’obtenir un passeport. Il y rencontra sainte Térèse qui, après quelques entretiens, jugeant que ces hommes de bonne volonté feraient d’excellents Carmes déchaussés, lui proposa d’entrer dans la Réforme du Carmel avec ses frères. Mariano, conquis par l’ascendant de la Sainte, abandonna son premier projet et consentit d’enthousiasme. Rui Gomez, mis au courant, approuva tout, car il était grand admirateur de Térèse et, depuis longtemps, son ami. Les travaux pour l’édification des bâtiments conventuels commencèrent sans retard. Ils étaient à peu près achevés à l’époque où Catherine de Cardonne eut ses visions touchant les Carmes déchaussés. La communauté fonctionnait sous la règle du Carmel et était dirigée par le Père Antoine de Jésus qui fut un des premiers à embrasser la Réforme et que sainte Térèse désigna comme supérieur[7].
[7] Pour plus de détails sur la communauté de Pastrana, voir le Livre des Fondations, chapitre XVII. C’est un récit délicieux comme tout ce qui sort de la plume de sainte Térèse.
Mariano tenant une place importante dans la vie nouvelle où Catherine allait s’engager, il n’est pas hors de propos de donner un aperçu des circonstances qui amenèrent sa vocation et un croquis de son caractère.
Ambroise Mariano de Azaro naquit, au royaume de Naples, d’une famille très riche appartenant à la noblesse. Dès son enfance il montra du goût pour les sciences, étudia, dans plusieurs universités, la jurisprudence et les mathématiques et devint, de bonne heure, un géomètre expert et un ingénieur habile.
Encore jeune, il fut chargé d’une mission en Pologne par les Pères du Concile de Trente. La reine de ce pays le distingua et se l’attacha comme intendant de son palais. Mariano s’acquitta fort bien de ses fonctions. Mais il y avait en lui une inquiétude d’esprit qui l’empêchait de demeurer longtemps à la même place. Il quitta donc bientôt Varsovie pour entrer dans l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Pourvu d’une commanderie, des goûts belliqueux lui vinrent. Il suivit les généraux de Philippe II à la guerre contre la France et prit une part brillante à la bataille de Saint-Quentin.
A la suite de cette campagne, il se crut destiné à faire sa carrière aux armées. Mais Dieu en ordonna autrement. « Il fut, dit sainte Térèse, accusé faussement d’avoir trempé dans un meurtre. On le tint deux ans dans une prison sans qu’il voulût prendre d’avocat ni permettre que personne défendît sa cause, s’en remettant à Dieu de son bon droit. Deux faux témoins soutenaient qu’ils avaient été chargés par lui de commettre le crime. Mais il leur arriva à peu près la même chose qu’aux vieillards accusateurs de Suzanne. On leur demanda séparément où Mariano se trouvait alors. L’un répondit qu’il était assis sur un lit. L’autre, qu’il se trouvait à une fenêtre. Enfin, ils avouèrent leur imposture. Le Père Mariano m’assura qu’il lui en avait coûté beaucoup d’argent pour leur épargner le châtiment qu’ils méritaient. De plus, celui-là même qui avait tramé cette intrigue contre lui étant tombé entre ses mains dans une circonstance où il pouvait faire une information contre lui, il avait épargné et lui avait pardonné.
« Cette générosité et d’autres vertus encore — car c’est un homme chaste, ennemi de tout commerce avec les femmes — lui méritèrent sans doute de Notre-Seigneur la grâce de voir le néant du monde et de chercher à en sortir ». (Livre des Fondations, pages 226 et 227.)
Libéré, Mariano retourna en Italie où il resta, quelque temps, dans le désœuvrement. Puis il passa en Espagne où Philippe II le chargea d’un travail de canalisation pour rendre le Guadalquivir navigable. L’entreprise échoua. Mortifié de cet insuccès, Mariano prit le monde en dégoût. Il venait de faire la connaissance d’un Père Mathieu qui gouvernait une société d’ermites au désert del Tardon, près de Séville. Après avoir fait à Cordoue les exercices de saint Ignace, il décida de se joindre à eux. Il entra, dès lors, résolument dans la voie de la pénitence et de la prière. Mais, en 1568, un ordre de Philippe II l’appela à Aranjuez pour y rectifier, comme ingénieur, le cours du Tage. Cette mission remplie, il revint auprès des ermites et les établit à Pastrana dans les conditions rapportées plus haut. De retour à la montagne Saint-Pierre, après une entrevue avec sainte Térèse, il prit l’habit de Carme déchaussé, en qualité de frère convers, sous le nom d’Ambroise de Saint-Benoit.
De caractère, il était emporté, brusque, imaginatif à l’excès, sujet à des découragements avec de soudains retours d’énergie qui le faisaient foncer sur des obstacles et, parfois, dépasser le but. Ses manières de soldat et ses outrances donnèrent souvent bien du tintouin à sainte Térèse. Du reste, de grandes qualités compensaient les défauts dus à la chaleur de son sang : une extrême bonté, une franchise totale, le goût joyeux de la pénitence et, surtout, un amour de Dieu qui se traduisait par un zèle sans limites pour le service de la religion.
Quant aux formes de sa piété, Napolitain, il y mettait l’exubérance des gens de son pays. Il devait ressembler un peu à ces pèlerins de Sicile que je vis à Lourdes se coller contre la pierre de la Grotte, l’embrasser avec frénésie, y frotter leurs mains et leurs joues, peut-être même la lécher. Ensuite, ils éclataient en sanglots, bramaient et gesticulaient, fous de contrition, aux harangues de leurs prêtres. Ou encore, aux intervalles de leurs exercices, ils bondissaient sur les évêques qui traversaient l’esplanade et les assaillaient, avec des cris sauvages, afin de leur baiser l’anneau.
Le frère Ambroise ne se montrait sans doute pas tout à fait aussi agité. Cependant, je crois que, dans les manifestations extérieures de sa foi, il ne gardait guère de mesure. C’est, du moins, ce que sainte Térèse laisse soupçonner dans plusieurs passages de ses écrits. Cela ne l’empêche pas d’apprécier les mérites de l’excellent Mariano et de lui pardonner, avec un sourire d’indulgence maternelle, ses façons originales de glorifier Notre-Seigneur. — Et, au surplus, on peut admettre que Dieu préfère les Marianos qui débordent d’emballements généreux aux âmes molles et froides qui se traînent parmi les pratiques d’une dévotion languissante comme le font les limaces dans ces potagers funestes où s’étiolent des choux malingres et peu charnus.
Pour en revenir à Catherine, elle écrivit donc à Rui Gomez une longue lettre où elle lui indiquait le lieu de sa retraite, le genre de vie qu’elle menait et le dessein qu’elle avait formé. En terminant, elle le priait de lui envoyer tout de suite des religieux pour prendre possession de sa grotte.
Le prince, enchanté d’avoir retrouvé sa grande amie, n’hésita pas à la servir comme elle le désirait. Il se rendit au monastère et ayant fait assembler les religieux dans la salle du chapitre, il leur lut la missive de la Solitaire. Puis, les trouvant disposés à exécuter un projet si conforme aux intérêts du Carmel réformé, il ajouta : « Je suis obligé d’aller à la Cour ; mais je compte sur Vos Révérences pour qu’elles envoient quelqu’un à la Roda. Il nous amènera doña Catherine. Et elle venant ici, tout ira bien. »
Le Prieur approuva et désigna Mariano comme son délégué. Sans perdre une minute, le Frère Ambroise, déjà plein de vénération pour une aussi admirable pénitente, se mit en route.
A mesure qu’il approchait de Roda, il entendait partout l’éloge de la Bonne Femme et constatait sa popularité. Il se réjouit des impressions qu’il recueillait de la sorte mais il se garda de manifester son contentement parce qu’il lui avait été recommandé de garder le secret sur le but de son voyage.
Il ne fut pas plutôt en présence de Catherine que celle-ci s’écria : « Voilà, voilà l’habit que j’ai vu ! »
Mariano se présenta comme l’envoyé de Ruy Gomez et des religieux de Pastrana. La Solitaire le fit asseoir et, à peine eurent-ils commencé à s’entretenir qu’ils s’aperçurent — sans doute à l’accent — qu’ils étaient compatriotes, ce qui leur causa un notable plaisir. La conversation se poursuivit en dialecte napolitain.
Mariano lui demanda ce que signifiait la phrase qu’elle avait prononcée en l’apercevant. Alors elle lui raconta en détail toute son existence et comment le désir lui était venu d’ériger un monastère, dont elle relèverait, auprès de sa grotte. Elle lui exposa aussi les visions que Dieu lui avait envoyées pour lui désigner, comme fondateurs, les Carmes déchaussés dont, jusque-là, elle ignorait l’existence.
Mariano admira la façon dont la Providence avait conduit toute chose. Il lui décrivit ensuite l’œuvre de réforme entreprise par sainte Térèse et conclut par ces mots : « Certainement, vous êtes appelée à y concourir.
— Si c’est la volonté de Dieu, répondit Catherine, je le ferai de bon cœur. Mais comment réaliser d’abord notre fondation ici même ?
— Il faut, reprit Mariano, que vous m’accompagniez à Pastrana. C’est le désir du prince et j’ai reçu mandat de mon supérieur pour vous y décider. »
Mais Catherine montra tout d’abord une vive répugnance. « Je ne veux point quitter ma chère solitude, dit-elle, car j’ai pris la ferme résolution de ne plus jamais rentrer dans le monde. Qu’irais-je faire à Pastrana ? Je vous serais un embarras plutôt qu’une aide et vous serez plus à même que moi de mener à bien le projet que Dieu m’inspira. »
Durant cette dérobade, Mariano, dont la patience n’était jamais très longue, s’anima : « Comment, s’écria-t-il, vous me déclarez que vous entendez vous placer, désormais, sous l’obéissance et dès la première minute qu’il faut le faire, vous vous rebiffez ? C’est une singulière façon de comprendre votre devoir !… »
Catherine, comprenant qu’elle errait, par abus du sens propre, reconnut sa faute et promit de se soumettre.
Mariano continua : « Ce déplacement est d’autant plus nécessaire que vous seule pouvez réunir les fonds pour bâtir le monastère. Le prince Ruy Gomez a fourni l’argent pour celui de Pastrana ; le solliciter de nouveau serait indiscret et d’ailleurs, il se trouve, en ce moment, fort gêné. Nous autres, Carmes, nous n’avons pas le sou. Par vos relations à la Cour, vous obtiendrez les aumônes qui remédieront à notre pénurie. Mais, à cet effet, il faut que l’on vous voie et même vous devrez probablement vous rendre à Madrid.
— Soit, répondit Catherine en soupirant, je ferai tout ce qu’on me dira et je quitterai, pour un temps, mon désert bien-aimé. »
Les choses ainsi convenues, tous deux attendirent la nuit, car ils craignaient, s’ils prenaient de jour le chemin de Pastrana, de susciter de l’émoi parmi les paysans qui ne verraient, certes, pas d’un bon œil l’éloignement de la Bonne Femme qu’ils considéraient comme leur protectrice devant Dieu.
Ce fut en pleurant que la Solitaire abandonna sa colline. Elle y avait vécu pendant huit ans et davantage — trois années et quelques mois totalement inconnue — cinq années depuis que Bénitez eut découvert sa retraite. Mais enfin elle fit son sacrifice et suivit Mariano sans autre objection.
De la Roda à Pastrana, on compte environ vingt lieues qu’ils couvrirent en trois étapes. De la première, Mariano envoya un messager à son Prieur pour l’avertir du jour où ils arriveraient au monastère.
Ils furent reçus par Ruy Gomez, revenu de Madrid, sa femme, leurs enfants et toute la communauté sortie à leur rencontre.
« C’était, écrit le Père François, le 3 mai, fête de l’Invention de la Sainte-Croix, ce qui fut considéré comme un heureux présage. Après une courte prière à l’église, Catherine parla aux princes et aux religieux mais avec une telle simplicité et des manières de s’exprimer si différentes de celles d’autrefois, qu’elle semblait appartenir à un autre monde. Ce n’était pas seulement l’étiquette et les termes de civilité en usage chez les grands qu’elle avait oubliés, mais le nom même des choses les plus communes lui échappait. Comme en elle tout sortait de l’ordinaire, on ne se lassait pas de la regarder. La plupart observèrent que, malgré la grossièreté de son habit et quoique les austérités l’eussent tellement consumée que son corps paraissait un tissu de racines d’arbres, on voyait s’épanouir autour d’elle un je ne sais quoi de divin qui lui donnait une grâce infinie. »
Ils furent aussi frappés de l’extrême mélodie de sa voix qui sonnait comme une musique aux notes de fin cristal.
Ruy Gomez avait fait préparer à Catherine une chambre dans son palais. Elle n’y passa qu’une seule nuit. Le lendemain, la princesse d’Eboli, femme du ministre, la conduisit au couvent des Carmélites de la Réforme installées à Pastrana, dans le même temps que s’était faite la fondation du monastère des Carmes déchaussés, et envoyées, comme eux, par sainte Térèse[8].
[8] Plus tard, les Carmélites durent abandonner ce monastère par suite des mauvais procédés à leur égard de la princesse d’Eboli. Celle-ci, après la mort de Ruy Gomez, mit tout sens dessus dessous dans la communauté ; les pauvres moniales, sur l’ordre de la Sainte, durent se réfugier au monastère de Ségovie. Voir le récit de cette tribulation dans l’excellente Histoire de Sainte Térèse (dite d’après les Bollandistes) par une Carmélite de Caen (1905).
Les religieuses firent fête à la Solitaire de qui elles avaient entendu dire tant de bien. Tout d’abord, son habit masculin et ses allures assez étranges les intimidaient. Mais comme elle se montrait fort affable et leur racontait volontiers les incidents de sa vie au désert, elles s’enhardirent peu à peu. Quelques-unes voulurent en savoir plus long et lui posèrent des questions sur les grâces intérieures dont Dieu l’avait favorisée. A ce coup, Catherine se replia sur elle-même et leur fit comprendre très nettement que c’était là un sujet réservé sur lequel il ne fallait pas l’interroger. Les religieuses se turent, toutes confuses, et ne s’avisèrent plus de revenir à la charge. Cependant, la Prieure la sollicita d’entrer dans la communauté, lui représentant que puisqu’elle désirait faire partie de l’Ordre, c’était le moyen le plus simple de s’y affilier.
Catherine ne l’entendait pas ainsi. Dès son arrivée, elle avait stipulé qu’elle prendrait l’habit de Carme et qu’elle ne se mettrait pas en clôture parmi des moniales. Elle répondit donc à la Prieure qu’elle s’estimait indigne de se placer sous son obédience. C’était une défaite polie, car, selon le Père François, « sa raison véritable c’était que sa grande âme ne s’accommodait pas à l’idée de vivre avec des femmes ».
Trois jours après, la prise d’habit eut lieu en une cérémonie où assistaient le prince, la princesse, leur famille et l’élite de la noblesse locale. « On la revêtit de la bure de l’Ordre avec le scapulaire et le capuce de couleur tannée. On compléta le costume par le manteau blanc qu’on crut devoir lui accorder parce que c’était ainsi que le prophète Élie lui était apparu. » Elle garda aussi les pieds nus, la tête découverte et les cheveux ras, comme elle l’avait désiré.
Vêtue de la sorte, elle resta chez les Carmélites jusqu’à l’époque où elle se rendit à Madrid avec l’intention de quêter l’argent dont elle avait besoin pour sa fondation de la Roda. Ce séjour dut se prolonger, car il est rapporté que, l’année suivante, elle prononça les trois vœux dans ce monastère. Le biographe fait remarquer que « ce n’étaient pas des vœux solennels mais des vœux simples, les seuls qu’elle pût faire, ne voulant point vivre en clôture ».
En somme, elle devint une Oblate du Carmel, logée provisoirement chez les religieuses mais n’en suivant point la règle puisqu’elle gardait la faculté d’aller et de venir avec la permission de son directeur.
Pendant son séjour à Pastrana, Catherine partagea son temps entre le palais du prince, l’église des Carmes et le monastère des religieuses. Autant qu’il lui fut possible, elle ne changea rien à son genre de vie : du pain et de l’eau pour sa subsistance, le sommeil par terre sans couverture, le cilice perpétuel et les disciplines fréquentes.
Les Carmélites admiraient sa vaillance. Mais ce qui les étonnait le plus c’était l’odeur délicieuse que leur nouvelle compagne répandait autour d’elle et qui se dégageait de ses vêtements comme de tout son corps.
Au début, on ne pouvait croire que ce parfum fût d’origine surnaturelle. Quelques-unes la soupçonnèrent de posséder une essence aromatique dont elle se frottait en cachette. Pour s’éclaircir de ce doute, elles la firent changer de tunique.
Quoiqu’elle fût tout imprégnée de sueur et de crasse, la bure continua d’embaumer ; or, si elle avait été aspergée d’une essence subreptice, celle-ci une fois évaporée, elle n’aurait certes plus senti que le vieux suint.
Non contentes de cette expérience, les Carmélites sous différents prétextes obtinrent que Catherine se dépouillât de tous ses vêtements pour vérifier si elle n’y dissimulait point quelque sachet. Elles ne trouvèrent rien. Il leur fallut donc admettre que nulle cause naturelle n’expliquait ce mystérieux parfum.
Beaucoup de prêtres, de religieux et de laïques ont constaté cette odeur miraculeuse. Après la mort de Catherine ils en témoignèrent par écrit et sous serment. « C’était, disent-ils, un parfum qui rappelait celui des violettes et des roses, mais plus intense ; il ne portait pas à la tête ; au contraire, il soulageait et fortifiait. Et il suffisait de toucher la main de la sainte femme pour l’emporter avec soi. »
Relatant les faits, le bon Père François est pris d’une crise d’érudition. Il cite Plutarque, Théophraste, Célius Rhodiginus pour démontrer que si certains organismes sentent bon par nature, ce ne pouvait être le cas de la Solitaire.
Sa conclusion paraît fort judicieuse. Il dit : « Une odeur suave, forte, pénétrante, différente de tous les parfums d’ici-bas, s’exhalant d’un corps épuisé, d’un sang affaibli, d’une sueur ancienne, de vêtements qui ne furent jamais lavés, c’est là une chose contraire à toutes les lois de la nature. Que, d’ailleurs, ces exhalaisons ne fussent point naturelles chez doña Catherine, il suffit pour s’en convaincre de se reporter au temps qui précéda sa retraite au désert : jamais personne ne les a senties avant cette époque. D’où l’on doit admettre que ce parfum venait de Dieu qui en gratifia, par faveur, ce corps que sanctifiaient la pénitence et la virginité. »
Au surplus, les exemples abondent de personnages vivant en Dieu et répandant l’odeur de sainteté. Il y a sainte Catherine de Sienne, sainte Lydwine et bien d’autres encore.
Quoique en fort bons termes avec les Carmélites, Catherine s’ennuyait dans leur monastère parce que, si régulières qu’elles fussent, après tout, c’étaient — des femmes. Elle éprouvait aussi la nostalgie de sa chère solitude et elle avait hâte de commencer ses quêtes pour y retourner au plus vite.
Néanmoins, il lui coûtait de reparaître dans le monde parce qu’elle savait qu’elle y serait en butte à des curiosités plus frivoles que pieuses ; cette pensée lui était insupportable. C’est pourquoi elle montra beaucoup de répugnance à obéir lorsque le Roi et les infants, ayant appris sa présence à Pastrana, lui mandèrent qu’ils voulaient la voir.
Le Prieur des Carmes eut beaucoup de peine à la décider au voyage. Il n’y parvint, qu’en lui représentant, avec insistance, que c’était le moyen le plus rapide d’obtenir des aumônes importantes pour sa fondation.
Résignée, mais toujours fort chagrine, elle partit donc pour Madrid. Mariano et deux autres religieux l’accompagnaient.
Ainsi qu’elle l’avait redouté, son arrivée dans la capitale, où elle logea chez Rui Gomez, produisit une grande sensation. Dans les rues, on se bousculait pour voir cette femme habillée en moine, cette dame de haute noblesse réduite, par sa propre volonté, à la condition de mendiante. Au palais du ministre, cent péronnelles titrées affluaient qui obsédaient Catherine de questions indiscrètes ou saugrenues. Certaines se plaçaient devant elle, bouche béante, puis émettaient des réflexions ineptes sur sa maigreur et la fatigue de son visage. D’autres l’importunaient de balivernes superstitieuses. De sorte qu’elle n’avait plus une minute pour faire oraison ou vaquer à ses exercices spirituels.
Pour échapper à ce supplice, elle se réfugia chez un de ses amis le señor Pierre Nino et tenta de se confiner dans sa chambre. Mais la cohue l’y suivit et força toutes les barrières. Aussi, ce lui fut une délivrance quand elle reçut l’ordre de venir à l’Escurial où la Cour résidait alors. Elle s’y rendit sans retard.
Les princes et particulièrement doña Jeanne d’Autriche, sœur du Roi, la reçurent avec déférence et lui marquèrent beaucoup d’affection. La princesse la prit dans son appartement pour la soustraire aux obsessions des courtisans qui, la voyant en faveur, se hâtaient de solliciter ses apostilles auprès des puissances.
Jeanne d’Autriche avait avec Catherine de longues conversations où elle lui ouvrait son âme sans restriction et elle en obtint les plus précieux avis pour son salut.
Cependant les dames d’honneur jalousaient Catherine. De dépit, elles feignirent de se scandaliser parce que, devenue fort rustique dans la solitude, elle avait oublié la morne étiquette et le langage empesé de la Cour. Quelque chose de leurs propos malveillants revint à Catherine qui, tout de suite, résolut de s’en expliquer avec la princesse.
« Vois-tu, ma fille, lui dit-elle, il ne faut pas m’en vouloir si j’oublie, la plupart du temps, de t’appeler Altesse royale. Sur ma montagne, le cérémonial m’est sorti de la tête ; et puis tiens compte de ceci que, pendant des années, je n’ai causé qu’avec des bûcherons et des pâtres. Si tu ne peux pas supporter mes manières villageoises ou si je t’ennuie, renvoie-moi et laisse-moi retourner à ma grotte ; je m’y entends très bien avec mes voisins. »
Cette déclaration si franche plut à la princesse. Moins sotte que ses camérières, « elle embrassa l’ermite en lui disant qu’elle lui faisait très volontiers grâce de tous les titres, pourvu qu’elle l’en dédommageât par un redoublement d’amitié. Elle ajouta : « Traitez-moi comme une de vos voisines ; rien ne peut me faire plus de plaisir… »
Peu après, la Cour retourna à Madrid où Catherine la suivit. La sœur du Roi la garda auprès d’elle et s’en faisait souvent accompagner lorsqu’elle sortait en carrosse. Le populaire s’empressait autour et prodiguait les acclamations à l’adresse de la Bonne Femme. Et naïvement, celle-ci distribuait des bénédictions, comme elle en avait pris l’habitude au désert. D’ailleurs ce geste lui était devenu à peu près machinal.
Le nonce du Pape Ormétano, récemment arrivé de Rome, ignorait l’histoire de la Solitaire. Certains envieux se servirent de cette circonstance pour l’indisposer contre elle. Ils vinrent le trouver et lui rapportèrent qu’on voyait sans cesse dans les rues, un carme déchaussé en voiture avec des dames et qui donnait des bénédictions comme s’il eût été un évêque. Ormétano, Napolitain lui aussi, connaissait depuis longtemps Mariano. Il le manda sur-le-champ et lui ordonna, d’un ton irrité, de lui amener ce singulier religieux qui se permettait de semblables irrégularités. Mariano essaya de donner quelques éclaircissements. Mais le nonce lui coupa la parole en répétant : « Je vous dis de le faire comparaître devant moi et tout de suite, et sans chercher des excuses !… »
Mariano transmit l’ordre à Catherine mais voulant voir de quelle façon, elle affronterait la colère du nonce, il se garda de lui dire que le prélat était fort monté contre elle.
Dans l’intervalle, Ormétano avait appris qu’il s’agissait d’une femme habillée en religieux ; et, bien entendu, les malveillants lui avaient présenté les choses de manière à le courroucer encore davantage.
Aussitôt que Catherine l’aperçoit, ne voilà-t-il pas qu’elle lui donne sa bénédiction ! — Ormétano, de tempérament fort irascible, croit qu’elle veut le braver. « Comment, dit-il à Mariano, c’est vêtue d’un froc de moine que tu as eu l’audace de conduire ici cette folle ?… » Puis se tournant vers Catherine : « Et toi, femme éhontée, dis-moi donc un peu de quel droit tu te permets de donner des bénédictions comme un évêque… »
Sur cette apostrophe, Catherine s’agenouilla devant le nonce et répondit, avec beaucoup d’humilité, que, si elle avait péché par ignorance, elle était prête à s’amender et à subir une punition.
Cette marque de soumission étonna le prélat car on lui avait affirmé que Catherine était une orgueilleuse qui ne supportait aucune critique. Un peu radouci, il la fit relever et lui ordonna de s’expliquer.
Alors la Solitaire, conservant la simplicité de langage dont elle avait coutume même vis-à-vis des Grands : « Mon fils, dit-elle, quand j’étais dans mon ermitage, après que j’eus été découverte, quelques personnes vinrent me trouver et me demandèrent de prier pour que Dieu les délivrât de leurs maladies ou de leurs chagrins. Je le fis, par charité, puis, comme je sais la vertu du signe de la croix, afin que ces infortunés ne m’attribuassent pas leur guérison, je les bénissais. Il a plu à Dieu d’opérer des miracles par ce moyen. Depuis, sans y réfléchir, je bénis tous ceux que je rencontre, pour qu’ils aient tous part aux mérites de la sainte croix. Si c’est une mauvaise habitude, et si tu me défends de continuer, je prierai Notre-Seigneur de me donner la force de t’obéir ; et je le ferai de bien bon cœur car, je te le jure, je te tiens pour son représentant sur terre…
« Quant à mon habit, permets-moi de te confier ceci : comme je désirais fonder près de ma grotte, un monastère de religieux, Jésus-Christ m’apparut avec ce vêtement entre les mains et notre père saint Élie m’a visité, portant ce même costume. Par là, j’ai cru comprendre que c’était la volonté de Dieu que je le prisse. Mais si tu me commandes de le quitter, je t’obéirai sans hésiter une minute… »
A ce coup, le nonce fut touché : — Passe pour les bénédictions, reprit-il, mais toi, Mariano, tu aurais dû la faire habiller en femme avant de l’introduire en ma présence.
— Hé, monseigneur, répondit Mariano, si tu m’avais laissé le temps de parler, je t’aurais tout expliqué et après tu aurais pu me donner tes ordres.
— J’ai peut-être été un peu prompt, reconnut Ormétano.
Sur quoi, tous trois se mirent à causer amicalement en dialecte napolitain. De ce colloque il résulta que le nonce dépouilla ses préventions contre Catherine. Il sentit sa sainteté, admira son zèle pour le service de Dieu, et la prit tout à fait en gré. De sorte qu’il termina l’entretien par ces mots : « Il ne convient pas d’introduire des nouveautés dans l’Église. Cependant, Bonne Femme, puisque tu n’y mets point de malice, j’autorise provisoirement les bénédictions et même, je permets que tu gardes ton habit. »
Après les avoir congédiés, il rassembla d’autres informations. Le bien qu’il apprit de Catherine lui fit résoudre de la laisser agir à sa guise. Il ne lui donna pas d’autorisation officielle mais il imposa silence aux ennemis de la Solitaire lorsque ceux-ci renouvelaient leurs insinuations. « La Mère Cardonne est une sainte femme, disait-il, elle m’a promis de prier pour moi et j’en suis très content. »
Cet incident fit comprendre à Catherine qu’il était urgent d’entamer les démarches pour la fondation, car elle se rendit compte que si elle s’attardait à la Cour, les malveillants reviendraient à la charge et réussiraient peut-être à entraver ses projets. D’autre part, elle ne cessait de soupirer après la solitude.
Elle se mit donc à la besogne et avec un tel esprit de suite que bientôt toutes les formalités pour l’acquisition du terrain autour de sa grotte furent remplies. Le Roi, lui-même, qui l’appréciait fort, prit soin de lui aplanir les difficultés. Dès qu’elle eut en main les titres de propriété du territoire entre Vala de Rei et la Roda, elle s’occupa de réunir les fonds pour la construction du monastère.
« Chacun s’empressa de les lui fournir, écrit le biographe, la famille royale, les princes, les seigneurs et les dames de la Cour lui apportèrent de l’argent et aussi des perles de grand prix, de riches étoffes pour les ornements d’église et des chasubles magnifiques et des calices d’argent. »
Tant de cadeaux suscitèrent de la jalousie dans le clergé de Madrid. Un grand vicaire de la cathédrale ne put en prendre son parti.
« Il me semble, disait-il, que pour des religieux déchaussés, qui se réclament d’une pauvreté rigoureuse, des calices de plomb et des chasubles de laine seraient bien suffisants !… »
Mais Catherine sut relever cette observation saugrenue.
« Comment, s’écria-t-elle, en dardant sur le prêtre envieux un regard foudroyant, toi qui n’es qu’un vermisseau, tu manges dans de la vaisselle en vermeil et tu voudrais qu’on prît du plomb pour le service du Roi des Rois ! »
L’autre, déconcerté, battit en retraite.
Tout étant réglé selon les lois du royaume et les ordonnances ecclésiastiques, Catherine, toujours accompagnée de Mariano, prit le chemin de la solitude. Le voyage se passa sans incidents notables.
C’est au mois d’avril 1572, qu’elle revit sa grotte. « Dire sa joie en retrouvant son ancienne demeure et la colline où elle avait remporté tant de victoires sur l’Ennemi c’est ce que nulle parole humaine ne saurait faire, écrit le Père François. Les religieux, qui étaient venus à sa rencontre, en purent bien voir la manifestation extérieure mais non le sentiment intime. Quant à eux, lorsqu’en arrivant à l’humble réduit, ils le virent si étroit et si effrayant d’austérité, ils en éprouvèrent un tel saisissement qu’ils déclarèrent ensuite n’avoir jamais rien imaginé de semblable. »
Les travaux furent mis en train tout de suite et Catherine décida que l’on commencerait à bâtir l’église du monastère sur l’emplacement de son terrier. En sa qualité d’ingénieur, Mariano dirigea la construction. Comme il avait réuni un grand nombre d’ouvriers — peut-être un peu plus qu’il n’était besoin — tandis qu’on ouvrait la tranchée pour les fondations, il employa une équipe à creuser une nouvelle grotte où Catherine s’isolerait et reprendrait ses exercices. Cette cavité s’ouvrait à quatre cents pas de l’église. On lui donna quatre pieds en largeur et douze en long, sur lesquels, à la demande de la Solitaire, on en prit huit qui furent occupés par un groupe en plâtre représentant Jésus au tombeau entouré de la Sainte Vierge, de sainte Madeleine et des Apôtres. L’espace restant servit de cellule. Malgré les observations de Catherine, qui aurait voulu qu’on se bornât au plus strict nécessaire, Mariano fit garnir le sol et les parois de boiseries contre l’humidité. C’est sur ce plancher, enveloppée dans son manteau blanc, que Catherine prit son sommeil. Pour oreiller, elle avait une petite marche de plâtre qui séparait la cellule de l’oratoire où s’érigeait le Tombeau.
Mais Mariano, « qui aimait avec passion à saper les montagnes et à vivre sous terre », ne s’en tint pas là. Il perça un couloir, avec des soupiraux de distance en distance, et il y fit placer des sculptures représentant des sujets tirés de la Passion. C’était, dit-il, afin que la Mère pût se rendre de sa grotte à l’église sans avoir à souffrir des intempéries. Ce travail coûta fort cher. Mais Mariano n’en avait cure. Il continua de dépenser l’argent sans compter et, de plus, il étalait, pour l’église et le monastère, des plans tellement gigantesques et luxueux que Catherine crut enfin devoir mettre une borne aux imaginations excessives du bouillant religieux. Elle fut appuyée en cela par les autres Carmes qui n’entendaient nullement se loger dans un palais. Mais Mariano n’accepta pas facilement ces entraves à son exubérance. Il se répandit en un flot de paroles acrimonieuses, et soutint que limiter son zèle c’était lésiner avec Dieu.
Mais Catherine tint bon contre ses reproches. Et d’abord, elle prit l’administration de la caisse fort diminuée par les prodigalités et les fantaisies de Mariano. Désormais elle régla, elle-même, le salaire des ouvriers, se mit en rapport avec les entrepreneurs et empêcha tout gaspillage dans l’achat ou dans l’emploi des matériaux. Grâce à son économie et à son sens de l’ordre, grâce aussi aux aumônes qui vinrent en abondance dès qu’on vit la Mère substituer son autorité aux caprices du Frère Ambroise, les bâtiments gardèrent les proportions modestes qui convenaient et s’achevèrent sans trop de délai.
Ici une réflexion s’impose. — Des personnes superficielles se figurent volontiers qu’un Mystique, c’est un individu mal équilibré, en proie à une exaltation morbide et chez qui n’existe pas l’ombre d’esprit pratique.
Or, le vrai Mystique ne présente pas la moindre ressemblance avec ces névrosés de la Foi auxquels les ignorants ont coutume de l’assimiler. Au contraire, tout à fait détaché des intérêts humains, faisant abnégation de lui-même, il voit toutes choses en Dieu et il échappe de la sorte aux erreurs de jugement où nous entraînent nos passions et les illusions de notre amour-propre. Il possède le suprême bon sens et, par là, il agit toujours de la façon la plus judicieuse lorsque les nécessités de sa mission le mettent en contact avec les réalités sensibles. C’est ce don qui fit de tous les Saints, en lutte avec les mœurs et les préjugés de leur temps, d’excellents diplomates et des organisateurs incomparables. Voyez sainte Térèse qui, pour l’instauration de sa Réforme, joignit une parfaite prudence à l’esprit d’initiative le plus délibéré. Et, dans la sphère plus humble qui nous occupe, voyez Catherine de Cardonne qui, constatant que son architecte verse dans l’extravagance, se substitue à lui, répare ses incartades et réalise, avec mesure, l’œuvre que de folles rêveries auraient menée à la ruine[9].
[9] Charles Maurras, quoique incroyant, a fort bien défini les qualités d’ordre pratique qui caractérisent le vrai Mystique. Il a écrit : « Sainte Térèse, saint François d’Assise, saint Dominique, saint Ignace, ces mystiques supérieurs furent, non seulement d’instinct, mais de propos délibéré et conscient, des positivistes certains. Ils s’aidaient tout en appelant le ciel à leur aide et la prudence humaine n’était bannie de leurs conseils qu’en apparence. En prêchant le sublime, ces grands esprits eurent l’horreur de l’absurde… » Le dilemme de Marc Sangnier, page 10.
Le monastère étant enfin construit, les Carmes déchaussés en prirent possession et y observèrent, avec exactitude, la règle de la Réforme telle que sainte Térèse l’avait établie. Catherine se retira dans sa grotte. Comme de grandes infirmités lui étaient venues, elle dut modérer quelque peu la rigueur de ses pénitences. Mais, en revanche, elle donna tout son temps à l’oraison. Elle ne parlait que sur l’ordre des supérieurs, quand ceux-ci envoyaient quelques religieux la visiter afin qu’elle les instruisît touchant les pratiques de l’ascétisme. Elle le faisait par obéissance car, à partir du jour où son rôle de fondatrice eut pris fin, elle se garda soigneusement d’intervenir dans le gouvernement de la communauté. « Moi, femme pécheresse », répondait-elle à ceux qui tentaient d’obtenir son avis sur quelque point d’administration, je prie pour la communauté, je lui demande ses prières ; pour le surplus, je ne suis que poussière et je n’ai rien à dire. »
Elle ne sortit de sa retraite qu’en deux occasions. Au printemps de 1573, elle fit un court voyage à Madrid pour demander au Roi la grâce d’un gentilhomme condamné à mort. Elle l’obtint. Au mois d’octobre de la même année, Rui Gomez étant mort, elle se rendit à Pastrana, afin de porter des consolations à sa veuve, la princesse d’Eboli.
A part ces deux brèves absences, elle ne quitta plus sa grotte que pour aller à l’église par le couloir que Mariano avait tracé dans le but de lui épargner la pluie et le vent. Ce n’était qu’à regret qu’elle usait de ce passage, estimant qu’il y avait en cela une complaisance envers son corps. Pour lever son scrupule, le Prieur lui fit remarquer que Mariano avait établi cet ouvrage malgré elle. Et comme elle ne se trouvait pas convaincue par cet argument et qu’elle alléguait que c’était « du luxe », il lui ordonna d’user du souterrain par obéissance. Alors, rassurée, elle ne présenta plus d’objections.
Cinq années passèrent de la sorte. Au mois de mai 1577, Catherine, épuisée par les austérités, tomba gravement malade. Dès le début, ayant eu révélation que c’était la fin de son existence sur terre, elle prédit qu’elle mourrait dans l’octave de l’Ascension. Le Prieur la fit transporter dans une petite maison de domestiques proche du monastère. On mit auprès d’elle deux femmes de ses amies qui lui prodiguèrent leurs soins et l’on dressa, dans sa chambre, un autel où la messe fut dite et où elle communiait tous les jours.
Enfin, le 11 mai, sentant venir la mort, elle fit prier la communauté de se réunir autour de son lit. Tous accoururent. Ils pleuraient et sanglotaient et lui demandaient sa bénédiction. « Elle n’y voulut d’abord pas consentir disant que c’était plutôt à eux de la bénir parce qu’ils étaient des saints et elle, une misérable pécheresse. Elle finit par triompher de leur résistance ; et quand tous lui eurent donné leur bénédiction, elle leur donna la sienne de bonne grâce. » Ensuite, elle eut un ravissement et parla de Dieu en des termes d’amour si brûlants que tous se sentirent comme élevés au-dessus d’eux-mêmes à l’entendre.
Puis elle entra dans un profond recueillement et, à la nuit tombante, sans agonie et sans marques de souffrance, elle rendit le dernier soupir.
Deux témoins affirment avoir vu, au moment où elle expirait, une croix formée d’étoiles éblouissantes se dessiner au-dessus de sa tête.
Dès qu’on apprit à la Roda et dans les villages d’alentour que la Bonne Femme était morte, laïques et prêtres accoururent en si grand nombre que la campagne était couverte de peuple. Les funérailles furent célébrées en grande pompe et le cercueil enterré dans une chapelle dédiée à Notre-Dame du Mont-Carmel. En 1603, les ossements furent mis dans deux châsses et transportés au monastère des Carmes déchaussés de Villeneuve de la Xara.
Ainsi vécut et mourut Catherine de Cardonne. Terminant sa relation, le bon Père François s’écrie : « Sa vie sera la condamnation rigoureuse de notre lâcheté. »
De notre temps, beaucoup de catholiques, amis de leurs aises, objecteront sans doute que : Dieu n’en demande pas tant et ils estimeront que Catherine — exagérait…
C’est une opinion ; mais il est loisible de ne point la partager.
Il y a plusieurs manières d’envisager la Révolution. Les dénombrer toutes serait fastidieux et d’ailleurs ce n’est pas l’objet que je me suis proposé dans ce chapitre. Rappelons-nous seulement qu’au point de vue religieux, la Révolution eut et continue d’avoir pour but de substituer le règne de l’homme au règne de Dieu. De là, ce caractère satanique que Joseph de Maistre dénonçait en elle. De là aussi, cette rage qui pousse le démocrate, logique avec ses principes, à traquer, à bâillonner, à supprimer quiconque préfère la tiare du Pape au bonnet rouge de Marat, l’amour du Crucifix au culte de la guillotine.
Certains esprits, dont la naïveté déconcerte, tentent de ménager un accord entre ces inconciliables et d’établir des distinctions. Ils vénèrent les bavards illusionnés de la Constituante mais réprouvent les massacreurs de septembre ; et pourtant ceux-ci procédaient de ceux-là comme le poussin sort de l’œuf. Avec une inconscience stupéfiante, ils s’efforcent de coudre au manteau de l’Église la loque dont Sanson se servait pour essuyer « le rasoir national ». Ce faisant, ils s’imaginent prouver leur libéralisme et mériter un siège au conseil de ces démagogues qui, sous couleur de République, nous mènent à l’enlisement rapide dans le marécage du socialisme intégral.
Cependant, pour peu qu’on étudie, à la clarté de la Révélation, la période qui commence à 1789 et qui dure encore, on s’aperçoit très vite que les promoteurs du délire humanitaire dont nous ne cessons de subir les accès, furent tout simplement — des possédés.
Or, à l’une des époques où cette fièvre chaude tourna en frénésie meurtrière, c’est-à-dire sous la Terreur, il y eut un certain nombre de dévoués pour assumer les blessures dont l’athéisme révolutionnaire criblait le corps mystique de Jésus-Christ. Les uns confessèrent joyeusement leur foi sur l’échafaud. D’autres, errant parmi la boue sanglante dont s’empoissait le pavé des rues, maintinrent, par l’oraison et le sacrifice, un peu de Lumière incréée dans les ténèbres qui couvraient la face de la France en folie.
Au nombre de ces derniers, on compte une Carmélite : la Mère Camille de l’Enfant-Jésus, née de Soyecourt, dont j’essaierai d’évoquer la figure. Je ne donnerai pas sa vie entière. Elle est racontée dans un volume, d’un style un peu clapotant, rédigé par une Carmélite, annoté par l’abbé Lescœur et publié en 1897. D’après ce livre et quelques écrits postérieurs, je m’efforcerai seulement de profiler la Mère Camille telle qu’elle se montra, — à savoir paisiblement énergique — à travers les gambades, les grimaces et les grincements de canines des anthropoïdes sanguinaires échappés de leur cage que les Michelet, les Hugo et autres rêveurs romantiques nomment : « les géants de 93 ».
Marie-Térèse-Françoise-Camille de Soyecourt naquit à Paris, le 25 juin 1757, d’une famille très ancienne dont la biographe étale, avec complaisance, la généalogie depuis le temps des Croisades. On peut supposer que, devenue Carmélite, Mlle de Soyecourt faisait bon marché de ses parchemins et qu’elle se répétait la phrase de sainte Térèse : « Disputer sur la noblesse de l’origine c’est débattre si telle sorte de terre vaut mieux que telle autre pour faire des briques ou du torchis… »
Nous passerons rapidement sur les premières années de cette existence. Ce qu’il nous importe seulement de connaître ce sont les circonstances où se développa la vocation religieuse de la Mère Camille.
Enfant, elle se montra d’abord assez vaniteuse des larges yeux noirs qui lui éclairaient toute la figure ; en outre, d’après son propre témoignage, elle manifestait un caractère impérieux et une force de volonté qui serait allée jusqu’à l’entêtement si ses parents — fort répandus dans le grand monde et, néanmoins, fort pieux — n’avaient pris soin de la corriger sans faiblesse.
Elle avait huit ans quand elle fut mise pensionnaire à la Visitation. Cette entrée au couvent déplut fort à la petite fille. L’esprit d’indépendance étant fort développé en elle, il arriva que dès la première minute où elle fut confiée aux soins des Religieuses par sa mère, elle entra en courroux. Trépignant, sanglotant, poussant les hauts cris, elle demandait à sortir, refusait de coucher au dortoir et de revêtir la robe d’uniforme. Il fallut toute la diplomatie de la Supérieure pour obtenir d’elle un semblant de résignation. Même quand elle parut soumise, en son intérieur, elle demeurait indignée contre la discipline et ne rêvait que d’escalader le mur du monastère pour retourner dans sa famille.
Peu à peu, sous l’influence de sa maîtresse de classe, Mme de Nollant, qui savait joindre la douceur à la fermeté, elle devint plus docile. Puis elle prit goût aux exercices de piété que, d’abord, elle considérait comme de fastidieuses obligations. Une petite flamme d’amour de Dieu commença de s’allumer dans son cœur. Dès lors, « le changement opéré chez Camille fut si notable que, trois ans après son entrée à la Visitation, elle était jugée digne d’être préparée à la confirmation qui, à cette époque, précédait souvent la première communion. »
Elle avait donc onze ans à la date de la cérémonie. Lorsque le Saint-Esprit descendit en elle, il lui sembla qu’un flot de lumière inondait son âme et qu’une voix mystérieuse la sollicitait de se détacher du monde pour être toute à Dieu. Presque défaillante de bonheur sous le souffle ardent qui la pénétrait, elle s’écria mentalement : « Seigneur, je me donne à vous ; me voici prête à accomplir votre volonté entière. »
Le moment venu de quitter la chapelle, l’enfant resta immobile. Elle était si ravie, hors d’elle-même, que deux religieuses, la croyant indisposée, l’emportèrent dans leurs bras.
Cette touche de la Grâce sanctifiante lui laissa une empreinte ineffaçable ; de ce jour, Camille comprit qu’elle serait religieuse. « Elle ne déviera plus de sa voie. Si des défaillances surviennent, elles seront courtes ; si les luttes se multiplient, elle les comptera par des victoires. »
Ses projets d’avenir s’étant fixés de la sorte, elle prit à tâche d’écarter tout ce qui aurait pu la distraire de sa vocation. Elle rechercha les occasions de briser son amour-propre, d’anéantir les velléités de révolte contre la règle qui lui revenaient par intervalles. Songeant au vœu de pauvreté, qu’elle comptait prononcer le plus tôt qu’il se pourrait, elle fit cadeau à ses compagnes des petits bijoux contenus dans une cassette qu’elle avait apportée au monastère. Elle refusa de prendre des leçons de danse et, quoique elle eût la voix très belle naturellement, elle réussit à éviter qu’on la cultivât. Le professeur de chant s’en plaignait. Mais elle lui répondit : « Je ne veux pas apprendre à chanter des romances. »
Bref, pendant ces années de pension, comme elle l’a dit plus tard, elle fit son possible pour éviter d’affaiblir le rayonnement de l’Esprit-Saint qu’elle sentait résider, d’une façon permanente, au centre de son âme.
Camille se trouvait fort heureuse à la Visitation lorsque son père, le comte de Soyecourt, dont elle était la préférée, l’en retira pour la garder quelque temps auprès de lui. Mais au XVIIIe siècle, il n’était guère de coutume que les jeunes filles achevassent leur éducation au foyer domestique. C’est pourquoi, l’époque de sa première communion approchant, on la conduisit, avec ses sœurs, chez les Bénédictines de Tresnel.
Une épreuve des plus douloureuses l’attendait dans cette maison. Non seulement la communauté suivait une règle très austère mais elle s’était contaminée de jansénisme et les religieuses mettaient un zèle farouche à modeler l’esprit de leurs élèves d’après cette morne doctrine. Sous leur influence, Camille sentit comme une cendre froide étouffer peu à peu la flamme d’amour divin qu’elle entretenait dans son âme. Comme on ne cessait de lui répéter que Jésus-Christ est un Maître implacable qui prédestine la plupart des hommes à la damnation et ne sauve que quelques élus arbitrairement choisis, elle vécut dans le tremblement et dans l’effroi. Elle se demandait, à chaque instant, si, malgré son ardent désir de la Grâce efficace et son ferme propos de tout entreprendre pour mériter son salut, elle n’était pas une réprouvée. Elle se torturait de scrupules dont on trouve l’écho dans les notes où elle tâchait de s’expliquer, à elle-même, ses états d’âme. Elle écrivait par exemple : « Seigneur, parlez à votre petite servante abattue et désolée ; relevez son courage ; rendez la paix à son cœur agité. Dites à mon âme qu’il lui est né un Sauveur… Mais êtes-vous né pour moi, Dieu de justice ? Je voudrais le croire : naissez donc dans mon pauvre cœur et achevez de vous y former. »
Cependant, nul secours ne lui venait de l’entourage. Courbées, elles aussi, sous le joug écrasant de l’implacable Divinité que l’hérésie leur imposait, les Bénédictines renchérissaient sur la doctrine des prêtres aberrants qui les dirigeaient. Rassurer les enfants dont elles avaient pris la charge leur aurait semblé une coupable faiblesse. A peine un atome d’espérance dans un océan de crainte, telle était la matière de leur enseignement.
Camille, étant d’une santé assez délicate, finit par succomber sous le bloc de glace dont on l’écrasait. Elle tomba si gravement malade que les médecins jugèrent qu’elle n’en reviendrait pas. Dieu pourtant lui rendit la santé d’une façon tellement inopinée qu’on crut y voir un miracle. Mais elle continua d’ignorer la paix de l’âme car à peine fut-elle rétablie que le Démon l’attaqua par la tentation de désespoir. « Aux suggestions infernales, dit le biographe, s’ajouta l’influence de lectures hasardées contenant des enseignements aussi faux que terrifiants, sur la préparation aux sacrements. En proie à de mortelles angoisses, n’entrevoyant, pour l’avenir, que de désolantes perspectives, livrée surtout à l’isolement le plus complet, elle perdit peu à peu ses forces et donna des chances de succès au tentateur. Une taciturnité morose s’empara d’elle et c’est avec peine qu’elle réussissait à dissimuler sa tristesse. »
Ce fut dans cet état qu’elle fit sa première communion. Selon les principes du jansénisme, la cérémonie avait été différée le plus possible. Camille avait quinze ans et demi lorsqu’elle s’approcha, pour la première fois, de la Sainte Table. Toujours dominée par le sentiment qu’elle était indigne de recevoir son Dieu, elle communia sans joie — cependant avec la ferme volonté de le servir sans partage et sans défaillance. « J’espérais seulement, a-t-elle dit plus tard, que cette communion me sanctifierait et me maintiendrait dans l’aversion pour le péché. »
Elle rentra ensuite dans sa famille où de nouvelles épreuves l’attendaient.
L’empreinte du jansénisme sur son âme avait été si forte, qu’elle persista lorsque Camille se trouva dans un milieu où les sombres impressions reçues au monastère auraient pu se dissiper. C’est ainsi qu’elle conserva cette crainte de la communion qui caractérise la secte et qu’elle laissa couler bien des jours avant d’oser recevoir de nouveau le sacrement. Elle souffrait d’autant plus de la contrainte qu’elle s’imposait de la sorte que son âme aurait voulu se dilater hors des ténèbres où elle languissait. Néanmoins, si épaisse que fût cette ombre où elle demeurait comme prostrée, elle voyait toujours, au plus intime d’elle-même, briller une petite étincelle du feu d’amour divin qu’elle avait reçu lors de sa confirmation et elle entendait parfois une voix mystérieuse lui chuchoter qu’elle prendrait le voile, si indigne qu’elle s’en jugeât. C’était sa vocation qui subsistait malgré les subterfuges employés par le Mauvais pour la maintenir sur la route de la désespérance.
Elle vivait donc dans cet état d’angoisse perpétuel et d’incertitude à peine atténué par un rudiment de lumière intérieure lorsque un événement se produisit qui l’obligea de prendre un parti décisif en lui fournissant une preuve que son penchant vers la vie religieuse constituait sa raison d’être au regard de Dieu.
Quoiqu’elle n’eût que dix-sept ans, ses parents décidèrent de la marier avec un vieux gentilhomme, des plus fripés, violemment asthmatique, cacochyme et brèche-dents mais chez qui force sacs d’écus compensaient — d’après les « gens pratiques », — la décrépitude. Au XVIIIe siècle, il n’était pas toléré qu’une mineure manifestât de l’opposition à un mariage voulu par ses père et mère. Camille ne concevait même pas qu’elle pût refuser le parti qu’on lui proposait. Tout ce qu’elle osa, ce fut de prier, ardemment et avec larmes, Notre-Seigneur, de lui épargner la catastrophe matrimoniale dont la seule pensée lui faisait horreur.
Elle fut exaucée car le prétendant suranné mourut avant même que les fiançailles eussent été déclarées.
Cette alerte tira la jeune fille de son engourdissement.
« Sans trop savoir où la mènerait sa résolution, dit la biographe, elle déclara à sa famille que, depuis plusieurs années, son désir était de se consacrer à Dieu. Cette détermination plongea ses parents dans la douleur. Le comte de Soyecourt, surtout, malgré sa foi profonde et son estime de la vie religieuse, ne pouvait entrevoir un pareil sacrifice. Il signifia à sa fille qu’elle n’aurait jamais son consentement. Camille répondit avec fermeté qu’elle attendrait, s’il le fallait, ses vingt-cinq ans, époque de sa majorité. Dès lors, elle se montra aussi ferme dans sa résolution qu’elle avait paru indécise à la première proposition.
« Son état intérieur n’était pourtant pas changé. Mais Dieu lui avait octroyé, sans la lui faire sentir, la grâce qui devait l’aider à suivre le chemin tracé par Lui de toute éternité. »
Il lui restait encore plus de neuf ans à passer dans le monde. On verra combien sa vocation était solide quand on se rappellera que rien, au dedans d’elle ni au dehors, ne venait plus l’encourager.
« Le combat se présentait sous toutes les formes. Dans son âme, la stupeur, la crainte continuelle, la nuit la plus obscure. » Dans son entourage, l’affection des siens qui mettaient tout en œuvre pour la détourner du cloître en lui donnant le goût des plaisirs mondains. « Briser son cœur pour l’offrir à Dieu lui eût semblé peu de chose si la confiance et l’amour l’eussent aidée dans son sacrifice. Mais cette double lutte, aggravée par une attente si prolongée, fit de la période qui suivit un martyr continuel. C’était une préparation à la carrière de sacrifice et de générosité que Dieu l’appelait à fournir dans l’Ordre du Carmel. »
C’était aussi une école d’énergie. Sa volonté s’y développa. Et ainsi, elle acquit cette endurance et cette vigueur d’âme dont elle allait avoir besoin pour traverser la tempête révolutionnaire.
La jeune fille avait gardé un appartement à l’abbaye de Tresnel pour y faire de longues retraites. Mais ses parents ayant exigé qu’elle passât plusieurs mois, chaque année, dans leur hôtel de la rue de Verneuil, elle se voyait obligée d’assister à des réceptions brillantes et à des fêtes qui troublaient son recueillement. Si jeune encore, elle ne laissait point, par moments, de subir un peu l’attrait de la société frivole et chatoyante qui bruissait autour d’elle.
Elle écrit dans des notes qui ont été conservées : « Il me fallait bien souvent lutter contre moi-même pour résister à l’entraînement. Je n’aimais pas le monde parce que j’avais compris sa vanité ; j’avais subi sa fascination parce que tout, en moi, avait besoin de vie et d’affection. » Et plus loin : « Au milieu de tant de relations que je me trouvais forcée d’entretenir même avec les personnes de la cour, je pris peu à peu leurs habitudes et me laissait aller à une si grande recherche de mes aises qu’évitant les moindres incommodités, j’en étais venue au point de faire lever ma femme de chambre la nuit, lorsque le moindre pli venait heurter ma délicatesse. Avec le désir de quitter le monde je commençais à arborer ses enseignes. J’aimais que tout ce que je portais fût de bon goût et je n’étais pas indifférente aux murmures flatteurs que ma présence provoquait. Cependant, au milieu de ces futilités, le son d’une cloche de couvent venait-il frapper mes oreilles, un saisissement involontaire s’emparait de tout mon être. Portant mes regards vers le ciel, je conjurais le Seigneur d’avoir pitié de moi. »
Quand Dieu appelle une âme à la vie religieuse et que celle-ci ne cède pas tout d’abord à la vocation, il se fait en elle un dédoublement. D’une part son imagination et sa sensibilité tentent sans cesse d’échapper aux invitations de la voix surnaturelle qui les presse d’obéir. D’autre part, quoiqu’elle cherche à se donner le change, son entendement et sa volonté sont, bon gré mal gré, ramenés, dès qu’elle rentre en elle-même, à la persuasion qu’elle fera le sacrifice que le Maître lui demande.
Tel fut le cas de Mlle de Soyecourt. Enfin, il arriva un moment où toute résistance se fit impossible. Elle résolut alors de vaincre sa famille en lui opposant le fait accompli. — Elle se rendit, sous prétexte d’y faire une retraite, chez les Bénédictines du Saint-Sépulcre. Mais le temps de la retraite terminé, avec l’agrément de l’abbesse, elle envoya à sa mère une lettre où elle lui demandait l’autorisation d’entrer au noviciat. Au reçu de cette missive, « Mme de Soyecourt ne fut pas maîtresse d’un mouvement d’indignation. Elle monta sur-le-champ en voiture, sans même prendre le temps de remédier au négligé de sa toilette, et se rendit en hâte au monastère. Sans ménager à l’abbesse le témoignage des sentiments de son cœur profondément affligé, elle fit à sa fille de sévères reproches pour un tel manque de soumission. Celle-ci essaya de protester, assurant qu’elle retarderait ses vœux jusqu’à sa majorité. Elle eut beau prier, conjurer, la comtesse demeura inflexible et l’obligea de quitter la clôture en lui défendant de parler à l’avenir de sa vocation ».
C’était demander la chose impossible. Pendant les dix-huit mois que Camille eut encore à passer dans le monde, à toutes les objurgations, elle répondit, avec une ferme douceur, qu’elle était sûre de sa vocation et que rien ne la ferait varier.
A la longue, les parents cédèrent. Leur chagrin était énorme mais, comme après tout, c’étaient de pieuses gens, ils finirent par comprendre qu’en s’obstinant, ils contrarieraient les desseins de Dieu sur l’âme de leur fille. Ils donnèrent donc leur consentement avec la promesse de laisser Camille choisir l’Ordre où elle prendrait le voile.
Camille avait en vue les Bénédictines. Mais avant de se décider, elle consulta le Père Rufin, son directeur, qui l’avait assistée avec zèle et clairvoyance, dans la crise qu’elle venait de traverser.
Au cours de l’entretien où Mlle de Soyecourt lui soumit son projet d’entrer dans l’ordre de Saint-Benoit, elle lui dit : « J’éprouve, néanmoins une répugnance fort grande pour un des usages de cette congrégation.
— Et lequel ? demanda le religieux.
— Les relations avec le monde y sont fréquentes, mon Père, surtout avec les dames pensionnaires et je voudrais tant rompre d’une façon totale avec le monde !
— Vous trouverez cet inconvénient partout, reprit le Père Rufin, sauf chez les Carmélites. »
A ces mots, Camille sentit en elle une illumination ; ce fut comme si une existence pressentie depuis longtemps et pour laquelle tout son être était préparé venait de lui être révélée.
« De grâce, mon Père, s’écria-t-elle avec vivacité, allez vite me proposer au Carmel. »
Le directeur y consentit. Il se rendit auprès de la Prieure des Carmélites de la rue de Grenelle, lui exposa en détail l’histoire de sa pénitente et formula l’opinion que le Carmel répondait parfaitement aux aspirations de cette âme assoiffée de sacrifice.
La Prieure, bien disposée par ce préliminaire, voulut voir Camille qui vint la trouver aussitôt et, dans un long entretien, lui décrivit, sans réticence, les grâces qu’elle avait reçues, ses angoisses, ses luttes, et enfin son désir de se donner à Dieu dans la clôture la plus stricte.
La Prieure reconnut à tous ces traits les marques d’une sincère vocation. Mais elle ne voulut pas prendre congé de la jeune fille sans lui laisser entrevoir quelques-unes des mortifications en usage au Carmel.
« Savez-vous quelque chose de notre genre de vie, lui dit-elle, et votre santé pourra-t-elle s’y faire ?
— Je compte sur Dieu, répondit la postulante.
— Aimez-vous le poisson ?
— Je le hais !
— Et les œufs ?
— Je les déteste ! Je fais maigre le vendredi mais, très souvent, j’ai la migraine le samedi.
— Comment pouvez-vous donc être Carmélite ?
— Je ferai pénitence ; c’est là tout mon désir. »
Vaincue par tant de résolution, la Prieure déclara qu’elle admettrait Camille comme postulante. On était au mois d’octobre 1783 ; l’entrée fut fixée au 2 février de l’année suivante, fête de la Purification de la Sainte Vierge.
La biographe ajoute : « Il s’agissait de préparer le départ et d’annoncer la résolution à la famille. La nouvelle fut donc donnée par Mlle de Soyecourt à ses parents. L’alarme fut grande et, malgré la certitude où l’on était de la séparation, le choix de l’Ordre vint s’ajouter à la douleur générale.
« Pour la mère surtout, le Carmel était le dernier mot de l’épouvante. Cette fille si aimée, de santé si frêle, allait entrer dans un Institut où tout est fait pour crucifier la nature. Elle ne pouvait s’habituer à cette pensée. On était à l’entrée de l’hiver dont les rigueurs s’annonçaient déjà et la mère s’exagérait les souffrances que sa fille aurait à endurer dès le début.
« C’est insensé, disait-elle à son mari, je crois, en vérité, que nous aurions le droit d’empêcher notre fille de commettre une pareille folie !… »
Mais M. de Soyecourt ne voulut pas revenir sur la parole donnée. En outre, il possédait, plus que sa femme, le sens du surnaturel.
« Vous avez raison, lui répondit-il, c’est une folie, mais cette folie se nomme la folie de la croix. Puisque cet Ordre est ancien et fort approuvé par l’Église, je ne vois aucun motif d’interdire à ma fille d’y entrer. Quel que soit mon chagrin, si Dieu l’y appelle et si c’est sa vocation, je m’incline. »
Mme de Soyecourt fut longue à se résigner ; elle fit encore plusieurs tentatives pour déterminer sa fille à choisir un Ordre moins austère. Mais le parti de Camille était bien pris. Elle repoussa toutes les obsessions avec douceur mais avec netteté. — Et elle entra, tout heureuse, au Carmel, le jour fixé par la Prieure, c’est-à-dire le 2 février 1784.
Le postulat de Camille dura trois mois au cours desquels sa vocation ne cessa de s’affirmer. Le courage qu’elle montra dans les épreuves corporelles que ne lui ménageait pas une règle attentive à vaincre la nature fit bien augurer de sa persévérance. Comme les premiers temps, la Prieure avait voulu que, pour dormir, elle eût un matelas sur la paillasse grossière qui constituait la seule couche de ses compagnes, elle se récria et voulut refuser cet adoucissement. Ce ne fut que sur un ordre formel qu’elle l’accepta. « Il est vrai, disait-elle plus tard, que ce pauvre matelas était si dur que la paillasse, assurément, ne m’aurait pas fait souffrir davantage. »
Au point de vue spirituel, la jeune fille sentit s’élargir l’horizon de sa vie intérieure. La contrainte terrifiée, qui pesait sur son âme depuis l’époque où elle avait subi une formation imbue de jansénisme, se dissipa pour ne plus revenir. Elle commença de se dilater au soleil de l’amour divin. Grâce à la direction aussi perspicace qu’affectueuse de ses supérieures, elle en vint à sentir que Notre-Seigneur n’est pas un tyran farouche et impossible à satisfaire mais, pour ceux qui se donnent à Lui avec une simplicité généreuse, un Grand Ami plein de sollicitude et d’indulgence. Bientôt elle put écrire dans le cahier où elle notait ses impressions quotidiennes, ces lignes significatives : « Mon Dieu, par vous je goûte à présent combien vous êtes doux et aimable. Le monde n’imagine pas cette sorte de bonheur et vous ne m’avez faite Carmélite que pour en convaincre le monde. Oui, mon Dieu, vous me tenez lieu de tout. Je perdrais tout le reste que rien ne pourrait plus me séparer de votre amour. Dans le ciel, je ne désire que vous. Sur la terre, je ne vois rien qui mérite mon amour si ce n’est vous. Vous m’aimez, je n’en puis douter. Mais, moi aussi, Seigneur, je vous aime et je me repose en paix dans votre amour. »
Cette effusion, où se retrouve l’esprit de sainte Térèse, montre bien que l’hérésie n’avait fait que ravager l’âme de Camille à la surface, sans la dessécher en ses profondeurs puisque, dès qu’elle eut repris contact avec la Vérité unique, toutes ses puissances s’épanouirent, dans l’amour, comme les fleurs splendides d’un Éden reconquis.
Le trimestre du postulat étant accompli, Camille fut jugée apte à poursuivre sa probation comme novice. La cérémonie de la prise d’habit fut fixée au 24 juillet. Mme de Soyecourt fut la seule de la famille à y assister, le père, quoiqu’il eût fait son sacrifice, n’ayant pu se résoudre à sanctionner, par sa présence, un acte qu’il considérait presque comme la mise au tombeau de son enfant.
Par contre, une nombreuse assistance remplissait la chapelle des Carmélites. « Les plus grandes familles de France y étaient représentées. La haute noblesse du faubourg Saint-Germain n’avait pas oublié la jeune fille souvent admirée dans ses fêtes et semblait désireuse de constater, par elle-même, si réellement la joie du sacrifice résidait dans son cœur. »
On possède sur les sentiments de cette frivole assemblée un témoignage assez inattendu : celui du roi Louis-Philippe. — Duc de Chartres à l’époque, il avait été conduit, avec sa sœur, Adélaïde, par Mme de Genlis, leur gouvernante commune, à la prise d’habit de la Sœur de Soyecourt. Le souvenir de la cérémonie lui était demeuré si présent, qu’un soir, en 1847, au château de Neuilly, le nom de la Carmélite ayant été prononcé par hasard, il en donna le détail avec une précision qui prouvait l’excellence de sa mémoire.
« Il y avait là, dit-il, une réunion de gens fort titrés mais on ne peut moins recueillis. On se passait des lunettes d’opéra pour examiner l’héroïne. En grand costume de cour, avec paniers, falbalas, coiffes, dentelles et piquets de roses, elle venait de s’agenouiller devant Mgr de Juigné, archevêque de Paris, assis juste au milieu de l’assistance, entouré d’évêques et de chanoines. La novice était si émue qu’elle semblait prête à crouler sous le poids de ses jupes. Le Père Le Guay, jésuite, prononça le sermon de vêture qu’on n’entendit guère à cause du flic-flac des éventails, du bourdonnement des conversations et des sanglots de Mme de Soyecourt. L’opinion générale était que la jeune fille ne résisterait pas plus de six mois au dur régime du Carmel et que cette prise de voile équivalait à un suicide. Bref, ce fut un événement mondain et l’on en parla pendant plusieurs jours. »
Quelqu’un demanda ce qu’était devenue la Carmélite.
« Je ne sais, répondit le roi, elle a dû succomber en peu de temps car elle paraissait bien frêle, à moins que la Révolution… » D’un geste coupant, il acheva sa pensée — et l’on parla d’autre chose[10].
[10] Voir G. Lenotre : Vieilles maisons, vieux papiers, 2e série, page 344.
L’année de noviciat permit à Camille d’avancer allégrement dans ce chemin de la perfection dont sainte Térèse a si admirablement marqué les étapes. Le 18 août 1785, elle prononça ses vœux solennels. Et maintenant, dans cette clôture d’où il paraissait assuré qu’elle ne sortirait jamais plus, elle goûtait cette joie dont les mondains ne peuvent soupçonner les douceurs : vivre dans le renoncement à soi-même, dans la pénitence pour les péchés d’autrui, dans une radieuse union avec Jésus-Rédempteur.
Il ne fallait pas moins que l’atmosphère surnaturelle où son âme baignait de la sorte pour que sa santé délicate supportât les rigueurs de la règle. Même les détails de la vie quotidienne lui demandaient un effort sans cesse renouvelé. Par exemple, chaque matin, au moment de revêtir la lourde robe de bure, elle devait la suspendre à un clou et se placer dessous pour s’y introduire car son peu de forces physiques ne lui aurait pas permis de la soulever. Afin, dit-elle, de développer ses muscles, elle demanda d’être appliquée aux travaux pénibles. On le lui permit ; et, dès lors, elle se donna les tâches d’une femme de peine. Elle monta au grenier des corbeilles remplies de linge ; elle fendit du bois, tira de l’eau du puits, arrosa le jardin. Quant à la couture, elle n’y réussit guère. Elle a dit plus tard, racontant à des novices ses débuts dans la vie religieuse : « Fort peu habile, j’en accusais la raideur de mes doigts. Je redoublais d’énergie mais je n’ai jamais réussi qu’à constater mes maladresses. »
Entre temps, suivant la tradition du Carmel, elle composait de petits cantiques qu’elle chantait à la récréation ou dont elle méditait les vers aux heures d’oraison. En la dernière strophe d’un de ces naïfs poèmes, elle a fort bien résumé l’esprit de son ordre :
C’est ainsi qu’elle vivait toute à Dieu, toute en Dieu, lorsqu’éclata la tempête qui la rejeta dans le monde de la façon la plus douloureuse.
La Révolution commence ; et l’une des premières mesures prises par les sectaires qui déchaînent ce fléau sur la France, c’est la destruction des communautés religieuses. L’opération est double : d’abord, on dresse l’inventaire de leurs biens pour les confisquer ; ensuite, en vertu de ce répertoire d’inepties : la table des droits de l’homme, on interdit aux moines et aux moniales de vivre en commun dans le renoncement perpétuel et de se vouer à l’obéissance, sous prétexte que cette abnégation offusque l’esprit de liberté qui doit, désormais, régir toutes les âmes.
Le 13 février 1790, l’Assemblée nationale décrète que la loi cesse de reconnaître les vœux solennels. En conséquence, les ordres dans lesquels ces vœux existent, sont et demeurent supprimés. Ceux et celles qui en font partie sont invités à se disperser dans le plus bref délai. En compensation, l’Assemblée leur promettait une pension de l’État qui ne fut, d’ailleurs, presque jamais payée.
La mesure fut appliquée avec rigueur. Aux visites et informations dans les maisons religieuses succédèrent les enquêtes sur le personnel, les charges et les revenus. Enfin l’avertissement fut donné que l’expulsion ne tarderait pas.
Les pauvres Carmélites ne comprenaient rien à cette rage de destruction. De bonne foi, elles crurent que, ne nuisant à personne, elles obtiendraient, sans peine, de l’Assemblée l’autorisation de rester ensemble et de conserver les quelques sous qui leur permettaient d’assurer leur chétive alimentation. Les Prieures des quatre monastères de Paris se concertèrent et rédigèrent une adresse où, avec une simplicité touchante, elles exposaient leur désir de poursuivre en commun leur existence de prière et de sacrifice.
Voici les principaux passages de cette supplique :
« … Les richesses des Carmélites n’ont jamais tenté la cupidité ; leurs besoins n’importunent pas la bienfaisance. Notre fortune est cette pauvreté évangélique qui, en acquittant toutes les charges de la société, trouve encore moyen d’aider les malheureux, de secourir la patrie et nous rend pourtant heureuses de nos privations. La liberté la plus entière préside à nos vœux ; l’égalité la plus parfaite règne dans nos maisons ; nous ne connaissons ici ni riches ni nobles et nous n’y dépendons que de la loi commune…
« Daignez vous informer de notre vie ; n’en croyez ni les préventions de la multitude, ni les craintes de l’humanité. On aime à publier, dans le monde, que les monastères n’enferment que des victimes lentement consumées par les regrets. Mais nous protestons devant Dieu que, s’il est sur la terre une véritable félicité, nous en jouissons à l’ombre du sanctuaire et que, s’il nous fallait opter entre le siècle et le cloître, il n’est aucune de nous qui ne ratifiât son premier choix…
« Non, vous ne nous arracherez pas à cette retraite où nous trouvons la source de toutes les consolations. Vous penserez que des femmes, volontairement engagées dans un état qui fait le bonheur de leur vie, réclament de tous les droits le plus inviolable quand elles vous conjurent de les y laisser mourir en paix… Nous osons le dire : nous regarderions comme l’oppression la plus cruelle et la plus injuste, celle qui troublerait des asiles que nous avons toujours regardés comme inviolables… »
Certes, rien de plus pathétique que cet humble appel à l’équité. Mais il s’agissait bien d’équité. Il s’agissait de détruire l’Église de France. Les Carmélites ignoraient que tel était l’objectif des soi-disant Pères de la Patrie auxquels s’adressait leur requête. Comme on leur répondit par une vague promesse de les laisser mourir dans leur maison, à condition qu’il ne s’y ferait plus de nouvelles professions, elles se crurent à l’abri. Leur sécurité alla si loin qu’elles chantèrent un Te Deum en action de grâces. L’événement ne tarda pas à leur prouver qu’elles n’avaient connu encore que les préludes de la persécution.
En effet, la Révolution poursuivait sa marche dévastatrice. Le 10 août 1792, le palais des Tuileries fut enlevé d’assaut par une bande d’énergumènes, la monarchie renversée et la famille royale enfermée au Temple. Les prisons s’emplissaient d’ecclésiastiques qui, par horreur du schisme, avaient refusé le serment d’adhésion à la constitution civile du clergé. Aux premiers jours de septembre commencèrent les massacres. Cent vingt prêtres, trois évêques incarcérés au couvent des Carmes furent tués, à coups de piques et de sabres, le 2 de ce mois. Comme la maison de la rue de Grenelle se trouvait à proximité, les religieuses furent averties presque aussitôt qu’elles étaient en danger car des voisins avaient entendu les égorgeurs dire : « Demain, ce sera le tour des religieuses. »
La Prieure réunit toutes ses filles et leur apprit le danger qu’elles couraient. Elle leur annonça la prochaine visite des massacreurs. Elle ajouta : « Toute permission nous est donnée de sortir de notre clôture, non pas seulement par les lois nouvelles qui ne reconnaissent plus nos vœux mais par nos supérieurs qui ne veulent pas nous contraindre à subir la violence et la mort. »
Quelques religieuses lui demandèrent si elle-même comptait s’enfuir.
« Non, dit la Prieure, d’un ton paisible, je préfère m’abandonner entre les mains de Dieu. J’attendrai pour m’en aller d’y être obligée par la force. »
Sur ce propos, les Carmélites, aussi intrépides que leur Mère, s’écrièrent d’un même élan et d’un même cœur : « Nous resterons avec vous ! »
Puis toutes se réunirent dans la chapelle, pour y passer la nuit en prières devant le Saint Sacrement.
Vers onze heures du soir, une cinquantaine de forcenés, brandissant des armes ruisselantes de sang, se présentèrent à la porterie et demandèrent l’entrée sous prétexte de saisir un prêtre, échappé des Carmes, et qu’on avait vu traverser le jardin du monastère. Il fallut leur ouvrir. Ils fouillèrent partout, mais n’ayant trouvé personne, ils finirent par se retirer non sans avoir déclaré qu’ils reviendraient et que, cette fois, les religieuses apprendraient « à danser sous le tranchant de leurs sabres ».
Quelques amis de la communauté, coururent à la section et supplièrent qu’on envoyât des gardes nationaux afin de protéger les religieuses. Mais les commissaires leur répondirent tranquillement qu’ils n’y pouvaient rien.
D’ailleurs, toute la populace du quartier s’était mise d’accord pour envahir la maison, la saccager et la piller. Les blanchisseuses des rues avoisinantes, avec qui faisaient chorus une tourbe d’ivrognes et de filous, « criaient, par-dessus les murs qu’il fallait chasser ces aristocrates dont la propriété leur appartenait par droit d’égalité ».
Le jour de la Nativité, donc le 8 septembre, un groupe de sectaires força la clôture et donna l’ordre aux religieuses de quitter l’habit monastique. On leur obéit. Mais cette soumission immédiate ne les apaisa point. Ce qu’ils voulaient c’était chasser les Carmélites et s’emparer des trésors qu’on leur attribuait.
Ils revinrent le 11 signifier son expulsion à la communauté. Ils lui accordèrent trois jours pour se disperser. Mais sans attendre la fin de ce délai, ils ouvrirent toutes les portes et dirent à la foule qu’elle pouvait entrer librement et dérober les objets à sa convenance. Aussitôt un flot d’hommes, de femmes et d’enfants envahit, pêle mêle, la maison. Ils raflèrent tout ce qui leur tomba sous la main, dévorèrent ou gaspillèrent les provisions, brisèrent les meubles. L’autorité laissait faire et applaudissait aux exploits des plus frénétiques. Inutile de dire que, durant ce ravage, les religieuses étaient copieusement insultées.
Les mêmes orgies se renouvelèrent le lendemain et le surlendemain. Les sœurs restaient habillées de leurs défroques laïques et passaient la nuit sur des chaises pour être prêtes, en cas d’égorgement.
Enfin, le 14, deux commissaires de la section se présentèrent munis d’un mandat de confiscation. « Ils mirent en pièces les reliquaires, s’emparèrent des vases sacrés en or ou en argent. Un tableau de la Sainte Face était conservé dans un cadre enrichi de diamants. La pieuse image fut d’abord jetée à terre, comme insignifiante, tandis que ses ornements étaient enlevés. Puis l’un des commissaires la ramassa et la remit entre les mains de la Prieure stupéfaite d’un tel procédé au moment où l’on se préparait à la chasser avec ses religieuses. »
La spoliation terminée, les Carmélites furent rangées deux par deux et on les fit défiler devant la populace qui poussait des huées, leur crachait à la figure et les bousculait avec de grands éclats de rire. Elles étaient trente et une dont la plus âgée comptait quatre-vingts ans.
Paisibles sous les outrages, s’unissant par l’oraison à Jésus sur la Voie douloureuse, elles sortirent par petits groupes et s’éloignèrent dans la nuit.
La maison fut fermée, et peu après, démolie. Comme les trois autres communautés de Paris avaient subi un sort analogue, le Démon eut lieu de se réjouir car il semblait bien que le Carmel fût à jamais aboli.
Ayant prévu la dispersion, la Prieure des Carmélites de la rue de Grenelle avait loué et fait arranger en ville plusieurs appartements entre chacun desquels ses filles furent réparties. Ainsi se reformèrent de petites communautés rue du Regard, rue Cassette, rue Coppeau, rue de la Harpe et rue Mouffetard. Sœur Camille fit partie de cette dernière avec six autres religieuses. Elles étaient obligées de porter des vêtements laïques, mais elles n’en suivaient pas moins leur règle aussi exactement que possible. Toutefois les Supérieurs leur avaient permis de se visiter. Elles l’auraient fait souvent si la surveillance ombrageuse des agents révolutionnaires le leur avait permis. Faute de mieux, elles s’écrivaient. Une converse, la Sœur Chrétienne cachait les lettres au fond d’une hotte, les recouvrait de mouron pour les petits oiseaux et faisait la navette entre les divers logis. Une mésaventure lui advint qui mit un terme à cette correspondance.
Un jour, oubliant que, pour la vraisemblance, elle aurait dû crier sa marchandise, elle courait, tête baissée, vers l’un des refuges, quand, au coin d’une rue, une femme l’arrête en l’empoignant par son fichu.
« Dites donc, ma petite, s’écrie-t-elle, vous me semblez une drôle de commerçante, vous ! Vous ne voulez donc pas vendre votre mouron ? »
Puis d’un coup de poing en pleine poitrine, elle renverse la Sœur sur le pavé. Le mouron et les lettres s’éparpillent çà et là. L’autre s’en empare, rosse la Sœur d’importance et s’éloigne en emportant les papiers. Il ne résulta rien de cette alerte. Mais les Carmélites n’osèrent plus employer le subterfuge. L’abbé de Launay, leur directeur, se chargea dès lors de transmettre les missives. Déguisé, il allait d’une communauté à l’autre. Et même il réussit à leur dire parfois la messe. A cet effet, se donnant pour professeur de dessin, il circulait dans Paris, un carton à modèles qui contenait une pierre d’autel sous le bras et, à la main, un étui à estampes renfermant un calice démonté. Il leur avait permis de garder le Saint-Sacrement dans une armoire, avec recommandation expresse de consommer les Saintes-Espèces, au moindre soupçon d’une visite domiciliaire.
« Jour et nuit, écrit la biographe, le divin prisonnier était adoré dans l’humble chambre transformée en chapelle. Il résidait dans un petit tabernacle, continuant à être leur force et leur espérance. Si momentanément il paraissait sommeiller, c’était afin de recevoir l’hommage de leur foi invincible et de leur confiance sans bornes. »
Sous l’égide du Sauveur, les Carmélites récitaient le bréviaire en commun ou séparément, veillaient, priaient, se mortifiaient — bref tâchaient d’observer sans trop de lacunes le coutumier de l’ordre. Cette existence d’oraison et d’entier abandon à Dieu acheva, pour ainsi dire, la formation de Sœur Camille. Elle y acquit ce calme imperturbable et cette fermeté d’esprit dont elle devait donner tant de preuves par la suite.
Le petit groupe ne possédant aucune ressource, les religieuses se mirent à confectionner des broderies qu’elles vendaient dans le voisinage. Elles tiraient de cette industrie quelques assignats qui leur procuraient une chétive nourriture. Pour ce travail, Camille ne les aidait guère. « J’y étais si peu apte, a-t-elle dit plus tard, que, pendant que mes sœurs profitaient des dernières lueurs du jour pour tirer l’aiguille, je me réfugiais tout près de notre cher Tabernacle et je priais. »
Elle se donna aussi pour objectif de soutenir le moral de la communauté. Aux récréations, elle montrait de la bonne humeur, elle savait par des propos enjoués « faire rentrer dans les cœurs alarmés la fière énergie dont le sien débordait ».
« Que ferons-nous, demandait une des Sœurs, si l’on nous mène devant les tribunaux ?
— Ce que Dieu voudra, répondit-elle ; n’a-t-il pas dit que son Esprit se tiendra lui-même sur nos lèvres pour nous donner les paroles qui conviendront. Comptons sur Lui… »
Cependant la quiétude relative du petit cénacle ne dura guère. Elles étaient espionnées de près et bientôt les zélés de la section acquirent la certitude qu’elles recevaient des prêtres insermentés. En ce temps, cela constituait un crime capital. Au nom de la liberté, on avait le droit de rendre hommage à des gourgandines représentant la déesse Raison et hissées sur les autels des églises profanées. Mais rester fidèle à l’Église, accueillir ses ministres proscrits, c’était se vouer à la guillotine, à la prison ou la déportation.
Un Polonais, président de la section, s’était juré de perdre les Carmélites contre lesquelles il nourrissait une haine démocratique. Il les dénonça et obtint un mandat de perquisition suivi de l’ordre d’arrêter ces « suspectes ».
Le jour du Vendredi Saint, 20 mars 1793, vers dix heures du matin, il se présente à la maison de la rue Mouffetard, suivi de trente sectionnaires en armes.
L’appartement est fouillé, retourné de fond en comble. « Chaque pièce, chaque meuble est l’objet d’une investigation minutieuse et de questions pressantes » — le tout assaisonné d’injures et de brutalités.
On mit la main sur une correspondance adressée à « la citoyenne Soyecourt » et dont les termes prouvaient que celle-ci se tenait en relation avec des prêtres réfractaires. Les lettres n’étaient d’ailleurs pas signées.
Camille et ses compagnes — moins deux qui avaient réussi à s’enfuir — furent emmenées par les sectionnaires et, le soir même, écrouées à la prison de Sainte-Pélagie. Elles furent jetées parmi des femmes de mauvaise vie qui les accueillirent par des quolibets fangeux et les plus ignobles blasphèmes.
Dans ce milieu abominable, elles reçurent pourtant les consolations d’un prêtre intrépide, l’abbé de Lalande qui trouva le moyen de parvenir jusqu’à elles.
Voici comment il s’y prenait. Chaque semaine, vêtu en garçon marchand de vins, il se présentait à la porte de la prison, avec un panier de bouteilles sur la tête. « Il amadouait les geôliers, leur versait à boire, parlait haut et fort ; puis les intéressant à son commerce, il obtenait d’eux de parcourir toute la prison, où il vendait ses liquides, encourageait les détenues, entendait les confessions, se chargeait des lettres pour le dehors et repassait le guichet en fumant sa pipe et en emportant les bouteilles vides. »
Cependant, la sœur Camille, tenue pour la plus dangereuse des fanatiques arrêtées rue Mouffetard, subissait chaque jour, devant les commissaires de la section du Panthéon, des interrogatoires prolongés. Ils avaient lieu généralement le soir et duraient souvent de cinq heures à minuit. Soutenue par l’oraison, elle y montrait beaucoup de sang-froid et de présence d’esprit. Attentive à ne compromettre personne, elle mesurait ses réponses, ou, lorsqu’il y aurait eu danger à dire la vérité, déclarait d’une voix ferme, qu’elle ne dirait rien. Dans ce cas, ni instances ni menaces ne réussissaient à lui arracher un mot.
Parfois les enquêteurs possédaient quelque culture ; la plupart du temps, c’étaient des illettrés, qui, ne comprenant rien aux missives saisies, s’imaginaient que toute phrase dissimulait des complots. La chose devenait presque comique, quand ils s’aheurtaient à des passages où il était question de spiritualité ou de vie intérieure.
C’est ainsi que l’un d’eux, déchiffrant avec peine une lettre de direction écrite par l’abbé de Floirac, crut y découvrir cette phrase : « Il faut faire mourir la nation. » A ce coup, il crut bien tenir l’indice d’une conjuration liberticide.
« Comment, s’écria-t-il, détestable aristocrate, tu admets qu’on souhaite de faire périr la nation ! »
Sœur Camille demanda le papier, examina le texte incriminé et répondit avec un sourire assez malicieux : « Vous avez mal lu ; il ne s’agit pas de la nation mais de la nature. Mon correspondant m’écrivait ceci : Il faut faire mourir la nature et quand elle se révolte, la comprimer quoi qu’il en coûte… Cela s’adresse à ma personne morale et n’a rien à voir avec la politique. »
Mais l’autre n’était pas convaincu. Il hocha la tête et mit la lettre de côté comme très suspecte.
On saisit combien, menés par des êtres aussi obtus, les interrogatoires devenaient périlleux. Il ne faut pas oublier que, dans la plupart des cas, les inculpées se trouvaient en présence d’imbéciles féroces du même acabit.
Aussi l’on partage l’indignation de Taine quand relatant une séance de ce genre, il s’écrie : « Le soi-disant conspirateur est livré à des bêtes grossières, colériques et despotiques, qui n’écoutent rien, qui ne comprennent rien, qui n’entendent même pas les mots usuels, qui trébuchent dans leurs quiproquos, et qui, pour singer l’intelligence, pataugent dans l’ânerie. Soumise au gouvernement révolutionnaire, la France ressemble à une créature humaine que l’on forcerait à marcher sur sa tête et à penser avec ses pieds. » (Origines de la France contemporaine.)
En une autre occasion, Sœur Camille montra que si elle usait de prudence ou gardait bouche close quand ses réponses auraient pu servir contre autrui, elle ne ménageait rien dès qu’il s’agissait de confesser sa foi.
On avait mis la main, lors de la perquisition, sur un certain nombre d’images du Sacré-Cœur. Cet emblème, plus que tout autre, avait le privilège de faire entrer en fureur les révolutionnaires. Ils y voyaient à la fois un symbole de « la superstition romaine » et un signe de ralliement pour les aristos.
Interrogée dans ce sens, Sœur Camille s’écria : « Le Sacré-Cœur de Jésus, oh ! ici, je ne crains de compromettre personne ; je puis répondre en toute liberté ! Vous me reprochez d’avoir dessiné ces images, eh bien, je m’en fais gloire et si, à cause de cela, vous me condamnez, j’aurai le bonheur de mourir pour ma foi ! Le Sacré-Cœur de Jésus m’est plus cher que la vie et si, au prix de mon existence, j’obtenais qu’il soit plus connu et plus aimé, je m’estimerais trop heureuse !
— Combien avez-vous fabriqué de ces images ? demanda l’un des juges.
— J’en ai tant fait et tant donné, répliqua tranquillement la Sœur, que je ne m’en rappelle plus le nombre… »
Malgré leur acharnement, les commissaires ne parvinrent à réunir que des présomptions. Il faut croire qu’ils conservaient quelque scrupule d’équité car leur rapport ne conclut pas à l’envoi des religieuses devant le Tribunal révolutionnaire. D’autre part, la famille de Soyecourt avait multiplié les démarches pour sauver la Sœur et ses compagnes. On a lieu de supposer également que quelques-uns des enquêteurs mirent à prix leur indulgence.
Bref, le 11 mai, ils déclarèrent les preuves insuffisantes et firent remettre en liberté les Carmélites.
La Prieure, estimant que Sœur Camille restait la plus compromise, décida qu’elle rentrerait provisoirement à la maison paternelle. La courageuse fille en éprouva beaucoup de chagrin ; mais elle était trop soumise à la Supérieure pour présenter quelques objections. Elle se soumit humblement.
Avant de suivre la Sœur Camille à travers les remous du cyclone révolutionnaire, il n’est peut-être pas hors de propos de rapporter la façon dont quelques-unes de ses Sœurs appartenant à la petite communauté de la rue Cassette et arrêtées peu après, tinrent tête aux sectaires. Cette digression présentera un double avantage. On y verra que l’énergie et la grandeur d’âme manifestées par la Sœur Camille ne lui étaient pas spéciales, puisque d’autres religieuses, formées, comme elle, selon l’esprit du Carmel, l’égalèrent en intrépidité. Ensuite, elle fournira un document de plus sur cette horrible époque où le seul fait de rester fidèle à l’Église, en réprouvant le schisme, constituait un délit qui, au regard des possédés de la Révolution, méritait les pires châtiments.
De par la constitution civile du clergé, le gouvernement révolutionnaire avait rompu avec Rome et il avait été décrété que tout prêtre qui refuserait le serment de se conformer à l’organisation nouvelle de l’Église serait mis en état d’arrestation, condamné sans délai, incarcéré ou déporté. Un trop grand nombre se soumit ; mais d’autres obéirent au Pape qui, par deux brefs, en date des 10 mars et 11 avril 1791, avait interdit le serment, déclaré nulles les élections laïques de curés aux paroisses et les élections épiscopales, sacrilèges les ordinations. Tout jureur qui ne se serait pas rétracté dans l’espace de quarante jours, était suspendu et s’il persistait, retranché de l’Église comme schismatique.
Aux religieux non-prêtres et aux religieuses, les sectaires voulurent imposer le serment d’égalité qui impliquait l’adhésion au régime. Sur ce point, les brefs du Pape ne se prononçaient pas. Mais les prêtres réfractaires, restés les directeurs secrets des religieuses, estimaient qu’un tel acte de soumission aux principes promulgués par des athées constituerait une faute grave et ils avaient interdit à leurs ouailles de le commettre. Les Carmélites de la rue Cassette, au nombre de neuf, avaient obéi ; et de là, leur arrestation.
On les conduisit d’abord à la section où on les somma de prêter le serment. Sur leur refus unanime, on délibérait de les envoyer au Tribunal révolutionnaire — autant dire à la guillotine — lorsque quelqu’un fit observer que ces filles étant fanatisées par de « perfides imposteurs », il suffirait peut-être de les tenir dans la prison de la section le temps que se dissipassent les effets de « l’influence superstitieuse » dont elles avaient été les victimes. Ce plan fut adopté et la petite communauté verrouillée à la prison de Port libre[11].
[11] C’était l’ancien couvent de Port-Royal, célèbre à l’époque la plus effervescente du Jansénisme.
Les administrateurs de police venaient, à peu près tous les jours, visiter les prisonnières et leur demandaient, chaque fois, si elles étaient disposées à jurer. Celles qui répondaient négativement étaient chargées d’injures et de menaces. Celles qui gardaient le silence étaient recluses pour vingt-quatre heures, dans une salle où l’on avait enfermé des folles.
Aucune des Carmélites ne faiblit. Elles avaient d’ailleurs pour les soutenir les visites de l’abbé de Lalande qui, toujours déguisé en garçon marchand de vins et muni de son panier à bouteilles, réussit à s’introduire auprès d’elles une ou deux fois par semaine.
L’abbé remit à l’une d’elles, Sœur Victoire, un écrit portant ce titre : Avis aux religieuses où un prêtre inconnu exposait les raisons qu’il y avait, au point de vue spirituel, de refuser le serment. C’était une imprudence car les prisonnières subissaient des fouilles fréquentes qui ne respectaient même pas leur vêtement le plus intime. Au cours de l’une d’elles, le papier fut découvert.
Grand émoi parmi les zélés de la section. Sœur Victoire comparut aussitôt devant les commissaires. Voici son interrogatoire. Je le reproduis tel quel car il montre à la fois l’état d’esprit des inquisiteurs et la trempe d’âme de leurs victimes.
Le Commissaire : « — Connaissez-vous cet écrit ?
Sœur Victoire : — Je le connais.
Le C. : — L’approuvez-vous ?
S. V. : — Oui je l’approuve.
Le C. : — Quelle raison nous donnerez-vous de ne pas faire le serment ?
S. V. : — Il est contraire à mes vœux et ma conscience s’y refuse.
Le C. : — Tu veux donc être esclave ?
S. V. : — Non des hommes mais de Dieu.
Le C. : — Cependant Dieu t’a créée libre ?
S. V. : — Oui, de faire le bien ou le mal. Or ce que vous me demandez est le mal pour moi.
Le C. : — Ce sont tes prêtres qui t’ont monté la tête !
S. V. : — Non, c’est la Convention elle-même qui m’apprend ce que j’ai à faire puisqu’elle déclare que la liberté, comme elle l’entend, est la suppression de tout engagement indissoluble. Comme mes vœux sont indissolubles, je ne puis faire un serment qui les anéantirait.
Le C. : — Alors tu préfères ne pas obéir aux lois ?
S. V. : — Je ne demande pas mieux que d’obéir tant que les lois ne seront pas contraires à ma conscience.
Le C. : — Ta conscience te dit donc que tu es plus élevée que moi qui représente la loi ?
S. V. : — Non, en ce moment, je vous regarde comme au-dessus de moi puisque vous êtes mon juge et qu’à ce titre, vous avez le droit de m’interroger.
Le C. : — Tu crois donc que, devant Dieu, il y a des hommes plus grands que les autres ?
S. V. : — Non, je sais que nous sommes tous égaux devant Dieu et devant la loi. Mais je ne veux pas faire le serment parce que la loi de Dieu, qui passe avant la loi humaine, me défend de jurer en vain.
Le C. : — Ce n’est pas jurer en vain, puisque c’est pour sauver ta vie.
S. V. : — J’aime mieux mourir.
Le C. : — Eh bien on se délivrera de toi et de cent mille comme toi !
S. V. : — Je vous pardonne d’avance ma mort. Vous me rendrez même un véritable service car, depuis que la force m’a fait sortir de mon couvent où j’étais par ma volonté, je mène dans le monde une vie malheureuse.
Le C. : — Alors fais donc le serment puisque tu es libre.
S. V. : — Précisément, parce que je suis libre, je ne le ferai pas.
Le C. : — Soit, puisque tu t’entêtes, tu comparaîtras devant le Tribunal révolutionnaire et tu verras ce qui t’arrivera.
S. V. : — Tout ce qu’il plaira à Dieu… »
Donnons encore quelques passages des interrogatoires subis par les autres Carmélites. Ils sont instructifs et même ne manquent pas d’actualité. En effet si, de nos jours, on n’exige plus le serment d’adhésion à la République des religieuses chassées de leurs monastères, dépouillées de leur bien et obligées, pour vivre en commun, de s’exiler, on leur explique encore volontiers qu’au nom de la liberté, elles ne sont pas libres de se tenir en clôture pour prier Dieu. Moins sanguinaire, plus hypocrite, la Révolution graisse de sophismes le cordeau dont elle les étrangle.
Lorsque comparut la seconde religieuse Sœur Louise-Térèse, le juge voulut entamer une controverse avec elle. Il lui fit d’abord, en style du Contrat social, un long exposé de la liberté telle que l’entendaient les révolutionnaires. Puis il lui demanda si elle ne jurerait pas maintenant obéissance à des principes aussi sublimes.
La Sœur, que ces tautologies pâteuses influençaient fort peu, lui répondit : « Je ne puis jurer de maintenir une liberté aussi… indéfinie que celle-là. »
Le commissaire lui représenta alors que le serment était exigé par la loi et il ajouta : « Tu voudrais donc une République sans lois ? »
Mais la Sœur avait de l’esprit ; elle répondit du tac au tac : « Supposez que je sois chez les Turcs ; est-ce que je ne pourrais pas vivre à Constantinople sans jurer de maintenir le Coran ? »
Le juge, cloué, se mit en colère : « De quoi vivras-tu, s’écria-t-il, si tu tombes à la charge de la nation ? »
Et la Sœur : « Je puis travailler et en tout cas, si ma pauvreté me met à la charge de la nation, à qui s’en prendre ? La maison, à laquelle j’appartenais, n’avait-elle pas des ressources ? N’avais-je pas une dot ? Vous avez tout confisqué. »
Sur ce coup droit, le commissaire chercha une diversion : « Où as-tu lu les brefs du Pape qui condamnent le serment ?
— Lorsque j’étais encore dans mon couvent.
— Mais, au fait, dis-moi un peu, qu’est-ce que c’est que ce Pape ?
— Il n’y a pas si longtemps que vous étiez catholique pour ignorer ce que c’est que le Pape ?
— Tu es l’esclave d’un homme et tu défères, en aveugle, à ses sentiments.
— Je défère aux sentiments du Pape parce que je le regarde comme le chef de l’Église et le vicaire de Jésus-Christ.
— Quelle fanatique !… Eh bien on te chassera du pays. Tu n’aimes donc pas ta patrie ? Tu lui préfères Rome, l’Italie ou l’Espagne ?
— J’ai toujours aimé ma patrie : je ne l’ai jamais quittée. Je ne puis donc désirer vivre dans un autre pays. Si l’on m’y force, à qui sera la faute ? »
Voyant que Sœur Louise-Térèse était d’intelligence trop alerte pour se laisser surprendre, le juge la fit reconduire en prison.
Sœur Rosalie lui succéda. Son interrogatoire fut bref. A la question : « Pourquoi ne veux-tu pas faire le serment ? » elle répondit : « Il est dit dans l’Évangile qu’on juge l’arbre par ses fruits. Comme je constate que les fruits de l’arbre de l’égalité et de la liberté ne tendent qu’à détruire la religion catholique dont je fais hautement profession, je ne veux pas m’attacher, par serment, à cet arbre. »
A Sœur Philippine on voulut faire avouer qu’elle avait été retenue au monastère par contrainte. Comme elle se récriait, le juge lui demanda : « Pourquoi donc y es-tu venue ? »
Elle répondit : « Parce que j’aime le Carmel et que je ne conçois point de loi qui interdise de se réunir plusieurs ensemble pour prier. »
Sœur Angélique fut particulièrement sollicitée de dénoncer le prêtre qui lui avait remis l’avis aux Religieuses et les ecclésiastiques qui venaient rue Cassette. Pendant plus de trois heures, elle fut retournée sur le gril de questions toujours pareilles ; elle ne livra aucun nom. D’ailleurs, il en alla de même pour toute la communauté. Unanimes à refuser le serment, les Carmélites ne le furent pas moins à garder le silence sur leurs directeurs.
N’espérant plus rien obtenir de ces « entêtées », les commissaires de la section prononcèrent un arrêt de renvoi devant le Tribunal révolutionnaire. Les Religieuses, le soir même, furent transférées à la Conciergerie.
L’acte d’accusation fut rédigé, dans le style boursouflé de l’époque, par le pourvoyeur habituel de la guillotine : Fouquier-Tinville. Les Carmélites y sont prévenues « de rassemblement et de machination tendant à troubler l’État et à provoquer la guerre civile par le fanatisme… Au lieu de vivre paisiblement sous la protection (?!) de la République, elles ont fait de leur maison un repaire de prêtres fourbes et fanatiques avec lesquels elles complotaient contre les principes immortels de liberté et d’égalité ».
Il y avait là de quoi les vouer à la boucherie.
Elles comparurent devant le Tribunal le lendemain. L’interrogatoire fut une reproduction des précédents. Toutes persistèrent dans leur refus de nommer les prêtres qui les avaient assistées et de prêter le serment. Un incident égaya d’une façon assez inattendue la séance. Le président Dumas cherchait à persuader à l’une d’elles, Sœur Chrétienne, converse, qu’elle avait fait des aveux, par mégarde, pendant l’instruction. L’accusée « qui, depuis vingt-cinq ans n’avait parlé à d’autre homme qu’à son confesseur », s’écria : « Non, mon Père, ce n’est pas vrai : je n’ai rien dit !… »
Un rire général, auquel les religieuses et les juges eux-mêmes ne purent s’empêcher de se joindre, éclata.
Après le plaidoyer fort insignifiant de défenseurs officieux et le réquisitoire ampoulé de Fouquier, trois questions furent posées aux jurés. Il est instructif de les reproduire :
1o Est-il constant qu’il a été formé un rassemblement de huit femmes auxquelles des prêtres criminels ont inspiré, par des écrits, des discours et des pratiques superstitieuses, un fanatisme qui égara leurs victimes ?
2o Les ci-devant religieuses sont-elles convaincues d’avoir fait partie de ce rassemblement fanatique et d’avoir refusé le serment ?
3o L’ont-elles fait dans le dessein de troubler l’État par une guerre civile en armant les citoyens les uns contre les autres et contre l’autorité légitime ?
La réponse affirmative sur les trois points emportait la peine de mort. Mais le jury, peut-être impressionné par l’attitude des religieuses, peut-être travaillé par quelque scrupule de conscience, répondit : Oui aux deux premières questions et non à la troisième qui était la plus dangereuse.
Sur quoi, Fouquier-Tinville se leva et requit l’application de la loi. « Pour préambule, il qualifia les religieuses de vierges folles, puis il ajouta que puisqu’il était jugé qu’elles vivaient loin des affaires publiques, elles n’auraient subi que la peine de la réclusion, comme suspectes, mais que, n’ayant pas voulu dire la demeure et les noms des prêtres réfractaires qui venaient chez elles, c’était comme si elles les avaient cachés dans leur maison (sic). En conséquence, elles étaient condamnées à la déportation et leurs biens confisqués au profit de la nation. »
Le tribunal prononça donc la peine de la déportation. Et l’auditoire, convaincu qu’en exilant des Carmélites fidèles à l’Église, on sauvait d’un grand danger le régime, cria : Vive la République !
En attendant qu’on les transportât à Cayenne, les Carmélites furent incarcérées à la Salpêtrière, maison de détention réservée d’habitude aux prostituées clandestines et aux voleuses. Le 9 Thermidor, qui mit fin à la Terreur, ne leur donna cependant pas la liberté. On les transféra d’abord à Bicêtre, parmi les folles, puis à la prison des Anglaises, rue des Fossés-Saint-Victor. Enfin en 1796 sur les démarches pressantes d’un ami inconnu, elles furent exilées en Belgique et trouvèrent un refuge au Carmel de Termonde.
Sœur Camille, retirée chez ses parents, y observa autant que possible, la vie claustrale. « Elle pouvait librement vaquer à ses exercices et jouir d’une profonde retraite. On la servait en maigre aux mêmes heures qu’à son couvent et Mme de Soyecourt préférait souvent se priver de la présence de sa fille plutôt que de troubler sa solitude. »
Malgré ce respect de sa vocation, la Carmélite souffrait d’être séparée de ses Sœurs et se sentait d’autant plus isolée que, par prudence, elle n’osait que rarement rendre visite à la Prieure et aux petits groupes dispersés çà et là. Pour reprendre la clôture, elle forma, un moment, le projet d’aller jusqu’à Rome à pied et en demandant l’aumône : « Je me serais présentée, disait-elle, comme une pauvre inconnue aux Carmélites de cette ville et je leur aurais demandé l’entrée de leur solitude. Elles auraient certainement eu pitié de moi ; chez elles j’aurais retrouvé le milieu sans lequel il me semblait que je ne pourrais plus vivre. »
Elle avait déjà fait ses préparatifs et le jour du départ était fixé. Mais sa mère qui, de toute sa tendresse, s’opposait à ce dessein, lui montra une lettre d’un cardinal qui, consulté, condamnait absolument un exode aussi périlleux.
Camille se résigna. Elle espérait, du moins, pouvoir continuer à vivre en religieuse dans l’hôtel familial quand, le 12 février 1794, son père et sa mère furent arrêtés par ordre du Comité de sûreté générale sous l’inculpation de complot contre la République et de menées liberticides. M. de Soyecourt fut enfermé aux Carmes encore ensanglantés des massacres de septembre et sa femme à la prison de Sainte-Pélagie où vinrent bientôt la rejoindre deux de ses filles : Mmes d’Hinnisdal et de la Tour. Les frères et beaux-frères de Camille avaient émigré, de sorte que la religieuse se trouva toute seule.
Elle s’attendait à suivre sans grand délai ses parents en prison. Mais probablement la police estima qu’en lui laissant la liberté et en surveillant toutes ses démarches, on arriverait, par elle, à découvrir la retraite de quelqu’un des prêtres réfractaires qui se cachaient un peu partout dans Paris. Ce calcul fut trompé : la Sœur, soupçonnant qu’on lui réservait le rôle d’indicatrice involontaire, se garda bien d’aller voir ses directeurs dont elle n’ignorait pourtant pas la retraite. Pour plus de sûreté, elle décida de quitter l’hôtel de Soyecourt et de se dérober, si possible, à l’espionnage des agents du Comité.
« L’arrestation de sa famille, écrit la biographe, la prévision de ce qui allait suivre lui étaient une manifestation de la voie qui s’ouvrait devant elle. Il était évident que Dieu voulait lui demander plus qu’il n’a coutume de faire même à ses épouses. L’héroïsme lui était offert, mais l’héroïsme dépouillé de gloire, l’héroïsme à petite journée, c’est-à-dire non tel ou tel acte passager dont la promptitude rend l’exécution facile, mais l’héroïsme qui lutte pied à pied contre les écueils du chemin, qui soutient, avec énergie, des combats quotidiens et renouvelés sous les formes les plus pénibles… » Il lui fallut accepter la lutte dans la solitude du cœur et de l’âme, vivre de Dieu seul, « sans secours spirituels, parmi des inquiétudes constamment renouvelées, et dans le dénuement. Cet héroïsme, elle l’accepta ».
Les épreuves se multiplièrent. Le 25 mars, Mme de Soyecourt mourut en prison d’une fièvre infectieuse. Peu après M. de Soyecourt et Mme d’Hinnisdal comparurent devant le Tribunal révolutionnaire, furent condamnés à mort presque sans débats et guillotinés le jour même. Mme de la Tour, remise en liberté, alla se cacher en province. Des autres parents de Camille, aucune nouvelle.
La Sœur, accompagnée d’une Carmélite de Pontoise qu’elle avait recueillie sur le pavé, quitta donc la maison paternelle. Afin de déjouer les recherches dont elle était l’objet, pendant plusieurs semaines, elle se transporta de taudis en taudis, dénuée de linge et de vêtements de rechange. Quant aux ressources pécuniaires, au moment de sa fuite, elle possédait six francs.
Décrivant cette période de son existence, elle a dit plus tard : « Que de fois j’ai passé la journée sans nourriture ! Le jeûne du Carmel si rigoureux n’approche pas de celui qui m’était imposé à cette époque. Quand j’avais pu, grâce à un peu de travail ou à la charité d’autrui, obtenir quelques aliments, mon inhabileté à les apprêter les rendait presque inutiles. Ma compagne n’était guère plus adroite que moi. Si bien que, habituellement, nous n’obtenions que d’étranges ragoûts. » Par exemple, il leur arrivait d’acheter un hareng saur. Ne sachant de quelle façon l’accommoder, elles le faisaient cuire dans de l’eau chaude et trempaient un peu de pain dans le bouillon.
« Mon estomac, dit-elle, avait bien de la peine à garder ce potage. Mais ce n’est pas tout ; une fois nous avions réservé le poisson pour notre repas du lendemain, quand un malencontreux chat, peu soucieux de nos mésaventures, y ajouta celle de dévorer, la nuit même, notre réserve. »
C’était un désastre, car dans son ignorance de la vie pratique, elle avait espéré ne dépenser qu’un sou par jour pour sa subsistance.
Une autre fois, entendant le cri d’un marchand de lait dans la rue, elle descendit aussitôt de sa mansarde, avec une petite tasse, pour s’en procurer. Comme elle passait les bras à travers les barreaux de la charrette, le laitier remarquant la blancheur et la finesse de ses mains soupçonna une aristocrate.
« Hé là, sacré petite ci-devant, s’écria-t-il, avec un gros rire, on a donc oublié de te couper le cou ? »
Et en même temps, le malotru fit mine de lui prendre la taille.
Camille épouvantée s’enfuit avec sa tasse vide. « Ce jour-là, elle ne mangea rien. »
Certain jour où des travaux de couture lui avaient rapporté une pincée d’assignats, elle voulut faire des provisions. Ayant acquis des œufs, quelques légumes et un quarteron de beurre, elle en avait rempli un petit panier qu’elle emportait chez elle, lorsque chemin faisant, l’idée lui vint de rendre visite à quelques-unes de ses Sœurs réunies rue du Regard. Les religieuses ignoraient sa détresse. Souffrant, elles-mêmes de la faim, d’une façon à peu près continuelle, elles crurent que Camille leur apportait du secours. Elles l’embrassent et lui expriment, les larmes aux yeux, leur reconnaissance. « Devant cette explosion de gratitude, la visiteuse se garde bien de les détromper. Elle leur abandonne le panier dont le contenu devait la faire vivre plus d’une semaine. Elle se retire, s’égayant à part soi de la plaisante aventure et on ne peut plus heureuse d’avoir pu leur dissimuler cet acte de charité. »
Quand elle souffrait par trop de la famine, elle se glissait dans le jardin de l’hôtel de Soyecourt où un domestique avait été laissé comme gardien des scellés apposés par la police. Cet homme élevait quelques poules. La Sœur s’informait si elles avaient pondu. Dans l’affirmative, elle demandait un œuf, le gobait cru sur place — et cela faisait le repas d’une journée.
Quelquefois, elle reçut l’aumône. C’est ainsi qu’un matin où sa fortune se montait à trois sous, elle les offrit à une vieille marchande de pommes contre une demi-douzaine de ces fruits. La bonne femme considère sa maigreur et ses traits tirés, et aussitôt elle lui met dans les mains une livre de ses plus belles pommes en lui disant d’une voix amicale : « Tenez, ma mignonne, fourrez tout cela dans vos poches et gardez vos trois sous. »
Elle n’était pas au bout de ses peines, car le 16 avril 1794, la Convention vota un décret interdisant aux « ci-devant nobles » d’habiter Paris. Camille dut obéir. Ne voulant pas trop s’éloigner de ses compagnes, elle se réfugia aux Moulineaux, dans une ferme qui appartenait à ses parents. Un régisseur malhonnête s’y était habitué à considérer le domaine comme son bien propre et s’en attribuait le revenu au détriment des propriétaires légitimes. Il reçut assez mal la fugitive mais il n’osa point lui refuser abri et nourriture. Quoique avec mauvaise grâce, il souffrit que la Sœur s’occupât de la vente des denrées et en tirât quelques ressources ; mais en compensation, il exigea qu’elle fît la besogne d’une fille de ferme.
Étant sous la surveillance de la police, elle devait se présenter, chaque jour, à la municipalité. Lorsqu’elle voulait se rendre, pour quelques heures à Paris, il lui fallait solliciter une permission spéciale qui ne lui était accordée qu’après cent formalités malveillantes.
Elle n’en continuait pas moins à suivre sa règle aussi exactement que possible ; c’était sa seule joie et elle ne craignait qu’une chose, c’était de manquer de ferveur. On jugera combien sa fidélité fut méritoire par ce passage d’une de ses lettres : « Le soir, lorsqu’après une journée de labeur tel que je n’en avais jamais connu, il me fallait réciter Matines après neuf heures, le violent effort que je devais faire pour vaincre ma lassitude me donnait une fièvre qui m’empêchait de dormir toute la nuit. »
Dans le même temps, Dieu lui envoya un directeur : M. Jalabert, ancien archidiacre de Notre-Dame, qui avait trouvé une cachette dans une maison de l’île Saint-Louis. Ce fut un grand réconfort pour Camille que de se rendre, tous les huit jours environ, auprès de lui. Elle se confessait ; recueillait précieusement les consolations du bon prêtre et, parfois aussi, assistait à une messe clandestine où elle recevait la sainte communion.
Pour traverser les rues de Paris sans être remarquée, elle s’affublait du costume que presque toutes les femmes du peuple revêtaient à cette époque : une jupe blanche rayée de rose ou de bleu, un grand fichu noué dans le dos, un bonnet de mousseline piqué d’une cocarde tricolore et des sabots. Cette tenue ne lui plaisait guère. Aussi pour la subir le moins longtemps possible, elle partait des Moulineaux, vêtue de la robe de bure brune qu’elle portait à la ferme et avec son « déguisement » — comme elle dit — dans une serviette, sous son bras. Arrivée dans la plaine de Grenelle, elle s’arrêtait derrière un buisson, changeait de vêtements et entrait en ville, pareille à tout le monde. Au retour, elle se rhabillait en paysanne à la même place.
Ce qu’il faut retenir de cette existence au jour le jour, c’est la sérénité parfaite avec laquelle Sœur Camille en supporta les souffrances et les angoisses. Elle avait à endurer un maximum de tribulations : le chagrin que lui avait causé la mort tragique de ses parents lui déchirait l’âme ; elle vivait dans la misère, parmi les outrages, les soupçons et les sévices ; d’un moment à l’autre, elle pouvait être arrêtée, jetée en prison, guillotinée ; enfin les émotions terribles ressenties depuis le commencement de la Révolution lui avaient infligé une maladie de cœur si grave que, quelques années après, les médecins disaient qu’elle en mourrait de bonne heure.
Or, malgré le présent si sombre et l’avenir si incertain, elle demeurait tellement unie à la croix du bon Maître, elle gardait, selon sa vocation, une conscience si nette de sa fonction de victime expiatoire pour les péchés et les folies sacrilèges de ses contemporains, qu’une paix radieuse émanait d’elle. Ah ! c’est que le soleil intérieur ne cessait de rayonner à travers les nuées qu’accumulait l’orage révolutionnaire. Quelque chose de cette illumination surnaturelle apparaissait dans son regard limpide. Tous ceux qui l’approchaient en étaient impressionnés. L’influence était si formelle que le maire des Moulineaux, sans-culotte effervescent, s’ébahissait de la subir : « Cette petite nonnain défroquée, disait-il, quand elle me regarde avec son air tranquille, elle me ferait faire tout ce qu’elle veut… »
O sang lumineux de Jésus, comme tu empourpres l’âme qui se voue à revivre ta Passion ! Même ceux qui t’outragent ou te nient reçoivent tes effluves et les splendeurs de ta Charité intarissable…
La vie errante de Sœur Camille n’était pas encore terminée. La ferme des Moulineaux fut mise en vente et la pauvre vagabonde involontaire dut chercher un autre asile. L’employé de la mairie, chargé de la surveillance des ci-devant nobles, la prit en pitié et la logea dans une maison abandonnée du village d’Issy. C’était une masure en ruines mais Camille se jugeait trop heureuse d’avoir un toit pour s’abriter car toutes ressources lui faisant alors défaut, elle ne possédait pas de quoi payer la location même d’une mansarde.
Dans ce dénuement, une aubaine lui vint. Une ancienne Sœur converse de la rue de Grenelle, Catherine de la Résurrection apprit sa détresse et vint vivre avec elle. La bonne fille possédait deux cents francs qu’elle avait gagnés en se plaçant comme servante depuis l’époque de la dispersion. Cette somme minime suffit à faire subsister les deux religieuses pendant plus de trois mois.
Dans l’humble réduit où elles vivotaient de la sorte, elles réussirent à disposer une chapelle et des prêtres réfractaires, cachés dans les carrières et les bois des environs, y vinrent dire de temps en temps la messe en grand secret. Les Carmélites reçurent d’une façon assez suivie la Sainte Eucharistie dont elles étaient privées depuis si longtemps. Et, comme on le pense bien, ce divin fortifiant leur fit oublier toutes les privations.
Sur ces entrefaites, arriva la réaction de Thermidor : Robespierre et sa bande furent mis hors la loi par l’initiative de quelques-uns de leurs complices qui, rompant avec la lâcheté propre aux énergumènes de la Convention, guillotinèrent l’affreux Petdeloup pour éviter qu’il les guillotinât. Le régime de la Terreur s’effondra dans la boue et dans les flaques de sang. Les prisons s’ouvrirent et les proscrits respirèrent.
Comme l’a très bien dit M. Pierre de la Gorce, dans sa belle Histoire religieuse de la Révolution (T. III in fine) : « On tuera encore. Il y aura encore dans l’ordre politique bien des violences, dans l’ordre religieux bien des persécutions. Cependant, pour qui ne s’applique pas aux détails mais voit les événements par masses, on a touché le fond de l’abîme. Maintenant c’est la remontée qui commence. Elle commence par la société civile. Encore quelques mois, et bien qu’avec de tenaces pratiques d’intolérance, bien qu’avec le maintien de lois iniques, elle commencera aussi pour la société religieuse… »
Il était temps pour Sœur Camille que la Terreur prît fin. En effet elle venait d’être prévenue que son dossier avait été remis à Fouquier-Tinville. On la cherchait pour la traduire, la semaine suivante, au Tribunal révolutionnaire où sa condamnation était certaine. Car, suivant l’expression de sa biographe, « la demi-liberté dont elle avait joui ressemblait assez à celle que la bête fauve laisse à sa proie, lorsqu’après l’avoir mise dans l’impuissance de s’échapper, elle la réserve pour l’heure de son caprice ».
Le 15 octobre 1794, Sœur Camille obtint la permission de rentrer à Paris. Elle se logea dans un petit appartement de la rue des Postes, voisin de la maison où, sous l’ancien régime, il y avait un séminaire. La chapelle n’en avait pas été profanée mais seulement dépouillée de ses ornements. La Carmélite eut l’idée d’y rétablir le culte. A cet effet, elle s’abouche avec l’abbé Baudot, ancien supérieur du séminaire, qui entre avec joie dans son projet. Quelques âmes dévouées se joignent à eux. La chapelle est nettoyée, parée tant bien que mal, et, un jour de la fin de janvier 1795, on y dit, pour la première fois, la messe. Il y eut ensuite un salut du Saint-Sacrement.
« L’abbé Baudot y bénit, avec émotion, une foule de chrétiens prosternés dans un recueillement qu’interrompaient seuls les larmes et les sanglots… L’allégresse de Sœur Camille fut si grande et si vif le souvenir qui lui en resta qu’elle ne pouvait en parler qu’avec attendrissement : — Si le sentiment que j’éprouvais alors, disait-elle, avait duré quelques instants de plus, je ne sais si j’aurais pu y résister. Heureuse mille fois si la joie de revoir mon Dieu glorifié m’eût fait mourir alors ! »
Les épreuves supportées avec une si héroïque constance, depuis quelques années, par la Sœur Camille avaient développé les qualités d’énergie et d’initiative que Dieu avait mises en elle. Sa première pensée fut de reconstituer, au moins partiellement, la communauté. Quelques ressources lui étant venues, elle obtint de sa prieure, la Mère Nathalie, l’autorisation d’entamer des démarches à cet effet. Trouver un local était le plus urgent. Elle s’y employa sans délai et ne tarda pas à découvrir, rue Saint-Jacques, une maison assez spacieuse qui avait longtemps servi d’auberge, sous l’enseigne de la Vache noire. Elle en fit l’achat, à des conditions peu onéreuses, et s’y installa, tout de suite avec neuf de ses compagnes échappées à la guillotine ou à l’exil. La Mère Nathalie ne tarda pas à les rejoindre en compagnie de six autres religieuses. Dès mars 1795, on put reprendre les exercices réguliers et organiser l’existence conventuelle.
« Tandis que le rez-de-chaussée fournissait quelques pièces destinées au service extérieur et aux travaux en commun, les étages supérieurs formaient une salle de communauté, un réfectoire et des cellules improvisées. Il ne manquait que la clôture qu’on n’osa rétablir car le gouvernement révolutionnaire demeurait ombrageux et eût considéré un local fermé à ses investigations comme un foyer de complots contre la République.
« Au centre de la maison, les Carmélites érigèrent une chapelle où bientôt, de toutes parts, des prêtres réfractaires vinrent célébrer les offices. Ils étaient si nombreux que les messes se succédaient, sans arrêt, de cinq heures du matin à midi. L’abbé de Dampierre, ancien grand-vicaire de l’archevêque de Paris se montra l’un des plus assidus. Les fidèles accoururent en foule de tout le voisinage. Leur empressement s’explique par le fait que la paroisse, Saint-Jacques du Haut-Pas, était occupée par le clergé constitutionnel et que les « vrais catholiques », obéissant aux instructions du Pape, fuyaient « les intrus ».
Voyant cette affluence, M. de Dampierre fit placer des fonts baptismaux. On donna le baptême ; on célébra des mariages. Et ainsi, la petite chapelle devint un centre où, chaque dimanche, on chantait la grand’messe et les vêpres, on prononçait des sermons.
En 1796, un décret autorisa les nobles non émigrés à rentrer dans leurs biens mis sous séquestre depuis plus de trois ans. Ceux de la famille de Soyecourt étaient considérables ; outre l’argent liquide, il y avait des maisons à Paris et des terres en Picardie. Sœur Camille s’en trouva propriétaire en partage avec sa sœur Mme de la Tour et son neveu, le jeune comte d’Hinnisdal. Elle se réjouissait de ce retour de fortune qui allait lui permettre non seulement de placer sa communauté à l’abri du besoin mais aussi de secourir d’autres maisons de l’Ordre quand un scrupule lui vint : son vœu de pauvreté ne constituait-il pas un obstacle à une prise de possession de l’héritage paternel ? Elle se rappelait qu’au temps où l’Assemblée nationale supprima les vœux, Pie VI avait déclaré qu’aucune puissance civile ne pouvait délier les consciences. Pour rien au monde Sœur Camille n’aurait passé outre à cette décision. Elle consulta ses directeurs. Ceux-ci lui suggérèrent d’adresser une demande au Pape à l’effet d’obtenir la permission d’accepter sa part dans la succession de ses parents.
« L’humble Carmélite hésita, dit la biographe. Il lui semblait voir crouler le rempart qu’elle avait voulu placer entre elle et le monde. « Hélas, s’écriait-elle, est-ce qu’il me faudra ne plus être pauvre ? » Mais l’assurance lui fut donnée que rien, en fait, ne serait changé à son dénuement. »
Alors elle se résigna à rédiger une supplique où elle exposait au Pape les motifs de sa démarche et la tristesse que son cœur en éprouvait.
Pie VI répondit immédiatement par un Bref qui permettait à Sœur Camille « d’acquérir, nonobstant son vœu de pauvreté, des biens meubles et immeubles et d’en disposer tant pour son propre intérêt que pour le soulagement des religieux de l’un et de l’autre sexe et d’autres personnes ecclésiastiques qui se trouveraient dans le besoin, déclarant d’ailleurs que la permission accordée ne préjudiciait aucunement à la substance du vœu solennel de pauvreté. »
Ainsi rassurée et autorisée, Sœur Camille se lança dans les courses, sollicitations et paperasses nécessaires pour recouvrer son dû. Comme à cette époque, la bureaucratie sévissait déjà d’une façon intense, multipliait les formalités, et fondait la tradition de traiter le public comme un ennemi personnel, la Carmélite connut tous les tracas des infortunés que des intérêts vitaux obligent d’affronter les minuties et les rebuffades de la gent administrative.
Aussi calme qu’active, elle ne se laissait pas déconcerter. On nous la montre « pâle, mince, douce, jamais impatiente ni fiévreuse malgré les difficultés de la tâche entreprise ».
« Vêtue d’une robe de laine noire, dit M. Lenotre, coiffée d’un bonnet blanc, elle courait les bureaux, les notaires, les hommes de loi. Elle obtenait, peu à peu, la restitution presque intégrale des biens immenses de sa famille. Et c’était pour les clercs et les ronds-de-cuir une stupeur d’entendre cette pauvresse, avec son petit cabas sous le bras, parler de millions, de ventes de terres, d’achats d’immeubles en un temps où les plus riches manquaient du nécessaire. »
La bataille contre les potentats du papier timbré et les hauts gardiens des grimoires légaux dura environ un an. A force de persévérance, Sœur Camille obtint la victoire.
Dès qu’elle fut en possession de sa fortune, sans prendre une minute de repos, elle se mit en devoir d’acquérir le couvent des Carmes, où, l’on s’en souvient, son père avait été détenu jusqu’au moment de comparaître devant le Tribunal révolutionnaire qui s’empressa de l’envoyer à l’échafaud.
Tout, aux Carmes, se trouvait en piteux état. Le cloître était loué à un marchand de bois qui en avait fait un dépôt de planches. Dans le jardin, un entrepreneur de plaisirs publics avait installé une tente et un orchestre sous cette enseigne : le bal des Marronniers ; on y dansait chaque décadi. « De l’ancien monastère, les pierres seules subsistaient ; on balayait la neige dans l’intérieur comme dans la rue et, sauf le mur où se voyaient encore les traces des balles et les éclaboussures de sang des massacres de septembre, toute clôture avait disparu. »
Le propriétaire actuel était un nommé Foreson qui, ne sachant que faire de ces vastes bâtiments, projetait de les démolir et de vendre les matériaux. Sœur Camille eut de longues négociations à mener avec cet homme qui lui demandait un prix excessif de la ruine. Enfin le marché fut conclu ; la Sœur et ses compagnes prirent possession le 29 août 1797. Aussitôt, l’on s’occupa de tout réparer et d’approprier le local aux obligations de la vie monastique. Par une pensée touchante la Sœur choisit, pour sa cellule, la petite chambre où son père avait vécu cinq mois avant de monter à l’échafaud.
L’installation eut lieu sans trop d’obstacle. Toutefois, un peu plus tard, maints révolutionnaires, qui voyaient d’un mauvais œil cette renaissance « d’un foyer de superstition », entreprirent de chasser les Carmélites. Des articles de journaux hostiles et des pamphlets parurent qui déversaient sur les religieuses l’outrage et la calomnie. Entre autres diatribes, on y lisait qu’une aristocrate impudente, la citoyenne Soyecourt prétendait élever en ce lieu un monument à la mémoire du « dernier tyran ». On disait aussi qu’elle formait un ramassis de « bigotes et de pontifes sanguinaires » pour préparer des attentats contre le régime des Droits de l’Homme.
Parfois aussi, la populace du quartier se rassemblait autour de la maison et témoignait l’intention de la mettre à sac. Peu à peu, à force de douceur et de charité l’on réussit à dissiper les préventions.
Il y eut pourtant encore une alarme. Un matin, un détachement d’artilleurs envahit la rue de Vaugirard et braque une pièce de canon contre la porte du monastère. La Sœur Camille, informée de ce qui se passe, rassure la communauté. « Je vais, dit-elle, me placer moi-même à la porte et si l’on tire, je recevrai le boulet. »
Et en effet, elle va s’asseoir sur une marche du perron, face aux artilleurs. Elle ne leur dit rien, se contentant de les regarder avec beaucoup de calme. Déconcertés par tant de sang-froid, admirant, malgré eux, le courage de cette frêle petite femme, les sectaires battent en retraite.
En 1798, la Prieure, Mère Nathalie mourut. Camille la remplaça par le suffrage unanime de ses Sœurs. Vinrent enfin le 18 brumaire, la dictature de Bonaparte, le Consulat et l’Empire.
La petite communauté vécut des jours moins troublés. Mais la Mère Camille devait personnellement subir encore la persécution. Il n’entre pas dans le cadre de cette étude de rapporter, tout au long, ses démêlés avec la police impériale. Voici les faits brièvement résumés d’après M. Lenotre.
En juillet 1811, la police apprit, par une lettre ouverte au cabinet noir et adressée à Mgr de Grégori, l’un des cardinaux tenus en surveillance sur l’ordre de l’empereur qu’une certaine dame Camilla, habitant le couvent des Carmes, s’occupait activement de faire copier et distribuer la bulle d’excommunication contre Napoléon fulminée par Pie VII après son arrestation à Rome et promulguée en secret pendant sa détention à Savone. Le préfet de Police, baron Pasquier, fit une enquête et apprit sans difficulté que cette dame Camilla était certainement la Mère Camille de Soyecourt. Deux agents vinrent arrêter la Carmélite et la menèrent à la préfecture de police où elle fut mise au secret. On lui fit subir de longs et minutieux interrogatoires desquels il ressortit qu’elle avait, en effet, pris une certaine part à la diffusion de la Bulle[12].
[12] On trouvera le détail de ces interrogatoires et leur texte officiel dans un appendice à la Vie de la Mère Camille. On y admirera la fermeté que montra la Carmélite et comment elle sut ménager ses réponses de façon à ne compromettre personne. (Pièces justificatives, p. 56 et suivantes.)
L’instruction terminée, comme l’empereur avait interdit de donner de la publicité à cette affaire, Camille, « par raison d’État », fut envoyée en exil à Guise. « Elle y logea chez les Sœurs de l’hôpital et, tout aussitôt les visites et les témoignages de vénération se multiplièrent, ce qui mettait en grand souci le préfet du département. L’Empire s’inquiétait de cette femme aussi intrépide que douce ; la police surveillait le couvent des Carmes où l’on assurait qu’elle venait quelquefois de Guise sous un travestissement. »
Le fait était exact. La Mère Camille n’abandonnait pas sa chère communauté. A diverses reprises, elle fit le trajet à pied, affublée d’une jupe d’indienne à carreaux bleus, d’un corsage bis et d’un bonnet noir. En outre, chemin faisant, elle contrefaisait la boiteuse. Grâce à ce subterfuge, elle passait, sans être reconnue, à travers les mailles du réseau policier et parvenait à résider quelques jours auprès de ses filles.
La Restauration mit fin à son exil. La Mère Camille, de retour à Paris, pouvait espérer la tranquillité. Mais après avoir supporté tant de traverses et de déménagements, il lui restait à subir un dernier exode. L’administration réclama le couvent des Carmes pour y établir une école ecclésiastique. La Mère, non sans chagrin, fit un sacrifice sur les instances de l’archevêque et transporta sa communauté dans une maison de la rue de Vaugirard qui avait appartenu aux Bernardines avant la Révolution. C’est là que se termina son existence.
Tant que la Mère Camille posséda quelques forces, elle les employa au service de sa communauté. Suivant la règle, elle avait déposé sa charge de Prieure en 1814. La religieuse qui lui succéda, ayant contracté de graves infirmités pendant la Révolution, ne put aller jusqu’au bout de son triennat et donna sa démission. La Mère Camille fut réélue à sa place et assuma le gouvernement jusqu’en 1845. A cette époque, il lui fallut déposer le pouvoir. Depuis longtemps, sa santé périclitait. Percluse de rhumatismes, affligée de crampes d’estomac opiniâtres, elle souffrait, en outre, d’une maladie de cœur. Lorsqu’elle en fut atteinte, sous la Révolution, les médecins avaient déclaré qu’elle n’y résisterait pas plus de deux ou trois ans. Vanité des diagnostics humains : malgré cette condamnation, elle n’en atteignit pas moins une vieillesse très avancée.
Pendant les dernières années, une paralysie des jambes l’immobilisa sur son fauteuil de paille. Elle y passait la journée, pleine de sérénité, s’intéressant à tous les détails de la vie conventuelle, donnant des conseils, encourageant les novices, distribuant à toutes les Sœurs les fruits de sa longue expérience.
On a conservé plusieurs de ses propos. Citons-en quelques-uns qui achèvent de peindre cette âme exceptionnelle.
« On avait été étonné, dans son enfance, de son immobilité à l’église, malgré son extrême vivacité. « Je ne répondais rien, disait la Mère dans sa vieillesse, quand on faisait cette réflexion devant moi mais je me disais : — Comment remuer quand le bon Dieu me regarde ?… — Vous regarde-t-il toujours de même ? lui demanda une Sœur. — Oh ! ma fille, lui répondit la vénérable Prieure, c’était alors le lait de l’enfance. La foi nous donne bien mieux encore son divin regard. Maintenant, il m’arrive de ne lui dire que ces mots : Mon Dieu, je crois… Mais parce que je crois, j’adore profondément… et il sait bien tout ce que je veux lui dire par là !… »
Elle aimait tant le travail que, malgré les infirmités, elle ne consentit jamais à rester oisive. Jusqu’au dernier jour, elle défila de la laine pour faire des oreillers aux pauvres. « Il faut travailler toujours, disait-elle, c’est une habitude à prendre, cela garde de mille imperfections et cela maintient l’esprit de pauvreté… D’ailleurs, voyez si la pauvreté abrège la vie. Malgré toutes les fois que j’ai eu faim et où tout me manquait, me voici arrivée à quatre-vingts ans… Donc pauvreté en tout, pauvreté partout, pour soi-même, gêne pour soi, mais largeur pour autrui et magnificence pour Dieu. »
Malgré les instances de ses filles, elle ne voulait rien ajouter ou modifier à l’alimentation plus que frugale du Carmel. « L’ordinaire, disait-elle, rien que le petit ordinaire de la règle. J’aime tant nos purées à l’eau et ce mets me va si bien qu’un bouillon me serait moins salutaire. » Et elle employait d’innocentes ruses pour observer les grands jeûnes, de sorte que la Sœur cuisinière s’écriait : « Notre Mère mange comme un petit oiseau. »
Tout à fait à la fin, on réussit pourtant à lui faire accepter parfois une grappe de raisin ou quelques gorgées de lait. Mais il ne fallait pas les lui offrir trop souvent, car alors, elle refusait d’un ton si net qu’il n’y avait pas à y revenir.
C’est qu’elle avait cet amour profond de la règle qui fait les communautés ferventes. La règle avant tout, disait-elle, la règle partout, sans adoucissement et sans trêve… J’aimerais mieux voir la communauté détruite que la règle s’y affaiblir. »
Cette austérité ne l’empêchait pas de se montrer enjouée aux heures de détente. A la récréation, sur la demande des plus jeunes parmi ses filles, elle improvisait de petites chansons qu’elle fredonnait d’une voix chevrotante, semblable au tintement d’une sonnette d’autel assourdie. Ce couplet, par exemple :
Ou encore :
Évidemment ce n’est point là de la grande poésie. Mais comme on trouve, dans ces innocentes amusettes, l’indice d’une âme en paix avec elle-même et à qui, en récompense de son amour, Dieu confère la simplicité joyeuse de l’enfance !
Son union à Dieu était si intime qu’elle disait un jour : « Jésus est toujours avec moi. Nous habitons, l’un et l’autre, dans la même maison. Il se donne souvent à moi et, moi aussi, je me suis donnée tout entière à lui. Je ne lui demande pas quelle récompense il me donnera ; je suis payée d’avance. Je goûterai dans le ciel plus de douceur et de consolation sans doute. Mais, au fond, je n’aurai rien de plus puisque, dès cette vie, Il se donne à moi. »
En 1848, elle s’affaiblit beaucoup et ne put guère quitter le lit. Pendant l’hiver de 1849, il devint visible que la fin approchait. A partir d’avril, les symptômes de la maladie de cœur s’aggravèrent. Suffoquant d’une façon presque continuelle, ne dormant plus, elle passait les nuits à réciter des psaumes. Elle avait fait placer en face d’elle deux images représentant la Sainte Vierge et sainte Térèse :
« Voyez, disait-elle, comme la Sainte Vierge me regarde. Elle semble me dire : — Demande-moi ce que tu voudras, je te l’obtiendrai de mon Fils… Ce sera elle et sainte Térèse qui remettront mon âme entre les mains de Dieu. »
« La dernière nuit fut agitée mais aussi fervente que les autres. Elle chanta d’une voix forte encore le psaume : Cantate Domino canticum novum. Puis elle s’écria : — Sainte Vierge, intercédez pour moi !… »
Ce furent à peu près ses paroles suprêmes. Dans la journée qui suivit, elle perdit connaissance. L’aumônier lui conféra l’extrême-onction et l’absolution sans qu’elle donnât signe qu’elle prenait part à la cérémonie. A cinq heures du soir, elle rendit le dernier soupir, tandis que la Communauté fondait en larmes autour de son lit.
C’était le 9 mai 1849. La Mère Camille avait quatre-vingt-douze ans. Selon son désir, elle fut enterrée dans la crypte de l’église des Carmes, parmi les victimes des massacres de septembre.
Après avoir subi l’épreuve de la crainte desséchante au temps où l’aberration janséniste pesa sur son âme, cette Sainte Religieuse s’épanouit enfin dans le rayonnement du Soleil d’amour qui habite les âmes de bonne volonté. C’est pourquoi, comme le dit sa biographe, « elle demeura vaillante et paisible au contact des événements les plus redoutables ; c’est pourquoi elle posséda cette charité forte et généreuse » qui fait qu’on se donne passionnément à Dieu pour sa gloire et celle de son Église.
Nous vivons à une époque de bolchevisme en croissance où rien ne prouve que des catastrophes semblables à celles que la Mère Camille eut à subir ne se reproduiront pas. Les enseignements fournis par son intrépidité dans la lutte contre le mal nous montrent comment une âme, qui aime vraiment son Dieu, se sauvegarde dans l’épreuve.
Saint Paul a dit : Si nous n’avons d’espérance que pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais si, à l’exemple de la Mère Camille, nous plaçons toute notre espérance dans la vie à venir, quand viendra la tribulation, quand les héritiers de la démence révolutionnaire se jetteront de nouveau, la hache à la main, sur les fidèles, nous confesserons hautement notre foi et nous connaîtrons le bonheur de mourir pour Notre-Seigneur Jésus-Christ et nous obtiendrons la grâce d’accomplir, comme le dit encore saint Paul, « ce qui manque à sa Passion ».
Un petit livre m’est parvenu que je crois bon de signaler parce qu’il montre comment une âme chrétienne, qui s’ouvre généreusement aux rayons du soleil intérieur, peut faire abnégation de ses propres souffrances pour se vouer à la consolation des peines du prochain.
Il s’agit, dans ce volume[13], d’un jeune homme qui, atteint d’un mal incurable, non seulement usa ses forces déclinantes à soigner les tuberculeux d’un sanatorium, mais encore conçut l’idée touchante de tresser sous le titre d’Union catholique des malades, un lien de prières entre le plus grand nombre possible de personnes affligées de maladies graves et disposées à offrir par l’oraison, leurs épreuves comme un bouquet de roses rouges sur l’autel de ce Sacré-Cœur qui nous enseigne l’amour par la douleur.
[13] L’Apostolat du malade : Louis Peyrot (1888-1916), par J. P. Belin, 1 vol. chez Bloud et Gay.
Le plus simple, pour faire saisir l’action évangélique de Louis Peyrot sera de raconter sa vie et de citer des extraits de son journal et de sa correspondance avec ses amis et avec quelques-uns de ceux qui suivirent avec lui la voie douloureuse et mirent leurs pas dans les pas de Jésus montant au Calvaire.
Louis Peyrot, fils d’un médecin, naquit à Néris-les-Bains, petite ville d’eaux du Bourbonnais, le 11 janvier 1888. Il fit ses études à Paris, au collège Stanislas d’abord puis à l’école Bossuet d’où il suivit les cours du lycée Louis-le-Grand. Sa formation religieuse avait été commencée dans la famille profondément catholique à laquelle il appartenait. Elle se développa et s’affermit encore sous l’influence des maîtres qui instruisirent sa première jeunesse. Il était, du reste, d’autant plus prédisposé à la subir, que Dieu l’avait doué d’un esprit sérieux, enclin à la méditation, une âme éprise de la vie intérieure et portée à y conformer ses actes.
Pour preuve, cette phrase qu’il écrivait à l’âge de quinze ans :
« Il me semble que la vie consiste à étudier avec réflexion l’ombre de l’Infini qui plane sur nous, à la deviner autant qu’il est possible puis à conformer notre existence à cet idéal entrevu. »
Ce qui caractérise également Peyrot c’est, dès cette époque, l’amour des humbles. Il était de ceux à qui la société contemporaine, imprégnée de matérialisme, pourrie par le goût du luxe et les jouissances grossières, procure un dégoût irrémédiable. L’égoïsme et la bassesse de pensée des classes dites dirigeantes l’écœuraient. Il est probable aussi qu’il eut maintes occasions d’observer la bourgeoisie catholique et de constater que, trop souvent, chez elle, l’esprit religieux s’est figé en des pratiques de convenance, en un pharisaïsme rogue et glacial dont les aspérités feraient fuir à plusieurs centaines de kilomètres les apôtres les plus intrépides.
Toujours est-il que son penchant vers les pauvres s’affirma de bonne heure. « Il éprouvait, écrit son biographe, un impérieux besoin de se rapprocher des faibles, non pas pour étudier curieusement leur cas ou pour proposer des remèdes à leurs misères mais parce qu’il souffrait lui-même directement de leur abandon, parce qu’il se sentait réellement leur frère. »
Lui-même a noté ce sentiment dans une lettre à un ami. Il lui écrit :
« C’est vrai, j’aime profondément les pauvres. Je me plais mieux dans leur société que dans le monde… Je vous assure que je ne suis pas fier d’être bourgeois. C’est un titre et un rang que j’abandonnerai bien volontiers si le bon Dieu le veut ! »
Son goût pour les milieux populaires ne se bornait pas aux paroles. En ses moments de loisir, il allait parfois dîner dans les restaurants sans faste où se nourrissent les ouvriers. Il y fréquentait sans col ni cravate, vêtu d’un maillot de cycliste, coiffé d’une casquette. « C’est curieux, disait-il, comme dans ce costume, je me trouve plus à l’aise dans la rue. »
Voici son impression un soir où il était entré, par hasard, en ce théâtre Montparnasse où les petites gens du quartier de la Gaîté aiment à se saturer de mélodrames à fracas.
« On donnait, dit-il, le Chiffonnier de Paris, pièce assez insignifiante et qui n’a rien de très empoignant. Mais c’était la salle que je considérais. On se sent chez soi ; on y est venu sans cérémonie, en vêtements de travail. Les femmes sont en cheveux ; les hommes restent couverts, contrairement à ce qui se passe ailleurs. Mais tout cela est gai, d’une gaîté franche et qu’aucune étiquette ne contraint. »
Peu après, il passa son baccalauréat et résolut de se faire médecin. « Cette carrière le séduisait par cette possibilité indéfinie de dévouement qu’il y entrevoyait. Il estimait qu’après celle du prêtre, c’était la plus belle qu’on pût choisir. »
Tandis qu’il commençait ses études pour le P. C. N., l’idée grandissait en lui de donner une part de son existence à l’éducation chrétienne de la classe ouvrière. Et justement, à cette époque il découvrit le Sillon.
Pour un esprit qui aspire à se donner, pour un adolescent sans expérience et en qui l’enthousiasme du sacrifice déborde, le socialisme, à première vue, offre par ses parades d’équité bien des aspects séduisants. Mais, comme en réalité, c’est une doctrine brutalement matérialiste et que le sophisme égalitaire mène ses adeptes à la haine, à l’envie et au goût de la violence, on doit conclure que l’arbre est mauvais et ne peut donner que des fruits détestables. L’erreur du Sillon fut de tenter une conciliation entre ces théories destructives et le principe chrétien. Il y avait en outre, chez certains Sillonnistes, une tendance anarchique plus ou moins consciente ; et de là leur condamnation par Pie X.
Louis Peyrot se sourit sans faire de restrictions. Il écrivait à un ami :
« Il faut bien reconnaître que le Sillon avait des torts. L’équivoque créée par notre volonté de faire œuvre éducatrice, tout en restant indépendants de l’Église, a fait tout le mal… Nous n’avons qu’à obéir, car le Pape est seul juge de la tactique générale suivant laquelle il veut utiliser ses troupes… »
Et plus loin :
« Je ne pense pas que tu sois de ceux qui ont pensé que la soumission du Sillon prouvait que les catholiques mettent leur respect de l’autorité au-dessus de leur conscience. Les journaux protestants ne se font pas faute de répéter ce sophisme. Mais nous croyons que le Pape a sur les questions de foi et de morale une compétence renforcée par des grâces uniques ; d’où notre confiance dans ses directions. »
Cette droiture dans l’obéissance, ce respect des décisions pontificales, cette rentrée dans la discipline — qui constitue l’une des plus grandes forces de l’Église — valurent à Peyrot un redoublement d’énergie pour l’accomplissement du devoir chrétien. Il en eut la conscience très nette.
« L’essentiel, disait-il, est de suivre la voie où le Seigneur nous appelle. Il ne peut vouloir que notre bien. Nous sommes donc certains, en aimant Dieu, de nous aimer nous-mêmes. Je veux dire : nous sommes certains en obéissant rigoureusement à Dieu, de travailler à notre bonheur. Notre bonheur, c’est de vouloir ce qu’il veut, de haïr ce qui est opposé à ses desseins. »
Dès qu’il se fut ancré dans une conviction aussi louable, il fut mûr pour l’apostolat auquel la grâce divine le réservait. Nous allons voir avec quelle vaillance il y répondit.
Bénéficiant de l’ancienne loi militaire, en 1906 Louis Peyrot s’engagea à dix-huit ans au 121e de ligne à Clermont-Ferrand, afin de ne faire qu’un an de service de par la dispense du P. C. N. Ses classes terminées, comme étudiant en médecine, il fut employé à l’infirmerie régimentaire. Il chercha bientôt à se faire affecter à l’hôpital où il espérait travailler plus librement et étudier des cas intéressants. Mais ce ne fut pas comme infirmier qu’il y entra. En janvier 1907, il tomba malade de la grippe ; une bronchite succéda et sans doute commenceront à se développer en ses poumons fragiles les germes de la tuberculose.
On le transporte à Paris, on lui octroie des congés. Mais le mal ne cède pas et, à la fin de l’année, il est obligé de se rendre compte qu’il est gravement atteint et qu’il lui faudra se soumettre à une cure de longue durée.
Tout d’abord la perspective de l’inaction qui le menaçait le consterna. « Je n’avais jamais eu pareille épreuve et celle-ci m’a trouvé sans courage pour la subir… »
Mais cet état de dépression ne persista point. Par la prière et l’abandon sincère à la volonté divine, il ne tarda pas à réagir :
« Cette longue inaction est bien pénible, écrit-il. Mais puisqu’elle était utile aux desseins que Dieu a sur moi, il faut l’accepter avec joie. Le plus triste, dans une maladie comme celle-là, c’est qu’on ne peut plus former de projets qui aient chance de se réaliser. Mais il fallait bien apprendre que Dieu seul dispose entre tout ce que l’homme propose et je dois comprendre que l’on ne vit pas pour soi, que l’on ne s’arrange pas une vie mais que l’on va où Dieu a besoin de nous… J’ai appris en même temps qu’on ne doit jamais s’exagérer sa propre valeur, se croire indispensable. Dieu a assez le moyen de nous remplacer. »
On admirera cette vaillance dans la résignation. Parce qu’elle se corroborait d’un grand esprit de foi, Peyrot en acquit un surcroît de ferveur religieuse. Et c’est alors qu’une lumière lui fut donnée sur les moyens d’utiliser la maladie pour le bien des âmes. Voici en quelles circonstances.
Après un séjour à Néris où, malgré les soins familiaux, son état ne s’améliora pas, il consulta des spécialistes qui l’engagèrent à essayer d’une cure d’air au sanatorium de Leysin dans le pays de Vaud.
Docile à leur avis, Peyrot se mit aussitôt en route. Il arriva à Leysin le 21 novembre 1907.
Il acceptait courageusement la situation sans, toutefois, s’illusionner à l’excès sur ses chances de guérison. Car, disait-il, « on voit à Leysin des hommes qui se sont déjà soignés, il y a dix ans, qui se sont crus guéris et qui sont forcés d’y revenir maintenant plus malades que jamais. Enfin, à la grâce de Dieu !… »
Au sanatorium, il se lia d’amitié avec plusieurs jeunes gens, aussi atteints ou plus atteints que lui-même. Il leur donnait l’exemple de la patience ; il les remontait par sa gaîté et par les effusions discrètes du feu d’amour divin qui allait toujours s’accroissant dans son âme. Plusieurs en subirent les effets et, sous cette influence, revinrent à Dieu.
Jusqu’en 1913, son existence se partage en séjours alternés à Néris et à Leysin. Parfois le mal reste stationnaire. Peyrot échafaude alors des plans d’études médicales et d’activité sociale, publie des articles dans divers journaux et revues. Mais bientôt, la fièvre et la toux reviennent, plus implacables. Il passe par des périodes de découragement où il ne trouve presque plus la force de prier. Toutefois, jamais il ne cessa de prononcer le Fiat consolateur. Il s’ensuivit une paix intérieure et un accroissement de confiance en Dieu qui se sont exprimées en des colloques d’une grande beauté dont il importe de citer quelques passages.
Il s’écrie : « Mon Dieu, je ne demande pas à monter très haut. Je me serais contenté des chemins faciles de la plaine où l’on a des compagnons qui rient. Mon Dieu, ayez pitié !… » Et il poursuit, prenant conscience que Dieu, par la souffrance, l’attire vers les sommets de la Charité : « La main qui me tire et qui me guide, resserre son étreinte et m’entraîne. J’entends une voix qui me dit : — Aie du courage ! Sois humble. Si tu savais les cimes radieuses auxquelles je te conduis ! Si tu savais quel soleil tu retrouveras après ces brumes éphémères !… Tu te plains que tu es seul, que tu ne rencontres que des amis peu nombreux. Mais c’est de quoi tu devrais me savoir gré. Je t’ai choisi du milieu de la foule. Écoute : tantôt tu penses aux joies immondes que tu as quittées, et tu murmures contre l’austérité de la voie où je te dirige. Tantôt l’esprit du mal, qui cherche à te reprendre et à te détacher de Moi, te souffle du mépris pour ceux que tu as un peu dépassés, grâce à mon aide. Tu oscilles entre la nostalgie de la boue sensuelle et l’orgueil du progrès que tu me dois. Reconnais que j’ai eu raison en enveloppant ta voie de brouillard. Abandonne-toi humblement à moi ; celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Viens, je suis ta force et ta lumière. Tu n’es pas seul puisque tu es avec moi et que je t’aime, moi, ton Dieu. »
Ainsi fortifié il ne tarda pas à démêler que Dieu ne lui demandait pas seulement l’acceptation personnelle de la souffrance, mais lui inspirait d’appliquer aux malades ce dogme de la communion des saints qui constitue l’une des plus sublimes croyances de l’Église. Et peu à peu se forma en lui le projet de cette Union catholique des malades, où se dépensèrent généreusement ses dernières forces.
Afin de bien montrer la façon dont l’idée naquit des méditations de Peyrot et se réalisa, je citerai un peu longuement certains passages de son journal et de sa correspondance qui révéleront mieux que toute analyse, comment il s’oublia lui-même pour assister autrui.
Il commença par spécifier la valeur surnaturelle de la maladie :
« Dieu nous envoie la maladie, écrivait-il : 1o pour, nous frappant dans nos forces, nous ôter le moyen de céder à nos passions. « Si votre œil, si votre main, si votre pied vous scandalisent, arrachez-les et jetez-les au feu. » Dieu fait l’opération que nous n’aurions pas eu le courage de faire. Si ta vigueur te scandalise, détruis-la. Car il vaut mieux pour toi entrer dans l’éternité sans yeux, sans mains, avec des cavernes dans tes poumons, infirme et sans muscles, que d’avoir un corps sain et bien développé et aller au feu éternel. »
« 2o Pour nous enlever de la vie active, du monde, où nous étions emportés, roulés dans le fleuve des occupations ; pour nous donner le temps de réfléchir.
« 3o Pour nous obliger à penser à la mort, à cet événement si proche et si peu attendu, si effrayant, et si oublié, si important et auquel nous n’attachons pas d’importance. Et pour que, ayant pensé à notre mort, nous apprenions à faire le départ en toutes choses entre celles qui meurent et celles qui sont immortelles ; entre ce qui passe et ce qui demeure, entre le contingent et ce qui est nécessaire.
« De façon à ce que nous comprenions enfin le sens de la vie. »
Ensuite, s’étant appliqué ces principes, mû par ce besoin de se dévouer aux autres qui fut la caractéristique de sa belle âme, il se demande comment il pourra le faire par l’oraison, ne pouvant plus le faire par l’action. Et il se répond :
« Le malade peut être utile aux autres : — 1o Par la valeur surnaturelle de ses souffrances, utilisées par la communion des Saints. — 2o Parce qu’il peut exercer un apostolat spécial auprès des autres malades, et en général de ceux qui souffrent, étant seul au courant de leurs états d’âme. — 3o Il peut accomplir les œuvres de miséricorde à l’égard de ses compagnons (visiter les malades, vêtir et nourrir et désaltérer ceux de ses compagnons qui sont dans le besoin, donner des conseils, encourager, prier pour les autres : vivants, agonisants ou morts). — La maladie est un privilège, à coup sûr, puisqu’elle nous mène progressivement à l’union intime avec Dieu, en nous ôtant tout autre souci, toute préoccupation autre que celle de Dieu. J’en reviens à la comparaison du sauvageon greffé dont on coupe les rejetons pour que la greffe prospère en absorbant toute la sève. »
Alors l’idée se précisa. Soutenu d’En-Haut, Peyrot se dit qu’une association de prières, une mise en commun des ressources d’énergie morale que procure l’acceptation joyeuse de la maladie, donneraient, aux catholiques qui se grouperaient de la sorte, des fortifiants d’âme.
« Il fut, à ce moment, sollicité de correspondre avec un malade qui se trouvait dans l’isolement. Il vit là une coïncidence providentielle et aussitôt, il conçut l’idée d’un groupement autonome. » Les malades y échangeraient des cahiers où ils noteraient leurs méditations, leurs oraisons et les réflexions que leur suggéreraient leurs luttes, en Dieu, contre le découragement et les mauvais conseils de la Malice.
« Les cahiers ne sont pas seulement un exutoire, un journal intime ; ce n’est pas non plus une tribune d’où l’on donne des conseils en pontifiant…, écrivait-il alors à son ami Jean G. Supposez — cela vous est déjà arrivé moult fois — qu’on vous prie de rendre visite à un malade de votre sanatorium qui s’ennuie et a besoin d’être réconforté. Vous imaginez parfaitement ce que vous lui direz pour le distraire d’abord, lui faire voir les bons côtés de la maladie, lui faire espérer sa guérison, l’inviter dans tous les cas à la patience et, à l’occasion, adroitement lui montrer le Ciel et les raisons surnaturelles de souffrir. Cela, vous savez très bien le faire. Et vous concevez facilement qu’on puisse le faire par écrit quand la distance interdit les visites. »
Encouragé par de premiers résultats assez favorables, il s’assura du concours de quelques amis, se mit en relations avec des malades dispersés un peu partout et lança le premier cahier le 4 mars 1914.
Il attendait l’effet produit avec une certaine anxiété. Mais il fut vite rassuré car, dès la fin du mois, le cahier lui revint accompagné de lettres qui prouvaient que son œuvre serait féconde.
« Les sept premiers messages, écrivait-il, sont très bons, tout à fait ce qu’on pouvait espérer de mieux au point. La variété des tempéraments se combine heureusement avec l’unité de vues. On sent déjà quelle sera l’atmosphère : chaude et simple, courageuse et joyeuse… Je ne sais pas si c’est parce que cette Union est un peu mon enfant, mais je la vois d’un œil enthousiaste ! Dieu veuille la bénir et la conduire. »
Dieu la bénit en effet, puisqu’elle compte aujourd’hui 110 membres répartis en 12 groupes, 5 en France et 7 en Suisse.
Les relations entre tous ces malades, entretenus dans leur ferveur par son initiative, se soutenant, s’exhortant les uns et les autres, devinrent tout à fait intimes. Peyrot, pour resserrer encore le lien qui les unissait, décida de publier un livre d’or contenant des notices sur les membres disparus de l’U. C. M. et quelques-unes de leurs lettres choisies parmi les plus émouvantes.
Il écrivit pour ce livre d’or une préface où il définissait admirablement cette amitié, en quelque sorte surnaturelle, qui attachait les uns aux autres tous les membres de l’Union.
« Mes chers Amis, y disait-il, nous ne nous sommes, pour la plupart, jamais vus ; tout au plus connaissons-nous, par des photographies, plus ou moins fidèles, et sans vie, nos physionomies respectives…
« Néanmoins l’intimité de l’Union catholique des malades est l’une des plus étroites qui soient, parce qu’elle est faite d’une communauté d’épreuves et de vocation, d’un difficile effort partagé, d’entr’aide, et de compassion réciproque.
« Nous faisons de compagnie le même voyage. Dans la foule où nous étions dispersés, nos infirmités nous ont servi de signe de ralliement : qui se ressemble, surtout par l’infortune, s’assemble. Et puis, comme nous avions les mêmes certitudes divines, comme nous marchions dans le même espoir de l’incorruptible Santé, nous avons compris que nous étions frères et nous avons uni nos faiblesses pour mieux traîner le lourd bagage de nos peines.
« Notre amitié, c’est la rencontre de nos âmes souffrantes dans la même foi, la même espérance, et la même charité. C’est pourquoi rien ne peut atteindre notre amitié, puisqu’elle ne repose pas sur un attrait physique inconstant, mais qu’elle est faite de raisons surnaturelles. Rien, si ce n’est l’abandon volontaire de la collective ascension. Pas la mort, en tout cas ; au contraire — puisque la mort, c’est l’ascension terminée, les risques de chute définitivement abolis, les raisons surnaturelles, dont nous parlions tout à l’heure, éclairées, multipliées, fortifiées par l’Infini.
« Rien ne nous sépare de vous, chers amis déjà parvenus à Dieu ! Nous continuons à nous prêter mutuellement l’appui de nos intercessions ; vos messages ne viennent plus nous réconforter, mais vous vous faites maintenant nos inspirateurs, les auxiliaires de nos anges gardiens ; en échange, nos prières terrestres augmentent votre gloire dans le Paradis ; et nos âmes, à tous, vivent toujours dans la même communion des Saints. »
Cinq mois après la mise en circulation du premier cahier, la guerre éclata. Peyrot souffrit d’abord cruellement de ne pouvoir courir aux armes pour la défense de la Patrie. « Quoi, s’écriait-il, rester étendu sur une chaise longue pendant que les autres se battent ! » Mais il ne tarda pas à se reprendre et, se tournant vers Dieu, il conçut bientôt la façon dont ses frères de souffrance et lui pourraient assister les combattants. Il écrivait en octobre 1914 :
« Qu’allons-nous faire, nous autres malades ? — Prier, c’est évident. Mais aussi prendre notre part de l’expiation nécessaire afin de hâter la rédemption de notre pauvre patrie. Offrons tout de bon cœur. Mortifions-nous au besoin. Faisons pénitence avec une ardeur inquiète : la France, en attendant, souffre tant. »
Et, quelques jours plus tard, il ajoutait :
« La guerre continue, la guerre sera longue et je vois bien, mes chers amis, que nous nous posons la question : Comment nous mettre, nous aussi, en campagne ? Par quel biais collaborer, malgré nos infirmités, à cet effort immense de notre patrie ?
« Eh bien ! je crois que le rôle des malades pourrait être de faire dans leur milieu du courage, de la confiance et de la joie. Nous devrions être des foyers d’idéalisme, quelque chose comme des soldats à l’intérieur combattant le pessimisme, les fausses nouvelles, les oiseaux de mauvais augure qu’il y a partout. Il nous reste la tâche qu’avait si splendidement entreprise A. de Mun qui, tous les jours, par ses articles de l’Écho de Paris, s’appliquait à tourner les âmes vers En-Haut, à unir les cœurs et à tendre les volontés.
« Il y a et il y aura toujours davantage de blessés grièvement, amputés, infirmes pour le reste de leur vie. Et nous sommes évidemment désignés pour être les appuis de ces pauvres gens qui vont avoir à faire le douloureux apprentissage de l’infirmité… En l’absence d’une foule d’hommes utiles, je me demande aussi s’il ne se trouvera pas de menus rôles de la vie sociale et économique que nous pourrions tenir. »
Il se trouvait alors dans sa famille, à Néris. L’hôpital y était rempli de blessés et, dans un désir de se dévouer, il avait obtenu d’être employé, à titre gratuit, aux écritures. Mais ce faible appoint à la défense nationale ne lui suffisait pas. Son zèle patriotique, son besoin de sacrifice intégral lui firent désirer d’être envoyé au front pour y couper les fils de fer barbelés qui défendaient l’accès des tranchées ennemies.
Il écrivit à Maurice Barrès, espérant obtenir, par son intermédiaire, qu’on l’acceptât pour ce volontariat héroïque.
« Pourquoi, disait-il, ne pas employer, dans ces missions périlleuses et meurtrières, des gens comme nous, voués en tout cas à la mort, mais qui seraient aussi capables, transportés immédiatement au lieu de l’action, de tenir bon quelques jours et ainsi d’épargner d’autres vies. »
Barres lui répondit que la chose était impossible et termina sa lettre en l’engageant à tout faire pour se guérir afin d’aider à la reconstitution de la France après la victoire.
Se guérir, il ne l’espérait guère, car il se savait profondément atteint. Du moins, il voulut employer ce qu’il lui restait de forces au service des tuberculeux réformés de la guerre.
Il obtint d’être envoyé à Cambo où l’on créait un sanatorium. C’est là qu’il passa les derniers mois de sa vie. Il y arriva au printemps de 1915 et se mit vaillamment au travail. Sans entrer dans le détail de son activité, disons qu’il réussit à organiser le sanatorium d’une façon si pratique qu’il en fit une installation modèle. Non seulement, il disciplina les valétudinaires placés sous ses ordres et leur rendit le goût de l’existence, mais encore il en ramena beaucoup à la pratique religieuse. En même temps il ne négligeait point l’U. C. M. et poursuivait sa correspondance avec ses adeptes anciens et nouveaux.
Cependant son mal progressait. Pendant l’été de 1916, il se sentit à bout d’énergie. Il écrivait le 3 juillet :
« Nous continuons de recevoir des malades et, cette fois, la maison est au complet. Il devient ennuyeux que je doive garder le lit car il y a des choses qui restent en souffrance. Aussi je suis décidé à me retirer et à laisser place à quelqu’un de valide. Mais cela ne me sourit pas du tout de reprendre la vie d’inactivité… Mon Dieu, je ne comprends pas du tout vos vues mais j’accepte et j’obéis. Donnez-moi la force, ayez pitié de moi !… »
Son départ était fixé au 18 août. Il avait fait ses adieux aux malades qui lui témoignèrent le grand chagrin qu’ils éprouvaient de le perdre.
Il comptait prendre un train du matin et rien dans son état ne faisait soupçonner une aggravation subite de son état. Mais, dans la nuit il fut pris d’un vomissement de sang si prolongé qu’il se rendit compte du danger qu’il courait. « Cette fois-ci, je crois que c’est la fin », dit-il à sa sœur qui se trouvait près de lui. Grâce à des soins empressés, l’hémoptysie fut enrayée. Mais ce n’était qu’un répit.
Son biographe va nous dire sa fin :
« Vers minuit, quand il fut calmé, il nous dit : « Demain matin, il faudra prévenir M. le curé. » On le rassura ; tout danger immédiat semblait écarté. De nouveau seul avec sa sœur, il lui fit quelques recommandations, à voix basse ou par signes, puis resta immobile et silencieux jusqu’au matin, suçant de petits morceaux de glace. M. le curé vint le voir (l’aumônier avait dû partir quelques jours avant), mais lui refusa l’extrême-onction ; il n’était pas en danger. Après avoir été assoupi toute la journée, il fut très agité la nuit suivante, voulant que rien de ce qu’avaient conseillé les médecins ne fût négligé : comme si une ardente volonté de vivre avait succédé à la première secousse. Le lendemain fut meilleur ; il remerciait gracieusement chacun de l’empressement amical qu’on lui témoignait ; il ne voulait même pas qu’on éloignât les hommes de la maison par crainte du bruit, mais ils aimaient trop Peyrot pour n’être pas parfaitement silencieux. Quelques-uns d’entre eux, qui lui étaient plus spécialement dévoués, demandaient comme une grâce la faveur de le veiller.
« Le dimanche, il allait bien. Il était très gai, comme s’il voulait laisser les siens sur cette impression de belle humeur. Il riait de si bon cœur qu’il lui fallait de temps en temps reprendre son sérieux pour ne pas tousser. L’inquiétude se dissipait ; ce serait long, sans doute ; ce n’est plus un mois de vacances qu’il faudrait, il prendrait tout le temps nécessaire, sans se soucier de la maison. Comme on avait laissé la porte entr’ouverte, les malades, qui ne l’avaient pas vu depuis trois jours, en passant, demandaient affectueusement de ses nouvelles. Après l’angoisse des derniers jours, c’était une détente.
« Cette dernière nuit, son ami D. devait la passer près de lui. Ils bavardèrent encore, Louis toujours plein de flamme pour son projet de colonie du travail. Au matin, il eut une légère quinte de toux puis une seconde. A peine le temps de serrer la main de son ami, il perdit connaissance. C’était cette fois une hémorragie interne. Il eut à peine vingt minutes d’agonie. »
Louis Peyrot avait vingt-huit ans lorsqu’il mourut ; il avait si bien utilisé sa maladie pour l’amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ qu’en recevant la Lumière éternelle, il pouvait s’écrier avec le serviteur de l’évangile : Domine, quinque talenta tradidisti mihi ; ecce enim quinque alia superlucratus sum.
« Jésus-Christ achève sa Passion en nous », a dit Pascal. Cette conviction que, par les souffrances de son corps mystique, qui est l’église, Notre-Seigneur ne cesse de poursuivre la rédemption du monde, constitue l’essence même du dogme de la communion des Saints. Aussi lorsque éprouvé par la maladie, la gêne, les mille tribulations de l’existence, le catholique, s’oubliant lui-même, offre ses peines pour le soulagement d’autrui, lorsqu’il prie pour ses frères douloureux comme ses frères prient pour lui, lorsqu’il renforce son abnégation d’un appel à la miséricorde divine pour le soulagement des âmes du Purgatoire, il prend conscience de participer au sacrifice sans cesse renouvelé de Celui qui verse son sang, chaque jour, sur les autels pour notre salut.
Alors, si intenses, si prolongés que soient les maux qui l’accablent, une paix lumineuse s’épanouit dans son cœur. Son front saigne sous la couronne d’épines, ses épaules meurtries saignent sous la croix faite de tous les péchés de l’univers ; les ténèbres pèsent sur sa tête. Les ennemis de Dieu sifflent, ricanent, blasphèment autour de son supplice. Mais lui leur répond : Je souffre volontiers pour que, quand vous serez vous-mêmes dans la souffrance, vous appreniez à lever des yeux implorateurs vers le Bon Maître qui meurt et qui ressuscite chaque jour afin de nous délivrer du Mal, afin que vos larmes ne soient point perdues…
Cette solidarité avec Notre-Seigneur montant au Calvaire, cette union de l’Église militante et de l’Église souffrante, c’est par elles que nous trouvons la force de gravir le chemin hérissé de cailloux aigus et de ronces qui aboutit au seuil de l’Église triomphante. Tous les fidèles savent qu’il leur est salutaire de s’en pénétrer et de les mettre en pratique. — Peut-être, cependant, n’est-il pas superflu de nous rappeler combien elles nous sont nécessaires au temps où nous sommes condamnés à vivre.
Le présent est sombre ; l’avenir menaçant. La guerre horrible qui vient de finir apparaît à beaucoup comme le prologue de cataclysmes encore plus épouvantables. Qui sait si, par la recrudescence de matérialisme où le monde s’entête à chercher le bonheur, nous ne verrons pas bientôt ce Règne de la Bête dont les barbares de Germanie furent les précurseurs, dont les sauvages de Russie tissent déjà la pourpre sanglante et fangeuse ?
Peut-être qu’il va surgir l’Enfant de Perdition dont saint Paul a dit : « Cet ennemi de Dieu s’élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu à tel point qu’il trônera lui-même dans le temple de Dieu, en se faisant passer pour un être divin.
« Et le mystère d’iniquité est en train de s’accomplir dès à présent ; et il faut que ceux qui sont fidèles maintenant persévèrent dans la fidélité. Car ce personnage, qui doit arriver accompagné de la puissance de Satan, avec toutes sortes de signes, de miracles et de prestiges trompeurs, est orné de toutes les séductions qui porteront à l’iniquité ceux qui sont destinés à périr, parce qu’ils n’auront pas accepté la Vérité qui les aurait sauvés… »
Seigneur Jésus-Christ, c’est vous qui êtes la Vérité unique, la Lumière dans les ténèbres, et que les ténèbres n’ont point comprise. Octroyez-nous la grâce de ne point sombrer dans cette nuit sans étoiles de l’apostasie où il est écrit que beaucoup se perdront. Faites que nous souffrions avec allégresse selon que vous nous le demandiez lorsque vous nous avez révélé votre Sacré-Cœur. Souffrance par amour ; amour par la souffrance, tel est le sens de votre enseignement. Faites que nous soyons rendus dignes de participer à votre perpétuel sacrifice. Qu’il ne s’éteigne pas le soleil allumé par vous dans nos âmes ! Donnez-nous des Saints car la Sainteté seule peut nous sauver en ce monde qui se détourne de plus en plus de votre Face pour se prosterner devant les sombres lueurs du Crépuscule irrémédiable où commence à se dessiner la figure de l’Antechrist…
FIN
Pages | |
| Saint Joseph de Cupertino | |
| Catherine de Cardonne | |
| Une Carmélite sous la Terreur | |
| La Charité du malade |
5084. — Imprimerie spéciale de la Maison Bloud et Gay.