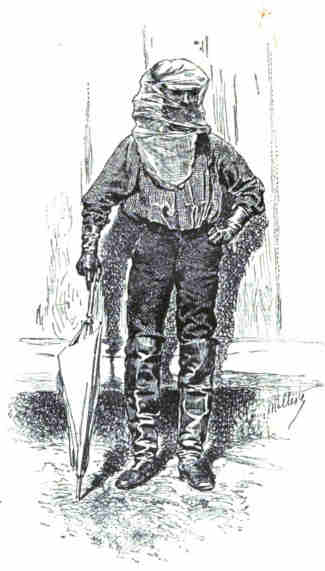
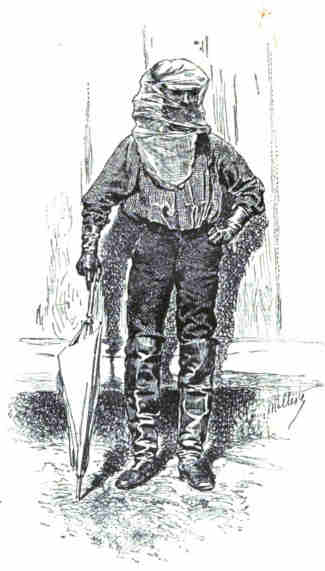

[Pg 1]
Routes conduisant à la Petchora.—Le Volga.—Mouvement de la navigation.—Iaroslav.—Vologda.—Nijni-Novgorod.—Les populations finnoises du Volga.—Les Bulgares.—Lutte des Finnois contre les Russes.—La colonisation slave.—Les Tatars.
Qui a bu boira, affirme un proverbe; qui a voyagé voyagera, pourrait-on dire non moins justement. Revenu depuis dix mois du Grönland, l'inaction me pesait. La nostalgie des pays du Nord m'avait pris, de ces pays où j'ai passé heureux tant d'étés dans le désert des montagnes et dans le silence des forêts. Elles sont si belles, si grandioses, ces solitudes mortes, si étranges dans leur fugitive parure d'éclatantes colorations, qu'elles laissent toujours l'envie cuisante de les revoir.
Après avoir exploré la Laponie, mes recherches m'avaient conduit en 1885 sur les bords de la mer Blanche. Pour continuer les études d'histoire naturelle[Pg 2] et d'ethnographie commencées dans ces voyages, il me restait à aborder les régions situées à l'est de cette mer: le bassin de la Petchora, l'Oural septentrional et la Sibérie.
Avant la relation de notre exploration, indiquons rapidement l'aspect de ces pays.
La Petchora, que nous proposons de descendre jusqu'aux abords du cercle polaire, est un des fleuves les plus grandioses d'Europe. La longueur de son cours est évaluée à 1 483 kilomètres[1] et la superficie de son bassin aux deux tiers de celle de la France. Seuls le Volga, le Don et le Dnièpr ont un développement supérieur. Ce vaste territoire, comme toute la zone boréale de l'ancien continent, présente deux aspects très différents. Le long de la côte de l'océan Glacial s'étend l'immense solitude des toundras, vastes plaines dépouillées d'arbres, marécageuses, continuant dans l'intérieur du continent l'uniformité de la mer qu'elles bordent. En arrière de ce désert commence la grande forêt de la Russie septentrionale. Sur des milliers de kilomètres s'étend une futaie ininterrompue d'arbres verts. A la monotonie aride de la toundra fait suite une uniformité verte, non moins triste et non moins poignante. Par le paysage, par la nature de ses produits et par la rigueur de son climat, le bassin de la Petchora appartient déjà au nord asiatique, et avec juste raison un naturaliste anglais a donné à cette région le surnom de Sibérie européenne. Vous passez l'Oural, un instant le pays devient intéressant par le spectacle de montagnes pittoresques, puis, de l'autre côté de la chaîne, vous retombez dans une plaine pareille à celle[Pg 3] du versant européen, avec la même forêt et de mêmes grands fleuves. Dans le bassin de l'Obi comme dans celui de la Petchora, partout c'est le même aspect. Vous parcourez des centaines de kilomètres et il vous semble toujours être au même endroit. C'est l'infini en monotonie. Tout l'intérêt du voyage est dans l'étude des habitants.
[1] Strelbitzky.
N'ayant rien appris de la civilisation, les indigènes de ces régions boréales offrent le spectacle de l'existence menée par nos ancêtres préhistoriques. En examinant les instruments en os qu'ils fabriquent, on comprend ceux que les fouilles mettent au jour dans nos pays, et à la lumière de cette comparaison les objets de l'âge de la pierre perdent leur anonyme. Pour mieux comprendre l'homme des temps géologiques, nous irons une fois de plus étudier les primitifs, les Zyrianes de la Petchora et les Ostiaks de l'Oural. Dans la nature, tout se modifie, les animaux, les pierres, les plantes; l'homme sauvage seul ne change pas.
Une fois le plan de l'exploration approuvé par le Ministre de l'instruction publique, je sollicitai les bons offices du gouvernement impérial. Le succès d'une expédition en Russie dépend de la qualité de vos recommandations; avec l'appui des fonctionnaires tout devient aisé, sans leur concours les difficultés restent invincibles. A la demande du service des missions scientifiques toujours soucieux d'assurer le succès de ses collaborateurs, le gouvernement impérial voulut bien m'accorder son appui. En même temps, la Société de Géographie de Saint-Pétersbourg me promit son puissant patronage avec une amabilité dont je lui garde une profonde reconnaissance. Que MM. de Séménov et Gregoriev, président et secrétaire général de cette importante association scientifique,[Pg 4] veuillent bien agréer ici l'expression de mes remerciements. A leurs judicieux conseils et à leur bienveillante intervention je dois la réalisation de mon programme.
Pour atteindre la Petchora, trois routes s'offrent au choix du voyageur.
La première part d'Arkhangelsk, passe par Pinéga, Mézène, et débouche dans la Petchora à Oust-Zylma. D'Arkhangelsk à Oust-Zylma, le pays et les indigènes sont peu intéressants, et à partir de cette dernière ville on doit remonter la Petchora à contre-courant pour atteindre l'Oural: d'où fatigues et perte de temps.
La seconde route a pour point de départ Vologda; elle suit la Soukona, puis la Vytchégda jusqu'à Oust-Syssoltsk, traverse ensuite une région marécageuse sur une mauvaise chaussée. Avec les lourds bagages que l'on traîne avec soi au début d'un voyage, cet itinéraire n'est guère pratique.
La troisième route est tracée par le Volga[2], puis par la Kama et ses affluents jusqu'à Tcherdine. Ces rivières forment une partie de la grande artère commerciale de la Russie et amènent le plus aisément du monde à 300 kilomètres seulement de la vallée supérieure de la Petchora. Et cette dernière distance est facilement parcourue sur des cours d'eau, puis sur un étroit portage. Cette route est la plus facile et en même temps la plus intéressante de toutes celles aboutissant à la Petchora. Vous traversez la partie active de la Russie et au milieu de ce mouvement vous rencontrez des populations figées dans un[Pg 5] passé vieux de plusieurs siècles. Les indigènes de la Russie orientale ont conservé leurs costumes archaïques, leurs usages particuliers, même leurs pratiques païennes. Il y a là des gens intéressants, dont l'étude est une introduction nécessaire à celle des Zyrianes et des Ostiaks, leurs cousins germains. Pour toutes ces raisons, je me décidai à prendre la route du Volga, et le 19 juin 1890 je quittai Saint-Pétersbourg, à destination de Rybinsk, par le chemin de fer de Moscou.
[2] Suivant l'usage français nous écrivons le Volga. En russe, on sait que le nom de ce fleuve est, au contraire, féminin.
Après vingt-trois heures de route, nous arrivons à destination. Autour de la gare une grande plaine mélancolique; pas un mouvement de terrain indiquant le voisinage d'un fleuve. Nous montons en voiture, traversons au galop la ville, puis tout à coup nous voici sur le bord d'un énorme trou rempli d'eau. La terre est fendue là brusquement en une large crevasse au fond de laquelle traîne une rivière. C'est le Volga.
Le fleuve est tout obstrué d'énormes chalands et le bleu du ciel rayé de centaines de mâts. On dirait une forêt ébranchée poussée au milieu de l'eau. Nous nous embarquons, le vapeur part et la file des bateaux s'allonge toujours; on la croit terminée et un peu plus loin elle recommence. Au delà du port le paquebot croise des remorqueurs tirant une escadrille de pesantes barques; après apparaissent de longs trains de bois avec de petites maisonnettes et une nombreuse population, hameaux flottant à la surface du fleuve, puis ce sont des barges aux formes lourdes et massives comme devait en avoir l'arche de Noé. Sans cesse, jour et nuit, la procession de bateaux monte le Volga, apportant les blés de la Russie centrale, le sel et les poissons de la Caspienne, les fers de l'Oural,[Pg 6] les denrées de la Sibérie et de la Perse, les marchandises du Nord et du Midi. En moyenne, chaque année, 14 000 bateaux montés par 300 000 hommes circulent sur le haut fleuve pendant les six mois de navigation. Comme une marée montante, l'Asie pénètre par le Volga à travers la Russie jusqu'à 300 kilomètres de Pétersbourg. Spectacle absolument nouveau pour nous autres Occidentaux; la vue de ce mouvement donne la sensation d'une autre partie du monde, vous devinez l'approche de l'Asie.
Quelques heures après avoir quitté Rybinsk, je débarquai à Iaroslav pour me rendre le lendemain à Vologda. Mon itinéraire sur la Petchora traversant la partie orientale de l'immense gouvernement dont cette ville est le chef-lieu, on m'avait recommandé d'aller présenter mes devoirs au gouverneur. De Iaroslav à Vologda c'est un voyage de 300 kilomètres, une simple excursion pour les Russes, habitués à ne compter les distances que par 1 000 kilomètres.
Le trajet se fait par un chemin de fer à voie étroite. Un seul train par jour circule dans chaque sens, la vitesse du convoi est de 19 kilomètres à l'heure, jugez du trafic du pays et de l'agrément du voyage.
Après avoir roulé pendant onze heures avec une lenteur de sommeil, j'aperçois tout à coup au bout d'une plaine trente-cinq tours, dômes et minarets qui émergent du sol comme de la pleine mer. C'est Vologda. Pour 18 000 habitants la ville compte 54 églises. C'est une des plus fortes proportions que l'on trouve en Russie, où Dieu sait si les églises sont nombreuses.
Les villes russes, il faudrait toujours les regarder de loin, et ne jamais y entrer. A distance, leur panorama d'églises multicolores les fait paraître magnifiques;[Pg 7] lorsque vous y pénétrez, vous n'y trouvez qu'un grand village.
Vologda est située sur les bords de la Vologda, affluent de la Soukona qui se jette elle-même dans la Dvina du Nord. De Vologda à Arkhangelsk, ces rivières forment une voie fluviale parcourue par des paquebots pendant la belle saison. Souvent la baisse des eaux arrête la navigation; aux personnes qui voudraient entreprendre ce voyage on doit par suite conseiller de le faire au plus tard dans la première quinzaine de juillet.
Le gouverneur de Vologda me fit un fort aimable accueil. Il eut la bonté de me remettre un otkrytyilist, c'est-à-dire une lettre générale de recommandation pour les autorités de la province, et de prescrire l'envoi d'un ouriadnik (gendarme de campagne) à ma rencontre sur la Petchora. La présence de ce soldat aurait pour effet d'aplanir toutes difficultés s'il s'en présentait.
De retour à Iaroslav, je continuai ma route sur le Volga. Jusqu'à Nijni-Novgorod la navigation dure trente-cinq heures.
Toujours la même impression. Le paysage n'est pas grandiose, il ne frappe pas, mais à chaque instant, l'attention est attirée par une scène amusante ou par un motif de croquis gai ou curieux.
Au coucher du soleil le panorama devient extraordinaire. Sur un ciel pourpre s'enlèvent en vigueur les églises éparses dans la campagne. Les dorures des dômes semblent en feu, et à travers les croisillons des campaniles apparaissent des pans de ciel rouge comme de gros cierges allumés appliqués sur les murailles blanches.
Le 25 juin au matin, voici Nijni-Novgorod, cette[Pg 8] ville fameuse dont le nom éveille dans l'imagination une fantasmagorie de scènes pittoresques.
Le soleil est de feu, le ciel d'un bleu éclatant, et partout des blancheurs vibrantes. Devant nous se dresse une colline de remparts, de tours, de clochetons et de minarets, tout cela d'un relief extraordinaire sous la lumière éblouissante. A droite c'est une plaine de maisons basses, dominée par une énorme cathédrale rouge, étincelante d'or et de reflets métalliques; autour, deux fleuves, le Volga et l'Oka, larges chacun d'un kilomètre, et peuplés de bateaux.
Devant le port, les rues sont sales, mal pavées, bordées de constructions en briques badigeonnées à la chaux. Nulle part un magasin de quelque apparence, nulle part un restaurant ayant bon air; rien que des échoppes et des cabarets. Ici nous sommes dans la partie active de Nijni et l'on pourrait se croire dans un faubourg. A part les luxueux étalages de Pétersbourg et de Moscou, je n'ai vu en Russie aucun magasin comparable à ceux de nos plus modestes villes de province. Ne croyez pas pourtant ces boutiques mal approvisionnées: telle échoppe d'aspect misérable renferme pour des centaines de mille francs de marchandises.
Partout l'animation est grande. Dans la foule, peu ou point de chapeaux, rien que des casquettes. Voici des marchands, tout de noir vêtus, avec une grande et ample lévite, des moujiks avec la traditionnelle chemise rouge, des Tatars coiffés de bonnets en peau de mouton, des marchands de poissons secs, d'autres chargés de chapelets de biscuits, des mendiants déguenillés, des nonnes, et au milieu de cette cohue un va-et-vient incessant de drochki et de véhicules[Pg 9] bizarres. En Russie, quiconque a quelques sous en poche va en voiture.
Sur la presqu'île entre le Volga et l'Oka, est située la ville de la foire. A ce mot de foire, ne vous représentez pas un fouillis pittoresque de baraques, d'échoppes et de cirques en plein vent. Rien de plus banal que cette ville, un vaste damier de maisons basses disposées au rez-de-chaussée en magasins, avec des églises, des hôtels, des restaurants de toute catégorie, des théâtres, des cafés-concerts et le reste. Pour le moment, tout est désert. C'est un quartier habité seulement quelques semaines, et le reste du temps abandonné.
La foire est ouverte le 25 juillet, par un service divin, et close officiellement le 6 septembre; mais l'évacuation des marchandises n'est guère achevée avant le 20.
Le chiffre des affaires qui se traitent à Nijni pendant cette période d'un mois et demi varie de 625 à 750 millions de francs. C'est, comme on le sait, le principal événement dans la vie économique de la Russie. A Irbit, dans la Sibérie occidentale, au mois de février, se tient une seconde foire, moins importante, mais encore très fréquentée.
De Nijni rayonnent de nombreuses lignes de navigation sur le Volga et ses affluents. Quatre compagnies font le service jusqu'à Astrakane; trois vont à Perm par la Kama, une à Oufa par la Kama et la Bielaya, une également à Viatka par la Kama et la Viatka. Enfin, de Nijni des vapeurs remontent l'Oka jusqu'à Riazane. Ces différentes rivières qui s'embranchent sur le Volga, comme des rameaux sur un tronc, portent la vie à un territoire dont la superficie est triple de celle de la France. Sans le Volga, la[Pg 10] Russie aurait été un désert fermé à la colonisation.
Tous les vapeurs du Volga et de la Kama font escale à Kazan; j'avais donc le choix. La meilleure compagnie est celle de Caucase et Mercure. Ses steamers du type américain offrent le luxe et le confort des grands paquebots. Ces superbes vapeurs sont commandés, m'a-t-on dit, par des officiers de la marine impériale, un gage de sécurité dont les gens prudents ne doivent pas faire fi. La navigation sur le Volga est souvent dangereuse en automne lorsque les eaux sont basses. Pendant mon séjour en Russie, plusieurs naufrages suivis de morts d'hommes ont eu lieu sur ce fleuve.
Pour me rendre à Kazan, je pris la compagnie Samoliote qui a le service de la poste.
Le prix du passage de Nijni à Kazan, pour une distance de 400 kilomètres, est seulement de 6 roubles; en payant le prix de deux billets, j'ai la jouissance exclusive d'une spacieuse cabine établie sur le pont. En Russie les tarifs des transports sont très bas et calculés en raison inverse des distances. Ainsi de Nijni à Perm, pour un voyage de 1 700 kilomètres, il n'en coûte en troisième que 3 roubles, 9 francs au cours d'alors.
A partir de Nijni-Novgorod le paysage est indifférent. Le Volga devient large de 1 000 à 1 500 mètres, avec des eaux jaune sale. La rive droite présente généralement des escarpements, rebords du ravin creusé par le fleuve; à gauche, ce ne sont qu'îles de sable, prairies et terres basses.
Aux environs de Nijni commence la région finnoise. Le bassin moyen du Volga est une mosaïque de races. Grande route ouverte entre la Russie centrale et l'Asie, ce fleuve a été suivi par les peuples[Pg 11] qui marchaient vers l'Occident et ceux qui voulaient s'ouvrir le chemin de l'Orient. Chaque invasion a amené dans le pays une race nouvelle, et chaque race s'est ensuite établie au milieu de ses voisins. Vous trouvez ainsi côte à côte des Finnois, des Tatars et des Russes. Chacun de ces différents peuples n'est point cantonné dans un territoire nettement délimité: à côté d'un groupe finnois vous rencontrez un village tatar et au milieu des Musulmans des Russes. Comme de puissants torrents, les grands courants des invasions passées par la vallée du Volga ont rompu la masse compacte des populations primitives, et de l'ancien niveau humain il ne reste que des témoins pareils à ces collines isolées au milieu des plaines, vestiges d'antiques formations géologiques.
Dans la région que nous traversons, le substratum ethnique a été formé par les Finnois et par les Bulgares. Ce dernier peuple a aujourd'hui disparu; mais grand a été son rôle, et durable a été son influence sur les populations. Il a constitué le premier centre de civilisation dans la Russie orientale.
Les Bulgares habitaient la région de Kazan et probablement s'étendaient dans la vallée inférieure de la Kama. Les ruines de Bolgar, leur capitale, se trouvent près du village Ousspenskoyé, sur la rive gauche du Volga, à 7 kilomètres du fleuve, un peu en aval de son confluent avec la Kama.
Le moine Nestor, le Grégoire de Tours de la Russie, mentionne simplement les Bulgares. Tous les renseignements que nous possédons sur ces anciens habitants de la vallée du Volga viennent des Arabes, avec lesquels il a été en contact dès le Xe siècle.
Les Bulgares étaient un peuple commerçant, en possession du monopole des échanges entre l'Europe[Pg 12] et l'Asie centrale, comme l'ont aujourd'hui les Russes. Aux Arabes ils fournissaient les marchandises du Nord, et aux Finnois celles d'Asie, que ceux-ci transportaient ensuite en Occident.
Du pays des Bulgares pour parvenir dans l'Europe occidentale, les marchandises d'Orient suivaient deux routes différentes. Une partie remontait la Kama, puis, par l'intermédiaire des Permiens, descendait la Dvina ou la Petchora et atteignait l'océan Glacial, d'où les Normands les transportaient par mer en Occident. La découverte de monnaies sassanides, indo-bactrianes, koufiques, anglo-saxonnes, germaniques, et d'objets indous ou chinois dans la vallée de la Kama a permis de jalonner cet ancien itinéraire du commerce de l'Orient. La seconde route était tracée par le haut Volga et exploitée par les Mériens, les ancêtres des Tchérémisses. Par cette voie les produits de l'Asie parvenaient à Novgorod.
Les Normands sont venus jusqu'à Bolgar. Heyd n'hésite pas à reconnaître des Scandinaves dans de prétendus marchands russes descendus en bateaux par le Volga[3].
[3] «Ce nom (de Russe), qu'ils se donnaient eux-mêmes, leur stature haute et élancée, leurs usages singuliers que décrit Ibn Fosslan pour les avoir vus lui-même en 920, tout cela démontre suffisamment, écrit le savant historien, qu'il ne s'agit pas ici de ces tribus slaves auxquelles le nom de Russes n'a été donné que par la suite des temps, mais de tribus scandinaves.» Heyd, Histoire du commerce du Levant au moyen âge. Leipzig. Harrassowitz.
Des traces d'influence scandinave sont encore aujourd'hui reconnaissables chez les Tchérémisses, comme nous l'expliquerons plus loin. Il faut donc agrandir considérablement vers l'est la zone de pénétration des anciens Normands.
[Pg 13]
Les Bulgares vendaient aux Arabes des nattes en écorce de tilleul, industrie encore actuellement répandue dans la vallée du Volga, du miel et de la cire fournis par les Finnois, grands éleveurs d'abeilles, de l'ambre venu des bords de la Baltique par l'intermédiaire des Scandinaves et des Mériens, enfin de l'ivoire de mammouth et des fourrures du Nord apportés par les Permiens. Ce dernier commerce prit une très grande importance après que Zobeïda, femme d'Aroun al-Raschid, eut mis à la mode en Orient les pelisses de zibeline et d'hermine. Il y a dix siècles, comme aujourd'hui, la mode était souveraine. Les Arabes achetaient en outre des peaux de loutres, de castors, de martes et de renards noirs. Ce dernier article était expédié jusqu'en Espagne. En échange de ces pelleteries, les Asiatiques apportaient à Bolgar des pierres précieuses, des perles de verre, des étoffes de soie, des bijoux et probablement aussi des kauris (Cypræa moneta) qui leur venaient des Indes par caravanes. Dès cette époque les Finnois du Volga employaient ce coquillage comme bijoux[4]. Enfin, les habitants de la vallée moyenne du Volga expédiaient du blé dans le nord-ouest de la Russie. En 1229, les Bulgares sauvèrent la Russie sousdalienne d'une famine terrible par leurs envois de céréales.
[4] Dans les tombes des Mériens, le comte Ouvarov a trouvé des kauris.
Le commerce n'attirait pas seul les Arabes sur le Volga; les curieux y venaient aussi pour jouir du spectacle, absolument étrange pour les Orientaux, d'un pays où, durant l'été, une pâle clarté prolonge le crépuscule jusqu'à l'aurore. La longueur du jour en été et sa brièveté en hiver sont mentionnés par[Pg 14] tous les auteurs arabes comme des phénomènes absolument extraordinaires[5]. Suivant la pittoresque expression du savant colonel Yule, Bolgar était pour le monde arabe ce qu'est Hammerfest pour les touristes du XIXe siècle.
[5] Voir la Géographie d'Edrisi, traduite par Jaubert, 1840, et Voyages d'Ibn Batoutah.
Frappé par la haute civilisation des Arabes, Almas, fils de Silkah, roi de Bolgar, envoya à Bagdad en 921 des ambassadeurs chargés de lui amener des savants versés dans l'étude du Coran et des architectes pour élever des mosquées et des forteresses. Le khalife répondit à sa demande en lui envoyant Sohoussen el-Rassi et Akmed ibn Fosslan, celui-là même qui nous a laissé de précieux renseignements sur Bolgar.
Almas se convertit[6] à l'islamisme, ses sujets suivirent son exemple, et jusqu'en 1573 la vallée moyenne du Volga fit partie du monde musulman. C'est la région la plus septentrionale où ait pénétré l'influence arabe. Avec le zèle des néophytes, les Bulgares essayèrent de faire des prosélytes parmi les Slaves, et tentèrent de convertir à leur foi Vladimir, qui devait introduire parmi ses sujets le christianisme byzantin.
[6] D'après la chronique de Kaswing, la conversion des Bulgares à l'islamisme n'aurait eu lieu que dans la première moitié du XIIe siècle; suivant Ibn Fosslan, elle remonterait à 922. Cette dernière date nous paraît la plus vraisemblable. Edrisi, qui vécut dans la première moitié du XIIe siècle, mentionne déjà à cette époque l'existence d'une grande mosquée à Bolgar.
D'après les historiens arabes, Bolgar est restée une bourgade, une sorte de station de nomades[7] jusqu'en 1236, époque à laquelle elle fut prise par les Tatars, conduits par Souboudaï Bagadour. Alors commence[Pg 15] une période tatare dans l'histoire du pays. Elle ne fut pas dépourvue de prospérité, et de cette époque datent peut-être les édifices dont les ruines subsistent aujourd'hui. A cette date les Bulgares semblent être arrivés à un degré de civilisation supérieur à celui auquel étaient parvenus les Russes. Sous la direction des Arabes ils étaient devenus des architectes habiles et les princes de Sousdalie les appelaient dans leurs États pour y construire des palais et des églises. En 1300 Bolgar fut de nouveau prise par les Tatars. Pour punir les habitants d'avoir oublié les préceptes du Coran, les envahisseurs saccagèrent la ville et massacrèrent en partie la population. Ce fut le coup de grâce; désormais Kazan, fondé au milieu du XIIIe siècle par un neveu de Gengis Khan, allait prendre dans la vallée du Volga la place de Bolgar.
[7] Saveljew, Ueber den Handel der Wolgaischen Bulgaren im neunten und zehnten Jahrhundert. Erman's Archiv, VI.
A quelle race appartenaient ces Bulgares? C'est une question très controversée. D'après certains auteurs, les Bulgares seraient des Finnois; une nombreuse population appartenant à cette race ne se trouve-t-elle pas encore dans le pays; suivant d'autres, ils seraient les ancêtres des Slaves. Les crânes découverts à Bolgar présentent une grande analogie avec ceux des tumuli du gouvernement de Moscou datant du VIIIe au Xe siècle et qui sont attribués aux Slaves[8]. M. Chpilevsky voit au contraire dans les Tatars de Kazan et les Tchouvaches les descendants des Bulgares, les uns avec le caractère plus spécialement turc, les autres avec le caractère plus particulièrement finnois[9].
[8] Maliev.
[9] Rambaud, le Congrès de Kazan, in Revue scientifique, 1879. A cet excellent article nous avons fait de nombreux emprunts pour ce résumé historique.
[Pg 16]
Profonde a été l'influence exercée par les Bulgares sur les populations finnoises. Ils leur ont appris l'art de construire des maisons, l'agriculture et l'industrie pastorale. Ils ont été les premiers éducateurs des Tchérémisses.
Si les Bulgares ont aujourd'hui disparu, fondus dans les autres races, en revanche très nombreuses sont restées les populations finnoises dans la région du Volga. Leur effectif peut être évalué à 1 500 000, et sur ce nombre 594 000 appartiennent au gouvernement de Kazan. Ces Finnois sont désignés sous le nom de Finnois du Volga, pour les distinguer de ceux de la Baltique et du groupe permien. On les divise en trois races: les Mordvines, les Tchérémisses et les Tchouvaches, ces derniers plus ou moins métissés suivant les régions.
Sur la rive droite du Volga sont établis les Mordva ou Mordvines, dans les gouvernements de Nijni-Novgorod, Penza, Simbirsk et Saratov. Rittich évalue leur nombre à 791 954, Maïnov à 1 148 800. Ils ont été profondément modifiés par l'influence russe. Au témoignage de Maïnov, pas moins de 300 000 Mordvines ont complètement oublié leur langue maternelle et ne parlent plus aujourd'hui que le russe[10].
[10] Ignatius, les Peuples Finno-Ougriens. Journal de la Société de statistique de Paris, 1886, no 2.
Au nord et au nord-est des Mordvines habitent les Tchérémisses. Leur nombre est également assez difficile à fixer, les évaluations présentent des différences de 70 000. Certains documents évaluent le chiffre de ces Finnois à 329 364[11], d'autres à 259 745[12].
[11] Kalendar Voljskago Viestnika na 1883 god. Kazan, 1888.
[12] Ignatius, loc. cit. Ce chiffre est également adopté par M. Sommier (Note di viaggio, Florence, 1889).
[Pg 17]
A notre avis, leur effectif doit être au moins de 300 000.Cette population est fractionnée en trois groupes d'inégale importance. Sur la rive droite du Volga, autour de Kosmodémiansk et de Tchéboksari, se trouve, à côté des Tchouvaches, un îlot comptant 42 000 individus[13]. Ce sont les Tchérémisses de montagnes, ainsi appelés en raison de la nature élevée de la rive qu'ils habitent, par opposition aux Tchérémisses des prairies, établis sur la rive gauche ordinairement basse. Au nord-est, dans le triangle dessiné par le Volga, la Vétlouga et la Viatka, à cheval sur les gouvernements de Kazan, de Kostroma et de Viatka, se rencontre le groupe le plus compact de ces Finnois. Ils sont là environ 183 000[14]. 5 460 habitent en outre le gouvernement de Nijni-Novgorod. Le troisième groupe tchérémisse se trouve plus à l'est, complètement isolé, dans l'Oural et le gouvernement d'Oufa. Il compte de 50 000 à 70 000 individus.
[13] J.-N. Smirnov, Tchérémissis, Kazan, 1889.
[14] Id. ibid.
La dispersion actuelle des Tchérémisses est le résultat d'un exode de ce peuple vers le nord-est.
La vallée moyenne de l'Oka et la rive droite du Volga jusqu'à la Soura ont été le berceau primitif des Tchérémisses[15]. L'arrondissement de Sousdal (gouvernement de Vladimir) est le territoire le plus occidental où des traces de ces Finnois aient été constatées[16]. Dans le gouvernement de Nijni-Novgorod, de nombreux noms de lieu dont le sens ne peut être expliqué que par la langue tchérémisse témoignent de l'ancienne occupation du pays par ce peuple. Au[Pg 18] XVIe siècle, des Tchérémisses étaient encore établis dans les limites de cette province.
[15] Id. ibid.
[16] Dans le gouvernement de Vladimir se trouvent deux villages portant le nom caractéristique de Tchérémisk.
Sous la poussée des Mordvines, ces Finnois quittèrent les vallées de l'Oka et de la Soura et partirent à la recherche de nouvelles terres. Un groupe, passant le Volga, remonta la Vétlouga, pour se diriger vers la Viatka. Une autre fraction du peuple tchérémisse longea la rive droite du Volga, puis traversa le fleuve et alla s'établir dans le nord du gouvernement actuel de Kazan.
A la fin du XVe siècle, les Tchérémisses avaient atteint la région qu'ils occupent actuellement, laissant sur la rive droite du Volga une arrière-garde, aujourd'hui fortement entamée.
Cette migration s'est effectuée par étapes, et dans chaque étape les émigrants ont séjourné longtemps.
Les traditions des Tchérémisses ont conservé le souvenir de ces déplacements. Les habitants du district de Tsarévokoktchaïsk racontent que leurs ancêtres étaient originaires de la vallée de la Soura, et ceux du district de Kosmodémiansk que leurs pères habitaient jadis à l'ouest de cette rivière dans le gouvernement de Nijni-Novgorod. Très caractéristique est la prière des Tchérémisses du gouvernement de Kostroma dans laquelle ils demandent aux dieux de leur donner autant de blé qu'il y a de sable dans le Volga. Cette invocation remonte sans aucun doute au temps reculé où les ancêtres de la population actuelle habitaient les bords du fleuve[17].
[17] Cet historique des migrations de peuple tchérémisse est résumé d'après l'excellent ouvrage de M. Smirnov, Tchérémissis, que nous aurons souvent l'occasion de citer.
Du noyau tchérémisse refoulé au nord du Volga[Pg 19] se détacha au XVIIe siècle un groupe nombreux envoyé par le gouvernement russe pour coloniser le pays des Bachkirs. Telle a été l'origine de l'îlot tchérémisse du gouvernement d'Oufa.
Dans la vallée du Volga, sur la rive droite du fleuve, à côté des Tchérémisses, habitent les Tchouvaches. Les auteurs ne sont pas d'accord sur la place de cette race dans les classifications ethnologiques; les uns la regardent comme un rameau turc modifié par l'influence finnoise; les autres, comme des Finnois tatarisés. Comme nous le dirons plus loin en détail, autour de Tsevilsk les Tchouvaches ont assez bien conservé le caractère finnois; ceux qui habitent plus au sud ont, au contraire, adopté la civilisation turque. L'effectif de cette race est évalué à 550 000, disséminés dans les gouvernements de Kazan, Simbirsk et Saratov. Le groupe le plus important massé autour de Tsevilsk compte environ 450 000 individus.
En bloc les Finnois du Volga peuvent être évalués actuellement à 1 500 000. A cet effectif, si on ajoute le groupe permien, c'est-à-dire les Votiaks, les Permiaks et les Zyrianes, puis les Caréliens et les Lapons du gouvernement d'Arkhangelsk, enfin les Finnois de Finlande et ceux des provinces Baltiques, on arrive à un total de 4 millions et demi de Finnois établis dans la Russie septentrionale. Au milieu de la grande masse slave, ces différentes races sont aujourd'hui éparses comme des îlots témoins d'un continent disparu, mais aux premiers âges de l'histoire elles formaient un groupe compact et continu de l'Oural à la Baltique.
Au nord, les Tchoudes Zavolotskaïens, les ancêtres des Caréliens actuels, reliaient le groupe permien à celui de Finlande. D'un autre côté, dans le bassin du[Pg 20] haut Volga, les Finnois étaient rattachés à leurs congénères des bords de la Baltique par des peuples aujourd'hui disparus, les Vesses, les Muroniens et les Mériens dont l'origine finnoise a été mise en lumière par les belles recherches des savants russes, notamment du comte Ouvarov. Les Vesses étaient établis autour du Bielozero, dans cette région aux eaux indécises, qui commande l'accès du bassin du Volga et de celui de la Dvina. Les Muroniens, dont le nom s'est conservé jusqu'à nos jours dans celui de la ville de Murom, occupaient la vallée de l'Oka; entre ces deux peuples habitaient les Mériens, les ancêtres des Tchérémisses[18] dans les gouvernements de Iaroslav et de Vladimir, autour du lac de Péréslav et de Rostov; de ce centre ils rayonnaient dans les gouvernements de Moscou, de Tver, de Kostroma, de Nijni-Novgorod, de Riazane et de Toula. Ainsi, toute la Russie septentrionale et une grande partie de la Russie centrale, notamment la région voisine de Moscou, le centre actuel du monde slave, ont été occupées par des races finnoises, à une époque relativement rapprochée[19].
[18] Dans un fort intéressant mémoire (Sur la parenté ou les rapports des Mériens et des Tchérémisses, en russe) M. T. Smirnov démontre l'étroite parenté des deux peuples à l'aide de la philologie, ainsi que l'avait déjà indiqué Castren. Comme les Tchérémisses actuels, les anciens Mériens portaient des vêtements ornés de galons et en guise de bijoux des colliers de monnaie (Ouvarov).
[19] Veské, Slaviano-finskiia koultournyia otnochéniia po dannim yazika, Kazan, 1890.
Dans cette partie de l'Empire des tsars s'est produit un phénomène ethnologique semblable à celui dont l'Allemagne du Nord a été le théâtre. De même que les Slaves, habitants primitifs du Brandebourg et de[Pg 21] la Prusse, ont été absorbés par les Allemands, de même les Finnois d'une partie de la Russie ont disparu sous la pression des Slaves. Longtemps on a pensé que cette substitution d'une race à une autre s'était produite pacifiquement, qu'il y avait eu lente infiltration d'un peuple dans l'autre. L'étude des anciens documents montre, au contraire, que les premiers rapports des Slaves et des Finnois furent loin d'être pacifiques. Entre les envahisseurs et les envahis, les luttes furent très vives. Lorsque les Novgorodiens pénétrèrent dans le pays des Tchoudes Zavolotskaïens, ils rencontrèrent une résistance acharnée des indigènes. En 1078, Gleb Sviatolovitch, prince de Novgorod, fut tué dans une rencontre avec ces Finnois. Le peuple a conservé dans ses légendes le souvenir des combats soutenus par les indigènes contre les envahisseurs[20].
[20] Dans le gouvernement de Vologda, des excavations portent le nom caractéristique de poghibelnitsy (mot à mot: endroit où l'on meurt). Au-dessus de ces trous les Tchoudes élevaient, au moyen de troncs d'arbres, des terre-pleins et du haut de ces forteresses se défendaient énergiquement. La lutte devenait-elle inégale, ils coupaient les pieux qui soutenaient l'édifice et s'ensevelissaient sous les décombres, préférant la mort à l'esclavage, absolument comme des héros de l'antiquité. Annuaire du gouvernement de Vologda. Lieux dits. Livre très intéressant.
Les Mériens résistèrent également aux Novgorodiens. Les noms de localités dont les racines évoquent des idées de guerre et de carnage, très nombreux dans la région occupée jadis par ce peuple, témoignent de ces luttes. Leurs descendants les Tchérémisses, aujourd'hui si paisibles, alliés aux Tatars, ont vigoureusement résisté aux Russes. Après la chute de Kazan ils reconnurent la suprématie de Moscou; mais cette soumission fut de courte durée. En 1572 eut lieu un[Pg 22] premier soulèvement. La répression énergique qui suivit ne découragea pas les Finnois; dix ans, puis vingt ans plus tard, ils se révoltèrent de nouveau. Un demi-siècle seulement après la prise de Kazan, les Tchérémisses acceptèrent définitivement la domination russe. Encore, de temps à autre, des séditions éclatèrent-elles. En 1609 par exemple, ils incendièrent le ville de Tsévilsk[21].
[21] J.-N. Smirnov, loc. cit.
Une fois la résistance des populations finnoises brisée, les colons russes arrivèrent; à leur contact les allogènes se fondirent et perdirent jusqu'au souvenir de leur origine et de leur nationalité.
Deux conditions particulières ont favorisé la colonisation russe en pays finnois. Tout d'abord la nature même de la région. Les peuples qui habitent des plaines résistent moins que les montagnards à l'assimilation. D'autre part, le paysan russe est un merveilleux colon. Il n'a pas grandes prétentions, le brave moujik, il ne se présente pas comme le représentant orgueilleux d'une race supérieure, il n'affiche aucun mépris pour les races inférieures au milieu desquelles il vit. Son état social diffère peu de celui de ses voisins: autant de conditions qui facilitent la fusion. Avec quelle rapidité s'est faite cette fusion, une fois les premières luttes terminées, une légende mordvine en témoigne dans une histoire naïve. Le grand-prince de Sousdal, Georges II, le fondateur de Nijni-Novgorod, descendait le Volga, racontent les Mordvines, lorsqu'il vit sur une montagne de la rive droite les indigènes occupés à sacrifier à leurs dieux. A la vue du cortège princier, les anciens de la peuplade envoyèrent de suite des jeunes gens[Pg 23] offrir au maître de la viande et de la bière. En route, les envoyés mangèrent et burent l'offrande destinée au grand-prince et en place lui présentèrent de la terre et de l'eau. Georges considéra ce présent comme le signe de la soumission des indigènes et continua sa route. Dans les endroits où il jetait une pincée de cette terre, il naissait un bourg russe; là où il en jetait une poignée, surgissait une ville. Ainsi, conclut la légende, la terre des Mordvines fut soumise aux Russes[22].
[22] A. Rambaud, d'après M. Melnikov, loc. cit., in Revue scientifique, 17 mai 1879.
La fusion des deux races slave et finnoise a marqué les Russes d'une empreinte profonde, indélébile, à la fois physique et morale. Les Scythes, les ancêtres des Slaves, d'après le professeur Bogdanov, avaient le crâne allongé. A mesure que l'on approche de l'époque actuelle, cette forme se modifie, et aujourd'hui les crânes courts dominent parmi les Russes. D'après M. Sommier, le savant voyageur italien, dont les travaux sur l'ethnologie de la Russie font autorité, cette modification ostéologique provient en partie de l'union des Slaves aux Finnois[23].
[23] S. Sommier, Un Estate in Siberia. Lœscher, Florence, 1885.
Tous les voyageurs sont d'accord pour reconnaître aux Finnois un entêtement invincible. Quand ils ont dit non, inutile d'insister, on perdrait son temps[24]. Dans l'amalgame des deux races les Slaves ont hérité de cette ténacité dans les entreprises qui fait leur gloire et leur force sur les champs de bataille.
[24] S. Sommier, Note di viaggio. Florence.
A côté des Finnois, les Tatars forment un élément important dans la population du gouvernement de Kazan. Sous le nom de Tatar, les Russes désignent[Pg 24] les différentes tribus de race turque et de religion musulmane établies sur le territoire européen de l'empire. Dans leur bouche, Tatar est synonyme de Mahométan. Actuellement l'effectif de ces croyants dans la Russie d'Europe est d'environ deux millions et demi, un million et demi dans le bassin du Volga et le reste en Crimée.
Les Tatars sont les débris des invasions mongoles restés sur le sol russe. Séparés de leurs vainqueurs par la religion et par l'organisation de la famille, les vaincus ne se sont point fondus avec leurs nouveaux maîtres et dans la formation de la nationalité russe n'ont point constitué un élément aussi important que les Finnois.
Cependant leur influence n'a pas été sans importance sur les Slaves. Sur les populations finnoises du Volga, elle a été beaucoup plus marquée. Dans cette partie de l'Europe s'est produit un phénomène d'assimilation semblable à celui qui se passe aujourd'hui en Afrique, où les Musulmans élèvent les peuplades fétichistes à un état de civilisation relativement supérieur. Les Tatars ont été les premiers éducateurs des populations finnoises.
Les différentes tribus de race turque éparses dans la Russie ont des origines très diverses; aussi pour les reconnaître a-t-on l'habitude de joindre à la dénomination générique de Tatars le nom de la région où ils sont établis. On distingue ainsi les Tatars de Riazane, d'Astrakane, de Kazan, etc.
Les Tatars de Kazan sont des Turcs mélangés d'éléments mongols. On observe surtout des yeux bridés et des pommettes saillantes dans les classes inférieures; les gens aisés ont, au contraire, un type aryen assez marqué, dû à des unions fréquentes avec[Pg 25] des coreligionnaires boukhares[25]. Ces musulmans se donnent le nom de Bourgarliks; dans leur pensée ils seraient les descendants des anciens Bulgares. Ce sont, pour la plupart, des gens intelligents, sobres, honnêtes, économes et de relations sûres. Leur force musculaire est très grande, et sous ce rapport plusieurs portefaix tatars jouissent d'une réputation légendaire. Tous ont les oreilles très écartées de la tête, déformation produite par l'usage de lourds bonnets en peau de mouton.
[25] Sommier, Note di viaggio.
Le gouvernement de Kazan ne renferme pas moins de 638 000 Tatars, la plupart établis dans la partie nord-est de la province. Dans les arrondissements de Mamadyche, Tétiouche et Tsarévokoktchaïsk, ils se trouvent en nombre supérieur aux Russes.
Mieux que toute description, une courte statistique fait ressortir le kaléidoscope des races établies autour de Kazan. A côté des 638 000 Tatars vous rencontrez 850 000 Russes et 594 400 Finnois appartenant à trois tribus distinctes. Ajoutez à cela quelques milliers d'Allemands, de Polonais et de Juifs. Il y a là comme un résumé vivant des principales populations de l'Empire.
[Pg 26]
L'Asie en Europe.—Progrès de l'industrie russe.—Climat de Kazan.—Le faubourg tatar.—Vêtement des Tatars.—Politique des Russes à l'égard des musulmans; ses résultats.
Dix-huit heures après avoir quitté Nijni, le vapeur entre dans une immense plaine. Plaine d'eau à droite, animée par le va-et-vient incessant de vapeurs; plaine de verdure à gauche, brouillée d'une buée de chaleur. Dans cette brume, sur une colline violette lointaine, apparaît Kazan.
En débarquant vous avez une sensation d'Asie. Sur la berge grouille une foule de portefaix tatars, de mendiants déguenillés, de femmes en jupes roses, jaunes ou vertes; un arc-en-ciel humain tremblote devant vos yeux. Foule autour d'échoppes en plein vent garnies de fruits éclatants de coloration, foule autour de véhicules bizarres avec leurs douga multicolores placées comme des diadèmes au-dessus de la tête des chevaux, foule sur les pontons, devant les magasins, autour des cabarets; partout une multitude affairée et gesticulante, avec des bonnets en[Pg 28] peau de mouton, des calottes, des casquettes, des kaftans noirs ou bleus, et des touloupes grises de crasse.

Vous débarquez et aussitôt vingt bras se disputent vos bagages; vous fuyez ces importuns, pour tomber au milieu de mendiants qui tâchent d'émouvoir votre pitié par de profondes révérences et par des signes de croix. C'est un tumulte et un coudoiement auxquels vous n'échappez qu'en sautant en voiture.
Le drojki roule lentement sur une épaisse couche de poussière, tourne un coin de rue, et au bout d'une plaine luisante de flaques d'eau vous apercevez sur une colline un hérissement de clochetons, de tours, de minarets, de coupoles, tout cela blanc et brillant, comme une cristallisation de sucre candi sur un ciel bleu. On a la vision d'une cité d'Orient.
Sept kilomètres séparent Kazan du Volga, sept kilomètres de bouts de ville et de campagne entremêlés de flaques d'eau.
La route suit la Kazanka, gravit un monticule, et nous voici à Kazan, où Mme Vieuille, propriétaire de l'hôtel de France, nous fait le meilleur accueil.
M. Mislavsky, professeur agrégé à la Faculté de médecine, me réserve également la plus cordiale réception; grâce à son inépuisable obligeance et à son amabilité de tous les instants, Kazan est resté un de mes meilleurs souvenirs de voyage. A un autre titre, M. Mislavsky a droit à toute ma reconnaissance. Je ne pouvais songer à mettre à exécution mes projets d'exploration sans le concours d'un Russe, et avant mon arrivée cet excellent ami avait eu la bonté de m'assurer pour le reste du voyage la société d'un jeune étudiant de l'Université, M. Alexis Carlovitch Boyanus. Vigoureux, intelligent, débrouillard, plein[Pg 29] d'entrain, avec cela très bien élevé, Boyanus a été pour moi un agréable compagnon autant qu'un précieux collaborateur, et ce serait injustice de ma part de ne pas rapporter en grande partie à son zèle le succès de l'expédition. Le meilleur éloge que je puisse faire de lui, c'est qu'après avoir voyagé trois mois ensemble nous nous sommes quittés et nous sommes restés bons amis.
Kazan est la ville la plus importante de la Russie orientale, avec une population de 142 000 habitants[26], une industrie prospère de cuirs et de savon, et une université importante.
[26] D'après le recensement de 1886.
Kazan se compose de trois parties, la ville russe, le Kremlin et le faubourg tatar. La principale artère, la Vosskressenskaya, est une large rue bordée de maisons basses; au bout se trouve l'Université, un magnifique établissement scientifique dont les laboratoires spacieux exciteraient l'envie de nos savants. Sous le rapport de la bâtisse administrative, la Russie n'est pas en retard, loin de là. L'Université de Kazan compte des professeurs dont le nom fait autorité dans toute l'Europe, et sous leurs auspices se publie un important périodique[27].
[27] Troudy obchtchestva estestvoïspytatéleï pri imperatorskom Kazanskom ouniversitetié.
Non loin de l'Université est installée, dans un joli bâtiment en bois de style russe, une fort curieuse exposition. Depuis plusieurs années les différentes provinces de la Russie organisent à tour de rôle des expositions régionales du plus haut intérêt. La première impression en parcourant les galeries bien remplies est celle de la puissance et de la vitalité[Pg 30] de l'industrie nationale. Depuis dix ans, les progrès réalisés sont considérables, surtout dans les articles de luxe. Actuellement la Russie peut se suffire à elle-même et bientôt pourra faire concurrence aux autres pays sur les marchés du monde. Le bas prix de la main-d'œuvre lui assure dès aujourd'hui un avantage marqué. Les amateurs de pittoresque regretteront cependant l'abandon du style indigène pour les dessins et les formes occidentales. Les modèles d'orfèvrerie viennent de France; les cuillers à thé russes, si recherchées à Paris, sont ici dédaignées par la mode. Maintenant également plus de ces pittoresques cotonnades si originales de dessin et de couleurs, dont la vue était un plaisir pour les yeux; actuellement les filateurs moscovites ne reproduisent plus que les scènes banales de nos mauvais papiers peints.
J'aurais volontiers passé toute la journée à l'exposition, mais sous ces bâtiments en bois la chaleur était étouffante. Pendant mon séjour à Kazan le thermomètre ne s'éleva pas au-dessus de +27° et la température moyenne ne dépassa pas +20°, la chaleur aurait donc été très supportable, si les maisons avaient offert un peu de fraîcheur. Mais dans ce pays où, l'hiver, la température s'abaisse à -34°, toutes les précautions sont prises contre le froid et non contre le soleil. Les doubles fenêtres de ma chambre étaient fixées aux murs, hermétiquement closes; pour aérer la pièce on ne pouvait ouvrir qu'un petit carreau. Avec cela point de persiennes; par suite la chambre a toujours la température d'une serre chaude. De plus les maisons sont couvertes de feuilles de tôle, qui n'entretiennent pas précisément le frais dans les habitations.
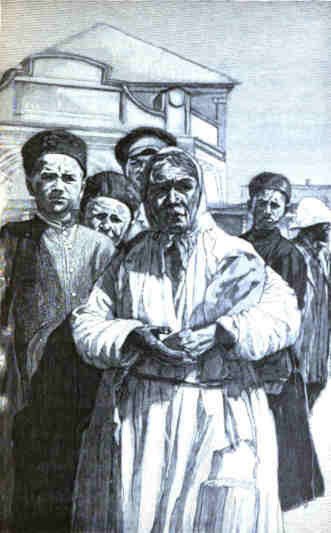
A cette époque, Kazan, comme toute la région du[Pg 32] Volga moyen et inférieur, est une fournaise. Un mois plus tard, le thermomètre s'élevait, à l'ombre, à +37°,6, et à 9 heures du soir marquait encore +30°,2. En juillet 1890, la température moyenne s'est élevée à +24°.
Par de pareils temps le seul endroit agréable est le bain, d'autant qu'en Russie ces établissements sont installés avec un confort inconnu dans nos pays. Vous avez la jouissance de deux pièces, une étuve avec baignoire et appareil à douches et à côté un salon avec des divans. Vous pouvez rester là tout le temps que vous voulez, y habiter même; personne ne viendra vous importuner. Toute la nuit, l'établissement est ouvert et vous y trouvez à boire, à manger et le reste. Les bains sont les cafés de la Russie.
Le principal monument de Kazan est le Kremlin. Le Kremlin n'est point, comme on le croit généralement, le palais des tsars à Moscou; chaque ville importante, comme Nijni, comme Kazan, a son Kremlin, qui est la forteresse de la ville. Place de défense, il est naturellement toujours situé sur la hauteur, et ses remparts renferment tout ce qui doit être mis à l'abri de l'ennemi, les églises, les trésors, les administrations. A Kazan, c'est une ville dans une ville, avec des cathédrales, des monastères et des palais. L'enceinte est formée par un mur en briques, crépi à la chaux, hérissé de tours et de créneaux à la lombarde; par-dessus cette fortification émerge un fouillis de dômes, de clochers, d'édifices pittoresques dominé par un minaret bizarre. On dirait un gigantesque bonnet de magicien posé sur le sol ou une énorme lunette placée à terre par le gros bout. C'est la tour de Soumbeka, remontant, croit-on, à la domination[Pg 33] des khans musulmans. D'après la légende, la princesse tatare Soumbeka se serait précipitée du sommet du minaret au moment de l'entrée des Russes dans Kazan, pour ne pas survivre à la honte de la défaite. Le fait est, paraît-il, inexact; la prétendue héroïne serait morte trois ans avant la prise de la ville, mais, en dépit des historiens, la légende vit toujours dans la mémoire des indigènes. Quelle chose maussade, l'histoire, elle veut effacer tous les actes qui embellissent la vie des peuples.
Du Kremlin et de la ville russe une pente rapide conduit à la ville tatare. Les descendants des anciens maîtres du pays sont aujourd'hui relégués dans un faubourg.
Ici nous sommes en Orient. Dans les rues une foule aux longs vêtements flottants, bariolée de couleurs criardes et partout des enseignes en caractères arabes; les minarets des mosquées complètent l'illusion. Mais c'est un Orient peu pittoresque. Rien que des maisons en briques, sans décoration et sans style. A l'intérieur comme à l'extérieur, les mosquées ne présentent non plus aucun intérêt. Avec leurs grands murs nus, leur haute chaire en bois, très simple, leur grand jour cru, elles ressemblent à des temples protestants.
Au point de vue politique, les Tatars de Kazan sont particulièrement intéressants pour les Français.
A étudier ces musulmans et le régime qui leur est appliqué par le gouvernement impérial il y a pour nous matière à enseignement. Les Russes ont fait une expérience dont nous pourrions profiter pour l'administration de l'Algérie. Depuis que l'opinion publique se préoccupe de l'avenir de notre grande colonie africaine, ni les rapports, ni les beaux discours,[Pg 34] ni les livres n'ont manqué pour éclairer notre jugement. Sur ce sujet tout le monde se croit compétent et chacun a sa recette pour assurer le bonheur de l'Algérie. D'après les uns, on doit encourager la colonisation européenne, dépouiller et refouler l'Arabe; selon les autres, la sécurité de la colonie ne peut être assurée que par l'assimilation des indigènes, et pour arriver à ce résultat n'a-t-on pas proposé de leur accorder le suffrage universel, et un brave sénateur est tout étonné que l'Arabe ne veuille pas de ces droits du citoyen. Un grain de mil ferait mieux son affaire. Ce serait certes un recueil drolatique que celui de toutes les réformes proposées pour donner la prospérité à l'Algérie et pour tenter l'assimilation des Arabes. C'est que tout cela n'est que rêveries de gens ignorant les populations primitives. Nos réformateurs jugent les musulmans avec leurs idées d'hommes civilisés et avec leur cerveau brouillé de théories politiques.
Voyons les Tatars de Kazan.
De ces musulmans les uns sont agriculteurs, les autres commerçants. Les premiers, nous a-t-il paru, cultivent leurs terres aussi bien que les Russes. Ceux de ces Turcs adonnés au commerce sont gens fort industrieux. La plupart des marchands ambulants qui grouillent dans les rues et sur les ports des villes du Volga sont des Tatars. Grâce à leur esprit d'économie, un certain nombre d'entre eux s'élèvent au-dessus de la condition de colporteurs; à Kazan, plusieurs musulmans sont des commerçants notables, possesseurs d'une fort jolie fortune. Par leur travail ces Turcs peuvent monter dans la hiérarchie sociale tout comme les autres races.
D'autre part, ces mahométans comprennent notre[Pg 35] civilisation et se montrent susceptibles de culture intellectuelle. Les fils de quelques riches marchands suivent les cours de l'Université, et tous les préparateurs de cet important établissement scientifique sont des Tatars. Et ces braves gens exercent leurs fonctions avec une intelligence et un zèle auxquels les professeurs russes sont unanimes à rendre hommage.
Le clergé musulman n'est pas non plus réfractaire à nos idées et quelques-uns de ses membres sont des savants. Un mollah a pris part au congrès archéologique de Kazan en 1877 et y a lu un mémoire sur l'histoire de Bolgar et de Kazan. Sous ce rapport, l'anecdote suivante me paraît significative. Accompagné de M. Mislavski, je photographiais un jour autour d'une mosquée, lorsque survint un mollah. On me présente à lui et on lui explique le but scientifique de mon voyage. Le prêtre musulman m'invite alors à venir le lendemain à la mosquée et à prendre une vue de l'intérieur pendant la prière. «Cela intéressera, ajouta-t-il, les Parisiens de voir la manière dont nous prions.» La loi de Mahomet défend aux fidèles de laisser reproduire l'image de leurs traits, et pour cette raison la photographie n'est pas vue par eux d'un bon œil. Le brave mollah, il est vrai, avait tourné la difficulté, car ce ne fut pas précisément la figure qu'exposèrent à l'objectif les croyants en prière. C'était du reste un homme fort intelligent, instruit, et très au courant de l'action de la France dans les pays musulmans.
Chez ces mahométans aucun fanatisme religieux. Ce sont des gens qui professent le mahométisme, absolument comme d'autres sont catholiques ou protestants. Enfin, au contact des Russes, une des principales[Pg 36] barrières qui séparent l'Islam de notre civilisation est tombée. La plupart de ces Tatars sont monogames, et dans la petite colonie musulmane de l'Université les femmes ont la même situation que dans notre société. Ne croyez pas que ces mahométans ont renoncé à la polygamie par économie, même les gens riches n'ont pour la plupart qu'une femme. Un soir, au Jardin d'été, je vis arriver un général donnant le bras à une sémillante petite femme très bien habillée, C'était M. et Mme Schamyl. Le fils de l'adversaire implacable des Russes, de l'Abd-el-Kader du Caucase, est général dans l'armée impériale; après avoir épousé la fille d'un riche négociant tatar, il vit ici paisiblement. Mme Schamyl circule, le visage découvert, coiffée d'une petite capote et est habillée par une couturière française.
A tous ceux qui déclarent les musulmans incapables de comprendre nos idées, à tous les faiseurs de plans d'organisation pour l'Algérie, je conseille un voyage à Kazan. Comme l'a dit très justement le capitaine Binger, dont personne ne peut méconnaître la haute compétence en cette matière, «dans les couvées soumises directement à l'influence des idées européennes, celles-ci affaiblissent considérablement le sentiment religieux, transforment et modernisent l'Islam[28]».
[28] Binger, Islamisme, Esclavage et Christianisme, Société d'Éditions scientifiques. Paris, 1891.
Cette assimilation des musulmans de la Russie orientale s'est faite tout naturellement. Le gouvernement impérial ne s'est point mis en frais d'imagination pour choisir une politique à l'égard des Tatars. Son système consiste simplement à les traiter avec justice.
[Pg 37]

[Pg 38]
Après la conquête et au XVIIIe siècle, un certain nombre de mahométans furent convertis par force au catholicisme grec. Il y a encore une cinquantaine d'années, les fonctionnaires s'efforçaient de faire du prosélytisme parmi les Tatars. La haute autorité de l'empereur a mis fin à ces persécutions. Le résultat obtenu n'était pas du reste très satisfaisant; de l'avis de tous, les Tatars convertis ont une moralité bien inférieure à celle de leurs frères restés musulmans. Aujourd'hui les musulmans ne sont plus inquiétés, ils sont traités par les pouvoirs civils et judiciaires sur le même pied que les Russes, et pour obtenir justice et protection auprès des fonctionnaires, la nationalité tatare n'est point un motif d'infériorité. Mais l'agent le plus actif d'assimilation a été le paysan russe. Le brave moujik ne regarde pas le musulman comme un être inférieur, pour lui ce n'est pas un ennemi, comme l'Arabe pour le colon français; il n'affiche à son égard ni mépris ni convoitise et jamais il n'aurait l'idée de le maltraiter pour le seul plaisir de faire le mal, comme ces Algériens qui ne manquent pas d'envoyer un coup de fouet aux Arabes qu'ils rencontrent dans la campagne. Les Russes appartenant aux classes élevées sont unanimes à rendre hommage aux qualités des Tatars. A leurs yeux ce sont des sujets russes au même titre que les autres, mais seulement professant une religion différente.
Et ne croyez pas cette assimilation superficielle. J'ai entendu un Tatar déplorer l'exécution du major Panitza dans les mêmes termes qu'aurait pu le faire un panslaviste. Les Russes ont su communiquer leurs sentiments politiques à leurs sujets musulmans de Kazan.
Cette assimilation des Tatars a une importance[Pg 39] politique de premier ordre. La Russie orientale ne compte pas moins de trois millions de mahométans, Tatars, Bachkirs, Kirghizes, et ces mahométans sont en relations suivies avec les foyers de fanatisme musulman de l'Asie centrale. Supposez la guerre sainte éclatant dans la Transcaspie, ne pourrait-elle pas avoir son contre-coup jusque sur les bords du Volga, si par une sage politique le gouvernement impérial ne s'était assuré de la fidélité de ses sujets tatars?
[Pg 40]
Aspect de la contrée.—Costumes et architecture tchérémisses.—Traces d'influence scandinave.—Industries.—Mariage.—Art indigène.
Jusqu'ici notre voyage a été une promenade en bateau à vapeur; maintenant nous abandonnons les routes battues pour aller visiter les populations finnoises des environs de Kazan.
Nous commençons par les Tchérémisses, et, le 1er juillet, nous partons pour Parate, village occupé par ces Finnois à 35 verstes de Kazan. Très amusant notre véhicule, une plétionka, le type de voiture le plus répandu dans cette partie de la Russie. Une grande corbeille en osier; point de ressorts ni de sièges; en place une épaisse couche de foin sur laquelle s'étendent les voyageurs.
Au sortir de la ville, un mouvement étrange et coloré de voitures, de cavaliers, de piétons. C'est un va-et-vient de personnages rouges, noirs, blancs, jaunes, en relief sur un ciel bleu vibrant de lumière.

La route court à travers de grandes plaines fertiles[Pg 42] cernées dans le lointain par une raie de collines violettes; paysage à larges horizons dont la vue laisse l'impression vague de la mer. Au-dessus de la nappe jaune des céréales émergent des poteaux rouges surmontés d'images sacrées, emblèmes des saints protecteurs des moissons. Sous l'aveuglante lumière ils brillent comme des miroirs à alouettes et constellent de paillettes lumineuses l'étendue tranquille des blés.
De distance en distance s'ouvre un ravin à moitié rempli d'eau. La voiture dégringole au fond de la crevasse, passe à gué, puis remonte péniblement l'autre versant. Par-dessus ces ravins existent bien des ponts, mais l'été, l'administration les barre, dans une pensée d'économie. En temps d'inondation seulement ils sont livrés à la circulation. Pour le moment, ces passerelles ont cependant une utilité. Au milieu de la plaine brûlée par le soleil elles forment un abri ombreux. En ces journées de juillet, la température devient ici étouffante, une chaleur blanche et sèche.
Après plusieurs heures de route, voici le village de Parate, moitié russe, moitié tchérémisse. Aucune différence extérieure ne distingue les maisons tchérémisses des isbas russes. Toutes sont construites sur le même plan, on dirait une cité ouvrière. Dans la longue rue circulent des êtres étranges tout de blanc vêtus; à la lueur mourante du crépuscule, on croit voir passer des fantômes. Ce sont des Tchérémisses qui rentrent des champs.
A la vue de ces gens, la première impression est celle de l'étonnement, d'un étonnement profond dont la sensation persiste encore au moment où j'écris ces lignes. Depuis le Volga nous avons été préparés par des transitions lentes à l'impression d'Asie que[Pg 43] nous a laissée Kazan, mais ici le saut est si brusque, si profond que nous en sommes abasourdis. D'un des centres les plus importants de l'Empire, nous sommes tombés tout d'un coup au milieu d'une population primitive. Ici nous sommes, semble-t-il, à mille lieues de Kazan, hors de la Russie, hors d'Europe. Costumes, langue, religion, tout chez ces Tchérémisses est différent de chez les Russes. Il y a là deux races juxtaposées, étrangères l'une à l'autre, l'une qui suit le mouvement de la civilisation, l'autre figée dans un passé de plusieurs siècles.
Très simple est le costume des Tchérémisses: pour les hommes, un pantalon et une blouse en toile blanche[29], des souliers en écorce, et en place de bas des morceaux de toile ou de drap. Non moins sommaire est le costume des femmes: un petit caleçon en toile blanche (iolache) que prolongent des jambières également en toile ou en drap noir (chtré), serrées autour des mollets par des cordelettes en écorce, enfin une longue chemise blanche (toghour), fermée sur la poitrine par une fibule en cuivre et serrée à la taille par une ceinture. Ce vêtement très simple devient un des plus pittoresques que l'esprit féminin ait inventés par les ornements curieux dont il est garni. Toutes les blouses des femmes sont chamarrées de broderies et couvertes de colliers, de plastrons, d'écharpes, de pièces de monnaie et de coquillages. Tout cela n'est ni gracieux, ni élégant, mais l'effet est absolument extraordinaire.
[29] Les chemises des hommes sont ornées d'un petit liséré de broderies.
Là malheureusement comme partout ailleurs, la civilisation a amené la décadence de l'art indigène.[Pg 44] Les cotonnades russes pénètrent chez ces Finnois, et sous l'empire d'idées religieuses absurdes, les femmes tchérémisses tendent à abandonner les ornements de leur costume national. Les convertis regardent comme un péché de porter des vêtements brodés[30]. Et ces idées ne trouvent que trop de crédit parmi les indigènes, au grand préjudice du pittoresque. A Parate et dans les environs, les broderies forment un dessin géométrique, une série de denticules serrés, disposé par bandes autour de l'ouverture de la poitrine, sur les manches, et au bas de la robe; elles sont en fil de coton, et de couleur carmin foncé. Les jours de fête, les femmes endossent des chemises à broderies rouges rehaussées de vert. Dans d'autres districts, la soie est employée à la place du coton[31]. Pendant l'hiver, hommes et femmes sont vêtus de longs kaftans tissés par eux. Dans les grandes circonstances, les femmes endossent un manteau de drap noir orné d'un large col rabattu garni de rubans d'argent, de pièces de monnaie et de coquillages.
[30] Smirnov, loc. cit.
[31] Ibid.
A Parate et dans les villages environnants, la coiffure des femmes est une longue serviette étroite, brodée, flottant autour du cou et fixée sur la nuque par un ruban passant sur le sommet de la tête. Cette coiffure, appelée charpane, n'est portée que par les femmes mariées; les jeunes filles vont nu-tête, la chevelure divisée derrière la tête en deux tresses garnies de vieux boutons, de morceaux de cuivre, de coquillages (kauris) et de pièces de monnaie.

Les Tchérémisses ont emprunté le charpane à leurs voisins d'au delà du Volga, les Tchouvaches, aussi ne[Pg 46] l'observe-t-on qu'aux environs de Kazan. Dans la partie ouest du district de Tsarévokoktchaïsk et dans les districts de Vétlouga et de Iaransk, les Finnoises portent une énorme coiffure en écorce de bouleau recouverte d'une serviette brodée, semblable à un shako de caricature. En avançant vers l'est, on rencontre chez les Tchérémisses une autre coiffure, qui a le nom euphonique de chienaschiavouchio suivant M. Sommier, ou de chimachobitch d'après M. Smirnov, réservé, comme le charpane, aux femmes mariées. C'est une longue serviette en forme de bonnet de police, dont une corne se trouve au-dessus du front et dont la partie postérieure descend très bas dans le dos. Les femmes de cette région divisent également leur chevelure en deux tresses, l'une cachée sous la chienaschiavouchio, l'autre entortillée sur le front en forme de corne pour soutenir la pointe du bonnet. Cette coiffure répond à une superstition; dans les clans tchérémisses établis près de l'Oural, les femmes mariées ne doivent laisser voir leur chevelure à aucun homme de leur race[32].
[32] Sommier, Note di viaggio, Florence, 1889.
Le costume des femmes tchérémisses est rehaussé d'ornements formés de pièces de monnaie et de ces jolis coquillages des mers de l'Inde connus sous le nom de kauris ou de porcelaine (Cypræa moneta)[33]. Ces Finnoises portent au cou et sur la tête leur fortune entière, 100, 150 ou 200 francs, quelquefois même plus. Tout l'argent qu'elles parviennent à économiser, elles en garnissent leurs vêtements. Les femmes sont des tirelires ambulantes, et ce n'est que[Pg 47] pressées par la plus extrême nécessité qu'elles se décident à détacher de leurs colliers quelques pièces, les vieilles surtout, qui ont à leurs yeux la valeur de talismans. Il n'est pas rare de trouver sur une Tchérémisse des monnaies très anciennes. Pour un antiquaire, ces femmes offrent l'intérêt d'un cabinet de médailles. C'est du reste le seul qu'elles présentent. Parmi les cinq ou six cents femmes tchérémisses que j'ai vues, pas une n'était jolie, même passable.
[33] Une des écharpes que j'ai acquises est bordée de Cypræa moneta var. icterina, d'après la détermination de M. Dautzenberg.
Autour de la nuque les femmes mariées suspendent au charpane une chaînette de verroterie, chargée de pièces de 20 kopeks (bouïgoltsia). A celle que j'ai achetée, il y avait pour 18 francs de numéraire. Leurs boucles d'oreilles sont également formées de trois pièces de 20 kopeks. En outre, quelques femmes s'accrochent le long des joues des paquets de fil de cuivre ou d'argent recourbés à leur extrémité; leur visage se trouve ainsi armé d'une paire de griffes. Qui s'y frotte s'y pique. D'autres se parent de larges cercles de métal; la quincaillerie est à la mode dans le pays. De plus, celles qui en ont les moyens portent autour du cou des colliers et des plastrons de pièces d'argent. Outre les pièces d'argent, les femmes tchérémisses emploient les kauris (Cypræa moneta) comme ornements[34].
[34] Les kauris sont récoltés dans l'océan Indien, surtout aux Maldives et sur la côte orientale d'Afrique aux environs de Zanzibar, puis de là expédiés principalement aux Indes et sur la côte du golfe de Guinée. Au pied de l'Himalaya les femmes du Sikkim ornent leur costume de ce coquillage. Telle est du reste la demande de cet article qu'en une seule année il a été importé en Angleterre 60 000 kilogrammes de kauris; la majeure partie a été réexpédiée aux nègres du golfe de Benin.
L'usage de mollusques appartenant au genre[Pg 48] Cypræa comme bijou ou comme monnaie remonte à une haute antiquité. Une cyprée a été découverte dans les ruines de Babylone, et dès les temps préhistoriques les Finnois de la Russie orientale ont fait servir ce coquillage à l'ornementation de leurs vêtements. Dans les tumuli des anciens Mériens, le comte Ouvarov a découvert deux kauris.
Les jeunes filles tchérémisses portent des colliers de cyprées, et en grande toilette les femmes mariées se parent de deux larges écharpes entièrement bordées de ces petits coquillages. Les ceintures, les plastrons, les tresses des cheveux, sont également ornés de kauris. Représentez-vous ces chemises blanches, chamarrées de broderies délicatement nuancées, étincelantes de reflets argentins, toutes brillantes de nacre, et vous comprendrez que ce costume si simple devient un des plus curieux que l'ingéniosité féminine ait imaginés.
Dès notre arrivée à Parate, nous nous occupons d'acheter des vêtements et des ornements, mais au début les transactions sont lentes. On se défie de nous. Même ici, près d'une grande ville, les Tchérémisses sont d'une sauvagerie extraordinaire. La venue d'un étranger leur inspire plus d'appréhension qu'au Lapon ou à l'Eskimo du Grönland. Russes et Tchérémisses vivent pourtant en bonne harmonie et entre les deux races des unions se produisent. D'autre part le gouvernement essaie d'élever ces Finnois au niveau des paysans slaves. Des écoles sont ouvertes dans lesquelles l'enseignement est donné en tchérémisse, en même temps la connaissance du russe vulgarisée. Néanmoins un certain nombre d'hommes et la plupart des femmes ignorent cette langue. De longtemps la fusion entre les deux races ne sera pas obtenue.
[Pg 49]
Le paysan russe auquel nous demandons l'hospitalité nous reçoit cordialement. «La France est amie de notre empereur», dit-il à Boyanus, et en amis il nous accueille. Dans ces campagnes n'arrive aucun journal, aucun bruit du monde extérieur, néanmoins par une lente infiltration les sentiments de sympathie pour notre pays ont pénétré jusque dans les masses les plus profondes du peuple russe.

Nous dînons frugalement d'œufs et de fraises, arrosés d'excellent thé, puis nous nous couchons sur le plancher recouvert d'une toile caoutchoutée. Désormais pendant plusieurs mois ce sera notre lit. Au début il semble bien un peu dur, mais après quelques jours d'accoutumance nous y dormirons à poings fermés. En même temps nous mangerons avec nos doigts et nous n'éprouverons plus le besoin de nous laver. Nous aurons perdu toutes les habitudes des gens civilisés; nous serons redevenus des primitifs[Pg 50] comme les Tchérémisses. La civilisation est un vernis très léger, qui s'écaille rapidement.
Le lendemain, visite de plusieurs villages tchérémisses.
Toujours le même paysage: de grandes plaines déchirées de vallons d'érosion. Au printemps, lors de la fonte des neiges, ces ravins sont agrandis par le ruissellement, et l'été chaque orage augmente encore leur largeur aux dépens des champs environnants. Dans cette région, les eaux produisent des effets de dénudation comme dans les Alpes. Maintenant au fond de ces ravins il n'y a plus qu'un maigre ruisseau alimenté par des sources. Souvent leur débit, insuffisant pour donner naissance à un cours d'eau, ne forme que quelques mares boueuses. Nulle part ailleurs on ne trouve d'eau. Pour cette raison tous les villages sont construits sur le bord de ces ravins. Quelques-uns de ces vallons ont une profondeur de 15 à 20 mètres. Sur aucun point de leurs pentes n'apparaît la roche en place.
Nous traversons un village tchérémisse; à quelques kilomètres de là, un second, habité par des Tatars; un peu plus loin, une bourgade russe. Très pittoresque est le village musulman d'Ourasli avec sa petite mosquée en bois perchée sur une colline. Si elle n'était surmontée du croissant, on la prendrait pour une modeste église de nos campagnes. Bientôt après voici une église grecque, et tout près de là un bois sacré où les Finnois viennent faire des sacrifices. Sur un espace de quelques kilomètres vous rencontrez des représentants de trois races et des zélateurs de trois religions différentes, et tout ce monde vit dans la plus parfaite harmonie, païens, musulmans, catholiques grecs. Ces pauvres gens, que l'on traite[Pg 52] de barbares, donnent aux nations civilisées l'exemple de la tolérance religieuse.

A midi, nous arrivons dans un village entièrement habité par des Tchérémisses. Même aspect qu'à Parate, mais ici les constructions sont plus typiques.
Chaque maison renferme deux habitations, une d'hiver et une d'été (kouda). La kouda est une construction spéciale aux Finnois de cette région. C'est un cube surmonté d'un cône. A cette baraque en bois ne se trouvent que deux ouvertures, la porte et, dans le toit, un trou pour laisser passer la fumée du foyer établi entre des pierres au milieu de l'unique pièce de la maison. A l'intérieur, le long des murs, sont établis des bancs et des étagères garnies d'ustensiles de cuisine.
Quelques fermes renferment des spécimens encore plus anciens de l'architecture indigène. Vous voyez dans un coin de l'aire un appareil conique de perches dressées au-dessus d'un trou. Actuellement cette construction sert de séchoir pour les céréales; on allume du feu dans la cavité, et sur les perches on entasse les gerbes. Dans le cours des âges cet édicule a changé de destination, primitivement il servait d'habitation, c'est le premier abri imaginé par les Tchérémisses, comme au reste par toutes les autres tribus finnoises. Examinez les kota des Finlandais, les huttes et les tentes des Lapons, les tchioumes des Ostiaks, toutes dérivent du même type primitif de construction: un cône formé de perches dressées; le revêtement de ces diverses habitations seul diffère suivant les régions et les races. Les Tchérémisses ont appris des Turco-Mongols l'art d'élever des maisons; avant, ils vivaient l'hiver dans des trous surmontés d'un toit couvert de terre.
[Pg 53]
Les Tchérémisses, comme tous les Finnois et les Russes, ont l'habitude de prendre chaque semaine un bain de vapeur, et toute habitation comporte une étuve. Très simple en est l'installation: une méchante baraque en bois, des bancs et un tas de pierres amoncelées au-dessus d'un fourneau. Pour produire la vapeur on fait rougir ces pierres, sur lesquelles on jette de l'eau. Dans ces hammams primitifs, le massage est remplacé par des flagellations avec de petits bouquets de branches de bouleau et des aspersions d'eau froide.

Dans le mobilier tchérémisse signalons un tabouret dont le siège est fait de lanières d'écorce. On le trouve également chez les Tchouvaches et les Zyrianes. A noter également des cuillers en bois ornées sur le manche de figures d'animaux, qui ont au plus haut degré le cachet norvégien. A l'exposition de Kazan, la collection tchérémisse renfermait des sièges formés d'un cylindre en bois, des plats également en bois, avec des têtes d'animaux et des anses relevées, tous objets présentant la plus frappante ressemblance avec les produits de l'industrie scandinave. Les Scandinaves qui fréquentaient les marchés de Bolgar ont laissé des traces évidentes de leur séjour parmi les populations du Volga.
Le village où nous nous trouvons, comme tous ceux que nous avons visités, grouille de marmaille. Les Tchérémisses sont très prolifiques; les familles de neuf enfants ne sont pas rares, et d'autre part la mortalité infantile est moindre parmi eux que chez les Russes. Depuis 1811 la population tchérémisse a[Pg 54] augmenté de 30 pour 100 dans la région au nord de Kazan[35].
[35] Smirnov, loc. cit.
Les Tchérémisses sont un peuple d'agriculteurs. Ils sont en outre grands éleveurs d'abeilles. La cire est employée à la fabrication des bougies nécessaires pour les cérémonies religieuses et une partie du miel à celle d'une boisson fermentée appelée piouré. Une superstition bizarre défend aux Finnois de vendre des essaims[36].
[36] Id., ibid.
Aux produits de l'agriculture, les Tchérémisses ajoutent ceux de la chasse et de la pêche. Ils poursuivent principalement les palmipèdes, le lièvre et l'écureuil, dont ils vendent la peau aux Tatars. Lors de notre voyage (1890), la dépouille de ce petit ruminant valait 20 kopeks, soit environ 60 centimes. Les Finnois du Volga emploient aujourd'hui le fusil; au commencement du siècle, un grand nombre se servaient encore d'arcs et de flèches. Dans un village tchérémisse, M. Smirnov a acquis une flèche terminée par une gibbosité dans laquelle était fixée, suppose-t-il, une pointe en pierre[37].
[37] Sans doute une flèche destinée à la chasse des animaux à fourrure et arrondie pour ne pas endommager les peaux, comme en emploient les Ostiaks.
Très curieuse est leur embarcation. Un simple tronc d'arbre creusé dont les bords sont exhaussés par deux planches. Les pirogues des Indiens ne sont pas plus primitives.
Le lendemain nous quittons définitivement Parate pour aller visiter un village païen situé très loin dans la campagne, à l'écart des chemins battus.
[Pg 55]

A notre arrivée, tout le monde est en liesse, un mariage va être célébré prochainement, le fiancé est venu rendre visite à sa future épouse et pour fêter cet heureux événement bon nombre de gens ont bu plus que de raison, le fiancé tout le premier. L'eau-de-vie joue un rôle très important dans la conclusion des mariages et c'est par des libations que la jeune fille marque son consentement à l'union projetée. Dans l'arrondissement de Vétlouga, raconte M. Smirnov, lorsqu'un jeune homme a fait choix d'une femme, il se rend à son domicile accompagné d'un compère, le svatoune (littéralement: épouseur, marieur), chargé de débattre les conditions de l'hymen. Tous deux sont munis de bouteilles. «Nous sommes venus faire boire la fille», disent-ils aux parents en entrant dans leur maison; en même temps le jeune homme présente à la jeune fille une bouteille de vodka (eau-de-vie de grain). Consent-elle à l'union, elle accepte la bouteille et en offre immédiatement une rasade au jeune homme. Celui-ci lui présente à son tour un verre, et une fois qu'elle a bu, la jeune fille régale ses parents et le svatoune. C'est maintenant à ce dernier de parler,[Pg 56] mais, avant d'entamer la discussion des questions d'intérêt, nouvelles libations. Quand tout est conclu, la fiancée reconduit son futur époux dans la cour en lui offrant de nouveau à boire, juste à ce moment de la cérémonie nous arrivons. La fiancée accompagne toute souriante le jeune homme à sa pletionka; évidemment c'est un mariage d'inclination, le futur est complètement ivre.
Dans cette région, depuis un siècle tous les indigènes sont monogames. Actuellement, seuls les Tchérémisses des arrondissements de Krasnoufimsk (gouvernement de Perm) et de Birsk (gouvernement d'Oufa) possèdent des harems, encore la plupart n'ont-ils que deux femmes. A ces deux femmes et aux enfants qui en sont issus la coutume reconnaît des droits égaux.
Chez les Tchérémisses, le mariage était encore opéré au XVIIIe siècle par le rapt. Aujourd'hui cette coutume barbare n'est plus pratiquée que par les Tchérémisses orientaux, qui, moins soumis à l'influence slave, ont mieux conservé les anciens usages. Généralement il y a accord préalable entre le ravisseur et la jeune fille; parfois cependant se produisent de véritables rapts accompagnés de violence et suivis de tentatives de suicide de la part de la jeune fille violentée.
Sous l'influence musulmane, cette pratique sauvage a été remplacée presque partout par l'achat de la jeune fille. Le futur époux achète sa fiancée, comme il achèterait une tête de bétail. Ici le prix d'une femme, le kalim, varie de 5 à 100 roubles, quelquefois moins: des filles pauvres sont cédées par leurs parents pour quelques bouteilles d'eau-de-vie. Que la future soit jolie ou laide, qu'elle ait ou non toutes les qualités d'une bonne maîtresse[Pg 57] de maison, peu importe pour la fixation du kalim. Tout dépend de la fortune du futur et des conditions qu'il pose pour la dot. Est-il riche et peu exigeant, d'autre part les parents désirent-ils se débarrasser de leur fille, le kalim sera naturellement de faible valeur.
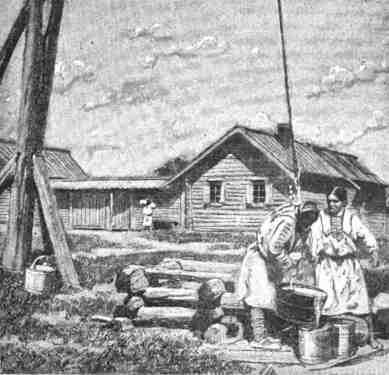
Actuellement la vente de la fiancée n'est plus qu'un symbole exprimant le consentement des parties, et le kalim est rendu au futur sous forme de dot. Cette dot consiste en vêtements, ornements, pièces d'argent et quelquefois en animaux domestiques.
[Pg 58]
Chez les Tchérémisses convertis, les mariages sont naturellement célébrés à l'église, mais la cérémonie est toujours suivie de pratiques païennes. Dans l'arrondissement de Kosmodémiansk, au retour de l'église, les époux sont conduits dans la kouda. Là, au bout d'une baguette pointue, on leur offre un gâteau consacré à l'esprit de la maison, et chacun doit en manger un morceau. M. Smirnov, auquel nous empruntons ce renseignement, voit dans cette coutume l'admission de l'épouse au culte des dieux de la maison dans laquelle elle entre. A l'appui de cette explication, il cite un autre usage. Une fois arrivée dans sa nouvelle demeure, l'épouse revêt de suite les vêtements de femme mariée et va puiser de l'eau, accompagnée de toutes les jeunes filles du cortège. Avant de remplir ses seaux, elle lance dans la fontaine trois perles de verre ou une pièce de monnaie, pour bien disposer en sa faveur l'esprit de l'eau, qui pourrait lui jeter quelque maléfice, à elle étrangère.
Les Tchérémisses ont une civilisation primitive qui leur est propre. Dans les arts du dessin, les broderies exécutées par les femmes sont, comme nous l'avons dit plus haut, des chefs-d'œuvre d'ornementation. Ces travaux d'aiguille, aussi chatoyants par l'harmonie des teintes que par la vivacité des couleurs, décèlent de véritables artistes, et les pauvres Finnoises n'emploient jamais de modèles. Ces broderies sont le produit de leur imagination et chaque district a ses dessins particuliers. Les ornements de la chemise servent ainsi en quelque sorte de passeport aux femmes tchérémisses en indiquant leur lieu d'origine. De plus, ces Finnois ont su inventer des instruments de musique, une cithare, une cornemuse et[Pg 59] un tambour. Les accords que les Tchérémisses tirent de ces instruments sont loin d'être harmonieux: ils chantent en majeur et l'accompagnement est en mineur[38]. Une fois les musiciens en train, cela devient un bacchanal épouvantable: aussi chaque fois qu'un orchestre tchérémisse se faisait entendre, fallait-il entraver avec soin les chevaux qui se trouvaient dans la cour.
[38] Sommier, loc. cit.
Après avoir passé toute la journée au milieu des Tchérémisses païens, nous repartons le soir même pour Kazan. Une agréable fraîcheur a succédé à la chaleur étouffante de la journée et c'est plaisir de courir la campagne à la rapide allure des excellents chevaux russes. Doucement bercés par le mouvement de la pletionka, nous nous endormons bientôt pour ne nous réveiller qu'aux portes de Kazan. A ce moment le soleil se lève radieux dans un ciel d'un bleu merveilleusement nuancé. Les dômes, les campaniles multicolores étincellent de lumière, leur masse enveloppée d'une légère gaze de vapeurs matinales semble flotter en l'air; dans le demi-réveil, cette vision semble un rêve.
[Pg 60]
La religion tchérémisse.—Ses dieux.—Prière tchérémisse.—Bois sacrés.—Clergé tchérémisse.—Sacrifices.—Fêtes religieuses.—Rites funéraires.
La région que nous venons de parcourir, située aux portes d'une des plus grandes villes de la Russie, est un des derniers centres de paganisme demeurés en Europe. Aujourd'hui encore la vallée moyenne du Volga renferme pour le moins un million de païens. En dépit des efforts du clergé longtemps appuyés par le pouvoir séculier, la plupart des Tchérémisses sont restés fidèles à la religion de leurs ancêtres. Officiellement ils ont bien été convertis et vous voyez un grand nombre d'entre eux porter autour du cou la croix comme de bons orthodoxes et assister aux exercices du culte, mais cela ne les empêche pas de sacrifier en cachette aux faux dieux. Même chez les convertis persistent les anciennes croyances; dans leurs idées religieuses, les saints du paradis orthodoxe ont simplement pris place à côté des divinités de l'Olympe indigène, et en leur honneur ils font des sacrifices[Pg 61] pareils à ceux qu'ils offraient jadis à leurs divinités. Catholicisme et paganisme se trouvent ainsi intimement mêlés dans les idées des Tchérémisses. Un très grand nombre d'entre eux sont restés païens, et demeurent attachés à leurs antiques croyances. Ces Finnois sont d'ailleurs sceptiques sur les avantages du catholicisme grec. Un Tchérémisse de l'Oural, auquel M. Sommier vantait les pompes de l'église orthodoxe, lui répondit: «Ma foi, je ne tiens pas à changer de religion; avec leurs chants et leurs cierges les Russes n'obtiennent pas davantage de leurs dieux que nous n'en obtenons des nôtres par des sacrifices dans les bois[39]».
[39] Note di viaggio.
Vis-à-vis des étrangers les Tchérémisses sont naturellement très réservés pour tout ce qui concerne leur religion. Ils nous ont cependant conduits dans leurs bois sacrés, mais se sont bornés à de vagues explications sur leurs croyances. Les quelques renseignements que nous avons recueillis nous ont montré le grand intérêt de ce sujet peu connu; et pour compléter le tableau de la vie des Tchérémisses esquissé dans le chapitre précédent, nous avons emprunté à deux ouvrages russes la description des cérémonies religieuses de ces Finnois. Les détails qui suivent sont extraits soit de la belle étude du professeur J.-N. Smirnov[40], à laquelle nous avons fait déjà de nombreux emprunts, soit de la traduction, due au regretté M. Dozon, d'une brochure publiée sur ce sujet par le curé Iakovliev[41].
[40] Le travail de M. Smirnov n'a pas été traduit.
[41] Cérémonies religieuses et coutumes des Tchérémisses, par A. Dozon.—Recueil de textes et de traductions, publié par les professeurs de l'École des langues orientales vivantes à l'occasion du VIIIe Congrès international des orientalistes, tenu à Stockholm en 1889, t. II. Paris, 1889.
[Pg 62]
Les Tchérémisses ont passé successivement par les trois phases habituelles du développement des conceptions religieuses: le fétichisme, l'animisme et l'anthropomorphisme.
Le vocable iouma, employé aujourd'hui pour désigner les divinités, signifie au sens propre le ciel. La voûte céleste était donc primitivement l'objet des adorations de ces Finnois, et ce n'est que plus tard, par extension, que ce mot a été appliqué aux divinités. Ce nom plus ou moins modifié est commun à toutes les langues finnoises; ce culte remonte donc vraisemblablement à l'époque lointaine où les différentes tribus finnoises, aujourd'hui éparses, étaient réunies dans la même région au pied de l'Altaï.
De l'adoration des phénomènes naturels et du fétichisme grossier, les Tchérémisses ont passé par une lente évolution à l'animisme. Leurs croyances actuelles conservent des traces du culte primitif. Encore aujourd'hui ils adorent les pierres, les montagnes, les arbres, mais à toutes ces choses inanimées ils supposent un esprit, et c'est à cet esprit qu'ils adressent leurs hommages.
Dans leurs idées, un génie bienfaisant habite les arbres, et un faisceau de branches préserve une maison de tout mauvais sort.
Chez ces Finnois peu de manifestations du culte des animaux. Un seul exemple est cité par M. Smirnov. Dans l'arrondissement de Krasnoufimsk (gouvernement de Perm), pour obtenir la guérison d'un malade, on attache dans la partie la plus haute de la kouda un sac renfermant les débris d'un animal domestique[Pg 63] auquel on adresse des prières. Ce sac devient une relique.
A côté de cet animisme se rencontrent, dans les croyances des Tchérémisses, des traces d'anthropomorphisme. Ils croient le tonnerre et l'éclair des frères inséparables et leur donnent pour compagnon le vent. De plus ils représentent les dieux du froid et du givre sous les traits de vieillards et de vieilles femmes. D'autre part, à leurs divinités ils donnent les titres de mère, de grand-père, leur attribuant en quelque sorte une organisation familiale semblable à la leur. Suivant toute probabilité, les prédications des missionnaires grecs et surtout le culte des icones, qui tient une si large place dans le catholicisme orthodoxe, ont développé l'anthropomorphisme chez ces Finnois.
Les Tchérémisses reconnaissent deux catégories d'esprits: des dieux (iouma) et des génies (keremet).
Vivant dans la dépendance immédiate des éléments, ces Finnois croient les forces brutes de la nature au service d'êtres surnaturels. Le froid, le vent, la pluie, obéissent, croient-ils, à des esprits, et de ces êtres surnaturels dépend leur bien-être. A titre d'exemple, voici quelques-unes de leurs divinités: le grand dieu du jour brillant, le grand dieu du jour «matériel», les grands dieux créateurs du soleil, de la lune et des étoiles, le grand dieu souverain des vents, l'aïeul du givre, les grands souverains de l'eau, de la terre, des récoltes, le grand dieu multiplicateur des abeilles, et l'on pourrait continuer ainsi pendant longtemps. Le Panthéon des Tchérémisses des prairies ne comprend pas moins de 140 divinités. Parmi ces dieux, nous devons signaler le grand dieu du tsar et le créateur[Pg 64] du dieu du tsar. En l'honneur de l'Empereur les Tchérémisses leur adressent des prières et accomplissent des sacrifices.
Ces 140 divinités ne portent pas toutes le titre de dieu (iouma), les unes ont celui de mère (ava), de grand-père et de grand'mère (koubaï, kougozaï), de maître de maison (ia, oza), de souverain (one) et de créateur (pouïrcho).
La hiérarchie entre tous ces dieux n'est pas clairement établie; sur ce point, les Tchérémisses ont des idées très vagues, et, suivant les localités, telle ou telle divinité porte le nom de mère ou de iouma. D'après M. Smirnov, les ioumas seraient supérieurs à tous les autres.
«Les dieux, croient les Tchérémisses, ont à leur disposition les forces qui rendent les hommes heureux ou malheureux, et pour se les rendre favorables les fidèles doivent leur faire des prières et des sacrifices[42].» C'est en somme l'égoïsme érigé en religion. Dans leurs prières, aucune règle de morale; leur seule préoccupation est d'assurer leur bien-être et la sauvegarde de leurs propriétés. Les fonctions qu'ils supposent aux dieux sont à cet égard particulièrement significatives. Une certaine divinité, Kioudourtché-kougou-iouma, donne la pluie, la fertilité et garde les animaux domestiques. Si on néglige de lui faire des sacrifices, elle fait périr le bétail et détruit les moissons par la sécheresse et la grêle. Toulkougou-iouma protège les maisons de l'incendie: de là nécessité de lui faire des offrandes pour se garder du feu. Un dieu qu'il faut également bien traiter est celui des vents; sans cela, gare les récoltes. On pourrait[Pg 65] multiplier les exemples. La prière suivante[43] est à cet égard caractéristique. C'est le «Donnez-nous notre pain quotidien» des Tchérémisses, et lors de chaque cérémonie ils répètent cette longue oraison:
[42] Smirnov, loc. cit.
[43] Dans cette prière nous avons suivi presque en tous points la version de M. Dozon, nous bornant à quelques modifications de détail d'après la leçon donnée par M. Smirnov. Les nombreuses répétitions contenues dans cette oraison sont particulières, comme on sait, à la poésie finnoise.
«Au grand dieu nous offrons un pain entier. Nous versons une canette pleine de bière, nous allumons un grand cierge d'argent en l'honneur du grand dieu. Nous demandons au grand dieu: la santé, l'accroissement de la famille et du bétail, une belle récolte, la santé et l'union de la famille. Que le grand dieu entende notre prière et nous accorde la prospérité demandée.
«Dans cette espérance, nous envoyons le bétail paître en liberté dans les champs; grand dieu bon! donne au bétail santé et tranquillité. Dieu grand et bon! dispense au bétail nourriture et boisson abondantes.
«Quand nous envoyons le bétail dans les champs, grand dieu! garde-le des vents nuisibles, des ravins profonds, de la boue profonde, du mauvais œil et de la mauvaise langue, des maléfices du sorcier, de tous les ennemis de son repos, des loups, des ours et de tous les animaux de proie.
«Dieu grand et bon! rends prolifique le bétail stérile, rends gras les animaux maigres, rends plantureux les pâturages. Dieu grand et bon! rends-nous heureux en multipliant toute espèce de bétail.
«Quand, à l'époque où commencent les travaux du printemps, nous sortirons dans les champs pour[Pg 66] labourer, et lorsque nous sèmerons, grand dieu! rends larges les racines des grains, solides leurs tiges, et leurs épis pleins comme des boutons d'argent. Grand dieu! donne à ces blés des pluies chaudes, des nuits calmes, préserve-les du froid et des grêles glacées et des ouragans; préserve-les de la sécheresse, grand dieu!»
La prière contient ensuite une longue série d'invocations au dieu pour lui demander une bonne récolte, et abondance en pain, abeilles, miel, gibier et poissons. Après cela, le dieu est supplié d'accorder assez de nourriture, une fois les contributions payées, pour manger avec tous les parents et soixante-dix familles amies. Les fidèles demandent également au dieu de protéger le transport de leurs marchandises contre les brigands tatars et russes et de leur faire rencontrer au bazar des marchands vendant à bon marché et achetant cher.
La fin de la prière est particulièrement poétique:
«Dieu grand et bon! nous implorons de toi l'abondance en abeilles. Rends fortes les ailes des abeilles. Quand elles vont volant par la rosée du matin, fais qu'elles rencontrent des fruits excellents. Lorsque, dans la cour de la maison, nous établirons des ruches, multiplie les abeilles, et accorde-leur abondance de miel. Alors que, marchant dans la forêt, nous suivrons les marques laissées par nos grands-pères et nos arrière-grands-pères (pour découvrir les ruches sauvages), nous grimperons en sautant à la façon du pivert, nous nous laisserons dévaler après avoir recueilli des rayons de miel aussi gros que des miches de pain; donne aux abeilles abondance.
«Dieu grand et bon! quand nous sortirons dans la plaine, là tu as des coqs de bruyère, là tu as des[Pg 67] gelinottes, là tu as toute sorte d'oiseaux, fais-nous-les rencontrer, accorde-nous abondance d'oiseaux. Dieu grand et bon! de même que le soleil brille, que la lune se lève, que la mer, quand le flot a monté, demeure pleine; de même accorde-nous abondance en toute sorte de blés, abondance de famille, abondance de bétail, abondance de monnaie et d'argent, toute espèce d'abondances accorde-nous.
«Aide-nous à rire en gazouillant comme l'hirondelle, en étendant nos jours comme la soie, en jouant à la façon de la forêt (?) en nous réjouissant à la façon des montagnes (?).
«Nous sommes jeunes et la jeunesse est étourdie. Peut-être ce qu'il fallait dire d'abord nous l'avons dit à la fin, et ce qu'il fallait dire en dernier nous l'avons dit d'abord; donne-nous raison et intelligence, politesse, santé, paix.
«Aide-nous à vivre bien, maintiens notre vie dans le bien-être, ajoute beaucoup d'années à notre vie.»
Les bois sont les temples des Tchérémisses. A certaines parties des forêts et à certains bosquets, ils attribuent un caractère sacré, et c'est là qu'ils célèbrent leurs principales cérémonies. Dans ce choix se révèle l'esprit poétique commun à toutes les races finnoises. Une belle futaie n'est-elle pas le plus magnifique des temples? Dans ces bois sacrés, défense de couper un arbre, même une branche, et si quelque chrétien vient à transgresser cette prescription, il court de grands risques.
Lorsqu'un bois sacré a été profané, un sacrifice purificatoire est immédiatement accompli. On apporte dans le sanctuaire une volaille domestique, et on la torture jusqu'à ce que mort s'ensuive. Après l'avoir plumée et fait cuire, on la jette sur le brasier en appelant[Pg 68] sur le coupable la malédiction divine: «Découvre celui qui a abattu cet arbre, crient les Tchérémisses, et donne-lui la mort comme à cet oiseau».
Au cours de notre excursion nous avons visité deux sanctuaires tchérémisses. L'un était une belle futaie de tilleuls et de chênes, perchée sur une colline au-dessus d'un vallon plein de fraîcheur. Un poète n'eût pas mieux choisi, dans ces campagnes brûlées, une retraite pour y rêver. Sur la lisière du bois était planté un poteau surmonté d'une image orthodoxe protectrice des récoltes. A côté s'ouvrait au milieu de la futaie un étroit sentier à moitié embroussaillé. Nous nous y engageons; à peine avons-nous fait quelques pas que voici le sol couvert d'ossements d'animaux domestiques, notamment de crânes de moutons et de veaux. Aux arbres du sentier sont suspendues des boîtes en écorce de bouleau et de tilleul renfermant des ossements. Un jeune chêne porte la dépouille d'un lièvre, offrande de quelque chasseur. Cette allée d'ex-voto conduit à une clairière qui forme le sanctuaire. Devant un chêne à moitié mort se trouve un foyer sur lequel on a fait récemment brûler les os d'un animal; la tête est encore intacte. Au tronc de l'arbre sont fixés deux petits cierges, et à toutes les branches voisines sont accrochées des offrandes comme sur les bords du sentier. Un peu plus loin se trouve une seconde clairière, pareille à la première.
Le second lieu sacré que j'ai visité était un bouquet de tilleuls et de sapins, isolé dans les champs, à quelques centaines de mètres d'un village. Au milieu était disposé un foyer surmonté d'une traverse pour supporter les marmites destinées au repas sacré.
De même que dans la plupart des religions il existe[Pg 69] des temples et des oratoires particuliers, pareillement les Tchérémisses ont des bois où ils accomplissent les sacrifices publics, et d'autres réservés à l'usage des familles.
Quand un Tchérémisse se marie, il plante dans la forêt plusieurs arbres qu'il consacre à différents dieux. Ainsi se forment les bosquets particuliers.
Il y a d'autre part une seconde division à signaler dans ces lieux sacrés. Les uns sont consacrés aux dieux, les autres aux esprits (keremet). Aux yeux des indigènes ce serait un sacrilège d'invoquer les keremet et même de prononcer leurs noms dans un bois réservé à l'adoration des ioumas.
La plupart des voyageurs donnent à ces sanctuaires le nom de keremet, confondant ainsi le temple avec le dieu. Cette expression est du reste comprise des indigènes dans ce sens. D'après Iakoliev, les Tchérémisses les appelleraient jumo oto (bosquet divin) et, suivant M. Smirnov, kiouçote.
Les kiouçotes ne sont pas réservés spécialement à tel ou tel dieu, on y célèbre des cérémonies en l'honneur de toutes les divinités indistinctement. Mais généralement quelques arbres sont consacrés à certains dieux. Les différentes cérémonies religieuses, prières et sacrifices, sont accomplies sous la direction de vieillards (karte) qui ont en quelque sorte, dans la société tchérémisse, le caractère de prêtres. Ils récitent les prières, invoquent les dieux et président les sacrifices; ils ont des aides appelés ousso, chargés de tuer les animaux. Pour chaque fête et pour chaque dieu, la population élit un karte particulier.
Le vendredi est le jour consacré au culte par ces Finnois.
Dans la religion tchérémisse comme dans toutes[Pg 70] celles qui ne relèvent pas du rationalisme, l'offrande, croient les fidèles, est le plus sûr moyen de gagner la protection des dieux, et pour obtenir l'accomplissement de leurs vœux, les Finnois accomplissent des sacrifices en l'honneur des divinités. Naturellement l'offrande est en rapport avec l'importance du désir dont on sollicite la réalisation, et la place occupée par le dieu dans la hiérarchie divine. Ainsi aux ioumas on offre un cheval, au pouïrcho un bœuf, à la mère du iouma une vache, le skatché scoukché doit se contenter d'un canard ou d'une oie. Pour que le sacrifice ait l'effet voulu, il est nécessaire que le dieu auquel il est offert manifeste auparavant son acceptation, et afin de préjuger les intentions divines, les fidèles procèdent à deux épreuves. Si du plomb en fusion, en tombant, dessine grossièrement la silhouette de l'animal que l'on a l'intention d'abattre, c'est que le sacrifice est agréable. Dans le bois, avant de tuer la victime, on l'asperge d'eau en prononçant la prière suivante: «Grand dieu! secoue l'animal qui t'est offert, regarde-le et accepte-le maintenant qu'il est purifié de toute impureté». Si la bête se trémousse au contact de l'eau versée sur elle, le sacrifice est agréé par les dieux. Demeure-t-elle impassible, on recommence l'opération; si pendant cinq ou six aspersions, l'animal est toujours resté immobile, on va en chercher une autre. Le noir est, croient les indigènes, désagréable aux dieux et jamais on ne sacrifie un animal de cette couleur. Les Tchérémisses du gouvernement d'Oufa augurent de la direction de la fumée du brasier allumé pour la cérémonie si l'offrande est agréable. La fumée monte-t-elle droit vers le ciel, le dieu accepte le sacrifice; il le refuse si, au contraire, elle se répand au-dessus du sol.
[Pg 71]

[Pg 72]
La cérémonie religieuse consiste en un repas sacré. L'animal est abattu par l'ousso, puis cuit et mangé par les assistants. En l'honneur du dieu on fait simplement brûler quelques petits morceaux de chair et les os. Jadis les Tchérémisses offraient l'animal entier à la divinité, maintenant ils sont devenus plus économes. Au lieu de faire la dépense d'une tête de bétail, les fidèles se contentent souvent d'apporter au dieu quelques morceaux du bœuf ou de la vache abattu pour la consommation. Dans quelques districts même le sacrifice a lieu simplement en effigie. En place d'un cheval ou d'une vache, les Tchérémisses offrent à leurs divinités des gâteaux ayant la forme de ces animaux. Durant l'agape sacrée, les fidèles boivent de l'hydromel, de la bière et de l'eau-de-vie, et la cérémonie religieuse devient bientôt une beuverie répugnante.
Le récit d'un savant russe, M. Kouznetzov, qui a pu assister à une fête célébrée en l'honneur des ancêtres, n'est guère édifiant: «Sur une natte d'écorce, étendue par terre à côté du bûcher, écrit-il, se trouvait une auge remplie d'énormes quartiers de viande de cheval bouillie, à côté étaient déposés un sac de sel et deux ou trois grands pains. Aussitôt arrivés, les Tchérémisses puisaient à pleines mains des morceaux de viande qu'ils avalaient en quelques minutes. L'appétit des indigènes était pantagruélique; les quartiers de cheval et les pains disparaissaient rapidement et en même temps les fidèles lampaient sans arrêter. Aussi lors de pareilles fêtes plusieurs assistants tombent-ils malades et souvent vont rejoindre dans l'autre monde ceux dont ils célébraient la commémoration par ce festin.»
Plusieurs explications de ces sacrifices ont été proposées.[Pg 73] D'après certains auteurs, les Tchérémisses croient que les dieux mènent dans un autre monde la même existence que les hommes ici-bas et par suite qu'ils ont besoin d'animaux domestiques. En tuant un cheval ou une vache, l'âme qu'ils supposent à cette bête rendra aux divinités les mêmes services que l'animal sur cette terre. D'après d'autres auteurs, ces sacrifices sont accomplis pour assurer l'alimentation des divinités. Les dieux, tout comme les hommes, ont besoin de nourriture, et les Tchérémisses se croient obligés de subvenir à leurs besoins. Chaque fois qu'ils prennent un repas dans les champs ou à la maison, ils jettent à terre un morceau pour les dieux. Mais à ces êtres surnaturels l'arome des mets suffit pour satisfaire leur appétit; dans les sacrifices importants, les fidèles mangent donc la chair de l'animal. Les Finnois ont une casuistique digne d'un peuple très élevé en civilisation.
Les hommes supposent toujours aux dieux leurs défauts, et quoique les Tchérémisses m'aient paru honnêtes, ils n'ont pas une très grande confiance dans la loyauté de leurs divinités. Aussi, de crainte qu'après un sacrifice les ioumas ne soient pas satisfaits et redemandent de nouvelles victimes, le karte s'écrie en s'adressant aux dieux: «Ne dites pas maintenant que vous avez bu et mangé sans savoir qui vous l'offrait». A cet effet on suspend à un arbre du bois sacré une image en plomb représentant l'animal sacrifié, destinée à attester que la divinité avait manifesté à l'avance son acceptation. C'est la quittance du sacrifice. Si après cela le dieu tourmente le fidèle pour obtenir une nouvelle offrande, il n'a point à se préoccuper de cette demande. Il est en règle vis-à-vis de lui.
[Pg 74]
Les cérémonies religieuses des Tchérémisses sont publiques ou privées. Les solennités publiques sont organisées par la commune entière et tous les habitants y participent. Lorsque des calamités ravagent le pays, des cérémonies extraordinaires sont célébrées pour apaiser les dieux.
«En pareille circonstance, écrit M. Dozon, on cherche parmi les vieillards quelqu'un qui aurait eu en songe une révélation. Après avoir convoqué les autres vieillards de sa commune, il leur fait savoir que, d'après un avertissement reçu en rêve, les Tchérémisses, pour mettre fin à la calamité qui les afflige, doivent s'assembler et offrir à tels et tels dieux telles et telles victimes. Les anciens, obéissant à cette manifestation divine, supputent la dépense nécessaire, en répartissent le montant par villages et par maisons, fixent le jour de la solennité et y convoquent les habitants.»
Les fêtes communales sont: celle du printemps, l'aga-païrem, le çurem, la fête des récoltes, celle de l'esprit de la terre et celle des morts. Ces cérémonies sont l'occasion de réunions populaires, très nombreuses. A ces solennités parfois assistent 6 ou 7 000 Tchérémisses venus de tous les environs. Le nombre des animaux sacrifiés est naturellement en rapport avec le nombre des fidèles. En 1879, rapporte M. Smirnov, lors d'une fête, pas moins de 300 têtes de bétail ont été abattues.
La fête du printemps (kugeçy, d'après Iakoliev; Chochoum-païrem, d'après M. Smirnov) se célèbre dans les maisons vers la Pâques grecque et dure deux jours. Deux kartes et le maître de maison jettent dans le poêle des gâteaux et de la bière, après avoir dit une prière. Une nouvelle oraison est ensuite récitée,[Pg 75] après quoi les trois compères vident un pot de bière et avalent un morceau de crêpe.
Ils invoquent ensuite toute la série des dieux, en recommençant chaque fois les mêmes rites; jugez si, après ces libations, prêtres et fidèles ne doivent pas être plus qu'émus, et on n'est encore qu'au début de la fête. Les prières terminées, les kartes bénissent le maître et la maîtresse de maison, en prononçant les paroles suivantes: «Puisse le grand dieu bon, le grand dieu de la Pâques, le grand destinateur du sort, nous accorder nombreuse famille, santé, paix, accroissement du bétail, et abondance de toute sorte; que la mère de l'abondance, la mère des récoltes, du blé, vous apporte l'abondance d'au delà du Volga, d'au delà des montagnes, d'au delà de la mer; soyez riches, ayez neuf fils et sept filles, que votre bétail se multiplie, que votre maison soit riche, ayez beaucoup de bâtiments, que le dieu vous comble de toute espèce d'abondance! Vivez de nombreuses années, demeurez en vie jusqu'à ce que vos cheveux blanchissent et vos barbes soient grises!»
Après cette bénédiction, le maître et la maîtresse de maison boivent un nouveau pot de bière, et tous les assistants les imitent. Cette libation générale est suivie d'une seconde, puis les kartes prononcent une dernière oraison. Toute l'assemblée se transporte ensuite dans une autre maison où la même cérémonie recommence. Cette solennité bachique se continue dans une douzaine d'habitations, et l'ivresse est générale.
Le lendemain a lieu un repas composé de viande de cheval, le mets le plus apprécié des Tchérémisses; après cela suivent des divertissements avec musique et danse. Les assistants se partagent en couples en[Pg 76] ayant soin que jamais un mari ne soit associé à sa femme, puis chacun successivement marche une sorte de pas en buvant et en jetant de la bière.
La deuxième fête communale est celle de la charrue, l'aga-païrem. Elle est célébrée en l'honneur des dieux dont le concours assure une bonne récolte, tels que les dieux du soleil, de la lune, des étoiles. La cérémonie a lieu dans les champs et consiste comme les autres en ripailles. Tous les fidèles réunis, on fiche en terre des pieux auxquels on suspend des lanternes allumées, puis on met le feu à un bûcher. D'après Iakoliev, la cérémonie de l'aga-païrem se compose des mêmes rites que celles décrites plus haut. Les prières achevées, les vieillards et les kartes s'assoient sur un banc que l'on dresse pour la circonstance, et sur un second vis-à-vis du premier les femmes des prêtres. «Les hommes apportent aux kartes un pot de bière, et déposent devant chacun d'eux un œuf, une crêpe, un pâté et un échaudé; les femmes offrent les mêmes victuailles aux femmes des kartes.»
A cette occasion, dans le district de Tsarévokoktchaïsk, les femmes mariées depuis le dernier aga-païrem sont bénies par les kartes. Au plus âgé de ces vieillards elles offrent chacune un broc de bière et deux œufs. Après que le bonhomme a appelé sur elles la protection des dieux, celui-ci leur remet à son tour des œufs, qu'elles mettent sur leur sein, sans doute comme symbole de la fécondité. Tout le monde retourne ensuite en cortège au village, et s'en va de maison en maison. A la porte de chaque habitation la procession est reçue par le chef de famille, ce dernier offre au karte différentes victuailles, puis le prêtre bénit le maître de la maison; après cela, nouvelle collation, et l'on continue ainsi de[Pg 77] maison en maison, jusqu'à ce que tous les fidèles soient ivres morts. La fête dure cinq jours, et pendant tout ce temps la bombance est générale.
Par le récit de toutes ces libations on comprend que les Tchérémisses se montrent réfractaires à la religion grecque, dont une des principales règles est l'abstinence.
Durant ces festins, les jeunes garçons jouent sur les aires avec des œufs rouges; ce jeu, pensent-ils, a la vertu de faire croître les grains de blé et de les rendre pleins comme des œufs.
Une troisième fête est célébrée en automne pour remercier les dieux de la récolte et invoquer leur secours à la chasse.
Un peu plus tard, en octobre ou novembre, chaque village sacrifie un bœuf à l'esprit de la terre afin qu'il accorde l'abondance l'année suivante.
D'après Iakoliev, les Tchérémisses célèbrent du 21 au 25 décembre une fête pour demander aux dieux la multiplication du bétail. Les indigènes forment sur l'aire de petits monticules de neige qui sont censés représenter des monceaux de blé, puis sur la table de leur maison des tas de pièces d'un kopek pour figurer une fortune considérable. Après cela les enfants vont secouer les pommiers couverts de neige en criant qu'il tombe une quantité de fruits, puis pénètrent dans la bergerie. «Puissent les brebis mettre bas deux agneaux et se multiplier!» disent-ils en touchant le sabot de chaque brebis, et ces paroles, croient les Tchérémisses, assurent la multiplication du bétail.
Au repas de famille on sert de petits pâtés de viande dans lesquels ont été introduits des kopeks et des licols minuscules. Un pâté avec une pièce de[Pg 78] monnaie présage la fortune, et l'assistant qui a un gâteau avec un licol pense être assuré d'une grande richesse en bétail.
Après une des fêtes de l'été a lieu la cérémonie de l'expulsion du chaïtan (diable), le sourem. Les indigènes frappent à coups de bâton les murs de l'habitation, pour en expulser le mauvais génie. Une fois le diable sorti de la maison, ils allument de grands feux par-dessus lesquels ils sautent pour débarrasser leurs vêtements du mauvais esprit. Afin de faire sortir le chaïtan de terre ils enfoncent des couteaux en terre. Dans le district de Tsarévokoktchaïsk les enfants frappent avec des fouets le mobilier de l'habitation. Par ce bruit on espère mettre en fuite les diables et les obliger à se réfugier dans la forêt voisine. Inutile d'ajouter que pour pareille peine les gamins reçoivent des friandises; sans une agape, point de cérémonie au pays des Tchérémisses.
La fête est suivie d'une course de chevaux.
Une cérémonie publique annuelle a lieu pour renouveler les rameaux protecteurs des maisons. Un soir de printemps, tous les hommes du village montent à cheval, vont de maison en maison recueillir les vieux bouquets et partent ensuite les jeter dans les champs. Après quoi ils se dirigent vers la forêt, coupent des branchages et les rapportent au village où a lieu la distribution. Une fois munie de son rameau, chaque maison se trouve désormais à l'abri du mauvais esprit.
Outre ces fêtes périodiques, ont lieu des cérémonies publiques à des intervalles indéterminés. Ce sont des ripailles offertes aux frais du mir[44] en l'honneur[Pg 79] des dieux, des morts, des eaux, du feu, de la terre, et de l'argent.
[44] Commune.
Les cérémonies religieuses privées sont celles relatives au mariage et à la mort des membres de la famille ou celles célébrées pour l'obtention d'un vœu particulier. Ainsi lorsqu'un Tchérémisse voit que son blé a mauvaise apparence, il fait une offrande à une des divinités protectrices de l'agriculture.
C'est également aux keremets que sont offerts la plupart des sacrifices domestiques. Pour obtenir la guérison d'un malade on fait, par exemple, un sacrifice à un de ces esprits. En pareille circonstance, nous a-t-on raconté, on promet au keremet de brûler des fagots en son honneur. C'est une superstition partagée par bien des peuples qui se croient plus élevés en civilisation que les Tchérémisses. «Les keremets, écrit M. Dozon, jouissent d'un crédit égal à celui des dieux et il est assez difficile de reconnaître en quoi leur culte diffère de celui rendu aux dieux.»
Une des principales cérémonies domestiques est le sacrifice annuel fait à l'esprit de la maison. Après les travaux d'automne, on dépose dans le souterrain de l'habitation des aliments en priant l'esprit de rendre la maison heureuse.
A la même époque, le jour où l'on mange les premiers pains faits avec de la farine nouvelle, pour remercier le soleil d'avoir mûri la récolte, le chef de famille procède à une petite cérémonie. Il s'en va dans la cour et, se tournant vers le soleil, élève au-dessus de la tête un plat rempli de pain.
Avant le mariage a lieu un petit sacrifice; une fois les parties d'accord relativement au kalim, elles jettent quelques-uns des gâteaux apportés par le fiancé dans un feu allumé à cet effet.
[Pg 80]
Les funérailles et le culte des morts sont également l'occasion de cérémonies bachiques.
Le cadavre, préalablement lavé et revêtu d'habits propres, est déposé dans une bière percée d'une petite ouverture, sans doute pour que l'esprit du mort puisse respirer. Sur des tombes de Lapons russes nous avons également observé une petite fenêtre analogue à celle ménagée dans la bière tchérémisse[45]. Pour ces primitifs la tombe est une demeure. Dans le cercueil on dépose des morceaux de toile, de petites bougies en cire, une écuelle dans laquelle on place quelques morceaux de crêpe et dans laquelle on verse de l'eau-de-vie, en prononçant les paroles suivantes: «Que cette crêpe arrive jusqu'à toi, ne pars pas sans boire ni manger, toi qui as faim».
[45] Si le corps n'est pas enfermé dans une bière, la tombe est percée d'une petite fenêtre. (S. Sommier, Note di viaggio.)
Au moment où le cortège quitte la maison mortuaire, une poule est égorgée. Avant de le descendre en terre, on coiffe le mort d'un bonnet, on lui met des gants et on dépose sur sa poitrine trois crêpes et une pièce d'un kopek, en disant: «Que cet argent te serve à acheter la terre». Dans les idées des Tchérémisses le mort doit mener dans un autre monde la même existence qu'ici-bas, croyance fort ancienne que l'on retrouve chez les peuples de l'antiquité. D'après des renseignements donnés à M. Sommier par un Tchérémisse de Kosmodémiansk, cet argent serait destiné à acheter le juge siégeant dans l'autre monde. Les pelles qui ont servi à creuser la tombe et les cordes employées à descendre le cercueil sont abandonnées sur le lieu de sépulture. Si le mort est un enfant, on dépose son berceau sur la tombe.
[Pg 81]
De retour à la maison, tous les assistants se mettent à table. A ce festin un membre de la famille vêtu des défroques du mort représente le défunt. Pendant ce repas et tous ceux qui suivent quarante jours durant, une écuelle contenant une petite portion des aliments servis sera placée en l'honneur de celui que la famille a perdu[46].
[46] Nous retrouverons la même coutume chez les Ostiaks. Voir plus loin, p. 237.
En mémoire du défunt trois autres cérémonies ont lieu le troisième, le septième et le quarantième jour après le décès. Cette dernière est la plus importante. Au coucher du soleil, la famille se rend à la tombe, dépose sur le sol un pain, y répand de l'eau-de-vie et invite le mort à se rendre à la fête préparée en son honneur.
De retour à la maison, les membres du cortège crient à la personne venue au-devant d'eux: «Nous ramenons comme convive un tel, faites-lui bon accueil, invitez-le à entrer dans l'habitation». Immédiatement on appelle le mort en le priant de venir prendre place au festin préparé. Aussitôt les convives à table, le karte allume une chandelle près de l'écuelle du défunt, puis verse des aliments et du liquide dans l'écuelle de celui en l'honneur duquel a lieu la cérémonie, en prononçant les paroles suivantes: «Que ce régal, nourriture et boisson, arrive jusqu'à toi; puisses-tu avoir beaucoup à boire et à manger». Après cela les voisins viennent apporter en l'honneur du défunt différentes victuailles, et chaque fois le karte nomme au mort la personne qui lui fait ce cadeau. Pendant ce temps les musiciens jouent de la cornemuse et de la harpe.
[Pg 82]
Une fois le repas terminé, les convives vont briser dans la cour l'écuelle du défunt. Cela fait, un individu qui en a reçu mandat du mort avant d'expirer, revêt ses habits et reste dehors sur l'escalier pendant que les autres rentrent. Lui donnant alors le nom du mort, on l'invite à venir festoyer. «Après avoir passé la nuit, ajoute-t-on, tu repartiras demain à l'aube.» Une nouvelle agape recommence, pendant laquelle le représentant du défunt est traité comme le défunt lui-même l'était de son vivant. La fête se termine par des danses.
Outre ces rites funéraires, les Tchérémisses ont trois fêtes en l'honneur des morts; toutes trois consistent en ripailles. Les cérémonies mortuaires n'éveillent chez ces Finnois aucune idée triste; leur seule ambition ici-bas est un pain quotidien abondant, et aux morts comme à leurs dieux ils supposent les mêmes désirs et les mêmes besoins. Leur culte est, en un mot, celui de l'estomac.
[Pg 83]
La poussière en Russie.—Architecture tchouvache.—La foire de Tsévilsk.—Costume des Tchouvaches.—Visite à un lieu de sacrifice.—Croyances et superstitions des Tchouvaches.
A quatre heures du matin nous sommes à Kazan. Quelques heures de sommeil et nous voici de nouveau frais et dispos avec le projet de partir le soir même pour le pays des Tchouvaches.
Le principal groupe de ces Finnois est cantonné sur la rive droite du Volga dans les arrondissements de Tsévilsk et de Tchéboksari. En amont de Kazan, sur la rive droite du Volga, derrière une mince ligne de colonies russes, ces Finnois forment un noyau compact de plus de 500 000 individus.
De Kazan à Tchéboksari c'est un petit voyage de 120 verstes par le Volga. A minuit nous sommes au port, mais point de vapeur. Une, deux heures se passent, rien ne vient. En France, les voyageurs pesteraient, interrogeraient les employés et s'emporteraient contre l'administration. Ici tout le monde reste calme et résigné, le Russe a l'habitude d'attendre.[Pg 84] La nuit est magnifique, une de ces nuits d'Orient chaudes et lumineuses avec une grosse lune toute jaune. Devant nous s'ouvre le large fossé noir du fleuve, ponctué de fanaux. On dirait une ville flottante. Pas un souffle de vent, un air mort; de la berge sablonneuse sortent des bouffées de chaleur comme d'un feu souterrain. Parfois au milieu du grand silence un clapotement d'eau amorti, fugitif, comme un demi-réveil après un profond sommeil. On a la sensation du repos de toutes choses après la cuisson de la journée. A trois heures le paquebot arrive et de suite nous embarquons.
Dès dix heures du matin la chaleur est accablante, avec un vent desséchant. A 1 heure de l'après-midi, +32° à l'ombre avec une pression de 749. Pendant notre séjour dans cette région le baromètre est resté très bas; la chaleur n'en était que plus sensible. Dans ma cabine, située à l'ombre et bien ventilée, couché sur le sofa, je sue comme une fontaine.
Dans l'après-midi, arrivée à Tchéboksari (5 000 habitants, tous Russes), sans intérêt, comme toutes les petites villes de Russie. A la maison de poste on nous donne un bouge pour déposer nos bagages; nulle part ici il n'existe d'auberge de campagne, comme dans nos pays de l'Europe occidentale. Quand nous sortons, le patron ferme la porte avec un cadenas et nous en remet la clé. On ne se fie pas à l'honnêteté du voisin. Depuis mon arrivée en Russie, que d'histoires de voleurs ne m'a-t-on point racontées: à croire les indigènes, on serait exposé à chaque instant à être dévalisé; en cela comme en beaucoup de choses il faut faire une part très large à l'exagération slave. La Russie vaut mieux que ne le disent les Russes.
[Pg 85]
Le soir même nous partons en plétionka, conduits par un Tchouvache. Pas brillant notre attelage, deux pauvres biques qui s'en vont trottinant, sans rien de l'allure vive habituelle aux chevaux russes. «Plus vite!» crions-nous à notre cocher tchouvache, et le bonhomme de nous expliquer en mauvais russe que ses chevaux ont déjà fourni une trotte de 85 kilomètres et que pour arriver au gîte il leur reste à parcourir 21 kilomètres. Pour toute nourriture pendant cette longue étape les pauvres bêtes n'ont brouté qu'un peu d'herbe sur les bords de la route. «On n'a faim que lorsqu'on a l'habitude de manger», ajoute philosophiquement notre automédon.
Ici bêtes et gens sont d'une résistance surprenante. Aussi facilement qu'ils absorbent des repas pantagruéliques, les Russes se serrent le ventre. Repus ou à jeun, ils marchent avec une égale endurance. Pendant toute une journée un cavalier galopera; un morceau de pain et quelques verres de thé suffiront à sa nourriture, et sa monture se contentera d'un peu d'herbe. Le cheval russe est le meilleur cheval du monde et le Russe l'Européen le plus endurci à la fatigue et aux privations. Jugez, par suite, de la force de l'armée: c'est le meilleur instrument de guerre existant actuellement.
Aujourd'hui les exploits de nos grands-pères pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire nous sont un sujet d'étonnement. Leurs marches rapides à travers l'Europe, leur résistance à la faim et aux privations de tout genre, donnent l'idée d'une autre virilité que la nôtre. Tout cela nous paraît extraordinaire à nous autres affaiblis par le bien-être. Le peuple russe laisse la même impression. Ce sont des gens d'il y a un siècle, habitués, comme nos grands-pères,[Pg 86] dès leur enfance à tous les efforts de la vie physique.
Toujours le même aspect, des plaines largement ondulées, couvertes de moissons. On passe un boursouflement et de l'autre côté c'est le même spectacle. Pays quelconque, sans caractère, qui pourrait aussi bien se trouver en France qu'en Russie. Seule la poussière est spéciale à cette partie de l'Europe. Sur ces terres très légères, le moindre vent soulève des tourbillons de fines particules. Aujourd'hui le ciel en est gris; lorsque ces nuages tombent, on est aveuglé et suffoqué. En Russie, il existe deux éléments supplémentaires: la poussière et la boue. Qui n'a vu que nos pays ne peut se faire une idée de leur importance dans l'Europe orientale.
Le pays est très habité. Comme les Tchérémisses, les Tchouvaches vivent en de petits hameaux épars au milieu des plaines. Quinze, vingt maisons entourées par des plantations de bouleaux, toujours sur le bord d'un ravin où traîne un ruisseau vaseux. En dehors de ces ruisselets, point d'eau dans la plaine.
Notre étape se termine au village tchouvache d'Abachévo. Dans chacune des bourgades situées en dehors des routes postales, il y a une maison dont le propriétaire a charge de loger les voyageurs. Cette hospitalité est très simple, cependant le logement est beaucoup plus propre que dans les affreux cabarets des petites villes. La maison où nous avons pris gîte se distingue même sous ce rapport; les bancs et la table de la chambre principale ont été lavés et les murs grattés. Notre hôte, du reste, a des habitudes de propreté étonnantes pour un Tchouvache: s'étant noirci les mains avec du charbon, il se lave immédiatement.
[Pg 87]
Très simple l'habitation tchouvache: une maisonnette en bois précédée d'un petit perron couvert d'un toit à deux auvents. Au milieu un couloir ouvrant à gauche sur un magasin à blé, à droite sur la chambre de famille, occupée en grande partie par le poêle russe traditionnel. Devant la maison, une cour rectangulaire bordée de hangars, d'étables, de magasins, et séparée de la rue par une clôture. Derrière chaque habitation s'étend un jardin. C'est en somme la même architecture que chez les Tchérémisses.
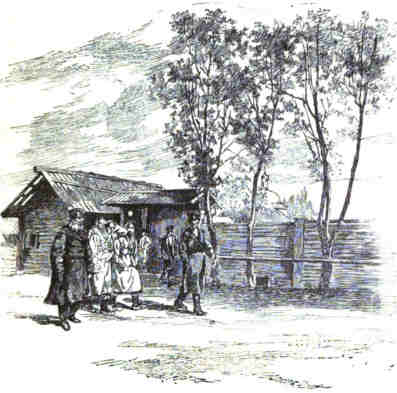
Le lendemain, en route pour Tsévilsk. A quelques kilomètres d'Abachévo, la plaine verse dans un fond[Pg 88] où se trouve Tsévilsk. De loin la ville est signalée par une nuée de poussière produite par le mouvement de la foire. Il y a là 5 à 6 000 Tchouvaches réunis sur un espace de quelques hectares. Chaque matin, des villages environnants arrivent en foule les indigènes; ils s'amusent là toute la journée, et, le soir venu, retournent chez eux pour recommencer le lendemain jusqu'à la fin de la fête. C'est le même spectacle que dans nos pays: des animaux que l'on vend et que l'on achète, des lignes de baraques où l'on débite de la cotonnade, des verroteries, de la ferraille, de l'épicerie, etc., enfin des chevaux de bois.
Autour de l'appareil, foule compacte. Il y a d'abord les gens qui se donnent le luxe de faire un tour sur la mécanique, puis il y a ceux qui, moyennant finance, ont été admis dans l'enceinte d'une palissade au plaisir de contempler les heureux de cette terre montés sur les chevaux de bois, enfin, par derrière, une masse compacte regarde ceux qui voient quelque chose.
Mais bientôt nous faisons concurrence aux saltimbanques. Nous installons les appareils de photographie et invitons les assistants à venir poser. De tous côtés on accourt; pour maintenir l'ordre autour de nous, l'aide de deux agents de police n'est pas de trop.
Comme le montrent les photographies ci-contre, les costumes des Tchouvaches présentent une très grande ressemblance avec ceux des Tchérémisses. Le vêtement des hommes est le même, et celui des femmes ne diffère de ceux que nous avons vus de l'autre côté du Volga que par des détails d'ornementation.
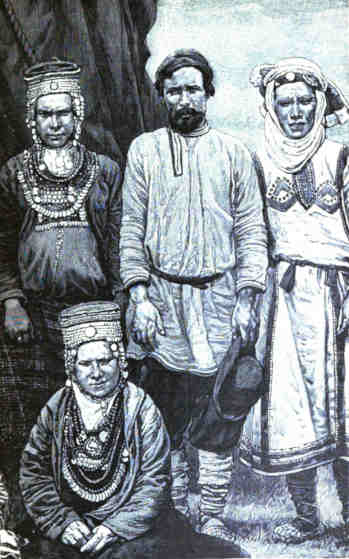
Les femmes tchouvaches ont, comme les Tchérémisses,[Pg 90] un costume masculin, un petit pantalon et une chemise-jupe en toile, généralement blanche, ornée de broderies en soie rouge et de rubans également rouges, du moins aux environs de Tsévilsk[47]. Toutes portent un tablier bordé dans le bas de broderies multicolores. Très curieuse est leur coiffure. Pour les jeunes filles, c'est une toque en cuir, agrémentée de dessins géométriques formés de perles de verre de différentes couleurs avec une garniture de petits disques d'argent simulant d'anciennes monnaies. Une jugulaire chargée de pièces d'argent maintient la coiffure. Les femmes mariées ont la nuque et le cou enveloppés d'une serviette (sorbane) assez semblable au charpane tchérémisse et dont les deux pans tombent dans le dos comme ceux d'une écharpe. Par-dessus, les riches portent un bonnet cylindrique orné de disques d'argent et de pièces de monnaie, auquel est suspendue par derrière une longue bande d'étoffe garnie aussi de pièces d'argent. Sur certaines de ces coiffures il y a pour 300 francs de numéraire, et les femmes aisées en ont bien pour une somme égale autour du cou et sur la poitrine. Toutes ont un collier de pièces d'argent, et, attachée au col de la chemise, une bande d'étoffe garnie de numéraire, enfin sur la poitrine un ou deux plastrons couverts de petits disques ou de vieilles pièces d'argent. Ajoutez à cela d'autres colliers et des pendeloques de kauris ou de perles de verre, ballottant sur la poitrine et dans le dos. Pour terminer la description des toilettes tchouvaches signalons la ceinture des femmes, ornée sur les côtés de[Pg 92] glands en laine rouge, de kauris, et garnie à la chute du dos d'une sorte de croupière. Sur les hanches les élégantes attachent de longs cordonnets chargés de morceaux de cuivre, très bruyants. Lorsque marchent des femmes parées de ces singuliers bijoux, vous croiriez qu'on remue un magasin de vieille ferraille. Jugez de l'aspect pittoresque de la foire avec tous ces costumes bizarres.
[47] Du temps de Pallas, les broderies étaient rouges, bleues ou noires. Aujourd'hui encore les couleurs varient suivant les districts.

Hommes et femmes sont grands et vigoureux. Tous laissent l'impression d'une race vivace. Beaucoup de femmes ont conservé le type finnois bien accusé. Ici du moins les Tchouvaches paraissent s'être peu mêlés aux Tatars. On nous montre cependant dans la foule des métis tchouvaches tatars que l'on appelle ici Metchériaks[48]. Des unions ont lieu également entre ces Finnois et les paysans russes. Dans le voisinage des villes, les Tchouvaches abandonnent leurs costumes pour adopter les vêtements de leurs voisins slaves, les différences extérieures s'effacent ainsi peu à peu entre les races, et lentement Russes et Finnois se fondent ensemble au grand dommage du pittoresque. Le jour de la fusion complète est heureusement encore éloigné.
[48] Les Metchériaks sont une petite tribu turque de la Russie orientale.
Dans la soirée nous quittons Tsévilsk pour aller passer la nuit dans un hameau voisin. L'ispravnik, d'une obligeance parfaite, nous fait accompagner par un agent de police parlant tchouvache. Précaution qui n'est point inutile: parmi les indigènes, l'usage du russe n'est pas encore très répandu, beaucoup d'hommes le comprennent à peine et la plupart des femmes n'en entendent pas un mot.
[Pg 93]

[Pg 94]
Excité par la présence du gendarme, notre cocher enlève ses chevaux et en vingt-cinq minutes nous fait parcourir sept kilomètres. C'est plaisir de galoper à travers ces plaines à la douce fraîcheur du soir. Il semble que vous reveniez à la vie après la prostration de la journée étouffante; cela fait l'effet d'un bain.
Dès notre arrivée au village, s'ouvre un marché très actif. Nous achetons des sorbanes, des chemises de femme, des ceintures, des ornements, des bonnets, bref toute une collection ethnographique. Ces transactions nous permettent de faire connaissance avec les Tchouvaches et nous servent en quelque sorte de préambule pour arriver à la question principale. Aux environs du village se trouve un lieu de sacrifice où les indigènes vont faire leurs dévotions et il s'agit de décider quelque habitant à nous y conduire.
Les Tchouvaches ont été convertis au catholicisme grec. Mais sur eux comme sur les Tchérémisses cette conversion n'a pas produit grand résultat. En fait, le plus grand nombre de ces indigènes sont restés fidèles à leurs anciennes croyances, et sur cette rive du Volga on compte pour le moins encore 500 000 païens.
L'administration civile connaît les pratiques idolâtres des Tchouvaches, mais fort sagement se désintéresse de tout prosélytisme parmi ces païens. Ce serait inutilement exciter des haines et retarder l'assimilation de la population.
La promesse d'un pourboire et les représentations énergiques de l'agent eurent promptement raison des scrupules d'un indigène, et bientôt sous sa conduite nous voici en route pour le sanctuaire. Le[Pg 95] guide nous fait marcher à travers un petit bois, afin de dissimuler notre marche aux Tchouvaches qui travaillent dans la plaine. Évidemment il redoute quelque mauvais traitement si ses coreligionnaires viennent à apprendre notre visite. Le bonhomme retrouve seulement son sang-froid lorsqu'il voit que nous nous bornons à photographier le lieu du sacrifice, sans toucher à quoi que ce soit.
Ce lieu de sacrifice est situé à un kilomètre et demi du village, dans un large et profond ravin parsemé de taillis de chênes[49]. C'est une réunion de cuisines en plein vent. Il y a d'abord un grand échafaudage long de 10 mètres, garni de 29 crochets en bois pour suspendre les marmites; en dessous, on voit les traces encore fraîches de 41 foyers. A côté se trouvent deux autres échafaudages beaucoup moins longs, l'un garni de deux crochets, l'autre d'un seul, sans doute des autels particuliers.
[49] D'après Pallas, les lieux de sacrifice des Tchouvaches seraient toujours situés au milieu de bouquets d'arbres et dans le voisinage d'une source ou d'un ruisseau.
Les femmes, nous a-t-on dit, n'assistent pas aux grands sacrifices, à moins qu'elles ne soient veuves et qu'elles n'aient point de fils âgé pour les représenter à la cérémonie. Si le renseignement est vrai, ce serait un emprunt aux idées musulmanes.
Comme leurs voisins tchérémisses, les Tchouvaches sont animistes, leur imagination peuple le monde extérieur d'esprits dont l'homme doit s'assurer le concours pour vivre heureux et dans l'abondance, et le moyen employé pour se concilier la faveur de ces êtres surnaturels est de leur faire des sacrifices.
Nous n'avons vu aucune représentation anthropomorphe[Pg 96] de ces divinités et nous ignorons s'il en existe. Au congrès archéologique de Kazan en 1878 fut présentée une idole tchouvache, «une simple planchette de bois, grossièrement taillée à la hache, sans aucune trace de dessin». C'était la représentation du dieu Melym-Khousia, adoré aux environs de Tchéboksari. Melym-Khousia habitait jadis chez les Tchérémisses sur la «montagne qui produit du miel», raconte M. A. Rambaud[50]. Un beau jour il quitta sa demeure pour aller s'établir sur la rive droite du Volga, au village de Masslovoya, chez un Tchouvache ancien soldat, nommé Ivan. En homme avisé, Ivan tira un fructueux parti de l'honneur que lui faisait le dieu. Il lui accorda l'hospitalité, et aussitôt de tous les environs les indigènes vinrent implorer Melym-Khousia. Pour s'assurer son secours, les uns lui offraient de l'argent, les autres de la volaille, toutes offrandes qu'Ivan n'avait garde de laisser perdre, c'était autant de boni pour lui. Quand le zèle des fidèles devenait moins ardent, le rusé compère s'en allait faire des tournées aux environs, menaçant les habitants de la colère de Melym-Khousia, s'ils ne le traitaient pas mieux. Et les Tchouvaches d'accourir et Ivan de faire de bonnes affaires. Le dieu indigène faisait ainsi une concurrence très préjudiciable à un sanctuaire orthodoxe voisin dédié à saint Nicolas. Personne ne venait plus implorer le saint grec, et un beau jour la police avertie vint saisir le dieu tchouvache et le transporta de son sanctuaire au musée ethnographique de Kazan. L'histoire date de la fin de 1870.
[50] Le Congrès de Kazan, in Revue scientifique.

La religion des Tchouvaches comporte des fêtes[Pg 97] publiques[51] et des cérémonies privées; toutes consistent en ripailles. Dans les grandes solennités ou pour obtenir la réalisation d'un désir qui leur tient[Pg 98] au cœur, les indigènes immolent des chevaux et du gros bétail; pour les petits sacrifices ils tuent des volailles, principalement des oies. Jamais ils n'immolent de porcs; à leurs yeux c'est un animal impur. Avant de procéder au sacrifice, raconte Pallas[52], les fidèles soumettent l'animal à plusieurs épreuves pareilles à celles en usage chez les Tchérémisses, pour s'assurer que le dieu accepte l'offrande.
[51] D'après Pallas, en septembre a lieu un sacrifice pour remercier les dieux de la récolte.
[52] Voyages de M. P. S. Pallas en différentes provinces de l'Empire russe et dans l'Asie septentrionale, traduits de l'allemand par M. Gauthier de la Peyrence. Paris, 1789.
Les Tchouvaches mettent en pratique le dicton: charité bien ordonnée commence par soi-même. Ils mangent la chair des victimes sacrifiées et en l'honneur des dieux se contentent de faire brûler les os. Dans les cérémonies publiques la direction du culte, si l'on peut s'exprimer ainsi, et la charge d'immoler les animaux appartiennent à des prêtres appelés iomzi, dont la situation paraît équivalente à celle des kartes chez les Tchérémisses. En tous temps le iomzi jouit d'un certain prestige auprès de ses compatriotes, joignant au sacerdoce les professions de rebouteur et de charlatan.
Les fêtes publiques portent le nom de simik; elles durent généralement plusieurs jours. Un jour les habitants d'un village sacrifient et de tous les environs on vient prendre part à l'agape sacrée, puis le lendemain c'est au tour d'un autre hameau de régaler les hommes en l'honneur des dieux. Les différents villages s'offrent ainsi une série de tournées.
Pendant toute la durée des fêtes, les Tchouvaches ne doivent pas travailler, même en cas d'urgence. Ceux qui transgressent cette défense risquent une correction; il y a quelques années, un indigène aurait[Pg 99] été tué pour n'avoir point respecté cette coutume. Du 24 au 29 juin les indigènes célèbrent une grande fête. Quelque temps auparavant, le jeudi qui précède la Trinité du calendrier russe, a lieu la commémoration des morts. La cérémonie consiste en ripailles et beuveries; ce jour-là, nous disait l'ispravnik de Tsévilsk, le cimetière devient un cabaret.
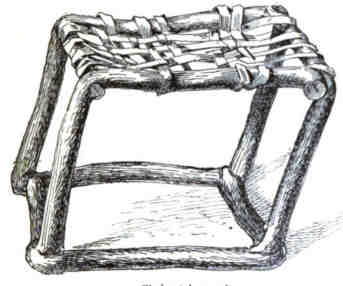
Les sacrifices privés sont faits en vue d'obtenir la guérison d'un malade ou à l'occasion des principaux événements de la vie domestique, naissance, mariage. Ainsi, après que la demande du jeune homme a été agréée par la jeune fille, celui-ci rend grâce aux dieux, en faisant un petit sacrifice à la première bifurcation qu'il rencontre sur sa route. Il répand, par exemple, sur le sol de l'eau-de-vie.
Voici maintenant une recette de médecine populaire qui nous a été communiquée par les Tchouvaches.[Pg 100] Elle remplace pour eux les pastilles Géraudel. Si elle n'est pas efficace, elle se recommande par sa simplicité. Êtes-vous enrhumé, vous n'avez qu'à jeter des œufs dans un puits et vous êtes débarrassé de votre toux.
Tous les peuples d'origine finnoise ont pour l'ours une sorte de vénération et supposent à cet animal un pouvoir surnaturel. Les Tchouvaches partagent ces superstitions et attribuent aux excréments de maître Martin le pouvoir de purifier l'endroit où il les dépose. Aussi, lorsque des saltimbanques promènent dans la campagne quelques-uns de ces animaux, ne manquent-ils pas de les faire entrer dans la cour de leurs habitations.
Chez les Tchouvaches nous n'avons observé qu'un seul instrument de musique, une cithare pareille à celle des Tchérémisses. Leur danse consiste en sautillements accompagnés de battements de mains.
Le 7 juillet, nous revenons sur le Volga à Soundéri, ou Marjinskii, petite ville située en aval de Tchéboksari. En attendant le vapeur qui doit nous transporter à Kazan, nous allons visiter Kakchamar, village habité par des Tchérémisses de montagnes, bien qu'il soit situé sur la rive des prairies.
On traverse en bac le Volga, divisé en deux bras par un îlot constitué de fines particules sablonneuses, puis on court à travers une riante campagne fraîche et ombreuse. Les habitants de Kakchamar ne présentent aucune différence appréciable avec les Tchérémisses que nous avons vus jusqu'ici, ils nous semblent seulement avoir plus subi l'influence russe que leurs congénères des environs de Tsarévokoktchaïsk. Les broderies qui ornent les vêtements des femmes sont sans art et sans caractère.
Nous passons une partie de la nuit sur le ponton[Pg 101] de Soundéri à attendre le vapeur. C'est demain grande fête à Kazan. Tous les ans à pareille époque, on transporte la célèbre image de Notre-Dame de Kazan d'un couvent situé aux environs de la ville, dans l'une des églises du Kremlin, où elle demeure quelque temps. Cette icone jouit d'une grande réputation dans toute la Russie, et de très loin une foule de fidèles vient assister à la procession. Lorsque le paquebot arrive à Soundéri, il est déjà bondé d'une foule de pèlerins.
Le lendemain, à notre arrivée à Kazan, une foule compacte garnit les talus des remparts du Kremlin le long desquels doit passer la procession. De loin la masse rouge des femmes fait l'effet d'un immense champ de coquelicots. Il est neuf heures du matin et le cortège ne passera qu'à midi, néanmoins tout le monde attend calme et résigné, sous un soleil ardent de 35° à 40° et sous une pluie de poussière!
Aujourd'hui nous voyons Kazan sous un de ses mauvais côtés. La poussière tombe dru, comme une ondée; au lieu d'eau c'est du sable qui tombe du ciel.
J'aurais vivement désiré voir le défilé de la procession, mais pour cela il eût fallu rester tête nue sous un soleil flamboyant. Je n'assistai qu'à la fin de la cérémonie, et bien m'en prit: à plus de 200 mètres de la procession il fallait se découvrir, et à l'ombre le thermomètre s'élevait à +27°. Néanmoins aucun des pieux assistants ne paraissait s'apercevoir de la chaleur. La foi protège de tout!
Avec cette foule de fidèles, impossible de trouver un coin dans un hôtel. Le bon Latif, le préparateur de M. Mislavsky, m'offrit l'hospitalité dans son sous-sol de l'Université sur un canapé en bois. Ce fut ma première bonne nuit en Russie et le lendemain j'étais frais et dispos pour le voyage de Perm.
[Pg 102]
La Kama.—Perm.—Les Permiaks.—Costumes et habitations de ces indigènes.
Les plaines ensoleillées de Kazan et leur grouillement multicolore de races diverses sont maintenant loin de nous. Nous avons quitté la région asiatique du Volga pour nous diriger vers Tcherdine, point de départ de notre exploration projetée dans le bassin de la Petchora.
De Kazan à Tcherdine c'est une navigation de 1 400 kilomètres, la distance de Paris à Dantzig. On descend le Volga sur une centaine de verstes, et le reste du trajet se fait par son affluent, la Kama, presque aussi important que le fleuve lui-même.
En Russie, les fleuves, comme toutes choses d'ailleurs, sont hors de proportions avec ce que nous sommes habitués à voir. La Kama, par exemple, est d'un tiers plus longue que le Rhin, et de simples rivières telles que ses affluents, la Bielaya et la Viatka, ont un développement de cours dépassant celui de la Loire et de la Seine.
[Pg 103]
Tour à tour, suivant les saisons, chaussées de glace ou «chemins qui marchent», ces grands cours d'eau sont les principales routes du pays; mais leurs variations rapides du régime en rendent la viabilité précaire. Après la débâcle qui a lieu en mai, la fonte des neiges détermine une inondation considérable; les rivières deviennent des mers d'eau douce. A cette époque le Volga est large d'une vingtaine de kilomètres, puis l'eau baisse rapidement, elle tombe pour ainsi dire, et dès le milieu d'août la navigation devient très difficile. A notre retour de Sibérie, au milieu de septembre, à la suite d'un été particulièrement sec, les vapeurs, même ceux de faible tonnage, ne circulaient sur le Volga et la Kama que très difficilement; partout ailleurs les services étaient interrompus.
Sur la Kama, dont le bassin s'étend très loin dans les régions humides du nord, pareille baisse des eaux est accidentelle, elle est au contraire habituelle sur les autres fleuves de la Russie orientale. Toutes les conditions nécessaires au maintien d'un débit abondant font défaut dans cette région; le sol sablonneux facilite les infiltrations, les pluies sont rares, et sous le soleil ardent de l'été l'évaporation est considérable.
Dans la vallée de la Kama, toujours des paysages boisés avec des fuites d'horizons lointains, bleuis par la masse des arbres. Ce ne sont plus, comme dans nos régions, des paysages limités, donnant la sensation de quelque chose de précis, de borné, ici c'est l'infini. Le sol est plus accidenté qu'aux environs de Kazan, des collines lointaines apparaissent, et la rive droite est formée de terrasses sablonneuses ou argileuses hautes en certains endroits d'une quarantaine[Pg 104] de mètres. A la base de ces escarpements sourdent des sources dont le suintement détermine dans l'épaisseur de la masse argileuse la formation de petits canons et de ravins. Ailleurs elles produisent des éboulements. Le lent travail de ces veines d'eau souterraines contribue à élargir le lit de la Kama aux dépens des terres environnantes.
Depuis les temps historiques le cours inférieur de la Kama s'est déplacé de plusieurs kilomètres vers l'ouest. Près du village de Sergievskoé, situé sur la rive gauche de la rivière, et voisin de son embouchure dans le Volga, se trouve, à une distance de 10 kilomètres de la rive actuelle, un hameau appelé Vieille Kama. D'après M. Maltsev, «l'aspect des lieux indique l'emplacement d'un ancien lit de rivière: toute la dépression est occupée par des buissons et des plantes marécageuses; la berge de gauche se prolonge jusqu'à la ville de Spassk, bâtie près des ruines de l'ancienne Bolgar[53]». Certains auteurs arabes rapportent d'ailleurs que la Kama coulait près de Bolgar, qui en est actuellement distant d'une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau. L'étude du terrain confirme les documents historiques, la plaine située au nord des ruines de Bolgar est constituée par des alluvions[54].
[53] Rambaud, le Congrès de Kazan, in Revue scientifique du 3 mai 1879.
[54] Ibid.
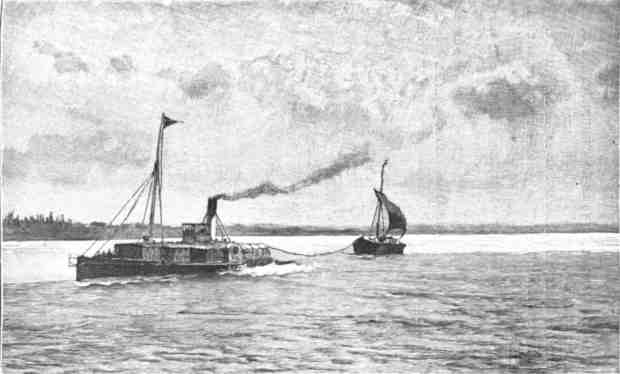
Sur la Kama la navigation est beaucoup moins active que sur le Volga, bien que ce soit la route principale de Sibérie. Cette immense dépendance de l'empire russe n'a pas encore une grande importance économique. La Sibérie si riche et si fertile dans sa partie méridionale, comme nous l'exposerons plus[Pg 106] loin, n'exporte en Europe qu'une très faible partie de ses produits, faute de voies de communication, et la Russie n'expédie au delà de l'Oural qu'une petite quantité de marchandises. Sur la Kama nous croisons seulement quelques vapeurs; fréquemment nous rencontrons d'immenses trains de bois, véritables îles flottantes. Les produits des vastes forêts sont expédiés dans la région des steppes.
Ce pays laisse l'impression d'un désert. De loin en loin, un village de masures noires dominé par le hérissement multicolore d'une église. Avec leurs dômes verts ou leurs cinq clochetons bleus, et leurs murailles blanches, ces églises donnent de la valeur au paysage sans intérêt. Ce sont les points d'orgue du tableau.
Tous les trois ou quatre cents kilomètres, une ville ou plutôt ce qu'on est convenu d'appeler une ville en Russie, Tchistopol, Sarapoul, chef-lieu d'un vaste district habité par les Votiaks, une des peuplades finnoises du groupe permien. Après une navigation de soixante heures nous sommes à Perm, au terme de la première partie du voyage.
Nous voici à l'extrémité orientale de l'Europe, au seuil de l'Asie. Si l'on tient compte de sa position par rapport à l'Oural, Perm est la dernière ville d'Europe; mais, comme le dit très justement M. Cotteau, pour démontrer que la domination de la Russie s'étend à la fois sur l'Europe et l'Asie, le gouvernement impérial n'a tenu aucun compte des limites naturelles acceptées de tout temps par les géographes[55] et a fait passer à l'est de l'Oural, au commencement de la[Pg 108] plaine sibérienne, la frontière orientale de la province de Perm.
[55] E. Cotteau, De Paris au Japon à travers la Sibérie. Hachette, 1883.

Très gai l'aspect de la ville, avec la gare monumentale du chemin de fer de l'Oural construite dans un joli style oriental, à côté un superbe palais étale ses colonnades et son fronton, plus loin des églises élèvent leurs dômes pittoresques, tout cela disséminé au milieu de la verdure devant le large fleuve. Derrière cette rangée d'édifices il n'y a qu'un village.
Aujourd'hui, 12 juillet, température étouffante. A une heure de l'après-midi, le thermomètre marque à l'ombre +25° et la pression est seulement de 741. Il y a six semaines, à la fin de mai il gelait la nuit. Ici la température peut descendre à -36° et s'élever à +30°. En 1890, pendant trois mois seulement, en juin, juillet et août, le thermomètre ne s'est point abaissé au-dessous du point de congélation. Le 5 septembre, s'est produite la première gelée.
Le lendemain, départ de Perm. Nous nous embarquons de nouveau sur la Kama à destination de Tcherdine avec le projet de faire en route une escale pour visiter les Permiaks.
Au delà de Perm, paysage très pittoresque. Tantôt les berges s'escarpent en hautes terrasses couronnées de bois, tantôt elles s'abaissent, découvrant de riantes perspectives de champs cultivés et de forêts. Par endroits dans ce cadre de verdure la rivière s'élargit en forme de lac, d'un bord à l'autre la distance est bien d'un kilomètre, et nous sommes ici à plus de 200 lieues de l'embouchure de la Kama!
Le soleil est éclatant, le ciel d'un bleu immaculé; n'importe ce rayonnement de lumière aveuglante, la masse compacte des arbres verts donne au pays un aspect septentrional; si on ne sent pas encore la fraîcheur[Pg 109] du nord, on la devine. Le pays est plus joli, plus agréable à l'œil que la vallée du Volga, mais il étonne moins. C'est une contrée comme une autre.
14 juillet.—A sept heures du matin nous débarquons à la station de Pogevo, située à proximité de la région occupée par les Permiaks.
Les Permiaks appartiennent à la grande famille finnoise, et constituent le groupe permien avec les Votiaks de la Kama et les Zyrianes de la Petchora.
Ce seraient, au témoignage des historiens, les plus anciens habitants du nord-est de la Russie[56]. Ils auraient apporté de l'Altaï l'art d'exploiter les mines, et des traces d'excavations que les indigènes attribuent aux Tchoudes légendaires seraient l'œuvre des anciens Permiaks[57]. Mais, comme le fait très justement observer M. Deniker, les anthropologistes n'ont point comparé leurs crânes à ceux des Tchoudes; par suite, la parenté entre les deux peuples n'a pu être établie avec certitude.
[56] Deniker, Esquisse anthropologique des Permiaks (compte rendu de l'ouvrage de M. Maliev, in Archives slaves de biologie. Paris, 1887, t. III, fascicule 3).
[57] Des trous de mines attribués aux Tchoudes se rencontrent dans la vallée supérieure de la Tchoussovaya, autour des sources de la Sosva et sur les bords du Vagran (cercle de Bogoslov). Les traces de ces exploitations ont été trouvées près des gisements actuellement les plus riches. (Aspelin, De la civilisation préhistorique des peuples permiens. Leyde, 1879.)
D'après le dernier recensement (1885), les Permiaks seraient au nombre de 90 000, la plupart établis dans la partie septentrionale du gouvernement de Perm (arrondissements de Solikamsk et de Tcherdine). En dehors de ces circonscriptions, on en trouve une dizaine de mille dans le gouvernement de Viatka[Pg 110] (arr. de Slobodsk et de Glasov) et quelques petits clans sporadiques dans l'Oural.
Dans le gouvernement de Perm, un des groupes permiaks les plus compacts occupe la longue vallée de l'Inva, tributaire de droite de la Kama. En poussant dans cette direction nous espérons trouver une population caractéristique.
A Pogevo nous louons une pletionka et maintenant fouette cocher! Malgré l'heure matinale, la chaleur est déjà très forte, pas un souffle d'air et sur la route blanche le soleil tape ferme.
A neuf heures du matin nous voici à Maïlkora (distance: 18 kilomètres, grand village de 5 000 habitants aggloméré autour d'un haut fourneau appartenant au prince Demidov. Nous changeons de voiture et de chevaux, puis repartons aussitôt pour Kouproz. Nouvelle étape de 22 kilomètres, parcourue en 2 heures 15 minutes.
A deux kilomètres au delà de Maïlkora commence la région habitée par les Permiaks. A première vue ces indigènes se distinguent des Russes par la couleur bleue de leur costume. Le bleu est la couleur favorite de ces Finnois. Hommes et femmes portent des vêtements de cette teinte, et leurs ustensiles de ménage sont également presque tous barbouillés de cette couleur. Les Finnois de Finlande, établis dans la Norvège septentrionale, partagent cette prédilection des Permiaks pour le bleu[58].
[58] Friis, En Sommer i Finmarken. Kristiania.
Bien que nous suivions une route fréquentée, tous les indigènes ne parlent pas russe, la plupart des femmes ignorent cette langue. L'assimilation est donc encore loin d'être complète.
[Pg 111]
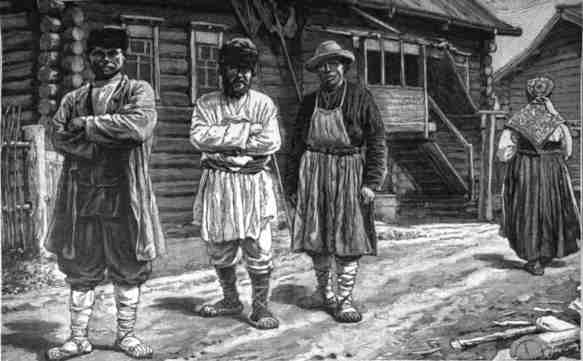
[Pg 112]
A signaler chez les Permiaks leurs maisons, très différentes de celles des Russes. Elles sont beaucoup plus hautes que les isbas. Quelques-unes ont deux étages, constructions que l'on ne trouve chez les Russes que dans des villages riches. L'habitation permiake caractéristique, la kirkou, ne comporte qu'un étage, situé à quatre ou cinq mètres au-dessus du sol. On y accède par un perron de deux ou trois marches couvert, puis par un escalier appliqué le long de la façade et également surmonté d'un toit. Au sommet de cet escalier se trouve un carré entouré de bancs, où les indigènes aiment à se reposer. La porte d'entrée conduit dans un couloir sur lequel ouvrent les deux pièces de l'habitation. Par derrière s'étend une cour couverte surmontée d'un grenier.
A midi, nous arrivons à Kouproz littéralement abrutis par l'ardeur du soleil et nous décidons d'attendre la fraîcheur pour nous remettre en route.
Le smotritel (maître de poste), interrogé par Boyanus sur les mœurs des indigènes, affirme avec hauteur qu'«il ne va pas au bois». Traduisez qu'il ne fait plus de sacrifices païens. Mais s'il a renoncé aux faux dieux, sa réponse autorise à croire que d'autres les adorent encore en cachette. Sur ce point, impossible d'avoir une réponse précise du bonhomme. En tous pays, des paysans ne vont pas trahir leurs secrets devant des étrangers.
Dès le XIVe siècle, les Permiaks ont été convertis par saint Stéphane, évêque de la Permie. A cette époque les indigènes manifestaient une hostilité marquée contre les Slaves et repoussaient avec énergie toutes les nouveautés importées dans le pays par les étrangers. «Ils rejetaient particulièrement l'emploi des caractères russes, qui n'avaient servi jusqu'alors[Pg 113] qu'à transmettre des ordres tyranniques[59].» Pour vaincre ces répugnances, saint Stéphane créa une liturgie en langue indigène et un alphabet avec des caractères depuis longtemps en usage dans le pays et qui, paraît-il, présentent une grande ressemblance avec les runes scandinaves. D'après certains archéologues russes, cet apôtre aurait composé des livres sacrés à l'aide de ces caractères, mais en dépit des recherches les plus minutieuses on n'a réussi jusqu'ici à découvrir aucun de ces documents.
[59] A. Rambaud, le Congrès de Kazan, in Revue scientifique, 2e série, 8e année, no 46.
Quoique convertis depuis cinq siècles, les Permiaks ont conservé certaines pratiques païennes. L'Église grecque a adopté ces cérémonies en en modifiant simplement le sens. Au lieu d'être organisées en l'honneur des dieux du paganisme finnois, elles sont maintenant consacrées aux saints du paradis orthodoxe. La principale consiste dans le sacrifice de taureaux de trois ans. Elle se célèbre le 30 août, jour des saints Florus et Laurus, devant une ancienne chapelle à eux consacrée et située au village de Bolchaïa-Kotcha (district de Tcherdine). Quelle que soit la distance à laquelle il demeure de ce sanctuaire, le Permiak qui a fait un vœu ne recule jamais devant le voyage. Un de ces Finnois désire-t-il obtenir la guérison d'un malade, écarter quelques malheurs de sa famille, il jure de sacrifier un taureau si son souhait se réalise. La victime doit être âgée de trois ans au moment du sacrifice et ne présenter aucun défaut.
Avant la cérémonie, les pèlerins allument des cierges devant les images sacrées de la chapelle et suspendent, autour du christ de l'iconostase, des rouleaux[Pg 114] de toile en guise d'ex-voto. Une fois le signal du sacrifice donné par le carillon de l'oratoire, aidé de ses parents et amis, chacun s'occupe à lier les jambes de son taureau et à le coucher par terre, mais à celui qui a prononcé le vœu incombe l'obligation de frapper la victime. Pour cela les Permiaks se servent d'un mauvais petit couteau, et souvent ce n'est qu'après de longs efforts qu'ils réussissent à immoler l'animal. Le spectacle devient atroce, les malheureuses bêtes blessées se débattent, essaient de se relever, beuglent, aspergent de sang les assistants, et les environs de la chapelle deviennent un champ de carnage immonde.
Les animaux abattus sont immédiatement dépecés. Les têtes sont offertes à la chapelle et entassées par le bedeau dans un petit hangar voisin de l'édicule sacré. Au pope on réserve les filets, aux pauvres on donne la poitrine, et le reste de la viande est incontinent cuit et mangé par les assistants. La cérémonie religieuse se transforme en une ripaille générale et en une beuverie répugnante[60]. Ainsi le christianisme des Permiaks ne diffère guère du paganisme des Tchérémisses. Les croyances des deux peuples sont identiques, l'étiquette seule diffère.
[60] Ces renseignements sur les pratiques païennes des Permiaks sont empruntés à un fort intéressant travail de feu M. Malakhov, publié dans le Bulletin de la Société ouralienne d'amateurs des sciences naturelles, t. II, liv. I. Ekaterinbourg, 1887.
Au témoignage de Maliev, les Permiaks vénèrent encore de petites idoles en métal, représentant des oiseaux, un ours, l'animal sacré des anciens Finnois, et des figurines humaines. A Koudimgkor une femme nous a vendu plusieurs de ces fétiches, pour lesquels elle ne paraissait pas avoir une grande vénération.
[Pg 115]
A six heures moins un quart, nous quittons Kouproz, en route pour Koudimgkor, situé à 59 kilomètres de là. Maintenant que la chaleur est passée, l'étape est charmante. On traverse de grands bois pleins de fraîcheur et d'aromes balsamiques, puis des prairies et des champs cultivés, gagnés depuis peu aux dépens de la forêt. Des troncs carbonisés indiquent un défrichement récent par le procédé du brûlage commun à tous les Finnois. Au sommet d'un plissement de la plaine se découvre un panorama extraordinaire. Deux lignes d'ondulations molles encadrent une plaine infinie, un horizon de mer derrière lequel le globe du soleil disparaît rouge et net comme en plein océan. Lentement la lumière jaune du couchant blanchit, puis jusqu'à l'aurore une pâle clarté remplit le ciel. Ni jour, ni nuit, cette lueur qui semble tomber d'une lune démesurée. Sous cette lumière mourante les traits du paysage restent précis, les lointains s'agrandissent, la forêt devient toute violette. Au-dessus de la rivière fument des brouillards blancs; la terre semble morte, on a la vision d'un paysage planétaire, d'un monde inanimé, la sensation de quelque chose d'extra-terrestre.
De loin en loin, des hameaux de deux ou trois maisons perdues au milieu des champs. La population est ici plus disséminée que dans les régions de race slave. Les Permiaks recherchent l'isolement, comme tous les Finnois.
A Koudimgkor, déception complète. Les habitants de ce village, que l'on nous avait représentés comme les Permiaks les plus caractérisés, ressemblent à tous ceux rencontrés sur la route. Les femmes portent le sarafane russe et de leur ancien costume n'ont conservé qu'un petit bonnet en étoffe orné de[Pg 116] dessins en verroterie. Seuls quelques enfants sont vêtus d'une blouse bleue bordée de petites broderies rouges. Les Permiaks, tout au moins dans la région visitée par nous, semblent avoir perdu l'art de la broderie. En chemin nous n'avons pu acheter que trois ceintures tissées par les indigènes; l'une verte, rehaussée de rouge, est d'un dessin charmant.
Jadis les Permiaks ont été des artistes en orfèvrerie, mais cet art indigène paraît également perdu, et aujourd'hui il est difficile d'en trouver des spécimens. A Koudimgkor nous avons pu cependant acheter une paire de boucles d'oreilles d'un travail très soigné.
Ces indigènes vivent de l'élevage du bétail et d'agriculture. Comme les Finnois de Finlande, ils emploient la faucille pour couper le foin. C'est un des rares instruments qu'ils aient conservé de leurs ancêtres.

A Koudimgkor comme dans tous les autres villages, la population enfantine est très nombreuse. Les Permiaks sont une race très prolifique. D'après Maliev, en deux ans, de 1883 à 1885, leur proportion par rapport aux Russes dans le district de Solykamsk a monté de 48,91 pour 100 à 51,11. L'effectif de chaque famille serait de 6,61, nombre supérieur à celui des Russes habitant dans le voisinage (5,27). Cet accroissement rapide des Permiaks est dû en partie à la liberté laissée aux jeunes filles. Chez ce peuple comme chez les Eskimos du Grönland, les hommes paraissent tenir en médiocre estime la virginité[Pg 117] de leurs fiancées. D'après une vieille coutume, au moment de la célébration du mariage, la future épouse, si elle est encore vierge, doit déposer un ruban rouge sur les pages de l'évangile ouvert. Or, dit-on, deux ou trois jeunes filles seulement sur cent sont en droit d'accomplir ce rite. Comme excuse on allègue que les femmes permiakes ne se marient guère avant vingt-cinq ans. Après le mariage elles rachètent, dit-on, leurs erreurs passées par une conduite exemplaire[61].
[61] Deniker, loc. cit.
Les indigènes de Koudimgkor nous affirmèrent qu'un peu plus loin au nord habitaient des Permiaks peu modifiés par l'influence russe. Depuis les plaines du Volga nous connaissions ce racontar. Dans le pays des Tchérémisses, lorsque nous demandions aux indigènes de nous indiquer un village habité par des païens, ils nous parlaient toujours de hameau plus éloigné, et dès que nous arrivions à cet endroit les habitants étaient unanimes à affirmer que nous devions aller plus loin pour trouver des indigènes intéressants. Maintenant l'été avance, il n'y a plus de temps à perdre, et, comme demain un vapeur à destination de Tcherdine passe à Pochevo, nous parcourons en une nuit les vingt-cinq lieues qui nous séparent de la Kama.
Le 16 juillet, à neuf heures du matin, nous nous embarquons de nouveau; le lendemain matin voici enfin Tcherdine, le point de départ de notre exploration projetée dans le bassin de la Petchora. Pour y arriver nous avons dû traverser toute l'Europe de l'ouest à l'est et parcourir 6 000 kilomètres. Nous sommes maintenant plus près des frontières de Chine que de France.
[Pg 118]
La Kolva.—La Vogoulka.—Les moustiques.—Les embâcles de bois.—Le portage entre Vogoulka et Petchora.—Les Zyrianes.
Tcherdine est une petite ville de 4 000 habitants, pittoresquement perchée au-dessus de la vallée de la Kolva. Ici pour la première fois depuis Kazan, changement de décors dans le paysage. Au loin, derrière une immensité bleue de forêts, s'élève la haute cime du Poloudov Kamen (524 m.), dernier renflement de l'Oural. Au milieu de la platitude générale elle fait l'effet d'une île élevée sortant de la mer. Depuis Perm nous suivons le pied de l'Oural, ici pour la première fois nous l'apercevons.
A Tcherdine commence notre exploration. Désormais plus de routes ni de moyens réguliers de transport. A travers la région déserte qui s'étend jusqu'à la Petchora, sur une distance de 300 kilomètres, le chemin est tracé par un long réseau de rivières tributaires de la Kama. C'est d'abord la Kolva, puis la Vitcherka et la Bérésovka, ensuite la Ielovka et enfin la Vogoulka. Ce dernier cours d'eau conduit les barques[Pg 119] à six kilomètres seulement de la Volosnitsa, affluent navigable de la Petchora. De la Kama à la Petchora s'étend ainsi une ligne navigable presque continue, grande route naturelle ouverte au milieu de ces solitudes.
Au moment de notre arrivée à Tcherdine, un des principaux négociants de la ville, M. Souslov, allait mettre en route un vapeur pour conduire deux ingénieurs à la Petchora; avec une amabilité dont nous ne saurions lui être trop reconnaissant, il nous offre le passage sur son steamer et l'hospitalité dans sa maison. Inconnus, nous sommes partout accueillis en amis.
A sept heures du soir nous partons pour Kamgort en pletionka, village à 21 kilomètres au nord de Tcherdine, où habite M. Souslov et où est mouillé son vapeur.
Dans ce pays de hiérarchie, où chacun est étiqueté sous une rubrique, M. Souslov appartient à la classe des paysans, mais ne croyez pas du tout que ce soit un laboureur. En France il serait un bourgeois important et compterait parmi les notables du pays. Le jour encore lointain où se formera en Russie une classe moyenne, c'est parmi ces paysans aisés et intelligents qu'elle se recrutera. Beaucoup sont gens d'initiative et ne craignent pas de se lancer dans de grandes entreprises fécondes pour le développement de la Russie. Un simple paysan du gouvernement d'Orembourg n'a-t-il pas installé un des premiers centres de l'industrie russe dans le Turkestan, tout comme M. Souslov crée ici une importante route commerciale? Et on pourrait multiplier les exemples de cette activité.
Chez M. Souslov une réception enthousiaste nous attend, une vraie réception russe. Pendant quatre heures on boit et on mange sans arrêt. Pour pouvoir[Pg 120] répondre aux politesses des habitants, un voyageur doit avant tout avoir la tête solide.
A une heure du matin, départ. Des brumes légères fument au-dessus de la Kolva et noient les contours de la forêt. Par endroits la silhouette noire d'un grand sapin perce le brouillard avec des airs de fantôme grandi par la réfraction, puis tout redevient blanc, diaphane, aérien comme si l'on naviguait au milieu des nuages.
18 juillet.—Continuation de la navigation sur la Kolva. La rivière coule claire et rapide entre de jolies collines boisées. Çà et là la masse verdâtre des pins est noircie par des bouquets de cembro, les premiers que nous ayons observés; à côté de ces taches foncées blanchissent comme une neige légère des plaques de lichen de rennes. A onze heures du matin, arrêt à Vetlane pour une excursion à Neyrop, village situé à 4 kilomètres de la Kolva.
Neyrop est une localité historique. Sur l'ordre de Boris Goudounov, l'oncle de Michel Romanov fut conduit ici et enfermé dans un trou qui fut muré par-dessus lui. L'air et le jour n'arrivaient au prisonnier que par une petite ouverture à travers laquelle les enfants lui faisaient parvenir des vivres. Une chapelle a été érigée au-dessus du caveau; on y conserve pieusement les lourdes chaînes dont était chargé le malheureux prince[62].
[62] Ces chaînes pèsent, paraît-il, 48 kilogr.
Plusieurs maisons sont construites sur le type des habitations permiakes (kirkou) de Koudimgkor, et pour couper le foin les indigènes se servent de la faucille. L'élément finnois forme évidemment ici une bonne part de la population, comme du reste dans[Pg 122] tout l'arrondissement de Tcherdine, mais aujourd'hui les habitants ont perdu le souvenir de leur origine et se disent Russes.

A Vetlane, la rive gauche de la Kolva s'élève en un bel escarpement calcaire haut de 60 à 80 mètres; à trois kilomètres de là, même accident de terrain sur la rive droite. La rivière coule ici dans une sorte d'étranglement. C'est la première fois, depuis notre entrée en Russie, que nous observons la roche en place.
A six heures du soir, le vapeur abandonne la Kolva pour s'engager dans son affluent de gauche, la Vitcherka. Sur cette rivière peu ou point de courant et partout une profondeur relativement grande. Près du confluent il y a, me dit-on, six mètres d'eau. Sur la Kolva, au contraire, des bancs rendent la navigation difficile. La Vitcherka, large d'une dizaine de mètres, coule tantôt entre des marais, tantôt entre des terrasses de sable et d'argile. Le long de ces berges se produisent des glissements qui entraînent dans l'eau des bouquets d'arbres. A chaque instant le vapeur croise des bois flottants ou évite des amoncellements d'arbres tombés des rives.
Le lendemain matin, nous rencontrons une équipe d'ouvriers occupés à débarrasser la rivière des arbres qui l'obstruent. Pour créer une voie commerciale facile entre la Kama et la Petchora, le ministre des voies et communications fait procéder en ce moment au curage de la Vitcherka et de ses affluents et sous-affluents.

Toujours le même paysage, des bois marécageux au milieu desquels la rivière circule comme une avenue couverte d'eau. Plus loin la Vitcherka s'élargit en un lac, le Tchoussovskoé ozero. Au bout de la nappe d'eau on ne voit qu'une mince bande de terre[Pg 124] verte qui a l'air de flotter entre le ciel et l'eau, tellement le pays est plat. De tous côtés, des saulaies avec des marais, des terres tremblantes; tout cela reluisant de lumière sous un ciel magnifique. Ce paysage laisse la même impression de grandeur triste que la campagne romaine.
Au delà du Tchoussovskoé ozero, mauvaise nouvelle: la profondeur de la Bérésovka diminue rapidement, on n'avance plus que très lentement, en sondant à l'avant avec une perche. A un moment, le vapeur est obligé de stopper, il n'a plus sous la quille que quelques centimètres d'eau. Il faut maintenant poursuivre le voyage dans les canots que nous avons pris en remorque, et d'ici le portage la distance est, affirment les indigènes, de 100 kilomètres; 100 kilomètres à parcourir à la rame, au milieu de marais!
Nous empilons en hâte les bagages dans les canots, et maintenant aux avirons. D'une embarcation à l'autre les équipages s'excitent par des plaisanteries et par des cris, c'est à qui prendra la tête de la flottille, puis quand, essoufflés, les vainqueurs ralentissent leur vitesse, d'autres plus ménagers de leurs forces repartent de plus bel et essaient de les dépasser. Tout le monde alors de rire et de hurler. Le paysan russe n'est ni triste ni silencieux, comme on le représente généralement. C'est que la plupart des voyageurs l'ont vu dans les villes ou sur les vapeurs du Volga. Discret et timoré, le moujik se tient sur la réserve dans ce milieu qui lui est étranger, mais voyagez avec lui à la campagne, il devient un compagnon enjoué et agréable.
Encore des marais, des saulaies, ou bien une terrasse sablonneuse couverte par la forêt sans fin d'arbres verts.
[Pg 125]
Dès que le soleil baisse, de ces marécages s'élèvent des nuées de moustiques. Autour de chacun de nous une centaine de ces insectes, pour le moins, susurrent leur musique énervante. Les bateliers s'enveloppent la tête de mouchoirs et nous nous coiffons de moustiquaires américaines, grands filets en tarlatane tendus sur des ressorts, en forme de nasses à poisson; des gants épais et des bottes complètent l'équipement. Impossible de laisser à découvert la moindre partie du corps et nécessité absolue de fermer hermétiquement toutes les ouvertures des vêtements; avec la température lourde que nous supportons il serait pourtant si agréable d'avoir la figure à l'air! En dépit de la chaleur, pendant des semaines, jour et nuit, en plein air comme dans les maisons il faudra conserver la moustiquaire sur la tête. Avec cela il n'est pas très facile de manger. Avant de se mettre quelque chose sous la dent c'est toute une manœuvre. Il faut d'abord écarter les insectes d'un coup de mouchoir, relever ensuite prestement le voile et avaler à la hâte un gros morceau. Quelle que soit la rapidité des mouvements, des moustiques réussissent toujours à se glisser sous le filet; pour chaque bouchée vous pouvez compter sur deux ou trois piqûres au moins. Notez que nous sommes maintenant à la fin de juillet et que depuis une quinzaine les moustiques ont diminué. En pleine saison qu'est-ce que cela doit être?
Dans la soirée nous rencontrons une barge, habitation flottante de l'ingénieur chargé des travaux de curage. A bord les plus minutieuses précautions sont prises pour arrêter les moustiques: partout ce ne sont que doubles portes, portières de mousseline et moustiquaires, devant l'entrée fume un feu tourbeux;[Pg 126] mais bien souvent, paraît-il, tout cela devient inutile.
L'installation des ouvriers est très curieuse. Ces pauvres gens ont pour gîtes de véritables habitations de troglodytes. Dans la hauteur de la berge sablonneuse ils ont creusé des cavités auxquelles on accède par un trou garni d'un linteau en bois pour soutenir le plafond et fermé par une nappe en écorce de tilleul. Ces abris, d'un usage courant en Russie, doivent être une survivance de l'époque préhistorique dans ces pays où les cavernes manquent par suite de l'absence de la roche en place à la surface du sol. Les Tchoudes, répandus jadis dans la région forestière du nord, habitaient des trous creusés en terre; dans le gouvernement d'Arkhangelsk, des cavernes de ce genre sont très fréquentes et portent encore aujourd'hui le nom de Tchoudskiia pechtcheri[63] (cavernes des Tchoudes).
[63] Alex. G. Schrenk, Reise nach dem Nordosten des europäischen Russlands durch die Tundren der Samoyeden zum Arktischen Uralgebirge. Dorpat, 1848, vol. I, p. 372.
A minuit, nous arrivons à Oust-Ielovka, hameau situé à l'embouchure de la Ielovka dans la Bérésovka. Rien que des entrepôts appartenant à des marchands de Tcherdine et un magasin de farines où les indigènes viennent s'approvisionner pendant l'hiver. Actuellement Oust-Ielovka n'est occupé que par une famille, seuls habitants rencontrés depuis le Tchoussovskoé ozero sur une distance d'une vingtaine de kilomètres, et leurs plus proches voisins demeurent à 60 kilomètres de là, au portage entre la Petchora et la Vogoulka. Après un maigre souper nous nous étendons sur le plancher d'une chambre surchauffée par le poêle de la maison. Impossible d'aérer, à cause des moustiques,[Pg 127] et sur les planches qui nous servent de lit grouillent des troupes compactes de punaises. Bast! en comparaison du moustique, la punaise est un insecte sympathique.
Nous sommeillons trois heures, puis de nouveau en route. A quelques centaines de mètres d'Oust-Ielovka voici la Vogoulka, affluent de la Ielovka, le dernier rameau du réseau fluvial que nous remontons. Un méchant ruisseau sans profondeur, large de quelques mètres, égout des tourbières environnantes. Pas de vue; à droite, à gauche, des marais, des fourrés de bouleaux et de saules, précédant la grande forêt sèche de conifères, le bor, comme l'appellent les Russes. Pas un habitant, pas un animal, pas un oiseau, c'est une solitude morne, poignante avec le ciel nuageux d'aujourd'hui.
Aucun souffle d'air, et une chaleur grise, humide, accablante. A midi T. = + 29°. Par un temps pareil et dans ces marécages les moustiques deviennent terribles. Nos voiles sont insuffisants à nous protéger, et, pour chasser les essaims les plus compacts, nous devons allumer un feu fumeux dans la marmite au fond de l'embarcation. Pas d'autre alternative, ou se laisser piquer sans trêve ni merci ou passer à l'état de jambon. Pour allumer ces feux, les indigènes recueillent des champignons poussés sur le tronc des bouleaux; en brûlant ils dégagent une odeur pénétrante qui a, dit-on, la vertu d'éloigner les moustiques, mais aujourd'hui on a beau activer le feu, la fumée paraît avoir perdu toute vertu.
A chaque instant les canots touchent ou sont arrêtés par des amoncellements de souches et de branches mortes. Comme la Witcherka et la Bérésovka, la[Pg 128] rivière est encombrée d'arbres. D'après les renseignements que m'a donnés un membre de la mission occupée au curage de ces rivières, seulement en deux points de la Bérésovka on n'aurait pas retiré moins de 27 000 mètres cubes de bois mort. Un grand nombre de cours d'eau de la Sibérie et du nord-est de la Russie présentent de pareilles embâcles. Ahlqvist raconte[64] avoir employé vingt-quatre heures pour parcourir 11 kilomètres sur une rivière du versant oriental de l'Oural encombrée d'arbres morts. A 40 kilomètres de son embouchure, la rivière Pich, affluent de droite de la Petchora, devient inaccessible aux barques par suite d'embarras d'arbres. En 1847, l'expédition d'Hoffmann fut arrêtée par des enchevêtrements de bois sur le Volok, affluent de l'Ilytche, conduisant à un portage entre cette rivière et le Potcherem. Ne pouvant détruire cette barricade par la hache ou le feu, l'expédition dut battre en retraite[65]. De pareils embarras existent également, sur une échelle beaucoup plus grandiose, dans le bassin du Mississipi et dans la région forestière du Canada. Un cours d'eau de ce dernier pays porte le nom caractéristique de Rivière des Barricades. Au commencement du siècle, l'Atchafalaya, l'Ouachita, affluents du Mississipi, étaient complètement cachés par des amas d'arbres sur une grande partie de leur cours; en plusieurs endroits on pouvait les traverser sans reconnaître qu'on franchissait des rivières[66]. Dans la région que nous parcourons, ces débris de végétaux n'atteignent point une puissance aussi considérable,[Pg 129] mais ils occupent parfois une surface assez étendue, relativement à l'importance des cours d'eau. Au milieu de ces marais les rivières changent souvent de cours, et, sur les différents lits qu'elles abandonnent successivement, laissent des amas d'arbres, que les tourbes viennent ensuite recouvrir. L'étude de ces dépôts serait d'un grand intérêt pour la question si importante de la formation de la houille.
[64] Ahlqvist, Unter Wogulen und Ostjaken. Helsingfors, 1885.
[65] Hofmann, Der nördliche Ural und das Küstengebirge Pae-Choi. Saint-Pétersbourg, 1856, vol. II, p. 69.
[66] Reclus, la Terre, d'après Lyell, Second Visit to the U. S.
A une heure de l'après-midi, arrêt pour laisser reposer les bateliers. Voilà huit heures que ces braves gens travaillent énergiquement. Les équipages préparent une sorte de thé avec des feuilles de fraisier pendant que nous faisons cuire un canard abattu la veille. Avec deux branches fourchues, et la baguette en fer de ma carabine Gras, la broche est installée, on la tourne cinq ou six fois et le volatile est rôti suivant les règles de l'art, sur les bords de la Vogoulka.
A quatre heures, en route de nouveau. La Vogoulka, devenue très étroite, coule sous une charmille de saules: cela serait idyllique sans les moustiques et sans l'humidité qui nous envahit. Nous sommes littéralement dans l'eau: pluie sur le dos, jambes dans l'eau, qui remplit les embarcations plus ou moins disloquées par de nombreux échouages, et avec cela bénédiction continuelle que les bateliers nous envoient avec les gaffes.
A six heures, nous arrivons au lieu dit Vechtomorskaya Pristane. L'agent de police et deux hommes débarquent pour aller chercher les chevaux à la station située sur le portage entre la Vogoulka et la Petchora et les amener ensuite à Poupavaïa Pristane, point où s'arrêtent les embarcations. Désireux de me dégourdir les jambes, je me joins à eux. Il y a, dit-on, une piste, les gens affirment la connaître, et[Pg 130] ce sera plaisir de se promener dans la forêt, après être resté quatorze heures en canot; de plus, à cette heure de la journée, on peut trouver du gibier, et le garde-manger est maintenant une grosse préoccupation.
Nous traversons péniblement un large marais; au bout les guides paraissent hésitants, et dix minutes après s'arrêtent, ils ont perdu la piste. Nous tournons dans tous les sens, sans trouver aucune trace. Nous sommes bel et bien égarés, point de soleil, point de boussole, de tous côtés la forêt uniforme, et avec cela pas de vivres. Pour nous tirer de là, il faut rejoindre à tout prix la Vogoulka et ensuite la suivre jusqu'à ce que nous ayons rattrapé nos compagnons. Mais allez donc retrouver, au milieu de ces marais, un ruisseau à moitié caché sous les arbres. Chacun de nous avance dans une direction donnée en restant toujours à portée de voix et en scrutant soigneusement le terrain. Une heure se passe en recherches longues et pleines d'anxiété; rien n'est signalé et le découragement s'empare de nos gens. L'agent de police se trouve mal; tout à coup un cri: un éclaireur vient de découvrir enfin la Vogoulka. Nous sommes sauvés, mais l'émotion a été grosse.
Le long de la rivière, point de sentier, il faut passer des saulaies coupées de fondrières, traverser de hautes herbes, sauter des trous, escalader des amas d'arbres déracinés enchevêtrés les uns dans les autres, partout des fossés masqués par la verdure, et pourtant personne ne tombe et ne fait de faux pas. En pareille circonstance il y a des grâces spéciales. En outre, au milieu de ces marais pensez si les moustiques sont nombreux, et pas moyen de porter de moustiquaires. Après une heure et demie de cet exercice[Pg 131] gymnastique nous rejoignons nos compagnons et bientôt arrivons à Poupavaïa Pristane, trempés comme si nous étions tombés à l'eau, et couverts de boutons comme si nous avions eu la petite vérole.
A Poupavaïa Pristane la Vogoulka n'est séparée de la Volosnitsa, affluent navigable de la Petchora, que par une langue de terre, basse, large de 6 kilomètres. A travers la forêt, une large tranchée a été pratiquée, et une sorte de route construite pour permettre de traîner les embarcations d'une rivière à l'autre. Au milieu de l'isthme habite un paysan russe chez lequel on trouve des chevaux nécessaires pour effectuer les transports à travers le portage. A peine débarqué, un ingénieur part à la recherche de cet ermite pendant que le reste de la troupe établit le bivouac. Un grand feu est allumé; tout le monde s'étend autour, le nez dans la fumée pour se protéger contre les moustiques et l'humidité des marais. A chaque minute les chevaux peuvent arriver et dans cette pensée on n'ose mettre la marmite sur le feu. On a faim pourtant et toutes les demi-heures on prend une collation ou une tournée pour combattre l'humidité et passer le temps. Après neuf heures d'attente, à six heures du matin arrivent les véhicules destinés au transport des bagages, sous la conduite d'un cocher bancal. Le bonhomme est coiffé d'une casquette rouge, et dans le dos lui pend un énorme foulard écarlate, le tout destiné à écarter les moustiques. Les insectes, affirment les indigènes, fuient les étoffes de couleur rouge ou blanche; le noir, au contraire, les attirerait.
La station est située à trois kilomètres seulement de Poupavaïa Pristane, deux pauvres maisonnettes perdues dans la solitude de la forêt.
[Pg 132]
Après un somme sur le plancher, nous nous remettons en marche. Au lieu de gagner la Volonitsa, nous prendrons à gauche à travers bois pour arriver directement à la Petchora à Iaktchinskaya Pristane.
Les bagages sont chargés sur deux traîneaux (narte) en bois dont le siège est très élevé, les seuls véhicules capables de circuler sur ces terrains spongieux. Trois chevaux sont attelés en flèche à une narte, deux seulement à l'autre, puis la caravane se met en selle.
Le sentier que nous suivons est large tout au plus d'un mètre, coupé de racines d'arbres. N'importe, on trotte toujours; à droite et à gauche émergent des troncs d'arbres sur lesquels on s'empalerait si le cheval tombait, mais les chevaux russes ont le pied sûr comme les mulets des Alpes. Bientôt le sol devient tremblant devant un ruisseau fangeux, en guise de pont on a jeté en travers deux madriers, et sans broncher, les montures traversent ce passage scabreux. Un peu plus loin, nos bêtes tendent le cou vers le sol, le flairent bruyamment, puis avancent avec précaution un pied après l'autre; la terre est couverte d'une belle herbe drue et haute, on dirait un petit pré bien gras. Le cheval fait encore quelques pas, et patatras le voilà dans la vase jusqu'aux jarrets. Ce pâturage fleuri cache une abominable fondrière, et il y en a comme cela quatre ou cinq échelonnés le long de la route. Cela distrait de la monotonie du paysage.
Un grand vide se fait à travers la forêt. Un incendie, allumé probablement par la foudre, a dévasté les bois, traçant une vaste clairière; des troncs calcinés gisent étendus avec des airs de squelettes grimaçants; le sol brûlé par le feu a une teinte de lèpre; au-dessus de petits tas de charbon s'élèvent[Pg 134] des fumerolles bleues, comme la buée d'un encens. De pareils accidents sont très fréquents dans ces régions; chaque été, en Russie et en Sibérie, des incendies détruisent des milliers d'hectares de forêts.
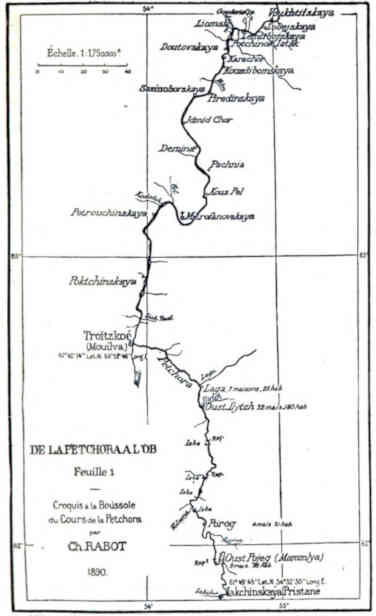
La terre s'enfle légèrement; un boursouflement du sol de trois ou quatre mètres marque la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Kama et celui de la Petchora, entre les tributaires de la Caspienne et ceux de l'océan Glacial; au delà nous traversons à gué la Volonitsa.
Encore quelques marais fangeux, puis le sol se raffermit, les bois s'éclaircissent, la lumière devient plus vive. Au bout de l'avenue apparaît une grande allée bleue, c'est la Petchora, large comme la Seine à Paris, ici à plus de 1 300 kilomètres de son embouchure. Quel plaisir de contempler ce paysage égayé par le mouvement de l'eau courante après être resté trois jours dans une forêt morne et indifférente.
Iaktchinskaya Pristane, situé sur la rive droite du fleuve et non sur la rive gauche, comme l'indiquent les cartes, semble de loin un bourg important. Vous arrivez et quel n'est pas votre étonnement d'y trouver la solitude la plus absolue. Nulle part âme qui vive, toutes les maisons sont fermées, pour le moment une seule est habitée. Iaktchinskaya Pristane est simplement un lieu de foire et l'entrepôt du commerce de la Petchora. Cette localité est occupée seulement au moment du marché et à l'époque des transports, le reste du temps elle n'est habitée que par le gardien des magasins.
Le commerce sur la Petchora a beaucoup plus d'importance qu'on ne serait tenté de le croire au premier abord. Dans cet immense bassin fluvial, grand à peu près comme la France, vit une centaine de mille d'habitants[Pg 135] qui ne communiquent avec le reste du monde que par ce fleuve. Chasseurs et pêcheurs, ils ont besoin de céréales, que ne produit point la terre qu'ils habitent, et d'objets manufacturés, qu'ils ne savent point fabriquer. En échange ils donnent des pelleteries et du poisson. Les négociants de Tcherdine ont en quelque sorte le monopole des affaires sur les bords de la Petchora. En décembre et janvier les marchandises sont transportées par terre à Iaktchinskaya Pristane, puis aux premiers jours de mai, après la débâcle, chargées sur des barques qui vont les disperser dans l'immense rameau fluvial dont la Petchora est le tronc. Vers le 15 août, une partie de cette flottille, la caravane de printemps, comme on l'appelle, remonte à Iaktchinskaya Pristane, rapportant le poisson pris par les Zyrianes après la débâcle; les autres bateaux, la caravane d'automne, reviennent dans les premiers jours d'octobre, principalement avec des cargaisons de saumons. Toutes ces marchandises restent renfermées dans les magasins du port jusqu'à l'époque où le traînage permet de les conduire facilement à Tcherdine.
Pendant l'hiver 1881-1882, de Iaktchinskaya Pristane on a expédié sur la Kama et de là dans la Russie 900 tonnes de divers poissons et 32 tonnes et demie de saumon. Cette année-là, cette dernière pêche n'avait pas été heureuse, d'ordinaire elle produit de 130 à 160 tonnes de ce poisson, particulièrement estimé par les gourmets russes[67].
[67] Ermilov, Poïzdka na Petchorou. Arkhangelsk. 1888.
A la fin de décembre se tient à Iaktchinskaya Pristane une foire importante. On y vient même d'Arkhangelsk, située à plus de 800 lieues de là. C'est principalement[Pg 136] un marché de fourrures. Les indigènes apportent les produits de leur chasse en paiement des marchandises qu'ils ont reçues à crédit l'été précédent, et en même temps font de nouveaux achats. Tout ce commerce se fait sans argent, par troc, absolument comme au Xe siècle, du temps que les Bulgares trafiquaient avec les Permiens. Depuis neuf siècles les mœurs des habitants ne se sont pas modifiées. D'autre part les transactions ne sont pas libres. Étant toujours débiteurs des marchands, les Zyrianes cèdent toutes leurs pelleteries à leurs créanciers pour les rembourser de leurs avances. Un étranger leur offrirait-il de leurs marchandises un meilleur prix que leur acheteur attitré, ils refuseraient de la lui céder, de crainte de perdre crédit chez leurs prêteurs. Les marchands de Tcherdine tiennent ainsi la population de la Petchora dans une dépendance complète. Naturellement ces négociants cotent très haut leurs marchandises, 8 à 10 roubles (24 à 30 francs) les 16 kilogrammes de farine de seigle, et très bas celles des indigènes, de manière à faire pencher toujours la balance en leur faveur. Profiter de la naïveté et de l'ignorance des races inférieures pour les voler, n'est-ce pas ce qu'on appelle en langage noble leur apporter les bienfaits de la civilisation? D'année en année le Zyriane s'endette ainsi de plus en plus. Presque tous les habitants des bords de la Petchora sont débiteurs des gens de Tcherdine et quelques-uns même pour des sommes importantes, 2 à 3 000 francs, un joli denier pour des gens qui n'ont ni sou ni maille. Ces pratiques commerciales sont du reste générales dans le Nord. En Sibérie, à la foire d'Obdorsk les marchands russes emploient les mêmes procédés à l'égard des Ostiaks et des Samoyèdes, et les Norvégiens[Pg 137] agissent de même à l'égard des Lapons. En tout pays l'homme civilisé a les mêmes appétits.
A Iaktchinskaya Pristane nous rencontrons l'ouriadnik Eulampy Arseniev Popov. D'après les ordres que le gouverneur de Vologda a eu l'amabilité de donner, il doit nous accompagner sur la Petchora, non point que les indigènes soient malveillants, mais afin de nous épargner tout ennui pour le recrutement des rameurs. Par suite de circonstances imprévues, Popov nous a accompagnés jusqu'en Sibérie. Dans la mesure de ses moyens, ce brave homme a été pour moi un auxiliaire très précieux, et je ne saurais trop rendre hommage à son intelligence et à sa profonde honnêteté. Popov était Zyriane et avait toutes les qualités de sa race.
Maintenant la route s'ouvre facile. Nous n'avons qu'à nous laisser tranquillement porter par la Petchora et bientôt nous arriverons en vue de l'Oural. C'est une nouvelle navigation de plus de cent cinquante lieues, facile et agréable sur ce beau fleuve.
Le soir de notre arrivée à Iaktchinskaya Pristane, nous nous remettons en marche, et le lendemain matin à trois heures nous atteignons le hameau d'Oust-Pojeg[68].
[68] Mammaly, en langue zyriane.
De suite Boyanus va demander l'hospitalité dans la maison que l'on nous dit être la plus propre. Le khozaïne[69], quoique troublé dans son sommeil, ne nous en reçoit pas moins très amicalement. Ces braves paysans font toujours mon admiration. Vous arrivez chez eux au beau milieu de la nuit, vous bouleversez tout leur intérieur, et toujours ils se montrent[Pg 138] aimables et empressés. La complaisance et la douceur sont le fond de leur caractère. Notre hôte nous abandonne deux pièces. Le mobilier en est sommaire: une table, des bancs, un lit formé de planches clouées au mur. Point de literie, nos couvertures et la tente, étendues sur le bois, la remplacent. Par-dessus nous disposons une grande tente moustiquaire, et à la porte de la chambre est allumé un feu fumeux dans un vase; grâce à ces précautions nous serons à l'abri des moustiques. Voilà la quatrième nuit que nous passons sans sommeil, je vous laisse à penser si nous dormons à poings fermés.
[69] Maître de maison.
Le village d'Oust-Pojeg[70] est situé sur la rive gauche de la Petchora, à 700 mètres environ en aval du confluent de la rivière Pojeg[71], dans une boucle du fleuve.
[70] 98 habitants, tous Zyrianes.
[71] La carte de l'état-major russe (feuille 124) place à tort Oust-Pojeg sur la rive droite de la Petchora et en amont de l'embouchure du Pojeg.
Durant notre séjour à Oust-Pojeg, tout le temps un beau soleil et une température élevée, trop élevée même à notre gré. Le 26 juillet, de neuf heures du matin à huit heures du soir, le thermomètre s'est maintenu à + 26° à l'ombre; le matin au soleil, il marquait + 33°. Pour un pays froid c'est un peu chaud. Avec une pareille température les maisons de bois deviennent des fours, et impossible de les ventiler, sans risquer de laisser pénétrer des essaims de moustiques. L'excès de chaleur est, après tout, préférable aux morsures de ces maudits insectes.

Sur la Petchora, comme sur le Volga, l'intérêt du voyage est dans l'étude de la population. Les Zyrianes, que nous rencontrons pour la première fois, à Oust-Pojeg,[Pg 140] ne sont ni aussi primitifs ni aussi originaux que les Tchérémisses et les Tchouvaches, mais n'en sont pas moins intéressants par certains côtés.
Leur civilisation est plus élevée que celle des Finnois du Volga, mais, vivant au milieu de forêts vierges, sous un climat qui interdit pour ainsi dire toute culture, ils ont dû rester à l'état de chasseurs, tandis que leurs cousins germains des environs de Kazan, habitant des pays plus favorisés, sont devenus agriculteurs.
Les Zyrianes sont disséminés dans la partie orientale des gouvernements d'Arkhangelsk et de Vologda, ainsi que dans l'extrême nord du gouvernement de Perm[72]. Quelques clans sporadiques se trouvent en outre en Sibérie dans le bassin inférieur de l'Obi.
[72] Oust-Pojeg se trouve à la frontière de ce dernier département.
Ces indigènes habitent de petits villages égrenés le long des cours d'eau. Les groupes les plus compacts se rencontrent dans la vallée supérieure de la Petchora[73], sur les rives de son affluent l'Ischma, et de la Witchegda, tributaire de la Dvina, enfin dans la partie supérieure du Mezen et de la Vachka. Ischma est la capitale des Zyrianes. D'après les statistiques, sujettes à caution ici plus que partout ailleurs, l'effectif de ces Finnois serait de 95 000[74], disséminés sur un territoire immense[75].
[73] La carte ethnographique de Rittich indique à tort la haute vallée de la Petchora comme habitée par des Russes. Depuis Oust-Pojeg jusqu'à Oust-Chtchougor, la population n'est composée que de Zyrianes.
[74] Ermilov, loc. cit.
[75] Les statistiques ci-jointes des trois communes (volost) de Troïtskoïé Petchorskoïé, Savinoborskoïé, et Oust-Chtchougor, qui constituent le territoire que nous avons traversé en descendant la Petchora, montrent la dispersion de la population dans cette région.
[Pg 141]

[Pg 142]
Liste des localités habitées dans le volost (canton) de Troïtskoïé Petchorskoïé.
| Têtes imposables. | |
| Village paroissial de Troïtskoïé Petchorskoïé (siélo) | 280 |
| Derevnia Oust-Ilytch | 45 |
| — Poktchinskaïa | 144 |
| Skoliapovskaïa | 47 |
| Kodatchinskaïa | 42 |
| Soïvinskaïa | 13 * |
| Porog | 4 |
| Pilia Stav | 10 * |
| Griché Stav | 8 * |
| Oust-Liaga | 15 |
| Koghil-Ous | 9 * |
| Maximovo | 9 * |
| Mort Ior | 7 * |
| Gord Mou | 15 * |
| Sariou-Oust | 20 * |
| Kodatchdinekost | 7 |
| Iag-ty-di | 2 * |
| Marko-Lasta | 3 * |
| --- | |
| 680 |
Les localités marquées d'un astérisque sont situées sur les bords de l'Ilytch, les autres sur les rives de la Petchora.
Cette statistique est établie d'après le dernier recensement, qui remonte à une dizaine d'années. Actuellement la population du district s'élève à 2 101 (936 hommes, 1 165 femmes).
Liste des localités habitées dans le volost de Savinoborskoïé.
| Distance en verstes au chef-lieu de la commune |
Hommes | Femmes | |
| Village parois. de Savinoborskoïé | 53 | 76 | |
| Derevnia Mitrofanovskaïa | 63 | 31 | 55 |
| — Ovinino | 50 | 17 | 24 |
| Evtyghinskaïa | 40 | 12 | 12 |
| Taïninskaïa | 25 | 30 | 36 |
| Rémino | 15 | 11 | 10 |
| Pyrédinskaïa | 7 | 59 | 78 |
| Kouzdibomskaïa | 20 | 35 | 49 |
| Doutovo | 30 | 28 | 20 |
| Lemty | 40 | 24 | 40 |
| Lemty-boj | 47 | 37 | 38 |
| Colonie Viatskii | 35 | 1 | 1 |
| --- | --- | ||
| 338 | 439 |
Tous ces villages et hameaux sont situés sur les bords de la Petchora.
[Pg 143]
Liste des localités dans le volost d'Oust-Chtchougor.
| Hommes. | Femmes. | |
| Village paroissial d'Oust-Chtchougor | 67 | 65 |
| Derevnia Lébiajskaïa | 4 | 5 |
| — Voukhtylskaïa | 5 | 10 |
| — Podtcherskaïa | 128 | 136 |
| — Boïarskii Iag | 20 | 16 |
| — Oust-Soplias | 12 | 22 |
| — Oust-Voïa | 12 | 17 |
| — Bérézovka | 20 | 29 |
| — Pozorika | 60 | 80 |
| — Boris Dikost | 33 | 34 |
| --- | --- | |
| Population actuelle | 361 | 475 |
Toutes ces localités sont situées sur les bords de la Petchora.
Les villages avec une église portent en russe le nom de siélo et les autres celui de derevnia.
Les Zyrianes, du moins tous ceux que nous avons rencontrés, soumis depuis des siècles à l'influence slave, sont presque complètement russifiés. Sous ce rapport ils peuvent se comparer à leurs voisins les Caréliens, néanmoins chez eux le sentiment de leur individualité ethnique reste vivant. Quand vous les interrogez sur leur nationalité, ils vous répondent toujours avec un sentiment d'orgueil qu'ils sont Zyrianes.
Ces indigènes sont très proches parents des Permiaks, et ne forment en réalité avec eux qu'une seule et même population. La division des Finnois établis dans les hauts bassins de la Kama et de la Petchora, en deux races distinctes, les Zyrianes et les Permiaks, est absolument arbitraire. Les deux populations parlent une langue presque semblable, présentent les mêmes caractères physiques, enfin, dans leur idiome, se donnent le même nom. En langue indigène Zyrianes et Permiaks s'appellent Komy mort (peuple de la Kama), preuve évidente que les premiers ont habité[Pg 144] jadis la vallée de la Kama à côté des seconds et ont ensuite émigré vers le nord. D'après Sjögren, le nom de Zyrianes dériverait du vocable finnois syrjä, signifiant limite ou frontière: ce serait donc la tribu établie aux confins de la région, étymologie que confirme la topographie.
Les Zyrianes les plus caractérisés que nous ayons rencontrés sont les habitants d'Oust-Pojeg. L'usage de la langue russe leur est encore peu familier, aux femmes surtout.
A l'inverse de ce que l'on observe généralement, seuls les hommes ont conservé en partie le costume national. L'été, tous sont vêtus d'un pantalon et d'une blouse-chemise en toile blanche. L'hiver, ils endossent un long et épais kaftan blanc et par-dessus un louzane, lorsqu'ils vont à la chasse. Ce dernier vêtement, spécial aux Zyrianes, est un plastron double tombant par devant et par derrière jusqu'à la ceinture, autour de laquelle il est fixé par des courroies, et qui laisse les bras complètement libres. Figurez-vous une très longue bavette carrée descendant jusqu'au ventre. Le louzane est en laine grossière, décorée de raies noires et blanches; dans le dos est appliquée une courroie servant à porter la hache du chasseur. A Oust-Chtchougor des gamins d'une quinzaine d'années étaient vêtus de blouses en toile blanche munies d'un capuchon pour les préserver des moustiques, semblables à l'anourak des Eskimos.
L'hiver, les indigènes sont coiffés d'un bonnet, présentant le même dessin que le louzane. L'été, la plupart ont la casquette noire des Russes. Les Zyrianes sont chaussés de bottes basses en cuir, qu'ils confectionnent eux-mêmes. Comme les Tchérémisses et les Tchouvaches, en place de chaussettes[Pg 146] ils s'entourent les pieds de morceaux de toile, et, ainsi que les Lapons, mettent une couche de joncs sur la semelle de leurs bottes[76].
[76] Ces chaussures portent le nom de kom, vocable que l'on peut rapprocher du mot lapon komager, employé par ce dernier peuple pour désigner les mocassins.
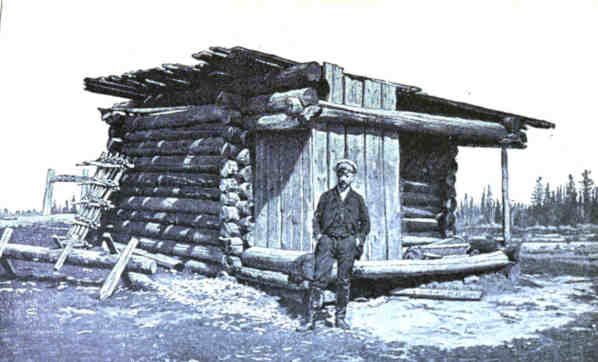
Toutes les femmes portent le sarafane. Pour les travaux de la maison elles endossent souvent un caraco en grosse toile carmin foncé. En hiver les indigènes portent des bas et des gants en laine de différentes couleurs, dessinant des denticules et des losanges d'un effet très agréable à l'œil. C'est la seule trace d'art indigène observée chez les Zyrianes.
Les habitations zyrianes (kerka) présentent une très grande ressemblance avec celles des Permiaks. C'est la même architecture et la même disposition intérieure: deux pièces occupant chacune une moitié de la maison, et ouvrant sur un vestibule (posvod) auquel accède un escalier couvert, accoté à la façade; par derrière, une cour surmontée d'un grenier. Les pièces de l'habitation sont généralement divisées jusqu'à mi-hauteur en deux parties par une cloison. Quelques maisons ont un type moins particulier; en place d'escalier, elles ont un simple perron de trois ou quatre marches et sont situées par suite à une moindre hauteur au-dessus du sol.
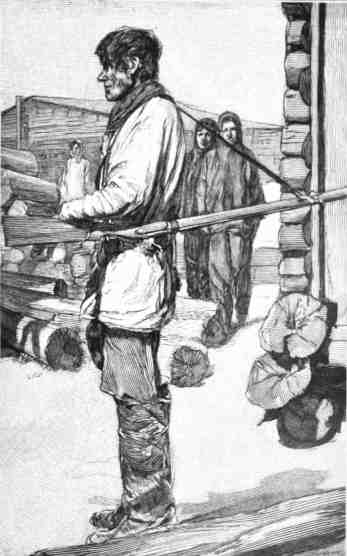
Chaque habitation a une maison de bains[77] (poulchiane) et une glacière, une cave profonde pour conserver le laitage et le poisson frais. Comme type de construction spécial à cette région nous devons également signaler un magasin isolé au-dessus du sol[Pg 148] par quatre ou six piliers pour tenir les provisions à l'abri des rongeurs. C'est la même architecture que celle du stabbur norvégien. En été, lors de la fenaison et de la pêche, les Zyrianes s'absentent souvent durant plusieurs semaines. Pour se mettre à l'abri pendant ces excursions ils édifient des appentis en écorce de bouleau, appelés tchioume. Les différentes constructions zyrianes sont, bien entendu, en bois. Elles sont d'abord plus chaudes que celles en pierre, et dans tout le pays on ne trouve pas le moindre affleurement rocheux.
[77] Très simple est la maison de bains: un petit vestibule garni de bancs, puis une pièce également bordée de bancs et d'une sorte d'estrade élevée.
Les habitants d'Oust-Pojeg et en général les Zyrianes de la Petchora supérieure sont tour à tour, suivant les saisons, agriculteurs, chasseurs ou pêcheurs. Sous un climat aussi rude que celui de cette région la culture ne fournit que des ressources précaires et insuffisantes. Survienne une gelée en août, la récolte est perdue; même dans les bonnes années, elle ne peut donner le pain quotidien aux indigènes, et les pauvres gens mourraient de faim l'hiver si la chasse et la pêche ne leur fournissaient les moyens d'acheter de la farine aux marchands de Tcherdine.

A Oust-Pojeg et dans la vallée supérieure de la Petchora, on cultive quelques carrés de seigle, d'orge[78], de pommes de terre, de choux et de raves[79]. Les instruments aratoires employés par les Zyrianes sont la charrue à bêche[80] (soka) et une herse avec dents[Pg 150] en bois. Aux produits de cette agriculture primitive les indigènes ajoutent ceux de l'élevage du bétail. Ils ont des chevaux, des vaches, des moutons, mais point de chèvres ni de porcs[81]. A Oust-Pojeg une vache vaut environ 50 francs, un cheval 100 francs, une brebis 3 fr. 50 à 5 francs, une poule 1 fr. 50 et un chien de chasse de 12 à 18 francs. Jugez par ces prix de la valeur de l'argent dans ce désert.
[78] Dans le bassin de la Petchora, la limite septentrionale des céréales passe un peu au-dessous de 66° de lat. N. A Oust-Oussa, l'orge vient à maturité et quelquefois le seigle (Schrenk, Reise nach dem Nordosten des europäischen Russlands, etc. Dorpat, 1848 et 1854). Dans le volost d'Oust-Chtchougor il n'y a cependant aucune culture.
[79] Le village possède 70 hectares et demi de terres cultivables.
[80] Instrument également en usage dans la vallée du Volga.
[81] Statistique du bétail dans les cantons de Troïtskoïé Petchorskoïé, de Savinoborskoïé et d'Oust-Chtchougor (1889):
| Bêtes à cornes. | Chevaux. | Moutons. | |
| Troïtskoïé Petchorskoïé | 587 | 357 | 1 167 |
| Savinoborskoïé | 476 | 229 | 1 191 |
| Oust-Chtchougor | 340 | 214 | 1 605 |
Jadis la chasse procurait aux Zyrianes le plus clair de leur revenu, mais aujourd'hui le gibier a, paraît-il, beaucoup diminué, surtout les lagopèdes. Ces oiseaux, racontent les indigènes, ont été poussés vers le nord par les vents du sud, qui, affirment-ils, soufflent depuis plusieurs années, et ont été noyés dans l'océan Glacial[82].
[82] Ermilov, loc. cit.
Actuellement un bon chasseur tue par an: 150 écureuils, 100 gelinottes et 200 coqs de bruyère[83]. Un assez joli tableau! A l'écureuil surtout, les Zyrianes font une guerre acharnée; la dépouille de ce rongeur constitue le principal article de leurs échanges avec les marchands russes. Dans la région de la Petchora, cette peau est pour ainsi dire l'unité monétaire. Demandez à un indigène le prix d'une denrée ou d'un objet, le plus souvent il vous répondra tant de peaux d'écureuil, et ce n'est qu'après avoir longtemps[Pg 151] réfléchi qu'il vous indiquera sa valeur en argent.
[83] Ermilov, loc. cit.
Statistique des produits de la chasse en 1889.
| Troïtskoïé Petchorskoïé. | ||
| Valeur en roubles. | ||
| Écureuils | 12 000 | 2 520 |
| Autres animaux à fourrure (hermines, zibelines, lièvres, ours) | 539 | 427 |
| Gelinottes | 10 000 | 2 000 |
| Autres oiseaux | 1 000 | 200 |
| Savinoborskoïé. | ||
| Écureuils | 3 600 | 680 |
| Autres animaux à fourrure (hermines, zibelines, lièvres, ours) | 13 | 91 |
| Gelinottes | 4 000 | 800 |
| Autres oiseaux | 415 | 130 |
| Oust-Chtchougor. | ||
| Écureuils | 2 115 | 1 830 |
Il y a deux périodes de chasse: l'une en automne, du commencement d'octobre au milieu de décembre, et l'autre au printemps, de février à avril.
Les Zyrianes sont très habiles tireurs, bien que leurs fusils ne soient pas précisément du dernier modèle. Celui figuré ci-après montre l'état de l'armurerie sur les bords de la Petchora. Pour faire tomber le chien on doit déclencher un os accroché à un clou. L'hiver l'armement du chasseur est complété par une paire de patins à neige[84].
[84] Ces patins mesurent une longueur de 1m,62 et une largeur de 0m,145. Ils sont donc très différents des ski norvégiens, longs parfois de 3 mètres et larges de 7 centimètres.
Les Zyrianes capturent le coq de bruyère à l'aide[Pg 152] de pièges qui écrasent l'oiseau. Dans le but de ménager la poudre, denrée rare et chère dans ces pays, ils ont imaginé une grande variété de ces engins, d'une ingéniosité remarquable[85]. Les habitants de quelques villages disposent sur le bord des cours d'eau des nids artificiels afin de récolter des œufs de palmipèdes. Quelquefois ils les font couver par des poules et se procurent ainsi des canards domestiques.
[85] Un grand nombre de ces pièges sont figurés dans l'ouvrage d'Hoffmann, Der Nördliche Ural und das Küstengebirge Pae-Choi.

Une chasse curieuse est celle faite aux palmipèdes lors de la mue. Trois ou quatre chasseurs montés dans des barques descendent une rivière en pourchassant devant eux les canards incapables de s'envoler. Rencontrent-ils un affluent, les Zyrianes l'explorent également et en chassent les oiseaux vers le gros de la bande, resté dans le cours d'eau principal. La descente de la rivière dure quelquefois plusieurs jours; pour ne pas amaigrir les oiseaux par la fatigue, les chasseurs les laissent reposer la nuit dans des endroits qu'ils ont au préalable reconnus. Une fois arrivés à l'embouchure du cours d'eau, les Zyrianes poussent la troupe de volatiles vers un immense filet disposé à cet effet sur la rive et les obligent[Pg 153] à s'y engouffrer. Par ce moyen on peut capturer de 1 500 à 2 000 oiseaux[86].
[86] Schrenk, loc. cit., p. 264.
La pêche la plus lucrative sur les bords de la Petchora est celle du saumon. Les habitants d'Oust-Pojeg en prennent de 200 à 240 kilogrammes, valant de 4 à 10 roubles les 16 kilogrammes[87]. Elle se fait de la fin de juin à septembre; les autres poissons[88] sont capturés au printemps et en automne[89]. Les Zyrianes pêchent au flambeau, tendent des filets fixes[90], ou obstruent les rivières par des barrages de filets au milieu desquels ils placent des nasses en osier. Comme les Lapons et les Finnois de Finlande, ils emploient, en place de flotteurs, des palettes en bois et des morceaux d'écorce de bouleau et, en guise de plombs, des pierres enveloppées d'écorce ou des morceaux d'argile cuite.
[87] Les 16 kilogrammes de S. lavaretus valent 2 roubles.
[88] Ces espèces sont: le Salmo lavaretus, le C. Leucichthys Gylden, le S. Thymallus, la perche, le brochet, la lotte commune, le Thymallus vexillifer, l'Acerina cernua et le Squalius grislagine L.
[89] Produits de la pêche en 1889.
| Valant. | ||
| Volost de Troïtskoïé Petchorskoïé | 1 920 kilogr. | 216 roubles. |
| Volost de Savinoborskoïé | 2 680 — | 360 — |
| Volost d'Oust-Chtchougor | 1 600 — |
[90] Ces filets portent le nom de koulam et ont une longueur moyenne de 5 mètres.
Dans le nord du bassin de la Petchora, sur les toundras riveraines de l'océan Glacial, un certain nombre de Zyrianes sont pasteurs de rennes et par suite astreints à la vie nomade[91]. Dans le district de[Pg 154] Poustosersk ils possèdent les troupeaux les plus nombreux, qu'ils ont acquis aux dépens des Samoyèdes. Au delà de l'Oural nous avons rencontré plusieurs de ces Finnois propriétaires de milliers de rennes, qu'ils faisaient garder par des Ostiaks.
[91] La plupart sont originaires d'Ischma. Ils vivent dans des tentes, couvertes l'été d'écorce de bouleau et l'hiver de peaux de renne.
Les Zyrianes forment une population vigoureuse et intelligente, particulièrement douée pour le commerce. Durant l'hiver un grand nombre vont trafiquer avec les Ostiaks au delà de l'Oural. Dans ces transactions ils affirment leur supériorité intellectuelle par un manque complet de scrupules. L'acheteur se présente toujours avec des bouteilles d'eau-de-vie; une fois le vendeur enivré, il lui donne, en échange de belles fourrures, de la ferraille clinquante, très appréciée des Ostiaks. Il vend par exemple 1 fr. 50 des boutons en cuivre qui valent bien un centime. Dans les idées de ces Finnois comme de beaucoup de gens civilisés, le commerce c'est le vol autorisé. Mais entre eux et avec les voyageurs, les Zyrianes sont d'une scrupuleuse honnêteté. Chez ces indigènes l'usage des serrures est inconnu, tout est ouvert à tout venant et jamais rien n'est pris. La langue zyriane n'aurait même, dit-on, aucun vocable pour désigner l'idée de vol. Dans les cabanes situées sur le bord des rivières ils placent en évidence des vivres à la disposition des passants, et ceux qui en ont besoin les prennent après en avoir déposé scrupuleusement le prix habituel.
Privés pour ainsi dire de toute communication avec les pays manufacturiers, les Zyrianes fabriquent eux-mêmes leurs ustensiles de ménage. Le bois et l'écorce sont les seules matières premières qu'ils aient à leur disposition; aujourd'hui encore le fer est rare et cher dans ce pays. C'est l'âge du bois. Les[Pg 155] assiettes et les tasses sont en pin; avec l'écorce du bouleau les indigènes confectionnent des sacs, des seaux, des bouteilles servant de salières, des cordes et des corbeilles. Leur mobilier présente une très grande analogie avec celui des Finnois de Finlande.

Chez les Zyrianes, aucune trace de paganisme. Depuis longtemps ils ont été convertis au catholicisme grec; un grand nombre appartiennent toutefois aux sectes dissidentes. Dans ces pays sans voies de communication le raskol a trouvé un asile à peu près inviolable contre la persécution. Certain village habité par des vieux-croyants se trouve à plus de 230 kilomètres de l'église paroissiale, et sur toute cette distance pas de route. Les schismatiques peuvent ainsi vivre dans la paix la plus complète. En tout pays les déserts sont l'asile de la liberté.
[Pg 156]
Description générale du fleuve.—Importance historique de cette région.—La Permie et la Iougrie.—Commerce des Arabes et des Byzantins dans ces régions.—La Petchora route d'exportation pour le commerce de l'Orient.—Les Normands.—Traces d'influence scandinave relevées chez les Permiaks et les Zyrianes.—Arrivée des Novgorodiens.—Les Anglais à l'embouchure de la Petchora.—Avenir de la région de la Petchora.
La Petchora, que nous allons descendre jusqu'aux abords du cercle polaire, prend sa source dans l'Oural par 62° 11, de lat. N. Jusqu'au confluent de la Volosnitsa elle coule torrentueuse entre des berges percées de grottes: d'où son nom de Petchora. Petchora est la forme slavone du vocable russe Pechtchéra (caverne)[92]. Cette partie du fleuve, appelée Petite Petchora, n'est point navigable[93].
[92] Schrenk, loc. cit.
[93] D'après J.-Ch. Stuckenberg (Hydrographie des russischen Reichs, IIe vol. Saint-Pétersbourg, 1884), la Petite Petchora s'étendrait jusqu'au confluent de la Mouïlva.
Au delà de la Volosnitsa commence la Grande Petchora. Dans sa partie supérieure elle n'est accessible aux barges que lors des hautes eaux du printemps.[Pg 157] Plus en aval, en été, la navigation n'est pas non plus toujours facile. Entre Troïtskoïé Petchorskoïé et Oust-Chtchougor, notre vapeur échoua à différentes reprises, bien qu'il fût à fond plat. Le milieu d'août est l'époque des plus basses eaux; dans les premiers jours de septembre, le niveau remonte sous l'influence des pluies d'automne.
Durant cinq mois, dans la partie méridionale du bassin et seulement pendant quatre dans la région nord, la navigation est possible. A Iaktchinskaya Pristane, la débâcle se produit à la fin d'avril ou au commencement de mai, et dès les premiers jours d'octobre le fleuve se recouvre de glace. Sept mois d'hiver, deux mois et demi de froid, et dix semaines d'été, tel est le climat de cette région. Certaines années le thermomètre ne reste toujours au-dessus de zéro que pendant deux mois, en juillet et août. Durant la courte période estivale la chaleur s'élève à + 26°, et en hiver le froid atteint - 44°. L'écart entre les températures extrêmes est de 70°!
A la fonte des neiges la Petchora éprouve une crue considérable. A Iaktchinskaya Pristane, le niveau des eaux resserrées entre de hautes berges s'élève d'une quinzaine de mètres; à Oust-Pojeg, où la rivière est très large, la hauteur de la crue ne dépasse guère 6 à 7 mètres et à Troïtskoïé Petchorskoïé 5 à 8 m. 50.
A la fin de l'époque quaternaire la Petchora a eu, comme les autres rivières du nord, un débit beaucoup plus considérable qu'aujourd'hui. Sur tout le cours du fleuve une ligne presque continue de deux terrasses marque les variations de niveau subies par le fleuve depuis cette période géologique[94]. La position[Pg 158] et la hauteur de ces anciennes berges sont très variables. A Iaktchinskaya Pristane, sur la rive gauche, à 10 mètres au-dessous de la surface normale de la plaine, est située une terrasse dominant d'une dizaine de mètres la berge actuelle du fleuve. A Oust-Pojeg, sur la rive droite, la plus haute terrasse atteint 35 mètres, la plus basse s'élève seulement de 6 à 7 mètres au-dessus des eaux. A Troïtskoïé Petchorskoïé, la première ligne d'ancien niveau sur laquelle est bâti le village se trouve à une douzaine de mètres au-dessus du fleuve; la seconde, surmontée par l'église, est plus élevée d'une vingtaine de mètres. A Podcherem, les deux terrasses se trouvent respectivement à 10 et 20 mètres au-dessus du niveau actuel. La hauteur des terrasses semble donc croître à mesure que l'on avance vers le nord.
[94] Sur la Kolva et la Poza, Schrenk signale également l'existence de deux terrasses très nettes situées de 100 à 200 ou 300 «brasses» l'une de l'autre.
Dans la région de la Petchora que nous avons parcourue, nous n'avons point observé la prédominance d'une berge élevée sur la rive droite, comme dans les vallées des grands fleuves de Sibérie coulant dans une direction voisine du méridien. En maints endroits la rive droite de la Petchora est basse tandis que sur le bord opposé s'élèvent de hautes terrasses. Sur la berge basse s'étend généralement à une petite distance du fleuve une suite de nappes d'eau marécageuses formant une ligne de fausses rivières.
Depuis Iaktchinskaya Pristane jusqu'à Oust-Chtchougor, nulle part nous n'avons reconnu la présence de la roche en place. Partout les berges sont constituées par des sables renfermant des strates de graviers. Par endroits ces sables plus ou moins agglutinés[Pg 159] par un ciment ferrugineux prennent l'aspect de grès.
Aujourd'hui inutile et à l'écart du grand mouvement des échanges, le bassin de la Petchora a été jadis un des centres commerciaux les plus importants de l'Europe et une des principales voies historiques de la Russie. Dans cette région actuellement délaissée ont passé les peuples les plus divers. Par le sud sont venus les Arabes, par le nord les Normands, et plus tard ce grand fleuve et ses affluents de droite ont conduit les Slaves en Sibérie avant la conquête de Iermak.
A ces mouvements de peuples la nature avait elle-même tracé la route. Examinez une carte, et au premier coup d'œil vous êtes frappé par l'enchevêtrement des divers bassins fluviaux de la Russie orientale. Entre les affluents du Volga et ceux de la Dvina ou de la Petchora, nulle part une colline, nulle part un relief du sol; partout des terres basses à travers lesquelles il est facile de traîner un canot d'une rivière à l'autre, partout des isthmes étroits, de ces portages qui ont été les voies historiques de la Russie. Dans le Nord russe comme au Canada, les portages ont tracé les voies à la colonisation. A l'existence de ces isthmes les régions inclinées vers l'océan Glacial doivent leur union au grand empire slave. Sans cette particularité topographique, les immensités du gouvernement d'Arkhangelsk auraient été fermées à l'influence russe et seraient restées un désert pareil aux parties les plus reculées de la Sibérie.
Dans le nord du gouvernement de Perm, entre le bassin de la Caspienne et les grands fleuves tributaires de l'océan Glacial, trois portages établissent des communications: celui entre la Vogoulka et la[Pg 160] Petchora, que nous avons suivi, celui des Keltma, aboutissant à la Dvina[95], et l'isthme séparant un affluent de la Bérésovka d'un tributaire de la Vitchegda. D'autre part, en de nombreux points, les affluents de la Petchora et de la Dvina se rejoignent presque et permettent de passer sans trop de difficultés d'un bassin dans l'autre.
[95] Sous le règne de la grande Catherine fut décidé et sous celui d'Alexandre Ier fut creusé un canal unissant ces deux cours d'eau. L'exécution de ce travail a été particulièrement importante pour l'histoire naturelle en permettant le mélange de la faune du Volga à celle du nord. Par cette voie les sterlets ont pénétré dans le bassin de la Dvina. (Schrenk, loc. cit.)
Si bien desservie qu'elle fût par des routes naturelles, la région de la Petchora n'aurait point eu d'histoire sans sa prodigieuse richesse en animaux à fourrure. Dans l'immense forêt qui couvre le pays, zibelines, loutres, martres, petit-gris, renards noirs, blancs ou bleus, pullulaient jadis plus nombreux alors qu'aujourd'hui et Dieu sait pourtant s'ils y sont encore abondants. Ces animaux, les indigènes les poursuivaient avec acharnement, comme le font de nos jours les Zyrianes, pour se procurer les pelleteries, qu'ils vendaient ensuite aux peuples du nord et du midi. Aux produits de la chasse les habitants de la région de la Petchora ajoutaient d'autres fourrures, qu'ils se procuraient chez les peuplades établies plus au nord et à l'est de l'Oural. De très bonne heure les Finnois de la Petchora ont traversé l'Oural septentrional et sont allés commercer dans le bassin de l'Obi.
Dans les premiers documents de l'histoire russe les régions septentrionales d'Europe et d'Asie portent les noms de Permie et de Iougrie.
Durant le moyen âge et même durant une partie[Pg 161] des temps modernes, ces contrées passaient pour un Eldorado septentrional. C'était le pays des fourrures comme, il y a quelques années, les territoires voisins de la baie d'Hudson, et, de tous les côtés, les peuples les plus divers venaient y chercher de précieuses pelleteries: les Arabes, les Mongols, les Byzantins, les Normands, les Novgorodiens.
Du temps de la splendeur de Bolgar les marchands arabes qui venaient trafiquer sur le Volga pénétrèrent dans la Permie[96]. Les renseignements contenus dans les géographes musulmans montrent qu'ils ont eu connaissance de la région de la Petchora et même de la partie la plus septentrionale. Le pays des Ténèbres, d'Ibn Batoutah, situé à quarante jours de Bolgar, est évidemment cette contrée.
[96] Près de Perm, des monnaies arabes et koufiques ont été découvertes.
La réputation de la Permie devint rapidement universelle. Les annalistes byzantins et slaves comme les géographes arabes relatent tous la prodigieuse richesse de ces pays du Nord en fourrures précieuses. Le récit de Marco Polo montre d'autre part les relations des Mongols avec les peuples de la Iougrie.
Par l'intermédiaire des Novgorodiens les riches pelleteries de la Permie et de la Iougrie arrivaient jusqu'à Byzance, et d'autre part de magnifiques produits de l'art grec parvenaient aux Permiens[97].
[97] Dans le gouvernement de Perm, des fouilles ont mis à jour de superbes vases en argent du style byzantin le plus pur. (Aspelin, loc. cit.)
En même temps que les Permiens commerçaient avec les pays d'Orient, ils entretenaient des relations suivies avec les Normands que leur humeur aventureuse avait conduits jusqu'à la mer Blanche. Dans les[Pg 162] sagas scandinaves ces Finnois sont désignés sous le nom de Bjarmes et leur pays sous celui de Bjarmland. Le Bjarmland comprenait tout le nord-est de la Russie, le littoral de la mer Blanche, le bassin de la Dvina et de la Petchora et une partie de la vallée de la Kama. Sous un même nom, les Norvégiens désignaient le pays des Tchoudes Zavolotskaïens et la Permie des annalistes slaves. Dans les anciens documents scandinaves, la mer Blanche porte le nom de Gandvig et la Dvina celui de Wimr.
Les Normands remontèrent la Dvina et, soit par les portages de la Poza, soit par ceux de la Vitchegda, atteignirent la Petchora et la région avoisinant la Kama. Eux aussi étaient attirés dans cette région lointaine de la Russie par le désir de se procurer de belles fourrures. Outre les pelleteries, les Scandinaves achetaient dans le Bjarmland des marchandises d'Orient que les Permiens recevaient des Arabes et des Bulgares. Bientôt à travers ces solitudes s'ouvrit une route d'exportation pour le commerce de l'Asie. Les Permiens transportaient les marchandises à travers la région des portages, puis descendaient la Petchora ou la Dvina pour les remettre aux Scandinaves, qui les portaient ensuite dans l'Europe occidentale[98]. La plus grande partie de ce trafic devait[Pg 163] se faire par la Dvina en empruntant le portage des Keltma et celui entre la Bérésovka et le Nem, de préférence à la route beaucoup plus longue de la Petchora. Alors comme aujourd'hui, c'était de Tcherdine que partaient les caravanes de marchandises destinées aux Normands. Sur la Dvina l'entrepôt de ce commerce était Kolmogor[99], l'Holmgaard des Scandinaves, situé à 47 milles de la mer Blanche, à une petite distance en aval du confluent de la Pinéga.
[98] Rasmussen, Essai historique et géographique sur le commerce et les relations des Arabes et des Persans avec la Russie et la Scandinavie durant le moyen âge. Journal de la Société asiatique, t. V, 1824. «Les marchandises, en remontant le Volga et la Kama, étaient transportées de la Bulgarie à Tcherdine, ancienne ville commerciale sur la Kolva. Les Bjarmiens apportaient les produits de l'Asie méridionale et ceux de leur propre pays à la Petchora et à la mer Glaciale; ils recevaient en échange des fourrures pour les habitants de l'Asie méridionale. Là ils trouvaient les Scandinaves qui faisaient voile pour le Bjarmland, c'est-à-dire la Permie, maintenant le pays d'Arkhangel.»
[99] Le premier document faisant mention de cette localité est une lettre du grand-duc Ivan Ivanovitch (1355-1359) au poradnik (gouverneur de la Dvina), mais, bien avant l'arrivée des Russes dans cette région, il y avait là un établissement florissant fréquenté par les Scandinaves et les Permiens. Early Voyages and Travels to Russia and Persia by Anthony Jenkinson, etc. Printed for the Hakluyt Society, vol. I, p. 23, n. 1.
Le premier texte relatif aux incursions des Normands dans la mer Blanche est le récit du voyage d'Othère, accompli au IXe siècle, que nous a conservé le roi d'Angleterre Alfred dans sa version du livre de Paul Orose, De miseria mundi. Mais bien avant cette date, dès le IIIe siècle, les Scandinaves auraient atteint la mer Blanche[100]. Si Othère a eu l'honneur d'être considéré comme le découvreur de cette région, cela tient à ce que, plus heureux que d'autres aventuriers, la relation de son expédition a été préservée de l'oubli grâce au roi Alfred.
[100] J.-Ch. Stuckenberg, loc. cit.
Les voyages des Normands au Bjarmland n'eurent pas toujours un caractère pacifique. Sur les bords de la mer Blanche comme ailleurs, les Scandinaves se comportèrent souvent en pirates et rançonnèrent les populations. La saga d'Harald Haarfager (IXe siècle) mentionne, par exemple, une grande victoire remportée par Eirik Haraldson sur les Bjarmes, et sous[Pg 164] Olaf le Saint un certain Thore pilla l'idole de Iumala, la divinité des Bjarmes, statue couverte d'or et d'argent, racontent les légendes.
A partir de 1217 les Scandinaves cessèrent leurs voyages dans le Bjarmland, et, de cette époque jusqu'au voyage de l'Anglais Chancelor en 1553, la mer Blanche et la Dvina cessèrent d'être une des routes d'exportation de la Russie.
Les expéditions des Normands sur les bords de la mer Blanche sont un fait historique certain, attesté par de nombreux documents, mais aucun texte ne mentionne leur pénétration jusqu'au centre de la Permie et l'existence d'une ancienne route de commerce entre Tcherdine et Kolmogor. Tchoulkov, Storch, Strahlenberg, Rasmussen, H. Muller, Sjögren, pour ne citer que les principaux historiens, relatent tous les relations des Permiens avec les Scandinaves par la Dvina ou la Petchora, sans citer, il est vrai, aucune preuve[101]. Récemment l'archéologue finlandais Aspelin a révoqué en doute ce fait qui semblait acquis, sans, lui aussi, fournir la démonstration de son opinion. Dans cette discussion l'ethnographie vient au secours de l'histoire; en l'absence de documents écrits, les traces d'influence scandinave relevées par nous chez les Permiaks et les Zyrianes permettent d'affirmer que les Normands ont pénétré jusque dans la Permie méridionale. Les Permiens ont eu avec eux des relations assez fréquentes pour que des unions aient pu se produire et qu'ils aient adopté une partie de la civilisation scandinave.
[101] Tchoulkov, Geschichte des Russischen Commerzes, IV, 6, p. 405, 407.
Les Permiaks, par exemple, ont des salières en[Pg 165] bois, en forme d'oiseau, présentant une grande analogie de forme avec des ustensiles du même genre que fabriquent encore aujourd'hui les paysans scandinaves. D'autre part, chez les Zyrianes on trouve des bâtons couverts de signes géométriques servant de calendriers, offrant une grande similitude avec les anciens calendriers norvégiens. Sur celui figuré ci-contre d'après la gravure insérée dans le travail de M. Kouznetzov[102], les jours de la semaine sont indiqués par un trait horizontal, les dimanches par une croix, les jours de jeûne par un trait oblique, les dimanches pour lesquels le jeûne est prescrit par une croix oblique, et les fêtes par des points[103].
[102] H.-J. Kouznetsov, Priroda i jiteli vostotchnago sklona sievernago Ourala, in Izviéstia imperatorskago rousskago geografitcheskago obchtchestva, t. XXII, 1887. Saint-Pétersbourg.
[103] Le calendrier reproduit ci-contre indique les fêtes suivantes: 1er août (jour du Sauveur), 6 août (Transfiguration), 15 août (l'Assomption), 29 août (la Décapitation de saint Jean-Baptiste), 1er septembre (fête de saint Simon le Stylite), 8 septembre (Nativité de la Vierge), 14 septembre (Érection de la Croix) (les dates sont celles du vieux style). Les autres mois sont tracés sur les différentes faces du bâton. Les jours écoulés sont indiqués par une entaille.


[Pg 166]
Enfin les affinités anthropologiques des Zyrianes actuels et des Norvégiens[104] ont été mises en évidence par M. Sommier. De l'avis de ce savant voyageur les Zyrianes sont des Finnois germanisés par l'influence normande.
[104] S. Sommier, Un Estate in Siberia. Florence, 1883.
Les portages qui relient le bassin de la Dvina à celui de la Petchora ont conduit les Slaves dans cette dernière région.
A la fin du IXe siècle ou au commencement du Xe, les Novgorodiens pénétrèrent dans le bassin de la Dvina, habité par les Tchoudes Zavolotchskaïens, et de là s'avancèrent vers le pays des fourrures situé plus à l'est, dont l'existence leur avait été révélée par les Finnois du Volga. Pour se procurer de précieuses pelleteries ils avaient été jusque-là obligés de les acheter aux Bolgares; en gens avisés, ils préféraient les obtenir eux-mêmes.
Dès le commencement du XIe siècle les Slaves atteignirent la Petchora et tentèrent de traverser l'Oural pour atteindre la fameuse Iougrie. En 1032, ils essayèrent de franchir les «Portes de Fer», mais furent battus par les Iougriens. Parmi les historiens, l'identification de ce passage a fait l'objet de longues discussions ennuyeuses, comme toutes les dissertations de ce genre. Suivant les uns, ce nom s'appliquerait au détroit de Vaïgatche, qui sépare l'île de ce nom du continent, d'après les autres, et c'est l'explication la plus plausible, il désigne une passe de l'Oural, peut-être celle formée par la vallée de Chtchougor[105].
[105] A une petite distance du confluent de la Petchora et de la Chtchougor, se rencontre un défilé appelé encore aujourd'hui les Portes de Fer (Ouldor-Kyrta en zyriane). D'après Sjögren, le passage dont il est question ici serait situé, au contraire, beaucoup plus à l'ouest, entre la Syssola et la Vodtcha.
[Pg 167]
A la fin du XIe siècle, en 1096, la région de la Petchora était tributaire de Novgorod; quelques années plus tard la Iougrie le devint également; mais cet établissement fut de courte durée. Moins d'un siècle plus tard, en 1187, les indigènes se soulevèrent et massacrèrent les représentants de la grande république non seulement dans la Iougrie, mais encore dans les pays à l'ouest de l'Oural septentrional, jusque dans le Zavolotche. Désormais, pendant bien des années, ces régions furent perdues pour Novgorod. En 1193, la république fit une nouvelle tentative infructueuse pour rétablir son autorité dans ces pays. Cet insuccès ne découragea pas les Novgorodiens, et, en 1264, la Iougrie et le «volost de la Petchora» étaient redevenus leurs tributaires[106].
[106] S. Sommier, Sirieni, Ostiacchi e Samoiedi dell'Ob. Florence, 1887.
Après la soumission de Novgorod à Ivan le Grand, la Iougrie dut payer tribut aux princes de Moscou, mais ce ne fut pas sans résistance de la part des indigènes. En 1465 et 1483, Ivan envoya des armées au delà de l'Oural. La seconde expédition passa les monts, probablement par le seuil d'Iékatérinebourg, prit la ville de Sibir, descendit l'Irtich, puis l'Ob et ne se retira qu'après avoir obtenu la soumission des Ostiaks. L'année suivante, les princes iougriens vinrent à Moscou présenter leurs hommages au Grand-Prince[107]. Cette armée fraya la route que devait suivre Iermak un siècle plus tard.
[107] S. Sommier, ibid.
En 1499 eut lieu une troisième expédition en Iougrie.[Pg 168] L'armée, forte de 4 000 hommes, tous montés sur des patins, partit des bouches de la Petchora, le 21 novembre, et, après deux semaines de marche, atteignit l'Oural. Au passage des monts elle culbuta une troupe de Samoyèdes et atteignit bientôt sur la haute Sygva la place forte de Liapine, dont elle s'empara. Divisés en deux corps, les envahisseurs se rendirent maîtres successivement de plus de quarante places fortifiées en faisant un grand nombre de prisonniers. L'autorité du grand-prince de Moscou était définitivement établie dans la Iougrie.
Pour arriver à Liapine, l'armée russe remonta la vallée de la Chtchougor. Pendant le moyen âge cette route a été très fréquentée; c'est le seul passage de l'Oural mentionné par Herberstein. Par cette voie passait le commerce entre la Moscovie et la Iougrie, et les Slaves pénétraient en Sibérie jusqu'à l'Obi. A la fin du XVIe siècle, une fois que Iermak eut franchi l'Oural central, la vallée de la Chtchougor fut peu à peu abandonnée. La dépression par laquelle passe aujourd'hui le chemin de fer de Perm à Tioumen devint la grande route de Sibérie, et les passages du nord ne servirent plus qu'aux chasseurs indigènes et aux nomades. La région de la Petchora cessa d'être la voie du transit entre la Russie et les pays à fourrures de l'Asie septentrionale.
A cette époque, une nouvelle période d'activité s'ouvre pour la Russie septentrionale. En 1553, l'Anglais Chancelor atteignait la mer Blanche et par la Dvina arrivait à la cour d'Ivan le Grand. Des relations commerciales et diplomatiques s'établirent bientôt par cette voie entre le tsar et la reine d'Angleterre. Comme au temps des Normands, la Dvina devint la grande route du commerce entre le nord[Pg 169] de l'Europe et les pays d'Orient. Par cette voie septentrionale les premiers Anglais pénétrèrent en Asie centrale. En 1557, Jenkinson, employé de la Muscovy Company, compagnie anglaise fondée pour exploiter le commerce de la Russie, gagna la mer Blanche, de là, par la Dvina, le Volga et la Caspienne parvint à Samarcande.
Des Français prirent également part au commerce de la mer Blanche. En 1580, un certain Jehan Sauvage, marchand de Dieppe, visita Vardö en Norvège et les ports de la mer Blanche, Kolmogor et Saint-Nicolas[108]. Six ans plus tard, le tsar Féodor, successeur d'Ivan le Terrible, dans une lettre à Henri III[109], concède aux marchands français le droit de «fréquenter avec toute espèce de marchandise le havre de Colmagret (Kolmogor)». L'année suivante fut signé un traité de commerce entre le tsar et des marchands parisiens, très avantageux pour ces derniers. Nos compatriotes avaient le droit de venir commercer «avecq navires à Colmogrote (Kolmogor), à Neufchateau de Arconge (Arkhangelsk), Volgueda (Vologda)», etc., «en payant seullement la moitiée des droicz moinz de ce que payent les austres estrangers en toutes noz villes susdites».
[108] Monastère situé sur l'emplacement actuel d'Arkhangelsk.
[109] Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution française.—Russie, avec une introduction et des notes, par Alfred Rambaud, t. I. Paris, 1890.
Une fois en possession de la majeure partie du commerce de la mer Blanche, la Muscovy Company voulut pousser plus loin et atteindre le pays à fourrures dont ses agents entendaient parler à Kolmogor et à Arkhangelsk.
[Pg 170]
En 1611, elle envoya un navire commandé par le capitaine James Vadun à l'embouchure de la Petchora.
Le commerce du pays parut aux marins anglais plein de promesses. «Que n'avons-nous des représentants à Poustosersk, à Oust-Zylma, à Perm, écrivait Richard Finch, agent de la Compagnie à Thomas Smith, président de cette association, nous ferions d'excellentes affaires en achetant en hiver des pelleteries[110].» Deux membres de l'expédition, Josias Logan et William Persglove, hivernèrent à Poustosersk; trois ans plus tard, William Goosden, second du navire, y passa également un hiver.
[110] Reise und Aufenthalt den Engländer im Petchora-Lande, in den Jahren 1611-1615, in Alexander G. Schrenk, loc. cit. vol. II.
Les renseignements recueillis par les représentants de la Muscovy Company sont très intéressants. Ils nous montrent qu'à cette époque la navigation était très active sur la Petchora et sur l'océan Glacial. Chaque été, un grand nombre de bateaux partaient de Kolmogor, Mezen, Poustosersk à destination de Mangazeï, situé dans l'estuaire de l'Obi. Tous ces bâtiments se rendaient dans la baie de Kara, puis de là atteignaient l'Obi, en traversant la presqu'île de Ialmal par des portages.
Une fois que les Russes furent parvenus à la Baltique et à la mer Noire, la Russie septentrionale perdit toute importance économique. La route de la Dvina fut délaissée et la Petchora ne servit plus qu'au commerce local. Grâce à l'heureuse initiative de M. Souslov, ce beau fleuve redeviendra bientôt une des voies d'exportation de la Russie orientale comme aux temps des Normands. Sous la direction de cet homme intelligent,[Pg 171] un chemin de fer à voie étroite sera, dans quelques années, construit à travers l'étroite langue de terre séparant les affluents de la Kama de la Petchora. Une fois sur ce dernier fleuve, les marchandises seront transportées par des vapeurs jusqu'à l'océan Glacial. M. Souslov possède déjà trois steamers sur la Petchora, un sur la Kolva et un navire de mer qui, en 1889, a transporté à Pétersbourg des marchandises de cette région.
Le gouvernement russe, comprenant toute l'importance de l'entreprise, fait approfondir les tributaires de la Kama aboutissant au chemin de fer projeté, la Vitcherka et la Bérésovka. Lorsque ces travaux seront terminés, la Petchora, cette belle artère fluviale jusqu'ici inutile, servira à transporter à peu de frais une partie des blés du Volga et des produits de l'Asie centrale jusqu'à l'océan Glacial, où pendant quatre mois et demi la navigation est ouverte avec le reste de l'Europe. En même temps, comme nous l'expliquerons plus loin en détail, M. Sibiriakov a fait ouvrir une route à travers l'Oural pour exporter en Europe les produits du bassin de l'Obi. C'est bien à tort que l'on n'attribue aucune importance économique à la Russie septentrionale. On croit toujours cette région couverte de neiges éternelles et la mer qui la borde encombrée de glaces. Dans l'état actuel, la Russie n'a pas, au contraire, de meilleure côte que celle de la Laponie, toujours ouverte à la navigation, et la Petchora est le seul fleuve permettant de conduire facilement les produits de la Russie orientale à la mer.
[Pg 172]
Les rapides.—La forêt.—Un village zyriane.
Après un arrêt de quatre jours à Oust-Pojeg, nous reprenons notre navigation sur la Petchora, toujours en canot; dans ces pays c'est le seul moyen de locomotion.
Le temps est magnifique, le ciel bleu comme sur les bords de la Méditerranée, et une lumière rutilante fait étinceler de reflets métalliques les aiguilles des pins. Dans tout l'espace rayonne une clarté aveuglante. Pour se garantir de la chaleur, une ombrelle devient même nécessaire. A 2 h. 30 du soir, le thermomètre s'élève à + 33°.
Sous cette splendeur d'été c'est plaisir de naviguer sur ce beau fleuve, doucement porté par le courant. Pas un être vivant, pas un bruit, pas une sensation violente, tout est uniforme et silencieux, et ce calme des choses mortes endort l'être entier. Isolé du monde, vous n'avez ici ni tracas, ni ennui; vous vivez tranquille dans une animalité heureuse. Du soleil et des vivres, avec cela la béatitude est parfaite en voyage.
[Pg 173]
Mais soudain voici une sourde rumeur d'eau en mouvement: nous approchons des porog (rapides). Le fleuve clapote bruyamment contre des pierres, puis dévale en tourbillons sur une distance de 200 mètres. L'équipage s'arrête quelques minutes pour examiner le passage: c'est qu'il ne faut pas heurter quelque caillou, et maintenant en avant! Les bateliers donnent à l'embarcation une vitesse supérieure à celle du courant afin de pouvoir gouverner; en quelques secondes le tourbillon est franchi.
Cinq kilomètres plus loin, nouveau rapide un peu plus difficile que le précédent, puis deux autres petits courants, et nous arrivons au hameau de Porog, situé à 20 kilomètres d'Oust-Pojeg.
Partout le même paysage: la forêt, toujours la forêt, composée en majeure partie de mélèzes et de sapins. Le bouleau et le pin sont moins abondants, et le cembro rare. Tous ces bois, qui se trouvent dans d'excellentes conditions d'exploitation, ont été à peine entamés par la hache des bûcherons. Pour le jour où les forêts de la Russie centrale seront complètement défrichées, il y a là une précieuse réserve.
Aux différentes heures du jour, la belle lumière du Nord donne à ces bois des teintes diverses. Uniforme dans ses lignes, le paysage devient varié dans ses aspects. Le soir, à la clarté du crépuscule, on se croirait dans le pays chanté par les ballades des poètes; le large fleuve coule sans bruit, et par toute la nature règne un silence qui fait sentir la solitude.
A 11 heures du soir, nous abordons à une île boisée, la première que nous ayons rencontrée sur la Petchora (Ielovik Ostrov en russe, Voradi en zyriane)[111].[Pg 174] Le campement est installé sur une plage. L'air tiède est embaumé des aromes de la forêt, et une lune éclatante argente le paysage. Sans les moustiques, comme on aimerait à rêver aux étoiles dans ce calme! mais ces maudits insectes gâtent le plaisir du voyage.
[111] Glossaire topographique zyriane: Di, île; Io, cours d'eau navigable; Ieul, ruisseau non navigable; Chor, petit ruisseau; Ti, lac; Kirta, escarpement; Iag, forêt sèche; Niour, marais; Kocht, rapide; Kouzlane, section d'une rivière sans courant; Is, pic dépassant la limite supérieure de la végétation forestière; Parma, montagne de forme arrondie en partie couverte de forêts.
Le lendemain, à 11 heures seulement, départ après un violent orage. Température: + 24°. On ne grelotte pas précisément dans les pays du Nord.
Toujours la forêt; de loin en loin une cabane inhabitée, et aux coudes principaux du fleuve des croix grecques tortillent leurs branches bizarres avec des airs macabres. En passant devant ces croix, les Zyrianes ont l'habitude de déposer un caillou en guise d'ex-voto (Schrenk).
Dans la soirée nous arrivons à Oust-Ilytch, village bâti, comme son nom l'indique[112], à l'embouchure de l'Ilytch dans la Petchora. L'affluent est aussi important que le fleuve, et après avoir reçu ses eaux, la Petchora double de largeur.
[112] Oust, embouchure en russe.
Oust-Ilytch compte environ 180 habitants, tous Zyrianes[113].
[113] 32 maisons. Nombre des animaux domestiques du village: 100 vaches, 100 chevaux, 200 moutons.
Le lendemain 28 juillet, continuation de la navigation sur la Petchora. A 10 kilomètres d'Oust-Ilytch, on rencontre le hameau de Laga. Population: 25 à 30 habitants. Sur la distance de 127 kilomètres qui sépare Oust-Pojeg de Troïtskoïé, Porog, Oust-Ilytch et[Pg 176] Laga sont les seules localités habitées, et le chiffre des indigènes ne dépasse pas 230. A droite et à gauche de la Petchora, c'est la solitude sur des centaines de kilomètres.

Dans la journée nous rencontrons des faucheurs zyrianes. Pour augmenter leur provision de fourrage ils sont venus faner une clairière ici, à plus de 15 kilomètres de leur habitation. Les indigènes connaissent tous les bouts de prairies naturelles épars au milieu des bois et n'ont garde de perdre leur produit.
Aujourd'hui point de soleil. La forêt de pins a un air de cimetière. Pendant dix heures nous naviguons dans une tristesse oppressante; le soir, les lourds nuages s'étirent en longues banderoles et un ciel pur apparaît rempli d'une lumière mourante. Plus de vent, plus de clapotement d'eau; dans ce silence agrandi par le vague de la lueur crépusculaire, au fond de l'horizon violet, se dresse une rangée de collines, pareille dans son isolement à une chaîne de montagnes superbes. Sur ces monticules brille comme un phare la coupole dorée d'une église; à la nuit tombante, cette lumière nous guide vers Troïtskoïé (Mouïlva en zyriane), où se termine notre étape.
Dans ce désert, Troïtskoïé passe pour une capitale, c'est un siélo, c'est-à-dire un village paroissial[114], et le chef-lieu d'un volost, circonscription correspondant à peu près à notre canton.
[114] Les villages sans église sont appelés en russe derevnia.
Le village est divisé en deux parties. Sur la rive droite de la Mouïlva se trouve le faubourg, habité par des dissidents, et de l'autre côté la principale agglomération, formée par les orthodoxes. Les deux quartiers présentent le même désordre: c'est un[Pg 178] fouillis de constructions bâties sans plan, au hasard. Les Zyrianes paraissent avoir l'horreur des alignements, si chers aux Russes.

A Troïtskoïé, plus de 300 kilomètres nous séparent encore d'Oust-Chtchougor, terme de notre navigation sur la Petchora. Une pénible navigation à la rame ne constitue pas précisément une partie de plaisir, surtout sur un cours d'eau monotone comme la Petchora. Aussi quelle n'est pas notre satisfaction d'apprendre qu'un vapeur va descendre le fleuve jusqu'à Poustosersk et que nous pourrons y prendre passage.
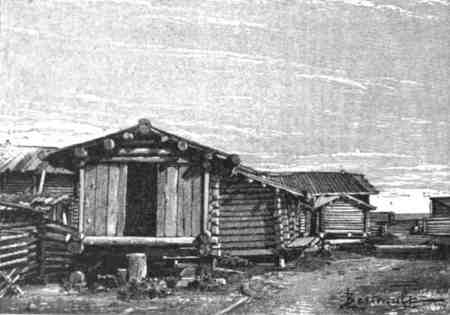
Le 29 juillet dans la soirée, nous nous embarquons, et, le 1er août, à une heure du matin, nous arrivons à Oust-Chtchougor, où la plus aimable hospitalité nous est donnée à la factorerie de M. Sibiriakov. Sur ce long trajet, partout le même paysage: la forêt monotone,[Pg 179] avec de rares villages espacés à de grandes distances. Un des plus importants, celui de Podtcherem, se trouve sur la rive droite de la Petchora, au confluent même de la Podtcherem, et non sur la berge gauche, ainsi que l'indique la carte de l'état-major russe. Les seules distractions du voyage sont les fréquents échouages du vapeur.
[Pg 180]
Les passes de l'Oural.—La route Sibiriakov.—Les rapides de la Chtchougor.—Ascensions dans l'Oural.
Arrivé à Oust-Chtchougor, il nous restait à accomplir la partie la plus difficile du voyage, la traversée de l'Oural septentrional.
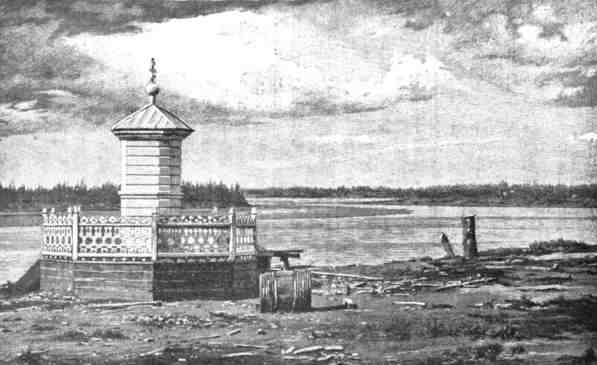
Développé en éventail dans sa partie sud, entre les tributaires de la Kama et les affluents des grands fleuves sibériens, l'Oural s'amincit à mesure qu'il s'étend vers le nord. Dans la région où nous nous trouvons, son épaisseur est faible, bien que ce soit précisément là que se dressent les points culminants de la chaîne septentrionale, le Sabli-Is et le Telpos-Is. Des premiers mamelons élevés au-dessus de la vallée de la Chtchougor aux derniers renflements dominant la plaine sibérienne, la distance ne dépasse guère 100 kilomètres, et nulle part une arête abrupte. Partout de hautes collines isolées par de larges dépressions, partout le passage serait facile sans d'immenses marais. Les marais, voilà la grosse difficulté dans l'Oural septentrional. Sur des distances énormes vous ne rencontrez pas un pouce de terre[Pg 182] ferme. D'Oust-Chtchougor à l'Oural s'étend une forêt marécageuse large d'une trentaine de lieues, coupée de profondes rivières. Quel obstacle présentent à la marche ces marécages, voici un fait qui le prouvera mieux que toute description. Il y a quelques années, à la suite d'un automne pluvieux, la grande route impériale construite à travers l'Oural méridional de Perm à Tioumen devint impraticable; les voitures restaient enlizées dans la boue, et à Iékatérinebourg, la grande ville de la région, les rues formaient des bourbiers où les passants risquaient de se noyer. Les communications étaient si dangereuses que les établissements d'instruction publique durent être fermés. Iékatérinebourg est situé dans une partie sèche de l'Oural. Jugez ce que peut être l'état du sol dans la région où nous sommes, sans chemin et couverte en tous temps de marais! L'été, les marécages empêchent pour ainsi dire toute communication entre les deux versants de la chaîne septentrionale. L'hiver seulement, une fois ces terres tremblantes solidifiées par la gelée et recouvertes d'une épaisse couche de neige, leur traversée devient facile. Dans les pays du nord, l'hiver est la période d'activité, la saison des transports et des foires. Sur la neige durcie par le froid, patineurs et traîneaux glissent alors rapidement, sans danger de s'embourber ou d'être arrêtés par les rivières. Terre et eau ne forment plus qu'une nappe cristalline dure et résistante.
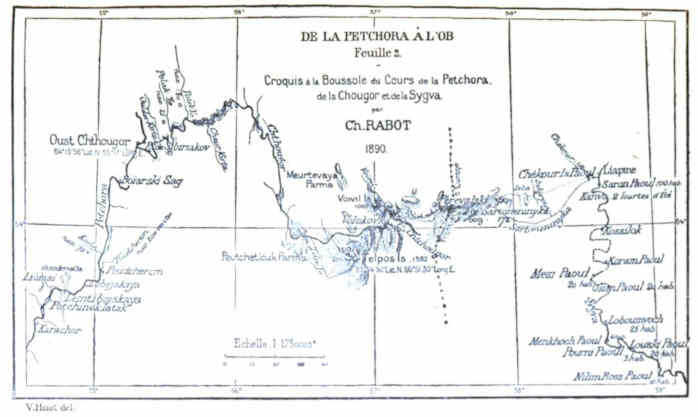
Pour le naturaliste, l'été est, au contraire, l'époque des voyages. Le précepte qui recommande de parcourir en hiver les pays froids a été inventé par des gens sédentaires. Quel travail pourrait faire un voyageur alors que le sol est recouvert d'un uniforme linceul! Impossible d'exécuter le moindre relèvement[Pg 184] topographique. Sous l'épais manteau de neige, allez donc distinguer un lac, une rivière, de la terre ferme! Allez donc faire des collections d'histoire naturelle alors que le sol est enfoui sous la neige!
A travers les marécages de l'Oural les seules routes praticables sont celles tracées par les cours d'eau. Prenez une carte, vous voyez que les sources de la Petchora et de ses tributaires de droite ne sont distantes que de quelques kilomètres des cours d'eau sibériens. Partout les affluents de la Petchora ne sont séparés de ceux de l'Obi que par des isthmes étroits. Entre les deux versants de la chaîne s'étendent des lignes d'eau presque continues, routes naturelles d'Europe en Asie.
Des sources de la Petchora à l'océan Glacial, l'Oural septentrional est ainsi traversé par quatre passages principaux.
Le plus méridional suit le cours supérieur de la Petchora et conduit dans la haute vallée de la Sosva.
Plus au nord, l'Ilytch, puis son tributaire, l'Iogra-Laga, amènent également près des sources de la Sosva.
Le troisième et le plus important de ces passages est formé par la Chtchougor et débouche dans la haute vallée de la Sygva, sous-affluent de l'Obi.
Enfin, à la limite méridionale des toundras, l'Oussa permet d'atteindre soit le Voïkar, soit le Sob, affluents de l'Obi.
Ces différents passages ont été pratiqués de bonne heure par les indigènes et les Russes, comme nous l'avons expliqué au chapitre précédent.
Aujourd'hui, grâce à l'heureuse initiative de M. Sibiriakov, ils pourront devenir un des débouchés de la Sibérie.
[Pg 185]
Dans le chapitre précédent je citais l'exemple de M. Souslov, qui travaille à créer une nouvelle route d'exportation pour les produits de la Russie orientale; voici maintenant un négociant qui, depuis quatorze ans, consacre les revenus d'une immense fortune à ouvrir des débouchés au commerce de Sibérie. C'est qu'en Russie l'initiative privée est grande et qu'en matière de colonisation les Russes n'attendent pas l'impulsion du gouvernement. A cet égard nous pourrions prendre d'eux d'excellentes leçons.
La Sibérie n'est pas du tout un vaste désert de neige comme on le croit généralement. Tout au contraire, elle renferme des immensités d'une merveilleuse fécondité; c'est même une des plus belles régions agricoles de la terre: mais, faute de voies d'exportation, ses produits sont jusqu'ici restés inutiles. A la création pour ces richesses de routes vers la mer M. Sibiriakov consacre libéralement une partie de ses énormes revenus. Tout d'abord, après les explorations du célèbre Nordenskiöld dans l'océan Glacial, le généreux Sibérien essaya d'établir des communications maritimes entre les ports d'Europe et l'embouchure du Iénisséi. Le succès ne répondit pas aux efforts. Les glaces brisèrent ou arrêtèrent les navires. M. Sibiriakov sacrifia sans résultat plusieurs millions dans l'entreprise. Pour un nabab comme lui, la perte était légère. Immédiatement il dirigea ses recherches d'un autre côté et s'occupa de tracer une route à travers l'Oural septentrional, reliant le bassin de l'Obi à celui de la Petchora. Sur le versant asiatique, par l'Obi, puis par la Sosva et la Sygva, des vapeurs arrivent facilement à Liapine, à 40 kilomètres seulement de la base des montagnes. De là à la Petchora la distance à vol d'oiseau n'est que de[Pg 186] 200 kilomètres, dont 70 ou 80 en montagnes. C'est à travers cette région que M. Sibiriakov a fait ouvrir une route.
Les premiers travaux furent exécutés en partant d'Oranez sur la Petchora, mais ce tracé fut bientôt abandonné pour un second à travers la vallée de la Chtchougor. La route part du port Sibiriakov, situé sur la rive droite de la Petchora, à une petite distance du confluent de la Chtchougor, et de là rejoint Liapine. Malheureusement dans cette région, montagnes et forêts ne forment qu'un immense marécage. Impossible d'établir une chaussée, impossible par suite de faire passer une voiture. Aussi M. Sibiriakov a, dit-on, l'intention d'abandonner cette route et d'en faire construire une troisième, dans la vallée de l'Ilytch, où le terrain est plus sec. Telle quelle, la voie tracée a néanmoins une grande importance comme route d'hiver. L'été, des vapeurs amènent des marchandises de Sibérie par la Sygva[115] jusqu'à Liapine, puis, dès que les terres tremblantes sont raffermies par la gelée et recouvertes d'un macadam de neige, elles sont conduites sur les bords de la Petchora, d'où, l'été suivant, elles peuvent être exportées en Europe par mer.
[115] La baisse rapide des eaux arrête très tôt la navigation sur cette rivière. En 1890, dès le 10 août, Liapine n'était plus accessible qu'à des barques.
Durant l'hiver de 1886, 640 tonnes de marchandises ont été amenées de Sibérie à la Petchora par la voie d'Oranez, et, l'hiver 1889-1890, 247 tonnes par la nouvelle route. Maintenant que les travaux sont achevés dans la vallée de la Chtchougor, le mouvement commercial augmentera d'année en année. Pour le bassin de la Petchora, cette voie est dès aujourd'hui[Pg 188] d'une utilité capitale. Par la Chtchougor les céréales arrivent facilement et à bon marché dans cette région. Grâce à ce ravitaillement, la disette n'y est plus à craindre. Une nombreuse population, jusque-là exposée aux souffrances de la famine, est assurée maintenant du pain quotidien, d'autant plus qu'en généreux philanthrope M. Sibiriakov vend le blé importé à prix coûtant. Avant l'ouverture de la route le sac de blé (144 kilog.) valait 40 francs; aujourd'hui il n'est plus payé que 25 francs[116].
[116] Les frais de transport de Tobolsk à la factorerie Sibiriekov sur la Petchora (dist. 2 500 kil. environ) sont de 35 kopeks par poud (1 fr. 25 par 16 kil., en évaluant le rouble à 3 fr., cours aujourd'hui beaucoup trop élevé, 1892). Ermilov, loc. cit.

M. Sibiriakov ne borne pas sa généreuse activité à ces grands travaux d'utilité publique, c'est de plus un bienfaiteur éclairé des sciences, et à un grand nombre d'expéditions scientifiques il a apporté dans une large mesure le concours de ses libéralités. Est-il besoin de rappeler que, de concert avec le roi de Suède et M. Oscar Dickson, il a fait les frais de la mémorable expédition de la Véga? Aussi, informé par l'aimable gouverneur de Tobolsk, le général Troïnitsky, de mon arrivée prochaine dans l'Oural, ce généreux mécène expédia à ses agents l'ordre de me donner la plus large hospitalité dans ses factoreries et d'envoyer au-devant de moi la caravane nécessaire pour la traversée des montagnes. Sans ce bienveillant concours, le passage aurait été une très grosse opération, peut-être même eût-il été impossible.
Le 31 juillet, à trois heures du matin, nous débarquons à la factorerie Sibiriakov d'Oust-Chtchougor. La journée est employée à des recherches d'histoire[Pg 189] naturelle et à l'organisation de la caravane pour remonter la Chtchougor jusqu'à Volokovka, au centre de l'Oural, la route étant en ce moment impraticable. Le 1er août, à six heures du soir, nous quittons le village avec un équipage de quatre vigoureux gaillards. Notre embarcation est une lodka, grande baleinière surmontée à l'arrière d'une petite cabine en forme de cercueil comme celle des gondoles vénitiennes. Cette cahute, longue de 2 m. 10 et large de 0 m. 90, sera notre habitation pendant plus d'une semaine. Les caisses de bagages entassées dans l'intérieur forment le lit; en avant se trouve le salon, un petit espace demeuré libre autour d'une grande boîte servant de table. Devant la porte, sur une large pierre plate, brûle un feu fumeux pour écarter les moustiques. En somme, excellente installation.
A peine entrée dans la Chtchougor, la lodka est repoussée par un courant de foudre. La rivière, large comme le grand bras de la Seine autour de la Cité, dévale avec une rapidité vertigineuse. Aussitôt deux hommes sautent à terre et halent le canot à la cordelle, pendant que le reste de l'équipage demeuré à bord pousse avec des gaffes. C'est ainsi que nous remonterons toute la Chtchougor! De son embouchure à Volokovka, la rivière a partout un cours aussi torrentueux; pour avancer contre ce tourbillon, point d'autre ressource que de haler le canot. Dans les endroits faciles on parcourt 3 kilomètres à l'heure. Plus haut, en travers du courant, des amoncellements de blocs forment digue, et par les brèches la masse d'eau se précipite tumultueuse. Jusqu'à Volokovka il y a bien une douzaine de ces rapides. Pour les traverser, l'équipage lance l'embarcation au milieu du torrent; de toutes leurs forces les haleurs[Pg 190] tirent la corde pendant que les bateliers restés à bord étayent le canot avec leurs gaffes. L'embarcation avance de 2 à 3 mètres au prix d'efforts inouïs. Aussitôt les bateliers quittent leur premier point d'appui pour en prendre un second en amont. On avance ainsi par échelons comme un gymnaste qui s'élève à la force du poignet sur le revers d'une échelle. Si une perche cassait ou si le câble se rompait, nous serions infailliblement roulés et noyés par ce courant irrésistible. La vie, dit-on, tient à un fil: la nôtre tenait à une corde en écorce.
2 août.—Le paysage devient intéressant. La Chtchougor coule tantôt en plaine, tantôt en des cluses profondes entre de beaux escarpements rocheux couronnés de forêts[117]. Les berges sont constituées par des calcaires et des schistes qui doivent être rapportés à l'étage permien. Les schistes renferment de nombreuses empreintes de plantes fossiles; les échantillons que nous avons rapportés sont malheureusement indéterminables, les plantes ayant dû séjourner longtemps dans l'eau avant de se déposer, d'après les renseignements que M. Zeiller, ingénieur au corps des mines, a eu l'obligeance de me donner après examen de ces fossiles.
[117] Dans cette région dominent le sapin et le bouleau.
Dans la matinée nous passons les hautes falaises calcaires d'Ouldor-Kirta (Portes de Fer[118]). Le soir, derrière la masse bleuâtre des bois, apparaît au loin un gros nuage violet étendu au-dessus de la forêt: c'est l'Oural. Désormais nous ne le perdrons plus de vue.
[118] Hauteur: 30 à 50 m.
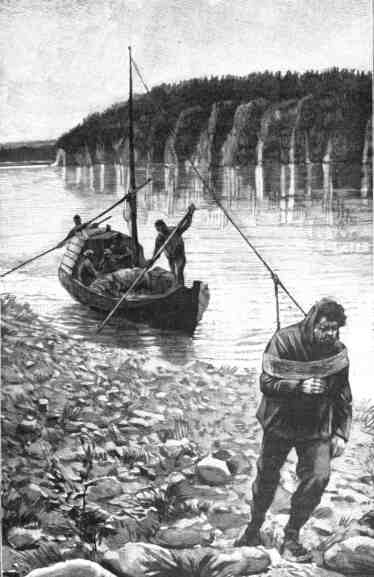
A dix heures du soir, halte. Pendant quatorze[Pg 192] heures les hommes ont halé l'embarcation, et ce long et pénible effort nous a fait seulement avancer de 8 tchiumkoss[119], soit 40 kilomètres. La nuit, un ours vient rôder autour du campement. Le feu du bivouac l'a éloigné. Quel dommage! depuis dix ans que je parcours les régions arctiques, jamais je n'ai pu tirer ni même apercevoir un de ces animaux.
[119] Tchiumkoss, mesure de longueur employée par les Zyrianes, valant 5 kilomètres d'après les renseignements qui nous ont été donnés. D'après Schrenk, cette mesure serait également en usage chez les Tchérémisses, les Tatars et les Votiaks. Sur les bords de la Petchora et de la Chtchougor, les tchiumkoss sont marqués par les accidents topographiques, coudes ou embouchures d'affluent.
3 août.—Temps magnifique. A deux heures le thermomètre s'élève à + 22°,8. Nous passons devant le confluent du Patek-Io, l'affluent le plus important de la Chtchougor[120], et, dans la journée, atteignons la Chour-Kirta, goulet semblable à l'Ouldor-Kirta. Au delà, la rivière s'élargit en un petit lac d'une merveilleuse transparence. Partout la Chtchougor est limpide comme un cristal[121]. A travers ses eaux vertes, profondes en certains endroits d'une dizaine de mètres et même plus, les moindres accidents du fond restent visibles. Passé ce joli paysage, voici deux tourbillons terribles dont la traversée nous donne pas mal de tablature (Syrankocht et Tarachimkocht). Après cet effort le campement est établi.
[120] C'est un affluent de droite, il serait navigable sur une longueur de 190 kilomètres.
[121] Sur une distance de plusieurs kilomètres en aval de l'embouchure, les eaux de la Chtchougor ne se mélangent pas avec celles de la Petchora; deux bandes d'eau, l'une claire, l'autre trouble, s'écoulent côte à côte.

Notre équipage, composé de Zyrianes, est admirable d'énergie et d'endurance. De solides gaillards, ces[Pg 194] Finnois! quatorze heures durant ils pataugent dans l'eau, puis, le soir venu, sans même prendre le temps de sécher leurs vêtements, ils s'endorment sous une tente, vêtus simplement d'une chemise et d'un pantalon en toile, et les nuits sont très fraîches. Avec cela une nourriture frugale de poisson et de pain noir. De même que tous les Finnois, ce sont de très habiles bateliers. Parmi eux comme parmi les Lapons et les Caréliens du gouvernement d'Arkhangelsk, la marine russe trouverait d'excellentes recrues pour les équipages de la flotte.
Encore deux rudes journées (4 et 5 août), et le 6 nous arrivons au pied de la Peutchétiouk Parma, un gros mamelon situé sur la rive gauche de la rivière. Immédiatement nous partons en faire l'ascension. J'ai hâte de gravir un sommet pour discerner les traits du pays; avec cette épaisse forêt qui couvre tout, impossible de distinguer la véritable position des accidents de terrain.
Du haut de la Peutchétiouk Parma (490 mètres) le panorama est très étendu, tout en longueur, comme une vue en ballon. Vers l'ouest, à perte de vue, une immensité bleue de forêts ponctuée de lambeaux miroitants de la Chtchougor, puis lentement la plaine s'accidente de collines rondes à pentes douces, comme une mer gonflée par les longues ondulations d'une grosse houle. En arrière, sublime dans son isolement, se dresse le puissant massif du Telpos-Is, le plus haut sommet de cette partie de l'Oural. Une des plus fières montagnes que j'aie jamais vues, cette cime superbe, avec ses sommets dentelés dressés à plus de 1 600 mètres à pic. Dans tout ce vaste territoire, étalé à nos pieds comme une carte en relief, pas une maison, pas même une hutte, nulle part un habitant. D'Oust-Chtchougor[Pg 195] à Chekour-Ia-Paoul, situé de l'autre côté de l'Oural, sur une distance de 250 kilomètres, deux fois seulement nous avons rencontré des hommes: cette forêt infinie d'arbres verts est une solitude poignante, funèbre. Une fois la position des points saillants du paysage relevée, nous dévalons rapidement pour rejoindre la lodka.
En approchant du Telpos-Is, le paysage devient grandiose. Au milieu de cette belle nature, la navigation semble moins pénible; le magnifique panorama fait oublier les fatigues du voyage. Et pourtant, à mesure que nous avançons, les difficultés augmentent. Nous passons trois rapides pour arriver dans une sorte de lac encombré d'îles marécageuses, où débouche une rivière importante, le Gloubnik-Io. Les bateliers s'égarent au milieu de ce dédale. Nous passons là plus d'un mauvais quart d'heure à faire des routes diverses, à nous échouer et déséchouer; et quand les hommes retrouvent enfin le chemin, la nuit est venue. Juste devant nous s'étend une belle plage; on ne saurait trouver meilleur emplacement pour le bivouac. De longtemps nous n'avons eu un lit aussi moelleux.
La nuit est tiède[122] et lumineuse. Le sommet du Telpos-Is scintille comme une étoile qui serait tombée sur terre, et tout au bout de la plaine, sur la lueur jaune du crépuscule, des montagnes isolées arrondissent leurs dômes bleus dans le calme profond du soir. Pas un bruit, on a l'impression du repos. Autour du feu nous restons longtemps à causer: on se sent si bien dans cet isolement et dans ce silence!
[122] Température, à 9 heures du soir, + 12°.
7 août.—A quatre heures du matin nous sommes[Pg 196] debout. Il serait pourtant agréable de dormir sous ce gai soleil! On boit le thé, et les bateliers reprennent la cordelle. Cinq heures plus tard, voici le Dourni-Porog, le rapide le plus redoutable de toute la Chtchougor. Figurez-vous un bout de torrent alpin encombré de blocs et de fonds pierreux. Après une heure de travail nous arrivons à l'embouchure du Dourni-Yeul, dont la vallée, disent nos gens, conduit au sommet du Telpos-Is.
Dans la mythologie indigène, le Telpos-Is est le séjour de l'Eole zyriane, et en passant au pied de ce pic, les bateliers, obéissant à la même superstition que les marins, défendent de siffler et de crier, de crainte d'attirer le vent. Telpos-Is signifie en langue zyriane la pierre du nid du vent. Les naturels regardent cette montagne comme inaccessible. Dès que vous approchez du sommet, le diable déchaîne une tempête et vous culbute dans les précipices. Un Samoyède ayant voulu gravir ce pic malgré les remontrances des Zyrianes fut, paraît-il, mis en pièces par le vent. Chez nos bateliers la curiosité l'emporta sur la crainte, et trois d'entre eux n'hésitèrent pas à nous accompagner sur le Telpos-Is. Nous traversons un marais, puis un bout de forêt, pour arriver à des monceaux d'énormes blocs éboulés. Le vallon du Dourni-Yeul est une ruine, la montagne semble avoir été disloquée par un tremblement de terre. Au milieu de cette désolation luit un petit lac vert; plus haut blanchit un petit névé dont la surface adhérente au sol est une plaque de glace. Plus loin, entre les traînées de pierres s'étendent de petites alpes ponctuées de fleurs éclatantes, puis la grande solitude recommence, grise, nue et morte, s'élevant par étages en grosses vagues de pierres. Derrière se dresse l'arête[Pg 198] maîtresse du Telpos-Is comme une lame de couteau ébréchée. Nous avançons jusqu'à l'altitude de 849 mètres, lorsque soudain le sommet se coiffe de gros nuages et une lourde pluie d'orage éclate. Rapidement le temps se fait, comme disent les marins, apportant d'épaisses brumes. La pluie tombe à torrents, la retraite devient nécessaire. Au même moment, de toutes les pierres et de toutes les herbes se lèvent des nuées de moustiques. En quelques secondes nous sommes noirs de ces insectes. Impossible de mettre la moustiquaire. Sur ces blocs branlants il faut ne pas avoir les yeux brouillés par le mouvement du voile.
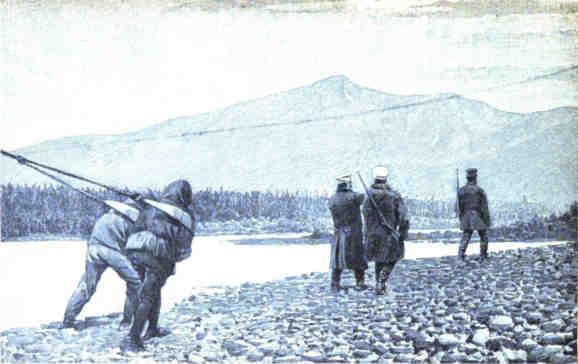
Avec des mouchoirs nous nous couvrons le cou, la partie la plus sensible du corps; lorsque nous trouvons une pierre solide, nous nous arrêtons une minute pour nous flageller la figure et faire une confiture de moustiques. Pendant une heure les souffrances sont atroces. Chose extraordinaire, en bas dans le marais les insectes sont beaucoup moins nombreux. Dans la soirée nous arrivons à la lodka. Après pareille expédition, combien semble agréable notre misérable cabanon! Là-dessous on est à l'abri de la pluie, et un bon feu fumeux éloigne les moustiques. Nous nous séchons, puis mangeons un souper frugal. Des vêtements secs et un morceau de pain, c'est la félicité parfaite en exploration.
8 août.—Continuation de la navigation; le temps est encore aujourd'hui brumeux, donc inutile de tenter l'ascension du Telpos-Is. Après notre mésaventure les Zyrianes sont plus que jamais persuadés de l'inaccessibilité de la montagne.
Encore un rapide difficile. Au delà s'ouvre une large vallée ombreuse, bordée de montagnes[Pg 199] chauves[123] doucement ondulées. On dirait un coin du Jura. Avec ses forêts, ses eaux claires et ses profils mous et fuyants, cette partie de l'Oural rappelle la Franche-Comté. Partout il y a de l'air dans le paysage, nulle part ces encaissements et ces enchevêtrements de montagnes entassées les unes contre les autres qui écrasent et arrêtent la perspective comme dans les Alpes.
[123] La limite supérieure des forêts est située à environ 100 mètres au-dessus de la rivière et la neige descend très bas.
La rivière fait un coude et nous amène dans une plaine cernée de montagnes. Nous arrivons au terme de notre navigation à la station de la Volokovka[124], située au confluent de cette rivière et de la Chtchougor[125].
[124] Le Nak-Sory-Ia des Ostiaks, d'après Hoffmann.
[125] De Volokovka au port Sibiriakov, sur la Petchora, la distance est de 98 kilomètres par la route et de 243 par la rivière, d'après les renseignements fournis par les bateliers.
La station se compose de deux maisons en bois. Le mobilier en est sommaire: dans un coin le traditionnel poêle russe, deux lits de camp, une table et un banc. Pour l'Oural, c'est du luxe.
Sur l'ordre de M. Sibiriakov, un iamchtchik (postillon) nous attend ici depuis un mois avec quatre chevaux.
Volokovka est un des plus jolis coins que j'aie vus dans les montagnes du Nord. Tout à l'entour, de belles eaux courantes, de magnifiques forêts de sapins et de bouleaux, des montagnes agréables à l'œil; avec cela, abondance de gibier. Ce serait un charmant séjour d'été sans les moustiques; heureusement une baisse subite de la température les a fait disparaître. Pour toujours nous sommes débarrassés de ces insectes acharnés.
[Pg 200]
Les marais.—Ascension dans l'Oural.—Première rencontre avec les Ostiaks.—Arrivée à Liapine.
Pendant deux jours, temps brumeux et pluvieux. Une fois les collections d'histoire naturelle terminées, je prends la résolution de partir immédiatement pour la Sibérie. Notre provision de pain est d'ailleurs finie, et maintenant nous devons nous contenter d'une pâte noire, mal cuite, dont les chiens bien élevés ne voudraient pas.
Le 10 août, la caravane se met en marche. Boyanus et moi sommes à cheval; les bagages sont chargés sur des traîneaux samoyèdes (narte), attelés chacun d'un cheval qui porte en outre son conducteur.
La route suit la vallée de la Volokovka; c'est une simple tranchée à travers la forêt. De macadam, pas plus trace que sur les autres voies de Russie; le sol forme le chemin, et ici quel sol! Dans les pays du Nord, les routes sont des pistes plus ou moins larges, presque toujours marécageuses en été et praticables seulement l'hiver, lorsque le sol, raffermi par la gelée, est couvert de neige.
[Pg 201]

[Pg 202]
A quelques centaines de pas de la Chtchougor, je sens mon cheval se dérober sous moi; j'ai la sensation brusque de me sentir engloutir, et en même temps je vois les montures de mes compagnons plonger dans la vase jusqu'à mi-jambes. Nous avançons sur une marmelade de terre, et sous la moindre pression elle cède. Avec les chevaux et les traîneaux lourdement chargés, jugez du pataugis. En certains endroits, les bêtes enfoncent jusqu'au ventre.
Partout une boue noire, partout des flaques d'eau, partout des tourbières. On va au pas au gré de sa monture, toujours prêt cependant à la faire changer de direction pour éviter les arbres. Merveilleux mon petit cheval! jamais il ne fait un faux pas sur ce sol mouvant, jamais il ne butte contre les racines entre-croisées. Voit-il son devancier patauger, vite il se jette à droite ou à gauche; aperçoit-il une plaque suspecte, il la flaire bruyamment pour s'assurer de sa solidité. Cette intelligente petite bête sait que partout où il n'y a point de végétation, la fondrière est plus liquide et elle choisit en conséquence sa route. En plein marais elle a toujours soin de mettre le pied sur les touffes saillantes de plantes palustres, l'expérience lui a appris que ce sont les seuls points solides du terrain. Par la pratique de l'Oural ces chevaux sont devenus quelque peu géologues.
La traversée d'un marais fangeux donne les mêmes sensations qu'une navigation en canot sur une mer houleuse. Le cheval monte, s'abaisse comme l'embarcation sur la vague. En pareil cas, il faut lâcher les étriers, serrer ferme les genoux, empoigner solidement la crinière d'une main et de l'autre tenir les rênes, prêt à enlever la monture en cas de faux pas.
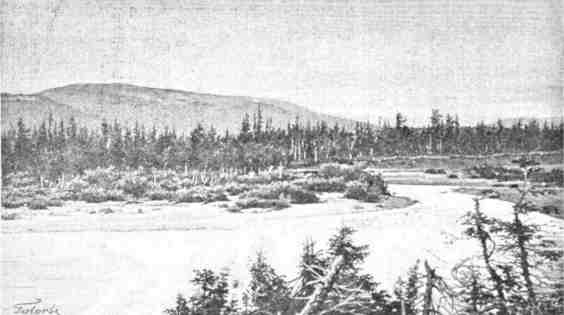
Pour nous reposer de ces fondrières nous passons[Pg 204] et repassons à gué la Volokovka. Nous la traversons seize fois. Le lit caillouteux de la rivière est résistant; en le suivant on est beaucoup plus au sec que dans le marais: là, pas de crainte de tomber dans quelque bourbier inattendu. En certains endroits, les berges sont escarpées; les chevaux attelés aux traîneaux font un petit saut en avant, puis, une fois à l'eau, donnent un coup de collier, et, patatras, la narte tombe de tout son poids dans le torrent. Tant pis pour les plaques photographiques!
Le paysage est pittoresque, avec une magnifique forêt encadrée de jolies montagnes, mais nous n'avons pas le loisir de l'admirer; tout le temps il faut avoir l'œil ouvert pour éviter une chute dans le bourbier, se garer d'un arbre ou d'une branche. Enfin, nous voici dans une sorte de cirque, aux sources de la Volokovka.
Une pente rapide sur un terrain solide conduit à un petit plateau (494 mètres), le point de partage des eaux entre le bassin de la Petchora et celui de l'Obi, la frontière de l'Asie. Nous poussons un joyeux hourra en l'honneur de la vieille Europe que nous quittons, et en avant! Mais aussitôt le tangage recommence. Le plateau culminant du passage est une vaste tourbière dans laquelle les chevaux restent enlizés. Ils semblent marcher sur une éponge gonflée d'eau. C'est une des plus mauvaises parties de la route. Sur ce sol jaune, des bouleaux morts tortillent leurs branches blanches avec des silhouettes de squelettes. Cela a un air de mort, de terre sans vie, de cimetière de la nature.
Le plateau verse dans un ravin et nous arrivons à la station de Pérévalski. Pour parcourir 27 kilomètres nous n'avons pas employé moins de sept heures, et pas une halte en route. Une rude étape!
[Pg 205]
La station se compose d'une baraque humide, que nous remplissons à nous quatre. La cassine s'incline comme un château de cartes prêt à tomber; ce sol ne peut rien porter.
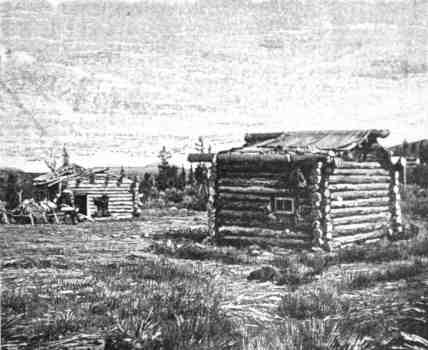
Le lendemain, avant de poursuivre notre route, nous allons gravir la Pérévalski-Sobka, une des croupes dominant l'entonnoir où nous nous trouvons. Toujours le même aspect: d'abord la forêt, puis, les derniers arbres dépassés[126], rien que des pierres. Sur un[Pg 206] point seulement, un peu au-dessous du sommet, la roche apparaît en place: partout ailleurs ce n'est qu'une ruine.
[126] Limite supérieure de la végétation forestière de l'Oural dans les vallées de la Chtchougor et de la Sygva: Peutchétiouk Parma, 490 mètres; Telpos-Is, vallon de Dourn-yeul, 315 et 397 mètres (limite supérieure des bouleaux, 556 mètres); Pérévalski-Sobka, 481 mètres (limite supérieure des bouleaux, 566 mètres).
Devant nous l'Oural présente une profonde dépression; il y a là un aplatissement de relief, comme un gâteau soufflé manqué.
Plus loin, vers le nord, le terrain se relève pour former un massif alpin; quel est son nom? Impossible de le savoir; pour notre guide, tout cela c'est l'inconnu, un pays anonyme, l'Oural; impossible d'en tirer aucun renseignement.
Vers l'est, c'est-à-dire vers la Sibérie, la chaîne tombe à pic; au delà de la Pérévalski-Sobka quelques collines, et après cela une étendue plane sans limites, on dirait la mer. De ce côté, l'Oural n'est pas précédé de contreforts comme sur le versant européen.
A trois heures, nous sommes de retour à la station; à quatre heures, en selle, et en route! Toujours des marais, puis des monceaux de pierres éboulées sur lesquels glissent nos chevaux. Ici la marche est encore plus lente qu'au milieu des marécages. Les montures n'osent mettre le pied sur une pierre qu'après l'avoir flairée pour s'assurer de sa solidité.
Nous suivons une vallée ombreuse entre de belles collines boisées. Cette partie de l'Oural est la chaîne la plus pittoresque que j'aie vue: partout de petits coins frais et riants. Aujourd'hui l'étape est courte, 17 kilomètres seulement, et, à sept heures du soir, la caravane arrive à la station de Sartonninka.
11 août.—Nous mangeons la dernière bouchée de la pâte noire décorée par les Zyrianes du nom de pain. Il faudra donc atteindre ce soir Liapine, et nous en sommes éloignés de 49 kilomètres. A partir[Pg 207] d'ici la route devient, dit-on, meilleure et l'on change les traîneaux contre de petites charrettes.
Nous suivons un large abatis pratiqué au milieu de la forêt. Le terrain monte et descend en longues ondulations. Tout à coup, à un détour, au bout de la longue avenue apparaît l'infinie nappe violette de la plaine sibérienne, toute brillante de lumière. Telle on voit la Lombardie du sommet des Alpes. Après cette vision, plus rien que la forêt marécageuse toujours pareille à elle-même.
A huit heures trente du soir, 15 kilomètres nous séparent encore de Liapine et la nuit vient, et nous avons faim. L'estomac est l'organe le plus exigeant et en même temps le plus important: il détermine les belles comme les mauvaises actions, la joie comme la tristesse: aujourd'hui il nous donne un regain d'énergie. Nous abandonnons les bagages à la garde de Popov, puis Boyanus et moi lançons nos chevaux, résolus à arriver coûte que coûte le soir même à Liapine.
Après une heure de trot, voici enfin du sable, un sol résistant, on redouble l'allure et nous atteignons le village ostiak de Chekour-Ia: un tas de misérables huttes posées sur le bord d'une rivière.
Pas beaux précisément les indigènes: de petits bonshommes ratatinés, vêtus de peaux sordides, se démenant avec des allures d'orangs. Nous passons la rivière, les chevaux à la nage, nous en pirogue. En se mettant ainsi à l'eau après une longue course, tout autre que le cheval russe prendrait une fluxion de poitrine. Lui, il ne s'en porte que mieux; comme son maître, il est fait à toutes les endurances. Les selles sont maintenant mouillées, tant mieux, on n'en sera que plus solide, et au trot! Il y a bien encore des fondrières,[Pg 208] une notamment où les chevaux patouillent jusqu'au poitrail. Nitchevo, comme disent les Russes, cela ne fait rien, les maisons de Liapine sont en vue.
Brusquement nos montures font un écart: dans l'obscurité, elles ont distingué un large trou vaseux, un bourbier nous sépare de la civilisation; on barbote encore une fois, enfin à dix heures vingt du soir nous atteignons la factorerie de Liapine. Un véritable village. De vastes magasins, des habitations pour les ouvriers, et une excellente maison pour le maître. Les agents de M. Sibiriakov nous reçoivent avec la plus franche cordialité, comme on sait recevoir en Russie.
Une table chargée de victuailles et d'excellents vins envoyés à notre intention est bientôt dressée. Nous avons des chaises pour nous asseoir, une lampe nous éclaire. Après les soucis de la vie matérielle dans le désert, un luxe asiatique. La civilisation a parfois du bon, mais pour l'apprécier à toute sa valeur il faut avoir peiné dans les régions mortes de la terre.
[Pg 209]
Séjour à Liapine.—Le village ostiak de Chekour-Ia.—Habitations, costumes et vie des indigènes.—A la recherche des idoles.
Depuis Kazan nous avons parcouru, en commençant par la fin, le livre vivant de l'histoire de la civilisation. Pas à pas, en visitant les divers peuples de la Russie orientale, nous avons suivi le cycle de la lente évolution du progrès humain. Sur les bords du Volga, des Finnois encore païens nous ont initiés à la vie d'agriculteurs primitifs. Dans la vallée de la Petchora, nous avons ensuite étudié chez les chasseurs zyrianes une période plus ancienne du développement des sociétés. Maintenant, avec les Ostiaks, nous arrivons au chapitre initial de l'histoire de l'homme. Nous voici au milieu d'une peuplade de chasseurs et de pêcheurs, frustes de civilisation, armés de flèches et d'arcs, image vivante de l'homme des premiers âges. En dégringolant les pentes de l'Oural nous avons sauté dans un passé vieux de centaines de siècles. Nous retrouvons ici les temps préhistoriques avec ces primitifs ignorant l'usage du fer, pareils à nos ancêtres des temps géologiques.
[Pg 210]
Les Ostiaks sont des Finno-Ougriens, proches parents des Hongrois et des Finlandais, venus comme eux de l'Altaï, mais restés à l'état sauvage, tandis que leurs frères d'Europe sont devenus des peuples civilisés. Leur effectif est d'environ 20 000, dispersés dans le bassin inférieur de l'Obi[127]. Dans le Sud, le 58° de latitude nord marque leur limite, et vers le nord ils se mêlent aux Samoyèdes sur les toundras riveraines de l'océan Glacial. L'habitat des Ostiaks comprend ainsi la plus grande partie du gouvernement de Tobolsk. Du confluent de l'Obi et de l'Irtich à Obdorsk ils constituent l'élément principal de la population. Le long du fleuve ils se trouvent dispersés par clans entremêlés de quelques colonies russes, mais, à droite et à gauche de l'Obi, ils deviennent les seuls habitants. Au sud de Samarovo, dans le district de Sourgout, se rencontre un second groupe d'Ostiaks, moins important. Un petit nombre seulement habite les rives du fleuve, la majorité a été refoulée dans les vallées des affluents de droite. Un troisième groupe, encore moins nombreux, est dispersé dans la partie sud-ouest du gouvernement de Tobolsk et dans le nord du gouvernement de Perm. Les hautes vallées de la Konda, de la Tavda, de la Sosva méridionale et de la Toura renferment quelques centaines d'Ostiaks très russifiés. Dans le volost de Kochousk se trouvent les trois clans les plus méridionaux formés par ces indigènes en Sibérie[128]. Dans le gouvernement de Perm, les districts[Pg 211] de Verkotourié et de Tcherdine contiennent également quelques centaines de ces allogènes.
[127] 19 000 Ostiaks et 4 580 Vogoules, d'après Sommier (Un Estate in Siberia). Cette statistique ne comprend pas les Ostiaks du Iénisséi, qui appartiennent à une race différente.
[128] Aug. Ahlqvist, Unter Wogulen und Ostiaken, Helsingfors, 1883.
Comme les Eskimos de l'Alaska, comme les Indiens des États-Unis, et tous les peuples primitifs vivant en contact de populations plus élevées en civilisation, les Ostiaks disparaissent. D'année en année leur effectif décroît. A Midkinskaya iourte, entre Samarovo et Bielagora, en peu de temps la population est descendue de 27 à 12 individus. D'autre part, dans la vallée inférieure de l'Irtich ces indigènes, nombreux lors de l'arrivée des Cosaques d'Iermak, ont aujourd'hui disparu.
Sous la poussée lente et continue de la colonisation russe, les Ostiaks ont été refoulés vers les régions du nord, où le combat pour la vie est plus rude et plus pénible. L'étendue de leur terrain de chasse a été peu à peu restreinte, et peu à peu leurs pêcheries les plus lucratives ont passé aux mains des Russes. Les ressources des indigènes ont ainsi progressivement diminué, et cet appauvrissement a eu pour conséquence naturelle une réceptivité plus grande des maladies.
Déprimés par la misère, les Ostiaks deviennent incapables de résister aux épidémies. La diphtérie et la variole occasionnent parmi eux de nombreux décès, que ne compense point une forte natalité. Les femmes ostiakes sont peu fécondes et une mortalité terrible sévit sur les enfants. D'après Poliakov[129], elle frapperait les deux tiers et même les trois quarts des enfants.
[129] Poliakov, Pisma i ottcheti o poutéchéstvii v dolinou r. Obi. Pétersbourg, 1877.
Enfin, de l'avis de tous les voyageurs, la diminution des Ostiaks est due en grande partie à l'institution[Pg 212] du kalym. Dans notre société, les filles, lorsqu'elles se marient, diminuent le patrimoine paternel; chez les indigènes de l'Obi, elles sont, au contraire, un capital pour le chef de famille. L'époux achète la jeune fille à son père, usage évidemment emprunté par les Ostiaks à leurs voisins les Tatars. Le kalym ou prix de la fiancée se paye en argent, en pelleteries ou en rennes. Autrefois les jeunes gens qui ne pouvaient réunir le capital nécessaire à l'acquisition d'une femme, demandaient à l'amour son puissant secours; s'ils réussissaient à inspirer de tendres sentiments à une jeune fille, ils l'enlevaient; le rapt rendait le mariage valable. Depuis quelque temps cette coutume n'est plus suivie; la vente seule opère le mariage; et comme les jeunes gens assez riches pour acheter une femme sont rares, le nombre des unions diminue.
D'après M. Sommier, la valeur du kalym varie de 60 à 250 francs. La plupart des Ostiaks, ne possédant pas une pareille somme, l'empruntent à des Russes dans des conditions très onéreuses. Pour racheter sa dette, le malheureux s'engage, par exemple, à livrer à son créancier les principaux produits de sa chasse ou de sa pêche à moitié prix de leur valeur jusqu'à concurrence de la somme prêtée. Dans l'aristocratie indigène, le kalym atteint parfois un capital relativement considérable. Poliakov cite un kalym comprenant 100 peaux de renards argentés, 2 de castors, 1 de renard noir, 2 marmites en cuivre, 150 rennes, et 11 mètres d'étoffe rouge. En échange, la fiancée recevait en dot 15 traîneaux chargés de poisson et de viande, une tente avec plusieurs couchettes, dont deux garnies de couvertures et draps, 30 clochettes et 15 aunes de courroies en peau d'ours.
[Pg 213]
Les Ostiaks admettent la polygamie, mais l'institution du kalym en interdit pour ainsi dire la pratique. La misère rend les Ostiaks vertueux.
Les ethnographes partagent cette population sibérienne en deux races distinctes: les Ostiaks et les Vogoules, les premiers habitant les bords de l'Obi, les seconds les pentes de l'Oural.
A mon avis, cette distinction doit être rejetée. Les quelques Slaves établis dans les vallées de la Sygva et de la Sosva du Nord, comme les indigènes eux-mêmes, ignorent le nom de Vogoules. Les naturels, lorsqu'ils parlent russe, se disent Ostiaks, et les pêcheurs russes ne les connaissent que sous ce nom. Dans leur langue, les aborigènes n'admettent pas la classification des ethnographes; de la Sygva à la Tavda, tous se considèrent comme appartenant à un seul et même peuple, et dans leur idiome se donnent le nom commun de Manzi, qu'ils appartiennent aux tribus ostiakes ou vogoules des savants de cabinet[130].
[130] Sommier, loc. cit.
D'autre part, tous les produits de l'industrie des prétendus Vogoules sont identiques à ceux des Ostiaks de l'Obi. Castren, la principale autorité en matière d'ethnographie finnoise, reconnaît que les deux peuples ne sont séparés que par des différences insignifiantes[131]. Enfin, d'après l'anthropologiste russe Maliev, les crânes ostiaks présentent une ressemblance presque complète avec ceux des Vogoules. Entre les deux peuples soi-disant distincts il y a identité complète de type et d'industrie. Rien n'autorise par suite à diviser les indigènes de la Sibérie occidentale[Pg 214] en deux races. Les ethnographes en chambre ont inventé une population qui n'existe pas.
[131] Castren, Etnologiska Föreläsningar, Helsingfors, 1857, p. 136.
Tous les voyageurs qui ont parcouru l'Oural septentrional partagent cette opinion. Hoffmann n'hésite pas à affirmer que les Vogoules et les Ostiaks de Liapine ne forment qu'un seul et même peuple[132]. Avant lui, Müller avait démontré que ces noms avaient seulement une valeur locale[133]. Plus récemment, M. Sommier, dont la compétence est absolue, signale également l'identité des Ostiaks et des Vogoules. Enfin un voyageur russe, M. V. J. Kouznetsov, est arrivé à la même conclusion, après avoir étudié les «Vogoules» de la Losva et de la Sosva méridionale.
[132] Hoffmann, Der Nördliche Ural und das Küstengebirge Pae-Choi, p. 50.
[133] «A la fin du moyen âge, après que la Iougrie fut devenue tributaire du grand-duc de Moscou à la suite de l'incorporation de la république de Novgorod à ses États, à côté de l'ancien nom de Iougrie apparurent de nouvelles dénominations telles que celles de Wogoules ou Wogoulitsch et d'Ostiaks. Au début, l'ancien nom se conserva à côté des nouveaux, puis, avec le temps, ne s'appliqua plus qu'à quelques localités. Ainsi s'explique comment les noms de Iougrie, de Vogoules et d'Ostiaks ont été employés les uns pour les autres sans y attacher d'importance.» (Ferdinand-Heinrich Müller, Der Ugrische Volksstamm, vol. I, p. 112.)
«Dans cette région, écrit-il, la population se divise en iassatchny (familles soumises au iassak, tribut en fourrure), Vogoules et Ostiaks. Quelle différence existe-t-il entre ces deux derniers groupes d'indigènes, aucun Russe n'a pu me l'indiquer, et moi-même n'ai pu le découvrir. Les uns comme les autres parlent la même langue, habitent des huttes construites sur le même modèle, portent des vêtements semblables et décorent leurs objets mobiliers des[Pg 215] mêmes ornements[134].» De l'avis de M. Kouznetsov, et c'est également le nôtre, la seule différence entre les Vogoules et les Ostiaks est que les premiers ont subi plus profondément l'influence russe que les seconds.
[134] N.-I. Kouznetsov, Priroda i jiteli vostotchnago sklona siévernago Ourala. (Izviestia Imperatorskago rousskago geografitcheskago obchtchestva, t. XXIII, 6, 1887.)
En faveur de la distinction des races, on a invoqué la différence des langues. L'argument est spécieux. D'abord les deux idiomes ostiak et vogoule sont très rapprochés et constituent plutôt deux dialectes que deux langues. En second lieu, toutes les races peu nombreuses, dispersées sur de vastes territoires et fractionnées en groupes isolés, ne maintiennent pas l'unité de leur langue. Ainsi les Lapons méridionaux, ceux de Röraas, par exemple, ne comprennent pas leurs congénères du Finmark, et ces derniers, bien que limitrophes de la presqu'île de Kola, n'entendent pas le dialecte de leurs frères russes. On ne divise pourtant pas les Lapons en races distinctes. Le même fait s'observe dans le bassin de l'Obi. La langue ostiake ne comprend, paraît-il, pas moins de trois dialectes: celui de Liapine, celui de l'Obi et celui de la Sosva méridionale ou des Vogoules.
Comme le montrent les citations, les savants russes sont d'accord avec nous pour reconnaître que la classification des Finnois Ougriens de la Sibérie occidentale en Ostiaks et Vogoules n'est point justifiée.
Après cette discussion, revenons à notre voyage. Nous déjeunons longuement, en gens déshabitués au luxe d'une table, puis nous allons visiter le village ostiak de Chekour-Ia[135].
[135] Sukker-ia-Paoul de l'Atlas Stieler, Schokurje d'Ahlqvist. Paoul, hameau indigène.
[Pg 216]
Figurez-vous une vingtaine de cahutes en bois éparses dans une clairière. Au centre s'élève un énorme cornet blanc debout sur le sol. C'est une tchioume, le premier abri imaginé par ces primitifs. En Sibérie, où sur des milliers de kilomètres on ne rencontre pas une roche, pas même une pierre, les indigènes n'ont pu trouver un gîte dans des cavernes, comme les habitants préhistoriques de nos pays, et ont dû improviser des huttes de branchages. Pour ces constructions, le bois ne leur faisait pas défaut. Ils ont dressé des cônes de perches, puis les ont recouverts de l'écorce imperméable du bouleau et ont ainsi obtenu la tchioume, le grand cornet dressé au milieu du village. Cet abri est une survivance des temps préhistoriques. Examinez les tentes des Lapons, les vieilles huttes (kota) des Finnois de Finlande, vous serez frappé au premier coup d'œil par la similitude absolue de ces diverses constructions; c'est le même type d'architecture, légèrement modifié par des influences de milieu. Il n'est donc pas téméraire d'affirmer que cet abri date de cette époque, vieille de plus de vingt siècles, où les Finnois, aujourd'hui épars en Europe et en Asie, vivaient réunis dans la Sibérie méridionale.

A côté de cette tente se trouvent des constructions moins primitives, des iourtes. Ces baraques, le type le plus perfectionné de l'architecture ostiake, ne comprennent qu'une seule pièce[136], précédée d'un petit vestibule. La plus grande partie de la chambre est occupée par un lit de camp (paoul), divisé, dans certaines habitations, en trois compartiments: l'un[Pg 217] réservé au père de famille, le second au fils aîné, et le troisième aux enfants ou aux pauvres. Dans les sociétés primitives, tout le monde est charitable, et toujours ces païens mettent en pratique les principes de l'Évangile, qu'ils ignorent. Le plus souvent la iourte renferme simplement deux lits de camp, disposés face à face sur les côtés, et au fond de la pièce un banc. Sur ces lits et le long des murs sont placés des paillassons, ornés de dessins géométriques et bordés de peaux de poisson, fabriqués par les femmes avec des plantes palustres[137]. Les Ostiaks[Pg 218] emploient ces nattes en guise de tapis; usage évidemment emprunté aux Tatars, lorsque, habitant des contrées plus méridionales, ils se trouvaient en contact avec les musulmans. Par-dessus cette sparterie sont étendues en place de matelas de belles peaux de rennes. Le restant du mobilier se compose d'étagères pour les ustensiles de ménage et de traverses comme portemanteaux.
[136] Cette pièce mesure généralement une longueur de 4 mètres sur une largeur de 3.
[137] Il y a deux espèces de paillassons, l'un tressé avec des roseaux, blanc et parsemé de dessins noirs, l'autre en plantes beaucoup plus fines, jaune et sans ornementation.
De ces iourtes, les unes servent d'abri en été, les autres d'habitations d'hiver, et, par suite, présentent des différences de construction. Dans la iourte d'été, le foyer est placé au centre de la chambre, entre des pierres, et au toit de la baraque est percé un large trou servant tout à la fois au passage de la fumée et à l'éclairage de la maison. Avec une pareille ouverture, la ventilation serait beaucoup trop complète par des froids de 40 degrés: aussi, dans l'habitation d'hiver ce foyer est-il supprimé et remplacé par une cheminée en pisé, dont l'ouverture supérieure peut être fermée par un morceau d'écorce de bouleau. Cette maisonnette, comme la tchioume, est généralement planchéiée; à défaut d'un parquet primitif, le sol est recouvert d'une nappe d'écorce de pin.
Une vingtaine d'indigènes seulement se trouvent à Chekour-Ia; pour le moment, le restant de la population est occupé à la chasse ou à la garde des rennes sur l'Oural et ne reviendra qu'à la fin de l'automne. Chekour-Ia est un village d'hiver. A cette époque, le nombre des habitants s'élève à cent cinquante.
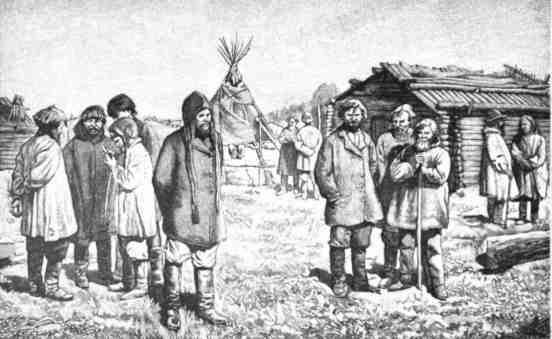
Par suite des nécessités de la pêche et de la chasse, les indigènes sont obligés à de fréquents déplacements.[Pg 220] Pour chaque saison ils ont une habitation dans laquelle tous les ans ils viennent passer un certain temps. L'hiver, ils résident dans des hameaux situés au milieu des forêts, et, le reste de l'année, occupent différentes stations sur les bords des cours d'eau, suivant les besoins de leur industrie.
Pendant que nous visitons leurs maisons, les habitants du village se sont assemblés. Dieu! qu'ils sont laids, ces petits bonshommes déguenillés, jaunis par la fumée et par la crasse, avec cela puant le poisson à 10 mètres à la ronde. Ajoutons, pour les anthropologistes, que la plupart des Ostiaks de la Sygva et de la Sosva sont châtain foncé et ont le système pileux peu développé. Un très petit nombre sont blonds.
L'été, les hommes sont habillés de toile grossière; un pantalon, une chemise, une longue blouse (torkyass), forment toute leur garde-robe; de coiffure, point; pour chaussure, des bottes en peau de renne maintenues aux genoux par des cordons attachés à la ceinture comme les jarretières anglaises. La tige de ces mocassins est tannée, la semelle seule est garnie de poils, pour assurer la marche. L'hiver, suivant la rigueur de la température, les indigènes endossent une, deux ou trois robes en peau de renne les unes par-dessus les autres. En place de chemise, ils portent alors une longue pelisse, dont le poil est tourné vers l'intérieur (malitsa), et par-dessus, le gus, vêtement de même forme, mais dont la fourrure est extérieure. Leur vestiaire est complété par la parka, une houppelande, également en peau de renne, plus courte et plus ornée que la malitsa. Dans un pays où la température descend à 50 degrés au-dessous de zéro, les vêtements doivent fermer hermétiquement. Gus et malitsa n'ont par suite d'autre ouverture que celle[Pg 222] nécessaire au passage de la tête. Au col est adapté un capuchon et aux manches des gants. Sous sa triple enveloppe de peaux, l'Ostiak ressemble à un ballot de fourrures.

Pas très élégant non plus le costume des femmes: une grande rotonde (sari) en peau d'écureuil ou de jeune renne ouverte sur le devant et laissant voir un pantalon également en peau. Comme les musulmanes, les femmes ostiakes se voilent et à cet effet portent sur la tête un grand châle de cotonnade rouge dont elles ramènent les pans. Devant les étrangers, les femmes peuvent circuler le visage découvert. La coutume n'est sévèrement observée qu'à l'égard des membres de la famille. Pratique bizarre, contradictoire, semble-t-il, puisque dans la société musulmane l'usage du voile a été imposé aux femmes pour protéger leur vertu contre les entreprises des étrangers. Ici, d'ailleurs, aucune aventure à redouter: la laideur des femmes ostiakes est la sauvegarde de leurs maris; sur les deux ou trois cents que nous avons vues, pas une n'était jolie. Leur chevelure est divisée derrière la tête en deux longues tresses, et à ces tresses, en guise d'ornements, est suspendue toute une quincaillerie de vieux boutons en cuivre, de sonnettes sans battant et de clefs hors d'usage. Dans ce pays, un marchand de ferraille ferait d'excellentes affaires. Les femmes ostiakes, tout comme les nôtres, aiment à faire montre d'une belle chevelure, et celles qui ne sont pas favorisées sous ce rapport usent des mêmes artifices que nos élégantes. Par d'ingénieux agencements de rubans et des intercalations de crins, les femmes presque chauves savent donner à leurs tresses une longueur démesurée.
Le costume féminin est complété par une certaine[Pg 223] ceinture (vorep) placée directement sur le corps, sur l'utilité de laquelle il est inutile de s'étendre dans ce récit.
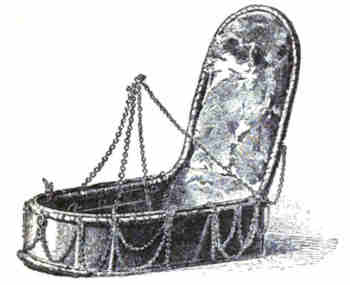
Vivant au milieu d'immenses forêts et sur le bord de cours d'eau, les Ostiaks sont un peuple de chasseurs et de pêcheurs très intéressant à observer. La vie de ces pauvres gens est une représentation exacte de l'existence de nos ancêtres préhistoriques. Un très petit nombre d'entre eux, habitant la région à céréales de la Sibérie, ont par suite pu s'élever à la fonction d'agriculteurs[138].
[138] Aux environs de Pelym, Ahlqvist a rencontré un «Vogoule» agriculteur.
En été, la pêche est la principale occupation des Ostiaks.
[Pg 224]
Très simples sont les engins de ces pauvres gens. Leurs pirogues sont l'enfance de l'art naval: un tronc d'arbre creusé, garni de chaque côté d'une planche fixée par des courroies. Ces frêles embarcations, les indigènes les manient avec une pagaie en restant agenouillés ou en se tenant debout au milieu de l'esquif. Point de bancs: quand le rameur est fatigué, il s'accroupit, le dos appuyé à une traverse établie à cet effet à l'arrière de la pirogue. Le moindre mouvement brusque fait chavirer le canot, mais l'adresse des bateliers est telle que les accidents sont très rares. Pour naviguer sur ces embarcations il faut avoir l'assiette du vélocipédiste ou de l'Eskimo dans son kayak. Les femmes tout comme les hommes rament ces pirogues. Leurs pagaies se distinguent par une certaine recherche d'ornementation. Le manche, peint en rouge, est découpé de losanges et percé de deux fentes traversées de petits morceaux de bois qui s'entre-choquent avec un bruit de castagnettes.
Les indigènes capturent le poisson à l'aide de nattes en osier qu'ils tendent en travers des rivières. Quelques-uns, plus élevés en civilisation, emploient des filets.
La région occupée par les Ostiaks est un des plus riches pays de fourrures de la terre. Du temps de Marco Polo, la réputation de ses pelleteries s'étendait jusqu'à la Chine. En dépit de la guerre acharnée qui leur est faite, zibelines[139], petits-gris, renards abondent dans les forêts vierges de la Sibérie occidentale. La chasse tient par suite, avec la pêche, la[Pg 225] principale place dans l'économie domestique des indigènes. Ces produits constituent non seulement la meilleure part de leur alimentation, mais encore leurs moyens d'échange avec leurs voisins. C'est en fourrures précieuses que les Ostiaks acquittent leur tribut (iassak) aux autorités russes et c'est au moyen de pelleteries qu'ils acquièrent de la farine, des cotonnades et surtout de l'eau-de-vie. Dans la vallée de la Sygva, comme sur les bords de la Petchora, la peau de l'écureuil est l'unité monétaire. Dans le dialecte «vogoule», le vocable lin, qui signifie écureuil, est synonyme de kopek. Le mot grivna (10 kopecks) se traduit par lou lin (dix écureuils); un rouble, set lin, cent écureuils. Depuis longtemps la peau de ce petit ruminant a une valeur de beaucoup supérieure au kopek, aussi, pour éviter toute confusion, les indigènes ajoutent au vocable lin celui de doksa, emprunté aux Tatars, pour bien marquer qu'il s'agit d'argent et non réellement de pelleteries[140].
[139] D'après Poliakov, la zibeline a été exterminée dans la région comprise entre Beriosov et Obdorsk.
[140] Ahlqvist, loc. cit.
Le petit-gris est certainement le mammifère le plus prolifique. Chaque mois d'été, un couple donne naissance à une douzaine de petits, qui, à leur tour, deviennent aptes à la reproduction quatre semaines plus tard. Le célèbre naturaliste russe de Baer a calculé qu'au bout de dix ans un seul couple de ces mammifères compterait une descendance de sept milliards d'individus, à condition que tous vécussent pendant ce laps de temps[141].
[141] De Baer, in S. Sommier, loc. cit.
L'armement des indigènes est très rudimentaire. Leur engin le plus perfectionné est le fusil à pierre et tous emploient encore l'arc et les flèches. Cet arc[Pg 226] est fait très ingénieusement de deux minces lames de bouleau et de cèdre soigneusement collées. Les flèches présentent plusieurs formes originales; les unes, destinées aux animaux de taille moyenne, sont armées de pointes en fer bifides, les autres présentent une fine pointe garnie de barbes. D'autres portent à l'extrémité une boule en os ou en bois, dont le choc est capable de tuer l'animal sans endommager la fourrure. Pour capturer le petit-gris et l'hermine, ces sauvages ont imaginé des pièges très ingénieux, des espèces d'arbalètes qu'ils fichent en terre sur les pistes suivies par ces animaux. En passant à travers une ouverture, les pauvres petites bêtes déclenchent l'arc et se trouvent prises au cou[142].
[142] Le piège destiné aux hermines se trouve figuré dans plusieurs ouvrages. Celui employé pour les écureuils n'a pas encore été représenté.
Le seul animal féroce de cette partie de la Sibérie est l'ours. Il y a quelques années encore, les Ostiaks n'hésitaient pas à l'attaquer à l'épieu; aujourd'hui ils préfèrent, non sans raison, l'emploi du fusil. Mais malheur au chasseur maladroit, s'il n'est accompagné de bons chiens qui maintiennent l'animal pendant qu'il recharge sa mauvaise arme.
Un autre gros gibier est l'élan, le plus grand quadrupède sauvage du nord de l'ancien continent. Sa taille atteint celle du cheval. Abondant dans nos régions à l'époque quaternaire, il ne se trouve plus aujourd'hui en dehors de la Russie que dans la Prusse orientale et dans les forêts de la Scandinavie méridionale, où il est protégé par des lois spéciales.
Cette région est également très riche en gibier à plume. Partout les coqs de bruyère, les gelinottes, les lagopèdes se rencontrent à chaque pas. Encore[Pg 227] plus nombreux sont les palmipèdes. Cygnes, oies, pingouins et canards pullulent sur les cours d'eau, les lacs et les marécages. Ces palmipèdes n'ont pas une grande valeur[143]; à Beriosov, la grande ville de la région, ils se vendent à peine quelques centimes. Ici la poudre est une denrée chère; ce serait donc jeter le plomb aux moineaux que de tirer pareil gibier. Pour le capturer, les Ostiaks dressent sur le bord des cours d'eau des filets dans lesquels les oiseaux viennent s'empêtrer la nuit. Avec un pareil engin, deux hommes peuvent en une séance de guet capturer de 50 à 100 canards[144]. Les plumes et les peaux de ces oiseaux sont un des articles de commerce du pays, particulièrement les dépouilles des Colymbus, dont le plumage gris moucheté est recherché par les fourreurs d'Europe. Avec les ailes des cygnes et des oies, les indigènes confectionnent de grands éventails, qu'ils emploient comme soufflets ou pour écarter les moustiques.
[143] Prix du gibier à Beriosov: lagopède et canard, de 1 à 3 kopeks; oie, 50 kopeks; coq de bruyère, de 8 à 15 kopeks.
[144] Ahlqvist, loc. cit.
Les gens de Chekour-Ia ne possèdent aujourd'hui qu'un très petit nombre de rennes, il y a quelques années une épizootie ayant décimé les troupeaux[145]. Le plus important compte actuellement 180 têtes[146], et plusieurs indigènes ont seulement 7 ou 8 animaux.[Pg 228] Ici comme en Laponie, une famille, pour pouvoir vivre entièrement des produits de l'élevage, doit posséder au moins 300 bêtes. Dans les premiers jours d'avril, les rennes sont acheminés vers l'Oural, où ils passent la belle saison sous la garde de pasteurs communaux, si une pareille expression peut être employée dans une société aussi primitive. Comme les rennes des Lapons, ceux des Ostiaks sont marqués par leurs propriétaires d'une entaille à l'oreille.
[145] En 1865, une épizootie ravagea la région comprise entre la Petchora et le Iénisséi, enlevant 150 000 rennes. En 1856, une semblable épizootie avait déjà tué 10 000 animaux dans le seul district d'Obdorsk. (Finsch, Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876-1877.)
[146] Les Ostiaks vivant uniquement de l'élevage du renne sont aujourd'hui très peu nombreux. Ils appartiennent pour la plupart au district d'Obdorsk et errent sur les toundras riveraines de l'océan Glacial.
Chez les Ostiaks, comme chez la plupart des peuplades circumpolaires, le renne est un élément important de l'économie domestique. Sa chaude fourrure fournit le vêtement et la chaussure, et sa chair les fins morceaux de l'alimentation. De plus, le renne est l'animal de trait par excellence de ces régions. C'est le chameau des déserts glacés du Nord. Sans lui, ces immenses solitudes seraient pendant neuf mois de l'année complètement fermées à l'homme. L'attelage ostiak se compose de deux rennes attelés de front à un traîneau (narte), et dans cet équipage le voyageur peut parcourir facilement les infinies blancheurs des plaines neigeuses sibériennes. En passant, signalons aux archéologues une pièce curieuse du harnachement: un chevêtre en os qui ressemble singulièrement aux fameux bâtons de commandement préhistoriques.
Cette pièce est un des rares objets en os fabriqués actuellement par les Ostiaks. Tous leurs ustensiles et armes sont en bois ou en écorce. Cette population en est à l'âge du bois.
Dans l'industrie primitive des Ostiaks, l'écorce de bouleau remplace la faïence. C'est la matière première de leur vaisselle. Avec cette écorce souple et imperméable, ils fabriquent des augettes qui leur servent[Pg 229] de plats, des assiettes, des cuillers, des seaux[147]. Les différents ustensiles sont ornés de dessins géométriques tracés à la pointe d'un mauvais couteau. Cette décoration consiste en mosaïques jaunes et blanches, d'une régularité parfaite, formant un ensemble agréable à l'œil. Les représentations animales sont rares et toujours d'une exécution inférieure. Un objet mobilier particulièrement artistique est un sac en peau de renne servant de nécessaire aux femmes et décoré d'une mosaïque de fourrures de différentes couleurs. L'art n'est pas le fruit de l'éducation; autant que les civilisés, les simples en ont la conception, et l'expression qu'ils savent donner à la manifestation de leur pensée est plus touchante que celle des gens dont le cerveau a été déformé par les idées reçues.
[147] Le Musée Guimet renferme la série complète des ustensiles ostiaks. Ce musée contient toute la collection ethnographique réunie au cours de notre voyage.
Les Ostiaks ont une notion vague de la propreté. Seuls de tous les peuples sauvages, ils éprouvent le besoin de s'essuyer les mains. N'ayant point de linge, ils le remplacent par des fibres de saules. Soigneusement raclée, cette matière devient souple et floconneuse comme de l'étoupe. A certaines époques, elle est employée par les femmes pour leur toilette intime.
Perdus au milieu des déserts, éloignés de tout centre de civilisation, les Ostiaks vivent heureux dans la plus complète ignorance. La plupart ne parlent point le russe. Seulement sur les bords de l'Obi, où ils sont en relations fréquentes avec les Slaves, l'usage de cette langue leur est familier. Quelques-uns d'entre eux, élevés au monastère de Kondinsk,[Pg 230] dont nous aurons occasion de parler plus loin, savent lire et écrire. Ceux-là jouissent à cent lieues à la ronde d'une réputation de savants. Dans leur isolement, les Ostiaks ne sont cependant pas dépourvus de moyens de communiquer leurs pensées. Ces sauvages ont su inventer des signes pour matérialiser leurs idées. Ils gravent, par exemple, des marques de propriété sur leurs engins et ustensiles et ont imaginé des sortes de caractères, analogues aux croix de nos paysans illettrés, qu'ils apposent en place de signatures sur les quelques documents officiels que l'administration exige d'eux[148]. D'autre part, à l'aide de simples incisions tracées sur les arbres ils expriment de longues phrases. Sur une entaille faite à un tronc de pin, raconte M. Kouznetsov, vous distinguez un pied d'élan presque informe, en dessous quelques traits horizontaux, et, à côté, de petites barres obliques. Pareil dessin signifie qu'un élan a été tué à cet endroit; le nombre des traits horizontaux indique le nombre des chasseurs, et les petites barres obliques celui des chiens. Par des hiéroglyphes analogues les indigènes signalent la capture de tout autre animal. Les signes ont une signification constante reconnue de tous et ont par suite la valeur de caractères. C'est l'enfance de l'écriture.
[148] L'ouvrage souvent cité du Dr Ahlqvist reproduit plusieurs spécimens de cette écriture.
Les Ostiaks ont été convertis au catholicisme grec, mais leur conversion est purement nominale. Tous continuent comme par le passé à sacrifier aux faux dieux et à immoler des animaux domestiques dans des bois sacrés (keremetes), devant de grossières idoles.
[Pg 231]
Dès mon arrivée à Liapine, je me préoccupai de visiter un de ces bois, mais les Ostiaks veillaient avec un soin jaloux sur leurs divinités, le prêtre orthodoxe du village ayant fait récemment en grande pompe un autodafé des idoles qu'il avait pu découvrir.
Dans la journée, après de longues recherches, les guides réussissent enfin à découvrir un keremet absolument intact, et le lendemain nous nous mettons en route.
Nous remontons la Sygva. A quelques centaines de mètres de Liapine elle reçoit une grande rivière dont nos bateliers ignorent le nom. Au confluent est établie une tchioume où nous faisons halte, dans l'espérance de dénicher quelque objet d'ethnographie. Et en effet voici une construction intéressante, une écurie primitive destinée à mettre les rennes à l'abri des moustiques. C'est un abri en clayonnage, (salikol) couvert en écorce de bouleau, dans lequel deux animaux peuvent prendre place[149]. Devant l'entrée, complètement ouverte, sont disposés deux petits feux fumeux destinés à écarter les insectes. La tchioume est habitée par un chaman.
[149] Hauteur de l'abri: 1 m. 10; profondeur: 3 m.
Les chamans ont, dans la société ostiake, la position de prêtres, et sont considérés comme les intermédiaires entre les dieux et les hommes. Comme tels, ce sont de véritables diseurs de bonne aventure. Les naturels leur supposent le don de prédire l'avenir et la capacité de guérir les maladies. Pour entrer en communication avec les esprits, les chamans se servent d'un tambour de basque en peau de renne. Cet instrument sacré et ces croyances sont communs à toutes[Pg 232] les populations ouralo-altaïques. Au milieu du siècle dernier, avant leur conversion, les Lapons avaient encore des tambours magiques[150] et des chamans. Aujourd'hui les indigènes de la Sibérie septentrionale ont seuls conservé ces pratiques de sorcellerie.
[150] Les rares tambours magiques lapons conservés dans les musées d'ethnographie sont pour la plupart oblongs et couverts de dessins grossiers représentant les esprits. Ceux des Ostiaks et des Samoyèdes sont ronds et sans ornementation. Les chamans les font résonner à l'aide d'une baguette en os garnie de peau de renne.
Après une courte navigation, les bateliers nous arrêtent brusquement devant un bout de forêt. Nous débarquons, et un sentier embroussaillé nous conduit au keremet. Au milieu d'une clairière, une barricade de pieux surmontés de chiffons, et dans un coin un petit édicule: voilà le temple et les idoles des indigènes.
Aux âges primitifs, les diverses tribus finnoises ont eu de pareils sanctuaires. Ainsi les Esthoniens, qui sont aujourd'hui un peuple civilisé, ont jadis partagé les croyances des Ostiaks. Suivant un traité d'idolâtrie composé en 1517 par le moine allemand Léonard Rubenus, ces Finnois consacraient à leurs divinités des arbres élevés qu'ils décoraient de pièces d'étoffes suspendues aux branches[151].
[151] Baudrillart, Dictionnaire général des eaux et forêts, 1823 t. I, p. 6.
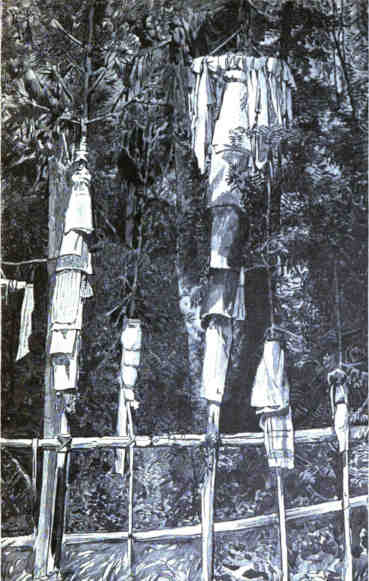
La gravure ci-contre, représentation exacte de ce lieu de sacrifice, dispense de toute description. On dirait un reposoir, avec d'autant plus de vraisemblance qu'il est surmonté d'une croix. Une cabane située à gauche de l'échafaudage de chiffons est construite sur le même modèle que les njalla des[Pg 234] Lapons[152]. Elle est juchée sur un tronc d'arbre à 1 m. 40 au-dessus du sol; on y accède par une planche garnie de grossières encoches en guise de marches. Ce cabanon renferme les images des divinités, deux grosses poupées formées de guenilles de diverses couleurs enroulées les unes autour des autres. Le visage du dieu est fait d'un morceau d'étoffe jaune, percé de quatre trous figurant le nez, les yeux et la bouche. A côté de ces idoles sont déposés deux paquets de flèches entourés de mouchoirs rouges, de cordons garnis de bagues en cuivre, et de grelots, un morceau de schiste micacé que ses facettes brillantes ont dû faire prendre pour quelque pierre précieuse, enfin des pieds de chevaux. Dans les idées des Ostiaks, les chevaux sont particulièrement agréables aux divinités, et lors des grandes fêtes, ils en sacrifient toujours à leurs dieux. A leurs yeux, le cheval blanc est un animal sacré.
[152] Petits magasins épars dans les forêts, où ces nomades font des dépôts de vivres et d'approvisionnements.
Généralement les images des dieux ostiaks sont de simples morceaux de bois grossièrement entaillés en forme de figures humaines. De simples incisions indiquent les yeux et la bouche. D'après Ahlqvist, la tête de certaines idoles serait garnie de plaques d'argent ou de plomb. Les indigènes se procureraient ces métaux par l'entremise des marchands russes, qui les achèteraient eux-mêmes à la grande foire d'Irbit.
Dans leurs sanctuaires, les Ostiaks déposent en guise d'ex-voto des fourrures précieuses et des pièces de monnaie. Il y a trois ans, divers objets en argent, d'une très grande valeur archéologique, provenant d'un bois sacré, ont été trouvés chez un[Pg 235] indigène de Liapine. C'étaient cinq assiettes, un plat carré et deux tablettes ornées de gravures figurant des scènes de la vie des naturels. L'une des plaques représentait un pêcheur et un archer tirant des rennes. Cette orfèvrerie, d'un fini merveilleux et d'un dessin irréprochable, est, suivant toute vraisemblance, une œuvre permienne. Ces Finnois ont été des ouvriers en métaux d'un goût artistique véritablement étonnant.
La présence de pareilles richesses dans un bois sacré est, croyons-nous, tout à fait accidentelle. Le keremet que nous avons visité ne renfermait pas un seul objet de valeur. En dépit de leurs plus minutieuses recherches, nos compagnons russes n'y ont découvert qu'un vieux kopek. Dans le bois sacré de Mouji, sur les bords de l'Obi, M. Sommier n'a également trouvé qu'une pièce de monnaie. A Liapine, Russes et Zyrianes affirment cependant que les keremets contiennent de véritables fortunes, et plusieurs d'entre eux passent pour avoir gagné une somme rondelette au métier de détrousseurs d'idoles. Que dans ces sanctuaires les Ostiaks déposent des fourrures de prix, la monnaie courante du pays, à cela rien d'extraordinaire, mais ils ne peuvent guère offrir à leurs divinités des pièces d'argent, par l'excellente raison que le numéraire est presque inconnu dans ces régions et que même les roubles-papier ne sont pas communs dans ce pays où tout le commerce se fait par voie d'échange. En cas de besoin les Ostiaks reprennent les offrandes faites à leurs divinités un jour d'abondance. Suivant la pittoresque expression du voyageur russe Poliakov, les idoles sont les caisses d'épargne des indigènes. Pendant leurs déplacements ils confient leur fortune à leurs[Pg 236] dieux. Tous les ustensiles et vêtements qu'ils n'emportent pas, ils les déposent sur des traîneaux qu'ils abandonnent dans les keremets.
Les bois sacrés comme celui de Liapine correspondent à nos églises de village. C'est là que tous les membres d'un même hameau viennent faire leurs dévotions. Au-dessus de ces keremets existent des sanctuaires communs à toute la race ostiake, dont la réputation attire de loin une foule de pèlerins. Aux environs de Troïtski, à une cinquantaine de kilomètres en aval du confluent de l'Obi et de l'Irtich, habite un dieu particulièrement vénéré, Tourom-asler, le dieu du confluent de l'Obi et de l'Irtich, d'après Ahlqvist. Tel est le renom de sainteté du lieu, que des Samoyèdes n'hésitent pas à entreprendre des voyages de plus de 1 000 kilomètres pour venir y implorer les esprits.
A côté de ces divinités publiques, chaque famille a en outre ses dieux domestiques. Chez les Ostiaks existe la même hiérarchie religieuse que dans le monde des anciens, et ce n'est pas le seul rapprochement que nous pourrions faire dans cet ordre d'idées. Les dieux lares sont figurés soit par une petite poupée appelée chiongote, soit par un caillou dont la forme rappelle vaguement la silhouette de quelque animal. D'après M. Sommier, les chiongotes sont consacrées aux parents décédés. Ces sauvages incultes vivant au jour le jour ont des sentiments qui ne sont généralement développés que chez les populations plus élevées en civilisation. Ainsi les morts sont de leur part l'objet d'un culte touchant. Après le décès d'un membre de la famille, les survivants fabriquent une poupée qui est censée représenter le défunt et qui est traitée comme le serait le mort de[Pg 237] son vivant. Le soir on la couche sous des peaux, le matin on la lève et on la place devant le feu. On met devant elle une tabatière, du tabac à fumer, et, lors des repas, on dépose à ses pieds de la nourriture. D'après Castren, une autre classe de chiongotes aurait, dans les croyances des indigènes, des fonctions différentes; elles seraient les dieux protecteurs du troupeau de rennes, de la santé de la famille du chasseur heureux, et comme telles, bien entendu, recevraient des offrandes.
Chez les Ostiaks comme chez les Finnois du Volga, les grandes cérémonies religieuses consistent en un repas sacré. Les indigènes abattent un animal, un renne ou un cheval, et le mangent devant les idoles après un simulacre d'offrande aux fétiches. Le chamane barbouille la bouche du dieu de viande et de sang, lui verse ensuite de l'eau pour le rafraîchir, et, si les fidèles possèdent du vodka, quelques gouttes du précieux liquide terminent le repas symbolique. La tête et la peau de l'animal sacrifié sont ensuite suspendues aux arbres. Dans le bois sacré de Liapine, à côté du reposoir, se trouvait tout un matériel culinaire: une table, une chaise, une cuve, des écuelles et des cuillers en bois. A un arbre était suspendu un tambour magique.
La plus haute divinité des Ostiaks est le dieu du ciel, Tourom[153], le souverain maître du monde et des hommes, celui qui, à son gré, déchaîne la tempête et fait rouler le tonnerre. Dans les croyances des indigènes[Pg 238] ce dieu occupe la même place que Jupiter dans la mythologie grecque et romaine. Bien que le plus élevé dans la hiérarchie religieuse des bords de l'Obi, Tourom n'est point l'objet d'un culte, et en son honneur on ne fait ni sacrifice ni offrande. Un peuple habitant au milieu des forêts et pour qui la pêche est une des principales industries a tout naturellement peuplé d'esprits les bois et les rivières. Meang est le dieu de la forêt, Koulji celui des eaux, et ceux-là sont particulièrement vénérés. Jamais un Ostiak ne part pour la chasse ou pour la pêche sans leur promettre une offrande en cas de succès. L'ours est l'objet d'un culte de la part des indigènes. Les Ostiaks comme tous les autres peuples finnois manifestent à son égard une crainte superstitieuse. L'animal s'offenserait, croient-ils, s'ils l'appelaient de son nom, et pour éviter sa colère ils le désignent sous diverses circonlocutions, comme du reste les Lapons et les Finnois de Finlande. Toujours ils le nomment le vieux fils de Tourom. Lorsqu'un ours a été tué, les Ostiaks célèbrent cet événement par des danses. Cette coutume remonte à une très haute antiquité. Le Kalevala raconte des réjouissances analogues en pareille occasion. Jadis l'ours vivait dans les régions éthérées, mais, bien qu'habitant le «septième ciel», il s'y ennuyait fort. Sur ses instances, son père le laissa partir pour la terre, à condition qu'il n'attaquerait jamais les bons, et qu'il serait ici-bas le représentant de la justice. Vivant ou mort, l'ours voit tout et sait tout. Pour cette raison les indigènes ont l'habitude de jurer sur sa patte ou sur sa dent en prononçant ces paroles sacramentelles: «Si je suis un imposteur, mange-moi». Dans leurs idées ce serment a la plus[Pg 239] haute valeur[154]. Comme fétiches tous les Ostiaks portent à la ceinture une dent d'ours. Ce morceau d'os a la vertu de préserver des douleurs dans le dos. En cas de maladie, les naturels raclent la dent et en avalent de petits morceaux.
[153] En langue ostiake, touroum signifie à la fois l'air, l'espace et dieu. En dialecte vogoule, tarom a la même signification. (Ed. Sayous, Des mots communs aux diverses langues finnoises. Mémoire manuscrit que le savant professeur de la Faculté de Besançon a eu l'amabilité de me communiquer.)
[154] Poliakov, loc. cit.
Sur les cours d'eau, les caps et les baies des rivières, habitent des esprits auxquels les Ostiaks ne manquent jamais de sacrifier lorsqu'ils passent.
Ainsi, un promontoire de l'estuaire du Nadyme, dans la baie de l'Obi, est le séjour de la divinité Émane. Dans les nuits obscures de l'hiver, le dieu éclaire d'un feu constant la route suivie par les navigateurs; il a de plus le pouvoir de changer la direction des vents. Lorsque nous arrivâmes devant cette pointe, raconte M. Poliakov, le plus vieil Ostiak de l'équipage remplit une soucoupe d'eau-de-vie, puis regardant le cap d'un air suppliant, la versa dans l'eau, et jeta ensuite deux pièces de 10 kopeks et trois bagues de cuivre. Le sacrifice prit fin après offrande d'une seconde soucoupe jetée avec le même cérémonial que la première. Après quoi je dus régaler d'eau-de-vie les Ostiaks. Tous les environs de ce cap sont considérés comme tabous[155]. Défense d'y chasser, d'y cueillir des fruits, et de boire l'eau du fleuve aux environs.
[155] Les arbres des bois sacrés sont également tabous. Défense d'y couper même une branche sous les peines les plus sévères.
Pour terminer ce long chapitre relatif aux Ostiaks, deux mots sur leur état moral. Étant encore naïfs, ils sont restés sincères, et, demeurés à l'écart de la civilisation, ils ont gardé l'honnêteté primitive. Les Ostiaks ignorent l'usage des serrures. Chez eux tout est ouvert à tout venant et jamais rien n'est pris.
[Pg 240]
Que de fois dans nos discussions de politique coloniale n'a-t-on pas fait sonner haut le prétendu devoir des races supérieures de porter les lumières de la civilisation aux peuples inférieurs! Ce sont là de pures déclamations. A notre contact les sauvages prennent tous nos vices sans acquérir aucune de nos qualités.
[Pg 241]
Descente de la Sygva.—Un clan zyriane.—Un prince ostiak.—Danse des indigènes.—Arrivée à Beriosov.
La traversée de l'Oural était la grosse difficulté de l'expédition. Cette chaîne de montagnes franchie, tout devient désormais facile. La route s'ouvre maintenant aisée et sans fatigue, tracée par de larges rivières. Dans les régions du nord, en Europe, en Asie comme en Amérique, les seules voies de communication sont les cours d'eau. La Sygva et la Sosva nous conduiront à Beriosov, puis l'Obi nous amènera à Samorovo, au confluent de ce fleuve et de l'Irtich. Au total, une navigation à la rame d'environ 1 200 kilomètres.
Notre première étape sera Beriosov, et le 17 août, dans l'après-midi, nous quittons la factorerie de Liapine. Nous sommes confortablement installés dans une spacieuse lodka et nous avons des vivres à discrétion. Pour obéir aux instructions de M. Sibiriakov, ses employés ont mis à notre disposition toutes les ressources des magasins, et au gré de ces braves gens nous usons avec trop de discrétion de cette hospitalité[Pg 242] si généreusement offerte. Ils voudraient nous charger de farine, de sucre, de thé; si nous n'y mettions bon ordre, notre embarcation deviendrait un entrepôt. Désormais sans souci du vivre ni du couvert, le voyage sera une partie de plaisir. Boyanus, notre brave Popov et moi, prenons place dans la lodka; une seconde transporte un ouriadnik de Beriosov et un interprète ostiak envoyés à notre rencontre par les autorités impériales. Fonctionnaires et simples particuliers rivalisent pour rendre facile notre exploration.
A deux heures, l'escadrille appareille et, à une demi-heure de Liapine, s'arrête pour prendre des rameurs au village de Sarompaoul. Nous irons ainsi jusqu'à Beriosov de station en station, changeant chaque fois d'équipe. Les hameaux (paoul) sont échelonnés le long de la rivière à 15, 20, 30 kilomètres les uns des autres. Ce sont les seules localités habitées; à droite, à gauche, s'étend la solitude absolue, la grande forêt inutile et déserte.
A un kilomètre en aval de Liapine, sur la rive gauche de la Sygva, se trouvent les ruines très bien conservées d'une forteresse russe. Dès la fin du XVe siècle, Liapine était une localité importante, et elle se trouve mentionnée dans les Notes sur la Russie d'Herberstein. La carte de Sibérie publiée par Strahlenberg[156] (1730) indique très exactement à Liapine un[Pg 243] poste russe sous le nom de Gorodok Liapinski. Les murailles du fort sont encore debout, c'est un blockhaus en bois, surmonté d'une terrasse d'où les défenseurs pouvaient répondre aux assaillants.
[156] Nova Descriptio Geographica Tattariæ Magnæ tam orientalis quam occidentalis in particularibus et generalibus territoriis una cum delineatione totius imperii Russici imprimis Siberiæ accurate ostensa. (Reproduction photolithographique publiée par la Société suédoise d'anthropologie et de géographie. Svenska sällskapet för Antropologi och Geografi. Geografiska Sektionens Tidskrift, 1879, vol. I, no 6.)
A notre grand regret, le manque d'instruments ne nous permit aucune fouille. L'exploration de ces ruines eût présenté du reste de grosses difficultés. Dans cette région sibérienne le sol reste éternellement gelé; à une profondeur de 60 centimètres, le sable est glacé et prend la consistance de la pierre. Cette zone, constituée uniquement par des formations arénacées, forme sur des milliers de kilomètres une gigantesque glacière souterraine, et dans cette couche se sont conservés presque intacts les débris du mammouth et du rhinocéros à narines cloisonnées de la période quaternaire. Quelques exemplaires ont été trouvés encore garnis de chair, dont les chiens des indigènes se sont régalés.
Le musée de l'Académie Impériale des Sciences à Saint-Pétersbourg renferme un squelette entier de mammouth. Cet animal, très voisin de l'éléphant actuel, armé comme lui de deux longues défenses, abondait dans la Sibérie septentrionale. Aujourd'hui la recherche de l'ivoire fossile est une des industries les plus lucratives des indigènes riverains de l'océan Glacial. En moyenne, les Toungouses de la Léna recueillent annuellement 16 000 kilogrammes d'ivoire fossile, représentant environ 200 individus; en 1840, Middendorf estimait déjà à 20 000 le nombre des mammouths dont les dépouilles avaient déjà été exploitées[157]. A la foire d'Obdorsk, en 1881, furent vendus 570 kilogrammes de dents de mammouth[Pg 244] pour la somme de 1 400 roubles[158]. Les déserts de Sibérie ont ainsi gardé dans une intégrité absolue les documents les plus précieux pour l'histoire de la terre.
[157] Lapparent, les Anciens Glaciers, Paris, 1892.
[158] Sommier, loc. cit.
Par un contraste bizarre, ce sol éternellement gelé porte la plus belle végétation qui puisse s'épanouir sous le cercle polaire. Partout la forêt est touffue, les arbres grands et élancés. Une terre vivante repose sur cette terre morte.
Cette couche glacée exerce une influence considérable sur la nature de la Sibérie. Imperméable, elle maintient marécageuses les strates superficielles du sol, et produit ainsi les immenses marais de l'Asie septentrionale. Cette immense glacière située à quelques centimètres de profondeur est, de plus, une des causes de la rigueur du climat sibérien. Durant notre séjour à Liapine, la température était pendant la journée très agréable avec des maximums de 14°; mais, dès le coucher du soleil, le thermomètre descendait brusquement à 5 ou 6 au-dessus de zéro. Un air glacial semblait sortir de terre.
A 4 kilomètres de Liapine, arrêt au village de Sarompaoul, habité par des Zyrianes.
De l'Oural à l'Obi sont essaimées de petites colonies de ces Finnois attirés en Sibérie par la richesse des pêcheries et l'appât de gains commerciaux. Le village de Muji, situé à moitié route entre Obdorsk et Beriosov, est l'établissement zyriane fixe le plus septentrional en Sibérie. Ces indigènes ont su monopoliser à leur profit les transactions de la région; aux Ostiaks ils achètent le produit de leur chasse et de[Pg 245] leur pêche et leur cèdent en échange de la farine et des objets manufacturés de mauvaise qualité. Intelligents et par conséquent peu honnêtes, ils réalisent facilement des profits considérables; ils vendent, par exemple, aux pauvres pêcheurs ostiaks 1 fr. 50 ou 2 francs de mauvais boutons en cuivre qui ne valent pas 2 sous. Grâce à ces procédés peu scrupuleux, les troupeaux de rennes, la principale source de richesse du pays, ont passé peu à peu des mains des Ostiaks dans celles des Zyrianes. Les indigènes se sont appauvris, et les immigrés enrichis. Ainsi un des Zyrianes de Chekour-Ia nous a avoué posséder 3 000 rennes, un bon petit capital, cet animal valant de 8 à 28 francs.
Sarampaoul compte une centaine d'habitants, une grande ville dans ce pays désert! Quelques-uns sont pasteurs de rennes; le plus grand nombre vit du produit de la pêche, auquel ils ajoutent les ressources de l'élevage du bétail. Les habitants possèdent un troupeau d'environ 70 vaches. Ces Zyrianes habitent des maisons en bois disposées comme celles de leurs congénères de la Petchora: un vestibule et des pièces divisées en trois compartiments par des séparations en bois.
Nous prenons une équipe de rameurs et aussitôt après en route. A quelques kilomètres en aval nous apercevons une dernière fois l'Oural. Sur l'horizon jaune du couchant les montagnes bleuâtres se détachent avec une netteté parfaite. On dirait des découpures bleues collées sur du papier jaune.
A dix heures du soir, nous arrivons à Kossilok, paoul ostiak, et dans la matinée du 18, à Lokmouspaoul. A peine débarqués, un Ostiak vient nous serrer la main avec force démonstrations amicales. Étonnés[Pg 246] d'un pareil sans-gêne de la part d'un indigène, nous allions le repousser, lorsque l'ouriadnik Reif, faisant office pour la circonstance de chambellan, nous présente le personnage, Son Altesse Seigneuriale Dmitri Tcheskine, prince des Ostiaks de la Sygva. Parmi ces sauvages habillés de peaux se trouvent, comme dans toutes les sociétés, des familles de noble origine, descendants des anciens souverains du pays. Aujourd'hui cette aristocratie est bien déchue: les princes ostiaks ne sont plus que des collecteurs d'impôts, et, d'après M. Sommier, n'auraient conservé de leurs privilèges politiques que le droit de jugement pour certains délits commis par les indigènes. Mais, toujours avisé, le gouvernement de Saint-Pétersbourg a eu soin de s'attacher ces personnages en leur confirmant leurs titres. Un bout de papier noirci de caractères indéchiffrables et quelques cachets ont fait l'affaire.
Son Altesse nous conduit immédiatement dans sa iourte et nous fait asseoir à ses côtés sur le lit de camp placé à gauche de la porte. Chaque fois que nous entrons dans une hutte en sa compagnie, toujours le bonhomme s'installe de ce côté: c'est probablement la place d'honneur dans le cérémonial ostiak. Le prince ne tarde pas à devenir très communicatif; il nous tape amicalement sur les genoux, et nous sourit, tout en se mouchant dans ses doigts. Pour le remercier de cet excellent accueil, nous lui faisons présent d'un grand foulard de soie rouge; désireux de ne pas être en reste de politesse avec nous, immédiatement Son Altesse m'offre une boîte à allumettes en corne de renne avec son monogramme.
Le prince est vêtu d'une belle parka en peau de renne blanc; pour le reste, il était aussi sale que ses[Pg 247] congénères. Son habitation ne diffère pas non plus de toutes celles que nous avons visitées jusqu'ici. Dans le coin de la hutte se trouve une malle russe, que Dmitri s'empresse d'ouvrir pour en extraire des parchemins. C'est la chancellerie seigneuriale renfermant les titres nobiliaires. A côté sont suspendus un vieux sabre de gendarme et une défroque de laquais de cour, présents du gouvernement impérial.

L'aimable accueil du prince n'était pas absolument désintéressé. Son Altesse ne tarda pas à nous faire part des doléances des indigènes et à solliciter notre protection. Comme les habitants de tous les pays du monde, les Ostiaks se plaignent de la lourdeur des impôts, et le prince nous demande notre appui auprès[Pg 248] du gouverneur de Tobolsk afin d'obtenir une diminution des charges qui pèsent sur ses sujets.
Dans la circonscription de Liapine, 380 Ostiaks sont soumis au iassak; par suite d'une erreur de scribe, les pièces officielles portent leur nombre à 480, d'où surcroît d'impôt, et Son Altesse serait très désireuse de soulager les maux de son peuple.
Le prince étant complètement illettré, le brave Popov s'occupe de rédiger une supplique. La rédaction en est laborieuse, elle dure deux heures pour le moins; après quoi, Dmitri appose cérémonieusement son sceau sur la requête.
Pendant ce travail, Boyanus recueille d'intéressants renseignements sur le commerce des fourrures. Ici la peau de petit-gris vaut de 25 à 50 centimes, celle de zibeline de 10 à 20 francs en moyenne. Dans cette région le petit-gris est relativement rare; un indigène en capture au maximum une centaine par an. Sur les bords de la Sosva il est beaucoup plus abondant; dans cette vallée un bon chasseur peut en tuer annuellement un millier.
La rédaction de la supplique terminée, nous nous remettons en route. Pour nous faire honneur, le prince tient absolument à nous accompagner. Nous avons eu l'imprudence de lui offrir de l'eau-de-vie, et dans l'espoir de recevoir de nouvelles rasades il désire rester en notre compagnie le plus longtemps possible. Redoutant la ménagerie qui grouille sur ses vêtements, nous faisons asseoir le personnage à la porte de notre petite cabine: mais cette place ne satisfait pas sa vanité. Pour marquer son rang aux yeux des rameurs et leur prouver que nous le traitons d'égal à égal, le prince Dmitri rapproche lentement son siège de l'entrée de la cahute, puis allonge un pied[Pg 249] dans l'intérieur: il n'a pas ainsi l'air d'être à la porte. Peu à peu il passe une jambe puis une autre, ensuite la tête; finalement le sire trouve moyen de s'installer complètement dans la pièce. Dmitri, tout fier de sa ruse, rit sous cape. Lorsque à sa mine réjouie nous éclatons de rire, le bonhomme ne peut retenir sa joie. Pour lui faire place je suis obligé de monter sur le toit de l'embarcation.
En passant, signalons la présence sur la rivière de nombreuses mouettes tridactyles et de guillemots de Brunnich.
Vers cinq heures du soir nous arrivons à une station où nous débarquons notre compagnon. Avant de nous débarrasser du personnage, nous lui offrons une collation servie dans des assiettes en fer-blanc et avec des couverts. Ces ustensiles ne laissent pas d'embarrasser singulièrement le prince; évidemment la fourchette du père Adam lui paraît plus commode, mais Son Altesse tient absolument à prendre les belles manières. Elle a du reste une bien meilleure éducation que les membres de l'aristocratie ostiake rencontrés par d'autres voyageurs sur l'Obi. Avant de nous quitter, Dmitri recommande aux indigènes de nous conduire rapidement, et en fidèles sujets ceux-ci rament avec une vigueur qui fait notre étonnement.
Dans la soirée nous atteignons Rakmatia Paoul, ayant parcouru environ 60 kilomètres en huit heures. Une bonne étape! Le temps de prendre de nouveaux rameurs et nous repartons. Le ciel est suffisamment clair la nuit pour nous permettre de relever le cours de la rivière. En nous relayant, nous pouvons travailler tout en marchant. C'est, du reste, plaisir de veiller par ces belles nuits d'automne.[Pg 250] Dans le ciel clair du Nord les étoiles brillent d'un éclat extraordinaire, et au milieu de l'obscurité les troncs blancs des bouleaux ont l'air d'une assemblée de fantômes devant lesquels nous défilons. Tout est silencieux. C'est le calme des choses mortes, et tout l'être est pénétré d'une sensation infinie de repos.
Comme tous les primitifs, les Ostiaks ont quelques notions d'astronomie. Ils connaissent la Polaire, l'étoile qui ne bouge pas, comme ils l'appellent, et sur elle ils se guident lorsque la nuit les surprend dans ces forêts où il est si facile de s'égarer.
Les Ostiaks divisent l'année en treize mois, qui portent des noms rappelant les phénomènes naturels ou leurs diverses occupations. D'après les uns, elle commencerait à l'équinoxe du printemps; d'après les autres, à celui d'automne[159]. C'est en somme le calendrier révolutionnaire.
[159] Ahlqvist, loc. cit.
Maintenant les nuits sont devenues très fraîches. Les indigènes ne sentent pas cependant cet abaissement de la température. Tous sont simplement vêtus de toile. Habitués à des froids de quarante degrés, ils éprouvent sans doute une sensation de chaleur tant que le thermomètre reste au-dessus de zéro.
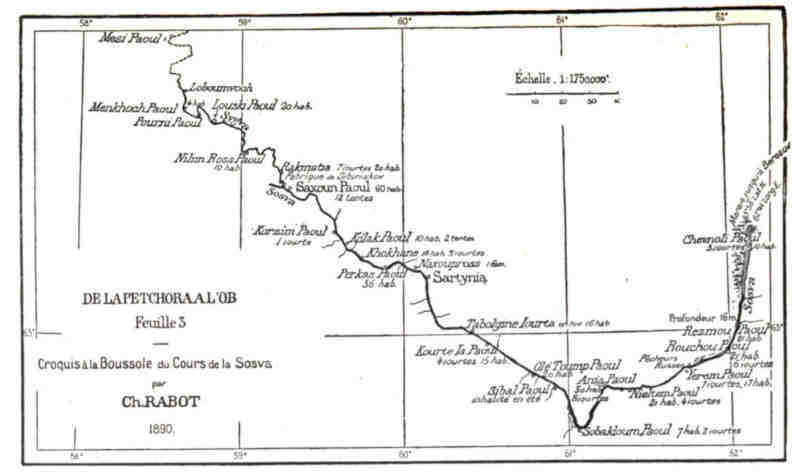
Quelques rameurs portent une longue chevelure flottante sur les épaules comme les tout jeunes misses anglaises. La plupart la divisent au contraire derrière la tête en deux nattes entourées d'une cordelière rouge et ornées à leur extrémité de morceaux d'étoffe. Ces tresses sont en outre attachées l'une à l'autre sur l'occiput par un cordon également rouge. Certains indigènes ont des nattes très longues qui[Pg 252] leur descendent parfois jusqu'à la ceinture. Avec cette coiffure et leur figure imberbe les hommes ne sont pas toujours faciles à distinguer des femmes. Des jeunes gens surtout ont l'air de jeunes filles. Tous ont les doigts couverts de bagues en cuivre. A propos de la parure, signalons un détail intéressant. D'après Ahlqvist, les femmes «vogoules» se tatoueraient les pieds et les mains de traits géométriques. Cette ornementation n'est pas en usage dans la région que nous avons visitée[160].
[160] Finsch a observé des tatouages sur une jeune Ostiake pendant son voyage de Tomsk à Samarovo. (Finsch, loc. cit.)
Le lendemain matin, 19 août, nous atteignons la Sosva, grande rivière qui dans tout autre pays que la Sibérie serait un fleuve important.
Sur la Sosva comme sur la Sygva, toujours le même paysage: une plaine boisée. Pas d'horizon, la vue est limitée aux deux berges couvertes de forêts. Si, toutes les trois ou quatre heures, on n'était intéressé par le spectacle amusant et curieux des stations indigènes, le voyage serait terrible d'ennui. Ici c'est le grand désert du Nord, triste et monotone, une terre inutile, fermée à l'homme. Avec cela, l'air est lourd, on sent un continent derrière soi. Tout est uniforme, le sol comme l'aspect du pays. Nulle part un rocher, une pierre, partout des terrasses sablonneuses couronnées de tourbières.
Au delà du confluent de la Sosva et de la Sygva est situé Saxoun Paoul[161], l'agglomération ostiake la plus importante rencontrée jusqu'ici: 60 habitants et 12 tchioumes. Les paouls des bords de la Sygva contiennent deux formes particulières d'habitation,[Pg 253] la tchioume carrée et le sasskol. Le sasskol forme le passage entre le simple abri en écorce de bouleau et la maison, entre la tchioume mobile et la iourte fixe. C'est une hutte rectangulaire couverte d'un toit à deux auvents, faite de perches et de pieux et entièrement garnie d'écorce. La disposition interne est semblable à celle de la iourte. Cette habitation légère n'est occupée qu'en été. Elle est spéciale aux Ostiaks de la région ouralienne. Au delà de Sartynia nous ne l'avons pas observée.
[161] Glossaire topographique ostiak: Saxoun, embouchure; Toump, île; Ia, rivière ou ruisseau.
A chaque station nous nous arrêtons une ou deux heures. Il faut d'abord manger; puis, pendant que les indigènes font leurs préparatifs de départ, nous examinons le mobilier des huttes et étudions la vie des naturels, si curieuse et si suggestive. Nous avons sous les yeux un passé vieux de centaines de siècles, l'enfance de l'humanité, alors que l'homme tirait toutes ses ressources de la chasse et de la pêche.
Une scène amusante est le repas des naturels. Le couvert se compose de deux augettes en écorce remplies, l'une de poisson bouilli, l'autre d'huile de poisson et d'un gros pain noir que dédaigneraient les chiens délicats. Cette huile remplace le beurre dans la cuisine des indigènes. Autour des deux plats déposés par terre la famille s'accroupit, et aussitôt commence la pêche des morceaux. Après chaque bouchée, les convives boivent un petit coup d'huile en guise de rafraîchissement. Entre temps les indigènes se mouchent avec les doigts, puis, après cette opération, sans même s'essuyer, attrapent dans le plat un filet de poisson. Le morceau ainsi assaisonné n'en est que meilleur. Durant l'été, cette soupe forme pour ainsi dire toute la nourriture des indigènes. Telle est son importance dans l'économie[Pg 254] domestique que le temps nécessaire à sa cuisson est l'unité de temps la plus courte des Ostiaks[162].
[162] Ahlqvist.
En hiver, le poisson est également un élément important de l'alimentation des Ostiaks. A cette époque, ils le mangent soit sec, soit fumé ou salé, et ils en absorbent d'énormes quantités. Les indigènes ont un estomac dont la capacité rivalise avec celui des Eskimos. Ils peuvent avaler jusqu'à vingt ou vingt-cinq livres de poisson par jour, et dans un seul repas quatre ou cinq coqs de bruyère avec une bonne portion de poisson sec[163]! Le poisson cru est très apprécié des indigènes. C'est, paraît-il, un excellent remède contre le scorbut. A chaque station notre interprète se faisait donner quelques corégones, qu'il engloutissait incontinent. En un tour de main il dégageait les filets, s'en remplissait la bouche, puis au ras des lèvres coupait le morceau.
[163] Poliakov et Ahlqvist.
Jadis la farine était une denrée rare et chère. Depuis l'établissement des magasins de M. Sibiriakov à Liapine, son prix a subi une baisse considérable, et maintenant elle entre dans l'ordinaire de chaque famille. Les ménagères boulangent grossièrement, et dans les grands jours préparent une bouillie de farine de seigle et de poisson qui est, paraît-il, excellente.
Comme tous les peuples sauvages, les Ostiaks sont omnivores. Ils mangent tous les animaux et oiseaux qu'ils abattent, même le renard et l'écureuil. Un pâté de farine et d'écureuil est considéré comme un fin morceau. Dans la gastronomie indigène, les deux gibiers les plus appréciés sont l'élan et le renne. La boisson la plus recherchée est naturellement l'eau-de-vie,[Pg 255] mais sur les bords de la Sygva et de la haute Sosva elle est rare, heureusement pour la santé des indigènes. Des Russes les Ostiaks ont pris l'usage du thé, mais, ne pouvant s'en procurer, le remplacent par des infusions de Spiræa ulmaria.
Une fois tout notre monde lesté, en route. Nous voulons arriver ce soir à Sartynia, le seul village russe de la région, la Capoue de la Sosva aux yeux des indigènes.
Dans la journée, arrêt à Kokane. Grand mouvement dans le paoul. Les hommes reviennent de la pêche et toutes les femmes sont occupées à préparer la provision d'hiver. Avec une omoplate de renne en guise de couteau, elles ouvrent le poisson, puis d'un tour de main rapide enlèvent l'intérieur, le déposent dans un vase, pour en extraire l'huile, et enfilent ensuite les deux filets du poisson sur une baguette. Des échafaudages hauts de plusieurs mètres sont entièrement chargés de petits poissons brillants[164] comme de l'argent; de loin, agité par la brise, tout cela scintille comme un énorme miroir à alouettes.
[164] Coregonus Merkii Gün. Les autres espèces de poissons abondantes dans la Sosva sont le C. Muksun, le C. Syrok, le C. Cavaretus Polj et le brochet.

Encore une station et, à la nuit tombante, nous arrivons à Sartynia, le premier hameau russe rencontré depuis la Petchora. En quarante-huit heures nous avons parcouru à la rame 290 kilomètres, d'après les évaluations des indigènes. Le starost ostiak nous souhaite la bienvenue et nous conduit dans une excellente maison. Pour la circonstance, cet Ostiak a revêtu[Pg 256] une redingote noire ornée d'une médaille, cadeau des autorités russes en récompense du zèle avec lequel il s'est acquitté de ses fonctions pendant je ne sais combien d'années.
Une église, six ou sept maisons, quelques tchioumes dispersés sur le bord de la rivière au milieu d'une clairière, forment la capitale de la vallée de la Sosva.
Le lendemain, c'est grande réjouissance parmi les indigènes. Moyennant une bonne régalade d'eau-de-vie, les habitants nous ont promis une représentation des danses qu'ils exécutent après la mort de l'ours. De larges distributions ont mis tout le monde de belle humeur.
Une fois rapporté au village, l'ours, nous raconte-t-on, est placé sur un banc, après quoi tous les habitants viennent l'embrasser et déposer sur le cadavre des ornements comme sur une relique vénérée. On passe des anneaux à ses griffes et on lui entre des pièces de monnaie dans les yeux. Après cette cérémonie commencent les danses, exécutées par des hommes la figure couverte d'un masque grossier en écorce de bouleau.
Pas très élégantes, ni très variées ces danses. Un saut rythmé accompagné de mouvements de bras, de véritables contorsions d'aliénés: le lecteur en jugera par la photographie instantanée reproduite pages 258 et 259[165].
[165] Le personnage de droite est le starost, qui, prenant part à la danse en qualité de dilettante, n'avait pas mis le masque.
Les naturels exécutent devant nous plusieurs divertissements chorégraphiques. C'est d'abord la danse de l'homme et du diable. Deux Ostiaks se poursuivent en sautillant, le diable cherchant à saisir[Pg 257] l'homme. Après commence la danse du bouleau. Au milieu de la pelouse, un homme qui figure le bouleau se plante immobile, tandis que son acolyte se trémousse en le battant et en essayant de le renverser. A la fin, l'arbre s'anime, le danseur recule étonné, puis tombe dans les bras de son partenaire, en criant: «C'est un homme!» et le divertissement prend fin. C'est l'art de l'enfance. La représentation se termine par la danse des chiffons. Comme dans les exercices précédents, elle ne comporte que deux danseurs, et la seule différence est qu'ils sautent en agitant des châles[166].
[166] Ahlqvist a assisté à une danse de l'ours moins primitive. Elle débuta par un monologue improvisé par un indigène masqué. Le bonhomme exalta son courage et son habileté de chasseur, puis se glorifia d'avoir abattu nombre d'animaux autrement dangereux que celui qu'il venait de tuer. Par des contorsions grotesques il mima ensuite, aux rires de l'assistance, l'attitude du chasseur peureux. Après ce prélude les acteurs représentèrent des scènes de la vie des indigènes.
Pendant la durée de la pantomime, un artiste indigène joue de la dombra, cithare à cinq cordes. Ces pauvres gens ont su inventer des instruments de musique et composer des airs d'une mélancolie profonde!
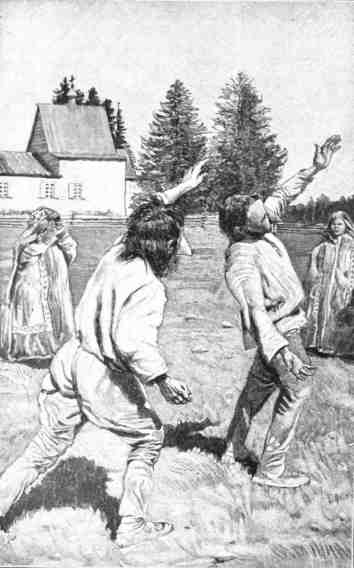

Mises en gaîté par l'absorption de nombreux petits verres, les femmes consentirent, elles aussi, à nous montrer leurs talents chorégraphiques. Tout d'abord, elles enfilent les gants de fourrures adaptés aux manches de leurs robes, puis se couvrent la tête de leurs châles. Elles semblent prendre à tâche de ne laisser voir aucune partie de leur visage ou de leur corps. Ainsi attifées, elles ont tout l'air de grossiers mannequins. Les ballerines commencent par agiter les bras et le corps, lentement et avec des mouvements[Pg 260] langoureux qui nous rappellent ceux des fameuses danseuses javanaises de l'Exposition de 1889. Puis, s'animant peu à peu, elles exécutent un pas saccadé analogue à celui des hommes, toujours en prenant des poses orientales. Cette danse est accompagnée de chants peu harmonieux dont les paroles sont improvisées. Les femmes célèbrent ainsi le généreux étranger qui est venu visiter Sartynia et qui les a libéralement régalées d'eau-de-vie. Un autre chant est l'éternelle histoire de la femme délaissée. Un étranger s'était épris d'une jeune indigène, il l'aimait follement, passionnément; de cet amour naquit un enfant, puis, un beau jour, le père prit la fuite. Pourquoi s'est-il sauvé? Sur ces mots finit le chant.
Les femmes ostiakes ne sont pas aussi naïves que pourraient le faire croire ces dernières paroles. Sur ce sujet, la femme de notre interprète Siméon nous fit les aveux les plus significatifs. Cette Ostiake, digne d'une société civilisée, proclamait la liberté des amours. Elle prenait pour un temps un mari dans un paoul, et, lorsque l'ennui arrivait, elle le quittait pour partir à la recherche d'un nouvel époux temporaire. L'enfant né de ses relations avec Siméon était très malade: «S'il meurt, nous dit-elle très naturellement, j'abandonne mon mari; c'est un propre à rien.»
En voyage la tâche de l'explorateur est aussi variée qu'étendue. En marche il relève sa route, note toutes les particularités topographiques et économiques. Aux haltes ne croyez pas qu'il puisse se reposer. Il doit faire des collections d'histoire naturelle, acheter des objets d'ethnographie, recueillir des renseignements sur la vie des indigènes, et tous ces renseignements sont longs à obtenir, et combien divers!
[Pg 261]
Ce matin nous observions les divertissements des indigènes, l'après-midi nous étudions le cimetière. A quelques pas de l'église, dans le calme éternel de la forêt vierge, sont éparses de petites caisses en bois, toutes pareilles. Quelques-unes tombent de vétusté, et l'entre-bâillement des planches laisse apercevoir des armes et des ustensiles déposés sur la fosse. Les Ostiaks croient à une autre vie, dans un monde souterrain où les morts mèneraient la même existence qu'ici-bas. Pénétrés de cette idée, ils placent sur les tombes tous les objets nécessaires au défunt pour assurer sa subsistance. Le cadavre est enseveli complètement habillé, avec un arc, des flèches, une pipe, une tabatière, une cuiller, etc. Dans les idées des indigènes, l'entrée du monde éternel serait située très loin au nord, au delà de l'embouchure de l'Obi, en plein océan Glacial. D'ici là le voyage est long. Pour que le mort puisse effectuer rapidement ce parcours et puisse ensuite circuler à travers le monde souterrain, on dépose à côté de la tombe un traîneau, et, après l'ensevelissement, on tue dans le cimetière le renne favori du défunt. La tête de l'animal est abandonnée à côté du véhicule[167].
[167] Poliakov, loc. cit.
Dans la soirée, départ de Sartynia.
21 août.—Dans la matinée, arrivée à Olé-Toump Paoul. Nous y faisons l'acquisition d'un jouet indigène: un oiseau en bois articulé. Le mouvement d'un contrepoids abaisse ou relève alternativement la tête ou la queue. Sur les boulevards les camelots en vendent de pareils. Après cela niez donc l'ingéniosité et l'intelligence des primitifs.
La Sosva est maintenant divisée en plusieurs bras[Pg 262] par de longues îles couvertes de saulaies. Derrière ces rideaux d'arbres, la rivière s'épanche en larges marécages boisés. De loin en loin apparaît la berge sablonneuse. En certains endroits elle est coupée par une passe étroite donnant accès dans une sorte de lac[168] greffé comme une fistule sur le tronc de la rivière. Ces nappes d'eau, peu profondes, sont particulièrement favorables au développement de la tourbe. Beaucoup de ces kouria sont même déjà séparées de la rivière par des cordons littoraux constitués par des dépôts végétaux.
[168] Kouria en langue indigène; sor en russe.

22 août.—Un temps brumeux, froid, pluvieux, le crachin du nord. Nous sommes au milieu d'immenses marais. La Sosva proprement dite est large de 500 à 600 mètres, et derrière des lignes d'oseraies s'étendent des marécages larges de 8 à 10 kilomètres[169]. Souvent la rangée d'îles présente une solution de continuité, et c'est à perte de vue une plaine de bois inondés. Sur ces marais s'ébattent des milliers de palmipèdes; si l'on en avait le temps, quelle belle chasse au canard on ferait!
[169] Profondeur moyenne, 16 mètres.
A sept heures du soir nous atteignons la station de Chaïtanskaya, la dernière avant Bériosov. Déjà on[Pg 263] sent le voisinage de la civilisation: il y a ici des meubles russes et des ustensiles de ménage en métal, du bétail et des chats.
La pluie cesse, le vent souffle grand frais, et de suite nous établissons la voilure. La rivière, large de plusieurs kilomètres, se hérisse de grosses vagues lourdes; lorsque nous nous éloignons de l'abri protecteur des îles, le canot roule comme en pleine mer, il faut alors ouvrir l'œil, avec une embarcation pareille à notre lodka et des mariniers du genre des Ostiaks. Vers onze heures du soir, dans le lointain apparaissent des lumières: voici Bériosov.
Le débarquement n'est pas facile. La Sosva, soulevée par la tempête, déferle sur la rive en hautes volutes, et menace de briser les embarcations. On se croirait en mer. Bientôt des agents de police arrivent à notre secours et nous conduisent chez le maître d'école, où un logement nous a été préparé. Le pédagogue nous reçoit en uniforme, et cérémonieusement nous introduit dans un gentil salon superbement éclairé. Des lampes, des bougies, comme tout cela paraît drôle après plusieurs semaines de désert! On étend par terre des matelas, un luxe inouï pour nous, et pour la première fois depuis quarante-cinq jours nous nous déshabillons et dormons en gens civilisés.
[Pg 264]
Bériosov.—Les marais.—L'Obi.—L'Obi route commerciale.—Arrivée à Samarovo.
Bériosov, la grande métropole de cette partie de la Sibérie, est une pauvre petite ville de 1 800 habitants. Sans commerce, elle doit toute son importance à la résidence des fonctionnaires. C'est le centre administratif de ces solitudes, le chef-lieu de l'arrondissement septentrional du gouvernement de Tobolsk. Cet arrondissement plus étendu que la France ne compte cependant que 8 000 habitants. Jugez par ces chiffres de l'immensité de la Sibérie et de la faible densité de sa population.
La ville est sans intérêt, comme toutes les bourgades russes. Des rues boueuses découpent en rectangles des pâtés de maisons basses et de cours enceintes de palissades; en avant, un large dépotoir parsemé de pans de murs et de moellons; au bout, isolées comme des îles, deux églises. Ces décombres sont les dernières traces d'un incendie qui, il y a quelques années, a détruit en partie Bériosov. De pareilles catastrophes[Pg 265] sont habituelles dans ces pays: à part quelques édifices publics, toutes les maisons sont en bois. Les villes sibériennes flambent comme des boîtes d'allumettes.
Bériosov[170] est situé au confluent de la Vogoulka et de la Sosva, sur la haute berge de cette dernière rivière. De cette éminence le coup d'œil est extraordinaire.
[170] Liste des stations de poste de Bériosov à Samarovo.
| Nom des stations | Distance en verstes | Nombre des habitations | Population | |||
| Hommes | Femmes | Enfants | Total | |||
| Chaïtanskaya | 23 | 4 | 16 | 5 | 21 | |
| Niérémo | 15 | 4 | 6 | 25 | ||
| Novaia-Iourta | 23 | 7 | 10 | 10 | ||
| Lapolevskia (Lapilski de Sommier) | 25 | 9 | 10 | 10 | 15 | 35 |
| Argninskaya | 15 | 10 | 14 | 15 | 10 | 39 |
| Narikarskaya | 15 | 15 | 34 | 30 | 27 | 91 |
| Pérégriobnaya-Strelka | 28 | 26 | 70 | 40 | 30 | 140 |
| Kalapanskaia | 23 | 16 | 4 | 6 | 26 | |
| Tcharkali (sielo) | 22 | » | » | » | » | » |
| Aliechinskaya[A] | 20 | 15 | 30 | 20 | 15 | 65 |
| Niziamskaya | 10 | 19 | 46 | 37 | 30 | 113 |
| Kondinsk (sielo) | 15 | » | » | » | » | » |
| Noviniskaya | 25 | |||||
| Bolchoï-Atlim | 20 | 65 | 172 | 183 | 355 | |
| Malo-Atlim | 20 | 29 | 95 | 97 | 192 | |
| Léoutchinskié | 15 | 9 | 19 | 14 | 33 | |
| Karimkar | 20 | 18 | 25 | 22 | 47 | |
| Sosnovskaya | 15 | 11 | 23 | 23 | 46 | |
| Kéontchinskaya | 15 | 17 | 36 | 36 | 72 | |
| Vorono | 15 | » | » | » | » | |
| Soukoroukovskaya-Iourta | 15 | 10 | 29 | 23 | 52 | |
| Soukoroukova (sielo) | 10 | » | » | » | » | |
| Iélisarova (sielo) | 20 | » | » | » | » | |
| Bogadaski | 25 | » | » | » | » | |
| Troïtski | 15 | |||||
| Bielogora | 20 | |||||
| Samarovo (sielo) | 35 | |||||
| --- | ||||||
| Total | 516 | |||||
[A] Jusqu'à Kondinsk la statistique de la population a été dressée d'après les renseignements oraux fournis par les indigènes à Boyanus. A partir de Kondinsk, les chiffres indiqués sont extraits des documents officiels.
[Pg 266]
A perte de vue, de l'eau, des îles basses, des lignes d'oseraies et de saulaies; une immense inondation morne et pesante, laissant l'impression biblique de la terre après le déluge. De l'autre côté, des tourbières et des marais. Sous un ciel gris ce paysage effrayant de tristesse pénètre de découragement et de désespérance. Au milieu de ces marécages sans fin, on a la sensation de l'isolement et de la distance.Ici, à quelques centaines de kilomètres de l'Europe, on est plus loin que dans une île perdue de l'Océanie; on est séparé de notre Occident par une largeur de continent. La terre isole, tandis que la mer unit. Tous les quinze jours seulement la poste apporte à Bériosov des nouvelles vieilles de plus d'un mois! Ajoutez à cela la rigueur du climat et vous vous rendrez compte des agréments qu'offre le séjour de Bériosov.
Les premières gelées se produisent à la fin d'août et les rivières ne sont dégagées de glace que dans les derniers jours de mai. En décembre, janvier et février, la température moyenne est de -21°,4 C.; parfois le thermomètre descend à -56°. Au total, dix mois de froid; en revanche, pendant le court été sibérien, la chaleur est parfois pénible. A Bériosov la température peut s'élever à +34°. Vous figurez-vous une vie avec neuf mois de neige dans le silence le plus absolu du monde extérieur!
Dans ces conditions, cette localité était désignée d'avance comme lieu de détention. Actuellement quelques nihilistes y sont internés; mais au siècle précédent, cette triste bourgade a abrité l'exil de deux grands personnages de l'histoire de Russie, Mentchikov et Ostermann. Mentchikov, le favori de Pierre le Grand, devenu régent de l'Empire pendant[Pg 267] la minorité de Pierre II, avait mécontenté la cour par son ambition et sa hauteur. Il ne rêvait rien moins que de marier sa fille au jeune tsar, et d'entrer dans la famille impériale, lorsqu'il fut renversé par une conspiration de palais. Le puissant favori fut exilé d'abord dans ses terres, puis à Bériosov, où il mourut en 1729. Par une vicissitude du sort dont l'histoire offre de fréquents exemples, le comte Ostermann, le président de la commission d'enquête qui avait condamné Mentchikov, fut à son tour banni dans la même localité où il avait exilé son rival.
Nous séjournons quarante-huit heures à Bériosov. Après être resté cinq jours dans une étroite cabine encombrée, on aime à remuer et à se dégourdir les jambes. Comme partout, les fonctionnaires nous ménagent la plus cordiale réception. Dès notre arrivée, l'ispravnik et le docteur viennent nous faire visite et nous invitent à dîner; tout le monde nous comble de prévenances. Notre estomac proteste bien un peu contre ces politesses. Dans ces pays glacés, les habitants absorbent, sans en être incommodés, des quantités considérables d'alcool. Dès que vous arrivez dans une maison, vite le maître de céans vous offre de l'eau-de-vie, et à Bériosov les usages de la société vous obligent à en avaler trois verres. Dans la journée de notre départ nous n'avons pas bu moins de dix-sept petits verres. En ce pays un voyageur doit pouvoir porter la toile, comme disent nos marins.
Le 25 août, à une heure du matin, nous quittons Bériosov pour remonter l'Obi jusqu'à Samarovo, situé près du confluent de ce fleuve et de l'Irtich. Là nous rejoindrons la grande route postale de Sibérie, et un vapeur venant de Tomsk nous conduira à Tobolsk.[Pg 268] C'est une nouvelle navigation à la rame de plus de 530 kilomètres, à contre-courant: au total, huit jours de route au moins.
Pour ce voyage, l'ispravnik a l'amabilité de nous prêter sa lodka, grande embarcation dans laquelle nous sommes très bien installés. La barque contient deux cabines: dans l'une, située à l'arrière, le fidèle Popov trouve place au milieu des bagages; la seconde, longue de 2 mètres, est notre habitation. Le mobilier se compose d'un étroit lit de camp, où nous couchons tête-bêche, de deux bancs et de deux étagères; enfin, luxe inouï, la cabine est éclairée par deux petites fenêtres. Lorsqu'il fera mauvais temps, nous ne serons pas condamnés à vivre dans un trou noir.
A une heure du matin, nous appareillons. L'air est tiède, le ciel pur brille d'étoiles, et c'est plaisir de rêver sur le rouf de la cabine.
Dans la matinée, nous nous trouvons dans les protoks[171]; de tous côtés, des saulaies et des oseraies inondées. Aucune vue; on navigue au milieu de broussailles et d'îles basses qui semblent flotter. On dirait une terre qui n'a pas été séparée d'avec les eaux. Les cartes placent le confluent de la Sosva et de l'Obi au nord de Bériosov, mais bien au sud de ce point les deux fleuves sont déjà réunis et ne forment qu'une même nappe d'eau divisée par des îles en bras innombrables. Pour atteindre l'Obi nous remontons ainsi la Sosva jusqu'à la station de Chaïtanskaya, et de là faisons route à travers les protoks. De cette station à celle de Tcharkali, où nous atteindrons la rive droite du grand fleuve, nous traversons une inondation large de 125 kilomètres.
[171] Petits bras du fleuve.
[Pg 269]
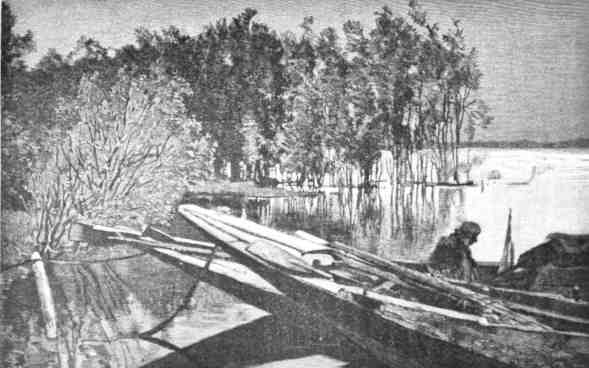
[Pg 270]
Dans l'après-midi nous arrivons au petit Obi, large de 300 à 400 mètres. Nous le suivons pendant quelque temps, puis nous rentrons dans les marais. Un archipel de terres basses occupe le milieu du courant, bordé par deux grands bras, le petit Obi, le long de la rive gauche, et le grand Obi à droite. Au printemps l'inondation couvre toutes les îles, et le fleuve devient une mer d'eau douce. A cette époque, en certains endroits, la largeur de la nappe dépasse 45 kilomètres[172].
[172] Sommier, loc. cit.
L'Obi est un des fleuves les plus magnifiques de la terre. Issu de l'Altaï chinois à peu près sous la même latitude que Prague, il se jette dans l'océan Glacial au-dessus du cercle polaire. D'après Latkine, la longueur de son cours serait de 3 200 verstes; suivant d'autres auteurs, elle atteindrait 5 000 kilomètres. A Samarovo, ses dimensions, déjà considérables, sont doublées par les apports de l'Irtich, affluent aussi important que le fleuve lui-même. Ce n'est donc pas sans raison que des géographes considèrent cette dernière rivière comme le rameau fluvial le plus important du bassin. Ces deux grandes artères collectent les eaux d'une région dont la superficie est égale au tiers de celle de l'Europe. Sur toute la terre, seul le bassin de l'Amazone dépasse en étendue celui de l'Obi.
Comme tous les fleuves russes, l'Obi subit une crue très forte à la fonte des neiges. A Samarovo, sa hauteur atteint 6 mètres, à Bériosov 5, et à Obdorsk, situé dans le voisinage de l'estuaire, 6,50 d'après les renseignements fournis à M. Sommier. A cette époque, le volume d'eau roulé par l'Obi est énorme.[Pg 271] D'après Finsch, une seconde crue se produit à Barnaul en juin et en juillet dans le bas fleuve.
Situé dans la zone boréale, débouchant dans une mer dont le régime des glaces est encore peu connu, ce fleuve grandiose est resté jusqu'ici inutile au mouvement des échanges. En moyenne, pendant cent cinquante jours[173] seulement il est ouvert à la navigation. A Barnaul, l'Obi est pris par les glaces de la première quinzaine de novembre au commencement de mai; à Bériosov, durant sept mois.
[173] Finsch, loc. cit.
Un jour peut-être, malgré la brièveté de sa période de navigabilité, l'Obi sera une grande route commerciale, et deviendra la voie d'exportation de la Sibérie Occidentale. La mer de Kara, qui reçoit les eaux de ce grand fleuve, a eu longtemps la réputation d'une des plus dangereuses régions de l'océan Glacial. Séparée de la mer de Barents[174] par la longue digue de la Nouvelle-Zemble et de l'île Vaïgatch, soustraite par suite à l'influence réchauffante du Gulf-Stream et des vents du sud-ouest, cette mer était, croyait-on, toujours obstruée par d'épaisses banquises. D'autre part, les passes donnant accès dans la mer de Kara, le Matotchkin Char, la Porte de Kara et le Chougor Char, passaient pour être presque toujours fermées par les glaces.
[174] On donne ce nom à la partie de l'océan Glacial comprise entre le Spitzberg, la Nouvelle-Zemble et la Norvège septentrionale.
Les célèbres expéditions de Nordenskiöld ont prouvé cette erreur, et l'étude des documents antérieurs à confirmé l'expérience de l'illustre explorateur suédois. La navigation sur la mer de Kara n'est certes pas aussi facile que sur la Méditerranée, mais elle ne[Pg 272] présente pas d'obstacles insurmontables pour de bons marins, comme on le croyait encore récemment. Certaines années, cette mer est complètement libre en été, et dès la fin de juillet des navires ont pu traverser les détroits sans apercevoir une glace. Très rares sont les étés où les banquises ont fermé la navigation. En moyenne, d'après les documents que nous possédons, la traversée de la mer de Kara paraît assurée à partir du commencement d'août. En 1876, un navire allemand, le Neptune, exécuta en deux mois et demi le voyage aller et retour de Hambourg à l'embouchure de l'Obi. La même année, un vapeur anglais accomplissait la même traversée en partant de Newcastle. Dans ces quinze dernières années, plusieurs bâtiments ont effectué sans encombre le trajet d'un port d'Europe à l'embouchure de l'Obi. Les quelques accidents arrivés ont malheureusement eu pour effet de discréditer les entreprises, et actuellement les négociants de la Sibérie occidentale semblent avoir renoncé à l'exportation de leurs marchandises par cette voie. Cet abandon ne nous paraît pas justifié. Les succès obtenus auraient dû faire oublier les accidents et encourager les efforts. Si cette navigation doit être reprise, il est absolument indispensable d'établir dans l'île de Vaïgatch un poste de veilleurs chargés de surveiller les mouvements des glaces dans la mer de Kara. Moyennant quelques sacrifices pécuniaires, il ne sera pas difficile de décider de hardis marins, quelques chasseurs de phoques norvégiens par exemple, à hiverner sur cette terre. Leurs observations fourniraient aux capitaines des navires des indications utiles sur la position des banquises; grâce à ces renseignements la navigation deviendrait moins[Pg 273] hasardeuse. En tous cas, les communications entre l'Obi et l'Europe ne peuvent être entretenues que par des vapeurs dirigés par de bons marins habitués aux glaces. Un des grands avantages de cette route commerciale est l'assurance d'un fret à l'aller et au retour. La Sibérie manque d'objets manufacturés; toutes les importations y trouvent donc un débouché rémunérateur. Pour le fret de retour, les capitaines n'auront que l'embarras du choix. La Sibérie n'est pas du tout ce désert éternellement glacé et neigeux qu'évoque son nom. C'est au contraire un pays admirablement fécond. Au sud de Tobolsk s'étend une région agricole d'une fertilité comparable à celle des fameuses Terres-Noires de la Russie méridionale, et cette zone s'étend sur des milliers de kilomètres. Il y a là un immense grenier à blé jusqu'à présent demeuré inutile. Le jour encore lointain où la Sibérie sera peuplée, elle deviendra au point de vue agricole les États-Unis de l'ancien continent et inondera de ses blés notre vieille Europe. Dans un avenir que l'initiative russe peut singulièrement rapprocher, notre agriculture sera menacée d'une nouvelle et terrible concurrence par les blés de Sibérie. Aujourd'hui, bien qu'une très infime portion du pays seulement soit défrichée, la production de la Sibérie occidentale en céréales est de beaucoup supérieure à la consommation locale. Transportés par voie fluviale à l'estuaire de l'Obi, les blés formeraient le principal fret des navires et dans des conditions de prix très avantageuses. Ajoutez à cela les produits des forêts vierges, les cuirs, etc.
Pour éviter aux navires de doubler la longue presqu'île de Ialmal qui proémine comme un long doigt au milieu de la mer de Kara, divers projets ont été[Pg 274] mis en avant. Au XVIe siècle, des bateaux russes partaient de la Petchora, gagnaient l'extrémité supérieure de la baie de Kara et, de là, par des rivières et des portages, atteignaient l'Obi, puis l'embouchure du Tas. Il y a quelques années, on a proposé le creusement d'un canal entre l'Obi et la baie de Kara. Après étude du terrain, ce projet a été abandonné. Plus récemment, il a été question de la construction d'un chemin de fer à travers cet isthme. Ne connaissant pas la région, je ne puis me prononcer sur sa possibilité, mais, d'après les renseignements que nous possédons sur la nature du sol dans ces pays, le terrain n'est guère propice à l'établissement d'une voie ferrée. D'autre part, la traversée de l'Oural septentrional nécessiterait le creusement de tunnel ou tout au moins de tranchées. Enfin les marchandises devraient subir deux transbordements, d'où une élévation des prix. Or le bon marché est une des conditions essentielles de la vente des produits de Sibérie sur les marchés européens.
Les Sibériens fondent aujourd'hui de grandes espérances sur le Transsibérien, je crains bien qu'ils ne nourrissent de dangereuses illusions à ce sujet. Le chemin de fer projeté et déjà commencé est, avant tout, politique et stratégique. Il augmentera et facilitera dans une singulière mesure les relations entre la Russie et la Chine. Si un conflit éclatait avec cette puissance, il permettrait de rapides mouvements de troupes, et cet avantage est de la plus haute importance.
En cas de guerre européenne, la frontière sibérienne-chinoise, longue de plusieurs milliers de kilomètres, devra être soigneusement observée. Peut-être les Célestes voudraient-ils profiter de complications[Pg 275] européennes pour créer à la Russie des embarras. Le prince de Bismarck avait compris avec sa haute intelligence politique l'importance de la Chine comme facteur dans les luttes entre les diverses nations occidentales. Le Ministre d'Allemagne à Péking, M. Brandt, avait employé au service de cette idée sa longue connaissance du pays et des hommes. Son autorité était grande auprès du Tsong-li-yamen, et, à tort ou à raison, les Européens établis en Extrême-Orient attribuaient à son influence une longue portée.
Depuis le traité de Kouldja, les rapports entre la Russie et la Chine sont bons; mais la sûreté des relations n'est pas précisément la qualité dominante des Célestes. La construction du Transsibérien enlèvera à la Russie toute préoccupation de ce côté. A la première démonstration hostile des Chinois, en quelques jours pourront être effectués des transports de troupes qui auparavant auraient exigé des mois. Gouverner, c'est prévoir, dit-on; les hommes d'État russes sont prévoyants.
D'autre part, considérable sera l'importance économique du Transsibérien. Les relations commerciales entre la Russie et la Chine, déjà si suivies, augmenteront dans une large mesure. Le transport des thés de Kiakhta, qui se fait actuellement par caravanes à travers la Sibérie, s'effectuera désormais par voie ferrée. Enfin, le chemin de fer sera la grande route de la colonisation et de la pénétration européenne en Sibérie. Il agrandira le champ d'exportation des manufactures russes et élargira le débouché de l'industrie moscovite. Mais les Sibériens se font illusions s'ils comptent sur cette route pour expédier en Europe les produits de leurs terres. Le Transsibérien ne sera jamais une voie d'exportation pour[Pg 276] la Sibérie. Il transportera en Europe l'or et les pierres précieuses; de pareilles marchandises peuvent supporter sans perte d'énormes taxes de transport. Mais la principale production du sol, les céréales, sera grevée de frais beaucoup trop considérables pour une vente avantageuse en Europe. D'autre part, en admettant même des tarifs très bas, les blés de Sibérie arriveraient dans la région du Volga et, venant faire concurrence à ceux de Russie, amèneraient fatalement une baisse. Le résultat le plus clair de l'opération serait l'appauvrissement du cultivateur russe.
Le débouché des céréales sibériennes est l'Europe septentrionale: la péninsule Scandinave, la Finlande, le Danemark, l'Allemagne du Nord, etc. La condition essentielle de leur placement sur ces marchés est leur bas prix. Les frais de transport doivent donc être réduits au minimum et par suite être effectués par eau. Par l'Obi, puis par l'Oural, la Petchora et la mer Blanche, le blé de Sibérie arrive déjà en Norvège par la voie d'Arkhangelsk. La route de M. Sibiriakov augmentera ce mouvement. Mais, longue et nécessitant deux transbordements, cette voie reste inférieure à celle de la mer de Kara. De ce côté devraient se tourner les efforts des hommes d'initiative si nombreux en Russie et en Sibérie. Ils sont habitués à vaincre la nature. La persévérance aidée de sacrifices pécuniaires triompherait sans aucun doute des difficultés de navigation dans la mer de Kara.
Après cette longue digression, revenons maintenant au récit de notre voyage. Dans l'après-midi nous arrivons à la station de Novaïa-Iourta, située en plein marais: trois ou quatre cassines entourées d'eau.[Pg 277] Depuis quelques jours seulement l'inondation a baissé, et le sol est resté détrempé et fangeux. Pour arriver aux maisons on avance jusqu'à mi-jambes dans une boue épaisse et tenace. On dirait une habitation lacustre des temps préhistoriques.
Les Ostiaks de Novaïa-Iourta, comme ceux de la station précédente de Niérémo, ont un type mongol accusé. Ils sont noirs, ont la peau bistre et les yeux fendus obliquement. Des neuf rameurs de Niérémo, sept présentent des caractères nettement mongoloïdes. Sur la basse Sosva, dans les paouls voisins de Bériosov, ce type est également fréquent. Chez les indigènes des bords de l'Obi la couleur noire paraît dominante, et nous l'observerons jusqu'à la station de Soukoroukovskaya, la dernière occupée par les Ostiaks. Les Samoyèdes ont évidemment remonté par la grande route du fleuve et se sont mêlés aux naturels. Depuis Bériosov une observation même superficielle révèle des modifications sensibles chez les indigènes. A mesure que nous avançons vers le sud, les traces d'une influence tatare se révèlent fréquentes et précises. Les Ostiaks, pendant longtemps en relations constantes et directes avec les Musulmans, leur ont emprunté de nombreux usages, tels que celui du voile chez les femmes et la coutume du kalym. Cette influence devient très apparente dans l'ornementation du vêtement des femmes. Les Ostiakes ont pris de leurs voisines musulmanes un goût très prononcé pour les parures en verroterie de couleur. Sur les bords de l'Obi, la perle de verre a une importance égale à celle du jais en Europe, et les femmes indigènes savent l'employer à des passementeries aussi chatoyantes de coloris que régulières de dessin. Rare dans la région de la Sygva et de la haute[Pg 278] Sosva, cette ornementation devient générale dans la vallée de l'Obi. Presque toutes les femmes portent aux manches et au col de leurs tuniques de larges garnitures de perles de verre. A leurs tresses pendent des rubans couverts de cette verroterie, et leurs sandales comme leurs gants sont ornés de broderies de ce genre.
Depuis Bériosov les Ostiaks sont également profondément modifiés par le contact des Slaves. Maintenant les tchioumes deviennent rares et les iourtes moins primitives. Quelques-unes sont des maisons avec deux pièces garnies de chaises et de tables. D'autre part, les vêtements en peau de renne sont remplacés par des blouses et des pantalons de grosse toile en fibres d'ortie. A Novaïa-Iourta, les hommes portent des chemises par-dessus le pantalon à la mode russe, des kaftans en guenilles, et bientôt nous verrons des gilets et des casquettes. Comme chaussures, en place des pimouï, des souliers en cuir de cheval, et un peu plus bas des bottes. Encore quelques années et les Ostiaks de cette région seront tous vêtus de défroques russes. Dans les iourtes, beaucoup d'ustensiles en métal; l'importance de l'écorce de bouleau comme matière première diminue. En 1872, le voyageur russe Poliakov avait trouvé des instruments en pierre chez les indigènes des bords de l'Obi; en 1882, d'après la description de M. Sommier, les Ostiaks avaient encore conservé en grande partie leur civilisation primitive; depuis, la russification a fait des progrès très rapides. En dix ans, l'état des habitants s'est modifié complètement, et il est à craindre, pour les ethnographes comme pour les amateurs de pittoresque, que les Ostiaks de l'Obi n'aient bientôt adopté la civilisation russe. Les Slaves sont[Pg 280] de merveilleux agents d'assimilation; à leur contact, les races indigènes fondent rapidement. C'est le peuple colonisateur par excellence.
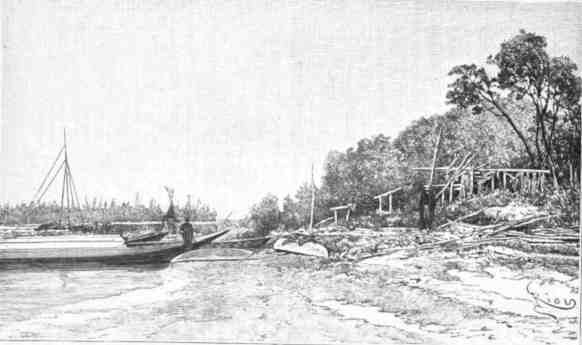
Les Ostiaks de cette région tirent toutes leurs ressources de la pêche. La chasse est pour eux une occupation secondaire. A mesure que l'on avance vers le sud, les animaux à fourrures deviennent rares[175]. Ces indigènes élèvent du bétail et des chevaux[176]. La récolte de foin étant insuffisante pour l'alimentation de ces animaux durant l'hiver, pendant cette saison leur nourriture consiste en feuillage desséché de bouleaux et de saules. A Novaïa-Iourta, la grande curiosité est un lièvre (Lepus borealis) apprivoisé que les indigènes nourrissent avec du poisson.
[175] Dans le volost Kotskaya, au sud de Kondinsk, en 1889, le rendement de la pêche était de 156 tonnes métriques, pour une population de 2 280 individus (hommes, femmes et enfants). Celui de la chasse avait une valeur de 5 000 francs.
[176] Dans le volost de Kondinsk, les indigènes possèdent 535 bêtes à cornes et 850 chevaux; dans celui de Kotskaya, on compte 720 bêtes à cornes et 1140 chevaux.
Au moment du départ, le ciel gris fond en bruine, la brise se lève mouillée avec un crachin froid et pénétrant; une tristesse de mort enveloppe un paysage lugubre. Depuis des semaines nous parcourons une terre partout pareille; jamais une découverte de pays imposante, jamais un moment d'admiration, jamais une vue soulevant l'enthousiasme, jamais une sensation forte, vibrante qui reste dans la mémoire comme un point lumineux. Toujours une monotonie exaspérante, toujours une même plaine basse, à moitié submergée. La Sibérie ne laisse aucun souvenir, rien qu'une impression d'ennui. Sur ce point tous les voyageurs sont d'accord. «Si[Pg 281] vous n'êtes animé par un enthousiasme scientifique, n'y allez pas», s'écrient en terminant leurs relations deux auteurs, l'un simple touriste, l'autre savant distingué.
La nuit venue, l'obscurité est profonde, le temps absolument bouché, comme disent les marins. Le jour, la facilité avec laquelle les Ostiaks reconnaissent la route au milieu de ce dédale de canaux et d'îles m'est toujours un sujet d'étonnement. Pour se guider sans boussole à travers ces terres basses, ces gens doivent posséder la plus merveilleuse mémoire des localités. Ce soir, la vue dépasse à peine un rayon de quelques mètres, et pourtant jamais notre barreur ne fait fausse route. Le bonhomme trouve son chemin sans y voir.
Par un temps pareil, qu'il semble bon et agréable le cabanon de la lodka! Notre habitation mesure 2 mètres de long et 1m,10 de haut. Mais là nous sommes à l'abri, et, éclairé par deux bougies enfoncées dans des bouteilles, notre chenil prend un aspect chaud et gai. Tout à coup, dans le grand silence de la nuit, les rameurs roulent une plainte rythmée; puis soudain éclate un hurlement furieux, un beuglement de fauves comme un formidable cri de guerre. En même temps, des branches battent la muraille de la cabine. Sommes-nous échoués? Mais non, nous avançons toujours. Et un second cri part plus terrible encore que le premier. Du coup, Boyanus ouvre la porte de la cabine. Qu'y a-t-il? Oh rien. Tout le monde rit aux éclats. Le courant est rapide, et pour se donner du courage et aussi pour s'amuser, les rameurs poussent ces hurlements! Point de plaisir sans bruit. Toute la nuit notre sommeil est ponctué de ces rugissements de bêtes.
[Pg 282]
Le mauvais temps est heureusement de courte durée; le lendemain, le soleil luit gai et brillant, emplissant l'air d'une douce tiédeur. Ce sont les derniers sourires de l'été.
Toute la journée du 26, continuation de la navigation au milieu des protoks. Dans la soirée nous atteignons le grand Obi. A lui seul il forme un fleuve magnifique, large de 2 kilomètres. Après un voyage de deux jours à travers une uniforme forêt inondée, voici enfin un paysage nouveau. Au bout de la nappe d'eau, derrière un premier plan de marécages boisés, blanchit sur la rive droite une haute terrasse couronnée de forêts. Taillée à pic, elle se dresse en une falaise de sable et d'argile à une quarantaine de mètres au-dessus de l'eau. Dans cette platitude, pareil monticule fait l'effet d'une haute cime, et telle est l'impression générale, que les Russes donnent à cette terrasse le nom de montagne (gora). Gravissez cet escarpement de sable: au sommet vous trouvez une immense plaine s'étendant sur des centaines de kilomètres. Cette plaine est le niveau normal du pays, le fleuve un large fossé creusé dans l'épaisseur du sol, et la gora, le talus de ce fossé. L'escarpement est produit par l'érosion constante que le fleuve fait subir à la berge. D'après les observations du célèbre naturaliste russe de Baer, les cours d'eau de notre hémisphère coulant dans le sens du méridien entament leur rive orientale et alluvionnent leur rive occidentale par l'effet de la rotation terrestre. «Une molécule d'eau qui se dirige du sud au nord, écrit M. de Lapparent qui d'ailleurs ne paraît guère accepter la théorie de Baer, rencontre, dans sa descente, des régions où la vitesse de rotation est de moins en moins prononcée; elle[Pg 284] doit donc conserver un excès de vitesse dans le sens où s'accomplit le mouvement diurne de la terre, c'est-à-dire de l'ouest à l'est, et ce serait cet excès qui entraînerait de préférence la dégradation des berges orientales.»
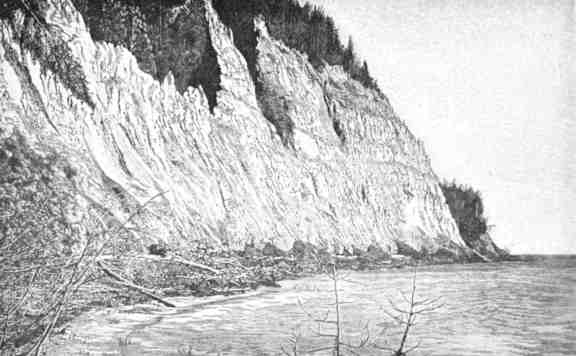
Ainsi se produit un lent déplacement vers l'est des fleuves sibériens coulant du sud au nord. Venant sans cesse frapper la rive droite, les eaux entament d'une manière continue cette berge, en même temps qu'elles abandonnent le bord opposé. La grande masse de l'Obi coule ainsi directement à la base de la haute terrasse, tandis qu'à gauche la berge se trouve partout précédée d'une large zone de terres basses, produit de l'alluvionnement. Le déplacement de l'Obi vers l'est est un fait reconnu par les indigènes, comme le prouve le nom de Vieil-Obi (Staraïa Obi) qu'ils donnent concurremment avec celui de Petit-Obi au bras gauche du fleuve. Cette branche est en effet la plus anciennement creusée et à une époque antérieure a servi de lit au Grand-Obi.
La berge droite du fleuve, constituée par des terrains détritiques quaternaires comme toute la Sibérie septentrionale, est très facilement entamable. Nulle part affleure une assise rocheuse. Partout, de bas en haut, la gora présente des couches de sable, de graviers et d'argile empâtant des blocs de pierres[177]. Sur un terrain d'une aussi faible consistance, l'érosion se produit naturellement avec des proportions grandioses, et détermine d'énormes éboulements. Poliakov évalue à 256 000 mètres cubes le volume d'une chute[Pg 285] de falaise survenue sur la rive droite de l'Irtich. A 5 verstes au nord de Malo-Atlim, lors de notre passage, la berge portait les traces d'une rupture fraîche dont la masse avait dû être considérable.
[177] Les assises ne sont pas partout horizontales. En plusieurs localités, j'ai observé un pendage des couches et des stratifications entre-croisées.
Outre le courant du fleuve, les eaux pluviales, les glaces et le vent contribuent à la dégradation de la falaise. Le ruissellement des eaux pluviales détermine la formation de profonds ravins. Sur ce terrain il produit les mêmes effets dévastateurs que les torrents sauvages dans les Alpes. Au moment de la débâcle, poussés violemment par les pressions, des blocs battent la terrasse sablonneuse, l'attaquent à coups de bélier, l'ébranlent; la terre se trouve ainsi préparée à céder à l'action du courant, lorsqu'elle ne s'éboule pas déjà sous le choc de ces assauts. L'été, l'air est un agent d'érosion non moins actif que l'eau. Si ses effets se manifestent dans des proportions moins grandioses, ils n'en sont pas moins continus. En passant sur ces falaises, le moindre vent enlève d'énormes quantités de particules sablonneuses. Par une forte brise un pulvérin s'élève de la gora, et remplit le ciel d'une fumée de poussière. A Samarovo, pendant une tempête, nous respirâmes du sable. Par les fentes des fenêtres pénétraient des particules terreuses, et dans l'intérieur des maisons tous les objets étaient couverts d'une couche arénacée. C'était une réduction du simoun.
Sous les actions réunies de ces différentes érosions la dégradation des falaises des fleuves sibériens est très rapide. Depuis la période historique, qui commence pour la Sibérie au XVIe siècle, le déplacement des fleuves vers l'est est parfaitement reconnaissable. Ainsi, à Démiansk, village russe en amont de Samarovo, l'emplacement de la première église,[Pg 286] situé, lors de la construction, sur la rive droite de l'Irtich, se trouve actuellement sur la rive gauche, et à la place où fut élevée la seconde, coule maintenant le fleuve. Certaines années, dans cette localité, la rive droite est rongée sur une largeur de 40 mètres[178].
[178] Sommier, loc. cit.
Ces diverses érosions jettent dans l'Obi une quantité énorme de particules arénacées. Pour le thé nous employions l'eau du fleuve, et chaque fois le fond de nos tasses était rempli d'une couche de sédiments. La présence de ces sables en suspension donne au fleuve une couleur jaune très accentuée. Une partie de ces sables sert à constituer les terres basses comprises entre le Grand et le Petit-Obi. La formation de ces dépôts est singulièrement facilitée par les saulaies dont les îles sont couvertes. Au moment de l'inondation, ces taillis seuls émergent et permettent par suite la fixation rapide des sédiments.
Le long de la rive droite, à la base de la falaise, on observe une ligne de blocs que les éboulements ont dégagés des couches arénacées. La formation de cette murette est due à l'action des glaces au moment de la débâcle. Sur les bords de tous les cours d'eau et de tous les lacs de Laponie existent de semblables alignements constitués dans les mêmes conditions. Lorsque la carapace cristalline se rompt au printemps, sous la poussée des glaces venant d'amont les glaçons empiètent sur la rive, repoussent les pierres disséminées et les accumulent en murettes.
Une autre conséquence de la dégradation de la berge, et celle-là très importante, est la chute dans le fleuve de masses considérables d'arbres. Les glissements de la falaise entraînent dans l'Obi des pans de[Pg 287] forêts que les eaux emportent jusqu'à l'océan Glacial et que les courants marins dispersent ensuite sur les terres polaires sous forme de bois flotté. Cette destruction des forêts par les fleuves est un des phénomènes les plus actifs de la zone boréale russe. Nous l'avons observé sur tous les nombreux cours d'eau parcourus pendant cette exploration, mais sur aucun il ne se produit avec une amplitude plus grande que sur l'Obi. Je ne crois pas donner un chiffre exagéré en évaluant en moyenne le volume des débris ligneux épars sur la berge droite à un mètre cube par 10 mètres courants de rive. La distance de Bériosov à Samarovo est de 546 kilomètres. Par suite, le cube des bois jonchant la rive droite sur cette distance sera de 534 063 mètres cubes, et ce chiffre est un minimum. Toutes les îles sont parsemées de bois flotté; il n'est pas un point des rives où l'on n'en trouve.
D'autre part, le Iénisséi, la Léna et toutes les autres rivières de Sibérie apportent dans l'océan Glacial un volume de bois non moins considérable. Jugez, par suite, de l'énorme masse de bois flotté fournie par les fleuves sibériens. Une fois en mer, les troncs sont poussés vers l'est par un courant côtier le long du littoral nord de l'Asie. Arrivés dans les parages de la Terre de Wrangel, ces bois sont ensuite chassés par un autre courant vers le nord-ouest, c'est-à-dire en sens inverse de la direction qu'ils ont suivie jusque-là. L'existence de ce courant a été révélée par la dérive de la Jeannette. Pendant deux ans le bâtiment, retenu prisonnier dans une banquise, fut entraîné au nord des îles de la Nouvelle-Sibérie par un mouvement des eaux constant analogue à celui qui porta le Tegetthoff vers la Terre François-Joseph.[Pg 288] Au delà des îles de la Nouvelle-Sibérie la marche de ce courant a été mise en lumière par un curieux cas de flottage. En 1881, la Jeannette se perdit à soixante milles au nord de l'archipel de la Nouvelle-Sibérie. Quel ne fut pas l'étonnement deux ans et demi plus tard, lorsque des épaves authentiques de ce bâtiment furent retrouvées sur un glaçon à l'extrémité sud-ouest du Grönland. Le bloc avait été apporté là par le grand courant polaire qui, après avoir longé la côte orientale du Grönland et doublé le cap Farvel, vient se perdre dans le détroit de Davis. Depuis longtemps ce courant avait été constaté, mais son origine était toujours demeuré inconnue. Le flottage des épaves de la Jeannette permet d'établir son trajet en quelque sorte expérimentalement. Complétée par les renseignements que l'on possédait déjà sur le mouvement des eaux autour de la Nouvelle-Zemble et du Spitzberg, cette découverte révélait le point de départ du courant polaire grönlandais. Sans aucun doute il est la continuation du courant des îles de la Nouvelle-Sibérie. Au delà de cet archipel les eaux poursuivent leur marche vers le nord-ouest, passent au nord de la Terre François-Joseph et du Spitzberg, dans le voisinage du pôle, puis redescendent vers le sud le long de la côte est du Grönland[179]. Les bois flottés suivent cet itinéraire. Par des dérivations du courant une partie est poussée vers le Spitzberg et la Terre François-Joseph; la plus grande partie arrive au Grönland où elle échoue; le restant, chassé au[Pg 289] sud du cap Farvel par les vents est ensuite entraîné par le Gulf-Stream de nouveau vers le Spitzberg et la Nouvelle-Zemble. Les troncs échoués sur les côtes du Grönland sont soigneusement recueillis par les indigènes pour la fabrication de leurs armes et de leurs embarcations. Ce sont les seuls bois qu'ils puissent se procurer. Ainsi finalement les produits des forêts de Sibérie servent à l'industrie des Eskimos.
[179] C'est sur l'existence de ce courant que compte M. Nansen pour atteindre le Pôle. Le célèbre voyageur norvégien a, comme on sait, quitté l'Europe, il y a quelques mois, en route pour les îles de la Nouvelle-Sibérie. De là il pense gagner le Pôle, poussé par le courant.
Nous voici maintenant sur le Grand Obi. Représentez-vous une large plaine d'eau bordée à l'est par une muraille verte égratignée de larges taches jaunes. De distance en distance, de profonds ravins déchirent la gora comme des entailles au couteau, et par toutes ces coupures la forêt descend pareille à une inondation verte au-dessus de l'inondation bleue des eaux. Poussée par six vigoureux rameurs, la lodka avance rapidement sous la pâleur jaunâtre du couchant. Dans le grand calme enveloppant du soir, une sensation d'infini vous pénètre. Vers l'ouest, à perte de vue, les terres confondues avec les eaux deviennent une immensité océanique. A l'horizon apparaît simplement une petite raie verte toute basse. On a une illusion de mer.
Désormais nous suivrons la rive droite du fleuve. De ce côté notre première étape est le village de Tcherkali (siélo), où un artiste indigène nous donne un concert. Les Ostiaks de l'Obi ont imaginé une harpe à neuf cordes métalliques dont la forme rappelle grossièrement celle d'un oiseau. La caisse résonnante forme le corps, la hampe le cou, et le sommet figure la tête. D'où le nom de liebed (cygne) donné par les Russes à cet instrument. La harpe de David devait être aussi primitive. A la tête de l'instrument pendent de petites guenilles, cadeaux[Pg 290] des danseuses à l'artiste; le nombre de ces morceaux de drap permet de juger à l'avance la virtuosité du harpiste. Aux premiers accords tous les indigènes se rassemblent autour de notre canot, leur figure s'illumine, pour quelques minutes ils semblent oublier leur pénible existence. L'air est triste, poignant; dans le calme du soir il monte comme une plainte de ces pauvres gens dont la vie est faite tout entière de souffrances et de privations.
Le lendemain, à travers la grisaille de l'horizon pluvieux perce un campanile blanc, puis le classique toit vert des églises grecques et un bloc de cassines sales. Nous arrivons au village russe de Kondinsk, la localité la plus importante entre Bériosov et Samarovo. Il est situé sur la rive montagneuse, et pour en permettre l'ascension un escalier en bois a dû être construit. Le village doit toute son importance à un monastère fondé dans un but de prosélytisme parmi les indigènes. Quelques jeunes Ostiaks et Samoyèdes y sont élevés par les moines; arrivés à l'âge d'homme, les néophytes sont renvoyés parmi leurs congénères avec mission d'y répandre les lumières de la religion et de la civilisation. L'institution, m'a-t-on assuré, n'a pas donné de très bons résultats.
Les Russes de Kondinsk tirent leurs principales ressources de la pêche. Pour l'exercice de cette industrie, ils emploient les mêmes engins que les Ostiaks. Comme eux, ils montent des pirogues qu'ils manient avec une adresse extraordinaire, et, comme eux, emploient de petits filets tendus sur un bâton et maintenus perpendiculairement dans l'eau par un poids en pierres. Ce peson est le seul objet en pierre que nous ayons observé en Sibérie. Au contact des[Pg 291] Russes, les survivances préhistoriques disparaissent rapidement. A mesure que nous avançons vers le sud, à part le type ethnique, les différences s'effacent entre les Slaves et les Ostiaks. Le lendemain, à Malo-Atlim, nous voyons les dernières tchioumes, et désormais tous nos rameurs sont vêtus de défroques russes.

Nous continuons à suivre la rive droite. Toujours la même impression. Par endroits l'immensité océanique des protoks donne l'illusion de la mer. A perte de vue ce sont de grandes trouées d'eau scintillante de lumière avec une mince raie verte à l'horizon.
Dans l'après-midi, en arrivant à une station, un aigle se lève des oseraies et va se percher tout près sur le toit d'une iourte ruinée. Vite la carabine, des cartouches, et j'avance lentement en me défilant soigneusement. Me voici à bonne portée, je lâche mon coup de fusil, l'oiseau tombe et en même temps toute la bande des Ostiaks arrive sur moi menaçante et hurlante: je venais d'abattre un aigle apprivoisé, tout comme Tartarin avait tué un lion mendiant. Le premier moment d'émoi passé, les cris s'apaisent de suite à la promesse d'un dédommagement pécuniaire. N'ayant pas encore appris l'art[Pg 292] de rançonner les voyageurs, les Ostiaks se montrèrent plus accommodants que les Arabes de Daudet. Pour deux roubles cinquante kopeks, le propriétaire de l'oiseau se déclara très satisfait. Dès lors, le bonhomme s'attache à nos pas, il tourne autour de nous en marmottant d'un air souriant; enfin, s'enhardissant, il nous propose de tirer un second aigle non moins apprivoisé, moyennant finances bien entendu. Sans attendre notre réponse il part à la recherche de son volatile et bientôt l'apporte par les pattes, ni plus ni moins qu'un vulgaire dindon. Boyanus se laisse tenter par les qualités de l'oiseau et nous l'embarquons dans la lodka de Reif.
29 août.—Dans la matinée nous traversons le grand Obi pour suivre la rive gauche. A sept heures, nous arrivons à la station de Kéoutchinskaya.
A la station suivante, à Vorono, tous les hommes sont partis à la pêche, ils reviendront très tard, et pour ne pas nous faire attendre, leurs femmes les remplacent. Plusieurs emmènent leurs nourrissons; pas gênants, les marmots: on les fourre sous les bancs dans les boîtes en écorce qui leur servent de berceaux. Quand leurs cris deviennent trop gênants, la mère prend une bouteille pleine de lait de vache, s'en emplit la bouche, puis insuffle le liquide à son enfant.
L'étape est heureusement courte, 15 verstes, puis voici les iourtes de Soukoroukova, la dernière station ostiake.
Avec regrets nous nous séparons de ces pauvres gens. Après un mois passé au milieu d'eux, vivant presque de leur vie, nous nous sommes pris à les aimer. Leur douceur, leur honnêteté, leur bonne volonté attachent, et toujours nous garderons au[Pg 293] cœur une sympathie profonde pour ces humbles, pour ces malheureux qui se débattent étouffés par la civilisation. A Soukoroukova ils sont tombés au dernier degré de la pauvreté. Tous sont vêtus de haillons sordides et leurs misérables cassines s'affaissent avec un air de mort.
A deux kilomètres de la station, en rangeant une saulaie inondée, l'œil vigilant de Popov découvre un magnifique aigle immobile, perché dans le taillis. Celui-là n'est point apprivoisé, mais pour ne pas prendre son vol à notre passage, très certainement il doit souffrir d'une indigestion. A vingt mètres je lui envoie une balle. L'oiseau tombe percé de part en part. Telle est la ténacité de la vie chez l'aigle que, lorsque nous voulons le ramasser, il se débat vigoureusement et, renversé sur le dos, se défend du bec et des serres. Pour le tuer, un homme doit lui appuyer pendant dix minutes le talon de la botte sur l'épine dorsale. Une magnifique pièce cet aigle; son envergure mesure 2 m. 20.
Deux heures de navigation et nous arrivons au village de Soukoroukova, situé en plein marais. Je ne sais s'il a été fondé par l'administration ou par de simples particuliers. Mais que cet établissement émane de l'initiative officielle ou particulière, en tout cas l'emplacement a été singulièrement choisi. Bâti au milieu de l'archipel, sur une langue de terre basse, le village est chaque année complètement inondé par la crue du printemps. Les rues sont transformées en canaux, et pendant plusieurs semaines Soukoroukova devient une petite Venise boréale. Cette année les eaux n'ont baissé qu'à la fin de juillet; aujourd'hui encore les rues sont à moitié remplies par de larges mares, et la rive à laquelle nous accostons est une[Pg 294] fondrière. Sur cette bourbe le débarquement serait impossible sans l'aide des habitants. Dès qu'ils aperçoivent notre lodka, les naturels accourent avec des planches et en quelques minutes installent un débarcadère. Le caractère russe a un fond de bonté et d'obligeance véritablement touchant. L'immense majorité de ces paysans sont de bons et braves gens.
A une journée radieuse succède une nuit superbe, chaude et lumineuse. Pas un nuage, pas un souffle de vent, nous glissons sans bruit sur un étroit canal au milieu de la forêt silencieuse. A travers le feuillage, la lumière blanche de la pleine lune ruisselle; des morceaux de rives prennent l'aspect de taches de neige, et la nappe d'eau s'émaille de plaques d'argent changeantes. Et partout un silence de choses mortes donnant la sensation du désert. Telles ces belles nuits d'amoureux chantées par les poètes. Pour rendre l'impression plus poignante, les rameurs entament un chœur russe si plein d'une douce mélancolie que les larmes nous montent aux yeux. Des heures et des heures on reste sur le toit de l'embarcation, enveloppé par la poésie profonde de la nature, bercé par cette musique pénétrante. Et quand se fait le jour pâle de l'aurore, de tous ces bois mouillés sortent des buées floconneuses, légères, transparentes. Au milieu de ces fumées blanches, des pans de forêt paraissent puis disparaissent avec des brusqueries de lanterne magique; la nature entière prend un aspect de rêve, de vague, d'inexistant. Puis soudain le soleil se montre lentement, bien lentement, avec des alternatives de lumière et d'obscurité; les vapeurs tourbillonnent, s'envolent comme aspirées, et la vision prend fin.
[Pg 295]
Nous déjeunons sur une île. Partout de grosses souches apportées par l'inondation et que la crue prochaine remportera. La forêt a ici un aspect plus méridional; peu ou point de conifères, les arbres à feuilles caduques dominent; sous la tiède chaleur du soleil on a l'impression du Midi. Derniers sourires de la nature sibérienne avant le long engourdissement de l'hiver. En dépit des apparences, les premiers froids sont proches et déjà les oiseaux émigrent. Tous les jours nous observons de nombreux passages d'oies en route vers le sud.
Dans l'après-midi, au bout d'une longue plaine herbeuse, apparaît le village de Troïtskoïé, signalé de loin par la tache blanche de son église: un horizon de prairies basses découpées de canaux, des troupeaux de vaches et de chevaux paissant tranquillement; un aspect de plantureuse Hollande.
Entre tous les Russes de Sibérie que nous avons vus, les habitants de Troïtskoïé se distinguent par leur énergie et leur fierté avec un air d'indépendance qui ne déplaît point. Dispersés sur d'immenses territoires, les indigènes sentent ici moins la main de l'autorité que dans la Russie d'Europe, et ne pouvant guère compter sur l'intervention de l'État, ils ont pris l'habitude d'une plus grande initiative. Ces gens-là réunissent toutes les qualités du colon.
Au delà de Troïtskoïé, très loin dans l'horizon bleui par la buée d'eau, une longue strate blanchâtre indique la terrasse de la rive droite. La plaine d'eau et de terres noyées s'élargit vers l'est. Nous voici en vue du confluent de l'Obi et de l'Irtich, presque au terme de notre voyage. Une dernière fois, à Bielagora, nous changeons les rameurs et en route pour Samarovo. Le vent souffle grand frais,[Pg 296] et immédiatement la voile est hissée. Sous la poussée de la brise, la lodka avance rapidement; au petit jour, Samarovo est en vue. De la rive gauche de l'Obi les protoks nous ont conduit dans l'Irtich. Non moins grandiose que l'Obi est l'Irtich. L'affluent est aussi large que le fleuve lui-même; à perte de vue c'est une plaine d'eau et de marais. On dirait deux bras de mer marchant l'un vers l'autre pour unir leur immensité.
A cinq heures et demie du matin, nous accostons au pristane[180] de Samarovo. Moment de satisfaction indicible, notre exploration est terminée et bien terminée. En voyage, après la joie du départ, la plus grande est celle du retour. On revoit alors en rêve toutes les péripéties de l'expédition; les incidents ennuyeux, les tracas s'oublient, et il ne reste plus dans la mémoire que le souvenir des grands spectacles de la nature, de cette vie solitaire pleine d'émotions fortes et d'impressions violentes. L'imagination pare tout de ses vives couleurs, et à la pensée des contrées parcourues l'esprit est traversé d'un rayonnement. Dans la tristesse de l'existence, les souvenirs des voyages sont la joie des mauvais jours. Ils rappellent les temps heureux où la vie était faite d'insouciance, dans le bien-être qu'éprouvent tous les gens forts au milieu des déserts de la nature.
[180] Port.
[Pg 297]
Samarovo.—L'Irtich.—Tobolsk.—En tarentass.—Le chemin de fer Transouralien. A travers la Russie.
Quel jour passera un vapeur à destination de Tobolsk? Telle est notre première question en débarquant. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans cinq jours. En tout cas, nous devons nous armer de patience, d'autant que la localité est absolument dépourvue de charme. Pour abri nous avons une baraque dont le seul défaut est le manque absolu de fenêtres. A cela près on y est à couvert; de plus mauvais gîtes ne sont pas rares. Une seule chose, et d'importance, nous inquiète: nos provisions sont épuisées, le cabaretier établi au pristane ne vend que de l'eau-de-vie; d'autre part, le village de Samarovo est éloigné de plus de 2 kilomètres. Aux portes de la civilisation nous risquons de mourir de faim.
Les bagages débarqués, nous nous acheminons prestement vers Samarovo pour aller demander un peu de nourriture à Semtzov. Semtzov, qui est un simple paysan enrichi, est la providence des voyageurs[Pg 298] dans ces parages. A tous, à Poliakov comme à Finsch, à Ahlqvist comme à Sommier, il a libéralement prêté les embarcations nécessaires pour le voyage de l'Obi. Il suffit d'expliquer à ce brave homme notre embarras, et de suite il nous offre de prendre tous nos repas chez lui. Cette cordiale et franche hospitalité est un des traits du caractère russe, et chez ces simples paysans elle vaut d'autant plus par la sûreté des relations.
Enfin, après trois longues journées d'attente, le vapeur arrive, mais au moment de la délivrance la maladresse du capitaine nous fait craindre une nouvelle détention. La brise souffle en bourrasques du nord; incapable de manœuvrer dans de pareilles conditions, le capitaine approche simplement de la rive et détache un canot à terre. Boyanus saute aussitôt à bord pendant que je fais embarquer nos nombreux colis dans une lodka. Mais dès que l'embarcation a rallié, le paquebot se remet en marche, me laissant sur la rive avec les bagages et avec les deux ouriadniks.
Me voilà condamné à attendre je ne sais combien de temps le passage d'un nouveau steamer dans cette bourgade sans intérêt. Le vapeur file toujours, il va disparaître lorsque soudain il s'arrête, vire de bord et se dirige de nouveau vers le pristane, où il accoste bientôt sans la moindre difficulté. Je suis sauvé grâce à l'énergie de Boyanus. Cet excellent ami a tenu rigoureusement tête au capitaine et l'a obligé à revenir en arrière. Ce moment d'émoi passé, nous pouvons goûter en toute quiétude les avantages de la civilisation. Après deux mois passés dans la cahute d'une lodka, on éprouve une agréable sensation à se trouver dans un salon confortable, bien éclairé, et[Pg 299] après deux mois d'un régime de tapioca, de poisson et de conserves une table passable semble un luxe oriental. Et pourtant nous regrettons notre vie sauvage.
Sur les bords de l'Irtich le paysage est aussi ennuyeux que sur l'Obi. A droite une haute plaine sablonneuse, et partout la forêt. A partir de Démiansk l'aspect de la vallée devient moins sévère. Nous entrons dans la région des céréales; autour des villages s'étendent des champs cultivés, mais les villages sont rares et, partant, les cultures peu étendues.
Après trois jours de navigation voici enfin Tobolsk. A ce nom sonore plein de souvenirs historiques vous vous représentez une grande et belle ville, quelque chose comme une merveilleuse cité asiatique des contes des Mille et une Nuits. Et de fait Tobolsk a fort bon air. Sur une hauteur, un fouillis de remparts et d'églises s'élève en masse architecturale et pittoresque dominant une plaine de baraques. Nous débarquons et ici, comme à Vologda, comme à Iaroslav, comme dans toutes les villes russes, ce bel aspect masque un grand village. Dans le chef-lieu de la Sibérie occidentale les voyageurs ne trouvent pas même une auberge, rien que des bouges infects aussi repoussants que les iourtes ostiakes! Un hôtel, à qui servirait-il? nous répond-on. Seuls s'arrêtent à Tobolsk les voyageurs qui ont des parents et des amis dans la ville, et ils logent chez ces parents et ces amis. Pendant notre séjour, l'aimable gouverneur, le général Troïnitsky, nous installa dans l'appartement d'un de ses amis absent pour le moment et nous offrit l'hospitalité de sa table. Sans cela nous aurions été forcés de dresser notre tente dans quelque coin de prairie et de faire la popote en plein vent comme des Bohémiens.
[Pg 300]
En toutes occasions, le général Troïnitsky s'efforçait d'aplanir toutes les difficultés devant nous, et son accueil chaud et cordial restera un de nos meilleurs souvenirs de Sibérie.
Comme presque toutes les cités bâties sur le bord d'un fleuve, Tobolsk est divisée en haute et basse ville. En haut est le Kremlin, gardant dans son enceinte de remparts la cathédrale et les bâtisses administratives. A ce quartier perché sur la falaise élevée de l'Irtich conduit une large avenue planchéiée, ouvrage des prisonniers suédois du temps des guerres de Charles XII. Elle conduit à un petit square orné d'une statue de Iermak. Le morceau est plus que médiocre, mais la pensée qui a présidé à son érection n'est pas banale. Le conquérant de la Sibérie est placé en face de l'immense plaine de l'Irtich, et le paysage grandiose donne la vie à ce bronze sans expression. Cette terre infinie, dont l'extrémité se perd dans la brume de l'horizon, ce continent illimité, voilà son apport à la patrie, à lui ce brigand qui, s'il n'avait assuré un empire à son tsar, aurait été pendu haut et court. Combien elle est suggestive l'histoire du conquérant sibérien! Ici, comme en Australie, une bande d'écumeurs et de détrousseurs de grands chemins a agrandi leur patrie d'un des plus vastes empires du monde. Examinez, du reste, toutes les importantes entreprises coloniales: presque toutes n'ont-elles pas été conduites par des gens qui aujourd'hui n'auraient pu être candidats au prix Montyon? Pour de pareilles expéditions il faut le goût des aventures et l'esprit d'initiative. Les vagabonds ne sont-ils pas des gens qui ont ces qualités à un degré incompatible avec les lois de la société?
[Pg 301]
A Tobolsk nous apprenons une nouvelle désagréable: par suite de la baisse des eaux la navigation est interrompue sur la haute Tobol, affluent de l'Irtich, conduisant à Tioumen, tête de ligne du chemin de fer transouralien.
Pour gagner cette ville nous devrons faire le trajet en tarentass. Ce sera pour nous l'occasion d'expérimenter ce mode de locomotion. Le tarentass et la Russie! l'un évoque l'autre, et notre voyage serait incomplet sans une excursion dans cette fameuse voiture. Avec son obligeance habituelle, le général Troïnitsky organise notre course, et, pour nous épargner l'ennui d'un changement de véhicule à chaque station, nous prête aimablement le sien. Représentez-vous une sorte de barque solidement fixée à un chariot non moins solide monté sur quatre roues. En avant, un siège pour deux personnes; dans la barque, point de banquettes, simplement, comme dans la plétionka, une épaisse couche de foin pour remplacer les ressorts et sur laquelle s'allongent les voyageurs. Le véhicule n'est pas précisément léger; pour le traîner à une allure rapide, quatre chevaux sont nécessaires.
Le 8 septembre, à dix heures trente du matin, nous quittons Tobolsk; les dernières maisons de la ville dépassées, les chevaux partent à fond de train. Sur la route excellente et absolument plate, le tarentass vole pour ainsi dire. En une heure trois quarts nous parcourons 27 kilomètres et demi, encore avons-nous perdu pour le moins dix bonnes minutes à la traversée de l'Irtich en bac. A midi quinze, nous arrivons à la station de Karatchine; en vingt minutes les chevaux sont changés, et maintenant au triple galop. En une heure quarante-cinq nous franchissons une[Pg 302] distance de 31 kilomètres, soit près de 18 kilomètres à l'heure: c'est le record de vitesse dans notre course de Tobolsk à Tioumen.
Partout le pays est constitué de terres noires très fertiles. Seulement autour des villages, le sol est cultivé pour la consommation locale. Le manque de débouchés rend inutile de plus abondantes récoltes.
Toute la journée et toute la nuit nous galopons ainsi, mais, à mesure que nous avançons, les voyageurs deviennent plus nombreux et, partant, les haltes plus longues. A une station nous attendons les chevaux pendant deux heures. Enfin, à trois heures de l'après-midi, nous faisons notre entrée à Tioumen, ayant ainsi parcouru 277 kilomètres en vingt-neuf heures.
Tioumen est une gentille petite ville de 15 000 habitants environ, très importante au point de vue commercial. C'est le lieu de transit entre l'Europe et la Sibérie. Située sur la Toura, à l'extrémité ouest du réseau des voies fluviales de la Sibérie occidentale, elle est en même temps en communications faciles avec le bassin du Volga et de la Kama par le chemin de fer transouralien. Malheureusement, souvent en automne, comme cette année, la baisse des eaux interrompt la navigation sur la Tobol et oblige le commerce à de coûteux transbordements et transports par terre. D'autre part, le chemin de fer Ouralien débouchant dans la vallée de la Kama qui est sans voie ferrée, cette route n'est pratique qu'en été. Lorsque le Transsibérien sera construit, il est donc probable, pour ces raisons, que le chemin de Tobolsk à Perm par Tioumen sera abandonné pour un autre plus avantageux, déjà en partie existant. A travers l'Oural méridional vient d'être construite une ligne débouchant[Pg 303] en Sibérie à Slata-Oust. Cette voie est reliée par Samara et le pont de Sizerane au restant du réseau russe. Lorsqu'elle aura été poussée d'autre part jusqu'à l'Irtich, en toutes saisons, la Sibérie se trouvera en relations constantes et rapides avec la Russie d'Europe. Ce sera l'embranchement européen du Transasiatique. A Tioumen existe un petit musée très intéressant par sa collection d'objets chinois et hindous découverts dans l'Oural.
Le soir même, nous prenons le chemin de fer, et le lendemain à midi nous arrivons à Iékaterinebourg. Cette ville est le chef-lieu d'un important district minier. Dans un rayon de trente ou quarante lieues à la ronde, c'est-à-dire aux environs, comme disent les Sibériens, se trouvent de très riches gisements de minerais et de minéraux précieux. A Iékaterinebourg sont installés une fonderie d'or et un atelier de polissage des marbres appartenant à la couronne. A notre point de vue, beaucoup plus intéressant est le musée très riche en objets préhistoriques provenant de tumuli attribués aux Tchoudes énigmatiques. Dans cette belle collection je remarque une pierre enveloppée d'écorce de bouleau identique à celles que les Ostiaks emploient encore aujourd'hui comme pesons pour leurs filets. Elle a été trouvée à une profondeur de 7 à 10 mètres dans les sables aurifères recouverts d'une couche de tourbe épaisse d'une dizaine de mètres. C'est généralement entre ces deux formations que se rencontrent les objets préhistoriques. Tous ces matériaux ont été réunis par les soins de la Société ouralienne d'amateurs des sciences naturelles. Cette société locale rend de grands services à la science, et son bulletin contient une foule de documents intéressants sur cette région ouralienne. Le[Pg 304] succès de cette publication appartient en grande partie au zèle de son secrétaire, M. Clerc. Le nom de ce modeste savant est très connu des voyageurs sibériens; tous ont pu apprécier la cordialité de son hospitalité et l'étendue de son savoir.
Nous aurions bien voulu accepter l'aimable offre de M. Clerc de faire en sa compagnie une excursion archéologique aux environs, mais le temps presse, et le lendemain nous reprenons le chemin de fer. La voie ferrée suit la base de l'Oural. Rien dans le paysage n'indique le voisinage d'une chaîne de montagnes; le terrain est doucement mamelonné avec de belles forêts et de frais vallons; cela me rappelle la Suède centrale. Voici Nijni-Tagilsk, les fameux établissements métallurgiques et miniers du prince Demidov, puis la station Asiatskaya, suivie de celle d'Ouralskaya, située au point culminant du seuil: 600 mètres seulement. Le train descend ensuite à Européiskaya. La chaîne est traversée sans que, pour ainsi dire, nous nous en soyons aperçus. L'Oural est simplement ici un large renflement entre l'Europe et l'Asie.
Le 12 au matin, nous arrivons à Perm, et aussitôt nous poursuivons notre route vers Pétersbourg.
Le 27 septembre, enfin, nous arrivons à Abo, à l'extrémité occidentale de la Finlande, pour nous embarquer à destination de Stockholm. En deux semaines j'ai traversé la Russie dans toute sa largeur, encore la lenteur de la navigation sur les rivières à moitié asséchées m'a-t-elle fait perdre pas mal de temps et ai-je dû m'arrêter plusieurs jours à Kazan et à Pétersbourg pour remercier les autorités russes de leur constant appui si bienveillant.
Me voici maintenant sur la Baltique. Avec quelle[Pg 305] volupté j'aspire ses effluves salins forts et tonifiants. Après trois mois de vie dans l'intérieur du continent, j'ai soif de la mer. Là-bas, en Sibérie, il me semblait respirer un air pourri, vicié par tous les milliers de poitrines qui l'avaient goûté avant moi. J'étais asphyxié et la fraîcheur de la brise marine me fait renaître. Dans cet air vivifiant je repasse tous les incidents du voyage, toutes les impressions fortes de la vie sauvage, et le souvenir donne à ces réalités d'hier le charme de la vision. Les voyages ne sont-ils pas des rêves vécus?
[Pg 307]
Au cours de ce voyage dans la Russie boréale, comme pendant mes précédentes explorations dans les régions arctiques, mes recherches ont eu principalement pour objet la récolte des animaux inférieurs. C'est ainsi que dans chacune des localités visitées je me suis préoccupé avant tout d'exécuter des pêches au filet fin dans les nappes d'eau et de recueillir des arachnides, des coléoptères et des mollusques.
I. Pêches au filet fin.
Des pêches ont été exécutées dans trois régions différentes de la Russie: 1o aux environs de Kazan; 2o dans les bassins supérieurs de la Kama et de la Petchora et dans la vallée de la Chtchougor; 3o en Sibérie dans la haute vallée de la Sygva.
1o Région de Kazan.
J'ai d'abord exploré le Kabane, fausse rivière située au pied de la haute terrasse de la rive gauche du Volga, à 4 ou 5 kilomètres de ce fleuve, dans le faubourg tatar de[Pg 308] Kazan. Les lacs marécageux, dont l'ensemble a reçu le nom de Kabane, sont peu profonds.
En visitant les Tchérémisses du district de Tsarévokoktchaïsk, j'ai exécuté des pêches dans toutes les nappes situées dans les ravins de la pêche. (Pour la formation et la situation de ces nappes, voir plus haut, p. 55.) La plus importante est le Tchernoïé-Ozero.
2o Région de la Kama, de la Petchora et de la Chtchougor.
Pendant mon excursion à travers la vallée de l'Inva, des pêches ont été exécutées dans de fausses rivières de la région. De même en traversant le Tchoussovskoïé-Ozero, formé par la Bérésovka. Au point exploré, ce lac marécageux avait une profondeur de 2 mètres. La Petchora, comme nous l'avons dit, est bordée de fausses rivières marécageuses situées de 5 à 12 mètres au-dessus du fleuve et à une distance de 5 à 600 mètres de la berge. J'ai pêché dans ce bassin à Oust-Pojeg et à Oust-Chtchougor, enfin dans des mares éparses dans la forêt au confluent de la Chtchougor et de la Volokovka (160 mètres). Enfin, aux environs de Chékour-Ia-Paoul j'ai exploré également des fausses rivières.
En résumé, sauf le Tchernoïé-Ozero et le Tchoussovskoïé-Ozero, nulle part je n'ai rencontré un véritable lac. Presque toutes ces fausses rivières, bordées de tourbières et de vase, étaient d'accès très difficile; en approchant de la rive, j'enfonçais parfois jusqu'aux genoux. D'autre part, le manque d'embarcation sur ces bassins limitait l'exploration à la région riveraine.
Les produits de mes pêches, comme ceux rapportés de mes précédents voyages, ont été étudiés par deux savants spécialistes, MM. Jules de Guerne et Jules Richard, et publiés par eux dans le Bulletin de la Société de Zoologie de France (t. XVI). A ce travail j'emprunte le tableau suivant donnant la détermination des espèces recueillies et leur distribution dans la région visitée.
[Pg 309]
| KAZAN | KAMA-PETCHORA-CHTCHOUGOR | SIBÉRIE | |||||
| Kabane | Environs de Kazan |
Vallée de l'Inva. |
Tchoussovskoïé-O. | Oust-Pojeg, etc. | Volokovka. | Chekour-Ia-Paoul. | |
| Copépodes. | |||||||
| Cyclops fuscus Jurine | + | ||||||
| — tenuicornis Claus | + | ||||||
| — annulicornis Sars | + | ||||||
| — viridis var. gigas Claus | + | + | |||||
| — Leuckarti Sars | + | + | + | ||||
| — oithonoides Sars | + | + | |||||
| — strenuus var. abyssorum Sars | + | ||||||
| — serrulatus Koch | + | + | + | ||||
| — macrurus Sars | + | + | |||||
| — diaphanus Fischer | + | ||||||
| — fimbriatus Fischer | + | ||||||
| — sp. ? | + | ||||||
| — sp. ? | + | ||||||
| — sp. ?(probt. bicuspidatus Cl.) | + | ||||||
| Diaptomus gracilis Sars | + | ||||||
| — graciloides Lilljeborg | + | + | |||||
| — cæruleus Fischer | |||||||
| Heterocope saliens Lilljeborg | + | ||||||
| — appendiculata Sars | + | ||||||
| Cladocères. | |||||||
| Leptodora Kindti Focke | + | ||||||
| Polyphemus pediculus de Geer | + | + | + | + | + | ||
| Holopedium giberum Zaddach | + | ||||||
| Sida crystallina Fischer | + | + | |||||
| Daphnella brandtiana Fischer | + | + | + | ||||
| Hyalodaphnia Jardinei Baird | + | + | |||||
| Daphnia longispina var. rectis pina | |||||||
| Kräyer | + | ||||||
| — — var. aquilina Sars | + | ||||||
| Simocephalus vetulus O. F. Müller | + | + | |||||
| Ceriodaphnia rotunda Straus | + | + | + | ||||
| — megops Sars | + | ||||||
| Scapholeberis mucronata O. F. Müller | + | + | + | + | + | ||
| Macrothrix laticornis Jurine | + | ||||||
| Bosmina cornuta Jurine | + | + | |||||
| — obtusirostris Sars | + | + | |||||
| — coregoni Baird | + | ||||||
| — sp. ? (jeune) | + | ||||||
| Eurycercus lamellatus O. F. Müller | + | + | |||||
| Camptocerus Lilljeborgi Schœdler | + | ||||||
| Acroperus angustatus Sars | + | ||||||
| Alona affinis Leydig | + | + | |||||
| — costata Sars | + | ||||||
| — testudinaria Fischer | + | + | + | ||||
| Pleuroxus truncatus O. F. Müller | + | + | |||||
| — excisus P. Fischer | + | ||||||
| Chydorus sphæricus Jurine | + | + | + | + | |||
[Pg 310]
[181] Bulletin de la Société Zoologique de France, t. XIV.
I. VALLÉE DE LA PETCHORA
1o Oust-Pojeg (62° lat. N.).
Lycosa cinerea Fabr.
Steatoda bipunctata L.
2o Entre Oust-Pojeg et Oust-Chtchougor.
Lycosa cinerea Fabr.
— cuneata Clerck.
Pardosa palustris L.
Tetragnatha extensa L.
Epeira marmorea Cl., forma principalis.
II. RÉGION OURALIENNE
1o Vallée de la Chtchougor jusqu'au confluent de la Volokovka.
Pardosa ferruginea L. Koch.
Epeira patagiata Cl.
Epeira marmorea Cl., forma principalis.
Pachygnatha Listeri Sund.
Linyphia phrygiana L. Koch.
Linyphia insignis Blackw.
Titanoeca sibirica L. Koch.
Prosthesima subterranea C. Koch.
Oligolophus morio Faler.
2o Oural. Du confluent de la Volokovka à la haute vallée de la Sygva.
Pardosa ferruginea L. Koch.
Linyphia phrygiana C. Koch.
Lycosa pinetorum Thorell.
Oligolophus morio Fabr.
III. SIBÉRIE
1o Haute vallée de la Sygva. Liapine, à 4 kilom. de Chekour-Ia-Paoul.
Epeira marmorea Cl., forma principalis.
Epeira patagiata Cl.
Tetragnatha extensa L.
Philodromus histrio Latr.
[Pg 311]
2o Vallée de la Sygva, entre Liapine et le confluent de la Sosva.
Epeira cornuta Cl.
Philodromus emarginatus Schrank.
Gongylidium rufipes L.
Calliethera scenica Cl.
3o Vallée inférieure de la Sosva.
Epeira marmorea Cl., forma principalis.
Epeira cornuta Cl.
— patagiata Cl.
— Westringi Thorell.
Tetragnatha groenlandica Thorell.
Theridion pictum Walck.
Steatoda bipunctata.
Bolyphantes index Thorell.
Xysticus pini Hahn.
Philodromus emarginatus Schrank.
Philodromus aureolus Cl.
Clubiona erratica C. Koch.
Prothesima rustica L. Koch.
Ergane (Hasarius) jalcata Cl.
4o Vallée de l'Obi. De Bériosov à Samarovo.
Epeira cornuta Cl.
Tetragnatha groenlandica Thorell.
Steaboda bipunctata L.
Gongylidium rufipes L.
Phalangium Nordenskiöldii L. Koch.
Sauf trois espèces (Phalangium Nordenskiöldii L. Koch, Titanoeca sibirica L. Koch, Tetragnatha groenlandica Thorell), toutes les autres, d'après M. E. Simon, appartiennent à la faune de l'Europe centrale, dont l'extension en Sibérie avait déjà été signalée par L. Koch.
[Pg 312]
I. PETCHORA
1o Oust-Pojeg.
Limnaea ovata Drap.
— stagnalis L.
— palustris Müll.
Planorbis albus Müll.
Valvata piscinalis Müll.
Pisidium fossarinum Clessin.
2o Podcherem.
Limnaea auricularia L.
Ancyclus fluviatilis Müll.
Pisidium amnicum Müll.
II. VALLÉE DE LA CHTCHOUGOR
Limnaea ovata Drap.
Planorbis albus Müll.
Succinea putris F. var? Un seul exemplaire jeune et en mauvais état
Helix Schrenki Middend.
III. SIBÉRIE
Obi entre Bolschoï—et Malo—Atlim.
Limnaea ovata Drap.
— palustris.
— peregra Müll.
Physa fontinalis L.
Planorbis complanatus L.
— spirorbis Müll.
Bithinia Leachi Sheppard.
— Kickxi Westendorp.
| Notonecta lutea Müll. | Koudimgkor. Vallée de l'Inva. Gouv. de Perm. |
| Salda pallipes Fabr. | Oust-Pojeg. |
| S. pallipis, var. dimidiata Curt. | — |
| Lepyronisa coleoptrata L. | Vallée de la haute Petchora. |
| Aradus lugubris Fall. | Oural boréal. |
| Neocoris Bohemanni Fall. | Liapine. Sibérie. |
| Idiocerus discolor Stor. | — — |
[Pg 313]
I. PETCHORA
1o Oust-Pojeg (Mammaly).
Chenopodium album L.
Ranunculus polyanthemos L.
Aconitum Lycoctonum L.
— Napellus L.
Viola bicolor L.
Vicia cracca L.
Spiræa Ulmaria L.
Galium boreale L.
Erigeron acris L.
— elongatus L.
Antennaria dioica Gaertn.
Achillæa Millefolium L.
Tanacetum vulgare L.
Leucanthemum vulgare L.
Centaurea Cyanus L.
Pyrola minor L.
Myosotis palustris With.
Veronica spuria L.
— chamaedrys L.
— peduncularis M. Bieb.
Rhinanthus minor Ehrb.
2o Troïtskoïé-Petchorskoïé (Mouïlva).
Dianthus superbus L.
Nasturtium palustre R. Br.
Silene inflata L.
Gnaphalium silvaticum var. norvegicum.
Crepis virens L.
Rhinantus crista Galli L.
Allium Schœnoprasum L.
Agrostis vulgaris With.
— alba L.
Bromus arvensis L.
3o Podcherem.
Poa annua L.
4o Oust-Chtchougor.
Arenaria graminifolia Sch.
Veronica longifolia L.
Linaria vulgaris Mill.
Veratrum album L.
Lythrum Salicaria L.
Aster alpinus L.
Artemisia vulgaris L.
Myosotis palustris With.
II. RÉGION OURALIENNE
1o Vallée de la Chtchougor.
Ranunculus repens L.
Trollius europæus L.
Turritis glabra Br.
Sagina apetala L.
Geranium palustre L.
Hedysarum obscurum L.[Pg 314]
Rubus arcticus L.
Rosa acicularis Lindb.
Alchemilla vulgaris L.
Sedum Rhodiola L.
Parnassia palustris L.
Epilobium palustre L.
— alpinum L.
Linnæa borealis L.
Galium boreale L.
Valeriana officinalis L.
Aster sibiricus L.
Solidago Virgaurea L.
Achillæa Millefolium L.
Chrysanthemum bipinnatum L.
Antennaria dioica L.
Gnaphalium silvaticum
— var. norvegicum.
— supinum L.
Senecio cacaliæformis Schultz.
Cirsium heterophyllum All.
Hieracium alpinum L.
Campanula rotundifolia L.
Vaccinium Vitis idæa.
Cassiope hypnoides D.
Loiseuleuria procumbens L.
Diapensia Lapponica L.
Trientalis europæa L.
Pedicularis verticillata L.
Pedicularis sudetica Willd.
Euphrasia officinalis L.
Thymus Serpyllum L.
Polygonum Bistorta L., jusqu'à l'alt. de 900m (Telpos-Is).
Polygonum viviparum L.
Orchis incarnata L.
Veratrum album L.
Luzulea spadicea D. C., jusqu'à l'alt. de 900m (Telpos-Is).
Eriophorum angustifolium Roth.
Carex saxatilis Wahl, jusqu'à l'alt. de 900m (Telpos-Is).
Hierochloa borealis R., jusqu'à l'alt. de 900m (Telpos-Is).
Phleum pratensa L.
Calamagrostis Halleriana D. C.
Aira flexuosa L.
— var. montana jusqu'à l'alt. de 900m (Telpos-Is).
Festuca ovina L.
Equisetum silvaticum L.
Lycopodium Selago L., jusqu'à l'alt. de 900m (Telpos-Is).
2o Pérévalski-Sebka (609m).
Tanacetum norvegicum L.
Saussurea alpina D. C.
Empetrum nigrum L.
Slix Lapponum L.
Eriophorum vaginatum L.
Carex saxatilis Wahl.
Calamagrostis Halleriana D. C.
— lanceolata Rolh.
Festuca ovina L.
III. SIBÉRIE
1o Vallée de la Sygva.
Thalictrum Kemense Fr.
Ranunculus reptans L.
— pusillus Ledeb.
Nasturtium palustre R. Br.
Barbarea stricta And.
Erysimum cheiranthoides L.
Camelina sativa Fries.
Brassica Napus L.
Melandrium dioicum L.
Agrostemma Githago L.
Stellaria longifolia Muhl.
Spiræa Ulmaria L.[Pg 315]
Comarum palustre L.
Sedum Telephium L.
Epilobium angustifolium L.
— palustre L.
Cicuta virosa L.
Linnæa borealis L.
Achillæa ptarmica L.
— Millefolium L.
Artemisia vulgaris L.
Gnaphalium uliginosum L.
Cacalia hastata L.
Senecio nemorensis L.
Mulgedium sibiricum Less.
Cassandra calyculata Don.
Veronica spuria L.
— longifolia.
Pedicularis palustris L.
Scutellaria galericulata L.
Chenopodium album L.
Rumex domesticus Hartm.
2o Vallée de la Sosva.
Erigeron acris L.
Luzula spadicea
— var. melanocarpa Ledeb.
Linaria vulgaris Mill.
Carex vesicaria L.
[Pg 316]
| Altitude. | |
| Maison du Volok entre la Vogoulka et la Volosnitsa |
108 mètres. |
| Oust-Pojeg | 28 — |
| Oust-Ilytch (village) | 28 — |
| Confluent de la Petchora et de l'Ilytch | 20 — |
| Chtchougor, près du Doronine Porog | 27 — |
| — près de Dadia di | 38 — |
| >— près de Klima di | 71 — |
| — Cheur kirta | 78 — |
| — Badia di | 128 — |
| — Pied de la Peutchétiouk Parma | 153 — |
| Sommet de la Peutchétiouk Parma | 490 — |
| Chtchougor, confluent du Dourni Ieul | 159 — |
| Petit lac dans la vallée du Dourni Ieul | 414 — |
| Confluent de la Chtchougor et de la Volokovka | 162 — |
| Thalboden de la Volokovka | 397 — |
| Point culminant du col de l'Oural entre Europe et Asie | 494 — |
| Station de Pérévalski | 360 — |
| Sommet de la Pérévalski Sebka | 609 — |
| Station de Sartoneninka | 172 — |
| Factorerie de Liapine | 10 — |
| Air. | Eau. | |
| 27 juillet, 3 h. du s., Petchora | + 22° | |
| 28 juillet, 9 h. mat., — | + 21° | + 19°,7 |
| 28 juillet, 2 h. 30, — | — | + 20°,8 |
| 1er août, 8 h. du s., Chtchougor | + 15°,8 | + 17°,2 |
| 2 août, midi, — | + 18°,4 | + 16°,5 |
| 3 août, 8 h. mat., — | + 20°,5 | + 15°,5 |
| 3 août, 2 h., — | + 22°,8 | + 16°,8 |
| 4 août, midi, — | — | + 17°,2 |
| 5 août, 5 h. mat., — | + 18°,2 | + 15°,2 |
| 8 août, — | + 12°,5 | + 13° |
[Pg 317]
DE PÉTERSBOURG A KAZAN
Routes conduisant à la Petchora.—Le Volga.—Mouvement de la navigation.—Iaroslav.—Vologda.—Nijni-Novgorod.—Les populations finnoises du Volga.—Les Bulgares.—Lutte des Finnois contre les Russes.—La colonisation slave.—Les Tatars 1
KAZAN
L'Asie en Europe.—Progrès de l'industrie russe.—Climat de Kazan.—Le faubourg tatar.—Vêtement des Tatars.—Politique des Russes à l'égard des musulmans; ses résultats 26
EXCURSION AU PAYS DES TCHÉRÉMISSES
Aspect de la contrée.—Costumes et architecture tchérémisses.—Traces d'influence scandinave.—Industries.—Mariage.—Art indigène 40
[Pg 318]
LE PAGANISME EN EUROPE
La religion tchérémisse.—Ses dieux.—Prière tchérémisse.—Bois sacrés.—Clergé tchérémisse.—Sacrifices.—Fêtes religieuses.—Rites funéraires 60
LES TCHOUVACHES
La poussière en Russie.—Architecture tchouvache.—La foire de Tsévilsk.—Costume des Tchouvaches.—Visite à un lieu de sacrifice.—Croyances et superstitions des Tchouvaches 83
LES PERMIAKS
La Kama.—Perm.—Les Permiaks.—Costumes et habitations de ces indigènes 102
DE TCHERDINE A LA PETCHORA
La Kolva.—La Vogoulka.—Les moustiques.—Les embâcles de bois.—Le portage entre Vogoulka et Petchora.—Les Zyrianes 118
LA PETCHORA
Description générale du fleuve.—Importance historique de cette région.—La Permie et la Iougrie.—Commerce des Arabes et des Byzantins dans ces régions.—La Petchora route d'exportation pour le commerce de l'Orient.—Les Normands.—Traces d'influence scandinave relevées chez les Permiaks et les Zyrianes.—Arrivée des Novgorodiens.—Les Anglais à l'embouchure de la Petchora.—Avenir de la région de la Petchora 156
[Pg 319]
DESCENTE DE LA PETCHORA D'OUST-POJEG A OUST-CHTCHOUGOR
Les rapides.—La forêt.—Un village zyriane 172
NAVIGATION SUR LA CHTCHOUGOR.—TRAVERSÉE DE L'OURAL SEPTENTRIONAL
Les passes de l'Oural.—La route Sibiriakov.—Les rapides de la Chtchougor.—Ascensions dans l'Oural 180
LA TRAVERSÉE DE L'OURAL
Les marais.—Ascension dans l'Oural.—Première rencontre avec les Ostiaks.—Arrivée à Liapine 200
LES OSTIAKS
Séjour à Liapine.—Le village ostiak de Chékour-Ia.—Habitations, costumes et vie des indigènes.—A la recherche des idoles 209
LA SYGVA ET LA SOSVA
Descente de la Sygva.—Un clan zyriane.—Un prince ostiak.—Danse des indigènes.—Arrivée à Beriosov 241
L'OBI
Bériosov.—Les marais.—L'Obi route commerciale.—Arrivée à Samarovo 264
[Pg 320]
LA GRANDE ROUTE DE SIBÉRIE
Samarovo.—L'Irtich.—Tobolsk.—En tarentass.—Le chemin de fer Transouralien.—A travers la Russie 297
APPENDICE 307
Coulommiers.—Imp. Paul BRODARD.
[Pg 322]
Collection de Voyages illustrés (form. in-16)
Chaque volume: broché, 4 fr.;—relié en percaline, 5 fr. 50
ABOUT (Ed.): La Grèce contemporaine.—1 vol.
ALBERTIS (D'): La Nouvelle-Guinée.—1 vol.
AMICIS (DE): Constantinople.—1 vol.
— L'Espagne.—1 vol.
— La Hollande.—1 vol.
— Souvenir de Paris et de Londres.—1 vol.
BELLE (H.): Trois années en Grèce.—1 vol.
BOULANGIER: Voyage a Merv.—1 vol.
BOVET (Mlle M.-A. DE): Trois mois en Irlande.—1 vol.
CAMERON: Notre future route de l'Inde.—1 vol.
CHAFFANJON: L'Orénoque et le Caura.—1 vol.
CHAUDOUIN: Trois mois de captivité au Dahomey.—1 vol.
COTTEAU (Edmond): De Paris au Japon a travers la Sibérie.—1 vol.
— Un touriste dans l'Extrême-Orient.—1 vol.
— En Océanie.—1 vol.
FARINI (G.-A.): Huit mois au Kalakari.—1 vol.
FONVIELLE. (W.): Les affamés du Pôle Nord.—1 vol.
GARNIER (Francis): De Paris au Tibet.—1 vol.
HUBNER (Comte de): Promenade autour du monde.—2 vol.
LABONNE: L'Islande.—1 vol.
LARGEAU (Victor): Le pays de Rirha.—1 vol.
— Le Sahara Algérien.—1 vol.
LECLERQ: Voyage au Mexique.—1 vol.
— La Terre des Merveilles.—1 vol.
MARCHE (Alfred): Trois voyages dans l'Afrique occidentale.—1 vol.
— Luçon et Palaouan.—1 vol.
MARKHAM: La mer glacée du pôle.—1 vol.
MONTANO (D.): Voyage aux Philippines.—1 vol.
MONTÉGUT (E.): En Bourbonnais et en Forez.—1 vol.
— Souvenirs de Bourgogne.—1 vol.
— Les Pays-Bas.—1 vol.
PFEIFFER (Mme Ida): Voyage d'une femme autour du monde.—1 vol.
RECLUS (Armand): Panama et Darien.—1 vol.
RECLUS (Elisée): Voyage à la Sierra de Ste-Marthe.—1 vol.
ROUSSET (L.): A travers la Chine.—1 vol.
SIMONIN: Le monde américain.—1 vol.
TAINE (H.): Voyage en Italie.—2 vol.
— Voyage aux Pyrénées.—1 vol.
— Notes sur l'Angleterre.—1 vol.
TANNEGUY DE WOGAN: Voyage du canot en papier le «Qui vive».—1 vol.
THOMSON (J.): Au pays des Massaï.—1 vol.
THOUAR: Voyages dans l'Amérique du Sud.—1 vol.
UJFALVY-BOURBON (Mme DE): Voyage d'une Parisienne dans l'Himalaya.—1 vol.
VERSCHUUR: Aux Antipodes.—1 vol.
WEBER (Ernest DE): Quatre années au pays des Boers.—1 vol.