ROBERT LOUIS STEVENSON
A LA PAGAIE
SUR L’ESCAUT, LE CANAL DE WILLEBROECK,
LA SAMBRE ET L’OISE
TRADUIT DE L’ANGLAIS AVEC AUTORISATION
PAR
LUCIEN LEMAIRE
Officier d’Académie
Professeur au lycée de Valenciennes
Préface de A. ANGELLIER,
Professeur de littérature anglaise
Doyen de la Faculté des lettres de Lille
Avec un Frontispice par WALTER CRANE
ET SIX ILLUSTRATIONS
PARIS
LIBRAIRIE HISTORIQUE DES PROVINCES
EMILE LECHEVALIER
39, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 39
—
1900
Il a été tiré 150 exemplaires sur papier Japon, numérotés de 1 à 150,
1 exemplaire sur papier de Chine, numéroté 151,
Et 50 exemplaires sur papier Hollande, numérotés à la presse de 152 à 201.
Dans l’œuvre très diverse de Robert Louis Stevenson, en dehors de ses romans fantastiques et de la série de ses romans historiques écossais, qui vivent d’une vie si active et si franche, il y a un coin particulièrement frais et charmant. Ce sont ses récits de voyages, mais non pas de voyages en chemin de fer ou en bateau à vapeur, avec séjours dans les grandes villes, et développements du Murray ou du Bœdeker. Ce n’est point là sa façon: il se plaît à parcourir des parties de pays ignorées, et il veut le voyage avec ses petites péripéties, ses efforts, ses ennuis, ses surprises, le voyage vraiment fait par le voyageur et non par quelque machine à laquelle il se confie. Tantôt il s’en va dans les montagnes avec un âne qu’il a chargé d’objets de campement et de cuisine, et il bivouaque en plein air. Tantôt il descend les rivières sur une fragile périssoire, non sans aventures et sans quelque danger. Il fait le vrai voyage, celui qui demande de l’énergie, du sang-froid, de l’effort physique, de l’endurance, et qui vous récompense par l’exercice et l’accroissement de ces qualités; sans compter le plaisir de mille incidents et de mille aspects inattendus; sans compter un délicieux sentiment d’indépendance. Les émotions et les rencontres du voyageur, notées au jour le jour, un peu à la façon de Topffer, mais avec un sens plus général et plus artistique, ont fourni les jolis carnets de voyage qui se nomment: An Inland Voyage, ou: Travels with a Donkey.
Ce sont des notations pleines de gaîté, de bonne humeur, parsemées de délicats paysages à la fois exacts et larges, de réflexions générales, d’observations bienveillantes, d’une 6 sorte de cordialité envers les gens, du sentiment de la vie au grand air et de ce qu’elle a de bracing, pour employer le terme anglais. Tout cela est exprimé dans une langue qui a fait de Stevenson un des écrivains les plus rares et les plus distingués de l’Angleterre contemporaine; une langue aisée, élégante, naturelle, mesurée, disant tout sans effort, colorée sans surcharge, et d’une merveilleuse souplesse. Sans étalage quoique avec de grandes ressources de vocabulaire, sans tension de syntaxe, elle glisse facilement autour des idées, qui se trouvent saisies et enveloppées sans presque qu’on y ait pris garde, quelque subtiles et fuyantes qu’elles soient. Elle a cette simplicité qui semble naturelle, qui est au fond très savante, dont est fait en grande partie le talent d’un de nos écrivains contemporains: je veux dire d’Anatole France. Mais la langue de celui-ci, pour exquise qu’elle soit, sent le renfermé: elle a une odeur de cabinet de travail ou de salon, un parfum d’autrefois, de fleur desséchée: elle est dépaysée au grand air. Même ses paysages sont vus à travers des vitres: ils ont quelquefois la couleur, ils n’ont jamais la brise. La langue de Stevenson, moins pénétrante, est plus active, plus franchement vivante; elle a plus couru les grands chemins, elle est plus virile, plus saine. On sent qu’elle aurait pu devenir un instrument d’action, tandis que celle de M. France, féminine et comme lassée, n’a foulé que des tapis; elle est sans force et plie, quand elle s’emploie à autre chose qu’à l’art; elle peut toucher à tout, elle ne peut rien soulever.
C’est en France que Stevenson a accompli ses principaux voyages. Sans parler de ses fraîches et riantes pages sur la forêt de Fontainebleau, les Travels with a Donkey ont été faits dans les Cévennes, et An Inland Voyage, au fil de l’Oise. Stevenson a pénétré ainsi dans la véritable vie française. Il la comprend et il l’aime; et s’il n’en fait pas une étude formelle, il la touche sans cesse en passant. Il est, avec Hamerton et Miss Matilda Betham-Edwards, (je ne parle pas du livre de Bodley qui est une 7 enquête sociale), un des auteurs anglais qui ont fait amitié avec l’âme de ce pays, et tenté de la faire connaître à leurs compatriotes. Travail méritoire! Car si les Anglais sont vraisemblablement le peuple le mieux informé sur les autres, ils sont peut-être aussi celui qui comprend le moins les autres. Ils vivent, surtout en ce qui nous concerne, dans un chaos de préjugés héréditaires, de renseignements minuscules, d’ignorances capitales rendues plus dangereuses par une surabondance de détails futiles, dans un clapotis de menus faits, ou radicalement faux, ou déformés par le besoin d’effet, de grossissement et d’importance dont sont atteints, par détérioration professionnelle, les correspondants de leurs journaux. Dans tout cela roulent, plus souvent qu’il ne conviendrait, des mensonges ou des calomnies dont on ne comprend pas qu’ils sortent, sans être écrasés, d’entre les mains d’hommes qui passent pour avoir de l’honneur. Qu’on imagine cette étrange et incohérente matière, entretenue et exploitée par les desseins des hommes politiques, ressassée et exagérée par une hypocrisie à base ethnique et protestante, amplifiée et renouvelée pour fournir, par contraste, une pâture presque quotidienne à l’amour-propre national; qu’on imagine en outre ces déformations et ces grossissements répercutés incessamment par une presse formidable, et on aura une idée de ce que peut devenir, dans des moments d’excitation, le jugement du peuple anglais sur la France. C’est pourquoi nous devons de la reconnaissance aux hommes comme Stevenson, qui prennent la peine de nous connaître, vivent cordialement avec nous, et, se tournant vers leurs compatriotes, avec un sourire et un léger haussement d’épaules, rétablissent les proportions et remettent les choses au point.
Ces carnets de voyage sont des livres dont nous pouvons tirer plusieurs genres de profit. Outre que l’agrément et la belle humeur dont ils sont pleins, et leur irrésistible attrait de promenade intellectuelle sont en soi des choses agréables, ils nous apprennent à nous mieux connaître et à 8 nous voir sous un angle qui est en dehors de nous. Une remarque nouvelle, comme un étranger en fait, nous ouvre parfois les yeux sur des parties inaperçues de nous-mêmes et pénètre dans l’ombre paisible des habitudes. Mais surtout il y a, dans ces pages, un sens si joyeux et si sain de la vie en plein air, un goût si vivant, si frais, des charmes de la nature, un regard si habile à les saisir et à discerner le caractère des sites, un chant si allègre de liberté, qu’elles communiquent leur esprit à ceux qui les lisent. On a envie de grand air, on rêve de voyages sur les rivières ou les grands chemins. Je sais des hommes pour qui les livres de Topffer ont été le premier attrait qui les a conduits en Suisse. Ils lui doivent ce qu’ils ont acquis, dans leurs courses sur les montagnes, de santé, d’entraînement et de hautes impressions. Les livres de Robert Louis Stevenson ont la même vertu qu’ils s’appliquent à des paysages plus voisins de nous, où le décor est plus familier et où l’homme fournit davantage. S’ils inspiraient à quelques-uns de leurs jeunes lecteurs français le désir, si aisément réalisable et à si peu de frais, de voyager à pied, ils seraient rien que par cela une bonne semence. Espérons qu’elle tombera sur quelques pierres qui aimeront à rouler.
M. Lemaire, qui est professeur au lycée de Valenciennes, a choisi avec raison An Inland Voyage, dont les paysages appartiennent à notre région et sont familiers à beaucoup de ceux qui le liront. Il l’a traduit avec beaucoup de conscience et une constante préoccupation d’exactitude. Peut-être ce souci méticuleux lui fait-il perdre parfois un peu du mouvement, de l’allure aisée de l’original. C’est un défaut on the right side. Il a su mener à bien une tâche très délicate. Je ne veux pas le féliciter d’avoir si utilement employé ses loisirs de professeur. Il en a été récompensé, chemin faisant, par l’intérêt de son travail, le plaisir de vivre avec un charmant et sympathique esprit, et le profit de lutter contre cette langue qui, par sa souplesse, est une adversaire redoutable. Je désire 9 plutôt le féliciter de la persévérance avec laquelle, ayant fait ce travail, il a su, malgré l’apathie des éditeurs et la routine des revues, arriver à le produire. J’imagine que cela a dû lui demander plus de peine que sa traduction elle-même. J’espère, et c’est, je crois, sa seule ambition qu’il ne lui en coûtera que son temps. Dans l’Université on trouve que c’est là un encouragement suffisant: le travail se paye par lui-même.
Des tentatives comme celles de M. Lemaire sont le symptôme d’un important progrès accompli dans notre pays. Il ne faut pas être très âgé pour se rappeler dans quel état informe et rudimentaire étaient chez nous la connaissance et l’enseignement des langues vivantes. Par un effort efficace parce qu’il a été continu, les chaires des lycées et de la plupart des collèges ont été graduellement occupées par des hommes qui possèdent à fond la langue qu’ils enseignent. Ils ont tous fait un ou deux ans de séjour dans le pays où on la parle, ils en connaissent la littérature et les mœurs. La majeure partie d’entre eux en reçoit des journaux et des livres; ils continuent à s’intéresser aux œuvres et aux hommes qui y surgissent, aux évènements qui s’y succèdent, aux tentatives sociales ou politiques qui s’y produisent. Leur esprit s’est ouvert à voir autre chose que notre mesquine vie étriquée en d’étroits règlements: ils savent que, dans d’autres conditions, des peuples agissent et prospèrent. Ils parlent de ces choses; leurs conversations sont aussi utiles que leur enseignement; ils sont, à certaines heures, des professeurs, et, à d’autres, les témoins et les avocats de ce qui se fait au-delà de nos frontières. Leur influence sociale peut compléter leurs services professionnels. Si nos directeurs de Revues et de Magazines étaient plus entreprenants et plus avisés, ils trouveraient là une armée de collaborateurs très capables de tenir la France au courant de ce qui se passe au dehors. C’est assurément un grand progrès et un précieux élément infusé dans notre vitalité intellectuelle. Encore quelques années de persévérance et 10 il ne se trouvera plus une seule petite ville, un trou perdu, où ne se rencontre au moins un homme qui soit un centre de culture étrangère, un intermédiaire de comparaisons avec le dehors. Ce seront autant de mèches de mine dans le bloc de notre ignorance et de notre routine; ils pourront contribuer à le disloquer. Par là l’Université aura rendu au pays un de ces profonds services de nutrition silencieuse, qui, heureusement, se poursuivent sous les fièvres, les incohérences et les crises hystériques de la surface.
AUG. ANGELLIER.
Mettre une préface à un si petit livre, c’est, j’en ai bien peur, pécher contre la règle des proportions. Mais, il est au-dessus des forces d’un auteur de résister au plaisir de faire une préface, car c’est la récompense de ses travaux. La première pierre une fois posée, l’architecte apparaît avec ses plans et se pavane, une heure durant, aux yeux du public. L’auteur ne fait pas autre chose dans sa préface. Il se peut qu’il n’ait pas un mot à dire; toutefois il doit se montrer un instant dans le portique, le chapeau à la main, et dans une attitude polie.
Il vaut mieux, en telle circonstance, s’en tenir adroitement à un état intermédiaire entre l’humilité et la supériorité; comme si le livre était l’œuvre de quelque autre personne et que vous n’ayez fait que le parcourir et insérer ce qu’il 12 a de bon. Mais, pour moi, je n’ai pas encore atteint à cette perfection. Je suis encore incapable de dissimuler la chaleur de mes sentiments envers le lecteur; et, si je le rencontre sur le seuil, c’est pour l’inviter à entrer avec une cordialité toute campagnarde.
A vrai dire, je n’eus pas plus tôt fini de lire les épreuves de ce petit livre que je me sentis en proie à une appréhension désespérante.
Il me vint à l’esprit qu’il se pourrait que je ne fusse pas seulement le premier à lire ces pages, mais aussi le dernier; qu’il se pourrait que j’eusse vainement fait œuvre de pionnier dans cette étendue de pays si riant, sans trouver une âme pour suivre mes pas. A force d’y songer, je ressentis pour cette idée une aversion, qui dégénéra en une sorte de terreur panique, et je me lançai dans cette préface, qui n’est rien de plus qu’un avertissement au lecteur.
Que dirai-je en faveur de mon livre? Caleb et Josué rapportèrent de Palestine une formidable grappe de raisin. Hélas! mon livre ne 13 produit rien d’aussi nutritif; et, d’ailleurs, nous vivons dans un siècle, où l’on préfère une définition à n’importe quelle quantité de fruits.
Je me demande si une négation n’aurait pas quelque chose de séduisant? car, au point de vue négatif, je me flatte que ce volume a un certain cachet. Bien qu’il contienne beaucoup plus de deux cents pages, je n’y ai pas fait remarquer une seule fois que l’univers de Dieu n’a pas de but, et je n’y donne pas non plus une seule fois à entendre que j’en eusse pu créer un meilleur. Je ne sais réellement pas où j’ai pu avoir la tête. J’avais apparemment oublié tout ce qu’il y a de glorieux à être homme. C’est une omission qui enlève à ce livre toute importance philosophique; mais, j’ai l’espoir que son excentricité pourra plaire dans les sociétés frivoles.
A l’ami qui m’accompagna, je dois déjà beaucoup de remercîments; je voudrais bien, certes, ne lui devoir rien d’autre; mais, en ce moment, je me sens pour lui une tendresse presque 14 exagérée. Lui, au moins, me lira, ne serait-ce que pour refaire en esprit ses propres voyages en suivant les miens.
R. L. S.
A Sir Walter Grindlay Simpson, Baronet
Mon cher Cigarette,
C’est assez pour vous d’avoir participé si généreusement aux pluies et aux portages de notre voyage; d’avoir pagayé si laborieusement, pour rattraper l’Aréthuse, abandonnée sur l’Oise grossie; d’avoir, dès lors, piloté une vraie épave humaine jusqu’à Origny-Sainte-Benoîte et jusqu’à un souper si ardemment désiré. C’est peut-être plus qu’assez, comme vous vous en êtes plaint une fois quelque peu piteusement, que je vous aie prêté tous les torts et que je me sois attribué toutes les réflexions convenables. Je ne pouvais pas, décemment, vous exposer à partager le désagrément d’un autre et plus notoire naufrage. Mais à présent, 16 que notre voyage va paraître en une édition à bon marché, ce péril, espérons-le, n’existe plus, et il m’est loisible de mettre votre nom sur le pavillon.
Mais, je ne puis m’arrêter avant de m’être lamenté sur le sort de nos deux bateaux. Ce ne fut pas, sir, un jour fortuné que celui où nous projetâmes l’achat d’une péniche; il ne fut pas heureux, le jour où nous fîmes part de notre rêve au plus espérant des rêveurs. A vrai dire, tout sembla nous sourire un moment. Nous nous procurâmes la péniche, nous la baptisâmes «les Onze mille Vierges de Cologne», et elle demeura pendant quelques mois l’admiration de tous les admirateurs, dans les eaux d’une charmante rivière et sous les murs d’une vieille ville.
M. Mattras, le charpentier émérite de Moret, avait concentré sur elle toute la diligence de ses ouvriers rivalisant d’ardeur; et vous n’aurez pas oublié la quantité de champagne doux consommé à l’auberge, au bout du pont, pour donner 17 du zèle aux ouvriers et activer le travail. Quant à la question pécuniaire, je préfère ne pas m’y arrêter. Notre péniche «les Onze mille Vierges de Cologne» pourrit dans la rivière où elle avait été embellie. Elle ne sentit pas l’impulsion de la brise; on n’y attela jamais le patient cheval de trait. Et, lorsqu’enfin le charpentier indigné de Moret la vendit, on vendit en même temps l’Aréthuse et la Cigarette, nos deux «canoës», l’un de cèdre, l’autre, comme nous le sentions si rudement dans les portages, de solide chêne anglais. A présent, ces bateaux historiques portent les trois couleurs et sont connus sous des noms nouveaux et étrangers.
R. L. S.
Nous produisîmes une grande agitation dans les docks d’Anvers. Un arrimeur et un groupe de portefaix des docks enlevèrent nos deux «canoës» et coururent à l’embarcadère. Derrière eux venait une foule d’enfants, poussant des hourras. La Cigarette partit au milieu d’un clapotis de petites vagues qui se brisaient. L’instant d’après, l’Aréthuse la suivait. Un vapeur descendait le fleuve; des hommes, sur le tambour, crièrent de rauques avertissements, l’arrimeur et ses portefaix, sur le quai, nous braillaient de prendre garde. Mais, en quelques coups de pagaie, les canoës étaient hors d’atteinte au milieu de l’Escaut, et nous laissions derrière nous tous les vapeurs, et les arrimeurs et les autres vanités du rivage.
Le soleil brillait d’un vif éclat; la marée faisait gaillardement ses quatre milles à l’heure; 22 le vent soufflait régulièrement avec, de temps en temps, des rafales. Pour ma part, je n’avais jamais été de ma vie à la voile dans un canoë, et ma première expérience, au beau milieu de ce large fleuve, ne se faisait pas sans me causer quelque appréhension. Qu’arriverait-il à la première bouffée de vent qui gonflerait ma petite voile? A mon avis, on courait presque autant de risques à tenter ainsi l’inconnu, qu’à publier un premier livre, ou à se marier. Toutefois, ma perplexité ne fut pas de longue durée, et vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’au bout de cinq minutes, j’avais fixé ma voile.
Cette circonstance, je le reconnais, ne fut pas sans me frapper quelque peu. Naturellement, comme le reste de mes semblables, j’avais toujours fixé la toile dans un bateau à voiles; mais, dans une embarcation aussi petite et aussi peu stable qu’un canoë, et avec ces rafales qui s’abattaient sur nous, je ne m’attendais guère à pouvoir agir d’après les mêmes principes; et ce fait m’inspira quelques réflexions 23 pleines de mépris sur le cas que nous faisons de la vie. On est à coup sûr, plus à l’aise pour fumer quand la voile est attachée; mais il ne m’était jamais arrivé de mettre une bonne pipe de tabac en balance avec un péril évident, et de courir le risque de propos délibéré en choisissant la bonne pipe de tabac. C’est un lieu commun que nous ne pouvons répondre de nous-mêmes, avant d’avoir été mis à l’épreuve; mais il est moins commun et, à coup sûr, plus consolant, de penser que nous nous trouvons habituellement beaucoup plus braves et beaucoup meilleurs que nous ne croyions. Tout le monde, à mon avis, en a fait l’expérience: mais la crainte de nous démentir plus tard nous empêche de trompeter bien loin ce sentiment réconfortant. Bien sincèrement je voudrais, car cela m’eût épargné beaucoup de peine, je voudrais, qu’il se fût trouvé quelqu’un pour me faire envisager la vie avec courage, quand j’étais jeune, pour me dire combien les dangers sont plus effrayants, quand on les voit de loin; pour me montrer que ce qu’il y a de 24 viril dans le cœur d’un homme ne se laisse pas étouffer et l’abandonne rarement, je dirai même jamais, à l’heure du danger. Mais nous sommes tous très forts pour jouer de la flûte sentimentale en littérature: et il n’y aura pas un homme parmi nous pour aller en tête de la colonne faire retentir les sons grisants du tambour.
Il faisait bon sur le fleuve. Un ou deux chalands passaient, chargés de foin. Des roseaux et des saules bordaient le cours d’eau: des bestiaux et de vénérables chevaux gris montraient leurs têtes placides par dessus le talus du rivage. Çà et là, un coquet village, parmi les arbres, avec un bruyant chantier de construction de bateaux: çà et là, une villa, au milieu d’une pelouse. Le vent nous favorisa pour remonter l’Escaut, puis le Rupel: et nous allions bon train, quand nous commençâmes à voir les briqueteries de Boom, qui s’étendent très loin sur la rive droite du fleuve. La rive gauche était toujours verte et champêtre, avec des allées d’arbres, le long de la digue, et, çà et là, un 25 escalier pour desservir un bac, où l’on pouvait voir, tantôt une femme assise, les coudes sur les genoux, tantôt un vieux monsieur avec des lunettes d’argent et un bâton. Mais Boom et ses briqueteries devenaient à chaque instant, plus enfumées et plus sales; et bientôt, une grande église, avec une horloge, et un pont de bois, jeté sur le fleuve, indiquèrent le quartier central de la ville.
Boom n’a rien d’agréable et n’est remarquable qu’en un seul point: la plupart des habitants ont la ferme conviction qu’ils savent parler anglais: ce que d’ailleurs, l’expérience ne justifie pas. Ceci jeta une sorte de brume sur notre conversation. Quant à l’hôtel de la navigation, c’est, je crois, ce qu’il y a de pire dans l’endroit. Il possède deux salles, dont il est très fier, toutes deux parsemées de sable; la première donnant sur la rue, avec un comptoir à une extrémité; la seconde, plus froide et plus sombre, avec, pour tout ornement, une cage sans oiseau et un tronc tricolore où 26 recevoir des souscriptions. Nous trouvâmes moyen de dîner dans cette seconde pièce, en compagnie de trois ingénieurs stagiaires peu expansifs et d’un commis-voyageur silencieux. La nourriture, comme il arrive d’ordinaire en Belgique, était en cette occasion d’un caractère indéfinissable. En vérité, je n’ai jamais été capable de découvrir quoi que ce fût qui ressemblât à un repas chez cet aimable peuple. Les Belges semblent becqueter leurs aliments, ils ont l’air de jouer avec les mets tout le long du jour en amateurs; ils essayent d’imiter les Français; ils font, en réalité, comme les Allemands; et à la rigueur, l’on peut dire qu’ils ont un genre intermédiaire.
Nettoyée et garnie de ses accessoires, la cage vide ne portait d’autre trace du favori qui y sifflait jadis, que l’écartement de deux barreaux, entre lesquels on mettait un morceau de sucre. Cette cage évoquait ainsi une sorte de gaieté de cimetière. Pas plus à nous qu’au commis-voyageur les ingénieurs ne daignaient adresser 27 la parole: mais ils échangeaient entre eux quelques mots à voix basse et nous dévisageaient à la lumière du gaz avec leurs lunettes. Car, bien qu’ils fussent de beaux garçons, ils portaient tous des besicles.
Il y avait dans l’hôtel une servante anglaise; elle avait quitté l’Angleterre depuis assez longtemps pour avoir recueilli à l’étranger toutes sortes d’expressions bizarres et de manières curieuses, qu’il n’est pas besoin de spécifier ici. Elle nous parla abondamment dans son jargon, nous demanda des détails sur les mœurs actuelles en Angleterre et rectifia obligeamment nos explications, quand nous essayâmes de lui répondre. Mais nous avions affaire à une femme, et, au fond, peut-être ne dédaignait-elle pas tant nos renseignements, qu’elle en avait l’air. Le beau sexe aime à recueillir des connaissances et tient néanmoins à conserver sa supériorité. C’est une politique habile et presque toujours une nécessité dans les circonstances de la vie. Car, si un homme s’aperçoit qu’une femme 28 l’admire, ne serait-ce que pour ses connaissances en géographie, il se mettra immédiatement à bâtir sur cette admiration. Ce n’est qu’à force d’incessantes rebuffades que les jolies femmes peuvent nous tenir à notre place. Les hommes comme aurait dit Miss Howe ou Miss Harlowe, sont de tels «empiéteurs». Pour ma part, je suis corps et âme avec les femmes: et, après un couple bien marié, il n’est rien au monde d’aussi beau que le mythe de Diane, la divine chasseresse. Il est inutile à un homme de se retirer dans les bois: nous le connaissons trop: Saint Antoine en fit l’expérience, il y a bien longtemps; et l’aventure eut, à tous égards, une fâcheuse issue pour lui. Mais il y a ceci de particulier chez certaines femmes et qui déconcerte les meilleurs gymnosophistes parmi les hommes: c’est qu’elles se suffisent à elles-mêmes et qu’elles peuvent marcher dans une zone élevée et froide, sans la protection d’aucun de ceux qui portent culottes. Je l’affirme, bien que je sois le contraire d’un 29 ascète déclaré, je sais aux femmes plus de gré de cet idéal que je n’en saurais à la plupart d’entre elles, ou même à toutes, à l’exception d’une seule, d’un baiser spontanément donné. Il n’est rien d’aussi encourageant que le spectacle d’une personne qui se suffit. Et quand je songe aux sveltes et charmantes vierges, créatures de la forêt et du clair de lune, courant les bois toute la nuit, au son du cor de Diane, errant parmi les vieux chênes, le cœur aussi libre qu’eux, insensibles à l’agitation de la vie ardente et troublée de l’homme,—bien qu’en fait d’idéals, il en soit beaucoup d’autres que je préfère,—je sens battre mon cœur en pensant à celui qu’elles ont choisi. C’est faire faillite à la vie, mais faire faillite avec tant de grâce! Une chose n’est pas perdue, si on ne la regrette pas. En somme, et ici l’homme se décèle, où serait une grande partie de la gloire d’inspirer l’amour, s’il n’y avait aucun dédain à surmonter?
Le lendemain matin, à notre départ sur le canal de Willebroeck, la pluie commença lourde et glacée. L’eau du canal était à peu près à la température où le thé peut se boire, et, sous cette froide aspersion, la surface était couverte de vapeur. La gaieté du départ et le mouvement aisé des bateaux sous chaque coup de pagaie nous aidèrent à faire contre fortune bon cœur, pendant toute la durée de l’averse; et, une fois le nuage passé et le soleil reparu, notre entrain reprit le dessus sur nos velléités de rester chez nous. Une bonne brise bruissait et frissonnait dans les rangées d’arbres qui bordaient le canal. Les feuilles s’agitaient en masses tumultueuses, tantôt en pleine lumière et tantôt dans l’ombre. Pour l’œil et l’oreille, le temps semblait propice à l’emploi de la voile; mais, sur l’eau, entre les hautes berges, le vent ne nous parvenait que 31 par bouffées faibles et irrégulières. A peine y en avait-il assez pour gouverner. Nous avancions d’une façon intermittente et peu satisfaisante. Du chemin de halage, un loustic, qui jadis avait été marin, nous salua par ces mots: «Ça va vite, mais c’est long».
Il y avait assez d’activité sur le canal. A tout instant, nous rencontrions ou nous dépassions une longue file de bateaux, avec de grandes barres de gouvernail peintes en vert; des poupes élevées avec, de chaque côté du gouvernail, une fenêtre, et, parfois, à l’une des fenêtres, une cruche ou un pot à fleurs; une barque attachée à l’arrière; une femme occupée à préparer le dîner du jour et à soigner une poignée d’enfants. Ces péniches, au nombre de vingt-cinq ou trente, étaient toutes attachées les unes derrière les autres avec deux câbles. En tête de cette file de bateaux se trouvait un vapeur d’étrange construction qui la remorquait. Il n’avait ni roues à palettes, ni hélice; mais, au moyen de quelque engrenage, dont un esprit peu initié 32 à la mécanique ne pouvait se faire une idée exacte, il amenait par dessus l’avant une petite chaîne brillante, qui s’étendait au fond du canal et, la faisant repasser par dessus l’arrière, il se halait en avant, anneau par anneau, avec toute sa suite de bateaux chargés. Tant qu’on n’avait pas trouvé la clef de l’énigme, il y avait quelque chose de solennel et d’inquiétant dans la progression d’un de ces trains, pendant qu’il s’avançait doucement dans le canal, sans autre marque de sa marche en avant qu’un petit remous, courant le long des flancs des bateaux et s’en allant mourir dans leur sillage.
De toutes les créations dues aux entreprises commerciales, une péniche est de beaucoup ce qu’il y a de plus agréable à considérer. Il lui est loisible de déployer ses voiles, et vous la voyez alors voguer bien haut, au dessus de la cime des arbres et du faîte du moulin à vent, voguer sur le cours d’eau, voguer à travers les champs de blé vert, la plus pittoresque des créatures amphibies. Ou bien le cheval s’avance 33 d’un pas paisible et lent, comme si les affaires n’existaient pas pour lui dans le monde; et l’homme qui rêve au gouvernail voit le même clocher à l’horizon tout le long du jour. On se demande comment les choses parviennent jamais à leur destination, au train dont elles vont, et le spectacle des bateaux qui attendent leur tour à une écluse offre un bel exemple de la facilité avec laquelle on prend la vie. Il devrait y avoir beaucoup d’esprits satisfaits à bord des bateaux; car mener une telle vie, c’est voyager tout en restant chez soi.
La cheminée fume pour le dîner à votre passage; les berges du canal déroulent lentement leur paysage aux yeux contemplatifs; le bateau flotte à travers de grandes forêts, à travers de grandes cités, avec leurs monuments publics et leurs lampes, le soir, et pour le batelier qui, dans sa demeure flottante, voyage sans bouger de son lit, c’est absolument comme s’il écoutait l’histoire d’un autre homme, ou comme s’il 34 tournait les pages d’un livre d’images, dans lequel ses intérêts ne sont pas en jeu.
Il peut faire sa promenade de l’après-midi en quelque pays étranger, sur les berges du canal, et revenir ensuite chez lui dîner au coin de son feu.
Dans une pareille existence, on ne prend pas assez d’exercice pour jouir d’une santé exubérante; mais les gens maladifs seuls ont besoin d’une santé exubérante. L’individu apathique, qui ne se porte jamais ni bien ni mal, va dans la vie son petit bonhomme de chemin et n’en meurt que plus aisément.
A coup sûr, je préférerais le métier de batelier à n’importe quelle position qui nécessiterait une présence assidue dans un bureau. Il y a peu de situations, devrais-je dire, où l’on abandonne moins de sa liberté en échange de repas réguliers. Le batelier est à bord; il est maître sur son bateau; il peut débarquer quand il veut; rien ne peut le forcer à courir des bordées pour éviter une terre sous le vent, pendant toute 35 une nuit de gelée, où les voiles sont aussi dures que du fer; et, autant que j’en puis juger, le temps s’écoule pour lui aussi tranquillement que le permet le retour de l’heure du coucher ou du dîner. On ne voit pas aisément pourquoi un batelier devrait jamais mourir.
A mi-route, entre Willebroeck et Vilvorde, dans un endroit où le canal, tel que l’avenue d’un châtelain, s’étendait devant nous en une perspective magnifique, nous descendîmes à terre pour goûter. Il y avait deux œufs, un chanteau de pain et une bouteille de vin, à bord de l’Aréthuse; et deux œufs, ainsi qu’un fourneau Etna, à bord de la Cigarette. Le maître de ce dernier bateau cassa un des œufs au cours du débarquement; mais, faisant observer plaisamment qu’on pouvait encore le faire cuire «à la papier», il le mit dans le fourneau sans le retirer du journal flamand qui l’enveloppait. Nous avions débarqué pendant un moment de beau temps; mais il n’y avait pas deux minutes que nous étions à terre que le vent fraîchit, au 36 point de devenir une demi-tempête, et que la pluie commença à nous fouetter les épaules. Nous nous assîmes aussi près que possible de l’Etna, dont l’alcool brûlait à grandes flammes. A chaque instant, l’herbe prenait feu et nous devions l’éteindre en la piétinant. Nous ne tardâmes pas à avoir plusieurs brûlures aux doigts. Mais la quantité de nourriture substantielle produite par notre cuisine n’était pas en proportion avec tant d’efforts. Et quand après deux essais de cuisson, nous renonçâmes à la partie, l’œuf qui était intact était un peu plus que tiède, tandis que l’autre «à la papier» ne formait qu’une froide et dégoûtante fricassée d’encre d’imprimerie et de débris de coquille d’œuf. Nous trouvâmes moyen de cuire les deux autres œufs, en les mettant tout contre la flamme de l’alcool; nous obtînmes cette fois un meilleur résultat. Puis, nous débouchâmes la bouteille de vin et nous nous assîmes sur le bord d’un fossé, nos tabliers de canoë sur les genoux. Il pleuvait à verse. Le manque de confort, 37 quand il n’est vraiment pas confortable, et n’a pas la prétention nauséabonde de l’être, est une chose excessivement humoristique; et des gens tout trempés et bien abrutis au grand air sont en d’excellentes dispositions pour rire. En se plaçant à ce point de vue, l’œuf à la papier même offert en guise de nourriture, peut passer comme une sorte d’accessoire à la plaisanterie. Mais ce genre de badinage, bien qu’il puisse se prendre en bonne part, ne demande pas à être répété; et, dorénavant, l’Etna voyagea comme un monsieur dans l’équipet de la Cigarette.
A peine avions-nous fini de goûter, repris place dans nos embarcations et mis à la voile que le vent, il est presque inutile de le dire, ne tarda pas à tomber. Pendant le reste du trajet jusqu’à Vilvorde, nous continuâmes à présenter notre voile au vent peu favorable, et, avec de temps en temps, une bouffée de brise, et de temps en temps, un coup de pagaie, nous dérivâmes lentement d’écluse en écluse entre les rangées d’arbres bien en ordre.
38
C’était un riche et magnifique paysage vert ou plutôt un simple chemin d’eau tout vert, allant sans interruption de village en village. Tout avait un air stable, comme dans les endroits habités depuis longtemps. Des enfants aux cheveux ras crachaient sur nous du haut des ponts, comme nous passions en dessous, avec un réel sentiment d’impassibilité. Mais, encore plus impassibles étaient les pêcheurs; attentifs à leurs flottes, ils nous laissaient passer sans un regard. Livrés à leur paisible occupation, ils se tenaient perchés sur les éperons et les arcs-boutants des ponts et le long des berges. Ils étaient aussi indifférents que des fragments de nature morte. Ils ne bougeaient pas plus que s’ils avaient été en train de pêcher dans une vieille estampe hollandaise. Les feuilles s’agitaient, l’eau clapotait, mais ils restaient dans la même position comme autant d’églises établies par la loi. On aurait pu trépaner la tête de chacun de ces inoffensifs pêcheurs sans trouver sous leur crâne autre chose que les replis multiples d’une ligne 39 à pêcher. Je me moque bien de vos solides gaillards en guêtres de caoutchouc, qui remontent les torrents de montagne, la ligne à saumon en main; mais j’aime tendrement cette sorte de gens qui exercent, pendant des journées entières, leur art peu fructueux dans des eaux tranquilles et dépeuplées.
A la première écluse après Vilvorde, il y avait une éclusière qui parlait français d’une façon compréhensible. Elle nous apprit que nous étions encore à une couple de lieues de Bruxelles. Au même endroit, la pluie recommença. Elle tombait en lignes droites et parallèles, et la surface du canal était criblée d’une infinité de petites sources de cristal. Impossible de trouver à coucher dans le voisinage. Il ne nous restait donc qu’à enlever la voile et à jouer ferme de la pagaie sous la pluie.
De magnifiques maisons de campagne avec des horloges et de longues rangées de fenêtres à volets, avec de superbes arbres séculaires, formant des bosquets et des avenues, donnaient 40 sous la pluie et dans l’obscurité croissante du crépuscule, un aspect riche et sombre aux rives du canal. Il me semble avoir vu à peu près le même effet dans des gravures: d’opulents paysages abandonnés, au dessus desquels passe un orage. Et, tout le temps, nous fûmes escortés par une charrette couverte, qui trottait misérablement le long du chemin de halage et se maintenait à une distance presque uniforme dans notre sillage.
La pluie cessa près de Laeken. Mais le soleil était déjà couché; l’air était glacé et nous avions à peine un fil de sec à nous deux. Qui plus est, nous nous trouvions à présent au bout de l’Allée Verte, et au seuil même de Bruxelles nous nous heurtâmes à une sérieuse difficulté. Les rives du canal étaient bordées d’une file ininterrompue de péniches, qui attendaient leur tour à l’écluse. Nulle part on ne pouvait trouver un endroit propice pour débarquer; pas même un hangar où laisser les canoës pour la nuit. Non sans peine, nous réussîmes à débarquer et nous entrâmes dans un estaminet où quelques pauvres hères étaient à boire avec le patron. Celui-ci y alla carrément avec nous. Il n’y avait à sa connaissance aucune remise, aucun hangar, ni 42 rien de ce genre; et voyant que nous étions venus sans intention de boire, il ne cacha pas son impatience d’être débarrassé de nous. L’un des pauvres diables vint à la rescousse. Quelque part dans le coin du bassin il y avait, nous dit-il, un embarcadère et quelque chose d’autre encore qu’il ne définit pas très clairement, mais que ses auditeurs interprétèrent dans un sens favorable à leurs désirs.
Au coin du bassin se trouvait réellement l’embarcadère, au haut duquel nous aperçûmes deux jeunes gens de bonne mine en costume de canotage. L’Aréthuse s’adressa à eux. L’un des deux dit que nous pourrions remiser nos bateaux chez eux pour la nuit, que cela ne souffrait pas la moindre difficulté; et l’autre, ôtant sa cigarette de ses lèvres, demanda si nos embarcations sortaient des chantiers de Searle et fils. Ce nom fut toute une présentation. Une demi-douzaine d’autres jeunes gens sortirent d’un «garage» portant l’inscription «Royal sport nautique» et se mêlèrent à la conversation. 43 Ils étaient tous très polis, pleins d’enthousiasme, parlaient avec volubilité, et entrelardaient leur langage de termes anglais de canotage, de noms de clubs anglais et de constructeurs de bateaux anglais. Je ne connais, je l’avoue à ma honte, aucun endroit dans mon pays natal, où j’aurais été reçu aussi chaleureusement par autant de gens. Nous étions des canotiers anglais, et les canotiers belges se jetaient à notre cou. Je me demande si les Huguenots français reçurent un accueil aussi cordial des protestants anglais, quand l’adversité les força à passer le détroit. Mais, après tout, quelle religion unit si étroitement les gens qu’un sport qui leur est commun?
On transporta les canoës dans le garage. Les domestiques du club nous les lavèrent à fond, suspendirent les voiles au grand air pour les faire sécher et arrangèrent tout aussi soigneusement et aussi délicatement que s’il se fût agi d’un tableau. Pendant ce temps, nos frères «récemment découverts», car tel est le nom 44 que plusieurs d’entre eux donnèrent à cette parenté, nous conduisaient à l’étage et mettaient leur cabinet de toilette à notre entière disposition. Celui-ci nous prêtait du savon, celui-là une serviette, un troisième et un quatrième nous aidaient à défaire nos sacs. Et tout le temps c’étaient des questions et des assurances de respect et de sympathie à n’en plus finir! Je déclare que jamais auparavant je n’avais su ce que c’était que la gloire.
«Oui, oui, le Royal Sport nautique est le club le plus ancien de la Belgique».
«Nous sommes deux cents».
«Nous—ceci n’est pas la substance d’un discours, mais un résumé de nombreux discours, l’impression que mon esprit a gardée après maintes conversations; et elle me paraît tout à fait sentir la jeunesse; elle me paraît être très agréable, très naturelle et très patriotique.—«Nous avons gagné toutes les courses, à part celles où les Français nous ont trichés».
Il faut laisser ici tous vos vêtements mouillés 45 pour les faire sécher. Oh! entre frères! Dans n’importe quel garage d’Angleterre nous trouverions le même accueil. (J’espère de tout mon cœur qu’ils le pourraient trouver).
«En Angleterre, vous employez des sliding-seats, n’est-ce-pas?»
«Nous sommes tous employés dans le commerce pendant le jour, mais le soir, voyez-vous, nous sommes sérieux».
Ce furent leurs paroles mêmes. Ils consacraient le jour aux frivoles intérêts mercantiles de la Belgique; mais le soir, ils trouvaient quelques heures pour les occupations sérieuses de la vie. Peut-être me fais-je une idée fausse de la sagesse; mais il me semble que c’était là une remarque fort sage. Les gens qui s’occupent de littérature et de philosophie passent toute leur existence à s’affranchir des notions de seconde main et des règles fausses. C’est leur profession de recouvrer, à la sueur de leur front, à force de méditation, la fraîche vue qu’ils avaient autrefois de la vie; d’établir une 46 distinction entre ce qu’ils aiment réellement et originellement et ce qu’ils n’ont fait qu’apprendre à tolérer par force. Et les jeunes gens du Royal Sport nautique portaient encore la distinction très visiblement dans le cœur. Ils avaient encore ces perceptions nettes de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, de ce qui est intéressant et de ce qui est ennuyeux, qualifiées d’illusions par les vieillards envieux. L’illusion de cauchemar de l’âge mûr, l’étreinte d’ours de l’habitude exprimant graduellement la vie de l’âme d’un homme, n’avaient pas encore eu de prise sur ces jeunes Belges, nés sous une heureuse étoile. Ils savaient encore que l’intérêt qu’ils prenaient à leurs affaires, était bien peu de chose, au prix de leur amour spontané et patient pour les exercices nautiques. Si vous savez ce que vous préférez, au lieu de répondre humblement Amen à ce que, selon le monde, vous devez préférer, c’est que vous avez gardé votre âme en vie. Un pareil homme pourra être généreux; il pourra être honnête, au-delà de ce 47 qu’on entend au sens commercial du mot; il pourra aimer ses amis avec une sympathie élective, personnelle, au lieu de les accepter comme des accidents de la position à laquelle il a été appelé. Il pourra être un homme, en un mot, agissant selon ses propres instincts, demeurant tel que Dieu l’a fait, et non une pure manivelle dans la salle aux machines sociales, soudée à des principes qu’il ne comprend pas et pour des fins dont il n’a cure.
Car, se trouvera-t-il quelqu’un pour oser me dire qu’il est plus intéressant de faire des affaires que de folâtrer au milieu des bateaux? Il faudrait n’avoir jamais vu un canot, n’avoir jamais vu un bureau, pour parler ainsi. Et, pour sûr, l’un est beaucoup meilleur que l’autre pour la santé. Rien ne devrait occuper un homme autant que ses amusements. A l’encontre de ceci, on ne peut rien avancer que la soif de l’or; nul autre que:
Mammon, l’esprit le moins élevé qui tomba
Du ciel,
48
n’oserait hasarder un mot de réponse. Il n’y a qu’un "cant" mensonger pour représenter le négociant et le banquier comme des gens peinant d’une façon désintéressée pour l’humanité, et, par conséquent, fort utiles lorsqu’ils sont bien absorbés dans leurs transactions; car l’homme est plus important que ses services. Et lorsque notre membre du Royal Sport nautique aura vu disparaître si loin sa jeunesse pleine d’espoir, qu’il ne pourra plus exalter son enthousiasme qu’en feuilletant son grand-livre, je doute fort qu’il soit encore un aussi brave garçon et j’hésite à croire qu’il accueillerait d’aussi bonne grâce deux Anglais trempés, arrivant à Bruxelles, en canoë, à la brune.
Lorsque nous eûmes changé nos vêtements mouillés et bu un verre de «pale ale» à la prospérité du club, l’un des membres nous conduisit à l’hôtel. Il ne voulut pas dîner avec nous, mais il accepta sans objection de prendre un verre de vin avec nous. L’enthousiasme est chose très ennuyeuse; et je commence à comprendre 49 pourquoi les prophètes furent impopulaires en Judée, où ils étaient le mieux connus. Pendant trois mortelles heures, cet excellent jeune homme resta près de nous à causer longuement de bateaux et de régates; et, avant de nous quitter, il eut l’obligeance de commander nos chandelles pour la nuit.
Nous essayâmes, à plusieurs reprises, de changer de sujet; mais la diversion durait un instant à peine. Le membre du Royal Sport Nautique serrait la bride, faisait un écart, répondait à la question et fonçait de nouveau dans le flot gonflant de son sujet. J’appelle cela son sujet; mais je crois plutôt que c’est lui qui était le sujet. L’Aréthuse, qui considère toutes les courses comme des inventions du diable, se trouvait dans un dilemme pitoyable. Il n’osait avouer son ignorance par amour pour l’honneur de la vieille Angleterre, et il parlait hardiment de clubs et de rameurs anglais, dont la réputation n’était jamais venue jusqu’à lui. A plusieurs reprises et surtout une fois à propos 50 de «sièges à glissières», il fut à deux doigts de se trahir. Quant à la Cigarette, qui avait ramé dans des régates lorsqu’il avait le sang bouillant, mais qui désavoue à présent ces erreurs de sa folle jeunesse, il se trouvait dans un cas encore plus désespéré; car le jeune homme du Royal Sport Nautique lui proposa de prendre une rame dans un de leurs «huit» le lendemain, pour comparer le coup d’aviron anglais au coup d’aviron belge. Je voyais mon ami suer sang et eau sur sa chaise, chaque fois que ce sujet particulier revenait sur le tapis. Et il y eut encore une autre proposition, qui produisit le même effet sur chacun de nous. Il se trouvait que le champion du canoë en Europe (comme la plupart des autres champions) était un membre du Royal Sport Nautique. Et, si nous voulions seulement attendre le dimanche, cet infernal pagayeur condescendrait à nous accompagner dans notre prochaine étape. Mais nous n’avions, ni l’un ni l’autre, 51 le moindre désir de rivaliser avec Apollon, à conduire les coursiers du soleil.
Une fois le jeune homme parti, nous contremandâmes nos chandelles et nous commandâmes un grog à l’eau-de-vie. Les grandes vagues avaient passé par dessus notre tête. Les membres du Royal Sport Nautique étaient des jeunes gens aussi gentils qu’on puisse souhaiter d’en voir; mais ils étaient un peu trop jeunes et un tantinet trop amoureux de sports nautiques, pour nous. Nous commencions à nous apercevoir que nous étions vieux et cyniques; nous aimions le bien-être; nous aimions le vagabondage agréable de l’esprit sur tel ou tel sujet. Nous ne tenions pas à jeter du discrédit sur notre patrie en gâchant un «huit» ou en peinant piteusement dans le sillage du champion du canoë. Bref, nous eûmes recours à la fuite. Il semblait que ce fût ingrat d’agir ainsi; mais, pour tâcher de rendre ce départ acceptable, nous laissâmes une carte chargée de sincères compliments. Et en vérité, 52 ce n’était pas le moment d’avoir des scrupules; car nous croyions nous sentir sur le cou le souffle brûlant du champion.
Par crainte de nos bons amis les membres du Royal Sport Nautique d’une part, et, de l’autre, parce qu’il n’y avait pas moins de cinquante-cinq écluses entre Bruxelles et Charleroi, nous décidâmes de traverser la frontière en chemin de fer, bateaux et tout. Franchir cinquante-cinq écluses en un jour, cela revenait presque à faire péniblement tout le trajet à pied, les canoës sur nos épaules, objet d’étonnement pour les arbres qui bordent le canal et de franche dérision pour tous les enfants sensés.
Passer la frontière, même en chemin de fer, est chose malaisée pour l’Aréthuse. D’une manière ou d’une autre, c’est un homme qui éveille les soupçons de la douane. Partout où il voyage il est sûr de trouver les douaniers assemblés. Des traités sont solennellement signés, des 54 ministres des affaires étrangères, des ambassadeurs et des consuls règnent en grande pompe de la Chine au Pérou, et le pavillon anglais flotte à tous les vents du ciel. Sous ces sauvegardes, les gras bénéficiers de l’Eglise, les maîtresses d’école, les messieurs en complet gris, la foule tumultueuse et la cohue des touristes anglais, le Murray à la main, se répandent librement sur tous les chemins de fer du continent. Et cependant, la fluette personne de l’Aréthuse est prise dans les mailles du filet, tandis que ces gros poissons continuent joyeusement leur route. S’il voyage sans passe-port, il est jeté, sans autre forme de procès, dans d’infects cachots. Si ses papiers sont en règle, certes, on lui permet de continuer son chemin: mais il n’obtient cette permission qu’après avoir subi l’humiliation d’une incrédulité générale. Il est né sujet anglais; il n’a cependant jamais réussi à persuader de sa nationalité un seul fonctionnaire. Il se flatte d’être assez honnête; il est rare, néanmoins, qu’on le prenne pour autre 55 chose qu’un espion, et il n’est pas d’absurdes et de malhonnêtes moyens de subsistance que ne lui ait attribués la grande méfiance des fonctionnaires ou du peuple.
Sur ma vie, je ne puis comprendre cela. Moi aussi, j’ai été appelé à l’église par le son des cloches, je me suis assis à la table des grands; mais rien en moi ne l’indique. Pour les lunettes des fonctionnaires, j’ai l’air aussi extraordinaire qu’un gueux d’Indien. Je pourrais venir de n’importe quelle partie du globe, semble-t-il, à part de celle d’où je viens. Mes ancêtres ont travaillé en vain et la glorieuse constitution anglaise ne peut me protéger dans mes promenades à l’étranger. C’est une chose très importante, croyez-moi, que d’offrir dans sa personne un bon type normal de la nation à laquelle on appartient.
Je fus le seul des voyageurs à qui l’on demanda ses papiers, sur la ligne de Maubeuge. Malgré l’énergie avec laquelle je me cramponnais à mes droits, il me fallut finalement choisir entre 56 ces deux alternatives: ou accepter l’humiliation, ou voir le train partir sans moi. J’étais désolé de céder; mais je désirais arriver à Maubeuge.
Maubeuge est une ville fortifiée avec un excellent hôtel, le Grand Cerf. Elle semblait être habitée surtout par des soldats et des commis voyageurs. Du moins, ce furent les seules personnes que nous vîmes, outre les domestiques de l’hôtel. Nous dûmes y rester quelque temps, car les canoës ne se pressaient pas de nous suivre et se trouvèrent en fin de compte désespérément retenus à la douane, jusqu’au moment où nous retournâmes les délivrer. Il n’y avait rien à faire, rien à voir. Nous eûmes de bons repas, ce qui est très important, mais ce fut tout.
La Cigarette faillit être arrêté. On l’accusait d’avoir pris des plans des fortifications, chose dont il était matériellement incapable. Et en outre, comme chaque nation belligérante a déjà un plan des places fortifiées des autres puissances, de telles précautions reviennent à fermer la porte de l’écurie quand le coursier est parti. 57 Mais je ne doute pas qu’elles ne contribuent à maintenir la confiance dans le pays. C’est beaucoup de pouvoir persuader aux gens qu’ils partagent un mystère. Cela les rehausse à leurs yeux. Les Francs-maçons même, qu’on a exhibés à satiété, conservent une sorte d’orgueil; et il n’est pas un épicier parmi eux, si honnête, inoffensif et inintelligent qu’il puisse au fond se sentir, qui à son retour d’une de leurs tenues, n’ait à ses propres yeux une importance sinistre.
On ne s’imagine pas quel bonheur peuvent éprouver deux personnes, pourvu toutefois qu’elles soient deux, à vivre dans un endroit où elles ne connaissent pas une âme. Je pense que le spectacle de toute une existence, à laquelle vous ne prenez aucune part, paralyse les désirs personnels. Vous êtes heureux de devenir simple spectateur. Le boulanger est debout à sa porte; le colonel, avec ses trois médailles, passe le soir, allant au café. Les soldats battent du tambour, sonnent de la trompette, et tous, aussi 58 audacieux que des lions, garnissent les remparts. Le langage ne saurait exprimer avec quelle sérénité vous contemplez tout ceci. Dans un endroit où vous avez tant soit peu pris racine, le spectacle vous provoque à sortir de votre indifférence: vous êtes pour quelque chose dans la partie; vos amis combattent avec l’armée. Mais dans une ville étrangère, ni assez petite pour devenir trop tôt familière, ni assez grande pour offrir aux voyageurs toutes les commodités de la vie, vous êtes à l’écart des affaires, au point d’oublier absolument que vous pouvez en approcher davantage. Vous ressentez si peu d’intérêt pour le monde qui vous entoure, que vous ne vous souvenez plus que vous êtes un homme. Les Gymnosophistes vivent dans les bois avec toute la nature qui fermente autour d’eux, avec de tous côtés le mystère du roman; ils atteindraient plus facilement leur but en fixant leur séjour dans une morne ville de province, où ils verraient juste assez de l’humanité pour les garder d’en désirer davantage, et ne seraient 59 témoins que des pratiques extérieures rebattues de la vie de l’homme. Ces pratiques extérieures sont aussi mortes pour nous que tant d’autres formalités et parlent une langue morte à nos yeux et à nos oreilles. Elles n’ont pas plus de signification que des jurons ou des salutations. Nous sommes tellement accoutumés à voir les couples mariés aller à l’église le dimanche, que nous avons complètement oublié ce qu’ils représentent; si bien que les romanciers sont conduits à réhabiliter l’adultère, quand ils veulent nous montrer combien il est beau pour un homme et pour une femme de vivre l’un pour l’autre.
Une personne à Maubeuge me permit pourtant de sonder un peu son cœur. Ce fut le cocher de l’omnibus de l’hôtel. C’était un petit homme, l’air assez vulgaire, aussi bien que je puis me le rappeler, mais avec une étincelle de quelque chose d’humain dans l’âme. Il avait entendu parler de notre petit voyage et il vint immédiatement à moi plein d’envie et de sympathie. Oh! comme il aspirait à voyager et à faire le 60 tour du monde avant de descendre au tombeau! «Vous me voyez ici, n’est-ce-pas? Je conduis l’omnibus à la station. Bon! Et ensuite, je le reconduis à l’hôtel. Et c’est la même chose chaque jour et pendant toute la semaine. Mon Dieu! est-ce là la vie?» Je ne pouvais pas dire qu’à mon sens telle était la vie pour lui. Il me pressa de lui raconter où j’avais été et où j’espérais aller. Et tout en m’écoutant, le gaillard, je vous le déclare, soupirait. Est-ce que cet homme n’aurait pas pu être un vaillant explorateur en Afrique? N’aurait-il pas pu aller aux Indes à la suite de Drake? Mais ce siècle est peu propice aux hommes que la vie de bohème attire. Il n’y a que le parfait rond-de-cuir pour faire fortune et acquérir de la gloire.
Je me demande si mon ami conduit toujours l’omnibus pour le Grand Cerf! Il est très probable que non, je crois. Car je pense qu’il était à la veille de se mutiner quand nous passâmes; et peut-être notre passage le détermina-t-il pour tout de bon. Il eut mille fois mieux valu pour 61 lui être un chemineau, raccommoder des pots et des casseroles sur le bord du chemin, dormir sous les arbres et voir chaque jour le soleil se lever et se coucher au-dessus d’un nouvel horizon. Il me semble vous entendre dire que c’est une position respectable que d’être conducteur d’omnibus. Parfait! Quel droit celui qui n’aime pas cette position respectable a-t-il d’empêcher de l’occuper celui qui en est fort amateur? Mais supposez qu’un plat ne soit pas à mon goût et que vous me disiez que pour le reste de la société c’est un mets favori; que devrais-je conclure de cela? Qu’il ne me faudrait pas, je suppose, achever de le manger malgré la répugnance de mon estomac.
La respectabilité est une excellente chose en elle-même; mais elle ne prime pas sur toutes les considérations. Je ne voudrais pas un instant me risquer à laisser entendre que ce soit affaire de goût; mais j’oserai aller jusqu’à affirmer ceci: si on admet que pour quelqu’un une position est pénible, désagréable, qu’elle n’est pas 62 nécessaire, que de plus elle est inutile, quand bien même elle serait aussi respectable que l’Eglise d’Angleterre, plus tôt un homme l’aura quittée, mieux cela vaudra pour lui-même et pour tous les intéressés[1].
Vers trois heures de l’après-midi, tout le personnel du Grand Cerf nous accompagna au bord de l’eau. Le conducteur de l’omnibus y était, les yeux hagards. Pauvre oiseau de cage! Est-ce que je ne me rappelle pas, moi aussi, le temps où je fréquentais la station pour voir les trains s’élancer en grand nombre dans la nuit, bondés d’hommes libres, et où, avec d’indescriptibles envies, je lisais sur les horaires les noms d’endroits éloignés.
Nous n’étions pas hors des fortifications qu’il commençait à pleuvoir. Le vent était contraire et soufflait par furieuses rafales; et le spectacle que présentait le pays n’était pas plus clément que ce qui se passait dans le ciel; car nous traversions un pays flétri, que des broussailles 64 couvraient çà et là, mais auquel des cheminées d’usine donnaient quelque variété et quelque beauté. Nous débarquâmes dans une prairie souillée au milieu de quelques arbres étêtés, et nous y fumâmes une pipe dans une échappée de beau temps. Mais le vent soufflait si fort que nous ne pûmes allumer une autre pipe. A part quelques sordides ateliers, il n’y avait dans le voisinage aucun objet naturel. Un groupe d’enfants conduit par une grande fille, demeura à nous observer à peu de distance tout le temps que nous restâmes. Je me demande ce qu’ils pouvaient bien penser de nous.
A Hautmont, l’écluse était presque infranchissable, le débarcadère étant escarpé et élevé, et l’embarcadère très éloigné. Une dizaine d’ouvriers, noirs de fumée, nous donnèrent un coup de main. Ils refusèrent toute récompense et ce qui est bien mieux, refusèrent noblement, sans que cela comportât la moindre idée d’insulte. «C’est notre façon d’agir dans notre pays», dirent-ils, et je trouve cette façon d’agir 65 tout à fait admirable. En Ecosse, où l’on vous rendra également des services gratis, les braves gens repoussent votre argent comme si vous aviez essayé de corrompre un électeur. Quand des gens se donnent la peine d’accomplir un acte plein de dignité, cela mérite bien qu’on généralise un peu cet acte et qu’on admette que tous ceux qui se seraient trouvés dans le même cas auraient agi d’une façon aussi digne. Mais dans nos braves pays saxons, où nous pataugeons dans la boue pendant soixante-dix ans, et où le vent chante sans cesse à nos oreilles depuis notre naissance jusqu’à notre mort, nous faisons le bien et le mal, la main haute et d’une façon presque offensante, et nous donnons, même à nos aumônes, la portée d’un témoignage et d’un fait de guerre contre le mal.
Après Hautmont, le soleil reparut et le vent tomba. Quelques coups de pagaie nous portèrent au-delà des établissements métallurgiques et nous traversâmes un pays ravissant. La rivière serpentait parmi de basses collines, de 66 sorte que nous avions le soleil parfois devant, parfois derrière, et la rivière qui se déroulait sous nos yeux formait une nappe d’eau d’un éclat intolérable. Des prairies et des vergers occupaient les deux rives qui étaient bordées de joncs et de fleurs aquatiques. Les haies très élevées, s’entrelaçaient avec des troncs d’ormeaux et la plupart des champs, par suite de leur peu d’étendue, avaient l’air de berceaux qui s’étageaient le long du cours d’eau. Il n’y avait jamais de perspective. Parfois, le sommet d’une colline apparaissait au-dessus de la haie la plus proche et formait une étape à mi-route du ciel; mais c’était tout. Le ciel était sans nuages. L’atmosphère, après la pluie, était d’une pureté ravissante. La rivière comme un miroir qui s’allongerait en une longue coulée de verre, décrivait de nombreux détours parmi les hauteurs; et les pagaies, en plongeant dans l’eau, faisaient trembler les fleurs le long des bords.

La rivière comme un miroir qui s’allongerait... (page 66).
Dans les prairies vaguaient des bestiaux blancs et noirs, fantastiquement tachetés. Une 69 bête avec la tête blanche et le reste du corps d’un noir luisant, vint au bord pour boire et resta gravement immobile, pointant ses oreilles vers moi à mon passage, semblable à quelque absurde ecclésiastique, dans une pièce de théâtre. Un instant après, j’entendis un bruyant plongeon, et, tournant la tête, j’aperçus l’ecclésiastique qui luttait pour remonter sur la rive. La bordure avait cédé sous ses pieds.
A part les bestiaux, nous ne vîmes aucun être vivant, si ce n’est quelques rares oiseaux et un grand nombre de pêcheurs. Ceux-ci étaient assis sur les bords des prairies qui longent la rivière, les uns avec une seule ligne, les autres avec une demi-douzaine au moins. Ils avaient l’air stupéfiés de béatitude; et quand nous les amenions à échanger quelques rares paroles avec nous sur le temps qu’il faisait, leurs voix résonnaient tranquilles et lointaines. Il y avait parmi eux une étrange diversité d’opinions sur le genre de poissons auxquels ils destinaient leurs amorces, mais ils s’accordaient tous à dire 70 que la rivière était très poissonneuse. Là où évidemment il n’y avait pas deux d’entre eux qui eussent attrapé le même genre de poissons, nous ne pouvions nous empêcher de soupçonner qu’il n’en était pas un peut-être qui eût jamais pris la moindre friture. J’espère que grâce à la beauté de cette après-midi, ils furent récompensés, tous sans exception, et qu’ils retournèrent chez eux, emportant dans leurs paniers un butin argenté pour la poêle à frire. Quelques-uns de mes amis diront peut-être qu’un tel vœu est une honte, mais je préfère un homme, ne fut-il qu’un pêcheur, à la plus superbe paire d’ouïes de toutes les eaux de Dieu. Je n’aime le poisson que quand il est cuit dans la sauce; tandis qu’un pêcheur à la ligne est une partie très importante d’un paysage de rivière et par conséquent mérite bien que les canotiers daignent le reconnaître. Il peut toujours vous dire, d’un air doux, où vous vous trouvez et sa présence tranquille sert à accentuer la solitude et le calme et à vous rappeler 71 les citoyens étincelants qui vivent sous votre bateau.
La Sambre serpentait si laborieusement çà et là parmi ses petites collines, qu’il était six heures passées quand nous approchâmes de l’écluse de Quartes. Sur le chemin de halage se trouvaient quelques enfants, avec lesquels la Cigarette se mit à plaisanter pendant qu’ils nous accompagnaient à la course. Ce fut en vain que je l’avertis. En vain lui dis-je en anglais que les gamins sont tout ce qu’il y a de plus dangereux au monde. Une fois que vous avez commencé à plaisanter avec eux, vous êtes bien sûr que cela se terminera par une grêle de pierres. Pour ma part, toutes les fois qu’une observation s’adressait à moi, je souriais doucement et hochais la tête, comme si j’étais quelqu’un d’inoffensif, n’ayant de la langue française qu’une connaissance insuffisante. Car, en vérité, j’ai acquis dans mon pays une telle expérience des enfants que j’aimerais mieux faire la rencontre d’une 72 troupe d’animaux sauvages que d’une bande de vigoureux moutards.
Mais je faisais injure à ces paisibles jeunes Hennuyers. Quand la Cigarette partit aux informations, je débarquai sur la digue, pour fumer une pipe, tout en veillant sur les bateaux, et je devins immédiatement l’objet de la plus aimable curiosité. A cette heure une jeune femme et un paisible adolescent qui avait perdu un bras s’étaient joints aux enfants. Cela me rassura un peu. Quand je prononçai mes deux ou trois premiers mots de français, une petite fille hocha la tête comme une grande personne avec une comique gravité: «Ah! vous voyez, dit-elle; il comprend suffisamment bien, à présent, c’était tout simplement pour nous en faire accroire.» Et les enfants de partir tous à la fois d’un franc éclat de rire.
La nouvelle que nous venions d’Angleterre fit sur eux une vive impression et la petite fille leur apprit que l’Angleterre était une île, «et bien loin d’ici.»
73
«Oui, vous pouvez le dire, bien loin d’ici,» ajouta le manchot.
Je n’ai jamais senti le mal du pays me serrer le cœur aussi douloureusement qu’à ce moment. Ils semblaient considérer comme si incalculable la distance qui me séparait de l’endroit où j’ai vu le jour!
Ils admirèrent beaucoup les canoës et j’observai chez ces enfants un trait de délicatesse qui mérite d’être mentionné. Désireux de monter en canoë, ils nous avaient assourdis de leurs demandes pendant les derniers cent mètres; et ils nous assourdirent de la même chanson le lendemain, quand nous arrivâmes pour partir. Mais, au moment où les canoës se trouvaient vides, pas un n’ouvrit la bouche pour faire pareille demande. Délicatesse? ou légère appréhension de l’eau peut-être, dans un si frêle esquif? Je hais le cynisme beaucoup plus que le diable; à moins peut-être que les deux ne fassent qu’un. Et cependant le cynisme est un bon tonique; c’est le «tub» froid et la serviette 74 de bain des sentiments, et il est assurément nécessaire à la vie dans les cas de sensibilité trop avancée.
Des bateaux, leurs yeux se portèrent sur mon costume. Ils n’avaient pas assez d’yeux pour regarder ma ceinture rouge, et mon couteau les remplissait de crainte.
«C’est ainsi qu’on fait les couteaux en Angleterre», dit le manchot.
J’étais bien aise qu’il ne sût pas comme on les fait mal de nos jours en Angleterre.
«Ces couteaux sont destinés aux gens qui vont en mer, ajouta-t-il, pour défendre leur vie contre les gros poissons.»
A mesure qu’il parlait, je me sentais devenir aux yeux du petit groupe un personnage de plus en plus romanesque. Et je suppose qu’il en était réellement ainsi. Ma pipe même, bien que ce fut une pipe française en terre et toute ordinaire, assez bien «culottée», comme ils appellent cela en France, était une rareté à leurs yeux, comme une chose venant de si 75 loin. Et si mes plumes n’étaient pas très belles en elles-mêmes, au moins venaient-elles toutes d’outre-mer. Cependant, un détail de mon accoutrement piqua leur curiosité jusqu’à leur faire oublier toute politesse: c’était la malpropreté de mes souliers de toile. Je suppose, quoi qu’il en soit, qu’ils s’imaginaient que la boue était un produit de mon pays. La petite fille (qui était le génie de la bande) étala ses sabots pour les comparer à mes souliers; et j’aurais voulu que vous pussiez voir avec quelle grâce et quelle satisfaction elle le fit.
La «canne» à lait de la jeune femme, une grande amphore de cuivre battu, reposait à quelque distance sur le gazon. Bien aise de me dérober à l’attention publique, et de rendre une partie des compliments que j’avais reçus, je l’admirais de tout cœur, autant pour sa forme que pour sa couleur et je leur dis, ce qui était très vrai, que c’était aussi beau que de l’or. Ils ne furent pas surpris. Ces objets était évidemment l’orgueil 76 du pays. Et les enfants s’étendirent sur la cherté de ces amphores, dont le prix s’élève parfois jusqu’à trente francs pièce. Ils m’expliquèrent comment les ânes les portaient une de chaque côté d’un bât, ce qui faisait un harnais assez coquet en soi-même. On pouvait voir ces amphores, ajoutèrent-ils, dans tout l’arrondissement; et dans les grosses fermes, elles étaient nombreuses et de grande taille.
Nous sommes des Marchands
La Cigarette revint avec de bonnes nouvelles. On pouvait avoir à loger à quelque dix minutes de l’endroit où nous étions, dans un village appelé Pont. Nous remisâmes les canoës dans un grenier et nous demandâmes aux enfants si l’un d’entre eux voulait bien nous servir de guide. Le cercle s’élargit instantanément autour de nous et nos offres de récompense furent reçues dans un silence décourageant. Nous étions évidemment une paire de Barbe bleues pour les enfants; ils nous parlaient bien dans les endroits publics et là où ils avaient l’avantage du nombre; mais c’était une autre paire de manches de se risquer à s’en aller seul avec deux personnages, ayant à leurs yeux quelque chose des monstres de légende tombés du 78 ciel sur leur hameau par cette tranquille après-midi, un couteau à la ceinture et sentant les grands voyages. Le propriétaire du grenier vint à notre aide. Il prit à part un petit garçon et le menaça de lui donner des coups; sans cela, nous aurions dû, je suppose, trouver notre chemin nous-mêmes. Quoi qu’il en soit, comme il avait déjà sans doute tâté des taloches de cet homme, l’enfant parut en avoir plus de crainte que des étrangers. Mais j’imagine que son petit cœur devait battre de la belle façon; car il ne cessa de trotter devant nous à une distance respectueuse, et de se retourner pour jeter sur nous des regards effrayés. Les enfants dans l’antiquité n’ont pas dû guider autrement Jupiter ou l’un de ses compères Olympiens, courant les aventures.
Par un chemin fangeux nous remontâmes de Quartes, où se dressaient l’Eglise et le moulin tremblotant. Les paysans revenant des champs regagnaient péniblement leurs demeures. Une 79 petite vieille à l’air vif passa près de nous. Elle était assise en travers d’un baudet, entre deux «cannes» à lait étincelantes. Chemin faisant, elle donnait de petits coups de talon dans le flanc du baudet et, d’une voix perçante, lançait des observations parmi les passants. Chose remarquable, aucun de ces hommes fatigués ne prenait la peine de répliquer. Notre guide nous fit bientôt quitter le petit chemin, pour prendre à travers la campagne. Le soleil était couché, mais l’occident en face de nous n’était qu’un lac d’or plain. Le sentier erra un instant à ciel ouvert. Puis il passa sous un treillis de branches, semblable à un berceau indéfiniment prolongé. De chaque côté se trouvaient des vergers ombragés; des chaumières s’étendaient bas au milieu des feuilles, envoyant leur fumée vers le ciel; çà et là, dans une trouée, apparaissait la grande face d’or de l’Occident.
Je n’ai jamais vu la Cigarette dans un état d’esprit aussi idyllique. Il devenait positivement lyrique dans son admiration des paysages 80 de la campagne. Je n’étais guère moi-même moins enthousiasmé; l’air doux du soir, les ombres, les riches lumières et le silence faisaient à notre marche un harmonieux accompagnement. Et nous prîmes tous deux la résolution d’éviter les villes à l’avenir et de loger dans les hameaux.
Le sentier s’engagea enfin entre deux maisons, et nous débouchâmes sur une grand’route large et boueuse, qu’un village d’aspect peu agréable bordait de chaque côté, à perte de vue. Les maisons s’élevaient à quelque distance de la route, dont elles étaient séparées, à droite et à gauche, par une large bande de terrain vague, où l’on voyait des tas de bois à brûler, des chariots, des brouettes, des monceaux de décombres et un peu de gazon douteux. Dans le lointain, sur la gauche, s’élevait au centre du village une grande tour maigre. Ce qu’elle avait été dans les siècles passés, je l’ignore: probablement, une forteresse en temps de guerre; mais pour le moment, elle portait, dans le haut, 83 un illisible cadran solaire et, dans le bas, une boîte aux lettres en fer.

..... s’élevait au centre du village une grande tour maigre (page 80).
De Quartes on nous avait envoyés à une auberge, mais elle était pleine, ou bien c’est que notre mine ne revint pas à la maîtresse. Il faut avouer qu’avec nos grandes valises de caoutchouc tout humides, nous n’avions guère l’air de gens civilisés. Nous ressemblions plutôt à des marchands de chiffons et d’os, imagina la Cigarette. «Ces messieurs sont des marchands?» demanda l’aubergiste. Et sans attendre une réponse, qu’elle jugeait, je suppose, superflue, dans un cas si évident, elle nous envoya chez un boucher qui habitait près de la tour et prenait des voyageurs à loger.
Nous nous rendîmes chez le boucher. Mais, il était en déménagement et tous les lits étaient démontés; ou bien notre mine ne lui revint pas. En guise d’adieu il nous décocha: «Ces messieurs sont des marchands?»
Il commençait à faire noir pour tout de bon. Nous ne pouvions plus distinguer le visage des 84 gens qui passaient auprès de nous, avec un bonsoir inarticulé. Les ménagères de Pont semblaient très économes de leur huile, car nous ne vîmes pas une seule fenêtre éclairée, dans tout ce long village. Je crois que c’est le plus long village du monde; mais j’ose dire que dans notre situation, chacun de nos pas comptait triple. Nous étions fort découragés quand nous arrivâmes à la dernière auberge. Regardant dans la maison par la porte qui n’était pas éclairée, nous demandâmes timidement si nous pouvions y loger pour la nuit. Une voix de femme consentit sur un ton peu amical. Nous jetâmes nos valises à terre et nous nous mîmes à chercher des chaises.
La salle était dans une complète obscurité, sauf une lueur rougeâtre qu’on voyait aux fentes et au ventilateur du poêle. Mais à présent, l’aubergiste allumait une lampe pour voir ses nouveaux hôtes. Ce fut, je suppose, l’obscurité qui nous épargna une autre expulsion; car je ne puis dire qu’elle eut l’air satisfaite à notre 85 aspect. Nous nous trouvions dans une grande salle nue, ornée de deux estampes allégoriques représentant la Musique et la Peinture, et d’une copie de la loi contre l’ivresse publique. D’un côté, il y avait un petit comptoir, avec une demi-douzaine de bouteilles environ. Deux ouvriers, dans une attitude de fatigue extrême, étaient assis attendant le souper. Une jeune fille de beauté médiocre circulait activement dans la salle avec un enfant de deux ans qui avait sommeil; et l’aubergiste se mit à déranger les pots et les casseroles qui étaient sur le poêle, pour faire cuire quelques biftecks.
«Ces messieurs sont des marchands?» demanda-t-elle d’une voix aigre; et la conversation n’alla pas plus loin. Nous commencions à nous figurer qu’après tout nous pouvions bien être des marchands. Je n’ai jamais connu de gens dont la faculté de faire des conjectures s’étendît dans un espace si restreint que les aubergistes de Pont-sur-Sambre. Mais la politesse et la façon de se comporter n’ont pas un 86 cours plus étendu que les billets de banque. Eloignez-vous seulement assez de votre quartier, et toute la perfection de vos manières ne vous servira de rien. Ces Hennuyers ne pouvaient voir aucune différence entre un marchand ordinaire et nous. Et ce fut pour nous matière à réflexion, pendant qu’on préparait les biftecks, de voir comme ils nous prenaient à leur propre évaluation et comme notre politesse la plus raffinée et nos plus grands efforts pour charmer semblaient absolument convenir à la qualité de marchand. Cela paraît être du moins une excellente preuve en faveur de la profession en France que, même devant de tels juges, nous ne réussîmes point à battre les marchands avec nos propres armes.
Enfin on nous pria de nous mettre à table. Les deux villageois (et l’un d’entre eux avait le visage pâle et un air de complet épuisement avec une apparence maladive, provenant sans doute de l’excès de travail et de l’insuffisance de nourriture) soupèrent d’une seule assiette de 87 soupe au lait, de quelques pommes de terre en robe de chambre, d’une chope de petite bière et d’une tasse de café sucré avec du sucre candi. L’aubergiste, son fils et la jeune fille, dont nous avons parlé plus haut, mangèrent la même chose. Notre repas fut un vrai banquet, en comparaison. Nous eûmes du bifteck, moins tendre qu’il aurait pu l’être, quelques-unes des pommes de terre, un peu de fromage, un second verre de bière et du sucre blanc dans notre café.
Vous voyez ce que c’est que d’être un monsieur,—pardon, ce que c’est que d’être un marchand. Je ne m’étais jamais avisé jusqu’alors, qu’un marchand fut un homme d’importance, dans un cabaret d’ouvriers; mais à présent que je devais en jouer le rôle pendant la soirée, je vis qu’il en était bien ainsi. Il a dans les auberges où il loge à la campagne, à peu près la même prééminence que celui qui prend un salon particulier dans un hôtel. Plus vous y regardez, plus les distinctions de classes sont infinies 88 parmi les hommes; et peut-être par une heureuse dispensation, n’y en a-t-il pas un seul au bas de l’échelle, pas un seul, qui ne puisse se trouver sur quelque autre une certaine supériorité, pour sauvegarder son orgueil.
Nous fûmes assez mécontents de notre nourriture, la Cigarette en particulier; car pour moi, j’essayai de faire croire que l’aventure, le bifteck coriace, tout m’amusait. D’après la maxime de Lucrèce, la vue de la soupe au lait des autres aurait dû donner de la saveur à notre bifteck. Mais nous ne trouvâmes pas qu’il en était ainsi dans la pratique. Théoriquement, vous pouvez savoir que d’autres gens vivent plus pauvrement que vous; mais il n’est pas agréable—j’allais dire, il est contre l’étiquette de l’univers—de s’asseoir à la même table qu’eux, pour prendre sa nourriture supérieure au milieu de leurs croûtes. Je n’avais pas vu pareille chose se passer, depuis le jour où j’avais remarqué à l’école un glouton d’élève mangeant son gâteau d’anniversaire. C’était assez odieux à voir, pouvais-je 89 me rappeler, et je n’avais jamais pensé jouer ce rôle moi-même. Mais une fois de plus, vous voyez ce que c’est que d’être un marchand.
Il n’y a pas de doute que les classes pauvres de notre pays ont beaucoup plus de dispositions à la charité que les classes riches. J’imagine que cela doit venir en grande partie du peu de comparaisons et de distinctions que font ces classes entre les gens aisés et ceux qui ne le sont pas autant. Un ouvrier ou un marchand ne peut s’isoler de ses voisins moins aisés. S’il s’offre une nourriture plus recherchée, il doit le faire en présence d’une douzaine de personnes qui ne le peuvent pas. Est-il quelque chose qui puisse conduire plus directement aux pensées de charité? Ainsi l’homme pauvre, campant à l’écart dans la vie, la voit telle qu’elle est, et il sait que chaque bouchée qu’il met dans son ventre a été arrachée aux mains des affamés.
Mais à un certain degré de prospérité, comme dans une ascension de ballon, l’homme heureux passe à travers une zone de nuages, et les choses 90 sublunaires sont dès lors cachées à sa vue. Il n’aperçoit rien que les corps célestes, tous dans un ordre admirable et positivement aussi beaux que neufs. Il se trouve entouré de la façon la plus touchante des attentions de la Providence et se compare involontairement aux lys et aux alouettes. Il ne chante pas précisément, bien entendu, mais il a dès lors l’air si modeste dans son landau ouvert! Si tout le monde dînait à une seule table, cette philosophie recevrait de rudes chocs.
Le Marchand Ambulant
Comme les laquais dans la comédie de Molière, lorsque les vrais gentilshommes faisaient irruption au milieu de leurs élégantes façons singées à l’office, nous étions destinés à être confrontés avec un véritable marchand. Pour rendre la leçon plus mordante encore pour des gentilshommes tombés comme nous, c’était un marchand infiniment plus considéré que le genre de pauvres diables pour lesquels on nous prenait: comme un lion au milieu de souris, ou un vaisseau de guerre arrivant sur deux chaloupes. En vérité, le nom de colporteur ne pouvait s’appliquer à lui; c’était un marchand ambulant.
Il était environ huit heures et demie, je suppose, quand ce digne Monsieur Hector Gilliard de Maubeuge fit halte à la porte du cabaret avec 92 sa charrette couverte traînée par un baudet et d’une voix joviale appela les gens de la maison. C’était un maigre et nerveux diable d’homme, la langue bien pendue, tenant à la fois de l’acteur et du jockey. Ses affaires avaient évidemment prospéré, sans qu’il eût reçu aucun des bienfaits de l’éducation; car, avec une gravité naïve il mettait tous les mots au masculin et, au cours de la soirée, il nous servit quelques futurs de fantaisie dans sa conversation fleurie et ampoulée. Il avait avec lui son épouse, avenante jeune femme dont les cheveux étaient maintenus dans un foulard jaune et son fils, bambin de quatre ans, qui portait une blouse et un képi. Chose remarquable, l’enfant était beaucoup mieux habillé que son père et sa mère. On nous apprit qu’il était déjà dans un pensionnat; mais on se trouvait au commencement des vacances, et il était venu les passer avec ses parents et faire une tournée avec eux. Délicieuse occupation de vacances, n’est-ce pas? que de voyager toute la journée avec ses parents, dans 93 la charrette couverte pleine de trésors innombrables, avec la verte campagne bruissant de chaque côté et les enfants, dans tous les villages, le contemplant avec envie et admiration. Il est plus amusant, pendant les vacances, d’être le fils d’un marchand ambulant que d’être le fils et l’héritier du plus grand filateur du monde. Et pour ce qui est d’être un prince régnant, le jeune Gilliard en était un, ou je ne m’y connais pas.
Tandis que Monsieur Hector et le fils de la maison conduisaient le baudet à l’écurie et mettaient sous clef toutes les choses de valeur, l’aubergiste faisait réchauffer les restes de notre bifteck et frire les pommes de terre froides coupées en tranches, et Madame Gilliard s’occupait à réveiller le bambin qui, après la longue étape de ce jour, était chagrin et ébloui par la lumière. Il ne fut pas plus tôt éveillé qu’il commença à se préparer à souper, en mangeant de la galette, des poires vertes et des pommes de terre froides, toutes choses qui ne firent, autant que j’en pus juger, qu’exciter son appétit.
94
Piquée dans son amour propre de mère, l’aubergiste éveilla sa petite fille et les deux enfants furent mis en présence. Le jeune Gilliard la regarda un instant, absolument comme un chien regarde sa propre image réfléchie dans un miroir, avant de tourner la tête. En ce moment, il était tout à sa galette. Sa mère parut dépitée qu’il montrât si peu d’inclination pour l’autre sexe. Elle exprima son désappointement avec une certaine candeur et une allusion fort juste à l’influence des années.
Il est certain qu’un temps viendra, où il fera plus d’attention aux jeunes filles et pensera beaucoup moins à sa mère. Espérons qu’elle aimera cela autant qu’elle semblait se l’imaginer. Mais il est assez singulier que, parmi les femmes, celles-là précisément qui professent le plus de mépris pour le sexe masculin, trouvent un certain charme et une certaine noblesse à ses plus vilains détails mêmes, lorsqu’elles les rencontrent chez leurs propres fils.
La petite fille le regarda plus longtemps et 95 avec plus d’intérêt; probablement parce qu’elle était chez elle; tandis que le bambin était un voyageur et qu’il était accoutumé à des spectacles étrangers. Et en outre, il n’y avait point de galette pour absorber son attention.
Pendant toute la durée du souper, on ne parla que de mon jeune seigneur. Le père et la mère aimaient follement leur enfant. Monsieur ne cessa d’insister sur la sagacité de son fils; il connaissait de nom, disait-il, tous les élèves de l’école; si la mémoire lui faisait défaut, quand on le mettait à l’épreuve, il poussait la prudence et l’exactitude à un degré extraordinaire. Lui posait-on une question, il s’asseyait et réfléchissait, et s’il ne pouvait y répondre: «Ma foi, il ne vous le dira pas,» ajoutait le père. C’est certainement là un haut degré de prudence. De temps en temps, M. Hector, la bouche pleine de bifteck, prenait sa femme à témoin de l’âge du bambin à certaines époques où il avait dit ou fait quelque chose de mémorable; et je remarquai que Madame 96 traduisait habituellement son approbation par des exclamations. Quant à elle, son cœur ne la portait point à vanter son fils; mais elle ne se rassasiait pas de le caresser et elle semblait prendre un doux plaisir à rappeler ce qu’il y avait d’heureux dans la courte existence de son enfant. Il est impossible à n’importe quel écolier de causer davantage des vacances qui venaient de commencer, et de parler moins de la sombre période scolaire qui devait inévitablement les suivre. Elle montrait avec un orgueil qu’inspirait peut-être en partie l’habitude du commerce, les poches de son fils bourrées en dépit du bon sens, de toupies, de sifflets, et de ficelle. Quand elle entrait dans une maison pour faire des affaires, il l’accompagnait, paraît-il; et à chaque vente, il recevait un sou sur le bénéfice. En réalité ils le gâtaient énormément, ces deux braves gens. Mais malgré cela, ils surveillaient attentivement ses manières, et ils lui adressèrent des remontrances au sujet de quelques légères fautes d’éducation qu’il commit 97 à différentes reprises au cours du souper.
En somme, je ne me sentais pas trop froissé d’être pris pour un marchand. Il m’était permis de penser que je mangeais avec plus de délicatesse ou que mes fautes de français étaient d’une tout autre nature; mais il était évident que l’hôtesse et les deux ouvriers ne pouvaient apprécier ces distinctions. Dans cette cuisine de cabaret, il n’y avait pas la moindre différence, pour toutes les choses essentielles, entre les Gilliard et nous. M. Hector, il est vrai, était plus à l’aise et prenait en parlant un ton plus important; mais cela s’expliquait par ce fait qu’il avait charrette et baudet, alors que nous, pauvres hères, nous allions à pied. Le reste de la société s’imaginait certainement, sans d’ailleurs y mettre la moindre méchanceté, que nous mourions d’envie d’occuper dans la profession un rang aussi élevé que celui des nouveaux arrivants.
Ce qu’il y a de certain, c’est qu’aussitôt que ces braves gens parurent, la glace se rompit; l’on 98 fit connaissance et la conversation devint générale. Je ne dis pas que j’aurais mis un grand empressement à confier à ce marchand ambulant une somme extravagante, mais je suis sûr qu’il avait l’âme foncièrement honnête. En ce monde mélangé, s’il vous est possible de trouver un ou deux points sensibles dans le cœur d’un homme, et par dessus tout, si vous trouvez une famille entière vivant en si bons termes, vous pouvez à coup sûr vous tenir pour satisfait et prendre le reste comme accordé; ou ce qui vaut beaucoup mieux, conclure hardiment que vous saurez parfaitement vous en passer et qu’un seul bon trait ne saurait se trouver amoindri par dix mille mauvais.
Il se faisait tard. M. Hector alluma une lanterne d’écurie et sortit pour faire quelques arrangements à sa charrette et mon jeune monsieur se mit à enlever ses principaux vêtements et à faire de la gymnastique sur les genoux de sa mère, puis de là sur le parquet, avec accompagnement de rires.
99
«Allez-vous coucher seul?» demanda la servante.
«Il n’y a pas de danger», répondit le jeune Gilliard.
«Mais vous couchez bien seul à l’école,» objecta sa mère. «Allons, allons, il faut être un homme.»
Mais il protesta qu’il ne fallait pas mettre sur le même pied l’école et les vacances, qu’il y avait des dortoirs à l’école, et il étouffa la discussion sous des baisers qui rendaient sa mère souriante et ravie au delà de toute expression.
Il n’y avait certainement pas de danger, selon son expression, qu’il couchât seul, car il n’y avait qu’un seul lit pour les trois Gilliard. Nous avions pour notre part énergiquement refusé de coucher à deux dans un lit et nous eûmes, dans le grenier de la maison, une soupente à deux lits avec, pour tous meubles, outre les lits, trois porte-manteaux et une table. Il ne s’y trouvait même pas un verre d’eau; mais par bonheur la fenêtre pouvait s’ouvrir.
100
Je n’étais pas encore endormi, que déjà le bruit des ronflements sonores emplissait le grenier, les Gilliard, les ouvriers et les gens de l’auberge paraissant, tous et d’un commun accord, prendre part au concert. Au dehors, la jeune lune resplendissante éclairait Pont-sur-Sambre et baignait de ses rayons le cabaret où étaient couchés tous les marchands.
En route pour Landrecies
Le matin lorsque nous descendîmes, l’aubergiste nous montra deux seaux d’eau derrière la porte de la rue: «Voilà de l’eau pour vous débarbouiller,» dit-elle. Nous nous arrangeâmes donc pour nous débarbouiller, pendant que Madame Gilliard, dehors, sur les marches de l’escalier, brossait les chaussures de la famille et que Mr Hector, tout en sifflant gaiement, arrangeait pour la tournée du jour quelques marchandises dans une boîte à compartiments portative, qui formait une partie de son bagage. Pendant ce temps, l’enfant faisait partir des amorces de Waterloo, dont il avait parsemé le parquet.
Soit dit en passant, je me demande comment on appelle en France les amorces de Waterloo; 102 peut-être des amorces d’Austerlitz? Ceci est un point de vue des plus suggestifs. Vous rappelez-vous ce Français qui, voyageant via Southampton, descendit à la gare de Waterloo et fut forcé de traverser le pont de Waterloo? M’est avis qu’il dut avoir l’envie de retourner dans son pays, sans aller plus loin.
Pont même est sur la rivière; mais tandis que par la terre ferme, il y a dix minutes de marche pour y venir de Quartes, il y a six mortels kilomètres par eau. Nous laissâmes nos sacs à l’auberge, et sans bagage, nous regagnâmes nos canoës à travers les prairies humides. Quelques-uns des enfants étaient là pour nous voir partir; mais nous n’étions plus les êtres mystérieux de la soirée précédente. Un départ est beaucoup moins romanesque qu’une arrivée inexpliquée par un soir doré. Quelque vive qu’ait été l’impression produite par la première apparition d’un fantôme, c’est avec une indifférence comparativement aussi grande que nous le voyons disparaître.

.... lorsque nous longions la forêt de Mormal (page 105.)
105
Les braves gens de l’auberge de Pont, lorsque nous allâmes chercher nos sacs, furent frappés d’admiration. A la vue de ces deux gracieux petits bateaux, sur chacun desquels flottait un pavillon anglais, et dont un lavage à l’éponge avait fait reluire le vernis, ils commencèrent à s’apercevoir qu’ils avaient reçu des anges, sans s’en douter. L’aubergiste se tenait sur le pont, désolée probablement de s’être fait si peu payer. Son fils courait çà et là et invitait les voisins à venir jouir du spectacle, et nous partîmes sous les yeux d’une véritable foule de spectateurs émerveillés. Ces messieurs, des marchands! allons donc! A présent, vous voyez un peu trop tard leur qualité.
Toute la journée, il tomba des averses, qui dégénérèrent parfois en pluies torrentielles. Nous fûmes trempés jusqu’aux os; puis en partie séchés par le soleil, puis trempés de nouveau. Mais nous eûmes quelques intervalles de calme et un notamment lorsque nous longions la forêt de Mormal. Ce nom sonne mal à l’oreille, mais 106 quel délicieux endroit pour la vue et l’odorat! Toute la partie qui bordait la rivière avait un air solennel, baignant dans l’eau l’extrémité de ses branches et formant dans le haut un mur de feuillage. Qu’est-ce qu’une forêt, sinon une cité de la nature, pleine de créatures vivantes, robustes et inoffensives, où rien n’est mort, où rien n’est dû à la main de l’homme, mais où les citoyens eux-mêmes sont à la fois les maisons et les monuments publics? Il n’est rien d’aussi vivant, et cependant d’aussi calme qu’un bois, et deux compagnons qui passent dans le balancement de leur canoë se sentent bien petits et bien agités en comparaison.
Et certainement de tous les parfums, celui qu’exhalent un grand nombre d’arbres est le plus délicieux et le plus fortifiant. La mer vous a comme une forte odeur qui éclate et vous prend subitement aux narines ainsi que le tabac à priser, et qui provoque en vous la sensation délicate d’une vaste étendue d’eau et de grands navires; mais l’odeur des bois, qui ressemble le 107 plus à celle de la mer par ses propriétés toniques, la surpasse de beaucoup en douceur. De plus l’odeur de la mer est peu variée, celle des bois l’est à l’infini; elle varie avec chaque heure de la journée, non seulement en force, mais en caractère, et à mesure que vous passez d’une zone de la forêt dans une autre, les différentes sortes d’arbres paraissent vivre au milieu de différentes atmosphères. Ordinairement c’est la résine du sapin qui prédomine. Mais il est des bois qui sont plus coquets dans leurs mœurs; et l’haleine de la forêt de Mormal, en parvenant jusqu’à nous par cette pluvieuse après-midi, ne nous apportait rien moins que le parfum délicat de l’églantier.
J’aurais voulu que notre route se continuât indéfiniment parmi les bois. Les arbres forment la société la plus polie. Un vieux chêne qui, dès avant la Réforme, a grandi à l’endroit même où il se dresse, plus élevé que la flèche de bien des clochers, plus majestueux que la plupart des montagnes, et qui est cependant un être 108 vivant sujet aux maladies et à la mort comme vous et moi, n’est-il pas en lui-même un enseignement frappant de l’histoire? Mais le spectacle de vastes étendues de terrain couvertes de pareils patriarches, avec leurs racines contiguës, leurs cimes verdoyantes ondulant au vent comme des vagues, et leurs robustes rejetons qui leur montent jusqu’aux genoux; le spectacle de toute une forêt saine et belle, donnant de la couleur à la lumière et du parfum à l’air, est-ce autre chose que la pièce la plus imposante du répertoire de la nature? Heine désirait reposer comme Merlin sous les chênes de Brocéliande. Pour moi, un seul arbre ne me suffirait pas; mais si la forêt se développait comme un figuier des Banians[2], je voudrais 109 être enterré sous la racine principale; toutes les parties de mon être circuleraient de chêne en chêne; ma conscience se trouverait répandue dans toute la forêt; elle donnerait un cœur commun à cette masse de flèches vertes, qui pourrait aussi se réjouir de sa beauté et de sa dignité. Il me semble sentir des milliers d’écureuils sautant de branche en branche dans mon vaste mausolée; il me semble sentir les oiseaux et les vents effleurant, rapides et joyeux, les cimes de hauteurs inégales qui forment sa voûte de verdure.
Hélas! la forêt de Mormal n’a que fort peu d’étendue et nous n’en longeâmes la lisière que 110 sur un très petit parcours. Le reste du temps, la pluie ne cessa de tomber par ondées et le vent de souffler en rafales, au point qu’on se sentait le cœur fatigué d’un temps aussi changeant et aussi grognon. Chose singulière, les averses commençaient toujours, quand il nous fallait porter nos bateaux de l’autre côté d’une écluse et exposer nos jambes à l’air. Et il en fut ainsi à chaque écluse. Ceci est une sorte de chose qui éveille volontiers en vous un sentiment d’animosité contre la nature. Il ne semblait pas y avoir de raison pour que l’averse ne vînt pas cinq minutes plus tôt ou plus tard, à moins de lui supposer une intention de vous braver. La Cigarette avait un mackintosh, qui le mettait plus ou moins au-dessus de ces contrariétés. Mais il me fallait supporter tout ce mauvais temps, car je n’avais aucun vêtement de ce genre. Je commençai à me rappeler que la nature est femme. Mon compagnon, qui voyait les choses plus en rose, écoutait mes jérémiades avec une grande satisfaction, et y joignait ironiquement 111 les siennes. «C’est comme les marées», disait-il, pour prendre comme exemple une chose analogue, «ça ne sert qu’à embêter les canotiers. Si, ça peut encore avoir un autre but: ça permet à la lune de se glorifier de l’influence qu’on lui attribue sur la production de ce phénomène.» A la dernière écluse, un peu en deçà de Landrecies, je refusai d’aller plus loin; et au beau milieu d’une averse, je m’assis sur la berge pour me ranimer en fumant une pipe. Un alerte vieillard que je pris pour le diable s’approcha de moi, et me questionna sur notre voyage. J’avais le cœur si gros que je lui dévoilai nos projets. Voilà bien, me dit-il, la plus sotte entreprise dont j’aie jamais entendu parler. Comment donc! est-ce que je ne savais pas, me demanda-t-il, qu’il n’y avait que des écluses, des écluses, et toujours des écluses, sur tout le trajet, sans compter qu’à cette saison de l’année, nous allions trouver l’Oise complètement à sec? «Montez en chemin de fer, mon petit jeune homme, et retournez chez vous auprès de vos 112 parents.» Je fus tellement abasourdi par la malice de cet homme que tout ce que je pus faire fut de fixer les yeux sur lui, sans pouvoir dire un mot. Un arbre ne m’aurait jamais tenu pareil langage. Enfin je trouvai quelques paroles pour me tirer d’embarras. Nous avions déjà fait, lui dis-je, un assez long trajet en venant d’Anvers jusqu’ici, et nous ferions le reste en dépit de lui. Oui, ajoutai-je, s’il n’y avait pas d’autre motif, je le ferais à présent, par la seule raison qu’il avait osé dire que nous ne le pourrions pas. L’aimable vieillard me regarda en ricanant, fit une allusion à mon canoë, et s’éloigna tranquillement en hochant la tête.
J’avais encore le cœur tout bouillant d’indignation quand deux jeunes gens m’abordèrent. Ils me prirent pour le domestique de la Cigarette, sans doute parce que je n’avais qu’un simple jersey, tandis que lui portait un mackintosh, et ils me firent beaucoup de questions sur ma place et sur le caractère de mon maître. Je répondis que c’était un assez bon garçon; mais qu’il 113 avait en tête cet absurde voyage. «Oh! non, non,» dit l’un d’eux, «il ne faut pas dire cela; ce n’est pas absurde du tout, c’est très courageux de sa part.» Je crois que ces deux jeunes gens étaient des anges envoyés pour me rendre du courage. Ce fut pour moi une chose vraiment fortifiante de reproduire ainsi toutes les insinuations du vieillard, comme si elles venaient de moi et qu’elles m’eussent été suggérées par mon rôle de domestique mécontent, et de les voir chasser comme autant de mouches par ces admirables jeunes gens.
Quand je racontai cet incident à la Cigarette, «les gens doivent se faire une curieuse idée de la manière d’agir des domestiques anglais,» dit-il sèchement, «car vous m’avez traité en bête brute à l’écluse».
Je fus très mortifié de ces paroles; mais il est de fait que mon caractère avait souffert.
A Landrecies la pluie tombait encore et le vent soufflait toujours; mais nous trouvâmes une chambre à deux lits bien meublée, de véritables pots à eau contenant de l’eau véritable, et un dîner, un dîner véritable avec du vin véritable. Pour moi, après avoir été marchand pendant une nuit, après avoir été le jouet des éléments pendant toute la journée, je sentis ce confort faire sur mon cœur l’effet d’un rayon de soleil. Il y avait au dîner un fruitier anglais qui voyageait avec un fruitier belge. Dans la soirée, au café, nous remarquâmes que notre compatriote perdait beaucoup d’argent au jeu de bouchon; et je ne sais pourquoi, ceci nous fut agréable.
Il advint que nous dûmes faire plus ample connaissance avec Landrecies que nous ne nous 115 y attendions; car le lendemain il faisait un vrai temps de chien. Cette ville n’est pas l’endroit qu’on aurait voulu choisir pour se reposer une journée, car elle ne se compose guère que de fortifications. A l’intérieur des remparts, quelques pâtés de maisons, une longue rangée de casernes et une église représentent la ville du mieux qu’ils peuvent. Il ne paraît pas y avoir de commerce, et un boutiquier chez qui j’achetai un briquet de treize sous éprouva une telle émotion d’avoir un client qu’il m’emplit mes poches de silex de reste par dessus le marché. Les seuls monuments publics qui eurent quelque intérêt pour nous furent l’hôtel de ville et le café. Cependant nous visitâmes l’église; c’est là que repose le maréchal Clarke; mais comme nous n’avions jamais entendu parler ni l’un ni l’autre de ce soldat héroïque, nous supportâmes avec fermeté les souvenirs de l’endroit.
Dans toutes les villes de garnison, les appels à la garde, les réveils et autres choses du même genre font un magnifique et romanesque 116 intermède dans la vie civile. Les clairons, les tambours et les fifres sont par eux-mêmes d’excellentes choses, et quand ils font penser aux armées en marche et aux pittoresques vicissitudes de la guerre, ils suscitent dans le cœur quelque chose de fier. Mais dans une ombre de ville telle que Landrecies, où il n’y a guère d’autre mouvement, ces accents guerriers produisaient une commotion grande à proportion. C’étaient en vérité les seules choses mémorables. C’était bien l’endroit pour entendre la ronde passant la nuit dans les ténèbres avec le pas pesant des hommes en marche et la répercussion frémissante des roulements de tambour. Cela vous rappelait que cette place même était un point dans le grand système militaire de l’Europe, qu’il se pourrait qu’un jour dans l’avenir elle fût entourée de la fumée et du tonnerre du canon et qu’elle se fît un nom parmi les places fortes.
En tous cas, le tambour, grâce à sa voix martiale et au remarquable effet physiologique 117 qu’il produit, je dirai plus, grâce même à sa forme embarrassante et comique, occupe une place à part parmi les instruments de percussion. Et s’il est vrai, comme je l’ai ouï dire, que les tambours sont recouverts de peau d’âne, quelle pittoresque ironie cela ne contient-il pas! Comme si la peau de ce patient animal n’avait pas été suffisamment battue pendant qu’il était en vie, tantôt par les marchands des quatre saisons de Lyon, tantôt par les présomptueux prophètes hébreux, il fallait encore qu’elle fût enlevée aux quartiers de derrière de la pauvre bête, après sa mort, tendue sur un tambour et battue chaque nuit à la ronde dans les rues de toutes les villes de garnison de France. Et sur les hauteurs de l’Alma et de Spicheren, et partout où la mort fait flotter son drapeau rouge et retentir le bruit de sa puissante épée sur les canons, là aussi, il faut que le jeune tambour se précipitant, les joues toutes 118 blanches, par dessus les camarades tombés, batte et maltraite ce morceau de peau, arraché aux reins de paisibles baudets.
En général on n’emploie jamais plus mal son temps qu’à donner des coups de bâton sur la peau des ânes. Nous savons l’effet que cela produit sur cet animal, pendant qu’il est en vie, et nous n’ignorons pas que vos coups ne hâteront pas la marche de votre âne stupide. Mais dans cet état de momie et de triste survivance à soi-même, lorsque la peau creuse retentit sous les coups des baguettes, que chaque rataplan va droit au cœur d’un homme, y introduit la folie et cette disposition du pouls, que dans notre façon emphatique de parler nous surnommons Héroïsme, n’y a-t-il pas une espèce de vengeance contre les persécuteurs de l’âne? Autrefois, pourrait-il vous dire, vous me faisiez monter la colline et descendre la vallée à coups de bâton, et j’étais forcé de l’endurer; mais à présent que je suis mort, ces coups sourds qu’on entendait à peine dans les chemins de campagne sont 119 devenus une musique entraînante en tête de la brigade, et pour chaque coup dont vous avez frappé ma peau, vous verrez un camarade chanceler et tomber.
Peu de temps après le passage des tambours devant le café, la Cigarette et l’Aréthuse, se sentant envie de dormir, partirent pour l’hôtel qui n’était qu’à deux pas. Mais bien que Landrecies ne nous eût guère paru intéressant, Landrecies s’était senti de l’intérêt pour nous. Nous apprîmes que tout le long de la journée, des gens avaient couru entre les rafales voir nos deux bateaux. Des centaines de personnes, disait-on, quoique l’assertion ne fût guère d’accord avec l’idée que nous nous faisions de la ville, des centaines de personnes avaient couru les regarder dans le magasin à charbon où ils se trouvaient. Nous devenions des lions à Landrecies, nous qui n’avions été que des marchands la veille au soir, à Pont.
Lorsque nous quittâmes le café, quelqu’un courut après nous et nous rattrapa à la porte de 120 l’hôtel. Ce n’était rien moins que le juge de paix, fonctionnaire qui, autant que j’en puis juger, joue le rôle d’un délégué du shériff en Ecosse. Il nous donna sa carte et nous invita à souper avec lui sur le champ, avec le charme délicat et la grâce exquise que les Français apportent à ces choses. C’était pour le crédit de Landrecies, dit-il, et bien que nous fussions parfaitement fixés sur le peu de crédit que nous pouvions faire à la ville, nous aurions été de grossiers personnages si nous avions refusé une invitation aussi poliment faite.
La maison du juge de paix se trouvait tout près. C’était un intérieur de célibataire bien installé, avec une curieuse collection de vieilles bassinoires en cuivre suspendues aux murs. Quelques-unes étaient artistement ciselées. Il semblait que cela fût une idée pittoresque pour un collectionneur. On ne pouvait s’empêcher de penser au grand nombre de bonnets de nuit qui s’étaient agités sur ces bassinoires dans les générations passées; aux plaisanteries qui avaient 121 pu se faire, aux baisers qui avaient pu se prendre, lorsqu’elles étaient en usage; on songeait forcément aux nombreuses fois qu’elles avaient paradé dans le lit de la mort. Si seulement elles pouvaient parler, à quelles scènes absurdes, inconvenantes et tragiques n’avaient-elles pas assisté?
Le vin était excellent. Quand nous complimentions le juge de paix sur une bouteille: «Je ne vous donne pas cela comme ce que j’ai de plus mauvais», disait-il. Je me demande quand les Anglais apprendront ces gracieuses façons hospitalières. Elles valent la peine qu’on les apprenne; elles ornent l’existence et embellissent les heures ordinaires.
Deux autres habitants de Landrecies étaient présents. L’un était un receveur d’une chose ou d’une autre, j’ai oublié quoi; l’autre, nous apprit-on, était le principal notaire de l’endroit. Il se trouvait donc que nos professions à tous les cinq avaient plus ou moins de rapport avec la loi. Dans ces conditions, il était presque certain 122 que la conversation deviendrait technique. La Cigarette expliqua d’une façon magistrale les lois sur le paupérisme. Et un peu plus tard, je me trouvai moi-même en train d’exposer la loi écossaise sur les enfants naturels, dont, je suis bien aise de le dire, je ne connais pas le moindre mot. Le receveur et le notaire, mariés tous deux, accusèrent le juge de paix, qui était célibataire, d’avoir soulevé la question. Il se défendit de l’accusation de l’air conscient et satisfait que prennent tous les hommes que j’aie jamais vus, qu’ils soient Français ou Anglais. N’est-il pas étrange que tous, dans les moments où nous ne sommes pas sur nos gardes, nous éprouvions une certaine satisfaction à ce qu’on nous juge un tant soit peu coquins avec les femmes?
A mesure que la soirée s’avançait, le vin devenait plus à mon goût; les liqueurs se trouvaient encore meilleures que le vin et la société était très animée. Ce fut le plus haut étiage de la faveur populaire de notre voyage. Après tout, comme nous nous trouvions chez un juge de paix, n’y 123 avait-il pas quelque chose de semi-officiel dans la façon dont il nous traitait? C’est pourquoi, nous souvenant quel grand pays est la France, nous rendîmes pleine justice à la réception qui nous avait été faite. Il y avait longtemps que Landrecies était endormi lorsque nous retournâmes à l’hôtel, et les sentinelles sur les remparts allaient bientôt voir poindre le jour.
Péniches
Il était tard et il pleuvait quand nous partîmes le lendemain. Le juge de paix abrité sous un parapluie eut la politesse de nous accompagner jusqu’au bout de l’écluse. Nous en étions arrivés à présent, en matière de temps, à un degré d’humilité qu’on n’atteint guère que dans les Highlands d’Ecosse. Un petit coin de ciel bleu ou un rayon de soleil faisait chanter nos cœurs et quand il ne pleuvait pas très fort, nous considérions la journée comme presque belle.
De longues files de bateaux s’étendaient le long du canal. Beaucoup d’entre eux avaient l’air tout à fait pimpants et ressemblaient à des navires dans leurs justaucorps de goudron d’Archangel, rehaussé de blanc et de vert. 125 Quelques-uns portaient une gaie balustrade en fer et tout un parterre de pots de fleurs. Les enfants jouaient sur le pont des bateaux, sans plus se soucier de la pluie que s’ils avaient été élevés sur les bords du lac Caron; les hommes pêchaient par dessus le plat-bord, quelques-uns sous un parapluie; les femmes faisaient leur lessive; et chaque bateau était fier de son petit roquet qui faisait office de chien de garde. Chacun de ces chiens aboyait furieusement après nos canoës, courant le long du bord jusque l’autre bout de son bateau et passant ainsi le mot au chien qui était sur le suivant. Nous avons dû voir, au cours de cette journée de canotage, quelque chose comme une centaine de ces embarcations, rangées les unes à la suite des autres comme les maisons dans une rue; et il n’y avait pas un seul de ces bateaux dont le chien ne nous accompagnât de ses aboiements. On croirait visiter une ménagerie, fit remarquer la Cigarette.
Ces petites cités le long du bord du canal 126 produisaient sur l’esprit une très bizarre impression. Elles ressemblaient, avec leurs pots de fleurs et leurs cheminées fumantes, leurs lessives et leurs dîners, à un coin de nature enraciné dans le paysage; et cependant, si le canal venait seulement à se dégager en aval, tous les bateaux l’un après l’autre hisseraient leur voile ou se feraient remorquer par des chevaux et s’en iraient dans toutes les parties de la France, et le hameau impromptu se séparerait, maison par maison, pour se disperser aux quatre vents. Quant aux enfants qui jouaient ensemble aujourd’hui sur le canal de la Sambre à l’Oise, chacun au seuil de l’habitation paternelle, où et quand pourrait se faire leur prochaine rencontre?
Depuis quelque temps notre conversation avait roulé sur les bateaux et nous avions formé le projet de passer nos vieux jours sur les canaux de l’Europe. Nous devions faire ces voyages tout à fait à loisir, tantôt sur une rapide rivière, à la remorque d’un vapeur, tantôt attendant 127 des chevaux pendant des journées entières à quelque jonction peu considérable. On devait nous voir nous agiter sur le pont dans toute la dignité des années, notre barbe blanche tombant sur notre poitrine. Nous devions être perpétuellement occupés parmi les pots de couleur, si bien qu’il n’y aurait pas de blanc d’une fraîcheur plus grande, ni de vert d’une plus belle teinte d’émeraude que le nôtre, dans tous les bateaux circulant sur les canaux. Il devait y avoir des livres dans la cabine, des pots à tabac et du vieux Bourgogne aussi rouge qu’un coucher de soleil en Novembre, et aussi parfumé qu’une violette en Avril. Il devait y avoir un flageolet dont la Cigarette, avec un doigté habile, tirerait des sons attendrissants sous les étoiles, et peut-être, mettant de côté son instrument, élèverait-il la voix—sa voix un peu plus grêle qu’autrefois, avec, de temps à autre, un chevrotement que vous appelleriez, si vous vouliez, une roulade naturelle—en une riche et solennelle psalmodie.
128
Toutes ces choses mijotant dans mon esprit me firent désirer aller à bord d’une de ces habitations idéales de la flânerie. Je n’avais que l’embarras du choix, tandis que je les côtoyais les unes après les autres et que les chiens aboyaient après moi, me prenant pour un vagabond. A la fin j’aperçus un brave vieillard et son épouse qui me regardaient tous deux avec intérêt. Je leur souhaitai donc le bonjour et m’arrêtai près de leur bateau. Je débutai par une remarque sur leur chien qui avait quelque chose du chien d’arrêt. Changeant alors de sujet, j’adressai à Madame un compliment sur ses fleurs, puis un mot d’éloge sur leur genre de vie.
Si vous tentiez pareille expérience en Angleterre, vous recevriez immédiatement un camouflet. On vous représenterait cette existence comme méprisable, non sans faire une allusion mordante à votre meilleur sort. Or ce que j’aime tant en France, c’est la franchise et l’intrépidité avec laquelle chacun reconnaît sa situation de fortune. Ils savent tous dans ce pays de 129 quel côté leur pain est beurré, et ils prennent plaisir à le montrer aux autres, ce qui est à coup sûr ce que la religion comporte de meilleur; et ils dédaignent de faire la petite bouche sur leur pauvreté, ce que je considère comme ce qu’il y a de supérieur dans le courage. J’ai entendu une femme dans une position tout à fait belle et possédant une fortune assez ronde, parler de son propre enfant avec une plainte navrante, comme de l’enfant d’un pauvre homme. Moi, je ne dirais pas pareille chose au duc de Westminster. Et les Français sont pleins de cet esprit d’indépendance. Peut-être est-ce le résultat des institutions républicaines, comme ils les appellent. C’est beaucoup plus vraisemblablement parce qu’il y a si peu de gens réellement pauvres que ceux qui se plaignent ne sont pas en nombre suffisant pour se soutenir les uns les autres.
Les gens du bateau étaient charmés de m’entendre admirer leur situation. Ils comprenaient parfaitement bien, me dirent-ils, comment Monsieur 130 enviait le sort. Sans doute Monsieur était riche, et dans ce cas il lui était loisible de faire une péniche jolie comme un château. Et ce disant, ils m’invitèrent à monter à bord de leur château d’eau. Ils s’excusèrent de la pauvreté de leur cabine; ils n’avaient pas été assez riches pour l’arranger comme elle aurait dû l’être.
«Le feu aurait dû être ici, de ce côté-ci,» expliquait le mari. «Ensuite on pourrait avoir un secrétaire au milieu—des livres—et» (d’une manière générale) «tout. Ça serait tout à fait coquet». Et il regardait autour de lui, comme si les améliorations étaient déjà faites. Ce n’était évidemment pas la première fois qu’il avait ainsi embelli sa cabine en imagination; et à la première bonne affaire qu’il fera, il faut m’attendre à voir le secrétaire au milieu de la cabine.
Madame avait trois oiseaux dans une cage. Ce n’était pas grand chose, expliquait-elle. Les beaux oiseaux étaient si chers! Ils avaient cherché à se procurer un hollandais l’hiver dernier, à Rouen (Rouen, pensai-je; est-ce que toute 131 cette demeure, avec ses chiens, ses oiseaux et ses cheminées fumantes, voyage jusque-là? et a-t-elle la même simplicité parmi les falaises et les vergers de la Seine qu’au milieu des vertes plaines de la Sambre?) ils avaient cherché à se procurer un hollandais l’hiver dernier à Rouen; mais ces oiseaux coûtent quinze francs pièce,—pensez un peu—quinze francs!
«Pour un tout petit oiseau», ajouta le mari.
Comme je continuais à admirer, ces braves gens cessèrent de s’excuser et se mirent à vanter leur bateau et leur heureuse condition, comme s’ils avaient été l’Empereur et l’Impératrice des Indes. Ce fut, selon l’expression usitée en Ecosse, une bonne audition, et cela me fit voir le monde sous un jour favorable. Si l’on savait combien il est encourageant d’entendre une personne se vanter, aussi longtemps qu’elle se vante de ce qu’elle a réellement, je crois qu’on le ferait plus librement et de meilleure grâce.
132
Ils commencèrent à faire des questions sur notre voyage. Il vous aurait fallu voir comme ils sympathisaient avec nous. Ils semblaient à moitié disposés à abandonner leur bateau et à nous suivre.
Mais ces mariniers ne sont que des bohémiens à demi-domestiqués. Cette demi-domestication se manifesta sous une forme assez jolie. Soudain le front de Madame s’assombrit. «Cependant», commença-t-elle, et elle s’arrêta; puis reprenant, elle me demanda si j’étais célibataire.
—«Oui,» répondis-je.
—«Et votre ami qui vient de passer il n’y a qu’un instant?»
Lui non plus n’était pas marié.
Oh! alors, tout était pour le mieux. Elle ne pouvait pas admettre qu’on laissât les femmes seules au logis; mais, puisqu’il n’y avait aucune épouse en jeu, nous faisions ce que nous pouvions faire de mieux.
—«Veiller aux intérêts de quelqu’un dans le monde», reprit le mari, «il n’y a que ça. D’autre 133 part, notez bien, si un homme reste fixé dans son village comme un ours, continua-t-il, il ne voit rien; et ensuite la mort est la fin de tout et il n’a rien vu.»
Madame rappela à son mari un Anglais, qui avait remonté ce canal en bateau à vapeur.
—«Peut-être M. Moens dans l’Ytene», suggérai-je.
—«Tout juste», approuva le mari. «Il avait avec lui sa femme et sa famille avec des domestiques. Il débarquait à toutes les écluses et demandait les noms des villages aux bateliers ou aux éclusiers, et alors il les écrivait, il les écrivait. Oh! il écrivait énormément. Je suppose que c’était un pari.»
Il y avait là une explication assez plausible pour nos exploits; mais il semblait assez original de croire qu’un pari fût une raison de prendre des notes.
Le lendemain matin il n’était pas neuf heures que les deux canoës étaient installés sur une légère charrette de campagne à Etreux. Nous ne tardâmes pas à les suivre sur la route qui longe une riante vallée couverte de houblonnières et de peupliers. D’agréables villages étaient disséminés sur la pente de la colline: notamment Tupigny avec ses perches à houblon laissant pendre leurs guirlandes jusque dans la rue et ses maisons tapissées de vignes avec leurs raisins. Il y eut un faible enthousiasme sur notre passage; les tisserands passaient leurs têtes aux fenêtres; les enfants criaient, émerveillés à la vue des deux barquettes, et des piétons en blouse, de connaissance avec notre charretier, plaisantaient avec lui sur la nature de son chargement.
135
Nous essuyâmes une ou deux averses, mais légères et fuyantes. L’air était pur et doux parmi tous ces champs verts et toutes ces choses vertes qui poussaient. Rien qui indiquât l’automne, dans le temps. Et quand à Vadencourt, nous nous embarquâmes au bord d’une petite prairie, en face d’un moulin, le soleil perça les nuages et fit resplendir toutes les feuilles dans la vallée de l’Oise.
Les pluies qui tombaient depuis longtemps avaient gonflé la rivière. Sur tout le parcours de Vadencourt à Origny, elle courait avec une rapidité toujours croissante, puisant de nouvelles forces à chaque mille et se précipitant comme si elle sentait déjà la mer. Jaune et tumultueuse, l’eau tournoyait en tourbillons irrités parmi les saules à demi-submergés et battait les bords pierreux d’un clapotis furieux. Son cours suivait en serpentant sans cesse une vallée étroite et bien boisée. Tantôt la rivière s’approchait du pied de la colline, courait en glissant le long de sa base crayeuse, et nous 136 laissait voir entre les arbres quelques champs de colza s’étendant à perte de vue. Tantôt elle longeait les murs des jardins derrière les maisons, où d’un rapide coup d’œil, nous pouvions, par la baie d’une porte, saisir la silhouette d’un prêtre qui se promenait, dans la lumière diaprée du soleil. Puis le feuillage formait un mur si épais devant nous qu’il semblait n’y avoir aucune issue; ce n’était qu’un bouquet de saules dominés par des ormes et des peupliers, sous lesquels la rivière courait impétueuse et rapide, traversée par un martin-pêcheur qui passait comme un morceau de ciel bleu. Sur ces différentes manifestations de la nature le soleil répandait ses rayons clairs et catholiques. Sur la surface rapide de la rivière, les ombres se dessinaient aussi fermes que sur les prairies immobiles. La lumière scintillait en filets d’or entre les feuilles dansantes des peupliers et nous permettait de jouir de la vue des collines. Et pendant tout ce temps, la rivière ne s’arrêtait jamais dans sa course et ne reprenait jamais 137 haleine; et sur toute la longueur de la vallée les roseaux se dressaient, frissonnant de la tête aux pieds.
Il doit y avoir quelque mythe (mais s’il en existe un, je ne le connais pas) fondé sur le frissonnement des roseaux. Il n’y a guère de choses dans la nature qui frappent davantage l’œil de l’homme. C’est une pantomime si éloquente de la terreur; et la vue d’un si grand nombre de créatures se réfugiant dans tous les creux du rivage comme dans un sanctuaire inviolable est suffisante pour répandre l’infection de la crainte dans un esprit faible. Peut-être n’est-ce qu’une question de froid? et cela n’aurait rien d’étonnant, puisque les roseaux sont plongés dans l’eau jusqu’à la taille. Ou peut-être ne se sont-ils jamais accoutumés à la hâte et à la fureur du flux de la rivière ou au miracle de son corps sans fin? Pan jouait autrefois du chalumeau sur leurs ancêtres; et ainsi par les mains de sa rivière, il continue à jouer sur ces récentes générations dans toute la vallée de 138 l’Oise; et il joue le même air, tout à la fois doux et perçant, pour nous dire ce qu’il y a de beau et de terrifiant dans le monde.
Le canoë était comme une feuille dans le courant qui le soulevait, le secouait et l’emportait en maître; tel un centaure emportant une nymphe. Pour conserver quelque pouvoir sur la direction des canoës, il nous fallait beaucoup d’habileté et d’activité dans le maniement de la pagaie. La rivière avait une telle hâte d’atteindre la mer! Toutes les gouttes d’eau couraient, prises d’une terreur panique, comme autant de gens dans une foule épouvantée. Mais y eut-il jamais une foule si nombreuse et si possédée d’une seule idée? Tous les objets visibles passaient avec le rythme d’une danse; la vue courait de la même course que la rivière. Les exigences de chaque moment tendaient tellement les cordes que notre être vibrait comme un instrument bien accordé et que le sang, secouant sa léthargie, trottait par tous les grands chemins et par tous les sentiers des veines et 139 des artères, entrait dans le cœur et en sortait précipitamment, comme si la circulation n’était qu’un voyage de vacances et non le labeur quotidien de soixante-dix années. Les roseaux pouvaient incliner leur tête en guise d’avertissement, et par leurs gestes tremblants, nous dire que la rivière était aussi cruelle qu’elle était impétueuse et froide, et que la mort était aux aguets dans les tourbillons sous les saules. Mais les roseaux devaient rester où ils étaient et ceux qui restent immobiles sont toujours de timides conseillers. Pour nous, nous aurions pu crier à tue-tête. A vrai dire, si cette charmante et magnifique rivière était une invention de la mort, la vieille coquine grise s’était fameusement trompée à notre égard. En ce moment l’intensité de ma vie était décuplée. Je marquais des points contre la mort à chacun de mes coups de pagaie, à chaque tournant du cours d’eau. J’ai rarement tiré meilleur profit de ma vie.
Car à mon avis, nous pouvons considérer notre petite guerre particulière avec la mort tant 140 soit peu sous ce jour. Si un homme sait que tôt ou tard il sera dévalisé dans un voyage, il prendra une bouteille de ce qu’il y a de meilleur dans chaque auberge et considèrera toutes ses extravagances comme autant de gagné sur les voleurs: Et ce sera surtout autant de gagné, si au lieu de dépenser simplement, il fait un placement avantageux d’une partie de son argent, lorsqu’il n’y aura plus aucun risque de le perdre. De même chaque moment de vie intense, surtout quand cette vie est pleine de santé, est autant de gagné sur la mort, la voleuse en gros. Nous aurons d’autant moins dans nos poches, d’autant plus dans notre estomac, le jour où elle s’écriera: «Halte là. Votre bourse!» Un rapide cours d’eau est un de ses artifices favoris, un de ces artifices qui est pour elle chaque année une source de grands revenus. Mais lorsque viendra pour elle et pour moi le moment de régler nos comptes, je lui sifflerai au nez, quand il sera question de ces heures passées sur l’Oise supérieure.
141
Au début de l’après-midi, le soleil resplendissant et la gaîté de la marche nous avaient plongés dans une sorte de douce ivresse. Nous ne pouvions plus nous contenir; nous ne pouvions plus contenir notre contentement. Les canoës étaient trop petits pour nous; nous éprouvions le besoin d’en sortir pour nous dégourdir les jambes sur le rivage. Et nous nous étendîmes de tout notre long sur le gazon dans une verte prairie, nous fumâmes un tabac déifiant et proclamâmes le monde excellent. Ce fut la dernière bonne heure de la journée et je m’y arrête avec une extrême complaisance.
D’un côté de la vallée, tout en haut du sommet crayeux de la colline, un laboureur avec son attelage paraissait et disparaissait à intervalles réguliers. Chaque fois qu’il se montrait, sa silhouette se détachait immobile pendant quelques secondes sur le fond du ciel, tout à fait semblable, au dire de la Cigarette, à un Burns de fantaisie qui viendrait retourner avec sa charrue la marguerite de la 142 montagne.[3] C’était le seul être vivant que nous eussions en vue, à moins que nous ne dussions compter la rivière.
De l’autre côté de la vallée, un groupe de toits rouges et un beffroi se montraient parmi le feuillage. De là quelque sonneur de cloches inspiré emplissait l’après-midi de la musique d’un carillon. Il y avait quelque chose de très doux, de très captivant dans l’air qu’il jouait, et nous pensâmes que nous n’avions jamais entendu de cloches parler d’une manière si intelligente ou chanter d’une façon aussi mélodieuse. Ce fut sans doute sur quelque rythme semblable que les fileuses et les jeunes filles chantaient «Eloigne-toi, ô mort,» dans l’Illyrie[4] de Shakespeare. Il y a si souvent une note menaçante, quelque chose de beuglant et de métallique dans la voix des cloches, que nous 143 avons, je crois, une impression bien plus pénible qu’agréable à les entendre. Mais tandis que ces cloches sonnaient dans le lointain, tantôt sur un ton haut, tantôt sur un ton grave, tantôt avec une cadence plaintive qui captivait l’oreille comme le refrain d’un chant populaire, elles étaient toujours modérées et mélodieuses, et semblaient être en harmonie avec l’esprit des endroits tranquilles et rustiques, comme le bruit d’une chute d’eau ou le babillage d’une colonie de corneilles au printemps. J’aurais bien demandé la bénédiction du sonneur de cloches, bon et grave vieillard qui tirait si doucement la corde, au rythme de ses méditations. J’aurais volontiers béni le prêtre, ou les héritiers, ou qui que ce soit en France qui s’occupe de ces sortes d’affaires, qui avaient légué ces harmonieuses vieilles cloches pour égayer l’après-midi, au lieu de tenir des réunions, de faire des quêtes, et d’avoir leurs noms imprimés à diverses reprises dans la feuille locale, pour monter un carillon de substituts d’airain tout flambant neufs 144 fondus à Birmingham, qui bombarderaient leurs flancs à la provocation d’un sonneur de cloches tout flambant neuf et rempliraient les échos de la vallée de terreur et de vacarme.
A la fin les cloches se turent, et avec leur note le soleil se retira. Le spectacle était fini; la vallée de l’Oise était retombée dans l’ombre et le silence. Nous nous mîmes à pagayer, le cœur joyeux, comme des gens qui, après avoir assisté jusqu’au bout à une noble représentation, retournent au travail. La rivière était plus dangereuse ici; elle courait plus vite; les tourbillons étaient plus soudains et plus violents. Pendant toute la descente nous avions eu des difficultés tout notre soûl. Tantôt c’était un barrage que notre habileté nous permettait de franchir avec la rapidité d’une flèche; tantôt c’en était un autre si peu profond et hérissé de tant de pieux qu’il nous fallait tirer les bateaux de l’eau et les porter au delà. Mais le principal genre d’obstacles avait pour cause les derniers grands vents. Tous les deux ou trois cents 145 mètres, un arbre était tombé en travers de la rivière et en avait ordinairement entraîné plus d’un autre dans sa chute. Souvent il y avait un passage libre à l’extrémité, et nous pouvions doubler ce promontoire de feuillage et entendre la succion et le bouillonnement de l’eau parmi les branches. Souvent aussi, quand l’arbre s’étendait d’une rive à l’autre, il y avait place pour, en se rasant, passer en dessous, canoë et tout. Quelquefois il était nécessaire de monter sur le tronc même et de faire passer les bateaux en les tirant; et parfois aussi, aux endroits où le courant était trop impétueux pour agir ainsi, il n’y avait rien à faire que d’atterrir et de transporter nos bateaux. Ceci fit une belle série d’accidents dans le trajet du jour et nous tint constamment en éveil.
Peu de temps après notre rembarquement comme j’étais en tête avec une longue avance toujours plein d’un noble et joyeux enthousiasme pour le soleil, la rapidité de notre allure et les cloches d’église, la rivière fit un de ses 146 sauts de lion à un brusque tournant, et j’aperçus un autre arbre tombé à une portée de pierre. En un clin d’œil j’eus baissé mon dossier et je visai un endroit où le tronc semblait assez élevé au dessus de l’eau et où les branches ne paraissaient pas trop touffues pour me laisser glisser par dessous. Quand un homme vient de vouer une éternelle confraternité à l’univers, il n’est pas en état de prendre de sang-froid de grandes déterminations, et je n’avais pas été heureusement inspiré en prenant celle-ci, qui aurait pu être pour moi très importante. L’arbre m’accrocha par la poitrine, et pendant que je m’efforçais encore de me faire plus mince et de me frayer passage, la rivière coupa court à tout en m’enlevant mon bateau. L’Aréthuse pivota, dériva bâbord avant, s’inclina sur le flanc, rejeta tout ce qui restait encore de moi à bord, et ainsi désencombrée, fila vivement sous l’arbre, se redressa et s’en alla gaiement au fil de l’eau.
J’ignore combien de temps je mis à me hisser à force d’efforts sur l’arbre, auquel j’étais resté 147 cramponné; mais ce fut plus long que je ne l’aurais désiré. Mes pensées étaient d’un caractère grave et presque sombre; mais je me cramponnais toujours à ma pagaie. Le courant m’entraînait par les talons aussi vite que je parvenais à soulever mes épaules hors de l’eau, et au poids, il me semblait avoir toute l’eau de l’Oise dans les poches de mon pantalon. Vous ne pourrez jamais savoir, tant que vous n’en aurez pas fait l’essai, avec quelle sourde violence une rivière tire sur un homme. La mort elle-même m’avait par les talons; car c’était ici sa dernière embuscade, et il fallait à présent qu’elle prît part en personne à la lutte. Et toujours je tenais ma pagaie. A la fin, je me hissai péniblement jusqu’au ventre sur le tronc et je restai là, loque mouillée, sans haleine, l’esprit partagé entre la mauvaise humeur et le sentiment de l’injustice du sort. Quelle triste figure j’ai dû faire aux yeux de Burns avec son attelage au sommet de la colline! Mais la pagaie se trouvait toujours dans ma main. Sur ma tombe, 148 si jamais j’en ai une, je veux que ces mots soient inscrits: «Il se cramponna à sa pagaie.»
La Cigarette venait de passer un instant auparavant; il y avait en effet, comme j’aurais pu l’observer, si j’avais été un peu moins enthousiasmé de l’univers à ce moment, un passage libre autour du sommet de l’arbre, du côté le plus éloigné. Il m’avait offert ses services pour me tirer de là; mais comme j’étais déjà sur les coudes, j’avais refusé et l’avais envoyé en aval, à la poursuite de la vagabonde Aréthuse. Le courant était trop rapide pour qu’un homme le remontât avec un seul canoë, à plus forte raison avec deux sur les bras. Je rampai donc le long du tronc jusqu’à la rive et je descendis à pied par les prairies qui bordent la rivière. J’avais tellement froid que mon cœur était endolori. Je me rendais bien compte par moi-même à présent de la raison pour laquelle les roseaux frissonnaient si tristement. J’aurais pu donner une leçon à n’importe lequel d’entre eux. A mon approche, la Cigarette fit facétieusement 149 remarquer qu’il pensait que j’étais «en train de prendre de l’exercice»; mais il acquit bientôt la certitude que c’était le froid qui me faisait claquer des dents. Je me frictionnai énergiquement avec une serviette et je mis des vêtements secs, que je tirai du sac en caoutchouc; mais je ne fus plus le même homme pendant le reste du voyage. Cela me donnait des nausées de penser que je portais sur moi mes derniers vêtements secs. La lutte m’avait fatigué; et peut-être, que je le susse ou non, étais-je quelque peu démoralisé? L’élément dévorant de l’univers avait bondi sur moi dans cette verte vallée qu’animait un rapide cours d’eau. Les cloches étaient toutes très jolies à leur façon; mais j’avais entendu quelques-unes des notes perfides de la musique de Pan. Est-ce que la traîtresse rivière voulait m’entraîner sous ses eaux par les talons, vraiment? et paraître si belle tout le temps? En somme, la bonne humeur de la nature n’était qu’à fleur de peau.
Il y avait encore un long trajet à faire en 150 suivant les sinuosités du cours d’eau; la nuit était tombée, et une cloche sonnait tardivement dans Origny-Sainte-Benoîte, quand nous arrivâmes.
un jour de repos
Le lendemain était un Dimanche, et les cloches de l’église n’eurent guère de repos. En vérité je ne me rappelle aucun autre endroit où l’on offre aux dévots un choix d’offices aussi varié. Et tandis que les cloches sonnaient joyeuses dans l’air ensoleillé, tous les chasseurs avec leurs chiens battaient les betteraves et le colza.
Dans la matinée un colporteur et sa femme descendirent la rue au pas, chantant sur un air très lent et très lamentable: «O France, mes amours.» Cela fit venir tout le monde à sa porte; et lorsque notre hôtesse appela l’homme chez elle pour lui acheter les paroles, il n’en restait plus aucun exemplaire. Elle n’était ni la première, ni la seconde personne à avoir été empoignée 152 par la chanson. Il y a quelque chose de fort pathétique dans l’amour que professent les Français depuis la guerre pour les chants patriotiques lugubres. J’ai observé un garde forestier natif d’Alsace, pendant que quelqu’un chantait «Les malheurs de la France» à un repas de baptême aux environs de Fontainebleau. Il se leva de table et prenant son fils à part, tout près de l’endroit où je me tenais: «Ecoute, écoute, dit-il, en posant la main sur l’épaule du petit garçon, et souviens-toi de ceci, mon fils.» L’instant d’après il était dehors dans le jardin et je pus l’entendre sangloter dans l’obscurité.
L’humiliation de ses armes et la perte de l’Alsace-Lorraine ont cruellement mis à l’épreuve l’endurance de ce peuple sensible; et les Français ont encore le cœur bouillant de colère, non pas tant contre l’Allemagne que contre l’Empire. En quel autre pays verrez-vous un chant patriotique amener tout le monde dans la rue? Mais l’affliction exalte l’amour; et nous ne sentirons jamais que nous sommes anglais, que 153 le jour où nous aurons perdu les Indes. L’Amérique indépendante est encore le tourment de mon existence. Je ne puis songer sans horreur au fermier Georges[5] et l’ardeur de mes sentiments pour ma patrie n’est jamais plus vive que lorsque je vois la bannière étoilée et que je me rappelle ce qu’aurait pu être notre empire.
Le petit livre du colporteur, que j’achetai, était un curieux mélange. Côte à côte avec les lestes et tapageuses inepties des cafés-concerts de Paris se trouvaient beaucoup de pièces pastorales qui, à mon avis, ne manquaient pas d’une certaine teinte de poésie et respiraient cette brave indépendance qui caractérise la classe pauvre en France. Vous pouviez y voir combien le bûcheron est fier de sa cognée, et combien le jardinier dédaigne d’avoir honte de sa bêche. Elle n’était pas très bien écrite, cette poésie du travail, mais 154 le courage du sentiment rachetait ce qu’il y avait de faible et de verbeux dans l’expression. Les pièces guerrières et les patriotiques d’autre part, étaient, toutes sans exception, des productions larmoyantes et pusillanimes. Le poète avait passé par les Fourches Caudines; il chantait pour une armée, visitant, les armes renversées, le tombeau de son antique renommée; il ne chantait pas la victoire, mais la mort. Dans la collection du colporteur, il y avait un numéro intitulé «Conscrits Français», qui peut se ranger parmi les poésies lyriques les plus propres à dissuader de la guerre que l’on ait conservées. Tout homme dans un pareil état d’esprit serait dans l’impossibilité de se battre. Le conscrit le plus brave pâlirait si l’on entonnait un tel chant à ses côtés le matin de la bataille, et des régiments entiers jetteraient leurs armes, rien que d’en entendre l’air.
Si ce que dit Fletcher de Saltoun de l’influence des chants nationaux est vrai, il faut en conclure que la France était tombée bien bas. 155 Mais du mal sortira le remède, et un peuple d’âme saine et courageuse se fatigue à la longue de geindre sur ses désastres. Déjà P.......... a écrit quelques viriles poésies militaires. Elles ne contiennent pas beaucoup peut-être de ces notes vibrantes qui nous font palpiter le cœur; elles manquent d’élévation lyrique, et leur mouvement est lent; mais elles sont écrites dans un esprit grave et stoïque, qui mènerait les soldats bien loin dans une bonne cause. On sent qu’on confierait volontiers quelque chose à P......... Ce sera un bonheur, s’il parvient à inoculer ses compatriotes au point qu’on puisse leur confier le soin de leur avenir. Et en attendant, ceci est un antidote à «Conscrits Français» et à beaucoup d’autres poésies lugubres.
Nous avions laissé nos bateaux pendant la nuit sous la garde d’un individu que nous appellerons Carnaval. Je n’ai pas bien saisi son nom, et peut-être ne fut-ce pas malheureux pour lui, vu que je ne suis pas à même de 156 le faire passer avec honneur à la postérité? Au cours de la journée, nous nous rendîmes en nous promenant à la remise de cet homme et nous y trouvâmes tout un petit rassemblement inspectant les canoës. Il y avait un gros monsieur très au courant des particularités de la rivière et brûlant de nous en faire part. Il s’y trouvait aussi un jeune homme fort élégant, vêtu de noir, sachant un peu d’Anglais, qui mit aussitôt la conversation sur les régates d’Oxford et de Cambridge. Il y avait encore trois belles jeunes filles de quinze à vingt ans, et un vieillard en blouse, que le manque de dents gênait pour parler et qui avait un fort accent de terroir. Tout à fait l’élite d’Origny, je suppose.
La Cigarette avait quelques arrangements secrets à faire à ses agrès dans la remise; je restai donc seul à faire la parade. Je trouvai que bon gré mal gré, j’avais aux yeux de ces gens beaucoup d’un héros. Les dangers de notre voyage faisaient éprouver aux jeunes filles 157 de petits frissons, et j’aurais eu mauvaise grâce, je pense, à ne pas continuer la conversation sur le terrain que les dames avaient choisi. Ma mésaventure de la veille racontée d’un ton dégagé produisit une profonde impression.
C’était un nouvel Othello avec pas moins de trois Desdémones et quelques sénateurs sympathiques à l’arrière-plan. Jamais les canoës ne reçurent plus de flatteries, ni surtout de flatteries plus délicates.
«On dirait un violon,» s’écria l’une des jeunes filles extasiée.
«Je vous remercie de l’expression, mademoiselle, répliquai-je, d’autant plus qu’il est des gens qui prétendent que cela ressemble à un cercueil.»
«Oh! mais c’est réellement comme un violon. Cela a le fini d’un violon,» continua-t-elle.
«Et le poli d’un violon,» ajouta un sénateur.
«On n’a qu’à tendre les cordes», conclut un autre, «et alors teum-teumté-teum,» fit-il, imitant le résultat avec entrain.
N’était-ce pas là une gracieuse petite ovation? 158 Où ce peuple trouve-t-il le secret de ses gentils propos? Je ne puis me l’imaginer, à moins que le secret ne soit tout bonnement qu’un sincère désir de plaire. Mais aussi en France il n’y a pas de honte à dire les choses nettement; tandis qu’en Angleterre, parler comme un livre, c’est refuser de se résigner aux exigences de la société.
Le vieillard en blouse entra furtivement dans la remise et informa la Cigarette, assez mal à propos, qu’il était le père des trois jeunes filles et de quatre autres encore, un véritable exploit pour un Français.
«Vous êtes bien heureux», répondit poliment la Cigarette.
Et le vieux monsieur, qui était apparemment arrivé à ses fins, s’esquiva.
Nous fûmes bientôt dans les meilleurs termes. Les jeunes filles ne parlaient de rien moins que de partir avec nous le lendemain matin, s’il vous plaît. Et plaisanterie à part, tout le monde désirait vivement savoir l’heure de notre départ. 159 Or, quand on va péniblement se glisser d’un mauvais embarcadère dans son canoë, une foule, pour amie qu’elle soit, n’est guère à désirer. Aussi leur dîmes-nous que nous ne partirions pas avant midi; bien que nous fussions intérieurement décidés à nous en aller à dix heures au plus tard.
Vers le soir nous sortîmes de nouveau pour mettre quelques lettres à la poste. Il faisait frais et bon. A part un ou deux marmots qui nous suivaient comme ils auraient pu suivre une ménagerie, ce long village était absolument désert. Les collines et les cimes des arbres s’élevaient de tous côtés dans l’air clair, et les cloches carillonnaient de nouveau pour un autre office.
Soudain nous aperçûmes les trois jeunes filles, debout avec une quatrième sœur, en face d’un magasin, sur le large trottoir de la grand’route. Nous avions bien ri avec elles peu auparavant, à coup sûr. Mais que voulait l’étiquette à Origny? Si elles s’étaient trouvées dans un chemin de campagne, nous n’aurions naturellement pas 160 hésité à leur parler; mais ici, sous les yeux de toutes les commères, devions-nous même seulement les saluer? Je consultai la Cigarette.
«Regardez», dit-il.
Je regardai. Il y avait bien encore les quatre jeunes filles à la même place; mais à présent, quatre dos étaient tournés vers nous, bien cambrés et conscients de ce qu’ils faisaient. Le caporal Modestie avait donné le mot d’ordre, et le piquet bien discipliné avait fait demi-tour comme un seul homme. Elles gardèrent cette formation tout le temps que nous fûmes en vue; mais nous entendîmes leurs rires étouffés, tandis que celle des jeunes filles que nous n’avions pas rencontrée riait à gorge déployée et même regardait l’ennemi par dessus l’épaule. Je me demande s’il n’y avait là que de la modestie, après tout, ou s’il ne fallait pas y voir une sorte de provocation campagnarde.
Comme nous retournions à l’auberge, nous vîmes flotter quelque chose dans le vaste champ du ciel, que dorait le soleil couchant, par dessus 161 les falaises crayeuses et les arbres qui les couronnent. C’était trop haut, trop grand et trop immobile, pour que ce fût un cerf-volant; et comme c’était noir, ce ne pouvait pas être une étoile. En effet, quand bien même une étoile serait noire comme de l’encre et rugueuse comme une noix, le soleil baigne si abondamment le ciel de ses rayons qu’elle serait pour nous aussi étincelante qu’une source de lumière. Le village était parsemé de gens qui regardaient en l’air. Les enfants étaient en révolution tout le long de la rue et bien loin sur la route droite qui gravit la colline, où nous pouvions encore les voir courir en groupes détachés. C’était un ballon, apprîmes-nous, qui avait quitté Saint-Quentin ce soir-là, à cinq heures et demie. C’est avec le plus grand calme que la majorité des grandes personnes prenaient la chose. Mais nous étions anglais et nous fûmes bientôt à courir au haut de la colline avec les plus rapides. Voyageurs nous aussi, quoique en petit, nous aurions 162 voulu voir descendre ces autres voyageurs. Le spectacle était fini, lorsque nous atteignîmes le sommet de la colline. Le ciel avait perdu tout l’éclat de ses teintes dorées, et le ballon avait disparu. Où? je me le demande; enlevé dans le septième ciel? ou descendu à terre sans accident, quelque part dans cette étendue bleue irrégulière, où la grand’route allait se plonger et se fondre à nos yeux? Les aéronautes étaient probablement déjà à se chauffer devant une cheminée de ferme; car on dit qu’il fait froid dans ces régions inhospitalières de l’air. La nuit tombait rapidement. Les arbres du bord de la route et les curieux désappointés, revenant à travers les prairies, se détachaient en noir sur la petite bande rouge du soleil couchant. L’autre côté présentait un spectacle plus gai. Nous descendîmes donc la colline, avec la pleine lune, de la couleur d’un melon, suspendue bien haut au dessus de la vallée boisée, et derrière nous, les blanches falaises que teintait légèrement de rouge le feu des fours à chaux.
163
Les lampes étaient allumées et, tout le long de la rivière, dans Origny-Sainte-Benoîte, les ménagères préparaient la salade du souper.
Nos Compagnons de Table
Malgré notre arrivée tardive au dîner, nos compagnons de table nous offrirent du vin mousseux. «Voilà comme nous sommes en France», dit l’un d’entre eux. «Ceux qui s’asseyent à notre table sont nos amis.» Et les autres d’applaudir.
Ils étaient trois en tout; trio bizarre que ces gens avec qui nous devions passer le dimanche.
Deux d’entre eux étaient des hôtes comme nous. Tous deux étaient du Nord. L’un vermeil et replet, la barbe et la chevelure épaisses et noires, l’intrépide chasseur de France, qui revendiquait comme une prouesse la prise d’une alouette ou de tout autre menu gibier si petit qu’il fût. 165 Pour un homme si grand, si bien portant, dont la chevelure n’avait rien à envier à celle de Samson, aux artères charriant des seaux de sang rouge, se vanter de ces exploits infinitésimaux produisait aux yeux de tous un sentiment de disproportion semblable à celui que produirait un marteau-pilon employé à casser des noisettes. L’autre était un homme tranquille et résigné, blond, lymphatique et triste, quelque peu l’air d’un Danois: «Tristes têtes de Danois!» comme avait coutume de dire Gaston Lafenestre.
Je ne dois pas laisser passer ce nom sans un mot pour le meilleur de tous les bons garçons, maintenant descendu dans la tombe. Nous ne verrons plus jamais Gaston dans son costume de forêt—tout le monde l’appelait Gaston, non par manque de respect, mais par affection,—nous ne l’entendrons plus jamais réveiller les échos de Fontainebleau des sons du cor de chasse, jamais plus son bon sourire ne fera la paix parmi les artistes de toutes 166 races et ne mettra l’Anglais à l’aise en France comme en son pays. Jamais plus les moutons, qui n’étaient pas plus doux que lui, ne poseront inconsciemment pour son laborieux crayon. Il mourut trop prématurément, au moment où, tel un jeune arbre qui pousse de frais bourgeons et donne ses premières fleurs, il commençait à produire des choses dignes de lui. Et cependant aucun de ceux qui l’ont connu ne pensera qu’il a vécu en vain. Je n’ai jamais connu un homme si petit, pour qui cependant j’ai éprouvé une si vive affection. J’ai la preuve que les autres éprouvaient le même sentiment, quand je vois jusqu’à quel point ils avaient appris à le comprendre et à l’estimer. Elle fut grande, certes, l’influence qu’il exerça, tant qu’il se trouva parmi nous; il avait un rire frais; cela vous faisait du bien de le voir: et quelque tristesse qu’il ait pu avoir au cœur, il montrait toujours une physionomie pleine d’audace et d’entrain et prenait les pires coups de la fortune comme les averses 167 du printemps. Mais à présent, sa mère est assise seule à la lisière de la forêt de Fontainebleau, où il cueillait des champignons au temps de sa jeunesse difficile et pauvre.
Beaucoup de ses tableaux trouvèrent acquéreurs de l’autre côté de la Manche, outre ceux qui lui furent volés, lorsqu’un lâche Yankee l’abandonna seul à Londres avec, pour toute ressource, quatre sous anglais dans sa poche et peut-être deux fois autant de mots d’anglais. Si parmi ceux qui liront ces lignes, il est quelqu’un qui ait une étude de moutons, à la manière de Jacques, signée de ce brave garçon, qu’il se dise que l’un des plus bienveillants et des plus honnêtes des hommes a contribué à décorer sa demeure. Il se peut qu’il y ait de meilleurs tableaux à l’académie de peinture; mais parmi les générations de peintres, pas un n’eut meilleur cœur. Précieuse aux yeux du maître de l’humanité, nous disent les psaumes, est la mort de ses saints. Elle devait être bien précieuse, car elle coûte très cher, la mort, 168 quand par un coup du sort, elle laisse une mère dans la désolation et fait descendre au tombeau avec César et les douze apôtres celui qui mettait la paix dans une société et veillait à l’y maintenir.
Il y a quelque chose qui manque parmi les chênes de Fontainebleau; et quand on apporte le dessert à table, à Barbizon, tous les regards convergent vers la porte dans l’attente d’une figure disparue.
Le troisième de nos compagnons à Origny n’était rien moins que le mari de l’hôtesse; pas l’hôte à proprement parler, puisqu’il travaillait lui-même dans une fabrique pendant le jour et qu’il ne venait dans sa maison à lui que le soir, en qualité de pensionnaire; un homme usé par une excitation perpétuelle, au point de n’avoir plus que la peau et les os, presque chauve, les traits anguleux, les yeux vifs et brillants. Samedi, en décrivant une aventure insignifiante advenue dans une chasse au canard, il cassa une assiette en mille pièces. Chaque fois 169 qu’il faisait une remarque, il regardait tout autour de la table, le menton levé, une étincelle de lumière verte dans les yeux, en quête d’approbation. Son épouse paraissait de temps en temps à la porte de la salle, où elle surveillait le dîner, avec un «Henri, vous vous oubliez», ou un «Henri, vous pouvez assurément causer sans faire tant de bruit.» En vérité c’était là une chose que le brave garçon ne pouvait faire. A la chose la plus insignifiante ses yeux s’enflammaient, son poing massacrait la table et sa voix grondait, retentissante comme les roulements du tonnerre. Je n’ai jamais vu un homme pareil: un vrai feu d’artifice. Je crois qu’il avait le diable au corps. Il avait deux expressions favorites: «C’est logique» ou «c’est illogique», suivant les cas; et cette autre, qu’il lança avec un certain air de bravade, comme on pourrait déployer une bannière, au commencement de plus d’une longue et ronflante histoire: «Je suis un prolétaire, vous voyez». En vérité nous le voyions très bien. Dieu me garde de 170 le rencontrer un fusil à la main dans les rues de Paris! Ce sera un mauvais quart d’heure pour tout le monde.
Ses deux phrases représentaient très bien, pensai-je, ce qu’il y a de bon et de mauvais dans sa classe et jusqu’à un certain point dans son pays. C’est une excellente chose de dire ce que l’on est sans en rougir, bien qu’il soit d’un goût douteux de le répéter trop souvent dans une soirée. Je n’admirerais pas cela chez un duc, naturellement; mais par le temps qui court, le trait est honorable chez un ouvrier. D’autre part, ce n’est pas du tout une excellente chose de s’appuyer sur la logique et sur notre logique en particulier; car elle est généralement erronée. Nous ne savons jamais où nous devons finir, une fois que nous commençons à suivre les mots et les docteurs. Il existe au cœur même de l’homme un fond de loyauté plus digne de confiance que tout syllogisme, et les yeux, comme les sympathies et les appétits, savent une ou deux choses qui n’ont pas encore 171 été controversées. Des raisons, il y en a autant que de grains de sable dans le désert, et comme les coups de poing, elles servent impartialement tous les partis. Ce n’est pas à leurs preuves que les doctrines doivent leur maintien ou leur chute, et elles ne sont logiques qu’autant qu’elles sont intelligemment appliquées. Un habile controversiste, pas plus qu’un habile général, ne démontre la justice de sa cause. Mais la France est partie tout entière à la remorque de deux ou trois grands mots et il se passera quelque temps avant qu’elle ne reconnaisse que ce ne sont que des mots, quelque grands qu’ils soient; et une fois cela fait, peut-être trouvera-t-elle la logique moins divertissante.
Les détails de la journée de chasse firent les premiers frais de la conversation. Quand tous les chasseurs d’un village chassent pro indiviso sur le territoire du village, il est évident qu’il doit surgir bien des questions d’étiquette et de priorité.
«Supposez», s’écriait l’hôte brandissant une 172 assiette, «que voici un champ de betteraves. Bon! Moi, je suis ici. J’avance, n’est-ce pas? Eh bien! sacristi!» et le récit, devenant plus bruyant, de se précipiter en un feu roulant de jurons retentissants, pendant que l’orateur promène autour de la table ses regards fiévreux, en quête de sympathie, et que chacun, pour avoir la paix, incline la tête en signe d’assentiment.
L’homme du nord au teint vermeil nous raconta quelques-unes de ses prouesses dans le maintien de l’ordre; notamment son aventure avec un marquis.
«Marquis» dis-je, «un pas de plus et je vous brûle la cervelle. Vous avez commis une vilenie, marquis.»
Là-dessus, paraît-il, le marquis porta la main à sa casquette et se retira.
L’hôte applaudit bruyamment. «A la bonne heure,» dit-il. «Il a fait tout ce qu’il pouvait faire. Il a admis qu’il avait tort.» Puis une avalanche de jurons. Lui non plus n’aimait pas 173 les marquis, mais il avait en lui le sentiment de la justice, ce prolétaire qu’était notre hôte.
Des sujets de chasse la conversation passa insensiblement à une comparaison entre Paris et la province. Et le prolétaire de faire retentir la table comme un tambour sous une volée de coups de poing à la louange de Paris. «Qu’est-ce que c’est que Paris? Paris, c’est la crème de la France. Il n’y a pas de Parisiens; c’est tout le monde, c’est vous, c’est moi qui sommes les Parisiens. On a quatre-vingt-dix-neuf chances sur cent de faire son chemin à Paris.» Et il traça un tableau animé de l’ouvrier, dans un réduit pas plus grand qu’une niche à chien, fabriquant des articles qui devaient se répandre dans le monde entier. «Eh bien! quoi, c’est magnifique ça!» s’écria-t-il.
L’homme du nord à l’air triste intervint pour faire l’éloge de la vie du paysan; il pensait Paris mauvais pour les hommes et les femmes. «La centralisation,» disait-il...
Mais l’hôte lui coupa brutalement la parole. 174 C’était tout ce qu’il y avait de plus logique, lui montra-t-il, tout ce qu’il y avait de plus magnifique. «Quel spectacle! quel coup d’œil!» Et les plats de danser sur la table sous une canonnade de coups.
Dans le dessein de faire la paix, je hasardai quelques mots à la louange de la liberté d’opinion en France. Je n’aurais guère pu tomber plus mal. Il y eut un silence soudain, et tous hochèrent la tête d’une façon significative. Ils ne goûtaient évidemment pas le sujet, et ils me donnèrent à entendre que le triste homme du nord était un martyr de ses opinions. «Demandez-lui un peu,» dirent-ils. «Oui, demandez-lui un peu.»
«Oui, monsieur,» fit-il de son air calme, me répondant, bien que je n’eusse pas parlé. «J’ai bien peur qu’il n’y ait moins de liberté d’opinion en France que vous vous l’imaginez.» Là-dessus, il baissa les yeux et sembla considérer le sujet comme épuisé.
Ceci excita vivement notre curiosité. Comment 175 ou pourquoi, ou quand ce commis-voyageur lymphatique avait-il été martyrisé? Nous conclûmes immédiatement que c’était à cause de quelque question religieuse et nous évoquâmes nos souvenirs de l’Inquisition, tirés principalement de l’horrible histoire de Poë et du sermon qu’on trouve dans Tristram Shandy, je crois.
Le lendemain nous eûmes l’occasion d’approfondir la question; car, levés de très bonne heure pour éviter toute démonstration de sympathie à notre départ, nous trouvâmes notre héros debout avant nous. Il déjeunait de vin blanc et d’oignons crus, afin sans doute de rester dans son rôle de martyr. Nous eûmes avec lui une longue conversation et, en dépit de sa réserve, nous découvrîmes ce que nous voulions. Mais voici quelque chose de vraiment curieux. Il semble possible que deux Ecossais et un Français discutent pendant une longue demi-heure et qu’ils aient, chacun selon sa nationalité, une idée différente en vue pendant tout ce temps. 176 Ce ne fut que tout à fait à la fin, que nous découvrîmes que son hérésie avait été une hérésie politique, ou qu’il soupçonna notre méprise. Les termes et l’esprit dans lesquels il parlait de ses croyances politiques étaient, à nos yeux, appropriés aux croyances religieuses. Et vice versa.
Rien ne saurait mieux caractériser les deux pays. La politique est la religion de la France; «satanée religion», comme aurait dit Nanty Ewart; tandis que nous, dans notre pays, nous réservons la majeure partie de notre acharnement pour toutes les divergences d’opinion sur un livre d’hymnes ou sur un mot hébreu, que peut-être aucun des adversaires ne saurait traduire. Et peut-être, cette conception fausse est-elle le type de beaucoup d’autres, qui peuvent n’être jamais redressées, non seulement entre gens de races différentes, mais entre gens de sexes différents.
Quant au martyre de notre ami, voici ce qu’il en était. Cet homme était un Communiste ou peut-être 177 seulement un Communard, ce qui est chose bien différente. Cela lui avait fait perdre plus d’une situation. Je crois qu’il avait aussi essuyé un refus dans une demande en mariage; mais peut-être avait-il une façon sentimentale de considérer les affaires qui me trompa. C’était quoiqu’il en soit, une créature douce et paisible et j’espère que depuis lors, il a obtenu une meilleure situation et épousé une femme plus digne de lui.
En Route pour Moy
Carnaval commença par nous exploiter d’une façon notoire. Nous trouvant de facile composition, il regretta de nous avoir laissés partir à si bon compte, et me prenant à part, il me débita une histoire à dormir debout avec, pour morale, une autre pièce de cent sous à donner au narrateur. L’absurdité de la chose sautait aux yeux; je payai cependant. Mais abandonnant aussitôt toute cordialité, je le tins à sa place, comme un inférieur, avec une dignité glaciale toute britannique. Il vit en un instant qu’il était allé trop loin et qu’il avait tué la poule aux œufs d’or. Sa figure s’allongea; je suis sûr qu’il m’aurait remboursé, s’il avait seulement pu imaginer un prétexte convenable. Il m’invita à boire avec lui, mais je ne voulus rien accepter. 179 Il devint d’une tendresse pathétique dans ses déclarations, mais je marchai silencieux à côté de lui, ou je lui répondis avec une politesse hautaine, et en arrivant au débarcadère, je donnai le mot à la Cigarette en argot anglais.
Malgré la fausse piste que nous avions indiquée la veille, il pouvait bien y avoir cinquante personnes sur le pont. Nous nous montrâmes aussi aimables que possible avec tous, sauf avec Carnaval. Nous fîmes nos adieux et nous donnâmes une poignée de mains au vieux monsieur qui connaissait la rivière et au jeune homme qui savait un peu d’anglais; mais pour Carnaval, pas un mot. Pauvre Carnaval, voilà qui était une humiliation! Lui qui s’était si bien identifié avec les bateaux, qui avait donné des ordres en notre nom, qui avait exhibé les canoës, et même les canotiers, comme une exposition particulière de choses lui appartenant, se voir à présent ainsi couvert de honte en public par les lions de sa caravane! Je n’ai jamais vu personne l’air plus penaud. Il restait 180 derrière, en suspens, s’avançant timidement de temps à autre, lorsqu’il croyait à quelque symptôme que notre humeur s’adoucissait, et se reculant à la hâte lorsqu’il rencontrait un regard froid. Espérons que cela lui servira de leçon.
Je n’aurais pas mentionné la peccadille de Carnaval si la chose n’avait été si rare en France. Ce fut, par exemple, le seul cas où dans tout notre voyage on n’agit pas avec probité à notre égard, et même où on nous écorcha un peu. Nous parlons beaucoup de notre probité en Angleterre. Eh bien! il est bon de se tenir sur ses gardes partout où l’on entend de grandes déclarations sur un très petit trait de vertu. Si les Anglais pouvaient seulement entendre comment on parle d’eux à l’étranger, ils pourraient rester chez eux, pendant un certain temps, pour remédier à cet état de choses, et peut-être, même après cela, faire moins leurs embarras.
Les jeunes demoiselles, les grâces d’Origny, 181 n’assistaient pas à notre départ; mais, lorsque après un tournant, nous atteignîmes le second pont, ah! mon Dieu! le pont était noir de curieux. Nous fûmes bruyamment acclamés, et des garçons et des filles nous accompagnèrent pendant un bon moment, en courant le long de la rive sans cesser leurs acclamations. Le courant aidant nos pagaies, nous allions comme des hirondelles. Ce n’était pas une petite affaire que d’aller de conserve avec nous sur la rive boisée. Mais les filles se retroussèrent comme si elles étaient sûres d’avoir la jambe bien faite, et nous suivirent jusqu’au moment où elles furent hors d’haleine. Les dernières à se fatiguer furent les trois grâces et deux de leurs compagnes. Et lorsqu’elles en eurent assez elles aussi, celle des trois qui tenait la tête, sauta sur une souche d’arbre et de la main envoya un baiser aux canotiers. Diane elle-même, bien que notre jeune fille eût plutôt l’air d’une Vénus, n’aurait pu faire une chose gracieuse plus gracieusement. «Revenez encore,» s’écria-t-elle; 182 et les autres lui firent écho, et les collines autour d’Origny répétèrent: «Revenez». Mais la rivière nous fit tourner à un coude en un clin d’œil, et nous fûmes seuls avec les arbres verts et l’eau courante.
Revenir? On ne revient pas, mes jeunes demoiselles, sur l’impétueux courant de la vie.
Et tous nous devons régler nos montres sur l’horloge du destin. Il y a un flot impétueux, irrésistible, qui emporte l’homme et ses fantaisies comme un fétu et court rapide au sein du temps et de l’espace. Elle est pleine de détours, comme ce flot, votre sinueuse rivière de l’Oise; elle s’attarde et retourne dans de charmants sites agrestes; et cependant, si on y songe bien, elle ne retourne jamais, jamais. En effet, quand bien même elle revisiterait le même arpent de prairie dans la même heure, elle aura décrit une vaste courbe entre-temps; beaucoup de petits ruisseaux s’y seront jetés; le soleil aura pompé une grande partie de ses eaux; et quand 183 même ce serait le même arpent, ce ne sera plus la même rivière Oise. Et ô grâces d’Origny, quand bien même la fortune vagabonde de ma vie me ramènerait aux lieux où vous attendez l’appel de la mort au bord de la rivière, ce ne sera plus le vieux moi qui parcourra la rue; et ces épouses et ces mères, dites, est-ce que ce sera vous?
Il n’y avait positivement pas à se tromper sur l’Oise. Dans ces parties supérieures de son cours, elle était toujours prodigieusement pressée d’atteindre la mer. Elle courait si vite et si allègre à travers tous les méandres de son lit, que je me foulai le pouce en luttant avec les rapides et qu’il me fallut pagayer tout le reste du parcours une main retournée. Parfois elle devait desservir des moulins et comme elle n’était encore qu’une petite rivière, ses eaux très basses couraient dans l’intervalle, laissant à sec une bonne partie de son lit. Il nous fallait sortir les jambes du bateau, et à l’aide des pieds nous pousser hors des sables 184 du fond. Et cependant elle continuait son chemin, chantant parmi les peupliers et faisant une verte vallée dans le monde. Après une bonne femme, un bon livre et du tabac, il n’est rien sur terre d’aussi agréable qu’une rivière. Je lui ai pardonné d’avoir attenté à ma vie; après tout cela était imputable en partie aux vents déchaînés du ciel qui avaient abattu l’arbre, en partie à la mauvaise direction que j’avais imprimée à mon canoë, et pour une tierce partie seulement, à la rivière elle même; encore n’était-ce pas par méchanceté, mais par suite de sa grande préoccupation à atteindre la mer. Et ce n’était pas peu de chose, car les détours qu’elle avait à faire sont innombrables. Les géographes semblent avoir renoncé à les noter, car je n’ai trouvé aucune carte qui représentât les méandres sans fin de son cours. Un fait en dira plus qu’aucun d’entre eux. Après avoir, pendant quelques heures, trois si je ne me trompe, filé le long des arbres à ce galop de casse-cou toujours le même, quand nous 185 arrivâmes dans un hameau et que nous demandâmes où nous étions, nous n’étions pas à plus de quatre kilomètres d’Origny. Si ce n’avait été pour l’honneur de la chose (selon le dicton écossais), il eût presque autant valu ne pas bouger.
Nous mangeâmes un morceau dans une prairie au milieu d’un parallélogramme de peupliers. Les feuilles dansaient et babillaient dans le vent tout autour de nous. La rivière pendant ce temps continuait à se hâter et semblait gronder contre notre retard. Peu nous importait. La rivière savait où elle allait; nous, pas; d’autant moindre était notre hâte, là où nous trouvions d’agréables séjours et un théâtre riant pour fumer une pipe. A cette heure les agents de change étaient à vociférer à la Bourse de Paris pour le deux ou le trois pour cent. Mais nous ne nous inquiétions pas plus d’eux que du cours d’eau qui glissait à nos pieds et nous sacrifiions une hécatombe de minutes aux dieux du tabac et de la digestion. La hâte est la ressource de ceux 186 qui manquent de foi. Pour un homme qui a confiance en son propre cœur ainsi qu’en celui de ses amis, demain est aussi bon qu’aujourd’hui. Et s’il meurt dans l’intervalle, eh bien! il meurt, voilà tout, et la question est résolue.
Il nous fallut prendre le canal au cours de l’après-midi, parce que, à l’endroit où il traverse la rivière, il y avait non pas un pont, mais un siphon. Sans un énergumène qui se trouvait sur la rive, nous filions droit dans le siphon, et c’en était dès lors fini pour nous de pagayer. Sur le chemin de halage nous rencontrâmes un homme, un monsieur, que notre voyage intéressa beaucoup. Et je fus témoin d’une étrange «attaque de mensonge» qu’eut la Cigarette. Celui-ci, parce que son couteau venait de Norvège, raconta toutes sortes d’aventures de ce pays, où il n’avait jamais mis les pieds. Il avait tout à fait la fièvre à la fin, et il allégua qu’il était possédé du démon.
Moy (prononcez Moÿ) était un charmant petit village, groupé autour d’un château dans un 187 bas-fond. L’air était parfumé du chanvre des champs avoisinants. Au Mouton d’Or nous fûmes parfaitement traités. Des obus allemands venant du siège de la Fère, des figurines de Nuremberg, des poissons rouges dans un bocal et toutes sortes de bibelots embellissaient la salle publique. L’aubergiste était une bonne grosse mère, toute simple et myope; il s’en fallait de fort peu qu’elle ne fût un vrai cordon bleu. Elle se doutait un peu elle-même de ses hautes capacités. Après avoir envoyé chaque plat, elle venait dans la salle inspecter un instant le dîner, de ses yeux ridés et clignotants: «c’est bon, n’est-ce pas?» disait-elle. Et lorsqu’elle avait reçu une réponse convenable, elle disparaissait dans la cuisine. Ce plat tout ordinaire en France, des perdrix aux choux, devint une chose nouvelle à mes yeux, au Mouton d’Or. Cela eut pour conséquence de me procurer d’amers désappointements dans beaucoup de dîners subséquents. Bien doux fut notre repos au Mouton d’Or à Moy.
Nous nous attardâmes à Moy une bonne partie de la journée, car nous aimions à philosopher et par principe, nous détestions de faire de longues étapes et de partir de grand matin. L’endroit en outre invitait au repos. Des gens en costume de chasse soigné sortaient du château avec des fusils et des gibecières; et c’était réellement un plaisir de rester derrière, pendant que ces élégants chercheurs de plaisirs choisissaient la première heure du jour pour s’amuser. De cette façon tout le monde peut être aristocrate et jouer le duc parmi les marquis et le monarque régnant parmi les ducs, s’il ne veut que les surpasser en tranquillité. Un maintien imperturbable vient d’une patience parfaite. Les esprits calmes ne sont sujets ni à la perplexité ni à la crainte; mais ils continuent, dans la 189 fortune comme dans l’infortune, à marcher leur pas, comme une horloge pendant les coups de tonnerre d’un orage.
Nous mîmes une toute petite journée pour nous rendre à la Fère; mais le crépuscule tombait et une petite pluie avait commencé, que nous n’avions pas encore remisé les bateaux. La Fère est une ville fortifiée dans une plaine; elle possède une double ceinture de remparts. Entre la première et la seconde s’étend une région de terrains incultes et de parcelles cultivées. Çà et là le long de la route, se trouvaient des affiches défendant au nom du génie militaire d’y pénétrer. Enfin une seconde porte nous donna accès dans la ville elle-même. Les fenêtres éclairées respiraient la gaieté, et des bouffées de bonne cuisine s’en échappaient, imprégnant l’air. La ville était pleine de réservistes, en route pour les grandes manœuvres, et les soldats marchaient rapidement, vêtus de leurs formidables capotes. Splendide, cette soirée, pour qui la passerait à l’abri à dîner et à écouter la pluie sur les fenêtres.
190
Nous ne pouvions la Cigarette et moi assez nous féliciter de cette perspective, car on nous avait dit qu’il y avait un hôtel hors ligne à la Fère. Nous allions faire un si bon dîner! dormir dans de si bons lits! et pendant tout ce temps, la pluie «pleuvrait» sur les gens sans abri par toute cette région couverte de peupliers. Cela nous faisait venir l’eau à la bouche. L’hôtel portait le nom de quelque animal des bois, cerf ou biche, j’ai oublié lequel. Mais je n’oublierai jamais comme il nous parut spacieux et éminemment habitable, lorsque nous en fûmes tout près. La porte cochère était vivement illuminée, non par intention, mais grâce à la simple superfluité des feux et des lumières de la maison. Un bruit de nombreux plats entrechoqués arrivait à nos oreilles. Une nappe vaste comme un champ s’offrait à nos regards; la cuisine avait l’éclat d’une forge et fleurait comme un jardin de choses à manger.
C’est dans cette cuisine, sanctuaire intime et cœur physiologique d’une hôtellerie, avec 191 tous ses fourneaux en action, tous ses dressoirs chargés de viandes, que vous devez à présent nous supposer faisant notre entrée triomphale, tels deux marchands de chiffons et d’os, mouillés, et portant chacun à la main un sac de caoutchouc souple. Je ne crois pas avoir une image bien exacte de cette cuisine; mais elle me parut remplie des nombreuses calottes blanches des cuisiniers, qui tous se retournèrent de dessus leurs casseroles et nous regardèrent avec surprise. Nul doute quant à la patronne, néanmoins; elle était là, commandant son armée, la face empourprée, l’air courroucé, ne sachant où donner de la tête. A elle je demandai poliment,—trop poliment, au dire de la Cigarette—, si nous pouvions avoir des chambres; elle, cependant, nous toisant froidement de la tête aux pieds.
«Vous trouverez des chambres dans le faubourg», fit-elle remarquer. «Nous avons trop à faire pour nous occuper de pareils à vous.»
192
Si nous pouvions entrer, changer de vêtements et commander une bouteille de vin, j’avais la certitude de pouvoir arranger les choses. Aussi dis-je: «Si nous ne pouvons coucher, rien ne s’oppose du moins à ce que nous dînions,» et j’allais déposer mon sac.
Terrible fut la convulsion de la nature qui se produisit alors dans le visage de la patronne. Elle se précipita vers nous, et frappant du pied: «Sortez! sortez! à la porte!» vociféra-t-elle.
Je ne sais comment cela se fit; mais l’instant d’après, nous étions dehors, sous la pluie et dans les ténèbres, et je maugréais devant la porte cochère comme un mendiant désappointé. Où étaient les canotiers belges? où, le juge et ses bons vins? où, les grâces d’Origny? Noire, noire était la nuit après la cuisine flamboyante; mais qu’est-ce que c’était auprès de la noire tristesse qui régnait dans nos cœurs? Ce n’était pas la première fois qu’on refusait de me loger. Maintes et maintes fois, j’ai projeté 193 ce que je ferais, si pareille mésaventure m’arrivait encore. Et rien n’est plus facile à projeter. Mais quant à mettre cela à exécution, le cœur tout bouillant devant l’outrage, essayez un peu, une fois seulement, et vous me direz ce que vous avez fait.
C’est fort beau de parler de vagabonds et de moralité. Soyez seulement six heures sous la surveillance de la police, comme cela m’est arrivé, ou qu’on vous chasse brutalement d’un hôtel, vous verrez si cela ne change pas vos vues sur le sujet aussi bien qu’une série de conférences. Tant que vous restez dans les régions supérieures, tout le monde s’inclinant devant vous sur votre passage, il semble que tout est pour le mieux dans les arrangements de la société; mais que vous vous trouviez une fois sous les roues, et vous enverrez la société à tous les diables. Je donne quinze jours d’une pareille existence aux gens les plus respectables; après quoi, je n’offrirai pas un rouge liard de ce qui leur restera de moralité.
194
Pour ma part, lorsque je fus jeté hors de l’hôtel du Cerf, ou de la Biche, ou de quoi que ce fût, j’aurais mis le feu au temple de Diane, s’il eût été à ma portée. Il n’y avait pas de crime assez complet pour exprimer ma désapprobation des institutions humaines. Quant à la Cigarette, je n’ai jamais vu un homme si changé. «On nous a encore pris pour des marchands,» dit-il. «Grand Dieu, qu’est ce que ce doit être, quand on est réellement un marchand?» Chacune des parties du corps de l’hôtesse était pour lui un sujet de plaintes. Timon était un philanthrope comparé à lui. Et quand il était au plus haut point de sa parabole de malédictions, il s’interrompait soudain et se mettait d’une voix larmoyante à prendre les pauvres en commisération. «Plaise à Dieu,» disait-il, et je ne doute pas que sa prière n’ait été exaucée, «que je ne manque jamais de politesse envers un marchand!» Etait-ce là l’imperturbable Cigarette? Etait-ce bien lui? Ô changement qui dépasse tout ce qu’on peut dire, penser ou croire!
195
Pendant ce temps le ciel pleurait sur nos têtes, et les fenêtres devenaient plus brillantes à mesure que croissait l’obscurité de la nuit. Nous nous traînions péniblement par les rues de la Fère; nous voyions des magasins et des maisons particulières où des gens dînaient copieusement; nous voyions des écuries où des chevaux de trait avaient le foin et la paille fraîche en abondance; nous voyions quantité de réservistes, qui se désolaient beaucoup de leur sort par cette nuit humide, je n’en doute pas, et soupiraient après leurs foyers rustiques. Mais chacun d’eux n’avait-il pas sa place dans les casernes de la Fère? Et nous, qu’avions-nous?
Il semblait qu’il n’y eût pas d’autre hôtel dans la ville entière. On nous donnait des indications que nous suivions de notre mieux avec, pour résultat, en général, de nous ramener sur le théâtre de notre disgrâce. Nous étions tout ce qu’il y avait de plus navrés, pendant que nous parcourions la Fère, et la Cigarette avait 196 déjà résolu de se coucher sous un peuplier et de dîner à même une miche de pain. Mais juste à l’autre extrémité, la maison qui fait suite à la porte de la ville était pleine de lumière et d’agitation: «A la croix de Malte. Bazin, aubergiste, loge à pied». Telle était l’enseigne. Là nous fûmes reçus.
La salle était pleine de bruyants réservistes qui buvaient et fumaient; et nous fûmes au comble de la joie, lorsque les tambours et les clairons se mirent à parcourir les rues et que tous les soldats sans exception durent saisir vivement leurs shakos et partir à la hâte pour leurs casernes.
Bazin était un homme de haute taille, avec une tendance marquée à l’embonpoint, à la voix douce, au visage délicat et paisible. Nous lui demandâmes de prendre un verre de vin avec nous, mais il refusa donnant pour excuse qu’il avait fait raison aux réservistes toute la journée. Il constituait un type d’ouvrier aubergiste, bien différent de l’individu braillard et 197 disputeur d’Origny. Lui aussi aimait Paris, où il avait travaillé comme peintre décorateur dans sa jeunesse. Il y avait là de telles occasions de s’instruire par soi-même, disait-il. Et pour celui qui aurait lu la description par Zola de la noce de l’ouvrier visitant le Louvre, il serait bon d’avoir entendu Bazin en manière d’antidote. Il avait fait ses délices des musées dans sa jeunesse. «On y voit de petits miracles de travail», disait-il; «c’est ce qui forme un bon ouvrier; cela fait jaillir une étincelle.» Nous lui demandâmes comment il vivait à la Fère. «Je suis marié», dit-il, «et j’ai mes jolis enfants. Mais franchement ce n’est pas une vie. Du matin au soir je fais raison à des tas d’assez braves gens qui ne savent rien».
Avec la nuit le temps s’éclaircit et la lune sortit des nuages. Nous étions assis devant la porte, causant doucement avec Bazin. Au corps de garde, en face, la garde devait continuellement présenter les armes, car les trains d’artillerie de campagne ne cessaient de rentrer en ville à 198 grand fracas émergeant de la nuit, ou des patrouilles de cavaliers passaient au trot, enveloppés dans leurs manteaux. Madame Bazin sortit un moment après. Fatiguée d’avoir travaillé toute la journée, je suppose, elle se blottit amoureusement contre son mari, appuyant la tête contre sa poitrine. Lui avait son bras autour du cou de sa femme et ne cessait de lui tapoter gentiment l’épaule. Je pense que Bazin avait raison et qu’il était réellement marié. De combien peu de gens en peut-on dire autant!
Les Bazin ne surent guère jusqu’à quel point ils nous furent précieux. Ils nous comptèrent la chandelle, la nourriture et la boisson, et les chambres où nous dormîmes. Mais la note ne mentionnait pas la conversation agréable du mari, ni le joli spectacle de leur vie conjugale. Et (autre chose encore qu’ils ne nous firent pas payer) leur politesse nous releva réellement dans notre propre estime. Nous avions soif de considération; toute saignante encore était la plaie que l’insulte avait laissée dans nos cœurs 199 et la politesse avec laquelle on nous traitait semblait nous rendre le rang que nous avions dans le monde.
Comme nous payons peu notre passage dans la vie! Bien que nous ayons continuellement la bourse à la main, la meilleure partie du service reste sans rémunération. Mais j’aime à croire qu’une âme reconnaissante donne autant qu’elle reçoit. Peut-être les Bazin surent-ils combien je les aimais? Peut-être furent-ils, eux aussi, guéris de quelques manques d’égards par les remerciements que je leur fis à ma façon?
A Travers la Vallée Dorée
En aval de la Fère la rivière court à travers une étendue de libre campagne pastorale, verte, opulente, chère aux éleveurs, nommée la Vallée dorée. Les eaux en larges nappes vont sans cesse d’un galop rapide et régulier visiter les champs et leur donner la verdure. Des vaches, des chevaux et de petits baudets capricieux broutent ensemble dans les prairies et descendent en troupes au bord de la rivière pour s’abreuver. Ils font un effet étrange dans le paysage, surtout lorsqu’on les voit, saisis de peur, galoper çà et là avec leurs formes et leurs faces peu harmonieuses. Cela semble donner la sensation des vastes pampas que rien ne limite et des troupeaux des peuples nomades. Dans le lointain à droite et à gauche 201 s’élevaient des collines; et d’un côté, la rivière bordait parfois les contreforts boisés de Coucy et de Saint-Gobain.
L’artillerie faisait les écoles à feu à la Fère; et bientôt le canon du ciel se joignit à ce jeu bruyant. Deux continents de nuages se rencontrèrent et échangèrent des salves par dessus notre tête; tandis que tout autour de l’horizon nous pouvions voir le soleil briller dans l’air limpide sur les collines. Les coups de canon et les roulements de tonnerre semèrent l’épouvante parmi tous les troupeaux de la vallée dorée. Nous pûmes les voir remuer la tête et courir çà et là craintifs et indécis; puis leur résolution une fois prise, quand le baudet suivit le cheval et la vache le baudet, nous pûmes entendre le tonnerre de leurs sabots résonner bien loin sur les prairies. Cela avait un son martial, comme les charges de cavalerie. Et somme toute, en ce qui concerne l’ouïe, nous eûmes une très émouvante pièce guerrière représentée pour notre amusement.
202
Enfin le bruit des canons et du tonnerre cessa; le soleil brillait sur les prairies humides; l’air était embaumé de l’haleine des arbres et du gazon joyeux; et la rivière continuait infatigablement à nous porter en avant de son pas le plus rapide. Il y avait un district manufacturier aux environs de Chauny, et après cela, les berges s’élevaient si haut qu’elles cachaient le pays adjacent et que nous ne pouvions plus rien voir que l’argile des bords et les saules l’un après l’autre. Seulement, çà et là nous passions auprès d’un village ou d’un bac, et un enfant sur la rive fixait sur nous ses regards émerveillés, jusqu’à notre disparition au premier tournant. Nous avons dû, sans aucun doute, continuer à pagayer dans les rêves de cet enfant pendant plus d’une nuit ensuite.
Le soleil et les averses alternaient comme le jour et la nuit, rendant les heures plus longues par la fréquence de leurs variations. Quand les averses étaient violentes, je sentais chaque goutte pénétrer à travers mon jersey et 203 heurter ma peau tiède; et l’accumulation de ces petits chocs me mettait presque hors de moi. Je décidai d’acheter un mackintosh à Noyon. Ce n’est rien d’être mouillé; mais le tourment que produisait chacune de ces piqûres de froid sur tout mon corps au même instant me faisait flageller l’eau comme un fou avec ma pagaie. Cet état d’exaspération amusait beaucoup la Cigarette et lui fournissait un autre spectacle que les berges d’argile et les saules.
Sans cesse la rivière courait en se glissant comme un voleur aux endroits resserrés ou tourbillonnait aux tournants avec un remous; tout le long du jour, les saules s’inclinaient et étaient minés par le pied; les berges d’argile s’écroulaient. L’Oise qui avait mis tant de siècles à faire la Vallée dorée semblait avoir changé d’idée et s’acharner à détruire son œuvre. Quelle quantité de choses fait une rivière en suivant simplement les lois de la pesanteur dans l’innocence de son cœur!
Noyon s’élève à environ un mille de la rivière, dans une petite plaine entourée de collines boisées, et couvre entièrement une éminence de ses toits de tuiles que domine une longue cathédrale au dos droit, avec deux tours raides. A mesure que nous pénétrions dans la ville, les toits de tuiles semblaient escalader la colline, grimpant les uns sur les autres dans le désordre le plus bizarre; mais malgré tous leurs efforts, ils ne montaient pas au-dessus des genoux de la cathédrale qui se dressait solennelle par dessus tout. Plus les rues se rapprochaient de ce génie tutélaire, à travers la place du marché sous l’hôtel de ville, plus elles se faisaient vides et calmes. Des murs nus et des fenêtres à volets fermés faisaient face au grand édifice, et l’herbe poussait sur la blanche chaussée. 207 «Ote tes souliers de tes pieds, car l’endroit où tu marches est une terre sacrée.» L’hôtel du Nord allume ses flambeaux profanes à quelques pas de l’église dont nous eûmes la magnifique aile orientale devant les yeux toute la matinée, de la fenêtre de notre chambre à coucher. J’ai rarement contemplé l’aile orientale d’une église avec une plus complète sympathie. Avec ses trois larges terrasses qui s’avancent en saillie, et sa base qui s’étend largement sur le sol, elle ressemble à la poupe de quelque grand et vieux bâtiment de guerre. Des arcs-boutants au dos creux portent des vases qui figurent les fanaux d’arrière. Il y a un roulis dans le sol et les tours ne font qu’apparaître par-dessus le faîte, comme si le brave vaisseau s’inclinait paresseusement par dessus la crête d’une énorme vague de l’Atlantique. A tout moment une fenêtre pouvait s’ouvrir, quelque vieil amiral y passer un tricorne et procéder à une observation. Les vieux amiraux ne sillonnent plus la mer, les vieux vaisseaux de 208 guerre sont tous démolis et ne vivent plus que dans les tableaux; mais celui-ci, qui était une église, bien avant qu’on pensât jamais à eux, est toujours une église et a toujours aussi grand air au bord de l’Oise. La cathédrale et la rivière sont probablement les deux choses les plus vieilles à plusieurs kilomètres à la ronde, et certainement, elles ont toutes deux une magnifique vieillesse.

Ils ne montaient pas au-dessus des genoux de la cathédrale (p. 204).
Le sacristain nous conduisit au sommet de l’une des tours et nous montra les cinq cloches suspendues dans leur campanile. Vue de là-haut la ville était un pavé de mosaïque de toits et de jardins; la vieille ligne des remparts se distinguait sans peine; et le sacristain nous montra au loin, à travers la plaine, entre deux nuages, les tours de Château-Coucy.
Je ne me fatigue jamais des grandes églises. C’est le genre de paysages de montagne que je préfère. L’homme ne fut jamais si bien inspiré que lorsqu’il fit une cathédrale, cette chose aussi une et aussi belle qu’une statue au premier 209 regard, et cependant, aussi vivante et aussi intéressante à l’examen qu’une forêt vue en détail. Il ne faut pas mesurer les clochers d’après les règles de la trigonométrie; ils sont d’une petitesse absurde; et cependant, comme ils sont élevés pour l’œil admirateur! Et là où nous avons tant d’élégantes proportions dont l’une donne naissance à l’autre pour se fondre en un seul tout, il semble que la proportion se soit surpassée elle-même et soit devenue quelque chose de différent et de plus imposant. Ce fut toujours pour moi une chose insondable qu’un homme osât élever la voix pour prêcher dans une cathédrale. Que peut-il dire qui ne soit quelque chose de bien au-dessous? Car malgré les sermons nombreux et variés que j’ai entendus, je n’en ai jamais entendu un seul qui fût aussi expressif qu’une cathédrale. C’est le meilleur des prédicateurs, et elle prêche nuit et jour, vous disant non seulement l’art et les aspirations de l’homme dans le passé, mais éveillant dans votre âme d’ardentes sympathies; 210 ou plutôt, comme tous ceux qui prêchent bien, elle fait de vous votre propre prédicateur, et chacun est en dernier ressort son propre directeur spirituel.
Comme j’étais assis devant l’hôtel au cours de l’après-midi, le tonnerre harmonieux et gémissant de l’orgue s’échappant de l’église flottait dans l’air comme un appel. Il ne me déplaisait pas, étant donné ma passion pour le théâtre, d’assister à un ou deux actes de la pièce; mais je ne pus jamais bien me rendre compte de la nature du service que j’avais sous les yeux. Quatre ou cinq prêtres et autant de choristes chantaient le Miserere devant le grand autel, lorsque j’entrai. Il n’y avait d’autre assistance que quelques vieilles sur des chaises, et quelques vieux agenouillés à même le pavé. Un moment après, un long cortège de jeunes filles, marchant deux à deux, chacune portant à la main un cierge allumé, et toutes vêtues de noir avec un voile blanc, sortit de derrière l’autel et se mit à descendre la nef, les quatre 211 premières portant une Vierge à l’enfant sur une civière. Les prêtres et les choristes agenouillés se relevèrent et s’avancèrent à la suite des jeunes filles en chantant «Ave Maria». Dans cet ordre ils firent le tour de la cathédrale, passant deux fois devant l’endroit où j’étais appuyé contre un pilier. Le prêtre qui semblait occuper le plus haut rang était un étrange vieillard aux yeux baissés. Ses lèvres ne cessaient de marmotter des prières, mais comme il me regardait dans les ténèbres, il ne me fit pas l’effet de les dire du fond du cœur. Deux autres qui avaient la charge de tout le chant étaient de solides gaillards de quarante ans, l’air soldatesque et brutal, l’œil hardi de gens trop nourris. Ils chantaient à tue-tête et lançaient l’Ave Maria comme un refrain de garnison. Les petites filles étaient timides et graves. En remontant lentement la nef latérale chacune jeta un rapide regard sur l’anglais, et la grosse nonne qui remplissait le rôle de maîtresse de cérémonies lui fit absolument perdre contenance 212 en le fixant. Quant aux choristes, du premier au dernier ils se comportèrent mal, comme seuls des jeunes garçons peuvent le faire, et ils gâtèrent cruellement la cérémonie par leurs singeries.
Je saisis en grande partie l’esprit de ce qui se passait. Il serait certes difficile de ne pas comprendre le Miserere, que je considère comme l’œuvre d’un athée. S’il est jamais bon de se mettre au cœur une telle désespérance, le Miserere est la musique convenable, et une cathédrale une scène appropriée. Jusque là, je suis d’accord avec les Catholiques (singulière appellation qu’ils se donnent, après tout). Mais pourquoi, au nom de Dieu, ces choristes de jour de fête? pourquoi ces prêtres qui glissent des regards errants dans l’assistance, tout en feignant d’être en prières? Pourquoi cette grosse dondon de nonne qui met tant de rudesse à diriger sa procession et secoue par le bras les jeunes vierges en défaut? Pourquoi ces crachements, ces reniflements, ces oublis de clefs, et les 213 mille et une petites mésaventures, qui troublent un état d’âme qu’on a laborieusement établi, grâce au plain-chant et à la musique de l’orgue? Les révérends-pères n’ont qu’à aller dans la première salle de spectacle venue pour voir ce qu’on peut faire avec un peu d’art, et comme il est nécessaire, pour susciter les hauts sentiments, d’exercer les figurants et de faire mettre chaque siège à la place convenable.
Il est encore une chose qui m’affligea. Je pouvais supporter un Miserere, moi; car je venais de prendre depuis peu beaucoup d’exercice en plein air. Mais j’aurais voulu voir ailleurs les vieillards. Ce n’était ni le genre de musique, ni le genre de théologie convenable pour des hommes et des femmes qui à cette époque de leur existence ont passé par la plupart des accidents et ont probablement une opinion à eux sur l’élément tragique de la vie. Une personne avancée en âge peut en général se faire à elle-même son propre miserere; et cependant, je remarque qu’elle aime mieux faire du Jubilate Deo son 214 chant ordinaire. En somme, le meilleur exercice religieux pour les gens âgés consiste à se remémorer leur propre expérience; tant d’amis morts, tant d’espérances déçues, tant d’erreurs et de faux pas; mais aussi, tant de jours brillants et de sourires de la providence. Il y a sûrement là matière à un sermon très éloquent.
En somme, tout cela m’avait pénétré d’une solennelle gravité. Dans la petite carte coloriée représentant tout notre «Voyage à la pagaie sur le continent», que mon imagination conserve encore, et déroule parfois pour l’amusement de mes moments de loisir, la cathédrale de Noyon figure à une échelle absurde et doit occuper presque autant de place qu’un département. Je vois encore le visage des prêtres, comme s’ils étaient à mes côtés; et j’entends encore Ave Maria, ora pro nobis résonner à travers l’église. Pour moi tout Noyon est effacé par ces souvenirs qui dominent tout, et je n’ai cure d’en dire davantage sur la ville. Elle n’était tout au plus qu’un amoncellement de toits bruns, 215 où les gens, je crois, mènent dans le calme une vie très honorable. Mais l’ombre de l’église tombe sur elle quand le soleil est bas, et la sonnerie des cinq cloches porte dans tous les quartiers l’annonce que l’orgue a commencé à se faire entendre. Si jamais je me rallie à l’église de Rome, ce sera à condition d’obtenir l’évêché de Noyon-sur-Oise.
En Route Pour Compiègne
Les gens les plus patients finissent par se lasser d’être continuellement mouillés par la pluie; sauf bien entendu, dans les «Hautes-terres» d’Ecosse où il n’y a pas assez d’intervalles de beau temps pour qu’on s’aperçoive de la différence. Tel semblait devoir être notre cas le jour où nous quittâmes Noyon. Je ne me rappelle rien du voyage; ce ne fut rien que des berges d’argile, des saules et de la pluie, une pluie incessante, impitoyable, battante, jusqu’au moment où nous nous arrêtâmes pour manger un morceau dans une petite auberge, à Pimprez, où le canal longeait la rivière de très près. Nous avions si triste mine, trempés comme nous l’étions, que l’aubergiste alluma quelques brins de bois dans la cheminée pour 217 nous réconforter. Nous nous assîmes là au milieu d’un nuage de vapeur, nous lamentant sur notre situation. Le mari jeta sa gibecière sur ses épaules et partit à longues enjambées pour la chasse; sa femme s’assit dans un coin éloigné à nous observer. Je crois que nous valions bien la peine d’être regardés. Nous grommelions sur notre infortune de la Fère; nous prévoyions d’autres La Fères dans l’avenir—bien que les choses allassent mieux avec la Cigarette pour truchement; il avait infiniment plus d’aplomb que moi et possédait une façon cavalière et péremptoire d’aborder une aubergiste, qui annihilait la mauvaise impression que faisaient nos sacs de caoutchouc. D’avoir parlé de la Fère cela nous fit causer des réservistes.
«Faire ses vingt-huit jours», dit-il, «semble une assez piètre façon de passer ses vacances d’automne».
«A peu près aussi piètre», répliquai-je avec abattement, «que d’aller en canoë».
«Ces messieurs voyagent pour leur agrément»? 218 demanda l’aubergiste avec une inconsciente ironie.
C’en était trop. Les écailles nous tombèrent des yeux. Une autre journée de pluie et, c’était bien décidé, nous mettions nos bateaux dans le train.
Le temps se le tint pour dit: Nous avions reçu notre dernière «douche». L’après-midi le temps se mit au beau; de grands nuages voyageaient encore dans le ciel, mais seuls maintenant, traçant leur route au milieu de l’immensité azurée; et un coucher de soleil offrant les tons les plus délicats du rose et de l’or inaugura une nuit obscure et étoilée et un mois de beau temps ininterrompu. En même temps la rivière commençait à nous laisser voir un peu mieux dans la campagne. Les berges n’étaient plus si hautes; il n’y avait plus de saules sur les rives, et de riantes collines s’élevaient tout le long de son cours dessinant leur profil sur le ciel.
Peu après le canal arrivant à sa dernière 219 écluse commença à déverser ses maisons d’eau dans l’Oise, en sorte que nous n’eûmes plus à craindre le manque de compagnie. Ici se trouvaient tous nos amis: le Deo Gratias de Condé et les quatre fils Aymon descendaient joyeusement le fil de l’eau avec nous. Nous échangeâmes des plaisanteries de circonstance avec le batelier perché au milieu de ses gaffes, ou avec le conducteur, enroué d’avoir braillé après ses chevaux, et les enfants vinrent à notre passage nous regarder par dessus bord. Nous n’avions jamais remarqué combien les bateaux nous manquaient; mais une impression d’incomparable douceur s’empara de nous, lorsque nous vîmes la fumée s’élever de leurs cheminées.
Un peu en aval de cette jonction, nous fîmes une autre rencontre d’importance plus grande encore, car c’est là que nous fûmes rejoints par l’Aisne, déjà bien loin de sa source, mais toute fraîche sortie de la Champagne. Ici finissait l’adolescence de l’Oise; c’était le jour de son 220 mariage; dès lors elle s’avança majestueuse et pleine jusqu’aux bords, ayant conscience de sa dignité et des diverses digues qu’il avait fallu lui élever. Elle devenait un trait calme dans le tableau. Les arbres et les villes se voyaient dans ses eaux comme dans un miroir. Elle portait allègrement les canoës sur sa large poitrine; il n’était pas besoin de lutter beaucoup contre les tourbillons, mais l’oisiveté passait à l’ordre du jour, et nous n’avions qu’à filer tout droit, plongeant la pagaie tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, sans intelligence ni effort. Il nous venait vraiment un temps calme à tous égards, et nous étions emportés vers la mer comme des «gentlemen».
Le soleil se couchait lorsque nous arrivâmes à Compiègne: beau profil de ville au-dessus de la rivière. Au delà du pont un régiment défilait tambour battant. Des gens flânaient sur le quai, les uns pêchant, les autres contemplant paresseusement la rivière. Et tandis que nous filions rapidement sur l’eau 221 devant eux, nous pûmes les voir montrer du doigt les canoës et se parler entre eux. Nous abordâmes à un lavoir flottant où les lessiveuses battaient encore leur linge.
Nous descendîmes à Compiègne dans un grand hôtel plein de mouvement, où personne ne remarqua notre présence.
La réserve et le militarisme (comme disent les Allemands) y dominaient. Un camp de tentes blanches en forme de cône, hors de la ville, avait l’air d’un feuillet détaché d’une bible illustrée. Des ceinturons décoraient les murs des cafés, et les rues ne cessaient de retentir toute la journée d’airs de musique militaires. Impossible d’être anglais, sans éprouver un sentiment d’orgueil, car les hommes qui suivaient les tambours étaient petits et marchaient mal. Chacun s’inclinait à son angle et cahotait à sa guise en marchant. Il n’y avait rien chez eux de la superbe allure avec laquelle un régiment de «highlanders» de haute taille s’avance 223 musique en tête, solennel et inévitable comme un phénomène naturel. Quel est l’homme qui, après avoir vu ce spectacle, peut oublier le tambour major marchant devant, les peaux de tigre des tambours, les «plaids» ondoyants des joueurs de flûte, l’étrange et élastique rythme du régiment entier, touchant le sol en cadence, et le coup de la grosse caisse, lorsque les cuivres cessent et que les fifres aigus reprennent l’air martial à leur place?
Une jeune anglaise en pension en France commença à dépeindre à ses compagnes françaises un de nos régiments à la parade, et tout en allant, elle me dit que le souvenir se faisait si vif, elle devint si fière d’être la compatriote de tels soldats et si triste de se trouver dans un autre pays, que la voix lui manqua et qu’elle fondit en larmes. Je n’ai jamais oublié cette jeune fille et, selon moi, il s’en faut de bien peu qu’elle ne mérite une statue. L’appeler une jeune demoiselle, avec toutes les futiles associations d’idées que fait naître ce mot, 224 serait lui faire insulte. En tous cas, elle peut être sûre d’une chose, c’est que quand bien même elle n’épouserait jamais un héroïque général, quand bien même sa vie n’aurait aucun résultat grand et immédiat, elle n’aura pas vécu en vain pour son pays natal.
Mais, bien que les soldats français ne payent pas de mine à la parade, en marche ils sont gais, alertes, pleins de bonne volonté, comme une troupe de chasseurs de renards. Je me rappelle avoir vu un jour une compagnie traverser la forêt de Fontainebleau, sur la route de Chailly, entre le Bas Bréau et la Reine Blanche. L’un des soldats marchait un peu avant les autres et chantait à tue-tête un audacieux chant de marche. Derrière lui ses camarades remuaient leurs pieds et même balançaient leur fusil en cadence. Un jeune officier avait toutes les peines du monde à garder son sérieux en entendant les paroles. Vous n’avez jamais rien vu d’aussi gai et d’aussi spontané que leur allure; les écoliers ne montrent pas plus d’ardeur 225 au jeu de la poursuite, et vous auriez pensé qu’il était impossible de fatiguer des marcheurs si pleins de bonne volonté.
Ce qui me charma le plus à Compiègne fut l’hôtel de ville. Je raffolai de l’hôtel de ville. C’est un monument d’un tourmenté tout gothique, tout garni de tourelles, de gargouilles et de taillades, et décoré d’une demi-douzaine de fantaisies architecturales. Quelques-unes des niches sont dorées et peintes, et dans un grand panneau carré, au centre, en relief noir sur fond d’or, se dresse, monté sur un cheval en marche, Louis XII, la main sur la hanche et la tête rejetée en arrière. On voit percer dans chacun de ses traits une arrogance royale. Le pied dans l’étrier saille insolemment sur le cadre; l’œil est dur, orgueilleux; le cheval même semble prendre plaisir à fouler aux pieds les serfs prosternés, et avoir le souffle de la trompette dans les naseaux. Ainsi chevauche à jamais, sur la façade de l’hôtel de ville, le bon roi Louis XII, père de son peuple.
226
Par dessus la tête du roi, dans la haute tourelle centrale, apparaît le cadran d’une horloge, et un peu au dessus, trois petits personnages mécaniques, chacun un marteau à la main, dont le rôle est de carillonner les heures, les demies et les quarts, pour les bourgeois de Compiègne. Celui du centre a une cuirasse dorée, les deux autres portent des hauts de chausses dorés, et tous trois ont d’élégants chapeaux à larges bords comme des cavaliers. A mesure que l’aiguille approche du quart, ils tournent la tête et se regardent sciemment les uns les autres; et alors, ding font les trois marteaux s’abattant sur les trois petites cloches placées au-dessous. L’heure suit, profonde et sonore, à l’intérieur de la tour; et les trois personnages dorés se reposent de leur travail.
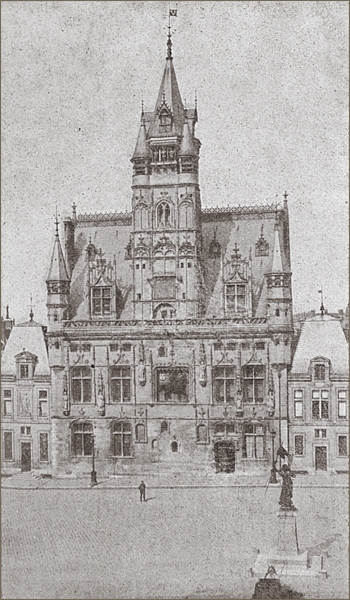
Ce qui me charma le plus à Compiègne, fut l’Hôtel-de-Ville (p. 225).
Je pris à leurs manœuvres un plaisir vif et sain, et j’eus grand soin de manquer aussi peu de leurs représentations que possible. Et je remarquai que même la Cigarette, tout en faisant mine de dédaigner mon enthousiasme, 229 était de son côté un spectateur plus ou moins assidu. Il y a quelque chose d’extrêmement absurde à exposer de pareils joujoux aux outrages de l’hiver au haut d’un édifice. Ils seraient mieux à leur place sous globe, en face d’une horloge de Nuremberg. La nuit surtout, lorsque les enfants sont couchés et que les grandes personnes même ronflent dans leurs draps, ne semble-t-il pas impertinent de laisser ces personnages couleur pain d’épices à se regarder et à tinter pour les étoiles et pour la lune qui monte au firmament. Il paraît assez naturel que les gargouilles contorsionnent là haut leur face simiesque, assez naturel que le potentat chevauche son destrier, semblable à un centurion dans une vieille estampe allemande représentant la Via Dolorosa; mais les joujoux devraient être serrés dans une boîte, enveloppés dans de l’ouate, jusqu’au lever du soleil et jusqu’au moment où les enfants sont de nouveau dehors à s’amuser.
Au bureau de poste de Compiègne un gros 230 paquet de lettres nous attendait, et, chose qui n’arriva qu’en cette occasion, les employés nous les remirent assez poliment sur notre simple demande.
On peut en quelque sorte dire que notre voyage se termine avec ce sac de lettres à Compiègne. Le charme était rompu. Dès ce moment nous étions en partie de retour chez nous.
On ne devrait avoir aucune correspondance quand on voyage. C’est bien assez déjà d’avoir à écrire mais il n’y a rien qui tue toute sensation de vacances comme de recevoir des lettres.
«C’est hors de mon pays et de moi-même que je vais». Je veux faire un plongeon pendant un certain temps dans de nouvelles conditions de vie, comme je plongerais dans un autre élément. Je n’ai rien à faire avec mes amis ou mes affections pendant ce temps. Quand je suis parti, j’ai laissé mon cœur chez moi dans un bureau ou je l’ai envoyé en avant avec mon porte-manteau m’attendre à ma destination. Mon voyage terminé, je ne manquerai pas de lire vos lettres 231 avec l’attention qu’elles méritent. Mais j’ai dépensé tout cet argent, remarquez bien, et j’ai donné tous ces coups de pagaie, à seule fin d’être au loin; et cependant, vous me retenez chez moi avec vos perpétuelles communications. Vous tirez sur la corde, et je sens que je suis un oiseau attaché. Vous me poursuivez par toute l’Europe de ces petites vexations que je voulais éviter par mon départ. Il n’y a pas de libération dans la guerre de la vie, je le sais bien; mais n’y aura-t-il pas seulement une semaine de congé?
Nous étions debout à six heures, le jour où nous devions partir. On avait si peu fait attention à nous que c’est à peine si je pensais qu’on daignerait nous présenter une note. Mais on n’y manqua pas; il y eut même quelques articles salés. Nous payâmes poliment à un commis désintéressé et nous quittâmes l’hôtel avec les sacs de caoutchouc sans être remarqués. Personne ne se soucia de savoir quoi que ce fût de nous. Impossible de se lever avant 232 un village; mais Compiègne était devenue une si grande ville qu’elle prenait ses aises le matin, et nous étions levés et bien loin, qu’elle était encore en robe de chambre et en pantoufles. Les rues étaient abandonnées aux gens qui lavaient les escaliers des portes; personne n’était en grande toilette, sauf les cavaliers sur l’hôtel de ville. Ils étaient bien lavés par la rosée, tout pimpants sous leur dorure; leurs visages respiraient l’intelligence et le sentiment de la responsabilité professionnelle. Kling firent-ils sur les cloches pour la demie de six heures, comme nous passions. Je trouvai bien gentil de leur part de me faire ce compliment d’adieu; jamais ils ne furent mieux en forme, pas même le dimanche à midi.
Il n’y avait personne à nous voir partir que les laveuses matinales—matinales et pourtant en retard—qui déjà portaient leur linge dans leur lavoir flottant sur la rivière. Très gaies avec quelque chose de matinal dans leurs manières, elles plongeaient hardiment leurs bras dans l’eau, 233 sans paraître saisies du froid. Ce serait un travail décourageant pour moi que ce début matinal et cette première immersion froide, un travail tout ce qu’il y a de plus décourageant. Mais je crois qu’elles auraient aussi peu volontiers changé de condition avec nous que nous avec elles. Elles se pressèrent à la porte pour nous regarder partir dans les minces brouillards ensoleillés étendus sur la rivière, et nous accompagnèrent de leurs cordiales acclamations jusqu’au moment où nous eûmes dépassé le pont.
A un certain point de vue, on peut dire que ces brouillards ne se levèrent jamais de dessus notre voyage; et depuis ce moment jusqu’à la fin, ils flottent très denses dans mon carnet de notes. Aussi longtemps que l’Oise avait été une petite rivière campagnarde, elle nous avait fait passer tout contre les portes des maisons et nous pouvions causer avec les habitants des champs riverains; mais à présent qu’elle était devenue si large, nous n’apercevions plus qu’à distance ce qui se passait le long des bords. Il y avait la même différence qu’entre une grand’route et un petit sentier de campagne qui se promène à travers des jardins. Nous nous trouvions maintenant dans des villes où personne ne nous importunait par ses questions; l’onde nous avait portés au milieu de la vie civilisée 235 où les gens passent sans se saluer. Dans les endroits où les habitants sont clairsemés, nous tirons de chaque rencontre tout le parti possible; est-ce une ville, nous ne sortons plus de nous-mêmes et ne disons plus un mot, hors que nous ne marchions sur les pieds de quelqu’un. Dans ces eaux-là nous n’étions plus désormais des bêtes curieuses et personne ne supposait que nous fussions venus d’au delà de la ville voisine. Je me rappelle qu’à notre entrée dans l’Isle-Adam par exemple, nous rencontrâmes des bateaux de plaisance par douzaines, sortant pour l’après-midi, et il n’y avait rien pour distinguer le véritable voyageur du promeneur, sauf, peut-être, la malpropreté de ma voile. Est-ce que la compagnie à bord de l’un des bateaux ne pensa pas reconnaître en moi un voisin? Fut-il jamais rien de plus blessant? Voilà où tout le roman en était tombé. Naguère, sur la haute Oise où, en général, rien ne naviguait que le poisson, la présence de deux canotiers ne pouvait s’expliquer d’aussi vulgaire façon; nous 236 étions des intrus étranges et pittoresques; et de l’étonnement des gens surgissait une sorte d’intimité légère et fugitive tout le long de notre route. Il n’y a en ce monde que prêtés rendus, bien qu’on ne les démêle pas toujours sans quelque difficulté; car nous n’étions pas nés quand on marqua les coches, et depuis que le monde existe, il n’y a pas encore eu de jour de règlement de comptes. On obtient à peu près autant de plaisir qu’on en donne. Tant que nous fûmes une sorte de vagabonds bizarres, de ceux qu’on regarde et qu’on suit comme un charlatan ou une troupe de bohémiens, nous ne manquâmes pas d’amusement en retour; mais sitôt que nous tombâmes nous-mêmes au lieu commun, tous ceux que nous rencontrâmes perdirent leur aspect merveilleux. Et c’est une raison entre mille qui fait que le monde est triste aux personnes tristes.
Dans nos précédentes aventures il y avait généralement à faire, et cela nous réveillait. Les averses mêmes avaient un effet revivifiant et 237 secouaient l’esprit de sa torpeur. Mais à présent que la rivière ne courait plus à proprement parler, qu’elle ne faisait que glisser à la mer d’une hâte égale, directe, mais imperceptible, et que le ciel nous souriait tous les jours invariablement, nous commençâmes à glisser dans cet assoupissement doré de l’esprit qui succède à beaucoup d’exercice en plein air. Je me suis plus d’une fois plongé dans cette torpeur. En vérité, je goûte extrêmement cette sensation, mais je ne l’eus jamais au même degré qu’en pagayant au fil de l’Oise. Ce fut l’apothéose de cette sorte d’engourdissement.
Nous cessâmes de lire entièrement. Parfois, quand je tombais sur un nouveau journal, je prenais un plaisir particulier à en lire le feuilleton; mais c’était assez d’un numéro, et je n’en pouvais supporter plus de trois; même le second m’était un désappointement. Sitôt que, de quelque façon, l’histoire se laissait deviner, elle perdait tout mérite à mes yeux; une simple scène ou, selon l’usage de ces feuilletons, la 238 moitié d’une scène, sans rien avant ni après, comme un fragment de rêve, avait le don de fixer mon intérêt. Moins je voyais du roman, mieux je l’aimais: réflexion profonde. Mais le plus souvent, comme j’ai dit, nous ne lisions ni l’un ni l’autre rien au monde et nous employions nos courts instants de veille, entre le dîner et le coucher, à examiner des cartes. J’ai toujours aimé les cartes et je voyage dans un atlas avec le plus grand plaisir. Les noms de lieux possèdent un attrait singulier; le contour des côtes et des rivières captive l’œil; et la rencontre dans une carte de quelque endroit dont vous avez entendu parler auparavant fait de l’histoire une nouvelle possession. Mais ces soirs-là, nous parcourions nos cartes avec la plus morne indifférence. Nous ne sentions pas plus d’intérêt pour un endroit que pour un autre. Nous regardions la feuille comme les enfants écoutent le bruit de leur hochet, et ne lisions des noms de villes et de villages que pour les oublier aussitôt. Le sujet n’avait pour 239 nous rien de romanesque; il n’y a pas d’indifférence plus grande que n’était la nôtre en ce moment. Si quelqu’un nous avait enlevé les cartes, au moment où nous étions le plus attentifs à les étudier, il y a gros à parier que nous aurions continué à étudier la table avec le même ravissement.
Une seule chose nous préoccupait fort: c’était de manger. Je me rappelle que mon imagination me représentait tel ou tel plat que je couvais des yeux, tant que l’eau m’en venait à la bouche; et longtemps avant que nous ne fussions rentrés pour la nuit, mon estomac criait la faim et me tiraillait avec instance. Parfois nous pagayions bord à bord pour un moment, et chemin faisant, nous nous excitions l’un l’autre par des imaginations gastronomiques. Une collation toute simple, gâteaux et Xérès, mais hors de portée sur l’Oise, me trotta par la tête pendant plus d’une demi-lieue; et il fut un moment, aux approches de Verberie, où la Cigarette chatouilla délicieusement ma sensualité 240 en me parlant de pâtés d’huîtres et de Sauterne.
Il me semble que personne parmi nous n’a bien connu le grand rôle que jouent dans l’existence le boire et le manger. La faim est chose si impérieuse qu’elle fait que nous digérons les nourritures les moins appétissantes et que nous sommes encore bien contents avec du pain et de l’eau pour notre dîner; comme il y a des gens qui ne peuvent se passer de lire, ne fût-ce que l’indicateur des chemins de fer. Mais c’est qu’il y a du roman là-dedans, après tout. Il n’est pas sûr que la table n’ait pas plus d’adorateurs que l’amour, et je n’hésite pas à dire que la nourriture offre pour la plupart beaucoup plus d’attraits que le paysage. Croyez-vous, comme disait Walt Whitman, que vous en êtes moins immortels? Le vrai matérialisme est d’avoir honte de ce que nous sommes. Ce n’est pas un moindre trait de la perfection humaine de découvrir la saveur d’une olive que de trouver de la beauté aux couleurs du soleil couchant.
241
Canoter était chose facile. De plonger la pagaie dans la rivière selon l’inclinaison convenable, tantôt à droite, tantôt à gauche, de maintenir l’avant au fil de l’eau, de vider la petite flaque d’eau qui se formait au creux du tablier, de protéger par un clignement des paupières les yeux contre l’étincellement du soleil sur l’eau, ou de passer de temps en temps sous la remorque qui se relève en sifflant du Deo gratias de Condé, ou des quatre fils Aymon, tout cela n’exigeait pas beaucoup d’art. De certains muscles bêtes suffisaient à l’accomplir dans un état moyen entre la veille et le somme, tandis que le cerveau en vacances s’endormait. Nous embrassions d’un regard les grands traits du paysage; d’un œil distrait nous regardions des pêcheurs en blouse et des lessiveuses qui barbotaient sur la rive. De temps en temps, il arrivait que la flèche de quelque clocher nous réveillait, ou le saut d’un poisson hors de l’eau, ou une traînée d’herbes aquatiques qui s’attachaient autour de la pagaie et 242 qu’il fallait arracher et rejeter. Mais ces intervalles lucides n’étaient lucides qu’en partie. Un peu plus de nous était remis en action, mais jamais le tout. Le bureau central des nerfs, ce que, à nos heures, nous appelons Nous-mêmes, jouissait de ses vacances sans trouble, comme un ministère. Les grandes roues de l’intelligence tournaient à vide dans la tête, comme des volants, sans nul grain à moudre. J’ai passé des demi-heures entières à compter mes coups de pagaie et à oublier les centaines. Je me flatte qu’il ne saurait y avoir dans les bêtes périssables une forme de conscience plus basse. Et quel plaisir c’était! Quelle cordiale et accommodante humeur cela produisait! Il n’y a nulle astuce dans un homme parvenu à ce point, la seule apothéose possible dans la vie, l’apothéose de la stupidité; et il commence à se sentir la dignité imposante et la longévité d’un arbre.
Un bizarre travail de métaphysique pratique accompagnait ce qu’on me permettra d’appeler la profondeur, si je ne dois pas l’appeler l’intensité, 243 de ma distraction. Ce que les philosophes appellent le moi et le non moi, ego et non ego, me préoccupait, bon gré mal gré. Il y avait moins de moi et plus de non moi que je n’étais accoutumé d’en trouver. Un autre manœuvrait ma pagaie à mes yeux; je sentais les pieds d’un autre contre le cale-pieds: il me semblait que mon corps n’avait pas plus de relation à moi que le canoë, la rivière ou le rivage. Ce n’est pas tout: quelque chose en moi-même, une partie de mon cerveau, une province de mon être propre, avait secoué l’obéissance et s’était établi pour son compte ou peut-être pour le compte de ce quelqu’un d’autre qui pagayait. Je m’étais ratatiné jusqu’à n’être plus qu’une toute petite chose en un coin de moi-même; j’étais isolé dans mon propre crâne. Des pensées se présentaient sans que je les en priasse. Ce n’étaient pas mes pensées: c’étaient évidemment celles de quelqu’un d’autre, et je les considérais comme une partie du paysage. Je crois, en un mot, que j’étais aussi près du 244 Nirvana que cela est compatible avec la vie pratique; et s’il en est ainsi, je fais aux Bouddhistes mes sincères compliments; c’est un état agréable, peu compatible avec le brillant de l’esprit, non pas précisément profitable au point de vue de l’argent, un état d’or, de calme, d’insouciance, un état qui met l’homme au-dessus des alarmes. Vous l’imaginerez parfaitement en supposant que vous êtes ivre-mort et cependant que vous demeurez à jeun pour jouir de cet état. J’ai idée que ceux qui travaillent au grand air, passent une grande partie de leurs journées dans cette stupeur d’extase qui explique l’extrême quiétude et endurance de ces gens-là. Quelle pitié que de dépenser de l’argent à acheter du laudanum, quand on a ici pour rien un paradis bien supérieur!
Cette disposition d’esprit fut à tout prendre le grand exploit de notre navigation. C’est le pays le plus lointain où ce voyage m’ait introduit. Aussi bien, il est situé si loin des sentiers battus du langage que je désespère de faire 245 goûter au lecteur la souriante, complaisante stupidité de ma condition, lorsque les idées allaient et venaient comme les poussières dans un rayon de soleil, que les arbres et les clochers le long de la rive se dressaient parfois, attirant mon attention comme des objets solides, au milieu d’un monde roulant de nuages; lorsque le frôlement rythmique du bateau et de la pagaie dans l’eau devenait une berceuse pour endormir mes pensées; lorsqu’une éclaboussure de vase sur le pont du bateau était, tantôt une souffrance intolérable pour l’œil, tantôt une compagnie pour moi, et l’objet d’une contemplation béate; et tout le temps, avec la rivière qui courait et les rives qui changeaient à droite et à gauche, je continuais à compter mes coups de pagaie, dont j’oubliais les centaines, j’étais la bête la plus heureuse de France.
Intérieurs d’Églises
Notre première étape après Compiègne nous conduisit jusqu’à Pont-Sainte-Maxence. J’étais dehors, le lendemain matin, un peu après six heures. L’air était piquant et sentait la gelée. Sur une place publique une vingtaine de femmes se disputaient pendant le marché du jour et le bruit de leurs négociations résonnait grêle et plaintif, tel le pépiement des moineaux par une matinée d’hiver. Les rares passants soufflaient dans leurs doigts et marchaient vivement, frappant le sol de leurs sabots, pour faire circuler le sang. Les rues étaient pleines d’une ombre glacée, bien que les cheminées fumassent au dessus des têtes dans l’or du ciel ensoleillé. Si vous vous éveillez assez tôt à cette saison de l’année, vous pouvez vous lever en Décembre pour déjeuner en Juin.
247
Je pris le chemin de l’église, car il y a toujours quelque chose à voir dans une église, ou des adorateurs vivants, ou des tombes de morts. Vous y trouvez un recueillement aussi complet que la mort et le spectacle des illusions les plus creuses; et même, si ce n’est point un morceau d’histoire, vous y attraperez toujours quelques bavardages contemporains. Il ne faisait pas aussi froid dans l’église qu’au dehors, mais il paraissait y faire plus froid. La blancheur de la nef donnait à l’œil l’illusion du pôle, et le clinquant d’un autel du continent avait l’air plus abandonné que de coutume dans la solitude et l’air glacial. Assis dans le sanctuaire, deux prêtres lisaient en attendant les pénitents; et plus loin, dans la nef, une très vieille femme faisait ses dévotions. C’était à se demander comment elle pouvait égrener son chapelet, alors que les jeunes gens pleins de santé soufflaient dans leurs doigts et se battaient les épaules pour se réchauffer. Mais si ceci m’affecta, la nature de ses exercices me découragea absolument. 248 Elle allait de chaise en chaise et d’autel en autel, naviguant autour de l’église. A chaque autel elle dédiait un nombre égal de grains et un égal laps de temps. Comme un prudent capitaliste qui agit d’une façon quelque peu cynique dans les affaires commerciales, elle désirait placer ses supplications en valeurs célestes et variées. Elle ne voulait rien risquer sur le crédit d’un seul intercesseur. Dans toute la foule des saints et des anges, il n’en était pas un qui pût se supposer son champion de prédilection pour la défendre aux grandes assises. Je ne pouvais considérer cela que comme une grossière et transparente jonglerie, basée sur une incrédulité inconsciente.
De vieille femme aussi morte je n’en ai jamais vu: rien que des os et du parchemin curieusement assemblés. Ses yeux qui interrogeaient les miens, étaient sans expression. Je ne sais si vous ne pourriez pas dire qu’elle était aveugle; cela dépend de ce que vous entendez par voir. Peut-être avait-elle connu l’amour? 249 peut-être mis au monde et allaité des enfants? peut-être leur avait-t-elle donné de petits noms d’amitié? Mais à présent, tout cela était disparu et ne l’avait laissée ni plus heureuse ni plus sage, et le meilleur emploi qu’elle pouvait faire de ses matinées était de venir dans cette froide église et de gagner par ses jongleries une tranche de ciel. Ce ne fut pas sans sentir ma poitrine se dilater que je m’échappai dans les rues et dans l’air vif du matin. Le matin! Grand Dieu! comme elle en serait lasse avant le soir! et si elle ne dormait pas, qu’est-ce que ce serait alors? Il est heureux qu’il y en ait peu parmi nous qui soient appelés à justifier publiquement leur vie à la barre du tribunal de la soixante-dixième année; heureux, que tant de gens soient fauchés à propos dans ce qu’ils appellent la fleur de l’âge et s’en aillent expier leurs fautes secrètement en quelque autre lieu; sans quoi, entre l’enfance maladive et la vieillesse morose, un profond dégoût de la vie pourrait s’emparer de nous.
250
J’eus besoin de toute mon hygiène cérébrale, pendant cette journée de canotage. Je ne pouvais digérer ma vieille dévote. Mais je fus bientôt au septième ciel de la stupidité, et je n’eus plus conscience de rien, si ce n’est que quelqu’un dans un canoë filait à force de pagaie, pendant que je comptais ses coups et oubliais les centaines. J’avais parfois peur de me rappeler les centaines, ce qui d’un plaisir aurait fait une fatigue; mais cette crainte était chimérique, car elles disparaissaient de mon esprit comme par enchantement, et je n’en savais pas plus que le roi de Prusse sur ce qui faisait mon occupation.
A Creil, où nous nous arrêtâmes pour goûter, nous laissâmes nos canoës dans un autre lavoir flottant. Comme nous étions en plein midi, ce lavoir était encombré d’une foule de bruyantes laveuses aux mains rouges. Ces laveuses avec leurs grosses plaisanteries sont à peu près tout ce que je me rappelle de l’endroit. Je pourrais compulser mes livres d’histoire, si vous y teniez 251 beaucoup, et vous citer une ou deux dates; car cette ville a joué un assez grand rôle dans les guerres avec les Anglais. Mais je préfère mentionner un pensionnat de jeunes filles qui nous intéressa, parce que c’était un pensionnat de jeunes filles et parce que nous nous imaginâmes que nous l’intéressions aussi. Du moins il y avait les jeunes filles dans le jardin, et nous sur la rivière; et il y eut plus d’un mouchoir qui s’agita à notre passage. Cela jeta tout un trouble dans mon cœur; et pourtant, comme nous nous serions fatigués et dédaignés, ces jeunes filles et moi, si nous avions été présentés les uns aux autres à une partie de croquet. Mais c’est une mode qui m’est chère, que d’agiter un mouchoir ou d’envoyer des baisers avec la main à des gens que je ne reverrai jamais, de jouer avec la possibilité et d’enfoncer une cheville où l’imagination puisse se suspendre. Cela donne une secousse au voyageur, lui rappelle qu’il n’est pas partout un voyageur et que son excursion n’est qu’une sieste au bord du 252 chemin dans la marche réelle de la vie.
L’église à Creil était un endroit indescriptible, éclaboussé à l’intérieur de la lumière crue tombant des fenêtres, et décoré de médaillons représentant le Chemin de la Croix. Mais il y avait comme ex-voto, un objet singulier, qui me plut énormément: une reproduction fidèle d’une péniche qui se balançait à la voûte, portant inscrite cette aspiration: Dieu conduise à bon port le Saint Nicolas de Creil! L’objet était nettement exécuté et aurait fait les délices d’une bande de gamins au bord de l’eau. Mais une chose qui me chatouillait, c’était la gravité du péril à conjurer. Qu’on suspende comme ex-voto le modèle d’un navire! très bien! Le vaisseau qui doit tracer un sillon autour du monde et visiter le tropique ou les glaces des pôles court des dangers qui valent bien un cierge et une messe. Mais le Saint Nicolas de Creil qui devait être halé pendant une dizaine d’années par de patients chevaux de trait, dans un canal rempli de mauvaises herbes, avec des peupliers 253 bavardant au-dessus de lui et le batelier sifflant au gouvernail; qui devait faire tous ses voyages parmi la verdure du continent, sans jamais perdre de vue un beffroi de village pendant tout son temps de navigation; ma foi, j’aurais pensé que si une chose pouvait se faire sans l’intervention de la Providence, c’était bien celle-là. Mais peut-être le patron était-il un humoriste? Ou peut-être un prophète, nous rappelant le sérieux de la vie par ce signe absurde.
A Creil, comme à Noyon, Saint Joseph semblait être un saint favori, à cause de sa ponctualité. On peut spécifier le jour et l’heure; et les personnes reconnaissantes ne manquent pas de le faire sur une plaque votive, lorsque les prières ont été ponctuellement et nettement exaucées. Toutes les fois que la question de temps entre en considération, Saint Joseph est l’intermédiaire tout désigné. Je pris une sorte de plaisir à observer la vogue qu’il avait en France, car ce juste joue un très petit rôle dans la religion de mon pays. Et cependant je ne 254 puis m’empêcher de craindre que l’on ne s’attende, dans les endroits où l’on recommande tant le Saint pour son exactitude, à ce qu’il soit reconnaissant de sa plaque votive.
Pour nous protestants, c’est de la folie et de toutes façons cela n’a pas grande importance. Que l’on conçoive sagement ou que l’on exprime comme il faut sa reconnaissance pour les faveurs que l’on reçoit, c’est une chose secondaire après tout, dès lors que l’on ressent de la reconnaissance. La véritable ignorance consiste à ne pas savoir qu’on a reçu un bienfait ou à s’imaginer qu’on l’a obtenu grâce à son propre mérite. L’homme fils de ses œuvres est après tout le plus plaisant sac à vent. Il y a une différence marquée entre décréter la lumière dans le chaos et allumer le gaz dans un salon de ville avec une boîte d’allumettes de la régie et nous avons beau faire, notre main a toujours quelque chose de tout fait, quand ce ne seraient que nos doigts.
Mais quelque chose de pire que de la folie 255 était placardé dans l’église de Creil. L’association du Saint Rosaire (dont je n’avais jamais entendu parler auparavant) est responsable de cela. Selon l’avis imprimé, cette association fut fondée par un bref du pape Grégoire XVI en date du 17 Janvier 1832. D’après un bas-relief peint, il semble qu’elle ait été fondée à une époque indéterminée par la Vierge, qui donne un rosaire à Saint Dominique, et par l’enfant Jésus, qui en donne un autre à Sainte Catherine de Sienne. Le pape Grégoire n’est pas aussi imposant, mais il est plus à notre portée. Je ne pus savoir exactement si l’association ne s’occupait que de dévotion, ou si elle avait aussi en vue les bonnes œuvres. En tout cas, elle est magistralement organisée. Quatorze matrones ou jeunes filles sont inscrites comme associées pour chaque semaine du mois. En tête de la liste se trouve un autre nom, celui de la Zélatrice, généralement une femme mariée, le chorège de la bande. L’accomplissement des devoirs de l’Association procure des indulgences plénières ou partielles. 256 «Les indulgences partielles sont attachées à la récitation du rosaire.» La récitation de la dizaine exigée confère promptement une indulgence partielle. Quand l’homme sert le royaume des cieux un livre de comptes à la main, je ne puis m’empêcher de craindre qu’il ne porte le même esprit mercantile dans ses relations avec ses semblables ce qui ferait de la vie une triste et sordide affaire.
Il y a pourtant un autre article d’importation plus heureuse. «Toutes ces indulgences, semblait-il, sont applicables aux âmes du Purgatoire.» Pour l’amour de Dieu, ô dames de Creil, appliquez-les toutes sans délai aux âmes du purgatoire. Burns ne voulut recevoir aucune rémunération pour ses derniers chants, préférant servir son pays par pur amour. A supposer que vous imitiez l’employé de la régie[6], mesdames, et quand bien même les âmes du Purgatoire n’éprouveraient pas grand soulagement, quelques âmes de Creil-sur-Oise ne s’en trouveraient pas 257 plus mal en ce monde ni dans l’autre.
Je ne puis m’empêcher de me demander, tout en transcrivant ces notes, si un homme né et élevé dans le protestantisme est bien en état de comprendre ces symboles et de leur rendre justice comme ils le méritent; et je ne puis faire autrement que de répondre que non. Ils ne peuvent avoir pour les fidèles cet air mesquin et laid que je leur trouve. Cela est à mes yeux aussi clair qu’un théorème de géométrie; car ces croyants n’ont ni faiblesse ni perversité d’esprit. Ils peuvent apposer leurs plaques, recommandant la promptitude de Saint Joseph, comme s’il était encore charpentier dans un village. Ils peuvent réciter la dizaine exigée et empocher métaphoriquement les indulgences, comme s’ils avaient accompli une tâche pour le ciel; et ils peuvent ensuite sortir et regarder sans honte à leurs pieds cette merveilleuse rivière qui coule près d’eux, et lever les yeux sans confusion vers les étoiles qui, semblables à des pointes d’aiguille, sont 258 en réalité de grands mondes pleins de rivières qui coulent, plus grandes que l’Oise. Il me paraît aussi clair, dis-je, qu’un théorème de géométrie qu’avec mes idées de protestant j’ai manqué le but, et qu’avec ces abus marche de front quelque esprit plus élevé et plus religieux que je ne l’imagine.
Je me demande si d’autres me feraient les mêmes concessions. Comme les dames de Creil, après avoir récité mon rosaire de tolérance, j’attends mon indulgence sur le champ.
Nous arrivâmes à Précy vers le coucher du soleil. La plaine est semée de nombreux bouquets de peupliers. En une large, lumineuse courbe, l’Oise s’étendait sous le flanc de la colline. Un léger brouillard commençait à s’élever et à confondre les différentes distances. On n’entendait pas un son, sauf celui des clochettes à moutons, dans quelques prairies sur les bords de la rivière, et le grincement d’un chariot, au bas de la longue route, qui descend la colline. Les villas dans leurs jardins, les boutiques le long de la rue, tout semblait avoir été abandonné la veille, et je me sentais porté à marcher discrètement, comme on s’y sent porté dans une forêt silencieuse. Tout à coup, nous tournâmes un coin de rue et nous aperçûmes devant nous, dans une petite prairie 260 autour de l’Eglise, un essaim de jeunes filles vêtues à la mode de Paris, jouant au croquet. Leurs éclats de rire et le son sourd de la balle contre le maillet faisaient un joyeux tapage dans le village, et l’aspect des sveltes formes de ces jeunes filles, toutes corsetées et enrubannées, produisit dans nos cœurs un trouble proportionné aux charmes du tableau. Nous sentions l’approche de Paris, semblait-il. Et voici que nous trouvions en ce lieu des femmes de notre rang jouant au croquet, comme si Précy avait été un endroit du monde réel, au lieu d’être une étape dans l’empire féerique des voyages. Car, pour être franc, on peut à peine considérer la paysanne comme une femme et cette troupe de coquettes sous les armes, succédant à toutes ces créatures en jupons que nous avions vues sur notre route bêcher, houer et faire à dîner, faisait un trait caractéristique tout à fait surprenant dans le paysage et nous convainquit immédiatement que nous étions des hommes sujets à des défaillances.
261
L’auberge à Précy est la pire qui soit en France. Nulle part, pas même en Ecosse, je n’ai trouvé si mauvaise nourriture. Cette auberge était tenue par deux jeunes gens, le frère et la sœur, qui n’avaient pas encore vingt ans. La sœur nous prépara un repas, si l’on peut s’exprimer ainsi; et le frère, qui avait passé la journée à boire, rentra ramenant avec lui un boucher en ribote pour converser avec nous pendant notre repas. Nous trouvâmes des morceaux de porc tièdes dans la salade et des morceaux d’une substance molle inconnue dans le ragoût. Le boucher nous amusa en nous dépeignant la vie parisienne, qu’il se piquait de connaître parfaitement, pendant que le frère, assis sur le bord du billard, penchait en avant d’une façon inquiétante, tout en suçant un bout de cigare. Au milieu de ces distractions, éclata soudain le bruit d’un tambour, qui passait près de la maison et une voix enrouée se mit à débiter une proclamation. C’était un montreur de marionnettes 262 annonçant une représentation pour la soirée.
Il avait installé sa baraque et allumé ses chandelles sur une autre partie du gazon où les jeunes filles jouaient au croquet, sous l’une de ces halles, si communes en France, qui servent à abriter les marchés; et, lorsque nous arrivâmes à cet endroit, le bateleur et sa femme essayaient de maintenir l’ordre parmi les spectateurs.
Ce fut la plus absurde des disputes. Les saltimbanques avaient disposé un certain nombre de bancs, et tous ceux qui s’y asseyaient devaient payer deux sous pour la place. Ces bancs étaient toujours garnis de monde—une salle comble—tant qu’il ne se passait rien; mais que la directrice parût avec l’air de vouloir faire une quête et, aux premiers sons du tambour, les auditeurs évacuaient prestement les sièges et se tenaient debout tout autour, à l’extérieur, les mains dans les poches. Cela aurait à coup sûr poussé à bout la patience d’un ange. Le directeur rugissait de l’avant-scène: il avait 263 parcouru toute la France, et nulle part, nulle part, pas même sur les frontières de l’Allemagne, il n’avait rencontré une manière d’agir aussi indigne. Tas de coquins, tas de fripons, tas de voleurs, leur criait-il. Et de temps en temps, son épouse sortait pour faire un autre tour et d’une voix perçante, ajoutait sa quote-part à la tirade. Je remarquai, ici comme ailleurs, jusqu’à quel point les femmes ont l’esprit plus riche en matière d’insultes. Les assistants riaient et poussaient des cris bruyants aux boutades mordantes de la femme. Elle savait trouver les endroits sensibles. Elle tenait l’honneur du village à sa merci. Des voix lui répondaient avec colère dans la foule et recevaient une riposte caustique pour leur peine. Près de moi, deux vieilles dames, qui avait dûment payé leurs places, toutes rouges d’indignation, s’entretenaient, assez haut pour être entendues, de l’impudence de ces saltimbanques; mais la directrice n’avait pas sitôt surpris quelques-unes de ces paroles, que sur le champ elle les prenait à partie: Si 264 ces dames pouvaient persuader à leurs voisins d’agir comme des honnêtes gens, les saltimbanques seraient assez polis. Ces dames avaient probablement eu leur assiette de soupe et peut-être un verre de vin, ce soir-là; les saltimbanques eux aussi aimaient bien la soupe et il ne leur plaisait pas de se voir frustrer de leurs maigres recettes, à leur nez et à leur barbe. A un certain moment, les choses en vinrent à tel point que quelques jeunes gens et le bateleur engagèrent un court pugilat, au cours duquel ce dernier roula à terre, aussi facilement qu’une de ses marionnettes, aux éclats de rire moqueurs des spectateurs.
Cette scène m’étonna beaucoup, car je suis assez au courant des mœurs des comédiens ambulants français, qui sont tous plus ou moins artistes et je les ai toujours trouvés singulièrement aimables. Tout comédien ambulant doit être cher à toute âme droite, ne serait-ce qu’en tant que protestation vivante contre les bureaux et l’esprit mercantile, et parce qu’il nous remet en mémoire, que la vie n’est pas 265 nécessairement ce que nous la faisons en général. Même une société de musiciens allemands, lorsqu’on la voit quitter la ville, pour faire une tournée dans les villages de la campagne, parmi les arbres et les prairies, a quelque chose de romanesque, qui séduit l’imagination. Il n’est pas une personne de moins de trente ans si insensible que son cœur n’éprouve quelque émotion à la vue d’un campement de bohémiens. Nous ne sommes pas tous des filateurs, ou, du moins, ceux qui le sont, ne le sont pas toujours. Il est encore des hommes qui veulent vivre et la jeunesse saura trouver parfois un mot courageux pour blâmer la richesse et renoncer à une position, pour courir les routes sac au dos.
Un Anglais a toujours des facilités spéciales pour se mettre en relations avec les gymnastes français; car l’Angleterre est la patrie naturelle des gymnastes. Celui-ci ou celui-là, dans son maillot pailleté, sans aucun doute sait un ou deux mots d’Anglais, a bu quelques verres 266 d’«aff-n-aff»[7], ou peut-être a travaillé dans un music hall anglais. C’est un de mes compatriotes de par sa profession. Cela entraîne pour lui, comme pour les canotiers belges, l’idée que je suis, moi aussi, un athlète.
Mais le gymnaste n’est pas mon favori. Sa nature n’a rien ou n’a que fort peu de chose de l’artiste: son âme est petite et terre à terre, la plupart du temps, puisque sa profession ne lui fait jamais appel et ne l’accoutume pas aux idées élevées. Mais, si un homme a en lui assez des qualités d’un acteur pour ânonner un rôle dans une farce, cela lui rend familier tout un nouvel ordre de pensées. Il faut qu’il songe à autre chose qu’à la caisse. Il a un orgueil à lui et ce qui est beaucoup plus important, il a un but devant lui, qu’il ne pourra jamais atteindre tout à fait. Il est parti pour un pèlerinage, qui durera toute sa vie parce qu’il n’y a pas de fin à ce pèlerinage tant que la perfection n’est pas atteinte. Il se perfectionnera 267 un peu tous les jours, ou même, s’il a renoncé à le faire, il se souviendra toujours qu’il fut un temps où il avait conçu ce haut idéal, qu’il fut un temps où il s’était épris d’amour pour une étoile. «Il vaut mieux avoir aimé et perdu.» Quand bien même la lune n’aurait rien à dire à Endymion, quand bien même ce dernier s’établirait avec Audrey et ferait paître les porcs, ne pensez-vous pas qu’il aurait plus de grâce dans sa démarche et qu’il chérirait de plus hautes pensées jusqu’à la fin? Les lourdauds qu’il rencontre à l’église n’ont jamais rien imaginé au delà du bandeau d’Audrey; mais, il y a au cœur d’Endymion une réminiscence qui, comme une épice, lui conserve l’âme fraîche et haute.
D’être seulement un de ces individus, dont la profession confine à l’art, cela imprime à la physionomie un cachet de beauté indélébile. Je me rappelle avoir dîné une fois avec une société, dans une auberge, à Château-Landon. La plupart des convives étaient évidemment des commis-voyageurs; 268 d’autres, des paysans riches; mais, il y avait un jeune homme en blouse, dont la physionomie tranchait d’une façon surprenante avec celle des autres. Elle paraissait plus affinée, elle laissait percer un peu plus d’intelligence; elle avait un air vivant et expressif et l’on pouvait voir que les yeux du jeune homme percevaient les choses. Mon compagnon et moi nous étions fort curieux de savoir qui il était et ce qu’il pouvait être. C’était l’époque de la foire de Château-Landon et, quand nous allâmes voir les baraques, nous eûmes la réponse à notre question; car, notre ami se trouvait là, fort occupé à jouer du violon, pour faire danser les paysans. C’était un violoniste ambulant.
Une troupe de comédiens ambulants vint un jour à l’auberge, où j’étais descendu, dans le département de Seine-et-Marne. Elle comprenait le père, la mère, leurs deux filles, gaillardes au teint hâlé, à l’air décidé, qui chantaient et jouaient sans la moindre notion de leur art: puis, un jeune homme brun, l’air d’un maître 269 d’école, peintre en bâtiments récalcitrant, qui chantait et jouait assez bien. La mère était le génie de la bande, autant qu’on peut parler de génie, quand il s’agit d’un tas de «m’as-tu vu» incompétents et le mari ne savait comment exprimer l’admiration qu’il éprouvait pour le paysan comique de sa femme. «Vous devriez voir ma vieille femme,» disait-il en inclinant sa face de buveur de bière. Un soir, ils donnèrent une représentation dans la cour de l’auberge à la lueur vacillante des lampes: misérable spectacle, que regardait froidement un auditoire de village. Le lendemain soir, sitôt les lampes allumées, il survint une pluie torrentielle et ils durent sauver tout leur bataclan, au plus vite, et se réfugier dans la grange, où ils se mirent à l’abri, glacés, trempés et sans souper. Dans la matinée, un de mes bons amis, qui partage ma vive affection pour les comédiens ambulants, fit une petite quête et me chargea de leur en remettre le produit, pour les consoler de leur déception. Je donnai la somme au père; il me 270 remercia cordialement, et nous prîmes une tasse de café ensemble dans la salle, en causant de routes, d’auditoires et de temps durs.
Comme je m’en allais, voilà mon vieux comédien qui se lève et chapeau bas: «Je crains bien, dit-il, que Monsieur ne me regarde tout à fait comme un mendiant; mais j’ai une autre demande à lui faire.» Je me mis à le haïr sur le champ. «Nous jouons encore ce soir,» poursuivit-il. «Bien entendu je refuserai d’accepter d’autre argent de Monsieur et de ses amis, qui ont déjà été si généreux. Mais notre programme de ce soir est quelque chose de vraiment remarquable et je compte que Monsieur voudra bien nous honorer de sa présence.» Et alors, avec un haussement d’épaules et un sourire: «Monsieur comprend,—la vanité d’un artiste! Dieu me pardonne!» La vanité d’un artiste! Voilà le genre de choses qui me réconcilie avec la vie: un vieux coquin déguenillé, ivrogne, incompétent, avec des manières de gentlemen et une vanité 271 d’artiste, garder le respect de lui-même!
Mais, l’homme selon mon cœur, c’est M. de Vauversin. Voilà près de deux ans que je l’ai vu pour la première fois et j’espère bien avoir souvent l’occasion de le revoir. Voici son premier programme, tel que je l’ai trouvé sur la table du déjeuner; je l’ai conservé depuis, comme une relique des jours glorieux:
«Mesdames et Messieurs»,
Mademoiselle Ferrario et M. de Vauversin auront l’honneur de chanter ce soir les morceaux suivants.
«Mademoiselle Ferrario chantera: Mignon—Oiseaux légers—France—Des Français dorment là—Le château bleu—Où voulez-vous aller?»
«Monsieur de Vauversin: Mme Fontaine et M. Robinet—Les plongeurs à cheval—Le mari mécontent—Tais-toi, gamin—Mon voisin l’original—Heureux comme ça—Comme on est trompé.»
On éleva une estrade à une extrémité de la salle à manger. Et quel spectacle c’était de voir M. de Vauversin, la cigarette à la bouche, pinçant de la guitare et suivant les yeux de Mademoiselle Ferrario avec le regard obéissant et bon d’un chien! La séance se termina 272 par une tombola, ou vente aux enchères de billets de loterie: admirable amusement avec toute l’excitation que produit la passion du jeu, et sans aucun espoir de gain, qui vous fasse honte de votre ardeur; car là, tout est perte; vous vous dépêchez de vider votre poche; c’est une lutte à qui perdra le plus d’argent, au bénéfice de M. de Vauversin et de Mademoiselle Ferrario.
Monsieur de Vauversin est un petit homme, avec une forêt de cheveux noirs, un air alerte et engageant, et un sourire, qui serait délicieux s’il avait de meilleures dents. Il était autrefois acteur au Châtelet; mais, il contracta à la grande chaleur et à la lumière éblouissante de la rampe une affection nerveuse, qui le mit hors d’état de paraître sur la scène. Dans cette crise, Mademoiselle Ferrario, ou si vous voulez, Mademoiselle Rita de l’Alcazar, consentit à partager sa fortune vagabonde: «Je ne saurais oublier la générosité de cette dame,» disait-il. Il porte des pantalons si étroits que ça été longtemps 273 un problème, pour tous ceux qui l’ont connu, de savoir comment il s’y prend pour entrer dedans et pour en sortir. Il a quelque talent à l’aquarelle; il écrit des vers; c’est le plus patient des pêcheurs; et il a passé de longues journées, au fond du jardin de l’auberge, à taquiner le goujon dans la limpide rivière.
Il faut l’entendre raconter ses aventures, tout en buvant une bouteille de vin. Sa causerie a un tour si agréable et le sourire lui vient si naturellement aux lèvres, quand il s’agit de ses propres malheurs, avec parfois, une gravité soudaine, tel un homme, qui entendrait mugir les vagues, pendant qu’il dirait les périls de l’abîme. Car, sans aller plus loin qu’hier soir, je crois, la recette ne s’éleva qu’à un franc cinquante pour couvrir les frais, qui comprenaient trois francs de chemin de fer et deux de nourriture et de logement. Le maire, un millionnaire, était assis au premier rang en face, applaudissant à tout instant Mlle Ferrario et cependant, de toute la soirée, il ne donna pas plus de trois sous. Les 274 autorités locales voient de si mauvais œil l’artiste ambulant. Hélas! je ne le sais que trop bien, moi qui ai été pris pour l’un d’entre eux, et impitoyablement incarcéré, par suite de cette méprise. Une fois M. de Vauversin alla trouver un commissaire de police, pour demander la permission de chanter. Le Commissaire, qui fumait à son aise, tira poliment son chapeau à l’arrivée du chanteur. «Monsieur le Commissaire,» commença-t-il, «je suis artiste.» Et le Commissaire de se recoiffer aussitôt. Aucune courtoisie pour les compagnons d’Apollon! «Voilà jusqu’à quel degré d’avilissement ils sont tombés,» dit M. de Vauversin, en décrivant une courbe avec sa cigarette.
Mais ce qui me charma le plus, ce fut la sortie qu’il fit, une fois que nous avions passé toute la soirée à causer des embarras, des outrages et des moments de gêne de sa vie errante. Quel qu’un disait qu’il vaudrait mieux avoir un million d’argent comptant, et Mlle Ferrario admettait qu’elle préférerait infiniment cela. 275 «Eh bien, moi non», s’écria M. de Vauversin, en frappant la table de sa main. «Si quelqu’un a manqué sa vie dans le monde, n’est-ce pas moi? J’avais un art, dans lequel j’ai fait des choses bien, aussi bien que quelques-uns, mieux, peut-être, que d’autres; et maintenant cet art m’est interdit. Il faut que j’aille dans la campagne recueillir des gros sous et chanter des inepties. Pensez-vous que je regrette ma vie? Pensez-vous que je préfèrerais être un bourgeois gros et gras comme un veau? Non, certes. J’ai eu des moments, où j’ai été applaudi sur les planches. De cela, je ne fais aucun cas. Mais, j’ai parfois eu la sensation intime, en mon for intérieur, alors que je n’obtenais pas un seul applaudissement de la salle entière, que j’avais trouvé une intonation juste ou un geste exact et frappant; et alors, messieurs, j’ai su ce que c’était que d’être artiste. Et savoir ce que c’est que l’art, c’est avoir pour toujours un intérêt, tel qu’aucun bourgeois n’en peut trouver dans ses mesquines affaires. Tenez, 276 messieurs, je vais vous le dire—c’est comme une religion.»
Telle fut, en tenant compte des manques de mémoire et des inexactitudes de traduction, la profession de foi de M. de Vauversin. Je lui ai donné son propre nom, de peur que quelque comédien ambulant ne vînt se mettre entre lui avec sa guitare et sa cigarette et Mlle Ferrario. Car tout le monde ne devrait-il pas faire ses délices d’honorer ce disciple malheureux et loyal des Muses? Puisse Apollon lui inspirer des rimes qu’on n’a jamais rêvées! Puisse la rivière être moins avare et faire mordre les poissons argentés à son appât! Puisse le froid ne pas le faire pâtir, au cours des longues tournées d’hiver! Puisse le petit greffier de village ne point le blesser par ses façons offensantes! Puisse-t-il enfin avoir toujours à ses côtés Mlle Ferrario, pour la suivre de ses yeux soumis et l’accompagner sur la guitare!
Les marionnettes faisaient un amusement bien lugubre. Elles jouaient une pièce appelée 277 Pyrame et Thisbé en cinq mortels actes, écrits en alexandrins tout aussi longs que les acteurs. Une marionnette était le roi, une autre le mauvais conseiller, une troisième, à laquelle on prêtait une beauté exceptionnelle, représentait Thisbé; puis il y avait des gardes et des pères inexorables et des messieurs qui se promenaient. Il ne se passa rien de particulier pendant les deux ou trois actes auxquels j’assistai; mais vous serez enchantés d’apprendre que les trois unités étaient dûment observées et que toute la pièce, sauf une seule exception, se développait conformément aux règles classiques. Cette exception, c’était le paysan comique, maigre marionnette en sabots, qui parlait en prose et dans un gros patois, qu’appréciait beaucoup l’auditoire. Il prenait des libertés inconstitutionnelles avec la personne de son souverain, donnait avec ses sabots des coups de pied dans la figure aux autres marionnettes, et toutes les fois que les soupirants qui parlaient en vers avaient le dos tourné, il faisait la cour à 278 Thisbé pour son propre compte en prose comique.
Les évolutions de cet individu et le petit prologue, dans lequel le montreur faisait un éloge humoristique de ses artistes, louant leur indifférence aux applaudissements et aux sifflets et leur pur dévouement à leur art étaient les seules circonstances de toute la pièce, capables de faire naître un sourire. Mais les villageois de Précy semblaient ravis. En vérité, tant qu’une chose est un spectacle et que vous payez pour la voir, il est presque certain qu’elle amusera. Si on nous faisait payer tant par personne pour les couchers de soleil, ou si Dieu faisait battre le tambour à la ronde avant la fleuraison des aubépines, quel train ne ferions-nous pas à propos de leur beauté? Mais de telles choses, de même que les bons compagnons, les sottes gens cessent bientôt de les observer. Et le commis voyageur distrait passe, secoué dans son cabriolet à ressorts, et ne remarque positivement pas les fleurs le long du chemin, ni le paysage du ciel par dessus sa tête.
Des deux jours de navigation qui suivirent il reste peu de chose dans mes souvenirs et rien du tout dans mon carnet de notes. La rivière continuait à couler régulièrement à travers les charmants paysages de rivière. Des laveuses en robe bleue, des pêcheurs en blouse bleue diversifiaient les rives vertes et le rapport des deux couleurs était analogue à celui de la fleur et de la feuille dans le myosotis. Une symphonie en myosotis: c’est ainsi, je pense, que Théophile Gautier aurait pu caractériser le panorama de ces deux jours. Le ciel était bleu et sans nuages; et la surface glissante de la rivière présentait, aux endroits unis, un miroir au ciel et aux rives. Les blanchisseuses nous saluaient par des rires, et le bruit des arbres et de l’eau faisait un accompagnement à 280 nos pensées assoupies, dans notre rapide marche au fil de l’eau.
Le volume considérable de la rivière, le but vers lequel elle tendait infatigablement tenaient l’esprit enchaîné. Elle semblait à présent si sûre de sa fin, si forte et si aisée dans son allure, tel un homme fait bien résolu. Les flots l’appelaient de leurs mugissements sur les sables du Hâvre.
Pour ma part, glissant le long de cette voie mouvante dans mon violon de canoë, je commençais aussi à soupirer après mon océan. Tôt ou tard, un désir de la vie civilisée s’empare nécessairement de l’homme civilisé. J’étais las de manier la pagaie; j’étais las de vivre à la lisière de la vie; je désirais me retrouver au beau milieu; je désirais me remettre au travail; je désirais me retrouver avec des gens qui comprissent ma langue et qui pussent voir en moi un de leurs égaux, un homme et non plus une curiosité.
Aussi, à Pontoise, une lettre nous décida; 281 et pour la dernière fois, nous tirâmes nos embarcations de cette rivière de l’Oise, qui les avait fidèlement portées, pendant de si longs jours, par la pluie comme par le soleil. Cette bête de somme rapide et sans pieds avait charrié nos fortunes pendant tant de milles que nous lui tournions le dos, émus de nous en séparer.
Longtemps, nous nous étions détournés du monde; mais à présent, nous étions de retour aux lieux familiers, où la vie elle-même est le courant qui nous emporte à la rencontre des aventures, sans qu’il soit besoin d’un coup de pagaie.
Maintenant, nous allions, comme tous les voyageurs, retourner voir quels changements la fortune avait apportés dans notre entourage, quelles surprises nous attendaient chez nous et quel chemin le monde avait parcouru en notre absence. Vous pourrez pagayer tout le long du jour, mais c’est quand vous rentrerez à la nuit tombante, et quand vous parcourrez du regard 282 la chambre familiale, que vous trouverez l’Amour ou la Mort, vous attendant près du foyer; et les plus belles aventures ne sont pas celles que nous allons chercher.
Le pays où ils voyageaient, cette verte et fraîche vallée du Loing, est plein d’attrait pour ceux qui aiment la gaieté et se plaisent à la solitude. Le temps était superbe; toute la nuit il avait tonné et éclairé, et la pluie était tombée à torrents; mais pendant la journée, le ciel fut sans nuages, le soleil brûlant, l’air vif et pur. Ils allaient séparés: la Cigarette traînant derrière assez philosophiquement, le maigre Aréthuse marchant devant de son pas rapide. De cette façon chacun jouissait de ses propres réflexions le long du chemin; chacun avait sans doute le temps d’en être fatigué, avant de rencontrer son camarade à l’auberge désignée; et les plaisirs de la société et de la solitude se combinaient pour remplir la journée. L’Aréthuse portait dans son havresac les œuvres 284 de Charles d’Orléans et employait quelques-unes des heures du voyage à l’élaboration de rondeaux anglais. Il a dû ainsi précéder dans cette voie Mr. Lang, Mr. Dobson, Mr. Henley, et tous les faiseurs de rondeaux contemporains; mais pour de bonnes raisons, il sera le dernier à publier ce qu’il a écrit. La Cigarette marchait chargé d’un volume de Michelet et ces deux livres, on le verra, jouèrent un rôle dans l’aventure suivante.
L’Aréthuse était vêtu d’une façon peu sage. Il n’apporte aucune recherche à sa toilette; mais en tous cas, il ne fut jamais si mal inspiré que dans cette excursion. Il était en effet parti, sans avoir eu le temps de se retourner, de Barbizon, l’endroit le moins à la mode d’Europe. Sur la tête il portait une calotte de fumeur, faite aux Indes, et dont le galon d’or était piteusement éraillé et terni. Une chemise de flanelle d’une agréable teinte sombre, que les esprits satiriques qualifiaient de noire; un veston de cheviotte claire, fait par un bon tailleur anglais, un pantalon de 285 toile de confection à bon marché et des guêtres de cuir complétaient son accoutrement. Sa personne est exceptionnellement maigre et son visage n’est pas, comme celui de mortels plus heureux, un certificat. Pendant des années il n’a pu passer une frontière, ni entrer dans une banque, sans être l’objet de soupçons. Partout sauf dans sa ville natale, la police le regardait de travers, et (bien que je sois sûr que ceci ne sera pas cru) on vient de lui refuser l’accès du Casino de Monte-Carlo. Si vous voulez bien vous le figurer vêtu comme on vient de le dépeindre, courbé sous son havresac, marchant à près de huit kilomètres à l’heure, avec les plis du pantalon de confection flottant autour de ses jambes héronnières, et si vous y ajoutez les regards qu’il ne cessait de jeter vivement autour de lui, comme s’il avait peur d’être poursuivi, le personnage ainsi réalisé est loin d’être rassurant. Lorsque Villon cheminait, (suivant peut-être la même riante vallée), pour se rendre en exil dans le Roussillon, je me demande s’il n’avait 286 pas quelque ressemblance avec lui. Il avait sans aucun doute quelques préoccupations du même genre, car il a dû, lui aussi, chemin faisant, tourner des vers dans son cerveau, mais avec plus de bonheur que son successeur. Et s’il a eu quelque chose comme le même temps inspirateur, les mêmes nuits de vacarme, des hommes en armure dégringolant avec fracas l’escalier du ciel, la pluie sifflant sur les rues du village, l’œil farouche du taureau de la tempête lançant ses éclairs toute la nuit dans la chambre nue de l’auberge, le même doux retour de la lumière, le même insondable bleu du midi, les mêmes soirs alcyoniens[8] et fortement colorés et surtout, s’il a eu quelque chose comme un aussi bon camarade, quelque chose comme un goût aussi vif pour ce qu’il voyait et 287 ce qu’il mangeait, et pour les cours d’eau où il se baignait et le fatras qu’il écrivait, j’échangerais volontiers de grands domaines aujourd’hui avec le pauvre exilé, et je croirais encore gagner au change.
Mais il y avait entre les deux voyages un autre point de similitude qui devait coûter cher à l’Aréthuse: ils se firent tous deux en des jours de sécurité incomplète. C’était peu après la guerre franco-allemande. Si rapide que soit l’oubli chez l’homme, ce coin de pays fourmillait encore d’histoires de uhlans et de sentinelles avancées, et de gens qui avaient été à deux doigts de la corde d’ignominie, et de charmantes amitiés momentanées entre l’envahisseur et l’envahi. Un an, deux ans après au plus, vous auriez pu parcourir ce pays en tous sens sans entendre une seule anecdote; et un an ou deux plus tard, vous auriez (à supposer que vous fussiez un jeune homme de mauvaise mine, affublé d’une façon indéfinissable) circulé dans la région en toute sûreté. Car, de même que d’autres choses 288 intéressantes, le spectre de l’espion prussien aurait quelque peu pâli dans l’imagination des gens.
Malgré tout cela, notre voyageur avait dépassé Château-Renard, avant d’avoir conscience de l’attention qu’il soulevait. Sur la route, entre cet endroit et Châtillon-sur-Loing, cependant, il rencontra un facteur rural. Ils lièrent conversation et causèrent de choses et d’autres. Mais tous les sujets qu’ils abordèrent laissaient le facteur visiblement préoccupé, et ses yeux restaient invariablement braqués sur le havresac de l’Aréthuse. Enfin, d’un air de mystère et de malice, il s’enquit de ce que contenait le sac, et sur la réponse de l’Aréthuse, il hocha la tête avec une bienveillante incrédulité: «Non, dit-il, non, vous avez des portraits.» Puis d’une voix insinuante, «Voyons, montrez-moi les portraits!» Il se passa quelques instants avant que l’Aréthuse, partant d’un éclat de rire, devinât ce que voulait le facteur. Par portraits il entendait des photographies obscènes; et dans l’Aréthuse, 289 auteur austère et encore à ses débuts, il avait cru reconnaître un colporteur de choses pornographiques. Quand les paysans en France se sont mis dans la tête qu’une personne exerce telle profession, toute argumentation est inutile. Pendant tout le reste de la route le facteur déploya toutes les ressources de son éloquence, pour que le voyageur le laissât jeter un coup d’œil sur la collection. Il employait tantôt les reproches tantôt les raisonnements: «Voyons, je ne le dirai à personne.» Puis il essaya de la corruption et insista pour me payer un verre de vin; et enfin, lorsque leurs routes se séparèrent: «Non, dit-il, ce n’est pas bien de votre part. Oh! non, ce n’est pas bien!» Et hochant la tête de l’air sentimental d’un homme qu’on a lésé, il partit pas trop satisfait.
Sur certaines petites difficultés que rencontra l’Aréthuse à Châtillon-sur-Loing, je n’ai pas le loisir de m’étendre; un autre Châtillon, de plus triste mémoire, sollicite trop mon attention. Mais le lendemain, dans un certain hameau 290 appelé la Jussière, il s’arrêta pour boire un verre de sirop dans un cabaret très pauvre et très nu. La cabaretière, une femme avenante qui donnait le sein à un enfant, examina le voyageur d’un air bienveillant et pitoyable. «Vous n’êtes pas de ce département?» demanda-t-elle. L’Aréthuse lui dit qu’il était Anglais. «Ah! fit-elle surprise. Nous n’avons pas d’Anglais; nous avons beaucoup d’Italiens pourtant, et ils font très bien; ils ne se plaignent pas des gens du pays. Il se peut qu’un Anglais y fasse très bien aussi; ce sera quelque chose de nouveau.» Et ici une remarque, obscure pour l’Aréthuse, et qu’il chercha à éclaircir tout en buvant sa grenadine. Mais quand il se leva et demanda ce qu’il devait, la lumière se fit en lui, soudaine comme l’éclair. «Oh! pour vous, répondit la cabaretière, un sou!» Pour vous! Par le ciel! elle le prenait pour un mendiant. Il donna son sou, sentant qu’il aurait eu mauvaise grâce à la tirer de son erreur. Mais quand il se retrouva dehors, sur la route, 291 il se sentit intérieurement vexé. La conscience n’est pas un habile monsieur, c’est un être brut et rabbinique[9]; et sa conscience lui disait qu’il avait volé le sirop.
Cette nuit-là nos voyageurs couchèrent à Gien. Le lendemain ils passèrent le fleuve et s’avancèrent (séparément selon leur habitude) pour couvrir la courte étape qui devait les conduire, à travers la plaine verte, du côté du Berri, à Châtillon-sur-Loire. C’était l’ouverture de la chasse, et l’air retentissait des détonations des armes à feu et des cris d’admiration des chasseurs. Par dessus notre tête les oiseaux étaient dans la consternation, tourbillonnant en nuages, se posant et reprenant leur vol. Et cependant, avec toute cette agitation de chaque côté, la route elle-même était solitaire. L’Aréthuse fuma une pipe près d’une borne kilométrique, et je 292 me rappelle qu’il passa une revue très exacte de tout ce qu’il devait faire à Châtillon: il devait s’offrir le plaisir d’un bain froid, changer de linge et attendre l’arrivée de la Cigarette, dans une sublime inaction, au bord de la Loire. Enflammé par ces idées, il n’en poussa que plus rapidement en avant et arriva de bonne heure dans l’après-midi, tout fumant de sueur, à l’entrée de cette ville de malheur. Le chevalier Roland à la sombre tour vint.
Un gendarme poli projeta son ombre sur le chemin.
«Monsieur est voyageur?» demanda-t-il.
Et l’Aréthuse, fort de son innocence et oubliant son méchant accoutrement, répliqua,—je dirai presque avec gaieté: «il paraîtrait que oui.»
Ses papiers sont en ordre? dit le gendarme. Et lorsque l’Aréthuse, avec une légère altération dans la voix, convint qu’il n’avait pas de papiers, on l’informa (assez poliment) qu’il devait comparaître devant le commissaire.
293
Le Commissaire était assis à une table, dans sa chambre à coucher, sans autre vêtement que sa chemise et son pantalon, et malgré cela transpirant abondamment; et lorsqu’il tourna vers le prisonnier une grosse face inintelligente qui, comme celle de Bardolph, n’était que boutons et pustules, les gens les plus bouchés auraient pu se préparer à souffrir. Je me trouvais devant un homme stupide, à qui la chaleur donnait envie de dormir, furieux d’être dérangé, insensible aux prières comme aux arguments.
Le Commissaire.—Vous n’avez pas de papiers?
L’Aréthuse.—Pas ici.
Le Commissaire.—Pourquoi?
L’Aréthuse.—Je les ai laissés derrière dans ma valise.
Le Commissaire.—Vous savez cependant, qu’il est défendu de circuler sans papiers?
L’Aréthuse.—Pardon. Je suis convaincu du contraire. Je suis ici dans mes droits, comme sujet anglais, en vertu d’un traité international.
294
Le Commissaire (avec mépris). Vous vous prétendez Anglais?
L’Aréthuse.—Oui.
Le Commissaire.—Hum! Quelle est votre profession?
L’Aréthuse.—Je suis avocat en Ecosse.
Le Commissaire (singulièrement gêné).—Avocat en Ecosse! Avez-vous la prétention de gagner votre vie avec cela dans ce département?
L’Aréthuse se défendit modestement de cette prétention. Le Commissaire avait gagné une manche.
Le Commissaire.—Pourquoi donc voyagez-vous?
L’Aréthuse.—Je voyage pour mon agrément.
Le Commissaire (montrant le havresac et avec une sublime incrédulité). Voyez-vous, je suis un homme intelligent.
Le coupable demeurant muet à ce coup droit, le Commissaire savoura un moment son triomphe; puis il demanda (comme le facteur, mais 295 il s’attendait à y trouver des choses bien différentes) à voir le contenu du havresac. Et ici l’Aréthuse, qui n’avait pas encore un sentiment bien net de sa position, commit une grave méprise. Il y avait peu ou pas de meubles dans la pièce, à part la chaise et la table du Commissaire; et pour faciliter les choses, l’Aréthuse (le plus innocemment du monde) appuya le havresac sur un coin du lit. Le Commissaire bondit positivement de sa chaise; son visage et son cou devinrent rouge-pourpre, presque bleus; et il cria de mettre sur le parquet l’objet profanateur.
Le havresac se trouva contenir des chemises, des souliers, des chaussettes et des pantalons de toile de rechange, un petit nécessaire de toilette, un morceau de savon dans l’un des souliers, deux volumes de la Collection Jannet intitulés Poésies de Charles d’Orléans, une carte géographique et un cahier de traductions contenant diverses notes en prose et les remarquables rondeaux anglais qui jusqu’ici n’ont pas 296 encore été publiés. Le Commissaire de Châtillon est la seule personne vivante qui ait jeté un regard sur ces bagatelles artistiques. Il retourna de façon blessante l’assortiment du bout du doigt; à voir la manière dont il touchait ces choses, il était évident qu’il considérait l’Aréthuse et tout ce qui lui appartenait, comme le temple même de l’infection. Il n’y avait cependant rien de suspect dans la carte, rien de réellement criminel que les rondeaux; quant à Charles d’Orléans, pour l’esprit ignorant du prisonnier, il semblait valoir un certificat, et il était à croire que la farce allait finir.
L’inquisiteur reprit son siège.
Le Commissaire (après une pause).—Eh bien! Je vais vous dire ce que vous êtes. Vous êtes Allemand et vous venez chanter à la foire.
L’Aréthuse.—Vous plairait-il de m’entendre chanter? Je pense que je pourrai vous convaincre du contraire.
Le Commissaire.—Pas de plaisanterie, monsieur.
297
L’Aréthuse.—Eh bien! Monsieur, faites-moi au moins le plaisir de regarder ce livre. Ici; je l’ouvre les yeux fermés. Lisez l’un de ces chants; celui-ci, par exemple; et dites-moi, vous qui êtes un homme intelligent, s’il serait possible de chanter cela dans une foire.
Le Commissaire (d’un air entendu).—Mais oui; très bien.
L’Aréthuse.—Comment! Monsieur, vous ne remarquez pas que c’est en vieux langage? C’est difficile à comprendre, même pour vous et pour moi; mais pour un auditoire de foire, ce serait incompréhensible.
Le Commissaire (prenant une plume).—Enfin, il faut en finir. Votre nom?
L’Aréthuse (parlant rapidement et mangeant ses mots à la façon des Anglais).—Robert Louis Stev’ns’n.
Le Commissaire (ayant bataillé à plusieurs reprises avec sa plume).—Eh bien! il faut se passer du nom. Ça ne s’écrit pas.
Ce qui précède est un résumé sommaire de 298 cette importante conversation, dans lequel je me suis surtout préoccupé de conserver la fleur des paroles du Commissaire. Mais du reste de la scène, l’Aréthuse, par suite peut-être de sa colère croissante, n’a gardé dans sa mémoire qu’un souvenir assez vague. Le Commissaire n’avait pas, je pense, la pratique des lettres; à peine du moins, eut-il pris la plume en main et se fut-il embarqué dans la composition du procès-verbal, qu’il devint manifestement plus impoli et commença à montrer de la prédilection pour la plus simple de toutes les formes de répartie: «Vous mentez.» Plusieurs fois l’Aréthuse passa là-dessus; puis soudain, il s’enflamma, refusa d’accepter plus d’insultes ou de répondre à d’autres questions, défia le Commissaire de lui faire tout le mal qu’il pourrait, et lui promit que, s’il le faisait, il s’en repentirait amèrement. Peut-être, s’il avait eu cet air hautain dès le début, au lieu de prendre les choses d’abord sur un ton badin et de continuer par des arguments, l’affaire aurait-elle pu tourner autrement? 299 Car si loin que les choses fussent allées[10], en ce moment, le Commissaire était visiblement hésitant. Mais il était trop tard; il avait été mis au défi; le procès-verbal était commencé; et carrant les coudes sur la table, il se reprit à écrire, et l’Aréthuse fut conduit en prison.
A quelques pas en descendant la route brûlante se trouvait la gendarmerie. C’est là que notre infortuné fut conduit et qu’il reçut l’ordre de vider ses poches. Un mouchoir, une plume, un crayon, une pipe et du tabac, des allumettes et une dizaine de francs de monnaie, voilà tout. Pas une lettre, pas un chiffre, pas le moindre écrit, soit pour établir son identité, soit pour le condamner. Le gendarme lui-même était épouvanté devant un tel dénûment.
300
«Je regrette, dit-il, de vous avoir arrêté, car je vois que vous n’êtes pas un voyou.» Et il lui promit d’être aussi indulgent que possible.
L’Aréthuse ainsi encouragé demanda sa pipe. Cela, lui dit-on, était impossible; mais s’il chiquait, il pourrait avoir du tabac. Il ne chiqua pas cependant, et demanda à avoir son mouchoir à la place.
«Non, dit le gendarme. Nous avons eu des histoires de gens qui se sont pendus.»
Quoi! s’écria l’Aréthuse. C’est pour cela que vous me refusez mon mouchoir. Mais voyez donc combien il me serait plus facile de me pendre avec mon pantalon.
L’homme fut frappé par la nouveauté de l’idée; mais il ne voulut pas démordre de ses prétextes et se borna à réitérer de vagues offres de service.
Au moins, dit l’Aréthuse, ne manquez pas d’arrêter mon camarade; il me suivra sans tarder sur la même route, et vous pourrez le reconnaître au sac qu’il portera sur les épaules.
301
Ceci promis, le prisonnier fut emmené dans l’arrière-cour du bâtiment; une porte de cave fut ouverte, on lui fit signe de descendre l’escalier; puis les verrous grincèrent et les chaînes retentirent derrière lui pendant sa descente.
L’esprit philosophique et plus encore l’esprit d’imagination est apte à se supposer en état de faire face à tout terrible accident. La prison, entre autres maux, était un de ceux qu’avait souvent affrontés l’intrépide Aréthuse. Au moment même où il descendait l’escalier, il se disait que c’était là une fameuse occasion de composer un rondeau et que, comme les linottes emprisonnées du mélodieux cavalier, il rendrait lui aussi sa prison harmonieuse. Je vais dire la vérité tout de suite: le rondeau ne fut jamais écrit; sans quoi, il serait imprimé ici, pour faire naître un sourire. Deux raisons intervinrent: la première morale, la seconde physique.
Une des curiosités de la nature humaine c’est que, bien que tous les hommes soient 302 menteurs, aucun d’eux ne souffre qu’on lui applique cette qualification. La recevoir et l’accepter d’une âme égale est un effort plus que stoïque, et l’Aréthuse qui n’avait pu avaler cette insulte sentait bouillonner dans son cœur la lave incandescente de sa colère étouffée. Mais la raison physique eut aussi son rôle. La cave dans laquelle il était enfermé se trouvait à quelques pieds sous terre; elle n’était éclairée que par une étroite ouverture sans vitre, pratiquée au haut du mur et masquée par les feuilles d’une vigne verte. Les murs étaient de maçonnerie nue; pour plancher, rien que le sol; en fait de meubles, un bassin en terre cuite, une cruche à eau et une couchette en bois avec, pour couverture, un manteau gris-bleu. D’être arraché à l’air chaud d’une après-midi d’été, à la réverbération de la route, et au mouvement d’une marche rapide, pour être plongé dans l’obscurité et l’humidité de ce réceptacle à vagabonds, cela glaça instantanément le sang de l’Aréthuse. Et vous allez voir comme il faut peu 303 de chose pour constituer une souffrance: le sol était excessivement raboteux sous les pieds; il gardait encore jusqu’aux marques laissées, je suppose, par les coups de bêche des ouvriers qui creusèrent les fondations de la caserne; et tant à cause du peu de clarté que de la surface inégale, il était impossible de marcher.
L’auteur coffré résista un bon moment, mais le froid glacial de la place le pénétrait de plus en plus; et à la longue, avec toute la répugnance que vous pouvez imaginer, il en fut réduit à grimper sur le lit et à s’envelopper dans la couverture publique. Le voilà donc couché, presque grelottant, plongé dans une demi-obscurité, enroulé dans un vêtement dont il redoutait le contact comme la peste, et (dans un état d’esprit fort éloigné de la résignation) passant en revue la kyrielle d’insultes qu’il venait de recevoir. Ce ne sont point là circonstances favorables à la muse.
Pendant ce temps (pour en revenir au dehors, où le soleil brillait toujours et où les coups de feu des 304 chasseurs retentissaient encore par toute la plaine semée de bouquets d’arbres,) la Cigarette s’approchait marchant de son pas plus philosophique. En ces jours de liberté et de santé, il fut le compagnon fidèle de l’Aréthuse et il eut de fréquentes occasions de partager la défaveur de celui-ci auprès de la police. Que de coupes amères il a vidées avec ce désastreux camarade! Il était, lui, né pour flotter aisément à travers la vie, la noblesse de ses traits et l’élégance de ses manières prévenant tout le monde en sa faveur. Il n’y avait qu’une seule chose suspecte qu’il ne pouvait éloigner: la présence de son compagnon. Il n’oubliera pas de sitôt le Commissaire de ce qu’on appelle ironiquement la ville libre de Francfort-sur-le-Mein, ni la frontière franco-belge, ni l’hôtel à la Fère; enfin (et ce n’aura pas été sa moindre mésaventure) il est à peu près certain qu’il se souviendra de Châtillon-sur-Loire.
A l’entrée de la ville, le gendarme le cueillit comme une fleur des chemins; et un moment 305 après, deux personnes, au comble de la surprise, étaient confrontées dans le bureau du Commissaire. Car si la Cigarette fut surpris d’être arrêté, le Commissaire ne fut pas moins renversé par l’aspect et la mise de son prisonnier. Celui-ci était un homme au sujet duquel il ne pouvait y avoir aucune méprise, un homme d’une distinction incontestable et inattaquable, tiré à quatre épingles, vêtu non seulement avec propreté mais avec élégance, prêt à exhiber son passe-port au premier mot et bien pourvu d’argent; un homme que le Commissaire aurait salué d’un grand coup de chapeau, si par hasard il l’avait rencontré sur la grand’route; et ce beau cavalier réclamait sans vergogne l’Aréthuse comme étant son camarade. La conclusion de l’entrevue était décidée d’avance. Parmi les choses humoristiques qui s’y dirent, il n’en est qu’une dont je me souvienne: «Baronnet?» demanda le magistrat, relevant les yeux de dessus le passe-port. «Alors, monsieur, vous êtes le fils d’un baron?» Et quand la Cigarette 306 eut nié (sa seule faute pendant toute l’entrevue) cette douce accusation, «Alors», reprit le Commissaire, «ce n’est pas votre passe-port?» Mais c’étaient là des coups de foudre sans effet; il n’avait jamais songé à mettre la main sur la Cigarette; bientôt, il tomba dans un état d’admiration sans bornes, dévorant des yeux le contenu du havresac, faisant l’éloge du tailleur de notre ami. Ah! quel hôte honorable le Commissaire recevait en ce moment! Comme ses vêtements étaient bien appropriés à la chaleur de la saison! Quelles superbes cartes, quel attrayant ouvrage d’histoire, il portait dans son havresac! Il n’y avait plus à présent, vous le comprenez, qu’un seul point, sur lequel ils ne fussent pas d’accord: Qu’allait-on faire de l’Aréthuse? la Cigarette demandant sa mise en liberté, le Commissaire le réclamant toujours comme la propriété du cachot. Or, il se trouvait que la Cigarette avait passé quelques années de sa vie en Egypte, où il avait fait connaissance avec deux choses très mauvaises: le 307 choléra morbus et les pachas; et dans l’œil du Commissaire en train de feuilleter le volume de Michelet, il semblait à notre voyageur qu’il y avait quelque chose de Turc. Je passe légèrement sur ceci; il est très possible qu’il y eût quelque malentendu; très possible, que le Commissaire (charmé de son visiteur) supposât l’attraction réciproque, et prît pour un acte d’amitié croissante ce que la Cigarette de son côté regardait comme un moyen de corruption. Quoiqu’il en soit, y eut-il jamais moyen de corruption plus singulier qu’un volume dépareillé de l’histoire de Michelet? L’ouvrage lui fut promis pour le lendemain, avant notre départ; et bientôt après, soit que son désir fût satisfait, soit qu’il ne voulût pas demeurer en reste de procédés amicaux: «Eh bien! dit-il, je suppose qu’il faut lâcher votre camarade». Et il mit en pièces ce régal d’humour, le procès-verbal inachevé. Ah! s’il avait seulement déchiré à la place les rondeaux de l’Aréthuse! Beaucoup d’ouvrages furent brûlés 308 à Alexandrie, beaucoup sont conservés précieusement au British Museum que, certes, je donnerais volontiers pour le procès-verbal de Châtillon. Pauvre Commissaire au visage couvert de pustules! Je commence à regretter qu’il n’ait jamais eu son Michelet; car j’aperçois en lui de beaux traits d’humanité, une forte dose de stupidité, du zèle dans ses fonctions de magistrat, un certain goût pour les lettres, une prompte admiration pour ce qui est admirable. Et s’il n’admira pas l’Aréthuse, il ne fut pas le seul.
Soudain un bruit de verrous et de chaînes arriva aux oreilles du prisonnier, grelottant sous la couverture publique. Il sauta vivement à terre, prêt à accueillir avec joie un compagnon d’infortune; mais au lieu de cela, la porte vivement s’ouvrit toute grande, le gendarme ami apparut au haut de l’escalier, dans l’éblouissante clarté du jour, et avec un geste magnifique, (c’était sans doute un amateur de drame)—«Vous êtes libre!» dit-il. Ce n’était pas trop 309 tôt pour l’Aréthuse. Je ne sais si son emprisonnement avait duré une demi-heure; mais à la montre de l’esprit, (et l’Aréthuse n’en portait pas d’autre) le temps lui avait paru huit fois plus long. Et escaladant les marches de l’escalier, il passa avec ravissement de la fraîcheur de la cave à la chaleur réconfortante du soleil de l’après-midi; et l’haleine de la terre lui arriva aussi douce que celle d’une vache; et de nouveau, il entendit, suave volupté, l’accord des bruits délicats que nous appelons le bourdonnement de la vie.
On pourrait croire que mon histoire finit ici; mais pas du tout. Ceci n’était qu’un arrêt de la pièce et non pas le baisser du rideau. Sur la scène qui suivit, en face de la gendarmerie, je me fais scrupule de m’étendre, puisqu’il y a une dame en cause. La femme du maréchal-des-logis était une belle personne; et cependant, l’Aréthuse ne fut pas fâché de quitter sa société. En sa mémoire traîne encore un vague souvenir des traits de cette femme, fraîche 310 comme une pêche, par cette après-midi torride; mais il se rappelle mieux sa conversation: «Vous avez là un très beau salon», dit l’infortuné.—«Ah!» dit madame la maréchale (des logis), «vous êtes bien familiarisé avec de pareils salons!» Et il vous aurait fallu voir de quel œil dur et méprisant elle toisait le vagabond debout devant elle! Je ne pense pas qu’il ait jamais haï le Commissaire; mais avant que cette entrevue touchât à sa fin, il haïssait Madame la Maréchale. Sa colère, si j’en crois quelqu’un qui était présent, se trahissait par le feu de ses regards, la pâleur de son visage, le tremblement de sa voix. Madame, pendant ce temps, goûtait les joies du matador, le piquant de mots acérés, et lui faisant baisser les yeux sous son regard froid.
Grande, certes, fut sa joie de ne plus être avec cette dame; plus grande encore celle qu’il éprouva à s’attabler devant un excellent dîner, à l’auberge. Ici aussi, les voyageurs méprisés réussirent à lier connaissance avec leur 311 plus proche voisin, un monsieur de l’endroit de retour de la chasse et qui eut le bon goût de prendre plaisir à leur société. Le dîner terminé, le monsieur proposa de faire plus ample connaissance au café.
Le café était bondé de chasseurs qui expliquaient bruyamment à tout le monde le peu de volume de leurs carniers. Vers le centre de la salle la Cigarette et l’Aréthuse étaient assis avec leur nouvelle connaissance; trio très satisfait; car les voyageurs, après leur récente expérience, étaient avides de considération et leur chasseur fier d’avoir une paire de patients auditeurs. Soudain la porte vitrée s’ouvrit avec fracas; dans l’encadrement, le maréchal des logis apparut, magnifique sous son ceinturon et ses aiguillettes, traversa la salle à grands pas, avec un bruit d’éperons et d’armes, et disparut par une porte à l’autre bout. Sur ses talons venait le gendarme à qui l’Aréthuse avait eu affaire dans l’après-midi, imitant avec une nuance marquée le port impérial de son supérieur. Seulement 312 en passant, il frappa légèrement du plat de la main sur l’épaule de son ex-prisonnier, et de ce ton retentissant, dramatique, dont il avait le secret: «Suivez», dit-il.
L’arrestation des membres du Parlement, le serment du jeu de paume, la signature de la déclaration d’indépendance, le discours de Marc Antoine, toutes les nobles scènes de l’histoire, je les conçois comme assez semblables à cette soirée du café de Châtillon. La terreur planait sur l’assemblée. Un moment après, quand l’Aréthuse eut suivi à l’autre bout de la maison ceux qui de nouveau le faisaient prisonnier, la Cigarette se trouva seul devant son café au milieu d’un cercle de chaises et de tables vides; tous les exubérants chasseurs se pressaient dans les coins; leurs voix tumultueuses à présent réduites à des chuchotements, et leurs yeux lui lançant des regards furtifs comme à un lépreux.
Et l’Aréthuse? Il avait, lui, une entrevue longue et parfois pénible dans l’arrière-cuisine. 313 Le maréchal des logis, un très bel homme, intelligent et honnête tout à la fois, à mon avis n’avait pas d’opinion claire sur l’affaire. Il pensait que le commissaire avait eu tort; mais il ne voulait pas attirer des désagréments à ses subordonnés; et il fit une proposition, puis une autre, puis une autre encore; et à toutes l’Aréthuse (qui sentait sa position devenir meilleure) faisait des objections.
«Bref, suggéra l’Aréthuse, vous désirez vous laver les mains de toute autre responsabilité? Eh bien! Alors laissez-moi aller à Paris.»
Le maréchal des logis tira sa montre.
«Vous pouvez, dit-il, prendre le train pour Paris à dix heures».
Et le lendemain, à midi, les voyageurs racontaient leur mésaventure dans la salle à manger chez Siron.
Robert Louis STEVENSON.
Traduit de l’Anglais par Lucien LEMAIRE.
[1] Tout ce dernier paragraphe est une allusion directe à la répugnance de l’auteur pour la profession d’ingénieur que ses parents lui avaient fait embrasser. Il prit finalement la décision de la quitter, malgré l’opposition de toute sa famille, désolée de le voir abandonner une profession si respectable pour une carrière aussi aléatoire que celle des lettres. Heureusement l’évènement lui donna raison et ses parents n’eurent plus tard qu’à se réjouir de ses succès littéraires.
[2] Le figuier des Banians est un arbre de l’Inde sur lequel on recueille la gomme laque. Cet arbre a une façon extraordinaire de se propager; les branches qui en forment la cime émettent des pousses grêles qui descendent verticalement et s’allongent de plus en plus, jusqu’à ce qu’elles touchent le sol. Elles y prennent bientôt racine, grossissent et forment comme autant de colonnes qui soutiennent la tête de l’arbre. Le tronc de celui-ci peut périr sans que la cime meure, et de nouvelles colonnes s’ajoutent toujours aux anciennes. Il en résulte comme une petite forêt, provenant d’un seul tronc. On voit à Nerbuddah un figuier des pagodes qui occupe une surface de six à sept cents mètres de circonférence.
(Note du traducteur).
[3] Allusion à une poésie de Burns intitulée: «A une Marguerite de montagne,» dans laquelle il plaint le sort d’une marguerite qu’il a retournée et déracinée avec sa charrue. La pièce, très jolie, comprend 9 strophes de 6 vers chacune.
[4] Shakespeare. La nuit des rois. Scène IV. Acte II.
N. d. T.
[5] Georges Washington, qui força l’Angleterre à reconnaître l’indépendance des Etats-Unis.
N. d. T.
[6] Burns a été employé de l’accise ou régie en Ecosse.
[7] Mélange de bière anglaise; moitié stout, moitié pale-ale.
[8] Alcyoniens: apaisés, calmes. Mythologie. Jours alcyoniens. Chez les Grecs, les sept jours qui précédaient et les sept jours qui suivaient le solstice d’hiver, pendant lesquels l’alcyon était supposé faire son nid et couver ses œufs sur la mer, qui alors était calme. L’alcyon était le symbole de la paix et de la tranquillité.
[9] Rabbinique: veut dire primitif, intransigeant, dont les principes sont restés intacts, n’ont subi aucune altération, aucun adoucissement par le fait de raisonnements subtils.
[10] Le texte dit: car même à cette onzième heure, le Commissaire: allusion biblique à la parabole du bon pasteur dans laquelle les ouvriers engagés à la onzième heure reçurent la même rémunération que ceux engagés dès le commencement de la journée.
314
TABLE DES MATIÈRES |
|
| Pages. | |
| Préface à la traduction. | 5 |
| Préface de l’auteur. | 11 |
| Dédicace. | 15 |
| D’Anvers à Boom. | 21 |
| Sur le canal de Willebroeck. | 30 |
| A Bruxelles: Le Royal sport nautique. | 41 |
| A Maubeuge. | 53 |
| Sur la Sambre canalisée. En route pour Quartes. | 63 |
| Pont-sur-Sambre. Nous sommes des marchands. | 77 |
| Pont-sur-Sambre. Le marchand ambulant. | 91 |
| Sur la Sambre canalisée. En route pour Landrecies. | 101 |
| A Landrecies. | 114 |
| Le canal de la Sambre à l’Oise: Péniches. | 124 |
| La crue de l’Oise. | 134 |
| Origny Sainte-Benoîte: Un jour de repos. | 151 |
| Origny Sainte-Benoîte: Nos compagnons de table. | 164 |
| Au fil de l’Oise: En route pour Moy. | 178 |
| La Fère de maudite mémoire. | 188 |
| Au fil de l’Oise: à travers la vallée dorée. | 200 |
| La cathédrale de Noyon. | 204 |
| Au fil de l’Oise: En route pour Compiègne. | 216 |
| A Compiègne. | 222 |
| Autres temps. | 234 |
| Au fil de l’Oise: Intérieurs d’églises. | 246 |
| Précy et les Marionnettes. | 259 |
| De retour au monde. | 279 |
| Epilogue—Pris pour espion. | 283 |
315
TABLE DES GRAVURES |
|
| Pages. | |
| Portrait de Robert Louis Stevenson. | 2 |
| Frontispice à l’eau-forte de Walter Crane. | 19 |
| La rivière comme un miroir qui s’allongerait. | 67 |
| S’élevait au centre du village une grande tour maigre. | 81 |
| Lorsque nous longions la forêt de Mormal. | 103 |
| Ils ne montaient pas plus haut que les genoux de la cathédrale. | 205 |
| Ce qui me charma le plus à Compiègne fut l’hôtel de Ville. | 227 |
Cette version numérisée reproduit dans son intégralité la version originale.
L’orthographe a été conservée. Seuls quelques mots ont été modifiés. Ils sont soulignés par des tirets. Passer la souris sur le mot pour voir l’orthographe originale.
La ponctuation a pu faire l’objet de quelques corrections mineures.
La couverture est illustrée par un portrait de R.-L. Stevenson, auteur inconnu, publié dans le livre de Sir Graham Balfour: "The life of Robert Louis Stevenson", (source: Internet Archive). Elle appartient au domaine public.